Pour plus de sécurité, fbls article 8 et le divorce, est sur : https://www.fbls.net/8B.htm
"L'article 8 de la Conv EDH
donne des droits en matière de divorce"
Frédéric Fabre docteur en droit.
ARTICLE 8 DE LA CONVENTION :
"1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui"
Cliquez
sur un lieu bleu pour accéder gratuitement à la JURISPRUDENCE DE LA CEDH :
- LE DIVORCE ET LE DROIT DE VISITE OU DE GARDE DES ENFANTS
- LE DROIT DE VISITE DES GRANDS PARENTS ET DES TIERS
- LES ENLÈVEMENTS D'ENFANTS APRÈS UN DIVORCE
- LE SECRET DE LA CORRESPONDANCE ET LE DIVORCE
- LE DEVOIR CONJUGAL ET LE DIVORCE
MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH
T.M. c. ITALIE du 7 octobre 2021 requête n° 29786/19
§ 62 En ce qui concerne la vie familiale d’un enfant, la Cour rappelle qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, entre autres, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010). Elle souligne d’ailleurs que dans les affaires dans lesquelles sont en jeu des questions de placement d’enfants et de restrictions du droit de visite, l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute autre considération (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 204, 10 septembre 2019). La plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016, et Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Le point décisif consiste donc à savoir si, en l’espèce, les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites entre le parent et l’enfant, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).§ 76 face à l’opposition de la mère de l’enfant, qui perdurait depuis 2008, et à la difficulté du requérant à exercer son droit de visite, les autorités nationales n’ont pas pris rapidement toutes les mesures nécessaires et qui pouvaient raisonnablement être exigées pour faire respecter le droit de l’intéressé d’avoir des contacts avec sa fille et d’établir une relation
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
CLIQUEZ SUR LES BOUTONS POUR ACCEDER A LA JURISPRUDENCE SUR LA PROTECTION DE L'ARTICLE 8
LE DIVORCE ET LE DROIT DE VISITE
OU DE GARDE DES ENFANTS
En matière de garde des enfants après un divorce, l'intérêt des enfants prime sur celui des parents
Cliquez sur un lien bleu pour accéder gratuitement à LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH sur :
- LE DROIT DE GARDE
- LE DROIT DE VISITE DE LA MÈRE
- LE DROIT DE VISITE DE L'EX EPOUX, De l'EX CONCUBIN, OU DE L'EX PARTENAIRE PACSE
- LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
A.T. c. ITALIE du 24 juin 2021 Requête no 40910/19
Art 8 • Vie familiale • Absence d’efforts adéquats, suffisants et rapides des autorités nationales pour faire respecter le droit de visite du requérant judiciairement prononcé • Opposition de la mère de l’enfant
a) Les principes généraux
66. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour garantir les droits légitimes des intéressés et assurer le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). La Cour rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, §§ 105 et 112, et Sylvester, § 70, tous deux précités).
67. La Cour rappelle également que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (Nicolò Santilli, précité, § 67). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que l’article 8 de la Convention confère à celui-ci (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004).
68. En ce qui concerne la vie familiale d’un enfant, la Cour rappelle qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, entre autres, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010). Elle souligne d’ailleurs que dans les affaires dans lesquelles sont en jeu des questions de placement d’enfants et de restrictions du droit de visite, l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute autre considération (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 204, 10 septembre 2019). La plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016, et Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Le point décisif consiste donc à savoir si, en l’espèce, les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites entre le parent et l’enfant, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).
b) Application de ces principes à la présente espèce
69. Se tournant vers les faits de la présente cause, la Cour estime que, devant les circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à rechercher si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre le requérant et son fils (Bondavalli c. Italie, no 35532/12, § 75, 17 novembre 2015) et à examiner la manière dont elles sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant tel que défini par les décisions de justice (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299‑A, et Kuppinger, précité, § 105). Elle rappelle aussi que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 58, 2 novembre 2010), car le passage du temps peut à lui seul avoir des conséquences sur la relation d’un parent avec son enfant.
70. La Cour relève qu’à partir de 2015, alors que l’enfant n’avait que onze mois, le requérant n’a cessé de demander au tribunal que des rencontres fussent organisées, mais qu’il n’a pas pu exercer son droit de visite en raison de l’opposition de L.R., qui avait quitté le domicile familial et l’empêchait d’avoir le moindre contact avec l’enfant.
71. En 2016, le tribunal de Trévise observa que le requérant ne pouvait pas voir son fils et que L.R. persistait à s’opposer aux rencontres entre le requérant et l’enfant.
72. À partir de décembre 2016, après le déménagement de la mère de l’enfant dans une autre ville, à environ six cents kilomètres de distance, sans le consentement des tribunaux et du requérant, ce dernier n’a plus été en mesure de voir son fils, en particulier en raison du refus de la mère d’organiser des rencontres.
73. La Cour observe que, nonobstant la décision de la cour d’appel de Venise du 30 janvier 2017 établissant que la résidence de l’enfant était à Z.B. et réfutant que le déménagement à Rome eût été autorisé, L.R. a fixé sa résidence à Rome.
74. Par conséquent, le 10 juillet 2017, le requérant saisit à nouveau le tribunal pour enfants de Venise en faisant valoir que L.R. avait déménagé sans autorisation et que de ce fait il lui était impossible de voir son fils car elle s’opposait aux rencontres.
75. En 2017, nonobstant les recours dont le parquet et le requérant saisirent le tribunal de Venise et le signalement effectué par les services sociaux, le tribunal n’a pris aucune mesure. La Cour note que pour pouvoir voir son fils, le requérant a été obligé de demander l’intervention de la force publique.
76. Elle remarque que le tribunal de Venise a attendu deux ans avant de se prononcer. Tout en reconnaissant que le comportement de L.R. était préjudiciable à l’enfant, il estima qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’être éloigné de L.R. et établit par conséquent la résidence principale de l’enfant chez sa mère, en accordant un droit de visite au requérant.
77. La Cour note qu’à ce jour le requérant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ce droit de visite parce que L.R. s’y oppose et que les rencontres ne sont pas organisées.
78. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, notamment parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce ignorer les faits précédemment exposés (paragraphes 70-77 ci-dessus). En particulier, elle note que le requérant n’a cessé de tenter d’établir des contacts avec son fils depuis 2014 et que, malgré les différentes décisions du tribunal pour enfants et de la cour d’appel, les autorités n’ont pas trouvé de solution pour lui permettre d’exercer régulièrement son droit de visite. L’avertissement du tribunal de Venise n’a eu aucun effet sur L.R., qui a continué à empêcher le requérant d’exercer son droit de visite et a même déménagé à six cents kilomètres de distance sans le consentement de celui-ci et des tribunaux. Ce comportement persiste aujourd’hui en dépit d’une nouvelle décision du tribunal pour enfants et de la condamnation pénale prononcée contre la requérante pour soustraction de mineur.
79. Certes, la Cour reconnaît que les autorités étaient confrontées en l’espèce à une situation très difficile qui découlait notamment des tensions existantes entre les parents de l’enfant. Elle admet que l’impossibilité pour le requérant d’exercer son droit de visite était au départ surtout imputable au refus manifeste de la mère de l’enfant, puis au refus de l’enfant et à la distance entre le lieu de résidence de l’enfant et celui du requérant. Elle rappelle cependant qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (Nicolò Santilli, § 74, Lombardo, § 91, et Zavřel, § 52, tous précités).
80. La Cour considère que les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce et qu’elles sont restées en deçà de ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Elle estime en particulier que les juridictions internes n’ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l’enfant (Bondavalli, § 81, Macready, § 66, Piazzi, § 61, et Strumia, § 122 tous précités). Elle constate notamment que les services sociaux de Rome, nonobstant les décisions judiciaires ordonnant l’organisation des rencontres, sont intervenus très tardivement (paragraphes 27-33 ci-dessus), qu’ils ont organisé une seule visite et qu’ils n’ont pas tenu le requérant informé de la situation de son fils.
81. La Cour considère que, dès la séparation des parents, alors que l’enfant n’avait qu’un an, les juridictions internes ont omis de prendre des mesures concrètes et utiles de nature à permettre l’instauration de contacts effectifs, et elle constate qu’elles ont ensuite toléré pendant environ sept ans que la mère, par son comportement, empêchât l’établissement d’une véritable relation entre le requérant et l’enfant. Elle relève que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements ou une délégation du suivi de la famille aux services sociaux, assortie de l’obligation pour ceux-ci d’organiser et de faire respecter le droit de visite du requérant (Lombardo, précité, § 92, et Piazzi, précité, § 61). Les services sociaux, de leur côté, ont agi avec retard et n’ont pas correctement exécuté les décisions judiciaires.
82. La Cour remarque que les services sociaux n’ont pas organisé les rencontres pendant la première période de confinement et bien au-delà (paragraphe 38 ci-dessus) alors que les déplacements motivés par l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement étaient autorisés (paragraphes 45-46 ci-dessus). Or bien que l’arsenal juridique prévu par le droit italien semble suffisant, aux yeux de la Cour, pour permettre à l’État défendeur d’assurer en abstrait le respect des obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention, force est de constater en l’occurrence que les autorités n’ont pas utilisé les instruments juridiques existants et n’ont entrepris aucune action à l’égard de L.R., lui laissant de surcroît la possibilité de déménager avec son fils pour s’installer à six cents kilomètres du domicile du requérant sans le consentement de celui-ci et contre la décision de la cour d’appel ; en particulier, L.R. a agi de la sorte sans avoir convenu au préalable avec le requérant d’un projet de coparentalité ou sans avoir soumis ledit projet aux juridictions pour approbation. Après cela, les autorités n’ont pas exécuté les précédentes décisions du tribunal de Trévise et de la cour d’appel de Venise qui accordaient un droit de visite au requérant. En outre, la Cour note que L.R. a été condamnée à un an et huit mois d’emprisonnement pour soustraction d’enfant, mais cela n’a pas changé la situation du requérant qui continuait à ne pas avoir accès à l’enfant. Aussi la Cour estime-t-elle que les autorités ont laissé s’enraciner une situation qui s’est de fait installée au mépris des décisions judiciaires (K.B. et autres c. Croatie, no 36216/13, 14 mars 2017). Après la période de confinement, lorsque les services sociaux ont constaté que L.R. refusait d’emmener l’enfant voir son père, elles ont suspendu ces rencontres sans engager la procédure de médiation ordonnée par le tribunal. Aucun contrôle sur l’activité et sur les omissions des services sociaux n’a été effectué par les juridictions.
83. La Cour note que, dans le cas d’espèce, face à l’opposition de la mère de l’enfant, qui perdurait depuis 2014, et aux difficultés rencontrées par le requérant pour exercer son droit de visite, les autorités nationales n’ont pas pris rapidement toutes les mesures nécessaires et qui pouvaient raisonnablement être exigées d’elles pour faire respecter le droit de l’intéressé d’avoir des contacts et d’établir une relation avec son fils (Terna, précité § 73 Strumia, précité, § 123).
84. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà constaté, dans l’arrêt Terna, (précité § 97), l’existence d’un problème systémique en Italie concernant les retards dans la mise en œuvre du droit de visite judiciairement prononcé.
85. La Cour relève également le retard avec lequel le tribunal de Venise a rendu sa décision. Elle rappelle à cet égard qu’elle peut prendre en compte, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la durée du processus décisionnel des autorités internes ainsi que celle de toute procédure judiciaire connexe. En effet, un retard dans la procédure risque toujours, en pareil cas, de trancher par un fait accompli le problème en litige. Or un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, §§ 64‑65, série A no 121, Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 136, 9 mai 2003, Solarino précité, § 39, 9 février 2017, et D’Alconzo c. Italie, no 64297/12, § 64, 23 février 2017).
86. Pour la Cour, un surcroît de diligence et de rapidité s’imposait dans l’adoption d’une décision touchant aux droits garantis par l’article 8 de la Convention. L’enjeu de la procédure pour le requérant exigeait un traitement urgent, car le passage du temps pouvait avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et son père, qui ne vivait pas avec lui. La Cour rappelle en effet que la rupture du contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de sa relation avec son parent. À cet égard, elle note qu’en dépit des demandes déposées par le requérant, les services sociaux et le parquet, qui signalaient une situation dangereuse pour l’enfant, il a fallu deux ans au tribunal de Venise pour prendre une décision, qui, à ce jour, n’est toujours pas exécutée, sans que ce défaut d’exécution entraîne de conséquences pour L.R., malgré les avertissements du tribunal et bien que L.R. ait été condamnée pour soustraction de mineur.
87. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant et qu’elles ont méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale.
88. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
S.L. et A.L. c. Italie du 5 juin 2020 requête n° 896/16
Article 8 : Les juridictions italiennes ont statué promptement dans un litige international de garde d’enfant. Les requérants se plaignent d'un délai de six ans mais la CEDH réduit le litige pour constater un délai de 4 mois et 12 jours.
L’affaire concerne une procédure de garde d’enfant entre des parents de nationalités différentes (un Italien et une Roumaine). En 2009, l’épouse du requérant engagea une procédure de divorce et de demande de garde de son fils devant les juridictions roumaines, alors qu’une procédure de séparation et de garde d’enfant, introduite par le requérant en 2007, était déjà pendante devant les juridictions italiennes. La juridiction roumaine prononça le divorce et accorda la garde de l’enfant à la mère en 2012, alors que la juridiction italienne accorda la garde de l’enfant au père en 2013. Le requérant alléguait que les juridictions italiennes avaient manqué de diligence car la procédure avait duré six ans, se plaignant d’une atteinte à son droit garanti par l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention. La Cour estime que la décision relative à la garde de l’enfant a été prise promptement, en conformité avec les exigences du droit à la vie familiale. Elle conclut que les autorités italiennes ont agi avec la diligence nécessaire et ont pris toutes les mesures que l’on pouvait attendre d’elles afin d’assurer aux requérants le maintien d’un lien familial. Elle note, entre autres, que l’activité procédurale du requérant et de son épouse a influé de manière déterminante sur la durée globale de la procédure et que le requérant n’a pas exercé certains recours. La requête est donc manifestement mal fondée.
FAITS :
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1972, et résidant en Italie. Il a introduit la requête en son nom et au nom de son fils, un ressortissant italien, né en 2006 et résidant en Roumanie auprès de sa mère. En 2005, le requérant se maria avec une ressortissante roumaine avec laquelle il eut un enfant. Le couple vécut en Italie. Puis, en 2006, l’épouse du requérant et son fils partirent à Bucarest, avec l’accord du requérant, dans l’intention de revenir en Italie pour les vacances de Noël. Le moment venu, l’intéressée décida de rester en Roumanie avec son fils. En 2007, le requérant introduisit une demande de séparation de corps devant le tribunal de Teramo (Italie) et demanda la garde de son fils. L’épouse du requérant se constitua partie au procès. Provisoirement, le tribunal accorda la garde de l’enfant à la mère, aménageant un droit de visite pour le père. Puis, en janvier 2012, le tribunal prononça la séparation de corps et, en juillet 2013, le tribunal confia au requérant la garde exclusive de l’enfant, ordonnant son retour immédiat en Italie. Par la suite, le requérant demanda la reconnaissance et l’exécution de ce jugement par les juridictions roumaines. Toutefois, saisie par l’épouse du requérant, la cour d’appel de l’Aquila (Italie) suspendit la procédure d’exécution car elle releva qu’entre-temps l’épouse du requérant avait obtenu le divorce ainsi que la garde exclusive de l’enfant en Roumanie, par une décision définitive rendue en décembre 2012 par le tribunal de Bucarest. La demande de garde exclusive du requérant fut ainsi déclarée irrecevable par la cour d’appel d’Aquila (Italie).
En 2015, le requérant se pourvut en cassation, demandant un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) sur la question de l’interprétation de la notion de litispendance européenne au sens de l’article 19 du règlement (CE) n o 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et des effets de la violation de cette disposition sur la procédure de reconnaissance du jugement rendu en Roumanie. La Cour de cassation saisit la CJUE.
En 2019, la CJUE se prononça sur la question préjudicielle, indiquant entre autres que les règles de litispendance figurant à l’article 19 du règlement (CE) n o 2201/2003 devaient être interprétées en ce sens que « lorsque, dans le cadre d’un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale ou d’obligations alimentaires, la deuxième juridiction saisie adopte, en violation de ces règles, une décision devenue définitive, elles s’opposent à ce que les juridictions de l’État membre dont relève la première juridiction saisie refusent, pour cette seule raison, de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation ne saurait, à elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l’ordre public de cet État membre ». La même année, à la suite de cet arrêt, la Cour de cassation rejeta le pourvoir du requérant.
Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, et les mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans l’exercice du droit protégé par l’article 8 de la Convention. Dans les affaires de ce type, les États doivent faire preuve d’une diligence exceptionnelle, en statuant dans un délai raisonnable (exigence procédurale implicite de l’article 8). Les mesures propres à réunir le parent et son enfant doivent donc être mises en place rapidement. En l’espèce, il s’agit de savoir si les requérants ont subi une ingérence dans leur droit au respect de la vie familiale compte tenu du temps que le tribunal de Teramo (Italie) a mis pour se prononcer sur la résidence principale de l’enfant et son retour en Italie, et du fait qu’entretemps la mère a obtenu la garde de l’enfant par un jugement de divorce rendu par le tribunal de Bucarest (Roumanie). La Cour relève que le requérant n’a pas saisi l’autorité centrale afin d’obtenir le retour de son fils en Italie en application de la Convention de La Haye1 , mais s’est borné à introduire une procédure de séparation de corps devant le tribunal civil, en demandant la garde exclusive de l’enfant et son retour en Italie.
Le tribunal de Teramo s’est prononcé provisoirement sur la garde et le placement de l’enfant 4 mois et 12 jours après l’introduction du recours, conformément aux exigences procédurales découlant de l’article 8 de la Convention. En ce qui concerne l’enlèvement de l’enfant, les autorités italiennes n’étaient pas appelées à se pencher sur cette question ni à ordonner son retour, la procédure de séparation n’étant pas un recours effectif à cette fin. En outre, le requérant n’a pas contesté devant la cour d’appel la décision d’attribuer la garde à la mère et de fixer la résidence principale de l’enfant auprès d’elle, ayant ainsi consenti aux mesures prises par le tribunal. La procédure a ensuite suivi son cours uniquement dans le but de préciser les modalités d’exercice du droit de visite. À cet égard, la Cour relève que, si certains renvois d’audience peuvent être imputés aux autorités, l’activité procédurale du requérant et de son épouse a influé de manière déterminante sur la durée globale de la procédure. En effet, le caractère conflictuel de la relation entre les parties les a empêchées de trouver des accords concrets et effectifs dans l’intérêt de leur enfant. En conséquence des difficultés rencontrées dans l’exécution du droit de visite, le tribunal de Teramo a pris des mesures dans l’intérêt de l’enfant uniquement. La Cour constate donc que la décision relative à la garde de l’enfant a été prise promptement, en conformité avec les exigences du droit au respect de la vie familiale. Par conséquent, elle conclut que les autorités italiennes ont agi avec la diligence nécessaire et ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin d’assurer aux requérants le maintien d’un lien familial dans l’intérêt de l’un comme de l’autre. La requête est donc manifestement mal fondée (article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention).
CEDH
a) Le Gouvernement
53. Le Gouvernement considère que le premier requérant n’a pas qualité pour agir au nom et pour le compte du second requérant puisque, au moment de l’introduction de la requête, la garde de celui-ci, qui est mineur, était conférée exclusivement à la mère en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 12 juin 2013 : il y aurait donc conflit d’intérêts entre les deux parents. De plus, le Gouvernement note que, dans le formulaire de requête, seul le premier requérant donne pouvoir à maître Menichetti pour le représenter, et il n’est pas précisé si l’avocat représente aussi le second requérant.
54. Le Gouvernement fait valoir que la décision relative à la garde et au placement de l’enfant a été adoptée 4 mois et 12 jours après l’introduction de la procédure de séparation de corps, délai qu’il estime conforme aux exigences procédurales découlant de l’article 8 de la Convention.
55. Le Gouvernement observe en outre que le premier requérant n’a introduit de recours (reclamo) devant la cour d’appel ni contre cette décision, qui attribuait la garde de l’enfant à sa mère et prononçait son placement auprès d’elle, ni contre l’ordonnance du 7 février 2013, qui confirmait la décision de placement. Il argue que, étant donné que la décision du tribunal de Teramo du 4 octobre 2007 n’impliquait pas le retour de l’enfant en Italie, à partir du moment où elle a été rendue l’État italien n’était plus compétent pour se prononcer sur le retour ou la garde de l’enfant (article 10, point b) iv) du Règlement Bruxelles II bis).
56. Enfin, le Gouvernement estime que la longue durée de la procédure de première instance est due uniquement au caractère conflictuel de la relation entre les parties : celles-ci auraient demandé l’admission de différentes preuves dans le seul but de trouver le « coupable » de la fin de la relation et n’auraient pas réussi à trouver une solution partagée, dans l’intérêt du mineur, sur la question des documents nécessaires à son expatriation.
b) Les requérants
57. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.
58. En ce qui concerne l’exception soulevée quant à la qualité du premier requérant pour agir au nom et pour le compte du second, ils font valoir que dans sa jurisprudence, la Cour reconnaît la possibilité pour les mineurs de la saisir de différentes façons. Ils considèrent également que dès lors qu’il est le père biologique du second requérant, le premier requérant a qualité pour ester devant la Cour au nom de son enfant afin de protéger les intérêts de celui-ci.
59. Les requérants arguent que l’article 8 de la Convention impose aux États d’adopter les mesures nécessaires pour que les enfants puissent revenir auprès de leurs parents. Ils soutiennent qu’en l’espèce, la responsabilité du retour de l’enfant et de l’attribution de sa garde incombait dès le début aux autorités italiennes, le premier requérant ayant exercé le droit reconnu par l’article 29 de la Convention de la Haye, qui permet de s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives de l’État concerné pour se plaindre d’une violation du droit de garde. À cet égard, ils arguent que, s’il existe plus d’une voie de recours susceptible de se révéler effective, les justiciables ne sont tenus d’exercer que l’une d’entre elles.
60. Les requérants se plaignent également que le tribunal de Teramo ait mis six ans à se prononcer sur la résidence principale et sur le retour en Italie de l’enfant, alors que ce dernier avait été enlevé et emmené en Roumanie par sa mère. Ils estiment que les retards qu’a connus la procédure sont imputables aux autorités judiciaires italiennes, celles-ci ayant reporté de nombreuses audiences et n’ayant pas prononcé de mesures d’urgence. Ils avancent que l’audience tenue devant le tribunal de Teramo a eu lieu presque un an après l’enlèvement du second requérant, et que ce tribunal n’a ordonné le retour de l’enfant en Italie que six ans après l’ouverture de la procédure. Ils arguent que les autorités italiennes avaient l’obligation de prendre toutes les mesures propres à conduire au retour de l’enfant, mais que, au contraire, elles sont restées passives malgré l’urgence de l’affaire.
61. La Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement quant à la qualité du premier requérant pour agir au nom du second requérant, la requête étant de toute façon irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous.
62. La Cour observe tout d’abord que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, même si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans l’exercice du droit protégé par l’article 8 de la Convention (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 43, CEDH 2000‑VIII ; K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 151, CEDH 2001‑VII ; et Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 102, 10 septembre 2019).
63. La Cour rappelle aussi que, dans les affaires concernant la relation entre un parent et son enfant, les États doivent témoigner d’une diligence exceptionnelle, car le passage du temps risque de trancher en pratique la question posée. Ce devoir de diligence, dont le respect revêt une importance décisive au moment de déterminer si la cause a été entendue dans le délai raisonnable requis par l’article 6 § 1 de la Convention, fait partie des exigences procédurales que contient implicitement l’article 8 (Ribić c. Croatie, no 27148/12, § 92, 2 avril 2015).
64. La Cour note également que, pour être adéquates, les mesures propres à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 102., CEDH 2000‑I, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004‑V (extraits), Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin 2006, et Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 84, 2 septembre 2010). Le facteur temps revêt donc une importance particulière, car tout retard procédural risque de trancher en fait le problème en litige (H. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 120, pp. 63-64, §§ 89-90, et P.F. c. Pologne, no 2210/12, § 56, 16 septembre 2014).
65. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, un retard dans la procédure risque toujours de trancher par un fait accompli le problème en litige (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, §§ 64‑65, série A no 121, D’Alconzo c. Italie, no 64297/12, § 64, 23 février 2017, Solarino c. Italie, no 76171/13, § 39, 9 février 2017, et Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 136, 9 mai 2003).
66. La Cour rappelle, enfin, que si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, le processus décisionnel lié aux mesures d’ingérence doit être équitable et propre à respecter les intérêts protégés par cette disposition.
67. En l’espèce, la Cour doit examiner la question de savoir si les requérants ont subi une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, compte tenu du temps que le tribunal de Teramo a mis pour se prononcer sur la résidence principale de l’enfant et sur son retour en Italie, et de ce que, entretemps, L.G. a obtenu du tribunal de Bucarest un jugement de divorce lui confiant la garde de l’enfant et reconnaissant un droit de visite au père.
68. La Cour reconnaît que les autorités et les juridictions nationales sont souvent confrontées à une tâche extrêmement difficile lorsqu’elles prennent des décisions concernant la garde de mineurs (Leonov c. Russie, no 77180/11, § 71, 10 avril 2018). Elle observe, en particulier, que la présente affaire est devenue assez complexe en raison du fait que L.G. a engagé une procédure de divorce et de demande de garde de l’enfant devant les juridictions roumaines alors que la procédure de séparation menée devant les autorités italiennes était encore pendante.
69. Se tournant vers les faits de la présente cause, la Cour relève que le premier requérant n’a pas saisi l’autorité centrale afin d’obtenir le retour de son fils en Italie en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« la Convention de La Haye »), mais s’est borné à introduire une procédure de séparation de corps devant le tribunal civil, en demandant la garde exclusive de l’enfant et son retour en Italie. Le tribunal de Teramo s’est prononcé provisoirement sur la garde et le placement de l’enfant le 4 octobre 2007, c’est-à-dire 4 mois et 12 jours après l’introduction du recours, conformément aux exigences procédurales découlant de l’article 8 de la Convention.
70. En ce qui concerne les observations du premier requérant sur l’enlèvement du second requérant, la Cour estime que les autorités italiennes n’étaient pas appelées à se pencher sur cette question ni à ordonner le retour de l’enfant, la procédure de séparation n’étant pas un recours effectif à cette fin (voir, à cet égard, le paragraphe 47 ci-dessus).
71. Elle observe, en outre, que le premier requérant n’a pas contesté devant la cour d’appel la décision d’attribuer la garde à L.G. et de fixer la résidence principale de l’enfant auprès de sa mère, et qu’il a ainsi consenti aux mesures prises par le tribunal.
72. La procédure a ensuite suivi son cours uniquement dans le but de préciser les modalités d’exercice du droit de visite. À cet égard, la Cour relève que, si certains renvois d’audience peuvent être imputés aux autorités, l’activité procédurale du premier requérant et de L.G. a influé de manière déterminante sur la durée globale de la procédure. En effet, le caractère conflictuel de la relation entre les parties les a empêchées de trouver des accords concrets et effectifs dans l’intérêt de leur enfant. Ainsi, les décisions du 7 février 2013 et du 8 juillet 2013, par lesquelles le tribunal de Teramo a confié la garde de l’enfant d’abord aux deux parents conjointement puis exclusivement au premier requérant, sont des mesures prises dans l’intérêt de l’enfant uniquement en conséquence des difficultés rencontrées dans l’exécution du droit de visite. La Cour rappelle que ces griefs ne sont pas l’objet du litige (paragraphe 53 ci-dessus).
73. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour constate que, comme le soutient le Gouvernement, la décision relative à la garde de l’enfant a été prise promptement, en conformité avec les exigences du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. En conséquence, elle conclut que les autorités italiennes ont agi avec la diligence nécessaire et ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin d’assurer aux requérants le maintien d’un lien familial dans l’intérêt de l’un comme de l’autre. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Lacombe c. France du 10 octobre 2019 requête n° 23941/14
Article 8 : En ordonnant le retour de l’enfant vers sa mère aux États-Unis, les autorités françaises n’ont pas violé le droit au respect de la vie familiale
L’affaire concerne la procédure de retour d’un enfant auprès de sa mère aux Etats-Unis, en application de la Convention de La Haye. La Cour a jugé que les juridictions internes ont dûment pris en compte les allégations du requérant et que le processus décisionnel a été équitable. Le requérant a pu pleinement faire valoir ses droits dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Eu égard à la marge d’appréciation des autorités, la Cour considère que la décision de retour se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention, considéré à la lumière de l’article 13 b) de la Convention de la Haye et de l’article 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qu’elle était proportionnée au but légitime recherché.
LES FAITS
Le requérant, M. Jean-Philippe Lacombe, est un ressortissant français, né en 1968 et résidant à Nice.
En avril 1998, M. Lacombe se maria au Mexique avec une ressortissante mexicaine ; un enfant naquit de leur union au Mexique. En février 2004, la mère emmena l’enfant aux États-Unis pendant deux mois sans prévenir M. Lacombe. Le divorce fut prononcé la même année et l’autorité parentale fut accordée conjointement aux deux parents mais la garde fut confiée à M. Lacombe avec des droits de visite pour la mère.
En juin 2005, la garde fut transférée à la mère avec un droit de visite pour le père. Une première procédure d’enlèvement international fut ouverte en 2005-2006, suite au départ de M. Lacombe pour la France avec l’enfant.
Par jugement du 19 octobre 2006, le tribunal de grande instance (TGI) de Marseille considéra le déplacement de l’enfant illicite, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye. Cependant, compte tenu d’une procédure en cours au Mexique pour tentative de meurtre dont le requérant fut victime et mettant en cause la mère, le TGI considéra qu’il existait un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger. Le Tribunal fit application de l’article 13 b) de la Convention de La Haye et n’ordonna pas le retour de l’enfant auprès de sa mère. A la suite d’un accord avec la mère, M. Lacombe accepta de lui confier de nouveau la garde de l’enfant. En avril 2007, le juge aux affaires familiales du district fédéral de Mexico déchut le requérant de l’autorité parentale à l’égard de son fils en raison du risque de départ à l’étranger. En octobre 2007, la mère quitta le Mexique pour les États-Unis avec l’enfant. Un mandat d’arrêt fut émis par les autorités mexicaines à son encontre pour enlèvement d’enfant. Ayant localisé son fils au Texas en février 2009, le requérant obtint de la justice du Texas que l’enfant lui soit confié provisoirement dans l’attente d’une audience ultérieure au cours de laquelle le juge américain statuerait sur l’attribution de la garde. Le requérant emmena son fils au Mexique puis en France, sans comparaître à cette audience.
Les autorités américaines émirent un mandat d’arrêt contre lui pour enlèvement d’enfant. La seconde procédure d’enlèvement international fut ouverte en 2009-2010. En octobre 2009, la mère saisit l’autorité centrale des États-Unis d’une demande de remise de l’enfant en application de la Convention de La Haye. En août 2010, les juridictions américaines accordèrent la garde de l’enfant à la mère et, dans le même temps, le TGI de Marseille ordonna le retour de l’enfant auprès de sa mère aux États-Unis. M. Lacombe remit l’enfant à la mère, mais fit appel du jugement. La cour d’appel confirma le jugement. Elle considéra que la résidence habituelle de l’enfant était bien au Texas et que l’enfant n’encourait aucun danger auprès de sa mère. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
CEDH
a) Les principes généraux
56. Concernant les principes généraux dégagés par sa jurisprudence sur les déplacements illicites d’enfants, la Cour renvoie à l’arrêt X c. Lettonie, précité, et particulièrement aux paragraphes 95, 100 à 102 et 106 à 107, où elle s’est exprimée ainsi :
« 95. Le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière (Maumousseau et Washington, précité, § 62), en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la principale considération, les objectifs de prévention et de retour immédiat répondant à une conception déterminée de «l’intérêt supérieur de l’enfant »
(...)
100. L’intérêt supérieur de l’enfant ne se confond pas avec celui de son père ou de sa mère, outre qu’il renvoie nécessairement à des éléments d’appréciation divers liés au profil individuel et à la situation spécifique de l’enfant. Néanmoins, il ne saurait être appréhendé d’une manière identique selon que le juge est saisi d’une demande de retour en application de la Convention de La Haye ou d’une demande de statuer au fond sur la garde ou l’autorité parentale, cette dernière relevant d’une procédure en principe étrangère à l’objet de la Convention de La Haye (...).
101. Partant, dans le cadre d’une demande de retour faite en application de la Convention de La Haye, qui est donc distincte d’une procédure sur le droit de garde, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant doit s’apprécier à la lumière des exceptions prévues par la Convention de La Haye, lesquelles concernent l’écoulement du temps (article 12), les conditions d’application de la convention (article 13 a)) et l’existence d’un « risque grave » (article 13 b)), ainsi que le respect des principes fondamentaux de l’État requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 20). Cette tâche revient en premier lieu aux autorités nationales requises, qui ont notamment le bénéfice de contacts directs avec les intéressés. Pour ce faire au regard de l’article 8 de la Convention, les juridictions internes jouissent d’une marge d’appréciation, laquelle s’accompagne toutefois d’un contrôle européen en vertu duquel la Cour examine, sous l’angle de la Convention, les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de ce pouvoir (voir, mutatis mutandis, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299-A, ainsi que Maumousseau et Washington, précité, § 62, et Neulinger et Shuruk, précité, § 141).
102. Précisément, dans le cadre de cet examen, la Cour rappelle qu’elle n’entend pas substituer son appréciation à celle des juridictions internes (voir, par exemple, Hokkanen, précité, et K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 154, Recueil 2001‑VII). Elle doit cependant s’assurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse a été équitable et qu’il a permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), no 14600/05, CEDH 2005‑XIII (extraits), Maumousseau et Washington, précité, et Neulinger et Shuruk, précité, § 139).
(...)
106. La Cour estime que l’on peut parvenir à une interprétation harmonieuse de la Convention et de la Convention de La Haye (paragraphe 94 ci-dessus) sous réserve que les deux conditions suivantes soient réunies. Premièrement, les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l’enfant en application des articles 12, 13 et 20 de ladite convention, notamment lorsqu’ils sont invoqués par l’une des parties, soient réellement pris en compte par le juge requis. Ce dernier doit dès lors rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, afin de permettre à la Cour de s’assurer que ces questions ont bien fait l’objet d’un examen effectif. Deuxièmement, ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l’article 8 de la Convention (Neulinger et Shuruk, précité, § 133).
107. Par conséquent, la Cour estime que l’article 8 de la Convention fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale particulière à ce titre : dans le cadre de l’examen de la demande de retour de l’enfant, les juges doivent non seulement examiner des allégations défendables de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour, mais également se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce. Tant un refus de tenir compte d’objections au retour susceptibles de rentrer dans le champ d’application des articles 12, 13 et 20 de la Convention de La Haye qu’une insuffisance de motivation de la décision rejetant de telles objections seraient contraires aux exigences de l’article 8 de la Convention, mais également au but et à l’objet de la Convention de La Haye. La prise en compte effective de telles allégations, attestée par une motivation des juridictions internes qui soit non pas automatique et stéréotypée, mais suffisamment circonstanciée au regard des exceptions visées par la Convention de La Haye, lesquelles doivent être d’interprétation stricte (Maumousseau et Washington, précité, § 73) est nécessaire. Cela permettra aussi d’assurer le contrôle européen confié à la Cour, dont la vocation n’est pas de se substituer aux juges nationaux. »
b) L’application de ces principes au cas d’espèce
i) Une ingérence dans la vie familiale prévue par la loi et répondant à un but légitime
57. La Cour constate à titre liminaire que le lien entre le requérant et son fils relève d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, il ne prête pas à controverse que les décisions rendues par les juridictions internes ordonnant le retour de l’enfant aux États-Unis constituent une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Pareille ingérence est constitutive d’une violation du paragraphe 2 de cet article à moins qu’elle ne soit « prévue par la loi », ne vise l’un ou plusieurs des buts légitimes au regard de ce même paragraphe et ne puisse passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique ».
58. En l’espèce, la Cour note que les décisions de retour prises par les autorités françaises étaient fondées sur la Convention de La Haye, qui est incorporée au droit français (paragraphe 45 ci-dessus), et visaient à protéger les droits et libertés de l’enfant. L’ingérence, prévue par la loi, poursuivait donc un intérêt légitime au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. La question qui se pose est donc celle de savoir si telle ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
ii) La nécessité de la mesure de retour dans une société démocratique
59. La Cour, qui doit se placer au moment de l’exécution de la mesure litigieuse (voir, mutatis mutandis, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 91, CEDH 2008), constate tout d’abord que peu de temps s’était écoulé en l’espèce à partir du déplacement jusqu’au moment où les autorités françaises ont été saisies de la demande fondée sur la Convention de La Haye.
60. En effet, l’enfant a quitté les États-Unis en octobre 2009 pour le Mexique et dès le 28 octobre 2009, D. a saisi l’autorité centrale des États-Unis d’une demande de remise de l’enfant en application de la Convention de La Haye, tandis qu’au mois de novembre ou décembre 2009, le requérant a déplacé l’enfant en France (paragraphes 31-33 ci‑dessus). À la suite de l’audition de l’enfant par la brigade des mineurs de Nice le 9 juin 2010, le procureur de la République a assigné, le 8 juillet 2010, le requérant devant le TGI de Marseille aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l’enfant. Le jugement de ce tribunal est intervenu le 27 août 2010 et l’enfant a été remis à sa mère le 30 août 2010. La Cour constate ainsi que non seulement l’introduction de la demande de retour devant l’autorité française, mais également la procédure interne et le retour de l’enfant sont intervenus dans la période de moins d’un an visé au premier alinéa de l’article 12 de la Convention de La Haye, lequel prévoit alors un retour immédiat. Par ailleurs, la Cour note que les juridictions nationales de première instance, d’appel puis de cassation ont été unanimes quant à la suite à donner à la demande de retour présentée par D.
61. Au vu des critères établis dans l’arrêt X c. Lettonie (précité), la Cour doit examiner si les juges internes ont effectivement pris en compte les allégations du requérant et justifié leurs décisions au regard des exceptions visées par la Convention de La Haye par une motivation suffisamment circonstanciée – c’est-à-dire, appuyée sur les données de l’espèce –, tout en sachant que ces exceptions doivent être d’interprétation stricte (X c. Lettonie, § 107).
62. La Cour observe qu’à titre principal, le requérant a fait valoir devant le tribunal de grande instance comme devant la cour d’appel, l’illégalité de la résidence de l’enfant aux États-Unis, ainsi que l’inapplicabilité des articles l et 12 de la Convention de La Haye. La Cour constate que les juridictions internes de première et deuxième instance ont considéré que la résidence légale de l’enfant au moment de son départ vers la France se situait bien au Texas et que ce déplacement de l’enfant vers la France était illicite. Elles ont souligné que le requérant ne pouvait contester la compétence du juge américain alors qu’il l’avait lui-même sollicité et qu’il avait obtenu l’autorisation de prendre provisoirement son fils avec lui à la condition, qu’il n’a pas respectée, de se représenter à une audience où la question de l’attribution de la garde devait être tranchée (paragraphes 29 et 41 ci-dessus).
63. La Cour note qu’à titre subsidiaire le requérant s’est prévalu devant les juridictions internes d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour aux États-Unis. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes dans l’examen de la question de risque grave de danger pour l’enfant, au sens de l’article 13 de la Convention de La Haye. En revanche, elle est compétente pour rechercher si les tribunaux internes, dans l’application et l’interprétation des dispositions de cette convention, ont respecté les garanties de l’article 8 de la Convention, en tenant notamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (K.J. c. Pologne, no 30813/14, § 63, 1er mars 2016).
64. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le retour d’un enfant ne saurait être ordonné de façon automatique et mécanique (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § .72, 6 décembre 2007, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 138, CEDH 2010 et, X c. Lettonie [GC], précité, § 98). En l’espèce, le requérant a soutenu devant le TGI que l’enfant était en danger avec sa mère et qu’il voulait rester avec son père (paragraphe 37 ci-dessus). La Cour observe que pour rejeter ce risque allégué de danger, le tribunal s’est expressément fondé sur l’audition de l’enfant par la brigade des mineurs. Or, elle rappelle qu’en matière d’enlèvement international d’enfants, les obligations que l’article 8 fait peser sur les États contractants doivent s’interpréter en tenant également compte de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (Neulinger et Shuruk, précité, § 132, et X c. Lettonie, précité, § 93) qui précise dans son article 12 § 1 qu’un enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et le droit de voir ces opinions dûment prises en considération eu égard à son âge et son degré de maturité.
65. En l’espèce, la Cour relève, ainsi que l’a fait la Cour de cassation, que le juge de première instance a pris en compte les sentiments exprimés par l’enfant, qui ne manifestait aucune opposition formelle à son retour (paragraphes 34, 38 et 43 ci-dessus). La Cour observe qu’il ressort de cette audition que J.-P. est pris dans un conflit de loyauté entre sa mère avec laquelle il vivait heureux au Texas et dont il n’avait plus aucune nouvelle depuis plusieurs mois et son père qui, ainsi que le relève le tribunal (paragraphe 38 ci-dessus), lui parlait très négativement de sa mère et passait son temps au téléphone et sur l’ordinateur à la suite de la multiplication des instances judiciaires. Aux yeux de la Cour, le tribunal de première instance a bien examiné les allégations de danger soutenues par le requérant et y a répondu par une motivation circonstanciée et non stéréotypée.
66. Devant la cour d’appel, alors que la décision de retour avait été exécutée, le requérant fit valoir de nouveau le risque grave de danger pour l’enfant, au sens de l’article 13 de la Convention de La Haye. Il soutint que ce risque découlait, d’une part, de la mère elle-même qui l’avait préalablement enlevé aux États-Unis et des poursuites pénales engagées à l’encontre de celle-ci et d’autre part, de la rupture totale des liens entre J.-P. et son père qui résulterait de ce retour et de la volonté de la mère (paragraphe 40 ci-dessus).
67. La Cour relève que sur le premier point, la juridiction d’appel a écarté le risque de danger pour l’enfant auprès de sa mère, en indiquant que le mandat d’arrêt des autorités mexicaines équivalait à un mandat d’amener français qui ne préjugeait pas de sa responsabilité et que la mère, pour déménager aux États-Unis, s’était fondée sur une décision mexicaine prononçant la déchéance du droit du requérant de vivre avec son fils, en raison d’un premier enlèvement par le père et du danger de réitération d’une telle infraction (paragraphe 23 ci-dessus). S’agissant du second point, la cour d’appel a retenu que le requérant n’apportait aucun élément précis permettant de craindre une rupture totale des liens avec son fils. La Cour constate donc que la juridiction d’appel a motivé sa décision au regard des deux aspects du risque allégué par le requérant.
68. La Cour observe cependant que, dans sa motivation, la juridiction interne ne se prononce pas expressément sur le certificat du pédopsychiatre P.C, daté du 16 juillet 2010 (paragraphe 40 ci-dessus). Or, elle rappelle que, dans l’affaire X c. Lettonie (précitée), elle a jugé que le refus de prendre en compte un risque de traumatisme de l’enfant en cas de séparation immédiate avec sa mère, reposant sur une attestation émanant d’un professionnel, était contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention, le caractère non contradictoire de cette expertise ne suffisant pas à dispenser les juges de l’examiner effectivement.
69. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a produit un certificat rédigé à sa seule demande et daté du 16 juillet 2010, soit avant l’audience devant le TGI de Marseille, mais ne l’a présenté pour la première fois que lors du débat devant la cour d’appel qui s’est tenu le 6 octobre 2011. Or, à cette date, l’enfant n’était plus sur le territoire français à la suite de sa remise à la mère (paragraphe 39 ci-dessus) et une expertise contradictoire s’avérait difficile, voire impossible, à effectuer. Ce certificat faisait état d’un risque de « décompensation » en cas d’un nouveau changement de cadre de vie chez un enfant déjà fragilisé par « de multiples séparations » et faisait apparaître l’existence possible d’un risque grave au sens de l’article 13 b) de la Convention.
70. Néanmoins, la Cour considère que le cas d’espèce diffère substantiellement de l’affaire X c. Lettonie (précité). D’une part, l’allégation de risque grave soulevée par le requérant devant la cour d’appel ne reposait pas sur le certificat médical et le contenu de celui-ci. Le certificat n’était que l’une des 79 pièces produites devant la cour d’appel et il n’a d’ailleurs été mentionné à aucun moment par le requérant dans ses conclusions d’appel contrairement aux exigences du droit procédural applicable (paragraphe 48 ci-dessus).
71. La Cour constate en outre que ce certificat médical ne portait sur aucun des deux dangers invoqués par le requérant pour caractériser l’existence d’un risque grave : il ne se prononçait ni sur la dangerosité de la mère ni sur un risque de rupture des liens entre l’enfant et le père. Le requérant n’a pas davantage développé l’argument selon lequel un retour de son fils auprès de sa mère aux États-Unis serait traumatisant en ce qu’il provoquerait un changement d’environnement et de cadre de vie.
72. D’autre part, dans l’affaire X. c. Lettonie (précitée), les juges d’appel avaient refusé d’examiner les conclusions de l’examen psychologique. La Cour rappelle que tant un refus de tenir compte d’objections au retour susceptibles de rentrer dans le champ d’application des articles 12, 13 et 20 de la Convention de La Haye qu’une insuffisance de motivation de la décision rejetant de telles objections seraient contraires aux exigences de l’article 8 de la Convention, mais également au but et à l’objet de la Convention de La Haye (X c. Lettonie, précité, §§ 106 et 107). Toutefois, la Cour note qu’en l’espèce, à aucun moment la cour d’appel n’a exclu ce certificat médical ou refusé d’examiner une allégation de risque grave. Il ressort au contraire de son arrêt qu’elle a considéré que l’enfant ne courait aucun danger auprès de sa mère, après avoir visé les pièces fournies au dossier. En conséquence, ainsi que l’a fait valoir le Gouvernement, l’allégation de risque grave en cas de retour de l’enfant a fait l’objet d’un examen effectif, fondé sur les éléments invoqués par le requérant au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction d’appel ayant à ce titre fourni une décision motivée. La Cour considère également que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à ordonner le retour de l’enfant a été équitable. Il a en effet permis au requérant, comme à la mère, de présenter pleinement leur cause, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant qui ne se confond pas avec celui de son père ou de sa mère et qui ne saurait être appréhendé d’une manière identique selon que le juge est saisi d’une demande de retour ou d’une demande de statuer au fond sur la garde ou l’autorité parentale (X c. Lettonie, précité, §§ 100 et 102). Ainsi, la cour d’appel a non seulement statué dans le respect des règles de procédure internes, comme indiqué précédemment (paragraphes 48 et 70 ci‑dessus), mais elle l’a également fait dans le cadre d’un examen effectif des éléments du dossier, sans perdre de vue l’intérêt supérieur de l’enfant.
73. S’agissant de la Cour de cassation, la Cour observe qu’elle n’a pas pour vocation de rejuger les faits mais de vérifier la conformité des décisions des tribunaux et des cours d’appel nationaux aux règles de droit (paragraphe 47 ci-dessus). En l’espèce, la Cour de cassation a effectivement contrôlé que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait suffisamment motivé sa décision de retour au regard de l’article 13 b) de la Convention et de l’intérêt supérieur de l’enfant (paragraphe 43 ci‑dessus).
iii) Conclusion
74. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les juges internes ont dûment pris en compte les allégations du requérant et que le processus décisionnel ayant conduit à l’adoption des mesures incriminées par les juridictions nationales a été équitable et a permis au requérant de faire valoir pleinement ses droits, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle estime que, eu égard à la marge d’appréciation des autorités en la matière, la décision de retour se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8, considéré à la lumière de l’article 13 b) de la Convention de la Haye et de l’article 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qu’elle était proportionnée au but légitime recherché.
75. Il s’ensuit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Khusnutdinov et X c. Russie du 18 décembre 2018 requête n° 76598/12
Article 8 : La décision des tribunaux internes de refuser le retour d’une fille chez son père n’est pas contraire à la Convention
L’affaire concerne un litige portant sur la résidence d’un enfant.
La Cour rappelle que, dès qu’un enfant arrive à maturité, les tribunaux doivent tenir dûment compte de son opinion et de son sentiment ainsi que de son droit au respect de sa vie privée. La fille de M. Khusnutdinov ayant clairement exprimé le souhait de continuer à vivre chez ses grands-parents, la décision par laquelle les tribunaux russes ont refusé son retour forcé chez son père peut passer pour fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour ajoute que c’est parce que M. Khusnutdinov a été passif pendant la période cruciale du début de sa séparation d’avec sa fille que celle-ci s’est habituée à vivre chez ses grands-parents et ne voulait pas partir de chez eux. Enfin, la Cour juge que les tribunaux internes ont conduit la procédure avec la diligence voulue, compte tenu de ce que celle-ci s’est déroulée en Russie alors que les parties résidaient en Ouzbékistan et aux États-Unis d’Amérique.
LES FAITS
En juin 2008, M. Khusnutdinov déménagea de Moscou vers les États-Unis avec sa femme, E., et leur fille, X, qui y fut scolarisée. Six mois plus tard, X déménagea cependant à Tachkent, en Ouzbékistan, pour vivre temporairement avec ses grands-parents car sa mère était tombée gravement malade. En décembre 2008, E. mourut d’un cancer aux États-Unis et M. Khusnutdinov se rendit à Tachkent pour les funérailles. Il retourna ensuite en Amérique, laissant à nouveau X temporairement à Tachkent avec ses grands-parents car son état de santé ne lui permettait pas de voyager. En mars 2009, M. Khusnutdinov revint à Moscou mais les grands-parents refusèrent de lui amener X. Au cours des mois suivants, il sollicita l’aide de plusieurs autorités consulaires russes pour récupérer sa fille. En septembre 2009, le ministère des Affaires internationales l’informa que des fonctionnaires du consulat russe en Ouzbékistan avaient rendu visite à X et à ses grands-parents à leur domicile et qu’ils avaient constaté que les conditions de vie de X étaient excellentes et que son père était libre de l’emmener avec lui à tout moment. Les services ouzbeks d’aide à l’enfance parvinrent à la même conclusion après avoir rendu visite à X. En janvier 2010, M. Khusnutdinov se rendit à Tachkent où il put parler à sa fille. En septembre 2010, il saisit un tribunal russe, estimant que les grands-parents retenaient illégalement sa fille. Différentes audiences eurent lieu mais, en 2011, plusieurs d’entre elles furent ajournées en raison de la noncomparution du requérant. En 2012, le tribunal de district rejeta la demande formulée par M. Khusnutdinov tendant à ce que X lui soit rendue. Prenant en considération les souhaits de X et l’avis de l’autorité d’assistance à l’enfance, le tribunal jugea qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester avec ses grandsparents. Le recours formé par M. Khusnutdinov contre la décision du tribunal de district fut ensuite rejeté, de même que son pourvoi en cassation.
Article 8
La Cour ne voit aucune raison de douter que les décisions des tribunaux internes étaient fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant. En particulier, ils ont tenu compte de ce que X avait clairement exprimé le souhait de continuer à vivre chez ses grands-parents. La Cour note que X était alors âgée de 13 ans et pouvait donc déjà former sa propre opinion sur la question et en comprendre les conséquences. De plus, aux yeux de la Cour, l’absence d’expertise psychologique ne constitue pas un vice dans la procédure. X était âgée de 13 ans lorsqu’elle a été entendue par un tribunal ouzbek sur la question du retour chez son père et elle était assistée par un spécialiste des services d’aide à l’enfance. Dans ces conditions, les tribunaux internes pouvaient raisonnablement penser que les déclarations de X reflétaient ses souhaits réels.
Sur l’argument tiré par M. Khusnutdinov de ce que la durée de la procédure, excessive selon lui, a eu pour conséquence de trancher de facto le litige, la Cour note tout d’abord qu’il avait choisi de saisir un tribunal russe alors que X habitait en Ouzbékistan chez ses grands-parents et que lui-même habitait aux États-Unis. Ce choix a inévitablement eu une incidence sur la durée de la procédure puisqu’il était devenu nécessaire de fixer un calendrier d’audiences de manière à permettre aux parties de voyager en provenance d’Ouzbékistan et des États-Unis vers Moscou, le lieu où les audiences devaient se tenir et, surtout, de communiquer aux autorités ouzbèkes des demandes d’entraide internationale afin d’établir les faits. Même si la procédure a connu certaines lenteurs imputables aux autorités russes, les tribunaux internes apparaissent globalement l’avoir conduite avec la diligence voulue.
La Cour observe en outre que M. Khusnutdinov est resté passif pendant un an et six mois après sa séparation d’avec X. Il ne lui a rendu visite qu’une seule fois pendant toute cette période, en janvier 2010. Il n’a pas non plus saisi les autorités ouzbèkes compétentes, alors que cette démarche semblait être la plus logique puisque sa fille se trouvait en Ouzbékistan. À part plusieurs plaintes formulées devant les autorités consulaires russes, il n’a pas entrepris la moindre action digne de ce nom pour récupérer sa fille pendant un an et six mois après leur séparation. Il en a donc chargé les autorités consulaires russes au lieu de prendre des initiatives lui-même. De plus, dès le mois d’octobre 2009, c’est-à-dire près d’un an avant la saisine par M. Khusnutdinov d’un tribunal russe, X avait déjà commencé à dire qu’elle préférait rester vivre avec ses grands-parents.
La Cour n’est donc pas convaincue que les lenteurs alléguées dans la procédure interne aient eu pour conséquence de trancher de facto le litige, X s’étant déjà apparemment formé sa propre opinion avant l’ouverture de la procédure. Dès lors, la décision des tribunaux internes d’entériner les souhaits de X et de refuser son retour forcé et immédiat auprès de M. Khusnutdinov peut passer pour avoir été prise dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu de la longue durée de son séjour chez ses grands-parents, de son attachement à eux et de son sentiment que leur domicile est le sien.
Article 13
La Cour observe que les requérants ont pu former un recours de droit interne. Le fait que ce recours a été rejeté ne veut pas dire en lui-même que celui-ci était ineffectif. Pour ce qui est de la durée de la procédure, excessive selon M. Khusnutdinov, elle juge que les tribunaux internes ont conduit celle-ci avec la diligence voulue. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté.
R. I. et autres c. Roumanie du 4 décembre 2018 requête n° 57077/16
Article 8 : Les autorités roumaines n’ont pas pris des mesures effectives pour assurer le retour d’enfants auprès de leur mère conformément aux décisions de justice
L’affaire concerne une mère qui a obtenu la garde de ses deux enfants mais n’a pas pu faire exécuter les décisions correspondantes, de sorte que les enfants sont restés avec leur père. Tout en admettant que les autorités se sont trouvées confrontées à une tâche difficile compte tenu de l’opposition du père et des enfants eux-mêmes, ces derniers étant peut-être influencés par celuilà, la Cour juge qu’elles n’ont pas pris en temps utile des mesures raisonnables aux fins de l’exécution des décisions attributives de la garde. La Cour reproche aux autorités de n’avoir pas prêté attention au fait que pendant qu’ils étaient séparés, le lien entre la première requérante (la mère) et ses enfants se désagrégeait progressivement, ni au comportement manipulateur du père. Elle conclut que dans l’ensemble, les requérants n’ont pas bénéficié d’une protection effective de leurs droits.
LES FAITS :
M.I. et I.I. sont nés de la relation de Mme R.I. avec M. R. (« R. »). En 2010, cette relation prit fin, et les parents convinrent que les enfants résideraient avec leur mère. En octobre 2013, R. enleva les enfants au domicile de leur mère. Depuis lors, les enfants résident avec lui. Mme R.I. engagea une action en justice et se vit attribuer la garde provisoire (mai 2014) puis définitive (septembre 2014) des enfants. R. ne respecta pas les décisions de justice et Mme R.I. fit appel à des huissiers de justice, en vain. Tout au long de la procédure, Mme R.I. allégua que R. montait ses enfants contre elle et leur faisait subir une maltraitance. Une expertise psychologique ordonnée par le tribunal conclut en novembre 2015 qu’il y avait des signes d’une aliénation parentale exercée par R. En août 2016, R. sollicita la garde des enfants. Il l’obtint en première instance, le tribunal ayant constaté que M.I. et I.I. avaient été séparés de leur mère pendant trois ans et estimé qu’un changement soudain de résidence les déstabiliserait. Mme R.I. fit appel de ce jugement, qui fut infirmé en mai 2018. La cour d’appel considéra que ce n’était pas par la faute de Mme R.I. que ses enfant vivaient toujours avec leur père, et que l’intéressée ne devait pas être pénalisée du fait de l’inexécution précédente des décisions attributives de la garde. Elle estima également que le père avait pu endoctriner les enfants contre leur mère.
LE DROIT :
Après avoir décidé d’examiner l’affaire uniquement sous l’angle de l’article 8, la Cour note que les autorités étaient tenues de prendre promptement des mesures pour assurer le retour des enfants auprès de leur mère, mais qu’en juillet 2018, date de la dernière communication des représentants de la mère, les enfants ne vivaient plus avec elle depuis novembre 2013. La Cour observe que les autorités doivent faire face à l’opposition de R. ainsi qu’à celle des enfants, qui refusent, peut-être sous l’influence de leur père, de retourner auprès de leur mère. Elle estime néanmoins que ce manque de coopération ne les dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour maintenir ou restaurer les liens familiaux. De manière générale, il apparaît que les services de protection de l’enfance ont été passifs. La première requérante a informé par deux fois le service de protection de l’enfance de Bucarest de sa difficulté à voir ses enfants, mais celui-ci a estimé ne rien pouvoir faire car le père n’était pas chez lui. Rien n’indique que les agents de ce service aient fait plus que simplement se rendre au domicile du père ni qu’ils aient mis en place un mécanisme visant à sanctionner l’obstruction exercée par celui-ci. Alors qu’un psychologue a indiqué en janvier 2015 qu’il était nécessaire que l’état psychique des enfants fasse l’objet d’un examen, celui-ci n’a été réalisé qu’après que la première requérante eut sollicité une ordonnance judiciaire à cette fin en juillet de la même année. Cet examen, réalisé ultérieurement, a confirmé la présence d’une maltraitance psychologique sous la forme d’une aliénation parentale exercée par le père. La Cour déplore le fait que les autorités n’aient pas prêté attention à la désagrégation progressive du lien entre la première requérante et ses enfants ni au comportement manipulateur du père, et elle conclut qu’elles n’ont pas agi en temps utile ni pris de mesures raisonnables compte tenu des circonstances pour assurer l’exécution des décisions de justice. La Cour juge que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts individuels et collectifs en présence, et que les requérants n’ont pas bénéficié d’une protection effective de leur droit au respect de leur vie familiale. Elle précise que l’arrêt ne doit pas être interprété comme signifiant que les autorités auraient dû faire retourner les enfants chez leur mère sans prendre au préalable de mesures préparatoires appropriées.
Leonov c. Russie du 10 avril 2018 requête n o 77180/11
Magomadova c. Russie du 10 avril 2018 requête n o 77546/14
Article 8 et garde des enfants après un divorce : La Cour examine deux affaires russes de garde d’enfant et conclut à une violation dans un cas et à une non-violation dans l’autre.
Dans des arrêts de chambre, rendus ce jour dans les affaires Leonov c. Russie (requête n°77180/11) et Magomadova c. Russie (requête n° 77546/14), la Cour européenne des droits de l’homme examine deux procédures différentes relatives à des affaires de garde d’enfant.
Dans l’affaire Leonov c. Russie, la Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, et par six voix contre une, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 8.
La Cour rejette à la majorité pour défaut manifeste de fondement un grief introduit sous l’angle de l’article 5 du Protocole n o 7 à la Convention (égalité entre époux).
Dans l’affaire Magomadova c. Russie, la Cour, à l’unanimité, conclut à une violation de l’article 8 et rejette un grief fondé sur l’article 13 (droit à un recours effectif). Ces deux affaires concernent les démarches judiciaires engagées par chacun des requérants pour obtenir la garde de leur enfant. Ni Sergey Leonov, le requérant dans la première affaire, ni Elita Magomadova, la requérante dans la seconde affaire, n’obtinrent gain de cause devant les juridictions nationales.
Ils reprochaient tous deux aux tribunaux internes d’avoir méconnu leurs droits garantis par la Convention. La Cour conclut que M. Leonov a été en mesure de présenter sa cause de manière exhaustive devant les juridictions nationales et que les raisons exposées par celles-ci pour justifier leur décision de ne pas lui accorder la garde de son enfant étaient pertinentes et suffisantes.
En particulier, la Cour n’est pas convaincue par l’argument avancé par M. Leonov selon lequel la juge dans son affaire pensait que les jeunes enfants devaient toujours être élevés par leur mère. Elle ne constate pas de violation des droits du requérant protégés par la Convention. Tel n’est pas le cas dans l’affaire de Mme Magomadova : la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas mené un examen assez approfondi pour permettre d’établir l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans l’ensemble, la Cour conclut à une violation des droits de Mme Magomadova tels que garantis par l’article 8. Mme Magomadova a fini par obtenir la garde de son enfant après que le père de celui-ci est décédé dans un accident de la circulation.
Principaux faits
Le requérant dans la première affaire est Sergey Aleksandrovich Leonov, un ressortissant russe né en 1983 et résidant à Moscou (Russie). La requérante dans la seconde affaire est Elita Khaidovna Magomadova, née en 1974 et résidant à Moscou.
M. Leonov demanda la garde de son fils A. en mars 2010, après que son épouse l’eut quitté en novembre 2009. Cependant, le tribunal de district chargé de l’affaire commença par accorder à son épouse une ordonnance de référé interdisant à M. Leonov de communiquer avec son fils ou de venir le chercher à l’école maternelle, puis finit par attribuer la garde de l’enfant à la mère en avril 2011. Le tribunal russe estima que les arguments présentés par M. Leonov, lequel disait résider dans un quartier de Moscou moins pollué et bénéficier de conditions de vie plus favorables ainsi que d’une meilleure situation financière, ou que la mère avait un casier judiciaire, n’étaient pas déterminants pour la décision relative à la garde de l’enfant. Celui-ci, qui n’avait que trois ans, vivait depuis longtemps avec sa mère. La décision d’attribuer la garde à la mère fut confirmée en appel en juin 2011. M. Leonov avait auparavant demandé la récusation de la juge de première instance, prétendant qu’elle avait déclaré que, selon la pratique établie du tribunal de district Timiryazevski, la garde de l’enfant était toujours décidée en faveur des mères. Sa demande fut rejetée. Mme Magomadova demanda la garde de son fils en février 2014, après que le père de celui-ci eut emmené l’enfant à Grozny, en Tchétchénie. Se fondant principalement sur un rapport favorable établi au sujet du père par les services locaux de l’enfance, le tribunal de district rejeta la demande de garde déposée par Mme Magomadova et accorda la garde de l’enfant au père, bien que celui-ci ne l’eût pas demandée. Cette décision fut confirmée en appel en juillet 2014 et le pourvoi en cassation formé par Mme Magomadova fut rejeté en novembre 2014. Auparavant, en septembre 2014, les services de l’enfance avaient écrit à Mme Magomadova pour lui faire savoir que le fonctionnaire des services de l’enfance qui avait rédigé le rapport élogieux concernant le père de l’enfant avait fait l’objet de mesures disciplinaires après qu’il était apparu que ce rapport contenait des informations incorrectes et incomplètes. En particulier, les déclarations par lesquelles le père avait prétendu percevoir un revenu élevé n’avaient pas été vérifiées et l’assertion selon laquelle Mme Magomadova n’avait pas pris part à l’éducation de l’enfant ne reposait sur aucune preuve. Le père décéda dans un accident de voiture en décembre 2014 et l’enfant fut restitué à Mme Magomadova en 2016.
Réponse de la CEDH
Article 8
La Cour note que les autorités et les juridictions nationales se trouvent souvent face à une tâche très délicate lorsqu’elles doivent décider auquel des deux parents confier la garde d’un enfant, et que dans les présentes affaires la justice ne pouvait pas ordonner une résidence partagée. Dans l’affaire de M. Leonov, la Cour ne décèle aucune raison de douter que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui a dicté les décisions des juridictions nationales. Rien n’indique que les constats établis par les tribunaux russes, lesquels étaient directement en contact avec les deux parents, aient présenté un caractère déraisonnable et que ces tribunaux aient donc outrepassé l’ample marge de manœuvre (« marge d’appréciation ») qui leur était consentie dans ce domaine. De plus, la Cour conclut que l’attribution de la garde s’est appuyée sur une appréciation des circonstances de la cause plutôt que sur une quelconque conviction judiciaire voulant que la place de l’enfant fût auprès de sa mère. La procédure a été contradictoire et M. Leonov a pu faire valoir ses arguments. Dans l’ensemble, il n’y a pas eu violation de ses droits. La Cour aboutit à une conclusion différente dans le cas de Mme Magomadova. Elle dit que dans pareilles affaires elle doit rechercher si les juridictions nationales ont examiné de manière approfondie la situation familiale dans son ensemble ainsi que tous les facteurs pertinents. Pour commencer, elle prend note de l’argument avancé par le Gouvernement selon lequel les juridictions nationales ont tenu compte des traditions tchétchènes, qui commandent que les enfants d’un couple séparé soient en règle générale élevés par la famille du père. Mme Magomadova a elle aussi fait référence à cet argument, pour mettre en évidence une discrimination à son endroit. La Cour estime toutefois que l’argument évoqué par le Gouvernement n’est pas étayé par les décisions des autorités nationales et elle l’exclut donc de son examen. Par ailleurs, la Cour considère que les juridictions internes ont déduit que, parce que Mme Magomadova travaillait et élevait seule ses deux enfants, elle n’aurait pas été en mesure de s’occuper correctement de son fils. Les tribunaux russes ont de plus écarté des facteurs tels que les conditions de vie et la situation financière de chacun des parents parce qu’ils ne les jugeaient pas décisifs et ils n’ont pas examiné d’autres éléments qui auraient pu être pertinents. Dans leur appréciation, ils n’ont absolument pas inclus le fait que le père avait des antécédents judiciaires, ils n’ont pas pris en compte la durée pendant laquelle l’enfant avait vécu respectivement chez son père et chez sa mère et ils ne se sont pas non plus demandé s’il souffrirait d’être séparé de sa demi-sœur. En outre, les juridictions nationales se sont contentées de prendre acte du rapport dressé par les services de l’enfance à propos du cas de Mme Magomadova sans vérifier s’il avait été élaboré correctement. On apprit plus tard que ce rapport n’était pas conforme à la réalité et que les informations qu’il contenait avaient été communiquées par le père et n’avaient pas été vérifiées.
Dans l’ensemble, l’examen de l’affaire de Mme Magomadova mené par les juridictions nationales n’a pas été assez minutieux, et le processus de décision a été entaché de carences et n’a pas permis d’établir l’intérêt supérieur de l’enfant. Il y a donc eu violation des droits de Mme Magomadova.
Autres articles
La Cour dit qu’il n’y a pas eu violation des droits de M. Leonov protégés par l’article 14 combiné avec l’article 8 car l’intéressé n’a pas été victime d’une différence de traitement à raison de son sexe, que ce fût en droit ou dans l’examen des circonstances particulières de son affaire. Elle note également que l’article 5 du Protocole n o 7 impose aux États de prévoir un cadre juridique satisfaisant pour assurer l’égalité des droits entre les époux dans des domaines tels que les relations avec leurs enfants. Cependant, M. Leonov n’a pas remis en cause le cadre juridique, mais simplement la manière dont les juridictions nationales l’ont appliqué, de sorte que son grief est manifestement mal fondé. La Cour rejette pour défaut manifeste de fondement le grief présenté par Mme Magomadova sous l’angle de l’article 13, estimant que l’intéressée a été en mesure d’exercer un recours interne, à savoir le dépôt d’une demande de garde. Elle a par ailleurs eu la possibilité de demander la réouverture de son affaire dès lors qu’il est apparu que le rapport établi par les services de l’enfance était erroné, mais elle s’en est abstenue.
N.Ts. c. Géorgie du 2 février 2016 requête no 71776/12
Les tribunaux n’auraient pas dû ordonner le retour contre leur volonté de trois enfants auprès de leur père
En février 2012, la cour d’appel annula sa décision et conclut que les enfants devaient vivre auprès de leur père. Les tantes et grands-parents maternels interjetèrent appel mais furent déboutés par la Cour suprême en mai 2012. Toutefois, la décision n’a toujours pas été exécutée, en raison du refus des enfants de s’installer auprès de leur père et de l’échec de deux tentatives en ce sens.
À la suite du décès de leur mère – la soeur de Mme Ts. –, survenu en novembre 2009, les garçons s’installèrent auprès de leurs tantes et de leurs grands-parents maternels. Leur père, G.B., suivait alors un traitement pour addiction aux stupéfiants ; il avait précédemment été condamné pour consommation de drogue.
Début 2010, G.B. entama une procédure judiciaire afin d’obtenir le retour de ses fils auprès de lui. Le tribunal de Tbilissi demanda à l’Agence des services sociaux de désigner un représentant pour la protection des intérêts des enfants. En mai 2010, le tribunal ordonna le retour des garçons auprès de leur père. Prenant en considération le dernier compte rendu médical relatif à G.B., qui indiquait une addiction en phase de rémission et l’absence de pathologie psychiatrique, le tribunal parvint à la conclusion que G.B. était apte à recouvrer ses responsabilités parentales. En parallèle, le juge compétent écarta pour défaut de fiabilité un rapport sur la santé psychologique des enfants qui – constatant qu’ils souffraient de troubles liés à une angoisse de séparation et montraient une attitude négative vis-à-vis de leur père – recommandait le maintien inchangé de leur cadre de vie.
Article 8 – sur le fond
Sur la question de savoir si les enfants ont été dûment associés à la procédure, le Gouvernement indique qu’ils ont été entendus par le biais du représentant qui leur avait été attribué par l’Agence des services sociaux. La Cour observe toutefois que cet organe n’a été formellement associé à la procédure qu’à partir du stade de l’appel. Il a participé à la procédure d’appel en qualité de « partie intéressée », statut dont aucune disposition du code de procédure civile géorgien ne définit les droits procéduraux. Il est donc malaisé de déterminer comment l’Agence aurait pu représenter de manière effective les intérêts des enfants sans avoir de rôle procédural formel. Si l’Agence a été désignée pour représenter les intérêts des enfants en vertu du code civil, les implications précises de cette représentation demeurent ambigües, car la législation pertinente n’expose pas les fonctions et pouvoirs du représentant. En pratique, pendant la période de plus de deux ans qu’a duré la procédure dans la cause des requérants, les représentants de l’Agence n’ont rencontré les enfants que de rares fois aux fins de la rédaction de comptes rendus sur leurs conditions de vie et leur état psychologique, mais aucun contact régulier n’a été maintenu dans l’optique d’un suivi et de l’établissement d’une relation de confiance avec les enfants.
Dans ce contexte, la Cour renvoie aux recommandations de plusieurs organes internationaux, notamment aux Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, qui préconise qu’en cas de conflit d’intérêt entre les parents et les enfants, il soit désigné un représentant indépendant chargé de représenter les points de vue de l’enfant et d’informer celui-ci du contenu de la procédure. La Cour ne voit pas comment l’Agence des services sociaux pourrait passer pour une représentation adéquate au regard de ces critères. De plus, en dépit des normes internationales pertinentes, les juridictions nationales n’ont pas envisagé la possibilité d’associer directement l’aîné des garçons à la procédure.
La décision des juridictions nationales reposait principalement sur deux motifs, à savoir que l’intérêt supérieur des enfants était de retrouver leur père et que la famille maternelle exerçait une influence négative sur les enfants. La Cour admet ces motifs mais note également que les juridictions nationales n’ont pas adéquatement pris en considération cet élément important : les enfants ne souhaitaient pas retourner auprès de leur père. Quel qu’ait été le rôle manipulateur de la famille maternelle vis-à-vis de G.B. – facteur qui d’après certains rapports a contribué à façonner la relation entre les garçons et leur père –, les juridictions nationales disposaient d’éléments sans équivoque concernant l’attitude hostile des garçons à l’égard de G.B. De plus, des rapports de psychologues avaient alerté sur les risques qui pourraient peser sur la santé psychologique des enfants si ceux-ci étaient renvoyés de force auprès de leur père. Dans ces conditions, ordonner une mesure si radicale sans envisager de transition adéquate semble avoir été contraire à leur intérêt supérieur.
La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 8 en raison d’une défaillance dans le processus décisionnel, exacerbée par un examen inadéquat et unilatéral de l’intérêt supérieur des enfants.
Arrêt Palau-Martinez C. France du 16/12/2003 requête 64927/01 Hudoc 4829
"§42: La Cour d'appel n'a pas cru devoir accéder à la demande de la requérante de faire procéder à une enquête sociale, pratique courante en matière de garde d'enfants; or celle-ci aurait sans doute permis de réunir des éléments concrets sur la vie des enfants avec l'un et l'autre de leurs parents, et sur les incidences éventuelles de la pratique religieuse de leur mère (témoin de Jéhovah) sur leur vie et sur leur échec, pendant des années où ils avaient vécu avec elle après le départ de leur père. La Cour estime dès lors qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est prononcée in abstrato et en fonction de considérations de caractère général, sans établir de lien entre les conditions de vie des enfants auprès de leur mère et leur intérêt réel. Cette motivation, bien que pertinente, n'apparaît pas suffisante aux yeux de la Cour.
§43: Dans ces conditions, la Cour ne peut conclure à l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Dès lors, il y a eu violation de l'article 8 combiné avec l'article 14 de la Convention"
ARRÊT GRANDE CHAMBRE
NEULINGER ET SHURUK c. SUISSE DU 6 JUILLET 2010 REQUÊTE 41615/07
Les requérants sont Isabelle Neulinger et son fils Noam Shuruk, des ressortissants suisses, nés respectivement en 1959 et 2003 et résidant à Lausanne (Suisse, canton de Vaud). En 1999, Madame Neulinger s’établit en Israël où elle épousa Shai Shuruk en 2001. Leur fils Noam naquit en 2003 à Tel Aviv. Devant les craintes de la mère d’un enlèvement de l’enfant par son père dans une communauté « Loubavitch-Habad » – la requérante décrit le mouvement Loubavitch comme ultra-orthodoxe, radical et pratiquant un prosélytisme intense –, le tribunal des affaires familiales de Tel Aviv prononça en 2004 une interdiction de sortie du territoire israélien pour Noam jusqu’à sa majorité. La garde provisoire de l’enfant fut attribuée à la requérante, et l’autorité parentale confiée conjointement aux deux parents. Le droit de visite du père fut ultérieurement restreint en raison de la nature menaçante de son comportement.
En février 2005 le divorce des époux fut prononcé, et en juin la requérante quitta clandestinement Israël pour la Suisse avec son fils. Dans une décision du 30 mai 2006, rendue sur requête du père de l’enfant, le tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv constata que Noam avait sa résidence habituelle à Tel Aviv et que les parents détenaient conjointement l’autorité parentale sur lui. Le tribunal conclut que le déplacement de l’enfant hors du territoire israélien sans l’accord du père constituait un acte illicite au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (« La Convention de La Haye »).
Par une décision du 29 août 2006, la Justice de paix du district de Lausanne rejeta la requête du père en vue de voir ordonner le retour de son fils en Israël, au motif qu’il existait un risque grave pour Noam d’être exposé à un danger psychique ou physique ou à une situation intolérable en cas de retour en Israël. Le tribunal du canton de Vaud rejeta le recours du père au motif qu’il s’agissait d’un cas d’exception au principe du retour immédiat de l’enfant, conformément à l’article 13 alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye.
Le 16 août 2007 le Tribunal fédéral admit le recours du père qui invoquait une mauvaise application de cet article, et ordonna à la requérante d’assurer le retour de l’enfant en Israël.
En février 2009, les requérants adressèrent à la Cour européenne des droits de l’homme le certificat d’un médecin ayant vu Noam en 2005, et à plusieurs reprises depuis, attestant qu’ « Un retour brutal en Israël sans sa mère constituerait un traumatisme important et une perturbation psychologique grave pour cet enfant. »
Par une ordonnance de mesures provisionnelles en date du 29 juin 2009, le tribunal d’arrondissement de Lausanne, sur demande de la requérante, fixa le domicile de Noam chez sa mère, suspendit le droit de visite du père sur son fils et attribua l’autorité parentale à la mère, pour lui permettre de renouveler les papiers d’identité de l’enfant.
LA CEDH IMPOSE L'INTERET DE L'ENFANT AU DROIT DU PERE
α) Principes généraux
131. La Convention ne doit pas être interprétée isolément mais en harmonie avec les principes généraux du droit international. Il convient en effet, en vertu de l'article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, de tenir compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties », en particulier celles relatives à la protection internationale des droits de l'homme (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, série A no 18, § 29, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH 2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI).
132. En matière d'enlèvement international d'enfants, les obligations que l'article 8 fait peser sur les Etats contractants doivent dès lors s'interpréter notamment en tenant compte de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, § 51, CEDH 2003-V, et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 95, CEDH 2000-I) et de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Maire, précité, § 72). La Cour s'est, par exemple, à plusieurs reprises inspirée de la Convention de La Haye, en particulier de son article 11, lorsqu'elle a été confrontée à la question de savoir si les autorités judiciaires ou administratives saisies d'une demande de retour d'un enfant ont procédé avec la rapidité et la diligence nécessaires, toute inaction d'une durée qui excède six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation (voir, pour le texte de cette disposition, paragraphe 57 ci-dessus et, pour des cas d'application, les arrêts Carlson c. Suisse, no 49492/06, § 76, CEDH 2008-..., Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, Monory, précité, § 82, et Bianchi, précité, § 94).
133. Toutefois, la Cour doit également tenir compte de la nature particulière de la Convention, instrument de l'ordre public européen pour la protection des êtres humains, et de sa propre mission, fixée à l'article 19, consistant à "assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes" à la Convention (voir, parmi d'autres, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, § 93, série A no 310). C'est pourquoi elle est compétente pour contrôler la procédure suivie devant les tribunaux internes, en particulier pour rechercher si, dans l'application et l'interprétation de la Convention de La Haye, ceux-ci ont respecté les garanties de la Convention, notamment de son article 8 (dans ce sens Bianchi, précité, 92, et Carlson, précité, § 73).
134. Dans ce domaine, le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge d'appréciation dont jouissent les États en la matière (Maumousseau et Washington, précité, § 62), en tenant compte toutefois de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer la considération déterminante (dans ce sens Gnahoré c. France, no 40031/98, § 59, CEDH 2000-IX), comme en atteste d'ailleurs le Préambule de la Convention de La Haye selon lequel « l'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa garde ». L'intérêt supérieur de l'enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l'emporter sur celui des parents (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 66, CEDH 2003-VIII). L'intérêt de ces derniers, notamment à bénéficier d'un contact régulier avec l'enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (ibid., et Haase c. Allemagne, no 11057/02, § 89, CEDH 2004-III (extraits), ou Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 58, CEDH 2002-I, avec les nombreuses références citées).
135. La Cour note qu'il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l'idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, ci-dessus, les multiples références citées dans les paragraphes 49-56, et notamment l'article 24 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). Comme l'indique par exemple la Charte, « tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
136. L'intérêt de l'enfant présente un double aspect. D'une part, il prévoit que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne. En conséquence, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent en principe conduire à une rupture du lien familial et tout doit être mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille (Gnahoré c. France, précité, § 59). D'autre part, il est certain que garantir à l'enfant une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l'article 8 ne saurait autoriser un parent à prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant (voir, parmi d'autres, Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 50, CEDH 2000-VIII, et Maršálek c. République tchèque, no 8153/04, § 71, 4 avril 2006).
137. La même philosophie se trouve à la base de la Convention de La Haye, qui prévoit en principe le retour immédiat d'un enfant enlevé sauf en cas de risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (article 13, alinéa premier, lettre b)). En d'autres termes, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant est sous-jacente également à la Convention de La Haye. D'ailleurs, certaines juridictions nationales ont expressément intégré cette notion dans l'application du terme « risque grave » au sens de l'article 13, alinéa premier, lettre b), de cette convention (paragraphes 58-64 ci-dessus). Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l'article 13 doit être interprété en conformité avec la Convention.
138. Il découle de l'article 8 que le retour de l'enfant ne saurait être ordonné de façon automatique ou mécanique dès lors que la Convention de La Haye s'applique. L'intérêt supérieur de l'enfant, du point de vue de son développement personnel, dépend en effet de plusieurs circonstances individuelles, notamment de son âge et de sa maturité, de la présence ou de l'absence de ses parents, de l'environnement dans lequel il vit et de son histoire personnelle (voir les lignes directrices du HCR, paragraphe 52 ci-dessus). C'est pourquoi il doit s'apprécier au cas par cas. Cette tâche revient en premier lieu aux autorités nationales, qui ont souvent le bénéfice de contacts directs avec les intéressés. Elles jouissent pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, laquelle s'accompagne toutefois d'un contrôle européen en vertu duquel la Cour examine sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de ce pouvoir (voir, par exemple, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55, et Kutzner précité, §§ 65-66 ; voir également Tiemann c. France et Allemagne, (déc.), nos 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000-IV, Bianchi, précité, § 92, et Carlson, précité, § 69).
139. En outre, la Cour doit s'assurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse a été équitable et qu'il a permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits (Tiemann, précité, et Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), no 14600/05, CEDH 2005-XIII (extraits)). Pour ce faire, elle doit vérifier si les juridictions nationales se sont livrées à un examen approfondi de l'ensemble de la situation familiale et de toute une série d'éléments, d'ordre factuel, affectif, psychologique, matériel et médical notamment, et si elles ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun, avec le souci constant de déterminer quelle était la meilleure solution pour l'enfant enlevé dans le cadre d'une demande de retour dans son pays d'origine (Maumousseau et Washington, précité, § 74).
140. La Cour a déjà eu à examiner la question de savoir si les conditions d'exécution d'une mesure de retour d'un enfant étaient compatibles avec l'article 8 de la Convention. Elle a défini ainsi les obligations incombant aux Etats à cet égard dans l'affaire Maumousseau et Washington (arrêt précité, § 83) :
« Si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, la Cour rappelle qu'il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. S'agissant de l'obligation pour l'Etat d'arrêter des mesures positives, l'article 8 implique le droit d'un parent – en l'occurrence le père – à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide précité, § 94). Toutefois, cette obligation n'est pas absolue, car il arrive que la réunion d'un parent avec ses enfants ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l'étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. En outre, lorsque des difficultés apparaissent, dues principalement au refus du parent avec lequel se trouve l'enfant de se soumettre à l'exécution de la décision ordonnant son retour immédiat, il appartient aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner ce manque de coopération et, si des mesures coercitives à l'égard des enfants ne sont pas, en principe, souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l'enfant (Maire précité, § 76). Enfin, dans ce genre d'affaire, le caractère adéquat d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre : les procédures relatives à l'attribution de l'autorité parentale, y compris l'exécution de la décision rendue à leur issue, appellent en effet un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. La Convention de La Haye le reconnaît d'ailleurs, en prévoyant un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus de façon illicite dans tout Etat contractant. Aux termes de l'article 11 de cette convention, les autorités judiciaires ou administratives saisies doivent ainsi procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant, tout retard pour agir dépassant six semaines pouvant donner lieu à une demande d'explication (Maire précité, § 74). »
β) Application de ces principes au cas d'espèce
141. La Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes dans l'examen de la question de savoir si l'enfant serait confronté à un risque grave de danger psychique, au sens de l'article 13 de la Convention de La Haye, en cas de retour en Israël. En revanche, elle est compétente pour rechercher si les tribunaux internes, dans l'application et l'interprétation des dispositions de cette convention, ont respecté les garanties de l'article 8 de la Convention, en tenant notamment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
142. La Cour note que les juridictions nationales saisies du
dossier n'ont pas été unanimes quant à la suite à lui donner. Ainsi, le 29 août
2006, le juge de paix du district de Lausanne rejeta la requête du père tendant
au retour de l'enfant, estimant qu'il se trouvait dans un cas d'application de
l'article 13, alinéa premier, lettre b), de la Convention de La Haye (paragraphe
36 ci-dessus). Le 22 mai 2007, cette décision fut confirmée en substance par la
chambre des tutelles du tribunal cantonal du canton de Vaud (paragraphe 41
ci-dessus). En revanche, le 16 août 2007, le Tribunal fédéral admit le recours
du père et ordonna le retour de Noam. Selon lui, on chercherait en vain dans le
jugement cantonal la preuve d'un risque grave de danger ou de situation
intolérable pour l'enfant, dans l'hypothèse
– acceptable, d'après le Tribunal – où la mère rentrerait en Israël (paragraphe
44 ci-dessus). Enfin, le 29 juin 2009, le président du tribunal d'arrondissement
de Lausanne prit une ordonnance de mesures provisionnelles fixant le domicile de
Noam chez sa mère à Lausanne, suspendant le droit de visite du père sur son fils
et attribuant à titre exclusif l'autorité parentale à la mère. Il observa
notamment que ni le père ni son avocat ne s'étaient jamais présentés aux
audiences devant ce tribunal et estima que, dès lors, le père s'était
désintéressé de la cause (paragraphe 47 ci-dessus).
143. Par ailleurs, plusieurs rapports d'expertise ont conclu à l'existence d'un danger pour l'enfant en cas de retour en Israël. D'après le premier, rendu le 16 avril 2007 par le docteur B., le retour de l'enfant en Israël avec sa mère l'aurait exposé à un danger psychique dont l'intensité ne pouvait être évaluée sans connaître les conditions de cet éventuel retour, en particulier celles qui seraient réservées à la mère et les répercussions qu'elles pourraient avoir sur l'enfant. Quant au retour de l'enfant sans sa mère, il l'aurait également exposé à un danger psychique majeur (paragraphe 37 ci-dessus). Le second rapport, établi le 23 février 2009 par le docteur M.-A., conclut au fait qu'un retour brutal de Noam en Israël sans sa mère constituerait un traumatisme important et une perturbation psychologique grave pour l'enfant (paragraphe 46 ci-dessus).
144. Il semble donc qu'aux yeux des juridictions et experts nationaux, en tout état de cause seul un retour de Noam avec sa mère soit envisageable. Même le Tribunal fédéral, seule juridiction nationale à avoir ordonné le retour de l'enfant, a fondé sa décision sur la considération qu'en l'absence de motifs qui justifieraient objectivement un refus de la mère de rentrer en Israël, on pouvait raisonnablement attendre de celle-ci qu'elle retourne dans cet Etat avec l'enfant. Il convient dès lors de déterminer si cette conclusion se justifie sur le terrain de l'article 8, c'est-à-dire si le retour forcé de l'enfant, accompagné de sa mère, qui semble pourtant exclure cette éventualité, représenterait une ingérence proportionnée dans le droit au respect de la vie familiale de chacun des requérants.
145. Même si des doutes à ce sujet peuvent paraître justifiés, la Cour est prête à admettre qu'en l'espèce, la mesure en question entre encore dans la marge d'appréciation des autorités nationales en la matière. Toutefois, pour juger du respect de l'article 8, il convient de tenir compte aussi des développements qui se sont produits depuis l'arrêt du Tribunal fédéral ordonnant le retour de l'enfant (voir, mutatis mutandis, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, 24 avril 2003). La Cour doit en effet se placer au moment de l'exécution de la mesure litigieuse (voir, mutatis mutandis, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 91, CEDH 2008-...). Si celle-ci intervient un certain temps après l'enlèvement de l'enfant, cela peut affecter notamment la pertinence en la matière de la Convention de La Haye, qui est essentiellement un instrument de nature procédurale, et non un traité relatif à la protection des droits de l'homme, protégeant les individus de manière objective. D'ailleurs, selon l'article 12, alinéa deuxième, de cette Convention, l'autorité judiciaire ou administrative saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa premier doit certes ordonner le retour de l'enfant, mais à condition qu'il ne soit pas établi que celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu (voir, dans ce sens, Koons c. Italie, no 68183/01, §§ 51 et suiv., 30 septembre 2008).
146. La Cour estime qu'elle peut s'inspirer ici, mutatis mutandis, de sa jurisprudence sur l'expulsion des étrangers (Maslov, précité, § 71, et Emre c. Suisse, no 42034/04, § 68, 22 mai 2008) en vertu de laquelle, pour apprécier la proportionnalité d'une mesure d'expulsion visant un mineur intégré dans le pays d'accueil, il y a lieu de prendre en compte son intérêt et son bien-être, en particulier la gravité des difficultés qu'il est susceptible de rencontrer dans le pays de destination, ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, d'une part, et avec le pays de destination, d'autre part. Entre également en ligne de compte la gravité des difficultés que l'un des membres de la famille de la personne menacée de l'expulsion risque de rencontrer dans le pays vers lequel elle doit être expulsée (dans ce sens Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 57, CEDH 2006-XII).
147. S'agissant de Noam, la Cour note qu'il a la nationalité suisse et qu'il est arrivé dans le pays en juin 2005, à l'âge de deux ans. Il y vit depuis lors sans interruption. Aux dires des requérants, il y est parfaitement intégré et y fréquente depuis 2006 une garderie laïque municipale et une garderie israélite privée agréée par l'Etat. Par ailleurs, il est scolarisé en Suisse et parle le français (voir l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2009, paragraphe 47 ci-dessus). Même s'il est vrai qu'il est encore à un âge où la faculté d'adaptation est encore grande, le fait d'être une nouvelle fois déraciné de son milieu habituel aurait sans doute des conséquences graves pour lui, en particulier s'il rentrait seul, comme cela ressort des rapports médicaux. Son retour en Israël ne saurait donc être considéré comme bénéfique.
148. Dès lors, le trouble important que le retour forcé du requérant risque de provoquer dans son esprit doit être pesé par rapport au bénéfice qu'il est susceptible d'en retirer. A cet égard, il y a lieu de relever, avec le tribunal d'arrondissement, que des restrictions avaient été imposées par les tribunaux israéliens, dès avant l'enlèvement de l'enfant, au droit de visite du père, lequel ne fut plus autorisé à le voir que deux fois par semaine, sous la surveillance des services sociaux, dans un centre de contact de Tel Aviv (paragraphe 47 ci-dessus). Par ailleurs, selon les requérants, non contredits par le Gouvernement, le père de Noam se serait remarié le 1 er novembre 2005 et aurait divorcé quelques mois plus tard seulement, alors que sa nouvelle épouse était enceinte. Il aurait ensuite contracté une troisième union. Il aurait à nouveau été poursuivi en 2008, par sa deuxième épouse cette fois, pour non-paiement d'une pension alimentaire pour sa fille. La Cour doute que de telles circonstances, à les supposer avérées, soient bénéfiques au bien-être et au développement de l'enfant.
149. Quant aux inconvénients qu'un retour représenterait pour la mère, elle pourrait être exposée à un risque de sanctions pénales, dont l'ampleur reste toutefois à déterminer. Les requérants ont invoqué devant la Cour la lettre de l'autorité centrale israélienne, du 30 avril 2007, dont il ressort que l'éventuelle renonciation par les autorités israéliennes à des poursuites pénales serait soumise à plusieurs conditions liées au comportement de la requérante (paragraphe 40 ci-dessus). Dans ces conditions, de telles poursuites, qui le cas échéant pourraient donner lieu à une peine d'emprisonnement, ne sont pas à exclure entièrement (voir, a contrario, Paradis et autres c. Allemagne, no 4783/03, (déc.), 15 mai 2003). Il est évident qu'un tel scénario ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, pour lequel la requérante représente sans doute la seule personne de référence.
150. Aussi le refus de la mère de retourner en Israël n'apparaît-il pas entièrement injustifié. Possédant la nationalité suisse, elle a le droit de rester dans ce pays. A supposer même qu'elle consente à retourner en Israël, se pose la question de savoir qui prendrait en charge l'enfant dans l'hypothèse où la requérante serait poursuivie, puis incarcérée. Il est permis de douter des capacités du père de le faire, compte tenu de son passé et du caractère limité de ses ressources financières. Il n'a jamais habité seul avec l'enfant et ne l'a pas vu depuis son départ.
151. En conclusion, et à la lumière de toutes ces considérations, notamment des changements ultérieurs dans la situation des intéressés, exprimés en particulier dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2009, la Cour n'est pas convaincue qu'il soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant de retourner en Israël. Quant à la mère, elle subirait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale si elle était contrainte de rentrer en Israël. En conséquence, il y aurait violation de l'article 8 de la Convention dans le chef des deux requérants si la décision ordonnant le retour en Israël du second était exécutée.
Diamante et Pelliccioni c. Saint-Marin requête no 32250/08 du 27 septembre 2011
La procédure d'attribution du droit de garde devant les juridictions saint-marinaises a respecté la vie familiale d'une mère italienne et de sa fille
Article 8
La Cour décide d’examiner le grief fondé sur l'article 6 dans le cadre de celui soulevé sur le terrain de l'article 8, les deux étant étroitement rattachés.
Les parties ne contestent pas que les décisions du juge national sur l'attribution de la garde et les droits de visite constituent une ingérence dans la vie familiale des requérantes qui était prévue par la loi. En outre, la Cour considère que ces mesures poursuivaient le but légitime de la protection des droits et libertés de l'enfant et de sesparents.
Sur le point de savoir si les juridictions internes ont fondé leur décision sur des motifs pertinents, la Cour constate qu'elles ont constamment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que d’éléments tels que la relation entre les parents et les problèmes inhérents à la garde partagée dans les cas où un parent est hostile envers l'autre. Le juge s'est appuyé sur des rapports détaillés du service de l'enfance, fruits d'un suivi constant.
Il est raisonnable, aux yeux de la Cour, que les juridictions internes aient jugé nécessaire pour la protection des intérêts de l'enfant non pas de s’en tenir à la garde unique en faveur de Mme Diamante mais d’ordonner la garde partagée. Il ne semble pas non plus illogique d'avoir opté pour la résidence chez le père. Les juridictions internes n’ont pas exclu un changement de régime si les circonstances l'imposent.
La Cour souligne que, bénéficiant de rapports directs avec les intéressés, les autorités nationales sont mieux placées que le juge international pour apprécier les besoins en cause. Les mesures adoptées en l’espèce ne semblent pas manifestement arbitraires ou injustes. Aussi la Cour n'a-t-elle pas à examiner dans le détail les modalités de visite les mieux indiquées. Il lui suffit de relever qu’il n’y a pas eu de déni des droits des intéressés, les requérantes ayant maintenu entre elles un contact constant et régulier, et la mère ayant conservé la garde partagée.
Si la surveillance et certaines restrictions quant au choix du lieu des visites ont dû limiter dans une certaine mesure les contacts entre la mère et sa fille ainsi que la possibilité pour elles de développer leurs liens, la Cour considère que la surveillance par le service de l'enfance était nécessaire pour permettre au juge national de rendre une décision avisée. En revanche, elle rejette la thèse du gouvernement saint-marinaise assimilant ces limitations à des mesures de précaution nécessaires contre le risque d'enlèvement de sa fille par Mme Diamante, étant donné notamment qu'elle a remis le passeport de sa fille quand on le lui avait demandé.
Par ailleurs, rien ne prouve que, comme l’allègue Mme Diamante, le service de l'enfance ait fait preuve d'impartialité et n’eût pas les qualités requises. Bien que l'article 8 n'impose expressément aucune exigence procédurale, la Cour doit rechercher si le processus de décision, dans son ensemble, a protégé comme il convenait les intérêts de Mme Diamante. Cette dernière a été représentée par des avocats tout au long de la procédure et a eu la possibilité d'exposer ses arguments. Quant à l'audience qui a conduit à la décision de février 2008 sur le droit de garde, la Cour considère que, Mme Diamante ayant été représentée au départ et eu la possibilité de plaider sa cause, sa participation ne peut passer pour ineffective. Dans les affaires concernant le lien entre une personne et son enfant, il y a un risque que l'écoulement du temps ait pour effet de trancher le litige par un fait accompli. La Cour juge donc raisonnable le refus d’ajournement de l’audience prononcé par les juridictions internes.
Quant au grief tiré de la durée de la procédure, si elle juge répréhensible qu'il a fallu trois ans pour statuer sur le recours formé contre la décision concernant le droit de garde, la Cour constate que plusieurs ordonnances ont été rendues et plusieurs accords conclus dans l'intervalle, que les droits de visite de Mme Diamante ont été régulièrement conservés et que le calendrier des visites a été modifié régulièrement. Il n'y a eu aucune période importante d'inactivité. La Cour considère donc que, globalement, les juridictions internes semblent avoir conduit la procédure avec la diligence voulue. Par ailleurs, bien que Mme Diamante se fût vu initialement refuser l'accès aux pièces du dossier, en particulier aux enregistrements vidéo de ses visites à sa fille, les éléments pertinents ont été ultérieurement mis à sa disposition.
La Cour en conclut à l'absence de violation de l'article 8.
ILKER ENSAR UYANIK c. TURQUIE du 3 mai 2012 requête n° 60328/09
La Décision de non-retour d’un enfant auprès de son père aux Etats-Unis prise sans examen approfondi, a violé la convention.
47. A titre liminaire, la Cour estime utile de préciser que son examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention se limitera aux seuls manquements dont elle se trouve saisie, à savoir ceux qui concernent la procédure judiciaire relative à la détermination par les juridictions nationales du retour ou non-retour de la fille du requérant aux Etats-Unis.
48. La Cour note ensuite qu’il n’est pas contesté que le lien entre le requérant et sa fille mineure relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, lequel est donc applicable en l’espèce. Reste dès lors à déterminer si les circonstances dénoncées par le requérant révèlent un manquement à cette disposition.
49. A cet égard, la Cour souligne avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur les obligations positives que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent à ses enfants. Elle a ainsi déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 impliquait le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de prendre celles-ci (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I). Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue. La nature et l’étendue de celles-ci dépendent des circonstances de chaque espèce (Ignaccolo-Zenide, précité, § 94).
50. La Cour rappelle en outre que, lorsque la Convention de La Haye est invoquée pour fonder le retour d’un enfant, celle-ci ne s’applique pas de manière automatique ou mécanique ; elle en veut pour preuve la reconnaissance par cet instrument de plusieurs exceptions à l’obligation de retour assumée par les Etats membres, qui reposent sur des considérations objectives relatives à la personne même de l’enfant et à son environnement, ce qui montre qu’il incombe à la juridiction saisie d’adopter une approche in concreto de l’affaire (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 72, 6 décembre 2007).
51. La Cour rappelle de surcroît que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne. Il en va de même lorsque le droit interne renvoie à des règles de droit international ou à des accords internationaux. Le rôle de la Cour se limite à vérifier leur applicabilité et la compatibilité avec la Convention de l’interprétation qui en est faite (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I et Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 133, CEDH 2010).
52. Dans ce domaine, le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les Etats en la matière (Maumousseau et Washington, précité, § 62), l’intérêt supérieur de l’enfant devant toutefois constituer la considération déterminante (Neulinger et Shuruk, précité, § 134). Cela étant, l’intérêt des parents, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (ibidem, § 134).
53. La Cour réitère aussi que l’intérêt de l’enfant doit s’apprécier au cas par cas et que cette tâche revient en premier lieu aux autorités nationales, lesquelles bénéficient souvent de rapports directs avec les intéressés. Elle doit toutefois s’assurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse a été équitable et qu’il a permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits (ibidem, § 139). Pour ce faire, elle doit vérifier si les juridictions nationales se sont livrées à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale et de toute une série d’éléments, d’ordre factuel, affectif, psychologique, matériel et médical notamment, et si elles ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts de chacun, avec le souci constant de déterminer quelle était la meilleure solution pour l’enfant enlevé dans le cadre d’une demande de retour dans son pays d’origine (Maumousseau et Washington, précité, § 74, et Neulinger et Shuruk, précité, § 139).
54. En l’espèce, la Cour souligne d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités nationales pour prononcer un éventuel retour de Yasemin Nur aux Etats-Unis, sur le fondement de la Convention de La Haye, comme le lui demande l’intéressé (paragraphe 29 ci-dessus). De même, elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes dans l’examen de la question de savoir si le non-retour de Yasemin Nur aux Etats-Unis était ou non illicite au sens de la Convention de La Haye (Karoussiotis, précité, § 87). Comme elle l’a déjà rappelé (paragraphe 51 ci-dessus), lorsque le droit interne renvoie à des règles du droit international général ou à des accords internationaux, son rôle se limite à vérifier leur applicabilité et la compatibilité à la Convention de l’interprétation qui en faite. En revanche, la Cour est compétente pour contrôler la procédure suivie devant les tribunaux internes, et rechercher si les raisons censées justifier les mesures effectivement adoptées quant à la jouissance par le requérant de son droit au respect de sa vie familiale sont pertinentes et suffisantes au regard de l’article 8 (Bianchi, précité, § 77).
55. La Cour observe que dans les circonstances de l’espèce, les juridictions nationales ont statué au terme d’une procédure au cours de laquelle le requérant était représenté par un avocat, a pu présenter ses arguments et ses moyens de preuve et contester ceux soumis par la partie adverse. Cela étant, elle relève que le requérant met en cause les critères pris en compte par ces juridictions pour fonder leur décision, soutenant qu’ils seraient contraires aux principes énoncés dans la Convention de La Haye et à la position adoptée par la Cour de cassation dans des affaires similaires.
56. A cet égard, la Cour souligne que le tribunal de la famille d’İzmir a statué en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et qu’il a jugé que c’était dans l’intérêt de l’enfant de rester avec sa mère. Ce tribunal a en outre estimé que la domiciliation de la fille du requérant en Turquie était possible au regard du droit turc, lequel ne ferait aucunement obligation à la mère de l’enfant de vivre avec sa fille aux Etats-Unis (paragraphe 18 ci-dessus).
57. En dépit de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la décision de rejet de la demande de retour de l’enfant a été adoptée par les juridictions internes en application des principes définis dans la Convention de La Haye, la Cour observe, à la lecture des décisions de ces juridictions, que les seuls critères qui apparaissent avoir pesé en l’espèce sont ceux de l’âge de l’enfant et de son besoin d’attention et d’affection maternelles en découlant (paragraphe 18 ci-dessus).
58. En effet, alors même que le procureur de la République, agissant sur saisine du ministère de la Justice ès qualité d’autorité centrale aux fins de la Convention de La Haye, avait estimé que les circonstances de l’espèce relevaient du champ d’application de la Convention de La Haye (paragraphe 15 ci-dessus) et que la décision du tribunal de la famille d’İzmir était contraire aux principes définis dans cette convention (paragraphe 19 ci-dessus), il ne ressort pour autant aucunement des décisions litigieuses que ces juridictions auraient statué ou examiné les circonstances de l’affaire à la lumière des principes posés dans la Convention de La Haye.
59. A cet égard, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3 de cette convention le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle et, exercé de façon effective. Or, elle relève que rien dans la motivation du tribunal de la famille d’İzmir n’indique que cette juridiction ait recherché si le requérant était ou non titulaire d’un droit de garde au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye.
60. Cette juridiction n’apparaît pas non plus s’être prononcée sur la licéité du non-retour litigieux de l’enfant aux Etats-Unis au regard de cette convention – question dont elle se trouvait pourtant saisie –, et ce alors même qu’il n’apparaissait pas contesté qu’il s’agissait du lieu de résidence habituelle de l’enfant (paragraphe 24 ci-dessus). Il en est de même de la Cour de cassation qui, dans le cadre du pourvoi en cassation, a, dans une motivation succincte, limité son appréciation au constat de l’absence d’erreur dans l’examen des preuves (paragraphe 21 ci-dessus).
61. En outre, la Cour observe que, en considérant que le non-retour de l’enfant n’était pas de nature à entraver les relations personnelles de celle-ci avec son père, le tribunal de la famille d’İzmir n’a pas suffisamment pris en compte le fait que la présence de Yasemin Nur en Turquie rendait de facto illusoire le maintien de ces relations personnelles. A cet égard, s’il ne fait pas de doute que son très jeune âge était un critère à prendre en compte dans ce type de litige pour déterminer l’intérêt de l’enfant (Raban, précité, § 38), il ne saurait être considéré à lui seul comme un motif suffisant, au regard des exigences de la Convention de La Haye, pour justifier le rejet de la demande du requérant.
62. Au vu de tout ce qui précède et des pièces du dossier, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, les juridictions nationales ne se sont pas livrées à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale en cause et que le processus décisionnel en droit interne n’a pas satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8 de la Convention. Ce constat suffit pour que la Cour conclue à la violation en l’espèce de cet article.
SANTOS NUNES c. PORTUGAL du 22 mai 2012 Requête no 61173/08
Le Manque de diligence des autorités portugaises durant 4 ou 5 mois à faire exécuter une décision de justice relative à la garde d’un enfant, est une violation.
a) Principes généraux
66. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 151, CEDH 2001-VII). Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre. La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime recherché (Couillard Maugery c. France, no 64796/01, § 237, 1er juillet 2004).
67. Si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge de l’Etat des obligations positives inhérentes au « respect » effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l’existence d’un lien familial se trouve établie, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés (voir, par exemple, Eriksson c. Suède, 22 juin 1989, § 71, série A no 156 ; Olsson c. Suède (no 2), 27 novembre 1992, § 90, série A no 250 ; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I ; Gnahoré c. France, no 40031/98, § 51, CEDH 2000-IX et, dernièrement, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 140, CEDH 2010). La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents - ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public - (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 62, CEDH 2007-XIII), en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante (dans ce sens Gnahoré, précité, § 59, CEDH 2000-IX), pouvant, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 66, CEDH 2003-VIII). L’intérêt de ces derniers, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu ( Haase c. Allemagne, no 11057/02, § 89, CEDH 2004-III (extraits), ou Kutzner c. Allemagne, précité, § 58). Dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, par exemple, W., B. et R. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, série A no 121, §§ 60 et 61, et Gnahoré, précité, § 52).
68. La Cour rappelle que l’obligation des autorités nationales de prendre des mesures à cette fin n’est pas absolue car il arrive que la réunion d’un parent avec son enfant qui a vécu depuis un certain temps avec d’autres personnes ne puisse avoir lieu immédiatement, et requière des préparatifs. Leur nature et leur étendue dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituera toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec le parent risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux. Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (voir Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299-A et Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 56, 23 juin 2005).
69. La Cour rappelle par ailleurs que, dans les affaires touchant la vie familiale, le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. En effet, la rupture de contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de sa relation avec son parent (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003-VI).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
70. Se penchant sur le cas d’espèce, la Cour constate que le tribunal accorda la garde de l’enfant E. au requérant le 13 juillet 2004. Cette décision ne reçut exécution que le 8 janvier 2009, quelques jours après la remise de E. au requérant, le 19 décembre 2008, à titre provisoire. Quatre années et cinq mois se sont donc écoulés avant que la décision judiciaire en question n’ait été exécutée.
71. La Cour admet à titre préliminaire, avec le Gouvernement, que le déroulement de la procédure litigieuse a sans conteste été marqué par le manque de coopération du couple G., qui s’est dérobé successivement aux nombreuses convocations des autorités judiciaires et de police. Elle relève cependant qu’un tel manque de coopération ne saurait dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 55, 22 novembre 2005).
72. Or, la Cour n’est pas convaincue que de tels moyens aient été mis en œuvre de manière efficace par l’ensemble des autorités chargées de l’affaire, au moins jusqu’au 21 mars 2007, date à laquelle Mme G. se présenta avec E. à l’hôpital de Coimbra.
73. A cet égard, la Cour relève d’abord que ce n’est que le 6 juin 2006 que le juge chargé de l’affaire a décidé que l’affaire devait être traitée en priorité, malgré la demande formulée par le requérant à cette fin, le 16 juillet 2004. Le requérant a alerté dès cette date les autorités sur le manque de coopération du couple G.
74. Suivirent plusieurs demandes du requérant en vue de l’assistance de la force publique dans l’exécution forcée de la décision. La Cour a pris note des efforts des autorités de police en vue de retrouver la trace de Mme G. et de l’enfant mais s’étonne du manque de résultats de tels efforts. Elle relève à cet égard que les autorités judiciaires nationales ont-elles aussi fait état d’un tel manque de résultats, le juge du tribunal de Torres Novas allant jusqu’à dessaisir la PSP de l’affaire et à confier celle-ci à la police judiciaire.
75. En effet, il a fallu attendre la mise en détention provisoire de M. G., deux ans et cinq mois après l’ouverture des poursuites à son encontre, et sa condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, à laquelle le sursis fut ultérieurement accordé, pour que Mme G. se décide à présenter l’enfant aux autorités.
76. La Cour est consciente du caractère délicat de l’affaire litigieuse ainsi que des retombées médiatiques de celle-ci tout au long de la période considérable pendant laquelle la procédure s’est déroulée. Les autorités étaient en effet confrontées à une situation nouvelle, qui allait au-delà d’un conflit entre les parents biologiques eux-mêmes ou entre ceux-ci et l’Etat. Ceci ne les dispensait toutefois pas de déployer tous les efforts nécessaires à l’exécution de la décision d’octroi de la garde de l’enfant au requérant, d’autant que dans ce type d’affaires, comme la Cour l’a déjà relevé, le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (Maire, précité, § 74).
77. Tout en rappelant qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, et tout en reconnaissant qu’en l’espèce les juridictions internes se sont appliquées, à partir du 21 mars 2007 et malgré quelques vicissitudes – il a notamment fallu changer l’équipe de pédopsychiatres suivant E, de bonne foi à préserver le bien-être de l’enfant, la Cour constate ainsi l’existence de manques de diligence graves dans la procédure.
78. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les autorités portugaises ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter les droits du requérant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale.
79. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
CINCIMINO c. ITALIE du 28 avril 2016 requête 68884/13
Violation de l'article 8 : Après son divorce, les Droits de visite de la mère sont retirés car elle subit un trouble de la personnalité jusqu'à donner de la drogue à sa fille. La CEDH sanctionne la durée excessive de la suppression des droits de visite alors que la fille a 12 ans et qu'il n'y aucune nouvelle expertise pour évaluer la mère. Les tribunaux internes se contentent de recopier leurs anciennes décisions.
62. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (Kutzner, précité § 58) et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 151, CEDH 2001-VII). Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre. La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime recherché (Couillard Maugery c. France, no 64796/01, § 237, 1er juillet 2004).
63. Si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge de l’État des obligations positives inhérentes au « respect » effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l’existence d’un lien familial se trouve établie, l’État doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés (voir, par exemple, Eriksson c. Suède, 22 juin 1989, § 71, série A no 156 ; Olsson c. Suède (no 2), 27 novembre 1992, § 90, série A no 250 ; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I ; Gnahoré c. France, no 40031/98, § 51, CEDH 2000-I, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 140, CEDH 2010). La frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au titre de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents - ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public - (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 62, CEDH 2007‑XIII), en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante (en ce sens, Gnahoré, précité, § 59), pouvant, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 66, CEDH 2003-VIII). L’intérêt de ces derniers, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (Haase c. Allemagne, no 11057/02, § 89, CEDH 2004-III (extraits), ou Kutzner, précité, § 58). Dans les deux hypothèses, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, par exemple, W., B. et R. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, série A no 121, §§ 60 et 61, et Gnahoré, précité, § 52). La Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d’enfants par l’administration publique et les droits des parents de ces enfants, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299‑A).
64. La Cour rappelle que, si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, le processus décisionnel lié aux mesures d’ingérence doit être équitable et propre à respecter les intérêts protégés par cette disposition. Il échet dès lors de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l’ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour « nécessaire » au sens de l’article 8 (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, § 64, série A no 121).
65. La Cour reconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude en matière de droit de garde. Il faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties juridiques destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations familiales entre un jeune enfant et l’un de ses parents ou les deux (arrêts Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94 § 49, CEDH 2000-VIII, et Sahin, précité, § 65).
66. L’article 8 exige que les autorités nationales ménagent un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents. D’un côté, il est certain que garantir aux enfants une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l’article 8 ne saurait en aucune manière autoriser un parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de ses enfants (Sahin précité, § 66). De l’autre, il est clair qu’il est tout autant dans l’intérêt de l’enfant que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne : briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines. Il en résulte que l’intérêt de l’enfant commande que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture du lien familial, et que tout soit mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles (Plasse Bauer c. France (déc.), no 21324/02, Pisano c. Italie (déc.), no 10504/02 et Brukarz c. France (déc.), no 16585/04).
Application des principes susmentionnés à la présente affaire
67. La Cour estime que, devant les circonstances soumises à son attention, sa tâche consiste à examiner si, face à la nécessité de prendre des mesures propres à maintenir les liens de la requérante avec son enfant au cours de la procédure, les autorités nationales ont agi conformément à leurs obligations positives découlant de l’article 8.
68. Dans les affaires touchant la vie familiale, la rupture du contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de sa relation avec son parent (voir, entre autres, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004‑V (extraits) et K.A.B. c. Espagne, précité, § 103). Il en va ainsi dans la présente affaire.
69. La Cour note qu’à partir de 2003, le droit de visite de la requérante fut limité à une rencontre par semaine, en présence des services sociaux. Au bout d’un certain temps, les services sociaux constatèrent les difficultés graves survenues dans la gestion des rencontres en raison du comportement tenu par la requérante et de l’attitude agressive et non collaborative vis-à-vis des travailleurs sociaux.
70. La Cour relève qu’en 2005 la requérante fut déchue de son autorité parentale par le tribunal de Palerme sur la base des expertises déposées lors de la procédure de séparation de corps dont les conclusions avaient conduit les juridictions saisies à considérer que, compte tenu de sa personnalité narcissique, la requérante n’était pas en mesure d’assurer le développement équilibré de sa fille.
71. La Cour relève tout d’abord le nombre et la fréquence des démarches entreprises par la requérante auprès des autorités nationales, dans le but de maintenir un contact avec sa fille née, en 2000 et dont la garde avait été confiée au père. Pour justifier leur réponse négative aux demandes de la requérante de voir l’enfant, les juridictions en mars 2010, ont énoncé que la requérante n’était pas encore en mesure d’exercer son rôle parental car elle n’avait pas correctement suivi le parcours thérapeutique indiqué par les autorités judiciaires (paragraphe 28 ci-dessus).
72. Les juridictions saisies par la requérante ont une nouvelle fois rejeté, en 2012, sa demande de pouvoir à nouveau rencontrer sa fille. Prenant en compte le souhait exprimé par l’enfant, au cours de son audition, de ne pas revoir sa mère après sept ans d’absence de tout contact avec elle, lesdites autorités ont estimé qu’il n’était ni opportun ni utile d’ordonner une nouvelle expertise au sujet de la requérante, au motif que les expertises réalisées dans le cadre de la procédure de séparation de corps en 2003 et devant le tribunal ecclésiastique en 2006 avaient confirmé que l’intéressée souffrait d’un trouble de la personnalité. De plus, selon la cour d’appel de Palerme une éventuelle reprise des contacts entre la requérante et sa fille serait préjudiciable pour l’enfant.
73. Il en résulte ainsi que, depuis 2006, il n’y a eu aucune nouvelle expertise psychiatrique indépendante au sujet de la requérante pour évaluer si elle continuait à souffrir d’un trouble de la personnalité et, dans l’affirmative, s’il existait encore, du point de vues des intérêts de l’enfant, des raisons pertinentes et suffisantes pour des mesures ne permettant aucun contact entre la requérante et son enfant âgée désormais de douze ans. Les juridictions se sont limitées à répéter les considérations déjà faites dans les décisions précédentes, alors que des indications avaient été données – certes par des experts nommés par la requérante – que sa situation s’était entre-temps améliorée.
74. Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’absence d’une expertise récente et indépendante sur la requérante, force est de conclure que le processus décisionnel n’a pas satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8 de la Convention (voir paragraphe 64 ci-dessus).
75. La Cour conclut en conséquence que l’État a méconnu à l’égard de la requérante les obligations positives mises à sa charge par l’article 8 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
Arrêt MEIRELLES c. BULGARIE du 18 décembre 2012 Requête 66203/10
70. Le Gouvernement expose que plusieurs éléments ont compliqué le processus de détermination des mesures provisoires liées au droit de visite de la requérante à son fils. D’abord, les positions des parties dans la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale ont été contradictoires, ce qui a rendu nécessaire un certain temps pour recueillir des preuves. Ensuite, compte tenu des relations conflictuelles des deux parents, ceux-ci n’ont pas eu un comportement coopératif dans la procédure. De plus, la procédure parallèle conduite en application de la loi sur la protection contre les violences domestiques devait aussi être prise en compte. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la complexité de l’affaire, le Gouvernement estime que même s’il est vrai qu’un retard de quatre mois a été constaté dans la période du 5 février 2010 au 20 septembre 2010 par le Conseil supérieur de la magistrature, la durée globale de l’examen de la demande de mesures provisoires ne paraît pas excessive au point de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale de la requérante protégé par l’article 8.
71. La requérante estime que les autorités judiciaires ont manqué à se prononcer sur les mesures provisoires pendant la période comprise entre le 10 septembre 2009 et le 27 octobre 2010, ce qui a eu pour résultat de l’éloigner de son enfant. Elle estime que les autorités n’ont tenu compte ni de ses affirmations selon lesquelles le père empêchait tout contact entre elle et l’enfant, ni du fait qu’elle avait engagé une procédure pour mauvais traitements contre B.A. Elle met en avant que, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, les éléments de preuve nécessaires pour la détermination des mesures provisoires avaient déjà été recueillis au moment de l’introduction des actions des parties, soit le 10 septembre 2009 et le 5 février 2010 respectivement, et que la procédure sur les allégations de violences domestiques avait pris fin le 21 avril 2010. Par conséquent, à la date de la première audience, soit le 26 avril 2010, le tribunal de district en charge de l’affaire sur l’exercice de l’autorité parentale disposait de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur les mesures provisoires.
72. La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des autorités publiques, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91, et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 2003‑XII).
73. La Cour réitère à cet égard le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37). Dans cette logique, elle rappelle qu’un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parents et enfants se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 82, 12 janvier 2006).
74. La Cour rappelle ensuite qu’en matière de respect de la vie familiale, les obligations positives de l’Etat impliquent la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés. Cet arsenal doit permettre à l’Etat d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova, précité, § 80). Elle rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).
75. Pour être adéquates, les mesures visant à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place rapidement, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo‑Zenide, précité, § 102, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004‑V, Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin 2006, Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 84, 2 septembre 2010). En particulier, compte tenu de la nature et de l’objectif des mesures provisoires de garde, les actions y afférentes doivent normalement être traitées avec un certain degré de priorité à moins qu’il existe des raisons spécifiques de ne pas le faire (Bevacqua et S. c. Bulgarie, no 71127/01, § 68, 12 juin 2008).
76. La tâche de la Cour n’est pas de se substituer aux organes compétents pour réglementer les questions de garde et de visites, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299‑A).
77. En l’espèce, la Cour note en premier lieu qu’il n’est pas contesté que le lien entre la requérante et son enfant relève de la notion de vie familiale au sens de l’article 8.
78. La Cour estime ensuite que, devant les circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à examiner si la réponse des autorités à la nécessité de prendre des mesures propres à maintenir les liens de la requérante avec son enfant au cours de la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale a été conforme à leurs obligations positives découlant de l’article 8.
79. La Cour observe qu’à l’époque des faits, le droit interne prévoyait que le tribunal de district était compétent pour fixer, au cours de tout litige sur l’exercice de l’autorité parentale et à la demande de l’un des parents séparés des mesures provisoires relatives au droit de visite (paragraphe 56 ci-dessus). Il est vrai que la requérante n’a pas introduit d’action en déchéance de l’autorité parentale contre le père accompagnée d’une demande de mesures provisoires dès sa séparation d’avec son enfant et son compagnon, intervenue au début du mois de septembre 2009, parallèlement à sa demande reconventionnelle de mesures de protection contre les violences domestiques prétendues, alors qu’elle était libre de le faire. Toutefois, elle s’est prévalue de la voie en question le 5 février 2010, dès qu’elle a été informée que son compagnon avait introduit, pour sa part, une action fondée sur l’article 127 du code de la famille (paragraphe 33 ci‑dessus). Le tribunal a fixé le régime des visites le 27 octobre 2010. La Cour retient dès lors que la demande relative aux mesures provisoires a été examinée entre ces deux dates, distantes de plus de huit mois et demi.
80. La Cour note en outre que la demande de mesures provisoires de garde a été formulée dans une situation où la requérante et le père de son enfant, alors âgé de deux ans, étaient séparés et se trouvaient en litige concernant l’autorité parentale. De plus, les relations des deux parents s’étaient détériorées et ils avaient tous deux engagé des procédures ayant trait à des violences physiques aussi bien entre eux qu’à l’égard de l’enfant. Enfin, la requérante prétendait que B.A., le père, l’empêchait de rendre des visites à son fils, ou bien que ce dernier ne la laissait pas voir son enfant seule lors des rares rencontres qui ont eu lieu (paragraphes 33, 36 et 43 ci‑dessus).
81. Dans de telles circonstances, la Cour estime qu’il pesait sur le tribunal compétent une obligation de se prononcer d’urgence sur les mesures provisoires relatives au régime des contacts entre la requérante et son enfant, compte tenu en outre du bas âge de ce dernier (paragraphe 75 ci‑dessus). Elle ne relève pas de raisons spécifiques de ne pas le faire, d’autant plus que la demande de la requérante était fondée, entre autres, sur des allégations de comportement agressif de la part de B.A. envers elle et sur le fait qu’elle n’avait vu l’enfant que trois fois en l’espace de huit mois (paragraphes 33 et 36 ci-dessus ; voir aussi Bevacqua et S., précité, § 68).
82. La Cour rappelle avoir déjà dit qu’une durée d’examen d’environ huit mois pour une demande de mesures provisoires de garde est sujette à critique, notamment si les autorités ne démontrent pas une attention suffisante au besoin de réagir avec une diligence particulière pendant cette période (Bevacqua et S., précité, § 76). Il convient dès lors de vérifier si, compte tenu des circonstances de l’affaire, les autorités bulgares ont procédé avec l’attention et la promptitude nécessaires pour examiner la demande de la requérante.
83. Il est vrai que les allégations de la requérante, ainsi que les circonstances pertinentes concernant la situation de l’enfant nécessitaient une vérification qui ne pouvait être réalisée sans recueillir des preuves. Dès lors, la requérante ne pouvait s’attendre à une réponse immédiate dès l’introduction de sa demande d’application de mesures provisoires. Force est toutefois de constater qu’aucun examen du dossier n’a été entrepris avant le 1er avril 2010, soit pendant environ deux mois après la demande. C’est seulement à cette date que le tribunal compétent ordonna la convocation des témoins, la réalisation de rapports sociaux et la production des preuves.
84. De plus, il apparaît que la question spécifique des mesures provisoires n’a été traitée avec aucune priorité par la suite non plus car le tribunal de district a, dans un premier temps, délibérément refusé de se prononcer au motif que cet examen retarderait la procédure sur la déchéance de l’autorité parentale (paragraphe 36 ci-dessus) et, dans un second temps, reporté les audiences à deux reprises pour des erreurs visiblement non attribuables à la requérante, telle que la citation irrégulière d’un expert (paragraphes 37-38 ci-dessus).
85. La Cour note par ailleurs qu’un changement du juge initialement désigné a dû être effectué, ce qui a nécessité un temps supplémentaire d’environ un mois entre le déport du premier juge et l’audience tenue devant le nouveau juge (paragraphes 42-43 ci-dessus), laps de temps qui ne semble pas déraisonnable en soi. En revanche, aucune raison valable n’a été avancée par le Gouvernement pour expliquer le refus d’examiner la demande de mesures provisoires entre le 5 février et le 27 octobre 2010, alors qu’il était évident que la requérante ne bénéficiait pas de contacts réguliers avec son enfant. De plus, depuis le 21 avril 2010, elle ne se trouvait plus dans l’interdiction de l’approcher, selon la dernière décision définitive dans la procédure pour violences domestiques (paragraphe 26 ci‑dessus). D’ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature a constaté, et le Gouvernement le reconnaît, que la procédure a été indûment retardée pendant environ quatre mois (paragraphes 40 et 70 ci-dessus). Enfin le tribunal de district a noté, dans son jugement du 23 février 2011, que les contacts entre la mère et l’enfant avaient subi une interruption importante (paragraphe 48 ci-dessus).
86. Au vu de ce qui précède, et notamment en raison du défaut injustifié de se prononcer, pendant une période de plus de huit mois, sur la question des contacts de la requérante avec son enfant de bas âge, dans des conditions de relations tendues entre les parents, la Cour estime que les autorités n’ont pas rempli leur obligation positive de prendre des mesures adéquates pour préserver les relations entre la requérante et son enfant.
87. Il y a eu dès lors violation de l’article 8 de la Convention de ce chef.
POLIDARIO c. SUISSE du 30 juillet 2013 Requête n°33169/10
La requérante renvoyée aux Philippines n'a pas pu voir son enfant après son divorce
63. La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des autorités publiques, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91 et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 2003‑XII).
64. La Cour réitère à cet égard le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37). Dans cette logique, elle rappelle qu’un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parents et enfants se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 82, 12 janvier 2006).
65. La Cour rappelle ensuite qu’en matière de respect de la vie familiale, les obligations positives de l’Etat impliquent la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés. Cet arsenal doit permettre à l’Etat d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova, précité, § 80). Elle rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).
66. Pour être adéquates, les mesures visant à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place rapidement, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo‑Zenide, précité, § 102, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004‑V (extraits), Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin 2006, Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 84, 2 septembre 2010).
67. La tâche de la Cour n’est pas de se substituer aux organes compétents pour réglementer les questions de garde et de visites, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299‑A, et Meirelles, précité, §§ 72 à 76).
68. En l’espèce, la Cour note qu’il ne peut y avoir aucun doute qu’il existe une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention entre la requérante et son enfant (voir, parmi d’autres, Özmen c. Turquie, no 28110/08, § 82, 4 décembre 2012).
69. La Cour estime que, devant les circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à examiner si la réponse des autorités suisses à la nécessité de prendre des mesures propres à maintenir les liens entre la requérante et son enfant au cours de la procédure sur l’exercice des droits parentaux a été conforme à leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention.
70. La Cour observe que, tout au long de la procédure, la requérante accomplit des démarches depuis les Philippines – tant bien que mal, compte tenu du peu de moyens financiers dont elle disposait – afin de pouvoir maintenir les liens avec son enfant. Ainsi notamment, elle sollicita une autorisation de séjour en Suisse, du moins le temps que le mineur y résidait, et demanda au tribunal d’ordonner toutes mesures d’exécution utiles aux fins de sa réunion avec l’enfant dans les meilleurs délais.
71. Notant que ces demandes furent intentées dans une situation où la requérante et le père de l’enfant étaient séparés et se trouvaient en litige concernant la garde de l’enfant, la Cour estime qu’il pesait sur les autorités judiciaires suisses une obligation de se prononcer d’urgence sur les mesures à prendre pour maintenir les liens entre la mère et son enfant, compte tenu notamment du bas âge de celui-ci.
72. Certes, devant la situation conflictuelle régnant entre les parents, les autorités devaient prendre des précautions et procéder à des vérifications quant à la situation de l’enfant ; la preuve en est que les autorités suisses ont cherché à trouver, à travers des expertises réalisées en Suisse et aux Philippines, une solution respectueuse notamment de l’intérêt de l’enfant.
73. Toutefois, la Cour attache beaucoup d’importance au fait que la requérante ne put maintenir aucun contact autre que téléphonique avec son enfant pendant plusieurs années (voir, a contrario, Diamante et Pelliccioni c. Saint-Marin, no 32250/08, § 185, 27 septembre 2011, et mutatis mutandis Cengiz Kılıç c. Turquie, no 16192/06, § 127, 6 décembre 2011).
74. Ainsi, la requérante était, pendant une première période, séparée de son enfant en bas âge entre 2005 et 2010.
En effet, le père - emmenant l’enfant en Suisse début octobre 2004 mais ne le ramenant pas, comme convenu oralement, aux Philippines en mars 2005 - vécut de facto avec l’enfant en Suisse, en dépit du fait que la requérante détenait l’autorité parentale et le droit de garde. Toutes les tentatives de la requérante afin de rapatrier l’enfant aux Philippines échouaient. Dans la mesure où elle s’était vu rejeter ses demandes d’autorisation de séjour (paragraphes 25 à 28), la requérante ne pouvait pas non plus se rendre en Suisse pour faire valoir ses droits au maintien d’une vie familiale avec son enfant. Ce n’était que dans le cadre de sa comparution à l’audience du 25 janvier 2010 devant le tribunal tutélaire que la requérante pouvait revoir son fils (paragraphe 32).
Le Gouvernement n’avance aucune explication pour justifier ce long délai pendant lequel la requérante batailla sans succès en vue de rendre effectif le droit de garde dont elle disposait.
75. Une deuxième période s’est ensuivie, pendant laquelle la requérante était toujours privée de relations familiales effectives et sûres avec son enfant.
Ainsi, à partir du 4 juin 2010, la requérante s’est vu accorder un droit de visite (paragraphe 35), dont il était précisé qu’il devait impérativement s’exercer en Suisse, alors qu’elle ne bénéficiait pourtant pas d’autorisation de séjour. Ceci avait pour conséquence que la requérante – qui ne pouvait se résoudre à regagner seule les Philippines suite aux quelques contacts qu’elle avait eus avec son fils à partir de l’audience du 25 janvier 2010 (paragraphe 33) – exerçait son droit de visite en résidant clandestinement et illégalement en Suisse, et donc sans bénéficier d’un statut juridique. Elle se trouvait ainsi dans une situation précaire, qui ne s’est résolue que par l’octroi d’un titre de séjour en date du 25 octobre 2012. Les autorités suisses n’étaient d’ailleurs pas sans ignorer la situation inextricable dans laquelle se trouvait la requérante pendant plus de deux ans, ainsi qu’en témoignent les échanges entre le service de protection des mineurs et le tribunal tutélaire (paragraphes 37 et 40).
76. La Cour prend note du fait que, grâce à l’octroi d’une autorisation de séjour à la suite de la communication de la présente requête, la situation de la requérante semble dorénavant régularisée, du moins le temps de la validité dudit document (paragraphe 42).
77. Toutefois, cela n’enlève rien à son constat selon lequel la requérante fut privée de l’exercice effectif de sa vie familiale avec son enfant pendant plus de six ans. Les relations personnelles entre la requérante et son fils ont ainsi été sérieusement altérées, à une période pourtant cruciale. Aux yeux de la Cour, les autorités suisses n’ont de ce fait pas rempli leur obligation positive de prendre des mesures adéquates pour préserver les liens entre la requérante et son enfant.
78. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
ANTONYUK c. RUSSIE du 1er août 2013 Requête 47721/10
Séparer une mère de ses enfants, est une violation dans les circonstances de la cause.
115. Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour rechercher si une ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », il convient d’examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier la mesure litigieuse étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention et si le processus décisionnel, considéré comme un tout, a assuré au requérant (en l’occurrence, un parent) la protection requise de ses intérêts, compte tenu des circonstances propres à chaque affaire (Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, §§ 62, 66 et 68, CEDH 2003‑VIII (extraits)).
116. L’article 8 exige que les autorités nationales ménagent un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents. En particulier, l’article 8 ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (voir T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 71, CEDH 2001‑V (extraits), et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000‑I).
117. Il faut avoir à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n’a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite ; toutefois il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (Sommerfeld, § 62).
118. La marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes varie selon la nature des questions en litige et l’importance des intérêts en jeu. Dès lors, la Cour reconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude, en particulier en matière de droit de garde. Il faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties juridiques destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations familiales entre un jeune enfant et l’un de ses parents ou les deux (ibid., § 63).
b) Application des principes en l’espèce
119. Il ne prête pas à controverse que la fixation de la résidence des enfants chez son ex-mari s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante, même si elle évoque principalement la notion de la « vie privée ». En effet, pour un parent, continuer à vivre ensemble avec ses enfants est un élément fondamental qui relève à l’évidence de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, lequel est donc applicable en l’espèce (Hoffmann c. Autriche, 23 juin 1993, § 29, série A no 255‑C, et Koons c. Italie, no 68183/01, § 47, 30 septembre 2008). Il est à noter que le fils de la requérante habitait et demeure avec son père à Briansk, tandis que la fille cadette est restée avec sa mère, la requérante, à Kalouga, en dépit du jugement du 12 février 2010.
120. La « légalité » de la mesure n’est pas sérieusement contestée par la requérante. Selon l’article 65 du code de la famille, faute d’accord entre les parents, un tribunal doit déterminer la résidence de l’enfant. La Cour admet que l’ingérence visait à « la protection des droits d’autrui », plus particulièrement ceux des enfants mineurs. Reste à déterminer si une telle ingérence était proportionnée au but poursuivi, compte tenu des principes généraux applicables présentés aux paragraphes 115-118 ci-dessus.
121. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit en l’occurrence d’une procédure civile qui a opposé deux parents légitimes et où les autorités nationales n’avaient pas d’autre choix que de trancher en faveur de l’un d’entre eux, puisqu’apparemment la résidence alternée n’est pas clairement envisageable en droit russe. En l’occurrence, les principes énoncés ci-dessus doivent être appliqués en ayant égard aux circonstances de l’affaire : les tribunaux internes devaient assurer la protection des intérêts de la requérante en tenant compte également de ceux de l’autre partie à la procédure, le père des enfants. Au surplus, l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est d’une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte.
122. Il y a encore un autre élément à prendre en considération en l’espèce. Certes, l’issue de la seconde procédure civile n’a affecté que la question la résidence des enfants et n’a pas fait perdre à la requérante l’exercice des droits parentaux à leur égard (voir en comparaison, Diamante et Pelliccioni c. Saint-Marin, no 32250/08, §§ 179-180, 27 septembre 2011, et A.K. c. Croatie, no 37956/11, § 60 et § 62, 8 janvier 2013). Toutefois, par la force des choses, la requérante a subi une restriction dans l’exercice quotidien desdits droits parentaux par rapport auxdits enfants, ceux-ci devant résider chez leur père à Briansk alors qu’elle-même, à l’issue de la procédure de divorce, résidait à Kalouga.
123. Tout d’abord, la Cour rappelle que, compte tenu de l’obligation de l’Etat d’assurer un processus décisionnel adéquat, inhérente à l’article 8 § 2, il y a lieu de déterminer si la requérante a eu le loisir de présenter tous les arguments en sa faveur lors de cette procédure (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 52, CEDH 2000‑VIII).
124. Les tribunaux internes se sont principalement appuyés sur le rapport d’experts du 15 juillet 2009, qui était issu de la première procédure civile, pour régler la question de la résidence des enfants. La requérante affirme que ledit rapport était illégal du fait que l’audience du 3 juin 2009 dans la première procédure civile s’était tenue sans qu’elle eût été avisée de sa date. De plus, la question de sa dangerosité n’était pas au nombre des questions posées par le tribunal aux experts dans la première procédure. Donc, selon la requérante, les experts avaient outrepassé leur mandat. De plus, la requérante estime discutable le choix du tribunal de faire primer les conclusions du rapport du 15 juillet 2009 sur les conclusions du bilan de santé et de l’avis d’experts indépendants et qui, selon elle, concluaient l’un et l’autre à son absence de « dangerosité » pour ses enfants (paragraphes 52 et 56 ci-dessus).
125. La Cour relève que le 3 juin 2009, le tribunal tint une audience préliminaire dans la première affaire en l’absence de la requérante. Pendant l’audience, M. A. demanda au tribunal d’ordonner une expertise psychiatrique au sujet de la requérante. Le tribunal accueillit la demande et, par une ordonnance du 3 juin 2009, ordonna qu’une expertise soit effectuée par les médecins de l’hôpital psychiatrique de Briansk.
126. La requérante allègue qu’elle n’avait pas été dûment avisée de l’audience du 3 juin 2009. Selon le Gouvernement, la requérante fut bien avisée à son domicile à Kalouga le 29 mai 2009 et le 2 juin 2009 que le service postal avait un pli recommandé avec accusé de réception qui lui était destiné. Il ressort du dossier que cette convocation avait été expédiée à Kalouga le 27 mai 2009. Restée non réclamée, la convocation fut renvoyée par le service postal à l’expéditeur le 5 juin 2009.
127. Aux yeux de la Cour, la question se pose de savoir si le 3 juin 2009 le tribunal avait suffisamment de preuves pour conclure que la requérante avait été dûment avisée de l’audience préliminaire du 3 juin 2009 dans la première procédure civile.
128. Même à supposer établi que la requérante avait été dûment avisée de l’audience, il convient d’observer que la requérante émet, également, des doutes concernant l’objet et l’étendue des conclusions du rapport du 15 juillet 2009, qui était censé porter uniquement sur sa capacité d’exercice. À cet égard, les tribunaux nationaux ont considéré que les experts étaient habilités à exprimer leur opinion sur l’éventuelle dangerosité de la requérante à l’égard de ses enfants sans qu’une question spécifique à cet effet n’ait besoin d’être posée par le juge.
129. La Cour rappelle que c’est en principe aux juridictions nationales qu’il revient d’apprécier les éléments rassemblés par elles (Sommerfeld, § 71). Par ailleurs, la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel (Cottin c. Belgique, no 48386/99, § 30, 2 juin 2005). Il appartient aux juridictions internes d’apprécier la pertinence des éléments dont une partie souhaite la production (ibid.).
130. La Cour note que les parties avaient chacune sollicité le versement au dossier d’un certain nombre de documents. M. A. avait notamment demandé au tribunal de joindre au dossier le rapport d’experts du 15 juillet 2009. La requérante, pour sa part, a présenté l’avis d’une association indépendante de médecins psychiatres établi à la suite de son examen du 26 novembre 2009. Les auteurs de cet avis s’opposaient aux conclusions du rapport du 15 juillet 2009 selon lesquelles la dépression récurrente de la requérante pouvait représenter un danger pour ses enfants. Selon les auteurs de l’avis, cet aspect était étranger à l’examen précédant ledit rapport et cette conclusion n’était pas étayée par des éléments objectifs (paragraphe 52 ci‑dessus). Par la suite, la requérante a demandé et obtenu de pouvoir verser au dossier des éléments supplémentaires, comme le bilan de son examen devant la commission médicale de l’hôpital psychiatrique de Kalouga en date du 20 janvier 2010, dont les conclusions étaient similaires à celles de l’avis du 26 novembre 2009 de l’association indépendante de médecins psychiatres.
131. Le tribunal a joint au dossier les éléments produits par les parties et les a soumis à la discussion contradictoire. De plus, le tribunal a ajourné une audience à la demande de la requérante, qui souhaitait la convocation de témoins. Le tribunal a entendu plusieurs témoins cités par les parties, notamment l’un des experts qui avaient contribué au rapport du 15 juillet 2009, les proches de la requérante, deux institutrices de l’école et un professeur de l’université dans lesquelles elle avait fait ses études, ainsi qu’une amie de la requérante. Les témoins ont exprimé leurs impressions quant à la personnalité de la requérante et à ses relations avec les enfants.
132. Dans ses motifs, le tribunal d’arrondissement a accordé foi à la conclusion du rapport d’experts du 15 juillet 2009 selon laquelle la requérante pourrait représenter un danger pour ses enfants compte tenu du caractère récurrent de sa maladie. Il a écarté les conclusions inverses émises dans le rapport du 24 novembre 2009 et le bilan du 20 janvier 2010 en faisant valoir qu’aucun des avis y contenus ne niait la présence d’une affection dépressive récurrente chez la requérante. Le tribunal en a déduit que la rémission actuelle de la requérante n’excluait pas une récidive de la maladie dans le futur, élément qu’il a retenu comme venant à l’encontre de l’intérêt des enfants. Le tribunal a conclu que la dépression récurrente de la requérante faisait courir à ses enfants un risque vital vu leur bas âge. La cour régionale, à son tour, a jugé que c’était à bon droit que le tribunal avait accepté le rapport d’experts du 15 juillet 2009 en tant que preuve et en avait retenu l’existence d’un danger potentiel pour les enfants de la requérante.
133. La Cour ne doute pas de la pertinence des motifs relevés par les juridictions nationales. La Cour rappelle certes qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation.
134. Cependant, aux yeux de la Cour, la question centrale qui se pose dans la présente affaire est de savoir si les juridictions nationales se sont livrées à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale et des éléments pertinents, qu’ils soient d’ordre factuel, affectif, psychologique, matériel ou médical notamment, et si elles ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun.
135. Les questions médicales relatives à la maladie de la requérante ont revêtu, en l’espèce, une importance capitale pour l’issue de la procédure quant au lieu de résidence des enfants. Certes, le tribunal a examiné et pris en considération les autres éléments du dossier pour apprécier la personnalité de la requérante (paragraphes 67-68 ci-dessus). Néanmoins, ces éléments n’ont pas été déterminants dans la conclusion du tribunal quant à la question de la dangerosité de la requérante. Le tribunal s’est borné à récapituler le contenu des divers éléments du dossier sans procéder à leur analyse approfondie par rapport à cette question et, plus globalement, par rapport à l’enjeu de la procédure, à savoir la résidence des enfants.
136. La Cour observe que, compte tenu de leur nature, les questions qu’estimait devoir trancher le tribunal pour régler la question de la résidence des enfants pouvaient, en l’espèce, assez naturellement être considérées par celui-ci comme relevant du domaine de compétence des experts (voir en comparaison, dans le contexte de l’article 6 de la Convention, Cottin, § 31).
137. Cela dit, la Cour estime discutable le choix des tribunaux nationaux de trancher la question de la résidence des enfants en s’appuyant fortement sur le rapport d’experts du 15 juillet 2009 (voir, mutatis mutandis, S. c. Estonie, no 17779/08, § 45, 4 octobre 2011).
138. Premièrement, le rapport du 15 juillet 2009 était issu d’une autre procédure civile, qui concernait la capacité d’exercice de la requérante. Le tribunal avait formulé ainsi les questions aux experts :
« [...] [La requérante] est-elle atteinte d’une affection mentale ? [La requérante] peut-elle se rendre compte de ses actes et les contrôler ? [La requérante] peut-elle être convoquée au tribunal pour témoigner ? [...]».
139. Pour la Cour, l’objet et l’enjeu de cette procédure étaient étrangers à la question primordiale qui était posée dans la seconde procédure, à savoir qui, du père ou de la mère, devait prendre soin, au quotidien, de leurs enfants mineurs. Or, le tribunal a indiqué que la décision de justice dans la procédure civile sur la capacité d’exercice de la requérante s’imposait à lui quant aux circonstances y établies (en se référant à l’article 61 du code de procédure civile).
140. Dans la seconde procédure civile, le tribunal aurait dû établir si l’observation non sollicitée qui figurait dans le rapport du 15 juillet 2009 (« l’affection [de la requérante] peut représenter un danger pour son enfant ») avait un fondement factuel suffisant et vérifié et se rapportait à des données médicales précises. En effet, l’avis de l’association indépendante de médecins psychiatres établi à la suite de l’examen de la requérante en novembre 2009 pouvait être de nature à faire naître un doute à cet égard puisque, selon les auteurs dudit avis, la question de la dangerosité éventuelle de la requérante pour ses enfants n’entrait pas dans l’examen précédant le rapport du 15 juillet 2009 et l’énonciation susmentionnée n’était pas étayée par des éléments objectifs et suffisants. La Cour note que le tribunal a, par ailleurs, rejeté la demande de la requérante tendant à ce que soient entendus les auteurs dudit avis (paragraphe 54 ci-dessus).
141. Deuxièmement, la Cour n’est pas convaincue par l’approche retenue par les tribunaux nationaux selon laquelle la dangerosité, présentée en l’occurrence comme éventuelle, de la requérante pour ses enfants devait se déduire, pour l’essentiel, du caractère récurrent de sa maladie.
142. La Cour note que le jugement du 12 février 2010 n’explicite pas, d’une manière suffisante, le lien qui existerait entre l’aspect récurrent de l’affection dépressive de la requérante et un danger suffisamment grave qui pourrait en résulter pour autrui, par exemple ses enfants. Pour leur part, les experts qui avaient collaboré au rapport du 15 juillet 2009 ont conclu que l’affection dépressive récurrente de la requérante pouvait « représenter un danger pour son enfant » en s’attachant aux éléments suivants : le caractère purement formel du regard « critique » de la requérante envers son affection psychique, sa tendance à se traiter au moyen de médicaments psychotropes obtenus par des voies détournées, la présence structurelle chez elle d’épisodes dépressifs et d’idées délirantes d’auto-inculpation, de persécution et de culpabilité. Un des experts a affirmé devant le tribunal dans la seconde procédure qu’une dégradation de l’affection pouvait survenir à tout moment, même sans raison particulière, puisque cette affection était provoquée, aux dires de cet expert, par des éléments liés à un dysfonctionnement cérébral au niveau moléculaire, ce dont on ne peut guérir tout à fait. Toutefois, la Cour note que, selon le procès-verbal de l’audience, la question concernant les effets négatifs pour les enfants dans l’éventualité d’une dégradation de son affection dépressive n’a pas été approfondie.
143. La Cour note que le juge national était habilité à ordonner qu’une expertise soit effectuée s’il était nécessaire d’examiner des questions relevant d’un domaine particulier scientifique, technique ou autre (paragraphe 91 ci-dessus). La requérante a fait une demande motivée afin que soit ordonnée une nouvelle expertise psychiatrique et psychologique à son égard. Mais le juge a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, compte tenu des éléments figurant déjà au dossier. Le juge a considéré également que cela aurait augmenté inutilement la durée de l’examen de l’affaire.
144. La Cour considère que la demande de la requérante était justifiée. L’article 6 de la Convention prescrit assurément une certaine célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (Boddaert c. Belgique, 12 octobre 1992, § 39, série A no 235‑D). La question est de savoir si, dans les circonstances de la cause, le raisonnement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale.
145. La Cour estime que l’examen effectué par le tribunal ne suffisait pas pour asseoir la conclusion concernant la dangerosité de la requérante pour la vie et la santé de ses enfants. La Cour rappelle que l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est d’une importance cruciale. Pour satisfaire à cette exigence, les questions portant sur les conséquences négatives, et l’éventuel risque vital, de la résidence des enfants avec leur mère méritaient une attention soutenue, compte tenu, par exemple, de l’appréciation de la résidence continue de la fille avec sa mère ou du fait qu’aucune décision n’a été prise, en application de l’article 73 du code de la famille (paragraphe 90 ci-dessus) au motif de la prétendue dangerosité de la requérante, au sujet de l’exercice par elle de ses droits parentaux. Par ailleurs, c’est précisément à cette disposition légale que se rapportait la conclusion contestée du rapport du 15 juillet 2009.
146. Compte tenu de ce qui précède et de l’enjeu de la procédure, la Cour considère que la procédure suivie par les juridictions russes ne leur a pas permis de rassembler suffisamment d’éléments pour prendre une décision motivée sur la question de la résidence des enfants dans les circonstances de la cause. L’examen de l’affaire par les juridictions russes n’a pas été suffisamment approfondi.
147. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
T.M. c. ITALIE du 7 octobre 2021 requête n° 29786/19
Violation de l'article 8 : face à l’opposition de la mère de l’enfant, qui perdurait depuis 2008, et à la difficulté du requérant à exercer son droit de visite, les autorités nationales n’ont pas pris rapidement toutes les mesures nécessaires et qui pouvaient raisonnablement être exigées pour faire respecter le droit de l’intéressé d’avoir des contacts avec sa fille et d’établir une relation
a) Les principes généraux
60. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). La Cour rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).
61. La Cour rappelle également que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (Nicolò Santilli c. Italie, no 51930/10, § 67, 17 décembre 2013). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que l’article 8 de la Convention confère à celui-ci (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004).
62. En ce qui concerne la vie familiale d’un enfant, la Cour rappelle qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, entre autres, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010). Elle souligne d’ailleurs que dans les affaires dans lesquelles sont en jeu des questions de placement d’enfants et de restrictions du droit de visite, l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute autre considération (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 204, 10 septembre 2019). La plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016, et Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Le point décisif consiste donc à savoir si, en l’espèce, les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites entre le parent et l’enfant, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).
b) Application de ces principes à la présente espèce
63. Se tournant vers les faits de la présente cause, la Cour estime que, devant les circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à rechercher si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre le requérant et sa fille (Bondavalli c. Italie, no 35532/12, § 75, 17 novembre 2015) et à examiner la manière dont elles sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant tel que défini par les décisions de justice (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299‑A, et Kuppinger c. Allemagne, no 62198/11, § 105, 15 janvier 2015). Elle rappelle aussi que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 58, 2 novembre 2010), car le passage du temps peut à lui seul avoir des conséquences sur la relation d’un parent avec son enfant.
64. La Cour relève qu’à partir de 2008, quand l’enfant n’avait que cinq ans, le requérant n’a cessé de demander au tribunal que des rencontres fussent organisées, mais qu’il n’a pu exercer son droit de visite que de manière très limitée en raison de l’opposition de la mère.
65. Entre mars 2009 et août 2009, le tribunal de Messine et le juge des tutelles observèrent que le requérant ne pouvait pas avoir accès à sa fille et qu’A.L.R. persistait à s’opposer aux rencontres entre le requérant et l’enfant.
66. À partir d’octobre 2009, après le déménagement de la mère de l’enfant dans une autre ville, à environ mille kilomètres de distance, sans le consentement du requérant et des tribunaux, ce dernier n’a plus pu rencontrer sa fille, en particulier en raison du refus de la mère d’organiser des rencontres et de l’opposition de l’enfant. Aucune expertise sur les capacités parentales d’A.L.R. et du requérant n’a été ordonnée et aucune expertise psychologique concernant la mineure n’a été réalisée.
67. La Cour observe que, le 19 novembre 2009, le tribunal de Messine ordonna aux services sociaux de Messine et de Milan de suivre la situation de la famille et constata qu’A.L.R. avait eu un comportement préjudiciable à l’enfant, en ce qu’elle s’était opposée au maintien de la relation entre le requérant et sa fille. Le tribunal enjoignit à A.L.R. de se conformer aux décisions du tribunal sous peine de suspension et/ou de déchéance de l’autorité parentale.
68. Toutefois, les services sociaux de Milan, qui avaient été chargés par le tribunal de Messine en 2009 de suivre la situation de la famille, ne commencèrent ce suivi qu’en juillet 2010 et ne rencontrèrent l’enfant que cinq fois entre juillet 2010 et novembre 2010.
69. Entre 2011 et 2014, nonobstant les demandes que le requérant forma auprès du tribunal aux fins de l’obtention du droit de visite et de l’exécution des précédentes décisions du tribunal de Messine, l’intéressé ne put jamais rencontrer son enfant. Tout en reconnaissant l’importance du maintien des relations entre le requérant et sa fille, les services sociaux rencontrèrent l’enfant seulement trois fois en 2014 et informèrent le tribunal que celle-ci refusait les rencontres.
70. En 2014, compte tenu du refus de l’enfant, le tribunal de Milan décida, sans avoir évalué la nécessité d’ordonner une expertise psychologique de l’enfant, de confier sa garde exclusive à A.L.R.
71. La Cour note que le requérant interjeta appel le 13 mai 2015, mais que la première audience devant la cour d’appel fut fixée six mois plus tard, en janvier 2016, et reportée ensuite au mois de mai 2016. Les services sociaux de Milan donnèrent un avis négatif sur la nécessité d’un parcours de médiation familiale et, en décembre 2016, après avoir invité les parties à effectuer un parcours de réflexion sur leur comportement, la cour d’appel rejeta le recours du requérant, estimant que les responsabilités étaient partagées entre ce dernier et A.L.R ainsi que la demande d’application de mesures coercitives contre A.L.R. (paragraphe 41 ci-dessus).
72. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, notamment parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce ignorer les faits précédemment exposés (paragraphes 64-71 ci-dessus). En particulier, elle note que le requérant n’a cessé de tenter d’établir des contacts avec sa fille depuis 2008 et, malgré les différentes décisions du tribunal pour enfants et du juge des tutelles, les autorités n’ont pas trouvé de solution pour lui permettre d’exercer régulièrement son droit de visite. Le requérant n’a pu exercer ce droit que de manière très limitée jusqu’en 2008. L’avertissement du tribunal de Messine n’a eu aucun effet sur A.L.R., qui a continué à empêcher le requérant d’exercer son droit de visite et a même déménagé à mille kilomètres de distance sans le consentement de celui-ci et des tribunaux.
73. Certes, la Cour reconnaît que les autorités étaient confrontées en l’espèce à une situation très difficile qui découlait notamment des tensions existantes entre les parents de l’enfant. Elle admet que l’impossibilité pour le requérant d’exercer son droit de visite était au départ surtout imputable au refus manifeste de la mère de l’enfant, puis au refus de l’enfant et à la distance entre le lieu de résidence de l’enfant et celui du requérant. Elle rappelle cependant qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (Nicolò Santilli, précité, § 74, Lombardo, précité, § 91, et Zavřel, précité, § 52).
74. La Cour considère que les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce et qu’elles sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Elle estime en particulier que les juridictions internes n’ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l’enfant (Bondavalli, précité, § 81, Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010, Piazzi, précité, § 61, et Strumia, précité, § 122). Elle constate notamment que, après la transmission du dossier de Messine à Milan, les services sociaux de Milan sont intervenus avec beaucoup de retard et que, entre 2010 et 2016, ils n’ont rencontré l’enfant qu’à huit reprises.
75. La Cour estime que, dès le début de la séparation des parents, quand l’enfant avait seulement cinq ans, les juridictions internes n’ont pas pris de mesures concrètes et utiles visant à l’instauration de contacts effectifs et elle constate qu’elles ont ensuite toléré pendant environ onze ans que la mère, par son comportement, empêchât l’établissement d’une véritable relation entre le requérant et l’enfant. Elle relève que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignement, une délégation du suivi de la famille aux services sociaux, assortie de l’obligation pour ceux-ci d’organiser et de faire respecter le droit de visite du requérant (Lombardo, précité, § 92, et Piazzi, précité, § 61). Les services sociaux, de leur côté, ont agi avec retard et n’ont pas correctement exécuté les décisions judiciaires. Or, bien que l’arsenal juridique prévu par le droit italien semble suffisant, aux yeux de la Cour, pour permettre à l’État défendeur d’assurer le respect des obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention, force est de constater en l’occurrence que les autorités n’ont entrepris aucune action à l’égard d’A.L.R., lui laissant de surcroît la possibilité de déménager à plus de mille kilomètres du domicile du requérant sans le consentement de celui-ci et des tribunaux ; en particulier, sans avoir convenu au préalable avec le requérant d’un projet de coparentalité ou sans avoir soumis ledit projet au tribunal pour approbation. Après cela, les autorités n’ont adopté aucune mesure visant à empêcher le déménagement et n’ont pas non plus exécuté les précédentes décisions du tribunal de Messine qui accordaient un droit de visite au requérant. En outre, elle note qu’A.L.R. a présenté plusieurs plaintes pénales, qui ont été en partie retirées et en partie rejetées (paragraphes 5, 9 et 23 ci-dessus). Aussi la Cour estime-t-elle que les autorités ont laissé se consolider une situation, qui s’est de fait installée au mépris des décisions judiciaires. Par la suite, lorsque les autorités ont constaté que la mineure refusait de rencontrer le requérant, au lieu d’encourager l’enfant, elles ont suspendu le droit de visite, en laissant l’organisation des rencontres à l’initiative des parties.
76. La Cour note que, dans le cas d’espèce, face à l’opposition de la mère de l’enfant, qui perdurait depuis 2008, et à la difficulté du requérant à exercer son droit de visite, les autorités nationales n’ont pas pris rapidement toutes les mesures nécessaires et qui pouvaient raisonnablement être exigées pour faire respecter le droit de l’intéressé d’avoir des contacts avec sa fille et d’établir une relation (Strumia, précité, § 123).
77. En l’espèce, la Cour observe que, dans leurs dernières décisions relatives à l’exercice des droits parentaux, les juridictions internes se sont fondées exclusivement sur l’avis des services sociaux et sur le refus de l’enfant de rencontrer le requérant, qu’elle ne voyait plus depuis dix ans. La Cour note qu’elles ne se sont pas appuyées sur les rapports d’expertise, demandés à plusieurs reprises par le requérant, et qu’elles n’ont ordonné aucun soutien psychothérapeutique pour l’enfant et ses parents.
78. La Cour relève également le retard avec lequel le tribunal pour enfants de Milan et la cour d’appel ont pris leurs décisions. Elle rappelle à cet égard qu’elle peut prendre en compte, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la durée du processus décisionnel des autorités internes ainsi que celle de toute procédure judiciaire connexe. En effet, un retard dans la procédure risque toujours, en pareil cas, de trancher par un fait accompli le problème en litige. Or un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, §§ 64‑65, série A no 121, Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 136, 9 mai 2003, Solarino c. Italie, no 76171/13, § 39, 9 février 2017, et D’Alconzo c. Italie, no 64297/12, § 64, 23 février 2017).
79. Pour la Cour, un surcroît de diligence et de rapidité s’imposait dans l’adoption d’une décision touchant aux droits garantis par l’article 8 de la Convention. L’enjeu de la procédure pour le requérant exigeait un traitement urgent, car le passage du temps pouvait avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et son père, qui ne vivait pas avec elle. La Cour rappelle en effet que la rupture du contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de sa relation avec son parent. À cet égard elle note que la Cour de cassation s’est bornée à confirmer les décisions visant à suspendre le droit de visite du requérant sans avoir constaté que le parcours de suivi psychologique auquel elle se référait n’avait pas été ordonné par les juridictions (paragraphe 43 ci-dessus).
80. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant et qu’elles ont méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale.
81. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
ANAGNOSTAKIS ET AUTRES c. GRÈCE du 23 septembre 2021 requête n° 46075/16
Art 8 • Vie familiale • Obligations positives • Retards dans la procédure relative à la fixation des modalités de contact entre le père et l’enfant • Plus de cinq ans et neuf mois pour quatre instances, y compris la procédure relative aux mesures provisoires
Article 6
Principes généraux
66. La Cour rappelle que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention (voir, entre autres, Olsson c. Suède (no 1), 24 mars 1988, § 59, série A no 130, et Gluhaković c. Croatie, no 21188/09, § 54, 12 avril 2011).
67. L’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il peut cependant engendrer de surcroît des obligations positives portant entre autres sur l’effectivité des procédures d’enquête relatives à la vie familiale (voir, entre autres, Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A no 31, Gluhaković, précité, § 55, et R.B. et M. c. Italie, no 41382/19, § 65, 22 avril 2021). Cela comprend une obligation pour les autorités internes de prendre des mesures en vue de réunir les parents avec leurs enfants et de faciliter ces réunions. Cela s’applique également aux cas où des conflits de contact et de garde concernant des enfants surviennent entre les parents et/ou d’autres membres de la famille des enfants (Gluhaković, précité, § 56).
68. Étant donné qu’un respect effectif de la vie familiale requiert que les relations futures entre parent et enfant sont déterminées uniquement sur la base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (Diamante et Pelliccioni c. Saint-Marin, no 32250/08, § 177, 27 septembre 2011), la conduite inefficace, et en particulier retardée, des procédures de garde et de contact peut entraîner un manquement aux obligations positives en vertu de l’article 8 de la Convention (Eberhard et M. c. Slovénie, nos 8673/05 et 9733/05, § 127, 1er décembre 2009, et S.I. c. Slovénie, no 45082/05, § 69, 13 octobre 2011), car un retard procédural peut conduire à trancher en fait le problème en litige (H. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, § 89, série A no 120, et Improta c. Italie, no 66396/14, § 52, 4 mai 2017). Il s’ensuit que, dans les affaires concernant la relation d’une personne avec son enfant, il y a une obligation de faire preuve de diligence exceptionnelle compte tenu du risque que l’écoulement du temps pourrait entraîner une décision de fait de l’affaire. Cette obligation, qui est déterminante pour évaluer si une affaire a été entendue dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, fait également partie des exigences procédurales implicites à l’article 8 (voir, par exemple, Süß c. Allemagne, no 40324/98, § 100, 10 novembre 2005, Strömblad c. Suède, no 3684/07, § 80, 5 avril 2012, et Ribić c. Croatie, no 27148/12, § 92, 2 avril 2015).
b) Application des principes en l’espèce
α) Sur la recevabilité
69. Constatant que cette partie du grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
β) Sur le fond
70. La Cour observe que le premier requérant a introduit une demande visant à ordonner des mesures provisoires devant le tribunal le 18 décembre 2015, que par sa décision no 2924/2016 du 27 juin 2016 le tribunal a fixé provisoirement les modalités de contact avec l’enfant et que l’audience de l’affaire sur le fond a été fixée au 4 juin 2018, soit presque deux ans plus tard. Même si, à la suite de la demande en révision formée par le requérant de la décision no 2924/2016, le tribunal a fixé des contacts plus favorables, il n’en demeure pas moins que l’examen de l’affaire sur le fond est toujours pendant et que la demande principale du requérant tendait, dès le début, à obtenir des contacts partagés à égalité avec la mère de l’enfant.
71. La Cour note que la procédure en cause a débuté le 18 décembre 2015 et que l’arrêt no 1020/2021 n’a pas encore été mis au net. Elle a donc durée, à ce jour, plus de cinq ans et neuf mois pour quatre instances, y compris concernant la procédure relative aux mesures provisoires. La Cour observe que les arguments présentés par le Gouvernement ne peuvent pas expliquer un tel retard. Elle rappelle en outre qu’un retard dans la procédure risque toujours, en pareil cas, de trancher par un fait accompli le problème en litige. Eu égard à l’obligation positive de faire preuve de diligence exceptionnelle dans des affaires similaires, la Cour conclut que le laps de temps écoulé ne peut pas être considéré comme raisonnable.
72. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
73. La Cour observe que les requérants susmentionnés n’ont pas introduit d’action principale contre Mme Evgenia-Martha Karabali concernant leur droit de visite. Il s’ensuit que la période qui doit être pris en considération en l’espèce a débuté le 10 décembre 2015, date à laquelle les requérants susmentionnés ont introduit une demande visant à ordonner des mesures provisoires, et a pris fin le 27 juin 2016, date à laquelle la décision no 2924/2016 du tribunal, fixant provisoirement leur droit de visite, a été publié. La procédure a alors duré moins de six mois en ce qui les concerne.
74. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure concernant la fixation des modalités de contact des requérants susmentionnés avec l’enfant n’était pas déraisonnable et que les autorités internes n’ont alors pas manqué à leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention.
75. Dès lors, pour autant que cet aspect du grief concerne les deuxième et troisième requérants, il convient de le rejeter pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
R.B. ET M. c. ITALIE du 22 avril 2021 requête n° 41382/19
Art 8 • Vie familiale • Impossibilité pour un père d’exercer son droit de visite dans les conditions fixées par les tribunaux, à cause de l’opposition de la mère de l’enfant • Absence d’efforts adéquats et suffisants des autorités nationales pour faire respecter le droit de visite.
a) Principes généraux
65. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, nº 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, nº 31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, nº 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). La Cour rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, nº 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, nº 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo‑Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).
66. La Cour rappelle également que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (Nicolò Santilli, précité, § 67). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que confère l’article 8 de la Convention à celui-ci (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004).
67. En ce qui concerne la vie familiale d’un enfant, la Cour rappelle qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, entre autres, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010). Elle souligne d’ailleurs que, dans les affaires dans lesquelles sont en jeu des questions de placement d’enfants et de restrictions du droit de visite, l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute autre considération (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 204, 10 septembre 2019). La plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016, et Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Le point décisif consiste donc à savoir si, en l’espèce, les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites entre le parent et l’enfant, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).
b) Application de ces principes à la présente espèce
68. Se tournant vers les faits de la présente cause, la Cour estime que, devant les circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à examiner si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre le premier requérant et son fils (Bondavalli c. Italie, no 35532/12, § 75, 17 novembre 2015) et à examiner la manière dont elles sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant tel que défini par les décisions de justice (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299‑A, et Kuppinger c. Allemagne, no 62198/11, § 105, 15 janvier 2015). Elle rappelle aussi que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 58, 2 novembre 2010) pour éviter que l’écoulement du temps puisse avoir, à lui seul, des conséquences sur la relation d’un parent avec son enfant.
69. La Cour note tout d’abord qu’au moment de la séparation du couple, selon l’accord conclu entre les parties et homologué par le tribunal, la garde était confiée aux deux parents, la résidence principale de l’enfant était fixée chez la mère, et le requérant bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement.
70. La Cour constate qu’en 2013, C.C. avait signalé que l’enfant avait des comportements inquiétants. Une enquête pénale avait été ouverte contre le premier requérant et les rencontres entre celui-ci et son fils avaient été interrompues.
71. La Cour observe qu’en 2013, à la suite du classement de l’enquête, l’expert nommé par le tribunal avait observé que la relation entre C.C et l’enfant était dysfonctionnelle, que cette dernière persévérait dans son attitude d’opposition aux rencontres avec le premier requérant et alimentait auprès de l’enfant l’idée que son père avait abusé de lui.
72. À partir du classement de l’enquête en 2014, le requérant n’a plus réussi à rencontrer son fils notamment en raison de l’opposition de la mère au déroulement des rencontres et ensuite de l’opposition du mineur, qui selon les experts était programmée par la mère.
73. La Cour observe que, entre avril et novembre 2015, nonobstant les difficultés mises en évidence par les services sociaux, qui demandaient à être entendus en raison de la suspension du programme thérapeutique, le tribunal n’a pas estimé nécessaire de répondre à leur demande et a décidé d’entendre l’enfant seulement en avril 2016.
74. Ensuite, après le dépôt d’une nouvelle expertise en juillet 2017, le tribunal a ordonné la tenue de rencontres en milieu protégé en octobre 2017, lesquelles ont été organisées seulement six mois plus tard.
75. Face au refus de l’enfant de rencontrer son père, en novembre 2018, le tribunal, se fondant sur l’expertise de 2017, a ordonné le placement de l’enfant avec sa mère dans une structure thérapeutique. La Cour note, à cet égard, que cette décision n’a pas été exécutée et qu’elle a été ensuite modifiée par la cour d’appel en avril 2019.
76. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce ignorer les faits précédemment exposés (paragraphes 69-75 ci-dessus). Elle note en effet que le premier requérant a essayé d’établir des contacts avec son fils depuis 2013, et que, en dépit de l’accord de séparation lui octroyant un droit de visite et d’hébergement, il n’a pas pu exercer ce droit tout d’abord en raison de l’opposition de la mère de l’enfant et de la plainte pénale pour abus sexuel déposée par elle.
77. Certes, la Cour reconnaît que les autorités étaient confrontées en l’espèce à une situation très difficile qui découlait notamment des tensions existantes entre les parents de l’enfant. Elle admet que la non-réalisation du droit de visite du requérant était au départ surtout imputable au refus manifeste de la mère, puis à celui de l’enfant. Elle rappelle cependant qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (Nicolò Santilli, précité, § 74, Lombardo, précité, § 91, et Zavřel, précité, § 52).
78. En effet, les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce et sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. La Cour estime en particulier que les juridictions internes n’ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l’enfant (Bondavalli, précité, § 81, Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010, Piazzi, précité, § 61, et Strumia, précité). Elle constate en particulier qu’entre 2013 et avril 2018, aucune rencontre n’a eu lieu et qu’aucune mesure n’a été prise afin de rétablir le lien entre le requérant et son fils. Elle estime qu’une réaction rapide face à cette situation aurait été nécessaire eu égard à l’incidence, dans ce genre d’affaires, de l’écoulement du temps, qui peut entraver la possibilité pour le parent concerné de renouer avec son enfant qui ne vit pas avec lui.
79. La Cour considère que les juridictions internes n’ont pas pris, dès le début de la séparation et après le classement de l’enquête pénale, quand l’enfant avait seulement quatre ans, des mesures concrètes et utiles visant à l’instauration de contacts effectifs et qu’elles ont ensuite toléré pendant environ sept ans que la mère, par son comportement, empêchât l’établissement d’une véritable relation entre le père et l’enfant. La Cour relève que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements et une délégation du suivi de la famille aux services sociaux (Lombardo, précité § 92, et Piazzi, précité, § 61). Or, bien que l’arsenal juridique prévu par le droit italien semble suffisant, selon la Cour, pour permettre à l’État défendeur d’assurer le respect des obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention, force est de constater en l’occurrence que les autorités n’ont entrepris aucune action à l’égard de C.C. bien que les expertises aient mis en lumière son comportement néfaste envers l’enfant et le premier requérant. De surcroît, la décision du tribunal prévoyant l’insertion dans une structure thérapeutique n’a pas été exécutée. Aussi la Cour estime-t-elle que les autorités ont laissé se consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires (K.B. et autres c. Croatie, no 36216/13, 14 mars 2017).
80. La Cour note que, dans le cas d’espèce, face à l’opposition de la mère de l’enfant qui perdurait depuis 2013 et à la difficulté du premier requérant à exercer son droit de visite, les autorités nationales n’ont pas pris rapidement toutes les mesures nécessaires qui pouvaient raisonnablement être exigées pour faire respecter le droit du premier requérant d’avoir des contacts avec son fils et d’établir une relation (Strumia, précité, § 123).
81. La Cour note également le retard dans la prise de décision du tribunal pour enfants. Elle relève, à cet égard, qu’entre avril 2015 et avril 2016, nonobstant les demandes urgentes des services sociaux qui demandaient à être entendus en raison de la suspension du programme thérapeutique, et les recours du requérant, aucune mesure n’a été prise. L’enfant a été entendu seulement en avril 2016 (M. et M. c. Croatie, no 10161/13, §§ 1181-184, CEDH 2015 (extraits)) et une nouvelle expertise a été ordonnée en décembre 2016. La décision de placement est ensuite intervenue deux ans plus tard. La cour rappelle, à cet égard, qu’elle peut prendre en compte, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la durée du processus décisionnel des autorités internes ainsi que celle de toute procédure judiciaire connexe. En effet, un retard dans la procédure risque toujours, en pareil cas, de trancher par un fait accompli le problème en litige. Or un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, §§ 64‑65, série A no 121, Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 136, 9 mai 2003, Solarino c. Italie, no 76171/13, § 39, 9 février 2017, et D’Alconzo, précité, § 64).
82. Pour la Cour, un surcroît de diligence et de rapidité s’impose dans l’adoption d’une décision touchant aux droits garantis par l’article 8 de la Convention. L’enjeu de la procédure pour le requérant exige un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et son père, qui ne vit pas avec lui. La Cour rappelle en effet que la rupture de contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de sa relation avec son parent.
83. Quant à la nomination du curateur ad litem, la Cour note que le système national prévoit les circonstances dans lesquelles le mineur peut continuer à être représenté par ses parents même en cas de situation conflictuelle entre eux, et prévoit également, en conformité avec les principes internationaux, que le mineur participe à la procédure et qu’il soit auditionné sur ses préférences. En cas de conflit entre le mineur et ses parents ou au cas où ces derniers seraient déchus de leur autorité parentale, le mineur doit être représenté par un curateur ad litem ou par un tuteur, et si nécessaire par un avocat. Cela dit en l’espèce la Cour constate que dans un premier temps le second requérant a pu participer à la procédure, dès lors que C.C. et le premier requérant n’avaient été ni suspendus ni déchus de leur autorité parentale. Ce n’est qu’en 2020 que la cour d’appel de Gênes, en prenant acte du conflit d’intérêts entre les parents, a décidé de nommer un curateur ad litem pour l’enfant. Dans cette situation, la Cour ne saurait conclure que le processus décisionnel n’a pas suffisamment protégé les intérêts du second requérant.
84. Compte tenu des considérations exposées aux paragraphes 68 à 82 ci-dessus et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du premier requérant et qu’elles ont méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale.
Cînța c. Roumanie du 18 février 2020 requête n° 3891/19
Violations article 8 et 14 : Les restrictions apportées au droit de visite d’un père en raison de son état de santé mentale ont causé une discrimination
La CEDH dit à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, et par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 de la Convention européenne. L’affaire concernait les restrictions judiciaires apportées aux contacts du requérant avec sa fille. La Cour relève en particulier que les décisions internes de restreindre le droit de visite du requérant se sont en partie fondées sur le fait que l’intéressé était atteint de troubles mentaux. Les juridictions ne lui avaient accordé le droit de voir sa fille que deux fois par semaine en présence de la mère de l’enfant, laquelle avait également obtenu le droit de garde. Elles n’ont toutefois procédé à aucune appréciation sérieuse pour expliquer en quoi la santé mentale du requérant pouvait justifier les restrictions apportées au droit de visite de celui-ci alors même que rien n’indiquait qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de sa fille. Les juridictions internes n’ont pas non plus examiné de manière appropriée les allégations selon lesquelles l’enfant n’aurait pas été en sécurité avec son père, ni montré de quelle manière elles ont pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ou envisagé d’autres modalités de contacts. La Cour considère que les troubles mentaux dont l’intéressé souffrait ne pouvaient pas en eux-mêmes justifier qu’il fût traité différemment des autres parents demandant un droit de visite. Les juridictions internes ont fondé les restrictions qu’elles ont apportées au droit de visite du requérant sur une distinction basée sur la santé mentale de celui-ci sans toutefois fournir de motifs pertinents et suffisants pour la justifier. L’intéressé a fait valoir une présomption de discrimination que l’État défendeur n’a pas été en mesure de lever. Il y a donc eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.
LES FAITS
Le requérant, Marcel-Dan Cînța, est un ressortissant roumain né en 1965. Il réside à Baia Mare (Roumanie). En juillet 2018, M. Cînța saisit le tribunal de première instance de Baia Mare d’une demande tendant à ce que sa fille, alors âgée de quatre ans, lui soit confiée pendant la procédure de divorce entre lui et sa femme ou puisse venir régulièrement chez lui. M. Cînța avait souffert de troubles psychiatriques, tout comme sa femme qui, au moment du divorce, n’était toutefois plus signalée comme malade mentale.
En septembre 2018, le tribunal autorisa M. Cînța à voir sa fille de 18 heures à 20 heures le mardi et le jeudi, seulement dans des lieux publics et en présence de la mère. Il décida également que l’enfant devait vivre avec sa mère et que le requérant devait payer une pension alimentaire. Le tribunal fonda sa décision sur des éléments d’ordre médical qui montraient que M. Cînța souffrait d’un trouble mental chronique, ainsi que sur des déclarations de la mère qui soutenait qu’en raison de son état l’intéressé s’était montré agressif physiquement et psychologiquement. L’enfant elle-même et d’autres membres de la famille qui s’occupaient d’elle furent également entendus. Dans l’appel qu’il forma devant le tribunal départemental de Maramureş, M. Cînța argua que le tribunal de première instance n’avait pris en compte que sa maladie et qu’il l’avait fait de manière subjective et partiale. Il affirma qu’il n’avait jamais été violent à l’égard de sa fille ou de sa femme. Le tribunal départemental rejeta toutefois son appel, jugeant que les éléments d’ordre médical, les témoignages, la correspondance produite et l’attitude du requérant à l’égard de la mère de l’enfant justifiaient les restrictions apportées au droit de visite de l’intéressé.
ARTICLE 8
Article 8 La Cour note qu’il ne prête pas à controverse que les décisions internes ont entraîné une ingérence dans l’exercice par M. Cînța du droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était prévue par la loi et visait le but légitime de la protection des droits d’autrui. La question pour la Cour est donc de déterminer si elle était « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour observe que la restriction imposée à M. Cînța n’a pas été fondée sur une preuve quelconque de l’inaptitude de l’intéressé à s’occuper de sa fille mais qu’elle a reposé, au moins en partie, sur le trouble mental dont il souffrait. Parallèlement, les décisions internes n’ont apporté aucun élément qui aurait permis d’étayer les allégations selon lesquelles le requérant aurait constitué une menace pour l’enfant. Les tribunaux disposaient en effet d’une lettre d’un hôpital psychiatrique dans laquelle il était attesté que M. Cînța prenait régulièrement ses médicaments et qu’il n’avait pas récemment connu de dégradation de son état de santé. Plus important, la Cour ne voit pas quels éléments le requérant aurait pu produire pour prouver que sa santé mentale ne représentait aucun danger pour la sécurité de sa fille. Les juridictions n’ayant demandé aucune expertise nouvelle le concernant, l’appréciation factuelle des aptitudes parentales de l’intéressé, de sa vulnérabilité et de son état mental s’en est trouvée sensiblement réduite. Elle ne voit pas non plus comment les juridictions internes ont établi ou apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant. Celles-ci ont, par exemple, décidé que les contacts devaient impliquer les deux parents alors même qu’elles avaient reconnu que les relations entre eux étaient tendues. Les décisions n’ont pas non plus donné d’indication quant aux bénéfices de telles modalités de visite pour l’enfant. Par ailleurs, elles n’ont pas dûment examiné les allégations de l’enfant concernant le comportement abusif de son père, alors que le droit interne interdit de manière absolue les châtiments corporels ainsi que les traitements humiliants et dégradants à l’égard des enfants. L’absence de toute appréciation de ce type jette un doute sur l’ensemble du processus décisionnel. Aucune autre modalité de contact entre l’enfant et son père n’a été envisagée, telle que par exemple des rencontres supervisées par les autorités de protection de l’enfance. La Cour conclut que le processus qui a abouti à la décision concernant le droit de visite de M. Cînța n’a pas été mené de manière à assurer une appréciation correcte de l’état de santé de l’intéressé à l’époque des faits et la prise en compte des vues et intérêts de tous. Elle n’est pas convaincue que la procédure a été assortie des garanties qui étaient nécessaires compte tenu de la gravité de l’ingérence et de l’importance des intérêts en jeu. Il y a donc eu violation des droits du requérant tels que garantis par l’article 8.
Article 14 combiné avec l’article 8
La Cour estime qu’à raison de sa santé mentale le requérant a été traité différemment des autres parents demandant un droit de visite, et que ce motif d’une possible discrimination peut s’assimiler à une « autre situation » au sens de l’article 14. Il reste à établir si la différence de traitement était justifiée. S’il n’appartient pas à la Cour de déterminer si la santé mentale de M. Cînța amoindrissait son aptitude à s’occuper de son enfant, il lui incombe d’examiner si les autorités ont fourni des motifs suffisants pour justifier la prise en compte de la maladie de l’intéressé dans l’appréciation de sa cause. La Cour observe qu’elle a déjà conclu sur le terrain de l’article 8 que la prise en compte de la santé mentale du requérant n’a pas été accompagnée au niveau interne d’une véritable appréciation de sa situation. Le danger que M. Cînța pouvait représenter pour sa fille n’a en effet pas été évalué. La Cour doit donc en conclure que l’intéressé a été perçu comme une menace pour son enfant du simple fait de son état de santé mentale, sans aucune prise en considération des circonstances concrètes de l’affaire et de la situation familiale. Elle relève que la législation nationale reconnaît que les personnes atteintes de troubles mentaux ont droit au respect de leur vie privée et au libre exercice de leurs droits civils. La Roumanie est, en outre, partie à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et la communauté internationale dans son ensemble s’efforce de garantir aux personnes atteintes de troubles et de handicaps mentaux une protection meilleure et plus cohérente de leurs droits. La jurisprudence de la Cour elle-même reconnaît que les malades mentaux constituent un groupe vulnérable dont les droits requièrent une attention particulière.
Satisfaction équitable (article 41)
La Cour dit que la Roumanie doit verser au requérant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral.
IMPROTA c. ITALIE du 4 mai 2017 Requête no 66396/14
Violation de l'article 8 : Une expertise d'un an pour savoir si le père pouvait avoir un droit de visite de sa fille n'est pas conforme à la Conv EDH alors que la cour d'appel, pour refuser le droit de visite s'est fixé sur un ancien rapport et non un nouveau rapport.
43. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 58, CEDH 2002) et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 151, CEDH 2001‑VII).
44. La Cour rappelle aussi que l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics et qu’il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au titre de cette disposition ne se prêtent pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble, tout en attachant une importance déterminante à l’intérêt de l’enfant (Gnahoré c. France, no 40031/98, § 59, CEDH 2000‑IX), lequel peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 66, CEDH 2003‑VIII).
45. La Cour rappelle en outre que l’obligation des autorités nationales de prendre des mesures pour faciliter des rencontres entre un parent et son enfant n’est pas absolue. Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (idem, § 58). Dans ce genre d’affaire, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05 § 83, 6 décembre 2007, Zhou c. Italie, no 33773/11, § 48, 21 janvier 2014, et Kuppinger c. Allemagne, no 62198/11, § 102, 15 janvier 2015). Le facteur temps revêt donc une importance particulière, car tout retard procédural risque de trancher en fait le problème en litige (H. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, §§ 89-90, série A no 120, et P.F. c. Pologne, no 2210/12, § 56, 16 septembre 2014).
46. Par ailleurs, les autorités nationales bénéficiant de rapports directs avec tous les intéressés, la Cour répète qu’elle n’a point pour tâche de réglementer les questions de garde et de visite. Toutefois, il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions que ces instances ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. La marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes varie selon la nature des questions en litige et l’importance des intérêts en jeu.
47. Se tournant vers les faits de la présente cause, la Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté que le lien entre le requérant et son enfant relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
48. La Cour note tout d’abord que, au moment où le couple s’est séparé, C. a changé la serrure de la porte d’entrée du domicile familial, de sorte que le requérant n’y a plus eu accès. Elle constate également que C. a décidé que le requérant ne pouvait voir sa fille que deux fois par semaine pendant une demi-heure et que les rencontres entre père et fille devaient se dérouler en sa présence. Elle observe que C. s’est très tôt opposée au droit de visite du requérant et à toute relation entre ce dernier et l’enfant.
49. La Cour note encore que, le 16 novembre 2010, à la suite de difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, le requérant a saisi le tribunal de Naples afin d’obtenir la garde partagée de l’enfant et un élargissement de son droit de visite. Elle relève que le tribunal, nonobstant une demande urgente déposée par le requérant le 23 juillet 2011, ne s’est prononcé sur le droit de visite de celui-ci qu’en novembre 2011.
50. La Cour rappelle que, lorsque des difficultés apparaissent qui sont dues principalement au refus du parent avec lequel vit l’enfant de permettre des contacts réguliers entre ce dernier et l’autre parent, il appartient aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner ce manque de coopération (voir, mutatis mutandis, Tocarenco c. République de Moldova, no 769/13, § 60, 4 novembre 2014 ; Strumia, précité §§ 121‑122).
51. Elle observe que le tribunal n’a autorisé le requérant à voir sa fille en milieu protégé qu’un an après sa saisine, laissant ainsi à la mère de l’enfant, pendant cette période, la liberté de choisir unilatéralement les modalités des contacts entre l’enfant et le requérant. Elle relève ensuite que le tribunal a décidé d’autoriser uniquement des rencontres en milieu protégé entre le requérant et sa fille alors que celle-ci ne courait aucun risque et que, quatre mois plus tard, ces rencontres ont été remplacées par les services sociaux en rencontres libres. Elle constate également qu’il a fallu quinze mois aux experts pour rendre leur rapport d’expertise définitif sur la situation de l’enfant.
52. La Cour rappelle qu’elle peut prendre en compte, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la durée du processus décisionnel des autorités internes ainsi que celle de toute procédure judiciaire connexe. En effet, un retard dans la procédure risque toujours, en pareil cas, de trancher par un fait accompli le problème en litige. Or un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, §§ 64‑65, série A no 121, et Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 136, 9 mai 2003 ; Solarino c. Italie, no 76171/13, § 39, 9 février 2017 ; D’Alconzo c. Italie, no 64297/12, § 64, 23 février 2017).
53. La Cour observe que, en l’espèce, le requérant ne peut voir sa fille librement depuis le 30 avril 2010 et que, pendant les douze premiers mois de la procédure, les juridictions internes ont toléré que la mère régisse de manière unilatérale les modalités du droit de visite du requérant, qui avait été éloigné de la maison familiale. Elle estime que les juridictions internes ont donc permis que, par son comportement, C. empêche l’établissement d’une véritable relation entre le requérant et sa fille.
54. Pour la Cour, un surcroît de diligence et de rapidité s’imposait dans l’adoption d’une décision touchant aux droits garantis par l’article 8 de la Convention. L’enjeu de la procédure pour le requérant exigeait un traitement urgent, car le passage du temps pouvait avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et son père, qui ne vivait pas avec elle. La Cour rappelle en effet que la rupture de contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de sa relation avec son parent.
55. La Cour n’est pas persuadée qu’un délai d’un an était nécessaire au tribunal pour se prononcer sur la demande du requérant relative à son droit de visite, étant donné que l’enquête financière demandée ne lui était pas utile pour statuer sur la question des visites. En conséquence, elle conclut à un retard injustifié de la part des autorités nationales.
56. Par ailleurs, elle note que la cour d’appel saisie par le requérant à la suite de la décision du tribunal a rejeté la demande de l’intéressé en se fondant sur les résultats de l’ancien rapport d’expertise, sans prendre en considération que l’enfant avait commencé à voir son père régulièrement et sans demander la mise à jour dudit rapport afin de vérifier quels étaient alors la situation de l’enfant et ses rapports avec le requérant.
57. Du fait des carences constatées dans le déroulement de cette procédure, la Cour ne saurait donc considérer que les autorités italiennes ont pris toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin d’assurer au requérant le maintien d’un lien familial avec son enfant, dans leur intérêt à tous les deux.
58. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.
ENDRIZZI c. ITALIE du 23 mars 2017 requête 71660/14
Violation de l'article 8 : une situation classique, un divorce, la mère accuse le père d'attouchements sexuels sur son enfant pour pouvoir avoir la garde exclusive. Deux procédures pénales durent quatre ans, avant l'acquittement du père. La mère qui ne supportait pas d'être séparée de son enfant, a pu, pendant 7 ans, empêcher le père d'avoir des relations normales avec son enfant. Les autorités italiennes et les services sociaux ont eu des actions stéréotypées de demandes de renseignement et d'expertises mais sans aucune action concrète et effective pour que le père qui a tout de même entamé 4 référés urgence, ait pu avoir une relation familiale avec son enfant, en application des décisions judiciaires.
a) Principes généraux
46. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 58, CEDH 2002) et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (K. et T. c. Finlande [GC, no 25702/94, § 151, CEDH 2001‑VII).
47. La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics et qu’il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au titre de cette disposition ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante (Gnahoré c. France, no 40031/98, § 59 CEDH 2000‑IX) pouvant, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 66, CEDH 2003‑VIII).
48. La Cour rappelle également que l’obligation des autorités nationales de prendre des mesures pour faciliter des rencontres entre un parent et son enfant n’est pas absolue. Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (idem, § 58). Dans ce genre d’affaire, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05 § 83, 6 décembre 2007 ; Zhou c. Italie, no 33773/11, § 48, 21 janvier 2014 ; Kuppinger c. Allemagne, no 62198/11, § 102, 15 janvier 2015). Le facteur temps revêt donc une importance particulière car tout retard procédural risque de trancher en fait le problème en litige (H. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 120, pp. 63-64, §§ 89-90 ; P.F. c. Pologne, no 2210/12, § 56, 16 septembre 2014).
49. Par ailleurs, les autorités nationales bénéficiant de rapports directs avec tous les intéressés, la Cour répète qu’elle n’a point pour tâche de réglementer les questions de garde et de visite. Toutefois, il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions que ces instances ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. La marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes varie selon la nature des questions en litige et l’importance des intérêts en jeu.
50. La Cour reconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude en particulier en matière de droit de garde. Il faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties juridiques destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations familiales entre un jeune enfant et l’un de ses parents ou les deux (Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, §§ 62-63, CEDH 2003-VIII).
51. La Cour rappelle encore que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 82 12 janvier 2006,). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures propres à réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et, notamment, des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits qui sont conférés à ce dernier par l’article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004). Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005 et Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016) et l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], nº 25735/94, §§ 49‑50, CEDH 2000‑VIII).
b) Application de ces principes à la présente espèce
52. Se tournant vers les faits de la présente cause, la Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté que le lien entre le requérant et son enfant relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
53. Dans la présente affaire, la Cour note tout d’abord que, au moment de la séparation du couple, T.L.G. est partie vivre avec l’enfant, âgé de six mois, à mille kilomètres de distance du lieu de résidence du requérant. Elle relève que, selon l’accord conclu entre les parties, la garde était confiée aux deux parents, la résidence principale de l’enfant était fixée chez la mère, en Sicile, et le requérant bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement très étendu. Elle observe que T.L.G. s’est très tôt opposée au droit de visite du requérant et à toute relation entre ce dernier et l’enfant.
54. La Cour constate que, en 2007, T.L.G. a déposé une première plainte contre le requérant pour violences sexuelles sur l’enfant. Cette première plainte a été classée en 2008. La Cour note que, par la suite, toujours en 2008, T.L.G. a déposé une deuxième plainte devant le parquet de Catane. Elle relève que le parquet de Catane n’a rendu sa décision de classement de la plainte que trois ans plus tard et que, entre-temps, une procédure visant à déchoir le requérant de son autorité parentale avait été engagée et les rencontres entre celui-ci et son fils interrompues.
55. La Cour observe que, en 2011, les experts ont exclu que l’enfant eût subi des violences sexuelles et souligné, par la même occasion, qu’il souffrait du conflit existant entre ses parents et d’un abus psychologique. La Cour relève que, par conséquent, le tribunal de Catane, compte tenu du classement de la plainte pénale, a décidé qu’il n’y avait plus lieu d’interdire les contacts entre le requérant et son fils. À cet égard, elle note que, entre août 2011 et avril 2015, aucune rencontre n’a eu lieu et qu’aucune mesure n’a été prise afin de rétablir le lien entre le requérant et son fils. Elle estime qu’une réaction rapide face à cette situation aurait été nécessaire eu égard à l’incidence, dans ce genre d’affaires, de l’écoulement du temps, qui peut entraver la possibilité pour le parent concerné de renouer avec l’enfant.
56. La Cour constate que, par la suite, en 2015, le tribunal chargé de se prononcer sur le divorce, après avoir observé que l’enfant se trouvait dans une situation très difficile puisqu’il ne voyait plus son père depuis plusieurs années, a demandé au service de neuropsychiatrie de Acireale de rendre un rapport sur l’exécution de la décision du tribunal du 26 octobre 2011. Elle relève que, de plus, l’expert nommé par le tribunal a suggéré une reprise des rencontres entre le requérant et l’enfant et la poursuite du parcours psychologique de l’enfant.
57. La Cour note également que, en 2016, afin d’empêcher toute rencontre entre le requérant et son fils, T.L.G. a saisi à nouveau le tribunal afin de suspendre les rencontres organisées par le tribunal civil de Catane en raison de nouveaux soupçons d’attouchements sexuels. Elle constate que, après avoir ordonné aux services sociaux d’enquêter sur la situation de la famille, le tribunal s’est déclaré incompétent.
58. La Cour observe que la situation perdure et que, à ce jour, le requérant ne peut toujours pas avoir de contact avec son fils.
59. Certes, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce ignorer les faits précédemment exposés (paragraphes 51-58 ci-dessus). Elle note en effet que le requérant a essayé d’établir des contacts avec son fils depuis 2007, et que, en dépit des décisions du tribunal et de la cour d’appel lui reconnaissant un droit de visite, il n’a pas pu exercer ce droit en raison de l’opposition de la mère de l’enfant et des plaintes pénales pour violences sexuelles déposées par cette dernière.
60. La Cour reconnaît que les autorités faisaient en l’espèce face à une situation très difficile en raison, notamment, des tensions existant entre le requérant et son ex-épouse. Elle estime cependant qu’un manque de coopération entre des parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir Lombardo c. Italie, no 25704/11, § 91, 29 janvier 2013 ; Fourkiotis c. Grèce no 74758/11, § 72, 16 juin 2016, et, mutatis mutandis, Reigado Ramos, précité, § 55, et Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 52, 18 janvier 2007).
61. La Cour considère que les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce et qu’elles sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Elle estime en particulier que les juridictions internes n’ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l’enfant (§ 81, Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010, et Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 61, 2 novembre 2010 et Bondavalli c. Italie, no 35532/12, § 90, 17 novembre 2015) et qu’elles n’ont pas pris, dès le début de la séparation, de mesures utiles visant à l’instauration de contacts effectifs compte tenu de la distance séparant les résidences du requérant et de son fils. Elle constate que, après une première plainte pénale classée dans un délai d’un an par le parquet de Trente, il a fallu trois ans au parquet de Catane pour classer la deuxième plainte.
62. La Cour constate qu’il ressort du dossier que entre mai 2009 et octobre 2011, date à laquelle le tribunal rendit sa décision, les services sociaux ne se sont pas activés afin de renouer le lien entre le requérant et son fils mêmes si des expertises avaient été demandées et un projet de soutien devait être mis en place pour aider les deux parents à améliorer leur capacités parentales (paragraphes 16-19 ci –dessus). Elle relève à cet égard qu’entre novembre 2009 et octobre 2010, le requérant avait déposé devant ce tribunal cinq recours urgents afin de pouvoir rencontrer son fils, nonobstant le fait que, en 10 juin 2009, le parquet avait donné son avis favorable aux rencontres entre lui et l’enfant.
La Cour observe que les juridictions ont ensuite toléré pendant environ sept ans que la mère, par son comportement, empêchât l’établissement d’une véritable relation entre le requérant et l’enfant.
63. La Cour relève que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements et une délégation du suivi de la famille aux services sociaux, (Piazzi, précité, § 61 et Lombardo, précité, § 92). Aussi estime-t-elle que les autorités ont laissé se consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires (Fourkiotis, précité, § 70).
64. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant et qu’elles ont méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale.
65. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
ALCONZO c. ITALIE du 23 février 2017 requête n° 64297/12
Violation de l'article 8 : une situation classique, un divorce, la mère accuse le père d'attouchements sexuels sur ses enfants pour pouvoir avoir la garde exclusive. Une procédure pénale qui dure toute l'enfance des enfants, avant l'acquittement du père. La CEDH condamne la durée de la procédure pénale et les empêchements du père de voir ses enfants durant la procédure pénale trop longue. En revanche, elle constate les efforts des autorités italiennes pour que le père puise voir ses enfants, après sa relaxe mais il est trop tard, les enfants subissent le syndrome d'abandon du père !
55. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 58, CEDH 2002) et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 151, CEDH 2001‑VII).
56. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés, ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, nº 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo‑Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). Par ailleurs, les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui ; elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo‑Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).
Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante (Gnahoré c. France, no 40031/98, § 59 CEDH 2000‑IX) pouvant, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 66, CEDH 2003‑VIII).
57. En outre, la Cour rappelle que, pour être adéquates, les mesures propres à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004‑V (extraits), Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin 2006, et Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 84, 2 septembre 2010). Le facteur temps revêt donc une importance particulière car tout retard procédural risque de trancher en fait le problème en litige (H. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 120, pp. 63-64, §§ 89-90 ; P.F. c. Pologne, no 2210/12, § 56, 16 septembre 2014).
58. La Cour rappelle encore que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Mihailova, précité, § 82). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures propres à réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et, notamment, des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits qui sont conférés à ce dernier par l’article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004). Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016, et Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005) et l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], nº 25735/94, §§ 49‑50, CEDH 2000‑VIII).
59. La Cour rappelle enfin que, si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, le processus décisionnel lié aux mesures d’ingérence doit être équitable et propre à respecter les intérêts protégés par cette disposition. Il échet dès lors de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l’ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour « nécessaire » au sens de l’article 8 (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, § 64, série A no 121).
60. En l’espèce, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 8 de la Convention et se propose de commencer son examen sous l’angle du volet procédural de cette disposition.
a) Quant aux retards déraisonnables qui seraient survenus dans la procédure pénale menée à l’encontre du requérant
61. Le requérant se plaint que la durée de la procédure pénale ait prolongé sa séparation d’avec ses enfants et qu’elle ait fait obstacle à la construction d’une véritable relation.
62. La Cour relève d’abord que le requérant était soupçonné d’avoir commis des abus sexuels sur la personne de ses enfants, C.L.M. ayant déposé une plainte pénale dans ce sens en mars 2011. Aussi estime-t-elle que, en attendant l’issue de l’enquête préliminaire, l’intérêt des enfants justifiait la suspension et la restriction du droit parental et du droit de visite du requérant, et qu’il légitimait l’ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale. L’ingérence était donc, jusqu’à l’issue de l’enquête préliminaire, « nécessaire à la protection des droits d’autrui », en l’espèce les droits des enfants.
63. Toutefois, ce même intérêt des enfants exigeait aussi de permettre au lien familial de se développer à nouveau dès que les mesures prises n’étaient plus apparues comme nécessaires (Olsson c. Suède (no 2), no 13441/87, § 90, série A no 250).
64. La Cour rappelle ensuite qu’elle peut aussi prendre en compte, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la durée du processus décisionnel des autorités internes ainsi que toute procédure judiciaire connexe. En effet, un retard dans la procédure risque toujours en pareil cas de trancher le litige par un fait accompli. Or un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (W. c. Royaume-Uni, précité, §§ 64 et 65, et Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 136, 9 mai 2003).
65. En l’espèce, la Cour note que, en octobre 2012, à la suite du rapport d’expertise, daté du 20 septembre 2011, selon lequel l’enfant ne présentait aucun signe de violence (paragraphe 16 ci-dessus), le parquet du tribunal de Viterbo a attendu treize mois avant de demander au GIP le classement des plaintes pénales.
66. La Cour constate que le GIP a attendu plus de six mois avant de se prononcer sur la demande de classement du parquet. Pendant ce temps, le requérant n’a pu exercer la moindre influence sur l’issue de la procédure et il n’a eu à disposition aucun recours un recours lui permettant de faire accélérer la procédure. En outre, entre la date à laquelle l’intéressé a été renvoyé en jugement (29 mai 2013) et la date à laquelle le GUP a tenu l’audience préliminaire (17 mars 2014) et s’est prononcé sur le fond de l’affaire, presque dix mois se sont écoulés.
67. La Cour n’est pas persuadée qu’un tel délai était nécessaire. En conséquence, elle conclut à un retard injustifié de la part des autorités nationales. En outre, pendant cette période, le requérant a eu un accès limité à ses enfants. En effet, à la suite de la décision du tribunal du 12 décembre 2012 ordonnant à la mère des enfants d’exécuter les décisions du tribunal et celles des services sociaux imposant que les rencontres eussent lieu même en cas de réticence des enfants, seules quelques rencontres entre le requérant et ses enfants ont été organisées. De plus, l’intéressé a dû attendre la décision d’acquittement pour demander à être rétabli dans son autorité parentale et pouvoir exercer un droit de visite élargi.
68. Pour la Cour, un surcroît de diligence et de rapidité s’imposait dans l’adoption d’une décision touchant aux droits garantis par l’article 8 de la Convention. Elle rappelle que l’enjeu de la procédure pour le requérant exigeait un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. En effet, la rupture de contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de sa relation avec son parent.
69. La Cour observe que, si la restriction des relations entre le requérant et ses enfants était justifiée tant que la procédure pénale à l’encontre du requérant n’était pas terminée, des retards déraisonnables sont survenus dans la procédure pénale, lesquels ont eu un impact direct et déterminant sur le droit à la vie familiale de l’intéressé. Du fait des carences constatées (Errico c. Italie, no 29768/05, § 61, 24 février 2009) dans le déroulement de cette procédure, la Cour ne saurait donc considérer que les autorités italiennes ont pris toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin de restaurer la vie familiale du requérant avec ses enfants, dans leur intérêt à tous.
70. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention sur ce point.
b) Quant aux mesures prises par les autorités afin de faire respecter le droit de visite du requérant à la suite de son acquittement
71. La Cour estime que, eu égard aux circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à examiner si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre le requérant et ses enfants (Bondavalli c. Italie, no 35532/12, § 75, 17 novembre 2015) et à examiner la manière dont les autorités sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant tel que défini par les décisions de justice (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299‑A, et Kuppinger c. Allemagne, n 62198/11, § 105, 15 janvier 2015). Elle rappelle aussi que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 58, 2 novembre 2010).
72. La Cour rappelle qu’elle a conclu en l’espèce que la durée de la procédure pénale à l’encontre du requérant était excessive et que les autorités italiennes n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin de restaurer la vie familiale du requérant avec ses enfants (paragraphe 69 ci-dessus). De plus, elle rappelle que, auparavant, le requérant avait été séparé pendant longtemps de ses enfants lors de leur enlèvement opéré par C.L.M. (paragraphe 6 ci-dessus) et que, pendant l’enquête pénale, l’absence de coopération de C.L.M. avait rendu difficile le déroulement des rencontres. Par conséquent, au moment de l’acquittement du requérant en 2014, la relation entre celui-ci et ses enfants était complexe.
73. La Cour note qu’il ressort des développements récents de la procédure que, depuis l’acquittement du requérant en mai 2014, les autorités internes ont déployé des efforts pour lui permettre d’exercer son droit de visite. En particulier, les services sociaux ont organisé la tenue des rencontres selon les modalités prévues, plusieurs expertises psychologiques des enfants ont été ordonnées et des rapports sur le déroulement des rencontres ont été rédigés. Le requérant a cependant dû faire face au refus de ses enfants, plus particulièrement à celui de D.A., de le voir et de nouer une relation avec lui.
74. Depuis mai 2014, le tribunal et la cour d’appel se sont prononcés à plusieurs reprises (paragraphes 32, 34, 36 et 40 ci-dessus) en modifiant l’exercice du droit de visite du requérant sur le fondement des expertises réalisées. La Cour estime que, confrontées aux graves incompréhensions existant entre les deux parents, les autorités ont pris, à partir de 2014, les mesures nécessaires pour inciter ceux-ci à collaborer et pour rétablir les relations entre le requérant et ses enfants. En effet, plusieurs rapports des services sociaux ont été déposés ; un parcours thérapeutique pour les parents a été ordonné, les enfants ont été préparés et accompagnés aux rencontres par les opérateurs des services sociaux, qui ont suivi attentivement les rencontres et ont informé le tribunal et la cour d’appel.
75. La Cour reconnaît que les autorités étaient confrontées en l’espèce à une situation très difficile, qui découlait notamment des graves incompréhensions mutuelles des parents et des plaintes réciproques de ceux-ci. En effet, la non-réalisation du droit de visite du requérant était imputable surtout au refus manifeste de la mère, puis à celui des enfants, suscité par celle-ci. Cela étant, elle rappelle qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (Nicolò Santilli, précité, § 74, Lombardo, précité, § 91, et Zavřel, précité, § 52). À cet égard, la Cour rappelle qu’il appartient à l’État défendeur de choisir les moyens lui permettant d’assurer le respect des obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8. Dans la présente affaire, la Cour a pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités italiennes étaient adéquates et suffisantes.
76. En l’espèce, la Cour estime que les autorités ont pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du requérant (voir, a contrario, Bondavalli, précité § 81, Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010, et Piazzi, précité, § 61). Elles ont pris des mesures utiles visant à l’instauration de contacts effectifs (voir, a contrario, Lombardo, précité, § 92, et Piazzi, précité, § 61) et elles ont mis en place un projet visant au rapprochement entre le requérant et ses enfants.
77. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent et à la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales ont, à partir de mai 2014, déployé les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour garantir le respect du droit de visite du requérant, conformément aux exigences du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation du droit à la vie familiale du requérant sur ce point.
OLARINO c. ITALIE du 9 février 2017 requête 76171/13
Violation de l'article 8 : L'histoire est classique, un divorce, le père est accusé d'attouchements sur mineur pour qu'il
ne puisse pas voir sa fille.. Bien évidemment la mère vénale n'oublie pas de réclamer les pensions alimentaires. La fille va mal. Elle subit un abandon du père alors qu'une expertise exclut tout abus sexuel. 37. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément
fondamental de la vie familiale (Kutzner c. Allemagne, no
46544/99, § 58, CEDH 2002) et que des mesures internes qui les en empêchent
constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention
(K. et T. c. Finlande
[GC], no
25702/94, § 151, CEDH
2001‑VII). 38. La Cour
rappelle que l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir
l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics et qu’il peut
engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect »
effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et
les obligations négatives de l’État au titre de cette disposition ne se prête
pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins
comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager
entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble
en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit
constituer la considération déterminante (Gnahoré
c. France, no
40031/98, § 59 CEDH 2000‑IX) pouvant, selon sa nature et sa gravité,
l’emporter sur celui des parents (Sahin c. Allemagne [GC], no
30943/96, § 66, CEDH
2003‑VIII). 39. La Cour
rappelle également que l’obligation des autorités nationales de prendre des
mesures pour faciliter des rencontres entre un parent et son enfant n’est pas
absolue. Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont
pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on
pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (idem,
§ 58). Dans ce
genre d’affaire, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa
mise en œuvre, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables
sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (Maumousseau
et Washington c. France, no
39388/05 § 83, 6
décembre 2007 ; Zhou c. Italie,
no
33773/11, § 48, 21 janvier 2014 ; Kuppinger
c. Allemagne, no
62198/11, § 102, 15 janvier 2015). Le facteur temps revêt donc une
importance particulière car tout retard procédural risque de trancher en fait le
problème en litige (H. c. Royaume-Uni,
arrêt du 8 juillet 1987, série A no 120, pp. 63-64, §§ 89-90 ;
P.F.
c. Pologne, no
2210/12, § 56, 16 septembre 2014). 40. Par ailleurs,
les autorités nationales bénéficiant de rapports directs avec tous les
intéressés, la Cour répète qu’elle n’a point pour tâche de réglementer les
questions de garde et de visite. Toutefois, il lui incombe d’apprécier sous
l’angle de la Convention les décisions que ces instances ont rendues dans
l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. La marge d’appréciation laissée aux
autorités nationales compétentes varie selon la nature des questions en litige
et l’importance des intérêts en jeu. 41. La Cour
reconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude en particulier en
matière de droit de garde. Il faut en revanche exercer un contrôle plus
rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les
autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties juridiques
destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants
au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le
risque d’amputer les relations familiales entre un jeune enfant et l’un de ses
parents ou les deux (Sommerfeld c. Allemagne
[GC], no
31871/96, §§ 62-63,
CEDH 2003-VIII). 42. En l’espèce, la
Cour relève que les décisions par lesquelles les autorités nationales ont décidé
de restreindre le droit de visite du requérant ont effectivement constitué une
ingérence dans le droit de ce dernier au respect de sa vie familiale et qu’il en
résultait une obligation positive pour l’État de maintenir les relations
personnelles entre les intéressés (T. c.
République tchèque, no
19315/11, § 105, 17
juillet 2014). 43. Elle note que
les mesures prises, fondées sur les dispositions pertinentes en la matière du
code civil, étaient prévues par la loi. Il ressort des motifs retenus par les
juridictions internes que leur application avait pour objectif la sauvegarde des
intérêts de l’enfant. Les mesures incriminées poursuivaient donc un but légitime
au regard du second paragraphe de l’article 8 de la Convention, à savoir la
protection des droits et libertés d’autrui. Il convient encore d’examiner, à la
lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier les
mesures litigieuses étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2
in fine de
l’article 8 de la Convention. 44. À cet égard, la
Cour constate tout d’abord que, en 2006, le requérant bénéficiait d’un droit de
visite élargi en vertu de la décision prononcée par le tribunal de Catane le 13
juin 2006 et que, à la suite de la plainte pour abus sexuels déposée par la mère
de l’enfant, ledit tribunal a suspendu l’exercice de ce droit dans l’attente de
l’aboutissement de l’enquête pénale. Aussi la Cour estime‑t-elle que, en
attendant l’issue de l’enquête pénale, l’intérêt de l’enfant justifiait la
suspension et la restriction du droit parental et du droit de visite du
requérant et qu’il légitimait l’ingérence dans le droit de ce dernier au respect
de sa vie familiale. L’ingérence était donc, jusqu’à l’issue de l’enquête
préliminaire, « nécessaire à la protection des droits d’autrui », en l’espèce
les droits de l’enfant. 45. La Cour
rappelle cependant que ce même intérêt de l’enfant exigeait aussi de permettre
au lien familial de se développer à nouveau dès que les mesures prises ne
seraient plus apparues comme nécessaires (Olsson
c. Suède (no
2), 27 novembre 1992, § 90, série A no
250). 46. En l’espèce, la
Cour constate que, à la suite du classement de la plainte pénale, le tribunal
pour enfants a décidé, par une décision du 26 mars 2009, en se basant sur
l’expertise menée sur la mineure et le requérant, que celui-ci pouvait à nouveau
rencontrer l’enfant, après avoir relevé que cette dernière était très contente
de voir son père. 47. La Cour note
toutefois que, à la demande de la mère, à partir de septembre 2009, le droit de
visite a à nouveau été limité et que, le 29 juillet 2011, la cour d’appel, sans
prendre en considération l’expertise établie dans un sens favorable au
requérant, et nonobstant le classement de la plainte pénale, a décidé
d’interdire tout contact entre l’enfant et les grands-parents paternels et de
restreindre le droit de visite du requérant, portant le nombre de rencontres à
une par semaine, en milieu protégé, jusqu’à ce que la mineure atteignît l’âge de
dix ans. Elle relève que la décision de la cour d’appel était principalement
motivée par des soupçons, exprimés par la mère de l’enfant, que le requérant et
les grands‑parents paternels s’étaient livrés à des attouchements sexuels sur la
fillette. 48. La Cour observe
ensuite que ce n’est qu’en novembre 2013 que le requérant a pu recommencer à
rencontrer librement la mineure, hors milieu protégé, deux fois par semaine, à
la suite de la décision du tribunal de Catane qui avait souligné qu’aucune
atteinte à l’intégrité de l’enfant ne pouvait être relevée. 49. La Cour
constate également que, en se basant sur le rapport d’expertise déposé en 2011,
le tribunal de Catane a déclaré en juin 2015 que l’enfant, qui était alors âgée
de plus de dix ans, avait subi un préjudice très grave en raison de l’altération
de la relation avec son père, ses grands‑parents paternels et son demi-frère, né
entre-temps. Selon le tribunal, la décision prise par la cour d’appel le 29
juillet 2011 était la conséquence d’une appréciation erronée de l’expertise et
était basée sur des arguments non pertinents. 50. La Cour relève
à cet égard que la cour d’appel n’a pas pris en considération l’expertise menée
sur l’enfant et le requérant et que, en outre, les soupçons pesant sur ce
dernier et sur les grands-parents paternels de s’être livrés à des attouchements
sexuels sur la mineure étaient le motif principal pour lequel le droit de visite
de l’intéressé avait été limité. 51. La Cour est
d’avis, à l’instar du tribunal de Catane, que les motifs de la décision
incriminée montrent que la juridiction nationale en cause, qui n’a pris en
considération ni l’expertise ayant exclu les abus sexuels ni le classement de la
plainte, n’a pas examiné avec soin la situation de l’enfant. Elle observe que la
cour d’appel a en revanche estimé, sur la base de simples soupçons, que le
maintien de contacts avec le requérant et les grands-parents paternels pouvait
être préjudiciable au développement de l’enfant. 52. La Cour estime
que, eu égard à l’importance de la question en jeu – à savoir la relation entre
un parent et son enfant –, cette juridiction n’aurait pas dû se baser sur de
simples soupçons pour restreindre le droit de visite du requérant et considérer,
en dépit des conclusions de l’expertise susmentionnée et du classement de la
plainte pénale, que le maintien de contacts avec le père et les grands‑parents
paternels pouvait nuire au développement de la mineure. 53. À la lumière de
ce qui précède, la Cour considère que la cour d’appel n’a pas fait état de
motifs suffisants et pertinents pour justifier sa décision, ultérieurement
réformée par deux décisions successives du tribunal de Catane, de restreindre le
droit de visite du requérant pour la période comprise entre septembre 2009 et
novembre 2013. 54. Dès lors, la
Cour conclut que les autorités nationales ont outrepassé leur marge
d’appréciation et qu’elles ont donc enfreint, dans le chef du requérant, les
droits garantis par l’article 8 de la Convention. Kacper Nowakowski c. Pologne du 10 janvier 2017 requête no 32407/13 Violation de l'article 8 : Les autorités
polonaises n’ont pas facilité les contacts entre un père sourd-muet et son fils La Cour souligne l’importance pour un
enfant de préserver et de développer ses liens avec sa famille et considère que,
en principe, il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que celui-ci garde des
contacts avec ses deux parents. De plus, le droit pour M. Nowakowski de voir son
fils n’a jamais été contesté devant les tribunaux nationaux. La Cour analyse les
motifs pour lesquels les juridictions nationales ont rejeté la demande
d’élargissement du droit de visite de M. Nowakowski, compte tenu des deux
caractéristiques particulières de l’espèce, à savoir le grave conflit entre les
parents et le handicap de M. Nowakowski ainsi que celui de son fils. S’agissant
du conflit entre les parents, les juridictions nationales étaient conscientes de
l’animosité entre eux, qui était notamment apparue au grand jour dans la
procédure parallèle concernant l’autorité parentale. En outre, les experts
qu’elles avaient désignés pour recueillir leur avis sur le droit de visite
avaient constaté l’existence d’un conflit entre les parents et recommandé que
ceux-ci consultent des spécialistes, soulignant la nécessité d’autres modalités
pour le droit de visite. Or, les juridictions n’ont pas tenu compte de la
recommandation des experts, la mère ayant déjà participé à un groupe de soutien
parental et le père s’étant déclaré disposé à s’y joindre. Elles n’ont pas non
plus dûment songé à recourir aux différents moyens juridiques prévus par la
législation interne qui auraient permis d’élargir les contacts entre M.
Nowakowski et son fils. Dès lors, si les problèmes relationnels entre les
parents n’ont certes pas facilité la tâche des juridictions lorsqu’elles ont
statué sur le droit de visite, celles-ci auraient dû néanmoins prendre des
mesures pour concilier les intérêts divergents des parties, en tenant compte du
caractère primordial de l’intérêt de l’enfant. Pour ce qui est du handicap de M.
Nowakowski et de ses difficultés de communication avec son enfant, la Cour
constate que la solution que les juridictions ont trouvée consistait à associer
la mère à l’exercice du droit de visite, étant donné qu’elle pouvait communiquer
aussi bien oralement qu’avec le langage des signes. Or, cette solution faisait
abstraction de l’animosité entre les parents et de ce que M. Nowakowski s’était
souvent plaint que la mère tentait d’entraver les contacts et de marginaliser le
rôle du père. De plus, les juridictions n’ont pas envisagé des mesures plus
adaptées au handicap de M. Nowakowski, par exemple recueillir l’avis d’experts
connaissant les problèmes des personnes atteintes de problèmes auditifs. En
effet, elles se sont appuyées sur des expertises mettant en avant les
difficultés de communication entre le père et son fils au lieu de réfléchir aux
moyens permettant de les surmonter. Enfin, la Cour note que, avec le temps,
maintenir le même droit de visite restreint risquait de rompre le lien entre M.
Nowakowski et son fils. En conclusion, la Cour estime que les juridictions
nationales n’ont pas pris toutes les mesures qui s’imposaient pour faciliter les
contacts de M. Nowakowski avec son fils, en violation de l’article 8. Compte
tenu de l’analyse ci-dessus et de la violation constatée, la Cour dit qu’il n’y
a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré par M. Nowakowski d’une violation
de l’article 14, en combinaison avec l’article 8. Arrêt GIORGIONI c. ITALIE du 15 septembre 2016, requête 43299/12 Violation de l'article 8 : Le droit de visite du père n'a pas été sauvegardé, face à l'opposition de la mère alors que
rien ne s'opposait à la garde partagée de l'enfant. a) Principes généraux 62. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a
essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de
s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent
s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie
privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au
respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux,
dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer
les droits légitimes des intéressés, ainsi que le respect des décisions
judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir,
mutatis mutandis,
Zawadka c. Pologne, nº
48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter
des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de
conflit opposant les deux parents (voir, mutatis
mutandis,
Ignaccolo‑Zenide c. Roumanie, no
31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c.
Autriche, nos
36812/97 et
40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c.
République tchèque, no
14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova
c. Bulgarie, no
35978/02, § 80, 12 janvier 2006). Par ailleurs, les obligations positives ne
se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir
un contact avec lui ; elles englobent également l’ensemble des mesures
préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir,
mutatis mutandis,
Kosmopoulou c. Grèce, no
60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai
c. Roumanie, no
4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo‑Zenide,
précité, §§ 105 et 112, et Sylvester,
précité, § 70). 63. En outre, la
Cour rappelle que, pour être adéquates, les mesures propres à réunir le parent
et son enfant doivent être mises en place rapidement, car l’écoulement du temps
peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et
celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir,
mutatis mutandis,
Ignaccolo-Zenide, précité, § 102,
Maire c. Portugal, no
48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII, Pini et autres
c. Roumanie, nos
78028/01 et
78030/01, § 175, CEDH 2004‑V (extraits),
Bianchi c. Suisse, no
7548/04, § 85, 22 juin 2006, et Mincheva c.
Bulgarie, no
21558/03, § 84, 2 septembre 2010). 64. La Cour
rappelle que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas
automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives
qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (voir,
mutatis mutandis,
Mihailova, précité, § 82). En effet, l’obligation
pour les autorités nationales de prendre des mesures propres à réunir l’enfant
et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et
la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un
facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter
pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en
la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts
et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et, notamment, des intérêts
supérieurs de l’enfant et des droits qui sont conférés à ce dernier par
l’article 8 de la Convention (Voleský c.
République tchèque, no
63267/00, § 118, 29 juin 2004). Comme la jurisprudence de la Cour le
reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il
s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova
et Savik c.
l’ex-République yougoslave de Macédoine, no
42534/09, § 77, 11 février 2016, Reigado
Ramos c. Portugal, no
73229/01, § 53, 22 novembre 2005) et l’article 8 de la Convention ne saurait
autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au
développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne
[GC], nº
25735/94, §§ 49‑50, CEDH 2000‑VIII). La tâche de la Cour en l’occurrence
consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les
visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger
d’elles pour maintenir les liens entre le requérant et son fils (Manuello
et Nevi c. Italie, no
107/10, § 52, 20 janvier 2015) et à examiner la manière dont les autorités
sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant tel
que défini par les décisions de justice (Hokkanen
c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no299‑A,
et Kuppinger c. Allemagne,
no
62198/11, § 105, 15 janvier 2015). b) Application de
ces principes à la présente espèce 65. La Cour estime
nécessaire d’examiner les griefs du requérant sur deux périodes distinctes : la
première période de août 2006 à novembre 2010, et la deuxième période de
novembre 2010 à 2016. i. Période entre
août 2006 et novembre 2010 66. La Cour note
tout d’abord que, au moment de leur séparation, le requérant et la mère de
l’enfant n’étaient pas parvenus à un accord sur les modalités du droit de visite
paternel. Elle observe que la mère de l’enfant s’est très tôt opposée au droit
de visite du requérant. 67. La Cour relève
que, à partir de 2007, le requérant n’a cessé de demander au tribunal
l’organisation de rencontres avec son fils, mais qu’il n’a pu exercer son droit
de visite que de manière très limitée en raison de l’opposition de la mère de
l’enfant. 68. À cet égard,
elle constate que, déjà en 2008, dans leur premier rapport, l’expert avait
observé que la garde de l’enfant devait être confiée aux deux parents et que
l’enfant devait rencontrer le requérant sans la présence de sa mère. Face à
cette situation, le tribunal s’est limité dans un premier temps à ordonner à la
mère de l’enfant et aux services sociaux de se conformer à ses décisions (le 22
juin 2008, le 28 avril 2009 et le 27 avril 2010 – paragraphes 8-16 ci-dessus).
Toutefois, les rencontres entre le requérant et son fils ont été réduites en
nombre et leur organisation a été difficile. 69. La Cour note
ensuite que en 2010 le tribunal a reconnu que le requérant n’avait pas pu
exercer son droit de visite en raison, en particulier, du non-respect par C.M.
de ses décisions. 70. A cet égard, la
Cour relève que, entre août 2006 et avril 2010, la plupart des rencontres
autorisées entre le requérant et son fils n’ont pas été organisées ou se sont
déroulées en présence de C.M. Elle estime qu’une réaction rapide à cette
situation aurait été nécessaire eu égard à l’incidence, dans ce genre
d’affaires, de l’écoulement du temps, celui-ci pouvant avoir des effets négatifs
quant à la possibilité pour le parent concerné de renouer une relation avec
l’enfant. 71. La Cour note
également que, par la suite, en 2010 le tribunal a pris acte de ce que la mère
avait sciemment œuvré à empêcher toute relation entre l’enfant et le requérant
et que, nonobstant les décisions des juridictions internes, elle persistait dans
son comportement. 72. La Cour observe
que la situation a ainsi perduré jusqu’en novembre 2010, lorsque le requérant
refusa de voir l’enfant en la présence de C.M. 73. La Cour
rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des
autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises,
car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle
évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le
contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado
Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut
en l’espèce ignorer les faits précédemment exposés (paragraphes 67-72
ci-dessus). Le requérant a essayé d’établir des contacts avec son fils depuis
2006, et, en dépit des décisions du tribunal lui reconnaissant un droit de
visite, il n’a pu exercer son droit de visite que de manière très limitée en
raison de l’opposition de la mère de l’enfant. 74. La Cour
reconnaît que les autorités faisaient en l’espèce face à une situation très
difficile, qui était notamment due aux tensions existant entre le requérant et
son ex-compagne. Elle estime cependant qu’un manque de coopération entre les
parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre
tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir
Fourkiotis c. Grèce
no74758/11
§ 72, 16 juin 2016, Lombardo,
précité, § 91, et voir aussi, mutatis mutandis,
Reigado Ramos,
précité, § 55 Zavřel,
précité, § 52). 75. En effet, les
autorités n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce et
sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. En
particulier, les juridictions internes n’ont pas pris les mesures appropriées
pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite
du père de l’enfant (Bondavalli,
précité, § 81, Macready c. République tchèque,
nos
4824/06 et
15512/08, § 66, 22 avril 2010, et Piazzi,
précité, § 61). Elles n’ont pas pris, dès le début de la séparation, des mesures
utiles visant à l’instauration de contacts effectifs. Elles ont ensuite toléré
pendant environ quatre ans que la mère, par son comportement, empêchât
l’établissement d’une véritable relation entre le requérant et l’enfant. La Cour
relève que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt
apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des
demandes successives de renseignements et une délégation du suivi de la famille
aux services sociaux assortie de l’obligation pour ceux-ci de faire respecter le
droit de visite du requérant (Lombardo,
précité § 92, et Piazzi,
précité, § 61). Aussi la Cour estime ‑ t ‑ elle que les autorités ont laissé se
consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires (Fourkiotis,
précité, §70). 76. Eu égard à ce
qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la
matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les
efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du
requérant entre août 2006 et novembre 2010 et qu’elles ont méconnu le droit de
l’intéressé au respect de sa vie familiale. 77. Partant, il y a
eu violation de l’article 8 de la Convention. ii. Période entre
novembre 2010 et 2016 78. La Cour observe
que, à partir de 2010, les services sociaux ont réagi aux injonctions du
tribunal en organisant la tenue des rencontres selon les modalités prévues et
que, de son côté, après une première période, le requérant a annulé les vacances
du mois d’août 2010 prévues avec l’enfant et a fait part, en novembre 2010, de
son intention de ne plus rencontrer ce dernier. 79. À cet égard, la
Cour prend note des positions des parties, rappelées ci-dessus. D’une part, le
requérant affirme que son comportement se justifiait en raison d’une absence de
médiation effective de la part des services sociaux face à l’attitude de la mère
de l’enfant, laquelle se serait constamment opposée à l’exercice de son droit de
visite. D’autre part, le Gouvernement considère que les autorités internes ont
déployé tous les efforts nécessaires pour protéger l’intérêt de l’enfant et des
deux parents, ce qui ressortirait de l’évolution de la situation, et il ajoute
que le requérant refuse de coopérer depuis 2010. 80. En
l’occurrence, la Cour relève que, en avril 2010, après avoir souligné que
l’enfant souhaitait passer plus de temps avec son père et que sa mère avait
sciemment œuvré à empêcher toute relation entre lui et le requérant, le tribunal
a chargé les services sociaux de veiller au respect de ses prescriptions. Elle
note que, à partir de cette date, plusieurs rencontres ont été finalement
organisées. 81. La Cour note
qu’il ressort des développements récents de la procédure que, depuis 2010, les
autorités internes ont déployé des efforts pour permettre l’exercice du droit de
visite du requérant, mais que, de son côté, celui-ci a fait preuve d’une
attitude négative puisqu’il a d’abord annulé plusieurs rencontres et a ensuite
décidé de ne plus prendre part aux visites. L’intéressé n’exerce ainsi plus son
droit de visite depuis plus de cinq ans et ne fait pas d’efforts pour maintenir
le lien avec son fils. La Cour vient de constater que les autorités nationales
n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le
droit de visite du requérant entre août 2006 et novembre 2010 (paragraphe 76
ci-dessus). Les explications fournies par le requérant ne sont pas de nature à
justifier son attitude négative à partir de novembre 2010 (voir,
a contrario,
Nicolò Santilli, précité, § 74), d’autant plus
que l’enfant a signalé qu’il percevait cette attitude comme un abandon de la
part de son père. 82. La Cour estime
que, confrontées aux graves incompréhensions existant entre les deux parents,
les autorités ont pris, à partir de 2010 les mesures nécessaires pour inciter
ceux-ci à collaborer et rétablir les relations entre le requérant et son fils. 83. Eu égard à
l’ensemble des éléments qui précèdent et à la marge d’appréciation de l’État
défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales ont, à
partir de novembre 2010, déployé les efforts que l’on pouvait raisonnablement
exiger d’elles pour garantir le respect du droit de visite du requérant,
conformément aux exigences du droit au respect de la vie familiale garanti par
l’article 8 de la Convention. Il n’y a donc pas eu, pour cette période,
violation du droit à la vie familiale du requérant. FOURKIOTIS c. GRÈCE du 16 juin 2016 requête 74756/11 Violation de l'article 8, ce n'est pas au père de porter plainte contre la mère c'est aux autorités de protéger les
enfants alors que des rapports sociaux démontraient qu'ils étaient en danger de favoriser automatiquement le droit de visite du père. a) Applicabilité de l’article 8 57. La Cour relève d’abord que nul
ne conteste que la situation litigieuse relève de la « vie familiale », au sens
de l’article 8 de la Convention, cette disposition trouvant donc à s’appliquer
en l’espèce. b) Principes généraux 58. La Cour rappelle que si
l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences
arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de
s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent
s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie
privée et familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au
respect de la vie privée et familiale, jusque dans les relations des individus
entre eux. La frontière entre les obligations positives et les obligations
négatives de l’Etat au titre de l’article 8 ne se prête pas à une définition
précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier,
dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les
intérêts concurrents (Odièvre c. France
[GC],
no
42326/98, § 40, CEDH 2003-III ; S.H. et
autres c. Autriche [GC], no
57813/00, § 87, CEDH-2011), en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt
supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante (en ce sens,
Gnahoré
c. France, no
40031/98, § 59, CEDH 2000-IX), pouvant, selon sa nature et sa gravité,
l’emporter sur celui des parents (Sahin c.
Allemagne [GC], no
30943/96, § 66, CEDH 2003-VIII). L’intérêt de ces derniers, notamment à
bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans
la balance des différents intérêts en jeu (Haase
c. Allemagne, no
11057/02, § 89, CEDH 2004-III (extraits). 59. L’article 8 implique ainsi le
droit d’un parent à des mesures propres à le « réunir » avec son enfant et
l’obligation des autorités nationales de les prendre (Hokkanen
c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A
no 299-A, § 55 ; Sommerfeld c. Allemagne
[GC], no
31871/96, §§ 60-66, CEDH 2003-VIII). La Cour a souligné l’importance du
droit d’un parent d’avoir accès aux éléments pertinents du dossier, contenus
notamment dans des rapports pédopsychiatriques, et d’être impliqués dans le
processus de l’établissement de ces rapports (Kosmopoulou
c. Grèce, no
60457/00, § 49, 5 février 2004). 60. La Cour rappelle que
l’obligation des autorités nationales de prendre des mesures à cette fin n’est
pas absolue car il arrive que la reprise de contacts d’un parent avec son enfant
ayant vécu depuis un certain temps avec d’autres personnes ne puisse avoir lieu
immédiatement, et requiert des préparatifs. Leur nature et leur étendue
dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la
coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituera toujours un
facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter
pareille collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la
matière doit être limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits
et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de
l’enfant et des droits que lui reconnait l’article 8 de la Convention. En effet,
la Cour a souligné que la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de
recourir à la coercition en ce domaine délicat (Reigado
Ramos c. Portugal, no
73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Dans l’hypothèse où des contacts avec le
parent risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il
revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux. Le
point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour
faciliter les contacts familiaux, toutes les mesures nécessaires que l’on
pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (voir
Hokkanen précité, § 58 ;
Zawadka c. Pologne,
no
48542/99, § 56, 23 juin 2005 et Reigado Ramos,
précité, § 48). 61. La Cour rappelle également que,
dans les affaires touchant la vie familiale, la rupture du contact avec un
enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de sa relation avec
son parent (voir, entre autres, Pini et autres c
Roumanie, nos
78028/01 et
78030/01, § 175, CEDH 2004‑V (extraits)). Les perspectives d’une réunion
familiale s’amenuiseront peu à peu et finiront par être anéanties si les parents
biologiques et les enfants ne sont jamais autorisés à se rencontrer, ou si
rarement qu’aucun lien naturel n’a de chances de se nouer entre eux (K.A.
c. Finlande, no
27751/95, § 139, 14 janvier 2003). c) Application des principes en
l’espèce 62. Un tel risque était flagrant
dans la présente affaire. En effet, depuis que le requérant a dû quitter le
domicile conjugal le 21 janvier 2010, il n’a eu que très peu de fois la
possibilité de voir ou de récupérer ses enfants dans le cadre de son droit de
visite. Il ressort clairement du dossier qu’I.P. a pour le moins tenté de mettre
fin aux contacts du requérant avec ses enfants. 63. La Cour note que, saisi d’une
demande de mesures provisoires le 25 janvier 2010, le tribunal de première
instance d’Athènes n’a rendu sa décision que le 9 juin 2010 fixant, entre
autres, le droit de visite du requérant. Souhaitant faire interdire les contacts
du requérant avec ses enfants, I.P. a de nouveau saisi le tribunal d’une telle
demande. Le tribunal a confié provisoirement la garde des enfants à I.P., mais
il a souligné que le vrai intérêt des enfants mineurs dictait la communication
régulière de ceux-ci avec leur père, afin d’écarter le risque de relâchement de
leurs liens et d’assurer leur équilibre psychosomatique et un développement
normal. Il a alors fixé de nouvelles règles concernant le droit de visite du
requérant, l’autorisant notamment à prendre les enfants du domicile d’I.P.
Enfin, il a déclaré qu’I.P. serait susceptible d’être détenue pour une durée
d’un mois et de payer une amende de 500 euros chaque fois qu’elle méconnaîtrait
les termes du jugement. Il ressort du dossier que la procédure principale
concernant l’attribution définitive de la garde est encore pendante. Un tel
retard est, en soi, un indice du manque de l’État à ses obligations positives de
prendre des mesures adéquates, tenant compte des circonstances de l’espèce, en
vue de faciliter la réunion d’un parent avec ses enfants, notamment lorsqu’il
s’agit d’enfants de bas âge ou il existe un risque aggravé d’altération de la
relation familiale (voir paragraphes 59 et 61 ci-dessus). 64. Les termes de ce jugement n’ont
toutefois pas été respectés par I.P. et le requérant a cherché l’assistance des
autorités judiciaires afin de le faire respecter comme la législation interne
lui en donnait la possibilité. 65. D’une part, le 9 mars 2011, le
requérant s’est adressé au procureur d’Athènes chargé des mineurs. Il l’invitait
à prendre toute mesure nécessaire pour préserver l’intérêt des enfants et sa
relation avec ceux-ci. Le procureur a ordonné une enquête sociale auprès du
service de l’assistante sociale de Nea Philadelphia. Celle-ci s’est rendue au
domicile d’I.P. à quatre reprises et a rédigé trois rapports dans une période de
cinq mois qu’elle a envoyés au procureur. Le 7 septembre 2011, le requérant a
invité le procureur à lui fournir copie des rapports et à ordonner toute mesure
propre à préserver les contacts avec ses enfants. Le procureur a cependant
refusé de lui transmettre copie des rapports. Le requérant précise que jusqu’à
la date de la saisine de la Cour, le procureur n’avait entrepris aucune autre
démarche. 66. Il apparaît donc que le
procureur n’a pas tenu compte du fait que le requérant n’avait pas de contact
avec ses enfants depuis plusieurs mois et que l’écoulement de cette période sans
contact avait déjà joué et continuerait à jouer un rôle certain dans l’attitude
de rejet que les enfants manifestaient vis-à-vis du requérant. Aucune médiation
ni autre forme de processus de rapprochement n’ont été mises en place pour aider
le requérant et ses enfants à rétablir leur rapport familial, tels qu’une
assistance sociale ciblée et/ou un accompagnement thérapeutique d’I.P. 67. D’autre part, en application de
la décision no
1376/2011, le requérant déposa, en vertu des articles 950 § 2 du code de
procédure civile et 232A du code pénal, plusieurs actions et plaintes devant le
tribunal de première instance d’Athènes : les 18 et 28 février 2011, les 4, 17,
18 et 28 mars 2011, le 12 avril 2011, le 9 mai 2011, le 30 juin 2011 et le 10
octobre 2011 (paragraphe 21 ci-dessus). Toutes les audiences furent fixées à
diverses dates en 2013 et 2014 mais à ces dates les procédures furent annulées à
la demande du requérant qui déclara qu’il ne souhaitait voir la mère de ses
enfants sanctionnée par l’une des peines prévues par les articles 950 § 2 du
code de procédure civile ou 232A du code pénal. 68. La Cour en convient que les
mesures judiciaires susmentionnées, à savoir l’action prévue à l’article 950 § 2
du code de procédure civile, l’instauration d’une responsabilité pénale et la
mesure prévue à l’article 1532 du code civil, ne sont pas nécessairement
toujours adaptées à des situations comme celle de l’espèce. Dans des affaires
concernant le droit de garde des enfants, l’adéquation d’une mesure se juge à la
rapidité de sa mise en œuvre. Lorsque des difficultés apparaissent, dues au
refus du parent avec lequel se trouve l’enfant de se soumettre à l’exécution de
la décision ordonnant un droit de visite de l’autre parent, des mesures
coercitives à l’égard du premier sont rarement souhaitables ou efficaces dans un
domaine si délicat (Mitrova et Savik
c. l’ex-République yougoslave de Macédoine,
no
42534/09, § 77, 11 février 2016 et Reigado
Ramos, précité, § 53). Outre le fait que les
procédures coercitives y afférentes sont lentes, ce qui risque de priver le
parent lésé d’avoir des contacts avec son enfant pendant une longue période,
elles risquent d’avoir un effet délétère sur le psychisme de l’enfant mineur et
miner ainsi encore plus le but recherché, à savoir la coopération des parents
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 69. De ce fait, la Cour ne saurait
tirer des conclusions défavorables contre le requérant de la circonstance que
celui-ci a décidé de ne pas poursuivre ses différentes actions et plaintes
contre I.P. Le requérant explique à cet égard, non sans discernement, que la
poursuite de ces procédures emporterait le risque de pousser la mère à éloigner
davantage les enfants de sa personne, car elle fournirait à I.P. un prétexte
supplémentaire pour le dénigrer auprès des enfants. En outre, à supposer même
que les plaintes eussent une issue favorable au requérant, elles auraient abouti
à imposer à la mère une sanction financière, voire, au pire, l’emprisonnement.
La Cour considère que l’usage de mesures impliquant, dans des affaires
concernant les droits de garde ou de visite, une privation de liberté de l’un
des parents doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et ne saurait
être mise en œuvre que lorsque les autres moyens ont été employés ou explorés. 70. La Cour ne peut que constater
que les autorités ont failli à leur devoir de prendre des mesures rapides et
pratiques en vue d’inciter les intéressés à une meilleure coopération, tout en
ayant à l’esprit l’intérêt supérieur des enfants qui consiste aussi à ne pas
permettre une dilution progressive voire même la rupture des relations avec leur
père. Après le jugement no
1376/2011 fixant le droit de visite du père, les autorités se sont désengagées
de tout contrôle de son exécution. À part l’enquête sociale ordonnée par le
procureur chargé des mineurs auprès du service de l’assistante sociale à
l’invitation du requérant le 9 mars 2011, et qui s’est étalée sur cinq mois,
aucune autre mesure n’a été mise en œuvre par les autorités. Cette enquête et
les cinq rapports auxquels elle a donné lieu n’ont d’ailleurs abouti à la prise
d’aucune mesure concrète. La lettre adressée le 7 septembre 2011 par le
requérant au procureur près la Cour de cassation pour se plaindre de
l’inactivité du procureur chargé des mineurs n’a même pas fait l’objet d’une
réponse. Les autorités ont ainsi laissé se consolider une situation
de facto au mépris du
jugement no
1376/2011. 71. Or, pendant toute cette période
le requérant était privé, par l’effet du comportement d’I.P., de tout contact
avec ses enfants. Même l’expérience à première vue prometteuse tentée par la
pédopsychiatre M.T., avec l’accord initial d’I.P., a été de courte durée, I.P. y
ayant mis un terme en refusant de donner les enfants au requérant pour les
vacances d’été 2011. 72. La Cour
constate que les enfants du requérant n’ont pas pu bénéficier d’un soutien
psychologique pour maintenir et tenter ainsi d’améliorer leurs rapports avec
leur père. La Cour n’ignore pas le fait que l’impasse dans les contacts du
requérant avec ses enfants est due surtout au manque de collaboration d’I.P.
Cependant, un tel manque de coopération ne saurait dispenser les autorités
compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le
maintien du lien familial (Reigado Ramos c.
Portugal, précité, § 55). 73. Quant au refus
des autorités de communiquer au requérant les rapports établis par les
pédopsychiatres, la Cour rappelle qu’elle a déjà souligné l’importance que revêt
pour les parents le fait d’être toujours placés en position d’avancer tous les
arguments leur permettant d’obtenir des contacts avec leur enfant et le fait de
pouvoir prendre connaissance des rapports psychiatriques ordonnés par le
procureur dans des affaires concernant l’accès de parents à leurs enfants (Kosmopoulou,
précité). Or, tout comme dans cette affaire, aucune mesure n’a été prise en
l’espèce par le procureur suite à l’établissement de différents rapports dont le
contenu démontrait la nécessité d’un soutien psychologique impliquant sans doute
tous les membres de la famille du requérant. 74. En définitive,
la Cour ne saurait reprocher au requérant le fait de ne pas avoir poursuivi ses
actions civiles ou plaintes pénales qui auraient pu permettre aux autorités
d’utiliser à l’encontre de la mère des moyens de contrainte, tels des amendes
voire l’emprisonnement. Quoique les autorités étaient parfaitement au courant de
l’obstruction d’I.P.au droit de visite du requérant, elles n’ont entrepris
aucune démarche se contentant de prendre acte de la situation. À cet égard, la
Cour ne peut que relever l’inertie du procureur chargé des mineurs suite à la
communication des rapports établis par l’assistance sociale ainsi que le refus
du procureur de transmettre au requérant ces rapports afin que celui-ci puisse
entreprendre un travail concret avec les pédopsychiatres. 75. La Cour conclut
que les autorités sont restées bien en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement
attendre d’elles afin de satisfaire à leur obligation positive de prendre des
mesures adéquates pour favoriser une réunion éventuelle du requérant avec ses
enfants et protéger le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale, 76. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. BONDAVALLI c. ITALIE du 17 novembre 2015 requête 35532/13 Violation de l'article 8 : Le requérant n'a pu voir sa fille que de manière très limitée durant 7 ans. Son ex épouse
psychiatre auprès des services sociaux a demandé à une ex étudiante de tout faire pour que son ex mari ne puisse pratiquement pas avoir accès à sa fille. a) Principes généraux 72. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet
de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles
ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles
peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un
arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures
spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis,
Zawadka c. Pologne,nº
48542/99, § 53, 23
juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à
réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux
parents (voir, mutatis mutandis,
Ignaccolo-Zenide c. Roumanie,
no
31679/96, § 108, CEDH
2000‑I, Sylvester c. Autriche,
nos
36812/97 et
40104/98, § 68, 24
avril 2003, Zavřel c. République tchèque,
no
14044/05, § 47, 18
janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie,
no
35978/02, § 80, 12
janvier 2006). Elle rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent
pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact
avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires
permettant de parvenir à ce résultat (voir,
mutatis mutandis,
Kosmopoulou c. Grèce, no
60457/00, § 45, 5
février 2004, Amanalachioai c. Roumanie,
no
4023/04, § 95, 26 mai
2009, Ignaccolo-Zenide,
précité, §§ 105 et 112, et Sylvester,
précité, § 70). 73. Pour être adéquates, les
mesures visant à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place
rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables
pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui
(voir, mutatis mutandis,
Ignaccolo-Zenide,
précité, § 102 ;
voir aussi Maire c. Portugal,
no
48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII, Pini et autres
c. Roumanie, nos
78028/01 et
78030/01, § 175, CEDH 2004‑V, Bianchi c.
Suisse, no
7548/04, § 85, 22 juin 2006, Piazzi,
précité, Lombardo c. Italie,
no
25704/11, 29 janvier 2013, et Nicolò Santilli
c. Italie, no
51930/10, 17 décembre 2013). b) Application de ces principes à
la présente espèce 74. Dans l’examen de la présente
affaire, la Cour note tout d’abord que, au moment de leur séparation, le
requérant et la mère de l’enfant n’étaient pas parvenus à un accord sur les
modalités du droit de visite paternel. 75. La Cour estime que, face aux
circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à examiner si la réponse
des autorités italiennes à la nécessité de prendre des mesures propres à
préserver le lien entre le requérant et son enfant au cours de la procédure a
été conforme à leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la
Convention. 76. La Cour relève que, à partir de
septembre 2009, nonobstant la décision du tribunal pour enfants de Bologne lui
reconnaissant un droit de visite très large, le requérant n’a pu exercer ce
droit que de manière très limitée en raison, d’une part, des rapports négatifs
des services sociaux, lesquels faisaient partie de la même structure
administrative que celle dans laquelle la mère de l’enfant exerçait en tant que
psychiatre, et, d’autre part, d’une expertise réalisée par une psychiatre ayant
effectué son stage de fin d’études avec celle-ci. 77. La Cour note également que le
requérant a, à plusieurs reprises, dénoncé la partialité de la psychiatre et des
services sociaux, et qu’il a demandé aux juridictions de confier son propre
suivi psychologique et celui de son fils à d’autres services sociaux ainsi que
d’ordonner l’accomplissement d’une nouvelle expertise par un médecin impartial.
Les juridictions internes ont cependant continué à confier le suivi aux services
sociaux de Scandiano et, en dépit d’une expertise produite par le requérant
selon laquelle il ne souffrait d’aucun trouble de la personnalité, elles ont
rejeté son recours, estimant que ses arguments étaient liés à son état
psychologique (paragraphe 34 ci-dessus). Par la suite, sur la base de
l’expertise produite en novembre 2010 par les services sociaux de Scandiano, les
juridictions internes ont interdit tout contact téléphonique entre le requérant
et son fils et, en mars 2012, elles ont suspendu les rencontres. Celles-ci n’ont
ensuite repris que de manière très restreinte. 78. La Cour note en outre que, par
la suite, malgré deux nouvelles expertises produites par le requérant selon
lesquelles il ne souffrait d’aucun trouble psychologique et qui suggéraient un
rapprochement avec son enfant, les juridictions, en se basant sur les expertises
des services sociaux de Scandiano de 2011, ont limité le droit de visite de
l’intéressé. Depuis cette date, les conditions d’exercice du droit de visite
sont restées presque inchangées. 79. La Cour rappelle qu’il ne lui
appartient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales
compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités
sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en
particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire
et les parties impliquées (Reigado Ramos,
précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce passer outre au fait que,
à plusieurs reprises, le requérant a mis en cause la partialité des services
sociaux et de la psychiatre auteur de l’expertise en raison de l’existence d’un
lien entre eux et la mère de l’enfant, et que ces recours ont été rejetés par
les juridictions internes. 80. La Cour rappelle avoir déjà
sanctionné les autorités italiennes parce qu’elles n’avaient pas tenu compte de
l’existence d’un lien entre l’expert chargé de procéder à une évaluation
psychologique de l’enfant et le beau-père de celui-ci (Piazzi, précité, § 61).
Dans la présente affaire, la Cour relève que l’existence d’un lien entre la mère
de l’enfant, les services sociaux et la psychiatre chargée de rédiger
l’expertise sur la famille était évidente dès lors qu’ils entretenaient des
liens professionnels (voir paragraphe 21 ci-dessus). 81. Or la Cour estime qu’il aurait
été non seulement dans l’intérêt du requérant mais encore particulièrement dans
celui de l’enfant que les juridictions internes répondent favorablement aux
demandes du requérant, qu’elles chargent un autre expert – indépendant et
impartial – de réaliser une nouvelle expertise, et qu’elles confient le suivi de
l’enfant aux services sociaux d’une autre commune. Sur la base de ces nouveaux
rapports, le tribunal et la cour d’appel auraient pu mieux évaluer s’il était
nécessaire de restreindre ou d’élargir le droit de visite du requérant, et ce en
tenant également compte des expertises produites par le requérant selon
lesquelles il ne souffrait d’aucun trouble de la personnalité justifiant une
telle restriction du droit de visite. La Cour relève que les juridictions
internes n’ont pris aucune mesure appropriée pour créer les conditions
nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l’enfant (Macready
c. République tchèque, nos
4824/06 et
15512/08, § 66, 22 avril 2010). 82. Cela étant, elle reconnaît que
les autorités faisaient en l’espèce face à une situation très difficile qui
était due notamment aux tensions existant entre les parents de l’enfant. Elle
rappelle cependant qu’un manque de coopération entre des parents séparés ne peut
dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens
susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir
Nicolò Santilli,
précité, § 74,
Lombardo,
précité, § 91, et,
mutatis mutandis,
Reigado Ramos c. Portugal, no
73229/01, § 55, 22 novembre 2005). En l’espèce, les autorités nationales
sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dès
lors que le tribunal et la cour d’appel se sont limités à restreindre le droit
de visite du requérant sur la base des expertises négatives produites par les
services sociaux et les psychologues travaillant dans la même structure
administrative que la mère de l’enfant. 83. La Cour estime que la procédure
aurait dû s’entourer des garanties appropriées permettant de protéger les droits
du requérant et de prendre en compte ses intérêts. Or la Cour constate que les
juridictions internes n’ont pas procédé avec la diligence nécessaire et que,
depuis environ sept ans, le requérant dispose d’un droit de visite très limité.
En outre, compte tenu de des conséquences
irrémédiables que le passage du temps peut avoir sur les relations entre
l’enfant et le requérant, la Cour estime à cet égard qu’il incomberait aux
autorités internes de réexaminer, dans un bref délai, le droit de visite du
requérant en tenant compte de la situation actuelle de l’enfant et de son
intérêt supérieur. 84. Eu égard à ce qui précède et
nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour
considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et
suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant et qu’elles ont
méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale. 85. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. Arrêt LOMBARDO c. ITALIE du 29 janvier 2013 Requête no 25704/11 LE DROIT DE VISITE DU PÈRE DOIT ÊTRE SAUVEGARDÉE NONOBSTANT LE CONFLIT AVEC LA MÈRE ET LES DIFFICULTÉS PSYCHOLOGIQUES DE L'ENFANT 80. Comme la Cour
l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 a essentiellement pour objet de
prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il
ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences :
à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives
inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent
impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque
dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal
juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés
ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques
appropriées (voir, mutatis mutandis,
Zawadka c. Pologne,
nº 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’Etat d’adopter
des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de
conflit opposant les deux parents (voir, mutatis
mutandis,
Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no
31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c.
Autriche, nos
36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel
c. République tchèque, no
14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova
c. Bulgarie, no
35978/02, § 80, 12 janvier 2006). Elle rappelle aussi que les obligations
positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son
parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également
l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat
(voir, mutatis
mutandis,
Kosmopoulou c. Grèce, no
60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c.
Roumanie, no 4023/04,
§ 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide,
précité, §§ 105 et 112, et
Sylvester, précité, § 70). 81. Pour être
adéquates, les mesures visant à réunir le parent et son enfant doivent être
mises en place rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des conséquences
irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit
pas avec lui (voir, mutatis mutandis,
Ignaccolo-Zenide,
précité, § 102, Maire c. Portugal,
no 48206/99,
§ 74, CEDH 2003‑VII, Pini et autres c. Roumanie,
nos 78028/01
et 78030/01, § 175, CEDH 2004‑V (extraits),
Bianchi c. Suisse, no
7548/04, § 85, 22 juin 2006, et Mincheva c.
Bulgarie, no 21558/03,
§ 84, 2 septembre 2010). 82. Se penchant
sur la présente affaire, la Cour note d’abord que, au moment de leur séparation,
le requérant et son ex-compagne n’étaient pas parvenus à un accord sur les
modalités du droit de visite paternel. Elle observe que la mère de l’enfant,
A.D., s’est très tôt opposée au droit de visite du requérant et qu’elle a, en
2003, saisi le tribunal pour enfants d’une demande visant à l’obtention de la
garde exclusive de l’enfant. Le tribunal a fait droit à sa demande tout en
accordant au requérant un droit de visite à raison de deux après-midi par
semaine, d’un week-end sur deux sans hébergement jusqu’aux trois ans de
l’enfant, de trois jours à Pâques, de six jours à Noël et de dix jours pendant
les vacances d’été. Entre 2003 et 2004,
le requérant a saisi à trois reprises le juge des tutelles en signalant
l’existence de difficultés dans l’exercice de son droit de visite. Le juge des
tutelles s’est borné à confirmer le décret du tribunal. Face à l’impossibilité
d’exercer son droit de visite, le requérant a attaqué le décret devant la cour
d’appel, laquelle a ordonné que les rencontres, à raison de trois après-midi par
mois, se déroulent dans les locaux des services sociaux de Campobasso. En juillet 2005, le
tribunal a, sur demande du requérant, limité l’autorité parentale de la mère,
confié la garde de l’enfant aux services sociaux et autorisé le requérant à
rencontrer l’enfant. Il a critiqué le comportement des services sociaux qui,
dans leur rapport du 6 juin 2005, avaient tenu compte des déclarations de la
mère en ignorant celles du père. Toutefois, nonobstant cette décision, le
requérant n’a pu exercer pleinement son droit de visite (paragraphes 18 et 19
ci-dessus). 83. En mars et en
mai 2006, le tribunal s’est prononcé à nouveau pour constater l’inexécution de
ses décrets précédents à cause, en partie, des obstacles dressés par la mère au
déroulement des rencontres (paragraphe 20 ci-dessus). Ce n’est qu’en décembre
2006 que le tribunal, après avoir constaté à plusieurs reprises que les décrets
précédents n’avaient pas été respectés, a ordonné à A.D. de suivre un programme
de soutien psychologique. 84. La Cour
rappelle que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas
automatiquement à la conclusion que l’Etat a manqué aux obligations positives
qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (voir,
mutatis mutandis,
Mihailova, précité, § 82). En effet, l’obligation
pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir l’enfant et
le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la
coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un
facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter
pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en
la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts
et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et, notamment, des intérêts
supérieurs de l’enfant et des droits que lui confère l’article 8 de la
Convention (Voleský c. République tchèque,
no
63267/00, § 118, 29 juin 2004). Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît
de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de
recourir à la coercition en ce domaine délicat (Reigado
Ramos c. Portugal, no
73229/01, § 53, 22 novembre 2005), et l’article 8 de la Convention ne saurait
autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au
développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne
[GC], nº 25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000‑VIII). Le point décisif consiste donc à
savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes
les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen
c. Finlande, nº 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII). 85. En l’espèce,
la Cour relève que, confronté à l’impossibilité d’exercer son droit de visite,
le requérant a une nouvelle fois saisi le tribunal le 30 mai 2007, signalant que
sa fille était devenue agressive et qu’elle n’était plus disposée à le
rencontrer. La Cour estime que les manquements qu’elle a relevés semblent
d’autant plus graves que, compte tenu de l’âge de l’enfant et du contexte
familial perturbé, l’écoulement du temps a eu des effets négatifs quant à la
possibilité pour le requérant de renouer une relation avec sa fille. 86. En 2007, le
tribunal, saisi par le requérant, a ordonné une garde conjointe de l’enfant et a
chargé les services sociaux d’organiser les rencontres à Termoli et à Rome (§ 30
ci-dessus). En 2009, la cour d’appel s’est limitée à ordonner aux services
sociaux d’assurer la mise en œuvre du droit de visite du requérant. 87. Par un décret
du 5 novembre 2009, le tribunal a rappelé à nouveau la nécessité pour toutes les
parties de donner exécution au décret précédent. Il a suggéré de faire suivre à
l’enfant un programme de soutien psychologique, afin de vaincre la résistance
opposé par celle-ci aux rencontres avec son père. Entre 2009 et 2010, le
requérant a saisi à plusieurs reprises le tribunal pour faire respecter son
droit de visite. En octobre 2010, le tribunal a déclaré que les rencontres
étaient interrompues de facto. 88. Ce n’est qu’en
2011 que la mère a commencé à ne plus s’opposer aux rencontres. Par conséquent,
en novembre 2011, le tribunal a décidé la clôture de la procédure et ordonné aux
services sociaux de veiller à la poursuite par l’enfant du programme de soutien
psychologique entamé. 89. Il convient de
rappeler que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se
juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Maire,
précité, § 74, et
Piazzi c. Italie, no
36168/09 § 58, 2 novembre 2010). En l’espèce, la Cour note que, selon le
Gouvernement, le comportement des services sociaux et du tribunal s’explique par
la volonté de ne pas traumatiser davantage l’enfant, et que, toujours selon le
Gouvernement, les juridictions internes se sont toujours prononcées sur la
demande du requérant et ont pris toutes les mesures nécessaires pour favoriser
les contacts entre l’intéressé et sa fille. Or la Cour observe que, alors même
que le requérant avait demandé au tribunal la mise en œuvre de ses décisions à
plusieurs reprises à partir de 2003, quand l’enfant n’était âgée que de deux
ans, le tribunal s’est limité à constater l’inexécution de ses décrets
précédents. 90. Ainsi, au lieu
de prendre des mesures propres à permettre l’exécution du droit de visite du
requérant, le tribunal s’est borné à prendre note de la situation de l’enfant et
à ordonner à plusieurs reprises aux services sociaux de maintenir le programme
de soutien psychologique mis en place d’abord pour la mère puis pour l’enfant.
La Cour rappelle à cet égard qu’il ne lui revient pas de substituer son
appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui
auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour
procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact
direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado
Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut
en l’espèce passer outre au fait que, à plusieurs reprises, le tribunal a relevé
que la non-exécution du droit de visite du requérant était imputable à la mère.
De plus, elle observe que le tribunal a attendu 2006 pour ordonner à A.D de
suivre un programme de soutien psychologique et 2009 pour ordonner d’en faire
bénéficier également l’enfant. 91. Cela étant, la
Cour reconnaît que les autorités faisaient en l’espèce face à une situation très
difficile qui était due notamment aux tensions existant entre les parents de
l’enfant. Elle estime cependant qu’un manque de coopération entre les parents
séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les
moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir,
mutatis mutandis,
Reigado Ramos, précité, § 55). Or, en l’espèce,
les autorités nationales sont restées en deçà de ce qu’on pouvait
raisonnablement attendre d’elles dès lors que le tribunal a délégué la gestion
des rencontres aux services sociaux. Elles ont ainsi failli à leur devoir de
prendre des mesures pratiques en vue d’inciter les intéressés à une meilleure
coopération, tout en ayant à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant (Zawadka,
précité, § 67). 92. La Cour note,
en outre, que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt
apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des
demandes successives de renseignements et une délégation du suivi aux services
sociaux leur ordonnant de faire respecter le droit de visite du requérant (Piazzi,
précité,
§ 61). Les autorités ont ainsi laissé se consolider une
situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires, alors même que
l’écoulement du temps avait à lui seul des conséquences sur la relation du père
avec son enfant. Il ne semble pas non plus que les autorités aient enjoint aux
deux parents de suivre une thérapie familiale (Pedovič
c. République tchèque, no
27145/03, § 34, 18 juillet 2006) ou qu’elles aient ordonné un déroulement des
rencontres au sein d’une structure spécialisée (voir, par exemple,
Mezl c. République tchèque,
no
27726/03, § 17, 9 janvier 2007, et Zavřel,
précité, § 24). La Cour constate que, compte tenu du très jeune âge de l’enfant
au moment de la séparation de ses parents, une telle rupture du contact avec son
père suivie d’un droit de visite limité du fait du non-déroulement des
rencontres programmées a rendu impossible pour le requérant la construction
d’une relation stable avec S. 93. Dans ces
circonstances, la Cour estime que, face à pareille situation, les autorités
auraient dû prendre des mesures plus directes et plus spécifiques visant au
rétablissement du contact entre le requérant et sa fille. En particulier, la
médiation des services sociaux aurait dû être utilisée pour encourager les
parties à coopérer et ceux-ci auraient dû, conformément aux décrets du tribunal,
organiser toutes les rencontres entre le requérant et sa fille, y compris celles
qui auraient dû se dérouler à Rome. Or les juridictions internes n’ont pris
aucune mesure appropriée pour créer pour l’avenir
les conditions nécessaires à l’exercice effectif
du droit de visite du requérant (Macready c.
République tchèque, nos
4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010, et
Piazzi,
précité,
§ 61). 94. Eu égard à ce
qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat défendeur en la
matière, la Cour considère que les autorités nationales ont manqué à déployer
des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du
requérant, et qu’elles ont ainsi méconnu le droit de l’intéressé au respect de
sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. 95. Partant, il y a eu violation de cette disposition Arrêt Vojnity c. Hongrie du 12 février 2013, requête no 29617/07 Déchéance d’un père de son droit de visite en raison de sa religion : la Cour conclut à la discrimination La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie
familiale. M. Vojnity avait eu des contacts réguliers avec son fils jusqu’à ce
que les autorités nationales décident de le déchoir de son droit de visite. Cette déchéance se fondait essentiellement sur les
convictions religieuses de M. Vojnity, ce qui s’analyse en une différence de
traitement avec les autres parents placés dans une situation similaire mais
n’ayant pas de fortes convictions religieuses. Conformément à la jurisprudence
de la Cour, pareille différence de traitement doit se fonder sur une
justification objective et raisonnable, faute de quoi elle est discriminatoire.
Dans ce cas particulier, les juridictions hongroises, prenant en compte
l’intérêt supérieur de l’enfant, ont dit que la vision du monde irrationnelle du
père ainsi que son prosélytisme mettraient en danger le développement de son
fils. Or aucun élément de preuve convaincant n’a été avancé pour
montrer que la religion du requérant ait exposé son fils à des pratiques
dangereuses ou à des dommages physiques. Alors qu’une restriction des droits
parentaux doit être décidée au terme d’un examen approfondi, les juridictions
nationales ont prononcé une déchéance totale sans expliquer concrètement la
nature du préjudice pouvant découler d’une «vision du monde irrationnelle». En outre, les tribunaux hongrois ont totalement privé M.
Vojnity de droit de visite sans dûment envisager les autres solutions possibles,
comme un droit de visite assorti de mesures de contrôle. En somme, il n’existait aucune circonstance exceptionnelle de
nature à justifier une mesure aussi radicale que la suppression de toute forme
de contact et de vie familiale entre M. Vojnity et son fils. Partant, cette
mesure était disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection
de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors, la Cour conclut que M. Vojnity a
fait l’objet d’une discrimination fondée sur sa religion dans l’exercice de son
droit au respect de sa vie familiale, au mépris de l’article 14 combiné avec l’article 8. Arrêt BALL contre Andorre du 11 décembre 2012 requête 40628/10 Un droit de visite aux enfants pouvait être suspendu pour cause de problème psychologique du parent 52. La Cour observe que le droit de visite défini dans le jugement de séparation a été
suspendu du 14 juillet 2006 au 2 avril 2007. Elle constate en outre que les
décisions de suspendre ce droit de visite prises par le juge de la séparation
les 14 et 20 juillet 2006 se fondaient sur des expertises psychologiques et
avaient l’appui du procureur, et que le requérant a malgré tout été autorisé à
maintenir un contact téléphonique avec ses enfants. La Cour relève aussi qu’à
compter du 14 juillet 2006 et jusqu’au 19 décembre 2006 au moins, le requérant
n’a demandé ni au juge de la séparation ni au juge du divorce d’adopter des
mesures visant à rétablir les contacts entre lui et ses enfants ; aucun élément
de preuve ne montre non plus que le requérant se soit plaint devant un tribunal
interne d’une absence de respect par sa femme de l’autorisation qui lui avait
été accordée de téléphoner à ses enfants. 53. La Cour
observe que la décision du 2 avril 2007 a en partie rétabli le droit de visite
défini dans le jugement de séparation. En effet, ce droit a été rétabli à
l’égard de la fille du requérant tandis qu’un psychologue a été désigné pour
examiner son fils. Ces mesures sont restées en vigueur jusqu’au 19 juin 2008, le
requérant n’ayant versé qu’une partie du dépôt en garantie du paiement du
traitement de son fils par un psychologue et dont le montant avait été fixé par
la décision du 2 avril 2007. Aucun élément n’indique que le requérant ait engagé
contre sa femme une procédure pour non-respect du droit de visite établi à
l’égard de sa fille. 54. Le droit de
visite initialement fixé dans le jugement de séparation fut remis en vigueur le
19 juin 2008 puis de nouveau suspendu le 24 juillet 2008 jusqu’à la réalisation
d’un examen psychologique. La Cour note que le requérant a fait appel de cette
décision mais que le jugement de divorce établissant un nouveau droit de visite
a été rendu le 21 octobre 2008 alors que l’appel était encore pendant. 55. Le requérant
fit appel du jugement de divorce et, dans l’attente de l’issue de son recours,
sollicita l’exécution de la décision que le juge de la séparation avait rendue
le 19 juin 2008. Cette démarche intervint dans le cadre de la procédure relative
à une demande d’éclaircissements sur le point de savoir quelle décision, du
jugement de divorce ou de la décision du 19 juin 2008, était exécutoire tant que
le recours contre le jugement de divorce n’était pas tranché. 56. La Cour note
que, le 23 avril 2009, le Tribunal supérieur de justice indiqua que la décision
du 19 juin 2008 n’était pas exécutoire au motif que le divorce avait déjà été
prononcé et qu’en conséquence la question des modalités de visite entre les
parents et les enfants relevait désormais du tribunal devant lequel se déroulait
la procédure de divorce. La Cour reconnaît la complexité de la situation, mais
constate que le requérant a pu faire appel de cette décision et s’est vu
notifier des décisions motivées tant du Tribunal supérieur de justice que de la
Cour constitutionnelle, dont il ressortait clairement que le droit de visite ne
serait pas fixé définitivement tant que le Tribunal supérieur de justice
n’aurait pas statué sur l’appel formé par l’intéressé contre le jugement de
divorce. 57. La Cour
observe également que rien ne montre que le requérant ait demandé au Tribunal
supérieur de justice d’ordonner des mesures provisoires lorsqu’il a fait appel
du jugement de divorce. 58. A la lumière
de ce qui précède, la Cour juge que, vu les circonstances particulières de la
cause, les autorités nationales n’ont pas failli à leurs obligations positives
au titre de l’article 8 de la Convention. Elle considère que lesdites
juridictions ont toujours tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants, se
fondant sur des expertises et autres éléments de preuve objectifs pour décider
de suspendre le droit de visite établi en faveur du requérant. En l’occurrence,
le rétablissement des contacts entre le père et ses enfants exigeait des efforts
de l’ensemble des personnes concernées, y compris le requérant lui-même, dont
l’inactivité semble avoir contribué à son absence de contact avec ses enfants.
La Cour attire l’attention sur plusieurs points : il ne ressort des documents
fournis aucun élément de preuve indiquant qu’à la suite de la première
suspension de son droit de visite, le requérant ait cherché à le faire rétablir
avant un délai de cinq mois ; l’intéressé n’a jamais fourni l’intégralité de la
somme demandée par le juge de la séparation en garantie du paiement de l’examen
psychothérapeutique de son fils et des deux parents ; et il n’a pas déposé
volontairement la somme exigée par le juge chargé de l’exécution du jugement de
divorce en garantie des frais de traitement psychologique de son fils, le juge
de l’exécution ayant même dû chercher à faire saisir les actifs du requérant à
cette fin, quoiqu’en vain. 59. La Cour ne
saurait non plus souscrire à l’argument du requérant selon lequel les décisions
du Tribunal supérieur de justice des 23 avril et 28 mai 2009 ont enfreint son
droit à un procès équitable. Comme le Tribunal l’a déclaré dans ses décisions du
19 juin 2008 et du 12 février 2009, et ainsi que cela ressort implicitement du
jugement de divorce du 21 octobre 2008, c’est le tribunal chargé de la procédure
de divorce qui est compétent pour statuer sur les modalités de contact entre les
parents et les enfants une fois le divorce prononcé. A cet égard, la Cour note
que le requérant pouvait faire appel de ces deux décisions (ce qu’il a
d’ailleurs fait) et que le juge du divorce et les juridictions d’appel lui ont
fourni des décisions motivées qui ne sauraient passer pour déraisonnables ou
arbitraires. Le jugement de divorce a établi de nouvelles modalités du droit de
visite en faveur du requérant qui annulaient et remplaçaient toutes les
décisions de justice antérieures en la matière. Ce nouveau droit de visite n’a
pas été appliqué, le requérant ayant formé un recours suspensif, jusqu’à ce que
le Tribunal supérieur de justice rende le 23 juillet 2009 un jugement confirmant
le jugement de divorce dans son intégralité. Comme on l’a déjà mentionné, rien
n’indique que le requérant ait demandé au Tribunal supérieur de justice de
prendre des mesures provisoires dans son recours contre le jugement de divorce,
ou à un stade ultérieur mais avant que le Tribunal supérieur de justice ne
statue sur son recours. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que les
juridictions internes ont failli aux obligations positives découlant pour elles
de l’article 8 de la Convention, le requérant ayant joué un rôle dans son
absence de contact avec ses enfants. 60. Dès lors, au
vu des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention. NICOLÒ SANTILLI c. ITALIE du 17 décembre 2013 requête 51930/10
Sous prétexte de soigner le requérant, son droit de visite lui a été retiré pour voir ses enfants.
68. La Cour estime que, devant les circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à examiner si la réponse des autorités italiennes à la nécessité de prendre des mesures propres à maintenir les liens entre le requérant et son enfant au cours de la procédure a été conforme à leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention.
69. En l’espèce, la Cour relève que, entre septembre 2006 et septembre 2008, le requérant n’a pu exercer son droit de visite que de manière très limitée et la plupart des rencontres autorisées ne furent pas organisées (voir paragraphes 12, 13 et 17 ci-dessus). Confronté à l’impossibilité d’exercer son droit de visite, le requérant saisit à plusieurs reprises le tribunal et le 15 octobre 2008, il signala que l’enfant était devenu agressif et qu’il n’était plus disposé à le rencontrer (voir paragraphe 17 ci-dessus). La Cour estime qu’une réaction rapide à cette situation aurait été nécessaire, compte tenu du fait que l’écoulement du temps peut avoir des effets négatifs quant à la possibilité pour le requérant de renouer une relation avec son fils.
70. Par un décret du 21 novembre 2008, le tribunal ordonna une expertise psychologique et nomma un curateur pour défendre les intérêts de l’enfant. Le 10 mars 2010, il ordonna aux services sociaux de mettre en place un soutien psychologique pour l’enfant. Toutefois, bien que les services sociaux eussent exprimé leur préoccupation pour le comportement de l’enfant qui refusait les rencontres (voir paragraphes 24 et 26 ci-dessus) et que les psychologues eussent affirmé qu’à cause de l’attitude de A.B. aucun parcours thérapeutique n’avait pu aboutir, le tribunal se limita à prendre note de la situation de l’enfant et à ordonner aux parties et aux services sociaux de donner exécution à ses décisions. Des mesures pratiques pour garantir le droit de visite du requérant ne furent adoptées par les services sociaux qu’à partir de 2011, les prescriptions ordonnant un parcours thérapeutique pour l’enfant demeurent toutefois inexécutées. Les derniers développements de la procédure montrent aussi une attitude négative de non-collaboration du requérant, qui a renoncé aux rencontres.
71. Il convient de rappeler que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Lombardo, précité, § 89 et Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 78, 2 novembre 2010). En l’espèce la Cour note que, selon le requérant, l’inertie des autorités compétentes a eu des conséquences irréparables sur la relation avec son fils. Par contre, le Gouvernement observe que les juridictions internes se sont toujours prononcées sur la demande du requérant et ont pris les mesures nécessaires pour favoriser les contacts entre le requérant et Y., sans toutefois traumatiser l’enfant et en respectant sa volonté.
72. La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce passer outre au fait que, à plusieurs reprises, le tribunal a relevé que la non-exécution du droit de visite du requérant était imputable au comportement de la mère et que le parcours de soutien psychologique pour l’enfant n’avait pas abouti, toujours à cause de l’attitude de celle-ci. De plus, elle observe que le tribunal avait connaissance de la situation psychologique de l’enfant qui refusait tout contact avec son père et qu’aucune mesure pratique n’a été prise à cet égard. Elle relève par ailleurs que, la décision du requérant de suspendre les rencontres était motivée par l’exigence de protéger l’intérêt de l’enfant qui vit une situation de stress lors des rencontres, et une réaction au fait que les autorités compétentes n’ont pas pris en charge la situation psychologique de l’enfant afin de rétablir les relations parent-enfant.
S’agissant de mesures susceptibles de permettre le rétablissement du lien familial entre le requérant et son fils, la Cour rappelle que, si des mesures coercitives à l’égard des enfants ne sont pas souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l’enfant (voir, notamment, Maire c. Portugal, précité § 76). Or, en l’espèce, les juridictions nationales semblent avoir fait l’économie de telles mesures vis‑à-vis de la mère de l’enfant.
73. Cela étant, la Cour reconnaît que les autorités faisaient en l’espèce face à une situation très difficile qui était due notamment aux tensions existant entre les parents de l’enfant. Elle estime cependant qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir Lombardo, précité, § 91 et, mutatis mutandis, Reigado Ramos, précité, § 55). En l’espèce, les autorités nationales sont restées en-deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dès lors que le tribunal s’est limité à enjoindre aux parties de collaborer et d’exécuter ses décisions. Elles ont ainsi failli à leur devoir de prendre des mesures pratiques en vue d’inciter les intéressés à une meilleure coopération, tout en ayant à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant (Zawadka, précité, § 67). En particulier elles n’ont pas assuré un suivi psychologique de l’enfant et ont ainsi manqué à l’obligation de rétablir des relations entre le père et son enfant.
74. La Cour note, en outre, que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que les injonctions à donner exécution à ses décisions (Piazzi, précité, § 61). Bien que la Cour soit consciente des derniers développements de la procédure montrant une action plus efficace des autorités compétentes pour faire respecter le droit de visite du requérant et un comportement non coopératif de celui-ci, elle note que ces mesures ont été prises six ans après le début de la procédure, quand l’enfant était déjà âgé de dix ans, et que cela a eu des conséquences très graves pour les relations entre l’enfant et le requérant. Elle note, de plus, que les mesures prises demeurent insuffisantes compte tenu du fait que l’enfant ne bénéficie pas encore d’un soutien psychologique visant à un parcours de rapprochement avec son père.
75. Les autorités ont ainsi laissé se consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires, alors même que l’écoulement du temps avait à lui seul des conséquences sur la relation du père avec son enfant (Lombardo, précité, § 92). La Cour constate que l’existence de tensions graves entre les parents de l’enfant, suivie d’un droit de visite limité du fait du non-déroulement des rencontres programmées selon les modalités prévues et de la non-exécution des décisions ordonnant un parcours thérapeutique pour l’enfant, a rendu impossible pour le requérant la construction d’une relation stable avec Y.
76. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant et qu’elles ont méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.
77. Partant il y a eu violation de cette disposition.
DROIT DE VISITE DE L'EX EPOUX - EX CONCUBIN
OU EX PARTENAIRE PACSE
CALLAMAND c. FRANCE du 7 avril 2022 Requête no 2338/20
Art 8 •Rejet par les juridictions internes de la demande de l’ancienne conjointe de la mère d’une enfant conçue par assistance médicale à la procréation d’obtenir un droit de visite et d’hébergement • Absence de juste équilibre entre l’intérêt de la requérante à la préservation de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant
CEDH : Art 8
32. La Cour rappelle que, si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre d’éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Elle constate ensuite que l’atteinte alléguée à l’article 8 est la conséquence de la séparation de la requérante et de S.E. Elle ne résulte pas directement d’une décision ou d’un acte d’une autorité publique. En effet, le juge interne n’a pas supprimé un droit de visite et d’hébergement dont la requérante pouvait se prévaloir à l’égard de A. Il n’est intervenu qu’à posteriori, pour rejeter la demande qu’elle avait formulée sur le fondement du second alinéa de l’article 371-4 du code civil, qui donne au juge aux affaires familiales la possibilité de fixer les modalités des relations entre un enfant et d’autres personnes que ses ascendants si tel est l’intérêt de l’enfant. La Cour renvoie à cet égard l’affaire Honner précitée (§§ 53-54), dans laquelle, comme en l’espèce, la requérante se plaignait d’une violation de l’article 8 de la Convention en raison du refus du juge français de lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant de son ex-compagne, à l’éducation duquel elle avait contribué durant les premières années de sa vie.
33. Il convient donc d’examiner la présente affaire sous l’angle de l’obligation positive des États parties à la Convention de garantir aux personnes relevant de leur juridiction le respect effectif de leur vie privée et familiale plutôt que sous l’angle de leur obligation de ne pas s’ingérer dans l’exercice de ce droit.
34. Dès lors que l’affaire est examinée sous l’angle des obligations positives, il n’y a pas lieu pour la Cour de rechercher si le refus du juge français d’accorder un droit de visite et d’hébergement à la requérante était prévu par la loi et poursuivait un but légitime, même si la requérante fait valoir que ces conditions ne sont pas remplies (paragraphes 25-26 ci-dessus). La Cour rappelle que, dans le contexte des obligations positives, elle a pour tâche de vérifier si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en présence.
35. Comme la Cour l’a souligné à de nombreuses reprises, en matière d’obligations positives comme en matière d’obligations négatives, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble. De même, dans les deux hypothèses, les États parties jouissent d’une certaine marge d’appréciation, laquelle est de façon générale ample lorsque les autorités publiques doivent ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou entre différents droits protégés par la Convention (ibidem, § 55). Or tel était le cas en l’espèce dès lors notamment qu’étaient en jeu, non seulement le droit au respect de la vie familiale de la requérante mais aussi le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits de A. au regard de l’article 8 de la Convention ainsi que les droits de S.E. au regard de cette disposition, en sa qualité de mère biologique.
36. La Cour rappelle aussi qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes, mais d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire (ibidem, § 56).
37. La question qui se pose en l’espèce est donc celle de savoir si, compte tenu de l’ample marge d’appréciation dont il disposait, l’État défendeur a ménagé un juste équilibre entre ces intérêts, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer.
38. La Cour observe que le rejet de la demande de la requérante tendant à a fixation d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de A. a des conséquences radicales sur son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu’il met fin à sa relation avec l’enfant, avec lequel S.E. et elle ont vécu en famille pendant plus de deux ans, de sa naissance et jusqu’à ce que S.E. décide de quitter le domicile familial avec lui. La Cour n’exclut pas que l’équilibre requis puisse être ménagé dans un tel cas de figure, en particulier lorsqu’il y a des raisons impérieuses tenant à la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, dès lors que la protection du droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale au titre de l’article 8 de la Convention était également en jeu, les juridictions internes étaient tenues de mettre en balance les intérêts éventuellement concurrents et, notamment, de montrer par leur raisonnement que les préoccupations relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant étaient d’une telle importance par rapport à l’intérêt de la requérante à au moins maintenir un contact avec lui, qu’il était justifié, au titre de l’article 8, de rejeter intégralement la demande qu’elle avait formulée sur le fondement de l’article 371-4 du code civil.
39. La Cour ne peut que constater que ni la cour d’appel de Bordeaux ni la Cour de cassation n’ont expressément reconnu que l’affaire dont elles étaient saisies soulevait également la question de la protection du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au titre de l’article 8, dans le cadre de l’examen de la demande qu’elle avait formulée sur le fondement l’article 371-4 du code civil. Ainsi, il ne ressort pas suffisamment du raisonnement des juridictions internes selon quelles modalités elles ont procédé pour rechercher si un juste équilibre avait été maintenu entre des intérêts potentiellement contraires, comme l’exige la jurisprudence de la Cour.
40. Il apparaît en fait à la lecture de l’arrêt du 3 avril 2018 que la décision de la cour d’appel de Bordeaux repose pour beaucoup sur la considération que la relation entre la requérante et A. ne relevait pas pleinement de la vie familiale. La cour d’appel a en effet retenu en conclusion de son arrêt qu’outre que la requérante ne démontrait pas pouvoir accueillir A. sereinement, elle n’avait voulu l’enfant qu’associée au vœu de sa compagne, n’avait contribué à l’élever que jusqu’à ses deux ans, et n’avait pas tenu à établir des liens de droit durables, faute d’avoir poursuivi son projet d’adoption. Or, comme elle l’a souligné au paragraphe 21 ci-dessus, la Cour estime au contraire qu’il existait entre la requérante et A. des liens personnels effectifs tenant du lien parent‑enfant, et bénéficiant de la protection de l’article 8 de la Convention.
41. La Cour a, en tout état de cause, du mal à voir en quoi les motifs retenus par la cour d’appel mentionnés ci-dessus et la circonstance que le projet parental de S.E. a précédé sa vie en couple avec la requérante, étaient décisifs pour l’examen de la demande de la requérante, qui ne visait ni à établir un lien de filiation entre l’enfant ni à obtenir le partage de l’autorité parentale. La requérante demandait seulement la possibilité de continuer à voir, de temps en temps, un enfant à l’égard duquel elle a agi en se considérant comme un co-parent pendant plus de deux ans depuis sa naissance.
42. La Cour relève que les juridictions internes se sont séparées sur l’issue à réserver à la demande de la requérante. Elle note que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux avait accordé un droit de visite et d’hébergement à la requérante (paragraphe 8 ci-dessus). De surcroît, devant la cour d’appel de Rouen, le ministère public avait conclu à la confirmation de cette décision, en proposant qu’il soit réduit au regard de l’absence de lien de parenté entre elle et l’enfant (paragraphe 9 ci-dessus).
43. En outre, il est difficile pour la Cour de déceler dans le raisonnement de la cour d’appel, alors même qu’elle n’a pas estimé nécessaire de procéder à une évaluation psychologique de l’enfant, la raison pour laquelle elle s’est séparée de l’appréciation du tribunal de grande instance de Bordeaux et du ministre public. La cour d’appel de Bordeaux a certes relevé dans son arrêt du 3 avril 2018 qu’A. avait des difficultés, constatant que le psychologue qui la suivait avait noté un « changement chez [elle] entraînant un malaise patent ... une détresse psychique ... en lien avec les perturbations récentes ... dans son environnement ». Elle a cependant admis que, si la relation fusionnelle dont la requérante faisait état n’allait pas dans l’intérêt de l’enfant, il ne pouvait être considéré que l’attitude de la requérante était seule à l’origine des difficultés de A., notant à cet égard qu’elle était confrontée à la séparation du premier couple qu’elle avait connu, aux plaintes de sa mère sur la requérante et aux litiges induits. La requérante fait à juste titre valoir à cet égard que la cour d’appel n’a pas démontré que le fait qu’A. avait des difficultés était la conséquence de ses rencontres avec elle.
44. La Cour relève que la présente affaire diffère de l’affaire Honner précitée, notamment parce que la conclusion de non-violation de l’article 8 de la Convention à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Honner repose sur le constat que la décision de la cour d’appel de Paris était attentivement motivée, notamment en ce qui concernait la caractérisation de l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour a observé à cet égard que pour juger qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre ses rencontres avec la requérante, la cour d’appel de Paris avait relevé qu’il était fragile, qu’il se trouvait dans une situation traumatisante et culpabilisante, au centre d’un conflit entre la requérante et sa mère biologique, lesquelles ne parvenaient pas à échanger sans agressivité, que les changements de mains de l’une à l’autre se passaient mal et qu’il s’était montré réticent à se rendre chez la requérante. En l’espèce, il n’y a rien dans le raisonnement des juridictions nationales qui permette à la Cour de voir si la situation était comparable et, donc, de nature à conforter la conclusion selon laquelle A. devait être protégée de tout contact avec la requérante
45. Ainsi, les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 avril 2018, compte-tenu de l’étendu limitée du contrôle effectué dans le cadre du pourvoi en cassation (paragraphe 13 ci-dessus), ne démontrent pas qu’un juste équilibre ait été ménagé entre l’intérêt de la requérante à la préservation de sa vie privée et familiale, d’une part, et, d’autre part, l’intérêt supérieur de l’enfant A.
46. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
Honner c. France du 12 novembre 2020 requête n° 19511/16
Article 8 : Refus d’accorder à la requérante un droit de visite à l’enfant né par PMA de son ex-compagne : pas de violation de la Convention
L’affaire concerne le refus d’accorder un droit de visite et d’hébergement à la requérante à l’égard de l’enfant que son ex-compagne avait eu par procréation médicalement assistée en Belgique lorsqu’elles étaient en couple, alors que la requérante avait élevé l’enfant pendant les premières années de sa vie. La Cour juge en particulier qu’en rejetant la demande de la requérante au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et en motivant attentivement cette mesure, les autorités françaises n’ont pas méconnu leur obligation positive de garantir le respect effectif du droit de la requérante à sa vie familiale.
Art 8 • Vie familiale • Obligations positives • Refus d’accorder un droit de visite et d’hébergement à une femme sans lien biologique à l’égard de l’enfant de son ex-compagne conçu par procréation médicalement assistée lorsqu’elles étaient en couple, qu’elle avait élevé pendant les premières années de sa vie avant leur séparation • Lien parent‑enfant de facto entravé par la séparation des deux femmes • Possibilité d’obtenir un examen judiciaire de la question de la préservation du lien • Relations conflictuelles entre les deux femmes • Tension plaçant l’enfant dans une situation traumatisante • Décision basée sur l’intérêt supérieur de l’enfant
FAITS
La requérante, Rachel Honner, est une ressortissante française, née en 1966 et résidant à Paris (France). L’enfant, G., né en 2007, est le fruit d’un projet parental élaboré entre la requérante et son excompagne, C., qui vivaient en couple depuis l’année 2000 et qui avaient conclu un pacte civil de solidarité en avril 2009 (PACS). Il a été élevé par les deux femmes jusqu’à la séparation du couple en mai 2012. Quelques semaines après leur séparation, l’ex-compagne de Mme Honner s’opposa à la poursuite de relations entre l’enfant et la requérante. Cette dernière saisit le juge aux affaires familiales d’une demande de droit de visite et d’hébergement. Le tribunal de grande instance lui accorda ce droit. Le juge considéra, en effet, notamment, que la naissance de l’enfant correspondait à un projet familial commun du couple et que la requérante s’était investie auprès de lui dès sa naissance. L’ex-compagne de la requérante interjeta appel du jugement du tribunal de grande instance, qui fut infirmé. La cour d’appel de Paris retint que les rencontres entre la requérante et l’enfant étaient trop traumatisantes pour ce dernier, et ainsi, qu’accorder un droit de visite et d’hébergement à Mme Honner était contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le pourvoi de Mme Honner devant la Cour de cassation fut rejeté. Entre temps, saisi par Mme Honner, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France avait prononcé un blâme contre le docteur qui avait rédigé des certificats produits par l’ex-compagne de la requérante devant la cour d’appel de Paris. Elle considéra que la rédaction de ces certificats était biaisée et que ceux-ci se référaient à des faits dont le médecin n’avait pu lui-même constater la réalité.
Article 8 (droit au respect de la vie familiale)
L’enfant G. est le fruit d’un projet parental élaboré entre la requérante et C., qui ont vécu en couple de l’année 2000 jusqu’à leur séparation en mai 2012. La Cour note que les liens qui se sont développés entre la requérante et G durant les quatre ans et demi de leur vie commune relèvent de la vie familiale au sens de l’article 8. La Cour constate que le lien entre l’enfant et la requérante a été entravé non pas du fait d’une décision ou d’un acte de l’autorité publique mais en conséquence de la séparation de la requérante et de son ex-compagne.
Le juge interne n’a pas supprimé un droit de visite et d’hébergement dont pouvait se prévaloir la requérante à l’égard de l’enfant, mais a rejeté la demande de celle-ci sur le fondement du second alinéa de l’article 371-4 du code civil, qui donne au juge aux affaires familiales la possibilité de fixer les modalités des relations entre un enfant et d’autres personnes que ses ascendants si tel est l’intérêt de l’enfant. La Cour examine donc l’affaire sous l’angle de l’obligation positive des Etats parties de garantir aux personnes relevant de leur juridiction le respect effectif de leur vie familiale, plutôt que sous l’angle de leur obligation de ne pas s’ingérer dans l’exercice de ce droit. La Cour rappelle qu’il convient d’avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble. Elle rappelle aussi que les Etats parties jouissent d’une certaine marge d’appréciation, ample lorsque les autorités publique doivent ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou bien entre différents droits protégés par la Convention ; or, tel était le cas en l’espèce dès lors notamment qu’étaient en jeu, non seulement le droit au respect de la vie familiale de la requérante mais aussi le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits de G. au regard de l’article 8 de la Convention ainsi que les droits de C., l’ex-compagne, au regard de cette disposition. La Cour observe que le droit français prévoit la possibilité pour une personne ayant développé un lien familial de facto avec un enfant d’obtenir des mesures visant à la préservation de ce lien. Le cadre légal français a ainsi donné à la requérante la possibilité d’obtenir un examen judiciaire de la question de la préservation du lien qu’elle avait développé avec G., possibilité dont elle a usé. La Cour constate ensuite que la cour d’appel de Paris a retenu que les rencontres entre la requérante et l’enfant étaient trop traumatisantes pour ce dernier, et qu’il n’était donc pas dans son intérêt de les poursuivre. Sa décision est donc fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. La cour d’appel a en effet relevé que G., enfant fragile, se trouvait dans une situation traumatisante et culpabilisante, au centre d’un conflit entre la requérante et sa mère biologique qui ne parvenaient pas à échanger sans agressivité. Elle a également relevé que les changements de mains de l’une à l’autre se passaient mal et que G. s’était montré réticent à se rendre chez la requérante. La Cour ne saurait mettre en cause la conclusion que la cour d’appel a tirée de ces constats, selon laquelle il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre ses rencontres avec la requérante. la Cour note également que la requérante reproche à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte les pièces qu’elle a produites et de s’être exclusivement fondée sur des attestations émanant de proches de C. et sur des certificats de complaisance, dont ceux établis par un médecin qui lui ont valu un blâme de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins parce qu’ils se référaient à des faits dont il n’aurait pas pu lui-même constater la réalité. Or, rien ne permet de considérer que la cour d’appel de Paris aurait omis de prendre en compte les éléments produits par la requérante. S’agissant des certificats, dont la fiabilité est en cause, le Gouvernement souligne pertinemment qu’il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel que celle-ci ne s’est pas fondée de manière déterminante sur ces documents. Quant au point de vue de la requérante selon lequel la cour d’appel de Paris aurait pu alternativement organiser des rencontres médiatisées entre G. et elle, il se heurte au fait que la cour d’appel de Paris a considéré que, compte tenu des relations particulièrement conflictuelles entre les deux femmes qui plaçaient l’enfant dans une situation traumatisante, il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’organiser des relations entre lui et la requérante. La Cour comprend la souffrance que la situation litigieuse et la réponse donnée par la cour d’appel de Paris ont pu causer à la requérante. Elle estime cependant que les droits de la requérante ne sauraient primer sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Eu égard aussi à l’ample marge d’appréciation dont il disposait, la Cour conclut que l’État défendeur n’a pas méconnu son obligation positive de garantir le respect effectif du droit de la requérante à sa vie familiale. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention
ARTICLE 8
recevabilité
26. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette disposition est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises. Ainsi, les griefs dont on entend la saisir doivent d’abord être soulevés, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, parmi de nombreux autres arrêts et décisions, Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999‑VI).
27. La Cour relève ensuite que la requérante s’est dûment pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2014. Elle rappelle à cet égard que le pourvoi en cassation figure parmi les procédures dont il doit ordinairement être fait usage pour se conformer à l’article 35 de la Convention. Pour pleinement épuiser les voies de recours internes, il faut donc en principe mener la procédure interne jusqu’au juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour (voir, par exemple, Graner c. France (déc.), no 84536/17, § 44, 5 mai 2020, ainsi que les références qui y sont indiquées).
28. Il en va notamment ainsi des griefs tirés d’une violation du droit au respect de la vie familiale tels que celui que la requérante soumet à la Cour. S’il est vrai que les faits ne peuvent plus être discutés devant la Cour de cassation française, le pourvoi en cassation visant à faire censurer la non‑conformité de la décision attaquée aux règles de droit (paragraphe 15 ci‑dessus), il revient du moins à la Cour de cassation, saisie d’un tel grief, de vérifier si la décision visée par le pourvoi est conforme aux exigences de la Convention relatives au droit au respect de la vie familiale.
29. Ceci étant, la Cour constate que, si le moyen de cassation de la requérante tendait essentiellement à dénoncer l’insuffisance de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris au regard des exigences de l’article 455 du code de procédure civile (paragraphes 9 et 15 ci-dessus), la requérante a néanmoins soulevé en substance devant la Cour de cassation le grief tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale qu’elle soumet à la Cour.
30. La requérante a en effet évoqué dans son mémoire ampliatif la jurisprudence de la Cour selon laquelle la vie familiale, telle que garantie par l’article 8 de la Convention, englobe les liens familiaux de facto, et selon laquelle de tels liens peuvent exister entre un adulte et un enfant qui n’ont pas de rapport de filiation. Ce faisant, elle a expressément renvoyé aux arrêts Keegan, Johnston et autres et Moretti et Benedetti (précités) dans lesquels la Cour a conclu à la violation de cette disposition. La requérante a ajouté que la censure de l’arrêt du 5 juin 2014 s’imposait d’autant plus qu’elle avait précisé dans ses observations en appel que le maintien des relations entre G. et elle « correspondait à leur droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la Convention » (paragraphe 10 ci-dessus). Le moyen de la requérante visait ainsi l’insuffisance de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris au regard de son droit au respect de sa vie familiale.
31. La Cour déduit de ce qui précède que la requérante a mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2014 était conforme aux exigences de la Convention relatives à ce droit.
32. S’agissant des autres recours évoqués par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’en tout état de cause, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (voir, par exemple, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999‑III).
33. Il convient donc de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
34. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondées ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
FOND
49. Les parties s’accordent à considérer que les liens entre la requérante et G. relèvent de la vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention.
50. Tel est également le constat que fait la Cour. Elle rappelle que la question de l’existence ou de l’absence d’une vie familiale est d’abord une question de fait, qui dépend de l’existence de liens personnels étroits. La notion de « famille » visée par l’article 8 concerne non seulement les relations fondées sur le mariage, mais aussi d’autres liens « familiaux » de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d’autres facteurs démontrent qu’une relation a suffisamment de constance. La Cour accepte ainsi, dans certaines situations, l’existence d’une vie familiale de facto entre un adulte ou des adultes et un enfant en l’absence de liens biologiques ou d’un lien juridiquement reconnu, sous réserve qu’il y ait des liens personnels effectifs (voir notamment Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, §§ 140 et 148, 24 janvier 2017, ainsi que les références qui y figurent). Elle a notamment déclaré que la relation entre deux femmes vivant ensemble sous le régime du pacte civil de solidarité et l’enfant que la seconde d’entre elles avait conçu par procréation médicalement assistée et qu’elle élevait conjointement avec sa compagne s’analysait en une « vie familiale » au regard de l’article 8 de la Convention (voir X et autres c. Autriche [GC], no 19010/07, § 95, CEDH 2013, et Gas et Dubois c. France (déc.), no 25951/07, 31 août 2010).
51. En l’espèce, né le 15 octobre 2007, G. est le fruit d’un projet parental élaboré entre la requérante et C., qui vivaient en couple depuis l’année 2000 et qui ont conclu un pacte civil de solidarité en avril 2009. G. a été élevé par les deux femmes avec S., fils de la requérante, jusqu’à la séparation du couple en mai 2012. Les liens qui se sont développés entre la requérante, C., S. et G durant les quatre ans et demi de leur vie commune relèvent sans aucun doute de la vie familiale au sens de l’article 8. Il en va spécialement ainsi du lien entre la requérante et G. Il ressort en effet du dossier qu’elle s’est investie dans son éducation, qu’elle s’est mise en disponibilité lorsqu’il avait quatre mois pour s’occuper au quotidien de lui et de son fils biologique, S., et qu’il l’appelait maman (paragraphes 4-5 et 7 ci-dessus). Le lien qui s’est construit entre elle et G. tient donc, de facto, du lien parent‑enfant.
52. La Cour note ensuite que les parties retiennent toutes deux qu’il y a eu en l’espèce ingérence d’une autorité publique dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de sa vie familiale, procédant ainsi à un examen du grief sous l’angle des obligations négatives que l’article 8 met à la charge des États parties.
53. La Cour ne partage pas cette approche. Elle rappelle que, si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre d’éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale (voir, par exemple, Moretti et Benedetti, précité, § 60). Elle constate ensuite que le fait que le lien entre G. et la requérante est entravé ne résulte pas d’une décision ou d’un acte d’une autorité publique mais est la conséquence de la séparation de cette dernière et de C. Il apparaît en outre que le juge interne n’a pas supprimé un droit de visite et d’hébergement dont la requérante pouvait se prévaloir à l’égard de G., mais a rejeté la demande qu’elle avait formulée sur le fondement du second alinéa de l’article 371-4 du code civil, qui donne au juge aux affaires familiales la possibilité de fixer les modalités des relations entre un enfant et d’autres personnes que ses ascendants si tel est l’intérêt de l’enfant (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour renvoie de plus aux affaires Moretti et Benedetti (arrêt précité, §§ 60-71) et V.D. et autres c. Russie (no 72931/10, §§ 125‑131, 9 avril 2019), qui concernaient la question du maintien d’un lien familial de facto entre des adultes et des enfants, et qu’elle a examinées sous l’angle de l’obligation positive des États parties de garantir aux personnes relevant de leur juridiction le respect effectif de leur vie familiale, plutôt que sous l’angle de leur obligation de ne pas s’ingérer dans l’exercice de ce droit.
54. La Cour procédera pareillement en l’espèce.
55. Elle rappelle qu’en matière d’obligations positives comme en matière d’obligations négatives, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble. De même, dans les deux hypothèses, les États parties jouissent d’une certaine marge d’appréciation, laquelle est de façon générale ample lorsque les autorités publiques doivent ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou entre différents droits protégés par la Convention (voir, parmi d’autres, Moretti et Benedetti, précités, §§ 60 et 63). Or tel était le cas en l’espèce dès lors notamment qu’étaient en jeu, non seulement le droit au respect de la vie familiale de la requérante mais aussi le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits de G. au regard de l’article 8 de la Convention ainsi que les droits de C. au regard de cette disposition.
56. La Cour rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes, mais d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire (ibidem, § 64).
57. La question qui se pose en l’espèce est donc celle de savoir si, compte tenu de l’ample marge d’appréciation dont il disposait, l’État défendeur a ménagé un juste équilibre entre ces intérêts, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer.
58. La Cour observe tout d’abord que le droit français prévoit la possibilité pour une personne ayant développé un lien familial de facto avec un enfant d’obtenir des mesures visant à la préservation de ce lien. L’article 371-4 du code civil permet en effet au juge aux affaires familiales de fixer les modalités des relations entre un tiers et un enfant si tel est l’intérêt de ce dernier, en particulier lorsque le tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation ou à son entretien, et a noué avec lui des liens affectifs durables (paragraphe 14 ci‑dessus). Cette disposition s’applique notamment lorsque, comme en l’espèce, un couple se sépare alors que l’un des conjoints avait développé un lien familial avec l’enfant de l’autre.
59. Le cadre légal français a ainsi donné à la requérante la possibilité d’obtenir un examen judiciaire de la question de la préservation du lien qu’elle avait développé avec G., possibilité dont elle a usé.
60. La Cour constate ensuite que, procédant à cet examen, la cour d’appel de Paris a retenu que les rencontres entre la requérante et l’enfant étaient trop traumatisantes pour ce dernier, et qu’il n’était donc pas dans son intérêt de les poursuivre. Sa décision est donc fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, comme la Cour l’a souligné ci-dessus (paragraphe 57), l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer.
61. Elle relève aussi que l’arrêt de la cour d’appel de Paris est attentivement motivé, notamment en ce qui concerne la caractérisation de l’intérêt supérieur de l’enfant. La cour d’appel a en effet relevé que G., enfant fragile, se trouvait dans une situation traumatisante et culpabilisante, au centre d’un conflit entre la requérante et sa mère biologique, lesquelles ne parvenaient pas à échanger sans agressivité. Elle a également relevé que les changements de mains de l’une à l’autre se passaient mal et que G. s’était montré réticent à se rendre chez la requérante. La Cour, qui rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de visite et d’hébergement, ne saurait mettre en cause la conclusion que la cour d’appel a tirée de ces constats, selon laquelle il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre ses rencontres avec la requérante.
62. La présente affaire se distingue donc des affaires V.D. et autres c. Russie et Moretti et Benedetti précitées, dans lesquelles la Cour a conclu à la violation de l’article 8. La première de ces affaires concernait notamment le cas d’une personne qui s’était trouvée privée de la possibilité de maintenir le lien familial de facto qui s’était développé entre elle et un enfant dont elle avait été tutrice pendant plusieurs années, après le retour de ce dernier chez ses parents. La conclusion de la Cour se fonde en particulier sur le fait que, le droit russe n’ouvrant pas cette possibilité aux personnes dépourvues de lien biologiques avec l’enfant, les juridictions internes avaient rejeté la demande de la requérante tendant à l’organisation de contacts, sans même examiner les circonstances de la cause ni caractériser l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans l’affaire Moretti et Benedetti, il s’agissait de parents d’accueil qui avaient vainement engagé une procédure visant à l’adoption d’un enfant qui leur avait été confié. Le constat de violation de la Cour repose notamment sur le fait que le juge interne n’avait pas motivé sa décision de rejeter la demande d’adoption.
63. Ceci étant, la Cour note que la requérante reproche à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte les pièces qu’elle a produites et de s’être exclusivement fondée sur des attestations émanant de proches de C. et sur des certificats de complaisance, dont ceux établis par le docteur F., qui ont valu à ce dernier un blâme de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins parce qu’ils se référaient à des faits dont il n’avait pas pu lui‑même constater la réalité. Elle lui reproche également de ne pas avoir ordonné une expertise médico-psychologique et une enquête sociale et de ne pas avoir, à défaut de lui reconnaître un droit de visite et d’hébergement, pris d’autres mesures permettant le maintien de ses relations avec l’enfant telles que des rencontres médiatisées.
64. Rien ne permet toutefois de considérer que la cour d’appel de Paris aurait omis de prendre en compte les éléments produits par la requérante. Son arrêt du 5 juin 2014 montre au contraire qu’elle a notamment fondé ses conclusions sur des témoignages relatifs au déroulement du week‑end du 31 janvier 2014, durant lequel la requérante avait accueilli G. dans son foyer, et sur une attestation de son fils S. Par ailleurs, s’agissant des certificats du docteur F., dont la fiabilité est en cause, le Gouvernement souligne pertinemment qu’il ressort de cet arrêt que la cour d’appel ne s’est pas fondée de manière déterminante sur ces documents. La Cour rappelle en outre qu’elle reconnaît aux États parties une très large marge de manœuvre en matière d’administration de la preuve, sous réserve qu’ils ne se livrent pas à l’arbitraire, et qu’il revient aux juridictions internes d’apprécier la valeur probante des éléments qui leur sont soumis (voir, dans un contexte très différent de celui de l’espèce, A.P., Garçon et Nicot c. France, nos 79885/12 et 2 autres, §§ 150-151, 6 avril 2017). On ne saurait donc tirer de conclusion de ce que la cour d’appel de Paris a décidé qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour évaluer les risques que le maintien de rencontres avec la requérante représentait pour G. et n’a donc pas jugé nécessaire d’ordonner une expertise médico-psychologique ou une enquête sociale.
65. Quant au point de vue de la requérante selon lequel la cour d’appel de Paris aurait pu alternativement organiser des rencontres médiatisées entre G. et elle, ce qui aurait permis de maintenir leur lien, il se heurte au fait que cette juridiction a retenu que, compte tenu des relations particulièrement conflictuelles entre les deux femmes et de ce que cette tension plaçait l’enfant dans une situation traumatisante, il n’était pas dans l’intérêt de ce dernier d’organiser des relations entre lui et la requérante.
66. La Cour comprend la souffrance que la situation litigieuse et la réponse que lui a donnée la cour d’appel de Paris ont pu causer à la requérante. Elle estime cependant que ses droits ne sauraient primer sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
67. Partant, eu égard aussi à l’ample marge d’appréciation dont il disposait, l’État défendeur n’a pas méconnu son obligation positive de garantir le respect effectif du droit de la requérante à sa vie familiale.
68. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
JURISPRUDENCE COUR DE CASSATION
LA COUR DE CASSATION REND UN ARRÊT DE PRINCIPE SUR LE DROIT DE VISITE D'UNE EX COMPAGNE SUR L'ENFANT
QUE LES DEUX FEMMES AVAIENT EN PARTIE ELEVE ENSEMBLE.
L'intérêt supérieur de l'enfant s'impose sur le droit de visite de l'ex compagne dont la violence est démontrée.
Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 24 juin 2020 pourvoi n° 19-15198 rejet
4. Aux termes de l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
5. Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
6. Aux termes de l’article 14 de la même Convention, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
7. Aux termes de l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
8. Ce texte permet le maintien des liens entre l’enfant et l’ancienne compagne ou l’ancien compagnon de sa mère ou de son père lorsque des liens affectifs durables ont été noués, tout en le conditionnant à l’intérêt de l’enfant.
9. En ce qu’il tend, en cas de séparation du couple, à concilier le droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés et l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne saurait, en lui-même, méconnaître les exigences conventionnelles résultant des articles 3, § 1, de la Convention de New-York et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il ne saurait davantage méconnaître les exigences résultant de l’article 14 de cette même Convention dès lors qu’il n’opère, en lui-même, aucune distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l’union contractée par le couple de même sexe, cette distinction résultant d’autres dispositions légales selon lesquelles la création d’un double lien de filiation au sein d’un couple de même sexe implique, en l’état du droit positif, l’adoption de l’enfant par le conjoint de son père ou de sa mère.
11. L’arrêt relève que Mme X..., bien que réticente à l’idée d’accueillir un enfant au sein de son foyer, s’est impliquée dans le projet de Mme Y... dès la conception de l’enfant, étant présente pour l’insémination, le suivi médical de la grossesse et au moment de l’accouchement. Il constate que la naissance de l’enfant a été annoncée par les deux femmes au moyen d’un faire-part mentionnant leurs deux noms. Il ajoute que chacune d’elles s’est investie dans le quotidien de l’enfant après sa naissance et qu’un droit de visite et d’hébergement amiable une fin de semaine sur deux a été instauré au bénéfice de Mme X... à l’issue de la séparation du couple, en septembre 2015.
12. Il relève cependant que le droit de visite et d’hébergement de Mme X... a cessé d’être exercé dès le mois de janvier 2016, Mme Y... refusant que sa fille continue de voir son ancienne compagne en raison du comportement violent de celle-ci. Il précise que, si le caractère conflictuel de la séparation n’est pas contesté par les parties, la violence des interventions de Mme X... à l’égard de Mme Y... est attestée par les pièces produites, qui font état d’intrusions sur le lieu de travail de celle-ci et au domicile de ses parents, en présence de l’enfant, qui a été le témoin de ses comportements véhéments et emportés.
13. Il estime que ces confrontations, en présence de l’enfant, ont généré une crainte et une réticence réelle de celle-ci à l’idée de se rendre chez Mme X..., et que cette dernière n’a pas su préserver C... du conflit avec son ancienne compagne, ce qui est de nature à perturber son équilibre psychique.
14. Il retient enfin que, si Mme X... a pu résider de manière stable avec l’enfant du temps de la vie commune du couple et a pourvu à son éducation et à son entretien sur cette même période, la preuve du développement d’une relation forte et de l’existence d’un lien d’affection durable avec C... n’est pas rapportée.
15. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement déduit qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la demande de Mme X.... Elle a ainsi, par une décision motivée, statuant en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être primordial, légalement justifié sa décision, sans porter atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X....
16. Il n’y a pas donc lieu d’accueillir la demande aux fins d’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme.
DROIT DE VISITE DES GRANDS PARENTS ET DES TIERS
Bogonosovy c. Russie du 5 mars 2019 requête n° 38201/16
Violation de l'article 8 : L’absence d’examen par les tribunaux de l’affaire d’un grand-père qui souhaitait conserver des liens avec sa petite-fille après l’adoption de celle-ci s’analyse en une violation de la Convention
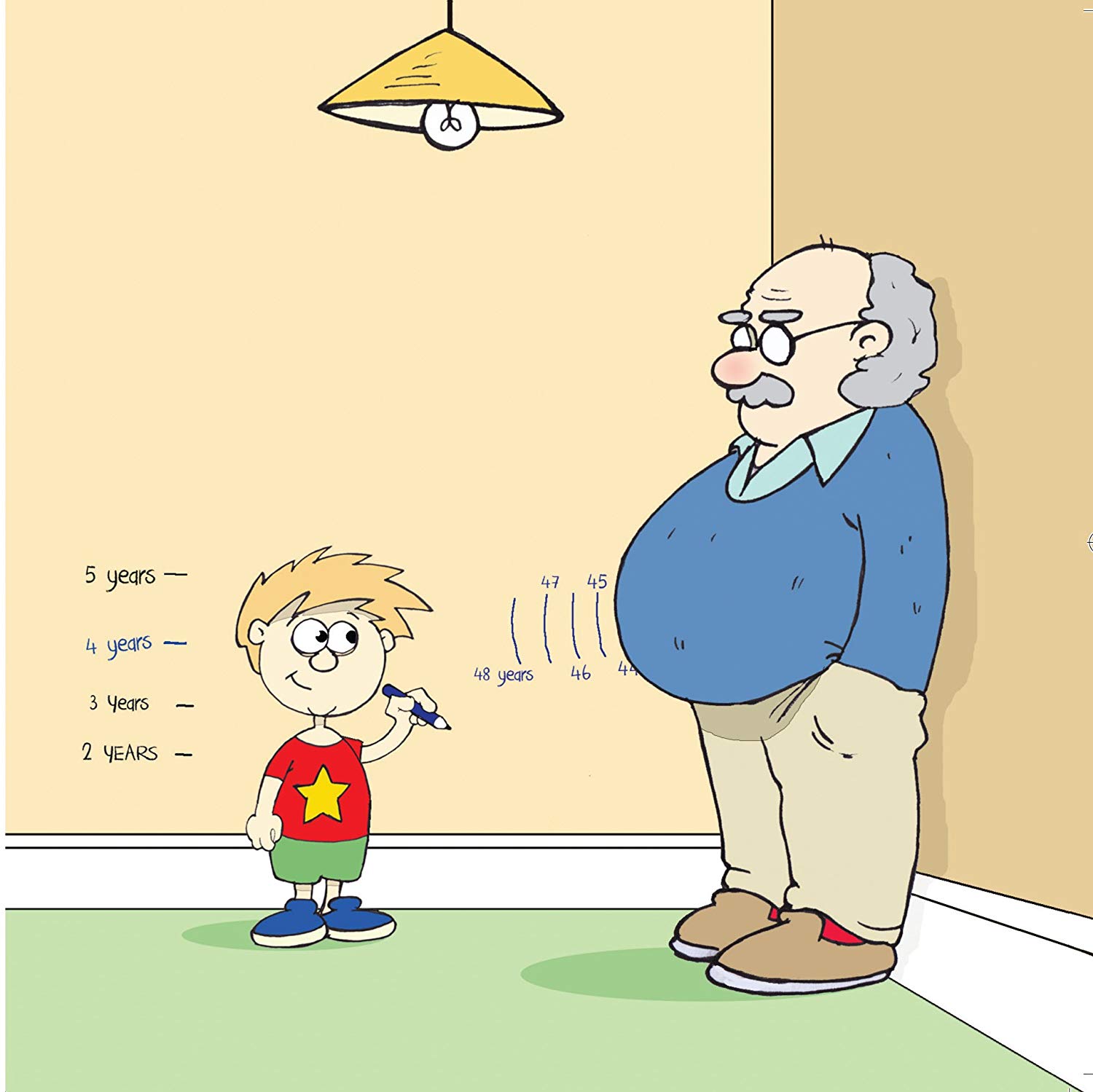 L’affaire concerne un grand-père qui souhaitait maintenir
des liens avec sa petite-fille après l’adoption de celle-ci par une autre famille.
La Cour dit que les juridictions internes auraient dû examiner sa demande de préservation des relations avec sa petite-fille postérieurement à l’adoption de
celle-ci mais qu’elles ont au contraire interprété et appliqué la loi d’une manière qui lui a refusé pareil examen. M. Bogonosov s’est ainsi trouvé
complètement et automatiquement exclu de la vie de sa petite-fille, ce qui s’analyse en une violation de ses droits.
L’affaire concerne un grand-père qui souhaitait maintenir
des liens avec sa petite-fille après l’adoption de celle-ci par une autre famille.
La Cour dit que les juridictions internes auraient dû examiner sa demande de préservation des relations avec sa petite-fille postérieurement à l’adoption de
celle-ci mais qu’elles ont au contraire interprété et appliqué la loi d’une manière qui lui a refusé pareil examen. M. Bogonosov s’est ainsi trouvé
complètement et automatiquement exclu de la vie de sa petite-fille, ce qui s’analyse en une violation de ses droits.
CEDH
La Cour décide de ne pas examiner la requête de Mme Bogonosova, aucun héritier ou proche n’ayant souhaité poursuivre la procédure après le décès de celle-ci.
Elle considère que M. Bogonosov entretenait avec sa petite-fille des liens familiaux au sens de l’article 8 dans la mesure où, en particulier, il s’était occupé d’elle de mai 2008 jusqu’à juillet 2013, avant que celle-ci n’allât vivre au domicile de la famille Z. Elle note que lorsqu’il a confirmé l’adoption, le tribunal de Saint-Pétersbourg a laissé croire au grand-père qu’il pourrait solliciter un droit de visite à l’égard de sa petite-fille postérieurement à l’adoption en vertu de l’article 67 du code de la famille et qu’il pourrait demander la délivrance d’une ordonnance contre les parents adoptifs si ceux-ci faisaient obstacle à ces visites. En réalité, pareil droit n’existait qu’à condition que le jugement d’adoption initial mentionnât la nécessité de maintenir des liens avec les grands-parents, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. La Cour pose la question de savoir si le droit interne était suffisamment clair sur la question du maintien ou de la rupture des relations entre un enfant adopté et sa famille d’origine. Présumant qu’il l’était, la Cour dit que le tribunal de Saint-Pétersbourg aurait dû examiner le droit de M. Bogonosov de garder le contact avec sa petite-fille au moment où il a examiné l’appel formé par l’intéressé contre l’adoption, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, lorsqu’il a rouvert la procédure d’adoption en 2015, le tribunal de Saint-Pétersbourg a interprété et appliqué le droit de telle manière que l’intéressé s’est trouvé complètement exclu de la vie de sa petite-fille après l’adoption de celle-ci, alors même que la question des visites postérieures à l’adoption était posée à ce tribunal. L’absence d’examen par le tribunal de la question des relations entre M. Bogonosov et sa petite-fille postérieurement à l’adoption de celle-ci s’analyse en une violation du droit au respect de la vie familiale dans le chef du requérant.
MANUELLO ET NEVI c. ITALIE du 20 janvier 2014 requête n°107/10
Violation de l'article 10 : L'État Italien n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour que les grands parents puissent voir leur petite fille.
47. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour garantir les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, nº 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, précité, § 108, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). Il en va de même lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, des relations entre l’enfant et ses grands-parents (Nistor c. Roumanie, no 14565/05, § 71 2 novembre 2010 ; Bronda c. Italie, 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV). Elle rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).
48. Pour être adéquates, les mesures visant à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (Lombardo, § 81, précité ; Nicolò Santilli c. Italie, no 51930/10, § 65 17 décembre 2013).
49. La Cour rappelle que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (voir Lombardo, § 84, précité ; Nicolò Santilli, § 67, précité). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et, notamment, des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui confère l’article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004). Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005) et l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], nº 25735/94, §§ 49‑50, CEDH 2000‑VIII). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen c. Finlande, nº 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
50. La Cour note en premier lieu qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le lien entre les requérants et M.C. relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention (voir Nistor, § 93, et Bronda, §50 précités).
51. La Cour observe ensuite qu’il ressort clairement des documents en sa possession que la procédure interne concernant le droit de visite des requérants a débuté en 2002 devant le tribunal pour enfants de Turin (RGNR no 1469/02). Partant, la Cour ne partage pas la thèse du Gouvernement selon laquelle la procédure interne devant le tribunal n’aurait commencé qu’en 2004 (voir paragraphe 42 ci-dessus).
52. Se penchant sur la présente affaire, la Cour estime que devant les circonstances qui lui sont soumises sa tâche consiste à examiner si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre les requérants et leur petite-fille et si elles ont ainsi respecté les obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention.
53. La Cour remarque que les requérants n’ont plus vu leur petite-fille depuis 2002 et qu’à ce jour tout contact avec l’enfant leur est interdit. À ce propos elle rappelle que, selon les principes élaborés en la matière, des mesures aboutissant à briser les liens entre un enfant et sa famille ne peuvent être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles (voir Zhou c. Italie, no 33773/11, § 46, 21 janvier 2014 ; Clemeno et autres c. Italie, n 19537/03, § 60, 21 octobre 2008). La Cour estime que ces principes s’appliquent également au cas d’espèce. À ce propos, elle rappelle avoir déjà jugé que les liens entre les grands-parents et les petits-fils relèvent de liens familiaux au sens de l’article 8 de la Convention (voir Kruškić c. Croatia (déc.), no 10140/13, 25 November 2014 ; Nistor c. Roumanie, n 14565/05, § 71, 2 novembre 2010 ; Bronda c. Italie, 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV).
54. La Cour note qu’en l’espèce l’impossibilité pour les requérants de voir leur petite-fille a été la conséquence, dans un premier temps, du manque de diligence des autorités compétentes et, dans un deuxième temps, de la décision de suspendre les rencontres. Les requérants n’ont pu ni obtenir la mise en œuvre, dans un délai raisonnable, d’un parcours de rapprochement avec leur petite-fille, ni faire respecter leur droit de visite, tel qu’il avait été reconnu par la décision du tribunal du 16 février 2006.
55. La Cour observe que ce n’est qu’en décembre 2005, soit trois ans après la demande des requérants aux fins de rencontrer leur petite-fille, que le tribunal des enfants de Turin est parvenu à une décision concernant l’autorisation des rencontres. Elle souligne aussi qu’entre 2005 et 2007 les services sociaux n’ont pas donné exécution à la décision du tribunal autorisant les rencontres et qu’aucune mesure visant à mettre en œuvre le droit de visite des requérants n’a été prise en l’espèce. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention imposent à l’État d’adopter des mesures propres à réunir les parents et l’enfant, sachant par ailleurs que le caractère adéquat d’une mesure se juge aussi à la rapidité de sa mise en œuvre (Nicolò Santilli, § 71, Lombardo, § 89, précités ; Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 78, 2 novembre 2010).
56. La Cour observe que la décision de suspendre les rencontres entre les requérants et l’enfant fut fondée exclusivement sur les rapports des psychologues selon lesquels l’enfant associait ses grands-parents à son père et aux souffrances subies en raison des prétendus attouchements sexuels.
57. La Cour relève que l’interdiction des rencontres s’inscrit dans les démarches que les autorités sont en droit d’entreprendre dans les affaires de sévices sexuels et rappelle que l’État a l’obligation de protéger les enfants de toute ingérence dans des aspects essentiels de leur vie privée (Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 103, 9 mai 2003 ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 64, Recueil 1996‑IV). Toutefois, la Cour constate en l’occurrence que la procédure pénale à l’encontre du père était pendante quand les juridictions internes ont autorisé les rencontres et que c’est après l’acquittement du père en 2006 (voir paragraphe 10 ci-dessus) que les mêmes juridictions ont décidé d’interdire toute possibilité de rencontre. La raison principale qui justifia la rupture presque totale des rapports entre les requérants et l’enfant était le fait que l’enfant associait ses grands-parents à son père et aux prétendus attouchements sexuels subis. Bien que la Cour soit consciente du fait qu’une grande prudence s’impose dans des situations de ce type et que des mesures visant à protéger l’enfant peuvent impliquer une limitation des contacts avec les membres de la famille, elle estime que les autorités compétentes n’ont pas déployé les efforts nécessaires pour sauvegarder le lien familiale et n’ont pas réagi avec la diligence requise (Clemeno et autres, précité, §§ 59-61).
La Cour remarque à cet égard que trois ans se sont écoulés avant que le tribunal de Turin ne se prononce sur la demande des requérants de rencontrer leur petite-fille (voir paragraphe 55 ci-dessus) et que la décision du tribunal accordant aux requérants le droit de visite n’a jamais été exécutée (voir paragraphe 54 ci-dessus).
58. La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce passer outre le fait que les requérants n’ont pu voir leur petite-fille depuis douze ans environ, qu’à plusieurs reprises ils ont sollicité la mise en place d’un parcours de rapprochement avec l’enfant, qu’ils ont suivi les prescriptions des services sociaux et des psychologues, et qu’en dépit de tout cela aucune mesure susceptible de permettre le rétablissement du lien familial entre eux et l’enfant n’a été prise en l’espèce. La rupture totale de tout rapport a eu des conséquences très graves pour les relations entre les requérants et l’enfant et il n’a pas été suffisamment envisagé en l’espèce de maintenir une forme de contact entre les requérants et leur petite-fille.
59. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour préserver le lien familial entre les requérants et leur petite-fille et qu’elles ont méconnu le droit des intéressés au respect de leur vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.
60. Partant la Cour conclut à la violation de cette disposition.
ENLÈVEMENTS DES ENFANTS APRÈS LE DIVORCE
Cliquez sur un lieu bleu pour accéder gratuitement à la JURISPRUDENCE DE LA CEDH :
- JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
S.N. et M.B.N. c. Suisse du 23 novembre requête no 12937/20
Art 8 : Le retour d’un enfant en Thaïlande, ordonné par les juridictions suisses dans une procédure d’enlèvement international, n’a pas violé la Convention
L’affaire concerne le retour de la fille (M.B.N.) de la première requérante (S.N.) en Thaïlande (où vit le père, un ressortissant français) ordonné par les tribunaux suisses dans le cadre d’une procédure d’enlèvement international d’enfant.
La Cour estime que, dans le cadre d’une procédure contradictoire, équitable et orale, les tribunaux suisses se sont basés sur les faits pertinents de l’affaire et ont dûment pris en compte tous les arguments des parties. Ils ont aussi rendu des décisions détaillées qui, selon eux, poursuivaient l’intérêt supérieur de l’enfant et ont permis d’exclure tout risque grave pour l’enfant. Par ailleurs, les autorités compétentes ont entrepris des démarches appropriées en vue de garantir la sécurité de l’enfant dans l’éventualité de son retour en Thaïlande. Le processus décisionnel a donc satisfait aux exigences de l’article 8 de la Convention.
Art 8 • Vie familiale • Retour d’une enfant en Thaïlande ordonné par les tribunaux suisses dans le cadre d’une procédure d’enlèvement international d’enfant • Existence d’une procédure contradictoire, équitable et orale • Décisions détaillées poursuivant l’intérêt supérieur de l’enfant • Exclusion de tout risque grave pour l’enfant • Démarches appropriées des autorités compétentes en vue de garantir la sécurité de l’enfant
FAITS
Les requérantes, S.N. et M.B.N., sont deux ressortissantes suisses. S.N., née en 1971, était mariée à F.B., un ressortissant français avec lequel elle eut une fille (M.B.N.) en 2012. En 2013, la famille s’installa en Thaïlande où S.N. était propriétaire d’une villa composée de deux appartements indépendants. En 2014, le couple décida de se séparer et convint que l’enfant bénéficierait d’une garde alternée de trois jours consécutifs auprès de chaque parent.
En 2016, lors de ses vacances en Suisse, S.N. déposa une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Le mois suivant, elle fit part de soupçons d’abus sexuels de la part du père au Service de protection des mineurs. Par la suite, elle retira sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et retourna en Thaïlande où les époux convinrent d’une garde alternée de leur fille.
En 2017, S.N. introduisit une demande en divorce en Thaïlande, et demanda que l’autorité parentale et la garde de l’enfant lui soient attribuées. Puis, redoutant l’issue de la procédure, elle quitta la Thaïlande pour la Suisse fin avril 2018 avec M.B.N.
En 2018, S.N. introduisit une procédure en divorce en Suisse et demanda que l’autorité parentale et la garde de sa fille lui soient attribuées.
La même année, le père adressa une requête en retour de sa fille à l’Office fédéral de la justice à Berne. Ensuite, S.N. déposa plainte auprès de la police cantonale vaudoise pour des attouchements sexuels que le père de l’enfant aurait commis en Thaïlande. Puis, elle introduisit une demande de suspension des relations personnelles du père ainsi qu’une interdiction de périmètre et de contacts envers elle et l’enfant.
En 2019, le tribunal cantonal ordonna le retour de l’enfant en Thaïlande et fixa un délai pour l’exécution volontaire au 20 août 2019. S.N. fit un recours contre ce jugement, mais le Tribunal fédéral estima que le tribunal cantonal avait vérifié de manière complète, actuelle et concrète la possibilité d’un retour en Thaïlande et, partant, qu’il pouvait raisonnablement être exigé de l’enfant qu’elle y retourne accompagnée de sa mère. Les requérantes résident actuellement en Suisse.
Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
La Cour précise que le retour de l’enfant ordonné par le Tribunal fédéral constitue une ingérence
dans le droit des requérantes au respect de leur vie familiale. Cette ingérence était prévue par la Convention de La Haye qui est incorporée dans l’ordre juridique suisse, et elle poursuivait le but légitime de la protection des droits et libertés de l’enfant et de son père.
En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour précise qu’elle doit vérifier si les instances internes ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts de chacun, avec le souci constant de déterminer quelle est la meilleure solution pour l’enfant enlevée. À cet égard, elle note ce qui suit.
L’intérêt supérieur de l’enfant, et notamment l’exclusion de tout « risque grave »
La Cour estime que les implications qu’un retour en Thaïlande aurait pour M.B.N. ont fait l’objet d’un examen circonstancié par les tribunaux suisses, aussi bien s’agissant de la sécurité de l’enfant que la situation financière de sa mère.
Elle observe, en particulier, qu’à aucun moment de la procédure interne, un retour de l’enfant seule n’a été envisagé par les autorités compétentes et que la mère a toujours affirmé qu’elle accompagnerait sa fille en cas de retour. Le tribunal cantonal a estimé que S.N. n’avait pas noué en Suisse des relations d’une solidité qu’on ne pouvait raisonnablement attendre de celle-ci qu’elle retourne en Thaïlande. Par ailleurs, les tribunaux ont constaté, sans tomber dans l’arbitraire, que la situation financière de S.N. lui permettrait de s’occuper de son enfant et qu’elle n’aurait pas à craindre des poursuites pénales par les autorités thaïlandaises. En outre, le tribunal cantonal a organisé trois audiences dans le cadre desquelles il a entendu les parties, y compris l’enfant, ainsi que différents professionnels, notamment au sujet d’un éventuel risque grave pour l’enfant en cas de retour. Il a aussi désigné un curateur pour faire valoir l’intérêt supérieur de l’enfant et en vue de la représenter, entre autres, devant le Tribunal fédéral.
Enfin, l’autorité centrale de la Suisse pour les enlèvements internationaux d’enfants a transmis des questions soulevées par le père de l’enfant en vue de de la nouvelle instruction de l’affaire à son homologue thaïlandais. En mai 2019, le Département des affaires internationales de l’Office de l’avocat général thaïlandais a précisé qu’en cas de retour effectif de l’enfant, elle aurait le pouvoir et l’obligation de garantir la sécurité de l’enfant ou l’exercice de ses droits en lui garantissant l’accès au Ministère public, avocat ou conseil légal. Il a également précisé que S.N. pourrait exercer ses droits parentaux et qu’elle ne serait pas condamnée pénalement en cas de retour dans la mesure où il s’agissait en vertu du droit interne d’un cas civil, et non d’un cas pénal, et qu’elle pourrait s’occuper de M.B.N. La Cour n’a aucune raison de douter de la véracité de ces informations ou de la bonne foi des autorités thaïlandaises.
Les autorités suisses ont également entrepris des démarches raisonnables afin de garantir la sécurité de l’enfant en Thaïlande en vue d’exécuter l’ordre de retour, notamment dans la détermination de l’exercice du droit de visite par le père.
La Cour conclut que le processus décisionnel a poursuivi l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il a permis d’exclure tout risque grave pour l’enfant au sens de l’article 13 de la Convention de La Haye.
La prise en compte de l’opinion de l’enfant
La Cour rappelle que la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Elle souligne, par contre, que, dans le cadre de l’application de la Convention de La Haye, si le point de vue des enfants doit être pris en compte, leur opposition ne fait pas nécessairement obstacle à leur retour.
En l’espèce, le Tribunal fédéral a conclu que l’article 13 de la Convention de La Haye n’avait pas été violé puisque l’enfant, âgée alors de sept ans, n’apparaissait pas avoir atteint une maturité suffisante pour être capable de distinguer le fait d’habiter en Thaïlande de celui de loger chez ou à proximité de son père. L’enfant aurait refusé de toute façon toute forme de retour et sans nuance.
La Cour prend également note du fait que l’enfant a été dûment entendue et observée par plusieurs professionnels dans le cadre de l’audience devant le tribunal cantonal. L’enfant n’aurait par ailleurs pas été capable de saisir que la procédure ne concernait ni la question de sa garde, ni celle de l’autorité parentale, mais tendait uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite.
Dès lors, la Cour estime que rien d’arbitraire ou déraisonnable ne découle des conclusions du Tribunal fédéral et des observations du Gouvernement.
L’intégration de l’enfant en Suisse
En vertu de l’article 12 de la Convention de La Haye, l’autorité compétente doit ordonner le retour de l’enfant même saisie après l’expiration d’un délai d’un an à partir du déplacement ou du non-retour illicite, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Or, en l’espèce, S.N. a quitté le Thaïlande fin avril 2018 pour s’installer en Suisse avec son enfant. Le père de l’enfant a saisi le tribunal cantonal le 23 août 2018, à savoir quatre mois plus tard. L’article 12 de ladite Convention ne saurait dès lors constituer une base utile pour les requérantes afin de plaider le non-retour de M.B.N. fondé sur son intégration en Suisse.
Conclusions générales
La Cour estime qu’on ne saurait prétendre que les tribunaux internes aient ordonné le retour de l’enfant de façon automatique ou mécanique. Bien au contraire, dans une procédure contradictoire, équitable et orale, ceux-ci se sont basés sur les faits pertinents de l’affaire et ont dûment pris en compte tous les arguments des parties et ont rendu des décisions détaillées qui, selon eux, poursuivaient l’intérêt supérieur de l’enfant et ont permis d’exclure tout risque grave pour l’enfant.
Par ailleurs, les autorités compétentes ont entrepris des démarches appropriées en vue de garantir la sécurité de l’enfant dans l’éventualité de son retour en Thaïlande. Le processus décisionnel a donc satisfait aux exigences de l’article 8 de la Convention et l’ingérence dans le droit des requérantes au respect de leur vie familiale était nécessaire dans une société démocratique. Dès lors, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
CEDH
a) Principes généraux
97. La Cour a réitéré les principes généraux devant la guider dans l’examen d’une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention en matière d’enlèvement international d’enfant dans les affaires Neulinger et Shuruk c. Suisse ([GC], no 41615/07, §§ 131-140, CEDH 2010), et X c. Lettonie ([GC], no 27853/09, §§ 92-108, CEDH 2013). La Cour y renvoie.
98. En particulier, la Cour rappelle que dans ce domaine, les obligations que l’article 8 fait peser sur l’État membre doivent notamment s’interpréter à la lumière des exigences imposées par la Convention de La Haye et à celles de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (voir, parmi d’autres, Neulinger et Shuruk, précité, § 132).
99. Le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la principale considération, les objectifs de prévention et de retour immédiat répondant à une conception déterminée de « l’intérêt supérieur de l’enfant » (X. c. Lettonie, précité, § 95).
100. Dans le cadre de cet examen, la Cour rappelle qu’elle n’entend pas substituer son appréciation à celle des juridictions internes. Elle doit cependant s’assurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse a été équitable et qu’il a permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, entre autres, Neulinger et Shuruk, précité, § 139, et X. c. Lettonie, § 102). Afin de déterminer si le processus décisionnel a respecté ces garanties, la Cour examine si les juridictions nationales se sont livrées à un examen adéquat des implications concrètes du retour sur l’enfant (B. c. Belgique, no 4320/11, § 63, 10 juillet 2012).
b) Application des principes généraux au cas d’espèce
101. La Cour constate d’abord qu’il n’est pas litigieux entre les parties que le retour de l’enfant ordonné par le Tribunal fédéral constitue une ingérence dans le droit des requérantes au respect de leur vie familiale protégé par l’article 8 de la Convention.
102. S’agissant de la justification de l’ingérence, les requérantes reconnaissent que l’ordre de retour de l’enfant était prévu par la Convention de La Haye, qui est incorporée dans l’ordre juridique suisse. Par ailleurs, la Cour accepte qu’il poursuivait la protection des droits et libertés de l’enfant et de son père.
103. Comme constaté ci-dessus, s’agissant de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, il appartient à la Cour de se concentrer sur le processus décisionnel et de vérifier si les instances internes ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts de chacun, avec le souci constant de déterminer quelle est la meilleure solution pour l’enfant enlevée (B. c. Belgique, précité, § 69). La Cour considère opportun d’examiner la présente affaire à travers les éléments suivants : Poursuite de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier exclusion de tout « risque grave » (i.), prise en compte de l’opinion de l’enfant (ii.), et intégration de l’enfant en Suisse (iii.).
Poursuite de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment exclusion de tout « risque grave »
104. À la lumière des principes généraux mentionnés ci-dessus, la Cour estime que la question principale qui se pose est de savoir si le processus décisionnel a poursuivi l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, a exclu tout « risque grave » pour l’enfant au sens de l’article 13 al. 1 lettre b) de la Convention de La Haye.
105. À cet égard, la Cour estime que les implications qu’un retour en Thaïlande aurait pour la deuxième requérante ont fait l’objet d’un examen circonstancié par les tribunaux suisses, aussi bien s’agissant de la sécurité de l’enfant que la situation financière de sa mère. La Cour observe, en particulier, qu’à aucun moment de la procédure interne, un retour de l’enfant seule n’a été envisagé par les autorités compétentes et que la mère a toujours affirmé qu’elle accompagnerait sa fille en cas de retour (voir, a contrario, Neulinger et Shuruk, précité, § 144). Le tribunal cantonal a estimé, dans son arrêt du 28 juin 2019, que la première requérante n’avait pas noué en Suisse des relations d’une solidité qu’on ne pouvait raisonnablement attendre de celle-ci qu’elle retourne en Thaïlande. Par ailleurs, les juridictions suisses n’ont pas déterminé le lieu de résidence exacte des requérantes en Thaïlande. Les tribunaux ont également constaté, sans tomber dans l’arbitraire, que la situation financière de la première requérante lui permettrait de s’occuper de son enfant et qu’elle n’aurait pas à craindre des poursuites pénales par les autorités thaïlandaises.
106. La Cour rappelle également que le tribunal cantonal a organisé trois audiences (le 24 septembre 2018, le 25 janvier 2019 et le 28 juin 2019) dans le cadre desquelles il a entendu les parties, y compris l’enfant, ainsi que différents professionnels, notamment au sujet d’un éventuel risque grave pour l’enfant en cas de retour. En outre, il importe de rappeler que le tribunal cantonal a désigné un curateur pour faire valoir l’intérêt supérieur de l’enfant et en vue de la représenter, entre autres, devant le Tribunal fédéral.
107. La Cour ne méconnaît pas que la pédopsychiatre Dr. X. a constaté qu’elle était « inquiète à l’idée d’un éventuel retour en Thaïlande pour l’enfant par rapport à ce qu’[elle a] pu constater » (paragraphe 27 ci-dessus). Or, elle rappelle que le jugement du tribunal cantonal du 31 janvier 2019, faisant suite à l’audience dans le cadre de laquelle ces observations avaient été faites et rejetant la requête de retour du père au motif qu’un retour de l’enfant était susceptible de créer un risque concret et grave pour son développement, a ultérieurement été annulé par le Tribunal fédéral par arrêt du 24 avril 2919. Dès lors, ce dernier a renvoyé la cause pour nouvelle instruction et décision à l’instance inférieure. Le tribunal cantonal devait notamment déterminer si la mère était en mesure de prendre soin de l’enfant en Thaïlande et si l’on pouvait l’exiger d’elle (paragraphe 31 ci-dessus). Après une nouvelle instruction approfondie sur les éventualités d’un retour en Thaïlande, le tribunal cantonal a rendu un nouveau jugement concluant qu’aucune exception au retour de l’enfant en vertu de l’article 13 al. 1 lettre b) de la Convention de La Haye n’existait, et a ordonné son retour.
108. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’autorité centrale de la Suisse pour les enlèvements internationaux d’enfants a transmis des questions soulevées par le père de l’enfant en vue de de la nouvelle instruction de l’affaire à son homologue thaïlandais. Le 28 mai 2019, le Département des affaires internationales de l’Office de l’avocat général thaïlandais a précisé qu’en cas de retour effectif de l’enfant, elle aurait le pouvoir et l’obligation de garantir la sécurité de l’enfant ou l’exercice de ses droits en lui garantissant l’accès au Ministère public, avocat ou conseil légal. Il a également précisé que la première requérante pourrait exercer ses droits parentaux et qu’elle ne serait pas condamnée pénalement en cas de retour dans la mesure où il s’agissait en vertu du droit interne d’un cas civil, et non d’un cas pénal.
109. Dans la mesure où les requérantes considèrent ces affirmations comme trop générales et vagues, la Cour estime qu’on ne pouvait, eu égard au stade peu avancé de la procédure de retour de l’enfant à ce moment-là, s’attendre de la part des autorités suisses à ce qu’elles insistent auprès des autorités thaïlandaises en vue de recevoir des informations plus détaillées sur l’éventualité d’un retour de l’enfant. Par ailleurs, la Cour estime que les informations reçues de la part des autorités thaïlandaises englobent certains éléments importants, notamment la garantie selon laquelle la mère ne serait pas poursuivie au pénal et, dès lors, pourrait s’occuper de la deuxième requérante. La Cour n’a aucune raison de douter de la véracité de ces informations ou de la bonne foi des autorités thaïlandaises.
110. Enfin, la Cour reconnaît que les autorités suisses, en particulier le SPJ, ont entrepris des démarches raisonnables afin de garantir la sécurité de l’enfant en Thaïlande en vue d’exécuter l’ordre de retour, notamment dans la détermination de l’exercice du droit de visite par le père (paragraphes 56‑59 ci-dessus).
111. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le processus décisionnel a poursuivi l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, qu’il a permis d’exclure tout « risque grave » pour l’enfant au sens de l’article 13 al. 1 lettre b) de la Convention de La Haye.
Prise en compte de l’opinion de l’enfant
112. En ce qui concerne plus particulièrement la question de savoir si l’avis de l’enfant a suffisamment été pris en compte, la Cour rappelle que la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (M. et M. c. Croatie, no 10161/13, § 171, CEDH 2015 (extraits), et M.K. c. Grèce, no 51312/16, § 91, 1er février 2018). Elle souligne, par contre, que, dans le cadre de l’application de la Convention de La Haye, si le point de vue des enfants doit être pris en compte, leur opposition ne fait pas nécessairement obstacle à leur retour (Raw et autres c. France, no 10131/11, § 94, 7 mars 2013, cf. également Rouiller c. Suisse, no 3592/08, § 73, 22 juillet 2014).
113. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a conclu, dans son arrêt du 4 septembre 2019, que l’article 13 al. 2 de la Convention de La Haye n’avait pas été violé puisque l’enfant, âgée alors de sept ans, n’apparaissait pas avoir atteint une maturité suffisante pour être capable de distinguer le fait d’habiter en Thaïlande de celui de loger chez ou à proximité de son père. L’enfant aurait refusé de toute façon toute forme de retour et sans nuance.
114. La Cour prend également note du fait que l’enfant a été dûment entendue et observée par plusieurs professionnels dans le cadre de l’audience devant le tribunal cantonal. L’enfant n’aurait par ailleurs pas été capable de saisir que la procédure ne concernait ni la question de sa garde, ni celle de l’autorité parentale, mais tendait uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite, comme rappelé par le Gouvernement.
115. La Cour, rappelant qu’il revient en principe aux juridictions internes d’apprécier les éléments rassemblés par elles (voir, parmi d’autres, Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, § 3, série A no 235-B), estime que rien d’arbitraire ou déraisonnable ne découle des conclusions du Tribunal fédéral et des observations du Gouvernement (voir, dans ce sens, Gajtani c. Suisse, no 43730/07, §§ 112-114, 9 septembre 2014, pour un enfant de 5 ans, et X. c. Lettonie, précité, §§ 22 et 112, pour un enfant qui avait environ 4 ans).
Intégration de l’enfant en Suisse
116. Devant la Cour, les requérantes allèguent que la deuxième requérante, résidant sans interruption en Suisse depuis avril 2018, serait aujourd’hui intégrée dans ledit pays, parle le français et fréquente l’école. Dès lors, un retour en Thaïlande ne saurait être dans son intérêt. La Cour rappelle qu’un tel constat découle également des observations du curateur de l’enfant, déposées devant le Tribunal fédéral le 16 août 2019.
117. La Cour constate que ces remarques n’ont pas eu de réponses explicites de la part du Tribunal fédéral. Elle estime, cependant, que cela ne saurait suffire pour conclure à un manquement procédural par l’État défendeur et ce pour les raisons qui suivent.
118. D’abord, elle rappelle le principe, en vertu de l’article 12 al. 2 de la Convention de La Haye, selon lequel l’autorité compétente doit également ordonner le retour de l’enfant même saisie après l’expiration d’un délai d’un an à partir du déplacement ou du non-retour illicite, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Or, en l’espèce, la première requérante a quitté le Thaïlande fin avril 2018 pour s’installer en Suisse avec son enfant. Le père de l’enfant a saisi le tribunal cantonal le 23 août 2018, à savoir quatre mois plus tard. L’article 12 al. 2 de ladite Convention ne saurait dès lors constituer une base utile pour les requérantes afin de plaider le non-retour de la deuxième requérante fondé sur son intégration en Suisse.
119. La Cour rappelle également que, dans l’affaire Neulinger et Shuruk (précité, § 147), la Grande Chambre a conclu que le fait d’être une nouvelle fois déraciné de son milieu habituel aurait sans doute des conséquences graves pour l’enfant, en particulier s’il rentrait seul, comme cela ressortait des rapports médicaux. Pour ces raisons, son retour en Israël n’était pas considéré comme bénéfique par la Grande Chambre. Or, cette affaire se distingue sensiblement de la présente et, surtout, la Cour possédait plus de détails concernant l’intégration de l’enfant de Mme Neulinger que ceux présentés par les requérantes dans le cas d’espèce. En effet, devant le Tribunal fédéral, les requérantes se sont contentées d’une allégation très générale selon laquelle la deuxième requérante était bien intégrée en Suisse et semble s’épanouir dans ledit pays (paragraphe 44 ci-dessus).
120. En conclusion, l’on ne saurait reprocher au Tribunal fédéral de ne pas avoir répondu explicitement à l’argument tiré de la prétendue intégration de l’enfant en Suisse.
Conclusions générales
121. Compte tenu de ce qui précède, l’on ne saurait prétendre que les tribunaux internes aient ordonné le retour de l’enfant de façon automatique ou mécanique. Bien au contraire, dans une procédure contradictoire, équitable et orale, ceux-ci se sont basés sur les faits pertinents de l’affaire et ont dûment pris en compte tous les arguments des parties et ont rendu des décisions détaillées qui, selon eux, poursuivaient l’intérêt supérieur de l’enfant et ont permis d’exclure tout risque grave pour l’enfant. Par ailleurs, les autorités compétentes ont entrepris des démarches appropriées en vue de garantir la sécurité de l’enfant dans l’éventualité de son retour en Thaïlande.
122. La Cour conclut que le processus décisionnel a satisfait aux exigences de l’article 8 de la Convention et que, partant, l’ingérence dans le droit des requérantes au respect de leur vie familiale était nécessaire dans une société démocratique. Dès lors, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
Rinau c. Lituanie du 14 janvier 2020 requête n°10926/09
Article 8 : La Cour constate une ingérence politique et de graves lenteurs dans le retour de Lituanie d’une fille de père allemand
L’affaire concernait les démarches entreprises par un père allemand pour faire revenir sa fille, qui était chez son ex-épouse en Lituanie, après le prononcé de décisions de justice en sa faveur. La Cour dit en particulier que, de toute évidence, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif avaient cherché à influencer le processus décisionnel en faveur de la mère, malgré les décisions de justice en faveur du père, lesquelles auraient dû être rapidement exécutées en Lituanie. Notamment, des mesures prises par la Cour suprême et par le président de celle-ci avaient été à l’origine de « vicissitudes procédurales » contraires aux buts poursuivis par les règles du droit international et du droit de l’Union européenne en matière d’autorité parentale.
LES FAITS
Les requérants, Michael Rinau, un ressortissant allemand, et sa fille Luisa, de nationalité lituanienne et allemande, sont nés respectivement en 1969 et 2005 et habitent à Bergfelde (Allemagne). Dans cette affaire, ils se plaignent de la manière dont les autorités lituaniennes ont traité le dossier dans le procès engagé par M. Rinau pour que sa fille retourne vivre chez lui en Allemagne. En 2006, I.R., l’ex-femme de M. Rinau, de nationalité lituanienne, emmena leur fille dans son pays natal pendant les vacances mais ne revint pas après deux semaines, contrairement à ce qu’elle avait promis. M. Rinau demanda et obtint des décisions de justice lui octroyant provisoirement la seule autorité parentale et ordonnant le retour de l’enfant chez lui. En 2007, les tribunaux allemands prononcèrent en outre le divorce et accordèrent à M. Rinau la garde permanente. En octobre 2006, M. Rinau saisit les juridictions lituaniennes pour obtenir le retour de l’enfant, s’appuyant sur la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et sur le Règlement II bis de Bruxelles relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Après avoir été débouté en première instance, il obtint gain de cause en mars 2007 dans une décision qui n’était pas susceptible de recours. Le procès donna lieu à de nombreux commentaires de la part des médias et des politiciens en Lituanie, qui critiquaient l’idée du retour de l’enfant en Allemagne et alléguaient que les autorités avaient manqué à protéger les droits d’une ressortissante lituanienne, la mère.
Il y eut plusieurs autres recours devant les juridictions lituaniennes par lesquels la mère et le procureur général cherchaient en particulier à faire rejuger la question du retour de l’enfant. En octobre 2007, le président de la Cour suprême prononça le sursis à l’exécution de la décision rendue par la cour d’appel en mars 2007. En avril 2008, la Cour suprême sollicita également une décision préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJE ») sur différents points du Règlement II bis de Bruxelles. La CJE conclut pour l’essentiel que dès lors que la décision de 2007 par laquelle les juridictions allemandes avaient ordonné le retour de l’enfant était valable, ce texte imposait à leurs homologues lituaniennes de s’y conformer. En août 2008, la Cour suprême rejeta les demandes formées par le procureur général et par I.R. en réouverture du procès civil et le pourvoi en cassation formé par I.R. en s’appuyant dans chacune de ses décisions sur la décision préjudicielle rendue par la CJE. En octobre 2008, alors que le retour de l’enfant était encore retardé, M. Rinau sortit sa fille d’une garderie en Lituanie et se rendit en Lettonie, où il fut brièvement détenu à l’aéroport de Riga avant d’être autorisé à retourner en Allemagne. Il était passible de poursuites pénales pour enlèvement en Lituanie mais le parquet classa l’affaire sans suite en novembre 2009.
CEDH
La Cour décide d’examiner les griefs des requérants sur le terrain du seul article 8. Elle observe que la décision essentielle rendue par la juridiction d’appel en Lituanie, qui confirmait le droit pour M. Rinau au retour de sa fille après que les juridictions allemandes avaient tranché en sa faveur, a été rendue en mars 2007, soit sept mois après qu’il avait formulé sa demande. Si cette durée excède le délai de six semaines fixé par la Convention de La Haye, la Cour admet que les tribunaux étaient saisis de prétentions délicates et contradictoires : ils ont dû agir rapidement car l’enfant se trouvait illégalement entre les mains de sa mère en Lituanie et ils ont dû examiner aussi l’allégation de celle-ci selon laquelle l’enfant serait violentée si elle revenait vivre chez M. Rinau. La Cour conclut que, jusqu’en juin 2007, le processus décisionnel devant les tribunaux, bien que long au regard des dispositions de la Convention de La Haye, a satisfait aux exigences de l’article 8.
La Cour examine ensuite les développements ultérieurs, notamment les allégations des requérants selon lesquelles des politiciens, aussi bien des parlementaires que des membres du gouvernement, ont tenté d’influencer le processus décisionnel. Elle observe qu’il y a eu une recrudescence de pressions publiques, politiques et institutionnelles après que l’huissier avait entamé l’exécution de la décision ordonnant le retour, notamment une pétition publique, des agressions verbales contre M. Rinau, qualifié de « porc allemand » ou de « nazi », ainsi que des menaces contre celui-ci, son avocat et l’huissier. La Cour est troublée par ce qu’elle considère comme des démarches officielles concertées visant à ce que l’enfant reste en Lituanie, des membres du parlement ayant ouvertement contesté la régularité des décisions de justice et le ministre de la Justice ayant nourri l’espoir de la mère que l’affaire serait rejugée. Il y a également eu des pressions contre l’huissier, un travailleur indépendant, dans le cadre de l’exécution des décisions de justice, ainsi que contre les services sociaux, afin que ceux-ci reviennent sur leur avis, qui était que l’intérêt supérieur de l’enfant était de revenir en Allemagne. De plus, le droit lituanien a été modifié de manière à permettre à la fille du couple d’obtenir la nationalité lituanienne malgré l’argument avancé par M. Rinau, qui était que selon les décisions de justice allemandes, lui seul avait l’autorité pour prendre des décisions concernant la nationalité de sa fille. Le gouvernement lituanien a également fourni à la mère une contribution financière pour aider celle-ci à saisir la CJE. La Cour en conclut qu’il ne fait aucun doute que les autorités lituaniennes n’ont pas assuré l’équité du processus décisionnel dans l’exécution du jugement ordonnant le retour de l’enfant. Elle constate également que le président de la Cour suprême est personnellement intervenu dans cette affaire et que, ensuite, la procédure ultérieurement conduite devant la Cour suprême a été suspendue dans l’attente de la décision préjudicielle de la CJE, alors que le droit lituanien ne permettait pas la réouverture d’une procédure tendant au retour d’un enfant sur la base de la Convention de La Haye. Ces éléments, ainsi que d’autres « vicissitudes procédurales », étaient totalement contraires aux buts essentiels poursuivis par la Convention de La Haye, par le règlement de l’Union européenne et par l’article 8 de la Convention. Si M. Rinau a fait revenir sa fille en Allemagne de façon « impromptue », il avait dû déjà attendre longtemps et il redoutait davantage de lenteurs en raison de l’opposition de la mère. La Cour conclut que le temps pris par les autorités lituaniennes pour rendre une décision définitive dans cette affaire n’a pas permis de répondre à l’urgence de la situation. Globalement, le comportement des autorités lituaniennes n’était pas à la hauteur de ce que l’article 8 exige de l’État et il y a eu violation de cette disposition à l’égard de chacun des requérants.
MK contre Grèce du 1er février 2018 requête n° 51312/16
Article 8 : Enlèvement d'enfant par le père, après un divorce. La justice française et grecque donne gain de cause, à la requérante mais l'enfant entendu a préféré vivre avec le père en Grèce. Il ne voulait pas retourner avec la mère en France. Les autorités judiciaires grecques ont la marge d'appréciation pour pouvoir entendre les volontés de l'enfant.
a) Principes généraux
73. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il existe actuellement un large consensus autour de l’idée que, dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer. L’intérêt de l’enfant présente un double aspect. D’une part, il prévoit que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent en principe conduire à une rupture du lien familial et que tout doit être mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille. D’autre part, il implique que garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant (Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, §§ 135-136, CEDH 2010). La même philosophie se trouve à la base de la Convention de La Haye, qui prévoit en principe le retour immédiat d’un enfant enlevé sauf en cas de risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable de toute autre manière (article 13, alinéa premier, lettre b). En d’autres termes, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant est sous-jacente également à la Convention de La Haye (idem, § 137).
74. Le droit à l’autonomie personnelle, inhérent à la notion de « vie privée », qui recouvre dans le cas des adultes le droit de choisir comment conduire sa vie, à condition de ne pas porter une atteinte injustifiable aux droits et libertés d’autrui, a une portée différente dans le cas des enfants. Ceux-ci, contrairement aux adultes, ne disposent pas d’une autonomie complète mais ils sont néanmoins des sujets de droits. Les enfants exercent leur autonomie limitée, qui augmente progressivement à mesure qu’ils gagnent en maturité, par le biais de leur droit à être consultés et entendus. Comme le précise l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, un enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement ses opinions et le droit de voir ces opinions dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité et, en particulier, il doit se voir offrir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant (M. et M. c. Croatie, no 10161/13, § 171, 3 décembre 2015).
75. En outre, il découle de l’article 8 de la Convention que le retour de l’enfant ne saurait être ordonné de façon automatique ou mécanique dès lors que la Convention de La Haye s’applique. L’intérêt supérieur de l’enfant, du point de vue de son développement personnel, dépend en effet de plusieurs circonstances individuelles, notamment de son âge et de sa maturité, de la présence ou de l’absence de ses parents, de l’environnement dans lequel il vit et de son histoire personnelle. C’est pourquoi il doit s’apprécier au cas par cas. Cette tâche revient en premier lieu aux autorités nationales, qui ont souvent le bénéfice de contacts directs avec les intéressés (idem, § 138). Les juridictions nationales doivent se livrer à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale et de toute une série d’éléments (X. c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 104, CEDH 2013). Elles jouissent pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, laquelle s’accompagne toutefois d’un contrôle européen en vertu duquel la Cour examine sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de ce pouvoir.
76. La Cour a dit aussi à de nombreuses reprises que, dans les affaires relatives à l’exécution des décisions relevant du droit de la famille, le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l’exécution, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles compte tenu des circonstances de l’espèce (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299-A, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 96, CEDH 2000-I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 59, 24 avril 2003, et Bajrami c. Albanie, no 35853/04, § 52, 12 décembre 2006).
77. Si des mesures coercitives à l’égard des enfants ne sont pas souhaitables dans ce domaine délicat (Giorgioni c. Italie, no 43299/12, § 64, 15 septembre 2016, et Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016), le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement illégal du parent avec lequel vivent les enfants (Ignaccolo-Zenide, précité, § 106, et Bajrami, précité, § 54). L’intérêt supérieur de l’enfant peut en outre parfois commander que l’enfant ne soit pas séparé du parent avec lequel il se trouve ou qu’il ne soit pas retourné au parent qui le réclame (Raw et autres c. France, no 10131/11, § 80, 7 mars 2013).
78. Pour déterminer si les autorités nationales ont respecté les obligations que leur impose l’article 8, il faut tenir dûment compte de la situation de tous les membres de la famille, car la protection que garantit cette disposition s’étend à toute la famille (Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 117, CEDH 2014 et Kacper Nowakowski c. Pologne, no 32407/13, § 71, 10 janvier 2017). La compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 83, 6 décembre 2007), souvent l’unique solution pacifique, adéquate et tenant compte de l’état psychologique de l’enfant. L’existence d’une voie de médiation civile dans le système judiciaire national, comme le préconise la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe no Rec (98)1 sur la médiation familiale, est souhaitable en tant qu’aide à une telle coopération à l’ensemble des parties au litige (Cengiz Kılıç c. Turquie, no 16192/06, §§ 132-133, 6 décembre 2011 et Kacper Nowakowski c. Pologne, précité, § 87).
79. L’adéquation des mesures prises par les autorités se juge en particulier à la rapidité de leur mise en œuvre, le passage du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux. La Convention de La Haye prévoit d’ailleurs un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un État contractant, et son article 11 précise que les autorités judiciaires ou administratives saisies doivent procéder d’urgence en vue de ce retour (voir, notamment, Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, §§ 84-91, CEDH 2011 (extraits), et Raw et autres, précité, § 83).
b) Application des principes en l’espèce
80. La Cour note d’emblée que : le jugement no 330/2008 a confié la garde des enfants à la requérante et a fixé un droit de visite pour le père ; la décision du juge aux affaires familiales de Charleville-Mézières de juillet 2013 a fixé en France le domicile de A. et a accordé à son père un droit de visite en Grèce ; le jugement no 404/2015 du tribunal de première instance de Ioannina a ordonné le retour de A. auprès de sa mère en application des dispositions de la Convention de La Haye ; la décision du juge aux affaires familiales de Charleville-Mézières du 2 octobre 2015 a indiqué que le domicile de A. était celui de sa mère en France et que A.V. l’avait illicitement retenu en Grèce ; le jugement no 31/2016 du tribunal de première instance de Ioannina a révoqué la décision antérieure du même tribunal par laquelle il avait attribué provisoirement la garde de A. à son père et l’a confiée à la requérante. Une multitude de décisions judiciaires, dont deux définitives – le jugement no 404/2015 et celui du juge aux affaires familiales de Charleville-Mézières du 2 octobre 2015 – ont attribué la garde de A. à la requérante.
81. La Cour estime que, dans la mesure où ils engagent la responsabilité de l’État défendeur, les faits de l’espèce constituent clairement une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale de la requérante, que l’inexécution de la décision d’attribution du droit de garde a privé de la présence de son fils A.
82. Elle doit donc déterminer si les autorités nationales ont pris pour assurer le retour de A. « toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles » ou, autrement dit, si elles ont pris « les mesures nécessaires et adéquates » à cette fin (Raw et autres, précité, § 84). Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que l’État défendeur est également partie à la Convention de la Haye, dont l’article 7 dresse une liste de mesures à prendre par les États pour assurer le retour immédiat des enfants.
83. En premier lieu, la Cour souligne que, en raison du caractère définitif du jugement no 404/2015, il s’imposait aux autorités judiciaires ainsi qu’aux autorités administratives et aux assistants sociaux de prendre des mesures de nature à favoriser l’exécution de celui-ci.
84. La Cour note que le 19 juillet 2016, la requérante a saisi le procureur près le tribunal correctionnel de Ioannina d’une demande en application de l’article 1er de la loi no 2102/1992 portant ratification de la Convention de La Haye. Elle invitait le procureur à ordonner au service compétent du ministère de la Santé, de l’Assistance sociale et de la Sécurité sociale d’assumer temporairement la garde de A. jusqu’à ce que celui-ci lui fût rendu, conformément au jugement no 404/2015 qui lui avait attribué la garde de l’enfant. Or, le même jour, le procureur a transmis cette demande aux services compétents, dont les services sociaux de la mairie de Ioannina. Il a aussi engagé des poursuites contre A.V. pour enlèvement d’enfant et refus de se conformer à une décision judiciaire. D’autre part, les services sociaux de la mairie de Ioannina se sont mobilisés rapidement lorsque le procureur les a saisis de la demande de la requérante : ils ont essayé à plusieurs reprises de localiser A. au courant du mois d’août 2016, et se sont finalement entretenus avec lui le 26 août.
85. Dans leurs constats inclus dans le rapport établi après cet entretien, ils notaient que l’enfant souhaitait rester chez son père, où il vivait avec son frère et sa grand-mère paternelle, jusqu’à ce que son frère termine ses études secondaires et décide de l’endroit où il souhaitait les poursuivre. Selon ce rapport, A. avait aussi déclaré qu’il souhaitait que sa mère arrête d’aller devant les tribunaux et qu’une solution fût trouvée ; il s’était plaint de la suspension de sa scolarisation pendant quatre semaines, fait dont il tenait sa mère pour responsable, et soutenait qu’il voulait continuer à aller à l’école à Ioannina ; il avait exprimé une vive colère contre sa mère et répété qu’il ne voulait pas retourner en France. L’assistant social ajoutait qu’il était impératif pour les parents de trouver une solution de compromis et d’arrêter de perturber l’état psychologique des enfants, notamment celui de A., et pour les enfants de consulter un pédopsychiatre.
86. Toujours le 26 août 2016, A. et I., respectivement âgés de 13 et 16 ans, avaient été entendus par le tribunal correctionnel dans le cadre de l’examen de la plainte déposée le 17 août 2016 par la requérante pour enlèvement d’enfant. À cette occasion, A. avait déclaré vouloir rester avec son frère et son père car il se serait senti plus en sécurité avec eux et car il n’aurait pas fait, à leurs côtés, l’objet de pressions psychologiques. Il avait ajouté qu’il aimait sa mère mais que, après ce qu’elle avait fait, il ne pouvait pas lui pardonner.
87. Enfin, dans un rapport établi le 15 septembre 2016 par le psychologue de la clinique psychiatrique de Ioannina appelé à évaluer les constats de l’assistant social, le psychologue notait que A. avait réitéré de manière constante et claire son souhait de rester en Grèce, où il aurait été près de son frère et où il aurait pu entretenir ses relations personnelles et poursuivre ses activités. A. lui aurait également fait part d’un sentiment de fatigue et de tristesse concernant le conflit entre sa mère et son père, mais aussi de colère contre sa mère en raison de l’insistance de celle-ci de le faire revenir en France contre sa volonté. Le psychologue préconisait de ne pas séparer les enfants compte tenu du fait que tous les deux décrivaient leur relation comme une source de soutien et d’assistance mutuels.
88. Force est de constater que l’article 7 de la Convention de La Haye fait obligation aux autorités centrales des États membres de coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable (paragraphe 44 ci-dessus). Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des relations hautement conflictuelles entre la requérante et son ex-mari et du fait que celle-ci résidait en France, la Cour constate que les autorités pouvaient difficilement privilégier la voie de la coopération et de la négociation entre les parents de A., comme le préconise l’article 7 précité ou celle de la médiation préconisée par la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la médiation familiale (paragraphe 48 ci-dessus). En outre, il convient de souligner qu’à l’époque des faits susmentionnés, A. avait atteint l’âge de discernement et sa volonté clairement exprimée de rester en Grèce ne pouvait que peser lourdement sur les choix offerts aux autorités. Or, l’intérêt supérieur de l’enfant s’oppose en règle générale à ce que des mesures coercitives soient prises à son encontre. La Cour note par ailleurs que l’article 13 de la Convention de La Haye, invoquée d’ailleurs par la requérante, prévoit que l’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’y oppose et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion (paragraphe 44 ci-dessus).
89. En outre, la Cour relève que dans son article 11 § 8, le Règlement Bruxelles II bis (paragraphe 50 ci-dessus) prévoit de confier aux autorités de l’État d’origine l’opportunité de s’opposer à une décision de non-retour qui aurait été rendue par les autorités de l’État refuge. Une telle décision de « retour nonobstant » jouit de la force exécutoire dans l’État refuge sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il ne soit possible de s’opposer à sa reconnaissance (article 42 § 1 combiné avec l’article 11 § 8 du Règlement). Toutefois, en l’espèce, la Cour part de l’idée que l’article 11 § 8 du Règlement ne s’applique pas, en l’absence d’une décision juridictionnelle française ordonnant formellement le retour de l’enfant conformément aux termes de cette décision. En effet le jugement du 2 octobre 2015 du juge aux affaires familiales de Charleville-Mézières ne remplit pas ces conditions.
90. En tout état de cause, les autorités grecques, en plus de correspondre au prescrit de l’article 8, semblent avoir agi aussi dans l’esprit de la Convention de La Haye et du Règlement. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le jugement de 2015 était fondé sur des éléments remontant à 2013 lorsque ce même juge avait fixé le domicile de A. en France. La Cour observe, en outre, que le jugement précité n’a pas pris en considération le fait que A. avait un frère qui était resté en Grèce et le lien très étroit qui l’unissait à lui. Autrement dit, l’arrêt en question n’a pas tenu compte de la situation familiale dans son ensemble. De plus, la situation pendant toutes ces années avait évolué radicalement, au point que A. ne souhaitait plus suivre sa mère en France et avait exprimé sa volonté de rester avec son frère et son père, à côté desquels il se sentait en sécurité. A. avait fait part de cette volonté de manière très ferme tant devant les assistants sociaux (paragraphe 34 ci‑dessus) que devant le tribunal correctionnel (paragraphe 36 ci-dessus). Ces éléments ne sauraient être ignorés dans l’appréciation de l’attitude des autorités grecques qui ont pris en compte l’ensemble de la situation familiale, l’évolution de celle-ci dans le temps et l’intérêt supérieur des deux frères et notamment de A. qui avait déjà atteint à cette époque l’âge de treize ans.
91. Or, la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (M. et M. c. Croatie, précité, § 171). Le droit d’un enfant d’être entendu et de participer à la prise de décision dans une procédure familiale qui l’affecte en premier lieu est garanti par plusieurs instruments juridiques internationaux. Ainsi l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant accorde à l’enfant le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant (paragraphe 45 ci-dessus). Ce droit est également prévu par les articles 3 et 6 de la Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant du Conseil de l’Europe (paragraphe 46 ci-dessus), par la Recommandation Cm/Rec(2012)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (paragraphe 47 ci-dessus) ainsi que par l’article 24 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (paragraphe 49 ci-dessus).
92. Les instruments en question ajoutent que les autorités compétentes administratives ou judiciaires doivent tenir dûment compte de l’opinion exprimée par l’enfant. Ainsi, l’article 13 de la Convention de la Haye prévoit que les autorités peuvent refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elles constatent que celui-ci s’oppose à son retour et que, eu égard à son âge et à sa maturité, il est approprié de tenir compte de cette opinion (paragraphe 44 ci-dessus). L’obligation des autorités de prendre dûment en considération les opinions des enfants est réitérée dans la Convention européenne et la Recommandation précitées ainsi que dans l’article 24 § 1 de la Charte des droits fondamentaux précitée.
93. Eu égard à ce qui précède et à la marge d’appréciation dont dispose l’État défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités grecques ont pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour se conformer à leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention. Partant il n’y a pas eu violation de cette disposition.
K.J. c. Pologne du 1er mars 2016 requête no 30813/14
Violation de l'article 8 : Enlèvement international d’enfants, les juridictions polonaises n’auraient pas dû admettre la réticence d’une mère à résider au Royaume-Uni comme fondement de leur refus d’ordonner le retour de l’enfant. Le père et la mère qui vivent au Royaume Uni se séparent, Madame part en vacances en Pologne avec l'enfant qui a deux ans et ne revient pas. Le recours du père pour enlèvement d'enfants, devant les juridictions polonaises sont rejetés. La mère alors qu'elle est en faute est crue sur sa réticence de vouloir vivre au Royaume Uni et sur sa prétendue crainte que l'enfant ne puisse plus quitter le pays.
La Cour observe que le fait que la mère n’ait pas voulu vivre au Royaume-Uni a été un élément central dans l’analyse des juridictions polonaises. Celles-ci ont admis que le conflit entre les parents et la supposée incapacité de l’épouse à s’adapter à la vie à l’étranger étaient des raisons suffisamment convaincantes pour les amener à conclure que le retour de l’enfant – avec ou sans sa mère – dans son milieu habituel au Royaume-Uni placerait la fillette dans une situation intolérable au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye.
Puisque c’était l’épouse, dont le requérant était séparé, qui s’opposait au retour de l’enfant, c’est à elle qu’il incombait d’étayer toute allégation de risques particuliers pesant sur sa fille. Or, elle avait essentiellement évoqué la rupture du mariage et sa crainte que l’enfant ne fût plus autorisée à quitter le Royaume-Uni. Aucun de ces deux arguments ne répond aux exigences de l’article 13 b) de la Convention de La Haye.
Les juridictions polonaises ont cependant examiné l’affaire, évaluant les risques au vu de ce qui semblait être un refus relativement arbitraire de la mère de retourner au Royaume-Uni avec la fillette. Ainsi, rien dans les circonstances dévoilées devant les juridictions nationales n’excluait la possibilité pour la mère de rentrer avec l’enfant. Il n’a pas été donné à entendre que l’épouse du requérant serait privée de l’accès au territoire britannique ou risquerait des sanctions pénales à son retour. Il ne semblait pas non plus que le requérant fût susceptible de l’empêcher activement de voir l’enfant au Royaume-Uni ou de chercher à la priver de son droit de garde.
Était également erronée la conclusion des juridictions polonaises selon laquelle le retour de l’enfant au Royaume-Uni avec sa mère serait dénué d’effets positifs sur le développement de la fillette. Les juridictions semblent avoir totalement fait fi des autres conclusions de l’expertise psychologique, à savoir que l’enfant, qui s’adaptait facilement, était en bonne santé sur les plans physique et psychologique, était liée affectivement à ses deux parents et plaçait la Pologne et le Royaume-Uni sur un pied d’égalité.
Par ailleurs, la Cour constate que la procédure nationale – alors que le caractère urgent d’une procédure fondée sur la Convention de La Haye est reconnu – a duré un an, entre l’enregistrement de la demande de retour de l’enfant formée par le requérant et la date de la décision finale. Aucune explication n’a été donnée pour justifier ce délai.
En conclusion, eu égard aux circonstances de l’affaire considérées dans leur ensemble, la Cour estime que l’État n’a pas satisfait à ses obligations découlant de l’article 8 de la Convention européenne.
Enfin, la Cour observe que, dès lors que l’enfant vit avec sa mère en Pologne depuis plus de trois ans et demi, rien ne permet d’interpréter cet arrêt comme obligeant la Pologne à prendre des mesures afin que soit ordonné le retour de l’enfant au Royaume-Uni.
HENRIOUD c. FRANCE du 5 novembre 2015 requête 21444/11
Non violation de l'article 8 : M. Henrioud n’a jamais fait mention du recours exercé par lui contre la révocation de l’interdiction faite à la mère de quitter le territoire Suisse. La Cour estime par conséquent que M. Henrioud, qui était intervenant volontaire et représenté par un avocat, n’a pas fourni à la cour d’appel les éléments essentiels pour contester son acquiescement.
70. S’agissant de ce grief, le Gouvernement et le requérant s’en remettent à la sagesse de la Cour.
71. La Cour estime que le non-retour des enfants, tel que décidé par les juridictions françaises, constitue une ingérence dans le chef du requérant au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Elle relève que cette décision était fondée sur les dispositions de la Convention de La Haye, en vigueur en France, et peut accepter, même si la question de l’acquiescement au non-retour des enfants du requérant n’a pas pu être examinée, qu’elle avait pour but de protéger leurs droits et libertés. Quant au point de savoir si la décision litigieuse était nécessaire dans une société démocratique, la Cour renvoie à l’arrêt X c. Lettonie [GC], no 27853/09, CEDH 2013), et particulièrement aux paragraphes 95 et 100 à 102 et 106 à 107, où elle s’est exprimée ainsi :
« 95. Le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière (Maumousseau et Washington, précité, § 62), en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la principale considération, les objectifs de prévention et de retour immédiat répondant à une conception déterminée de «l’intérêt supérieur de l’enfant » (...)
100. L’intérêt supérieur de l’enfant ne se confond pas avec celui de son père ou de sa mère, outre qu’il renvoie nécessairement à des éléments d’appréciation divers liés au profil individuel et à la situation spécifique de l’enfant. Néanmoins, il ne saurait être appréhendé d’une manière identique selon que le juge est saisi d’une demande de retour en application de la Convention de La Haye ou d’une demande de statuer au fond sur la garde ou l’autorité parentale, cette dernière relevant d’une procédure en principe étrangère à l’objet de la Convention de La Haye (...).
101. Partant, dans le cadre d’une demande de retour faite en application de la Convention de La Haye, qui est donc distincte d’une procédure sur le droit de garde, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant doit s’apprécier à la lumière des exceptions prévues par la Convention de La Haye, lesquelles concernent l’écoulement du temps (article 12), les conditions d’application de la convention (article 13 a)) et l’existence d’un « risque grave » (article 13 b)), ainsi que le respect des principes fondamentaux de l’État requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 20). Cette tâche revient en premier lieu aux autorités nationales requises, qui ont notamment le bénéfice de contacts directs avec les intéressés. Pour ce faire au regard de l’article 8 de la Convention, les juridictions internes jouissent d’une marge d’appréciation, laquelle s’accompagne toutefois d’un contrôle européen en vertu duquel la Cour examine, sous l’angle de la Convention, les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de ce pouvoir (voir, mutatis mutandis, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299-A, ainsi que Maumousseau et Washington, précité, § 62, et Neulinger et Shuruk, précité, § 141).
102. Précisément, dans le cadre de cet examen, la Cour rappelle qu’elle n’entend pas substituer son appréciation à celle des juridictions internes (voir, par exemple, Hokkanen, précité, et K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 154, Recueil 2001‑VII). Elle doit cependant s’assurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse a été équitable et qu’il a permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), no 14600/05, CEDH 2005‑XIII (extraits), Maumousseau et Washington, précité, et Neulinger et Shuruk, précité, § 139).
106. La Cour estime que l’on peut parvenir à une interprétation harmonieuse de la Convention et de la Convention de La Haye (paragraphe 94 ci-dessus) sous réserve que les deux conditions suivantes soient réunies. Premièrement, les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l’enfant en application des articles 12, 13 et 20 de ladite convention, notamment lorsqu’ils sont invoqués par l’une des parties, soient réellement pris en compte par le juge requis. Ce dernier doit dès lors rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, afin de permettre à la Cour de s’assurer que ces questions ont bien fait l’objet d’un examen effectif. Deuxièmement, ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l’article 8 de la Convention (Neulinger et Shuruk, précité, § 133).
107. Par conséquent, la Cour estime que l’article 8 de la Convention fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale particulière à ce titre : dans le cadre de l’examen de la demande de retour de l’enfant, les juges doivent non seulement examiner des allégations défendables de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour, mais également se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce. Tant un refus de tenir compte d’objections au retour susceptibles de rentrer dans le champ d’application des articles 12, 13 et 20 de la Convention de La Haye qu’une insuffisance de motivation de la décision rejetant de telles objections seraient contraires aux exigences de l’article 8 de la Convention, mais également au but et à l’objet de la Convention de La Haye. La prise en compte effective de telles allégations, attestée par une motivation des juridictions internes qui soit non pas automatique et stéréotypée, mais suffisamment circonstanciée au regard des exceptions visées par la Convention de La Haye, lesquelles doivent être d’interprétation stricte (Maumousseau et Washington, précité, § 73) est nécessaire. Cela permettra aussi d’assurer le contrôle européen confié à la Cour, dont la vocation n’est pas de se substituer aux juges nationaux. »
72. En l’absence d’observations des parties sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour examinera celui-ci uniquement sur la base de ce qui a été soulevé par le requérant dans son formulaire de requête (paragraphe 68 ci-dessus).
73. La Cour observe qu’une partie de ce grief porte précisément sur l’excès de formalisme de la Cour de cassation. Elle rappelle toutefois avoir conclu ci-dessus qu’en imposant au requérant une charge disproportionnée, la Cour de cassation a porté atteinte à la substance de son droit d’accès à un tribunal, et l’a privé d’un examen tenant au point de savoir si les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat des enfants tel que visés à l’article 13 a) de la Convention de La Haye étaient réunis. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’étudier cette partie du grief sur le terrain de l’article 8 de la Convention.
74. Pour le reste, la Cour observe que le tribunal de grande instance de Bordeaux a considéré qu’il n’y avait pas eu déplacement illicite des enfants au motif que la mère n’avait pas eu connaissance de l’interdiction du territoire qui avait été prise à son égard et que cette interdiction avait en tout état de cause été révoquée. Il a noté également que les enfants étaient bien intégrés en France. La cour d’appel a reconnu que Mme V.F avait déplacé illégalement les enfants ; elle a déduit cependant de l’absence de recours exercé contre la décision de révocation de l’interdiction de quitter la Suisse du 11 novembre 2008 l’acquiescement du requérant au non-retour de ses enfants.
75. Or, le requérant avait exercé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Cour de cassation civile du tribunal cantonal de Neuchâtel, en invoquant la violation de la Convention de La Haye (paragraphe 15 ci‑dessus). Il n’en a cependant pas informé la cour d’appel de Bordeaux bien qu’il ait été autorisé à intervenir devant cette juridiction. Il lui appartenait en conséquence, alors qu’il avait produit un mémoire par l’intermédiaire de son représentant devant cette juridiction et était présent à l’audience du 3 avril 2009, de fournir une copie de son recours formé le 27 novembre 2008, et de démontrer qu’il n’y avait pas de preuve tangible de son acquiescement (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). La Cour observe que ce n’est qu’au stade du pourvoi en cassation que ces éléments furent apportés (paragraphe 26 ci‑dessus).
76. La Cour ne doute pas que l’obligation procédurale que fait peser l’article 8 de la Convention sur les juridictions nationales impose, dans une situation où l’acquiescement du parent victime postérieurement au déplacement est allégué, un examen effectif du caractère certain et non équivoque de cet acquiescement, afin que ce processus tienne compte aussi des intérêts de celui-ci protégés par l’article 8 de la Convention. Elle constate cependant que le requérant n’a pas apporté devant la cour d’appel les éléments suffisants pour contester son acquiescement au non-retour au sens de l’article 13 a) de la Convention et en conclut qu’il ne peut faire valoir que le processus décisionnel à ce stade de la procédure n’a pas satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8 de la Convention.
77. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
PHOSTIRA EFTHYMIOU ET RIBEIRO FERNANDES c. PORTUGAL du 5 février 2015 requête 66775/11
Violation de l'article 8, vu les délais de procédures l'enfant est inséré au Portugal et son retour à Chypre serait une violation de l'article 8 alors qu'il s'agit au départ d'un enlèvement d'enfant par la mère.
Le 1er septembre 2009, avec l’accord de Monsieur D., la deuxième requérante partit en vacances avec l’enfant au Portugal, avec un retour à Chypre prévu pour le 15 septembre. Ce jour venu, la deuxième requérante informa son compagnon qu’elle avait décidé de rester au Portugal avec leur fille et qu’elle ne reviendrait pas à Chypre.
37. La Cour constate à titre liminaire que, pour les requérantes, continuer à vivre ensemble est un élément fondamental qui relève à l’évidence de leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, lequel est donc applicable en l’espèce (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 44, série A no 290). La Cour observe ensuite qu’il n’est, en l’espèce, pas contesté que le retour de l’enfant ordonné par les juridictions portugaises constitue une « ingérence » dans son droit et celui de la deuxième requérante au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
38. Elle rappelle que la Convention doit s’appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH 2001‑II ; et Al‑Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI). En ce qui concerne plus précisément les obligations positives que l’article 8 fait peser sur les États contractants en matière de réunion d’un parent et de ses enfants, celles-ci doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye (Ignaccolo-Zenide précité, § 95), dont il est directement question en l’occurrence, ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 72, CEDH 2003‑VII ; Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 132, CEDH 2010).
39. En l’espèce, la Cour note que la décision de retour prise par les autorités portugaises était fondée sur la Convention de La Haye, qui est incorporée au droit portugais, et visait à protéger les droits et libertés de l’enfant, l’ingérence poursuivait donc un intérêt légitime au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
40. La question qui se pose est donc celle de savoir si telle ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention interprété à la lumière des instruments internationaux précités, le point décisif consistant à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents présents – ceux de l’enfant, des deux parents entre eux et ceux de l’ordre public – a été ménagé dans les limites de la marge d’appréciation dont les États jouissent en la matière (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 62, 6 décembre 2007), en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la principale considération, les objectifs de prévention et de retour immédiat répondant à une conception déterminée de « l’intérêt supérieur de l’enfant ». La Cour rappelle que la Convention de La Haye associe cet intérêt au rétablissement du statu quo ante, par une décision de retour immédiat de l’enfant dans son pays de résidence habituelle en cas d’enlèvement illicite, mais ce tout en tenant compte du fait qu’un non-retour peut parfois s’avérer justifié par des raisons objectives qui correspondent à l’intérêt de l’enfant, ce qui explique l’existence d’exceptions (X c. Lettonie [GC], no 27853/09, §§ 95-97, 26 novembre 2013). Il découle directement non seulement de l’article 8 de la Convention, mais également de la Convention de La Haye elle-même, compte tenu des exceptions qu’elle prévoit expressément au principe d’un retour rapide de l’enfant dans le pays du lieu de résidence habituelle, que ce retour de l’enfant ne saurait être ordonné de façon automatique ou mécanique (Maumousseau et Washington, précité, § 72, et Neulinger et Shuruk, précité, § 138).
41. Dans le cadre d’une demande de retour faite en application de la Convention de La Haye, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant doit s’apprécier à la lumière des exceptions prévues par la Convention de La Haye, lesquelles concernent l’écoulement du temps (article 12), les conditions d’application de la convention (article 13 alinéa premier lettre a) et l’existence d’un « risque grave » (article 13 alinéa premier lettre b), ainsi que le respect des principes fondamentaux de l’État requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 20). Cette tâche revient en premier lieu aux autorités nationales requises, qui ont notamment le bénéfice de contacts directs avec les intéressés. Pour ce faire, au regard de l’article 8 de la Convention, les juridictions internes jouissent d’une marge d’appréciation, laquelle s’accompagne toutefois d’un contrôle européen en vertu duquel la Cour examine, sous l’angle de la Convention, les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de ce pouvoir (voir, mutatis mutandis, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299-A ; ainsi que Maumousseau et Washington, précité, § 62 ; et Neulinger et Shuruk, précité, § 141).
42. Dans le cadre de cet examen, la Cour rappelle qu’elle n’entend pas substituer son appréciation à celle des juridictions internes (voir, par exemple, Hokkanen, précité ; et K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 154, Recueil 2001-VII). Elle doit cependant s’assurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse a été équitable et qu’il a permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), no 14600/05, CEDH 2005‑XIII (extraits) ; Neulinger et Shuruk, précité, § 139). Pour ce faire, elle doit vérifier si les juridictions nationales se sont livrées à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale et de toute une série d’éléments, d’ordre factuel, affectif, psychologique, matériel et médical notamment, et si elles ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun, avec le souci constant de déterminer quelle était la meilleure solution pour l’enfant dans le cadre d’une demande de retour dans son pays d’origine (Maumousseau et Washington c. France, précité, § 74). Il leur appartient également, lorsqu’une partie se prévaut de l’une des exceptions expressément prévues à l’article 13 alinéa premier de la Convention de La Haye, de procéder à un examen effectif des allégations de celle-ci.
43. En effet, l’article 8 de la Convention fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale particulière à ce titre : dans le cadre de l’examen de la demande de retour de l’enfant, les juges doivent non seulement examiner toute allégation défendable de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour, mais également se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce. Un refus de tenir compte d’objections au retour susceptibles de rentrer dans le champ d’application des articles 12, 13 et 20 de la Convention de La Haye, tout comme une insuffisance de motivation de la décision rejetant de telles objections, seraient contraires aux exigences de l’article 8 de la Convention, mais également au but et à l’objet de la Convention de La Haye. La prise en compte effective de telles allégations doit ressortir une motivation des juridictions internes qui soit non pas automatique et stéréotypée, mais suffisamment circonstanciée au regard des exceptions visées par la Convention de La Haye, sachant cependant que celles-ci doivent être d’interprétation stricte (Maumousseau et Washington, précité, § 73) est nécessaire. Il s’agit aussi pour la Cour d’être mise en mesure d’assurer sa mission de contrôle européen, sans qu’il y ait lieu pour elle de se substituer aux juges nationaux (X c. Lettonie, précité, § 107). En d’autres termes, la nécessité de respecter les brefs délais prévus par la Convention de La Haye n’exonère pas les autorités judiciaires du devoir de procéder à un examen effectif des allégations d’une partie fondées sur l’une des exceptions expressément prévues à l’article 13 alinéa premier (X c. Lettonie, précité, § 118).
44. Enfin, dans ce genre d’affaires, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre : les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale, y compris l’exécution de la décision rendue à leur issue, appellent en effet un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. La Convention de La Haye le reconnaît d’ailleurs, en prévoyant un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus de façon illicite dans tout État contractant. Aux termes de l’article 11 de cette convention, les autorités judiciaires ou administratives saisies doivent ainsi procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant, tout retard pour agir dépassant six semaines pouvant donner lieu à une demande d’explication (Maire, précité, § 74).
45. En l’espèce, la Cour note que toutes les juridictions saisies de l’affaire au niveau national ont considéré que la rétention de l’enfant au Portugal était illicite au sens de l’article 3 b) de la Convention de La Haye, dans la mesure où les responsabilités parentales à son égard étaient exercées conjointement par ses deux parents et où c’était sans l’accord du père que la deuxième requérante avait décidé de ne pas rentrer à Chypre le 15 septembre 2009. En revanche, elles n’ont pas été unanimes quant à la suite à donner à l’affaire. En effet, le tribunal aux affaires familiales de Coimbra, en première instance, puis la Cour suprême, statuant en dernier ressort, ont estimé que le retour de l’enfant s’imposait, tandis que la cour d’appel de Coimbra est parvenue à la conclusion inverse.
46. Les motifs de ces décisions divergentes peuvent se résumer comme suit. Dans son jugement du 10 janvier 2010, tout d’abord, le tribunal aux affaires familiales de Coimbra a rejeté les objections de la deuxième requérante au retour de l’enfant au motif que la rétention datait de moins d’un an et qu’aucune des exceptions prévues aux articles 12 et 13 de la Convention de La Haye n’était d’application en l’espèce, en estimant entre autres non pertinents ses arguments relatifs aux difficultés qu’elle avait rencontrées pour s’intégrer à Chypre, à la bonne adaptation de l’enfant au Portugal et au fait qu’elle était la principale personne de référence de l’enfant.
Infirmant ce jugement, dans son arrêt du 15 juin 2010 la cour d’appel de Coimbra a considéré que la condition d’application de l’exception prévue à l’article 13 alinéa premier lettre b) de la Convention de La Haye était remplie étant donné l’intégration de l’enfant au Portugal, son éloignement d’avec son père depuis le 15 septembre 2009 et le fait qu’il n’avait pas été démontré que les autorités chypriotes offriraient des mesures de protection adéquates à l’enfant en cas de retour.
Dans son arrêt du 14 avril 2011, enfin, tout en regrettant que la situation sociale de l’enfant à Chypre n’ait pas été mise en lumière au cours de la procédure comme l’aurait voulu l’article 13 de la Convention de La Haye, la Cour suprême a, quant à elle, écarté l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour et confirmé le jugement du tribunal aux affaires familiales de Coimbra.
Il apparaît, somme toute, que la motivation des divergences de position des juridictions internes sur la question, au vu des circonstances de l’espèce, de l’applicabilité ou non des exceptions au retour de l’enfant prévues par la Convention de La Haye a été particulièrement succincte et reposait sur peu d’éléments de preuve.
47. En ce qui concerne l’administration de la preuve des faits retenus à l’appui de leurs décisions, les juridictions internes ont tenu compte des arguments présentés par la deuxième requérante et par Monsieur D. dans leurs mémoires respectifs, entendu un témoin présenté par la deuxième requérante et pris connaissance du rapport qui avait été présenté par les services sociaux portugais le 5 janvier 2010.
48. La Cour constate qu’aucun élément du dossier ne permettait de déterminer quelle était la situation antérieure de l’enfant à Chypre avant son déplacement, comme l’avait d’ailleurs regretté le parquet en cassation (voir ci-dessus paragraphe 24). Les juridictions n’ont en outre pas jugé nécessaire de demander à l’autorité centrale chypriote des renseignements concernant la situation du père et son éventuelle incapacité à prendre soin de l’enfant, telle qu’alléguée par la requérante.
49. Or, l’article 8 de la Convention imposait aux autorités portugaises une obligation procédurale, en exigeant que toute allégation défendable de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour fasse l’objet de la part des juges d’un examen effectif, ce dernier devant ressortir d’une motivation circonstanciée (X. c. Lettonie, précité, § 107). Il appartenait donc aux juges portugais de procéder à des vérifications sérieuses permettant soit de confirmer soit d’écarter l’existence d’un « risque grave » (B. c. Belgique, no 4320/11, §§ 70-72, 10 juillet 2012 ; X. c. Lettonie, précité, § 116), le cas échéant en sollicitant des observations sur la situation de l’enfant à Chypre, comme le recommande l’article 13 de la Convention de La Haye (voir ci‑dessus paragraphes 25 et 28).
50. La Cour observe aussi qu’à l’appui de son recours devant la cour d’appel de Coimbra, la requérante avait produit un rapport d’un psychologue établi le 2 février 2010 concluant à l’existence d’un risque de traumatisme pour l’enfant en cas de séparation d’avec sa mère. Le 22 mars 2010, elle avait également remis une copie d’un mandat d’arrêt émis le 11 mars 2010 par les autorités mozambicaines à l’encontre du père de l’enfant. Or, dans son arrêt du 17 juin 2010, la cour d’appel de Coimbra a implicitement écarté toute considération à ce sujet, en énonçant que l’existence de poursuites judiciaires contre le père n’était pas au nombre des faits qu’elle tenait pour établis. En outre, l’arrêt de la Cour suprême du 14 avril 2011 ne fait référence à aucun des éléments présentés par la requérante l’appui de son recours.
51. Pour finir, comme indiqué dans l’affaire Neulinger et Shuruk, le facteur « temps » est décisif pour apprécier le respect de l’article 8. Certes, selon l’article 12, alinéa 2, de la Convention de La Haye « l’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an (...), doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu » (sur ce dernier point, voir Koons c. Italie, no 68183/01, §§ 51 et suivants, 30 septembre 2008).
52. À cet égard, la Cour note que la demande de retour a été adressée le 23 septembre 2009 par l’autorité centrale chypriote à son homologue portugaise (voir ci-dessus paragraphe 12), que le jugement du tribunal aux affaires familiales de Coimbra a été rendu le 14 janvier 2010, l’arrêt de la cour d’appel de Coimbra le 15 juin 2010, et l’arrêt de la Cour suprême le 14 avril 2011. La procédure a ainsi duré 1 an, 6 mois et 20 jours pour trois degrés de juridiction, ce qui apparaît excessif au vu de l’urgence inhérente à la matière et le délai de six semaines imparti par l’article 11 de la Convention de La Haye. Contrairement au Gouvernement, la Cour estime que la deuxième requérante a fait un usage normal des voies de recours que lui ouvrait le droit interne et ne peut être tenue responsable de la durée de la procédure.
53. En outre, si le tribunal de Coimbra a ordonné le retour de l’enfant en tenant compte du fait que la rétention datait de moins d’un an, la Cour suprême n’a pas estimé nécessaire de revoir ce point. Or, la Cour estime que la durée de la procédure peut avoir causé des changements dans la situation de l’enfant, d’autant plus que celle-ci semblait déjà bien intégrée dans son nouveau cadre de vie et son milieu scolaire à la date du rapport des services sociaux, le 5 janvier 2010.
54. Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’absence d’informations concernant la situation à Chypre et aux risques pour l’enfant en cas de séparation d’avec sa mère, exposés par cette dernière et mentionnés dans le rapport du psychologue du 2 février 2010, force est de conclure que le processus décisionnel n’a pas satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8 de la Convention. Partant, la Cour estime qu’il y aurait violation du droit des requérantes au respect de leur vie familiale si la décision ordonnant le retour de la première à Chypre était exécutée.
VOROZHBA C. RUSSIE du 16 octobre 2014 requête 57960/11
Article 8 en matière d'enlèvement d'enfant dans une procédure de divorce. C'est la mère qui a effectué toutes les démarches pour faire appliquer le jugement qui lui donne la garde de l'enfant. Les autorités ont été très peu efficaces.
82. La Cour note tout d’abord qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le lien entre la requérante et sa fille V. relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Elle constate que le jugement du 15 septembre 2009 fixant la résidence de V. au domicile de la requérante a reçu exécution le 27 octobre 2011. Elle observe ainsi que la durée de l’exécution du jugement a été de deux ans à compter du 28 octobre 2009, date de l’arrêt de cassation ayant confirmé le jugement du 15 septembre 2009.
La Cour doit donc déterminer si les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires et adéquates que l’on pouvait attendre d’elles pour faciliter l’exécution de ce jugement.
83. Afin de répondre à cette question, la Cour procédera à l’analyse de la procédure d’exécution pour deux périodes différentes : celle comprise entre le 19 novembre 2009, date de l’ouverture de la procédure d’exécution, et le 25 décembre 2009, date du départ de D.V. avec l’enfant de la Russie (i) ; et celle comprise entre le 25 décembre 2009 et le 27 octobre 2011, date de la remise de l’enfant à la requérante (ii).
i. Première période
84. En ce qui concerne cette période, il n’est pas contesté entre les parties que le service des huissiers a agi conformément aux dispositions pertinentes de la loi relative aux procédures d’exécution. À ce titre, la Cour relève que le service en question a ordonné l’ouverture de la procédure d’exécution du jugement (paragraphe 13 ci-dessus), porté à maintes reprises à la connaissance de D.V. l’obligation pour lui de se conformer à la décision dans les délais impartis (paragraphes 13, 16 et 17 ci-dessus) et sanctionné l’intéressé d’une amende (paragraphe 16 ci-dessus). Elle note que les mesures susmentionnées ont été prises dans un délai relativement court, à savoir trente-cinq jours.
De même, la Cour observe qu’après le départ de D.V., le service des huissiers a immédiatement lancé un avis de recherche (paragraphe 18 ci‑dessus). Elle considère que ce service ne saurait être critiqué pour ne pas avoir pris des mesures préventives propres à empêcher le déplacement de l’intéressé avec l’enfant à l’étranger, ce déplacement apparaissait imprévisible tant pour la requérante que pour les autorités. Elle note en effet que la requérante n’a déposé sa déclaration d’opposition à la sortie de l’enfant du territoire russe et les autorités n’ont ordonné la restriction du droit de D.V. de quitter le territoire russe (paragraphes 20 et 31 ci-dessus), qu’après le départ en question. La Cour ne saurait donc reprocher au service des huissiers une quelconque inertie dans l’exécution du jugement pendant cette période.
ii. Deuxième période
85. Concernant la deuxième période, les parties sont en désaccord sur l’efficacité de la procédure de recherche de D.V.
86. La Cour prend note de l’argument avancé par le Gouvernement selon lequel la police a entrepris un certain nombre de démarches propres à permettre de retrouver D.V. (paragraphe 70 ci-dessus). Cela étant, elle relève le caractère stéréotypé des lettres adressées par la police au service des huissiers au cours de l’enquête, lesquelles ne permettaient de refléter ni l’évolution de cette enquête ni les démarches effectuées dans le cadre de celle-ci, à supposer que ces démarches aient réellement eu lieu. Elle note en effet que la police s’est contentée à maintes reprises de constater que le lieu de résidence de D.V. était introuvable (paragraphes 22 et 26 ci-dessus).
87. Or, la Cour constate que si D.V. ne résidait pas à son lieu de domicile déclaré il ne vivait pas pour autant dans la clandestinité. Outre le faits qu’il était passé par un point de contrôle russe lors de son retour en Russie (paragraphe 24 ci‑dessus), il apparaissait dans des lieux publics – notamment au bureau de police auprès duquel il s’était rendu pour faire immatriculer sa voiture (paragraphe 27 ci-dessus) – et s’était fait arrêter lors d’un contrôle par la police routière (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour en conclut que, à son retour en Russie le 26 mars 2010, la localisation de l’intéressé était à la portée des autorités nationales.
88. À cet égard, la Cour note que, selon la requérante, la police a commis une négligence en laissant partir D.V., ce qui aurait permis à ce dernier de se soustraire à l’exécution du jugement pour quelques mois. Elle observe que le Gouvernement ne fait pas de commentaires sur ce point et qu’il soutient en revanche que la loi en vigueur ne donnait pas aux autorités frontalières le pouvoir d’arrêter la personne visée par une décision de justice à la sortie du territoire russe.
89. La Cour constate que la législation nationale confère certains pouvoirs aux autorités compétentes pour la recherche des personnes visées par une décision de justice dans le cadre d’une procédure d’exécution (paragraphes 58-62 ci-dessus). Elle note en particulier que le service fédéral des frontières a le droit de remettre les personnes recherchées pour inexécution d’un jugement à la police (paragraphe 61 ci-dessus) et que, à leur tour, les policiers ont le droit d’amener ces personnes dans les locaux de police, d’examiner la question relative à leur éventuelle mise en détention (paragraphe 58 ci-dessus), d’avertir les huissiers (paragraphe 59 ci-dessus in fine) et même de priver ces personnes de liberté le temps nécessaire pour leur transfert auprès du service des huissiers (ibidem).
90. Si la Cour ne saurait indiquer aux autorités nationales la nécessité d’appliquer des mesures contraignantes, telles l’arrestation ou la détention, dans un cas concret – cette matière relevant exclusivement de la compétence de ces autorités –, elle peut néanmoins examiner si les mesures prises dans une espèce ont été suffisantes et adéquates vis-à-vis du but poursuivi.
91. En l’occurrence, la Cour constate l’incongruité de la situation : en effet, bien que D.V. ait été plusieurs fois en contact avec les autorités et ait exprimé un refus avéré et manifeste de se conformer au jugement, les autorités ont tout de même persisté à ne pas clôturer la procédure de recherche. De surcroît, la Cour nourrit des doutes quant à l’efficacité de cette recherche étant donné que la nouvelle adresse de l’intéressé est demeurée inconnue du service des huissiers pour la suite de la procédure (Bordeianu c. Moldova, no 49868/08, § 76, 11 janvier 2011).
92. Or, la procédure de recherche constituait un obstacle de jure à la poursuite de l’exécution du jugement (paragraphe 51 ci-dessus) et, notamment, à l’application de mesures coercitives, la Cour estime que la situation a été, d’une certaine manière, favorable à l’intéressé. Cette situation a été mise en évidence par la requérante (paragraphe 43 ci‑dessus), laquelle avait demandé la levée du sursis à l’exécution du jugement aux fins d’application à D.V. de mesures coercitives. La Cour doute dès lors qu’il y ait eu un quelconque intérêt à poursuivre la procédure de recherche de D.V. puisque les contacts répétés de ce dernier avec les autorités n’avaient entraîné aucune conséquence ni pour lui ni pour la requérante.
93. De plus, s’agissant de l’évocation par le Gouvernement du comportement dilatoire de D.V., la Cour estime que les autorités compétentes pour l’exécution du jugement n’ont pas fait preuve de la diligence adéquate pour amener l’intéressé, qui se montrait récalcitrant, à exécuter son obligation, si besoin était par des mesures de coercition suffisamment systématiques, voire plus sévères, pour le faire changer d’attitude (paragraphe 79 ci-dessus). De l’avis de la Cour, le défaut d’exécution est imputable surtout à l’absence de réaction des autorités à la résistance exprimée par l’intéressé.
94. En outre, prenant note de la lettre du 27 septembre 2010 adressée à la requérante par l’adjoint du procureur du district Khassanksiy, qui admettait l’insuffisance des mesures prises pour la recherche de D.V. (paragraphe 42 ci-dessus), la Cour est d’avis que cette lettre conforte plus la version de la requérante que celle du Gouvernement (paragraphe 70 in fine ci‑dessus).
95. La Cour observe de surcroît que cette situation continue n’est en aucune façon imputable à la requérante, laquelle a régulièrement entrepris des démarches auprès de différentes autorités afin d’obtenir le retour de sa fille (paragraphes 32-45 ci-dessus). La Cour est frappée par le caractère peu cohérent des réponses données par les autorités face aux demandes instantes de la requérante (comparer les paragraphes 33, 35 et 37 ci‑dessus).
96. Enfin, la Cour ne souscrit pas à l’argument du Gouvernement selon lequel le jugement du 15 septembre 2009 (paragraphe 10 ci-dessus) ne renfermait aucune obligation pour le père de remettre l’enfant à la requérante et que, par conséquent, il était inexécutable. À aucun moment de la procédure d’exécution, le service des huissiers n’a évoqué le manque de clarté du jugement. Ce dernier était suffisamment clair, aux yeux du service des huissiers, aussi bien pour engager la procédure d’exécution (paragraphe 13 ci-dessus) que pour procéder finalement à son exécution sans précisions supplémentaires (paragraphe 47 ci-dessus).
97. La Cour conclut que, nonobstant la marge d’appréciation dont dispose l’État défendeur en la matière, les autorités nationales n’ont pas pris en l’espèce toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exécution du jugement prononcé par le tribunal du district Khassanskiy le 15 septembre 2009 en faveur de la requérante. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
Décision d'Irrecevabilité
MR et LR C. Estonie du 4 juin 2012 requête N° 13420/12
La décision ordonnant le retour d’une enfant à son domicile en Italie auprès de son père n’était pas arbitraire. En matière des droits de l'homme les droits du père son sauvegardés contre la mère !
Comme le père est dans un milieu particulier, il peut se faire arrêter et laisser sa fille en bas âge, seule. La CEDH répond que l'Italie est soumise au respect de la Convention.
Les requérantes sont M.R., une ressortissante estonienne née en 1981, et sa fille, L.R., née en 2009, ayant la nationalité estonienne et italienne. Elles vivent à Kõrveküla, dans le comté de Tartu (Estonie).
M.R. rencontra le père de L.R., R., un ressortissant italien, au cours de ses études aux Pays-Bas. Elle vécut ensuite avec lui à Arluno, près de Milan. Après la naissance de leur fille, leur relation se détériora. D’après R., il souhaitait élever l’enfant selon les traditions italiennes avec l’aide de ses parents. M.R. allègue au contraire qu’il l’a soumise à un harcèlement moral. En mars 2011, alors qu’elles étaient en voyage en Estonie, les requérantes ne rentrèrent pas en Italie.
Le tribunal du comté de Tartu examina la demande de la mère en vue d’obtenir seule la garde de sa fille et la demande du père en vue du retour de l’enfant en Italie au titre de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (« la Convention de La Haye »).
Article 8
La Cour considère que les griefs des requérantes doivent être examinés sous l’angle de l’article 8. Elle observe que la décision de renvoyer l’enfant en Italie a été prise sur le fondement de la Convention de La Haye, incorporée dans le droit estonien, et que cette décision visait le but légitime de protéger les droits et libertés de l’enfant et du père. Il reste donc à la Cour à rechercher si l’ingérence dans l’exercice par la mère et la fille du droit au respect de la vie familiale était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8.
L’affaire a été étudiée en Estonie par trois degrés de juridiction. Le tribunal de comté a tenu une audience et les parties ont pu présenter des observations. Dans ces circonstances, le rejet de la demande de M.R. portant sur une audience supplémentaire, une audition de témoins et un examen psychiatrique du père n’a pas rendu la procédure inéquitable. De fait, les décisions des tribunaux estoniens se sont fondées sur d’amples éléments de preuve et sur la présomption des autorités selon laquelle, d’après la Convention de La Haye, le retour immédiat de l’enfant à son lieu habituel de résidence était conforme à l’intérêt supérieur de celle-ci.
De plus, les expertises sur les conséquences du retour de l’enfant en Italie et des relations entre les parents et l’enfant – qui ont été prises en compte par les juridictions estoniennes – revêtaient un caractère contradictoire. En outre, aucun des experts n’a pu confirmer les allégations d’abus sexuels du père sur l’enfant.
Concernant l’argument de M.R. selon lequel R. ne s’occuperait pas personnellement de leur fille si l’enfant retournait en Italie, la Cour rappelle que la procédure en Estonie ne portait pas sur le droit de garde des parents, qui fait l’objet d’une procédure distincte en Italie. Pour ce qui est du risque que M.R. soit arrêtée en Italie pour enlèvement d’enfant et de ses doutes quant au fait que R. subvienne effectivement à ses besoins et à ceux de leur fille en cas de retour, la Cour note que les autorités italiennes sont tenues, tant dans la procédure pénale que dans la procédure civile relative à la garde de l’enfant, par la Convention européenne et les garanties qu’elle prévoit.
La Cour conclut que le rejet par les juridictions estoniennes des arguments de M.R. au sujet de son impossibilité de rentrer en Italie n’a pas outrepassé leur marge d’appréciation. Rien n’indique non plus que leur décision d’ordonner le retour de l’enfant en Italie ait été arbitraire ou que les autorités aient failli à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Partant, la Cour rejette les griefs des requérantes pour défaut manifeste de fondement et lève l’application de l’article 39 de son règlement.
SHAW C. HONGRIE du 26 juillet 2011 Requête 6457/09
La Hongrie n'a pas fait en sorte qu'une enfant enlevée par sa mère retourne à Paris auprès de son père
Le requérant, Leslie James Shaw, est un ressortissant irlandais né en 1953 et résidant à Paris (France).
Il divorça de son épouse hongroise en juin 2005. Il fut décidé que la garde de leur fille née en octobre 2000 serait partagée. L'enfant était censé vivre avec sa mère, tandis que le père jouissait d'un droit de visite selon les modalités fixées par le jugement de divorce.
En décembre 2007, la mère emmena l'enfant en vacances en Hongrie, ce dont M. Shaw était au courant. Cependant, le 5 janvier 2008, elle écrivit à son ex-mari pour lui annoncer qu'elle avait inscrit leur fille dans une école hongroise et qu'elle n'avait aucune intention de revenir en France.
En mars 2008, invoquant le règlement communautaire sur la reconnaissance des jugements et la Convention de La Haye sur l'enlèvement international d'enfants, M. Shaw forma un recours civil en Hongrie contre son ex-femme. Les tribunaux hongrois firent droit à sa demande et rendirent un jugement définitif en septembre 2008 constatant l'enlèvement de sa fille et ordonnant son retour en France.
À partir d'octobre 2008, les autorités hongroises tentèrent à plusieurs reprises de faire en sorte que la mère se conforme volontairement à son obligation de rendre l'enfant.
Devant l'échec de ces tentatives, une amende de 180 euros (EUR) lui fut infligée en décembre 2008. Parallèlement, en mars 2009, un tribunal parisien délivra un mandat d'arrêt européen visant l'ex-femme de M. Shaw pour soustraction d'enfant à la garde de son père. Elle fut arrêtée le 27 juillet 2009 mais remise en liberté le lendemain par les tribunaux hongrois au motif qu'une procédure pénale était ouverte contre elle en Hongrie pour les mêmes faits.
À partir du 29 juillet 2009, les autorités hongroises cherchèrent de nouveau à retrouver la mère et sa fille qui avaient pris la fuite entre-temps. Des investigations eurent lieu dans certains lieux publics ou dans des bâtiments proches du lieu de résidence de la mère. Son ancien employeur et d'autres témoins furent entendus. Par ailleurs, ses communications téléphoniques furent mises sous écoute. L'école de sa fille fut surveillée, de même que la base de données des prestataires médicaux au cas où elle ou son enfant aurait fait appel à eux. Aucune de ces mesures ne fut couronnée de succès.
En avril 2008, M. Shaw saisit en vain les tribunaux hongrois pour faire valoir son droit de visite. Ce même mois, les tribunaux français lui accordèrent la garde exclusive et ordonnèrent que sa fille vive avec lui. La procédure de reconnaissance de ce jugement est en cours.
M. Shaw porta également plainte à deux reprises au pénal contre son ex-femme en automne 2008 et en juin 2009, respectivement pour atteinte à l'autorité parentale sur son enfant et mise en danger de celui-ci par non-respect d'un jugement définitif. Ces plaintes furent l'une et l'autre rejetées.
M. Shaw saisit la Commission européenne en janvier 2009 pour se plaindre d'une violation du règlement communautaire susmentionné sur la reconnaissance des jugements, d'un règlement communautaire sur la signification des actes et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La procédure est toujours en cours.
Vie privée et familiale (article 8)
La Cour rappelle que l'article 8 inclut le droit pour un parent d'être réuni avec son enfant et que les autorités ont l'obligation de faciliter pareille réunion.
Les procédures judiciaires en Hongrie concernant le retour de la fille de M. Shaw ont duré plus longtemps que les six semaines autorisées par le règlement communautaire
sur la reconnaissance des jugements, applicable en Hongrie. Aucune raison n'a été avancée pour justifier un retard cumulé de plusieurs semaines et il n'existait aucune
circonstance exceptionnelle propre à expliquer ce retard. Dès lors, les tribunaux hongrois n'ont pas statué promptement dans le cadre de cette procédure. La Cour en conclut que, du fait de ce seul retard, les autorités hongroises ont manqué à leur obligation de prendre des mesures de protection.
En outre, même si les autorités hongroises ont tenté de retrouver la mère et la fille, près de 11 mois se sont écoulés entre la signification du jugement définitif exécutoire
ordonnant le retour de l'enfant et la disparition de celui-ci et de sa mère. Durant cet intervalle, les seules mesures d'exécution prises ont été les demandes formulées en vain par les huissiers pour que la mère rende volontairement l'enfant et l'amende relativement modeste infligée à elle. Bien que la mère ait été arrêtée le 27 juillet 2009,
les autorités n'ont rien fait pour exécuter le jugement en question ce jour-là ni à un quelconque moment après le 18 juin 2009, une fois devenue définitive la décision sur les modalités d'exécution forcée.
Enfin, la Cour relève que la situation a été aggravée par le fait que, les tribunaux hongrois ayant constaté qu'ils ne pouvaient faire respecter le droit de visite de M. Shaw, celui-ci n'avait pas vu sa fille depuis trois ans et demi alors qu'il avait le droit de lui rendre visite régulièrement.
La Cour en conclut à la violation de l'article 8.
Satisfaction équitable (article 41)
La Cour dit que la Hongrie doit verser à M. Shaw 20 000 EUR pour dommage moral et 12 000 EUR pour frais et dépens.
Dore c Portugual (requête 775/08) et Karoussiotis c Portugal (requête 23205/08) du 1er février 2011
Inefficacité de procédures concernant l’enlèvement international d’enfants
La Cour est, pour l’essentiel, amenée à trancher la question de savoir si le fait que Mme Karoussiotis ait préalablement introduit un « procédure d’infraction » contre le Portugal devant la Commission européenne entraîne l’irrecevabilité de sa requête devant la Cour, au motif que cette requête aurait ainsi déjà été « soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement » (article 35).
Il en irait ainsi si la « procédure d’infraction » pouvait être assimilée sous l’angle procédural et sous l’angle des effets potentiels à une requête individuelle prévue par la Convention (article 34).
Or, la Cour estime que tel n’est pas le cas. En effet, la « procédure d’infraction » a uniquement pour objectif d’obtenir la mise en conformité volontaire de l’Etat membre aux exigences du droit de l’Union européenne. La Commission européenne dispose du pouvoir discrétionnaire de lancer une « procédure d’infraction » devant la Cour de Justice de l’Union européenne, dont l’arrêt n’a aucun effet sur les droits du plaignant et ne peut lui accorder aucune réparation individuelle (la Cour de Justice ne peut dans ce cas que contraindre l’Etat concerné à se mettre en conformité avec ses obligations).
Il ne peut donc être considéré que Mme Karoussiotis a déjà soumis sa requête à « une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ». Elle est recevable.
Atteinte alléguée au droit au respect de la vie privée et familiale (dans les deux affaires)
La Cour rappelle que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à la réunion avec son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (mais ce droit n’est pas absolu : l’Etat doit notamment tenir compte des intérêts supérieurs de l’enfant). Elle rappelle également que les procédures dans ce domaine doivent être traitées avec célérité, le passage du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui. D’ailleurs, tant la Convention de La Haye que le Règlement no 2201/2003 exigent que les autorités saisies procèdent d’urgence en vue du retour de l’enfant, tout retard dépassant six semaines pouvant donner lieu à une demande d’explication.
Dans le cas de M. Dore, la Cour relève qu’il a fallu près de six mois aux autorités portugaises pour retrouver la trace de l’enfant, alors qu’il était scolarisé dans l’établissement indiqué par M. Dore dès le début de la procédure. Il leur a encore fallu presque trois mois pour déposer une demande formelle de retour de l’enfant. Ces deux retards, à eux seuls, suffisent à conclure que les autorités portugaises n’ont pas déployé des moyens efficaces pour traiter l’affaire avec la célérité exigée. De surcroît, la Cour s’interroge sur le fait que M. Dore n’ait pas été convoqué et entendu par le tribunal saisi de la demande de retour de l’enfant, alors que la mère et la tante de l’enfant l’ont été. Enfin, le délai de réponse pris par les autorités portugaises suite à la demande des autorités britanniques d’exercer un appel a encore ralenti la procédure.
Dans le cas de Mme Karoussiotis, la Cour note que la procédure portant sur la demande de retour de l’enfant en Allemagne a duré au total environ trois ans et dix mois, pour deux degrés de juridictions. Force est de conclure que cette durée a créé une situation de fait défavorable à Mme Karoussiotis, vu notamment que l’enfant avait moins de quatre ans au moment de son départ au Portugal. Quant à la procédure portant sur la réglementation des responsabilités parentales, elle est toujours pendante, après plus de cinq ans et huit mois.
Dans ces affaires, les autorités portugaises n’ont pas déployé des moyens efficaces pour traiter de façon expéditive les procédures en cause, ce qui a provoqué un éloignement entre les requérants et leurs enfants respectifs. M. Dore et Mme Karoussiotis ont chacun subi une violation de l’article 8.
KÜCÜK contre Turquie et Suisse requête N° 33362/04 du 17 mai 2011
La Turquie et la Suisse ont assuré le retour d’un enfant enlevé, mais l’enfant et son père ont été détenus illégalement en Turquie
Principaux faits
Les requérants, Murat Küçük, et son fils, Nevzat Abdullah Küçük, sont deux ressortissants turcs nés respectivement en 1972 et 1997 et résidant à Ankara. Suite à son divorce en 2001, Murat Küçük se vit attribuer l’autorité parentale et la garde exclusives de son fils. En juillet 2002, la mère de l’enfant exerça son droit de visite et partit pour un mois avec lui, accompagnée de son frère. A la fin de la période prévue, elle ne ramena pas l’enfant à son père.
Le 2 août 2002, Murat Küçük saisit la justice pour faire respecter son droit de garde et obtenir le retour de Nevzat Abdullah. Il fut informé qu’un jour plus tard, son ex-épouse avait franchi la frontière turco-bulgare avec leur fils en utilisant des documents falsifiés.
A la suite des informations fournies par Murat Küçük et de son dépôt de plainte, le parquet d’Edirne ouvrit une instruction contre l’ex-épouse et son frère pour utilisation de faux passeports. Des ordonnances furent rendues par les juridictions nationales afin d’interdire la sortie de l’enfant du territoire turc et de prendre des mesures de contrôle appropriées en cas de retour de celui-ci en Turquie. Le procureur près la cour d’assises d’Istanbul engagea des poursuites pénales contre l’ex-épouse et son frère pour faux et usage de faux. Un mandat d’arrêt national et une « notice rouge » de recherche à l’égard des fugitifs furent émis. Le bureau central national d’Interpol à Ankara diffusa des notices jaune et rouge dans tous les pays membres d’Interpol.
En juin 2003, les autorités suisses informèrent les autorités turques que les fugitifs avaient été localisés en Suisse. Les autorités turques saisirent immédiatement l’office fédéral suisse de la justice, afin que soient prises toutes les mesures nécessaires pour assurer le retour de l’enfant. Elles lui transmirent toutes les informations dont elles disposaient dans ce dossier. Les autorités suisses procédèrent sans délai à la recherche des fugitifs (interrogatoires de témoins, recherches dans les écoles et les locaux où les fugitifs avaient été aperçus etc.). Un mandat d’amener fut délivré par la police cantonale du Jura à l’encontre de la mère et de l’oncle de l’enfant, pour enlèvement. Les autorités turques demandèrent la localisation des fugitifs sur la base de la loi fédérale relative à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, mais les autorités suisses répondirent que pour faire appliquer ce type de mesures, il convenait que les autorités turques aient recours au mécanisme de l’entraide pénale internationale.
Le 15 octobre 2004, les autorités suisses localisèrent l’enfant, qui vivait dans la clandestinité avec sa mère et son oncle, et le placèrent dans un foyer pour mineurs. Murat Küçük obtint la restitution de son fils. Le 18 novembre 2004, il retourna avec lui en Turquie. Arrivés à Ankara, ils furent tous deux appréhendés par la police vers 1 heure du matin et placés en détention à l’aéroport d’Esenboğa, du fait de la restriction imposée auparavant pour les fugitifs, et afin de procéder à la vérification de leur identité. Murat Küçük exposa la situation, documents à l’appui, et demanda à être traduit devant un magistrat. Le lendemain matin, après plusieurs heures en détention, il fut entendu par le procureur et remis en liberté avec son fils.
Article 8 (concerne la Turquie et la Suisse)
La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de
les prendre. Les « obligations positives » que cet article fait peser dans ce domaine sur les Etats contractants doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Dans l’affaire de Murat et Nevzat Abdullah Küçük, le point décisif consiste donc à savoir si les autorités turques et suisses ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exercice des droits de garde et d’autorité parentale reconnus à Murat Küçük.
Ayant examiné en détail toute la batterie de mesures prises par les autorités turques et suisses à cette fin, la Cour constate que les autorités turques et suisses ont fait le nécessaire à cet égard et qu’elles ont accompli de nombreux actes d’investigation. Si Murat Küçük n’a pu obtenir que d’autres actes soient effectués, en particulier des écoutes téléphoniques, ou que d’autres pistes soient explorées par les autorités nationales, cela ne saurait suffire en soi à faire qualifier les instructions d’insuffisantes.
Le fait que les procédures judiciaires, policières et diplomatiques turques et suisses ne se soient pas déroulées selon le souhait de Murat Küçük et que l’intéressé n’ait pas obtenu le résultat voulu dans un délai plus court, ne signifie pas que les autorités en question soient demeurées inactives.
Au final, malgré le laps de temps écoulé entre l’enlèvement de l’enfant et son retour en Turquie, ayant suivi toutes les démarches imposées par leur droit national et les conventions internationales, les autorités turques et suisses ont atteint le résultat souhaité par les requérants, et n’ont pas manqué à leur obligation positive résultant des faits litigieux. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Bianchi contre Suisse du 22 Juin 2006 requête 7548/04
1. Les principes contenus dans la jurisprudence de la Cour
76. L’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics ; il engendre, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I ; Karadžić c. Croatie, no 35030/04, § 51, 15 décembre 2005 ; Monory c. Roumanie et Hongrie, no 71099/01, § 72, 5 avril 2005).
77. La Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités compétentes pour réglementer les questions de garde et de visites, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle doit rechercher si les raisons censées justifier les mesures effectivement adoptées quant à la jouissance par le requérant de son droit au respect de sa vie familiale sont pertinentes et suffisantes au regard de l’article 8 (voir, par exemple, Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55).
78. S’agissant plus particulièrement de l’obligation pour l’Etat d’arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, les arrêts Ignaccolo-Zenide, précité, § 94 ; Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, §§ 127 et suiv., CEDH 2000-VIII ; Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, § 49, CEDH 2003-V ; Monory, précité, § 73).
79. Le point décisif, en matière de droit de la famille, consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l’exécution des décisions rendues par les juridictions internes accordant au requérant le droit de garde et l’autorité parentale exclusive de l’enfant, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Karadžić, précité, § 53).
80. Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue. La nature et l’étendue de celles-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux (Ignaccolo-Zenide précité, § 94, Iglesias Gil et A.U.I., précité, § 50, Karadžić, précité, § 52).
81. La Cour rappelle aussi que la Convention ne doit pas être interprétée isolément, mais qu’il convient, en vertu de l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin 1990 et dont les articles 31 à 33 sont considérés, de surcroît, comme faisant partie du droit international coutumier (voir Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 14, § 29), de tenir compte de toute règle pertinente de droit international applicable à la partie contractante (voir, parmi d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH 2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI).
82. Cela étant, les obligations que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent à ses enfants doivent s’interpréter à la lumière de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 72, CEDH 2003-VII) et de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (Iglesias Gil et A.U.I., précité, § 51 ; Ignaccolo-Zenide, précité, § 95 ; Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), no 14600/05, CEDH 2005-... (extraits) ; Monory, précité, § 73 ; Guichard c. France (déc.), no 56838/00, p. 414, CEDH 2003-X ; Paradis c. Allemagne, (déc.), no 4783/03, 15 mai 2003).
83. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que l’Etat défendeur est également partie à ce dernier instrument, ce depuis le 1er janvier 1984. Dans le préambule de cette convention, les parties contractantes expriment leur conviction que « l’intérêt de l’enfant est d’une importance primordiale pour toute question relative à sa garde » et soulignent leur volonté de « protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et d’établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle, ainsi que d’assurer la protection du droit de visite » (voir, ci-dessus, partie « Le droit interne et international pertinent »). Ces dispositions, considérées à la lumière de l’article 7 de ladite convention, qui dresse une liste non exhaustive de mesures que doivent prendre les Etats pour assurer le retour immédiat des enfants (Ignaccolo-Zenide, précité, § 95, et Monory, précité, § 73), doivent être perçues comme constituant l’objet et le but, au sens de l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, de la Convention de La Haye (voir, dans ce sens, Paradis, précitée).
84. La Cour réitère également le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33). Dans cette logique, elle rappelle qu’un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple déroulement du temps. Elle peut aussi avoir égard, sur le terrain de l’article 8, au mode et à la durée du processus décisionnel (W. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, p. 29, § 65 ; Eskinazi et Chelouche, précitée ; McMichael c. Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, série A no 307-B, pp. 55 et 57, §§ 87 et 92).
85. Dans ce contexte, la Cour a noté que l’adéquation d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale, y compris l’exécution des décisions rendues à leur issue, exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux (Ignaccolo-Zenide, précité, § 102 ; voir aussi, mutatis mutandis, Maire, précité, § 74, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004-V (extraits), et Monory, précité, § 82).
2. Application en l’espèce des principes précités
a) Applicabilité à l’espèce de l’article 8, existence d’une ingérence ainsi que d’une base légale et d’un but légitime
86. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté que, pour le requérant et son fils – dont le premier a obtenu la garde en vertu des décisions des tribunaux italiens –, continuer à vivre ensemble représente un élément fondamental qui relève de la vie familiale au sens du premier paragraphe de l’article 8 de la Convention, lequel est donc applicable en l’espèce (Maire, précité, § 68, CEDH 2003-VII ; Eskinazi et Chelouche, précitée).
87. Le requérant entend se plaindre, d’une part, de l’inadéquation et de la durée des procédures engagées par les autorités suisses à la suite du second enlèvement de l’enfant par sa mère, et, d’autre part, de la négligence des autorités compétentes s’agissant d’exécuter l’ordre de retour découlant de la décision du tribunal supérieur du 12 juillet 2004. La Cour estime que sont donc en jeu aussi bien les obligations « négatives » que « positives » des autorités du canton de Lucerne, mais qu’il n’y a pas lieu d’insister sur cette distinction, qui ne se prête de toute manière pas à une définition précise et dont les principes applicables sont largement comparables (Iglesias Gil et A.U.I., précité, § 48 ; Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 55, 24 avril 2003 ; Eskinazi et Chelouche, précitée).
88. En l’espèce, le 23 décembre 2003, le père a confié l’enfant à sa mère afin de permettre à celle-ci d’exercer son droit de visite selon le calendrier convenu entre les parties. Par la suite, elle a disparu avec l’enfant. Il ne semble pas prêter à controverse que les décisions et procédures dénoncées à la suite de la disparition de l’enfant constituaient une « ingérence » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, dans la mesure où elles ont empêché le requérant, au moins temporairement, de jouir de l’exercice du droit de garde de son fils (voir, en ce sens, McMichael, précité, p. 55, §§ 86 et suiv. ; Monory, précité, § 70 ; Eskinazi et Chelouche, précitée ; Paradis, précitée).
89. Pareille immixtion enfreint l’article 8, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Reste donc à savoir si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
90. En l’espèce, la Cour relève que tout au moins la décision litigieuse du tribunal d’arrondissement du 3 mai 2004 était fondée sur les dispositions de la Convention de La Haye, intégrées au droit suisse et appliquées dans le but de protéger l’enfant, but dont la légitimité n’a d’ailleurs pas été contestée (voir, en ce sens, Tiemann c. France et Allemagne (déc.), nos 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000-IV ; Eskinazi et Chelouche, précitée).
b) Nécessité de l’ingérence dans une société démocratique
91. La Cour observe qu’au regard de l’article 3 de la Convention de La Haye, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite « lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué à une personne (...) par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ». S’agissant du fils du requérant, la Cour estime que le refus de sa mère de le ramener après l’exercice du droit de visite, en décembre 2003, entre assurément dans le champ d’application de la Convention de La Haye. Par ailleurs, l’« illicéité » du non-retour de l’enfant a ultérieurement été confirmée par les instances suisses, notamment par la préfecture de Willisau qui en vertu du code pénal a condamné la mère, le 15 mars 2004, à une amende pour enlèvement de mineur.
92. La Cour juge opportun, pour déterminer si les procédures et décisions juridictionnelles ainsi que les mesures prises par les autorités du canton de Lucerne en vue de mettre en œuvre ces décisions satisfont aux exigences de l’article 8, d’analyser de manière chronologique et à la lumière de la Convention de La Haye les faits considérés par elle comme étant pertinents.
Il convient tout d’abord de rappeler que le requérant a formé le 6 janvier 2004 une demande en vue du retour de son fils en Italie, ce devant le tribunal d’arrondissement de Willisau qui, par une décision du 7 janvier 2004, a ordonné le maintien de l’enfant en Suisse pendant la durée de la procédure concernant son éventuel retour en Italie. La Cour exprime des doutes quant à l’opportunité de cette décision, dans la mesure où celle-ci a en quelque sorte entériné la situation créée par l’acte indéniablement illicite de la mère, laquelle avait déjà enlevé son enfant en juin 2002. Par ailleurs, force est de constater que l’existence d’une situation visée par l’article 13 de la Convention de La Haye n’est nullement mentionnée dans le dispositif de la décision du 7 janvier 2004.
La Cour se demande également, à l’instar du gouvernement italien, qui est partie intervenante, si la décision du tribunal d’arrondissement de procéder à une nouvelle instruction complète du dossier était appropriée, dès lors que l’affaire avait déjà été soumise à son examen et qu’elle avait été tranchée par la haute juridiction suisse à peine neuf mois auparavant, le 23 avril 2003. Il est vrai qu’il revient au premier chef aux autorités nationales, singulièrement aux instances juridictionnelles, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 20, § 46). Néanmoins, dans la mesure où la Cour est compétente pour contrôler la procédure suivie devant les tribunaux suisses, en particulier pour rechercher si l’interprétation par les juridictions internes des garanties de la Convention de La Haye est à l’origine d’une violation de l’article 8 de la Convention (voir Monory, précité, § 81 ; Iglesias Gil et A.U.I, précité, § 61 ; et Guichard, précitée, pp. 414 et suiv.), elle n’est pas convaincue que la manière dont a procédé le tribunal de première instance cadre avec l’objet et le but de la Convention de La Haye, consistant, d’après le préambule et l’article premier notamment, à assurer le « retour immédiat » des enfants déplacés ou retenus illicitement (voir, ci-dessus, partie « Le droit interne et international pertinent »). La Cour note à cet égard que ni les autorités du canton de Lucerne ni le gouvernement suisse n’ont invoqué un changement fondamental des circonstances qui aurait appelé à reconsidérer la situation juridique fixée antérieurement par les tribunaux italiens et suisses (à ce sujet, voir par exemple Sylvester, précité, §§ 61-64).
93. Il convient aussi de prendre en compte le fait que le tribunal d’arrondissement n’a pas proposé un règlement du droit de visite favorable au requérant pour la durée de la procédure pendante, de sorte à maintenir le lien entre l’intéressé et son enfant. Or, les parties contractantes à la Convention de La Haye sont tenues, en vertu de l’article 7 alinéa 2 f), de prendre « [toutes les mesures appropriées, le cas échéant, afin de] permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite ». En l’occurrence, c’est à la demande du requérant lui-même que les autorités compétentes lui ont octroyé, par une décision du 23 avril 2004, le droit de voir son enfant une fois par semaine. Il ressort par ailleurs d’un rapport de l’autorité tutélaire en date du 27 août 2004 que les neuf rencontres entre le requérant et son enfant – intervenues entre le 24 avril et le 18 juillet 2004 – se sont déroulées de manière très satisfaisante et que le requérant a respecté toutes les modalités imposées par les autorités compétentes.
94. Ensuite, la Cour constate que le tribunal d’arrondissement de Willisau n’a statué que le 3 mai 2004, soit près de quatre mois après le dépôt de la demande du requérant tendant au rapatriement de l’enfant. Elle n’est pas convaincue qu’un tel laps de temps cadre avec l’article 11 de la Convention de La Haye, lequel exige que les autorités judiciaires ou administratives saisies procèdent « d’urgence » en vue du retour de l’enfant, toute inaction dépassant les six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation (pour une application de cette disposition, voir Ignaccolo-Zenide, précité, § 102 ; Monory, précité, § 82).
95. Le tribunal d’arrondissement de Willisau a finalement rejeté la demande du requérant au motif que les conditions de l’article 13 de la Convention de La Haye étaient remplies en l’espèce. La Cour exprime des réserves au sujet du processus décisionnel ayant conduit à ce jugement. Pour autant que l’enfant aurait fait preuve de réticences sérieuses quant à son retour en Italie, il faut en effet se demander s’il était opportun de se contenter en l’espèce d’un seul rapport, rédigé sur la base de deux rencontres entre l’enfant (âgé alors de quatre ans) et son père, intervenues le 24 avril et le 1er mai 2004, donc quatre mois après leur dernier contact (voir, a contrario, l’arrêt Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, § 71, CEDH 2003-VIII (extraits), qui porte sur le droit de visite d’un parent n’exerçant pas la garde de l’enfant, âgé de treize ans : il en ressort que ce serait aller trop loin que de dire que les tribunaux internes sont toujours tenus de solliciter l’avis d’un psychologue sur cette question, dans la mesure où cela dépend des circonstances particulières de chaque cause et, notamment, de l’âge et de la maturité de l’enfant concerné).
96. Dans ce contexte, la Cour est aussi d’avis que les réticences de l’enfant face à l’hypothèse de son retour – point mis en avant par le tribunal d’arrondissement – étaient essentiellement dues au fait que les autorités du canton de Lucerne avaient négligé de mettre en œuvre toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire exécuter la restitution de l’enfant ou, pour le moins, garantir un contact régulier entre lui et son père pendant la procédure pendante, ce afin d’éviter toute conséquence irrémédiable pour leurs relations. A ce sujet, elle partage l’opinion du tribunal supérieur selon laquelle il était tout à fait normal que l’enfant, qui avait alors quatre ans et qui s’était trouvé pendant des mois sous l’influence exclusive de sa mère, se fût opposé à son retour en Italie.
97. Le 12 juillet 2004, soit un peu plus d’un mois après sa saisine par le requérant (le 8 juin 2004), le tribunal supérieur du canton de Lucerne a finalement annulé la décision de l’instance inférieure, en ordonnant la restitution de l’enfant à son père pour le 31 juillet 2004 au plus tard et en autorisant l’intervention de la police, si nécessaire.
98. Il existe aussi une divergence d’opinion manifeste et profonde entre le requérant et le gouvernement défendeur sur la question de savoir si les autorités administratives et policières ont entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’elles pour l’exécution de l’arrêt du tribunal supérieur du 12 juillet 2004. A cet égard, l’article 7 alinéa 2 lettre a) de la Convention de La Haye commande aux Etats parties de « [prendre toutes les mesures appropriées] pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ».
La Cour ne remet pas en question le fait que les autorités du canton de Lucerne ont pris à partir de septembre 2004 de nombreuses mesures afin de retrouver la mère et l’enfant, notamment des perquisitions, des enquêtes auprès d’établissements bancaires et postaux, la surveillance de comptes, des surveillances téléphoniques et des observations. Néanmoins, la Cour est très surprise du déroulement des faits survenus le 15 août 2004, date à laquelle la mère s’est présentée au poste de police. Elle s’étonne que les agents compétents l’aient laissée partir sans qu’elle ait rendu l’enfant, alors qu’elle l’avait déjà enlevé précédemment et qu’elle avait été sanctionnée à peine cinq mois auparavant, par la préfecture de Willisau, pour enlèvement d’un mineur au sens du code pénal suisse.
A ce sujet, la Cour n’estime pas suffisamment étayée l’allégation du gouvernement suisse d’après laquelle l’arrestation de la mère n’aurait pas constitué une mesure envisageable compte tenu des risques pour la santé de l’enfant. La simple promesse de la mère selon laquelle elle restituerait l’enfant une fois que le Tribunal fédéral aurait statué sur le recours qu’elle envisageait d’introduire contre la décision du tribunal supérieur du 12 juillet 2004 n’est pas non plus, d’après la Cour, une raison justifiant la passivité des autorités avant, pendant et après les contacts du 15 août 2004. De même, la Cour ne juge pas convaincant l’argument du gouvernement défendeur selon lequel le temps dont elles disposaient au moment de l’interrogatoire de la mère n’aurait pas permis aux autorités de préparer sa mise sous surveillance. Il convient de rappeler à ce sujet, premièrement, que c’est la police cantonale elle-même qui avait convoqué la mère à l’interrogatoire, seulement cinq jours auparavant ; deuxièmement, que la mère avait préalablement avisé la police, par téléphone, qu’elle se rendrait au poste ; troisièmement, que la rencontre a incontestablement duré quarante minutes.
99. Compte tenu de ce qui précède, la Cour admet que les autorités du canton de Lucerne ont entrepris, à partir de septembre 2004, de multiples démarches afin de localiser la mère et son fils. Elle estime néanmoins que leur attitude, entre l’enlèvement de l’enfant et leur dernier contact avec la mère, le 15 août 2004, témoigne dans l’ensemble d’un certain laxisme, qui ne cadre ni avec l’objet et le but de la Convention de La Haye, ni avec son libellé particulièrement clair et rigoureux.
Cette passivité est à l’origine de la rupture totale des relations entre l’enfant et son père, qui dure depuis près de deux ans et qui comporte, vu le très jeune âge de l’enfant, le risque d’une « aliénation » croissante entre les deux, aliénation qui n’est aucunement à considérer comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, mutatis mutandis, Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 79, CEDH 2002-I).
Il s’ensuit qu’on ne saurait prétendre que le droit au respect de la vie familiale du requérant a été protégé de manière effective, comme le prescrit la Convention.
100. Dès lors, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention."
B. c. BELGIQUE du 10 juillet 2012 Requête n° 4320/11
LE RENVOI D'UN ENFANT AUX USA PRES DU PERE SERAIT A LA LUMIERE DES CIRCONSTANCES UNE VIOLATION
51. La Cour considère que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et n’a relevé aucune autre motif d’irrecevabilité. Elle doit donc être déclarée recevable.
52. Sur le fond, la Cour constate d’emblée que, pour les requérantes, continuer à vivre ensemble est un élément fondamental qui relève à l’évidence de leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, lequel est donc applicable en l’espèce (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 44, série A no 290).
53. La Cour remarque qu’il ne prête pas à controverse que le retour de l’enfant ordonné par les juridictions belges constituait une « ingérence » dans le chef des deux requérantes, au sens du paragraphe 2 de l’article 8 (voir, dans le même sens, Neulinger et Shuruk, précité, § 90).
54. La Cour note qu’il n’est pas non plus contesté que la mesure litigieuse était « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention et que la base légale résidait dans la Convention de La Haye (articles 2 et 3), traité en vigueur en Belgique et ayant effet direct en droit belge. Lors du départ des requérantes pour la Belgique, l’autorité parentale était en effet exercée de manière conjointe par les deux parents et la garde était partagée en application des décisions judiciaires américaines. Par ailleurs, la décision de la Circuit Court d’Alachua du 16 mai 2008 avait interdit expressément que l’un des parents quitte le pays sans l’accord de l’autre ou sans la permission du juge. Or, ceux-ci n’avaient pas été obtenus par la première requérante quand elle quitta les Etats-Unis avec sa fille, ce qui rendait l’enlèvement illicite au sens de la convention précitée.
55. Il appartient donc à la Cour de rechercher si la mesure litigieuse poursuivait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique au sens du paragraphe 2 de l’article 8.
1. Rappel des principes généraux applicables en la matière
56. La Cour a constamment souligné qu’en matière d’enlèvement international d’enfants, les obligations que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats devaient être interprétées à la lumière des exigences imposées par la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant ainsi que de celles de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, tout en tenant compte de la nature différente de ces traités (Neulinger et Shuruk, précité, § 132 et les références citées).
57. L’interaction entre ces instruments a plusieurs facettes. D’une part, la Convention de New York oblige les Etats parties à prendre des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d’enfants à l’étranger et ces Etats sont invités à conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux ou à adhérer aux accords existants – dont la Convention de La Haye (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 71, 6 décembre 2007).
58. D’autre part, la notion « d’intérêt supérieur de l’enfant », qui est au cœur de la protection offerte par la Convention de New York, entre également en jeu dans l’application de la Convention de La Haye malgré son caractère essentiellement procédural (Neulinger et Shuruk, précité, § 145). Cet instrument, en son Préambule et son article 1er, part de la présomption qu’un déplacement ou non-retour illicite est nuisible aux enfants. Il envisage l’intérêt objectif de ceux-ci à ne pas être déplacés par voie de fait, à un retour immédiat au statu quo ante et à ce que les décisions relatives à leur garde et au droit de visite soient prises dans leur pays de résidence habituelle. L’article 13 prévoit des exceptions au retour immédiat notamment en cas de « risque grave » que le retour n’expose les enfants à un « danger physique ou psychique » (alinéa 1er, b).
59. L’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant s’apprécie à l’évidence au cas par cas et l’examen de la question de savoir si l’enfant serait confronté à un risque grave au sens de l’article 13 alinéa 1er b) de la Convention de la Haye revient, en premier lieu, aux autorités nationales qui ont souvent le bénéfice de contacts directs avec les intéressés et qui jouissent, pour ce faire, d’une certaine marge d’appréciation (ibidem, § 138).
60. Ce postulat repose sur le principe général de subsidiarité du rôle de la Cour à qui il appartient de contrôler la procédure suivie par les juridictions internes afin de rechercher si, dans l’application et l’interprétation des dispositions de la Convention de La Haye, elles ont respecté les garanties de l’article 8 de la Convention (ibidem, § 133, Šneersone et Kampanella c. Italie, no 14737/09, § 85, 12 juillet 2011), étant entendu que la Cour s’abstiendra de remettre en question l’appréciation de la situation faite par les juridictions internes à moins que celle-ci apparaisse clairement arbitraire (Raban c. Roumanie, no 25437/08, § 38, 26 octobre 2010).
61. Dans ce domaine, le point décisif au regard de l’article 8 consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents présents – ceux de l’enfant, des deux parents entre eux et ceux de l’ordre public – a été ménagé par les juridictions internes dans les limites de leur marge d’appréciation (Maumousseau et Washington, précité, § 62). Dans cet exercice, une importance particulière doit être accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant (Raban, précité, § 36) et l’intérêt des parents, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, doit être un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (Neulinger et Shuruk, précité, § 134).
62. Selon la Cour, au sens de l’article 8, tel qu’interprété à la lumière des instruments internationaux précités, l’intérêt de l’enfant présente un double aspect. D’une part, il implique que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne (Gnahoré, précité, § 59). D’autre part, il s’agit de garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain (voir, parmi d’autres, Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 50, CEDH 2000‑VIII, et Maršálek c. République tchèque, no 8153/04, § 71, 4 avril 2006).
63. Afin de déterminer si le processus décisionnel a respecté ces garanties, la Cour examine si les juridictions nationales se sont livrées, dans un délai raisonnable (Lipkowsky et McCormack c. Allemagne (déc.), no 26755/10, 18 janvier 2011), à un examen adéquat des implications concrètes du retour sur l’enfant.
64. Ainsi, la Cour a considéré que les juridictions internes avaient dûment pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant en envisageant la solution la moins préjudiciable à l’enfant et en ordonnant une solution alternative, à savoir : que l’enfant soit retourné avec le parent ravisseur afin que celui-ci continue à être présent auprès de l’enfant (Lipkowsky et McCormack, décision précitée). A l’inverse, elle a jugé que l’intérêt supérieur de l’enfant n’avait pas été suffisamment pris en compte par les juridictions qui n’avaient pas analysé les dangers potentiels, sur le plan psychologique, d’un retour sur l’enfant pourtant mentionnés dans des expertises produites devant elles (ibidem, § 95, voir également Karrer c. Roumanie, no 16965/10, §§ 46 et 47, 21 février 2012).
65. De la même manière, la Cour s’estime tenue de prendre en considération les éléments apparus postérieurement aux décisions des juridictions internes en raison de l’écoulement du temps, y compris de la durée de la procédure devant elle. Ce fut le cas dans l’affaire Neulinger et Shuruk précitée dans laquelle elle constata que l’enfant résidait en Suisse depuis quatre ans sans interruption au moment où elle statua, et y était parfaitement intégré. Soulignant que l’écoulement du temps avait indéniablement pour résultat d’affecter la pertinence de la Convention de La Haye (ibidem, § 145), elle conclut que le rétablissement du statu quo ante aurait sans doute eu des conséquences graves pour l’enfant, en particulier s’il était rentré tout seul, et ne pouvait être considéré comme bénéfique pour lui (ibidem, § 147).
2. Application des principes généraux en l’espèce
66. Les requérantes se plaignent que la cour d’appel de Gand, en ordonnant le retour de la deuxième requérante aux Etats-Unis, n’a pas examiné la situation familiale de manière approfondie et n’a pas mis en balance les intérêts des personnes en jeu ni fait primer l’intérêt supérieur de l’enfant, entraînant une ingérence disproportionnée dans leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
67. La Cour observe à titre préliminaire que les juridictions nationales saisies du dossier n’ont pas été unanimes quant à la suite à lui donner. Alors que le tribunal de première instance avait jugé que le retour de la deuxième requérante aux Etats-Unis ne pouvait se justifier en raison de l’article 13 de la Convention de La Haye, la cour d’appel ordonna le retour immédiat de l’enfant, considérant qu’il n’y avait pas de preuve d’un risque grave de danger ou de situation intolérable pour l’enfant dans l’hypothèse d’un retour aux Etats-Unis. Ce faisant, la cour d’appel ne suivit pas l’avis du ministère public qui, soupçonnant un risque de « situation intolérable », avait recommandé de procéder à des investigations supplémentaires et s’était prononcé contre le retour.
68. La Cour relève ensuite que, devant la cour d’appel de Gand, chaque partie a été entendue, le père étant intervenu dans la procédure, et a pu défendre sa position sur la base de conclusions écrites. En outre, la cour d’appel avait à sa disposition des rapports d’expertise psychologique relatifs à l’enfant, versés au dossier par la première requérante, ainsi qu’une vidéo filmée à l’occasion d’une rencontre en Belgique entre l’enfant et le père. La cour a rendu un arrêt longuement motivé dans lequel elle a envisagé tous les arguments soulevés par les parties.
69. Comme rappelé dans les principes généraux, il appartient à la Cour de se concentrer sur le processus décisionnel et de vérifier si la cour d’appel a procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts de chacun, avec le souci constant de déterminer quelle est la meilleure solution pour l’enfant enlevé.
70. Premièrement, la Cour relève que, d’après les rapports d’expertise psychologique dont disposait la cour d’appel, l’intérêt de l’enfant commandait de ne pas l’éloigner de sa mère au motif que celle-ci était la seule personne de référence sur le plan affectif et qu’un tel éloignement pourrait avoir des conséquences néfastes sur le développement psychologique de l’enfant (paragraphes 24 et 27). Dans le rapport établi postérieurement au jugement du tribunal de première instance, la psychologue H.S.W. souligne le danger que représenterait un retour forcé aux Etats-Unis d’autant que le père s’était vu confier la garde exclusive de l’enfant à la suite de l’enlèvement (paragraphe 27).
71. Ces rapports ont été examinés par la cour d’appel qui, tout en prenant acte que le père n’avait pas joué de rôle durant les quatre premières années de vie de l’enfant et que la mère était la personne de référence pour elle, les rejeta. Les motifs tenaient, en substance, à ce que ces rapports avaient été établis unilatéralement par la mère et que la vidéo filmée à l’occasion de la rencontre père-fille, bien que « non déterminante », ne faisait pas apparaître de problème manifeste entre eux (point 2.2.6. de l’arrêt, paragraphe 32).
72. Selon la Cour, il relevait à l’évidence de la marge d’appréciation de la cour d’appel de ne pas accorder plein crédit aux expertises psychologiques versées au dossier par l’une des parties. Toutefois, elle constate que la cour d’appel n’a pas cherché à vérifier elle-même, au moyen d’autres expertises qu’elle aurait commanditées et comme le lui recommandait le ministère public, la réalité des risques évoqués dans ces rapports que l’enfant soit exposée à une « situation intolérable » (voir, dans le même sens, Šneersone et Kampanella, précité, § 95). La Cour constate qu’il s’agit là d’une lacune d’ordre procédural qui distingue la présente espèce de la récente affaire M.R. et L.R. c. Estonie (déc., no 13420/12, 15 mai 2012), dans laquelle les juridictions estoniennes avaient à leur disposition, outre plusieurs rapports d’expertise psychologique soumis par les parties, l’avis d’un expert psychothérapeute désigné par voie judiciaire. A cela s’ajoutaient les informations et investigations menées dans le pays où résidait l’enfant avant son enlèvement qui apportaient un éclairage sur la situation familiale (§§ 44 et 45). Or, en l’espèce, de telles informations n’étaient pas disponibles à défaut pour les juridictions américaines d’avoir ordonné une quelconque expertise à ce sujet (paragraphes 7 à 21).
73. Deuxièmement, la Cour remarque que, contrairement au tribunal fédéral dans l’affaire Neulinger et Shuruk précitée, la cour d’appel n’a pas fondé sa décision sur « la considération qu’en l’absence de motifs qui justifieraient objectivement un refus de la mère de rentrer [aux Etats-Unis], on pouvait raisonnablement attendre de celle-ci qu’elle retourne dans cet Etat avec l’enfant » (§ 144, voir également Lipkowsky et McCormack, décision précitée). Elle ne s’est pas non plus appuyée, comme l’avaient fait les juridictions françaises dans l’affaire Maumousseau et Washington précitée, sur la possibilité pour la mère d’accompagner son enfant aux Etats-Unis pour y faire valoir ses droits de garde et de visite (§ 74, voir également M.R. et L.R., décision précitée, § 48). Au contraire, la cour d’appel est simplement partie du constat selon lequel il était invraisemblable que la mère retourne aux Etats-Unis où elle encourait une peine d’incarcération et la perte de son autorité parentale (point 2.2.5. de l’arrêt, paragraphe 32).
74. Troisièmement, s’agissant de la situation de la deuxième requérante en Belgique, la Cour note que l’enfant, qui a la double nationalité, y est arrivée en octobre 2008 à l’âge de cinq ans et y réside depuis sans interruption. Il n’est pas contesté qu’elle parle le néerlandais et est parfaitement intégrée dans son cadre de vie et son milieu scolaire. Au moment où la cour d’appel a statué, la deuxième requérante était donc déjà depuis plus de deux ans en Belgique. La cour d’appel a envisagé ce facteur « temps » uniquement sous l’angle procédural en constatant qu’elle n’aurait été tenue de prendre en compte l’intégration de l’enfant en Belgique que si la demande de retour avait été faite après un délai d’un an, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (point 2.2.6. de l’arrêt, paragraphe 32).
75. S’est ensuite encore écoulé un délai de onze mois avant que la Cour de cassation se prononce. Tout en reconnaissant que le maintien de l’enfant en Belgique durant cette dernière période résultait de l’indication d’une mesure provisoire visant à suspendre son retour vers les Etats-Unis (paragraphe 35), la Cour rappelle avoir souligné dans l’affaire Neulinger et Shuruk précitée (§§ 145 à 147) l’importance du facteur « temps » pour juger du respect de l’article 8. Ces considérations s’appliquent en l’espèce et, selon la Cour, déjà devant la cour d’appel, le facteur « temps » était un élément crucial qui devait être pris en considération pour investiguer de manière plus approfondie les implications concrètes du retour. Il ne fait aucun doute à la Cour que la cour d’appel a eu le temps matériel d’y procéder.
76. En conclusion, à la lumière de tout ce qui précède, la Cour considère que la cour d’appel n’était pas en mesure de déterminer, de manière éclairée, s’il existait un risque au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye et que le processus décisionnel en droit interne n’a donc pas satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8 de la Convention. Il en résulte, de l’avis de la Cour, que le retour forcé de la deuxième requérante aux Etats-Unis ne saurait être considéré comme étant nécessaire dans une société démocratique.
77. En conséquence, la Cour conclut qu’il y aurait violation de l’article 8 de la Convention si la décision ordonnant le retour de la deuxième requérante était exécutée.
Arrêt RAW C. France du 7 mars 2012, requête n° 10131/11
76. En premier lieu, la Cour souligne que les liens entre la première requérante et ses enfants ainsi qu’entre ces derniers relèvent de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Cela n’a d’ailleurs pas prêté à controverse.
77. Ensuite, elle constate qu’en réalité, les requérants ne se plaignent pas d’une « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie familiale, au sens du second paragraphe de l’article 8 de la Convention, mais d’un manquement des autorités françaises à assurer le retour de D. et A. en Grande-Bretagne pour les réunir. Elle juge donc inappropriée l’approche des parties, fondée sur l’hypothèse de l’existence d’une « ingérence » de ce type, et consistant à vérifier si elle est « prévue par la loi », poursuit l’un des buts légitimes énumérés par ce paragraphe et est « nécessaire » « dans une société démocratique » pour l’atteindre.
78. Cela étant, la Cour rappelle que, si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre aussi des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000‑I).
79. S’agissant de l’obligation pour l’Etat d’arrêter des mesures positives, l’article 8 implique non seulement le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant (ibidem) mais aussi le droit de l’enfant à des mesures propres à le réunir à son parent (voir, par exemple, Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, § 56, CEDH 2003‑V).
80. Cette obligation des autorités nationales n’est toutefois pas absolue, car il arrive que la réunion d’un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l’autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration. Une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre (voir, parmi d’autres, Ignaccolo-Zenide, précité, § 94).
Il y a lieu de plus de garder à l’esprit dans ce contexte que l’intérêt supérieur de l’enfant s’oppose en règle générale à ce que des mesures coercitives soient prises à son encontre (voir notamment Ignaccolo-Zenide précité, § 106, et Maire c. Portugal, no 48206/99, § 76, CEDH 2003‑VII). Il peut en outre parfois commander que l’enfant ne soit pas séparé du parent avec lequel il se trouve ou qu’il ne soit pas retourné au parent qui le réclame (voir en particulier Neulinger et Shuruk précité).
81. Selon la Cour, ces considérations valent aussi mutatis mutandis lorsqu’est en jeu le lien entre des membres d’une fratrie.
82. La Cour rappelle également que la Convention doit s’appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme. S’agissant plus précisément des obligations positives que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent à ses enfants, elles doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (voir, parmi d’autres, Ignaccolo-Zenide précité, § 95) et de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (voir, par exemple, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 72, CEDH 2003‑VII), qui mettent notamment l’accent sur le caractère primordial de l’intérêt de l’enfant (voir Neulinger et Shuruk, précité, §§ 49-56 et 137, et Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, § 83, CEDH 2011 (extraits)).
83. Enfin, la Cour réaffirme qu’un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parents et enfants ne se règlent pas par le simple écoulement du temps, mais sur la base de l’ensemble des éléments pertinents ; elle peut donc aussi avoir égard, sur le terrain de l’article 8, au mode et à la durée du processus décisionnel. Ainsi a-t-elle souligné que, dans les affaires de ce type, l’adéquation des mesures prises par les autorités se juge en particulier à la rapidité de leur mise en œuvre, le passage du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux. La Convention de La Haye prévoit d’ailleurs un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant, et son article 11 précise que les autorités judicaires ou administratives saisies doivent procéder d’urgence en vue de ce retour (voir, notamment, précités, Ignaccolo-Zenide, § 102, Maire, § 74, et Karoussiotis, §§ 84-91, et Monory c. Roumanie et Hongrie, no 71099/01, §§ 82-84, 5 avril 2005).
84. Le point décisif en l’espèce consiste donc à savoir si les autorités françaises ont pris, pour assurer le retour de D. et A., « toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles » ou, autrement dit, si elles ont pris « les mesures nécessaires et adéquates » à cette fin (voir, parmi d’autres, Ignaccolo-Zenide précité, §§ 96 et 101).
85. La Cour relève la rapidité avec laquelle les autorités françaises ont réagi une fois le mécanisme prévu par la Convention de La Haye déclenché. L’autorité centrale de l’Angleterre et du Pays de Galles a transmis la demande de retour formulée le 12 janvier 2009 par la première requérante à l’autorité centrale française le 13 janvier 2009, qui, dès le 14 janvier 2009, l’a adressée au parquet général de Poitiers aux fins de saisine du juge aux affaires familiales. Le procureur de la République de Poitiers a alors, le 20 janvier 2009, assigné le père de D. et A. devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers pour voir ordonner leur retour en Grande-Bretagne. Une audience a eu lieu le 23 janvier 2009 et, le 2 février 2009, le juge a ordonné le retour de D. et A. en Grande-Bretagne dans les soixante-douze heures, sous astreinte, cette décision étant exécutoire à titre provisoire. Dès le 4 février 2009, le Procureur de la République de La Roche-sur-Yon a reçu leur père pour lui rappeler les termes de cette ordonnance et l’inciter à assurer leur retour au Royaume-Uni. Le 10 mars 2009, le premier président de la cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée le 23 févier 2009 par le père, qui avait interjeté appel le 5 février 2009.
86. La Cour juge par ailleurs approprié, au vu notamment du rapport du 3 février 2009 établi à la demande du juge des enfants de La Roche-sur-Yon (paragraphe 14 ci-dessus), que les autorités aient attendu que la question de l’application de l’article 13 de la Convention de La Haye soit définitivement tranchée avant de s’impliquer entièrement dans le retour de D. et A. en Grande-Bretagne auprès de leur mère. L’intérêt supérieur des enfants commande aussi une certaine prudence de la part des autorités lorsque des éléments concrets – tels que ceux mis en lumière dans ce rapport – donnent à penser que leur retour pourrait leur être préjudiciable.
87. La Cour constate de plus que, par la suite, après l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 16 avril 2009, dans un premier temps du moins, les autorités françaises ont déployé divers moyens pour convaincre le père de D. et d’A. de coopérer à l’organisation de leur retour en Grande-Bretagne. Une réunion fut organisée à cette fin par le procureur de la République le 22 avril 2009. Une autre réunion eut lieu le 6 mai 2009, à laquelle participèrent également un intervenant social membre du service d’aide à la médiation internationale familiale et, par visioconférence, un magistrat anglais, qui expliqua précisément le statut de protection dont les enfants bénéficieraient en Grande-Bretagne, indiquant en particulier qu’un administrateur ad hoc et un avocat seraient désignés. Répondant aux sollicitations du substitut du procureur, le père accepta de ramener ses fils en Grande-Bretagne, à condition qu’un service éducatif l’assiste pour leur expliquer les conditions de leur retour et qu’une reprise de contact avec leur mère soit organisée préalablement sous l’égide d’un service éducatif extérieur.
88. Une rencontre fut en conséquence organisée entre D. et A. et un intervenant social le 25 mai 2009 et, le lendemain, le procureur de la République reçut leur père et son avocat afin qu’ils lui précisent les conditions dans lesquels l’exécution de la décision de retour allait se réaliser.
89. L’entrevue médiatisée entre D. et A. et leur mère eut lieu dès le 4 juin 2009 au matin dans un lieu neutre, en présence de l’intervenant social susmentionné, de leur père, d’un éducateur et de la psychologue qui les avait déjà rencontrés. Il était prévu que l’après-midi, mère et fils partent ensemble en Grande-Bretagne. La tentative de reprise de contact échoua cependant, en raison de la réaction négative des enfants (paragraphes 25-29 ci-dessus).
90. Cet événement ayant grandement affecté D. et A. (paragraphes 30‑31 ci-dessus), la Cour juge compréhensible que le procureur général de la cour d’appel de Poitiers ait alors considéré qu’en l’état, leur retour en Grande-Bretagne auprès de leur mère ne pouvait être réalisé (paragraphe 32 ci-dessus).
91. L’autorité centrale française poursuivit néanmoins ses efforts, en collaboration avec l’autorité centrale d’Angleterre et du Pays de Galles. La Cour relève en particulier qu’elle coopéra activement à la mise en œuvre de la visioconférence ordonnée par la High Court of Justice, entre le père, le tuteur des enfants et le travailleur social désignés par cette juridiction, et qu’elle obtint de cette dernière qu’elle décide qu’à leur retour en Grande‑Bretagne, ils ne seraient pas remis à leur mère et n’auraient pas de contact avec elle et que, si leur père décidait de les accompagner, il pourrait rester à leurs côtés dans l’attente d’une évaluation de leur résidence temporaire (paragraphes 33-39 ci-dessus).
92. Cela étant, les autorités françaises se sont peu à peu désinvesties, face notamment au peu d’empressement du père à coopérer à la réalisation de cette visioconférence (paragraphes 38-39 ci-dessus). De l’aveu même du Gouvernement, aucune mesure de nature à favoriser l’exécution de l’arrêt du 16 avril 2009 ne fut prise entre l’automne 2009 et le 29 avril 2010, date à laquelle l’autorité centrale française invita vainement le père à prendre contact avec elle en vue d’une rencontre (paragraphe 40 ci-dessus), et il ne ressort pas du dossier que les autorités aient par la suite fait des démarches significatives.
93. La Cour ne met certes pas en cause le choix des autorités de privilégier la voie de la coopération et de la négociation, d’autant moins que l’article 7 de la Convention de La Haye met l’accent sur la nécessité de rechercher une solution amiable. Elle estime en outre que la décision du procureur général près la cour d’appel de Poitiers de ne pas procéder à l’exécution forcée de l’arrêt du 16 avril 2009 (prise en juin 2009 et réitérée en avril et en août 2010 ; paragraphes 32 et 42-43 ci-dessus) et la décision du préfet du 19 août 2009 de refuser le concours de la force publique (paragraphe 37 ci-dessus), fondées en particulier sur l’intérêt de D. et A., gravement troublés par la situation, ne sont pas critiquables (paragraphes 30 et 31). Comme elle l’a souligné précédemment, l’intérêt supérieur des enfants s’oppose en règle générale à ce que des mesures coercitives soient prises à leur encontre. La Cour estime cependant que des mesures de cette nature auraient pu être prises à l’encontre de leur père, afin de l’inciter à coopérer d’avantage. A cet égard, elle ne s’explique pas pourquoi les autorités françaises compétentes n’ont pas donné suite à la plainte pour non-représentation d’enfants déposée par la première requérante le 17 mars 2009 (paragraphe 22 ci-dessus) une fois qu’il pouvait être considéré que la voie de la coopération et de la négociation n’aboutirait pas.
94. La Cour n’ignore pas que l’une des difficultés auxquelles les autorités se sont heurtées en l’espèce tient de l’attitude des enfants eux‑mêmes, qui ont clairement manifesté leur refus de retourner en Grande‑Bretagne auprès de leur mère. Elle estime toutefois que cette attitude n’était pas nécessairement immuable, ce dont atteste le fait que, le 11 décembre 2010, A. a volontairement quitté la maison paternelle pour rejoindre sa mère (paragraphe 44 ci-dessus). Elle observe en outre que, dans le cadre de l’application de la Convention de La Haye et du Règlement de Bruxelles II bis, si le point de vue des enfants doit être pris en compte, leur opposition ne fait pas nécessairement obstacle à leur retour.
95. Eu égard à ce qui précède, et nonobstant la marge d’appréciation dont dispose l’Etat défendeur en la matière (paragraphe 78 ci-dessus), la Cour conclut que les autorités françaises n’ont pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 16 avril 2009 ordonnant le retour de D. et A. en Grande-Bretagne. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
X C. Lettonie requête 27853/09 du 26 novembre 2013
L'Article 8 de la Convention doit être appliquée à la lumière de la Convention de la Haye. Par conséquent, en matière d'Enlèvement international d’enfant, un retour dans le pays d’origine n'est possible que s'il y a un examen effectif des allégations de « risque grave » pour l’enfant
La Cour relève d’emblée que la décision de retour de l’enfant en Australie a constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Cette ingérence était prévue par la loi. Certes, la requérante soutient que la Convention de La Haye ne pouvait pas s’appliquer dès lors qu’elle élevait seule sa fille au moment de son départ d’Australie. La Cour relève cependant que cette question, qui relève de la seule compétence des juridictions nationales, a été expressément examinée par les juges lettons, lesquels ont constaté qu’un juge australien avait confirmé la parenté et les droits de T à l’égard de l’enfant. Par ailleurs, la Cour estime que cette ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits de l’enfant et de son père.
Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle que les différents textes internationaux doivent faire l’objet d’une application combinée et harmonieuse, sans opposition ou confrontation entre les différents traités, sous réserve que la Cour puisse assurer sa mission, à savoir veiller au respect des engagements des Etats parties à la Convention, par une interprétation de celle-ci qui assure des droits concrets et effectifs.
La Cour relève ensuite l’existence d’un large consensus autour de l’idée que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer dans les décisions le concernant. Cet intérêt ne se confond pas avec celui de ses parents et, lorsqu’il concerne une demande de retour faite en application de la Convention de La Haye – question distincte du droit de garde –, il doit être apprécié à la lumière des exceptions prévues par la Convention de La Haye, en particulier s’agissant de l’écoulement du temps (article 12)
et l’existence d’un « risque grave » (article 13 b). Cette tâche revient aux autorités nationales, qui jouissent d’une marge d’appréciation à cette fin. La Cour exerce quant à elle un contrôle qui consiste à vérifier, sans substituer son appréciation à celle des autorités internes, si le processus décisionnel qui a conduit à prendre la décision de retour de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle était équitable et respectueux de son intérêt supérieur.
Ainsi, au regard de l’article 8 de la Convention, si les juridictions internes saisies d’une demande de retour n’ont pas à se livrer, contrairement à ce qui a pu être soutenu, à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale, elles doivent néanmoins respecter une double obligation procédurale : d’une part, en examinant les allégations de «risque grave» pour l’enfant en cas de retour, ce qui doit ressortir d’une décision motivée sur ce point ; d’autre part, en s’assurant que les garanties adéquates sont prévues dans l’Etat de résidence habituelle (l’Australie en l’espèce), notamment avec des mesures de protection concrètes en cas de risque avéré.
En l’espèce, la Cour constate que moins d’un an s’est écoulé entre le départ de l’enfant d’Australie et la demande de retour dans ce pays, ce qui impliquait dès lors un retour immédiat. Toutefois, elle note que, devant la cour régionale de Rīga, la requérante a produit un certificat rédigé par un psychologue après le jugement de première instance, dont il ressortait notamment qu’une séparation immédiate de l’enfant avec sa mère était à exclure en raison d’un risque de traumatisme psychologique pour l’enfant. Aux yeux de la Cour, les juges internes ne pouvaient écarter cette expertise au motif qu’elle concernait non pas la demande de retour dont ils étaient saisis, mais relevait d’une question de fond sur le droit de garde étrangère à la procédure en cours : en effet, l’expertise dénonçait un risque de traumatisme psychologique directement lié à l’intérêt supérieur de l’enfant et constituait une allégation défendable de « risque grave », qu’il fallait donc examiner à la lumière de l’article 13 b) de la Convention de la Haye, à l’instar de la question de savoir si la requérante pouvait suivre sa fille en Australie et maintenir le contact avec elle. La nécessité d’agir à bref délai, certes également prévue par la Convention de la Haye, ne pouvait exonérer les autorités lettones d’un examen effectif d’une telle allégation.
En conclusion, la Cour estime qu’en refusant d’examiner une attestation émanant d’un professionnel et faisant apparaître l’existence possible d’un « risque grave » pour l’enfant au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye, les autorités lettones ont failli à leurs obligations procédurales. En conséquence, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
López Guió c. Slovaquie du 3 juin 2014 requête n° 10280/12
Violation de l'article 8 : Les tribunaux slovaques ont privé un père de ses droits procéduraux dans une affaire d’enlèvement international d’enfant
Les faits
La Cour constitutionnelle intervint en décembre 2011 et annula l’arrêt de la Cour suprême qui exigeait le retour de l'enfant en Espagne.
La décision ordonnant le retour s’en trouva annulée et l’affaire fut renvoyée, pour une nouvelle procédure relevant de la Convention de La Haye, devant les juridictions ordinaires. Ces dernières jugèrent finalement en août 2012 que l’enfant ne devait pas revenir en Espagne, au motif que cette mesure ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant étant donné que ce dernier – alors âgé de trois ans – était attaché à la mère et intégré au cercle familial élargi en Slovaquie, avait été inscrit dans un jardin d’enfants là-bas et ne parlait que le slovaque.
La CEDH
La Cour constate que la principale ingérence dans le droit de M. López Guió au respect de sa vie familiale est imputable non pas à une action ou une omission de l’État slovaque mais plutôt à la mère de son enfant, qui – comme les tribunaux slovaques l’ont conclu – retenait illicitement l’enfant en Slovaquie. Elle doit donc rechercher si l’État slovaque avait l’obligation de prendre des mesures visant à garantir le droit de M. López Guió au respect de sa vie familiale et, dans l’affirmative, si cette obligation a été respectée.
À la fois État membre de l’Union européenne et partie à la Convention de La Haye (sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants), la Slovaquie – en tant que pays où l’enfant a été déplacé – avait l’obligation de conduire une procédure aux fins du retour de l’enfant dans le pays de sa résidence habituelle, l’Espagne, afin que les tribunaux espagnols statuent sur toutes les questions touchant la situation de l’enfant. Sur ce point, la Cour constate que les parties ont plaidé l’affaire sur le seul terrain de la Convention de La Haye et que les tribunaux internes ont tranché le litige essentiellement sous l’angle de cet instrument.
Pour déterminer si, dans l’exercice de ses obligations découlant de la Convention de La Haye, la Slovaquie a satisfait à ses obligations positives tirées de l’article 8 de la Convention, il est essentiel de rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents en jeu, l’intérêt supérieur de l’enfant étant primordial.
La décision de la Cour constitutionnelle slovaque qui a cassé l’arrêt antérieurement rendu par la Cour suprême – puis conduit à l’annulation de la décision ordonnant le retour de l’enfant en Espagne et le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance – était essentielle dans le règlement définitif de l’affaire concernant M. López Guió. Bien que non définitive, elle a beaucoup retardé la procédure, ce qui est crucial dans les affaires touchant le droit de la famille.
La Cour estime que la décision de la Cour constitutionnelle était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection des droits de l’enfant. Quant au statut procédural de M. López Guió, elle constate cependant que ce dernier n’était ni demandeur ni défendeur dans le recours constitutionnel. Les dispositions légales pertinentes régissant ce type de recours ne donnent pas clairement aux tiers les moyens d’intervenir ou d’être informés de la procédure devant une juridiction qu’ils peuvent saisir. De plus, M. López Guió n’a pas été avisé, pendant la période considérée, du recours constitutionnel introduit par la mère de l’enfant. Il n’a donc pas été associé à la procédure et n’a eu aucune possibilité d’influer sur son issue, alors qu’il pouvait se prévaloir en l’espèce d’un intérêt légitime.
Cette absence totale de protection procédurale est aggravée par le fait que, avant l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires que la mère de l’enfant pouvait emprunter pour s’opposer à l’ordonnance de retour avaient été épuisées. De plus, des éléments indiquent qu’il pourrait exister un problème systémique étant donné que les recours ordinaires et extraordinaires en cassation sont ouverts en Slovaquie dans les procédures de retour.
Le renvoi de l’affaire devant les juridictions de droit commun étant à l’origine de nouvelles lenteurs, la situation de l’enfant n’a pas pu être judiciairement tranchée pendant une longue période, les tribunaux slovaques étant incompétents et les tribunaux espagnols n’ayant pas eu la possibilité pratique de statuer. Cette situation ne pouvait donc être dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Au vu de ces éléments, la Cour conclut que la Slovaquie n’a pas garanti à M. López Guió le droit au respect de sa vie familiale en lui ouvrant, aux fins du retour de son enfant, un recours conforme aux exigences de l’article 8. Il y a donc eu violation de cette disposition.
Rouiller C. Suisse du 22 juillet 2014 requête 3592/08
NON VIOLATION DE L'ARTICLE 8 : Quant on divorce, on ne peut pas vivre loin de son ex conjoint afin que les enfants puissent voir le père et la mère. L'ordonnance de retour en France des enfants installés en Suisse avec la mère est légitime.
33. La requérante soutient que le retour de ses enfants en France ordonné par la justice suisse constituait une violation de l’article 8 de la Convention. Elle fait notamment valoir que les enfants habitaient avec elle en Suisse depuis presque deux ans au moment où le Tribunal fédéral a rendu sa décision et qu’ils y étaient bien intégrés et scolarisés. Selon elle, c’est à tort que les tribunaux suisses se sont fondés sur la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants pour ordonner ce retour. La requérante ajoute que l’opinion des enfants n’a pas suffisamment été prise en compte. À cet égard, elle critique les juridictions supérieures qui, tout en reconnaissant l’insuffisance du compte-rendu établi par le tribunal de première instance, n’ont pas procédé à une nouvelle audition des enfants.
2. L’appréciation de la Cour
a) Ingérence
53. La Cour constate qu’il ne prête pas à controverse que le retour des enfants ordonné par le Tribunal fédéral constitue une « ingérence » dans la vie familiale de la requérante au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention (voir, dans ce sens, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, §§ 90 et 91, CEDH 2010).
54. Il convient donc de rechercher si l’ingérence litigieuse répond aux exigences du paragraphe 2 de l’article 8, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », motivée par un ou des buts légitimes et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
b) Justification de l’ingérence
i. Base légale
55. En l’espèce, la Cour relève que l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2007 se fonde sur la Convention de La Haye, qui est incorporée au droit suisse. Toutefois, la requérante conteste l’applicabilité de cet instrument en l’espèce car, d’après elle, l’éloignement des enfants du territoire français par elle n’était pas illicite. La Cour doit dès lors vérifier si la Convention de La Haye constituait une base légale valable pour ordonner le retour des enfants.
56. La Cour rappelle à titre liminaire que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne. Il en va de même lorsque le droit interne renvoie à des règles du droit international général ou à des accords internationaux. Le rôle de la Cour se limite à vérifier leur applicabilité et la compatibilité avec la Convention de l’interprétation qui en est faite (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I, et Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 72, CEDH 2008).
57. La Cour reconnaît que la requérante, bien que représentée par un avocat, n’a pas explicitement contesté, au niveau interne, avoir commis un enlèvement international. La Cour note toutefois que, saisis d’une demande de retour des enfants basée sur la Convention de La Haye, les tribunaux suisses ont examiné l’applicabilité de cet instrument au cas d’espèce et ont, quoique brièvement, répondu par l’affirmative à cette question. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il convient de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes (voir, dans ce sens, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 43, CEDH 2009).
58. La Cour rappelle que la Convention de La Haye ne s’applique qu’aux situations dans lesquelles il y a eu un enlèvement international d’enfant, formule recouvrant tout déplacement ou non-retour illicite au sens de l’article 3 de ladite convention.
59. Il convient d’observer que la notion de droit de garde, au sens de la Convention de La Haye, a une portée autonome dans la mesure où elle est appelée à s’appliquer à tous les États parties à ce traité international, dont les systèmes juridiques peuvent varier quant à la définition de cette notion (Neulinger et Shuruk, précité, § 102). Au sens de l’article 5 a) de cette convention, le « droit de garde » comprend « le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ».
60. En l’espèce, il ressort des termes du jugement de divorce du tribunal de grande instance de Mulhouse du 10 octobre 2000 que les parties avaient convenu que l’autorité parentale sur les enfants serait exercée en commun et que le tribunal avait fixé leur résidence principale chez la mère (paragraphe 8 ci‑dessus).
Les deux parties ayant contesté ce jugement, dans son arrêt du 24 janvier 2006 la cour d’appel de Colmar avait rejeté à la fois l’appel du père, en considérant que les enfants évoluaient bien dans leur situation actuelle et qu’il était opportun de ne pas modifier leur résidence habituelle chez leur mère, et l’appel de la mère, qui souhaitait se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale (paragraphe 9 ci‑dessus).
61. La Cour estime que le déplacement des enfants à Binningen, bien que cette localité ne soit distante que de quelques kilomètres, était susceptible d’avoir des conséquences non négligeables pour l’avenir des enfants, notamment leur scolarisation dans le système suisse et leur développement personnel dans un environnement culturel et social différent de celui qui était le leur en France. Partant, eu égard à l’exercice en commun de l’autorité parentale des deux parents, la mère ne pouvait pas, en l’absence de consentement du père, passer outre et modifier unilatéralement le pays de résidence habituelle des enfants. Par ailleurs, il n’existe aucun indice selon lequel le père n’aurait pas, avant le déplacement des enfants en Suisse, exercé de manière effective, au sens de la lettre b) de l’article 3, alinéa premier, de la Convention de La Haye, le droit de garde qu’il détenait conjointement avec la mère.
62. Compte tenu de ce qui précède, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour se prononcer sur la question, ne considère pas comme manifestement erroné ou arbitraire l’avis du Tribunal fédéral selon lequel le déplacement par la requérante de ses enfants vers la Suisse constituait bien un « déplacement illicite » au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye. Partant, étant donné que c’est en application de l’article 12 de ladite convention que le Tribunal fédéral a ordonné le retour des enfants, la mesure litigieuse reposait sur une base légale.
ii. But légitime
63. La Cour ne doute pas que l’ordre de retour émis par les instances internes avait pour but légitime de protéger les droits et libertés des enfants de la requérante et de leur père, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la requérante devant la Cour.
iii. Nécessité de l’ingérence dans une société démocratique
64. La requérante soutient en revanche, au moins en substance, que le retour des enfants n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
65. À cet égard, la Cour a rappelé certains principes dans son arrêt X c. Lettonie [GC], no 27853/09, 26 novembre 2013 :
« 106. La Cour estime que l’on peut parvenir à une interprétation harmonieuse de la Convention et de la Convention de La Haye (...) sous réserve que les deux conditions suivantes soient réunies. Premièrement, [il faut que] les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l’enfant en application des articles 12, 13 et 20 de ladite convention, notamment lorsqu’ils sont invoqués par l’une des parties, soient réellement pris en compte par le juge requis. Ce dernier doit dès lors rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, afin de permettre à la Cour de s’assurer que ces questions ont bien fait l’objet d’un examen effectif. Deuxièmement, ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l’article 8 de la Convention (...).
107. Par conséquent, la Cour estime que l’article 8 de la Convention fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale particulière à ce titre : dans le cadre de l’examen de la demande de retour de l’enfant, les juges doivent non seulement examiner [l]es allégations défendables de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour, mais également se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce. Tant un refus de tenir compte d’objections au retour susceptibles de rentrer dans le champ d’application des articles 12, 13 et 20 de la Convention de La Haye qu’une insuffisance de motivation de la décision rejetant de telles objections seraient contraires aux exigences de l’article 8 de la Convention, mais également au but et à l’objet de la Convention de La Haye. La prise en compte effective de telles allégations, attestée par une motivation des juridictions internes qui soit non pas automatique et stéréotypée, mais suffisamment circonstanciée au regard des exceptions visées par la Convention de La Haye, lesquelles doivent être d’interprétation stricte (Maumousseau et Washington [c. France, no 39388/05, 6 décembre 2007], § 73) est nécessaire. Cela permettra aussi d’assurer le contrôle européen confié à la Cour, dont la vocation n’est pas de se substituer aux juges nationaux.»
66. La requérante soutient que les enfants se sont opposés à leur retour en vertu de l’alinéa 2 de l’article 13 de la même convention. Dans ce contexte, notamment sous l’angle de l’obligation procédurale particulière découlant de l’article 8 de la Convention (X c. Lettonie, précité, § 107), se pose donc la question de savoir si, eu égard à leur âge et à leur maturité, leurs opinions respectives, surtout celle de F., qui avait indiqué préférer rester en Suisse, ont suffisamment été prises en compte par les autorités suisses.
67. Au vu des critères établis dans l’arrêt X c. Lettonie, précité, § 107, la Cour doit examiner si les juges internes ont effectivement pris en compte les allégations de la requérante et justifié leurs décisions au regard des exceptions visées par la Convention de La Haye par une motivation suffisamment circonstanciée – c’est-à-dire, appuyée sur les données de l’espèce –, tout en sachant que ces exceptions doivent être d’interprétation stricte.
68. En l’espèce, les juridictions suisses ont notamment fondé leurs décisions de non-retour (première instance) ou de retour (deuxième instance et Tribunal fédéral) sur le compte-rendu d’audition du 23 mai 2007, rédigé par le greffier du tribunal de district d’Arlesheim alors que la présidente du tribunal menait l’entretien avec l’enfant.
69. Le 19 mars 2014, à la demande de la Cour, la fille de la requérante a autorisé la Cour à consulter ledit compte-rendu (paragraphe 22 ci‑dessus).
En résumé, il ressortait de ce compte-rendu : que F. déclarait s’être bien intégrée à Binningen ; qu’elle y avait rencontré de nouveaux amis, sans totalement perdre le contact avec ses amis restés en France ; que ses résultats scolaires étaient généralement satisfaisants ; qu’elle craignait, dans l’éventualité d’un retour en France, de devoir intégrer une nouvelle école où elle ne connaîtrait personne ; et que, pour ces raisons, elle préférait rester à Binningen.
Pour le restant des déclarations figurant dans le compte-rendu, notamment lorsque celles-ci manquent manifestement de pertinence en l’espèce, la Cour respecte le souhait de confidentialité exprimé par la fille de la requérante.
70. En premier lieu, la Cour constate que la juridiction de première instance a rejeté la demande de retour, aux motifs notamment : qu’en l’espèce on ne pouvait parler d’un enlèvement d’enfants proprement dit ; qu’il s’agissait plutôt d’une violation du droit de garde, commise par la requérante à travers le fait qu’elle n’avait pas respecté l’opposition fermement exprimée par son ex-mari à un déplacement des enfants ; qu’il n’y avait jamais eu de véritable « enlèvement » et que le droit de visite du père n’avait jamais été compromis ; qu’au vu de ces circonstances très particulières, on pouvait s’interroger sur l’applicabilité de la Convention de La Haye en l’espèce ; et que lors de l’audition, sans être influencée par ses parents, F. avait clairement et sans équivoque déclaré qu’elle voulait rester à Binningen et qu’elle s’opposait à son retour en France (paragraphe 15 ci‑dessus).
71. Comme indiqué plus haut, l’avis du Tribunal fédéral et du tribunal cantonal de Bâle-Campagne, selon lequel le déplacement par la requérante de ses enfants vers la Suisse constituait bien un « déplacement illicite » (paragraphe 62), apparaît raisonnable.
72. Au vu des éléments du dossier, le tribunal cantonal de Bâle-Campagne – ou, à défaut, le Tribunal fédéral – aurait pu ordonner une nouvelle audition des enfants si d’éventuelles carences du compte-rendu l’avaient rendu opportun pour évaluer de façon suffisante la pertinence en l’espèce des exceptions au retour immédiat des enfants ménagées par la Convention de La Haye – sachant que cette opportunité devait s’apprécier en tenant compte, comme le souligne le Gouvernement à juste titre (paragraphe 51), des conséquences traumatisantes que de nouvelles auditions pouvaient avoir pour les enfants.
73. Ainsi, la Cour trouve également que l’avis du Tribunal fédéral et du tribunal cantonal de Bâle-Campagne, selon lequel la Convention de La Haye ne confère pas à l’enfant la possibilité de librement choisir l’endroit où il veut vivre, n’est pas arbitraire ou déraisonnable. Partant, la Cour estime que les motifs de la préférence exprimée par F. pour un maintien en Suisse (paragraphe 22 ci-dessus), selon le compte-rendu d’audition susmentionné, ne suffisaient pas pour qu’entrât en jeu l’une quelconque des exceptions au retour prévues par l’article 13 de la Convention de La Haye, compte tenu notamment que ces exceptions doivent être d’interprétation stricte (X c. Lettonie, précité, § 107).
74. Enfin, la Cour observe que les juridictions internes ont motivé leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée.
75. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les juges internes ont dûment pris en compte les allégations de la requérante et justifié leurs décisions par une motivation suffisamment circonstanciée au regard des exceptions posées par la Convention de La Haye.
76. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
GAJTANI C. SUISSE du 9 septembre 2014 Requête n°43730/07
Non violation de l'article 8 : Retour des enfants d'un couple divorcé vers le papa ou la maman. L'opinion des enfants est entendu par la juridiction de première instance. La Cour d'Appel n'a pas ensuite à les réentendre. Une audition est suffisamment pénible pour eux, alors que les parents ont tendance à manipuler les enfants pour se battre tranquillement, entre eux.
a. Base légale et buts légitimes de l’ingérence
101. La Cour constate à titre liminaire que l’existence d’une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale n’a pas été contestée par le Gouvernement.
102. La requérante, pour sa part, n’a jamais contesté – ni devant les instances internes, ni devant la Cour – que l’ingérence avait une base légale, à savoir la Convention de La Haye. Il ressort de la décision du tribunal d’appel du canton du Tessin que l’autorité parentale était détenue conjointement par les deux parents et il n’existe au cas d’espèce aucun élément permettant de penser qu’elle n’était pas exercée effectivement de la part du père. Selon le Gouvernement, non contredit par la requérante, ladite autorité comprenait notamment le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ainsi, elle doit être assimilée au « droit de garde » au sens de l’article 5 lettre a) de la Convention de La Haye (paragraphe 34 ci‑dessus).
Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne considère pas comme manifestement erroné ou arbitraire l’avis des tribunaux suisses et du Gouvernement selon lequel le déplacement par la requérante de ses enfants vers la Suisse constituait bien un « déplacement illicite » au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye.
103. La requérante n’a pas non plus contesté que la mesure litigieuse poursuivait des buts légitimes au sens de l’article 8 § 2. La Cour estime que la décision ordonnant le retour des enfants adoptée par le tribunal d’appel avait pour but légitime de protéger les droits et libertés des enfants et de leur père (voir, mutatis mutandis, Neulinger et Shuruk c. Suisse ([GC], no 41615/07, § 106, CEDH 2010).
104. Le grief principal de la requérante consiste à prétendre que le retour forcé des enfants était illicite et les mesures d’exécution disproportionnées, d’autant plus que les enfants se seraient vivement opposés à leur retour en ex-République yougoslave de Macédoine. Dans ce contexte, elle allègue plus particulièrement que l’opinion des enfants, en particulier du fils, n’a pas été suffisamment prise en compte. La Cour doit examiner ces questions au regard de la nécessité de la mesure dans une société démocratique.
b. Nécessité dans une société démocratique
105. Dans l’affaire X c. Lettonie [GC] (no 27853/09, arrêt du 26 novembre 2013), la Cour a fixé et réitéré dans les termes suivants les critères devant guider les autorités internes dans le processus décisionnel lorsqu’elles sont confrontées à une demande de retour d’enfants fondée sur la Convention de La Haye :
« 107. [L]a Cour estime que l’article 8 de la Convention fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale particulière à ce titre : dans le cadre de l’examen de la demande de retour de l’enfant, les juges doivent non seulement examiner des allégations défendables de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour, mais également se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce. Tant un refus de tenir compte d’objections au retour susceptibles de rentrer dans le champ d’application des articles 12, 13 et 20 de la Convention de La Haye qu’une insuffisance de motivation de la décision rejetant de telles objections seraient contraires aux exigences de l’article 8 de la Convention, mais également au but et à l’objet de la Convention de La Haye. La prise en compte effective de telles allégations, attestée par une motivation des juridictions internes qui soit non pas automatique et stéréotypée, mais suffisamment circonstanciée au regard des exceptions visées par la Convention de La Haye, lesquelles doivent être d’interprétation stricte (...), est nécessaire. Cela permettra aussi d’assurer le contrôle européen confié à la Cour, dont la vocation n’est pas de se substituer aux juges nationaux. »
106. S’agissant du cas d’espèce, la Cour précise que la seule question qui se pose ici est celle de savoir si les autorités compétentes ont suffisamment pris en compte les opinions des enfants. La requérante ne soutient par ailleurs pas que la procédure interne aurait été inéquitable pour d’autres raisons, ni que les décisions internes auraient été insuffisamment motivées ni qu’une pièce pertinente n’aurait pas dûment été prise en compte. La présente affaire se distingue dès lors de l’affaire X c. Lettonie, précitée, où l’allégation concrète d’un « risque grave », au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye, reposait sur une attestation émanant d’un expert dénonçant un risque de traumatisme psychologique pour l’enfant en cas de séparation immédiate d’avec sa mère (X c. Lettonie, précitée, § 114).
107. La Cour rappelle également que l’autorité de surveillance en matière de tutelle a dûment entendu le fils avant de prendre sa décision. Le tribunal d’appel a constaté, après avoir soigneusement examiné ses déclarations, qu’il n’était pas assez mûr pour que son refus catégorique de rentrer puisse être pris en compte. Le tribunal a trouvé que son comportement ne révélait pas une maturité suffisante pour que son opinion puisse être considérée comme suffisamment autonome. Il a remarqué son intention de préserver sa mère de sa responsabilité, surtout en ce qui concernait l’enlèvement. Cette juridiction a noté par ailleurs que l’enfant se trouvait pris dans un conflit de loyautés et qu’il craignait probablement de se couper de sa mère s’il reprenait contact avec son père.
108. La Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles (voir, parmi beaucoup d’autres, Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, § 33, série A no 235‑B). Elle souligne que, dans le cadre de l’application de la Convention de La Haye, si le point de vue des enfants doit être pris en compte, leur opposition ne fait pas nécessairement obstacle à leur retour (Raw et autres c. France, no 10131/11, § 94, 7 mars 2013). En outre, elle observe que la Convention de La Haye prévoit, dans son article 13 alinéa 3, que
« [l]’autorité judiciaire ou administrative peut [...] refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. »
Il ressort de la formulation de cet alinéa : d’une part, que les autorités ont certes la faculté de refuser le retour d’un enfant en cas d’opposition de sa part mais qu’il ne s’agit pas pour elles d’une obligation ; d’autre part, que l’appréciation de la question de savoir s’il est opportun de tenir compte de l’opinion d’un enfant enlevé appartient en premier lieu aux autorités internes, qui jouissent dans ce domaine d’une certaine latitude.
109. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’en matière d’enlèvement international d’enfants, les obligations que l’article 8 fait peser sur les États contractants doivent s’interpréter en tenant également compte de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (Neulinger et Shuruk, précité, § 132, et X c. Lettonie, précité, § 93), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997. Aux termes de son article 12 § 1, « [l]es États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et son degré de maturité. » Le paragraphe 2 de cette disposition précise en outre qu’« [o]n donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ».
110. Dans la mesure où elle est compétente pour trancher la question, la Cour ne considère pas comme déraisonnable la conclusion du tribunal d’appel selon laquelle l’on ne pouvait prendre en compte les déclarations du fils de la requérante dans la décision sur le retour des enfants. Elle estime que la décision de cette juridiction, intervenue sur la base de l’audition du fils par l’instance inférieure, est dûment appuyée sur une motivation circonstanciée (X c. Lettonie, précité, § 107).
111. Eu égard à la marge d’appréciation certaine dont jouissent dans ce domaine les autorités internes, qui sont mieux placées que la Cour, le tribunal d’appel pouvait raisonnablement considérer qu’il n’était ni nécessaire ni opportun d’entendre encore une fois le fils, d’autant plus que celui-ci se trouvait pris dans un conflit de loyautés et que de telles auditions peuvent avoir des impacts traumatisants pour un enfant et retarder considérablement la procédure.
112. Quant à la fille du couple, âgée alors de 5 ans, il n’apparaît pas qu’elle ait été entendue par les instances du canton du Tessin.
La Cour rappelle à cet égard que dans l’affaire Eskinazi et Chelouche (décision précitée), elle a souligné qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celles des juridictions nationales quant à l’adéquation d’une audition, procédé délicat, ni de contrôler l’interprétation et l’application faites des dispositions des conventions internationales, en l’occurrence les articles 13 de la Convention de La Haye et 12 § 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, sauf en cas d’arbitraire (position confirmée dans l’affaire Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 79, 6 décembre 2007). Il convient également de relever que dans la récente affaire X c. Lettonie, précitée, la Grande Chambre a entériné l’avis des instances lettones selon lequel le jeune âge de l’enfant – environ 4 ans à l’époque – l’empêchait d’exprimer valablement sa préférence quant à son lieu de résidence (§§ 112 et 22).
113. En l’espèce, la requérante n’allègue pas avoir demandé, devant les instances internes, une audition de sa fille et s’être heurtée à un refus. Elle ne prétend pas non plus qu’une audition était indispensable pour déterminer si l’une des exceptions au retour de l’enfant prévues par l’article 13 alinéa 1 lettre b) de la Convention de la Haye rentrait en jeu. La Cour observe par ailleurs que cette convention, notamment son article 13 alinéa 2, n’impose nullement aux autorités nationales d’entendre l’enfant.
114. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal d’appel ne saurait se voir reprocher son refus de prendre en compte l’opposition au retour manifestée, notamment, par le fils de la requérante. Dès lors, le processus décisionnel en droit interne a satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8.
115. Partant, l’ordre de retour des enfants n’apparaît pas disproportionné et il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention à cet égard.
SECRET DE LA CORRESPONDANCE ET DIVORCE
M.P. c. PORTUGAL du 7 septembre 2021 requête n° 27516/14
Art 8 • Vie privée • Correspondance • Obligations positives • Messages électroniques échangés par la requérante sur un site de rencontres produits sans son consentement par son ex-mari lors de procédures civiles • Art 8 applicable • Protection adéquate du cadre juridique pénal existant • Pertinence des messages uniquement divulgués dans le cadre des procédures avec accès restreint au public • Messages non examinés concrètement par le tribunal • Mise en balance des intérêts en jeu dans le respect de la jurisprudence de la Cour
a) Rappel des principes pertinents
39. La Cour rappelle que si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale. Ces obligations peuvent nécessiter l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, § 78, CEDH 2013, et Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 98, CEDH 2012). La responsabilité de l’État peut ainsi se trouver engagée si les faits litigieux résultent d’un manquement de sa part à garantir aux personnes concernées la jouissance des droits consacrés par l’article 8 de la Convention (Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, § 110, 5 septembre 2017, et Schüth c. Allemagne, no 1620/03, §§ 54 et 57, CEDH 2010). Si la frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au regard de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, l’État jouissant en toute hypothèse d’une certaine marge d’appréciation (Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 114, CEDH 2014 (extraits)).
40. Le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants. Il existe en effet plusieurs manières différentes d’assurer le respect de la vie privée, et la nature de l’obligation de l’État dépendra de l’aspect de la vie privée qui se trouve en cause (Söderman, précité, § 79, et Bărbulescu, précité, § 113).
41. La Cour a déjà jugé que, dans certaines circonstances, le respect des obligations positives qu’impose l’article 8 exige de l’État qu’il adopte un cadre législatif propre à protéger le droit en cause (López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 113, 17 octobre 2019, et les exemples qui y sont cités). Pour ce qui est des actes interindividuels de moindre gravité susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale, l’obligation qui incombe à l’État, au titre de l’article 8, de mettre en place et d’appliquer en pratique un cadre juridique adapté offrant une protection n’implique pas toujours l’adoption de dispositions pénales efficaces visant les différents actes pouvant être en cause. Le cadre juridique peut aussi consister en des recours civils aptes à fournir une protection suffisante (Söderman, précité, § 85). Il faut également garder à l’esprit que seules des défaillances suffisamment sérieuses dans la législation et la pratique, ainsi que dans leur application, emporteraient violation des obligations positives de l’État en vertu de l’article 8. La Cour ne saurait se substituer aux autorités internes dans l’appréciation des faits de la cause ; elle ne saurait non plus statuer sur la responsabilité pénale de l’agresseur allégué (voir M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 167-168, CEDH 2003‑XII)
42. Lorsque surgit un conflit entre deux droits également protégés par la Convention, il faut opérer une mise en balance des intérêts en jeu (Fernández Martínez, précité, § 123). Si les autorités nationales ont réalisé cette mise en balance dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011).
b) Application de ces principes à la présente espèce
43. La requérante se plaint que son ex-mari ait accédé à des messages électroniques qu’elle avait échangés sur un site de rencontres et qu’il les ait produits, sans son consentement, dans le cadre d’une part d’une procédure qu’il avait engagée en vue de la répartition de l’autorité parentale et, d’autre part, d’une procédure de divorce (paragraphe 32 ci-dessus). Elle reconnaît que le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne n’a finalement pas tenu compte de ces messages. Elle se plaint donc uniquement du fait que les juges n’aient pas sanctionné son mari pour les avoir divulgués. Elle estime qu’ils n’ont pas dûment mis en balance les intérêts qui étaient en jeu (paragraphe 36 ci-dessus).
44. Étant donné que la présente affaire porte sur une ingérence faite dans la vie privée de la requérante, non par l’État, mais par une personne privée, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner les griefs de l’intéressée sous l’angle des obligations positives qui incombent à l’État en vertu de l’article 8 de la Convention. À la lumière de sa jurisprudence, rappelée aux paragraphes 40‑42 ci-dessus, elle considère qu’il s’agit ici de savoir, premièrement, si le cadre juridique existant a permis à la requérante de faire valoir son droit au respect de sa vie privée et, deuxièmement, si les juridictions saisies de sa cause ont dûment mis en balance les intérêts en jeu.
45. En ce qui concerne le cadre juridique, elle note que le fait d’accéder au contenu de lettres ou de télécommunications sans le consentement des correspondants et le fait de divulguer le contenu ainsi obtenu sont sanctionnés pénalement (paragraphe 26 ci-dessus). Elle constate que, faisant suite à la plainte pénale déposée par la requérante pour violation de sa correspondance, le parquet près le tribunal de Lisbonne a ouvert une enquête (paragraphes 14-15 ci-dessus). Par ailleurs, à sa demande, la requérante a été autorisée à intervenir dans le cadre de la procédure pénale en qualité d’assistente, au titre de l’article 69 du CPP, ce qui lui a permis de jouer un rôle actif dans cette procédure (paragraphe 27 ci-dessus). Elle a ainsi eu, notamment, la possibilité de présenter ses moyens de preuve, puis de demander l’ouverture d’une instruction lorsque le parquet a décidé de classer l’affaire sans suite (paragraphes 15, 18 et 21 ci-dessus). Par ailleurs, elle aurait pu introduire une demande d’indemnisation lorsqu’elle a sollicité l’ouverture de l’instruction (paragraphe 28 ci-dessus), mais elle ne l’a pas fait (paragraphe 18 in fine ci-dessus). Elle a donc renoncé à cette possibilité, comme elle l’a d’ailleurs expressément indiqué dans son mémoire en appel devant la cour d’appel de Lisbonne (paragraphe 21 ci-dessus). Autrement dit, elle a exprimé le souhait de voir se poursuivre la procédure pénale ouverte pour violation de sa correspondance dans le seul but d’obtenir la reconnaissance de l’atteinte qu’elle estimait avoir été portée à ses droits (paragraphe 21 ci-dessus).
46. Au vu des constatations qui précèdent, la Cour est d’avis que le cadre juridique existant au Portugal offrait dans les cas tels que celui de la requérante une protection adéquate du droit au respect de la vie privée et au secret de la correspondance. La requérante n’affirme d’ailleurs pas le contraire. Il reste donc à déterminer si les juridictions saisies ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts qui étaient en jeu, à savoir, d’une part, le droit de la requérante au respect de sa vie privée et, d’autre part, le droit de son mari à bénéficier d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à la requérante (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, 27 octobre 1993, § 33, série A no 274, et Almeida Santos c. Portugal, no 50812/06, § 38, 6 octobre 2009) dans le cadre de deux procédures civiles qui, par leur nature même, touchaient à la vie privée du couple et de la famille (voir, mutatis mutandis, L.L. c. France, no ² 7508/02, § 45, 10 octobre 2006, et N.N. et T.A. c. Belgique, précité, § 46).
47. S’agissant de l’accès aux messages électroniques de la requérante, la Cour note que, dans son arrêt du 25 septembre 2013, la cour d’appel de Lisbonne a considéré que cette dernière avait donné à son mari un accès total à la messagerie qu’elle entretenait sur le site de rencontre et que, à partir de ce moment, ces messages faisaient partie de la vie privée du couple (paragraphe 24 ci-dessus). Elle estime que le raisonnement tenu par les autorités internes quant à l’accès mutuel à la correspondance des conjoints est sujet à caution (paragraphes 17, 20, 24-25 ci-dessus), d’autant que tout porte à croire en l’espèce que le consentement finalement donné par la requérante à son mari est apparu dans un contexte conflictuel. Cela dit, la conclusion à laquelle les juridictions internes ont abouti quant à l’accès même auxdits messages n’apparaît pas arbitraire au point de justifier que la Cour substitue sa propre appréciation à la leur.
48. En ce qui concerne spécifiquement le versement des messages électroniques dans le cadre des procédures de divorce et de répartition de la responsabilité parentale, la Cour relève que la cour d’appel de Lisbonne a exclu toute responsabilité pénale du mari pour violation du secret de la correspondance après avoir conclu que la condition d’absence de consentement dans la divulgation posée à l’article 194 § 3 du CP n’était pas remplie (paragraphes 24-25 ci-dessus). La Cour partage l’avis de la cour d’appel quant à la pertinence des messages litigieux dans le cadre des procédures civiles en cause, qui allaient donner lieu à une appréciation de la situation personnelle des conjoints et de la famille. Elle rappelle, toutefois, que dans une telle situation, l’ingérence dans la vie privée qui découle de la production de pareils éléments doit se limiter, autant que faire se peut, au strict nécessaire (N.N. et T.A. c. Belgique, précité, § 47).
49. Souscrivant à l’approche de la cour d’appel, elle estime de même que les effets de la divulgation des messages litigieux sur la vie privée de la requérante ont été limités. En effet, ces messages n’ont été divulgués que dans le cadre des procédures civiles. Or, l’accès du public aux dossiers de ce type de procédures est restreint (voir paragraphe 31 ci-dessus, et comparer avec N.N. et T.A. c. Belgique, précité, § 50). De plus, les messages n’ont pas été examinés concrètement, le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne n’ayant finalement pas statué sur le fond des demandes formulées par le mari (paragraphe 13 ci-dessus ; voir, a contrario, L.L. c. France, précité, § 46).
50. La Cour ne voit donc pas de raison sérieuse qui justifierait en l’espèce qu’elle substitue son avis à celui des juridictions internes (voir, notamment, la jurisprudence citée au paragraphe 42 ci-dessus). D’une part, les autorités nationales ont mis en balance les intérêts en jeu en respectant les critères qu’elle a établis dans sa jurisprudence. D’autre part, dès lors que la requérante avait renoncé à toute prétention civile dans le cadre de la procédure pénale, seule restait à trancher la question de la responsabilité pénale du mari, question sur laquelle la Cour ne saurait statuer (voir la jurisprudence citée au paragraphe 41 in fine ci-dessus).
51. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’État s’est acquitté de l’obligation positive qui lui incombait de garantir les droits de la requérante au respect de sa vie privée et au secret de sa correspondance.
52. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
LE LIEU DE VIE ET SON ENVIRONNEMENT D'UN NOURRISSON EST SA MERE ET LE LIEU OU ELLE VIT
Cour de CASSATION Chambre civile 1, arrêt du 12 juin 2020 Pourvoi n° 19-24.108 cassation
Vu les articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, 2, 11), et 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale :
Au sens de ces textes, est illicite tout déplacement ou non-retour d’un enfant fait en violation d’un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour.
De la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 2 avril 2009, A, C-523/07, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, arrêt du 9 octobre 2014, C, C-376/14 PPU, arrêt du 8 juin 2017, OL, C-111/17 PPU, arrêt du 28 juin 2018, HR, C-512/17) résultent les éléments ci-après.
En premier lieu, la résidence habituelle de
l’enfant, au sens du règlement n° 2201/2003, correspond au lieu où se situe,
dans les faits, le centre de sa vie et il appartient la juridiction nationale de
déterminer où se situe ce centre sur la base d’un faisceau d’éléments de fait
concordants (arrêt précité du 28 juin 2018).
En deuxième lieu, la résidence habituelle doit être interprétée au regard des objectifs du règlement n° 2201/2003, notamment celui ressortant de son considérant 12, selon lequel les règles de compétence qu’il établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité (arrêts précités du 2 avril 2009, points 34 et 35, du 22 décembre 2010, points 44 46, et du 8 juin 2017, point 40).
En troisième lieu, lorsque l’enfant est un nourrisson, son environnement est essentiellement familial, déterminé par la personne ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui, et il partage nécessairement l’environnement social et familial de cette personne ou de ces personnes. En conséquence, lorsque, comme dans la présente espèce, un nourrisson est effectivement gardé par sa mère, dans un État membre différent de celui où réside habituellement le père, il convient de prendre en compte notamment, d’une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de celle-ci sur le territoire du premier État membre, d’autre part, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l’enfant dans le même État membre (arrêt précité du 8 juin 2017, point 45).
En quatrième lieu, lorsque dans les mêmes circonstances, un nourrisson est effectivement gardé par sa mère, l’intention initialement exprimée par les parents quant au retour de celle-ci accompagnée de l’enfant dans un autre Etat membre, qui était celui de leur résidence habituelle avant la naissance de l’enfant, ne saurait être à elle seule décisive pour déterminer la résidence habituelle de l’enfant, au sens du règlementn° 2201/2003, cette intention ne constituant qu’un indice de nature compléter un faisceau d’autres éléments concordants. Cette intention initiale ne saurait être la considération prépondérante, en application d’une règle générale et abstraite selon laquelle la résidence habituelle d’un nourrisson serait nécessairement celle de ses parents (même arrêt, points 47 et 50). De même, le consentement ou l’absence de consentement du père, dans l’exercice de son droit de garde, ce que l’enfant s’établisse en un lieu ne saurait être une considération décisive pour déterminer la résidence habituelle de cet enfant, au sens du règlement n° 2201/2003 (mêmearrêt, point 54).
En l’espèce, pour fixer la résidence habituelle de l’enfant en Grèce, l’arrêtretient que, s’agissant d’un nourrisson, il est nécessaire de prendre en considération la résidence du couple et l’intention commune des parents, et qu’en cas de séjours temporaires l’étranger, un changement de résidence ne peut tre pris en considération qu’en cas d’intention ferme, formulée par les deux parents, d’abandonner leur résidence habituelle afin d’en acquérir une nouvelle, peu important le lieu où l’enfant a passé le plus de temps depuis sa naissance. Il relève que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 30 juillet 2015 en Grèce où ils résident régulièrement depuis quatre ans et où M. Y... exerce principalement son activité professionnelle, Mme X... ayant mis fin son activité professionnelle pour s’installer en Grèce avec son époux. Il constate que C... est de nationalité grecque et est né en Grèce où il a vécu pendant quatre semaines, le logement ayant été aménagé pour sa naissance, qu’il dispose d’un passeport grec, d’une mutuelle et est enregistré auprès de l’assurance maladie grecque. Il relève encore que les deux parents ont indiqué une adresse commune en Grèce lors de l’établissement de l’acte de naissance de leur fils et que la résidence de la famille est enregistrée auprès de la mairie du Pirée. Il en déduit que la résidence habituelle de M. Y... et Mme X... et, subséquemment, celle de C... est établie en Grèce et que, si le déplacement de l’enfant en France ne présente aucun caractère illicite, les deux parents étant venus ensemble, d’un commun accord, avec l’enfant sur le territoire national, Mme X... ne pouvait décider de modifier unilatéralement la résidence habituelle de l’enfant sans l’accord du père et s’opposer son retour.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si, au regard du très jeune âge de l’enfant et de la circonstance qu’il était arrivé l’âge d’un mois en France et y avait séjourné de manière ininterrompue depuis lors avec sa mère, son environnement social et familial et, par suite, le centre de sa vie, ne s’y trouvait pas, nonobstant l’intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant, en Grèce après son séjour en France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
LA RESIDENCE DE L'ENFANT DOIT ÊTRE DETERMINEE EN EXAMINANT L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES
Cour de CASSATION Chambre civile 1, arrêt du 4 mars 2015 Pourvoi N° 14-19015 cassation
Vu les articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble les articles 2 11) et 11, paragraphe 1, du règlement (CE) du Conseil n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
Attendu qu'au sens de ces textes est illicite tout déplacement d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts A du 2 avril 2009 n° C-523/ 07, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, aff. C-497/ 10 PPU, arrêt du 9 octobre 2014, C, n° C-376/ 14 PPU) que la résidence habituelle de l'enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un État membre n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial et qu'à cette fin, doivent être notamment pris en compte non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit État mais aussi l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre État membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet État ;
Attendu que, pour écarter la demande de retour de l'enfant, l'arrêt retient que jusqu'en août 2012, date à laquelle le couple X...-Y... a envisagé une vie commune en Belgique, lieu de la résidence professionnelle du père, la mère résidait habituellement en France où Rachel est née, que Mme Y... a déménagé avec ses trois enfants, les deux aînés-issus d'une première union-ayant été inscrits dans une école en Belgique où ils ont suivi les cours pendant le premier trimestre et Rachel ayant été inscrite dans une crèche, qu'elle avait néanmoins conservé son appartement à Limoges où elle avait également inscrit ses deux aînés à l'école le 26 septembre 2012, se réservant ainsi manifestement la possibilité d'un retour en France en cas d'échec de la cohabitation envisagée avec son compagnon, que l'essai de vie commune du couple du mois d'août 2012 au 22 décembre 2012 n'a pas eu pour conséquence de transférer la résidence habituelle de l'enfant en Belgique, que la notion de résidence habituelle de l'enfant, sur laquelle repose l'action en retour de l'enfant illégalement déplacé dans les termes de la Convention de La Haye, suppose en effet une stabilité de cette résidence dans le temps qui, au regard des circonstances susvisées, fait manifestement défaut ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résidence de l'enfant doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances de fait particulières dont la commune intention des parents de transférer cette résidence ainsi que les décisions prises en vue de l'intégration de l'enfant, la cour d'appel, qui s'est prononcée en considération de la seule durée du séjour de la mère et de sa fille, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
LE DEVOIR CONJUGAL ET LE DIVORCE
H.W. c. FRANCE du 23 janvier 2025 Requête no 13805/21
Art 8 • Vie privée • Divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs de la requérante pour ne pas avoir accompli son devoir conjugal en ayant refusé d’avoir des relations intimes avec son époux • Prévisibilité de la loi • Marge d’appréciation étroite • Devoir conjugal ne prenant pas en considération le consentement aux relations sexuelles • Dimension prescriptive de la règle de droit à l’égard des époux dans la conduite de leur vie sexuelle • Refus de s’y soumettre ayant des conséquences juridiques • Obligation matrimoniale contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps ainsi qu’à l’obligation positive de prévention pesant sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles • Autres moyens possibles pour assurer les droits de l’époux de la requérante • Absence de motifs pertinents et suffisants • Juste équilibre non ménagé entre les intérêts concurrents
Motivations remarquables :
86. En l’espèce, la Cour constate que le devoir conjugal, tel qu’il est énoncé dans l’ordre juridique interne et qu’il a été réaffirmé dans la présente affaire (paragraphes 14 et 19 ci-dessus), ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, alors même que celui-ci constitue une limite fondamentale à l’exercice de la liberté sexuelle d’autrui.
87. Des obligations relatives à la prévention des violences sexuelles et domestiques ont d’ailleurs été introduites aux articles 5 § 2 et 12 § 2 de la Convention d’Istanbul (paragraphe 34 ci-dessus).
88. Or, la Cour constate que l’obligation litigieuse ne garantit pas le libre consentement aux relations sexuelles au sein du couple.
89. La Cour en déduit que l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.
91. La Cour ne saurait admettre, comme le suggère le Gouvernement, que le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible. Or, la Cour juge de longue date que l’idée qu’un mari ne puisse pas être poursuivi pour le viol de sa femme est inacceptable et qu’elle est contraire non seulement à une notion civilisée du mariage mais encore et surtout aux objectifs fondamentaux de la Convention dont l’essence même est le respect de la dignité et de la liberté humaines (S.W. c. Royaume‑Uni, précité, § 44, et C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 42, série A no 335-C). Aux yeux de la Cour, le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances.
a) Principes généraux
62. La Cour rappelle que la notion de « vie privée », au sens de l’article 8 de la Convention, est un concept large qui recouvre notamment la vie sexuelle (Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 41, série A no 45, et E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 43, 22 janvier 2008). Elle rappelle en outre que le respect de l’autonomie personnelle est un principe important qui sous‑tend l’interprétation des garanties de l’article 8 ( Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 62, CEDH 2002-III, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 90, CEDH 2002-VI, M.L. c. Pologne, no 40119/21, § 91, 14 décembre 2023, et Pindo Mulla c. Espagne [GC], no 15541/20, § 137, 17 septembre 2024 ; voir également M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 165‑166, CEDH 2003-XII). Le droit au respect de la vie privée doit ainsi être compris comme garantissant la liberté sexuelle (voir, déjà, J.L. c. Italie, no 5671/16, § 134, 27 mai 2021, et M.A. et autres c. France, nos 63664/19 et 4 autres, § 138, 25 juillet 2024) et le droit de disposer de son corps (Pretty, précité, § 66, et K.A. et A.D. c. Belgique, nos 42758/98 et 45558/99, § 83, 17 février 2005).
63. L’article 8 de la Convention a d’abord pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics (voir, parmi d’autres, Libert c. France, no 588/13, §§ 40‑42, 22 février 2018, et Drelon c. France, nos 3153/16 et 27758/18, § 85, 8 septembre 2022). À cet engagement négatif s’ajoutent des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale, qui peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91, et Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, § 78, CEDH 2013). La frontière entre les obligations positives et négatives ne se prête toutefois pas à une définition précise (X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 114, CEDH 2014 (extraits)).
64. Une ingérence dans les droits garantis par l’article 8 ne peut se justifier que si elle est prévue par la loi, vise un ou plusieurs des buts légitimes énumérés dans ce paragraphe et est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts.
65. Les termes « prévue par la loi » imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais aussi que la « loi » soit accessible et qu’elle soit énoncée avec assez de précision pour permettre aux personnes auxquelles elle s’applique de régler leur conduite : en s’entourant au besoin de conseils éclairés, celles-ci doivent être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (voir, par exemple, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V, et Vavřička et autres c. République tchèque [GC], nos 47621/13 et 5 autres, § 266, 8 avril 2021). Le terme « loi » doit être entendu dans son acception matérielle et non formelle. Il inclut donc à la fois le droit écrit, lequel ne se limite pas aux textes législatifs mais englobe aussi les actes et instruments juridiques de rang inférieur, et le droit non écrit. En résumé, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété (Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 88, CEDH 2005-XI, et Vavřička et autres, précité, § 269).
66. L’énumération des exceptions au droit au respect de la vie privée qui figure dans le second paragraphe de l’article 8 est exhaustive et la définition de ces exceptions est restrictive. Pour être compatible avec la Convention, une restriction à ce droit doit notamment être inspirée par un but susceptible d’être rattaché à l’un de ceux que cette disposition énumère (S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 113, CEDH 2014 (extraits), et L.B. c. Hongrie [GC], no 36345/16, § 108, 9 mars 2023).
67. Les principes relatifs à l’appréciation de la nécessité d’une ingérence dans les droits garantis par l’article 8 ont été résumés dans l’arrêt Vavřička et autres (précité, §§ 273-275), auquel il est renvoyé.
68. La Cour rappelle en particulier que les autorités nationales jouissent en principe d’une certaine marge d’appréciation en la matière. L’ampleur de cette marge d’appréciation dépend d’un certain nombre d’éléments déterminés par les circonstances de la cause. Cette marge est d’autant plus étroite que le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre intime qui lui sont reconnus. Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’État est également restreinte. À l’inverse, lorsque, parmi les Parties contractantes à la Convention, il n’y a de consensus ni sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ni sur les meilleurs moyens de le protéger, la marge d’appréciation est plus large, surtout lorsque sont en jeu des questions morales ou éthiques délicates. De la même façon, la marge d’appréciation est généralement ample lorsqu’il doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou différents droits protégés par la Convention (Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 77, CEDH 2007-I, S.H. et autres c. Autriche [GC], no 57813/00, § 94, CEDH 2011, Vavřička et autres, précité, §§ 273 et 275).
69. En application de ce dernier principe, la Cour a jugé que les États jouissent généralement d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils élaborent une législation relative au divorce et lorsqu’ils la mettent concrètement en application, de tels exercices supposant de concilier des intérêts personnels divergents (Babiarz c. Pologne, no 1955/10, § 47, 10 janvier 2017).
b) Application en l’espèce
70. La requérante ne se plaint pas du divorce en tant que tel – qu’elle demandait également –, mais des motifs pour lesquels il a été prononcé.
71. La Cour considère que la réaffirmation du devoir conjugal et le fait d’avoir prononcé le divorce pour faute au motif que la requérante avait cessé toute relation intime avec son époux constituent des ingérences dans son droit au respect de la vie privée, dans sa liberté sexuelle et dans son droit de disposer de son corps. S’il est vrai que le droit interne dissocie désormais largement les conséquences pécuniaires du divorce des torts éventuels des époux (paragraphe 22 ci-dessus), il n’en demeure pas moins que ces mesures sont particulièrement intrusives, en ce qu’elles touchent à l’un des aspects les plus intimes de la vie privée de l’individu (Dudgeon, précité, § 52, Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 90, CEDH 1999-VI, Y.F. c. Turquie, précité, § 33, et K.A. et A.D. c. Belgique, précité, § 83). En outre, les conclusions de la cour d’appel sont particulièrement stigmatisantes, dans la mesure où le refus opposé par la requérante a été considéré comme une violation « grave et renouvelée » des obligations du mariage rendant « intolérable » le maintien de la vie commune (paragraphe 14 ci-dessus).
72. Ces ingérences dans les droits de la requérante étant le fait d’autorités publiques, la Cour estime qu’elles doivent être examinées sous l’angle des obligations négatives.
Sur la justification des ingérences
α) Sur l’existence d’une base légale prévisible
73. La Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Sauf si l’interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, la tâche de la Cour se limite à déterminer si ses effets sont compatibles avec la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Leyla Şahin, précité, § 87, Sanchez c. France [GC], no 45581/15, § 128, 15 mai 2023, et Pindo Mulla, précité, § 132).
74. En l’espèce, la Cour relève que le divorce a été prononcé en application des articles 229 et 242 et suivants du code civil (paragraphe 20 ci-dessus), qui prévoient qu’un divorce peut être prononcé pour faute lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à l’un des époux et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Le désaccord des parties porte uniquement sur l’étendue des « devoirs et obligations du mariage » et plus particulièrement sur la persistance du devoir conjugal.
75. À titre principal, la requérante soutient que le droit interne ne fait pas obligation aux époux d’avoir des relations sexuelles.
76. La Cour relève toutefois qu’il résulte d’une jurisprudence ancienne mais constante de la Cour de cassation que les époux sont tenus à un devoir conjugal et que son inexécution peut constituer une faute justifiant le divorce (paragraphe 23 ci-dessus). L’arrêt du 5 septembre 1990 auquel la requérante se réfère n’a pas été rendu en matière de divorce, mais en matière pénale : il se borne à rappeler le caractère répréhensible du viol conjugal (paragraphe 30 ci-dessus). Malgré cette évolution jurisprudentielle, la Cour de cassation a confirmé, par un arrêt du 17 décembre 1997, que « l’abstention prolongée de relations intimes imputées à l’épouse » était de nature à justifier le prononcé du divorce pour faute dès lors que celle-ci « n’était pas justifiée par des raisons médicales suffisantes ». Si la Cour de cassation n’a plus réaffirmé cette jurisprudence depuis lors, celle-ci n’a jamais fait l’objet d’un revirement et continue d’être appliquée par les juridictions du fond (paragraphes 25 et 29 ci-dessus). La Cour en conclut que les ingérences litigieuses reposaient sur une jurisprudence interne bien établie.
77. À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que la portée exacte du devoir conjugal était imprévisible.
78. À cet égard, il est exact que la jurisprudence interne ne considère pas tout refus d’avoir des relations sexuelles comme fautif. Elle laisse aux juges du fond le soin de déterminer si ce refus suffit à caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage justifiant le divorce (paragraphe 26 ci-dessus). Elle admet en outre que certaines circonstances telles que l’âge, l’état de santé ou le caractère abusif ou violent du conjoint sont de nature à justifier l’inexécution du devoir conjugal (ibidem). La Cour rappelle cependant que l’exigence de prévisibilité de la loi ne va pas jusqu’à imposer un degré de précision tel que le citoyen puisse être absolument certain des conséquences pouvant découler de son application. Beaucoup de lois se servent, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (Silver et autres c. Royaume-Uni, 25 mars 1983, § 88, série A no 61, Michaud c. France, no 12323/11, § 96, CEDH 2012, et M.K. c. Luxembourg, no 51746/18, § 56, 18 mai 2021). Elle rappelle en outre qu’il appartient aux autorités nationales, et au premier chef aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, § 169, 24 janvier 2017, et Sanchez, précité, § 126). Dès lors, la circonstance que le droit interne confère aux juges du fond le pouvoir d’apprécier si la méconnaissance d’une obligation matrimoniale est, ou non, suffisamment grave pour justifier le divorce n’est pas de nature à remettre en cause sa prévisibilité. La Cour estime que la jurisprudence en cause était énoncée avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante de régler sa conduite, en s’entourant au besoin de conseils éclairés.
79. Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère que les ingérences litigeuses étaient « prévues par la loi » au sens de l’article 8 § 2.
β) Sur la légitimité du but poursuivi
80. Il incombe à la Cour de déterminer si les restrictions contestées ont été inspirées par un but susceptible d’être rattaché à l’un de ceux que le second paragraphe de l’article 8 énumère (Parrillo c. Italie [GC], no 46470/11, § 163, CEDH 2015, et L.B. c. Hongrie, précité, § 108), ce contrôle étant sommaire dans la plupart des cas (Leyla Şahin, précité, § 99, Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 297, 28 novembre 2017 et L.B. c. Hongrie, précité, § 109).
81. Le Gouvernement indique que les ingérences litigieuses visaient à protéger les droits d’autrui, et plus particulièrement le droit de chacun des époux à mettre fin au lien matrimonial lorsque la poursuite de la vie commune n’est plus possible (voir, en ce sens, N.N. et T.A. c. Belgique, précité, § 42).
82. Relevant que le droit interne garantit le droit de divorcer et que la désunion a une incidence sur les droits de chacun des époux, la Cour reconnaît que la finalité des ingérences litigieuses, qui renvoient au droit de chacun des époux à mettre fin aux relations matrimoniales, se rattachait à la « protection des droits et libertés d’autrui » au sens de la Convention.
83. Il reste cependant à la Cour à trancher la question, étroitement liée à celle de l’existence d’un but légitime, de savoir si les restrictions en cause sont justifiées, en d’autres termes si celles-ci sont fondées sur des motifs pertinents et suffisants et si elles sont proportionnées au but poursuivi (voir, sur ce point, Merabishvili, précité, § 302, et L.B. c. Hongrie, précité, § 109).
γ) Sur la nécessité des ingérences
84. Il y a lieu de rechercher si les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts individuels concurrents en jeu, à savoir, d’une part, la liberté sexuelle de la requérante, et d’autre part, le droit de son conjoint d’obtenir qu’il soit mis fin au lien matrimonial s’il estime que l’abstinence sexuelle qui lui est imposée rend son maintien intolérable. À cet égard, la Cour n’exclut pas que le maintien forcé d’un époux dans l’union en dépit d’un constat d’altération irrémédiable du lien conjugal puisse, dans certaines circonstances, porter une atteinte excessive à ses droits (Ivanov et Petrova c. Bulgarie (déc.), no 15001/04, § 61, 14 juin 2011, et Babiarz, précité, § 50 ; voir, également, F. c. Suisse, 18 décembre 1987, § 38, série A no 128, et Aresti Charalambous c. Chypre (déc.), no 43151/04, § 56, 19 juillet 2007).
85. Dans la mesure où les ingérences en cause touchent à l’un des aspects les plus intimes de la vie privée de la requérante, la Cour estime que la marge d’appréciation laissée aux États contractants est étroite (Dudgeon, précité, § 52, et S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 102, CEDH 2008). Elle rappelle que seules des raisons particulièrement graves peuvent justifier des ingérences des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité (Dudgeon, précité, § 52, Smith et Grady, précité, § 89, et K.A. et A.D. c. Belgique, précité, § 84). Sur ce point, l’espèce se différencie nettement de l’affaire Babiarz, où aucun des droits invoqués par les époux dans le cadre de la procédure de divorce qui les opposait n’avait une telle nature ou une telle importance (comparer avec Babiarz, précité, §§ 37 et 47).
86. En l’espèce, la Cour constate que le devoir conjugal, tel qu’il est énoncé dans l’ordre juridique interne et qu’il a été réaffirmé dans la présente affaire (paragraphes 14 et 19 ci-dessus), ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, alors même que celui-ci constitue une limite fondamentale à l’exercice de la liberté sexuelle d’autrui.
87. À cet égard, la Cour rappelle que tout acte sexuel non consenti est constitutif d’une forme de violence sexuelle (voir, sur ce point, M.C. c. Bulgarie, précité, § 163). Elle juge en outre de façon constante, sous l’angle de l’article 8 seul ou combiné à l’article 3, que les États contractants doivent instaurer et mettre en œuvre un cadre juridique adapté offrant une protection contre les actes de violence pouvant être commis par des particuliers (Söderman, précité, § 80 et références citées). Des obligations relatives à la prévention des violences sexuelles et domestiques ont d’ailleurs été introduites aux articles 5 § 2 et 12 § 2 de la Convention d’Istanbul (paragraphe 34 ci-dessus).
88. Or, la Cour constate que l’obligation litigieuse ne garantit pas le libre consentement aux relations sexuelles au sein du couple. Cette règle de droit a une dimension prescriptive à l’égard des époux, dans la conduite de leur vie sexuelle. En outre, sa méconnaissance n’est pas sans conséquence sur le plan juridique. D’une part, le refus de se soumettre au devoir conjugal peut, dans les conditions prévues à l’article 242 du code civil, être considéré comme une faute justifiant le prononcé du divorce, comme ce fût le cas en l’espèce (paragraphes 20 et 23-26 ci-dessus). D’autre part, il peut entraîner des conséquences pécuniaires et fonder une action indemnitaire (paragraphes 22 et 27 ci-dessus).
89. La Cour en déduit que l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.
90. Si le Gouvernement fait valoir que l’incrimination des atteintes sexuelles commises au sein du couple suffit à assurer la protection de la liberté sexuelle de chacun, la Cour estime que cet interdit pénal ne suffit pas à priver d’effet l’obligation civile introduite par la jurisprudence. Elle observe que cette dernière s’inscrit à rebours des avancées opérées en matière pénale (paragraphes 30 à 33 ci-dessus), ainsi que des engagements internationaux pris par la France pour lutter contre toute forme de violence domestique (paragraphe 34 ci-dessus).
91. La Cour ne saurait admettre, comme le suggère le Gouvernement, que le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible. Or, la Cour juge de longue date que l’idée qu’un mari ne puisse pas être poursuivi pour le viol de sa femme est inacceptable et qu’elle est contraire non seulement à une notion civilisée du mariage mais encore et surtout aux objectifs fondamentaux de la Convention dont l’essence même est le respect de la dignité et de la liberté humaines (S.W. c. Royaume‑Uni, précité, § 44, et C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 42, série A no 335-C). Aux yeux de la Cour, le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances.
92. Au demeurant, la Cour ne discerne, dans la présente affaire, aucune raison d’une particulière gravité propre à justifier une ingérence dans le champ de la sexualité (Dudgeon, précité, § 52, Smith et Grady, précité, § 89, et K.A. et A.D. c. Belgique, précité, § 84). Elle relève que le conjoint de la requérante avait la possibilité de solliciter le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il lui incombait à cet égard de respecter les prescriptions de l’article 1077 du code de procédure civile, en présentant cette demande à titre principal et non à titre subsidiaire, comme il le fit en l’espèce (paragraphes 13 et 60 ci-dessus). La défense de ses droits pouvait donc être assurée par d’autres moyens.
93. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour déduit que la réaffirmation du devoir conjugal et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la requérante ne reposaient pas sur des motifs pertinents et suffisants et que les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Les éléments qui précèdent suffisent à constater la violation de l’article 8 de la Convention.
CLIQUEZ SUR LES BOUTONS POUR ACCEDER A LA JURISPRUDENCE SUR LA PROTECTION DE L'ARTICLE 8
Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH, lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.