ARTICLE 6-1 DE LA CEDH
Pour plus de sécurité, fbls non accès au tribunal est sur : https://www.fbls.net/6-1nonactribu.htm
Aucune publicité, aucun cookie garanti = liberté préservée pour chacun !
"Le "non accès à un tribunal" est la formule polie
pour qualifier un déni de justice"
Frédéric Fabre docteur en droit.
Article 6§1 en ses termes compatibles :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue; par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle"
Cliquez sur bouton ou un lien bleu pour accéder gratuitement à LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH :
- les résolutions de l'ONU, immunités diplomatiques et du chef d'État
- la CEDH et l'interprétation du droit de l'UE
- la demande doit être défendable en droit interne
- la notification d'une décision par Internet ne porte pas atteinte à l'accès au tribunal
- le rôle de la CEDH pour contrôler l'accès effectif à un tribunal
- la faute des juridictions qui empêche un recours devant une juridiction supérieure
- un non accès devant les juridictions administratives
- un non accès devant les juridictions de cassation
- un non accès devant les juridictions constitutionnelles
CLIQUEZ SUR LES BOUTONS POUR ACCÉDER AU NON ACCÈS AU TRIBUNAL CIVIL OU PÉNAL

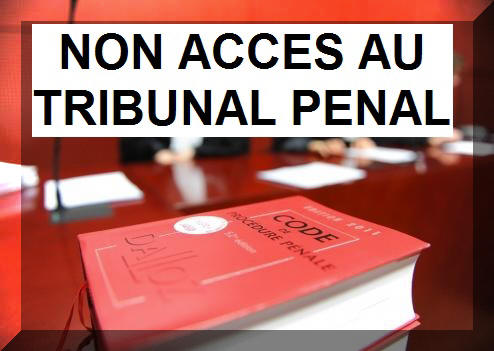

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
Cliquez sur le bouton ci dessous pour accéder gratuitement à l'analyse de l'article 6 par la CEDH au format PDF
MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH
GRZĘDA c. POLOGNE du 16 mars 2022 Requête no 43572/18
L'arrêt est lisible ici au format pdf
Art 6 § 1 (volet civil) • Accès à un tribunal • Absence de contrôle juridictionnel de la cessation prématurée, ex lege, consécutive à une réforme législative, du mandat de membre du Conseil national de la magistrature d’un juge en exercice de la Cour administrative suprême • Art. 6 applicable • Contestation réelle et sérieuse sur le « droit », en droit interne, à mener à son terme un mandat de membre juge du CNM • Première condition du critère Eskelinen à préciser de manière à englober l’exclusion implicite, dans le droit interne, de l’accès à un tribunal • Seconde condition du critère Eskelinen non remplie, l’impossibilité faite au requérant d’accéder à un tribunal n’étant pas justifiée par des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’État compte tenu de l’impact négatif de la réforme sur l’indépendance du CNM • Nécessité de comprendre l’indépendance de la justice de manière inclusive, et de l’appliquer aux juges non seulement dans leur rôle judiciaire mais aussi dans leur rôle de membre d’un conseil de la magistrature • Nécessité de protéger l’indépendance du conseil de la magistrature à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif pour préserver l’intégrité de la procédure de nomination des juges • Nécessité d’appliquer en cas de cessation du mandat d’un membre juge du conseil de la magistrature des garanties procédurales analogues à celles devant s’appliquer en cas de révocation ou de destitution d’un juge • Affaiblissement de l’indépendance de la justice et du respect des normes de prééminence du droit du fait des réformes successives entreprises par le gouvernement polonais • Atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal
257. Pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait contestation sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. De plus, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Baka c. Hongrie [GC], n 20261/12, § 100, 23 juin 2016, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 71, 29 novembre 2016, Károly Nagy c. Hongrie [GC], no 56665/09, § 60, 14 septembre 2017, et Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, § 99, 19 septembre 2017). Enfin, le droit doit revêtir un caractère « civil » (Mennitto c. Italie [GC], no 33804/96, § 23, CEDH 2000-X).
L'OBLIGATION DE LOYAUTE D'UN JUGE N'EST PAS UNE OBLIGATION DE LOYAUTE A UN PARTI POLITIQUE MAIS ENVERS LA PREEMINENCE DU DROIT
346... En outre, la relation de travail entre les juges et l’État doit se comprendre à la lumière des garanties spécifiques essentielles à l’indépendance de la justice. Ainsi, lorsqu’il est fait référence à « la confiance et la loyauté spéciales » exigées des juges, il s’agit de la loyauté envers la prééminence du droit et la démocratie et non envers les détenteurs de la puissance publique. La nature complexe de la relation de travail entre les juges et l’État commande que les premiers soient suffisamment éloignés des autres branches de l’État dans l’exercice de leurs fonctions pour pouvoir rendre, sans craintes ni faveurs, des décisions fondées a fortiori sur les exigences du droit et de la justice. Il serait illusoire de croire que les juges peuvent faire respecter l’état de droit et donner effet à la Convention s’ils sont privés par le droit interne des garanties posées par la Convention sur les questions touchant directement à leur indépendance et à leur impartialité (Bilgen, § 79, et Broda et Bojara, § 120, tous deux précités).
La Cour souligne également qu’il est nécessaire de protéger l’autonomie des conseils de la magistrature de toute ingérence des pouvoirs législatif et exécutif, notamment dans les questions touchant la nomination des juges, et de préserver leur rôle de rempart contre toute influence politique sur le pouvoir judiciaire. Elle estime que, appelée à apprécier une justification avancée à l’appui de l’impossibilité d’accéder à un tribunal pour contester une décision relative à l’appartenance à un organe d’administration judiciaire, elle doit tenir compte de l’intérêt public fort qu’il y a à préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire et la prééminence du droit. Elle prête attention également au contexte global dans lequel s’inscrivent les différentes réformes entreprises par le gouvernement polonais, dont le cas d’espèce reflète un aspect problématique, et qui se traduisent par un affaiblissement de l’indépendance de la justice et du respect des normes de prééminence du droit.
347. En l’espèce, le Gouvernement n’a avancé aucune raison pour justifier l’absence de contrôle juridictionnel – il s’est contenté de répéter son argumentation relative à l’inapplicabilité, selon lui, de l’article 6 à la présente affaire.
348. La Cour observe que, pris dans son ensemble, l’enchaînement des événements qui se sont produits en Pologne (paragraphes 14-28 ci-dessus) montre très nettement que les réformes judiciaires qui se sont succédé visaient à affaiblir l’indépendance de la justice. Pour commencer, de graves irrégularités ont entaché l’élection des juges à la Cour constitutionnelle en décembre 2015. Ensuite, le CNM a été remodelé et de nouvelles chambres ont été créées au sein de la Cour suprême, tandis que le contrôle du ministre de la Justice sur les tribunaux a été étendu et son rôle en matière de discipline judiciaire renforcé, entre autres mesures. À ce stade, la Cour juge important de rappeler ses arrêts relatifs à la réorganisation du système judiciaire polonais (Xero Flor w Polsce sp. z o.o., Broda et Bojara, et Reczkowicz, tous précités) ainsi que les arrêts adoptés par la CJUE (paragraphes 150-156 et 160-161 ci-dessus) et ceux rendus respectivement par la Cour suprême et par la Cour administrative suprême (paragraphes 100-108 et 109-119 ci-dessus). Du fait des réformes successives, le pouvoir judiciaire, branche indépendante du pouvoir étatique, s’est trouvé exposé à l’ingérence des pouvoirs exécutif et législatif et, par conséquent, considérablement affaibli. Le cas du requérant est une illustration de cette tendance générale.
349. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que, à raison de l’absence de contrôle juridictionnel en l’espèce, l’État défendeur a porté atteinte à la substance même du droit pour le requérant d’accéder à un tribunal (Baka, précité, § 121).
350. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation dans le chef du requérant du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
VERMEERSCH c. BELGIQUE du 16 février 2021 Requête no 49652/10
87. Comme illustré par la présente affaire, un moyen fondé sur une telle loi nouvelle ne peut pas être soumis à la Cour de cassation. Cette lacune n’a pas été comblée par la Cour de cassation qui, en se référant au caractère d’ordre public des règles de procédure précitées, a considéré que ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable ne justifiaient de s’en écarter. En toute hypothèse, si une autre interprétation des dispositions procédurales n’était pas légalement possible, le système légal belge ne permettait pas au requérant de soumettre utilement à la Cour de cassation le moyen tiré de la nouvelle loi. Il en a résulté une situation qui n’était pas adaptée aux circonstances particulières de l’espèce (dans le même sens, mutatis mutandis, Gajtani c. Suisse, no 43730/07, § 75, 9 septembre 2014).
88. Dans ces circonstances, la Cour estime que la réglementation a cessé de servir les buts de la « sécurité juridique » et de la « bonne administration de la justice ». Combinée à l’incertitude juridique relative à la suspension et l’interruption du délai de prescription par l’introduction d’un recours en annulation telle qu’elle existait à l’époque des faits, cette réglementation a constitué une sorte de barrière qui a empêché le requérant de voir son litige tranché au fond. Son droit d’accès à un tribunal s’est donc trouvé atteint dans sa substance même.
89. Ce constat suffit à conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
ONU ET IMMUNITÉ DES DIRIGEANTS
Cliquez sur un lien bleu pour accéder gratuitement à LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH SUR :
- UNE RÉSOLUTION DE L'ONU NE PEUT PAS LIMITER L'ACCES A UN TRIBUNAL
- L'IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE ET DES ETATS
- LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION FRANÇAISE.
UNE RÉSOLUTION DE L'ONU NE PEUT PAS LIMITER L'ACCES A UN TRIBUNAL
GRANDE CHAMBRE AL-DULIMI ET MONTANA MANAGEMENT INC. c. SUISSE Requête 5809/08 du 21 juin 2016
Violation de l'article 6-1 : l'exécution d'une décision de l'ONU en bloquant les avoirs des requérants sans souplesse, est une violation d'accès à un tribunal.
a) Sur l’existence d’une limitation du droit d’accès à un tribunal et d’un but légitime
i. Existence d’une limitation
126. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX). Chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, § 54, CEDH 2010, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18, et Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII).
127. La Cour rappelle ensuite que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37). La remarque vaut également pour le droit d’accès aux tribunaux, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Aït-Mouhoub c. France, 28 octobre 1998, § 52, Recueil 1998-VIII). Il serait incompatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique et avec le principe fondamental qui sous-tend l’article 6 § 1, à savoir que les revendications civiles doivent pouvoir être portées devant un juge, qu’un État puisse, sans réserve ou sans contrôle des organes de la Convention, soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérer de toute responsabilité des catégories de personnes (Fayed c. Royaume-Uni, 21 septembre 1994, § 65, série A no 294-B).
128. L’article 6 § 1 de la Convention exige en principe l’existence d’un recours de pleine juridiction, c’est-à-dire un recours dans le cadre duquel le tribunal a compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (voir, par exemple, Sigma Radio Television Ltd c. Chypre, nos 32181/04 et 35122/05, §§ 151‑157, 21 juillet 2011). Cela implique notamment que le juge doit disposer du pouvoir de se pencher point par point sur chacun des moyens du plaignant sur le fond, sans refuser d’examiner aucun d’entre eux, et donner des raisons claires pour leur rejet. Quant aux faits, le juge doit pouvoir réexaminer ceux qui sont au centre du recours du plaignant (Bryan c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 45, série A no 335-A).
129. Cependant, la Cour a toujours jugé que le droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient en revanche à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle se doit de vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation au droit d’accès à un tribunal, y compris l’immunité juridictionnelle en vertu du droit international, ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cudak, précité, § 55, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I, et Stichting Mothers of Srebrenica et autres, décision précitée, § 139).
130. De même, le principe de pleine juridiction a été plusieurs fois tempéré par la jurisprudence de la Cour, qui lui a souvent donné une interprétation souple, notamment dans les affaires de droit administratif où la compétence de l’instance de recours était restreinte en raison de la nature technique de l’objet du litige (voir, par exemple, Chaudet c. France, no 49037/06, § 37, 29 octobre 2009).
131. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour constate que, dans ses arrêts du 23 janvier 2008, le Tribunal fédéral suisse a exposé, d’une manière très détaillée, les motifs pour lesquels il se considérait obligé de se limiter à contrôler si les noms des requérants figuraient effectivement sur les listes établies par le comité des sanctions et si les avoirs concernés leur appartenaient. En revanche, il a refusé d’examiner leurs allégations concernant la compatibilité de la procédure de confiscation de leurs avoirs avec les garanties fondamentales d’un procès équitable consacrées entre autres par l’article 6 § 1 de la Convention. Pour justifier ce refus, le Tribunal fédéral a invoqué, premièrement, la primauté absolue des obligations résultant de la Charte des Nations unies et des décisions prises par le Conseil de sécurité de l’ONU conformément à cette Charte sur toute autre norme du droit international, hormis celles découlant du jus cogens, et, deuxièmement, le caractère très précis et détaillé des obligations imposées aux États par la Résolution 1483 (2003), ne laissant à ceux-ci aucune latitude (paragraphe 29 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour considère que le droit d’accès des requérants à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a été de toute évidence restreint. Elle observe au surplus que les parties semblent s’accorder sur ce point. Dès lors, elle estime qu’il convient d’examiner si cette restriction était justifiée, c’est-à-dire si elle poursuivait un but légitime et était proportionnée à ce but.
ii. But légitime
132. La Cour constate que la mesure litigieuse, à savoir la confiscation des avoirs des requérants, a été prise en application de la Résolution 1483 (2003), adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU au titre du chapitre VII de la Charte et ayant pour but d’imposer aux États membres une série de mesures en vue de la stabilisation et du développement de l’Irak. Il s’agissait notamment, en vertu du paragraphe 23 de cette résolution, de garantir que les avoirs et les biens de hauts responsables de l’ancien régime irakien, dont faisait partie le requérant, considéré par le comité des sanctions comme étant un ancien responsable des finances des services secrets irakiens, fussent transférés au Fonds de développement pour l’Irak et, partant, rendus au peuple irakien pour qu’il en bénéficiât. La Cour admet que cette décision met en œuvre un objectif compatible avec la Convention.
133. Dès lors, elle accepte l’argument du gouvernement défendeur selon lequel le refus des tribunaux internes d’examiner au fond les griefs des requérants découlant de la confiscation de leurs avoirs était inspiré par leur souci d’assurer une mise en œuvre efficace au niveau national des obligations découlant de cette résolution. Ce refus poursuivait donc un but légitime, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il convient donc de vérifier si, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce but et les moyens employés pour l’atteindre.
b) Sur la proportionnalité de la limitation en question
i. Le contexte normatif international
134. La Cour rappelle que les dispositions de la Convention ne peuvent s’interpréter et s’appliquer en dehors du contexte général dans lequel elles s’inscrivent. En dépit de son caractère particulier d’instrument de protection des droits de l’homme, la Convention est un traité international à interpréter conformément aux normes et principes du droit international public, et notamment à la lumière de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Ainsi, la Cour n’a jamais considéré les dispositions de la Convention comme le seul cadre de référence pour l’interprétation des droits et libertés qu’elle contient. Au contraire, elle doit également prendre en considération toute règle et tout principe de droit international applicables aux relations entre les Parties contractantes (voir notamment Loizidou c. Turquie (fond), 18 décembre 1996, § 43, Recueil 1996-VI, Al‑Adsani, précité, § 55, CEDH 2001-XI, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, précité, § 150, CEDH 2005‑VI, Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, § 67, CEDH 2008, Chypre c. Turquie (satisfaction équitable) [GC], no 25781/94, § 23, CEDH 2014, ainsi que l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités aux termes duquel l’interprétation d’un traité doit tenir compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties »).
135. La Cour souligne que l’un des éléments essentiels du système actuel de droit international est l’article 103 de la Charte des Nations unies, qui affirme la primauté, en cas de conflit, des obligations découlant de la Charte sur toute autre obligation née d’un accord international, que celui-ci ait été conclu avant ou après la Charte et qu’il ait ou non une portée simplement régionale. L’une des obligations bénéficiant de cette autorité particulière est celle, prévue à l’article 25 de la Charte, « d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la (...) Charte » (voir, respectivement, l’arrêt et l’ordonnance de la CIJ dans les affaires Nicaragua c. États-Unis et Lockerbie, cités aux paragraphes 41 et 43 ci-dessus).
136. Devant le Tribunal fédéral, les requérants avaient soutenu que les garanties d’un procès équitable consacrées par les articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention constituaient un élément du jus cogens devant lequel la Résolution 1483 (2003) perdait son effet obligatoire. La Cour renvoie aux termes de l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, selon lesquels le jus cogens est « une norme impérative du droit international général (...) acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ». La Cour observe que les garanties d’un procès équitable, et en particulier le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1, occupent une position centrale dans la Convention. Comme la Cour l’a dit dans l’arrêt Golder, précité, « [l]e principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus » (ibidem, § 35). Toutefois, malgré leur importance, la Cour ne considère pas ces garanties comme figurant parmi les normes du jus cogens en l’état actuel du droit international (voir paragraphe 57 ci-dessus). Par conséquent, sur ce point, la Cour admet les conclusions formulées en ce sens dans les arrêts du Tribunal fédéral suisse ainsi que dans les observations du gouvernement défendeur et dans celles des tiers intervenants.
ii. Sur l’allégation d’un conflit d’obligations
137. En l’occurrence, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la Suisse était confrontée à un conflit entre les obligations découlant de la Résolution 1483 (2003) – et donc, de la Charte des Nations unies –, et celles résultant de la Convention. Le gouvernement défendeur, soutenu sur ce point par les tiers intervenants, affirme que ce conflit existait et que, de surcroît, il était insurmontable puisque la Suisse ne disposait d’aucune marge de manœuvre dans la mise en œuvre de la résolution. En revanche, les requérants contestent l’existence d’un vrai conflit d’obligations.
138. La Cour rappelle tout d’abord qu’en assumant de nouvelles obligations internationales, les États ne sont pas supposés vouloir se soustraire à celles auxquelles ils ont précédemment souscrit. Quand plusieurs instruments apparemment contradictoires sont applicables simultanément, la jurisprudence et la doctrine internationales s’efforcent de les interpréter de manière à coordonner leurs effets, tout en évitant de les opposer l’un à l’autre. Il en découle qu’il faut autant que possible harmoniser deux engagements divergents de manière à leur conférer des effets en tous points conformes au droit en vigueur (voir Nada, précité, § 170, et la jurisprudence y citée, ainsi que les références citées dans le rapport du groupe d’étude de la Commission du droit international intitulé « Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international », paragraphe 56 ci‑dessus).
139. La Cour souligne ensuite qu’il ne lui revient pas de se prononcer sur la légalité des actes du Conseil de sécurité de l’ONU. Toutefois, lorsqu’un État invoque la nécessité d’appliquer une résolution du Conseil de sécurité pour justifier une limitation aux droits garantis par la Convention, il appartient à la Cour d’examiner son libellé et sa portée afin d’assurer son articulation avec la Convention de façon efficace et cohérente (voir, mutatis mutandis, Al-Jedda, précité, § 76). Dans ce contexte, la Cour tiendra également compte des buts qui ont présidé à la création des Nations unies. Au-delà du but consistant à maintenir la paix et la sécurité internationales qu’énonce son premier alinéa, l’article 1er de la Charte dispose en son troisième alinéa que les Nations unies ont été créées pour « [r]éaliser la coopération internationale (...) en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». L’article 24 § 2 de la Charte impose au Conseil de sécurité, dans l’accomplissement de ses devoirs tenant à sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, d’agir « conformément aux buts et principes des Nations unies » (idem, § 102).
140. Par conséquent, il faut présumer que le Conseil de sécurité n’entend pas imposer aux États membres une quelconque obligation qui contreviendrait aux principes fondamentaux en matière de sauvegarde des droits de l’homme (Al-Jedda, précité, § 102). En cas d’ambiguïté dans le libellé d’une résolution, la Cour doit dès lors retenir l’interprétation qui cadre le mieux avec les exigences de la Convention et qui permet d’éviter tout conflit d’obligations. Vu l’importance du rôle joué par l’ONU dans le développement et la défense du respect des droits de l’homme, le Conseil de sécurité est censé employer un langage clair et explicite s’il veut que les États prennent des mesures particulières susceptibles d’entrer en conflit avec leurs obligations découlant des règles internationales de protection des droits de l’homme (ibidem). En conséquence, lorsqu’une résolution du Conseil de sécurité ne contient pas une formule claire et explicite excluant ou limitant le respect des droits de l’homme dans le cadre de la mise en œuvre de sanctions visant des particuliers ou des entités au niveau national, la Cour présumera toujours la compatibilité de ces mesures avec la Convention. En d’autres termes, en pareil cas, dans un esprit d’harmonisation systémique, elle conclura en principe à l’absence d’un conflit d’obligations susceptible d’entraîner la mise en œuvre de la règle de primauté contenue dans l’article 103 de la Charte des Nations unies.
141. Le gouvernement défendeur, ainsi que les gouvernements français et britannique, tiers intervenants, soutiennent que les autorités suisses n’avaient aucune latitude dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité pertinentes en l’espèce. La Cour rappelle que dans l’arrêt Al Jedda précité, elle a estimé que la résolution en cause dans cette affaire, à savoir la Résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité, autorisait le Royaume-Uni à prendre des mesures pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Irak, mais que ni cette résolution ni aucune autre résolution adoptée ultérieurement par le Conseil de sécurité n’imposait expressément ou implicitement au Royaume-Uni d’incarcérer, sans limitation de durée ni inculpation, un individu qui, selon les autorités, constituait un risque pour la sécurité en Irak (idem, § 109). Peu après, dans l’affaire Nada (arrêt précité, § 172), elle a conclu en revanche que la Résolution 1390 (2002) demandait expressément aux États d’interdire l’entrée et le transit sur leur territoire des personnes figurant sur la liste des Nations unies. La Cour a considéré dans cette affaire qu’il en découlait que la présomption selon laquelle le Conseil de sécurité « n’entend pas imposer aux États membres une quelconque obligation qui contreviendrait aux principes fondamentaux en matière de sauvegarde des droits de l’homme » (Al-Jedda, précité, § 102), était renversée, eu égard aux termes clairs et explicites employés dans le libellé de cette résolution, imposant une obligation d’introduire des mesures susceptibles de violer les droits de l’homme. Cependant, elle a estimé également que « la Suisse jouissait d’une latitude, certes restreinte, mais néanmoins réelle, dans la mise en œuvre des résolutions contraignantes pertinentes du Conseil de sécurité » (Nada, précité, § 180). Partant de cette constatation, elle a jugé que l’État défendeur ne pouvait pas valablement se contenter d’avancer la nature contraignante des résolutions du Conseil de sécurité adoptées conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations unies, mais qu’il aurait dû la convaincre qu’il avait pris – ou au moins tenté de prendre – toutes les mesures envisageables en vue d’adapter le régime des sanctions à la situation individuelle du requérant. Elle a dit que cette conclusion la dispensait de trancher la question de la hiérarchie entre les obligations des États parties à la Convention en vertu de cet instrument, d’une part, et celles découlant de la Charte des Nations unies, d’autre part (idem, §§ 196‑197).
142. Dans la présente affaire, la Cour relève que le paragraphe 23 de la Résolution 1483 (2003) impose aux États l’obligation de « geler sans retard » les avoirs financiers et les ressources économiques de l’ancien gouvernement irakien ou de certaines personnes ou entités présumées liées à ce dernier – à moins que ces avoirs ou ressources n’aient fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale –, et de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l’Irak. Quant aux personnes ou entités concrètes visées par ces mesures, la Cour observe que, à l’exception de Saddam Hussein, aucune autre personne n’est désignée nommément dans le paragraphe 23 susvisé ; cependant, la Résolution 1518 (2003) confie à un comité des sanctions spécialement constitué la tâche d’identifier les personnes concernées et de les inscrire sur des listes nominatives.
143. La Cour rappelle toutefois qu’à la différence notable des affaires Al-Jedda et Nada précitées (ainsi que de l’affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, CEDH 2011), la présente affaire ne porte ni sur la substance des droits matériels touchés par les mesures litigieuses ni sur la compatibilité de celles-ci avec les exigences de la Convention. La compétence de la Cour se limite ici à dire si les requérants ont ou non bénéficié des garanties du volet civil de l’article 6 § 1, c’est‑à‑dire s’ils ont disposé d’un contrôle judiciaire adéquat (paragraphe 99 ci-dessus ; voir, mutatis mutandis, Stichting Mothers of Srebrenica et autres, décision précitée, § 137). Or, ni le paragraphe 23 de la Résolution 1483 (2003) ni aucune autre disposition de ce texte, ni la Résolution 1518 (2003) – compris suivant le sens ordinaire des termes qui y sont employés –, n’interdisaient explicitement aux tribunaux suisses de vérifier, sous l’angle du respect des droits de l’homme, les mesures prises au niveau national en application de la première de ces résolutions (voir, mutatis mutandis, Nada, précité, § 212). Au demeurant, la Cour ne décèle aucun autre élément juridique susceptible de légitimer une interprétation aussi restrictive et, partant, de démontrer l’existence d’une telle interdiction.
144. Dans l’affaire Nada, la Cour a accordé une importance particulière au fait que le paragraphe 2 b) de la Résolution 1390 (2002), relative à Oussama Ben Laden, au réseau Al-Qaïda ou aux talibans, imposait aux États d’interdire l’entrée des personnes visées sur leur territoire, mais qu’il « ne s’appliqu[ait] pas lorsque l’entrée ou le transit [était] nécessaire pour l’aboutissement d’une procédure judiciaire ». Elle a aussi noté que le paragraphe 8 de la même résolution exhortait tous les États « à prendre des mesures immédiates pour appliquer ou renforcer, par des mesures législatives ou administratives, selon qu’il conviendra, les dispositions applicables en vertu de leur législation ou de leur réglementation à l’encontre de leurs nationaux et d’autres personnes ou entités agissant sur leur territoire ». Les formulations « nécessaire » et « selon qu’il conviendra » laissaient donc aux autorités nationales une certaine souplesse en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de cette résolution (Nada, précité, §§ 177-178).
145. La Cour relève, par ailleurs, que l’inscription de particuliers sur les listes des personnes soumises aux sanctions décrétées par le Conseil de sécurité entraîne concrètement des ingérences pouvant être d’une extrême gravité pour les droits garantis par la Convention à ceux qui y figurent. Établies par des organes dont le rôle est limité à la déclinaison individuelle de décisions politiques prises par le Conseil de sécurité, ces listes traduisent néanmoins des choix dont les conséquences pour les personnes concernées peuvent être si lourdes qu’elles ne sauraient être mises en œuvre sans que soit ouvert un droit à un contrôle adéquat, d’autant plus indispensable que les listes en question sont le plus souvent établies dans des circonstances de crises internationales et à partir de sources d’informations peu propices aux garanties qu’exigent de telles mesures. À cet égard, la Cour tient à rappeler que l’objet et le but de la Convention, instrument de protection des droits de l’homme protégeant les individus de manière objective (Neulinger et Shuruk, précité, § 145), appellent à interpréter et à appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (Artico, précité, § 33). La Cour rappelle ensuite que, la Convention étant un instrument constitutionnel de l’ordre public européen (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, § 75, série A no 310, et Al-Skeini et autres, précité, § 141), les États parties sont tenus, dans ce contexte, d’assurer un contrôle du respect de la Convention qui à tout le moins préserve les fondements de cet ordre public. Or, l’une des composantes fondamentales de l’ordre public européen est le principe de l’État de droit, dont l’arbitraire constitue la négation. Même dans le domaine de l’interprétation et de l’application du droit interne, où la Cour laisse aux autorités nationales une très large marge de manœuvre, elle le fait toujours, explicitement ou implicitement, sous réserve d’interdiction de l’arbitraire (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I, et Storck c. Allemagne, no 61603/00, § 98, CEDH 2005-V).
146. Il ne saurait en aller autrement s’agissant, pour la mise en œuvre d’une résolution du Conseil de sécurité, de l’inscription des personnes soumises aux mesures contestées sur des listes établies tant au niveau des Nations unies qu’au niveau national. Dès lors, vu la gravité de l’enjeu pour les droits de ces personnes garantis par la Convention, lorsqu’une résolution comme celle en cause en l’espèce, à savoir la résolution 1483, ne contient pas de formule claire et explicite excluant la possibilité d’un contrôle judiciaire des mesures prises pour son exécution, elle doit toujours être comprise comme autorisant les juridictions de l’État défendeur à effectuer un contrôle suffisant pour permettre d’éviter l’arbitraire. En limitant ce contrôle à l’arbitraire, la Cour tient compte de la nature et du but des mesures prévues par la résolution en question, afin de maintenir le juste équilibre entre la nécessité de veiller au respect des droits de l’homme et les impératifs de la protection de la paix et la sécurité internationales.
147. En pareil cas, dans l’hypothèse d’une contestation de la décision d’inscription ou du refus de radiation de la liste, les juridictions nationales doivent pouvoir obtenir, le cas échéant selon les modalités adaptées au degré de confidentialité à respecter en fonction des circonstances, des éléments suffisamment précis pour exercer le contrôle qui leur incombe en présence d’une allégation étayée et défendable formulée par des personnes inscrites sur les listes litigieuses et selon laquelle cette inscription est entachée d’arbitraire. À ce titre, l’impossibilité d’accéder à de telles informations est susceptible de constituer un solide indice du caractère arbitraire de la mesure litigieuse et cela d’autant plus si celle-ci se prolonge dans le temps, faisant durablement obstacle à tout contrôle judiciaire. Aussi l’État partie dont les autorités donneraient suite à l’inscription d’une personne – physique ou morale – sur une liste de sanctions sans s’être au préalable assuré – ou avoir pu s’assurer – de l’absence d’arbitraire dans cette inscription, engagerait sa responsabilité sur le terrain de l’article 6 de la Convention.
148. Par ailleurs, la CJUE a elle aussi jugé que « les principes régissant l’ordre juridique international issu des Nations unies n’impliqu[ai]ent pas qu’un contrôle juridictionnel de la légalité interne du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux serait exclu en raison du fait que cet acte vise à mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations unies » (arrêt Kadi I, précité, § 299 (paragraphe 62 ci-dessus)). Or, comme la Cour vient de le constater, le Conseil de sécurité est appelé à exercer ses fonctions dans le plein respect des droits de l’homme et en vue de promouvoir ceux-ci (paragraphe 140 ci‑dessus). En résumé, elle considère que le paragraphe 23 de la Résolution 1483 (2003) ne peut pas être compris comme excluant tout contrôle judiciaire des mesures prises pour le mettre en œuvre.
149. Dans ces circonstances, et dans la mesure où l’article 6 § 1 de la Convention est en jeu, la Cour estime que la Suisse n’était pas en l’espèce confrontée à un vrai conflit d’obligations susceptible d’entraîner l’application de la règle de primauté contenue dans l’article 103 de la Charte des Nations unies. Cette conclusion dispense la Cour de trancher la question de la hiérarchie entre les obligations des États parties à la Convention en vertu de cet instrument, d’une part, et celles découlant de la Charte des Nations unies, d’autre part (voir, mutatis mutandis, Nada, précité, § 197). De même, cette conclusion rend sans objet la question de l’application du critère de la protection équivalente soulevée par les requérants (paragraphe 102 ci-dessus). Dès lors, l’État défendeur ne peut pas valablement se contenter d’avancer la nature contraignante des résolutions du Conseil de sécurité ; il doit convaincre la Cour qu’il a pris – ou au moins tenté de prendre – toutes les mesures envisageables en vue d’adapter le régime des sanctions à la situation individuelle des requérants, leur assurant au moins une protection adéquate contre l’arbitraire (voir, mutatis mutandis, Nada, précité, § 196).
iii. L’étendue des obligations de l’État défendeur en l’espèce
150. Se tournant vers les obligations précises imposées par la Convention à la Suisse dans la présente affaire, la Cour admet que le Tribunal fédéral ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé ou l’opportunité des mesures que comportait l’inscription des requérants sur la liste. En effet, pour ce qui est de la substance des sanctions – en l’espèce, le gel des avoirs et des biens des hauts responsables de l’ancien gouvernement irakien ordonné par le paragraphe 23 de la Résolution 1483 (2003) –, la Cour considère que ce choix relevait du rôle éminent du Conseil de sécurité en tant que décideur politique ultime dans ce domaine. En revanche, avant d’exécuter les mesures susmentionnées, les autorités suisses devaient s’assurer de l’absence de caractère arbitraire dans cette inscription. Or, dans ses arrêts du 23 janvier 2008, le Tribunal fédéral s’est limité à contrôler si les noms des requérants figuraient effectivement sur les listes établies par le comité des sanctions et si les avoirs concernés leur appartenaient, ce qui était insuffisant pour s’assurer que l’inscription des requérants était exempte d’arbitraire.
151. Au contraire, les requérants auraient dû disposer au moins d’une possibilité réelle de présenter et de faire examiner au fond, par un tribunal, des éléments de preuve adéquats pour tenter de démontrer que leur inscription sur les listes litigieuses était entachée d’arbitraire. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. Le fait que, à la différence de l’affaire Nada (idem, § 187), les requérants dans la présente affaire n’ont soumis – ni devant le Tribunal fédéral suisse, ni devant la Cour elle-même –, aucun argument précis tendant à démontrer qu’ils n’auraient pas dû figurer sur la liste établie par le comité des sanctions ne change rien à cette analyse, dès lors que ce ne sont pas ces carences qu’ont retenues les autorités suisses pour ne pas examiner le recours des requérants. Par conséquent, le droit des requérants d’accéder à un tribunal a été atteint dans sa substance même.
152. La Cour relève par ailleurs que les requérants ont subi et subissent toujours des restrictions importantes. La confiscation de leurs avoirs a été prononcée le 16 novembre 2006. Ils sont donc privés de l’accès à leurs avoirs depuis déjà longtemps, même si la décision de confiscation n’a pas encore été mise en œuvre. Or, l’impossibilité absolue de toute contestation de cette confiscation pendant des années est à peine concevable dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Nada, précité, § 186 ; voir également, pour la nature fondamentale du droit d’accès à un tribunal, les arrêts de la CJUE et des juridictions internes cités aux paragraphes 59-65 et 70-77 ci‑dessus).
153. La Cour constate que le système de sanctions des Nations unies, et notamment la procédure d’inscription de personnes physiques et morales sur les listes des personnes visées et les modalités de traitement des requêtes par lesquelles elles demandent à en être radiées, ont fait l’objet de critiques très sérieuses, répétées et convergentes de la part des Rapporteurs spéciaux de l’ONU (paragraphes 52-55 ci-dessus), partagées par des sources extérieures à cette organisation. Ainsi en est-il de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans sa Résolution 1597 (2008) (paragraphe 58 ci-dessus). De telles critiques ont également été formulées par plusieurs juridictions, telle la CJUE, la Cour suprême du Royaume Uni et la Cour fédérale du Canada (paragraphes 59-65 et 70-77 ci-dessus). Le gouvernement défendeur admet lui-même que le système applicable en l’espèce – même dans sa forme améliorée à la suite de la Résolution 1730 (2006) –, permettant aux requérants de demander auprès d’un « point focal » leur radiation des listes établies par le Conseil de sécurité, n’offre pas une protection satisfaisante (paragraphe 114 ci-dessus). L’accès à ces procédures ne pouvait donc ni remplacer un contrôle juridictionnel approprié au niveau de l’État défendeur ni même compenser en partie son absence.
154. Au demeurant, la Cour note que les autorités suisses ont pris certaines mesures concrètes en vue d’améliorer la situation des requérants, montrant de la sorte que la Résolution 1483 (2003) pouvait être appliquée avec souplesse (paragraphes 31-32 et 34 ci-dessus). Cependant, toutes ces mesures n’étaient pas suffisantes à la lumière des obligations décrites ci‑dessus et incombant à la Suisse en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention.
155. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la présente affaire.
ARRÊT DE CHAMBRE AL-DULIMI ET MONTANA MANAGEMENT INC. c. SUISSE Requête 5809/08 du 26 novembre 2013
a) Question préalable : La coexistence des garanties de la Convention et des obligations imposées aux Etats par les résolutions du Conseil de sécurité
111. Selon une jurisprudence constante, les Parties contractantes sont responsables en vertu de l’article 1 de la Convention de toutes les actions et omissions de leurs organes, que celles-ci découlent du droit interne ou d’obligations juridiques internationales. L’article 1 ne fait aucune distinction à cet égard entre les différents types de normes ou de mesures et ne soustrait aucune partie de la « juridiction » des Parties contractantes à l’empire de la Convention (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, précité, § 153, et Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 29, Recueil 1998-I). Les engagements conventionnels contractés par l’Etat après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard peuvent donc engager sa responsabilité au regard de cet instrument (Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, no 61498/08, § 128, CEDH 2010, et Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, précité, § 154, avec les références citées).
112. Par ailleurs, la Cour rappelle que la Convention ne doit pas être interprétée isolément mais de manière à se concilier avec les principes généraux du droit international. En vertu de l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, l’interprétation d’un traité doit se faire en tenant compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties », en particulier de celles relatives à la protection internationale des droits de l’homme (voir, par exemple, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 131, CEDH 2010, Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI, et Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 29, série A no 18).
113. Le gouvernement défendeur ainsi que les gouvernements français et britannique, tiers intervenants, soutiennent que les autorités suisses n’avaient aucune latitude dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité pertinentes en l’espèce. La Cour rappelle que dans l’affaire Al‑Jedda, (arrêt précité, § 109), elle a estimé que la résolution en cause, à savoir la Résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité, autorisait le Royaume-Uni à prendre des mesures pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Irak, mais que ni cette résolution ni aucune autre résolution adoptée ultérieurement par le Conseil de sécurité n’imposait expressément ou implicitement au Royaume-Uni d’incarcérer, sans limitation de durée ni inculpation, un individu qui, selon les autorités, constituait un risque pour la sécurité en Irak. Ultérieurement, dans l’affaire Nada (arrêt précité, § 172), elle a conclu en revanche que la Résolution 1390 (2002) demande expressément aux Etats d’interdire l’entrée et le transit sur leur territoire des personnes figurant sur la liste des Nations unies. Il en découlait, selon la Cour, que la présomption selon laquelle « le Conseil de sécurité n’entend pas imposer aux Etats membres une quelconque obligation qui contreviendrait aux principes fondamentaux en matière de sauvegarde des droits de l’homme » (Al-Jedda, précité, § 102), était renversée en l’espèce, eu égard aux termes clairs et explicites employés dans le cadre de cette résolution, imposant une obligation d’introduire des mesures susceptibles de violer les droits de l’homme.
114. La Cour rappelle que la Convention n’interdit pas aux Parties contractantes de transférer des pouvoirs souverains à une organisation internationale à des fins de coopération dans certains domaines d’activité. Les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la Convention de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d’observer les obligations juridiques internationales (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, précité, §§ 152‑153). Une mesure de l’Etat prise en exécution de pareilles obligations juridiques doit être réputée justifiée dès lors qu’il est constant que l’organisation en question accorde aux droits fondamentaux une protection à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention. En d’autres termes, si l’on considère que l’organisation offre semblable protection équivalente, il y a lieu de présumer que les Etats respectent les exigences de la Convention lorsqu’ils ne font qu’exécuter des obligations juridiques résultant de leur adhésion à l’organisation (Michaud c. France, no 12323/11, § 103, 6 décembre 2012). En revanche, un Etat demeure entièrement responsable au regard de la Convention de tous les actes ne relevant pas strictement de ses obligations juridiques internationales, notamment lorsqu’il a exercé un pouvoir d’appréciation (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 338, CEDH 2011, et Michaud, précité, § 103).
115. Le critère de la protection équivalente est bien établi dans la jurisprudence de la Cour (outre les arrêts Michaud et Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, précités, voir, en particulier, l’affaire Gasparini c. Italie et Belgique (déc.), no 10750/03, 12 mai 2009, dans laquelle la Cour a conclu que « la protection offerte au requérant en l’espèce par le mécanisme de règlement interne des conflits de l’OTAN n’était donc pas entachée d’une « insuffisance manifeste » au sens donné à ce terme dans l’arrêt Bosphorus, particulièrement dans le contexte spécifique d’une organisation telle que l’OTAN » ; voir, pour d’autres références, mais moins explicites, au critère de la protection équivalente, Galić c. Pays-Bas (déc.), § 46, no 22617/07, 9 juin 2009, Blagojević c. Pays‑Bas (déc.), § 46, no 49032/07, 9 juin 2009, et Rambus Inc. c. Allemagne (déc.), no 40382/04, 16 juin 2009).
116. La plupart des affaires précitées concerne le rapport entre le droit de l’Union européenne et les garanties découlant de la Convention. La Cour constate néanmoins qu’elle n’a jamais exclu d’appliquer le critère de la protection équivalente à une situation concernant la compatibilité avec la Convention d’actes relevant d’autres organisations internationales que l’Union européenne. En effet, elle estime que la présomption de protection équivalente vise en particulier à éviter qu’un Etat partie soit confronté à un dilemme lorsqu’il lui faut invoquer les obligations juridiques qui s’imposent à lui, en raison de son appartenance à une organisation internationale non partie à la Convention (Michaud, précité, § 104). Or, comme en témoigne la présente affaire, ce dilemme peut se présenter pour un Etat aussi bien du fait de son appartenance à l’Union européenne, en tant qu’organisation supranationale de vocation européenne, qu’en sa qualité d’Etat membre des Nations unies.
117. La Cour estime que la présente affaire se prête à un examen à la lumière du critère de la protection équivalente, en particulier du fait que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment le paragraphe 23 de la Résolution 1483 (2003), ne confèrent aux Etats visés aucun pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre des obligations en découlant. A cet égard, la situation de l’espèce se distingue essentiellement de celle de l’affaire Nada, précitée, dans laquelle la Grande Chambre a conclu que la Suisse jouissait d’une certaine latitude dans la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité (Nada, précité, §§ 175-180).
118. En ce qui concerne la protection offerte dans la présente affaire, la Cour constate que le gouvernement défendeur admet lui-même que le système en place, même dans sa forme améliorée à la suite de la Résolution 1730 (2006), permettant aux requérants de demander auprès d’un « point focal » leur radiation des listes établies par le Conseil de sécurité, n’offre pas une protection équivalente à celle qu’exige la Convention (paragraphe 106 ci-dessus). La Cour partage ce point de vue.
119. Cette conclusion se voit par ailleurs confirmée dans le rapport du 26 septembre 2012 du Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme (paragraphe 62 ci-dessus). Le Rapporteur spécial y exprime clairement qu’en dépit des progrès considérables accomplis sur le plan de la procédure grâce aux Résolutions 1904 (2009) et 1989 (2011) du Conseil de sécurité, ayant créé un bureau du médiateur, le régime des sanctions contre Al-Qaïda établi par la Résolution 1267 (1989) ne garantit toujours pas le respect des normes internationales minimales en la matière (paragraphe 59 du rapport, cité au paragraphe 64 ci‑dessus). La Cour se rallie sans réserve à cette conclusion du Rapporteur spécial.
120. En l’absence d’un mécanisme de contrôle comparable au bureau du médiateur créé dans le cadre du régime des sanctions contre l’ancien gouvernement irakien prévu par la Résolution 1483 (2003), il s’ensuit, a fortiori, que la protection offerte au niveau international n’est pas équivalente à celle découlant de la Convention. Par ailleurs, les défauts procéduraux du régime des sanctions ne sauraient en l’espèce être considérés comme étant compensés par des mécanismes internes de protection des droits de l’homme, étant donné que le Tribunal fédéral a refusé de contrôler le bien-fondé des mesures litigieuses (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Nada, précité, § 213, dans lequel la Cour a conclu que le requérant n’a eu à sa disposition aucun moyen effectif de demander la radiation de son nom de la liste annexée à l’ordonnance sur les talibans et, dès lors, de faire remédier aux violations de la Convention qu’il dénonçait).
121. Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que la présomption de protection équivalente ne trouve pas à s’appliquer.
122. Dès lors, il incombe à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé du grief concernant le droit d’accès à un tribunal.
b) L’examen du grief concernant l’accès à un tribunal
i. Les principes généraux applicables
123. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX). Chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, § 54, CEDH 2010 ; Golder, précité, § 36 ; et Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII).
124. Toutefois, le droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient en revanche à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle se doit de vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation au droit d’accès à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cudak, précité, § 55 ; Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I ; T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 98, CEDH 2001-V ; et Fogarty c. Royaume-Uni [GC], no 37112/97, § 33, CEDH 2001-XI).
125. Il y a lieu aussi de rappeler que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut également pour le droit d’accès aux tribunaux, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Aït-Mouhoub c. France, 28 octobre 1998, § 52, Recueil 1998-VIII). Il serait incompatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique et avec le principe fondamental qui sous-tend l’article 6 § 1, à savoir que les revendications civiles doivent pouvoir être portées devant un juge, qu’un Etat puisse, sans réserve ou sans contrôle des organes de la Convention, soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérer de toute responsabilité des catégories de personnes (Fayed c. Royaume-Uni, 21 septembre 1994, § 65, série A no 294-B).
ii. Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
– Limitation du droit d’accès à un tribunal
126. La Cour estime que les requérants, qui ont en vain tenté de saisir les juridictions suisses pour contester la confiscation de leurs avoirs, ont subi une limitation de leur droit d’accès à un tribunal. Cela ne semble pas avoir été mis en question par le gouvernement défendeur. Dès lors, il convient d’examiner si cette limitation poursuivait un but légitime et s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
– Justification de la limitation
127. Selon le gouvernement défendeur, la restriction du droit d’accès à un tribunal poursuit un but légitime, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationales. La Cour est prête à accepter cette conclusion. Adoptée par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte, la Résolution 1483 (2003), qui est à la base de la restriction litigieuse, avait pour but d’imposer aux Etats membres toute une série de mesures en vue de la stabilisation et du développement de l’Irak. Il s’agissait notamment, en vertu du paragraphe 23 de cette résolution, de garantir que des avoirs et des biens de hauts responsables de l’ancien gouvernement irakien, dont le premier requérant, qui, selon le Conseil de sécurité, était un ancien responsable des finances des services secrets irakiens, fussent transférés au Fonds de développement pour l’Irak et, partant, rendus au peuple irakien pour qu’il en bénéficiât, un but pleinement compatible avec la Convention.
128. La Cour accepte l’argument du gouvernement défendeur selon lequel le refus des tribunaux internes d’examiner au fond les griefs des requérants découlant de la confiscation de leurs avoirs était inspiré par leur souci d’assurer une mise en œuvre efficace au niveau interne des obligations découlant de ladite résolution.
– Existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
129. En ce qui concerne le rapport entre les moyens employés et le but visé, la Cour observe d’emblée que le Tribunal fédéral a exposé, dans des arrêts très détaillés, les motifs pour lesquels il se considérait incompétent pour examiner les demandes des requérants tendant à l’annulation de la confiscation (paragraphe 38 ci-dessus). Il a par ailleurs vérifié si les noms des requérants figuraient effectivement sur les listes établies par le comité des sanctions et si les avoirs concernés leur appartenaient. En revanche, il a refusé d’examiner au fond les allégations des requérants concernant leurs droits de caractère civil.
130. La Cour estime que, contrairement à la situation qui était à l’origine des mesures dont se plaignait le requérant dans l’affaire Nada (précitée), il ne s’agissait pas, en l’espèce, par l’adoption de la Résolution 1483 (2003) de répondre à une menace imminente de terrorisme, mais de réinstaller l’autonomie et la souveraineté du gouvernement irakien et de garantir au peuple de ce pays le droit de déterminer librement son avenir politique et de contrôler ses ressources naturelles (voir, dans ce sens, l’alinéa 4 du préambule de la Résolution 1483 (2003). Par conséquent, les mesures litigieuses s’inscrivent dans le prolongement d’un conflit armé, qui a eu son origine en 1990. Des mesures plus différenciées et ciblées semblent dès lors plus facilement compatibles avec une mise en œuvre efficace des résolutions (voir, dans ce sens également, l’arrêt Nada, précité, § 186, dans lequel la Cour a estimé que le maintien, voire le renforcement des mesures litigieuses au fil du temps doit être expliqué et justifié de manière convaincante par les autorités internes).
131. La Cour considère par ailleurs que les requérants subissent des restrictions importantes. Ceux-ci allèguent que leurs avoirs ont déjà été gelés en 1990, allégation non contestée par le Gouvernement. La confiscation de leurs avoirs a été prononcée le 16 novembre 2006. Les requérants sont donc privés de l’accès à leurs avoirs depuis un laps de temps considérable déjà, même si la décision de confiscation n’a pas encore été mise en œuvre. Sans devoir se pencher sur le bien-fondé de ces mesures, la Cour estime que les requérants ont le droit, conformément à l’article 6 § 1, de le faire contrôler par un tribunal. L’impossibilité de contester la confiscation pendant des années est à peine concevable dans une société démocratique (voir, pour la nature fondamentale du droit d’accès à un tribunal, l’affaire Kadi, arrêt de la Cour de justice, §§ 335 et suiv. (paragraphes 51 et suiv. ci-dessus), l’opinion de Lord Hope dans l’affaire Ahmed and Others v. HM Treasury, arrêt de la Cour suprême du Royaume‑Uni du 27 janvier 2010 (paragraphes 67 et suiv. ci-dessus), l’opinion du juge Zinn dans l’affaire Abdelrazik v. Canada (Ministre des Affaires étrangères) de la Cour fédérale du Canada du 4 juin 2009, § 51 (paragraphe 71 ci-dessus)).
132. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé qu’il appartenait à l’instance inférieure d’octroyer au premier requérant un bref et dernier délai pour lui permettre d’introduire devant le comité des sanctions une nouvelle procédure de radiation selon les modalités améliorées par la Résolution 1730 (2006), notamment la création d’un point focal pouvant recevoir des demandes de radiation. Or, ladite demande a été rejetée le 6 janvier 2009 (paragraphe 39 ci-dessus).
133. Le Gouvernement soutient par ailleurs que les autorités suisses ont fait droit à quatre demandes des requérants qui sollicitaient l’accès aux avoirs gelés pour le paiement de leurs frais de défense. Les intéressés auraient également été informés de l’autorisation de recourir aux avoirs gelés en Suisse pour régler les futurs honoraires d’un avocat américain pour la procédure de confiscation en Suisse et la procédure de radiation devant le comité des sanctions (paragraphes 44 et 45 ci-dessus). La Cour estime que ces mesures sont certes susceptibles d’alléger dans une certaine mesure les restrictions apportées à la jouissance par les requérants de leur propriété, mais elles ne portent pas remède à l’impossibilité de faire examiner par un tribunal le bien-fondé des restrictions dont les intéressés se plaignent devant la Cour sur le terrain de l’article 6.
134. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que tant qu’il n’existe pas d’examen judiciaire efficace et indépendant, au niveau des Nations unies, de la légitimité de l’inscription des personnes et entités sur leurs listes, il est essentiel que ces personnes et entités soient autorisées à demander l’examen par les tribunaux nationaux de toute mesure prise en application du régime des sanctions. Or, les requérants n’ont pas bénéficié d’un tel contrôle. Il s’ensuit que leur droit d’accès à un tribunal a été atteint dans sa substance même.
135. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
L'IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE ET DES ETATS
RENOUARD c. FRANCE du 27 novembre 2025 requête n° 46911/21
Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Octroi de l’immunité de juridiction aux Émirats Arabes Unis (EAU) rendant irrecevable une demande concernant l’absence de rémunération du requérant pour sa qualité d’intermédiaire auprès des autorités françaises pour la création d’une université aux EAU • Analyse approfondie des juridictions internes de la transaction litigieuse, s’appuyant sur la nature et le but de la mission litigieuse, pour considérer que celle-ci participait à l’exercice de la souveraineté des EAU • Approche non entachée d’arbitraire et ne s’étant pas écartée des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des États • Décisions des juridictions internes motivées en fait et en droit • Restriction au droit du requérant d’accéder à un tribunal non disproportionnéeCEDH : Principe généraux
35. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, §§ 28-36, série A no 18, Fogarty c. Royaume-Uni [GC], no 37112/97, § 32, CEDH 2001-XI (extraits), et Jones et autres c. Royaume-Uni, nos 34356/06 et 40528/06, § 186, CEDH 2014).
36. Toutefois, le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande par sa nature même une règlementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (McElhinney c. Irlande [GC], no 31253/96, § 34, CEDH 2001‑XI (extraits), Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, § 55, CEDH 2010, et Sabeh El Leil c. France [GC], no 34869/05, § 47, 29 juin 2011).
37. Par ailleurs, la Convention doit s’interpréter à la lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui énonce en son article 31 § 3 c) qu’il faut tenir compte « de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties ». En effet, la Convention, y compris son article 6, ne saurait s’interpréter dans le vide. Aussi la Cour ne doit-elle pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l’homme que revêt la Convention, mais elle doit également tenir compte des principes pertinents du droit international, y compris ceux relatifs à l’octroi de l’immunité aux États (Fogarty, précité, § 35, Cudak, précité, § 56, Sabeh El Leil, précité, § 48, et Oleynikov c. Russie, no 36703/04, § 56, 14 mars 2013).
38. Dès lors, on ne saurait, de façon générale, considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1 de la Convention des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent les règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des États. De même que le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet article, de même certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité des États (Fogarty, précité, § 36, McElhinney, précité, § 37, Cudak, précité, § 57, et Sabeh El Leil, précité, § 49).
39. S’agissant des règles de droit international applicables, la Cour rappelle qu’il est bien établi en droit international que, même non ratifiée, une disposition d’un traité peut avoir force contraignante, en plus des obligations créées pour les parties contractantes, si elle reflète le droit international coutumier, soit qu’elle « codifie » ce dernier, soit qu’elle donne naissance à de nouvelles règles coutumières (Cudak, précité, § 66, et Sabeh El Leil, précité, § 54). Ainsi, la Cour a déjà dit, à propos des articles 10 et 11 de la CNUIJE, que ces dispositions s’appliquent au titre du droit international coutumier, même si l’État défendeur n’a pas ratifié cette convention, dès lors qu’il ne s’y est pas non plus opposé (Sabeh El Leil, précité, §§ 57 et 58, et Oleynikov, précité, § 66).
40. Il y a lieu de rappeler en outre que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter le droit interne (Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 149, 19 décembre 2018). Il en va de même lorsque le droit interne renvoie à des dispositions du droit international général ou d’accords internationaux (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I). Sauf si l’interprétation est arbitraire ou manifestement déraisonnable, la tâche de la Cour se limite à déterminer si ses effets sont compatibles avec la Convention (J.C. et autres c. Belgique, no 11625/17, § 55, 12 octobre 2021).
41. La Cour rappelle également que pareille limitation doit poursuivre un but légitime et que l’immunité des États, consacrée par le droit international, est issue du principe par in parem non habet imperium, en vertu duquel un État ne peut être soumis à la juridiction d’un autre État (Cudak, précité, § 60, Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 54, CEDH 2001-XI, et Sabeh El Leil, précité, § 52). Elle a estimé que l’octroi de l’immunité à un État dans une procédure civile poursuivait le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États par le respect de la souveraineté d’un autre État (ibidem).
42. Enfin, la restriction litigieuse doit également être proportionnée au but poursuivi. La Cour rappelle à cet égard que l’immunité absolue des États a subi depuis de nombreuses années une érosion certaine, en particulier avec l’adoption de la CNUIJE (Cudak, précité, § 64, et Sabeh El Leil, précité, § 53).
Application de ces principes au cas d’espèce
43. En l’espèce, à l’instar des parties qui s’accordent sur ce point, la Cour considère que l’octroi de l’immunité de juridiction aux EAU poursuivait ce but légitime.
44. Reste à trancher la question de savoir si la restriction litigieuse au droit d’accès du requérant à un tribunal avait une base légale suffisante et était proportionnée au but poursuivi.
45. À cet égard, la Cour rappelle que les dispositions d’un traité international qui reflètent le droit coutumier s’appliquent à l’État défendeur, même s’il n’a pas ratifié ce traité, dès lors qu’il ne s’y est pas non plus opposé. En l’espèce, elle observe que si la CNUIJE n’est pas entrée en vigueur à ce jour, la France a non seulement signé cette convention le 17 janvier 2007, mais elle l’a également ratifiée le 28 juin 2011 (paragraphe 16 ci-dessus).
46. La Cour relève également que, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les juridictions internes excluent, au visa des principes de droit international, l’immunité de juridiction des États étrangers dès lors que l’acte ayant donné lieu au litige est un acte de gestion (paragraphe 14 ci‑dessus). Si, pour ce faire, elles ne se réfèrent pas spécifiquement aux dispositions de la CNUIJE, reste qu’elles se prononcent au regard des critères énoncés dans l’article 2 de cette convention pour déterminer si l’acte litigieux peut se voir qualifier d’acte de gestion (paragraphe 15 ci-dessus).
47. Dès lors, la Cour considère qu’il n’y a aucune raison de se départir de la conclusion des juridictions internes selon laquelle les articles 2 et 10 de la CNUIJE, pertinents en l’espèce, s’appliquent à l’État défendeur, au titre du droit coutumier (pour une approche similaire voir Cudak, précité, §§ 66 et 67, Sabeh El Leil, précité, § 54, et Oleynikov, précité, § 66).
48. La Cour va donc examiner les décisions rendues par les juridictions internes dans la présente affaire à la lumière de ces règles internationales et au regard de l’article 6 § 1 de la Convention.
49. Se référant à la définition de la « transaction commerciale » prévue à l’article 2 de la CNUIJE (paragraphe 18 ci-dessus), la Cour considère que, le critère du but (ou de la finalité) de la transaction étant utilisé en droit français (paragraphes 14 et 15 ci-dessus), celui-ci doit être pris en considération en l’espèce, en plus de celui de la nature de la transaction.
50. À cet égard, la Cour observe que, dans la présente affaire, les juridictions internes, y compris la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 octobre 2015 ayant écarté l’immunité de juridiction des EAU, se sont constamment référées à ces deux critères pour déterminer si la mission confiée au requérant par l’État émirien dans le cadre de la création de l’UPSAD devait être qualifiée de « transaction commerciale » au sens de l’article 10 de la CNUIJE.
51. S’agissant du poids accordé au critère du but de la transaction, la Cour relève que l’absence d’écrit rendait plus difficile en l’espèce l’analyse de la nature du mandat allégué (en particulier, le contenu précis de la mission et l’existence éventuelle de clauses exorbitantes du droit commun), alors que la finalité de l’opération était largement documentée. Elle constate que les juridictions internes n’ont cependant pas omis de prendre en considération la nature de la transaction litigieuse. En effet, dans son arrêt du 28 mai 2019, la cour d’appel de Paris a d’abord constaté que le mandat confié au requérant avait pour objet, selon les propres affirmations du requérant, d’œuvrer auprès des autorités françaises pour la réalisation d’un projet d’implantation à Abou Dhabi d’une antenne de l’université La Sorbonne. Elle a ensuite répondu de manière détaillée au requérant qui soutenait que le montant élevé des frais d’inscription à l’UPSAD établissait la nature marchande ou commerciale de l’opération (paragraphe 11 ci-dessus), en mettant en évidence les liens étroits existant entre l’UPSAD et les autorités émiriennes. La Cour note à cet égard que la cour d’appel ne s’est pas contentée d’affirmations, mais qu’elle a justifié sa décision en se référant aux documents et faits portés à sa connaissance (comparer avec Sabeh El Leil, précité, § 64).
52. La Cour constate ainsi que les juridictions internes ont procédé en l’espèce à une analyse approfondie de la transaction litigieuse (comparer avec Oleynikov, précité, §§ 69 à 71), s’appuyant sur des éléments tenant à la fois à la nature et au but de la mission litigieuse pour considérer que celle-ci participait à l’exercice de la souveraineté des EAU. Après avoir répondu à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant, elles en ont conclu, par des décisions motivées en fait et en droit, que l’immunité de juridiction des EAU s’appliquait en l’espèce. De l’avis de la Cour, cette approche qui n’est pas incompatible avec les règles internationales coutumières consacrées aux articles 2 et 10 de la CNUIJE, n’est entachée d’aucun arbitraire ni d’aucune interprétation déraisonnable dans la manière dont les juridictions internes ont appliqué ces règles au cas d’espèce (voir pour une approche similaire J.C. et autres c. Belgique, précité, § 63).
53. S’agissant du manque allégué d’indépendance et d’impartialité des juridictions émiriennes, la Cour note d’abord que le requérant se borne, sur ce point, à critiquer l’appréciation de la charge de la preuve par les juridictions internes. La Cour considère ensuite, que, compte tenu du principe de l’immunité de juridiction des États qui a pour finalité de sauvegarder la courtoisie et les bonnes relations entre États, on ne saurait reprocher aux juridictions françaises d’avoir refusé de présumer le manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions émiriennes. Enfin, elle considère que rien ne permet de remettre en cause l’appréciation des juridictions internes qui ont conclu que le requérant n’avait pas démontré que son action en paiement d’honoraires devant les juridictions émiriennes se heurtait au fait que la législation émirienne soustrairait à la compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérerait de toute responsabilité des catégories de personnes.
54. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour déduit que les juridictions françaises ne se sont pas écartées, dans la présente affaire, des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des États et que l’on ne saurait considérer la restriction au droit du requérant d’accéder à un tribunal comme disproportionnée au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
55. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
NDAYEGAMIYE-MPORAMAZINA c. SUISSE du 5 février 2019 requête n° 16874/12
Non violation de l'article 6-1 : Une secrétaire membre de la mission permanente diplomatique du Burundi, près de l'ONU à Genève saisit les juridictions suisses contre son employeur. Elle subit l'immunité diplomatique du Burundi qui empêche les juridictions suisses d'examiner son recours.
La CEDH estime que l’octroi de l’immunité souveraine à un État dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États grâce au respect de la souveraineté d’un autre État.
Dès lors, il convient d’examiner si la restriction litigieuse du droit d’accès de la requérante à un tribunal était proportionnée au but poursuivi. C'est parfaitement le cas en l'espèce puisqu'il appartient à la requérante de saisir les juridictions administratives du Burundi sans que celles -ci ne puissent opposer une prescription, puisqu'elle a agi devant les juridictions suisses.
1. Le droit international
21. En principe, l’immunité de juridiction des États est régie par le droit international coutumier.
22. Le 16 avril 2010, la Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens (« la CNUIJE », publiée dans le recueil systématique (RS) sous le numéro 0.273.2), qui n’est pas encore entrée en vigueur. D’après le Conseil fédéral suisse, la Suisse, « qui a pris une part active à l’élaboration du texte, a aisément pu se rallier au consensus relatif à son adoption, car la convention codifie au niveau international, pour l’essentiel, des principes appliqués par le Tribunal fédéral depuis 1918 » (Message du Conseil fédéral du 25 février 2009 concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention de l’ONU sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens ; Feuille fédérale (FF) 2009 1443, 1444).
23. La CNUIJE reconnaît le principe général de l’immunité de l’État et de ses biens devant les tribunaux d’un autre État en son article 5 (règle exprimée par l’adage par in parem non habet imperium, selon lequel un État ne peut être soumis à la juridiction d’un autre État).
24. L’article 7 de la CNUIJE (Consentement exprès à l’exercice de la juridiction) est libellé comme suit :
« 1. Un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction dans une procédure devant un tribunal d’un autre État à l’égard d’une matière ou d’une affaire s’il a consenti expressément à l’exercice de la juridiction de ce tribunal à l’égard de cette matière ou de cette affaire :
a) Par accord international ;
b) Dans un contrat écrit ; ou
c) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite dans une procédure déterminée.
2. (...). »
25. Dans son rapport soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies sur les travaux de sa quarante‑troisième session, de 1991, la Commission du droit international précisait, dans la partie « projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens et commentaires y relatifs » (« le projet d’articles de la Commission du droit international ») ce qui suit dans son commentaire relatif à l’article 7 (Annuaire de la Commission du droit international 1991 [deuxième partie], A/CN.4/SER.A/1991/Add.I (Part 2), page 27, point 8) :
« En aucun cas, il n’y a donc lieu de présumer le consentement d’un État qui ne se montre pas disposé à consentir et qui n’a pas exprimé son consentement clairement et sans équivoque (...). »
26. L’article 11 de la CNUIJE (Contrats de travail) est ainsi libellé :
« 1. À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas :
a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique ;
b) Si l’employé est :
i) Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ;
ii) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ;
iii) Membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est engagé pour représenter un État lors d’une conférence internationale ; ou
iv) S’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique ;
c) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat ;
d) Si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis du chef de l’État, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l’État employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité ;
e) Si l’employé est ressortissant de l’État employeur au moment où l’action est engagée, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’État du for ; ou
f) Si l’employé et l’État employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’État du for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action. »
27. Dans le projet d’articles de la Commission du droit international (idem, pages 42-43), l’article 11 était ainsi rédigé :
« 1. À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas :
a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions étroitement liées à l’exercice de la puissance publique ;
b) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat ;
c) Si l’employé n’était ni ressortissant ni résident habituel de l’État du for au moment où le contrat de travail a été conclu ;
d) Si l’employé est ressortissant de l’État employeur au moment où l’action est engagée ; ou
e) Si l’employé et l’État employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’État du for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action. »
28. Dans le commentaire y afférent (idem, pages 45-46), la Commission du droit international précisait ce qui suit quant aux exceptions contenues aux lettres c) et d) de cet article :
« 11) L’alinéa c du paragraphe 2 prévoit lui aussi que l’immunité des États s’applique lorsque l’employé n’est ni ressortissant ni résident habituel de l’État du for, (...). La protection de l’État du for est limitée essentiellement à la main-d’œuvre locale, c’est-à-dire aux ressortissants de l’État du for et aux non-ressortissants qui y résident habituellement. Sans le lien de la nationalité ou de la résidence habituelle, l’État du for n’est plus fondé à revendiquer la prépondérance de sa législation du travail et de sa juridiction en la matière face à un État employeur étranger, malgré le lien territorial que constituent le lieu du recrutement de l’employé et le lieu où le travail doit être accompli conformément au contrat.
12) Une autre mesure de sauvegarde importante visant à protéger l’intérêt de l’État employeur est prévue à l’alinéa d du paragraphe 2. Si l’employé a la nationalité de l’État employeur au moment où l’action est engagée, ce fait emporte l’application de la règle de l’immunité de juridiction des tribunaux de l’État du for. S’agissant des relations entre un État et ses propres nationaux, aucun autre État ne doit revendiquer la prépondérance de sa juridiction pour des questions découlant de contrats de travail. Des voies de recours existent dans l’État employeur et les tribunaux peuvent y être saisis. La question de savoir si le droit à appliquer est le droit administratif ou le droit du travail de l’État employeur ou de tout autre État est sans importance en l’espèce. (...)
14) Les règles énoncées à l’article 11 apparaissent conformes à la tendance qui se fait jour depuis peu dans la pratique législative et conventionnelle d’un nombre toujours plus grand d’États. »
29. Il est à noter que la Cour suprême du Royaume-Uni a refusé d’appliquer l’article 11 § 2 e) de la CNUIJE en tant que règle de droit international coutumier (jugement du 18 octobre 2017 dans l’affaire Benkharbouche v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Libya v Janah, [2017] UKSC 62).
30. Pour un plus ample exposé, la Cour renvoie aux affaires Cudak c. Lituanie ([GC], no 15869/02, §§ 25-33, CEDH 2010-III) et Sabeh El Leil c. France ([GC], no 34869/05, §§ 18-23, 29 juin 2011).
2. Le droit interne
31. Des informations sur la pratique suisse (ainsi que sur celle d’autres États membres du Conseil de l’Europe) sont accessibles dans la « Base de données sur les immunités des États et des organisations internationales » du Comité des conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI) à l’adresse https://www.coe.int/fr/web/cahdi/database-immunities.
32. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a interprété la notion de « résidence permanente » figurant à l’article 11 § 2 e) de la CNUIJE comme suit (voir, à titre d’exemple, les arrêts du Tribunal fédéral 4A_542/2011 et 4A_544/2011 du 30 novembre 2011) :
« Pour cerner la notion de résidence permanente au sens de l’art. 11 al. 2 let. e CNUIJE, on peut s’inspirer de celle de résidence habituelle (...), que l’on trouve notamment dans les conventions internationales de La Haye élaborées depuis 1951 (...). La résidence habituelle implique la présence physique dans un lieu précis, l’impression objective donnée aux tiers d’y résider normalement étant plus importante que l’intention subjective de la personne concernée d’y créer le centre de sa vie (... ; cf. ATF 120 Ib 299 consid. 2a p. 302 [qui renvoie à la Résolution (72) 1 du Conseil de l’Europe du 18 janvier 1972 relative à l’unification des concepts juridiques de « domicile » et de « résidence »]). La résidence habituelle est généralement créée dans un but déterminé, notamment pour exercer une activité professionnelle; elle peut d’emblée être limitée dans le temps. (...) »
B. Sur les clauses attributives de juridiction dans les contrats individuels de travail internationaux
33. En droit suisse, pour que la renonciation à l’immunité de juridiction ou d’exécution soit valable, l’État doit expressément manifester son consentement à l’exercice par les tribunaux suisses de leur juridiction dans le cas litigieux (FF 2009 1443, 1456).
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
49. S’agissant des litiges relevant d’un contrat de travail conclu entre des ambassades ou missions permanentes et le personnel employé par celles-ci, la Cour renvoie aux principes généraux dégagés dans sa jurisprudence, qui ont été énoncés dans ses arrêts de Grande Chambre Fogarty c. Royaume‑Uni ([GC], no 37112/97, §§ 24-28, CEDH 2001‑XI (extraits)), Cudak (précité, §§ 54-59) et Sabeh El Leil (précité, §§ 46-54), et confirmés plus récemment dans ses arrêts de chambre Wallishauser c. Autriche (no 156/04, § 59, 17 juillet 2012), Radunović et autres c. Monténégro (nos 45197/13 et 2 autres, §§ 61-68, 25 octobre 2016) et Naku c. Lituanie et Suède (no 26126/07, § 86, 8 novembre 2016).
2. Application de ces principes à la présente espèce
50. La Cour note d’emblée que la présente affaire se distingue des affaires précitées au paragraphe précédent à plusieurs égards. Premièrement, le contrat de travail de la requérante contient un article concernant le « contentieux », qui, de l’avis de la requérante, constitue une clause de renonciation anticipée de la part de la République du Burundi à son immunité de juridiction (paragraphes 55 et suivants ci-dessous). Deuxièmement, la requérante, qui était ressortissante de l’État employeur au moment où elle a saisi les juridictions helvétiques de son action dirigée contre celui-ci, n’avait pas sa résidence permanente dans l’État du for, à savoir la Suisse, au moment où elle a introduit cette action (paragraphes 61 et suivants ci-dessous). Enfin, considérant les faits de l’espèce et les tâches effectivement confiées à la requérante au sein de la mission permanente, il y a un chevauchement complexe entre les actes jure imperii et jure gestionis accomplis par celle-ci (paragraphe 65 ci‑dessous).
51. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient en revanche à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle se doit de vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation du droit d’accès à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cudak, précité, § 55, avec les références qui y sont citées).
52. La Cour rappelle également que la Convention doit s’interpréter à la lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui dispose en son article 31 § 3 c) qu’il faut tenir compte de « toute règle de droit international applicable aux relations entre les parties ». La Convention, y compris son article 6, ne saurait s’interpréter dans le vide. La Cour ne doit pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l’homme que revêt la Convention et elle doit tenir compte des principes pertinents du droit international. La Convention doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international, dont elle fait partie intégrante, y compris celles relatives à l’octroi de l’immunité aux États (Cudak, précité, § 56, et Fogarty, précité, § 35).
53. À ce propos, la Cour rappelle que la doctrine de l’immunité absolue des États a subi depuis de nombreuses années une érosion certaine, en particulier avec l’adoption de la Convention sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (Cudak, précité, § 64). Notamment, dans le domaine des contrats de travail, l’article 11 § 1 de la CNUIJE dispose que, à moins que les États concernés n’en conviennent autrement (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), le principe qui prévaut est celui selon lequel un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État. L’article 11 § 2 a) à f) de la CNUIJE prévoit plusieurs exceptions à ce principe. Ainsi, à titre d’exemple, un État peut seulement invoquer l’exception d’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État « si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique » (article 11 § 2 a) de la CNUIJE) ou « si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat » (article 11 § 2 c) de la CNUIJE) ou « si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si (...) cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité » (article 11 § 2 d) de la CNUIJE). Jusqu’à présent, dans sa jurisprudence relative à l’article 11 de la CNUIJE (paragraphe 49 ci-dessus), la Cour n’a eu l’occasion d’analyser que ces exceptions qui émanent, en principe, du droit international coutumier.
54. En l’espèce, compte tenu du principe par in parem non habet imperium (paragraphe 23 ci-dessus), la Cour estime que l’octroi de l’immunité souveraine à un État dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États grâce au respect de la souveraineté d’un autre État (Cudak, précité, § 60, et Sabeh El Leil, précité, § 52).
55. Dès lors, il convient d’examiner si la restriction litigieuse du droit d’accès de la requérante à un tribunal était proportionnée au but poursuivi.
56. À l’instar de la requérante, qui le soulève à juste titre, la Cour estime qu’il n’y aurait pas lieu de procéder à une analyse des exceptions de l’article 11 § 2 de la CNUIJE si la République du Burundi avait consenti expressément à l’exercice de la juridiction des tribunaux suisses dans l’article 8 du contrat de travail (en application de l’article 7 § 1 b) de la CNUIJE ; paragraphe 24 ci-dessus).
57. À ce propos, la Cour note qu’un État étranger peut renoncer, notamment par le biais de clauses contractuelles, à son droit d’immunité devant les tribunaux d’un autre État (voir également l’article 11 § 2 f) de la CNUIJE). L’article 7 de la CNUIJE est identique à celui qui figure dans le projet d’articles de la Commission du droit international, et dont l’élément central est la présomption de l’absence de consentement de l’État à l’exercice de la juridiction, sauf consentement exprès. Le commentaire y relatif contenu dans ce projet d’articles précise que cette disposition correspond à la pratique des États et qu’elle relève du droit international coutumier. En ce qui concerne les exigences d’un tel consentement exprès, l’article 7 § 1 b) de la CNUIJE mentionne les dispositions contractuelles expresses par lesquelles un État exprime sa renonciation clairement et sans équivoque.
58. La Cour prend note de la position de la requérante, qui soutient que l’article 8 du contrat de travail correspondait clairement à la volonté des parties selon laquelle celui-ci constituait une clause de renonciation anticipée de la République du Burundi à son immunité de juridiction. Elle se plaint ainsi d’avoir subi une limitation disproportionnée de son droit d’accès à un tribunal aux motifs que le Tribunal fédéral a indûment admis l’immunité de juridiction de la République du Burundi.
59. La Cour observe d’emblée que le Tribunal fédéral et la Cour de justice ont accueilli l’exception d’immunité de juridiction soulevée par la République du Burundi, laquelle l’a de plus toujours invoquée pendant toute la procédure. En outre, elle note que trois instances nationales ont interprété la clause contenue dans l’article 8 du contrat de travail de manière très différente. Par conséquent, la Cour considère qu’il ne s’agit pas d’une clause contractuelle exprimant de manière expresse, claire et non équivoque l’intention de la République du Burundi de renoncer à son immunité de juridiction. Les allégations de la requérante ne sont d’ailleurs pas de nature à permettre à la Cour de remettre cette constatation en question. Cela vaut notamment pour le renvoi au procès-verbal du 14 avril 2011 (paragraphe 16 ci-dessus) auquel l’intéressée procède. En effet, il ressort uniquement de ce procès-verbal que la représentante de la République du Burundi avait relu, lors de l’audience devant la Cour de justice, l’article 8 du contrat de travail et avait simplement confirmé sa teneur, sans corroborer la thèse selon laquelle la République du Burundi avait interprété cette clause comme une disposition autorisant la requérante à saisir la justice suisse. Dans de telles circonstances, la Cour est d’avis que le Tribunal fédéral pouvait présumer que la clause en question n’était pas la manifestation d’une volonté claire et non équivoque de la part de la République du Burundi. Dès lors, la condition d’un consentement exprès prévue par l’article 7 § 1 b) de la CNUIJE faisant défaut dans la présente affaire, il s’ensuit que la République du Burundi n’a pas renoncé à son immunité de juridiction.
60. En l’espèce, le Tribunal fédéral avait noté que la disposition litigieuse n’autorisait pas la requérante à poursuivre la République du Burundi devant les tribunaux suisses, car la compétence du pouvoir judiciaire local n’y était envisagée que pour autant que les usages diplomatiques le permettaient. Aux yeux de la Cour, l’interprétation du Tribunal fédéral selon laquelle cette réserve des usages diplomatiques devait « être comprise comme visant l’ensemble des règles coutumières ou conventionnelles valables entre la République du Burundi et l’État du for relatives à la mission concernée, ce qui inclut l’immunité de juridiction », n’a rien d’arbitraire.
61. En ce qui concerne les litiges relevant d’un contrat de travail conclu entre des ambassades ou missions permanentes et le personnel employé par celles-ci pour accomplir des tâches subalternes, la Cour rappelle que, dans sa jurisprudence constante, qui reflète le droit international coutumier, elle a toujours protégé les ressortissants de l’État du for (Cudak, précité (requérante de nationalité lituanienne, et lieu de travail situé à Vilnius, en Lituanie), Sabeh El Leil, précité (requérant de nationalité française, et lieu de travail situé à Paris, en France), Wallishauser, précité (requérante de nationalité autrichienne, et lieu de travail situé à Vienne, en Autriche), Radunović, précité (requérants de nationalité monténégrine, et lieu de travail situé à Podgorica, au Monténégro), et Naku, précité (requérante de nationalité lituanienne, et lieu de travail situé à Vilnius)) et les non-ressortissants qui y résident (Fogarty, précité (requérante de nationalité irlandaise qui avait sa résidence permanente à Londres, où elle travaillait, et qui disposait d’une autorisation d’établissement permanente pour le Royaume-Uni)). A contrario, comme l’indique également le commentaire relatif à l’article 11 figurant dans le projet d’articles de la Commission du droit international (paragraphe 28), lorsque ce lien avec l’État du for fait défaut, l’État du for n’est plus fondé à revendiquer la prépondérance de sa législation du travail et de sa juridiction en la matière face à un État employeur étranger, malgré le lien territorial que constituent le lieu du recrutement de l’employé et le lieu où le travail doit être accompli conformément au contrat. En outre, si l’employé a la nationalité de l’État employeur, des voies de recours existent dans l’État employeur et les tribunaux peuvent y être saisis.
62. La Cour observe que l’article 11 § 2 e) de la CNUIJE emploie l’expression de « résidence permanente » (sans pour autant la définir dans la convention même) et diverge ainsi du projet d’articles de la Commission du droit international (article 11 dudit projet, lettre c), qui se réfère à la notion de « résidence habituelle » ; paragraphe 27 ci-dessus). Elle estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire d’approfondir ce point, notamment relativement à la nature de cette disposition en tant que règle de droit international coutumier (sur ce débat, voir la référence donnée au paragraphe 29 ci‑dessus) parce qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la requérante n’a jamais eu une quelconque résidence dans l’État du for au moment où elle a engagé une action contre son ex-employeur, ni au sens du droit international public ni au sens du droit interne. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la résidence au sens de l’article 11 § 2 e) de la CNUIJE se définit comme « la présence physique [d’une personne] dans un lieu précis, l’impression objective donnée aux tiers d’y résider normalement étant plus importante que l’intention subjective de la personne concernée d’y créer le centre de sa vie » (paragraphe 32 ci-dessus). La Cour constate en effet que la requérante, de nationalité burundaise, vivait avec son mari et ses enfants à Prévessin-Moëns, en France, au moment où elle a engagé une action contre son ex-employeur. Partant, ni le fait que le poste de travail de la requérante était en Suisse ni l’existence d’une prétendue pratique appliquée entre la France et la Suisse (que l’intéressée mentionne dans sa requête sans d’ailleurs l’étayer de manière suffisante) ne permettent à la Cour de remettre en question la constatation de la Cour de justice selon laquelle, d’un point de vue objectif, la requérante n’a jamais eu sa résidence en Suisse. Le fait qu’elle s’est installée à Genève, après l’introduction de son recours en matière civile devant le Tribunal fédéral (paragraphe 20 ci-dessus), n’y change rien.
63. Il en découle que les circonstances de la présente affaire tombent dans le champ d’application de l’article 11 § 2 e) de la CNUIJE eu égard au fait que la requérante était ressortissante de l’État employeur au moment où l’action a été engagée et qu’elle n’a jamais eu sa résidence permanente dans l’État du for.
64. Quant à l’argument de la requérante selon lequel, en raison de l’octroi de l’immunité de juridiction à la République du Burundi, le Tribunal fédéral l’a privée de la possibilité de faire valoir des prétentions devant un tribunal digne de ce nom, la Cour rappelle que la compatibilité de l’octroi de l’immunité de juridiction à un État avec l’article 6 § 1 de la Convention ne dépend pas de l’existence d’alternatives raisonnables pour la résolution du litige (Stichting Mothers of Srebrenica et autres c. Pays-Bas (déc.), no 65542/12, § 164, CEDH 2013 (extraits), avec référence à la jurisprudence de la Cour internationale de justice, qui avait explicitement réfuté l’existence d’une règle selon laquelle, en l’absence d’autre recours, la reconnaissance de l’immunité entraînerait ipso facto une violation du droit d’accès à un tribunal ; voir l’arrêt Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) du 3 février 2012, CIJ, Recueil 2012, § 101). La Cour note d’ailleurs qu’en l’espèce la requérante ne se trouve pas dans d’une situation d’absence d’autre recours. En effet, il ressort du procès-verbal du 14 avril 2011 que, par le passé, la requérante avait soumis un litige de travail aux autorités burundaises, que ces dernières avaient bien su résoudre. La Cour observe également que, d’après le même procès-verbal, la République du Burundi avait fourni des assurances à la requérante : selon celles-ci, cette dernière pourrait, au cas où la Cour de justice maintiendrait l’immunité de juridiction, saisir la Cour administrative de Bujumbura, et il n’y aurait pas de problème de prescription puisque l’intéressée avait déjà saisi un tribunal suisse – ce qui, d’après la République du Burundi, vaudrait interruption de la prescription (paragraphe 16 ci‑dessus).
65. Dès lors, les exceptions de l’article 11 § 2 a) à f) de la CNUIJE étant alternatives, il n’y a plus lieu d’examiner l’exception contenue à la lettre a), soulevée par le Gouvernement.
66. Par conséquent, la Cour est d’avis que les tribunaux suisses ne se sont pas écartés des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des États et que l’on ne saurait considérer la restriction au droit d’accès à un tribunal comme disproportionnée en l’espèce.
67. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Décisions d'irrecevabilité NML Capital Ltd c. France du 5 février 2015, requête no 23242/12
La Cour juge irrecevable la requête de la société NML Capital, société créancière de la République d’Argentine
La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1 de la Convention). Or, si la société requérante a bien épuisé tous ses recours devant le juge judiciaire, elle peut encore intenter une action en responsabilité contre l’État devant le juge administratif. La Cour note ainsi que le Conseil d’État a reconnu dans des affaires analogues la possibilité d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, quand l’immunité diplomatique d’exécution crée un préjudice grave et spécial au détriment du requérant.
La Cour rejette donc la requête comme irrecevable, pour non-épuisement des voies de recours internes.
Jones et autres c. Royaume-Uni du 14 janvier 2014
requêtes nos 34356/06 et 40528/06
La CEDH confirme la décision de la Chambre des lords jugeant l’immunité des États applicable en matière civile aux actes de torture commis par des fonctionnaires saoudiens contre des ressortissants britanniques à l’étranger mais dit que la question appelle un examen permanent.
La Cour rappelle que l’article 6 § 1 donne à chacun le droit de soumettre à un tribunal tout différend juridique portant sur des droits ou obligations à caractère civil mais que ce droit d'accès n'est pas absolu. Les États peuvent le restreindre. Toutefois, toute restriction de ce type doit poursuivre un but légitime et il doit exister un lien raisonnable entre ce but et les moyens employés pour le poursuivre (la restriction doit être proportionnée).
Quant aux critères retenus dans les affaires d'immunité d'État, la Cour renvoie à l'arrêt rendu en 2001 dans l'affaire similaire Al-Adsani c. Royaume-Uni (n° 35763/97), où la Grande Chambre a dit que l'immunité des États souverains est un concept de droit international en vertu duquel un Etat ne peut être soumis à la juridiction d'un autre Etat et que l'octroi de cette immunité souveraine dans une procédure civile poursuit le but légitime d'observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États grâce au respect de la souveraineté d'un autre Etat.
Cela dit, la question déterminante lorsqu'il s'agit d'examiner la proportionnalité de la mesure est de savoir si la règle d'immunité appliquée par la juridiction nationale reflète les règles généralement reconnues du droit international public en la matière. Dans l'affaire Al-Adsani, qui concernait la radiation d'une action en réparation contre le Koweït, la Cour n’a pas jugé établi qu'il fût admis en droit international, à la date de cet arrêt, que les États ne pouvaient prétendre à l'immunité dans le cadre d'actions civiles en dommages-intérêts pour des actes de torture qui auraient été perpétrés en dehors de l'Etat du for. Il n'y avait donc pas eu violation de l’article 6 § 1.
En l'espèce, la Cour reconnaît que la restriction à l'accès à un tribunal s'agissant des actions dirigées contre l'Arabie Saoudite et ses agents poursuivait le but légitime de favoriser les bonnes relations entre nations. Elle applique donc le critère de proportionnalité retenu dans l'arrêt Al-Adsani. La question principale qui se pose ici est donc de savoir si les restrictions à l'accès à un tribunal nées de l'immunité de l'État étaient conformes aux règles généralement reconnues de droit international public.
Pour ce qui est de l'action formée contre le royaume d'Arabie Saoudite, la Cour est appelée à déterminer si l'on pouvait dire que, à la date de la radiation de l'action formée par M. Jones (en 2006), il existait en droit international public une exception au principe de l'immunité en matière civile d'un État accusé d'actes de torture. Elle examine si, depuis son arrêt Al-Adsani, les règles internationales d'immunité ont évolué lorsque l’État est accusé de torture. Elle estime que la réponse définitive à cette question a été donnée par la Cour internationale de Justice (« la CIJ ») dans son arrêt rendu en février 2002 en l'affaire Allemagne c. Italie, où la CIJ a rejeté la thèse de l'apparition d'une exception en matière de torture au principe de l'immunité des États. Elle en conclut que l'application par les tribunaux britanniques de cette immunité pour rejeter l'action au civil formée par M. Jones contre l'Arabie Saoudite ne constituait pas une restriction injustifiée à son droit d'accès à un tribunal. La radiation de son action dirigée contre l'Arabie Saoudite n’emporte donc pas violation de l’article 6 § 1.
Pour ce qui est des actions formées contre les agents de l'État, là encore la seule question qui se pose est de savoir si l'octroi d'une immunité à ces derniers reflétait les règles généralement reconnues de droit international public en matière d'immunité de l'État. La Cour conclut de son analyse de la jurisprudence et des matériaux de droit national et de droit international que l'immunité de l'État offre en principe aux agents de l'État, à raison des actes accomplis pour le compte de ce dernier, la même protection accordée à l'État lui-même, car sinon l'immunité de celui-ci pourrait être contournée en assignant des individus désignés nommément. Elle recherche ensuite s'il existe une exception à cette règle de principe en cas d'allégations de torture. Elle passe en revue l'état du droit international et examine la jurisprudence internationale et nationale. Elle relève qu'un soutien apparaît dans la sphère internationale en faveur d'une règle spéciale ou d'une exception en droit international public dans le cadre des actions au civil dirigées contre les agents d'un État étranger pour faits de torture. Elle conclut toutefois que les précédents faisant autorité indiquent toujours que le droit pour l'État à l'immunité ne peut être contourné en assignant à la place de ce dernier certains de ses agents désignés nommément, bien qu'elle souligne qu'il pourrait y avoir une évolution. Dans cette affaire, la Chambre des lords a minutieusement examiné tous les arguments ainsi que les matériaux pertinents de droit international et de droit comparé et a rendu un arrêt détaillé comportant de nombreuses références. Les juridictions d'autres pays ont jugé cet arrêt hautement persuasif.
La Cour est donc convaincue que l'octroi, dans le cadre des actions au civil formées par les requérants, d'une immunité aux agents de l'État saoudien reflétait les règles actuelles généralement reconnues de droit international public et ne constituait donc pas une restriction injustifiée à leur droit d'accès à un tribunal. Il n'y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 à raison de ces actions dirigées contre des agents de l'État saoudien désignés nommément. Toutefois, au vu des développements en cours dans cette branche du droit international public, la Cour ajoute que cette question appelle un examen permanent de la part des États contractants.
Grande Chambre SABEH EL LEIL C. FRANCE du 29 juin 2011 Requête n°34869/05
L’impossibilité, pour un comptable renvoyé par une ambassade à Paris, de contester son licenciement est contraire à la Convention
Les Faits
Le requérant, M. Farouk Sabeh El Leil, est un ressortissant français. Par un contrat à durée indéterminée du 25 août 1980, il fut engagé comme comptable par l’ambassade du Koweït à Paris. Il fut promu chef comptable en 1985.
En mars 2000, l’Ambassade licencia le requérant pour motifs économiques, invoquant en particulier la restructuration de l’ensemble de ses services. M. Sabeh El Leil saisit alors le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par un jugement rendu en novembre 2000, lui octroya diverses indemnités d’un montant total de 82 224,60 euros. Contestant le montant des sommes accordées, le requérant interjeta appel. La cour d’appel de Paris infirma le jugement de première instance, concluant en particulier à l’irrecevabilité de l’action de M. Sabeh El Leil en application de l’immunité de juridiction dont bénéficiait l’Etat du Koweït, lequel ne pouvait en conséquence être attrait devant les tribunaux français.
Recevabilité
La Cour rappelle qu’il faut ménager aux Etats contractants la possibilité de redresser dans leur ordre juridique interne les violations des droits de l’homme alléguées contre eux avant d’avoir à en répondre devant un organisme international. En l’espèce, M. Sabeh El Leil a affirmé devant les juridictions françaises qu’il n’avait pas participé à l’exercice de l’activité de puissance publique de l’Etat du Koweït ni exercé ses fonctions dans l’intérêt du service public diplomatique, et qu’en conséquence l’immunité de juridiction de l’Etat du Koweït ne pouvait lui être opposée. Dès lors, M. Sabeh El Leil a bien soulevé en substance devant les juridictions internes son grief tenant au défaut d’accès à un tribunal, lequel est donc également recevable devant la Cour.
Accès à un tribunal (article 6 § 1)
Se référant à sa jurisprudence antérieure, la Cour constate que M. Sabeh El Leil demandait également réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que ses fonctions au sein de l’ambassade ne sauraient justifier des restrictions à l’accès de l’intéressé à un tribunal pour des motifs objectifs dans l’intérêt de l’Etat. L’article 6 § 1 trouve donc à s’appliquer dans son affaire.
La Cour observe ensuite que l’immunité des Etats, consacrée par le droit international, vise à favoriser les bonnes relations entre Etats par le respect de la souveraineté d’un autre Etat. Cependant, l’immunité absolue des Etats a subi depuis de nombreuses années une érosion certaine, en particulier avec l’adoption de la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2004. Cette dernière a introduit une exception importante en matière d’immunité des Etats, le principe étant que la règle de l’immunité ne s’applique pas aux contrats de travail conclus entre un Etat et le personnel de ses missions diplomatiques à l’étranger, sauf dans un nombre limité de situations dont la présente affaire ne relève pas. En effet, le requérant, qui n’était ni agent diplomatique ou consulaire du Koweït ni ressortissant de cet Etat, ne relevait d’aucune des exceptions énumérées dans la Convention de 2004. En particulier, le requérant n’a pas été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique, et il n’est aucunement établi qu’il existait un risque quelconque d’interférence avec les intérêts de l’Etat du Koweït en matière de sécurité.
La Cour observe en outre que, si la France n’a pas ratifié la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, elle l’a signée le 17 janvier 2007 et la procédure de ratification est actuellement en cours devant le Parlement français. De plus, la Cour souligne que la Convention de 2004 s’applique au titre du droit international coutumier même à des Etats, comme la France, qui ne l’ont pas ratifiée.
Par ailleurs, M. Sabeh El Leil a été recruté et a travaillé en tant que comptable jusqu’à son licenciement pour motif économique en 2000. A cet égard, deux documents, une attestation de fonction établie en 1985 à l’occasion de sa promotion au poste de chef comptable et un certificat de travail datant de 2000, ne mentionnaient que sa qualité de comptable, sans évoquer d’autres tâches ou fonctions qui lui auraient été assignées. Si les juridictions nationales ont évoqué une série de responsabilités supplémentaires que M. Sabeh El Leil aurait assumées, elles n’ont pas expliqué pourquoi elles avaient conclu que l’intéressé, du fait de ces responsabilités, participait à l’exercice de l’activité de puissance publique du Koweït.
La Cour conclut que les juridictions françaises ont rejeté la demande de M. Sabeh El Leil sans donner de motifs pertinents et suffisants, portant ainsi atteinte à la substance même du droit du requérant à accéder à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1.
Article 41
La Cour dit, par seize voix contre une, que la France doit verser au requérant 60 000 euros (EUR) pour l’ensemble des dommages, et 16 768 EUR pour frais et dépens.
Urechean et Pavlicenco c. République de Moldova
du 2 décembre 2014 requêtes nos 27756/05 et 41219/07
Violation article 6-1 : L’immunité générale dont a bénéficié l’ancien président de la Moldova lors d’une action en diffamation contre lui a porté atteinte à la Convention
C’est la première fois que la Cour est amenée à se pencher sur l’immunité de juridiction civile dont bénéficie le président d’un pays, contrairement à la question d’une telle immunité pour les députés.
La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner de nombreuses affaires touchant à la limitation du droit d’accès à un tribunal en raison de l’immunité parlementaire. Dans ces affaires, elle a reconnu que le fait pour les États d’accorder généralement une immunité plus ou moins étendue aux parlementaires constitue une pratique de longue date, qui vise les buts légitimes que sont la protection de la liberté d’expression au Parlement et le maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Cependant, plus une immunité est large et plus les raisons la justifiant doivent être impérieuses.
S’appuyant sur les principes établis dans ces affaires relatives à l’immunité parlementaire, la Cour dit que dans les circonstances de la cause des requérants un juste équilibre n’a pas été ménagé entre les intérêts concurrents en jeu, à savoir l’intérêt général à protéger la liberté d’expression du président dans l’exercice de ses fonctions et l’intérêt pour les requérants à avoir accès à un tribunal pour obtenir une réponse motivée à leurs griefs.
Tout d’abord, les juridictions moldaves ne se sont pas penchées sur la question de savoir si les déclarations concernant les requérants avaient été formulées par le président de la Moldova dans l’exercice de son mandat. Elles se sont bornées à une lecture de la disposition constitutionnelle pertinente, qui elle-même ne définit pas les limites de l’immunité. Cette disposition est à la fois absolue, en ce qu’on ne peut pas la faire céder face à d’autres impératifs, et perpétuelle, en ce que le président ne peut pas voir mettre en jeu sa responsabilité après qu’il a quitté son poste. En effet, appliquer de la sorte la règle de l’immunité a contribué à conférer une immunité générale au chef de l’État. La Cour estime que pareilles inviolabilité et immunité générale doivent être évitées.
Par ailleurs, les requérants ne disposaient pas d’autres moyens de redressement pour les déclarations censément diffamatoires formulées par le président de l’époque. Le Gouvernement soutient qu’un moyen de redressement pour les requérants, personnages politiques, consistait à recourir aux médias pour répliquer aux allégations du président. Cependant, compte tenu de la pratique administrative de la censure qui visait alors la télévision publique, pratique constatée dans l’arrêt Manole et autres c. Moldova (no 13936/02, CEDH 2009), la Cour n’est pas convaincue que les requérants aient disposé d’un moyen effectif pour répondre aux accusations formulées contre eux par le chef de l’État.
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
L'IMMUNITẾ DES ETATS ETRANGERS
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 28 mars 2013, pourvoi n° 11-10.450 rejet
Attendu que la société NML Capital Ltd fait grief à l’arrêt d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées les 3 avril, 25 août, 2, 10, 15, 21 et 25 septembre, 15 et 30 octobre 2009, à sa requête, à l’encontre de la République argentine, entre les mains de la société BNP Paribas, en ce qu’elles portent sur des créances de contributions fiscales et sociales de la République argentine à l’égard de la succursale de la BNP Paribas à Buenos Aires
Attendu que, selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies, du 2 décembre 2004, sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, si les Etats peuvent renoncer, par contrat écrit, à leur immunité d’exécution sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, il ne peut y être renoncé que de manière expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie ; qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Grande chambre, 21 novembre 2001, Al Adsani/Royaume Uni, requête n° 35763/97, Forgaty/Royaume Uni, req. n° 37112/97, Mc Elhinney/Irlande, req. n° 31253/96 ; 12 décembre 2002, Kalogeropoulou e.a. /Grèce et Allemagne, req. n° 59021/00 ; Grande chambre, 23 mars 2010, Cudak/Lituanie, req. n° 15869/02, 29 juin 2011, Sabeh El Leil/France, req. n° 34869/05), qu’il convient d’interpréter la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de manière à la concilier le plus possible avec les autres règles du droit international, dont cette dernière fait partie intégrante, telles que celles relatives à l’immunité des Etats étrangers, de sorte que le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de cette Convention, et dont l’exécution d’une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s’oppose pas à une limitation à ce droit d’accès, découlant de l’immunité des Etats étrangers, dès lors, que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au delà des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des Etats
Et attendu qu’ayant relevé, d’une part, que les saisies litigieuses portaient sur des créances fiscales et sociales de l’Etat argentin, c’est à dire sur des ressources se rattachant nécessairement à l’exercice par cet Etat des prérogatives liées à sa souveraineté et, d’autre part, que les contrats d’émission d’obligations ne prévoyaient aucune renonciation expresse de la République argentine à son immunité d’exécution sur ses ressources de nature fiscale ou sociale, la cour d’appel en a exactement déduit que les saisies litigieuses étaient nulles ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 28 mars 2013, pourvoi n° 11-13.323 rejet
Attendu que la société NML capital fait grief à l’arrêt de déclarer nulles les saisies conservatoires des créances des 2 avril et 16 novembre 2009, pratiquées par elle, à l’encontre de la République argentine, entre les mains de la société Air France, et d’en donner la mainlevée, en tant que de besoin
Attendu que, selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies, du 2 décembre 2004, sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, si les Etats peuvent renoncer, par contrat écrit, à leur immunité d’exécution sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, il ne peut y être renoncé que de manière expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie ; qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Grande chambre, 21 novembre 2001, Al-Adsani/Royaume-Uni, requête n° 35763/97, Forgaty/Royaume-Uni, req. n° 37112/97, Mc Elhinney/Irlande, req. n° 31253/96 ; 12 décembre 2002, Kalogeropoulou e.a. /Grèce et Allemagne, req. n° 59021/00 ; Grande chambre, 23 mars 2010, Cudak/Lituanie, req. n° 15869/02, 29 juin 2011, Sabeh El Leil/France, req. n° 34869/05), qu’il convient d’interpréter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de manière à la concilier le plus possible avec les autres règles du droit international, dont cette dernière fait partie intégrante, telles que celles relatives à l’immunité des Etats étrangers, de sorte que le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de cette Convention, et dont l’exécution d’une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s’oppose pas à une limitation à ce droit d’accès, découlant de l’immunité des Etats étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des Etats ;
Et attendu qu’ayant relevé, d’une part, que les saisies litigieuses portaient sur des créances fiscales et sociales de l’Etat argentin, c’est-à-dire sur des ressources se rattachant nécessairement à l’exercice par cet Etat des prérogatives liées à sa souveraineté et, d’autre part, que les contrats d’émission d’obligations ne prévoyaient aucune renonciation expresse de la République argentine à son immunité d’exécution sur ses ressources de nature fiscale ou sociale, la cour d’appel en a exactement déduit que les saisies litigieuses étaient nulles que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches
CEDH ET INTERPRETATION DU DROIT DE L'UE
Cliquez sur un lien bleu pour accéder des informations juridiques gratuites sur :
- LE REFUS DE SAISIR LA CJUE D'UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE
- LA CEDH DEMANDE DE RESPECTER LE DROIT DE L'UE
REFUS DE SAISIR LA CJUE D'UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE
Sanofi Pasteur c. France du 13 février 2019 requête n° 25137/16
Article 6-1 : Action en réparation contre la société Sanofi Pasteur en raison d’une sclérose en plaques apparue après l’injection d’un vaccin contre l’hépatite B
Art 6 (civil) • Procès équitable • Point de départ du délai de prescription d’une action en indemnisation à partir de la consolidation de la maladie • Maladie évolutive insusceptible de consolidation • Droit interne donnant plus de poids au droit des victimes de dommages corporels à un tribunal qu’au droit des personnes responsables de ces dommages à la sécurité juridique • Choix non mis en cause en tant que tel au vu d’une marge d’appréciation importante reconnue aux États • Absence d’imprescriptibilité
non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, à raison des modalités de fixation du point de départ de la prescription de l’action en réparation dirigée contre la société requérante,
violation de l’article 6 § 1 de la Convention, à raison du défaut de motivation de la décision de rejet de la demande de la société requérante tendant à ce que des questions préjudicielles soient posées à la Cour de justice de l’Union européenne. L’affaire concerne la responsabilité de la société Sanofi Pasteur à l’égard d’une personne, alors élève infirmière, vaccinée contre l’hépatite B, qui a souffert ensuite de diverses pathologies dont une sclérose en plaques, et la condamnation de la société requérante au paiement de réparations. En ce qui concerne la question du délai de prescription de l’action en réparation, la Cour observe que le droit positif prévoyait à l’époque des faits un délai de dix ans, et, en matière de préjudice corporel, fixait le point de départ à partir de la date de consolidation : ce délai se trouvait donc décalé tant que la consolidation n’était pas constatée. La Cour estime qu’elle ne saurait mettre en cause le choix opéré par le système français de donner plus de poids au droit des victimes de dommages corporels à un tribunal, qu’au droit des personnes responsables de ces dommages à la sécurité juridique. En ce qui concerne le rejet de la demande de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la Cour constate que la Cour de cassation n’a pas dûment motivé sa décision.
FAITS
La requérante est la société anonyme Sanofi Pasteur, personne morale de droit français ayant son siège social à Lyon. En sa qualité d’élève infirmière, X, née en 1972, dut se faire vacciner contre l’hépatite B. En 1993, une sclérose en plaque lui fut diagnostiquée ; en 1999, la maladie de Crohn ; en 2004, une polymyosite. X saisit le juge administratif en 2002, d’une action en responsabilité de l’État et obtint gain de cause. L’État fut condamné à lui payer 656 803,83 euros [EUR] en réparation de ses préjudices et à lui verser une rente annuelle de 10 950 EUR. En 2005, X assigna la société Sanofi Pasteur devant le juge civil afin d’obtenir réparation en raison de l’aggravation des préjudices dont elle avait obtenu réparation. Le tribunal de grande instance de Toulouse, puis la cour d’appel de Toulouse déclarèrent l’action recevable, faisant courir la prescription décennale à partir de la consolidation du dommage. La société Sanofi Pasteur fut reconnue responsable du préjudice de X. Constatant que le juge administratif avait condamné l’État à indemniser le préjudice, le juge civil ordonna une expertise visant notamment à dire si l’état actuel de la victime caractérisait une aggravation du préjudice déjà réparé. La société requérante se pourvut en cassation. Elle reprochait à la cour d’appel d’avoir fixé le point de départ de la prescription à la date de consolidation du dommage, alors que la pathologie de X n’était pas susceptible d’une telle consolidation, ce qui rendait son action imprescriptible. La société requérante demanda à la Cour de cassation, à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) des questions préjudicielles. Les deux premières questions proposées visaient l’article 4 de la directive 85/374, qui établit que la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. La première chambre civile de la cour de Cassation rejeta les pourvois. Le 17 novembre 2015, au vu du rapport d’expertise, le tribunal de grande instance de Toulouse condamna la société requérante à payer à X : 8 050 EUR au titre du déficit fonctionnel permanent, 1500 EUR au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, une rente annuelle de 5 475 EUR pour l’assistance d’une tierce personne et 2 000 EUR de frais de procédure.
Article 6 § 1
En ce qui concerne les modalités de fixation du point de départ de la prescription :
La Cour relève que, à l’époque des faits, le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extracontractuelle était de dix ans. La Cour de cassation avait précisé que ce délai courait à partir de la date de consolidation de la maladie, lorsque l’action visait à l’indemnisation d’un préjudice corporel. Comme l’indique le Gouvernement, en fixant le point de départ à la date de la consolidation, le droit entendait permettre à la victime d’obtenir l’entière réparation du préjudice, dont l’étendue ne peut être connue qu’après consolidation. Le choix ainsi opéré dans le système juridique français était donc de donner plus de poids au droit des victimes de dommages corporels à un tribunal qu’au droit des personnes responsables de ces dommages à la sécurité juridique. La Cour rappelle à cet égard l’importance que la Convention accorde à la protection de l’intégrité physique et observe que cette modalité permet de prendre en compte le fait que les besoins des personnes atteintes d’une maladie évolutive telle que la sclérose en plaque, en termes d’assistance par exemple, peuvent augmenter au fil de la progression de leur affection. Notant par ailleurs qu’il n’y avait pas à proprement parler d’imprescriptibilité, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1, à raison des modalités de fixation du point de départ de la prescription de l’action en réparation dirigée contre la société requérante En ce qui concerne le défaut de motivation de la décision de rejet de la demande de question préjudicielle à la CJUE : Lorsqu’une question relative notamment à l’interprétation du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou des actes pris par les institutions de l’UE est soulevée dans le cadre d’une procédure devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne – telle la Cour de cassation – cette juridiction est tenue d’en saisir la CJUE à titre préjudiciel. Cette obligation n’est toutefois pas absolue. Il ressort de la jurisprudence Cilfit de la CJUE qu’il revient à ces juridictions nationales d’apprécier si une décision sur un point de droit de l’Union est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision ; en conséquence, elles ne sont pas tenues de renvoyer une question d’interprétation de droit de l’Union soulevée devant elles lorsqu’elles constatent que cette question n’est pas pertinente, que la disposition de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la CJUE ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas comme tel un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel par le juge interne devant la CJUE. L’article 6 § 1 met toutefois à la charge des juridictions internes une obligation de motiver les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle, d’autant plus lorsque le droit applicable n’admet un tel refus qu’à titre d’exception. Dans son arrêt Ullens de Schooten et Rezabek, la Cour a précisé que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, qui refusent de saisir la CJUE à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union européenne soulevée devant elles, sont tenues de motiver leur refus au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la Cour de justice.
En l’espèce, la Cour de cassation s’est limitée à indiquer qu’elle concluait au rejet du pourvoi de la société requérante « sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. » La Cour de cassation ne s’est donc pas référée expressément à l’un des trois critères Cilfit. De plus, rien n’indique qu’elle aurait estimé que les dispositions de droit de l’Union avaient « déjà fait l’objet d’une interprétation » par la CJUE ou que « l’application correcte du droit de l’Union européenne s’imposait avec une telle évidence qu’elle ne laissait place à aucun doute raisonnable».
Par ailleurs, la Cour ne voit dans les motifs de l’arrêt de la Cour de cassation aucun élément dont il pourrait être déduit que, comme le soutient le Gouvernement, elle aurait considéré que les questions proposées n’étaient « pas pertinentes ». La motivation de l’arrêt de la Cour de cassation ne permet donc pas d’établir si ces raisons ont été examinées à l’aune des critères Cilfit et, le cas échéant, au regard de quels critères la haute juridiction a décidé de ne pas les transmettre à la CJUE
Soulignant de plus que les circonstances de l’espèce et l’enjeu de la procédure pour la société requérante appelaient tout particulièrement une motivation explicite de la décision de ne pas saisir la CJUE des questions préjudicielles formulées par cette dernière, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Article 6 § 1 et article 1 du Protocole n° 1
La Cour observe que la société requérante n’a pas préalablement saisi la Cour de cassation du présent grief et qu’elle n’a donc pas dûment épuisé les voies de recours internes. Cette partie de la requête est donc irrecevable.
CEDH
Appréciation de la Cour
68. Comme la Cour l’a exposé dans l’arrêt Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique (nos 3989/07 et 38353/07, § 56, 20 septembre 2011), il résulte du troisième alinéa de l’article 267 TFUE que, lorsqu’une question relative notamment à l’interprétation du Traité ou des actes pris par les institutions de l’Union européenne est soulevée dans le cadre d’une procédure devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne – telle, en l’espèce, la Cour de cassation –, cette juridiction est tenue d’en saisir la CJUE à titre préjudiciel. Cette obligation n’est toutefois pas absolue. Il ressort en effet de la jurisprudence Cilfit de la CJUE qu’il revient aux juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne comme aux autres juridictions nationales, d’apprécier si une décision sur un point de droit de l’Union est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision. L’arrêt précise à cet égard qu’en conséquence, elles ne sont pas tenues de renvoyer une question d’interprétation de droit de l’Union soulevée devant elles lorsqu’elles constatent que « [cette question] n’est pas pertinente », que « la disposition [de l’Union] en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour [de justice] » ou que « l’application correcte du droit [de l’Union] s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (paragraphes 35-38 ci-dessus).
69. La Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel par le juge interne devant la CJUE (voir Baydar c. Pays-Bas, no 55385/14, § 39, 24 avril 2018 ; voir aussi Ullens de Schooten et Rezabek, précité, § 57). L’article 6 § 1 met toutefois à la charge des juridictions internes une obligation de motiver au regard du droit applicable les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle, d’autant plus lorsque le droit applicable n’admet un tel refus qu’à titre d’exception. La Cour en a déduit que, lorsqu’elle est saisie sur ce fondement d’une allégation de violation de l’article 6 § 1, sa tâche consiste à s’assurer que la décision de refus critiquée devant elle est dûment assortie de tels motifs. Cela étant, elle a rappelé que, s’il lui revient de procéder rigoureusement à cette vérification, il ne lui appartient pas de connaître d’erreurs qu’auraient commises les juridictions internes dans l’interprétation ou l’application du droit pertinent (voir Ullens de Schooten et Rezabek, précité, §§ 60-61, et Dhahbi c. Italie, no 17120/09, § 31, 8 avril 2014). Sur ce dernier point, elle a également rappelé qu’il revient au premier chef aux autorités nationales, tout particulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, le cas échéant en conformité avec le droit de l’Union européenne, le rôle de la Cour se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de leurs décisions (Ullens de Schooten et Rezabek, précité, § 54).
70. La Cour a ensuite précisé dans l’arrêt Ullens de Schooten et Rezabek (§ 62) que, dans le cadre spécifique du troisième alinéa de l’article 267 TFUE, cela signifie que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne qui refusent de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union européenne soulevée devant elles, sont tenues de motiver leur refus au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la Cour de justice.
71. La Cour a confirmé ces principes dans des arrêts et décisions postérieurs, tout en précisant qu’ils ne faisaient pas obstacle à ce que, lorsqu’une juridiction interne supérieure rejette par une motivation sommaire une requête parce qu’elle ne soulève pas de questions juridique foncièrement importante où qu’elle n’a pas de chance d’aboutir, il est le cas échéant acceptable au regard de l’article 6 de la Convention, qu’elle ne traite pas explicitement de la demande de question préjudicielle soulevée dans le cadre de cette requête (voir, en particulier, Baydar, précité, §§ 42, 46 et 48). Il en va de même lorsque le recours est déclaré irrecevable pour non-respect des conditions de recevabilité (Astikos Kai Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Axiomatikon et autre c. Grèce (déc.), nos 29382/16 et 489/17, § 47, 9 mai 2017). Dans de tels cas de figure, les réponses aux questions envisagées, quelles qu’elles soient, n’auraient pas d’effet sur le résultat de l’affaire (ibidem). La Cour admet aussi que, in concreto, les raisons de rejet de la demande de question préjudicielle au regard des critères Cilfit puissent se déduire de la motivation du reste de la décision de la juridiction concernée (voir Krikorian c. France (déc.), no 6459/07, §§ 97-99, 26 novembre 2013, Harisch c. Allemagne, no 50053/16, §§ 37-42, 11 avril 2019 et Ogieriakhi c. Irlande (déc.), no 57551/17, § 62, 30 avril 2019) ou de motifs quelque peu implicites indiqués dans la décision rejetant la demande (Repcevirág Szövetkezet c. Hongrie, no 70750/14, §§ 57-58, 30 avril 2019).
72. En l’espèce, les questions préjudicielles que la société requérante souhaitait voir transmises par la Cour de cassation à la CJUE, qui visaient l’interprétation des articles 4 et 6 de la directive 85/374, étaient formulées avec précision et selon les modalités requises par le droit interne (paragraphes 17-18 ci-dessus) (comparer avec Somorjai c. Hongrie, no 60934/13, §§ 59-60, 28 août 2018). Cela n’a du reste pas prêté à controverse entre les parties.
73. Par ailleurs, la Cour de cassation n’a pas déclaré le pourvoi de la société requérante non-admis comme étant irrecevable ou non fondé sur des moyens sérieux, mais l’a rejeté. On ne se trouve donc pas dans le premier cas évoqués au paragraphe 71 ci-dessus.
74. Ensuite, en réponse à la demande de la société requérante relative à la saisine préjudicielle de la CJUE, la Cour de cassation s’est limitée à indiquer qu’elle concluait au rejet du pourvoi de la société requérante « sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européen » (paragraphe 21 ci-dessus).
75. La Cour de cassation ne s’est donc pas expressément référée à l’un des trois critères Cilfit, et rien n’indique qu’elle aurait estimé que les dispositions de droit de l’Union en cause avaient « déjà fait l’objet d’une interprétation » par la CJUE ou que « l’application correcte du droit de l’Union européenne s’imposait avec une telle évidence qu’elle ne laissait place à aucun doute raisonnable » ; le Gouvernement ne le soutient du reste pas.
76. Le Gouvernement semble en revanche considérer que la formule « sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européen » indique que la Cour de cassation a retenu que les questions n’étaient « pas pertinentes ». Il fait valoir à cet égard qu’aucune question d’interprétation de la directive 85/374 ne pouvait se poser dès lors que le vaccin litigieux avait été mis sur le marché avant la date butoir de sa transposition.
77. La Cour ne voit cependant dans les motifs de l’arrêt de la Cour de cassation aucun élément dont il pourrait être déduit que telle aurait été l’approche de la Cour de cassation.
78. Certes, l’arrêt de la Cour de cassation contient du moins une référence aux questions préjudicielles soulevées par la société requérante (par le biais de la formule « sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ») (voir, par contraste, Dhahbi, précité). Néanmoins, cet arrêt n’indique pas les raisons pour lesquelles il a été considéré que les questions soulevées ne méritaient pas d’être transmise à la CJUE (voir, Dhahbi, précitée, §§ 32-34 ; voir aussi Schipani et autres c. Italie, no 38369/09, §§ 70-71, 21 juillet 2015, ainsi que Baltic Master LTD. c. Lituanie, no 55092/16, §§ 41-43, 16 avril 2019). La motivation de l’arrêt de la Cour de cassation ne permet donc pas d’établir si ces questions ont été examinées à l’aune des critères Cilfit et, le cas échant, au regard duquel ou desquels de ces critères la haute juridiction a décidé de ne pas les transmettre à la CJUE.
79. Enfin, la Cour estime que les circonstances de l’espèce appelaient tout particulièrement une motivation explicite de la décision de ne pas saisir la CJUE des questions préjudicielles formulées par la société requérante.
80. Elle observe en effet qu’il ressort du dossier que l’avocat général a examiné dans son avis devant la Cour de cassation la question de savoir si la directive 85/374 devait être prise en compte alors qu’en méconnaissance du délai prévu par son article 19 (qui avait expiré le 30 juillet 1988), elle n’avait pas été transposée en droit français à l’époque des faits (la transposition ayant été opérée par la loi no 98-389 du 19 mai 1998). Il a rappelé que la Cour de cassation avait jugé en 2003 dans une affaire similaire que le droit interne applicable devait être interprété à la lumière de cette directive, notant par ailleurs que telle avait été l’approche du juge du fond en l’espèce. Elle note au surplus que le jour où elle s’est prononcée en l’espèce, la Cour de cassation a renvoyé à la CJUE des questions préjudicielles similaires relatives à cette directive, dans une affaire comparable à certains égards à la présente à laquelle la société requérante était partie (paragraphes 64 et 67 ci-dessus). Dans ce contexte et vu l’enjeu de la procédure pour la société requérante, il était particulièrement important que la raison du rejet de sa demande de saisine préjudicielle de la CJUE soit explicitée.
81. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION et 1 du protocole no 1 à raison D’UNE PRéTENDUE CONDAMNATION DE LA Société requérante sur le fondement d’une double présomption irréfragable
82. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la société requérante se plaint d’avoir été « condamnée » sur le fondement d’une double présomption de causalité entre la vaccination et les pathologies de X, d’une part, et la défectuosité du vaccin, d’autre part ; dès lors qu’il s’agirait d’une présomption de facto irréfragable, il y aurait là non seulement une atteinte à son droit à un procès équitable, mais aussi une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens.
83. Le Gouvernement soutient que la société requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 de la Convention. Il lui reproche en premier lieu de ne pas avoir formulé ce grief devant la Cour de cassation, notant à cet égard que, si elle s’est plainte dans la cinquième branche de son deuxième moyen en cassation d’un renversement de la charge de la preuve, elle n’a pas pour autant dénoncé une violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens. Ensuite, s’agissant spécifiquement de l’article 1 du Protocole no 1, le Gouvernement constate que la décision qui a eu un effet direct sur le patrimoine de la société requérante n’est pas celle qui a ensuite donné lieu à l’arrêt de cassation du 12 novembre 2015, qui se borne à constater la recevabilité de l’action en réparation et la responsabilité de la société requérante, mais le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 17 novembre 2015, qui la condamne à verser certaines sommes au titre de la réparation (paragraphe 22 ci-dessus). Or, observe le Gouvernement, la société requérante n’a pas interjeté appel de ce jugement.
84. La société requérante réplique qu’elle a soulevé ce grief en substance devant la Cour de cassation dans le cadre de la cinquième branche de son second moyen.
85. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement préalable des voies de recours internes que pose l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas seulement que les requêtes aient été adressées aux tribunaux internes compétents et qu’il ait été fait usage des recours effectifs permettant de contester les décisions déjà prononcées ; le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant ces mêmes juridictions nationales appropriées (voir, parmi de nombreux autres, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 142, CEDH 2010). En l’espèce, la société requérante a soulevé devant la Cour de cassation la question de la charge de la preuve dans le cadre de la cinquième branche de son second moyen en cassation (paragraphe 15 ci-dessus). Toutefois, elle n’a évoqué dans ce moyen ni l’article 6 § 1 de la Convention, ni l’article 1 du Protocole no 1, et n’a tiré aucune conclusion quant à une atteinte à son droit à un procès équitable ou à son droit au respect de ses biens. La Cour en déduit qu’elle n’a pas, ne serait-ce qu’en substance, préalablement saisi la Cour de cassation du présent grief, et qu’elle n’a donc pas dûment épuisé les voies de recours internes.
86. Partant, cette partie de la requête est irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Harisch c. Allemagne du 11 avril 2019 requête n° 50053/16
Article 6-1 : Le refus de renvoyer une affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas emporté violation de la Convention
L’affaire concerne une procédure civile au cours de laquelle le requérant a demandé un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La Cour juge en particulier que le refus des juridictions nationales de procéder au renvoi préjudiciel, refus qui ne semble pas avoir été arbitraire, était suffisamment motivé.
FAITS
M. Harisch est l’un des deux fondateurs de T.AG, un service de renseignements téléphoniques. Contre paiement, T.AG reçut de DTAG les informations requises sur les abonnés. En 2007 et en 2008, DTAG fut condamné à rembourser à T.AG une partie des montants versés au motif qu’ils avaient été excessifs. M. Harisch engagea une action contre DTAG, arguant qu’en raison de ces prix excessifs le cofondateur de T.AG et lui-même avaient été contraints de réduire le montant de leur participation dans la société avant son entrée en bourse. Il plaida avoir subi un préjudice à cet égard, et également du fait d’une baisse de la valorisation de la société le jour de son introduction en bourse. Le tribunal régional le débouta en mai 2013. M. Harisch fit appel. Lors d’une audience devant la cour d’appel, il demanda la suspension de la procédure et un renvoi préjudiciel devant la CJUE. En juillet 2014, la cour d’appel le débouta, livrant un raisonnement détaillé sur les raisons pour lesquelles selon elle la jurisprudence de la CJUE ne corroborait pas l’avis juridique de l’intéressé. Par ailleurs, la cour d’appel indiqua qu’elle ne voyait pas de raisons d’autoriser la formation d’un pourvoi en cassation, au motif qu’il n’était pas nécessaire de clarifier les questions juridiques soulevées. Le requérant contesta le refus de l’autoriser à se pourvoir en cassation et réitéra sa demande de renvoi à la CJUE. La Cour fédérale de justice écarta son action, indiquant brièvement les raisons pour lesquelles elle n’autorisait pas le pourvoi en cassation ; elle se dispensa de tout autre raisonnement en se fondant sur l’article 544 § 4 du code de procédure civile, auquel renvoyait sa décision. M. Harisch déposa également une plainte dans laquelle il alléguait une violation de son droit à être entendu (Anhörungsrüge). La Cour fédérale de justice rejeta cette plainte, déclarant qu’une décision rendue en dernière instance n’exigeait pas un raisonnement plus détaillé. En février 2016, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel qu’avait formé M. Harisch.
Article 6 § 1
La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel à la CJUE. Toutefois, le refus d’accepter un renvoi peut être jugé arbitraire dans une affaire où les normes applicables ne prévoient pas d’exception à l’octroi d’un renvoi ou lorsque le refus repose sur d’autres raisons que celles qui sont prévues par ces normes, ou lorsqu’il n’est pas dûment motivé. L’obligation pour les juridictions nationales de motiver leurs jugements constitue une garantie essentielle contre l’arbitraire. Toutefois, la question de savoir si un tribunal a manqué à cette obligation ne peut être analysée qu’à la lumière des circonstances de l’espèce. Pour la Cour, il est acceptable au regard de l’article 6 § 1 qu’une juridiction nationale supérieure écarte un recours en renvoyant simplement à la disposition juridique pertinente lorsque l’affaire ne soulève pas de question juridique fondamentale, en particulier si elle concerne une demande d’autorisation de former un recours. La Cour observe tout d’abord que la Cour fédérale de justice a statué en dernier ressort, au sens de l’article 267 § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et que cette juridiction n’a que brièvement motivé sa décision, comme le lui permettait le droit national. La Cour relève également que la cour d’appel avait auparavant examiné en détail le droit de l’Union européenne (UE) et s’était largement référée à la jurisprudence de la CJUE. De plus, la question du droit de l’UE avait été débattue lors d’une audience et la cour d’appel avait expliqué qu’il n’y avait pas de doute raisonnable quant à l’application correcte du droit allemand et du droit de l’UE. La Cour remarque par ailleurs que, selon la jurisprudence nationale, un refus d’autoriser la formation d’un pourvoi en cassation tient compte de la considération selon laquelle un renvoi à la CJUE n’est pas nécessaire dans l’affaire en question. Elle conclut que la cour d’appel a examiné la demande de renvoi formée par M. Harisch et l’a écartée en refusant à l’intéressé l’autorisation de se pourvoir en cassation.
En outre, eu égard au fait que la cour d’appel a motivé sa décision par un raisonnement détaillé, après examen avec les parties de la question du droit de l’UE, la Cour considère que M. Harisch était en mesure de comprendre la décision de la Cour fédérale de justice. Après avoir examiné la procédure dans son ensemble, la Cour dit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il est acceptable que la Cour fédérale de justice n’ait pas fourni de raisonnement plus complet et qu’elle ait simplement renvoyé aux dispositions juridiques pertinentes lorsqu’elle a statué sur la plainte de M. Harisch relative au refus de l’autoriser à se pourvoir en cassation. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.
Somorjai c. Hongrie du 28 août 2018 requête n° 60934/13
Article 6 : Le refus d’une demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’union européenne n’a pas été arbitraire
Article 6 § 1 (procès équitable)
La Cour rappelle que la tâche d’interpréter et d’appliquer le droit interne, au besoin en conformité avec le droit de l’UE, incombe avant tout aux juridictions internes. Elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet donc pas en cause l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions étaient arbitraires ou manifestement déraisonnables. Elle en conclut que le grief tiré de l’interprétation du droit de l’UE par la Kúria échappe à sa compétence. La Cour constate que la présente affaire a été examinée à deux reprises par les juridictions suprêmes hongroises et que M. Somorjai était tenu par le droit interne d’expliciter de manière suffisamment exhaustive et explicite son pourvoi devant la Kúria, sans renvoyer à ses prétentions antérieures. Or, à ce stade, il n’a pas demandé la saisine de la CJUE par la voie préjudicielle ni précisé en quoi la décision du juge interne aurait été contraire à l’article 234 du traité CE. Dans ces conditions, le défaut de motivation sur ces points semble être conforme aux règles de procédure interne. La Cour ajoute que c’est aux seules juridictions internes qu’il revient de se prononcer dans chaque cas sur la nécessité d’une décision préjudicielle de manière à leur permettre de statuer. La Kúria a jugé que les règles de droit hongrois n’étaient pas en conflit avec le droit de l’UE et elle en a conclu qu’une décision préjudicielle sur une question relevant du droit de l’UE n’était pas nécessaire. Ne voyant donc aucune apparence d’arbitraire dans les décisions du juge interne, la Cour déclare irrecevable le grief tiré d’un manque d’équité de la procédure.
Article 6 § 1 (durée de la procédure)
Le caractère raisonnable ou non de la durée d’une procédure s’apprécie toujours à la lumière des circonstances de l’espèce sur la base des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour ce dernier. La Cour constate que l’affaire n’était pas exceptionnellement complexe et qu’aucun retard n’est à imputer à M. Somorjai. De plus, dans les litiges en matière de pensions, une diligence particulière s’impose. Le litige a duré plus de six ans et neuf mois, devant deux niveaux d’autorités administratives et deux degrés de juridictions. Dans ces conditions, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure était excessive et n’a pas respecté l’exigence de « délai raisonnable ». Elle en conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Baydar c. Pays-Bas du 24 avril 2018 requête n° 55385/14
Article 6-1 : Une demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union Européenne peut être refusée en termes sommaires
Non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne le grief de M. Baydar. Celui-ci se plaignait de ce que la Cour de cassation ait refusé par un raisonnement sommaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle. En octobre 2011, M. Baydar fut reconnu coupable de trafic d’héroïne et de traite d’êtres humains. Le jugement fut confirmé en appel, et la Cour de cassation fixa sa peine à 34 mois d’emprisonnement. Relativement à la condamnation pour traite d’êtres humains, M. Baydar sollicita le renvoi préjudiciel de l’affaire devant la CJUE. Il souhaitait que celle-ci définisse le terme « séjour » au sens du droit de l’Union tel qu’appliqué dans le code pénal néerlandais. La Cour de cassation refusa de donner suite à cette demande. La Cour juge en particulier que dans le cadre des procédures accélérées, il est acceptable au regard de l’article 6 § 1 de la Convention qu’un pourvoi en cassation comprenant une demande de renvoi préjudiciel soit déclaré irrecevable ou rejeté par un raisonnement sommaire lorsqu’il ressort clairement des circonstances de la cause que la décision n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable.
La Cour considère qu’il n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention que les cours supérieures rejettent un grief par simple référence aux dispositions légales pertinentes si l’affaire ne soulève pas de question de droit d’une importance fondamentale, en particulier dans le cadre des procédures accélérées. Elle souligne qu’elle a seulement pour tâche de vérifier que les décisions des juridictions nationales ne sont pas entachées d’arbitraire ni manifestement déraisonnables. La Cour souscrit à l’explication avancée par la Cour de cassation selon laquelle il est clair que lorsqu’un pourvoi est rejeté il n’est pas nécessaire de poser une question préjudicielle puisque l’affaire ne soulève pas de question de droit devant être tranchée. Elle note de plus que la CJUE a dit que les juridictions nationales (au sens de l’article 267 § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) ne sont pas tenues de lui poser les questions d’interprétation du droit de l’Union soulevées devant elles qui ne sont pas pertinentes, c’est-à-dire celles auxquelles la réponse serait sans incidence sur l’issue de l’affaire. La Cour conclut qu’étant donné que la Cour de cassation a dûment examiné les moyens du pourvoi de M. Baydar et qu’il n’y a par ailleurs aucune apparence de défaut d’équité dans la procédure de cassation, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle note en particulier que la demande du requérant a été rejetée par trois membres de la Cour de cassation et que ceux-ci ont exposé un raisonnement sommaire reposant sur le droit national, après avoir pris connaissance de l’ensemble des moyens écrits de l’intéressé ainsi que de l’avis consultatif de l’avocat général.
Principaux faits
Le requérant, Ilkay Baydar, est né en 1968 et réside à Apeldoorn (Pays-Bas). Il a les nationalités néerlandaise et turque. En octobre 2011, la cour d’appel d’Arnhem le reconnut coupable de transport d’héroïne et de traite d’êtres humains et le condamna à 40 mois d’emprisonnement. Elle jugea établi que de novembre 2006 à janvier 2007, il avait, dans un but lucratif, facilité le séjour irrégulier de 20 migrants irakiens aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark. Par la suite, la Cour de cassation confirma cette décision, mais ramena la peine à 34 mois en raison de la durée excessive de la procédure de cassation. Relativement à la condamnation pour traite d’êtres humains, le requérant soutenait que les éléments sur lesquels s’était appuyée la cour d’appel ne prouvaient pas que les migrants irakiens aient « séjourné » aux Pays-Bas, en Allemagne ou au Danemark, mais qu’ils montraient seulement qu’il les avait amenés au Danemark en passant par les Pays-Bas et l’Allemagne et qu’ils avaient à chaque fois été interceptés en Allemagne. Il arguait que le séjour des migrants aux Pays-Bas et en Allemagne n’avait été que bref et transitoire, et que rien ne permettait donc de dire qu’ils aient « séjourné » dans ces pays. À cet égard, il s’appuyait sur le droit de l’Union européenne (directive 2002/90/CE du Conseil et décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil). Il priait la Cour de cassation de demander à la CJUE à titre préjudiciel qu’elle précise l’interprétation à donner au terme « séjour ». La Cour de cassation refusa de saisir la CJUE et rejeta le pourvoi, indiquant que, selon le droit national, aucune motivation supplémentaire n’était requise, les griefs ne faisant pas apparaître qu’il fût nécessaire de trancher un point de droit dans l’intérêt de l’uniformité ou du développement du droit.
Article 6
La Cour considère qu’il n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention que les cours supérieures rejettent un grief par simple référence aux dispositions légales pertinentes si l’affaire ne soulève pas de question de droit d’une importance fondamentale, en particulier dans le cadre des procédures accélérées. Elle souligne qu’elle a seulement pour tâche de vérifier que les décisions des juridictions nationales ne sont pas entachées d’arbitraire ni manifestement déraisonnables. La Cour souscrit à l’explication avancée par la Cour de cassation selon laquelle il est clair que lorsqu’un pourvoi est rejeté il n’est pas nécessaire de poser une question préjudicielle puisque l’affaire ne soulève pas de question de droit devant être tranchée. Elle note de plus que la CJUE a dit que les juridictions nationales (au sens de l’article 267 § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) ne sont pas tenues de lui poser les questions d’interprétation du droit de l’Union soulevées devant elles qui ne sont pas pertinentes, c’est-à-dire celles auxquelles la réponse serait sans incidence sur l’issue de l’affaire. La Cour conclut qu’étant donné que la Cour de cassation a dûment examiné les moyens du pourvoi de M. Baydar et qu’il n’y a par ailleurs aucune apparence de défaut d’équité dans la procédure de cassation, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle note en particulier que la demande du requérant a été rejetée par trois membres de la Cour de cassation et que ceux-ci ont exposé un raisonnement sommaire reposant sur le droit national, après avoir pris connaissance de l’ensemble des moyens écrits de l’intéressé ainsi que de l’avis consultatif de l’avocat général.
DHAHBI C. ITALIE arrêt du 8 avril 2014 requête 17120/09
31. La Cour rappelle que dans l’affaire Vergauwen c. Belgique (déc.), no 4832/04, §§ 89-90, 10 avril 2012), elle a exprimé les principes suivants :
– l’article 6 § 1 met à la charge des juridictions internes une obligation de motiver au regard du droit applicable les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle ;
– lorsqu’elle est saisie sur ce terrain d’une allégation de violation de l’article 6 § 1, la tâche de la Cour consiste à s’assurer que la décision de refus critiquée devant elle est dûment assortie de tels motifs ;
– s’il lui revient de procéder rigoureusement à cette vérification, il ne lui appartient pas de connaître d’éventuelles erreurs qu’auraient commises les juridictions internes dans l’interprétation ou l’application du droit pertinent ;
– dans le cadre spécifique du troisième alinéa de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne (soit l’actuel article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union (TFUE)), cela signifie que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne sont tenues, lorsqu’elles refusent de saisir la CJUE à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’UE soulevée devant elles, de motiver leur refus au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la Cour de justice. Il leur faut donc indiquer les raisons pour lesquelles elles considèrent que la question n’est pas pertinente, ou que la disposition de droit de l’UE en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la CJUE, ou encore que l’application correcte du droit de l’UE s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
32. En l’espèce, le requérant a demandé à la Cour de cassation de poser à la CJUE la question préjudicielle de savoir si l’article 65 de l’Accord euro-méditerranéen permettait de refuser à un travailleur tunisien l’allocation de foyer familial prévue par l’article 65 de la loi no 448 de 1998 (paragraphes 10 et 12 ci-dessus). Ses décisions n’étant susceptibles d’aucun recours juridictionnel en droit interne, la Cour de cassation avait l’obligation de motiver son refus de poser la question préjudicielle au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la CJUE.
33. La Cour a examiné l’arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2008 sans y trouver aucune référence à la demande de renvoi préjudiciel formulée par le requérant et aux raisons pour lesquelles il a été considéré que la question soulevée ne méritait pas d’être transmise à la CJUE. La motivation de l’arrêt litigieux ne permet donc pas d’établir si cette question a été considérée comme non pertinente, ou comme relative à une disposition claire ou déjà interprétée par la CJUE, ou bien si elle a été simplement ignorée (voir, a contrario, Vergauwen, précité, § 91, où la Cour a constaté que la Cour constitutionnelle belge avait dûment motivé son refus de poser des questions préjudicielles). À cet égard, la Cour observe que le raisonnement de la Cour de cassation ne contient aucune référence à la jurisprudence de la CJUE.
34. Ce constat suffit pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
LA CEDH DEMANDE DE RESPECTER LE DROIT DE L'UE
Spasov c. Roumanie du 6 décembre 2022 requête no 27122/14
Art 6 de la CEDH et Art 1 du Protocole 1: Le propriétaire d’un navire bulgare, condamné en Roumanie pour pêche illicite dans les eaux communautaires en mer Noire au mépris du droit de l’Union européenne, a été victime d’un déni de justice
L’affaire concerne la condamnation de M. Spasov, commandant et propriétaire d’un navire battant pavillon bulgare, par les juridictions roumaines pour pêche illicite dans la zone économique exclusive de la Roumanie en mer Noire. Devant les autorités roumaines, M. Spasov fit valoir que la quantité de poisson pêchée faisait partie du quota de capture de turbot alloué à la Bulgarie dans le cadre de la politique commune de pêche de l’Union européenne (UE). La cour d’appel de Constanța estima toutefois que le droit de l’UE n’était pas applicable et condamna le requérant en application de la loi interne. La Cour rappelle qu’en vertu du principe de la primauté du droit de l’Union, un règlement doté d’un effet direct l’emporte sur le droit interne contraire. Elle note en l’espèce que la Commission européenne a clairement indiqué aux autorités roumaines que les poursuites engagées contre le requérant étaient contraires au droit de l’UE, et particulièrement aux Règlements (CE) n o 2371/2002 et (UE) n o 1256/2010. Au vu des dispositions du Règlement (CE) n o 2371/2002 et de l’opinion très claire de la Commission européenne au sujet de l’application des règles de la politique commune de la pêche, la Cour juge qu’en condamnant M. Spasov, la cour d’appel a commis une erreur de droit manifeste et que le requérant a été victime d’un « déni de justice ». En cas de doute, la cour d’appel aurait pu saisir la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) au sujet de l’interprétation des règles du droit de l’UE. La Cour juge aussi que les dispositions internes sur lesquelles la cour d’appel s’est fondée (OUG n o 23/2008) ne pouvaient servir de base légale aux sanctions complémentaires d’ordre pécuniaire infligées au requérant alors que des normes européennes claires l’autorisaient à pêcher dans la zone concernée.
Art 6 § 1 (pénal) • Condamnation pénale reposant sur des dispositions de droit interne manifestement contraires aux règlements de l’UE l’emportant sur celles-ci et directement applicables • Erreur de droit manifeste revenant à un déni de justice
Art 1 P1 • Confiscation en valeur et interdiction temporaire de pêcher dans la zone économique exclusive, en lien avec une condamnation pénale contraire au droit de l’UE • Licence de pêche maritime délivrée dans un autre État membre de l’UE, partiellement vidée de sa substance • Art 1 P1 applicable • Principe de légalité non respecté
FAITS
À l’époque des faits, M. Spasov était commandant et propriétaire d’un navire immatriculé en Bulgarie. Il pratiquait la pêche dans les « eaux communautaires » en mer Noire. Le 13 avril 2011, alors que le navire se trouvait au large des côtes roumaines, à une distance de 20 milles marins, dans la zone économique exclusive de la Roumanie en mer Noire, il fut arraisonné par des garde-côtes roumains qui trouvèrent à bord une vingtaine de turbots et un filet de pêche dont le maillage était inférieur à celui prévu par la législation roumaine sur la pêche du turbot. Le navire fut conduit sous escorte au port de Mangalia où il fut mis sous séquestre et les turbots furent saisis. M. Sapsov fut ensuite placé en garde à vue. À sa sortie, il lui fut interdit de quitter la Roumanie pendant l’enquête du parquet. Il fut finalement autorisé à retourner en Bulgarie le 15 mai 2011 et son navire lui fut restitué le 22 mars 2012. Pour sa défense, M. Spasov présenta aux autorités roumaines sa licence et son permis de pêche bulgares. Il fit valoir que ces documents l’autorisaient à pêcher dans la zone économique exclusive de la Roumanie en mer Noire une certaine quantité de turbot qui faisait partie du quota de capture de turbot alloué à la Bulgarie dans le cadre de la politique commune de pêche de l’UE. À la demande du parquet, l’Agence nationale de pêche roumaine précisa que les règles de la politique commune de la pêche autorisaient l’accès des navires battant pavillon d’un État membre de la zone économique exclusive de la Roumanie en mer Noire, mais que le droit d’y pêcher était soumis à l’obtention d’une licence de pêche délivrée par les autorités roumaines. Le 5 septembre 2011, se fondant sur les dispositions du droit roumain (OUG n o 23/2008) et reprochant à M. Spasov d’avoir pratiqué la pêche sans licence et d’avoir utilisé du matériel de pêche interdit, le parquet renvoya M. Spasov devant le tribunal de Mangalia. Le 18 octobre 2011, le tribunal relaxa M. Spasov, estimant qu’il était en possession de tous les documents requis par le droit de l’UE pour pêcher le turbot dans la zone concernée et qu’en vertu des règles commune de la pêche (en particulier du Règlement (CE) n° 2371/2002) M. Spasov n’avait pas besoin d’une licence de pêche roumaine pour pratiquer ce type de pêche. Le parquet interjeta appel. Entretemps, la Commission européenne, saisie par les autorités bulgares, demanda des explications au autorités roumaines. Puis, le 21 décembre 2011, la Direction générale des Affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne adressa aux autorités roumaines une lettre dans laquelle elle les informait qu’elles avaient commis dans le traitement de l’affaire de graves erreurs d’interprétation et d’application des règles de la politique commune de la pêche et en particulier du Règlement (CE) n° 2371/2002 et du Règlement (UE) n° 1256/2010. Dans sa lettre, elle indiquait également que les poursuites engagées contre M. Spasov étaient contraires au droit de l’UE. Finalement, le 2 octobre 2013, la cour d’appel de Constanța estima que le droit de l’UE n’était pas applicable en l’espèce. Elle jugea que les normes applicables dans la zone concernée étaient la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et la législation nationale adoptée en vertu de cette convention. Elle estima, de ce fait, que M. Spasov s’était rendu coupable de pêche illicite puisqu’il n’était pas titulaire d’une licence de pêche roumaine, et que la pêche pratiquée était constitutive de braconnage et mettait l’équilibre de l’écosystème marin en danger. Elle condamna M. Spasov à une peine d’un an avec sursis et lui infligea trois amendes – d’environ 1 350 euros (EUR) chacune – ainsi que des sanctions complémentaires d’ordre pécuniaire (confiscation d’une partie de la valeur du navire – environ 2 250 EUR – et interdiction de pêche dans la zone économique exclusive de la Roumanie en mer Noire pendant un an).
ARTICLE 6
a) Les principes généraux
80. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 83, 11 juillet 2017, où elle a examiné sous l’angle du volet pénal de l’article 6 de la Convention un grief tiré d’un manque d’équité allégué du raisonnement suivi par les juridictions internes, elle a résumé en ces termes les principes généraux :
« a) Il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention, par exemple si elles peuvent exceptionnellement s’analyser en un « manque d’équité » incompatible avec l’article 6 de la Convention.
b) L’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables. »
81. Dans cet arrêt, la Cour a précisé qu’une décision de justice interne ne peut être qualifiée d’« arbitraire » au point de nuire à l’équité du procès que si elle est dépourvue de motivation ou si cette motivation est fondée sur une erreur de fait ou de droit manifeste commise par le juge national qui aboutit à un « déni de justice » (Moreira Ferreira (no 2), précité, § 85).
82. La Cour rappelle également que la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel par le juge interne devant la CJUE (Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, nos 3989/07 et 38353/07, § 57, 20 septembre 2011 ; voir aussi Sanofi Pasteur c. France, no 25137/16, § 69, 13 février 2020).
83. Il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, le cas échéant en conformité avec le droit de l’Union européenne. Sous réserve d’une interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable, le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de cette interprétation (Thimothawes c. Belgique, no 39061/11, § 71, 4 avril 2017 et la jurisprudence citée).
b) Application de ces principes en l’espèce
84. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que les autorités roumaines ont poursuivi le requérant aux motifs qu’il n’était pas titulaire d’une licence de pêche roumaine et qu’il avait utilisé des filets interdits par la législation roumaine (paragraphe 9 ci-dessus).
85. Dans son arrêt définitif du 2 octobre 2013, la cour d’appel a jugé que les navires communautaires, dont celui du requérant, étaient soumis aux dispositions de la législation roumaine adoptée en application de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (paragraphe 38 ci-dessus). Elle a fait application en l’espèce des règles nationales encadrant spécifiquement la pêche au turbot, et elle a considéré que ces règles n’étaient pas contraires aux règles du droit de l’Union concernant la politique commune de la pêche (paragraphe 43 ci-dessus).
86. Le requérant reproche à la cour d’appel, d’une part, de ne pas avoir saisi la CJUE d’une question préjudicielle d’interprétation des règles de la politique commune de la pêche et, d’autre part, d’avoir rendu une décision qu’il estime arbitraire au regard de ces règles (paragraphe 75 ci-dessus).
87. La Cour note d’emblée que la présente affaire se distingue sensiblement des affaires où la Cour a précédemment examiné l’obligation des juridictions internes de motiver au regard du droit applicable les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle Ullens de Schooten et Rezabek, et Sanofi Pasteur, arrêts précités). En effet, il ne s’agit pas en l’espèce du refus de la cour d’appel de Constanta de renvoyer à la CJUE une demande d’interprétation du droit de l’Union qui aurait été formulée devant elle par les parties, mais de la question de savoir si l’arrêt définitif du 2 octobre 2013 était le résultat d’une erreur de droit manifeste.
88. Le requérant estime qu’il a fait l’objet d’une condamnation arbitraire car contraire aux règles du droit de l’Union. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et soutient que l’arrêt du 2 octobre 2013 était dûment motivé.
89. La Cour constate que la question de l’application des règles du droit de l’Union aux activités de pêche pratiquées dans la zone économique exclusive de la Roumanie en mer Noire était au cœur du litige (paragraphes 21 et 38 ci-dessus).
90. Elle constate également que la cour d’appel a procédé à sa propre interprétation de ces règles (paragraphe 41 et 42 ci-dessus) et a appliqué en l’espèce la législation interne sur la pêche (paragraphe 38 et 40 ci-dessus).
91. Elle est donc appelée à déterminer si la motivation de l’arrêt de la cour d’appel sur ce point est conforme aux standards de la Convention.
92. La Cour note que les règles de la politique commune de la pêche sont définies dans un ensemble de règlements qui sont obligatoires en tous leurs éléments et directement applicables dans les États membres (paragraphes 59 et 60 ci-dessus).
93. Elle rappelle qu’elle a déjà souligné dans sa jurisprudence que dans le système juridique de l’UE un règlement est, à la différence d’une directive, obligatoire en tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre (Avotiņš c. Lettonie [GC], no 17502/07, § 106, 23 mai 2016). En vertu du principe de la primauté du droit de l’Union, un tel règlement, doté d’un effet direct, l’emporte sur le droit interne contraire (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, § 92, CEDH 2005‑VI).
94. En l’espèce, la Cour note que le navire du requérant a été arraisonné alors qu’il se trouvait au large des côtes roumaines, à une distance de 20 milles marins, dans la zone économique exclusive de la Roumanie (paragraphe 6 ci-dessus). Il s’ensuit que les dispositions de l’article 17 du règlement (CE) no 2371/2002 qui prévoient l’égalité d’accès aux eaux et aux ressources dans les eaux communautaires étaient applicables au cas du requérant. Concernant les dispositions de l’article 8 du règlement susmentionné, la Cour constate que les autorités internes n’ont nullement fait usage du mécanisme prévu par cet article pour limiter l’accès à ces ressources.
95. La Cour note également que la Commission a clairement indiqué aux autorités roumaines que les poursuites engagées contre le requérant étaient contraires au droit de l’UE, et particulièrement aux Règlements (CE) no 2371/2002 et (UE) no 1256/2010 (paragraphe 23 ci-dessus). Elle a précisé que la législation nationale qui exigeait une licence de pêche roumaine et prévoyait un maillage minimal dans la zone économique exclusive de la Roumanie en mer Noire était contraire aux règles de la politique commune de la pêche (paragraphes 24 et 25 ci-dessus). La position de la Commission, qui portait spécifiquement sur le cas du requérant, a été communiquée aux autorités roumaines bien avant que la cour d’appel ne rende son arrêt définitif (paragraphes 23 –26 ci-dessus).
96. Le manquement de l’État défendeur aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de la politique commune de la pêche a d’ailleurs fait l’objet d’une procédure d’infraction qui portait sur l’incident impliquant le requérant et d’autres incidents similaires (paragraphes 36, 49 et 50 ci‑dessus). Cette procédure était pendante à la date à laquelle la cour d’appel a adopté l’arrêt définitif du 2 octobre 2013 (paragraphe 37 ci-dessus) et la Commission n’a mis fin à la procédure qu’après que la Roumanie a modifié sa législation interne et les règles d’accès aux eaux et ressources de la mer Noire se trouvant sous sa juridiction afin de les mettre en conformité avec le droit européen (paragraphes 51 et 52 ci-dessus).
97. Au vu des dispositions du règlement (CE) no 2371/2002 et de l’opinion très claire de la Commission au sujet de l’application des règles de la politique commune de la pêche, la Cour considère qu’en condamnant le requérant alors que selon la Commission, les poursuites contre lui étaient contraire à ces règles (paragraphe 95 ci-dessus), la cour d’appel a commis une erreur de droit manifeste. En cas de doute, la cour d’appel aurait pu saisir la CJUE au sujet de l’interprétation des règles en question.
98. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que le requérant a été victime d’un « déni de justice ».
99. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1
113. La Cour note d’emblée que la cour d’appel a jugé le requérant coupable de pêche illicite au moyen de matériel interdit et l’a condamné, outre la peine privative de liberté et les amendes pénales, à des sanctions complémentaires d’ordre pécuniaire : confiscation en valeur et interdiction temporaire de pêcher dans la zone économique exclusive de la Roumaine en mer Noire (paragraphes 45 et 46 ci-dessus).
114. Elle estime que les sanctions complémentaires pécuniaires infligées au requérant constituent une atteinte au droit de l’intéressé au respect de ses biens, et que cette atteinte s’analyse en une « réglementation de l’usage des biens », au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, pour l’interdiction temporaire de pêcher, O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd, précité, § 104 et, pour la confiscation en valeur, Plechkov c. Roumanie, no 1660/03, § 87, 16 septembre 2014).
115. Elle rappelle ensuite que l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » ; le second alinéa reconnaît aux États le droit de réglementer l’usage des biens en mettant en vigueur des « lois ». Il s’ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999‑II).
116. En l’espèce, la Cour note que les sanctions d’ordre pécuniaire infligées par la cour d’appel au requérant étaient fondées sur les dispositions de l’OUG no 23/2008 et qu’elles étaient complémentaires à la condamnation pour pêche illicite (paragraphes 46 et 57 ci-dessus).
117. Cependant, elle rappelle qu’elle vient de constater que la condamnation pénale du requérant était le résultat d’une erreur de droit manifeste (paragraphe 97 ci-dessus).
118. Dès lors, les dispositions susmentionnées ne pouvaient servir de base légale aux sanctions complémentaires d’ordre pécuniaire infligées au requérant alors que des normes européennes claires l’autorisaient à pêcher dans la zone économique exclusive de la Roumanie en mer Noire.
119. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels.
120. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
GRANDE CHAMBRE
AVOTIŅŠ c. LETTONIE du 23 mai 2007 requête 17502/07
Non violation de l'article 6-1, la CEDH examine le droit européen sur les significations des actes judiciaires interétatiques et constate qu'il n'y a pas de violation de la Convention.
1. Considérations préliminaires
96. À titre liminaire, la Cour rappelle qu’en matière de contestation dont l’issue est déterminante pour des droits de caractère civil, l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à l’exécution des décisions de justice étrangères définitives (McDonald c. France (déc.), no 18648/04, 29 avril 2008 ; Saccoccia c. Autriche, no 69917/01, §§ 60-62, 18 décembre 2008, et Sholokhov c. Arménie et Moldova, no 40358/05, § 66, 31 juillet 2012). Nul ne conteste que le jugement par lequel le tribunal de district de Limassol a, le 24 mai 2004, condamné le requérant au paiement d’une dette contractuelle, des intérêts correspondants et des frais et dépens afférents à la procédure avait pour objet la substance d’une obligation « de caractère civil » incombant à l’intéressé. L’article 6 § 1 trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
97. Le jugement du 24 mai 2004 a été rendu par un tribunal chypriote, et les juridictions lettonnes ont ordonné son exécution sur le territoire letton. En conséquence, les griefs que le requérant tire de l’article 6 de la Convention portaient dans sa requête à la fois sur la procédure chypriote et sur la procédure lettonne. À la première, il reprochait d’avoir méconnu les droits de la défense, à la seconde, d’avoir validé la procédure chypriote en ordonnant la reconnaissance et l’exécution du jugement. Toutefois, la Cour a déclaré le grief contre Chypre irrecevable pour tardiveté (décision partielle du 3 mars 2010, paragraphe 4 ci-dessus). La requête est donc, au stade actuel de la procédure, dirigée uniquement contre la Lettonie. Dans ces conditions, la Cour n’est pas compétente ratione personae pour se prononcer formellement sur le respect des exigences de l’article 6 § 1 par le tribunal de district de Limassol. En revanche, il lui appartient de dire si, en accordant l’exequatur au jugement chypriote, les juges lettons ont agi conformément à cette disposition (voir, mutatis mutandis, Pellegrini c. Italie, no 30882/96, §§ 40-41, CEDH 2001‑VIII). Or, pour ce faire, elle doit tenir compte des éléments pertinents de la procédure chypriote.
98. La Cour considère que ne peut être reconnue comme compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention une décision d’exécution d’un jugement étranger prise sans qu’aucune possibilité de dénoncer utilement le caractère inéquitable de la procédure ayant abouti à ce jugement n’ait été offerte à la partie succombante, dans l’État d’origine ou dans l’État requis. Dans sa tierce intervention, le gouvernement estonien insiste sur l’importance de la différence entre l’exécution d’une décision provenant d’un autre État partie à la Convention et l’exécution d’une décision prise par les autorités d’un État tiers. Dans le premier cas, où il est présumé que les parties peuvent obtenir la protection des droits garantis par la Convention dans le pays d’origine de la décision, le contrôle opéré par le juge requis devrait être plus restreint que dans le second cas (paragraphe 87 ci-dessus). La Cour observe qu’elle n’a encore jamais été appelée à se prononcer sur le respect des garanties du procès équitable dans le contexte de la reconnaissance mutuelle fondée sur le droit de l’Union européenne. Cela étant, elle a toujours appliqué le principe général selon lequel un juge saisi d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision étrangère ne peut y donner suite qu’après avoir opéré un certain contrôle de la décision en question à la lumière des garanties du procès équitable, l’intensité de ce contrôle pouvant varier en fonction de la nature de l’affaire (voir, mutatis mutandis, Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, § 110, série A no 240, et Pellegrini, précité, § 40). En l’espèce, elle doit donc déterminer, à la lumière des circonstances pertinentes de la cause, si le contrôle opéré par le sénat de la Cour suprême lettonne était suffisant aux fins de l’article 6 § 1.
99. La Cour tient à rappeler qu’en vertu de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne dans l’appréciation des preuves dont elle était saisie, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés protégés par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 197, CEDH 2012). Ainsi, elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les questions de fait soulevées en l’espèce devant elle, telle l’allégation du requérant selon laquelle il avait acquitté sa dette avant d’être assigné devant le juge (paragraphes 15 et 77 ci-dessus).
100. La Cour constate ensuite que la reconnaissance et l’exécution du jugement chypriote ont eu lieu en vertu du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil de l’Union européenne du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I, applicable à l’époque des faits. Le requérant allègue le non-respect, par le sénat de la Cour suprême, de l’article 34, point 2, de ce règlement, et de la disposition correspondante de la loi lettonne sur la procédure civile. La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer formellement sur le respect du droit interne, d’autres traités internationaux ou du droit de l’Union européenne (voir, par exemple, S.J. c. Luxembourg, no 34471/04, § 52, 4 mars 2008, et Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 110, 3 octobre 2014). La tâche d’interpréter et d’appliquer les dispositions du règlement Bruxelles I incombe, premièrement, à la CJUE, qui se prononce dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, et, deuxièmement, aux juges nationaux en leur qualité de juges de l’Union, c’est-à-dire lorsqu’ils mettent en œuvre le règlement tel qu’interprété par la CJUE. La compétence de la Cour européenne des droits de l’homme se limite au contrôle du respect des exigences de la Convention – en l’espèce de son article 6 § 1. Par conséquent, en l’absence d’arbitraire posant en lui-même un problème sur le terrain de l’article 6 § 1, il n’appartient pas à la Cour de porter un jugement sur la question de savoir si le sénat de la Cour suprême lettonne a correctement appliqué l’article 34, point 2, du règlement Bruxelles I ou toute autre disposition du droit de l’Union européenne.
2. Sur la présomption de protection équivalente (présomption Bosphorus)
a) Sur la portée de la présomption de protection équivalente
101. La Cour rappelle que même quand ils appliquent le droit de l’Union européenne, les États contractants demeurent soumis aux obligations qu’ils ont librement contractées en adhérant à la Convention. Ces obligations sont toutefois à apprécier sous le bénéfice de la présomption que la Cour a établie dans l’arrêt Bosphorus et développée dans l’arrêt Michaud (tous deux précités, voir également l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 338, CEDH 2011, et la décision Povse, précitée, § 76). Dans l’arrêt Michaud, la Cour a résumé sa jurisprudence relative à cette présomption de la manière suivante :
102. La Cour rappelle qu’il serait contraire au but et à l’objet de la Convention que les États contractants soient exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dès lors qu’ils agissent en exécution d’obligations découlant pour eux de leur appartenance à une organisation internationale à laquelle ils ont transféré une partie de leur souveraineté : les garanties prévues par la Convention pourraient sinon être limitées ou exclues discrétionnairement, et être par là même privées de leur caractère contraignant ainsi que de leur nature concrète et effective. Autrement dit, les États demeurent responsables au regard de la Convention des mesures qu’ils prennent en exécution d’obligations juridiques internationales, y compris lorsque ces obligations découlent de leur appartenance à une organisation internationale à laquelle ils ont transféré une partie de leur souveraineté (Bosphorus, précité, § 154).
103. Il est vrai cependant que la Cour a également jugé qu’une mesure prise en exécution de telles obligations doit être réputée justifiée dès lors qu’il est constant que l’organisation en question accorde aux droits fondamentaux (cette notion recouvrant à la fois les garanties substantielles et les mécanismes censés en contrôler le respect) une protection à tout le moins équivalente – c’est-à-dire non pas identique mais « comparable » – à celle assurée par la Convention (étant entendu qu’un constat de « protection équivalente » de ce type n’est pas définitif : il doit pouvoir être réexaminé à la lumière de tout changement pertinent dans la protection des droits fondamentaux). Si l’on considère que l’organisation offre semblable protection équivalente, il y a lieu de présumer que les États respectent les exigences de la Convention lorsqu’ils ne font qu’exécuter des obligations juridiques résultant de leur adhésion à l’organisation.
Les États demeurent toutefois entièrement responsables au regard de la Convention de tous les actes ne relevant pas strictement de leurs obligations juridiques internationales, notamment lorsqu’ils ont exercé un pouvoir d’appréciation (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 338). Par ailleurs, cette présomption peut être renversée dans le cadre d’une affaire donnée si l’on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste ; dans un tel cas, le rôle de la Convention en tant qu’ « instrument constitutionnel de l’ordre public européen » dans le domaine des droits de l’homme l’emporterait sur l’intérêt de la coopération internationale (Bosphorus, précité, §§ 152-158 ; voir aussi, notamment, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 338-340).
104. Cette présomption de protection équivalente vise notamment à éviter qu’un État partie soit confronté à un dilemme lorsqu’il lui faut invoquer les obligations juridiques qui s’imposent à lui, en raison de son appartenance à une organisation internationale non partie à la Convention, à laquelle il a transféré une partie de sa souveraineté, pour justifier, au regard de la Convention, ses actions ou omissions résultant de cette appartenance. Cette présomption tend également à déterminer les cas où la Cour peut, au nom de l’intérêt de la coopération internationale, réduire l’intensité de son contrôle du respect des engagements résultant de la Convention par les États parties, que lui confie l’article 19 de la Convention. Il résulte de ces objectifs que la Cour n’est prête à cet aménagement que dans la mesure où les droits et garanties dont elle assure le respect ont bénéficié d’un contrôle comparable à celui qu’elle opérerait. À défaut, l’État échapperait à tout contrôle international de la compatibilité de ses actes avec ses engagements résultant de la Convention. »
102. La Cour a jugé, dans le cadre de l’ancien « premier pilier » de l’Union (Bosphorus, précité, § 72), que la protection des droits fondamentaux assurée par l’ordre juridique de l’Union européenne était en principe équivalente à celle assurée par la Convention. Pour parvenir à cette conclusion, elle a constaté, premièrement, que l’Union européenne offrait une protection équivalente à celle de la Convention sur le plan des garanties substantielles, relevant à cet égard que, déjà à l’époque des faits, le respect des droits fondamentaux était une condition de légalité des actes communautaires, et que la CJUE se référait largement aux dispositions de la Convention et à la jurisprudence de Strasbourg lorsqu’elle procédait à son appréciation (Bosphorus, précité, § 159). Ce constat vaut a fortiori depuis le 1er décembre 2009, date à laquelle est entré en vigueur l’article 6 modifié du Traité sur l’Union européenne, qui confère à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne la même valeur que les traités et qui prévoit que les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union européenne en tant que principes généraux (Michaud, précité, § 106).
103. La Cour a conclu à l’équivalence de la protection substantielle accordée par le droit de l’Union en tenant compte des dispositions de l’article 52 § 3 de la Charte des droits fondamentaux, aux termes duquel, dans la mesure où les droits de la Charte correspondent à ceux qui sont garantis par la Convention, leur sens et leur portée sont les mêmes, sans préjudice de la possibilité pour le droit de l’Union d’accorder une protection plus étendue (Bosphorus, précité, § 80). Appelée à vérifier si, dans l’affaire dont elle est saisie, elle peut toujours considérer que la protection accordée par le droit de l’Union est équivalente à celle accordée par la Convention, la Cour est d’autant plus attentive au respect de la règle énoncée à l’article 52 § 3 de la Charte des droits fondamentaux que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (paragraphe 37 ci-dessus) a donné à cette charte la même valeur juridique que celle des traités.
104. Deuxièmement, la Cour a reconnu que le mécanisme de contrôle du respect des droits fondamentaux prévu par le droit de l’Union européenne accorde lui aussi, lorsqu’il a pu déployer l’intégralité de ses potentialités, une protection comparable à celle qu’offre la Convention. Sur ce point, elle a attaché une grande importance au rôle et aux compétences de la CJUE, bien que l’accès des particuliers aux recours ouverts devant cette juridiction soit nettement plus restreint que celui qu’ils ont aux recours ouverts devant elle en vertu de l’article 34 de la Convention (voir les arrêts précités Bosphorus, §§ 160-165, et Michaud, §§ 106-111).
b) Sur la question de l’application de la présomption de protection équivalente en l’espèce
105. La Cour rappelle que l’application de la présomption de protection équivalente dans l’ordre juridique de l’Union européenne est soumise à deux conditions, qu’elle a formulées dans l’arrêt Michaud (précité) : l’absence de marge de manœuvre pour les autorités nationales et le déploiement de l’intégralité des potentialités du mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union européenne (ibidem, §§ 113-115). Elle doit donc s’assurer du respect de ces deux conditions dans la présente affaire.
106. Pour ce qui est de la première condition, la Cour constate tout d’abord que la disposition mise en œuvre par le sénat de la Cour suprême figurait dans un règlement, directement applicable dans les États membres en tous ses éléments, et non dans une directive, qui aurait lié l’État quant au résultat à atteindre mais lui aurait laissé le choix des moyens et de la forme (voir, a contrario, Michaud, précité, § 113). En ce qui concerne la disposition précise appliquée en l’espèce, à savoir l’article 34, point 2 du règlement Bruxelles I, la Cour relève qu’elle ne permettait le refus de la reconnaissance et de l’exequatur d’un jugement étranger que dans des limites très précises et sous réserve que soient remplies certaines conditions préalables : il fallait que « l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’[ait] pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ». Il ressort de l’interprétation donnée par la CJUE dans une jurisprudence relativement abondante (paragraphes 57-61 ci-dessus) que cette disposition ne conférait pas de pouvoir d’appréciation au juge saisi de la demande d’exequatur. La Cour conclut donc que le sénat de la Cour suprême lettonne ne disposait ici d’aucune marge de manœuvre..
107. Dès lors, la présente affaire se distingue de l’affaire M.S.S. (précitée), dans laquelle, examinant la question de la responsabilité de la Belgique au regard de la Convention, la Cour a relevé que, sous le régime du règlement applicable (règlement Dublin II), les autorités de l’État belge conservaient le pouvoir discrétionnaire de décider de faire usage ou non de la clause dite de « souveraineté », qui leur permettait d’examiner la demande d’asile et de ne pas renvoyer le requérant en Grèce si elles considéraient que cet État était susceptible de ne pas honorer ses obligations au titre de la Convention (§§ 339-340). En revanche, l’article 34, point 2, du règlement Bruxelles I n’accordait aux États aucun pouvoir discrétionnaire d’appréciation de ce type.
108. Dans sa tierce intervention, le Centre AIRE avance que le sénat de la Cour suprême lettonne aurait pu et aurait dû recourir à l’article 34, point 1, du règlement Bruxelles I, en vertu duquel la demande d’exequatur était rejetée si « la reconnaissance [était] manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ». Selon le Centre AIRE, cette disposition laissait à la juridiction lettonne une marge d’appréciation (paragraphe 94 ci‑dessus). Toutefois, devant la Cour suprême, le débat a été circonscrit par le requérant à l’application du point 2 de l’article susvisé. La Cour limitera donc son analyse aux doléances du requérant telles qu’il les a formulées devant la Cour suprême, et devant elle dans le cadre de la présente affaire ; elle considère qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité d’appliquer une autre disposition du règlement Bruxelles I.
109. En ce qui concerne la seconde condition, à savoir le déploiement de l’intégralité des potentialités du mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union européenne, la Cour rappelle d’abord que dans l’arrêt Bosphorus précité, elle a reconnu que, considérés globalement, les mécanismes de contrôle mis en place au sein de l’Union offraient un niveau de protection équivalent à celui assuré par le mécanisme de la Convention (ibidem, §§ 160‑164). Se tournant ensuite vers les circonstances de la présente affaire, elle relève que le sénat de la Cour suprême n’a pas saisi la CJUE d’un renvoi préjudiciel concernant l’interprétation et l’application de l’article 34, point 2, du règlement. Toutefois, elle estime que cette seconde condition doit être appliquée sans formalisme excessif et en tenant compte des particularités du mécanisme de contrôle en cause. Elle considère en effet qu’il serait sans pertinence de subordonner la mise en œuvre de la présomption Bosphorus à la condition que la juridiction nationale s’adresse à la CJUE dans tous les cas sans exception, y compris ceux où aucune question réelle et sérieuse ne se poserait quant à la protection des droits fondamentaux par le droit de l’Union ou ceux dans lesquels la CJUE aurait déjà indiqué de façon précise l’interprétation – conforme aux droits fondamentaux – qu’il convient de donner aux dispositions du droit de l’Union applicable.
110. La Cour rappelle que, dans un contexte différent, elle a dit qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue de motiver au regard des exceptions énoncées dans la jurisprudence de la CJUE son refus de saisir cette cour à titre préjudiciel. Le juge national doit donc indiquer les raisons pour lesquelles il considère qu’un renvoi préjudiciel n’est pas nécessaire (Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, nos 3989/07 et 38353/07, § 62, 20 septembre 2011, et Dhahbi c. Italie, no 17120/09, §§ 31-34, 8 avril 2014). La Cour souligne que le contrôle qu’elle opère à cet égard a pour objet de déterminer si le refus d’opérer un renvoi préjudiciel a constitué en lui-même une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et que, pour ce faire, elle prend en compte la ligne de conduite déjà fixée par la jurisprudence de la CJUE. Ce contrôle est donc différent de celui qu’elle opère lorsque, comme en l’espèce, elle tient compte de la décision de ne pas opérer un renvoi préjudiciel dans l’appréciation d’ensemble que, conformément à sa jurisprudence Michaud, elle fait du degré de protection des droits fondamentaux assuré par le droit de l’Union européenne afin de déterminer si elle peut appliquer à la décision contestée la présomption de protection équivalente, présomption qu’elle applique selon des conditions qu’elle fixe elle-même.
111. La Cour considère donc qu’il faut apprécier en fonction des circonstances particulières de chaque affaire la question de savoir si les mécanismes de contrôle prévus par le droit de l’Union européenne ont pu déployer l’intégralité de leurs potentialités, et plus précisément si le fait que la juridiction interne saisie du litige n’ait pas opéré de renvoi préjudiciel à la CJUE est de nature à écarter l’application de la présomption de protection équivalente. En l’occurrence, elle constate que le requérant n’a avancé aucun point précis lié à l’interprétation de l’article 34, point 2, du règlement Bruxelles I et à sa compatibilité avec les droits fondamentaux qui permettrait de considérer qu’il aurait été nécessaire de procéder à un renvoi préjudiciel devant la CJUE. Cette analyse est confirmée par le constat que le requérant n’a présenté au sénat de la Cour suprême de Lettonie aucune demande de renvoi préjudiciel. La présente affaire se distingue donc nettement de l’affaire Michaud (précitée), où la haute juridiction nationale avait écarté la demande de saisine préjudicielle de la CJUE formée par le requérant alors que la question de la compatibilité avec la Convention de la disposition litigieuse du droit de l’Union européenne n’avait jamais été tranchée par la CJUE auparavant (ibidem, § 114). Ainsi, l’absence de renvoi préjudiciel n’est pas un facteur déterminant en l’espèce. La seconde condition d’application de la présomption Bosphorus doit donc être considérée comme remplie.
112. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la présomption de protection équivalente s’applique en l’espèce, le sénat de la Cour suprême n’ayant fait qu’exécuter les obligations juridiques découlant pour la Lettonie de sa qualité de membre de l’Union européenne (voir, mutatis mutandis, la décision Povse, précitée, § 78). Dès lors, la tâche de la Cour se limite à rechercher si la protection des droits garantis par la Convention est entachée en l’espèce d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser cette présomption, auquel cas le respect de la Convention en tant qu’« instrument constitutionnel de l’ordre public européen » dans le domaine des droits de l’homme l’emporterait sur l’intérêt de la coopération internationale (voir les arrêts précités Bosphorus, § 156, et Michaud, § 103). Dans le cadre de cet examen, la Cour devra tenir compte tant de l’article 34, point 2, du règlement Bruxelles I en tant que tel que des circonstances particulières de sa mise en œuvre en l’espèce.
3. Sur l’allégation d’insuffisance manifeste de protection des droits garantis par la Convention
a) Remarques générales sur la reconnaissance mutuelle
113. À titre général, la Cour observe que le règlement Bruxelles I s’appuie pour partie sur des mécanismes de reconnaissance mutuelle eux‑mêmes fondés sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne. En son préambule, le règlement indique que sa logique est celle de la « confiance réciproque dans la justice » au sein de l’Union, ce qui implique que « la déclaration relative à la force exécutoire d’une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu’il soit possible pour la juridiction de soulever d’office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement » (paragraphe 54 ci-dessus). La Cour est consciente de l’importance des mécanismes de reconnaissance mutuelle pour la construction de l’espace de liberté, de sécurité et de justice visé à l’article 67 du TFUE, et de la confiance mutuelle qu’ils nécessitent. Comme l’indiquent les articles 81 § 1 et 82 § 1 du TFUE, la reconnaissance mutuelle des décisions de justice sert notamment à faciliter une coopération judiciaire efficace dans les domaines civil et pénal. La Cour a déjà indiqué à de nombreuses reprises son attachement à la coopération internationale et européenne (voir, entre autres, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, §§ 63 et 72, CEDH 1999‑I, et Bosphorus, précité, § 150). Ainsi, elle estime entièrement légitimes au regard de la Convention, dans leur principe, la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en Europe et l’adoption des moyens nécessaires à cette fin.
114. En revanche, les modalités de la création de cet espace ne peuvent se heurter aux droits fondamentaux des personnes concernées par les mécanismes ainsi mis en place – cette limite est d’ailleurs confirmée par l’article 67 § 1 du TFUE. Or il apparaît que l’objectif d’efficacité poursuivi par certaines de ces modalités conduit à encadrer strictement le contrôle du respect des droits fondamentaux, voire à le limiter. Ainsi, la CJUE a récemment indiqué dans son avis 2/13 que « lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres peuvent être tenus, en vertu de ce même droit, de présumer le respect des droits fondamentaux par les autres États membres, de sorte qu’il ne leur est pas possible (...), sauf dans des cas exceptionnels, de vérifier si cet autre État membre a effectivement respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux garantis par l’Union » (paragraphe 49 ci-dessus). Or limiter aux seuls cas exceptionnels le contrôle par l’État requis du respect des droits fondamentaux par l’État d’origine de la décision de justice à reconnaître pourrait, dans des situations concrètes, aller à l’encontre de l’obligation qu’impose la Convention de permettre au moins au juge de l’État requis de procéder à un contrôle adapté à la gravité des allégations sérieuses de violation des droits fondamentaux dans l’État d’origine afin d’éviter une insuffisance manifeste dans la protection de ces droits.
115. Par ailleurs, la Cour rappelle que lorsque les autorités internes mettent en œuvre le droit de l’Union européenne sans disposer d’un pouvoir d’appréciation à cet égard, la présomption de protection équivalente énoncée dans l’arrêt Bosphorus trouve à s’appliquer. Tel est le cas lorsque les mécanismes de reconnaissance mutuelle obligent le juge à présumer le respect suffisant des droits fondamentaux par un autre État membre. Le juge national se voit alors privé de son pouvoir d’appréciation sur cette question, ce qui entraîne une application automatique de la présomption d’équivalence de l’arrêt Bosphorus. La Cour souligne qu’ainsi, de façon paradoxale, le contrôle du juge sur le respect des droits fondamentaux est doublement limité par l’effet conjugué de la présomption sur laquelle repose la reconnaissance mutuelle et de la présomption de protection équivalente de l’arrêt Bosphorus.
116. Dans l’arrêt Bosphorus, la Cour a rappelé que la Convention est un « instrument constitutionnel de l’ordre public européen » (ibidem, § 156). En conséquence, elle doit, lorsque les conditions d’application de la présomption de protection équivalente sont réunies (paragraphes 105-106 ci‑dessus), s’assurer que les dispositifs de reconnaissance mutuelle ne laissent subsister aucune lacune ou situation particulière donnant lieu à une insuffisance manifeste de la protection des droits de l’homme garantis par la Convention. Ce faisant, elle tient compte, dans un esprit de complémentarité, du mode de fonctionnement de ces dispositifs et notamment de leur objectif d’efficacité. Néanmoins, elle doit vérifier que le principe de reconnaissance mutuelle n’est pas appliqué de manière automatique et mécanique (voir, mutatis mutandis, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, §§ 98 et 107, CEDH 2013) au détriment des droits fondamentaux – droits dont la CJUE rappelle elle aussi le nécessaire respect dans ce contexte (voir, par exemple, l’arrêt Alpha Bank Cyprus Ltd cité au paragraphe 48 ci-dessus). Dans cet esprit, lorsque les juridictions des États qui sont à la fois partie à la Convention et membres de l’Union européenne sont appelées à appliquer un mécanisme de reconnaissance mutuelle établi par le droit de l’Union, c’est en l’absence de toute insuffisance manifeste des droits protégés par la Convention qu’elles donnent à ce mécanisme son plein effet. En revanche, s’il leur est soumis un grief sérieux et étayé dans le cadre duquel il est allégué que l’on se trouve en présence d’une insuffisance manifeste de protection d’un droit garanti par la Convention et que le droit de l’Union européenne ne permet pas de remédier à cette insuffisance, elles ne peuvent renoncer à examiner ce grief au seul motif qu’elles appliquent le droit de l’Union.
b) Sur l’existence d’une insuffisance manifeste de protection des droits fondamentaux en l’espèce
117. La Cour doit à présent rechercher si la protection des droits fondamentaux opérée par le sénat de la Cour suprême lettonne est entachée en l’espèce d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente, en ce qui concerne tant la disposition du droit de l’Union européenne appliquée en l’occurrence que sa mise en œuvre dans le cas particulier du requérant.
118. La Cour considère que l’obligation d’épuisement des voies de recours posée par le mécanisme instauré par l’article 34, point 2, du règlement Bruxelles I tel qu’interprété par la CJUE (le défendeur doit avoir exercé les recours disponibles dans l’État d’origine avant de pouvoir invoquer l’absence de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance) n’est pas en elle-même problématique au regard des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’agit d’une condition préalable qui poursuit l’objectif d’assurer une bonne administration de la justice dans un esprit d’économie procédurale, et qui procède d’une logique comparable à celle de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention. Cette logique s’articule autour de deux axes : d’une part, un État n’a pas à répondre de ses actes au plan international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans son ordre juridique interne ; d’autre part, il est présumé que cet ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, mutatis mutandis, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, et Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], no 40167/06, § 115, CEDH 2015). La Cour ne décèle donc aucune insuffisance manifeste sur ce point.
119. Cela étant, elle tient à rappeler que le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de « procès équitable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils exigent un « juste équilibre » entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (voir, par exemple, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 56, CEDH 2004‑III). Ces principes, qui couvrent l’ensemble du droit procédural des États contractants, s’applique également dans le domaine particulier de la signification et de la notification aux parties des actes judiciaires (Miholapa c. Lettonie, no 61655/00, § 23, 31 mai 2007, et Övüş c. Turquie, no 42981/04, § 47, 13 octobre 2009), même si l’article 6 § 1 ne peut pas être interprété comme prescrivant une forme particulière de signification ou de notification (Orams c. Chypre (déc.), précitée).
120. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour constate que, devant les juridictions lettonnes, le requérant soutenait en particulier que la citation à comparaître devant le tribunal de district de Limassol et la demande de la société F.H. Ltd ne lui avaient pas été dûment communiquées en temps utile, de sorte qu’il n’avait pas pu se défendre. Il estimait donc qu’il y avait lieu de refuser de reconnaître la décision de justice litigieuse en vertu de l’article 34, point 2, du règlement Bruxelles I. Selon lui, en effet, la citation avait été envoyée à une adresse où il ne pouvait matériellement pas être trouvé, alors que les avocats chypriotes et lettons représentant la société demanderesse connaissaient parfaitement son adresse professionnelle à Riga et pouvaient aisément obtenir son adresse privée (paragraphe 30 ci-dessus). Il a donc plaidé devant les juridictions lettonnes, de manière argumentée, l’existence d’un vice procédural a priori contraire à l’article 6 § 1 de la Convention et faisant obstacle à l’exécution du jugement chypriote en Lettonie.
121. À la lumière des principes généraux rappelés ci-dessus, la Cour constate que, devant le sénat de la Cour suprême, le requérant avait invoqué l’absence de citation et de notification du jugement chypriote. Il se fondait donc sur le cas de non-reconnaissance prévu par l’article 34, point 2, du règlement Bruxelles I. Or cette disposition énonce expressément que l’on ne peut invoquer un tel cas qu’à condition d’avoir exercé au préalable un recours à l’encontre de la décision en question, pour autant qu’un tel recours ait été possible. Dès lors que le requérant se fondait sur cet article sans avoir exercé le recours exigé, la question de la disponibilité à Chypre de cette voie de droit dans les circonstances de l’espèce se posait nécessairement. Dans ces conditions, le sénat ne pouvait pas, comme il l’a fait dans son arrêt du 31 janvier 2007, se contenter de reprocher au requérant de ne pas avoir contesté la décision litigieuse, tout en restant silencieux sur la question de la charge de la preuve de l’existence et de la disponibilité d’un recours dans l’État d’origine, alors que l’article 6 § 1 de la Convention, comme le libellé de l’article 34, point 2, in fine, du règlement Bruxelles I, lui faisait obligation de vérifier qu’était remplie cette condition sans laquelle il ne pouvait refuser d’examiner le grief soulevé par le requérant. La Cour estime que la détermination de la charge de la preuve, qui, comme la Commission européenne le souligne (paragraphe 92 ci-dessus), n’est pas régie par le droit de l’Union européenne, était donc décisive en l’espèce. Ce point devait donc être examiné dans le cadre d’un débat contradictoire aboutissant à une conclusion motivée. Or la Cour suprême a tacitement présumé soit que cette charge pesait sur la partie défenderesse soit que le requérant avait effectivement disposé d’un tel recours. Cette attitude, qui traduit une application littérale et automatique de l’article 34, point 2, du règlement Bruxelles I, pourrait en théorie constituer une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente des droits de la défense protégés par l’article 6 § 1. Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que tel n’est pas le cas, même si cette défaillance est regrettable.
122. Il ressort en effet des informations fournies par le gouvernement chypriote à la demande de la Grande Chambre, et non contestées par les parties, que le droit chypriote offrait au requérant après qu’il eut appris l’existence du jugement une possibilité tout à fait réaliste de recours malgré le temps écoulé depuis le prononcé de ce jugement. En vertu du droit et de la jurisprudence chypriotes, lorsque le défendeur contre lequel un jugement a été rendu par défaut forme une opposition contre ce jugement et soutient, de manière défendable, qu’il n’a pas été correctement cité devant le juge du fond, la juridiction saisie a l’obligation – et non pas seulement le droit – d’annuler le jugement rendu par défaut (paragraphe 68 ci-dessus). Dès lors, l’argument du requérant consistant à dire qu’une telle procédure aurait été vouée à l’échec ne convainc pas la Cour. Celle-ci a toujours dit que, s’il existe un doute quant à la question de savoir si une voie de recours déterminée offre une perspective réelle de succès, ce point doit être soumis aux juridictions internes (voir par exemple Akdivar, précité, § 71, et Naydenov c. Bulgarie, no 17353/03, § 50, 26 novembre 2009). En l’espèce, elle considère que le requérant a disposé d’un temps suffisant entre le 16 juin 2006 (date à laquelle il a eu accès à l’intégralité du dossier de l’affaire dans les locaux du tribunal de première instance et pu prendre connaissance de la teneur du jugement chypriote) et le 31 janvier 2007 (date de l’audience du sénat de la Cour suprême) pour exercer un recours devant les instances chypriotes. Or, pour des raisons connues de lui seul, il n’a pas même tenté de le faire.
123. Le fait que les voies de recours disponibles n’aient pas été mentionnées dans le jugement chypriote est sans incidence sur les conclusions de la Cour. Il est vrai que l’article 230 § 1 de la loi lettonne sur la procédure civile oblige les tribunaux à indiquer dans les décisions qu’ils rendent les modalités et les délais de recours contre ces décisions (paragraphe 67 ci‑dessus). Toutefois, l’existence de cette obligation, dont on ne peut que se féliciter puisqu’elle apporte une garantie supplémentaire facilitant l’exercice des droits des justiciables, ne peut pas être déduite de l’article 6 § 1 de la Convention (Société Guérin Automobiles c. les 15 États de l’Union européenne (déc.), no 51717/99, 4 juillet 2000). Il incombait donc au requérant après qu’il eut pris connaissance du jugement litigieux de s’enquérir lui-même, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, des recours disponibles à Chypre.
124. Sur ce point, la Cour considère comme le gouvernement défendeur que le requérant, qui exerçait la profession de consultant en investissement, aurait dû être conscient des conséquences juridiques de l’acte de reconnaissance de dette qu’il avait signé. Cet acte était régi par la loi chypriote, il concernait une somme d’argent empruntée par le requérant à une société chypriote et il contenait une clause de choix du for en faveur des tribunaux chypriotes. Dès lors, le requérant aurait dû veiller à connaître les modalités d’une éventuelle procédure devant les juridictions chypriotes (voir, mutatis mutandis, Robba c. Allemagne, no 20999/92, décision de la Commission du 28 février 1996, non publiée). Ne s’étant pas informé à ce sujet, il a, par son inaction et son manque de diligence, largement contribué à créer la situation dont il se plaint devant la Cour, situation qu’il aurait pu éviter de manière à ne subir aucun préjudice (voir, mutatis mutandis, Hussin c. Belgique (déc.), no 70807/01, 6 mai 2004, et McDonald c. France, décision précitée).
125. Ainsi, dans les circonstances particulières de la cause, la Cour ne constate pas d’insuffisance manifeste de protection des droits fondamentaux de nature à renverser la présomption de protection équivalente.
126. Enfin, pour ce qui est du reste des griefs que le requérant tire de l’article 6 § 1, et dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, elle ne décèle aucune apparence de violation des droits garantis par cette disposition.
127. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.
ROMANCZYK contre FRANCE du 18 novembre 2010 Requête 7618/05
56. En l'espèce, la Cour relève que la requérante a obtenu une décision définitive, rendue par les tribunaux polonais, ordonnant à A.R. de verser une pension alimentaire et qu'elle a eu recours au mécanisme de la Convention de New York afin d'obtenir l'assistance des autorités françaises (« l'Etat du débiteur ») dans le recouvrement de cette pension. La Cour considère qu'en dénonçant l'impossibilité d'obtenir des autorités françaises l'exécution du jugement polonais et la durée excessive de la procédure, la requérante se plaint en réalité de leur manque de diligence pour l'assister dans le recouvrement de ses créances alimentaires.
AVOTIŅŠ c. LETTONIE du 25 février 2014 requête 17502/07
45. La Cour rappelle qu'en matière de contestation dont l'issue est déterminante pour des droits de caractère civil, l'article 6 § 1 de la Convention s'applique à l'exécution des jugements étrangers passés en force de chose jugée (Sholokhov c. Arménie et Moldova, no 40358/05, § 66, 31 juillet 2012, et McDonald c. France (déc.), no 18648/04, 29 avril 2008). Or, nul ne conteste que le jugement du tribunal de district de Limassol du 24 mai 2004, condamnant le requérant au paiement d'une dette contractuelle, ainsi que des intérêts et des frais et dépens y afférents, avait pour objet la substance d'une obligation « de caractère civil » dans le chef de l'intéressé. L'article 6 § 1 trouve donc à s'appliquer en l'espèce.
46. La Cour note ensuite que le jugement sur le fond du 24 mai 2004 a été rendu par un tribunal chypriote, et que les juridictions lettonnes ont ordonné son exécution sur le territoire letton. Cependant, le grief contre Chypre ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté (voir la décision partielle du 3 mars 2010), la requête est, au stade actuel de la procédure, dirigée uniquement contre la Lettonie. Dans ces circonstances, la Cour n'est pas compétente ratione personae pour se prononcer sur le respect des exigences de l'article 6 § 1 par le tribunal de district de Limassol. En revanche, il lui appartient de dire si, en donnant l'exequatur au jugement chypriote, les juges lettons ont agi conformément à ladite disposition (voir, mutatis mutandis, Pellegrini c. Italie, no 30882/96, §§ 40-41, 2001‑VIII).
47. En l'occurrence, le requérant allègue le non-respect, par le sénat de la Cour suprême, de l'article 34, point 2, du Règlement, et de la disposition correspondante de la loi sur la procédure civile. À cet égard, la Cour tient à rappeler qu'en vertu de l'article 19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention elle-même et par ses Protocoles. Elle n'est donc pas compétente pour se prononcer formellement sur le respect du droit interne, d'autres traités internationaux et du droit de l'Union européenne (voir, par exemple, Jetzen c. Luxembourg, no 34471/04, § 52, 4 mars 2008). En particulier, la tâche d'interpréter et d'appliquer les dispositions du Règlement incombe, premièrement, à la Cour de justice de l'Union européenne qui se prononce dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, et deuxièmement, aux juges nationaux en leur qualité de juges de l'Union, c'est-à-dire lorsqu'ils mettent en œuvre l'interprétation donnée par la Cour de justice. Quant à la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle se limite au contrôle du respect des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention dans les circonstances de l'espèce. Par ailleurs, la Cour a jugé que la protection des droits fondamentaux accordée par l'Union européenne était en principe équivalente à celle assurée par la Convention (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, §§ 160-165, CEDH 2005‑VI).
48. La Cour rappelle ensuite qu'un élément important de la notion de « procès équitable », au sens de cette disposition, est le principe de l'égalité des armes, qui exige un « juste équilibre » entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (voir, par exemple, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 56, CEDH 2004‑III). Ces principes visant l'ensemble du droit procédural des États contractants, ils s'appliquent également dans ce domaine particulier qu'est la signification et la notification des actes judiciaires aux parties (Miholapa c. Lettonie, no 61655/00, § 23, 31 mai 2007, et Övüş c. Turquie, no 42981/04, § 47, 13 octobre 2009). En revanche, l'article 6 § 1 de la Convention ne peut pas être interprété comme prescrivant une forme particulière de signification ou de notification (Orams c. Chypre (déc.), no 27841/07, 10 juin 2010).
49. La Cour relève que, selon le préambule du Règlement de Bruxelles I, ce texte se fonde sur le principe de « confiance réciproque dans la justice » au sein de l'Union, ce qui implique que « la déclaration relative à la force exécutoire d'une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu'il soit possible pour la juridiction de soulever d'office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement » (paragraphe 24 ci-dessus). À cet égard, la Cour rappelle que l'exécution par l'État de ses obligations juridiques découlant de son adhésion à l'Union européenne relève de l'intérêt général (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi précité, §§ 150-151, et Michaud c. France, no 12323/11, § 100, CEDH 2012) ; le sénat de la Cour suprême lettonne se devait donc d'assurer la reconnaissance et l'exécution rapide et effective du jugement chypriote en Lettonie.
50. Devant les juridictions lettonnes, le requérant soutenait que la citation de comparaître devant le tribunal de district de Limassol et la demande de la société F.H.Ltd. ne lui avaient pas été correctement communiquées en temps utile, de sorte qu'il n'avait pas pu se défendre ; par conséquent, selon lui, la reconnaissance de ce jugement devait être refusée sur la base de l'article 34, point 2, du Règlement. Dans son arrêt du 31 janvier 2007, le sénat de la Cour suprême a écarté tous ses moyens – et, donc, l'application de l'article 34, point 2, du Règlement – en déclarant que, le requérant « n'ayant pas fait appel du jugement, les arguments de son avocat selon lesquels [il] ne se serait pas vu dûment notifier l'examen de l'affaire par un tribunal étranger, n'ont aucune importance ». Cela correspond en substance à l'interprétation donnée à la disposition susmentionnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt Apostolides c. Orams, aux termes duquel « la reconnaissance ou l'exécution d'une décision prononcée par défaut ne peuvent pas être refusées au titre de l'article 34, point 2, du règlement no 44/2001 lorsque le défendeur a pu exercer un recours contre la décision rendue par défaut et que ce recours lui a permis de faire valoir que l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent ne lui avait pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre » (paragraphe 28 ci-dessus).
51. Or, il y a lieu de constater qu'effectivement, le requérant n'a même pas tenté d'exercer un recours quelconque contre le jugement du 24 mai 2004 du tribunal de district de Limassol. Les raisons qu'il avance pour justifier cette omission ne convainquent pas la Cour. En effet, il ressort des faits de l'affaire que le requérant, lui-même consultant en investissement, a emprunté une somme d'argent à une société chypriote ; qu'il a signé un acte de reconnaissance de dette régi par la loi chypriote et contenant une clause de choix de for en faveur des tribunaux chypriotes. Puisqu'il a assumé cette responsabilité contractuelle de son plein gré, on pouvait aussi attendre de lui qu'il prît connaissance – s'entourant au besoin de conseils éclairés – des conséquences juridiques d'un éventuel non-paiement de sa dette, y compris des modalités de la procédure devant les juridictions chypriotes. Le fait que le jugement litigieux ne comportât aucune mention des voies de recours, n'est pas non plus décisif en l'espèce, le requérant étant libre de s'enquérir lui-même, ou par le biais d'un avocat, des recours disponibles à Chypre, après avoir pris connaissance du jugement litigieux. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a, de son propre fait, perdu l'opportunité de plaider la méconnaissance du droit chypriote, et que c'est à lui qu'il incombait d'apporter la preuve de la non-existence ou de l'inefficacité d'éventuels recours, – ce qu'il n'a fait ni devant le sénat de la Cour suprême lettonne ni par ailleurs devant la Cour européenne des droits de l'homme.
52. Eu égard à toutes les circonstances particulières de l'affaire, en particulier l'intérêt qu'avaient les juridictions lettonnes d'assurer l'exécution des obligations juridiques découlant du statut de membre de l'Union européenne, la Cour considère qu'en écartant les moyens du requérant par une simple référence au fait qu'il n'avait pas fait appel du jugement du tribunal de district de Limassol, le sénat de la Cour suprême de Lettonie a tenu suffisamment compte des droits de l'intéressé au titre de l'article 6 § 1 de la Convention.
53. Enfin, pour ce qui est du reste des allégations du requérant sous l'angle de l'article 6 § 1, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par cette disposition.
54. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 dans la présente affaire.
COMPETENCE UNIVERSELLE EN DROIT INTERNE
Association des familles des victimes du Joola c. France du 24 février 2022 requête no 21119/19
Art 6-1 : L’immunité de juridiction d’un État étranger : une limitation au droit d’accès à un tribunal compatible avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme
La Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable comme manifestement mal fondée. Le 26 septembre 2002, le navire Joola, acquis par l’État sénégalais, en 1990, pour assurer une liaison entre la Casamance et le reste du pays, fit naufrage dans les eaux internationales au large de la République de Gambie : 1 863 des 1 928 passagers et hommes d’équipage embarqués trouvèrent la mort ou furent portés disparus, parmi lesquels plusieurs ressortissants français. L’Association requérante, qui regroupe des hommes, des femmes, des enfants ayant perdu dans le naufrage du ferry sénégalais un membre de leur famille ou un proche ainsi que des victimes rescapées de cet accident, invoquait devant Cour une méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal en raison de l’immunité de juridiction ayant conduit au prononcé d’un non-lieu dans le cadre des plaintes portées devant les juridictions françaises. La Cour rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle l’octroi de l’immunité souveraine à un État dans une procédure civile poursuit le but légitime d’assurer le respect du droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États en garantissant le respect de la souveraineté des autres États. La Cour relève ensuite que les juridictions françaises ont considéré que les violations des réglementations internationales de navigation maritime qui étaient imputées aux personnes impliquées à un niveau élevé de l’État sénégalais résultaient d’un exercice de la souveraineté du Sénégal et non d’actes de gestion privée. Elle note que la Cour de cassation a souligné que les infractions reprochées aux dirigeants sénégalais de l’époque du naufrage, quelle qu’en soit la gravité, ne relevaient pas des exceptions au principe de l’immunité des représentants de l’État dans l’expression de sa souveraineté. La Cour constate enfin qu’en accordant l’immunité concernée, les juridictions internes ne se sont pas écartées des normes internationales actuellement admises. Après avoir relevé qu’il n’y avait rien d’arbitraire ni de déraisonnable dans l’interprétation donnée par les juridictions internes aux principes de droits applicables ni dans la manière dont elles les ont appliqués au cas d’espèce, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée.
CEDH
24. Le droit d’accès aux tribunaux n’est toutefois pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi les précédents concernant l’immunité juridictionnelle d’un État étranger, Fogarty, précité, § 33, et, Jones et autres c. Royaume-Uni, précité, § 186).
25. En l’espèce, et comme l’a rappelé la chambre de l’instruction, la requérante a subi une limitation de son droit d’accès à un tribunal en ce que qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un procès où il serait débattu de la responsabilité pénale des dirigeants sénégalais de l’époque du naufrage.
26. Sur le point de savoir, en premier lieu, si cette limitation du droit à un tribunal poursuivait un but légitime, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, en application du principe par in parem non habet imperium, en vertu duquel un État ne peut être soumis à la juridiction d’un autre État, elle considère que l’octroi de l’immunité souveraine à un État dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États en garantissant le respect de la souveraineté des autres États (Fogarty, précité, § 34, Jones et autres c. Royaume-Uni, précité, § 188). Elle ne voit aucune raison de mettre en cause la légitimité de ce but dans les circonstances de l’espèce.
27. La Cour doit, en second lieu, déterminer si la restriction litigieuse était proportionnée au but poursuivi.
28. À cet égard, elle rappelle, premièrement, la nécessité d’interpréter la Convention avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie intégrante, y compris celles régissant l’octroi de l’immunité aux États, ce qui l’a conduit à conclure que des mesures prises par un État qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des États ne sauraient passer pour imposer une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1. Ainsi, de même que le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet article, certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité des États (Fogarty, précité, §§ 35-36, Jones et autres précité, § 189).
29. La Cour constate que les juridictions internes ont considéré que la coutume internationale qui s’oppose à la poursuite des États devant les juridictions pénales d’un État étranger s’étend aux organes et entités qui constituent l’émanation de l’État ainsi qu’à leurs agents en raison d’actes qui relèvent de la souveraineté de l’État. S’agissant des personnes ayant agi à un degré élevé dans l’appareil d’État sénégalais à propos du navire, elles ont ensuite analysé si leurs actes ou omissions relevaient des actes de puissance publique ou de gestion, aux fins de rechercher si l’immunité de juridiction s’appliquait ratione materiae à l’ensemble de ces actes ou omissions, et dans la négative, si elle était susceptible de limitation. Elles ont finalement estimé que les violations des réglementations internationales de navigation maritime qui leur étaient imputées résultaient d’un exercice de la souveraineté du Sénégal et non d’actes de gestion privée. La Cour note également que la Cour de cassation, se remettant à l’état du droit international, a souligné que les infractions reprochées aux dirigeants sénégalais de l’époque du naufrage, quelle qu’en soit la gravité, ne relevaient pas des exceptions au principe de l’immunité des représentants de l’État dans l’expression de sa souveraineté (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).
30. Rappelant qu’il appartient au premier chef aux juridictions internes d’interpréter les règles de droit international général (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999‑I, Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 72, CEDH 2008, et Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 149, 19 décembre 2018), la Cour constate qu’en accordant l’immunité concernée, les juridictions internes ne se sont pas écartées des normes internationales actuellement admises (paragraphe 20 ci-dessus). Elle observe à cet égard que la requérante n’a apporté aucun élément permettant de conclure que l’état du droit international se soit développé dans un sens qui rendrait le constat établi au paragraphe 28 ci-dessus irrecevable.
31. La Cour note, deuxièmement, que les juridictions internes n’ont pas opté pour un refus d’informer en raison de l’immunité des personnes mises en cause, mais elles ont rendu un non-lieu après avoir conduit des investigations particulièrement minutieuses et exhaustives afin de faire la lumière sur les événements ayant conduit au naufrage (paragraphes 9 à 11 ci-dessus). À l’issue de ces investigations, les autorités judiciaires ont retenu que les faits à la base de l’action de la requérante présentaient le « caractère matériel de l’infraction d’homicide involontaire » (paragraphe 16 ci-dessus) et qu’il y avait lieu de réparer les préjudices en résultant.
32. Enfin, et troisièmement, si les juridictions internes ont constaté que les parties civiles étaient effectivement empêchées par l’immunité de juridiction de demander publiquement la réparation de leurs préjudices, elles ont cependant souligné qu’elles disposaient de voies de recours civiles à cette fin. Rappelant que l’action civile en réparation d’un dommage, distincte de l’action publique, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage direct causé par l’infraction, elles ont retenu que les parties civiles n’avaient pas été privées de tout accès à la justice puisqu’elles avaient eu, ou étaient sur le point de l’être, la possibilité d’obtenir la réparation de leur préjudice en vertu du dispositif relatif à l’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction (paragraphe 16 ci-dessus). En conséquence, la requérante et les autres parties civiles ne se sont pas trouvées dans une situation d’absence de tout recours.
33. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour ne relève rien d’arbitraire ni de déraisonnable dans l’interprétation donnée par les juridictions internes aux principes de droits applicables ni dans la manière dont elles les ont appliqués au cas d’espèce. Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Ali Rıza c. Suisse du 13 juillet 2021 requête no 74989/11
Art 6 : La Suisse n’a pas violé la Convention dans une procédure opposant un joueur de football au club turc Trabzonspor devant le Tribunal arbitral du sport
Non-violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne un litige opposant un joueur de football professionnel à son ancien club de la ligue turque (Trabzonspor). M. Ali Rıza se plaignait d’avoir été condamné par la Fédération de Football de Turque à payer des dommages et intérêts pour avoir quitté le Club sans préavis, avant le terme de son contrat. Il avait saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), ayant son siège à Lausanne, qui se déclara incompétent. Cette décision fut confirmée par le Tribunal Fédéral. La Cour juge que le TAS a, dans le cadre d’une décision motivée et détaillée, expliqué de manière convaincante pourquoi il ne pouvait pas connaître du litige et, en particulier, pourquoi le litige ne revêtait pas un élément international. Il s’ensuit que M. Ali Rıza avait saisi un tribunal qui était incompétent pour connaître de ses griefs. L’arrêt du Tribunal fédéral est également motivé et répond à tous les moyens soulevés par M. Ali Rıza. Ces décisions ne sont ni arbitraires ni manifestement déraisonnables. La Cour estime que, compte tenu de ce qui précède et étant donné le lien extrêmement tenu entre le litige de M. Ali Rıza et la Suisse, ainsi que la spécificité de la procédure devant le TAS et le Tribunal, la limitation au droit d’accès à un tribunal n’était pas disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice et l’effectivité des décisions judiciaires internes. La Cour déclare irrecevables les griefs tirés de l’absence de la tenue d’une audience et du nonrespect du principe de l’égalité des armes, estimant qu’ils sont manifestement mal fondés.
FAITS
Le requérant, Ömer Kerim Ali Rıza, est un ressortissant britannique et turc. Il est né en 1979 et réside à Broxbourne (Royaume-Uni). M. Ali Rıza, qui avait signé un contrat de travail à durée déterminée (du 17 janvier 2006 au 30 juin 2008) avec Trabzonspor, informa le Club, en janvier 2008, qu’il ne jouerait plus avec lui au motif que le Club n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en raison de retards dans le paiement des salaires. Le Club porta le litige devant le Comité de résolution des litiges de la Fédération de Football de Turque (FFT, Türkiye Futbol Federasyonu Üyuşmazlık Çözüm Kurulu), elle-même affiliée à la Fédération internationale de Football Association (FIFA), demandant une interdiction de transfert, des dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat et le paiement de l’amende prononcée par son conseil d’administration.
En décembre 2008, le Comité de résolution des litiges donna raison au Club et condamna M. Ali Rıza à payer à Trabzonspor des dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat ainsi qu’à une amende. Par ailleurs, il suspendit sa capacité à signer un contrat avec un autre club pour une durée de quatre mois. M. Ali Rıza interjeta appel contre cette sentence. En avril 2009, le Comité d’arbitrage de la FFT confirma la sentence du Comité de résolution des litiges, en réduisant le montant dont M. Ali Rıza devait s’acquitter et en annulant la sanction sportive prononcée à l’encontre de l’intéressé. Ce dernier contesta cette sentence devant le Tribunal arbitral de sport (TAS), ayant son siège à Lausanne. En juin 2020, la TAS rendit une décision d’irrecevabilité pour défaut de compétence, estimant entre autres que le litige ne présentait pas d’élément international. M. Ali Rıza introduisit un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral qui confirma la décision de la TAS et rejeta le recours. Le 28 janvier 2020, la Cour a rendu un arrêt (Ali Rıza et autres c. Turquie, n os 30226/10 et 4 autres) dans le cadre de la requête introduite par M. Ali Rıza contre la Turquie. La présente requête concerne uniquement les décisions rendues par le TAS et le Tribunal fédéral et est dirigée contre la Suisse.
CEDH
Article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal)
La Cour exprime certains doutes concernant la question de savoir si M. Ali Rıza peut se prévaloir d’un droit d’accès à un tribunal vis-à-vis de la Suisse, dans la mesure où le litige qui fait l’objet de la présente requête ne présentait qu’un lien extrêmement tenu avec l’État défendeur. Elle précise à cet égard que la procédure menée devant les instances de la FFT n’avait a priori pas de lien avec les juridictions suisses et ne revêtait pas d’élément international. Au contraire, elle concernait un litige entre le requérant, joueur de football turc (possédant certes également la nationalité britannique), d’une part, et un club de football turc et la FFT, d’autre part. Par ailleurs, le droit en vigueur à l’époque des faits prévoyait que les sentences du Comité d’arbitrage étaient définitives et exécutoires. Dès lors, il n’existait pas de droit de recours au TAS et, partant, la procédure devant celui-ci ne pouvait pas être considérée comme faisant partie de la procédure d’arbitrage forcé devant les instances de la FFT.
À supposer que M. Ali Rıza ait pu se prévaloir d’un droit d’accès à un tribunal vis-à-vis de la Suisse, la Cour estime que la restriction du droit d’accès au TAS poursuivait un but légitime, à savoir la bonne administration de la justice et de l’effectivité des décisions judiciaires internes. La Cour réitère que la réglementation sur les limitations du droit d’accès aux tribunaux admises peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, l’État partie jouit d’une certaine marge d’appréciation. De surcroît, une décision portant incompétence d’un tribunal n’enfreint pas le droit d’accès à un tribunal si les arguments de l’intéressé en faveur de la compétence du tribunal ont fait l’objet d’un examen réel et effectif et si le tribunal a motivé de manière adéquate les raisons sur lesquelles sa décision est fondée. Elle note à cet égard que, dans une sentence motivée de manière extensive et détaillée, le TAS a tout d’abord rappelé que l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS établissait que sa compétence pouvait résulter soit d’un contrat contenant une clause arbitrale, soit d’une convention d’arbitrage ultérieure, soit encore des statuts ou règlements d’un organisme sportif prévoyant l’appel au TAS. Or, ce tribunal a estimé que rien dans le contrat de travail conclu entre M. Ali Rıza et le Club n’établissait sa compétence. Il a également constaté que les parties n’avaient conclu aucune convention d’arbitrage ultérieurement et que ni les statuts de la FIFA ni le Règlement de 2008 du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA ne fondaient sa compétence. Ensuite, le TAS a conclu le litige ne présentait aucun élément international et, par conséquent, que l’article 14 du Règlement sur le Comité d’arbitrage de la FFT ne s’appliquait pas en l’espèce. De ce fait, l’article R47 du Code n’était pas rempli et, par conséquent, rien ne fondait la compétence du TAS. Puis, le Tribunal fédéral a entériné la décision du TAS, selon laquelle le litige ne présentait pas d’élément international et ne remplissait donc pas les conditions de l’article 14 du Règlement du Comité d’arbitrage de la FFT. Ainsi, rien ne fondait la compétence du TAS. Par conséquent, la Cour estime que le TAS a, dans le cadre d’une décision motivée et détaillée, expliqué de manière convaincante pourquoi il ne pouvait pas connaître du litige et, en particulier, pourquoi le litige ne revêtait pas un élément international. Il s’ensuit que M. Ali Rıza, après avoir été débouté par les instances du FTT, avait saisi un tribunal qui était incompétent pour connaître de ses griefs. Les conclusions du TAS ont, par ailleurs, été confirmées par le Tribunal fédéral, dont l’arrêt est également motivé de manière détaillée, répond à tous les moyens soulevés par M. Ali Rıza et contient un raisonnement clair et des conclusions convaincantes. La Cour conclut, dans la limite de son contrôle restreint, que les décisions du TAS et du Tribunal fédéral ne sont ni arbitraires ni manifestement déraisonnables au sens de sa jurisprudence. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné le lien extrêmement tenu entre le litige de M. Ali Rıza et la Suisse, ainsi que la spécificité de la procédure devant le TAS et le Tribunal, la limitation au droit d’accès à un tribunal n’était pas disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice et l’effectivité des décisions judiciaires internes. Dès lors, ce droit n’était pas atteint dans sa substance même. Il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit d’accès à un tribunal.
Autres griefs tirés de l’article 6 § 1
La Cour rejette le grief tiré de l’absence de la tenue d’une audience pour défaut manifeste de fondement, estimant que la question de la compétence de la TAS constituait une question juridique hautement technique qui pouvait valablement être résolue sans le recours à une audience. La Cour rejette le grief tiré du non-respect du principe de l’égalité des armes pour défaut manifeste de fondement, estimant que M. Ali Rıza n’a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport au Club et à la FFT devant le Tribunal Fédéral.
Hussein et autres c. Belgique du 16 mars 2021 requête no 45187/12
Article 6-1 : Limitation, en 2003, de la compétence des juridictions belges concernant les crimes de droit international humanitaire : non-violation de la Convention
L’affaire concerne dix requérants jordaniens qui vivent à Amman et qui se sont constitués parties civiles auprès d’un juge d’instruction de Bruxelles contre des hauts dignitaires de l’État du Koweït, pour crimes de droit international humanitaire, pour des faits liés à la première guerre du Golfe (1990-1991). En 2001, au moment où les requérants se sont constitués partie civile, le droit belge reconnaissait la compétence universelle pénale dans une forme absolue, même en l’absence de lien de rattachement avec la Belgique. Le législateur belge a ensuite progressivement introduit des critères de rattachement avec la Belgique ainsi qu’un système de filtrage de l’opportunité des poursuites. Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003, la procédure que les requérants avaient mise en mouvement en 2001 ne répondait pas aux nouveaux critères de compétence des juridictions belges définis pour l’avenir ; elle n’aurait donc pas pu être maintenue sur cette base. En définitive, l’action des requérants échoua au motif qu’aucun acte d’instruction n’avait encore été accompli au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003, et que les juridictions belges étaient en toute hypothèse sans compétence pour connaître de l’action publique. La Cour juge que les juridictions belges ont donné une réponse spécifique et explicite au moyen soulevé par les requérants et qu’elles n’ont pas manqué à leur obligation de motivation. Elle n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable. La Cour juge aussi que le rejet par les juridictions belges, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2003, de leur compétence pour connaître de la constitution de partie civile en 2001, n’était pas disproportionné par rapport aux buts légitimes poursuivis. En effet, les motifs invoqués par les autorités belges (la bonne administration de la justice et la question des immunités que ces poursuites soulevaient au regard du droit international) pouvaient être considérés comme des motifs d’intérêt général impérieux.
Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Absence de compétence universelle civile absolue des juridictions pénales en matière de torture concernant la constitution de parties civiles en vertu d’une nouvelle loi à portée rétroactive • Loi ayant introduit des critères de rattachement ratione personae et ratione loci avec la Belgique et un système de filtrage de l’opportunité des poursuites • Motifs d’intérêt général impérieux ni arbitraires ni manifestement déraisonnables • Intervention du législateur ne rendant pas vaine toute continuation des procédures • Rejet proportionné des juridictions nationales • Motivation suffisante des décisions internes.
FAITS
Lors de la première guerre du Golfe (1990-1991), les requérants, qui résidaient au Koweït, furent réprimés par les autorités du Koweït et expulsés vers la Jordanie.
Par la suite, une association fut créée selon le droit jordanien (« Cooperative Society for the Gulf War Returnees ») dont le but était d’entraider les membres, notamment d’obtenir des compensations des pertes morales et matérielles subies. En décembre 2001, le conseil des 7 738 membres de l’association, parmi lesquels les requérants, se constitua partie civile en leur nom et pour leur compte auprès d’un juge d’instruction de Bruxelles contre 74 personnes, pour la plupart, des hauts dignitaires de l’État du Koweït, en vue d’obtenir la mise en mouvement d’une action publique du chef de génocide sur la base des dispositions de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire (dite « loi de compétence universelle »), telle que modifiée par la loi du 10 février 1999, et finalement remplacée par la loi du 5 août 2003. Ils réclamaient également réparation du préjudice moral et matériel subi du fait des infractions dont ils se prétendaient lésés. Au terme de la procédure, qui s’acheva avec l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2012, l’action des requérants échoua au motif qu’aucun acte d’instruction n’avait encore été accompli au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003, et que les juridictions belges étaient en toute hypothèse sans compétence pour connaître de l’action publique.
Article 6 § 1 (droit à un procès équitable)
Motivation des décisions juridictionnelles internes À la lumière de sa jurisprudence, la Cour considère que les juridictions internes ont donné une réponse spécifique et explicite au moyen soulevé par les requérants et qu’elles n’ont pas manqué à leur obligation de motivation à cet égard. En outre, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’interprétation donnée par les juridictions internes de la notion d’acte d’instruction. En effet, cette interprétation correspond à la finalité de la loi du 5 août 2003 de limiter le contentieux basé sur la compétence universelle tout en évitant, par la mise en place d’un régime transitoire, que soient affectées les affaires pendantes à l’instruction. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la motivation des décisions rendues par la chambre des mises en accusation et la Cour de cassation.
Accès à un tribunal
La Cour relève que les requérants ont subi de toute évidence une limitation de leur droit d’accès à un tribunal en ce que les juridictions belges se sont déclarées incompétentes pour connaître de l’action publique qu’ils avaient mise en mouvement en se constituant partie civile en mains du juge d’instruction de Bruxelles. Cette limitation de compétence était déduite du dispositif transitoire de la loi du 5 août 2003. Le Gouvernement explique que le but poursuivi par le nouveau dispositif était d’assurer la bonne administration de la justice. Il fait valoir le risque de surcharge pour les tribunaux qui aurait résulté par une explosion du contentieux basé sur la compétence universelle sans aucun lien de rattachement avec la Belgique, ainsi que les difficultés pratiques relatives à l’administration de la preuve. Il ressort également des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2003 que la réforme visait à remédier à des tensions diplomatiques suscitées par la reconnaissance de cette compétence universelle absolue et l’utilisation politique manifestement abusive qui en avait résulté. La Cour estime que les motifs qui ont présidé à l’examen du projet de loi par le parlement, tenant à la bonne administration de la justice, ainsi que le lien avec la question des immunités que ces poursuites soulevaient au regard du droit international, pouvaient être considérés comme des motifs d’intérêt général impérieux. Elle note ensuite que, en 2001, au moment où les requérants se sont constitués partie civile, le droit belge reconnaissait la compétence universelle pénale dans une forme absolue. Le législateur a ensuite progressivement introduit des critères de rattachement avec la Belgique ainsi qu’un système de filtrage de l’opportunité des poursuites. Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003, le 7 août 2003, la procédure que les requérants avaient mise en mouvement en 2001 ne répondait pas aux nouveaux critères de compétence des juridictions belges définis pour l’avenir. L’affaire des requérants n’aurait donc pas pu être maintenue sur cette base. Par ailleurs, eu égard à la décision de la Cour de cassation selon laquelle la compétence des juridictions belges ne pouvait être maintenue que si un acte d’instruction avait été accompli avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action engagée par les requérants était nécessairement vouée à l’échec s’il s’avérait qu’un tel acte n’avait pas été accompli. C’est effectivement ce qu’ultérieurement la chambre des mises en accusation et la Cour de cassation ont constaté. Par conséquent, la Cour estime que le rejet par les juridictions belges, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003, de leur compétence pour connaître de la constitution de partie civile introduite en 2001 par les requérants, n’était pas disproportionné par rapport aux buts légitimes poursuivis. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
CEDH
b) Appréciation de la Cour
44. La Cour note que les motifs de l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 9 juin 2011 – qui a débouté les requérants en appel – tenaient, à titre principal, à ce que les faits tels qu’ils les dénonçaient ne pouvaient être qualifiés d’infractions au sens des articles 136bis à 136quater du code pénal, et en ordre subsidiaire, que, même si ces actes pouvaient être qualifiés d’actes de génocide, quod non, les actes posés avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003 n’étaient pas des actes d’instruction au sens des dispositions transitoires de la loi (paragraphe 27 ci‑dessus). Contrairement à la lecture que donnent les requérants de ce raisonnement, il apparaît à la Cour que chacun de ces motifs peut suffire en lui-même pour justifier la décision de la chambre des mises en accusation.
45. C’est aussi le raisonnement de la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 18 janvier 2012, a considéré que la décision de la chambre des mises en accusation constatant l’absence d’acte d’instruction rendait sans pertinence les conclusions des requérants soutenant que les faits dénoncés par eux constituaient les infractions visées par les articles 136bis à 136quater du code pénal, et a, du même coup, rejeté le moyen que les requérants tiraient du défaut de motivation de la décision concernant l’applicabilité des dispositions précitées.
46. Cette approche des juridictions internes – qui n’estiment pas nécessaire de se prononcer sur la qualification des infractions puisqu’en tout état de cause, l’action publique est irrecevable pour un autre motif – n’apparaît pas critiquable aux yeux de la Cour. Elle limite du même coup la portée de son examen du grief de défaut de motivation à la seule question de l’absence d’actes d’instruction.
47. Sur ce terrain ainsi délimité, les requérants allèguent que l’interprétation donnée par les juridictions internes de la notion d’acte instruction n’est pas légalement justifiée et est manifestement déraisonnable, et que ces juridictions ont donc manqué à leur obligation de motivation au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
48. La Cour rappelle que, même si les tribunaux ne sauraient être tenus de donner une réponse détaillée à chaque argument d’une partie (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288, et Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303-A), ils ne sont pour autant pas dispensés d’examiner dûment les moyens décisifs pour l’issue de la procédure et d’y répondre (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 84, 11 juillet 2017, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 185, 6 novembre 2018). Si, de surcroît, ces moyens ont trait aux droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles, les juridictions nationales sont astreintes à les examiner avec une rigueur et un soin particuliers (voir, parmi d’autres, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 96, 28 juin 2007, et Felloni c. Italie, no 44221/14, § 24, 6 février 2020).
49. Quant à l’exactitude de l’interprétation du droit interne – que les requérants contestent –, la Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne, et que, sauf si l’interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, sa tâche se limite à déterminer si ses effets sont compatibles avec la Convention (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 149, 20 mars 2018, S., V. et A. c. Danemark [GC], nos 35553/12 et 2 autres, § 148, 22 octobre 2018, et Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 149, 19 décembre 2018). La Cour, qui n’est pas une instance d’appel, n’est donc pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités (Van de Hurk, précité, § 51, Perez, précité, § 80, et Fourchon c. France, no 60145/00, § 22, 28 juin 2005).
50. En l’espèce, la Cour observe que la chambre des mises en accusation et la Cour de cassation ont écarté la compétence des juridictions belges au départ d’une même interprétation de la notion d’« acte d’instruction », au sens de tout acte par lequel le juge d’instruction, agissant dans l’exercice de sa mission de recherche de la vérité, recueille les informations pertinentes pour le jugement de la cause. C’est également l’interprétation retenue par l’avocat général à la Cour de cassation. De cette définition, que la chambre des mises en accusation a estimé correspondre « au sens usuel du terme », étaient exclus, selon elle, les actes de procédure posés en l’espèce. De même, la Cour de cassation a estimé que ni le procès-verbal de constitution de partie civile, ni le procès-verbal de transfert du dossier au parquet, ni le procès-verbal de saisine du parquet fédéral, ne constituait un commencement de l’instruction proprement dite et n’entrait donc pas dans la notion d’acte d’instruction telle qu’elle résultait de l’économie de la loi du 5 août 2003.
51. Examinant ces motifs à la lumière de la jurisprudence rappelée ci‑dessus, la Cour considère que les juridictions internes ont donné une réponse spécifique et explicite au moyen soulevé par les requérants et qu’il ne saurait être jugé qu’elles ont manqué à leur obligation de motivation à cet égard.
52. En outre, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’interprétation donnée par les juridictions internes de la notion d’acte d’instruction. Ainsi que le fait valoir le Gouvernement, cette interprétation correspond à la finalité de la loi du 5 août 2003 de limiter le contentieux basé sur la compétence universelle tout en évitant, par la mise en place d’un régime transitoire, que soient affectées les affaires pendantes à l’instruction. Force est également de considérer, ainsi que l’a souligné l’avocat général à la Cour de cassation (paragraphe 19 ci-dessus), que suivre l’interprétation proposée par les requérants aurait pour effet de priver le régime transitoire de son objet puisque l’ouverture de tout dossier d’instruction présuppose un acte de saisine qui est, selon la disposition pertinente de procédure pénale belge, interruptif de la prescription.
53. En ce qui concerne l’application de cette interprétation aux faits de l’espèce, les requérants se plaignent que des actes pourtant accomplis par le juge d’instruction – l’enquête sur l’immunité diplomatique et l’ordonnance en application de l’article 61ter du CIC – ont été écartés alors qu’ils auraient dû, selon eux, être considérés comme des actes d’instruction. Ils appuient cette thèse sur les conclusions de l’avocat général à la Cour de cassation (paragraphe 19 ci‑dessus).
54. La Cour observe à cet égard que, dans le mémoire à l’appui de leur pourvoi en cassation, les requérants se sont eux-mêmes limités à se référer au procès-verbal de constitution de partie civile, au procès-verbal de transfert du dossier au parquet et au procès-verbal de saisine du parquet fédéral, sans mentionner les autres actes d’instruction pourtant explicitement écartés par la chambre des mises en accusation (paragraphe 16 ci-dessus) et considérés comme pertinents par l’avocat général à la Cour de cassation.
55. Il y a donc lieu, selon la Cour, de constater que les requérants ont délimité leur argumentation devant la Cour de cassation et de considérer que la circonstance que celle-ci n’a pas fait mention des autres actes d’instruction ne saurait davantage passer pour un défaut de motivation.
56. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la motivation des décisions rendues par la chambre des mises en accusation et la Cour de cassation.
Accès à un tribunal
a) Thèses des parties
57. Les requérants soutiennent que les modifications législatives subséquentes – en soumettant la recevabilité de leur action à des conditions qui n’existaient pas au moment de l’ouverture de la procédure, et, au surplus, sans définir de façon précise les notions clés, telles que celle d’acte d’instruction, – ont abouti de facto à les priver du droit d’accès à un tribunal. À l’époque où ils ont déposé leur plainte, en 2001, la loi reconnaissait la compétence universelle des juridictions belges et les conditions de recevabilité de leur action étaient remplies. La loi du 5 août 2003 est venue ensuite modifier de manière brutale les règles de compétence des juridictions belges pour l’avenir et, limiter, par le biais des dispositions transitoires, de manière rétroactive, l’accès à un tribunal pour les procédures en cours. À cela s’ajoute que dans leur procédure, le magistrat instructeur s’est saisi du dossier dès 2001, pour le compléter en 2003, et le procureur fédéral a expressément indiqué que la possibilité de dessaisissement prévue par la première mouture des dispositions transitoires de la loi n’était pas applicable. Ce n’est finalement qu’en 2008 que la question de la satisfaction aux critères posés par l’article 29 § 3 de la loi, entre-temps modifié, s’est posée. Les requérants sont donc restés cinq ans dans la conviction qu’ils continueraient à bénéficier de la compétence universelle des juridictions belges.
58. Le Gouvernement fait valoir que le droit d’accès à un tribunal n’est pas un droit absolu et que les restrictions qui sont intervenues en l’espèce étaient légitimes et proportionnées. La loi du 5 août 2003 visait à mettre fin aux problèmes suscités par l’application de loi de 1993 qui avait institué un cas unique en son genre de compétence universelle par défaut ou in absentia sans aucun critère de rattachement avec la Belgique. Il s’agissait, dans un objectif de bonne administration de la justice, d’éviter une explosion du contentieux basé sur la compétence universelle et une instrumentalisation de celle-ci à des fins politiques, et de prévenir les difficultés en matière de collecte et d’appréciation des preuves. Pour autant, cette loi a maintenu une large possibilité de poursuites contre les auteurs en matière de droit pénal humanitaire et prévu un régime transitoire pour les affaires en cours pendantes à l’instruction. L’appréciation de la proportionnalité de la restriction au droit d’accès qui en a résulté doit tenir compte de ce que la Convention n’impose pas aux États de prévoir une compétence universelle inconditionnelle de leurs juridictions et qu’en l’abrogeant, la Belgique n’a pas contrevenu à ses autres engagements internationaux. Quant à la solution finalement appliquée aux requérants, le Gouvernement renvoie à son argumentation sur le terrain de la motivation des décisions internes pour faire valoir que l’entrave qui en a résulté était basée sur un critère objectif dénué de tout arbitraire.
b) Appréciation de la Cour
59. La Cour souligne d’emblée qu’à la différence de l’affaire Naït‑Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, 15 mars 2018 qui portait sur la question de la compétence universelle des juridictions civiles dans le cadre d’une procédure civile autonome, la présente espèce concerne la possibilité de se constituer partie civile dans une procédure pénale engagée devant les juridictions pénales sur la base du principe de compétence universelle. Cela étant, dans les deux types d’affaires, c’est le droit d’accès à un tribunal en matière civile qui est en cause et les principes généraux que la Cour a rappelés dans l’arrêt Naït‑Liman à ce sujet (§§ 112-116) s’appliquent de la même manière.
60. La présente affaire met également en cause l’application d’une loi à des procédures judiciaires en cours. À cet égard la Cour réaffirme que si, en principe, il n’est pas interdit au pouvoir législatif de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 126, CEDH 2006‑V, et références citées).
61. En l’espèce, les requérants ont subi de toute évidence une limitation de leur droit d’accès à un tribunal en ce que les juridictions belges se sont déclarées incompétentes pour connaître de l’action publique qu’ils avaient mise en mouvement en se constituant partie civile en mains du juge d’instruction de Bruxelles. Cette limitation de compétence était déduite du dispositif transitoire de la loi du 5 août 2003 qui est venue abroger la loi du 16 juin 1993 prévoyant une compétence universelle même en l’absence de lien de rattachement avec la Belgique (paragraphe 27 ci-dessus).
62. Les requérants allèguent que l’intervention du législateur et l’influence qu’elle a eue sur le dénouement de leur action judiciaire a constitué une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal. Ils se plaignent que la nouvelle loi a été d’application immédiate et que les limitations qu’elle a apportées à la compétence des juridictions belges ont pesé sur le sort des affaires qui, comme la leur, étaient en cours d’instruction au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
63. La Cour réitère que le litige devant elle est limité aux conséquences en matière civile des restrictions apportées par le législateur belge à la compétence universelle dans le domaine pénal. Il échet donc d’apprécier les effets de la loi du 5 août 2003 sur l’action civile des requérants à la lumière du contexte pénal de leur constitution de partie civile.
64. Sur le point de savoir, en premier lieu, si les limitations du droit d’accès des requérants à un tribunal poursuivaient un but légitime, le Gouvernement explique que le but poursuivi par le nouveau dispositif était d’assurer la bonne administration de la justice. Il fait valoir à cet égard le risque de surcharge pour les tribunaux qui aurait résulté d’une explosion du contentieux basé sur la compétence universelle sans aucun lien de rattachement avec la Belgique ainsi que les difficultés pratiques pour les juridictions belges sur le terrain de l’administration de la preuve. Il ressort également des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2003 que la réforme visait à remédier à des tensions diplomatiques suscitées par la reconnaissance de cette compétence universelle absolue et l’utilisation politique manifestement abusive qui en avait résulté (paragraphe 27 ci‑dessus).
65. Il est vrai que les États qui, comme la Belgique, ont rendu leurs juridictions compétentes pour connaître de demandes de réparation pour des actes de torture, donnent effet au large consensus dans la communauté internationale sur l’existence d’un droit de victimes d’actes de torture à une réparation appropriée et effective, y compris quand leurs demandes se fondent sur des faits commis en dehors des frontières géographiques de l’État du for. La Cour rappelle toutefois qu’il ne résulte ni du droit international ni de la Convention une obligation à charge des États contractants de se doter d’une compétence universelle civile (voir, mutatis mutandis, Naït-Liman, précité, § 198). De plus, elle a reconnu qu’en tout cas il n’était pas déraisonnable pour un État de lier une compétence universelle civile à des facteurs de rattachement avec cet État (ibidem, §§ 218-219). En l’espèce, elle estime que les motifs invoqués par le Gouvernement pendant l’examen du projet de loi par le parlement, tenant à la bonne administration de la justice, pour justifier l’introduction par le législateur de nouveaux critères de compétence universelle (paragraphe 63 ci-dessus), ainsi que le lien avec la question d’immunité que ces poursuites soulevaient au regard du droit international, pouvaient être considérés comme des motifs d’intérêt général impérieux. La légitimité du but n’a, du reste, pas prêté à controverse entre les parties (voir, mutatis mutandis, Naït-Liman, précité, §§ 126 et 128).
66. La Cour doit ensuite rechercher si les conséquences qui ont découlé en l’espèce sur le déroulement de la procédure des requérants étaient proportionnées par rapport au but poursuivi par la loi.
67. La Cour note qu’en 2001, au moment où les requérants se sont constitués partie civile, le droit belge reconnaissait la compétence universelle pénale dans une forme absolue. Le législateur a ensuite progressivement introduit des critères de rattachement ratione personae et ratione loci avec la Belgique ainsi qu’un système de filtrage de l’opportunité des poursuites (paragraphe 27 ci‑dessus). Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003, le 7 août 2003, la procédure que les requérants avaient mise en mouvement en 2001 ne répondait pas aux nouveaux critères de compétence des juridictions belges définis pour l’avenir. L’affaire des requérants n’aurait donc pas pu être maintenue sur cette base. Toutefois elle n’a pas non plus fait l’objet, comme l’a indiqué le procureur fédéral dans son courrier du 1er mars 2004, de la procédure de dessaisissement instaurée par la nouvelle loi, étant donné qu’au moins un plaignant était de nationalité belge au moment de l’engagement initial de l’action publique (paragraphe 8 ci-dessus), ce qui répondait à une des conditions prévues par le régime transitoire de la loi du 5 août 2003. L’affaire des requérants est donc restée à l’instruction.
68. La poursuite de l’action publique s’est ensuite heurtée aux règles d’immunité profitant à certains des inculpés, pour finalement se cristalliser, à partir de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2010, sur le point de savoir si, en vertu des dérogations prévues par le dispositif transitoire de la nouvelle loi (paragraphe 27 ci-dessus), la compétence des juridictions belges pouvait être maintenue du fait de l’accomplissement d’un acte d’instruction avant l’entrée en vigueur de la loi (paragraphe 14 ci-dessus).
69. Comme les juridictions belges n’ont pas été dessaisies de l’affaire des requérants dès l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003, l’on ne saurait considérer que l’intervention du législateur, du seul fait que la loi s’appliquait aux affaires pendantes, rendait vaine toute continuation des procédures (voir, a contrario, Arnolin et autres c. France, nos 20127/03 et 24 autres, §§ 73-74, 9 janvier 2007, et Ducret c. France, no 40191/02, §§ 36-37, 12 juin 2007). Néanmoins, eu égard à la décision de la Cour de cassation selon laquelle la compétence des juridictions belges ne pouvait être maintenue que si un acte d’instruction avait été accompli avant l’entrée en vigueur de la loi (arrêt du 8 décembre 2010, voir paragraphe 14 ci‑dessus), l’action engagée par les requérants était nécessairement vouée à l’échec s’il s’avérait qu’un tel acte n’avait pas été accompli. C’est effectivement ce qu’ultérieurement la chambre des mises en accusation et la Cour de cassation ont constaté (arrêts respectivement des 9 juin 2011 et 18 janvier 2012, voir paragraphes 16 et 21 ci-dessus).
70. Cela étant dit, il est également vrai que la notion d’acte d’instruction au sens de l’article 29 § 3 de la loi du 5 août 2003 n’a pas été précisée dans la loi même et qu’elle a fait l’objet d’interprétations différentes (paragraphe 19 ci‑dessus).
71. À cet égard toutefois, la Cour constate qu’une fois la pertinence de l’accomplissement d’un acte d’instruction soulignée par la Cour de cassation (dans son arrêt du 8 décembre 2010, paragraphe 14 ci‑dessus), les requérants ont limité leur argumentaire à cet égard à certains actes de procédure (paragraphe 18 ci‑dessus). La Cour ne s’exprime pas sur le point de savoir s’ils auraient utilement pu élargir leur thèse à d’autres actes de procédure qui avaient, eux aussi, été écartés par la chambre des mises en accusation (paragraphe 16 ci-dessus) ; elle constate toutefois que ces autres actes ont par la suite été considérés comme pertinents par l’avocat général à la Cour de cassation (paragraphe 19 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, force est de constater que le grief des requérants, tel que développé dans leur second moyen en cassation, se référait à certains actes précis.
72. La Cour rappelle de plus qu’elle a considéré que les motifs retenus par les juridictions pour se déclarer incompétentes n’étaient ni arbitraires ni manifestement déraisonnables (paragraphe 52 ci-dessus).
73. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour estime que le rejet par les juridictions belges, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003, de leur compétence pour connaître de la constitution de partie civile introduite en 2001 par les requérants en vue d’obtenir la mise en mouvement d’une action publique du fait de violations graves de droit international humanitaire et la réparation du préjudice qu’ils alléguaient avoir subi en conséquence, n’était pas disproportionné par rapport aux buts légitimes poursuivis.
74. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
DEMANDE DEFENDABLE EN DROIT INTERNE
Peleki c. Grèce du 5 mars 2020 requête n° 69291/12
Non violation de l'article 6-1 : Sanction d’un notaire ayant opéré un transfert de propriété de biens de l’État à un monastère : non-violation de la Convention.
L’affaire concerne une procédure disciplinaire dirigée contre la requérante, notaire de profession, pour avoir procédé à un transfert de propriété de biens de l’Etat à un monastère. La Cour observe qu’un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante a été effectué par la cour d’appel qui a remédié aux défauts allégués de la procédure qui avait eu lieu devant le conseil disciplinaire des notaires près le tribunal de première instance d’Athènes. La requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire, et ses droits à être informée dans le détail de la nature et de la cause des infractions reprochées n’ont pas été méconnus. Elle a pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Le caractère équitable de la procédure litigieuse n’a donc pas été affecté.
LES FAITS
La requérante, Mme Ekaterini Peleki, est une ressortissante grecque, née en 1965 et résidant à Athènes. En mai et en décembre 2007, M. Peleki, en tant que notaire, rédigea deux contrats entre la Société hellénique immobilière et le monastère de Vatopedi, ayant pour objet l’échange d’une part indivise du lac Vistonida, appartenant au monastère, contre des biens immobiliers appartenant à l’Etat grec. Ces contrats prévoyaient plus particulièrement que le monastère obtiendrait la propriété d’une surface de 860,8 hectares située à Ouranoupoli en Chalcidique. En septembre 2008, parurent des articles de presse laissant entendre que l’échange aurait été réglé en faveur du monastère. A la suite d’une enquête disciplinaire, le procureur adjoint près le tribunal de première instance d’Athènes engagea des poursuites disciplinaires contre Mme Peleki devant le conseil disciplinaire des notaires près le tribunal de première instance d’Athènes pour violation du code des notaires. Le 19 février 2009, le conseil disciplinaire rendit sa décision, concluant que le terrain en cause ne pouvait faire l’objet d’une transaction et décida de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Athènes en formation de cinq juges, afin que celle-ci statue sur l’infliction à la requérante d’une interdiction définitive d’exercer ses fonctions. Dans son arrêt rendu le 19 avril 2011, la cour d’appel estima que le terrain en question faisait partie d’un site protégé qualifié de monument historique classé. Elle indiqua que les biens communs ne pouvaient faire l’objet ni de transaction ni de transfert. La cour d’appel jugea la requérante coupable de deux infractions : le transfert d’un terrain qui avait été classé monument historique sans avoir, en outre, exclu du transfert les deux monuments historiques byzantins qui ne pouvaient pas non plus faire l’objet d’un transfert; et la création d’une société à responsabilité limitée. Elle condamna la requérante à une interdiction temporaire d’exercer ses fonctions pour une durée de quatre mois pour la première infraction et de deux mois pour la deuxième. Mme Peleki se pourvut en cassation. La Cour de cassation annula l’arrêt de la cour d’appel en ce qui concernait la création d’une société à responsabilité limitée, mais rejeta le pourvoi pour le reste.
Article 6 § 1
La Cour reconnaît que l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer sous son volet civil. En ce qui concerne l’instance de premier degré, la Cour note tout d’abord qu’il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion devant le conseil disciplinaire des notaires que les avocats de la requérante ont demandé la parole et que ce droit leur ait été refusé. La Cour rappelle que de toute façon, d’après sa jurisprudence constante, lorsqu’une autorité administrative ne remplit pas toutes les exigences de l’article 6 § 1, il n’y a pas violation de la Convention si la procédure fait l’objet d’un contrôle ultérieur d’un organe judiciaire doté de la pleine juridiction. La Cour note que la cour d’appel a entendu des témoins et ajourné l’audience pour obtenir des preuves. La requérante a eu l’occasion de présenter les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Ces arguments ont été examinés point par point par la cour d’appel sans qu’elle ne se soit vu contrainte de se déclarer incompétente pour y répondre ou pour contrôler les constats de fait ou de droit établis par le conseil disciplinaire des notaires. La Cour constate également que la requérante ne soulève aucun grief concernant la procédure qui s’est déroulée devant la cour d’appel. La Cour constate qu’en l’espèce un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante a été effectué par la cour d’appel et que celle-ci a remédié aux défauts allégués de la procédure devant le conseil disciplinaire des notaires près le tribunal de première instance d’Athènes. En ce qui concerne la requalification des infractions reprochées à la requérante, la Cour relève que les juridictions internes ont considéré que le terrain en question était protégé par la loi n o 3028/2002 pour deux raisons. Premièrement, toute la zone avait été classée monument historique par la décision ministérielle de 1965 et, deuxièmement, cette zone incluait deux monuments historiques, classés comme tels par décisions ministérielles de 1981 et 1984. La Cour constate que la dénomination précise du terrain en question n’était pas claire et que les juridictions internes ont employé une terminologie différente à chaque étape de la procédure. Par ailleurs, la cour d’appel a ajourné l’examen sur le fond du dossier afin d’obtenir l’avis de l’autorité responsable concernant le classement du terrain. En tout état de cause, la Cour attribue une importance décisive à la procédure qui s’est déroulée devant la cour d’appel. La cour d’appel s’est livrée à un examen complet de la cause de la requérante, tant au regard du droit procédural qu’au regard du droit matériel. Après avoir étudié le dossier de l’instance inférieure qui, par ailleurs, n’a pas publié de décision définitive, et les observations présentées par la requérante, la cour d’appel a entendu lors d’une séance publique les observations des avocats de la défense. A supposer que l’infraction ait été requalifiée, la Cour considère que la requérante a eu l’occasion de présenter sa défense à cet égard devant la cour d’appel. En outre aucune requalification des infractions reprochées à la requérante n’est intervenue devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation. Enfin, en ce qui concerne l’instance devant la Cour de cassation, la Cour note que la requérante reprochait au conseil disciplinaire de ne pas avoir donné la parole à ses avocats après le réquisitoire du procureur. Dans son arrêt du 5 juin 2012, la Cour de cassation s’est bornée à déclarer que la requérante n’avait pas soulevé le moyen tiré du refus qui aurait été opposé à la demande de ses avocats de prendre la parole devant le conseil disciplinaire et que ce moyen devait donc être rejeté. À cet égard, la Cour relève que cette conclusion est contredite par le procès-verbal de l’audience ayant conduit à l’arrêt n° 8/2010 de la cour d’appel, dans lequel ce moyen est amplement exposé. Par ailleurs, la Cour observe que le même moyen a été soulevé devant elle et qu’elle a déjà conclu que la cour d’appel avait effectué un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante et donc remédié aux défauts allégués de la procédure devant le conseil disciplinaire, y inclus le refus prétendu du président du conseil disciplinaire de donner la parole aux avocats de la requérante.
La Cour conclut donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1
CEDH
Recevabilité
34. La Cour réaffirme l’autonomie de la notion d’« accusation en matière pénale » telle que la conçoit l’article 6 § 1 de la Convention. Selon sa jurisprudence constante, l’existence ou non d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, couramment dénommés « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22). Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (voir, entre autres, Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30-31, CEDH 2006-XIV, et Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003-X).
35. La Cour s’est penchée dans différentes affaires sur l’applicabilité à des procédures disciplinaires de l’article 6 § 1 de la Convention sous son volet pénal. Elle considère de longue date que les poursuites disciplinaires ne relèvent pas, comme telles, de la « matière pénale » (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981, § 42, série A no 43, et Durand, décision précitée, § 56, et les affaires qui y sont citées). Plusieurs catégories professionnelles ont été visées : des avocats (Brown c. Royaume-Uni (déc.), no 38644/97, 24 novembre 1998, Müller-Hartburg c. Autriche, no 47195/06, §§ 41-48, 19 février 2013, Helmut Blum c. Autriche, no 33060/10, § 59, 5 avril 2016, et Biagioli c. Saint-Marin (déc.), no 64735/14, §§ 51-57, 13 septembre 2016) ; des fonctionnaires (J.L. c. France (déc.), no 17055/90, 5 avril 1995, Costa c. Portugal (déc.), no 44135/98, 9 décembre 1999, Linde Falero c. Espagne (déc.), no 51535/99, 22 juin 2000, Moullet c. France (déc.), no 27521/04, 13 septembre 2007, Vagenas c. Grèce (déc.), no 53372/07, 23 août 2011, et Nikolova et Vandova c. Bulgarie, no 20688/04, § 59, 17 décembre 2013) ; des médecins (Ouendeno c. France (déc.), no 18441/91, 2 mars 1994) ; des militaires (Kaplan et Karaca c. Turquie (déc.), no 40536/98, Gökden et Karacol c. Turquie, (déc.), no 40535/98, Batur c. Turquie, (déc.), no 38604/97, Duran et autres c. Turquie (déc.), no 38925/97, Yildirim c. Turquie (déc.), no 40800/98, et Durgun c. Turquie (déc.), no 40751/98, décisions du 4 juillet 2007) ; des liquidateurs judiciaires (Galina Kostova c. Bulgarie, no 36181/05, § 52, 12 novembre 2013) ; des juges (Oleksandr Volkov, précité, §§ 92-95, Di Giovanni c. Italie, no 51160/06, § 35, 9 juillet 2013, Sturua c. Géorgie, no 45729/05, § 28, 28 mars 2017, et Kamenos c. Chypre, no 147/07, §§ 50-53, 31 octobre 2017) et, comme dans les circonstances de la présente affaire, des notaires (Durand, décision précitée, §§ 55-60 ; voir également Yankov c. Bulgarie (déc.), no 44768/10, 18 juin 2019). Il peut en aller différemment, bien sûr, dans certains cas précis, par exemple, lorsqu’est en jeu une privation de liberté (Engel et autres, précité, §§ 80-85).
36. La Cour rappelle aussi que le fait que des actes susceptibles de conduire à une sanction disciplinaire constituent également des infractions n’est pas suffisant pour considérer qu’une personne responsable selon le droit disciplinaire est « accusée » d’un crime (Rola c. Slovénie, nos 12096/14 et 39335/16, § 56, 4 juin 2019 ; avec référence à Müller-Hartburg c. Autriche, no 47195/06, 19 février 2013, et à Biagioli c. Saint-Marin (déc.), no 8162/13, 8 juillet 2014).
37. La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de cette approche dans la présente affaire. Elle relève tout d’abord que les textes administratifs appliqués dans le cadre des procédures litigieuses relèvent du régime disciplinaire applicable aux notaires. Les faits qui étaient reprochés à la requérante et qui, comme le soutient celle-ci, tombaient dans le champ d’application de la loi pénale, étaient également contraires à l’article 43 de la loi no 2830/2000 du code des notaires. Enfin, s’agissant du degré de sévérité de la sanction que risquait de subir l’intéressée, la Cour observe que l’interdiction définitive d’exercer ses fonctions revêt un caractère généralement disciplinaire. Elle note de plus que l’amende prévue par la loi n’atteint pas un niveau de gravité comparable à celui des sanctions pénales. Dans ces conditions, elle considère que les poursuites disciplinaires engagées contre la requérante et les procédures judiciaires subséquentes n’entrent pas dans le champ d’application du volet pénal de l’article 6 de la Convention.
38. Pour autant que le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 de la Convention sous son volet civil dans la procédure devant le conseil disciplinaire de premier degré, la Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 74, CEDH 2009, et Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, § 99, 19 septembre 2017).
39. La Cour rappelle aussi que, selon sa jurisprudence constante, un contentieux disciplinaire dont l’enjeu est, comme en l’espèce, le droit de continuer à pratiquer un métier à titre libéral, peut donner lieu à des « contestations » sur des droits civils au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Philis c. Grèce (no 2), arrêt du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, p. 1085, § 45). La Cour reconnaît donc que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer dans son volet civil non seulement quand le requérant fait l’objet d’une interdiction temporaire (Diennet c. France, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 325‑A, pp. 8 et 13, §§ 11 et 27) ou permanente d’exercer son métier (A c. Finlande (déc.), no 44998/98, 8 janvier 2004), mais aussi dans le cas de l’imposition d’une amende pécuniaire (Hurter c. Suisse (déc.), no 53146/99, 8 juillet 2004). En effet, l’issue concrète d’une procédure n’est pas indispensable pour juger de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention ; il peut suffire, le cas échéant, que le droit d’exercer un métier soit en jeu, du seul fait que la suspension de l’exercice de la profession figure dans le catalogue des mesures possibles à l’encontre du requérant (Damilakos c. Grèce, no 13320/03, § 16, 30 mars 2006).
40. Il s’ensuit que l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce sous son volet civil.
41. Par ailleurs, constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
Sur le fond
(a) Principes généraux
52. La Cour rappelle qu’elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I, et Perez c. France [GC], no 47287/99, § 82, CEDH 2004‑I), par exemple si elles peuvent s’analyser en un « manque d’équité » incompatible avec l’article 6 de la Convention (De Tommaso c. Italie [GC], no 43395/09, §§ 169-170, 23 février 2017).
53. En effet, la Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 197, CEDH 2012). En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 61, CEDH 2015 et les affaires qui y sont citées, ainsi que l’application de cette jurisprudence dans des arrêts plus récents : Pavlović et autres c. Croatie, no 13274/11, § 49, 2 avril 2015, Yaremenko c. Ukraine (no 2), no 66338/09, §§ 64-67, 30 avril 2015, et Tsanova‑Gecheva c. Bulgarie, no 43800/12, § 91, 15 septembre 2015).
54. La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (García Ruiz, précité, § 26). Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose que la partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (voir, parmi d’autres exemples, Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, §§ 29‑30, série A no 303‑A, et Higgins et autres c. France, 19 février 1998, §§ 42‑43, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).
55. Enfin, les impératifs inhérents à la notion de « procès équitable » ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale. En témoigne l’absence, pour les premiers, de clauses détaillées semblables aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention. Partant, et bien que ces dispositions aient une certaine pertinence en dehors des limites étroites du droit pénal, les États contractants jouissent d’une latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil que dans celui des poursuites pénales (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, 27 octobre 1993, § 32, série A no 274). L’article 6 § 1 de la Convention se révèle donc moins exigeant pour les contestations relatives à des droits de caractère civil que pour les accusations en matière pénale (König c. Allemagne, 28 juin 1978, § 96, série A no 27). Pour autant, lorsqu’elle examine une procédure relevant du volet civil de l’article 6 de la Convention, la Cour peut estimer nécessaire de s’inspirer de l’approche qu’elle a appliquée en matière pénale.
56. En matière pénale, la Cour a jugé que, en ce qui concerne les modifications de l’accusation, y compris celles touchant sa « cause », l’accusé doit en être dûment et pleinement informé, et il doit également disposer du temps et des facilités nécessaires pour y réagir et organiser sa défense sur la base de toute nouvelle information ou allégation (Mattoccia c. Italie, no 23969/94, § 61, CEDH 2000‑IX). À cet égard, la Convention n’interdit pas aux juridictions nationales de préciser, sur la base des éléments produits lors des débats publics et portés à la connaissance de l’accusé, les modalités d’exécution de l’infraction qui lui est reprochée (Previti c. Italie (déc.), no 45291/06, § 209, 8 décembre 2009, et Sampech c. Italie (déc.), no 55546/09, § 110, 19 mai 2015).
(b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
(i) Sur le grief relatif à une méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre de l’instance de premier degré
57. Quant aux doléances concernant spécifiquement la procédure devant la juridiction de premier degré, la Cour note qu’il s’agit de deux griefs séparés : en premier lieu, la requérante se plaint d’un refus du président du conseil de premier degré de donner la parole à ses avocats après le réquisitoire du procureur sur la culpabilité et sur la peine à infliger à l’intéressée. En deuxième lieu, elle dénonce une participation du procureur au délibéré : au début de la décision no 3/2009, il est indiqué que celui-ci faisait partie du conseil, et la requérante a déduit de cette mention qu’il avait participé au délibéré avec les membres du conseil.
58. La Cour note tout d’abord qu’il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion devant le conseil disciplinaire que les avocats de la requérante ont demandé la parole et que ce droit leur a été refusé. De toute façon, la Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence constante, lorsqu’une autorité administrative chargée d’examiner des contestations portant sur des « droits et obligations de caractère civil » ne remplit pas toutes les exigences de l’article 6 § 1, il n’y a pas violation de la Convention si la procédure devant cet organe a fait l’objet du contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article, c’est-à-dire si des défauts structurels ou de nature procédurale identifiés dans la procédure devant une autorité administrative sont corrigés dans le cadre du contrôle ultérieur par un organe judiciaire doté de la pleine juridiction (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 132, 6 novembre 2018 et les affaires y citées ; voir également Vera Fernández-Huidobro c. Espagne, no 74181/01, § 131, 6 janvier 2010, et les affaires y citées : Helle c. Finlande, 19 décembre 1997, § 46, Recueil 1997‑VIII, et Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 134, CEDH 2005‑XIII). Une juridiction supérieure ou suprême peut bien entendu, dans certains cas, redresser les défauts de la procédure de première instance (De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 33, série A no 86).
59. En l’espèce, le Gouvernement allègue, et la requérante ne le conteste pas, que la cour d’appel avait compétence pour examiner l’affaire sans être liée par la décision de renvoi du conseil de premier degré, ce qui est en plus confirmé par l’article 57 du code des notaires. La Cour note que la cour d’appel a entendu des témoins et ajourné l’audience pour obtenir des preuves, et que la requérante a eu l’occasion de présenter les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause, lesquels ont été examinés point par point par la cour d’appel sans que celle‑ci ne se soit vue contrainte de se déclarer incompétente pour y répondre ou pour contrôler les constats de fait ou de droit établis par le conseil disciplinaire (paragraphes 16-21 dessus). La Cour constate que la requérante ne soulève aucun grief concernant la procédure qui s’est déroulée devant la cour d’appel. Il n’est donc pas contesté, dans les circonstances particulières de l’affaire et compte tenu des griefs valablement soulevés devant la Cour, que la cour d’appel est un organe judiciaire de pleine juridiction au sens de la jurisprudence de la Cour, respectant les garanties de l’article 6 de la Convention.
60. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante a été effectué par la cour d’appel et que celle-ci a remédié aux défauts allégués de la procédure devant le conseil disciplinaire.
(ii) Sur le grief relatif à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison d’une requalification des infractions reprochées à la requérante
61. La Cour rappelle que, en l’espèce, le volet civil de l’article 6 s’applique, et que l’article 6 § 3 de la Convention n’est donc pas applicable. Cependant, elle va procéder à l’examen du grief de la requérante concernant la requalification dans le contexte de l’article 6 § 1 de la Convention en s’inspirant de l’approche qu’elle a appliquée en matière pénale (paragraphe 55 ci-dessus).
62. À cet égard, la Cour note que, au stade de l’enquête disciplinaire, il a été reproché à la requérante d’avoir transféré un terrain qui avait été classé site archéologique par une décision ministérielle de 1965 et faisait partie du site protégé par la loi no 3028/2002 relative « à la protection des monuments historiques et en général de l’héritage culturel ». Dans la décision de renvoi no 3/2009 du conseil disciplinaire, il était mentionné que le terrain en question avait été qualifié « d’espace constituant l’environnement de monuments historiques » par la décision ministérielle de 1965 et qu’il ne pouvait donc pas faire l’objet d’une transaction. Le conseil disciplinaire reprochait en outre à la requérante de ne pas avoir exclu du transfert les deux monuments historiques situés sur le terrain (paragraphe 11 dessus). Par la suite, après la décision de la cour d’appel d’ajourner l’examen sur le fond en attendant la réponse de la direction générale des antiquités et de l’héritage culturel sur le classement du bien immobilier en question (paragraphe 17 ci-dessus), la cour d’appel a publié l’arrêt no 3/2011 par laquelle la requérante a été condamnée pour le transfert du terrain qui avait été classé comme monument par la décision ministérielle de 1965 et qui était protégé par la loi no 3028/2002, sans en outre exclure les deux monuments historiques byzantins, qui ne pouvaient pas non plus faire l’objet d’un transfert (paragraphes 22 ci-dessus).
63. La Cour relève que les juridictions internes ont considéré que le terrain en question était protégé par la loi no 3028/2002 pour deux raisons. Premièrement, toute la zone avait été classée monument historique par la décision ministérielle de 1965 et, deuxièmement, elle incluait deux monuments historiques, classés comme tels par les décisions ministérielles de 1981 et 1984 respectivement.
64. La Cour constate également que la dénomination précise du terrain en question en droit interne n’est pas claire et que les juridictions internes ont employé une terminologie différente à chaque étape de la procédure : site archéologique, espace constituant l’environnement de monuments historiques et monument historique. Par ailleurs, la cour d’appel a ajourné l’examen sur le fond du dossier afin d’obtenir l’avis de l’autorité responsable concernant le classement précis du terrain en question.
65. En ce qui concerne la différence entre les reproches formulés au stade de l’enquête disciplinaire et ceux formulés au stade du conseil disciplinaire, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel la décision no 3/2009 apporte des précisions quant à la nature du site archéologique en ajoutant qu’il s’agit d’un espace constituant l’environnement de monuments archéologiques. Cependant, la Cour note que, dans la loi no 3028/2002, le site archéologique et le monument, qui, selon l’article 2, b, cc) de cette loi, comprennent aussi leur environnement immédiat, sont deux termes différents (paragraphe 28 ci-dessus). D’autre part, la Cour constate que les poursuites disciplinaires faisaient déjà de référence à la décision ministérielle de 1965 qui avait classé les monuments byzantins, avec l’espace constituant leur environnement, comme étant des monuments historiques.
66. En tout état de cause, la Cour attribue une importance décisive à la procédure qui s’est déroulée ultérieurement devant la cour d’appel. Il convient de noter, en effet, que la cour d’appel s’est livrée à un examen complet de la cause de la requérante, tant au regard du droit procédural qu’au regard du droit matériel (Dallos c. Hongrie, no 29082/95, § 50, CEDH 2001‑II). Après avoir étudié le dossier de l’instance inférieure, qui, par ailleurs, n’a pas publié de décision définitive, et les observations présentées par la requérante, la cour d’appel a entendu lors d’une séance publique des observations orales de la part des avocats de la défense (paragraphes 15 ‑ 18 ci-dessus).
67. À supposer même, donc, que l’infraction ait été requalifiée, la Cour considère que la requérante a eu l’occasion de présenter devant la cour d’appel sa défense à cet égard (Dallos, précité, § 52).
68. En ce qui concerne la requalification alléguée par la cour d’appel, la Cour ne souscrit pas à l’argument de la requérante. Même si le conseil disciplinaire a employé les termes « espace constituant l’environnement de monuments historiques » et la cour d’appel les termes « monument historique », la Cour note qu’il s’agit de la terminologie utilisée dans la décision ministérielle de 1965 ayant classé les monuments byzantins, avec l’espace constituant leur environnement, en tant que monuments historiques (paragraphe 29 ci-dessus). En outre, contrairement à ce que la requérante soutient, la Cour note qu’aucune requalification des infractions reprochées à la requérante n’est intervenue devant la Cour de cassation.
69. À la lumière de ce qui précède, la Cour relève que la requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire et que les droits de celle-ci à être informée dans le détail de la nature et de la cause des infractions reprochées dirigées contre elle et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense n’ont pas été méconnus. La Cour estime que la requérante a pu, aux différents stades de la procédure, présenter les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause.
70. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, et eu égard à sa jurisprudence selon laquelle les États contractants jouissent d’une latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil qu’en matière de poursuites pénales, le caractère équitable de la procédure litigieuse n’a pas été affecté en raison des défauts indiqués par la requérante à cet égard.
(iii) Sur le grief relatif à une méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre de l’instance devant la Cour de cassation
71. En ce qui concerne la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation, il ressort de la jurisprudence précitée (paragraphes 52-54 dessus) qu’une décision de justice interne ne peut être qualifiée d’« arbitraire » au point de nuire à l’équité du procès que si elle est dépourvue de motivation ou si cette motivation est fondée sur une erreur de fait ou de droit manifeste commise par le juge national qui aboutit à un « déni de justice » (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 85, 11 juillet 2017). Il en ressort aussi que l’obligation des autorités judiciaires de motiver leurs arrêts présuppose que la partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (voir paragraphe 54 ci-dessus).
72. La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la motivation de la décision de justice rendue par la Cour de cassation a respecté les exigences de la Convention.
73. La Cour note, en particulier, que la requérante reprochait au conseil disciplinaire de ne pas avoir donné la parole à ses avocats après le réquisitoire du procureur. Dans son arrêt du 5 juin 2012, la Cour de cassation s’est bornée à déclarer que la requérante n’avait pas soulevé le moyen tiré du refus qui aurait été opposé à la demande de ses avocats de prendre la parole devant le conseil disciplinaire et que ce moyen devait donc être rejeté.
74. À cet égard, la Cour relève que cette conclusion est contredite par le procès-verbal de l’audience du 29 novembre et du 14 décembre 2010, c’est-à-dire de l’audience ayant abouti à l’arrêt no 8/2010 de la cour d’appel, aux pages 9 et 10 de laquelle ce moyen est amplement exposé. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel il ne ressort pas du procès-verbal de l’arrêt no 3/2011 de la cour d’appel que la requérante a soulevé ledit moyen. Cependant, ni le Gouvernement ni la Cour de cassation n’ont soutenu que la requérante aurait dû exposer de nouveau son argument devant la cour d’appel après l’arrêt no 8/2010, par lequel l’arrêt sur le fond a été ajourné en attendant la réponse de la direction générale des antiquités et de l’héritage culturel en ce qui concernait le classement du bien immobilier en question (paragraphe 17 ci-dessus).
75. La Cour observe, par ailleurs, que le même moyen a été soulevé devant elle et qu’elle déjà conclu que la cour d’appel a effectué un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante et a, donc, remédié les défauts allégués de la procédure devant le conseil disciplinaire, le refus prétendu du président du conseil disciplinaire de donner la parole aux avocats de la requérante inclus. Se référant à ses conclusions relatives aux griefs tirés par la procédure déroulée devant le conseil disciplinaire (voir paragraphes 57‑60 ci-dessus), la Cour estime, par conséquent, que le moyen soulevé par la requérante et rejeté par la Cour de cassation ne peut pas être considéré décisif pour l’issue de la procédure en cause.
76. Compte tenu des observations qui précèdent, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation.
GRANDE CHAMBRE NAÏT-LIMAN c. SUISSE du 15 mars 2018 requête n° 51357/07
Article 6-1 et compétence universelle en matière de torture. Le requérant n'avait pas de lien suffisant avec la Suisse puisqu'il résidait en Italie quand il a été arrêté pour être renvoyé en Tunisie et torturé. C'est ensuite qu'il a demandé sa résidence suisse. La CEDH prévient que ce sujet va évoluer à l'avenir.
Non-violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne le refus des juridictions suisses d’examiner l’action civile de M. Naït-Liman en réparation du préjudice moral causé par des actes de torture qu’il allègue avoir subis en Tunisie. La Cour considère au terme d’une étude de droit comparé que le droit international ne faisait pas peser d’obligation sur les autorités suisses d’ouvrir leur for en vue de faire statuer sur le fond de la demande de réparation de M. Naït-Liman, ni au titre d’une compétence universelle civile pour acte de torture, ni au titre du for de nécessité. Il en résulte que les autorités suisses jouissaient d’une large marge d’appréciation en la matière. S’agissant des conditions fixées par le législateur, la Cour conclut qu’en instituant un for de nécessité aux conditions fixées à l’article 3 de la loi fédérale sur le droit international privé, le législateur suisse n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation. S’agissant de la marge d’appréciation des juridictions nationales, la Cour ne discerne aucun élément manifestement déraisonnable ou arbitraire dans l’interprétation faite par le Tribunal fédéral en son arrêt du 22 mai 2007, par lequel Tribunal fédéral rejeta le recours de M. Naït-Liman, considérant que les tribunaux suisses n’étaient pas compétents à raison du lieu. La Cour rappelle cependant que cette conclusion ne met pas en cause le large consensus dans la communauté internationale sur l’existence d’un droit des victimes d’actes de torture à une réparation appropriée et effective, ni le fait que les États sont encouragés à donner effet à ce droit.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
94. Le requérant se plaint de ce que les tribunaux suisses ont décliné leur compétence pour connaître du fond de son action civile dirigée contre la Tunisie et contre A.K., responsables, selon lui, des actes de torture qui lui auraient été infligés sur le territoire tunisien. Il dénonce une violation de son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
95. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la nature et l’objet du litige
96. La Cour estime approprié de clarifier d’emblée la nature du présent litige et son enjeu particulier. Elle rappelle à cet égard que le requérant affirme avoir été victime d’actes de torture et que les autorités suisses lui ont octroyé l’asile en raison des persécutions subies dans son pays d’origine. À l’origine de la requête se trouvent donc des faits qui, s’ils sont avérés, présentent une particulière gravité.
97. Dans ce contexte, la Cour souligne avant toute chose le large consensus dans la communauté internationale sur l’existence d’un droit des victimes d’actes de torture à une réparation appropriée et effective (paragraphes 61 et 62 ci-dessus). Si les effets contraignants de ce droit pour les États ne font guère de doutes s’agissant d’actes de torture commis sur le territoire de l’État du for ou par des personnes relevant de sa juridiction, il n’en va pas de même des actes commis par des États tiers ou des personnes relevant de ceux-ci (paragraphes 182-202 ci-dessous). Or, c’est bien cette dernière catégorie d’actes qui se trouve en cause en l’espèce. La Cour tient dès lors à préciser que, quelles que soient les conséquences qu’elle sera amenée à tirer de cette circonstance sur le terrain de la Convention, elles ne mettent pas en cause, dans son principe, le droit des victimes d’actes de torture à une indemnisation appropriée et effective.
98. La Cour estime également utile de clarifier quatre aspects qui ont trait à l’objet du litige. Premièrement, elle rappelle que la chambre a laissé ouverte la question de l’immunité de juridiction au bénéfice des défendeurs dans la procédure en cause en l’espèce, étant donné que le Tribunal fédéral avait d’abord décliné sa compétence ratione loci à connaître du recours du requérant et en avait conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de l’immunité de juridiction (arrêt de chambre, paragraphe 106).
99. La Cour constate que cette approche correspond à la pratique internationale en la matière. En effet, la CIJ, dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 ((République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, Recueil CIJ 2002, § 46), a estimé :
« D’un point de vue logique, le second moyen ne devrait pouvoir être invoqué qu’après un examen du premier, dans la mesure où ce n’est que lorsqu’un État dispose, en droit international, d’une compétence à l’égard d’une question particulière qu’un problème d’immunité peut se poser au regard de l’exercice d’une telle compétence. »
La CIJ a eu l’occasion de confirmer ce principe ultérieurement (Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, Recueil CIJ 2012, § 82). Dès lors, compte tenu de la conclusion à laquelle elle parvient quant à la compétence des juridictions suisses, la Cour n’estime pas nécessaire d’aborder la question des éventuelles immunités de juridiction.
100. Deuxièmement, quant au reproche du requérant formulé à l’encontre des autorités de poursuite au sujet de leur manque de diligence à l’égard de A.K., – reproche partagé par les auteurs de l’opinion dissidente jointe à l’arrêt de chambre –, la Cour observe que le requérant a déposé sa plainte pénale le 14 février 2001 et que le jour même, le procureur général a demandé au chef de la police de sûreté, par courrier interne, de « tenter de localiser et d’identifier le mis en cause, qui serait hospitalisé à Genève, aux HUG, pour une intervention d’ordre cardiaque » et, le « cas échéant, [de] l’interpeller et [de] le mettre à disposition d’un juge d’instruction. » (paragraphe 20 ci-dessus). Aussitôt en possession de cette demande, la police a pris contact avec l’hôpital qui l’a informé que A.K. avait effectivement été hospitalisé, mais avait quitté l’hôpital dès le 11 février 2001, puis le territoire suisse. Cette décision de classement n’a pas été contestée par le requérant. La Cour en déduit que l’on ne saurait reprocher aux autorités de poursuite suisses une négligence dans le traitement de la plainte pénale du requérant. Dès lors, cet aspect ne sera pas pris en compte par la Grande Chambre pour apprécier le respect de l’article 6 de la Convention.
101. Troisièmement, la Cour rappelle que, lors de l’audience du 14 juin 2017, le requérant a confirmé qu’il avait adressé une requête à l’IVD (paragraphe 36 ci-dessus). En février 2016, il aurait reçu un simple accusé de réception, mais n’aurait plus eu de nouvelles de l’IVD depuis lors. Dans la mesure où cette instance a été créée postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral pertinent en l’espèce, la Cour estime que la possibilité de s’adresser à celle-ci, suivie éventuellement d’une procédure judiciaire, comme expliqué par le Gouvernement (paragraphes 31-35 ci-dessus), n’est pas pertinente pour l’examen de la présente affaire.
102. Quatrièmement, s’agissant du fait que le requérant n’a, semble-t-il, jamais intenté une action en Italie, que ce soit contre les autorités tunisiennes, au titre des actes de torture subis, ou contre les autorités italiennes, au titre de son arrestation et de sa remise aux autorités tunisiennes, le 22 avril 1992 (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour souligne qu’elle a posé aux parties une question spécifique à ce sujet en vue de l’audience du 14 juillet 2017, sans cependant obtenir des informations précises en réponse. Elle rappelle par ailleurs que le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la deuxième condition en vue de l’application de l’article 3 LDIP – qu’une action à l’étranger soit impossible ou ne puisse être raisonnablement exigée – était remplie (cons. 3.3 de l’arrêt, paragraphe 30 ci-dessus). Dès lors, et en l’absence de plus d’amples informations à ce sujet, l’issue de telles procédures, en ce compris la compétence des juridictions italiennes, reste spéculative. Dans ces conditions, la Cour ne saurait se prononcer sur cette question.
B. Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention
103. Devant la chambre, le Gouvernement, en se référant principalement à l’arrêt Al-Adsani (précité, § 47), a soutenu en substance que l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait créer, par voie d’interprétation, un droit matériel de caractère civil n’ayant aucune base légale dans l’État concerné. D’après lui, le droit suisse ne reconnaît pas un droit d’intenter une action en réparation pour des actes de torture sans lien avec la juridiction suisse. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’appliquerait pas en l’espèce.
104. La chambre a écarté cette thèse en ces termes (arrêt, § 85) :
« En l’espèce, le requérant avait fondé sa demande sur les articles 82 et suivants du code des obligations et des contrats de la Tunisie, qu’il considérait applicables en vertu de l’article 133 alinéa 2 LDIP. La Cour observe par ailleurs que des dispositions analogues prévoyant une responsabilité civile pour fait illicite, s’appliquant entre autres aux atteintes à l’intégrité physique ou morale d’une personne, se trouvent en droit suisse, notamment aux articles 41 et suivants du code des obligations (...). L’interprétation restreinte du concept du for de nécessité qu’a opérée le Tribunal fédéral ne constitue pas d’obstacle à l’application de l’article 6 § 1 au cas d’espèce (mutatis mutandis, Al-Adsani, précité, §§ 46‑49, et Jones et autres, précité, § 164). Cette disposition trouvant dès lors à s’appliquer dans la présente espèce, l’exception d’incompatibilité de la requête avec les dispositions de la Convention doit être rejetée. »
105. La Grande Chambre constate que, devant elle, le Gouvernement n’a pas réitéré son argument ni contesté l’avis de la chambre sur ce point. Elle considère néanmoins utile de préciser ce qui suit.
106. L’applicabilité de l’article 6 § 1 en matière civile est d’abord subordonnée à l’existence d’une contestation (en anglais « dispute »). Ensuite, celle-ci doit se rapporter à des « droits et obligations » que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne. Enfin, ces « droits et obligations » doivent revêtir un « caractère civil » au sens de la Convention, bien que l’article 6 ne leur assure par lui-même aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants (voir, par exemple, Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 88, CEDH 2016 (extraits), Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, § 91, CEDH 2012, et James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 81, série A no 98). Cette notion ne saurait s’interpréter par simple référence au droit interne de l’État défendeur ; il s’agit d’une notion « autonome » découlant de la Convention. L’article 6 § 1 de la Convention s’applique indépendamment de la qualité des parties comme de la nature de la loi régissant la « contestation » et de l’autorité compétente pour trancher (voir, par exemple, Georgiadis c. Grèce, 29 mai 1997, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III). C’est en effet au regard non seulement de la qualification juridique, mais aussi du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l’État en cause, qu’un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans la Convention (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 57, CEDH 2004‑I).
107. En l’espèce, la Cour ne doute pas que l’on est en présence d’une contestation « réelle et sérieuse », comme exigée par la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, § 71, et Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 81, série A no 52). Le fait que l’État défendeur ne conteste pas véritablement l’existence d’un droit des victimes de torture à obtenir réparation, mais plutôt son application extraterritoriale, importe peu, étant donné que la contestation peut porter aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur son étendue ou ses modalités d’exercice (Benthem c. Pays-Bas, 23 octobre 1985, § 32, série A no 97).
108. La Cour estime également que le requérant peut se prétendre titulaire d’un droit qui est, au moins de manière défendable, reconnu en droit suisse. Outre l’article 41 du code des obligations suisse mentionné par la chambre (paragraphe 38 ci-dessus), lequel reconnaît le principe général de la responsabilité civile pour fait illicite, la Cour renvoie aux éléments de droit international mentionnés ci-dessus (paragraphes 61-63, ci-dessus) et tout particulièrement à l’article 14 de la Convention contre la torture (paragraphes 45 et suivants ci-dessus). Celui-ci garantit un droit solidement ancré, en tant que tel, en droit international général, à savoir le droit des victimes d’actes de torture d’obtenir réparation et d’être indemnisés équitablement et de manière adéquate. Avec la ratification de cet instrument par la Suisse le 2 décembre 1986, ses dispositions sont devenues partie intégrante de l’ordre juridique suisse, obligeant les autorités nationales à s’y conformer.
109. Quant à la question de savoir si les États parties à cet instrument sont obligés de garantir ce droit même pour les actes de torture qui ont été infligés hors de leurs territoires par des agents étrangers, comme le prétend le requérant, la Cour estime qu’elle touche au fond de la présente affaire, lequel sera examiné ci‑dessous (paragraphes 112 et suivants). Pour autant, elle n’est pas déterminante s’agissant de l’applicabilité de l’article 6.
110. La Cour en déduit que le droit des victimes d’actes de torture à obtenir réparation est aujourd’hui reconnu en droit suisse. Par ailleurs, les parties s’accordent à considérer qu’il s’agit d’un droit civil.
111. Compte tenu de ce qui précède, l’article 6 § 1 de la Convention est applicable aux faits de la cause.
C. Sur le fond
1. Les principes régissant le droit d’accès à un tribunal
112. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal – c’est-à-dire le droit de saisir un tribunal en matière civile – constitue un élément inhérent au droit énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention, qui pose les garanties applicables en ce qui concerne tant l’organisation et la composition du tribunal que la conduite de la procédure. Le tout forme le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 § 1 (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 120, CEDH 2016 ; et Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18).
113. Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (voir, parmi d’autres, Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], no 5809/08, § 126, CEDH 2016 ; Eşim c. Turquie, no 59601/09, § 18, 17 septembre 2013, et Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002‑IX). Chaque justiciable a droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (voir, parmi d’autres, Howald Moor et autres c. Suisse, nos 52067/10 et 41072/11, § 70, 11 mars 2014, et Golder, précité, § 36).
114. Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Baka, précité, § 120 ; Al-Dulimi et Montana Management Inc., précité, § 129 ; Yabansu et autres c. Turquie, no 43903/09, § 58, 12 novembre 2013, et Howald Moor et autres, précité, § 71). Cela étant, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (Baka, précité, § 120 ; Al-Dulimi et Montana Management Inc., précité, § 129 ; Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012, et Howald Moor et autres, précité, § 71).
115. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Baka, précité, § 120 ; Al-Dulimi et Montana Management Inc., précité, § 129 ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 50, Recueil 1996‑IV ; Stagno c. Belgique, no 1062/07, § 25, 7 juillet 2009, et Howald Moor et autres, précité, § 71).
116. La Cour rappelle, enfin, le principe fondamental selon lequel c’est aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu’il appartient d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176‑A ; Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 59, Recueil 1998‑II ; et Nusret Kaya et autres c. Turquie, nos 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 et 60915/08, § 38, CEDH 2014 (extraits)). La Cour ne peut dès lors mettre en cause l’appréciation des autorités internes quant à des erreurs de droit prétendues que lorsque celles-ci sont arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, dans ce sens, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, §§ 85-86, CEDH 2007‑I).
2. L’application des principes au cas d’espèce
117. De toute évidence, le requérant a subi une limitation de son droit d’accès à un tribunal en ce que les juridictions suisses se sont déclarées incompétentes pour connaître de sa demande en réparation. La Cour doit donc rechercher à présent si cette limitation poursuivait un but légitime et, dans l’affirmative, si elle se trouvait dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but visé.
a. La limitation du droit d’accès du requérant à un tribunal poursuivait-elle un but légitime ?
i. L’arrêt de chambre
118. S’agissant du but poursuivi par la limitation du droit d’accès à un tribunal, la chambre a estimé que le refus de donner suite à l’action civile du requérant visait à assurer la bonne administration de la justice et l’effectivité des décisions judiciaires internes. Elle a par ailleurs souscrit à l’avis du Gouvernement selon lequel une compétence universelle civile risquerait de créer des difficultés pratiques considérables pour les tribunaux, notamment sur le terrain de l’administration des preuves et de l’exécution des décisions judiciaires (paragraphe 107 de l’arrêt de chambre).
ii. Les observations des parties devant la Grande Chambre
α) Le requérant
119. En ce qui concerne les buts légitimes tirés de la bonne administration de la justice et de l’effectivité des décisions judiciaires internes, le requérant soutient que la chambre n’a pas véritablement expliqué ce qu’il faut entendre par ces notions. Il estime que la jurisprudence de la Cour, depuis des décennies, a massivement ouvert l’accès aux tribunaux pour les justiciables sans jamais retenir l’argument de la surcharge de travail des tribunaux qui pourrait en découler.
120. Quant aux difficultés dues à l’administration des preuves, le requérant fait valoir que l’arrêt n’en apporte aucune explication ou justification. Au sujet des difficultés liées à l’exécution des décisions judiciaires, il affirme que la possibilité d’exécuter à l’étranger un jugement rendu en Suisse ne saurait être une condition préalable à la reconnaissance de la compétence des juridictions suisses, ajoutant que l’arrêt du Tribunal fédéral ne mentionne pas cet argument dans son raisonnement.
β) Le Gouvernement
121. En ce qui concerne les buts poursuivis par la limitation de l’accès du requérant à un tribunal, le Gouvernement renvoie à l’argumentation de la chambre (paragraphe 118 ci-dessus).
iii. L’appréciation de la Cour
122. S’agissant des buts légitimes de la limitation litigieuse, la Grande Chambre en discerne plusieurs, qui tous se rattachent aux principes de la bonne administration de la justice et du maintien de l’effectivité des décisions judiciaires internes.
123. Tout d’abord, il ne fait guère de doute qu’une action telle que celle du requérant, alléguant qu’il avait été torturé en Tunisie en 1992, poserait aux tribunaux suisses des problèmes considérables au niveau du rassemblement et de l’appréciation des preuves.
124. En outre, l’exécution d’un arrêt donnant suite à une telle action pourrait entraîner des difficultés pratiques (paragraphe 107 de l’arrêt de chambre). À cet égard, on peut en effet s’interroger, dans l’optique d’un droit d’accès effectif à un tribunal, sur le point de savoir si un arrêt rendu dans de telles conditions pourrait effectivement être exécuté (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, paragraphes 40-45, Recueil 1997‑II).
125. Ensuite, il apparaît légitime pour un État de vouloir dissuader le forum shopping, en particulier dans un contexte caractérisé par une limitation des ressources allouées à la justice.
126. Par ailleurs, la Cour considère justifiée la crainte exprimée par le Gouvernement selon laquelle le fait d’accueillir une action comme celle du requérant, dont les liens de rattachement avec la Suisse au moment des faits apparaissent assez ténus, risquerait d’attirer des plaintes similaires de la part d’autres victimes dans la même situation à l’égard de la Suisse et, ainsi, d’entraîner une surcharge des tribunaux nationaux. Une limitation raisonnable des recours recevables apparaît dès lors susceptible d’assurer l’effectivité de la justice.
127. Enfin, et à titre surabondant, la Grande Chambre accepte qu’un État ne saurait ignorer les difficultés diplomatiques que pourrait entraîner la reconnaissance d’une compétence en matière civile dans les conditions proposées par le requérant.
128. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la limitation du droit d’accès du requérant à un tribunal peut passer pour poursuivre les buts légitimes énoncés ci-dessus. Il convient à présent de rechercher si elle était proportionnée par rapport à ceux-ci.
b. La limitation était-elle proportionnée ?
i. L’arrêt de chambre
129. S’agissant de la proportionnalité de la limitation en question, la chambre a estimé que celle-ci n’avait pas enfreint le droit d’accès du requérant à un tribunal dans sa substance même (paragraphe 108 de l’arrêt). Elle a notamment considéré que l’État défendeur n’était pas tenu d’admettre une compétence universelle civile en vertu d’autres normes du droit international, en dépit de la nature incontestée de jus cogens de la prohibition de la torture en droit international (paragraphe 116).
130. La chambre a souligné ensuite que le libellé même de l’article 14 de la Convention contre la torture, ratifiée par la Suisse, n’est pas sans équivoque quant à son application extraterritoriale et qu’aucun élément concret ne pouvait être tiré à ce sujet des travaux préparatoires relatifs à cette disposition (paragraphe 117). La chambre a rappelé également que son étude révélait qu’aucun des 26 États européens couverts par celle-ci ne reconnaît actuellement la compétence universelle civile pour des actes de torture (paragraphe 118). Elle en a conclu qu’aucune obligation conventionnelle n’obligeait la Suisse à accepter l’action civile du requérant sur cette base‑là (paragraphe 120).
131. La chambre a estimé en outre que l’interprétation par le Tribunal fédéral de l’article 3 LDIP dans le cas d’espèce, bien que restrictive, n’était pas entachée d’arbitraire (paragraphe 112). Elle a rappelé que le requérant avait acquis entre-temps la nationalité suisse, mais observé que la confirmation par la Ville de Versoix de la naturalisation du requérant était intervenue postérieurement à l’adoption de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2007 et n’avait donc pas pu être prise en compte par celui-ci (paragraphe 113). Par ailleurs, la chambre a observé que seulement 9 des 26 États contractants pris en compte dans son étude comparative reconnaissent le concept du for de nécessité et que, dans les États qui l’appliquent, il est, comme en Suisse, subordonné à des conditions importantes qui doivent être réunies cumulativement. La chambre en a conclu que l’interprétation donnée en l’espèce à l’article 3 LDIP n’a rien d’exceptionnel et reflète la solution adoptée dans les États membres du Conseil de l’Europe qui ont introduit un tel for de nécessité dans leurs ordres juridiques (paragraphe 114).
ii Les observations des parties devant la Grande Chambre
α) Le requérant
132. Le requérant soutient que la limitation du droit d’accès à un for approprié, en l’occurrence la Suisse, était manifestement déraisonnable et a en l’espèce porté atteinte à la substance même de ce droit. Quant aux travaux préparatoires de l’article 3 LDIP, il rappelle que le Conseil fédéral avait noté que « [l]es autorités suisses doivent se déclarer compétentes même dans des affaires où les liens avec notre pays sont très minces, lorsqu’il est impossible d’agir ou d’introduire un recours à l’étranger. » (cons. 3.4 de l’arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant à la Feuille fédérale 1983 I 290). Or, selon le requérant, le Tribunal fédéral se serait néanmoins écarté de cette solution en indiquant que l’article 3 LDIP doit être interprété restrictivement, tout en niant l’existence de liens suffisants entre lui et la Suisse.
133. Quant à l’atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6, le requérant soutient qu’il est établi qu’il ne pouvait pas porter son affaire devant le for ordinaire en Tunisie. Il soutient qu’en interprétant la notion de « cause » comme ne pouvant recouvrir que les faits à l’origine de l’action juridique, soit la torture, le Tribunal fédéral a fermé la porte à toute possibilité pour le requérant d’obtenir les réparations auxquelles il prétend. Ce faisant, ce tribunal aurait refusé la possibilité d’effectuer une vraie pesée de tous les intérêts en jeu entre les possibles buts légitimes permettant de justifier une restriction, d’une part, et le fait qu’il s’agissait de réparations pour un crime de droit international et ses liens avec la Suisse, d’autre part.
134. Selon le requérant, la présente affaire n’exige pas nécessairement que la Cour se prononce sur le rejet ou l’acceptation de la compétence universelle civile. Elle porte plutôt sur la question de savoir si un État qui a réglementé le droit d’accès en instaurant un for de nécessité peut interpréter celui-ci en faisant abstraction des liens que l’une des parties au litige présente avec cet État.
135. Quoi qu’il en soit, le requérant estime que l’approche suivie par le Tribunal fédéral est incompatible avec le droit international. Il soutient que l’article 14 de la Convention contre la torture impose aux États parties une obligation de ne pas interpréter les dispositions de leur droit interne de manière à réduire à néant le droit à réparation des victimes de torture. Il rappelle l’Observation générale no 3 (2012) du Comité contre la torture des Nations unies (paragraphes 52-53 ci-dessus) dans lequel il est précisé que « [l]e Comité considère que l’application de l’article 14 ne se limite pas aux victimes de préjudices commis sur le territoire de l’État partie ou commis par ou contre un ressortissant de l’État partie (...). Cela est particulièrement important quand la victime n’est pas en mesure d’exercer les droits garantis par l’article 14 sur le territoire où la violation a été commise. » (Observation générale no 3 (2012), § 22). Ainsi, le requérant soutient que l’article 14 de la Convention contre la torture consacre une obligation à la charge de tous les États parties à la Convention contre la torture. Il ajoute que la CIJ a précisé, à propos des obligations erga omnes partes, que « quelle que soit l’affaire, chaque État partie a un intérêt à ce qu’elles soient respectées. » (CIJ, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, Recueil CIJ 2012, § 68). Quant à la torture, il rappelle également que la CIJ a considéré qu’en établissant la compétence de leurs tribunaux pour connaître des crimes de torture, « les États parties garantiss[e]nt l’intervention de leur système judiciaire à cet effet et s’engagent à coordonner leurs efforts pour éliminer tout risque d’impunité » (Ibidem, § 75).
136. Le requérant relève en outre que, lors de sa session de Tallinn en 2015, l’IDI a adopté la résolution intitulée « La compétence universelle civile en matière de réparation pour crimes internationaux » (paragraphe 62 ci-dessus). Le requérant précise que cette résolution énonce en son article 2 le droit de disposer d’un accès effectif à la justice afin de pouvoir réellement solliciter et obtenir cette réparation. Le même article prévoit dans le détail les conditions devant guider les tribunaux suisses dans l’établissement de leur compétence lorsqu’ils ont à connaître des actions en réparation pour crimes de droit international. Le requérant conclut que le recours à l’article 2 de la résolution de l’IDI aurait permis une interprétation de l’article 3 LDIP qui préserve pleinement le droit du requérant à un for approprié. Par ailleurs, en tant que réfugié reconnu en Suisse, il invoque également l’article 16 de la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés (paragraphe 60 ci-dessus) à l’appui de sa cause.
137. Le requérant rappelle ensuite que l’exigence d’un for de nécessité a été énoncée en 2012 par l’ADI dans les Lignes directrices de Sofia sur les meilleures pratiques en matière d’actions civiles pour violation des droits de l’homme (paragraphe 66 ci-dessus). Cette proposition tend à promouvoir l’adoption des règles de droit international privé pour permettre le règlement équitable et efficace des questions soulevées en matière d’actions civiles pour violation des droits de l’homme. Le requérant ajoute que, même si elle ne relève pas (encore) du droit positif, elle constitue néanmoins un élément à prendre en compte s’agissant de la formation d’une opinio juris qui entend assurer, de la manière la plus appropriée, une protection contre les dénis de justice.
138. Le requérant rappelle également que la question principale qui s’est posée au Tribunal fédéral était celle de savoir ce qu’il fallait entendre par « le lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant » pour déterminer l’existence d’un for en Suisse. Il ajoute que, sur ce point, le Tribunal fédéral a rattaché la notion de cause au seul état de fait à la base de la demande, soit l’acte criminel (la torture), en refusant que des faits ayant trait à la personne du demandeur puissent constituer des éléments admissibles permettant d’interpréter la notion de lien suffisant avec la Suisse (cons. 3.5, sous‑paragraphe 6 de l’arrêt du Tribunal fédéral ; paragraphe 30 ci-dessus). Or, selon le requérant, le domicile d’une partie (la victime) ne peut pas ne pas compter parmi les composantes de la « cause ». En ce qui concerne plus spécifiquement la responsabilité civile, comme dans l’espèce, si les faits se sont déroulés à l’étranger, un for ne pourrait jamais être donné sur la base de l’article 3 LDIP et, par conséquent, l’interprétation du Tribunal fédéral rend impossible l’application même d’un for de nécessité. En d’autres termes, la mise en œuvre restrictive de la notion de « cause » par le Tribunal fédéral réduit à néant le but même de cette disposition, à savoir d’éviter un déni de justice.
139. Le requérant observe encore que la reconnaissance d’un for en Suisse est actuellement subordonnée à des conditions plus strictes dans un cas de torture que celles prévalant pour d’autres domaines du droit, ce qui serait parfaitement incompatible avec le but de l’article 3 LDIP, qui est de réserver un for de dernier secours pour des cas exceptionnels, par exemple en matière de crimes de droit international. Il précise à cet égard que la pratique suisse connaît de nombreuses illustrations légales ou jurisprudentielles du fait que la « cause » ne saurait s’entendre du seul complexe de faits à l’origine de la question juridique à trancher. Pour ces situations, le législateur ou les tribunaux ont été d’avis que si l’action ne pouvait pas être intentée au for ordinaire de l’action, ou s’il ne pouvait raisonnablement être exigé qu’elle le soit, un for alternatif devait être donné en Suisse, en présence d’un lien supplémentaire, pouvant aller de la nationalité de l’une des parties à la simple existence d’un séquestre. Dans aucune de ces situations, le fait que la cause juridique se trouvait à l’étranger n’a été considéré comme rédhibitoire pour connaître un for approprié en Suisse.
140. En d’autres termes, l’interprétation à laquelle le Tribunal fédéral a procédé, dans un cas où l’action concernait des mesures de réparation à la suite d’actes de torture, se heurterait à la systématique de la loi et aux développements de la jurisprudence dans des affaires d’annulation de poursuites, de validation de séquestre, de divorce, d’effets généraux du mariage, de filiation par naissance ou d’adoption, entre autres.
141. Le requérant soutient également que la chambre a à juste titre considéré, quant aux solutions adoptées dans d’autres États, que « [l]es liens de rattachement suffisants sont habituellement la nationalité, le domicile ou la résidence habituelle ». Il ajoute qu’ « [i]l s’ensuit que l’article 3 de la LDIP n’a rien d’exceptionnel et s’inscrit dans un consensus très large parmi les États membres du Conseil de l’Europe qui ont introduit une telle compétence dans leurs ordres juridiques » (arrêt de chambre, paragraphe 114). Selon le requérant, il est dès lors incompréhensible que la chambre n’ait pas conclu que l’arrêt du Tribunal fédéral est en opposition à sa propre conclusion, étant donné qu’il ne tient pas compte de tels liens avec la Suisse et s’attache uniquement à la localisation à l’étranger des éléments en rapport avec la cause juridique du litige.
142. Enfin, le requérant fait valoir que, dans l’affaire Arlewin c. Suède (no 22302/10, 1er mars 2016), la Cour a récemment reconnu une violation du droit d’accès à un tribunal dans une situation où les tribunaux internes niaient l’existence d’un for suédois dans le cas d’une émission de télévision dont le contenu et le but poursuivi visaient exclusivement la Suède et portaient atteinte à la réputation de ressortissants suédois vivant en Suède. Il ajoute que la situation était telle que le refus d’accepter la compétence du juge suédois ne laissait au requérant pas d’autre choix que de devoir se tourner vers un tribunal étranger dont la compétence était certes donnée, mais était manifestement inappropriée. Le seul fait que la diffusion avait été entreprise par une compagnie britannique opérant sur le territoire britannique n’était pas un motif légitime pour soutenir que le for approprié était au Royaume‑Uni. Le requérant soutient que l’arrêt Arlewin est important pour la présente affaire dans la mesure où il affirme un droit d’accès à un tribunal (suédois) alors qu’une juridiction aurait également pu être saisie au Royaume-Uni. Il estime que le droit à un procès équitable a clairement fait pencher la balance en faveur de la compétence des tribunaux suédois.
β) Le Gouvernement
143. En ce qui concerne la proportionnalité de la restriction du droit d’accès à un tribunal, le Gouvernement invite également à suivre le raisonnement de la chambre. Quant à l’opinion dissidente, le Gouvernement admet que, dans la lutte contre la torture, les États ont, jusqu’à un certain point, une responsabilité d’agir comme gardien universel de la justice, mais il est convaincu que le postulat de se doter d’une compétence universelle en matière civile pour actes de torture dépasserait les limites de ce que peut réaliser un État de droit, et ce pour les raisons suivantes.
144. Prévoir une juridiction civile quasiment illimitée à charge d’un système juridictionnel national surmènerait les instances juridiques de quelque nation que ce soit. Il n’est dès lors pas surprenant qu’aucun État européen ne semble avoir adopté une loi prévoyant une juridiction civile pour des situations similaires à celle du requérant ou avoir interprété, le cas échéant, la règle du for de nécessité en ce sens.
145. Le Gouvernement rappelle également que, certes, la jurisprudence du Tribunal fédéral connaît peu de cas d’application de l’article 3 LDIP, mais que cette disposition n’est pourtant pas restée lettre morte. La jurisprudence cantonale a notamment admis son application en matière de droit de la famille, des successions et de la poursuite pour dettes et faillite. Dès lors, il est établi que les tribunaux ont appliqué le for de nécessité dans de constellations très diverses.
146. Selon le Gouvernement, il découle de cette jurisprudence que les éléments constitutifs d’un « lien suffisant » susceptible d’établir la compétence des autorités suisses au titre de l’article 3 LDIP sont la nationalité suisse du demandeur lorsqu’il s’agit d’une question du droit de la famille ou d’une affaire concernant le statut des personnes, le domicile en Suisse du demandeur ou d’une autre partie directement intéressée, à condition qu’il s’agisse d’une question liée au droit de la famille, la localisation des biens en Suisse pour des questions de droit des successions, et, sous certaines conditions, l’existence d’un for de poursuite en Suisse.
147. L’affaire qui occupe actuellement la Grande Chambre serait toutefois très particulière et la seule du genre qui a dû être tranchée par les tribunaux suisses. A la lumière de la pratique de ces derniers, le Gouvernement conclut que l’application qu’a faite le Tribunal fédéral dans le cas d’espèce n’a néanmoins rien d’extraordinaire et s’inscrit dans la ligne de la pratique antérieure. Il s’ensuit que le refus d’accepter le for de nécessité tel que conçu par l’article 3 LDIP est loin d’être entaché d’arbitraire ou manifestement déraisonnable.
148. Quant à la question de savoir s’il existait une éventuelle obligation d’accepter une compétence universelle en matière civile, le Gouvernement fait valoir que le droit international et la pratique des États semblent encore moins développés à l’égard d’une telle obligation. Il souligne qu’aucun État européen n’a accepté une telle compétence. Le Gouvernement expose en outre qu’aucun des instruments invoqués par le requérant ne la reconnaît, qu’il en va notamment ainsi de l’article 16 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et qu’aucune règle de droit international coutumier ne la prévoit. Il ajoute que le texte de l’article 14 de la Convention contre la torture ne contient aucun indice pour une application extraterritoriale de cette norme et que plusieurs jugements rendus par des juridictions nationales confirment que l’article 14 de la Convention contre la torture ne contient pas d’obligation d’instaurer une juridiction civile universelle pour des victimes de torture (voir, notamment, UK House of Lords, Jones v. Ministry of Interior Al-Mamlaka Al-Arabiya as Saudiya and others [2006] UKHL 26, et cour d’appel de l’Ontario, Bouzari v. Iran, précité (paragraphe 73 ci-dessus)). Le Gouvernement soutient dès lors que, à l’heure actuelle, aucune tendance ne se manifeste en droit international vers un élargissement du principe de la compétence universelle pour englober les procédures civiles. Enfin, il fait valoir que la pratique du Comité contre la torture ne peut servir de base solide pour en déduire une obligation pour les États d’accepter une compétence universelle en matière civile indépendamment de tout lien d’une cause avec ces États, bien que l’Observation générale no 3 (2012) du Comité semble préconiser une telle interprétation.
149. Au sujet des travaux de l’ADI et de l’IDI, le Gouvernement relève qu’ils émanent d’associations à but exclusivement scientifique et sans caractère officiel. Ensuite, le Gouvernement rappelle que ces travaux ont été publiés en août 2012 (ADI) et le 30 août 2015 (IDI), c’est-à-dire bien après que le Tribunal fédéral eut rendu son arrêt, le 22 mai 2007. Sur le fond, le Gouvernement estime que les Lignes directrices de Sofia de l’ILA ne s’appliquent pas à une constellation comme celle de l’espèce, dans la mesure où son article 1.1 en limite le champ d’application aux actions civiles d’acteurs non-étatiques. En ce qui concerne la Résolution de Tallinn de l’IDI, le Gouvernement insiste sur le fait que l’article 2 § 1 utilise le conditionnel (« Un tribunal devrait exercer... »), ce qui implique que la résolution relève de la lex ferenda, plutôt que de la lex lata.
150. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement conclut que le droit international n’oblige pas la Suisse à traiter la demande du requérant et, dès lors, que, dans cette optique, les décisions des tribunaux suisses sont conformes à l’article 6 § 1.
151. Quant à l’article 3 LDIP, le Gouvernement soutient que le Tribunal fédéral, en interprétant les trois conditions pour admettre un for de nécessité, a d’emblée constaté l’inexistence d’un for ordinaire (première condition). Ce tribunal a laissé ouverte la question de savoir si une procédure à l’étranger se serait révélée impossible (deuxième condition) pour se consacrer plus amplement à la troisième condition, soit celle du « lien suffisant » entre la cause du requérant et la Suisse.
152. Le Gouvernement, à l’instar du Tribunal fédéral, rappelle que l’article 3 doit être interprété restrictivement et qu’il constitue une soupape de sécurité destinée à éviter des dénis de justice en cas de conflit négatif de compétence (arrêt du Tribunal fédéral, cons. 3.4 ; paragraphe 30 ci-dessus). Il ajoute cependant qu’il résulte des travaux préparatoires que le cas d’un étranger dont la cause ne présentait aucun lien avec la Suisse a bien été envisagé lors des débats parlementaires, mais qu’il a explicitement été renoncé à lui accorder un for, au prix de ne pas pouvoir éviter tous les dénis de justice.
153. Concernant la question de savoir quels éléments sont susceptibles de créer un « lien suffisant », le Gouvernement observe que le critère de la nationalité n’a pas été retenu en tant que critère généralement admis pour ouvrir le for de nécessité. Si la nationalité peut être un critère déterminant pour fonder un for en Suisse en droit des personnes et dans certains domaines du droit de la famille (et dans une moindre mesure en droit des obligations), elle ne crée pas, en tant que telle et dans tous les cas, un « lien suffisant » exigé par la loi.
154. En outre, selon le Gouvernement, la question de savoir quels éléments font partie d’une « cause » comporte également un aspect temporel. Dans de nombreux cas, une action en justice vise à influencer une situation de fait existante et la question de savoir quels éléments font partie de la cause se rapporte à la situation telle qu’elle se présente au moment de l’introduction de l’action. En revanche, lorsqu’une action porte sur un complexe de faits qui s’est terminé avant que l’action ne soit soulevée, les éléments de la cause doivent être examinés tels qu’ils se présentaient durant la période des faits, antérieure à la procédure. Lorsqu’un élément de la cause est modifié après que le complexe de faits déterminant s’est terminé, cette modification ne fait pas partie de la « cause » et ne peut dès lors plus créer un lien justifiant un for de nécessité.
155. S’agissant de la procédure de naturalisation, le Gouvernement rappelle que cette procédure n’a pas pu influencer l’issue du procès, parce qu’il s’agit, là aussi, d’un « fait postérieur à la cause » (arrêt du Tribunal fédéral, cons. 3.5). Sur la base de l’approche adoptée par le Tribunal fédéral, la naturalisation ne saurait être traitée différemment par rapport aux éléments que le requérant a fait valoir, à savoir son domicile en Suisse, son statut de réfugié et le fait de bénéficier de prestations sociales. Par ailleurs, le Gouvernement soutient qu’il faut partir de l’idée que le Tribunal fédéral n’était pas au courant de la procédure de naturalisation en cours. En tout état de cause, le mémoire d’appel ne fait pas référence à cette procédure, ce qui indique, selon le Gouvernement, que le requérant lui-même n’a pas considéré cet aspect comme un argument militant en faveur de l’application du for de nécessité.
156. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement conclut que les tribunaux ont certes appliqué le for de nécessité dans des constellations très diverses, toutefois aucune d’elles ne semble comparable au cas d’espèce. La totalité des actes pour les conséquences desquels le requérant, à l’époque ressortissant tunisien, réclame une indemnité pour tort moral, lui auraient été infligés en Tunisie, par l’État tunisien et ses agents, sans aucun rapport avec la Suisse. Dans ces circonstances, le Gouvernement estime que ne pas accepter le for de nécessité tel que conçu par l’article 3 LDIP est loin d’être entaché d’arbitraire ou manifestement déraisonnable.
iii Les observations des tiers intervenants
α) Le Royaume-Uni
157. Le Royaume-Uni estime que la chambre a procédé à une analyse fouillée du droit international et comparé quant à la compétence universelle dont il partage entièrement les conclusions. Il considère exacte l’opinion de la chambre selon laquelle aucun des 26 États parties pris en compte dans l’étude menée par la Cour ne reconnaît une compétence universelle devant les juridictions civiles pour actes de torture (arrêt de chambre, paragraphe 49).
158. Il soutient également que l’article 14 de la Convention contre la torture n’oblige pas les États parties à établir une compétence universelle. Il partage l’opinion de la chambre selon laquelle le texte de cette disposition n’est pas clair à ce propos et que les travaux préparatoires ne sont pas non plus susceptibles d’éclairer cette question (arrêt de chambre, paragraphe 117).
159. Le Royaume-Uni estime également que l’arrêt de chambre reflète correctement les conclusions découlant de l’affaire Jones v. Saudi Arabia ([2006]) UKHL 26, dans laquelle la Chambre des Lords a jugé que l’article 14 de la Convention contre la torture n’établissait pas une compétence universelle en matière civile qui aurait pu constituer une exception aux immunités de l’État (arrêt de chambre, paragraphe 51).
160. Le tiers intervenant soutient enfin que la bonne administration de la justice et l’effectivité des décisions judiciaires doivent guider les États dans leurs décisions d’établir ou non une compétence universelle. Il ajoute encore que l’argument du requérant selon lequel la rareté des affaires auxquelles sont confrontées les juridictions nationales dans ce domaine ne change rien aux problèmes pratiques causés par des cas comme celui du requérant.
β) Amnesty International et la Commission internationale des juristes
161. Amnesty International et la Commission internationale des juristes soutiennent que l’article 14 de la Convention contre la torture, interprété tout d’abord à la lumière de son libellé, ne prévoit pas de limitation de son champ d’application géographique. Une telle approche serait par ailleurs confirmée par le Comité contre la torture dans son Observation générale no 3, évoquée ci-dessus, ainsi que par le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez, selon lequel « l’article 14 n’est pas géographiquement limité et s’applique où que les actes de torture soient commis. » (Rapport intermédiaire, 7 août 2015, UN Doc. A/70/303, § 56).
162. Les tiers intervenants voient une telle approche corroborée par la pratique des États. Ils notent que, parmi les 160 États parties à la Convention contre la torture, seuls les États-Unis auraient formulé une réserve relative au champ d’application géographique de l’article 14.
163. Les tiers intervenants soutiennent en outre que les travaux préparatoires à l’article 14 de la Convention contre la torture militent en faveur d’une compétence universelle. En effet, ils indiquent qu’une proposition des Pays-Bas visant à inclure les mots « committed in any territory under its jurisdiction » après le mot « torture » fut rejetée. Ils en concluent que les États qui ont négocié la Convention avaient l’intention de ne pas limiter géographiquement la portée de l’article 14.
164. Les tiers intervenants soutiennent ensuite que, selon une étude préliminaire d’Amnesty International concernant la compétence universelle de 2012, pas moins de 147 sur les 193 États membres des Nations unies auraient établi une compétence universelle pour un ou plusieurs crimes internationaux, soit pour génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, torture, disparition forcée ou exécution extrajudiciaire (Universal Jurisdiction: a Preliminary Survey of Legislation around the World – 2012 Update (IOR 53/019/2012)).
165. Les tiers intervenants se réfèrent enfin au mémoire d’amicus curiae de la Commission européenne soumise à la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Kiobel c. Royal Dutch Petroleum Co. en date du 13 juin 2012. Dans celui-ci, la Commission a considéré ce qui suit (références omises) :
« Cette application de la loi sur la responsabilité délictuelle pour les étrangers (Alien Tort Statute – ATS) s’accorde avec la reconnaissance croissante, au sein de la communauté internationale, du fait qu’un recours effectif pour les crimes odieux commis en violation des droits de l’homme les plus fondamentaux comporte, et cela en est un élément essentiel, la possibilité d’accorder aux victimes une indemnisation au civil (...) Ce principe s’applique incontestablement aux États, y compris ceux appartenant à l’Union européenne, qui permettent actuellement aux victimes de crimes de demander une indemnisation en se portant partie civile dans des procédures pénales sur le fondement de la juridiction universelle. De même, en dehors de l’Union européenne, de nombreux États dans le monde permettent de demander une indemnisation au civil dans le cadre de procédures pénales à raison de délits commis à l’étranger. »
γ) « Redress Trust » et l’OMCT
166. « Redress Trust » et l’OMCT relèvent que certains États parties à la Convention reconnaissent le for de nécessité. Ils soulignent que cette reconnaissance croissante se reflète également dans les Lignes directrices de Sofia sur les meilleures pratiques en matière d’actions civiles pour violation des droits de l’homme adoptées par l’ADI en août 2012, mentionnée ci‑dessus (paragraphe 66).
167. Les tiers intervenants font valoir que la compétence universelle est un principe ancré dans le droit international, basé sur le consensus international selon lequel certains crimes, dont la torture, constituent des crimes de droit international dont les auteurs doivent être tenus pour responsables, quelles que soient le lieu du crime et la nationalité de son auteur. Ils ajoutent que le droit international reconnaît également le droit pour les victimes de graves violations des droits de l’homme à un recours effectif et à une réparation.
168. Les tiers intervenants relèvent que de nombreux États parties à la Convention permettent aux victimes de graves crimes internationaux de demander une compensation financière par voie d’action civile dans le cadre de procédures pénales basées sur la compétence universelle, et qu’au moins dix de ces États avaient conduits des procédures pénales sur une telle base.
169. Les tiers intervenants concluent que les affaires dans lesquelles les États parties à la Convention ont ordonné des réparations sur la base de la compétence universelle pour les victimes de torture et d’autres graves crimes internationaux ont non seulement illustré une tendance à reconnaître les droits des victimes sur la base de la compétence universelle, mais également montré que, nonobstant les difficultés pratiques, de telles procédures étaient réalisables et qu’elles constituaient souvent l’unique moyen disponible pour les victimes pour accéder à la justice.
δ) Citizens’ Watch
170. Citizens’ Watch rappelle que la Convention doit être lue comme un tout. Dès lors, ce tiers intervenant estime que le grief invoqué par le requérant, à savoir le droit d’accès effectif à un tribunal, est intrinsèquement lié à l’interdiction de la torture en vertu de l’article 3 de la Convention. En d’autres termes, l’interdiction de la torture qui « se trouve au cœur même de la Convention » (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 158, CEDH 2016), doit guider la Cour dans l’interprétation de la présente affaire portant sur l’article 6 de la Convention.
171. Citizens’ Watch rappelle également que l’article 3 impose aux États parties à la Convention l’obligation procédurale de mener une enquête effective face à des allégations crédibles de mauvais traitements au sens de cette disposition. Même si l’article 3 est normalement interprété comme exigeant des investigations de nature pénale, rien n’empêche de prendre en compte d’autres types de procédure, de nature civile ou disciplinaire dirigées contre les auteurs présumés de la torture.
172. Quant à d’autres sources du droit international, Citizens’ Watch n’estime pas que l’article 14 de la Convention contre la torture exige des États parties d’établir une compétence universelle en matière civile. Par contre, il estime que les victimes de torture devraient avoir accès à un tribunal s’il existe un lien tangible avec l’État du for saisi, comme la résidence ou la présence des parties à la procédure ou encore la présence des biens de la partie défenderesse potentielle.
iv L’appréciation de la Cour
173. S’agissant de la proportionnalité de la limitation au droit d’accès du requérant à un tribunal, la Cour rappelle que l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation dans la réglementation de ce droit (paragraphe 114 ci‑dessus). Dans des cas comme celui qui se présente en l’espèce, l’étendue de cette marge dépend notamment du droit international pertinent en la matière. Il convient donc d’examiner celui-ci avant de se pencher sur l’application de l’article 3 LDIP en l’espèce.
174. À cet égard, la Cour rappelle que les dispositions de la Convention ne peuvent s’interpréter et s’appliquer en dehors du contexte général dans lequel elles s’inscrivent. En dépit de son caractère particulier d’instrument de protection des droits de l’homme, la Convention est un traité international à interpréter conformément aux normes et principes du droit international public, et notamment à la lumière de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Ainsi, la Cour n’a jamais considéré les dispositions de la Convention comme le seul cadre de référence pour l’interprétation des droits et libertés qu’elle contient. Au contraire, en vertu de l’article 31 § 3 c) de ladite Convention, l’interprétation d’un traité doit se faire en tenant compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties », en particulier de celles relatives à la protection internationale des droits de l’homme (voir, par exemple, Golder, précité, § 29, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 131, CEDH 2010, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 169, CEDH 2012, et Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 138, CEDH 2016).
175. Par ailleurs, dans des affaires qui touchent à des sujets qui sont en constante évolution dans les États membres du Conseil de l’Europe, la Cour peut se pencher sur la situation qui prévaut dans d’autres pays membres relativement aux questions soulevées en l’espèce pour évaluer s’il existe un « consensus européen » ou au moins une certaine tendance parmi les États membres (voir, mutatis mutandis, Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 122, CEDH 2011 ; Hämäläinen c. Finlande [GC], no 37359/09, §§ 72-75, CEDH 2014, et Magyar Helsinki Bizottság, précité, § 138).
α) Sur le droit international pertinent et la marge d’appréciation qui en résulte en l’espèce
176. Avec la chambre, la Cour discerne deux notions de droit international pertinentes pour le cas d’espèce : le for de nécessité et la compétence universelle. Bien que le requérant ait contesté devant la Grande Chambre qu’il invoque la compétence universelle, la Grande Chambre considère qu’en substance, son argumentaire s’en rapproche fortement. Avant toutefois d’examiner les effets de ces deux notions en l’espèce, il convient de les distinguer.
177. La « compétence » est le pouvoir d’un organe ou d’une institution de trancher une question de droit se posant dans un cas particulier, sous la forme d’un différend ou d’un litige. En droit international privé, le caractère universel de la compétence vise l’absence de lien exigé entre la juridiction saisie et la « cause » ou la situation litigieuse.
178. La Cour estime que, contrairement au domaine civil, la compétence universelle est assez largement acceptée par les États dans le domaine pénal, ce qui est reflété dans le fait que l’article 5 § 2 de la Convention contre la torture prévoit clairement une compétence universelle en matière pénale, contrairement à son article 14, qui s’avère plus ambigu quant à sa portée géographique (paragraphes 45 et suivants ci-dessus).
179. Dans la forme absolue du concept, la compétence universelle ne dépend d’aucun facteur de rattachement ratione personae déterminant les personnes sujettes à la juridiction exerçant une telle compétence (Rapport d’Andreas Bucher, précité, § 181). Elle ne dépend pas non plus d’un facteur de rattachement ratione loci exigeant que cette compétence ne s’exerce qu’en présence de certains liens – géographiques ou autrement liés à l’espace – avec la juridiction saisie dans le cas particulier (ibidem).
180. Sur ce dernier élément précisément, à savoir l’absence d’un lien avec la juridiction saisie, la compétence universelle, dans sa forme absolue, se distingue du for de nécessité. En effet, le « for de nécessité » désigne la compétence exceptionnelle (ou résiduelle) des juridictions civiles d’un État qui ne seraient normalement pas compétentes pour connaître du litige selon les règles générales ou spéciales de compétence prévues par le droit de cet État, lorsqu’une procédure à l’étranger se révèlerait impossible ou excessivement et déraisonnablement difficile en droit ou en fait.
181. Compte tenu de ce qui précède, la Cour examinera à présent si les autorités suisses étaient juridiquement tenues d’ouvrir leur for au requérant, en vertu soit d’une compétence universelle civile pour torture, soit du for de nécessité. Les conclusions tirées serviront à déterminer l’étendue de la marge d’appréciation dont jouissaient en l’espèce lesdites autorités.
- Sur l’existence d’une obligation pour les autorités suisses d’ouvrir leur for au requérant au titre d’une compétence universelle civile pour actes de torture
182. La Cour rappelle que l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice énumère les sources formelles du droit international. S’agissant de la présente affaire, elle estime approprié de rechercher si la Suisse était tenue de reconnaître une compétence universelle civile pour actes de torture en vertu d’une coutume internationale ou du droit conventionnel. Il convient d’examiner successivement ces deux éventualités.
183. S’agissant d’une éventuelle coutume internationale, il découle de l’étude de droit comparé entreprise par la Cour que, parmi les 39 États européens examinés, seuls les Pays-Bas reconnaissent la compétence universelle en matière civile pour des actes de torture, laquelle toutefois a été consacrée par une jurisprudence postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral dans la présente affaire, rendu le 22 mai 2007 (voir les affaires El‑Hojouj c. Amer Derbas et autres et Akpan de 2012 et 2013, respectivement (paragraphe 69 ci-dessus)). Par ailleurs, au moins dans l’affaire Akpan, il existait un lien de rattachement solide avec les Pays-Bas, dans la mesure où l’entité poursuivie devant les tribunaux néerlandais était une filiale d’une société relevant de cet État. On ne saurait dès lors parler d’une compétence universelle au sens absolu s’agissant de cette affaire-là.
184. En dehors de l’Europe, une compétence universelle en matière civile pour torture n’est reconnue qu’aux États-Unis en vertu de deux lois fédérales, ainsi qu’au Canada, dans ce dernier cas à la condition notamment que le demandeur prouve que la torture a eu lieu dans le cadre d’un acte terroriste (paragraphe 73 ci-dessus).
185. Par ailleurs, selon les informations dont dispose la Cour, plusieurs États membres du Conseil de l’Europe prévoient la compétence universelle de leurs tribunaux en matière pénale et permettent dans ce cas à un demandeur de se constituer partie civile dans une procédure engagée devant une juridiction pénale (paragraphes 79-83 ci-dessus). La Cour observe que la possibilité de joindre une demande de réparation à une procédure pénale en cours pose moins de difficultés pratiques, étant donné que cette demande peut s’appuyer sur les avantages de la poursuite pénale, comme le déclenchement et la poursuite d’office de la procédure par l’organe de poursuite pénale compétent, ou l’établissement et l’appréciation centralisés des faits et preuves dans le cadre de l’enquête menée par cet organe. Il est dès lors naturel et légitime pour les États d’accepter plus facilement une telle procédure de constitution de partie civile, sans pour autant reconnaître une compétence universelle dans le cadre d’une procédure civile autonome. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’en l’espèce, le requérant a déposé en 2001 une plainte pénale avec constitution de partie civile mais que la plainte a été classée puisque A.K., le responsable présumé des actes de torture, avait quitté le territoire suisse.
186. La Cour observe par ailleurs que les États cités dans le mémoire d’amicus curiae de la Commission européenne dans l’affaire Kiobel précitée (paragraphe 165 ci-dessus), évoqué par Amnesty International et la Commission internationale des juristes, admettent la compétence universelle à la condition que les actions civiles s’intègrent dans le cadre d’une procédure pénale (« within criminal proceedings »). Or, en l’espèce, le requérant a introduit son action civile en dommages-intérêts, en 2004, indépendamment d’une procédure pénale. Par ailleurs, l’étude préliminaire d’Amnesty International sur la compétence universelle dans le monde, publiée en 2012, concerne plutôt la compétence universelle au sens pénal du terme et non au sens civil, cette dernière étant seule en jeu dans la présente affaire (paragraphe 164 ci-dessus).
187. Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que les États qui reconnaissent une compétence universelle en matière civile opérant de manière autonome pour des actes de torture constituent à l’heure actuelle l’exception. Malgré le fait que la pratique des États évolue, sa densité à ce jour n’est pas suffisante pour pouvoir y déceler l’émergence, voire la consolidation d’une coutume internationale qui aurait obligé les juridictions suisses à se déclarer compétentes pour connaître de l’action du requérant.
188. S’agissant du droit international conventionnel, en son état actuel il ne consacre pas non plus, de l’avis de la Cour, une compétence universelle civile pour des actes de torture qui obligerait les États à créer, en l’absence d’un autre lien avec le for, des recours civils au titre d’actes de torture perpétrés en dehors du territoire étatique par des agents d’un État étranger.
189. Certes, le Comité contre la torture a plaidé, notamment dans son Observation générale no 3 (2012), en faveur d’une interprétation large de l’article 14 de la Convention des Nations unies contre la torture, lequel prévoit que tout État partie garantisse, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate (paragraphes 52-53 ci‑dessus). Il a encouragé les États à offrir un tel recours aussi dans les cas où les actes de torture ont été perpétrés en dehors du territoire de l’État, y compris, semble-t-il, par des agents d’un État étranger (ibidem).
190. La Cour observe toutefois que le Comité contre la torture semble plus réservé sur la question à l’occasion de l’examen de communications individuelles (voir notamment les affaires pertinentes relevées ci-dessus, paragraphes 54-55). En tout état de cause, à la connaissance de la Cour, le Comité n’a jamais conclu à une violation de la Convention contre la torture par un État partie pour ne pas avoir reconnu une compétence universelle civile dans son ordre juridique interne. Le requérant, en tout cas, ne prétend pas le contraire.
191. Quant aux autres arguments avancés par Amnesty International et la Commission internationale des juristes et tirés de l’article 14 de la Convention contre la torture (paragraphes 161-164 ci-dessus), la Cour n’y souscrit pas pour les raisons suivantes. S’agissant tout d’abord du texte de cette disposition, force est de constater que l’article 14, qui consacre de manière générale le droit pour les victimes de torture d’obtenir réparation, est muet concernant la manière de mettre en œuvre effectivement ce droit ou l’étendue géographique de l’obligation des États parties à cette fin. On ne saurait dès lors prétendre que le texte de l’article 14 constitue, en soi, un argument en faveur d’une compétence universelle en matière civile. C’était par ailleurs déjà l’avis de la chambre (paragraphe 117 de l’arrêt de chambre).
192. S’agissant des travaux préparatoires, la Cour rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article 32 de la Convention de Vienne, ils constituent seulement un moyen « complémentaire » d’interprétation des traités. Il convient dès lors de les prendre en compte à titre subsidiaire et avec une certaine prudence dans l’interprétation des termes d’un traité (voir, dans ce sens, la prudence exprimée par la CIJ dans l’affaire Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, compétence et recevabilité (arrêt, Recueil CIJ 1995, paragraphe 41)).[3] Par ailleurs, la Cour rappelle que la chambre a conclu qu’aucun élément concret ne peut être tiré des travaux préparatoires à la Convention contre la torture quant à la portée géographique de l’article 14 (paragraphe 117 de l’arrêt). Ayant fait ses propres vérifications, la Grande Chambre partage ce point de vue. Certes, la proposition des Pays-Bas d’inclure les mots « committed in any territory under its jurisdiction » a disparu lors de l’adoption de la Convention. Toutefois, les raisons de cette omission restent inconnues (Manfred Nowak/Elizabeth McArthur, op.cit., paragraphe 49 ci-dessus). Dans ces conditions, il est difficile d’y attacher une importance déterminante. On ne saurait dès lors déduire des travaux préparatoires l’intention des auteurs de la Convention contre la torture d’admettre une compétence universelle dans le cadre de l’article 14.
193. Dans ce contexte, Amnesty International et la Commission internationale des juristes ont également fait valoir que l’absence de réserves formulées à l’égard de l’article 14, à l’exception d’une réserve des États-Unis, serait un indice révélant l’accord des États parties en vue d’admettre une compétence universelle civile. La Cour ne partage pas non plus ce point de vue. Il ne saurait être exclu, en effet, que face à un texte qui n’évoque pas cette hypothèse et des travaux préparatoires presque muets à cet égard, les États n’ont tout simplement pas pensé à l’hypothèse d’une compétence universelle et, dès lors, ne se sentaient pas obligés d’émettre des réserves à l’égard de l’article 14 afin d’exclure une telle compétence.
194. Il est vrai que certains textes non juridiquement contraignants, préconisant que les États garantissent aux victimes de torture un accès effectif à la justice afin d’obtenir une réparation adéquate, ont récemment été adoptés. Selon ces textes, si l’État dans lequel un acte de torture a eu lieu n’offre pas de recours à la victime, les tribunaux des États tiers sont encouragés à se déclarer compétents afin d’éviter un déni de justice, par exemple en acceptant une compétence universelle.
195. Parmi ces textes figure, notamment la résolution de l’IDI adoptée à Tallinn le 30 août 2015 (paragraphe 62 ci-dessus). La Cour note cependant que, tandis que le « droit à une réparation appropriée et effective » des victimes de crimes internationaux et leur « droit à un accès effectif à la justice afin de demander réparation » sont fermement exprimés à l’article 1 §§ 1 et 2 de la résolution, le libellé de celle-ci apparaît plus hésitant concernant l’existence d’une obligation générale à la charge des tribunaux étatiques d’exercer leur compétence pour connaître des demandes en réparation des victimes en l’absence de liens plus étroits entre le litige et un autre État. En effet, la rédaction de l’article 2 § 1 a) au conditionnel semble suggérer qu’il relève de la lex ferenda plutôt que du droit positif.
196. De plus, dans son rapport relatif à cette résolution, le rapporteur de l’IDI soutient que l’article 14 de la Convention contre la torture n’impose pas une compétence universelle civile dans le domaine des crimes internationaux (paragraphes 65 et 66 du rapport, cités au paragraphe 63 ci‑dessus). En outre, la doctrine ne paraît pas unanime sur le point de savoir si l’article 14 de la Convention contre la torture doit faire l’objet d’une application extraterritoriale, même lorsque l’acte de torture a été perpétré par des agents d’un État étranger (paragraphes 56-58 ci-dessus).
197. Enfin, dans la mesure où le requérant, en tant que réfugié reconnu en Suisse, invoque l’article 16 de la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés (paragraphe 60 ci-dessus), la Cour relève que le requérant s’est contenté, devant le Tribunal fédéral, de se référer de manière très générale à cette disposition, sans expliquer pour quelle raison et à quel titre elle aurait pu être pertinente pour le grief qui fait l’objet de la présente requête. Or, la Cour observe que le texte de cette disposition évoque en des termes généraux le droit des réfugiés d’accéder à un tribunal, mais ne garantit pas en tant que tel le droit de poursuivre un État étranger ou l’un de ses agents pour des actes de tortures commis à l’étranger. Par conséquent, même à supposer que le requérant ait dûment invoqué ce grief devant les juridictions internes, il ne saurait en tirer un argument supplémentaire à l’appui de sa requête.
198. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le droit international n’obligeait pas les autorités suisses à ouvrir leur for au requérant au titre d’une compétence universelle civile pour actes de torture.
- Sur l’existence d’une obligation pour les autorités suisses d’ouvrir leur for au requérant au titre du for de nécessité
199. La Cour observe que tant devant la chambre que devant la Grande Chambre, le requérant fonde son grief principalement sur le for de nécessité au sens de l’article 3 LDIP et dénonce l’interprétation, jugée trop restrictive, de cette disposition par le Tribunal fédéral dans l’arrêt qui fait l’objet de la présente requête. A ce stade, la Cour doit donc rechercher si le droit international faisait peser sur les autorités suisses une obligation de mettre à disposition du requérant un for de nécessité, afin d’examiner la demande en réparation du préjudice qu’il disait avoir subi par l’effet de violations des droits de l’homme. Seront examinés successivement le droit comparé, en vue de discerner l’existence éventuelle d’une coutume internationale, puis le droit international conventionnel.
200. Il ressort tout d’abord de l’analyse menée par la Grande Chambre que parmi les 40 États étudiés, y compris la Suisse, 28 États européens ne reconnaissent pas le for de nécessité. Celui-ci n’existe que dans 12 États étudiés, y compris la Suisse (paragraphe 84 ci‑dessus). En outre, il existe depuis peu et sous de strictes conditions au Canada. En revanche, les États de tradition anglo-américaine ne le reconnaissent pas. Au contraire, ils appliquent le concept de forum non conveniens qui permet à un tribunal de refuser d’examiner une affaire si un tribunal d’un autre État présente un lien de rattachement plus approprié (paragraphe 90 ci-dessus).
201. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le for de nécessité n’est pas généralement accepté par les États, l’on ne saurait conclure à l’existence d’une coutume internationale consacrant la notion de for de nécessité.
202. La Cour constate par ailleurs qu’une obligation de droit international conventionnel obligeant les États à prévoir un for de nécessité fait également défaut.
- Sur l’étendue de la marge d’appréciation en l’espèce
203. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que le droit international ne faisait pas peser d’obligation sur les autorités suisses d’ouvrir leur for en vue de faire statuer sur le fond de la demande de réparation du requérant, ni au titre d’une compétence universelle civile pour actes de torture, ni au titre du for de nécessité. Il en résulte que les autorités suisses jouissaient d’une large marge d’appréciation en la matière.
204. Dès lors, il y a lieu de rechercher à présent si cette marge d’appréciation a été dépassée dans le cas d’espèce.
β) Sur le point de savoir si les autorités suisses ont dépassé leur marge d’appréciation en l’espèce
205. Afin de déterminer si les autorités suisses ont dépassé leur marge d’appréciation en l’espèce, la Cour doit examiner successivement l’article 3 LDIP et les décisions rendues par les juridictions suisses en l’espèce, en particulier l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2007.
206. S’agissant de l’article 3 LDIP, la Cour relève tout d’abord que le simple fait d’introduire un for de nécessité, appelé par nature à élargir la compétence des juridictions nationales plutôt qu’à la réduire, ne saurait, à l’évidence, s’analyser en un dépassement par le législateur de sa marge d’appréciation.
207. Quant aux conditions fixées par le législateur suisse à la mise en œuvre de l’article 3 LDIP dans un cas donné, l’étude de droit comparé mentionnée plus haut révèle que dans tous les États qui connaissent le for de nécessité, celui-ci n’est appliqué qu’exceptionnellement et sous deux conditions cumulatives, à savoir l’absence d’un autre for compétent et l’existence d’un lien suffisant entre les faits en cause et l’État qui se déclare compétent (paragraphes 88-89 ci-dessus). Ces deux mêmes conditions se retrouvent également dans le droit de l’Union européenne mentionné ci‑dessus (paragraphes 91-93). S’agissant du lien de rattachement, les textes pertinents n’en définissent pas les critères, laissant cette tâche aux juridictions nationales, En cela donc, l’article 3 LDIP correspond entièrement aux conceptions prévalant en la matière.
208. La Cour en conclut qu’en instituant un for de nécessité aux conditions fixées à l’article 3 LDIP, le législateur suisse n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation.
209. S’agissant à présent de la marge d’appréciation des juridictions nationales, la Cour rappelle que dans les États qui reconnaissent le for de nécessité les tribunaux bénéficient d’une large marge pour définir les liens de rattachement appropriés et les appliquer au cas par cas. Pour ce faire les tribunaux nationaux tiennent compte le plus souvent tantôt de la nature du litige, tantôt de l’identité des parties (paragraphe 89 ci-dessus). C’est en partant de ces éléments que la Cour examinera la question de savoir si le Tribunal fédéral a outrepassé sa marge d’appréciation en l’occurrence en interprétant l’article 3 LDIP.
210. À cet égard, il y a lieu de rappeler tout d’abord que c’est aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu’il appartient d’interpréter et d’appliquer le droit interne (paragraphe 116 ci-dessus).
211. Le requérant critique principalement le fait que le Tribunal fédéral a estimé devoir se placer à l’époque des faits allégués, soit en 1992, pour apprécier sa compétence. C’est à tort que le Tribunal fédéral n’aurait pas tenu compte des liens qu’il a noués ultérieurement avec la Suisse.
212. Sur ce point, la Cour relève que selon le Tribunal fédéral, le terme « cause » doit être compris dans l’acception restreinte de « complexe de faits ». Autrement dit, ce sont les faits allégués – et non la personne du demandeur – qui doivent présenter un lien suffisant avec la Suisse (arrêt du 22 mai 2007, consid. 3.5, paragraphe 30 ci-dessus). A propos de la cause et de l’application de l’article 3 LDIP, le Gouvernement fait d’ailleurs valoir que l’opportunité d’ouvrir un for de nécessité général, accessible également aux personnes étrangères sans lien avec la Suisse, a été discutée lors des travaux préparatoires de cet article mais n’a pas été retenue.
213. Selon le Gouvernement, la question de savoir quels éléments font partie d’une « cause » comporte également un aspect temporel (paragraphe 154 ci-dessus). Lorsqu’une action porte sur un complexe de faits qui s’est terminé avant qu’elle ne soit introduite, les éléments de la cause doivent être examinés tels qu’ils se présentaient durant la période des faits, antérieure à la procédure. Par conséquent, quand un aspect de la cause est modifié après que le complexe de faits déterminant s’est terminé, cette modification ne fait pas partie de la « cause » et ne peut dès lors plus créer un lien justifiant un for de nécessité.
214. Tenant compte de la large marge d’appréciation reconnue aux juridictions nationales en la matière et au vu de la pratique pertinente des tribunaux suisses, exposée ci‑dessus (paragraphes 40-44 ci-dessus), la Cour ne discerne pas d’éléments manifestement déraisonnables ou arbitraires dans l’interprétation faite par le Tribunal fédéral de l’article 3 LDIP en l’espèce. Même si certaines décisions juridictionnelles semblent retenir l’introduction de l’action comme moment déterminant pour l’application de l’article 3 LDIP, elles ne permettent pas, de l’avis de la Cour, d’en tirer des enseignements concluants. En effet, la jurisprudence des tribunaux suisses sur la question est peu abondante et concerne des cas très variés, notamment des situations continues non comparables avec le cas du requérant.
215. Enfin, dans la mesure où le requérant invoque l’arrêt Arlewin c. Suède (précité) à l’appui de sa thèse selon laquelle le refus de donner suite à son action était disproportionné (paragraphe 142 ci‑dessus), la Cour estime que cet arrêt n’est pas pertinent en l’espèce. Elle observe, à cet égard, que l’action du requérant dans l’affaire Arlewin présentait plusieurs liens de rattachement évidents et solides avec la Suède. En effet, il s’agissait d’une plainte en diffamation dans le cadre d’une émission de télévision dont le contenu concernait exclusivement la Suède et qui portait atteinte à la réputation de ressortissants suédois vivant en Suède. La question d’un éventuel for de nécessité ne se posait donc pas. Dès lors, la Cour estime que le requérant, dont l’action en responsabilité ne présentait, au moment des faits pertinents, aucun lien avec la Suisse, ne saurait utilement se prévaloir de cette affaire.
216. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne discerne aucun élément manifestement déraisonnable ou arbitraire (paragraphe 116 ci-dessus) dans l’interprétation par le Tribunal fédéral de l’article 3 LDIP. Par ailleurs, elle ne relève pas d’éléments donnant à penser que le Tribunal fédéral aurait outrepassé sa marge d’appréciation d’une autre manière. Dès lors, les limitations au droit d’accès du requérant à un tribunal n’étaient pas disproportionnées par rapport aux buts légitimes poursuivis.
γ) Conclusion générale
217. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le rejet par les tribunaux suisses, par application de l’article 3 LDIP, de leur compétence pour connaître de l’action du requérant en vue d’obtenir réparation des actes de torture qu’il allègue avoir subis a poursuivi des buts légitimes et n’était pas disproportionné par rapport à ceux-ci. Dès lors, il n’y a pas eu violation du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention.
218. Cela étant, il y a lieu de réitérer que cette conclusion ne met pas en cause le large consensus dans la communauté internationale sur l’existence d’un droit des victimes d’actes de torture à une réparation appropriée et effective, ni le fait que les États sont encouragés à donner effet à ce droit en dotant leurs juridictions de la compétence pour connaître de telles demandes de réparation, y compris quand elles résultent de faits commis en dehors de leurs frontières géographiques. A ce titre, il convient de saluer les efforts des États tendant à rendre le plus effectif possible l’accès à un tribunal en vue d’obtenir réparation pour des actes de torture.
219. Toutefois, il n’apparaît pas déraisonnable pour un État qui instaure un for de nécessité de lier son exercice à l’existence de certains facteurs de rattachement avec cet État, qu’il appartient à celui-ci de déterminer dans le respect du droit international et sans excéder la marge d’appréciation qui lui est reconnue au titre de la Convention.
220. Pour autant, la Cour n’exclut pas, s’agissant d’un domaine dynamique, qu’il puisse connaître des développements à l’avenir. Dès lors, et bien qu’elle conclue à la non-violation de l’article 6 § 1 en l’espèce, la Cour invite les États parties à la Convention à tenir compte dans leur ordre juridique de toute évolution favorisant la mise en œuvre effective du droit à réparation pour des actes de torture, tout en examinant avec vigilance toute requête de cette nature afin d’y déceler, le cas échéant, les éléments qui feraient obligation à leurs juridictions de se déclarer compétentes pour l’examiner.
Grande Chambre KÁROLY NAGY c. HONGRIE du 14 septembre 2017
Article 6-1 : Le pasteur révoqué de l’Église réformée de Hongrie ne disposait pas d’un droit défendable en droit interne, son service pastoral relevant du droit ecclésiastique et non du droit civil
1. Les principes généraux
60. La Cour a dit à maintes reprises que pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait contestation sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 71, 29 novembre 2016, Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 100, 23 juin 2016, et Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 42, CEDH 2015).
61. L’article 6 § 1 n’assure aux « droits et obligations » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants : la Cour ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné (voir, par exemple, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 119, CEDH 2005‑X, et Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, § 91, CEDH 2012). En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence bien établie de la Cour, il convient de maintenir la distinction entre ce qui est d’ordre procédural et ce qui est d’ordre matériel : aussi subtile qu’elle puisse être dans une réglementation nationale donnée, il n’en reste pas moins que cette distinction détermine l’applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l’article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s’appliquer aux limitations matérielles d’un droit consacré par la législation interne (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, précité, § 100).
62. Pour décider si le « droit » invoqué possède vraiment une base en droit interne, il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes (voir, récemment, Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], no 5809/08, § 97, 21 juin 2016). La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Dès lors, sauf dans les cas d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions (Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, §§ 49-50, 20 octobre 2011). Ainsi, lorsque les juridictions nationales supérieures ont analysé de façon complète et convaincante la nature précise de la restriction litigieuse [en l’espèce la restriction du droit d’accès à un tribunal], et ce en s’appuyant sur la jurisprudence pertinente issue de la Convention et sur les principes qui en découlent, la Cour doit avoir des motifs très sérieux pour prendre le contre-pied de ces juridictions en substituant aux leurs ses propres vues sur une question d’interprétation du droit interne et en jugeant, contrairement à elles, que la personne concernée pouvait prétendre de manière défendable posséder un droit reconnu par la législation interne (Roche, précité, § 120).
63. Enfin, c’est le droit tel qu’il a été invoqué par le requérant dans la procédure interne qu’il faut prendre en compte pour apprécier l’applicabilité de l’article 6 § 1 (Stichting Mothers of Srebrenica et autres c. Pays-Bas (déc.), no 65542/12, § 120, CEDH 2013 (extraits)). Lorsqu’il y avait, au sujet de l’existence de ce droit, une contestation réelle et sérieuse, le fait que les juridictions internes aient conclu que ce droit n’existait pas n’ôte pas rétroactivement au grief du requérant son caractère défendable (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 89, CEDH 2001‑V).
2. Application de ces principes au cas d’espèce
64. La Cour considère que la première question à laquelle il faut répondre en l’espèce est celle de savoir si le requérant avait un « droit » que l’on pouvait prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne.
65. Dans ce but, elle doit prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en ont fait les juridictions internes (Roche, précité, § 120).
66. Pour ce qui est du droit interne, il n’est pas contesté que, en vertu de l’article 15 § 2 de la loi de 1990 sur les Églises, les créances découlant des lois et règles internes d’une Église ne pouvaient faire l’objet d’une exécution forcée par les organes de l’État (paragraphe 28 ci‑dessus). Il n’est pas contesté non plus que, si les juridictions internes établissaient qu’un litige en cours concernait une créance de nature ecclésiastique insusceptible d’exécution forcée par les organes de l’État, elles devaient mettre fin à la procédure en vertu de l’article 130 § 1 f) du code de procédure civile (paragraphe 27 ci-dessus). La principale question qui se posait devant ces juridictions portait donc sur la nature exacte de la relation existant entre le requérant et l’Église réformée.
67. Dans son arrêt de 2003 (paragraphe 29 ci-dessus), la Cour constitutionnelle hongroise a précisé la situation des membres du clergé relativement à leur service ecclésiastique, jugeant que les créances reposant sur le droit ecclésiastique ne pouvaient faire l’objet d’une exécution par les tribunaux de l’État. Elle a expliqué que les relations entre les Églises et les membres de leur clergé pouvaient soit être régies par le droit ecclésiastique, dans l’exécution duquel les autorités publiques ne pouvaient jouer aucun rôle, soit être fondées sur le droit national. À ce dernier égard, elle a tenu le raisonnement suivant :
« En vertu du principe de séparation des Églises et de l’État interprété conjointement avec le droit d’accès à un tribunal, les juridictions de l’État sont tenues d’examiner au fond les litiges relatifs à des droits et obligations des personnes se trouvant au service d’une Église lorsque ces droits et obligations sont régis par le droit de l’État ; en pareil cas toutefois, les autorités judiciaires doivent respecter l’autonomie de l’Église. »
68. La Cour note à cet égard que le service ecclésiastique du requérant était défini par la lettre du Presbytère de la paroisse le nommant pasteur de l’Église réformée de Hongrie (paragraphe 9 ci‑dessus). Aux termes de cette lettre, le requérant devait accomplir les « [t]âches définies par les lois et dispositions juridiques ecclésiastiques, en particulier par les dispositions sur les pasteurs et le service pastoral énoncées dans la loi ecclésiastique no II de 1994 et par le code de conduite [pertinent] ». À cet égard, la Cour observe que l’article 9 de la loi ecclésiastique no II de 1994 sur la constitution et la gouvernance de l’Église réformée de Hongrie prévoyait que le droit ecclésiastique devait s’appliquer aux relations de service des pasteurs et des autres personnes accomplissant un service de nature pastorale (paragraphe 32 ci-dessus). De plus, l’article 34 de la loi ecclésiastique no I de 2000 sur la juridiction de l’Église réformée de Hongrie prévoyait que les litiges concernant, notamment, la nomination, la rémunération et la retraite des pasteurs relevaient de la compétence des tribunaux ecclésiastiques (paragraphe 33 ci-dessus).
69. Or, au lieu de porter son litige patrimonial devant les tribunaux ecclésiastiques, après avoir été révoqué de ses fonctions pastorales le requérant a d’abord engagé une procédure devant les juridictions du travail, soutenant que sa relation avec l’Église réformée était assimilable à une relation de travail (paragraphe 13 ci-dessus). Le tribunal du travail a mis fin à la procédure, jugeant que les tribunaux nationaux ne pouvaient donner force exécutoire à la créance du requérant (paragraphe 14 ci‑dessus). Le requérant ne s’est pas pourvu devant la Cour suprême mais il a porté son affaire devant les juridictions civiles, soutenant que sa relation avec l’Église réformée s’analysait en fait en un contrat d’agence au sens du code civil (paragraphes 15 à 18 ci-dessus). La chambre n’ayant déclaré recevable que cette dernière procédure, celle-ci est la seule à être soumise à l’examen de la Grande Chambre (paragraphe 43 ci‑dessus).
70. Lorsqu’elle s’est penchée sur l’affaire du requérant, la juridiction civile de première instance a conclu, en vertu des dispositions du droit interne, que la relation entre l’intéressé et l’Église défenderesse ne pouvait être assimilée à un contrat d’agence tel que défini par le code civil, car elle était dépourvue d’un certain nombre de caractéristiques importantes de ces contrats ; en particulier, les services ecclésiastiques du requérant n’avaient pas de valeur marchande (paragraphe 19 ci-dessus). Cette analyse a été confirmée par la Cour suprême. Celle-ci a considéré que la créance du requérant était de nature ecclésiastique et non civile et que, dès lors, elle était insusceptible d’exécution par les juridictions nationales. En conséquence, conformément aux dispositions du droit interne, elle a conclu qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le fond du litige, et elle a mis fin à la procédure (paragraphes 24 et 66 ci-dessus). Aucune des juridictions internes n’a accueilli l’argument du requérant selon lequel son service pastoral devait être considéré séparément de sa rémunération pastorale (paragraphe 58 ci-dessus).
71. Devant la Cour, le requérant soutient qu’au début de la procédure il avait en droit interne un droit suffisamment reconnu pour faire entrer en jeu l’article 6 de la Convention. Cette affirmation implique une appréciation, par la Cour, du contenu de la loi nationale hongroise et, le cas échéant, une appréciation différente de celui-ci que celle à laquelle se sont livrées les juridictions nationales. La Cour rappelle dans ce contexte qu’elle ne saurait procéder à un tel exercice que si les solutions adoptées par les juridictions nationales apparaissent arbitraires ou manifestement déraisonnables (paragraphe 62 ci-dessus).
72. La Cour note que dans l’affaire du requérant, après avoir examiné de manière approfondie la question de la compétence des juridictions de l’État et celle du droit d’accès à un tribunal pour les personnes accomplissant un service ecclésiastique, tous les juges nationaux – que ce soit les juges du travail, les juges civils ou ceux de la Cour suprême – ont mis fin à la procédure, estimant que les tribunaux nationaux ne pouvaient donner force exécutoire à la créance du requérant au motif que le service pastoral accompli par celui-ci et la lettre de nomination sur laquelle il se fondait relevaient du droit ecclésiastique et non de celui de l’État (paragraphes 14 et 24 ci-dessus). Elle observe également que ces conclusions sont conformes aux principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt de 2003 (paragraphes 29 et 67 ci-dessus).
73. La Cour ajoute qu’elle n’est pas convaincue par l’affirmation du requérant selon laquelle les conclusions des juridictions du fond constatant l’existence d’une relation relevant du droit ecclésiastique étaient annihilées par l’arrêt de la Cour suprême. Celle-ci a au contraire conclu qu’il existait une relation de droit ecclésiastique avant de mettre fin à la procédure devant les tribunaux internes (paragraphe 70 ci-dessus). L’argument tiré du droit fiscal ne convainc pas davantage, l’autonomie du droit fiscal permettant à des autorités nationales de soumettre à la loi fiscale des revenus qui ne procèdent pas de relations de droit privé national. Enfin, le fait que l’Église réformée n’ait pas invoqué l’exclusivité de sa compétence ne saurait emporter la conviction de la Cour, étant donné qu’il appartient aux tribunaux internes, et non aux autorités ecclésiastiques, de délimiter les compétences des uns et des autres.
74. La Cour estime par ailleurs établi que l’article 15 § 2 de la loi de 1990 sur les Églises était limité aux questions relevant des « lois et règles internes des Églises » (paragraphe 28 ci-dessus) et ne conférait pas aux Églises ou à leurs représentants une immunité illimitée contre toute action civile quelle qu’elle soit. Au contraire, comme le démontre l’exemple de la résolution de principe de la Cour suprême (invoquée par le Gouvernement, voir le paragraphe 30 ci-dessus), d’autres actions, visant par exemple la protection des droits de la personnalité, pouvaient être introduites contre des membres d’une Église dès lors qu’elles ne concernaient pas les « lois et règles internes des Églises » au sens de l’article 15 § 2 de la loi de 1990 sur les Églises.
75. Or l’action du requérant ne portait pas sur un tel droit protégé par la loi mais concernait l’affirmation qu’une créance patrimoniale découlant de son service ecclésiastique, régi par le droit ecclésiastique, devait en réalité être considérée comme relevant du droit civil. Après avoir soigneusement examiné la nature de cette créance, les juridictions internes, pour autant qu’elles statuaient sur le fond de l’affaire, ont conclu à l’unanimité que tel n’était pas le cas conformément aux dispositions du droit interne.
76. Compte tenu du cadre juridique et jurisprudentiel global en place en Hongrie lorsque le requérant a introduit son action civile, la conclusion des juridictions internes selon laquelle le service pastoral de l’intéressé relevait du droit ecclésiastique et leur décision de mettre fin à la procédure ne sauraient être considérées comme arbitraires ou manifestement déraisonnables.
77. En conséquence, eu égard à la nature du grief formulé par le requérant, à la base sur laquelle se fondait son service pastoral et au droit interne tel qu’interprété par les juridictions internes tant avant le litige du requérant que durant la procédure engagée par lui, force est pour la Cour de constater que le requérant ne possédait pas un « droit » que l’on pouvait prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Dans le cas contraire, elle créerait, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel dépourvu de base légale dans l’État défendeur.
78. Partant, la Cour conclut que l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer aux faits de la présente espèce. Dès lors, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
NOTIFICATION D'UNE DECISION PAR INTERNET
NE PORTE PAS ATTEINTE A L'ACCES AU TRIBUNAL
Stichting Landgoed Steenbergen et autres c. Pays-Bas du requête no 19732/17
Article 6 : La notification en ligne d’une décision portant sur la délivrance d’un permis à un circuit de motocross ne constitue pas une violation.
L’affaire concerne la notification en ligne d’un projet de décision et d’une décision concernant une demande de prolongation des heures d’ouverture d’une piste de motocross, qui, selon les requérants, a entravé leur accès à un tribunal, faute pour eux d’avoir eu connaissance de la décision. La Cour juge en particulier qu’il est souvent suffisant de publier de tels documents en ligne uniquement et que les requérants n’ont pas démontré en quoi ils ont été privés de la possibilité de présenter leurs arguments contre la décision.
FAITS
Les requérants, Stichting Landgoed Steenbergen, Hermine Sofia Maria van Veen, Walter Henricus Franciscus Vendel et Andreas Bottema, sont respectivement une fondation néerlandaise et trois ressortissants néerlandais. Ces trois derniers sont nés en 1963, 1962 et 1961 respectivement et vivent à Wapenveld (Pays-Bas). La fondation requérante est également enregistrée à Wapenveld. Le 27 septembre 2013, la direction d’un circuit local de motocross sollicita un permis d’étendre ses heures d’ouverture et ses activités. La province de Gelderland publia en ligne un avis d’intention de donner suite à la demande, ce qu’elle fit, n’ayant reçu aucune objection. Les requérants prirent connaissance de cette décision pour la première fois le 4 novembre 2014 et déposèrent rapidement un recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, en faisant valoir, notamment, qu’il n’était pas évident que les pièces pertinentes pour apprécier la décision avaient jamais été publiées. Le recours fut jugé tardif. La section du contentieux considéra que la publication sur Internet constituait une publication appropriée en conformité avec la loi, la Convention et la jurisprudence. La section du contentieux releva, notamment, que l’ordonnance sur la communication électronique, qui prévoit la notification par Internet, était déjà entrée en vigueur.
CEDH
La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal peut être soumis à certaines limitations, compte tenu du fait que l’accès dépend de la réglementation de l’État. La Cour admet que la communication électronique entre les autorités et les citoyens peut contribuer à l’objectif d’un service public plus accessible et plus performant. Toutefois, cela comporte le risque que certains citoyens ne soient pas pris en compte. En l’espèce, la Cour observe que le projet de permis et le permis avaient été notifiés par Internet uniquement, et que seuls avaient eu la possibilité de faire appel de la décision ceux qui avaient déjà fait part de leur point de vue. Cependant, eu égard, notamment, au taux élevé de pénétration de l’Internet aux Pays-Bas, ainsi qu’au fait que la pratique consistant à publier des notifications exclusivement en ligne était déjà en vigueur depuis un certain temps et avait fait l’objet d’une publicité dans les journaux locaux au moment de son introduction, la Cour estime que les requérants n’ont avancé aucun argument de nature à lui permettre de conclure qu’ils n’ont pas disposé d’une possibilité claire, pratique et effective de faire part de leur point de vue et d’introduire un recours. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour juge les griefs tirés de l’article 8 de la Convention irrecevables pour non-respect des conditions formelles d’exercice d’un recours interne pertinent concernant les griefs en question.
RÔLE DE LA CEDH POUR EXAMINER L'ACCES A UN TRIBUNAL
DIEUDONNÉ ET AUTRES c. FRANCE du 4 mai 2023 requête n° 59832/19 et 6 autres
Art 6 § 1 (civil) • Impossibilité pour des copropriétaires minoritaires d’un bien exproprié de faire appel du jugement fixant les indemnités d’expropriation sans atteinte au droit d’accès à un tribunal • Intérêts de la collectivité des copropriétaires représentés dans la procédure par le syndicat des copropriétaires • Autorités expropriantes devenues copropriétaires majoritaires par le jeu d’achats amiables • Possibilité pour les copropriétaires devenus minoritaires d’exercer un recours pour abus de majorité contre la décision de l’assemblée générale des copropriétaires de ne pas interjeter appel du jugement
Rappels des principes pertinents
α) Principes généraux relatifs à l’accès à un tribunal
44. Le droit d’accès à un tribunal a été défini dans l’arrêt Golder c. Royaume-Uni (21 février 1975, §§ 28-36, série A no 18) comme un aspect du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Se référant aux principes de la prééminence du droit et de l’interdiction de tout pouvoir arbitraire qui sous-tendent pour une bonne part la Convention, la Cour y a conclu que le droit d’accès à un tribunal est un élément inhérent aux garanties consacrées par l’article 6. Ainsi, l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit de faire statuer par un tribunal sur toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil (Grzęda, précité, § 342 ; voir aussi Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 76, 5 avril 2018).
45. Le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif », et non pas « théorique et illusoire ». Cette remarque vaut en particulier pour les garanties prévues par l’article 6, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Zubac, précité, § 77, et références citées). L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits. De même, le droit d’accès à un tribunal comprend non seulement le droit d’engager une action mais aussi le droit à une solution juridictionnelle du litige (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 86, 29 novembre 2016, et références citées).
46. Le droit d’accès aux tribunaux n’est toutefois pas absolu : il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac, précité, § 78, et références citées ; voir aussi Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 195, 25 juin 2019, et références citées, et Grzęda, précité, § 343).
β) Principes généraux relatifs à l’accès à une juridiction supérieure
47. L’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil (Zubac, précité, § 80, et références citées).
48. Il n’appartient toutefois pas à la Cour d’apprécier l’opportunité des choix opérés par les États contractants relativement aux restrictions à l’accès à un tribunal ; son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent. Il n’appartient pas non plus à la Cour de trancher les différends relatifs à l’interprétation du droit interne régissant l’accès à un tribunal, son rôle étant plutôt de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (ibidem, § 81, et références citées).
49. À cet égard, il convient de rappeler que la manière dont l’article 6 § 1 s’applique aux cours d’appel ou de cassation dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (ibidem, § 82, et références citées).
50. Lorsqu’elle est amenée à apprécier si la procédure devant une juridiction d’appel ou de cassation a respecté les exigences de l’article 6 § 1, la Cour tient compte de la mesure dans laquelle l’affaire avait été examinée par les juridictions inférieures, du point de savoir si la procédure devant ces juridictions soulevait des questions concernant l’équité, et du rôle de la juridiction concernée (ibidem, § 84, et références citées).
d) Application de ces principes à la présente espèce
51. La Cour constate qu’en droit français, en cas d’expropriation d’un bien relevant d’une copropriété, les intérêts de la collectivité des copropriétaires sont représentés dans la procédure d’expropriation par le syndicat des copropriétaires – qui regroupe tous les copropriétaires –, qui négocie l’indemnité d’expropriation avec l’expropriant. En cas d’échec de la négociation, c’est le syndicat des copropriétaires qui est assigné par l’expropriant à comparaître devant le juge de l’expropriation aux fins de la fixation des indemnités. Les copropriétaires expropriés n’ont pas personnellement accès à l’instance, leurs intérêts en tant que copropriétaires du bien exproprié étant représentés par le syndicat des copropriétaires. Ils ne peuvent pas non plus interjeter appel à titre individuel du jugement fixant les indemnités d’expropriation, la décision d’agir en justice appartenant au syndicat des copropriétaires.
52. Ainsi, en l’espèce, seuls l’OPAC, bénéficiaire de l’expropriation, d’un côté, et le syndicat des copropriétaires, de l’autre côté, ont participé à la procédure devant le juge de l’expropriation à l’issue de laquelle les indemnités d’expropriation ont été fixées par un jugement du 12 mai 2012. L’appel que les requérants ont ensuite interjeté de leur propre chef contre ce jugement a été déclaré irrecevable.
53. Selon la Cour, l’exclusion à titre personnel des copropriétaires des parties communes d’une copropriété immobilière de la procédure relative à l’indemnisation de l’expropriation de celles-ci n’est pas incompatible dans son principe avec leur droit d’accès à un tribunal, dès lors que leurs droits en tant que copropriétaires sont défendus dans cette procédure par un organe qui représente la collectivité des copropriétaires et dont l’objectif est le même que le leur : obtenir que l’expropriant paie la meilleure indemnisation possible au titre du bien exproprié. Les intérêts des copropriétaires se confondent alors avec ceux de la copropriété dans leur opposition à ceux de l’expropriant. Dans cette configuration, la Cour est prête à admettre que cette limitation du droit d’accès à un tribunal des copropriétaires poursuit un but légitime tenant de la bonne administration de la justice, et qu’il y a en principe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et ce but.
54. À cet égard, la présente affaire peut dans une certaine mesure être rapprochée de l’affaire Lithgow et autres c. Royaume-Uni (8 juillet 1986, §§ 196-197, série A no 102), relative notamment à l’impossibilité pour les actionnaires d’une société qui faisait objet d’une procédure de nationalisation de saisir eux-mêmes les juridictions pour déterminer leur indemnité, cette possibilité étant réservée à un représentant des actionnaires désigné par l’ensemble des porteurs de titres de la société en question, qui les représentait tous. La Cour a constaté que les intérêts de chacun d’eux se trouvaient ainsi défendus, quoiqu’indirectement. Elle a de plus relevé que la loi prévoyait la tenue d’assemblées au cours desquelles les actionnaires pouvaient donner des instructions au représentant ou lui indiquer leur opinion, et qu’elle leur accordait le pouvoir de le révoquer, et qu’un recours contre lui s’ouvrait à quiconque lui reprochait un manquement à ses obligations légales ou à celles que la common law lui imposait en qualité de mandataire. La Cour a retenu que, nonobstant l’obstacle à un accès personnel, elle n’estimait pas, dans les circonstances de la cause, qu’il y avait eu atteinte à la substance même du droit à un tribunal. Elle a de plus considéré que cette limitation au droit à un accès individuel et direct au tribunal visait un but légitime : éviter, dans le contexte d’une mesure de nationalisation de grande envergure, une profusion de demandes et d’instances introduites par tel ou tel actionnaire. Elle a ajouté qu’eu égard aux pouvoirs et devoirs du représentant et à la marge d’appréciation du Gouvernement, elle n’apercevait pas non plus un défaut de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et l’objectif ainsi poursuivi.
55. Cela étant, lorsque l’expropriant figure parmi les copropriétaires et qu’il est majoritaire, l’intérêt de la collectivité des copropriétaires, par l’expression de la majorité en son sein, peut être au contraire d’obtenir que l’indemnisation soit favorable à l’expropriant. Dans une telle configuration, les intérêts des copropriétaires mis en minorité par l’expropriant ne sont plus dûment représentés face à celui-ci.
56. C’est ce qui s’est produit en l’espèce au stade de l’appel. Les copropriétaires ont été réunis en assemblée générale pour décider s’il y avait lieu de faire appel du jugement relatif aux indemnités d’expropriation, qui fixait celles-ci à un montant très inférieur à celui que, par la voie du syndicat des copropriétaires, ils avaient demandé devant le juge de l’expropriation. Les autorités expropriantes étant devenues non seulement copropriétaires par le jeu d’achats amiables réalisés dans le cadre du projet d’aménagement urbain litigieux, mais aussi majoritaires, elles ont pu, dans leur intérêt en tant qu’expropriantes, faire obstacle à la saisine du juge d’appel en vue d’une augmentation des indemnités.
57. Les requérants, copropriétaires mis en minorité par les expropriants devenues copropriétaires, qui n’ont pas pu participer à l’instance devant le juge de l’expropriation pour défendre eux-mêmes leurs droits patrimoniaux, n’ont pu ensuite ni faire appel du jugement du 12 mai 2012 relatif aux indemnités ni faire opposition.
58. Il reste que, comme le souligne le Gouvernement, les requérants avaient la possibilité d’exercer un recours pour abus de majorité contre la décision de l’assemblée générale des copropriétaires de ne pas interjeter appel de ce jugement. Dès lors que le nœud du problème se trouve dans les modalités de l’expression de la majorité au sein de l’assemblée générale des copropriétaires lorsqu’elle a pris cette décision, cette voie était particulièrement adaptée.
59. Certes, l’exercice d’un tel recours n’aurait pas eu pour effet la suspension du délai d’appel, qui était d’un mois, si bien qu’à supposer qu’il eût abouti à une décision donnant gain de cause aux requérants, cette décision aurait vraisemblablement été prononcée après l’expiration de ce délai. Par ailleurs, elle aurait eu pour seule conséquence l’annulation de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires. Un recours pour abus de majorité n’aurait donc pas permis un examen de la contestation des requérants relative au montant des indemnités d’expropriation.
60. Le Gouvernement fait toutefois valoir qu’un tel recours aurait pu aboutir non seulement à l’annulation de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse mais aussi, le cas échéant, à l’octroi de dommages et intérêts (paragraphe 43 ci-dessus).
61. Il apparaît en effet qu’en cas de succès de cette procédure, les requérants auraient eu la possibilité d’engager ensuite une action en responsabilité civile contre l’OPAC et de demander dans ce cadre réparation du préjudice résultant selon eux du refus abusif de l’assemblée générale des copropriétaires d’interjeter appel du jugement du 12 mai 2012. Si cette action n’aurait pu conduire à une réévaluation des indemnités d’expropriation comme l’aurait permis l’appel du jugement du juge de l’expropriation, elle aurait pu du moins aboutir à la réparation de la perte, en conséquence de ce refus, de la chance d’obtenir une telle réévaluation.
62. Les requérants avaient donc accès à une procédure permettant un examen judiciaire indirect de leur contestation relative à leurs droits de caractère civil et susceptible d’aboutir à l’indemnisation au moins partielle de leur préjudice.
63. La Cour note en outre que les requérants ne soutiennent pas que, devant le juge de l’expropriation, le syndicat des copropriétaires n’a pas défendu les intérêts des copropriétaires face à ceux de l’expropriant. Il ressort du reste du dossier qu’il a fait valoir devant ce juge une évaluation des indemnités d’expropriations (1 361 115 EUR) qui, si elle ne correspondait pas au calcul des requérants (paragraphe 18 ci-dessus), était néanmoins nettement supérieure à celle que proposait l’expropriant (45 000 EUR) (paragraphe 9 ci-dessus). Elle note aussi que le juge de l’expropriation a effectivement examiné les prétentions du syndicat des copropriétaires relatives aux indemnités d’expropriation. En outre, l’appel des requérants en leur propre nom ainsi que leur tierce opposition ont été examinés d’abord par la cour d’appel et ensuite par la Cour de cassation. Toutes ces instances ont confirmé l’application rigoureuse d’une jurisprudence bien établie, en particulier sur la répartition des rôles entre les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires.
64. On ne saurait dire dans ces conditions, ni qu’il y a eu atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal dans le chef des requérants, ni que les moyens employés étaient disproportionnés par rapport au but légitime poursuivi.
65. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
ROTH c. SUISSE du 8 février 2022 Requête no 69444/17
Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Décision d’une autorité administrative de retirer l’effet suspensif du recours du père, suivi du départ à l’étranger de l’enfant avec sa mère, ayant entraîné l’incompétence des tribunaux nationaux • Transfert de la compétence internationale à l’État de destination • Exclusion d’un contrôle effectif ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction national • Nécessité de prévoir la possibilité de s’adresser à un juge avant l’entrée en vigueur du retrait de l’effet suspensif dans des procédures relevant du droit de la famille • Raison de l’urgence invoquée pas assez grave pour justifier l’absence d’une telle possibilité • Proportionnalité
CEDH
a) Principes généraux
49. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal – c’est‑à‑dire le droit de saisir un tribunal en matière civile – constitue un élément inhérent au droit énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention, qui pose les garanties applicables en ce qui concerne tant l’organisation et la composition du tribunal que la conduite de la procédure. Le tout forme le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 § 1 (Golder c. Royaume‑Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18). Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu. Il peut être soumis à des limitations pour autant que celles-ci ne restreignent ni ne réduisent l’accès de l’individu au juge d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 195, 25 juin 2019, Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012, et Markovic et autres c. Italie [GC], no 1398/03, § 99, CEDH 2006‑XIV).
b) Application des principes au cas d’espèce
50. La Cour estime approprié d’aborder le grief tiré du droit d’accès en répondant successivement aux questions qui suivent : (i) Quel est l’objet du litige à trancher par la Cour ? (ii) Le requérant a-t-il subi une limitation du droit d’accès à un tribunal ? (iii) La limitation de ce droit était-elle justifiée ?
51. À titre liminaire, la Cour constate que le requérant affirme que l’APEA est une autorité administrative, et non un tribunal au sens de la loi (paragraphe 26 ci‑dessus), ce que le Gouvernement ne conteste pas d’ailleurs (paragraphe 35 ci‑dessus). En outre, le Tribunal fédéral l’a confirmé dans son arrêt du 23 mars 2017 (paragraphe 13 ci‑dessus). Ainsi, la Cour ne voit pas de motif d’en décider autrement.
52. La Cour constate que le requérant a tenté de contester la décision de l’APEA devant la Cour suprême bernoise et le Tribunal fédéral. Cependant, l’APEA avait décidé de l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours en application de l’article 450c du code civil (paragraphes 7‑16 ci-dessus). Ainsi, la décision de l’APEA étant immédiatement exécutoire, F.L. a déménagé avec L.L. en Allemagne dans les jours qui suivirent cette décision (paragraphe 11 ci‑dessus). Le changement de lieu de résidence a entraîné le transfert de la compétence internationale à cet État et donc l’incompétence des juridictions suisses pour connaître des recours du requérant en application de l’article 5 de la Convention de La Haye de 1996 (paragraphe 18 ci‑dessus). Par conséquent, suite au recours du requérant contre la décision de l’APEA, la Cour suprême bernoise a constaté dans son arrêt du 23 juin 2016 qu’elle n’était plus compétente pour se prononcer sur le recours, traiter de la demande de rétablissement de l’effet suspensif et du fond de l’affaire (paragraphe 12 ci‑dessus). Le 23 mars 2017, le Tribunal fédéral confirma la décision de la Cour suprême bernoise (paragraphe 13 ci‑dessus).
53. La question qui se pose à la Cour dans ce contexte est de savoir si le requérant a été privé d’un accès effectif à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention par le biais du retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours qui a entraîné l’incompétence des tribunaux suisses.
54. La Cour est amenée à examiner si le requérant a subi une limitation de son droit d’accès à un tribunal. Elle rappelle, à cet égard, que chaque justiciable a droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (Naït‑Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 113, 15 mars 2018, avec autres références). La Cour estime que le requérant a en effet subi une limitation de son droit d’accès à un tribunal qui a été causée par le retrait par l’APEA de l’effet suspensif à un éventuel recours et a été matérialisée par la déclaration d’incompétence des tribunaux nationaux.
55. La question suivante que la Cour est amenée à trancher est celle de savoir si la restriction du droit d’accès à la Cour suprême bernoise poursuivait un but légitime. La Cour observe qu’il se dégage des observations du Gouvernement (paragraphe 42 ci‑dessus) que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours avait pour but légitime de protéger les droits et libertés de la mère et de l’enfant du requérant.
56. Quant au rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, une décision portant incompétence d’un tribunal n’enfreint pas le droit d’accès à un tribunal si les arguments de l’intéressé en faveur de la compétence du tribunal ont fait l’objet d’un examen réel et effectif et si le tribunal a motivé de manière adéquate les raisons sur lesquelles sa décision est fondée (dans ce sens, Obermeier c. Autriche, 28 juin 1990, § 68, série A no 179, et Konkurrenten.no AS c. Norvège (déc.), no 47341/15, §§ 46‑47, 5 novembre 2019).
57. C’est dans le cadre d’un contrôle européen limité que la Cour appréciera la décision de la Cour suprême bernoise, entérinée par le Tribunal fédéral.
58. Le Gouvernement considère que le requérant a pu contester la décision de l’APEA auprès de la Cour suprême bernoise, puis saisir le Tribunal fédéral qui constituent des tribunaux au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et bénéficiaient d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit en application de l’article 314 alinéa 1 en relation avec l’article 450a alinéa 1 du code civil (paragraphe 36 ci‑dessus). En outre, le Gouvernement estime que le requérant a bénéficié d’une appréciation matérielle de ses griefs dans les motivations circonstanciées subsidiaires des juridictions de recours internes à leurs déclarations d’incompétence (paragraphe 37 ci‑dessus).
59. Cependant, la Cour est d’avis que ces juridictions, s’étant déclarées incompétentes, n’ont pas pu réaliser un examen effectif et complet en fait et en droit, lors d’un examen contradictoire de l’affaire au cours d’un procès équitable respectant les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention.
60. La Cour reconnaît, en outre, que l’étendue de la marge d’appréciation accordée à l’État peut dépendre notamment du droit international pertinent en la matière (Naït‑Liman c. Suisse [GC], précité, §§ 173‑174).
61. Les arrêts de la Cour suprême bernoise et du Tribunal fédéral se fondent sur la Convention de La Haye de 1996, qui est incorporée au droit suisse (paragraphe 18 ci‑dessus), suite au déplacement de la résidence habituelle de L.L. en Allemagne par l’APEA.
62. La Convention de La Haye de 1996 ne s’applique qu’aux situations dans lesquelles il y a eu un déplacement du lieu de résidence habituelle d’un enfant au sens de l’article 5 de ladite convention (paragraphe 18 ci‑dessus).
63. La Cour considère donc que les arrêts de ces juridictions ayant déclaré leur incompétence, en application de l’article 5 de la Convention de La Haye de 1996, n’étaient pas arbitraires et peuvent être justifiés si l’on considère seulement l’aspect du changement accompli de la résidence habituelle (comparer Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 62-65, 12 juillet 2001).
64. Cependant, le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours a été décidé par l’APEA, qui est une autorité administrative, sans que la Cour suprême bernoise puis le Tribunal fédéral n’aient pu remédier à cette situation.
65. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 exige que, dans la détermination des droits et obligations civils, les décisions prises par les autorités administratives qui ne satisfont pas elles-mêmes aux exigences de cet article – comme c’est le cas en l’espèce avec l’APEA (paragraphe 51 ci‑dessus) – doivent faire l’objet d’un contrôle ultérieur par un « organe judiciaire de pleine juridiction », y compris le pouvoir d’annuler à tous égards, sur des questions de fait et de droit, la décision contestée (voir Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 132 in fine, 6 novembre 2018).
66. Dans le cas d’espèce, la Cour estime que le contrôle effectif ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction national a été exclu par l’APEA qui a décidé de l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. La Cour suprême bernoise puis le Tribunal fédéral se sont en effet déclarés incompétents pour traiter des recours du requérant.
67. La Cour est bien consciente qu’il existe des situations exceptionnelles, dûment justifiées par l’intérêt supérieur de l’enfant, dans lesquelles l’urgence particulière commande que le parent concerné puisse changer le domicile de l’enfant sans devoir attendre le jugement définitif au fond. Dans de tels cas, il est suffisant mais nécessaire qu’une procédure effective de recours avec des mesures provisionnelles soit à disposition. Il n’est dès lors pas exclu que les autorités administratives retirent exceptionnellement l’effet suspensif à un éventuel recours. Toutefois, dans de telles circonstances, il faut qu’il soit assuré que le parent concerné ait la possibilité de s’adresser à un juge avant que le retrait de l’effet suspensif n’entre en vigueur et qu’il soit rendu attentif à la procédure à suivre.
68. L’APEA dans sa décision du 27 janvier 2016 (paragraphe 10 ci‑dessus) et le Gouvernement (paragraphe 41 ci‑dessus) ont justifié l’urgence qui commandait le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours à savoir l’intérêt supérieur de L.L. pour laquelle l’APEA souhaitait éviter l’impact difficile qu’aurait pu avoir un éventuel recours. La Cour estime que les raisons de l’urgence invoquées en l’espèce n’étaient pas assez graves pour justifier que le requérant n’ait pas eu la possibilité de s’adresser à un juge avant que le retrait de l’effet suspensif n’entre en vigueur. Cela d’autant plus s’agissant d’une procédure relevant du droit de la famille, susceptible d’avoir des conséquences très graves et délicates pour le requérant dans la mesure où des questions du future rapport avec son enfant ainsi que ses droits vis-à-vis de ce dernier étaient directement en jeu (voir, mutatis mutandis, Gajtani c. Suisse, no 43730/07, § 75, 9 septembre 2014, et Assunção Chaves c. Portugal, no 61226/08, § 82, 31 janvier 2012).
69. Le Gouvernement (paragraphe 48 ci-dessus), tel que le Tribunal fédéral (consid. 6.3, paragraphe 13 ci-dessus), considère que le requérant aurait pu demander la restitution de l’effet suspensif à la Cour suprême bernoise, le jour même de la notification de la décision de l’APEA, soit le 27 janvier 2016, et non attendre le 22 février 2016, sachant que F.L. commençait son nouveau travail en Allemagne le 1er février 2016. En effet, il estime que si la Cour suprême bernoise avait accédé à la demande du requérant, la compétence internationale de la Suisse pour le fond de l’affaire aurait été maintenue. En tout état de cause, ce moyen lui aurait permis de faire examiner par une autorité judiciaire le risque d’un transfert de la compétence internationale vers l’Allemagne. Selon le Gouvernement, la possibilité de saisine à titre superprovisionnel n’a pas à figurer expressément dans l’indication des voies de droit figurant dans la décision attaquée et ne saurait du reste être déduite de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 48 ci‑dessus).
70. Selon le requérant, il n’aurait pas pu demander la restitution de l’effet suspensif préalablement au départ de L.L. au regard du temps dont le président de la Cour suprême bernoise devait disposer pour rendre sa décision et donc de l’impossibilité de la communiquer à la mère avant son départ en Allemagne (paragraphe 34 ci‑dessus).
71. En l’espèce, la Cour peut donc se poser la question du temps que le requérant a pris pour réaliser son recours devant la Cour suprême bernoise, soit presque un mois, au regard de la date de la notification de la décision et de sa connaissance de la date de début du nouveau travail de F.L. en Allemagne. Le requérant n’a donc a priori pas utilisé une voie de recours existante en théorie dans un délai raisonnable.
72. La Cour reconnaît qu’il incombait au requérant après qu’il eut pris connaissance de la décision litigieuse de s’enquérir lui-même, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, des recours disponibles (Avotiņš, précité, § 123). Cependant, la recherche des recours disponibles contre la décision de l’APEA, après avoir eu connaissance de celle-ci le jour de sa notification le mercredi 27 janvier 2016, en présence d’une situation juridique complexe, a pu demander un certain temps au requérant et à son avocat. Tout en admettant que ce ne soit pas un argument valable en soi, la Cour reconnaît qu’il ne leur restait donc que trop peu de temps pour introduire la demande de saisine à titre superprovisionnel et a fortiori obtenir une décision juridictionnelle, préalablement au départ de F.L. avec L.L en Allemagne qui s’est probablement réalisé l’après-midi du vendredi 29 janvier 2016 (paragraphes 11 et 34 ci-dessus) sachant que F.L. commençait son nouveau travail en Allemagne le lundi 1er février 2016.
73. Autrement dit, il n’est pas entièrement exclu, mais peu probable qu’une réaction précipitée et sans aucune réflexion du requérant pour saisir la Cour suprême bernoise aurait permis de sauvegarder la juridiction de la Suisse et l’accès à un tribunal. Dans ces circonstances, la Cour est donc d’avis que le requérant n’a pas été assuré d’avoir la possibilité de s’adresser à un juge avant que le retrait de l’effet suspensif n’entre en vigueur et qu’il n’a pas été rendu attentif à la procédure à suivre (paragraphe 67 ci-dessus).
74. Aussi, le Gouvernement, en l’espèce, n’a pas fait la preuve de la mise en œuvre et de l’efficacité pratique des recours qu’il suggère dans les circonstances particulières de la cause, avec des exemples de jurisprudence pertinente des tribunaux nationaux dans une affaire analogue (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, §§ 75-82, 17 mai 2016, Parrillo c. Italie [GC], no 46470/11, §§ 87‑105, CEDH 2015, et Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 71, 17 septembre 2009).
75. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de rejeter l’argument du Gouvernement (paragraphe 69 ci-dessus).
76. La Cour considère par conséquent que le requérant n’a pas pu avoir accès à un tribunal national, avant le départ en Allemagne de F.L. avec L.L., pour demander le rétablissement de l’effet suspensif et pour contester, le cas échéant, effectivement la décision de l’autorité administrative « APEA » au fond.
77. Compte tenu de ce qui précède, le droit d’accès à un tribunal était atteint dans sa substance même par la décision de l’APEA de retirer l’effet suspensif au recours du requérant, suivi du départ en Allemagne de F.L. avec L.L., qui a entrainé l’incompétence des tribunaux suisses à travers le transfert de la compétence internationale vers l’Allemagne. Cette limitation au droit d’accès à un tribunal était disproportionnée au but poursuivi, à savoir la protection des droits et libertés de la mère et de l’enfant du requérant, au regard de l’importance pour le requérant des questions soulevées par la procédure litigieuse.
78. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit d’accès à un tribunal.
PLAZZI c. SUISSE du 8 février 2022 Requête no 44101/18
Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Décision d’une autorité administrative de retirer l’effet suspensif du recours du père, suivi du départ à l’étranger de l’enfant avec sa mère, ayant entraîné l’incompétence des tribunaux nationaux • Transfert de la compétence internationale à l’État de destination • Exclusion d’un contrôle effectif ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction national • Nécessité de prévoir la possibilité de s’adresser à un juge avant l’entrée en vigueur du retrait de l’effet suspensif dans des procédures relevant du droit de la famille • Raison de l’urgence invoquée pas assez grave pour justifier l’absence d’une telle possibilité • Proportionnalité
CEDH
a) Principes généraux
40. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal – c’est-à-dire le droit de saisir un tribunal en matière civile – constitue un élément inhérent au droit énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention, qui pose les garanties applicables en ce qui concerne tant l’organisation et la composition du tribunal que la conduite de la procédure. Le tout forme le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 § 1 (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18). Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu. Il peut être soumis à des limitations pour autant que celles-ci ne restreignent ni ne réduisent l’accès de l’individu au juge d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 195, 25 juin 2019, Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012, et Markovic et autres c. Italie [GC], no 1398/03, § 99, CEDH 2006‑XIV).
b) Application des principes au cas d’espèce
41. La Cour estime approprié d’aborder le grief tiré du droit d’accès en répondant successivement aux questions qui suivent : (i) Quel est l’objet du litige à trancher par la Cour ? (ii) Le requérant a-t-il subi une limitation du droit d’accès à un tribunal ? (iii) La limitation de ce droit était-elle justifiée ?
42. À titre liminaire, la Cour constate que le requérant affirme que l’APEA est une autorité administrative, et non un tribunal au sens de la loi (paragraphe 24 ci‑dessus), ce que le Gouvernement ne conteste pas d’ailleurs (paragraphe 30 ci‑dessus). La Cour ne voit pas de motif d’en décider autrement.
Définition de l’objet du litige pendant
43. La Cour constate que le requérant a tenté de contester la décision de l’APEA devant le Tribunal d’appel et le Tribunal fédéral. Cependant, l’APEA avait décidé de l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours en application de l’article 450c du code civil (paragraphes 5 et 13 ci‑dessus). Ainsi, la décision de l’APEA étant immédiatement exécutoire, D.R. a signalé le changement de lieu de résidence habituelle le jour même de la notification de la décision et a déménagé avec V.R. à la Principauté de Monaco (paragraphe 7 ci‑dessus). Le changement de lieu de résidence a entraîné le transfert de la compétence internationale à cet État et donc l’incompétence des juridictions suisses pour connaître des recours du requérant en application de l’article 5 de la Convention de La Haye de 1996 (paragraphe 16 ci‑dessus). Par conséquent, suite au recours du requérant contre la décision de l’APEA, le Tribunal d’appel a constaté dans son arrêt du 17 octobre 2017 qu’il n’était plus compétent pour se prononcer sur le recours, traiter de la demande de rétablissement de l’effet suspensif et du fond de l’affaire (paragraphe 9 ci‑dessus). Le 12 mars 2018, le Tribunal fédéral confirma la décision du Tribunal d’appel (paragraphe 11 ci‑dessus).
44. La question qui se pose à la Cour dans ce contexte est de savoir si le requérant a été privé d’un accès effectif à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention par le biais du retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours qui a entraîné l’incompétence des tribunaux suisses.
Limitation du droit d’accès à un tribunal
45. La Cour est amenée à examiner si le requérant a subi une limitation de son droit d’accès à un tribunal. Elle rappelle, à cet égard, que chaque justiciable a droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (Naït‑Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 113, 15 mars 2018, avec autres références). La Cour estime que le requérant a en effet subi une limitation de son droit d’accès à un tribunal qui a été causée par le retrait par l’APEA de l’effet suspensif à un éventuel recours et qui a été matérialisée par la déclaration d’incompétence des tribunaux nationaux.
Justification de la limitation
46. La question suivante que la Cour est amenée à trancher est celle de savoir si la restriction du droit d’accès au Tribunal d’appel poursuivait un but légitime. La Cour observe qu’il se dégage des observations du Gouvernement (paragraphe 31 ci‑dessus) que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours avait pour but légitime de protéger les droits et libertés de la mère et de l’enfant du requérant.
47. Quant au rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, une décision portant incompétence d’un tribunal n’enfreint pas le droit d’accès à un tribunal si les arguments de l’intéressé en faveur de la compétence du tribunal ont fait l’objet d’un examen réel et effectif et si le tribunal a motivé de manière adéquate les raisons sur lesquelles sa décision est fondée (dans ce sens, Obermeier c. Autriche, 28 juin 1990, § 68, série A no 179, et Konkurrenten.no AS c. Norvège (déc.), no 47341/15, §§ 46‑47, 5 novembre 2019).
48. C’est dans le cadre d’un contrôle européen limité que la Cour appréciera la décision du Tribunal d’appel, entérinée par le Tribunal fédéral.
49. Le Gouvernement considère que le requérant a pu contester la décision de l’APEA auprès du Tribunal d’appel, puis saisir le Tribunal fédéral qui constituent des tribunaux au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et bénéficiaient d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit en application de l’article 314 alinéa 1 en relation avec l’article 450a alinéa 1 du code civil (paragraphe 32 ci‑dessus).
50. Cependant, la Cour est d’avis que ces juridictions, s’étant déclarées incompétentes, n’ont pas pu réaliser un examen effectif et complet en fait et en droit, lors d’un examen contradictoire de l’affaire au cours d’un procès équitable respectant les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention.
51. La Cour reconnaît, en outre, que l’étendue de la marge d’appréciation accordée à l’État peut dépendre notamment du droit international pertinent en la matière (Naït‑Liman, précité, §§ 173‑174).
52. Les arrêts du Tribunal d’appel et du Tribunal fédéral se fondent sur la Convention de La Haye de 1996, qui est incorporée au droit suisse (paragraphe 16 ci‑dessus), suite au déplacement de la résidence habituelle de D.R. à la Principauté de Monaco par l’APEA.
53. La Convention de La Haye de 1996 ne s’applique qu’aux situations dans lesquelles il y a eu un déplacement du lieu de résidence habituelle d’un enfant au sens de l’article 5 de ladite convention (paragraphe 16 ci‑dessus).
54. La Cour considère donc que les arrêts de ces juridictions ayant déclaré leur incompétence, en application de l’article 5 de la Convention de La Haye de 1996, n’étaient pas arbitraires et peuvent être justifiés si l’on considère seulement l’aspect du changement accompli de la résidence habituelle (comparer Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 62-65, 12 juillet 2001).
55. Cependant, le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours a été décidé par l’APEA, qui est une autorité administrative, sans que le Tribunal d’appel puis le Tribunal fédéral n’aient pu remédier à cette situation.
56. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 exige que, dans la détermination des droits et obligations civils, les décisions prises par les autorités administratives qui ne satisfont pas elles-mêmes aux exigences de cet article – comme c’est le cas en l’espèce avec l’APEA (paragraphe 42 ci‑dessus) – doivent faire l’objet d’un contrôle ultérieur par un « organe judiciaire de pleine juridiction », y compris le pouvoir d’annuler à tous égards, sur des questions de fait et de droit, la décision contestée (voir Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 132 in fine, 6 novembre 2018).
57. Dans le cas d’espèce, la Cour
estime que
58. La Cour est bien consciente qu’il existe des situations exceptionnelles, dûment justifiées par l’intérêt supérieur de l’enfant, dans lesquelles l’urgence particulière commande que le parent concerné puisse changer le domicile de l’enfant sans devoir attendre le jugement définitif au fond. Dans de tels cas, il est suffisant mais nécessaire qu’une procédure effective de recours avec des mesures provisionnelles soit à disposition. Il n’est dès lors pas exclu que les autorités administratives retirent exceptionnellement l’effet suspensif à un éventuel recours. Toutefois, dans de telles circonstances, il faut qu’il soit assuré que le parent concerné ait la possibilité de s’adresser à un juge avant que le retrait de l’effet suspensif n’entre en vigueur et qu’il soit rendu attentif à la procédure à suivre.
59. L’APEA dans sa décision du 24 août 2017 (paragraphe 6 ci-dessus) et le Gouvernement (paragraphe 31 ci‑dessus) ont justifié l’urgence qui commandait le retrait de l’effet suspensif d’un éventuel recours à savoir l’intérêt supérieur de V.R. pour laquelle l’APEA souhaitait éviter qu’un éventuel recours l’ait placée dans une situation de forte incertitude. La Cour estime que les raisons de l’urgence invoquées en l’espèce n’étaient pas assez graves pour justifier que le requérant n’ait pas eu la possibilité de s’adresser à un juge avant que le retrait de l’effet suspensif n’entre en vigueur. Cela d’autant plus s’agissant d’une procédure relevant du droit de la famille, susceptible d’avoir des conséquences très graves et délicates pour le requérant dans la mesure où des questions du futur rapport avec son enfant ainsi que ses droits vis-à-vis de ce dernier étaient directement en jeu (voir, mutatis mutandis, Gajtani c. Suisse, no 43730/07, § 75, 9 septembre 2014, et Assunção Chaves c. Portugal, no 61226/08, § 82, 31 janvier 2012).
60. Le Gouvernement considère que le requérant aurait pu demander la restitution de l’effet suspensif au Tribunal d’appel, le jour même de la notification de la décision de l’APEA, soit le vendredi 25 août 2017, et non attendre le mardi 29 août 2017. En effet, il estime que si le Tribunal d’appel avait accédé à la demande du requérant, la compétence internationale de la Suisse pour le fond de l’affaire aurait été maintenue (paragraphe 39 ci‑dessus). En tout état de cause, ce moyen lui aurait permis de faire examiner par une autorité judiciaire le risque d’un transfert de la compétence internationale vers la Principauté de Monaco.
61. Selon le requérant, il n’aurait pas pu demander la restitution de l’effet suspensif puisqu’il a reçu la décision de l’APEA le 25 août 2017 et que D.R. a annoncé son départ aux autorités communales et a déménagé avec V.R. à la Principauté de Monaco le jour même, alors qu’il n’en avait pas eu connaissance (paragraphe 7 ci‑dessus).
62. En l’espèce, la Cour ne peut constater que le requérant aurait tardé à introduire son recours auprès du Tribunal d’appel au regard de la date de la notification de la décision. Le requérant ne s’est pas abstenu d’utiliser les voies de recours existantes au moins en théorie.
63. En outre, D.R. est partie avec V.R. pour la Principauté de Monaco le jour même de la notification de la décision de l’APEA et dès lors le requérant n’avait aucune chance de s’adresser au Tribunal d’appel pour restituer l’effet suspensif de son recours afin de maintenir la juridiction de la Suisse et avoir accès à un tribunal au fond.
64. Aussi, le Gouvernement n’a pas apporté la preuve de la mise en œuvre et de l’efficacité pratique des recours qu’il suggère dans les circonstances particulières de la cause, avec des exemples de jurisprudence pertinente des tribunaux nationaux dans une affaire analogue (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, §§ 75‑82, 17 mai 2016, Parrillo c. Italie [GC], no 46470/11, §§ 87‑105, CEDH 2015, et Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 71, 17 septembre 2009).
65. La Cour conclut donc qu’un tel recours devant le Tribunal d’appel n’aurait pas présenté des perspectives raisonnables de succès relativement au grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention.
66. La Cour considère par conséquent que le requérant n’a pas pu avoir accès à un tribunal national, avant le départ à la Principauté de Monaco de D.R. avec V.R., pour contester la décision de l’autorité administrative « APEA » au fond et demander le rétablissement de l’effet suspensif.
67. Compte tenu de ce qui précède, le droit d’accès à un tribunal était atteint dans sa substance même par la décision de l’APEA de retirer l’effet suspensif du recours du requérant, suivi du départ à la Principauté de Monaco de D.R. avec V.R., qui a entraîné l’incompétence des tribunaux suisses à travers le transfert de la compétence internationale vers la Principauté de Monaco. Cette limitation était disproportionnée au but poursuivi, à savoir la protection des droits et libertés de la mère et de l’enfant du requérant, au regard de l’importance pour le requérant des questions soulevées par la procédure litigieuse.
68. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit d’accès à un tribunal.
Broda et Bojara c. Pologne du 29 juin 2021 requêtes nos 26691/18 et 27367/18
La révocation des requérants, vice-présidents du tribunal régional de Kielce, par le ministre de la Justice n’a pas respecté leur droit d’accès à un tribunal
Violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme
L’affaire concerne la plainte des requérants de n’avoir pas eu à leur disposition des voies de recours pour contester les décisions du ministre de la Justice de mettre prématurément fin à leurs mandats de vice-présidents du tribunal régional de Kielce. La Cour souligne l’importance accordée à la nécessité de sauvegarder l’indépendance du pouvoir judiciaire et au respect de l’équité procédurale dans les affaires concernant la carrière des juges. La Cour observe que le cadre juridique national applicable au moment de la révocation des requérants ne précisait pas clairement les conditions dans lesquelles un chef de juridiction pouvait être révoqué par dérogation au principe d’inamovibilité des juges en cours de mandat. La quasi-totalité des pouvoirs en la matière ont été concentrés entre les mains du seul représentant du pouvoir exécutif, le Conseil national de la magistrature, notamment, ayant été exclu du processus. La Cour note en outre que les requérants n’ont pu être entendus ni n’ont pu connaître les motifs des décisions ministérielles. Il n’y a eu enfin aucun contrôle de ces décisions de révocation par une instance indépendante du ministre de la Justice. La cessation prématurée des mandats de vice-président de juridiction dont les requérants avaient été investis n’ayant été examinée ni par un tribunal ordinaire ni par un autre organe exerçant des fonctions judiciaires, l’État défendeur a porté atteinte à la substance même du droit pour les requérants d’accéder à un tribunal.
FAITS
Les requérants, M. Mariusz Broda et Mme Alina Bojara, sont des ressortissants polonais, nés en 1969 et 1960, et résidant à Kielce. Juges depuis 1998 et 1988, M. Broda et Mme Bojara exercent la fonction de juge du tribunal régional de Kielce depuis le 14 avril 2014 et le 25 octobre 1995. En octobre et mai 2014, ils furent nommés vice-présidents de ce même tribunal par le ministre de la Justice pour un mandat de six ans. Le 2 janvier 2018, le secrétaire d’État adjoint au ministre de la Justice informa par lettre les intéressés de la cessation de leur mandat de vice-président de juridiction en application de l’article 17 § 1 de la loi du 12 juillet 2017 portant modification de la loi sur l’organisation des tribunaux ordinaires.
M. Broda et Mme Bojara demandèrent au secrétaire d’État adjoint au ministre de la Justice de leur communiquer les motifs des décisions ministérielles qui avaient été rendues et de leur indiquer les voies de recours qu’ils pouvaient exercer pour les contester. En réponse, les intéressés furent informés que selon l’article 17 de la loi du 12 juillet 2017, le ministre de la Justice était habilité, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette loi, soit du 12 août 2017 au 12 février 2018, à révoquer les chefs de juridiction sans que ne fussent applicables les conditions prescrites par les articles 23 à 25 de la loi Pusp dans sa version en vigueur à compter du 12 août 2017, et sans que le ministre concerné ne fût obligé de communiquer aux intéressés les motifs de sa décision. Il ajouta que les décisions de révocation que le ministre de la Justice avait adoptées étaient insusceptibles de recours. M. Broda et Mme Bojara réitérèrent leur demande. Ils estimaient qu’il se dégageait des lettres ministérielles qui leur avaient été adressées que leur révocation avait eu pour cause de supposés « dysfonctionnements administratifs » du tribunal régional de Kielce et que leur maintien en poste aurait nui au « bon fonctionnement des tribunaux ». Ils considéraient ces déclarations dénuées de tout fondement et qu’elles avaient nui à leur réputation en tant que vice-présidents de juridiction et juges. Ils soutenaient que leur manière d’exercer leurs fonctions n’avait jamais été remise en cause et avait au contraire été toujours appréciée dans leur milieu professionnel. Le 16 mai et le 13 juin 2018, les services du ministère de la Justice informèrent M. Broda et Mme Bojara par lettre que le ministre de la Justice avait exercé la prérogative en matière de révocation des chefs de juridiction qui lui était dévolue en application de l’article 17 § 1 de la loi du 12 juillet 2017 et que les intéressés avaient interprété à tort l’exposé des motifs ministériels à l’origine de leur révocation. Les services du ministère ajoutèrent que le ministre de la Justice pouvait appliquer les différentes mesures à sa disposition non seulement pour remédier aux dysfonctionnements qui avaient été constatés au sein des cours et tribunaux mais aussi pour apporter des améliorations même quand la situation était satisfaisante. Le 1 er avril 2019, Mme Bojara partit en retraite anticipée.
Article 6
La Cour constate tout d’abord qu’il se dégage des courriers ministériels que les décisions du ministre de la Justice de révoquer les requérants n’étaient susceptibles d’aucun recours. Il se dégage des observations du Gouvernement que l’exclusion d’un recours pour se plaindre de la révocation avait pour but de faciliter la mise en œuvre des réformes ministérielles du système judiciaire polonais. La Cour tient à souligner l’importance croissante que les instruments internationaux et ceux du Conseil de l’Europe, ainsi que la jurisprudence des juridictions internationales accordent au respect de l’équité procédurale dans les affaires concernant la révocation ou la destitution de juges, et notamment à l’intervention d’une autorité indépendante des pouvoirs exécutif et législatif pour toute décision touchant à la cessation du mandat d’un juge. La Cour observe que les requérants ont été prématurément démis de leurs fonctions de chefs de juridiction par le ministre de la Justice statuant en application de l’article 17 de la loi du 12 juillet 2017. La disposition législative était transitoire et habilitait le ministre impliqué à révoquer les chefs de juridiction à son entière discrétion sans que celui-ci fût tenu par une quelconque condition de fond ou de procédure. Les décisions critiquées du ministre de la Justice n’étaient pas motivées et n’ont pas été soumises au contrôle d’un organe externe et indépendant du ministre concerné. Eu égard à l’ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, la Cour conclut, d’une part, que la révocation des requérants est intervenue sur la base d’une disposition législative dont la compatibilité avec les exigences de l’État de droit lui paraît douteuse, et d’autre part, que cette mesure n’était entourée d’aucune des exigences fondamentales de l’équité procédurale. Les décisions ministérielles de révoquer les requérants n’étaient accompagnées d’aucune motivation. La Cour relève que le cadre juridique national applicable au moment de la révocation des requérants ne les protégeait d’aucune manière contre la cessation anticipée et arbitraire de leurs fonctions de vice-président de juridiction. Elle considère que les magistrats doivent bénéficier d’une protection contre l’arbitraire du pouvoir exécutif, et que seul le contrôle par un organe judiciaire indépendant de la légalité d’une telle décision de révocation est à même de rendre ce droit effectif. La Cour souligne l’importance accordée tant à la nécessité de sauvegarder l’indépendance du pouvoir judiciaire qu’au respect de l’équité procédurale dans les affaires concernant la carrière des juges. Elle constate que le cadre juridique national qui était applicable au moment de la révocation des requérants ne précisait pas clairement les conditions dans lesquelles un chef de juridiction pouvait être révoqué par dérogation au principe d’inamovibilité des juges en cours de mandat. La quasi-totalité des pouvoirs en la matière ont été concentrés entre les mains du seul représentant du pouvoir exécutif, les organes d’auto-administration judiciaire, et notamment le Conseil national de la magistrature, ayant été exclus de ce processus. La Cour note en outre l’exclusion dans le chef des intéressés du droit d’être entendu et du droit de connaître les motifs des décisions ministérielles les concernant et l’absence d’un quelconque contrôle par une instance indépendante du ministre de la Justice. La Cour relève avec préoccupation que dans ses observations, le Gouvernement défendeur a déclaré que le cadre législatif de la révocation anticipée des chefs de juridiction lui avait permis de passer outre les procédures applicables en la matière. Or, la Cour souligne que ce sont justement ces procédures qui constituent les garanties au cœur du principe, inscrit à l’article 6 de la Convention, selon lequel un « tribunal indépendant » – au sens de cette disposition conventionnelle – est nécessairement « inamovible », que le juge concerné soit révoqué de ses fonctions judiciaires ou seulement des fonctions administratives qu’il occupait dans les organes de l’autorité judiciaire. Compte tenu de l’importance du rôle qui est dévolu aux juges en matière de protection des droits garantis par la Convention, la Cour estime qu’il est impératif que des garanties procédurales propres à assurer une protection adéquate de l’autonomie judiciaire contre les influences indues soient mises en place. La confiance dans le pouvoir judiciaire se trouve en jeu. La cessation prématurée des mandats de vice-président de juridiction dont les requérants avaient été investis n’ayant été examinée ni par un tribunal ordinaire ni par un autre organe exerçant des fonctions judiciaires, l’État défendeur a porté atteinte à la substance même du droit pour les requérants d’accéder à un tribunal. Il y a donc eu violation du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
CEDH
Principes pertinents relatifs à l’applicabilité du volet civil de l’article 6 § 1
94. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 100, 23 juin 2016, Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, § 90, CEDH 2012, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 71, CEDH 2016 (extraits), et Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, § 99, CEDH 2017 (extraits)).
95. L’article 6 § 1 n’assure aux « droits et obligations » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants : la Cour ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné (voir, Baka, précité, § 101, et Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 45, 25 septembre 2018). Il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en donnent les juridictions internes (Károly Nagy c. Hongrie [GC], no 56665/09, § 62, CEDH 2017, et Regner, précité, § 100).
96. Les droits ainsi conférés par les législations nationales peuvent être soit matériels, soit procéduraux, soit encore une combinaison des deux (Denisov, précité, § 46, et Regner, précité, § 101).
97. La Cour rappelle de plus que la portée de la notion de « caractère civil » au sens de l’article 6 n’est pas limitée par l’objet immédiat du litige. En effet, la Cour a dégagé une approche plus large selon laquelle le volet « civil » englobe des affaires qui, si elles n’apparaissent pas a priori toucher un droit civil, n’en ont pas moins pu avoir des répercussions directes et notables sur un droit de nature pécuniaire ou non pécuniaire dont l’intéressé est titulaire (Denisov, précité, § 51, et les références qui y sont citées).
98. Par ailleurs, pour ce qui est du caractère « civil » d’un tel droit au sens de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, les litiges opposant l’État à ses fonctionnaires entrent en principe dans le champ d’application de cette disposition sauf si deux conditions, cumulatives, sont remplies. En premier lieu, le droit interne de l’État concerné doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’État (voir, Vilho Eskelinen et autres, précité, § 62, Regner, précité, § 107, et Baka, précité, § 103).
99. La Cour rappelle également que la portée du volet « civil » a été nettement étendue dans le contentieux de la fonction publique. Eu égard à la situation au sein des États contractants et à l’impératif de non-discrimination entre agents publics et employés du secteur privé, la Cour, dans l’arrêt précité Vilho Eskelinen et autres, a établi une présomption que l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer aux « conflits ordinaires du travail » entre les agents publics et l’État, et elle a dit qu’il appartient à l’État défendeur de démontrer, premièrement, que d’après le droit national l’agent public en question n’avait pas le droit d’accéder à un tribunal, et, deuxièmement, que l’exclusion des droits garantis par l’article 6 était fondée s’agissant de cet agent (ibidem, § 62).
100. Si, dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres, la Cour a dit que son raisonnement se limitait à la situation des fonctionnaires (ibidem, § 61), les critères établis dans cet arrêt ont été appliqués par la Cour à des litiges concernant des juges. Notamment, dans l’affaire Baka la Grande Chambre a souligné que, s’ils ne font pas partie de l’administration au sens strict, les magistrats n’en font pas moins partie de la fonction publique au sens large (voir Baka, précité, § 104, et les références qui y sont citées).
101. Par exemple, l’article 6 a été appliqué à des litiges relatifs à l’emploi de juges révoqués de la magistrature (voir, Denisov précité, § 52 et les références qui y sont citées, par exemple, Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 2172/11, §§ 91 et 96, 9 janvier 2013, Kulykov et autres c. Ukraine, no 5114/09 et 17 autres, §§ 118 et 132, 19 janvier 2017, Sturua c. Géorgie, no 45729/05, § 27, 28 mars 2017, et Kamenos c. Chypre, no 147/07, § 88, 31 octobre 2017), démis de leurs fonctions administratives sans pour autant avoir été révoqués de la magistrature (Baka, précité, §§ 34 et 107-111, et Denisov, précité, §§ 25 et 47-48), suspendus de leurs fonctions judiciaires (voir, Paluda c. Slovaquie, no 33392/12, § 34, 23 mai 2017, et Camelia Bogdan c. Roumanie, no 36889/18, 20 octobre 2020) ou sanctionnés disciplinairement (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], no 55391/13 et 2 autres, §§ 119-120, 6 novembre 2018).
102. Les critères énoncés dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres ont été également appliqués à des litiges relatifs à la carrière ou à la promotion de juges (Dzhidzheva-Trendafilova c. Bulgarie (déc.), no 12628/09, 9 octobre 2012 et Tsanova-Gecheva c. Bulgarie, no 43800/12, 15 septembre 2015), à la mutation (Bilgen c. Turquie, no 1571/07, 9 mars 2021) et à la cessation de service (Olujić c. Croatie, no 22330/05, § 67, 5 février 2009 et Harabin c. Slovaquie, no 58688/11, §§ 118-123, 20 novembre 2012 (les deux arrêts sur la révocation disciplinaire du président de la Cour suprême)).
103. La Cour rappelle également que, bien qu’en principe la Convention ne garantisse aucun droit à exercer telle ou telle fonction publique au sein de l’administration judiciaire (Dzhidzheva-Trendafilova, décision précitée, § 38, et Harabin c. Slovaquie (déc.), no 62854/00, Recueil des arrêts et décisions 2004-VI), un tel droit peut exister au niveau interne. Si l’accès à un emploi et aux fonctions exercées peut constituer en principe un privilège qu’on ne saurait faire judiciairement sanctionner, tel n’est pas le cas du maintien ou des conditions d’exercice d’une telle relation professionnelle. Par exemple, dans l’arrêt précité Baka, la Cour a reconnu que le requérant avait le droit, au regard du droit national, d’accomplir l’intégralité de son mandat de six ans à la présidence de la Cour suprême hongroise (voir, Baka, précité, §§ 107-111, et Denisov, précité, § 46).
1) Sur l’existence d’un droit
104. La Cour note que chacun des requérants a été nommé vice‑président de juridiction pour un mandat de six ans, conformément à l’article 26 § 2 de la loi Pusp dans sa formulation applicable à l’époque de leur prise de fonctions (paragraphe 23 ci-dessus). Elle relève ensuite, d’une part, que les intéressés ont perçu le traitement attaché à leur fonction et, d’autre part, que leur nomination n’a pas été contestée au niveau interne. Elle observe en outre qu’en vertu de la disposition précitée de l’article 26 § 2 de la loi Pusp, les vice‑présidents de juridiction étaient nommés pour six ans et ne pouvaient être renommés à cette fonction qu’à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la fin de leur mandat. Partant, il découle incontestablement de cette disposition que les mandats respectifs des requérants auraient dû en principe durer six ans (d’octobre et mai 2014 à octobre et mai 2020, respectivement). Or, en l’espèce, les intéressés ont été démis de leurs fonctions en janvier 2018.
105. La Cour observe qu’à l’époque de la prise de fonctions des requérants, la révocation des chefs de juridiction était soumise à certaines conditions de fond et de procédure. Elle note en particulier que l’article 27 § 1 de la loi Pusp prévoyait une liste exhaustive de motifs de révocation anticipée (paragraphe 24). Elle relève de plus que conformément à cette disposition, un mandat de chef de juridiction ne pouvait être révoqué qu’en cas d’un manquement flagrant par l’intéressé à ses obligations professionnelles et/ou si, pour d’autres motifs, celui-ci ne pouvait concilier les intérêts de la justice et l’exercice de son mandat de chef de juridiction. Elle observe en outre que conformément à l’article 27 §§ 2 et 3 de la même loi, la décision ministérielle de révocation était assujettie à l’approbation du CNM, auquel le ministre de la Justice devait communiquer ses motifs (paragraphe 25).
106. De plus, les principes constitutionnels relatifs à l’indépendance de la magistrature et à l’inamovibilité des juges confirmaient que le droit pour les requérants d’accomplir l’intégralité de leur mandat était protégé. L’article 180 de la Constitution établissait en effet que les juges ne pouvaient être révoqués et suspendus de leurs fonctions qu’en vertu d’une décision de justice et uniquement dans les cas prévus par la loi. L’article 178 de la Constitution garantissait quant à lui l’indépendance des juges (paragraphe 14 ci-dessus ; voir, mutatis mutandis, Baka, précité, § 108).
107. La Cour considère que le fait qu’il ait été mis fin au mandat des requérants ex lege, par l’effet de la disposition transitoire de l’article 17 § 1 de la nouvelle loi entrée en vigueur le 12 juillet 2017 (paragraphe 33 ci‑dessus), ne peut anéantir rétroactivement le caractère défendable du droit que les règles qui étaient applicables au moment de leur prise de fonctions leur garantissaient. Comme indiqué ci-dessus, ces règles prévoyaient clairement la durée de leur mandat – six ans – ainsi que les motifs précis pour lesquels celui-ci pouvait prendre fin. Étant donné que c’est elle qui aurait annulé les anciennes règles, la loi du 12 juillet 2017 constitue l’objet même du « litige » à l’égard duquel il convient de rechercher si les garanties d’équité de la procédure découlant de l’article 6 § 1 doivent s’appliquer. Eu égard aux circonstances de la présente affaire, la Cour ne peut donc pas trancher sur la base de la loi en question le point de savoir s’il existait un droit en droit interne (voir, mutatis mutandis, Baka, précité, §§ 110-111).
108. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’une « contestation » a surgi au sujet du droit pour les requérants d’occuper un poste de vice-président de juridiction. Cette « contestation » était « réelle », puisqu’il était question de savoir si les requérants avaient le droit de continuer à exercer leurs mandats respectifs de chef de juridiction. Elle était en outre « sérieuse », compte tenu du rôle joué par les chefs de juridiction et des conséquences pécuniaires directes qu’a emporté pour les requérants la cessation anticipée de leurs mandats (paragraphe 151 ci-dessous). Enfin, elle était « directement déterminante » pour le droit en cause, la révocation des requérants ayant eu pour résultat de mettre prématurément fin à l’exercice par eux de leurs mandats respectifs de chef de juridiction (voir, mutatis mutandis, Denisov, précité, §§ 48-49).
109. En conséquence, la Cour considère qu’il existait un droit pour les titulaires du mandat de vice-président de juridiction d’accomplir celui-ci jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de son mandat de juge et que les intéressés pouvaient prétendre de manière défendable que le droit national les protégeait d’une cessation arbitraire de leur mandat de vice-président de juridiction (voir, Baka, précité, § 109).
2) Sur le « caractère civil » du droit en cause : application des critères Vilho Eskelinen et autres
110. La Cour doit à présent déterminer, à l’aune du critère énoncé dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres (précité), tel qu’appliqué dans les affaires précitées Baka, §§ 112-118, et Denisov, §§ 51-54, si le « droit » revendiqué par les requérants était de « caractère civil », au sens autonome que prend cette notion à l’article 6 § 1.
111. La Cour juge non convaincante la thèse du Gouvernement selon laquelle l’article 6 § 1 est inapplicable dans son volet civil au seul motif que le litige en question relève du droit public et qu’aucun droit à caractère « civil » n’est en cause. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le volet civil de cette disposition peut trouver à s’appliquer à un litige relevant du droit public si les considérations de droit privé priment sur les considérations de droit public eu égard aux conséquences directes sur un droit civil de nature pécuniaire ou non pécuniaire. En outre, la Cour suit les critères de la jurisprudence Vilho Eskelinen et autres (arrêt précité) et présume de manière générale que les « conflits ordinaires du travail » des membres de la fonction publique, dont ceux des magistrats, produisent de telles conséquences directes sur les droits civils de ceux-ci (Vilho Eskelinen et autres, précité, § 62, Baka, précité, § 104 et Denisov, précité, § 53).
112. La Cour rappelle dans ce contexte que dans l’arrêt Denisov (précité), qui avait trait à la révocation anticipée d’un requérant de son poste de président d’une cour d’appel, elle-même a dit que le litige consécutif à cette révocation était un « conflit ordinaire du travail » car il touchait essentiellement i) l’étendue des tâches que le requérant était tenu d’accomplir en tant qu’employé et ii) sa rémunération dans le cadre de sa relation de travail (Denisov, précité, § 54). En considération de ces deux constats, elle a jugé qu’il n’y avait aucune raison de conclure que le litige en question ne présentait aucun élément « civil » ou qu’un tel élément n’était pas suffisamment important pour faire entrer en jeu l’article 6 sous son volet « civil ».
113. Poursuivant l’application des critères dégagés dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres, la Cour redit que, pour que la première de ces conditions soit remplie, l’État défendeur doit avoir expressément prévu, dans son droit interne, l’exclusion de l’accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie salariale concernés (voir, Baka, précité, § 113).
‒ Le droit national privait-il les requérants du droit d’accès à un tribunal ?
114. La Cour rappelle que, pour que la législation nationale excluant l’accès à un tribunal ait un quelconque effet au titre de l’article 6 § 1 dans un cas donné, elle doit être compatible avec la prééminence du droit. Cette notion, qui est expressément mentionnée dans le préambule de la Convention et qui est inhérente à tous les articles de ce texte, commande notamment que toute ingérence dans l’exercice d’un droit soit en principe fondée sur un instrument d’application générale (Baka, précité, § 117).
115. La Cour rappelle de plus que, dans les rares affaires où elle a jugé que la première condition du critère « Vilho Eskelinen » était remplie, l’exclusion de l’accès à un tribunal pour le poste en question était claire et « expresse » (voir, Baka, précité, § 113). Par exemple, dans l’affaire Suküt c. Turquie ((déc.), no 29773/00, 1er septembre 2007), qui avait trait à la retraite anticipée d’un militaire pour motifs disciplinaires, la Constitution turque prévoyait clairement que les décisions du Conseil supérieur militaire échappaient à tout contrôle juridictionnel. Il en allait de même des décisions du Conseil supérieur des juges et procureurs dans les affaires Apay et Nazsiz (décisions précitées), qui concernaient respectivement la nomination et la révocation disciplinaire de procureurs (voir aussi Özpınar c. Turquie, no 20999/04, § 30, 19 octobre 2010, qui portait sur la révocation d’un juge pour motifs disciplinaires).
116. La présente affaire doit être distinguée de celles qui sont citées ci‑dessus, car le Gouvernement n’établit pas que le droit national privait les requérants clairement et « expressément » d’accès à un tribunal. À cet égard, la Cour observe que pour appuyer ses arguments à propos d’une telle exclusion dans le chef des requérants, le Gouvernement invoque toute une série d’articles de la loi Pusp sur le statut des juges et les voies de recours dont quelques-unes des décisions concernant les juges seraient susceptibles en droit national. Le Gouvernement s’appuie en outre sur deux exemples tirés de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle polonaise qu’il considère pertinents en l’espèce (paragraphes 36-37 et 63 ci-dessus). Cependant, aucun des articles de loi cités par le Gouvernement ne dispose, et encore moins clairement et « expressément », que les juges qui, outre leurs fonctions judiciaires, exercent des fonctions administratives ou managériales au sein de l’ordre judiciaire sont exclus d’accès à un tribunal en cas notamment de litige consécutif à leur révocation anticipée. Elle considère qu’il en va de même pour les exemples de jurisprudence que le Gouvernement lui a soumis. Elle estime en effet que les arrêts de la Cour constitutionnelle auxquels le Gouvernement se réfère ne sont pas à même de confirmer l’existence d’une pratique interne de nature à exclure de façon abstraite du droit d’accès à un tribunal les juges relevant de la catégorie en question. Cependant, dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si la première condition de l’approche Vilho Eskelinen et autres est satisfaite dès lors que, pour les raisons exposées ci-après, la deuxième condition du même critère n’est pas remplie.
‒ L’exclusion supposée d’accès à un tribunal des requérants reposait-elle sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’État ?
117. Le Gouvernement soutient que du fait de leur nature, les fonctions exercées par les requérants impliquaient l’exercice de prérogatives inhérentes à la souveraineté de l’État et relevaient donc de l’exercice de la puissance publique (paragraphes 58-59). La Cour rappelle à cet égard que le simple fait qu’une personne relève d’un secteur ou d’un service qui participe à l’exercice de la puissance publique n’est pas en lui-même déterminant. Pour que l’exclusion soit justifiée, il faut que l’État montre que l’objet du litige est lié à l’exercice de l’autorité étatique ou remet en cause le lien spécial de confiance et de loyauté entre l’intéressé et l’État (Vilho Eskelinen et autres, précité, § 62).
118. La Cour rappelle avoir souligné dans sa jurisprudence récente le rôle particulier du pouvoir judiciaire dans la société : comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit, celui-ci doit jouir de la confiance des citoyens pour mener à bien sa mission (Baka, précité, § 164, et les références qui y sont citées). Cette considération est tout aussi pertinente dans le cas de l’adoption d’une mesure touchant la carrière d’un juge, telle la révocation des fonctions administratives de l’intéressé au sein de l’ordre judiciaire. Compte tenu de la place éminente, parmi les organes de l’État, qu’occupe la magistrature dans une société démocratique et de l’importance croissante qui s’attache à la prééminence du droit et à la séparation des pouvoirs et à la nécessité de préserver l’indépendance de la justice (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 196, et Guðmundur Andri Ástráðsson [GC], no 26374/18, § 233, 1er décembre 2020), la Cour doit se montrer particulièrement attentive à la protection des juges lorsqu’il s’agit de résoudre des litiges relatifs au maintien en fonction, à la révocation ou aux conditions de service de ceux‑ci.
119. À cet égard, après l’arrêt Vilho Eskelinen et autres (précité), la Cour n’a eu à connaître que de quelques cas où elle a été appelée à discuter du second critère dégagé par elle : dans l’affaire Suküt (décision précitée), où il était question de la mise à la retraite anticipée d’un militaire pour des raisons disciplinaires, et dans l’affaire Spūlis et Vaškevičs c. Lettonie ((déc.), nos 2631/10 et 12253/10, 18 novembre 2014), qui concernait le retrait de leur attestation de sécurité à un requérant qui avait été chargé de tâches de renseignement et de contre-espionnage et à un autre requérant qui occupait l’un des postes les plus élevés au sein du service des recettes de l’État et était responsable du département des enquêtes criminelles des douanes. Dans chacune de ces affaires, elle a estimé que l’exclusion de l’accès à un tribunal était justifiée parce que l’objet du litige était lié à l’exercice de l’autorité étatique ou remettait en cause le « lien spécial de confiance et de loyauté » entre l’individu concerné et l’État, en tant qu’employeur.
120. La Cour constate que la jurisprudence précitée, qui avait trait à un officier de l’armée et à de hauts fonctionnaires, tous rattachés hiérarchiquement au pouvoir exécutif de l’État, ne peut être transposée aux circonstances de la présente affaire, qui concerne des membres du pouvoir judiciaire. Pour la Cour, le critère selon lequel l’objet du litige est lié à la remise en cause du lien spécial de confiance et de loyauté doit être lu à la lumière des garanties d’indépendance du pouvoir judiciaire. Ces deux notions, à savoir le lien spécial de confiance et de loyauté exigé des fonctionnaires et l’indépendance du pouvoir judiciaire, ne sont pas aisément conciliables. Si la relation de travail entre un fonctionnaire et l’État peut traditionnellement être définie sur la base de la confiance et de la loyauté envers le pouvoir exécutif dans la mesure où les employés de l’État sont tenus de mettre en œuvre les politiques gouvernementales, les membres du pouvoir judiciaire bénéficient de garanties spécifiques considérées comme essentielles à l’exercice des fonctions judiciaires et sont soumis au devoir, entre autres, de contrôle des actes du gouvernement. La nature complexe de la relation de travail entre les membres de la magistrature et l’État commande que le pouvoir judiciaire soit suffisamment éloigné des autres branches de l’État dans l’exercice de ses fonctions afin qu’il puisse rendre des décisions fondées a fortiori sur les exigences du droit et de la justice, sans craintes ni faveurs. Il serait illusoire de croire que les magistrats peuvent faire respecter l’État de droit et donner effet au principe de prééminence du droit s’ils sont privés par le droit interne de la protection de la Convention sur les questions touchant directement à leur indépendance et à leur impartialité (voir, mutatis mutandis, Kövesi, précité, § 124, et Bilgen c. Turquie, no 1571/07, § 79, 9 mars 2021).
121. En l’espèce, la Cour souscrit à la thèse des requérants et observe que le Gouvernement défendeur ne lui a soumis aucun argument propre à lui permettre d’établir que l’objet du litige – la cessation prématurée du mandat de chef de juridiction de chacun des requérants – relevait de l’exercice de l’autorité étatique et que l’exclusion des garanties de l’article 6 était donc objectivement justifiée. Elle considère que l’absence de contrôle juridictionnel de la légalité de la décision mettant fin aux mandats respectifs des requérants ne peut servir l’intérêt d’un État qui respecte le principe de prééminence du droit (Kövesi, précité, § 124). La Cour note en outre que les décisions ministérielles de révoquer les requérants n’étaient pas motivées, ce qui l’empêche d’autant plus de considérer que le litige avait trait à des raisons exceptionnelles et impérieuses propres à justifier son exclusion du contrôle juridictionnel (voir, mutatis mutandis, Bilgen, précité, § 80). Elle considère que les juges doivent pouvoir jouir d’une protection contre l’arbitraire des pouvoirs législatif et exécutif, et que seul un contrôle de la légalité de la mesure litigeuse, opéré par un organe judiciaire indépendant, peut assurer l’effectivité d’une telle protection (voir, mutatis mutandis, Kövesi, précité, § 124).
122. Dès lors, même à supposer que la première des conditions du « critère Vilho Eskelinen » soit remplie, le Gouvernement n’est pas en mesure de démontrer que l’exclusion des requérants du droit d’accès à un tribunal était justifiée par des motifs relevant de l’intérêt de l’État et que l’objet du litige était lié à l’exercice de l’autorité étatique ou remettait en cause le « lien spécial de confiance et de loyauté » qui existait entre les intéressés et l’État employeur. En effet, compte tenu du statut particulier des membres du corps judiciaire et de l’importance du contrôle juridictionnel des procédures concernant la révocation ou la destitution des juges, la Cour estime qu’on ne saurait affirmer qu’un lien spécial de confiance entre l’État et les requérants justifiait l’exclusion des droits garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis, Savino et autres c. Italie, nos 17214/05 et 2 autres, § 78, 28 avril 2009).
123. L’article 6 § 1 de la Convention est donc applicable à la lumière de la seconde condition posée dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres.
124. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire d’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention formulée par le Gouvernement.
137. Les parties n’ont pas fait d’autres observations que celles qui sont présentées ci-dessus.
138. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal – c’est‑à‑dire le droit de saisir un tribunal en matière civile – constitue un élément inhérent au droit énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention, qui pose les garanties applicables en ce qui concerne tant l’organisation et la composition du tribunal que la conduite de la procédure. Le tout forme le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 § 1 (Baka, précité, § 120).
139. La Cour rappelle en outre que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX, Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], no 5809/08, § 126, CEDH 2016). Chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, § 54, CEDH 2010, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18, et Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001‑VIII).
140. Toutefois, le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu ; il peut donner lieu à des limitations. Celles-ci ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 78, 5 avril 2018, et Baka, précité, § 120).
141. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe qu’il se dégage des courriers ministériels mentionnés aux paragraphes 6, 8 et 12 ci‑dessus que les décisions de révoquer les requérants de leurs fonctions respectives de vice‑président de juridiction que le ministre de la Justice a adoptées n’étaient susceptibles d’aucun recours. Elle note de plus que le Gouvernement défendeur n’a pas soutenu le contraire dans les observations qu’il lui a communiquées quant à la recevabilité et au fond des présentes requêtes (paragraphes 64-69 ci‑dessus).
142. En ce qui concerne le caractère légitime de la restriction incriminée, la Cour observe qu’il se dégage des observations du Gouvernement résumées ci-dessus au paragraphe 72 que l’exclusion dans le chef des requérants d’un recours pour se plaindre de leur révocation avait pour but de faciliter la mise en œuvre des réformes ministérielles du système judiciaire polonais.
143. Sans contester la légitimité du but invoqué de la restriction litigeuse en tant que tel, la Cour tient à souligner l’importance croissante que les instruments internationaux et ceux du Conseil de l’Europe, ainsi que la jurisprudence des juridictions internationales et la pratique d’autres organes internationaux accordent au respect de l’équité procédurale dans les affaires concernant la révocation ou la destitution de juges, et notamment à l’intervention d’une autorité indépendante des pouvoirs exécutif et législatif pour toute décision touchant à la cessation du mandat d’un juge (Baka, précité, § 121, et Kövesi, précité, § 156, en ce qui concerne les procureurs). Ensuite, la Cour a souligné l’importance croissante qui s’attache à la séparation des pouvoirs et à la nécessité de préserver l’indépendance de la justice (Ramon Nunez de Carvalho e Sá, précité, § 196, et Baka, précité, § 165).
144. En l’espèce, la Cour relève que les requérants ont été prématurément démis de leurs fonctions de chef de juridiction par le ministre de la Justice statuant en application de l’article 17 de la loi du 12 juillet 2017. Elle note que la disposition législative précitée était transitoire et habilitait le ministre impliqué à révoquer les chefs de juridiction à son entière discrétion sans que celui-ci fût tenu par une quelconque condition de fond ou de procédure. Elle observe de plus que les décisions critiquées du ministre de la Justice d’une part n’étaient pas motivées et d’autre part n’ont pas été soumises au contrôle d’un organe externe au ministre concerné et indépendant vis-à-vis de celui-ci.
145. La Cour prend note des déclarations des requérants résumées au paragraphe 78 ci‑dessus et non contestées par le Gouvernement, à propos de leur manière d’exercer leurs fonctions respectives de chef de juridiction et de l’absence d’une quelconque remise en cause de la part du ministre de la Justice de celle-ci. Elle considère que compte tenu des éléments précités et des circonstances ayant entouré leur révocation, les intéressés pouvaient légitimement soupçonner un élément d’arbitraire dans les décisions que le ministre concerné avait prises à leur encontre. La Cour rappelle que l’arbitraire, qui implique la négation de l’état de droit (Al-Dulimi et Montana Management Inc., précité, § 145), est tout aussi intolérable en matière de droits procéduraux qu’en matière de droits substantiels (Muhammad et Muhammad c. Roumanie [GC], no 80982/12, § 118, 15 octobre 2020).
146. Eu égard à l’ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, la Cour ne peut que conclure, d’une part, que la révocation des requérants est intervenue sur la base d’une disposition législative dont la compatibilité avec les exigences de l’État de droit lui paraît douteuse (paragraphes 144‑145 ci-dessus) (voir, mutatis mutandis, Baka, précité, § 117), et d’autre part, que cette mesure n’était entourée d’aucune des exigences fondamentales de l’équité procédurale. La Cour souligne encore que les décisions ministérielles de révoquer les requérants n’étaient accompagnées d’aucune motivation. Elle estime que, dans un cadre juridique comme celui de l’espèce, où la révocation des chefs de juridiction est laissée à l’entière discrétion du ministre de la Justice et les décisions ministérielles de révocation ne sont accompagnées d’aucune motivation, l’absence de tout contrôle de la légalité de ces décisions ne peut être dans l’intérêt de l’État. La Cour relève qu’à la différence du cadre législatif interne en vigueur tant avant l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi du 12 juillet 2017 qu’après la fin de sa période d’application, le cadre juridique national qui était applicable au moment de la révocation des requérants ne les protégeait d’aucune manière que ce soit contre la cessation anticipée et arbitraire de leurs fonctions de vice-président de juridiction (paragraphes 17-32 ci‑dessus). La Cour considère cependant que les magistrats doivent bénéficier d’une protection contre l’arbitraire du pouvoir exécutif, et que seul le contrôle par un organe judiciaire indépendant de la légalité d’une telle décision de révocation est à même de rendre ce droit effectif (voir, mutatis mutandis, Kövesi, précité, § 124).
147. La Cour souligne l’importance accordée tant à la nécessité de sauvegarder l’indépendance du pouvoir judiciaire qu’au respect de l’équité procédurale dans les affaires concernant la carrière de juges. En l’espèce, elle constate non seulement que le cadre juridique national qui était applicable au moment de la révocation des requérants ne précisait pas clairement les conditions dans lesquelles un chef de juridiction pouvait être révoqué par dérogation au principe d’inamovibilité des juges en cours de mandat (Guðmundur Andri Ástráðsson, précité, § 239), mais aussi que la quasi-totalité des pouvoirs en la matière ont été concentrés entre les mains du seul représentant du pouvoir exécutif (voir le paragraphe 98 de l’avis adopté par la Commission de Venise lors de sa 113e session plénière (Venise, 8-9 décembre 2017, CDL-AD(2017)031), cité au paragraphe 38 ci‑dessus, et le paragraphe 47 de l’avis no 19 (2016) adopté par le CCJE le 10 novembre 2016, cité au paragraphe 43 ci-dessus), les organes d’auto‑administration judiciaire, et notamment le CNM, ayant été simultanément exclus de ce processus (voir, le paragraphe 106 de l’avis précité de la Commission de Venise, paragraphe 38 ci-dessus ; pour d’autres éléments internationaux pertinents, voir aussi les paragraphes 1.3 et 7.1-2 de la Charte européenne sur le statut des juges du 8-10 juillet 1998 et les paragraphes 49-52 de l’annexe à la Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres aux États membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilité, adoptée le 17 novembre 2010, cités aux paragraphes 77-78 de l’arrêt Baka, précité, et les autres références pertinentes citées aux paragraphes 79, 81 et 83 du même arrêt). La Cour note en outre les circonstances entourant la révocation des requérants, telles que, notamment, l’exclusion dans le chef des intéressés du droit d’être entendu et du droit de connaître les motifs des décisions ministérielles les concernant et l’absence d’un quelconque contrôle par une instance indépendante du ministre de la Justice impliqué des décisions de révocation critiquées.
148. La Cour relève avec préoccupation que dans ses observations résumées ci-dessus au paragraphe 72, le Gouvernement défendeur a déclaré que le cadre législatif – décrit ci-dessus – de la révocation anticipée des chefs de juridiction lui avait permis de passer outre les procédures applicables en la matière. Or, la Cour constate que ce sont justement ces procédures-là qui en l’espèce constituent les garanties qui se trouvent au cœur du principe, inscrit à l’article 6 de la Convention, selon lequel un « tribunal indépendant » – au sens de cette disposition conventionnelle – est nécessairement « inamovible » (Guðmundur Andri Ástráðsson, précité, § 239), que le juge concerné soit révoqué de ses fonctions judiciaires ou seulement des fonctions administratives qu’il occupait dans les organes de l’autorité judiciaire. Compte tenu de l’importance du rôle qui est dévolu aux juges en matière de protection des droits garantis par la Convention, la Cour estime qu’il est impératif que des garanties procédurales propres à assurer une protection adéquate de l’autonomie judiciaire contre les influences externes (législatives et exécutives) ou internes indues soient mises en place. Ce qui est en jeu est la confiance dans le pouvoir judiciaire (Bilgen, précité, § 96). La Cour considère que lorsqu’il est question de la carrière de juges, comme dans la présente affaire, où le ministre de la Justice a décidé unilatéralement et de manière anticipée de révoquer les requérants, il devrait y avoir des raisons sérieuses propres à justifier une absence exceptionnelle de contrôle juridictionnel. Or, le Gouvernement n’en a fourni aucune à la Cour en l’espèce (ibidem, § 96).
149. La cessation prématurée des mandats de vice‑président de juridiction dont les requérants avaient été investis n’ayant été examinée ni par un tribunal ordinaire ni par un autre organe exerçant des fonctions judiciaires, l’État défendeur a porté atteinte à la substance même du droit pour les requérants d’accéder à un tribunal (Baka, précité, § 121).
150. Partant, il y a eu violation à l’égard des requérants du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
HASAN TUNÇ ET AUTRES c. TURQUIE du 31 janvier 2017 requête 19074/05
Violation de l'article 6-1 pour le non accès à la Cour de Cassation pour cause de valeur trop faible du terrain ainsi que pour la durée de la procédure.
Non violation sur l'absence d'audience de la Cour de Cassation et sur l'examen des preuves par les juridictions internes, la CEDH n'est pas une quatrième instance.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Les requérants se plaignent du rejet de leur recours en rectification d’arrêt par la Cour de cassation. Selon eux, la haute juridiction a commis une erreur d’appréciation en jugeant que la valeur des biens objet du litige était inférieure au seuil exigé par la loi pour pouvoir introduire ce recours. Ils allèguent à cet égard que la valeur en question, telle qu’elle a été estimée par un rapport d’expertise lors de la procédure devant le tribunal de grande instance, était supérieure au seuil légal requis pour le dépôt d’un recours en rectification d’arrêt.
23. Ils se plaignent ensuite que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
24. Ils dénoncent également une absence de débats publics devant la Cour de cassation. Ils allèguent que cette juridiction a rejeté leur demande quant à la tenue d’une audience en raison d’une appréciation erronée de la valeur des biens objet du litige.
25. Les requérants critiquent enfin l’appréciation des preuves effectuées par le tribunal de première instance, reprochant notamment à celui-ci d’avoir accepté et pris en considération des preuves soumises par la partie défenderesse en dehors du délai accordé pour ce faire. Ils se plaignent aussi de l’application du droit interne et de la solution retenue par les juridictions internes.
26. La Cour juge opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur le grief relatif au rejet du recours en rectification d’arrêt
27. Constatant que le grief relatif au rejet du recours en rectification d’arrêt n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
28. Le Gouvernement fait observer que la Cour de cassation a rejeté le recours en rectification d’arrêt introduit par les requérants en considérant que la valeur des biens objet du litige indiquée par les requérants lors de l’introduction de leur demande était inférieure au seuil requis par la loi. Il soutient que la condition de la valeur de l’objet du litige prévue par la loi pour la recevabilité des recours en rectification d’arrêt est conforme à l’article 6 de la Convention.
29. La Cour estime que les requérants se plaignent en substance d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal.
30. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 § 1 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits ou obligations de caractère civil. Ce « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, peut être invoqué par toute personne qui a des raisons sérieuses d’estimer illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits de caractère civil et qui se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18).
31. La Cour rappelle en outre que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 précité que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce, no 39442/98, § 15, CEDH 2000‑XII).
32. La Cour rappelle également que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour l’introduction des recours (Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII, et Mottola et autres c. Italie, no 29932/07, § 29, 4 février 2014). Les règles relatives aux délais à respecter pour recourir visent à assurer une bonne administration de la justice. Cela étant, l’application qui est faite des règles en question ne devrait pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible. Par ailleurs, il convient dans chaque cas que la Cour procède à une appréciation à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit et en fonction du but et de l’objet de l’article 6 § 1 de la Convention (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 36, CEDH 2000‑I).
33. La Cour rappelle aussi qu’il résulte de ces principes que, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, no 35787/03, § 29, 26 juillet 2007). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 24, 27 juillet 2006).
34. La Cour rappelle encore qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I, et Perez c. France [GC], no 47287/99, § 82, CEDH 2004‑I), par exemple si elles peuvent exceptionnellement s’analyser en un « manque d’équité » incompatible avec l’article 6 de la Convention. Si cette disposition garantit le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, par exemple, Dulaurans c. France, no 34553/97, §§ 33-34 et 38, 21 mars 2000, Khamidov c. Russie, no 72118/01, § 170, 15 novembre 2007, Anđelković c. Serbie, no 1401/08, § 24, 9 avril 2013, et Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 61, CEDH 2015).
35. La Cour note qu’en droit turc le recours en rectification d’arrêt a pour objet d’inviter la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué à réviser cette décision en raison d’une erreur de sa part. En fait, la juridiction en cause procède à un deuxième examen de la même affaire sur simple recours des parties, sans qu’il y ait d’éléments nouveaux (Dedecan et Ok c. Turquie, nos 22685/09 et 39472/09, § 23, 22 septembre 2015, et Gök et autres c. Turquie, nos 71867/01, 71869/01, 73319/01 et 74858/01, § 50, 27 juillet 2006).
36. La Cour rappelle avoir déjà considéré que le recours en rectification d’arrêt, tel qu’il est prévu en droit turc pour les procédures civiles, constitue un recours interne efficace au sens des principes du droit international généralement reconnus (voir Molin İnşaat c. Turquie, (déc.) no 23762/94, 7 septembre 1995, et Latif Fuat Öztürk et autres c. Turquie, no 54673/00, § 29, 2 février 2006).
37. La Cour note ensuite que, selon l’article 440 de la loi sur la procédure civile, applicable à l’époque des faits, ce recours était accessible aux parties pour les affaires dont l’objet du litige avait une valeur supérieure à 150 000 000 TRL (paragraphe 17 ci-dessus).
38. La Cour constate qu’en l’espèce la Cour de cassation a rejeté le recours en rectification d’arrêt formé par les requérants en jugeant que la valeur des biens objet du litige, tel qu’elle était précisée par les requérants à la date de l’introduction de leur demande, à savoir 13 000 000 TRL, était inférieure au seuil exigé par la loi pour l’introduction d’un tel recours.
39. Or, la Cour relève que, le 10 février 1999, le tribunal de grande instance, en se fondant sur le rapport d’expertise du 30 novembre 1998 estimant la valeur des biens litigieux à 5 450 625 000 TRL, a demandé aux requérants de payer des frais de justice supplémentaires et que les intéressés ont réglé ces frais le 12 février 1999. La valeur actualisée des biens objet du litige, acceptée par le tribunal de grande instance, était donc de 5 450 625 000 TRL.
40. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’en rejetant le recours en rectification d’arrêt introduit par les requérants en prenant en considération la valeur des biens litigieux indiquée par ceux-ci au début de la procédure, et non pas celle acceptée ultérieurement par le tribunal de grande instance sur la base du rapport d’expertise, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif (voir, dans ce sens, Zubac c. Croatie, no 40160/12, § 40, 11 octobre 2016).
41. En effet, le recours des requérants pouvait bien être considéré comme répondant aux conditions de recevabilité énoncées par la loi puisque la valeur des biens objet du litige sur la base de laquelle les requérants ont payé les frais de justice, en l’occurrence 5 450 625 000 TRL, était bien supérieure au seuil exigé pour l’introduction du recours en rectification d’arrêt à l’époque des faits, à savoir 150 000 000 TRL.
42. Partant, la Cour estime que l’interprétation particulièrement stricte par la Cour de cassation de l’article 440 de la loi sur la procédure civile a restreint de façon disproportionnée le droit des requérants à voir leur recours en rectification d’arrêt examiné au fond (voir Reichman c. France, no 50147/11, § 38, 12 juillet 2016, et Miessen c. Belgique, no 31517/12, § 73, 18 octobre 2016).
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce.
B. Sur le grief relatif à la durée de la procédure
43. La Cour fait d’abord observer qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Elle rappelle que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle requête, faute pour les requérants d’avoir fait usage des voies de recours internes, notamment le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée de la procédure.
44. La Cour rappelle également que dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, § 77) elle a précisé notamment qu’elle pourrait poursuivre, par la voie de la procédure normale, l’examen des requêtes du même type qui avaient été communiquées au Gouvernement avant l’adoption de l’arrêt pilote en question. Elle note en outre que le Gouvernement n’a pas soulevé dans le cadre de la présente affaire une exception portant sur ce nouveau recours. À la lumière de ce qui précède, elle décide de poursuivre l’examen de la présente requête.
45. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
46. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse ne peut être considérée comme déraisonnable au regard de la complexité de l’affaire. Il allègue en outre que les requérants ont eux-mêmes contribué à la prolongation du délai de la procédure. À cet égard, il affirme que les requérants ont fait preuve d’un manque de diligence puisqu’ils auraient été absents à certaines audiences et que leur avocat a formulé des demandes de délais supplémentaires pour soumettre ses observations à deux reprises.
47. La Cour constate que la période à prendre en considération a débuté le 1er novembre 1996 par la première demande introductive d’instance déposée par les requérants devant le tribunal de grande instance et qu’elle s’est terminée le 1er novembre 2004 par le rejet de leur recours en rectification d’arrêt par la Cour de cassation. La durée globale de la procédure en cause était donc d’environ huit ans pour deux degrés de juridiction.
48. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
49. La Cour rappelle ensuite avoir conclu à maintes reprises à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans des affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce (voir, entre autres, Mehmet Yolcu c. Turquie, no 33200/05, §§ 26-30, 15 novembre 2012, Şevket Kürüm et autres c. Turquie, no 54113/08, §§ 61-67, 25 novembre 2014, et Sodan c. Turquie, no 18650/05, §§ 66-69, 2 février 2016). En l’espèce, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure a été excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
50. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
C. Sur le grief relatif à l’absence d’audience devant la Cour de cassation
51. La Cour note d’abord que, selon l’article 435 de la loi no 1086 sur la procédure civile, tel qu’il était applicable à l’époque des faits, la tenue d’une audience devant la Cour de cassation était possible pour les affaires qui étaient relatives à une créance ou à un bien et dont l’objet du litige avait une valeur supérieure à 10 000 000 000 TRL. La valeur des biens objet du litige dans l’affaire des requérants étant de 5 450 625 000 TRL, la Cour n’aperçoit pas d’erreur d’appréciation quant au rejet de la demande de tenue d’audience.
52. La Cour souligne ensuite que plusieurs audiences ont eu lieu devant la juridiction de première instance. Eu égard au rôle de la Cour de cassation dans le système juridique, elle estime que l’absence de débats en deuxième instance n’est pas de nature à entacher l’équité de la procédure, telle que prévue à l’article 6 de la Convention (Suat Ünlü c. Turquie, no 12458/03, § 65, 15 janvier 2008, et Emire Eren Keskin c. Turquie (déc.), no 49564/99, 16 décembre 2003).
53. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D. Sur le grief relatif à l’appréciation des preuves et à l’issue de la procédure
54. La Cour rappelle que, aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz, précité, § 28). La Cour ne peut apprécier elle‑même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (nº 3), 24 novembre 1994, § 44, série A nº 296-C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie, nº 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
55. En l’espèce, la Cour note que les requérants mettent en cause la façon dont les juridictions ont interprété et appliqué le droit interne pertinent ainsi que l’issue de la procédure. Elle estime que le simple désaccord des requérants avec l’appréciation des preuves faite par les tribunaux internes ne l’autorise pas à conclure que la procédure devant les juridictions internes n’a pas été équitable. De surcroît, elle ne décèle rien dans le dossier qui permette de croire que celles-ci ont fait preuve d’une attitude arbitraire en statuant en défaveur des intéressés.
56. Il s’ensuit que cette partie de la requête est de type « quatrième instance » et qu’elle doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
GRANDE CHAMBRE BAKA c. HONGRIE du 21 juin 2016 requête 20261/12
Violation de l'article 6-1 de la Convention, le requérant n'a pas eu accès à un tribunal pour faire examiner la légalité de la cessation prématurée de son mandat de président de la Cour suprême.
1. Les principes établis dans la jurisprudence de la Cour
100. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, § 90, CEDH 2012, et Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 42, CEDH 2015).
101. L’article 6 § 1 n’assure aux « droits et obligations » (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants : la Cour ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné (voir, par exemple, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 119, CEDH 2005‑X, et Boulois, précité, § 91).
102. En ce qui concerne le « caractère civil » du droit, la Cour avait dit, avant d’adopter son arrêt Vilho Eskelinen et autres, que les litiges du travail entre les autorités et des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’État n’étaient pas des litiges « civils » et qu’ils ne relevaient donc pas du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention (Pellegrin, précité, § 66). À la suite de l’adoption dans l’arrêt Pellegrin du critère fonctionnel, les litiges du travail concernant des emplois dans la magistrature ont été soustraits du champ d’application de l’article 6 § 1 car elle a considéré que, s’ils ne faisaient pas partie de l’administration au sens strict, les magistrats n’en faisaient pas moins partie de la fonction publique au sens large (Pitkevich c. Russie (déc.), no 47936/99, 8 février 2001, et, en ce qui concerne le président d’une juridiction suprême, Harabin (décision précitée).
103. Lorsqu’elle a précisé la portée de la notion de « caractère civil » dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres, la Cour a élaboré de nouveaux critères quant à l’applicabilité de l’article 6 § 1 à des litiges du travail concernant des fonctionnaires. Selon ces critères, pour que l’État défendeur puisse invoquer devant la Cour le statut de fonctionnaire à propos d’un requérant afin de soustraire celui-ci à la protection offerte par l’article 6, deux conditions doivent être réunies. En premier lieu, le droit interne de l’État concerné doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal s’agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’État. Pour cela, il ne suffit pas que l’État démontre que le fonctionnaire en question participe à l’exercice de la puissance publique ou qu’il existe, pour reprendre les termes employés dans l’arrêt Pellegrin, un « lien spécial de confiance et de loyauté » entre l’intéressé et l’État employeur. Il faut aussi que l’État montre que l’objet du litige est lié à l’exercice de l’autorité étatique ou remet en cause le lien spécial susmentionné. Ainsi, rien en principe ne justifie de soustraire aux garanties de l’article 6 les conflits ordinaires du travail – tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou d’autres droits de ce type – à raison du caractère spécial de la relation entre le fonctionnaire concerné et l’État en question. En pratique, il y aura présomption que l’article 6 trouve à s’appliquer, et il appartiendra à l’État défendeur de démontrer, premièrement, que d’après le droit national le requérant fonctionnaire n’a pas le droit d’accéder à un tribunal, et, deuxièmement, que l’exclusion des droits garantis par l’article 6 à l’égard de ce fonctionnaire est fondée (Vilho Eskelinen et autres, précité, § 62).
104. Si, dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres, la Cour a dit que son raisonnement se limitait à la situation des fonctionnaires (paragraphe 61 de l’arrêt), la Grande Chambre note que les critères établis dans cet arrêt ont été appliqués par différentes chambres de la Cour à des litiges concernant des juges (G. c. Finlande, no 33173/05, 27 janvier 2009, Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, CEDH 2013, Di Giovanni c. Italie, no 51160/06, 9 juillet 2013, et Tsanova-Gecheva c. Bulgarie, no 43800/12, 15 septembre 2015), y compris des présidents de juridictions suprêmes (Olujić c. Croatie, no 22330/05, 5 février 2009, et Harabin c. Slovaquie, no 58688/11, 20 novembre 2012). La Grande Chambre ne voit pas de raison de s’écarter de cette approche. Elle considère que, s’ils ne font pas partie de l’administration au sens strict, les magistrats n’en font pas moins partie de la fonction publique au sens large (Pitkevich, décision précitée).
105. La Cour note aussi que les critères énoncés dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres ont été appliqués à tous les types de litiges concernant des fonctionnaires et des juges, y compris des litiges relatifs au recrutement ou à la nomination (Juričić c. Croatie, no 58222/09, 26 juillet 2011), à la carrière ou à la promotion (Dzhidzheva-Trendafilova (déc.), no 12628/09, 9 octobre 2012), à la mutation (Ohneberg c. Autriche, no 10781/08, § 25, 18 septembre 2012) et à la cessation de service (affaires Olujić (arrêt précité) et Nazsiz (décision précitée), concernant respectivement la révocation disciplinaire du président de la Cour suprême et la révocation disciplinaire d’un procureur). Dans l’arrêt G. c. Finlande (précité, §§ 31‑34), où le gouvernement défendeur soutenait que le droit pour un juge de demeurer en fonction était particulier et ne pouvait être assimilé à un « conflit ordinaire du travail » au sens de l’arrêt Vilho Eskelinen et autres, la Cour a implicitement rejeté cet argument pour appliquer les principes posés dans cet arrêt. De manière plus explicite, elle a dit dans l’arrêt Bayer c. Allemagne (no 8453/04, § 38, 16 juillet 2009), qui concernait la révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire d’un huissier employé par l’État, que les litiges portant sur « un salaire, une indemnité ou d’autres droits de ce type » n’étaient que des exemples parmi d’autres de « conflits ordinaires du travail », auxquels l’article 6 devait en principe s’appliquer en vertu du critère Eskelinen. Dans l’arrêt Olujić (précité, § 34), elle a dit que la présomption d’applicabilité de l’article 6 découlant de l’arrêt Eskelinen s’appliquait aussi aux cas de révocation.
106. La Cour tient encore à souligner que, contrairement à ce que suggère le Gouvernement, le critère Eskelinen relatif à l’applicabilité de l’article 6 § 1 est tout aussi pertinent pour les affaires portant sur le droit d’accès à un tribunal (voir, par exemple, Nedeltcho Popov c. Bulgarie, no 61360/00, 22 novembre 2007, et Sükut c. Turquie (déc.), no 59773/00, 11 septembre 2007) qu’il l’est pour celles concernant les autres garanties consacrées par cette disposition (comme il l’était par exemple dans l’affaire Vilho Eskelinen et autres, qui traitait du droit à une audience et du droit à une décision dans un délai raisonnable). Appelée à statuer sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la lumière de ce critère, la Grande Chambre ne voit pas de raison d’établir une distinction entre les différentes garanties contenues dans cette disposition.
2. Application des principes précités en l’espèce
a) Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention
i. Sur l’existence d’un droit
107. La Cour note que le 22 juin 2009 le requérant a été élu président de la Cour suprême pour un mandat de six ans par le Parlement (décision no 55/2009) conformément à l’article 48 § 1 de la Constitution de 1949. Les règles régissant le mandat de président de la Cour suprême figuraient non dans la Constitution de 1949 mais, jusqu’à la fin dudit mandat (31 décembre 2011), dans la loi LXVI de 1997 sur l’organisation et l’administration des tribunaux (paragraphes 40-43 ci‑dessus). En vertu de l’article 62 de cette loi, les présidents des juridictions figuraient au nombre des « chefs de juridiction », c’est-à-dire des juges chargés de la gestion et de l’administration des tribunaux. Élu président de la Cour suprême conformément à l’article 48 § 1 de la Constitution de 1949, le requérant était un « chef de juridiction ». D’après l’article 69 de la loi LXVI, les chefs de juridiction étaient nommés pour six ans. La conséquence incontestée de cette disposition est que le mandat du requérant à la présidence de la Cour suprême aurait dû en principe être de six ans (du 22 juin 2009 au 22 juin 2015). L’article 73 de la loi prévoyait une liste exhaustive de motifs de cessation du mandat des chefs de juridiction (commun accord, démission, destitution, expiration du mandat et cessation des fonctions judiciaires du titulaire du mandat). Comme l’indique cette disposition, à moins qu’un mandat ne prît fin parce qu’il avait expiré ou parce que la personne cessait d’exercer ses fonctions judiciaires (alinéas d) et e)), il ne pouvait y être mis un terme que dans les cas suivants : commun accord, démission ou destitution (alinéas a) à c)). De plus, l’article 74/A § 1 prévoyait que le seul motif possible de destitution était l’incompétence avérée pour l’exercice de fonctions managériales, auquel cas l’intéressé pouvait solliciter le contrôle juridictionnel de la mesure de destitution devant le tribunal de la fonction publique (paragraphe 43 ci-dessus). Il ressort donc de ces dispositions qu’il existait un droit pour le titulaire du mandat d’accomplir celui-ci jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de son mandat de juge. L’existence de ce droit est en outre démontrée par le fait que, s’il venait à être mis fin au mandat de manière anticipée contre le gré de son titulaire, c’est-à-dire par destitution, l’intéressé pouvait solliciter un contrôle juridictionnel de la décision correspondante (voir, mutatis mutandis, Zander c. Suède, 25 novembre 1993, § 24, série A no 279‑B).
108. De plus, les principes constitutionnels relatifs à l’indépendance de la magistrature et à l’inamovibilité des juges confirmaient que le droit pour le requérant d’accomplir l’intégralité de son mandat à la présidence de la Cour suprême était protégé. L’article 48 § 3 de la Constitution de 1949 établissait que les juges ne pouvaient être révoqués que pour des motifs et selon des procédures prévus par la loi. L’article 50 § 3 de la Constitution garantissait quant à lui l’indépendance des juges (paragraphe 38 ci-dessus).
109. En conséquence, à la lumière du cadre législatif interne en vigueur au moment de l’élection du requérant et pendant son mandat, la Cour considère que l’intéressé pouvait prétendre de manière défendable que le droit hongrois le protégeait d’une cessation de son mandat de président de la Cour suprême pendant cette période. À cet égard, elle attache un certain poids au fait que la Cour constitutionnelle n’a pas rejeté pour défaut de base légale le recours constitutionnel formé par l’ancien vice-président de la Cour suprême contre la cessation prématurée de son mandat (paragraphe 55 ci-dessus). Avant de le débouter, la haute juridiction a examiné le bien‑fondé de son grief, de sorte qu’elle a statué sur le litige concernant le droit de l’ancien vice-président – équivalent à celui du requérant – d’accomplir l’intégralité de son mandat.
110. Enfin, la Cour considère que le fait qu’il a été mis fin au mandat du requérant ex lege, par l’effet de la nouvelle loi entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (article 185 de la loi CLXI de 2011 sur l’organisation et l’administration des tribunaux et article 11 des dispositions transitoires de la Loi fondamentale) en vertu de la nouvelle Loi fondamentale, ne peut anéantir, rétroactivement, le caractère défendable du droit que lui garantissaient les règles qui étaient applicables au moment de son élection. Comme indiqué ci-dessus, ces règles prévoyaient clairement un mandat présidentiel de six ans ainsi que les motifs précis pour lesquels il pouvait prendre fin. Étant donné que c’est cette nouvelle législation qui a annulé les anciennes règles, elle constitue l’objet même du « litige » auquel il s’agit de savoir si les garanties d’équité de la procédure découlant de l’article 6 § 1 doivent s’appliquer. Dans les circonstances de la présente affaire, on ne peut donc pas trancher sur la base de la nouvelle législation la question de savoir s’il existait un droit en droit interne.
111. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’en l’espèce, il y avait une contestation réelle et sérieuse sur un « droit » que le requérant pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit interne (voir, mutatis mutandis, Vilho Eskelinen et autres, précité, § 41, et Savino et autres c. Italie, nos 17214/05, 20329/05 et 42113/04, §§ 68-69, 28 avril 2009).
ii. Sur le « caractère civil » du droit en cause : application du critère Eskelinen
112. La Cour doit à présent déterminer, en fonction du critère énoncé dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres, si le « droit » revendiqué par le requérant était de « caractère civil » au sens autonome que prend cette notion à l’article 6 § 1.
113. La première condition de ce critère est que le droit national « exclue expressément » l’accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie de salariés en question. À cet égard, la Cour note que, dans les rares affaires où elle a jugé que cette condition était remplie, l’exclusion de l’accès à un tribunal pour le poste en question était claire et « expresse ». Par exemple, dans l’affaire Süküt (décision précitée), qui avait trait à la retraite anticipée d’un militaire pour motifs disciplinaires, la Constitution turque prévoyait clairement que les décisions du Conseil supérieur militaire échappaient à tout contrôle juridictionnel. Il en allait de même des décisions du Conseil supérieur des juges et procureurs dans les affaires Serdal Apay et Nazsiz (décisions précitées), qui concernaient respectivement la nomination et la révocation disciplinaire de procureurs (voir aussi Özpınar c. Turquie, no 20999/04, § 30, 19 octobre 2010, qui portait sur la révocation d’un juge pour motifs disciplinaires). Dans l’affaire Nedeltcho Popov (arrêt précité), une disposition du code du travail bulgare prévoyait clairement que les juridictions internes n’étaient pas compétentes pour connaître des litiges relatifs à la révocation de titulaires de certains postes au Conseil des ministres, dont celui occupé par le requérant (conseiller principal). Bien que cette restriction ait ultérieurement été déclarée inconstitutionnelle (sans effet rétroactif), la Cour a noté qu’« au moment de la révocation du requérant » celui-ci n’avait pas, en vertu du cadre juridique interne, le droit d’accéder à un tribunal pour intenter une action pour révocation abusive (Nedeltcho Popov, précité, § 38).
114. La Cour considère que la présente affaire est à distinguer des affaires susmentionnées en ce que le requérant, titulaire du mandat en question avant que le litige ne naisse, n’était pas « expressément » exclu du droit d’accès à un tribunal. Au contraire, le droit interne prévoyait expressément le droit à un tribunal dans les circonstances limitées où la destitution d’un chef de juridiction était possible : le chef de juridiction démis avait en effet le droit de contester sa destitution devant le tribunal de la fonction publique (paragraphe 43 ci-dessus). Dans ce cadre, le droit interne permettait à l’intéressé de bénéficier d’une protection judiciaire, conformément aux normes internationales et aux normes du Conseil de l’Europe relatives à l’indépendance de la magistrature et aux garanties procédurales applicables en cas de révocation de juges (voir, en particulier, le point 20 des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature au paragraphe 72 ci-dessus, l’Observation générale no 32 du Comité des droits de l’homme des Nations unies au paragraphe 73 ci‑dessus, la jurisprudence pertinente du Comité des droits de l’homme des Nations unies aux paragraphes 74 à 76 ci-dessus, les paragraphes 1.3, 5.1 et 7.2 de la Charte européenne sur le statut des juges au paragraphe 77 ci‑dessus, les paragraphes 59-60 de l’Avis no 1 (2001) du Conseil consultatif de juges européens sur les normes relatives à l’indépendance et l’inamovibilité des juges au paragraphe 79 ci-dessus, le paragraphe 6 de la Magna Carta des juges du CCJE au paragraphe 81 ci-dessus et la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme au paragraphe 84 ci-dessus).
115. Néanmoins, le requérant a été empêché d’accéder à un tribunal par le fait que la mesure litigieuse, à savoir la cessation prématurée de son mandat de président de la Cour suprême, a été incluse dans les dispositions transitoires de la loi sur l’organisation et l’administration des tribunaux entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Il s’est ainsi vu priver de la possibilité de contester cette mesure devant le tribunal de la fonction publique, alors qu’il aurait pu le faire s’il avait été démis de son mandat en vertu du cadre légal existant (paragraphe 43 ci‑dessus). De plus, et à la différence du vice‑président de la Cour suprême, au mandat duquel il avait aussi été mis fin par un texte législatif, à savoir les dispositions transitoires de la loi sur l’organisation et l’administration des tribunaux, le requérant a été démis de son mandat par l’effet des dispositions transitoires de la Loi fondamentale, entrées elles aussi en vigueur le 1er janvier 2012 (paragraphe 49 ci‑dessus). Dans ces conditions particulières, le requérant, contrairement à l’ancien vice-président de la Cour suprême (paragraphe 55 ci‑dessus), n’a pas introduit de recours constitutionnel contre la disposition légale mettant fin à son mandat.
116. À la lumière de ces considérations, la Cour est d’avis que dans les circonstances particulières de l’espèce, elle doit déterminer si l’accès à un tribunal était exclu en droit interne non pas au moment où la mesure litigieuse concernant le requérant a été adoptée mais avant cela. Procéder autrement reviendrait à admettre que la mesure litigieuse elle-même, constitutive de l’ingérence alléguée dans le « droit » du requérant, pourrait en même temps former la base légale de l’impossibilité faite à l’intéressé d’accéder à un tribunal. Pareille approche ouvrirait la voie à des abus, car elle permettrait aux États contractants d’interdire l’accès à un tribunal relativement aux mesures individuelles prises à l’égard de leurs fonctionnaires, en incluant simplement ces mesures dans une disposition de loi ad hoc non soumise au contrôle juridictionnel.
117. À cet égard, la Cour tient à souligner que, pour que la législation nationale excluant l’accès à un tribunal ait un quelconque effet au titre de l’article 6 § 1 dans un cas donné, elle doit être compatible avec la prééminence du droit. Cette notion, qui est expressément mentionnée dans le préambule de la Convention et qui est inhérente à tous les articles de ce texte, commande notamment que toute ingérence dans l’exercice d’un droit soit en principe basée sur un instrument d’application générale (voir, mutatis mutandis, Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 99, 25 octobre 2012, et, en ce qui concerne les ingérences de nature législative et la prééminence du droit, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, §§ 47-50, série A no 301‑B). La Commission de Venise a dit aussi relativement au cas du requérant que les lois visant uniquement un individu donné étaient contraires à l’état de droit (paragraphe 59 ci‑dessus).
118. À la lumière de ce qui précède, on ne peut pas conclure que le droit national « excluait expressément l’accès à un tribunal » pour contester la régularité d’une cessation prématurée du mandat du président de la Cour suprême. La première condition du critère Eskelinen n’est donc pas remplie, de sorte que l’article 6 trouve à s’appliquer sous son volet civil. Les deux conditions du critère devant être remplies pour que l’application de l’article 6 soit exclue, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de déterminer si la seconde condition est satisfaite (voir, par exemple, Karaduman et Tandoğan c. Turquie, nos 41296/04 et 41298/04, § 9, 3 juin 2008).
119. Il s’ensuit que l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement quant à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejetée.
b) Sur le respect de l’article 6 § 1 de la Convention
120. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal – c’est-à-dire le droit de saisir un tribunal en matière civile – constitue un élément inhérent au droit énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention, qui pose les garanties applicables en ce qui concerne tant l’organisation et la composition du tribunal que la conduite de la procédure. Le tout forme le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 § 1 (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18). Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu. Il peut être soumis à des limitations pour autant que celles-ci ne restreignent ni ne réduisent l’accès de l’individu au juge d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Markovic et autres c. Italie [GC], no 1398/03, § 99, CEDH 2006‑XIV, et Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012).
121. En l’espèce, la cessation prématurée du mandat de président de la Cour suprême conféré au requérant n’a pas été examinée par un tribunal ordinaire ou par un autre organe exerçant des fonctions judiciaires, et elle ne pouvait pas l’être. Cette absence de contrôle juridictionnel résulte d’un texte de loi dont la compatibilité avec les exigences de l’état de droit est douteuse (paragraphe 117 ci-dessus). Même si ses conclusions précédentes quant à l’applicabilité de l’article 6 ne préjugent pas de l’issue de son examen de la question du respect de cette disposition (Vilho Eskelinen et autres, précité, § 64, et Tsanova-Gecheva, précité, § 87), la Cour ne peut manquer de constater l’importance croissante que les instruments internationaux et ceux du Conseil de l’Europe ainsi que la jurisprudence des juridictions internationales et la pratique d’autres organes internationaux accordent au respect de l’équité procédurale dans les affaires concernant la révocation ou la destitution de juges, et notamment à l’intervention d’une autorité indépendante des pouvoirs exécutif et législatif pour toute décision touchant à la cessation du mandat d’un juge (paragraphes 72‑77, 79, 81 et 84 ci‑dessus). Dans ces conditions, la Cour considère que l’État défendeur a porté atteinte à la substance même du droit pour le requérant d’accéder à un tribunal.
122. Partant, il y a eu violation à l’égard du requérant du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
PAROISSE GRECO-CATHOLIQUE LUPENI ET AUTRES c. ROUMANIE arrêt du 19 mai 1995 requête 76943/11
Non violation de l'article 6 : la CEDH n'a pas pouvoir d'examiner la qualité de la loi interne qui prévoit une procédure en réparation
70. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier en soi le système législatif mis en place par le législateur roumain pour régler la situation juridique des lieux de culte ayant appartenu aux églises gréco‑catholiques et transférés pendant le régime totalitaire dans le patrimoine de l’Église orthodoxe. Il ne lui appartient pas non plus de trancher quant aux règles de droit applicables en général dans une action en revendication portant sur un lieu de culte. La Cour se bornera donc, autant que possible, à examiner les problèmes concrets dont elle se trouve saisie (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 34, série A no 333‑B). Si elle n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales quant à l’application du droit interne, il lui appartient de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention. À cette fin, elle doit néanmoins en l’espèce se pencher sur le critère de la « volonté des fidèles des communautés détentrices de ces biens » pour décider si l’application de celui-ci a porté atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal.
71. À cet égard, la Cour constate que les juridictions internes ne se sont pas déclarées incompétentes pour connaître de l’affaire mais qu’elles ont examiné celle-ci au fond avant de la déclarer manifestement mal fondée. Elles ont exposé qu’elles entendaient appliquer le critère de la loi spéciale en recourant à des éléments de fait concrets. Ainsi, elles ont tenu compte du contexte historique, des contributions financières des différentes parties à la construction de l’église et de la manière dont cet édifice a été utilisé (paragraphes 28 à 30 ci-dessus). Elles ont procédé à un examen dans le temps du critère de la volonté des fidèles des communautés détentrices du bien, et elles ont pris en compte des éléments historiques et sociaux et non pas uniquement des éléments statistiques. Elles ont examiné tous les moyens des requérants au fond, point par point, sans jamais se voir contraintes de décliner leur compétence pour y répondre ou pour rechercher les faits pertinents. Elles ont rendu des arrêts soigneusement motivés et les arguments des requérants qui étaient importants pour l’issue de l’affaire ont fait l’objet d’un examen approfondi. La Cour constate ainsi que les juridictions internes ont disposé en l’espèce de la plénitude de juridiction pour appliquer et interpréter la loi interne, sans avoir été tenues par le refus formulé par la partie orthodoxe dans la procédure amiable préalable. En outre, le contrôle auquel elles ont procédé était d’une étendue suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, Potocka et autres c. Pologne, no 33776/96, §§ 56-59, CEDH 2001‑X, et, a contrario, Terra Woningen B.V. c. Pays-Bas, 17 décembre 1996, § 52, Recueil 1996‑VI).
72. La Cour rappelle que l’effectivité du droit d’accès à un tribunal demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (Bellet, précité, § 36). Elle constate qu’en l’espèce les requérants ont bénéficié d’un examen approfondi de leur action par un juge. Le seul fait qu’ils estiment injuste le critère prévu par la loi spéciale, à savoir « la volonté des fidèles des communautés détentrices des biens », n’est pas suffisant pour rendre ineffectif leur droit d’accès à un tribunal.
73. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que les requérants ont pu exercer leur droit d’accès à un tribunal. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Bellet C. France du 4 décembre 2015 requête 23805/94
Violation de l'article 6 : Le requérant n'était pas prévenu que le fait d'accepter une négociation, l'empêchait d'aller au tribunal.
33. La Cour souligne que la mise en place par l'État français d'un mécanisme d'indemnisation spécifique des personnes hémophiles et transfusées atteintes du sida démontre un remarquable esprit de solidarité (paragraphes 18-21 ci-dessus).
34. Toutefois, en l'espèce, la Cour n'a pas à apprécier en soi le système français d'indemnisation. Elle se bornera donc, autant que possible, à examiner les problèmes concrets dont elle se trouve saisie (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Philis c. Grèce du 27 août 1991, série A n° 209, p. 21, par. 61). Si elle n'a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales quant à l'application du droit interne, il lui appartient de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention. A cette fin, elle doit néanmoins se pencher sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 dans la mesure où les limitations au droit d'accès résultent des modalités d'exercice des recours offerts à M. Bellet.
35. La Cour n'a pas à étudier la question de savoir si l'acceptation par le requérant de l'offre du fonds d'indemnisation s'analyse ou non en une transaction, dès lors que le Gouvernement n'avance plus cet argument. Reste à rechercher si la cour d'appel, en déclarant irrecevable l'action du requérant, a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal.
36. Le fait d'avoir pu emprunter les voies de recours internes mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l'article 6 par. 1 (art. 6-1): encore faut-il que le degré d'accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l'individu le "droit à un tribunal" eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique. L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir l'arrêt de Geouffre de la Pradelle précité, p. 43, par. 34).
37. En l'espèce, la Cour relève que le requérant pouvait raisonnablement croire à la possibilité d'introduire ou de poursuivre des actions parallèles à sa demande d'indemnisation présentée au fonds, même après acceptation de l'offre de ce dernier.
Compte tenu du libellé de l'article 47 VIII de la loi, on ne saurait reprocher à M. Bellet de s'être référé à l'intention du législateur, telle qu'elle ressortait des travaux parlementaires. D'après ceux-ci, le législateur a effectivement souhaité que les victimes, fussent-elles déjà indemnisées, conservent leur intérêt à agir. A la lumière de la loi et des travaux préparatoires, M. Bellet, qui avait de bonne foi accepté l'indemnité, ne devait pas s'attendre à ce que la cour d'appel déclare son recours irrecevable.
Au total, le système ne présentait pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané.
38. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour constate que le requérant n'a pas bénéficié d'un droit d'accès concret et effectif devant la cour d'appel de Paris. Partant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
FAUTE DES JURIDICTIONS QUI EMPÊCHE LE RECOURS
DOMENECH FIGUEROA c. ESPAGNE du 28 septembre 2021 requête n° 54696/18
Article 6-1 : L'erreur entre la demande principale et la demande subsidiaire du tribunal a eu pour conséquence que le requérant n'a pas pu saisir avec espoir de succès la cour de cassation
FAITS
5. Le requérant était employé dans un établissement bancaire et, au vu de l’annonce de la fermeture de toutes les agences, il décida d’adhérer volontairement au licenciement collectif qui avait été convenu avec l’entreprise. Après un certain temps, aucune agence n’ayant finalement été fermée, le requérant entama une procédure civile ordinaire, demandant à titre principal la nullité de son adhésion au plan de licenciement collectif pour cause de vice de consentement (articles 1265, 1269, 1270 et 1300 du code civil espagnol) et, à titre subsidiaire, l’indemnisation du préjudice subi (article 1101 du code civil espagnol). Au cours de la procédure orale, il renonça expressément à la prétention subsidiaire et maintint la prétention principale.
6. Par un jugement du 23 décembre 2015, le juge des affaires sociales no 13 de Málaga débouta le requérant. Il déclara par erreur que celui-ci avait retiré sa demande en nullité formée à titre principal et qu’il avait maintenu la demande d’indemnisation formée à titre subsidiaire. En tout état de cause, la prétention principale fut également tranchée au fond puisque le juge conclut que l’existence d’un vice de consentement n’avait pas été prouvée.
7. À la suite d’une demande du requérant, le juge des affaires sociales rendit le 26 janvier 2016 une décision qui corrigeait cette erreur et précisait que la prétention que l’intéressé avait maintenue et qui avait été tranchée était bien la demande en nullité formée à titre principal.
8. Le requérant fit appel (suplicación) du jugement de première instance. Il exposa explicitement que la procédure concernait une action en nullité et fit expressément mention de la décision corrigeant l’erreur commise dans le jugement. De même, il indiqua que par son recours devant la juridiction d’appel il entendait bien faire déclarer nulle son adhésion au licenciement collectif et obtenir sa réintégration à son poste.
9. Par un arrêt daté du 11 janvier 2017, le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie débouta le requérant de son appel. Il commit la même erreur que celle faite précédemment et exposa que le requérant avait maintenu sa demande subsidiaire et retiré sa demande principale. Le requérant fit une demande de rectification, qui fut rejetée par une décision du 1er février 2017. La juridiction d’appel déclara que l’erreur éventuellement commise était imputable au requérant et qu’en tout état de cause la demande en nullité, à supposer qu’elle eût été maintenue, aurait été rejetée car elle aurait dû être invoquée dans le cadre d’une procédure de règlement des conflits du travail et non d’une procédure ordinaire telle qu’en l’espèce. La demande en nullité introduite ultérieurement par le requérant fut rejetée le 29 mars 2017 par la même juridiction.
10. Le requérant se pourvut en cassation. En faisant une demande d’harmonisation de la jurisprudence, il exposa que l’arrêt rendu par le Tribunal supérieur de justice était en contradiction avec les conclusions formulées par d’autres tribunaux supérieurs de justice espagnols. Selon lui, la question juridique objet de décisions contradictoires était celle de savoir si une demande en nullité d’un licenciement pouvait être formée dans le cadre d’une procédure ordinaire ou si elle exigeait le déclenchement d’une procédure de règlement des conflits du travail.
11. Par une décision rendue le 12 décembre 2017, le Tribunal suprême déclara le pourvoi en cassation irrecevable. Il exposa que, dès lors que les arguments rendus par le Tribunal supérieur de justice dans la décision du 1er février 2017 concernant l’inadéquation de la procédure civile ordinaire étaient des obiter dicta, la contradiction jurisprudentielle n’était pas réelle en l’espèce mais hypothétique. Ainsi, il n’était pas possible d’examiner la contradiction jurisprudentielle alléguée par le requérant.
12. Le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision rendue le 29 mai 2018, signifiée au requérant le 1er juin 2018, cette haute juridiction déclara irrecevable le recours d’amparo, estimant qu’il n’avait pas de pertinence constitutionnelle particulière.
Art 6-1
a) Principes généraux
19. L’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil (Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 97, CEDH 2009 ; Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 80, 5 avril 2018).
20. Par ailleurs, en ce qui concerne l’application de restrictions légales à l’accès aux juridictions supérieures découlant du taux du ressort, la Cour a pris en considération, à différents degrés, certains facteurs : i) la prévisibilité de la restriction, ii) le point de savoir si c’est le requérant ou l’État défendeur qui doit supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure et qui ont eu pour effet de priver le requérant d’un accès à la juridiction suprême, et iii) celui de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif » (Zubac, précité, § 85).
21. S’agissant en particulier du deuxième critère, il n’est pas rare que, pour trancher la question de la proportionnalité, la Cour identifie les erreurs procédurales commises au cours de la procédure et qui, en définitive, ont empêché le requérant d’accéder à un tribunal, et qu’elle détermine si l’intéressé a dû supporter une charge excessive en raison de ces erreurs. Lorsque l’erreur procédurale en question n’est imputable qu’à un côté, selon le cas celui du requérant ou celui des autorités compétentes, notamment la juridiction (ou les juridictions), la Cour a habituellement tendance à faire peser la charge sur celui qui a commis l’erreur (Šimecki c. Croatie, no 15253/10, §§ 46-47, 30 avril 2014 ; Egić c. Croatie, no 32806/09, § 57, 5 juin 2014 ; Sefer Yılmaz et Meryem Yılmaz c. Turquie, no 611/12, §§ 72‑73, 17 novembre 2015 ; Zubac, précité, § 90).
22. La Cour rappelle toujours qu’il ne lui appartient pas généralement de connaître des erreurs de fait et de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf erreur manifeste d’appréciation ayant porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I ; Perez c. France [GC], no 47287/99, § 82, CEDH 2004‑I). Il est extrêmement rare que la Cour remette en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux en estimant que leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (en ce sens, voir Dulaurans c. France, no 34553/97, § 38, 21 mars 2000 ; Khamidov c. Russie, no 72118/01, § 170, 15 novembre 2007 ; Anđelković c. Serbie, no 1401/08, § 24, 9 avril 2013 ; Lazarević c. Bosnie‑Herzégovine, no 29422/17, § 32, 14 janvier 2020 ; Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, §§ 63-65, CEDH 2015).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
23. La Cour estime que le cas d’espèce ne concerne pas l’application d’une restriction légale à l’accès à une juridiction supérieure découlant du taux du ressort (paragraphes 20-21 ci-dessus). Elle observe cependant que les principes généraux mentionnés à ce sujet sont pertinents, mutatis mutandis, pour trancher la présente affaire.
24. La Cour note qu’au cours de la procédure la juridiction interne a commis une erreur en déclarant que le requérant avait retiré sa demande en nullité du licenciement, formée à titre principal, et qu’il avait maintenu sa demande d’indemnisation du préjudice, formée à titre subsidiaire, alors que c’était exactement le contraire. La juridiction de première instance a corrigé l’erreur en temps utile et a bien précisé que, en tout état de cause, la demande en nullité du licenciement formée à titre principal avait été tranchée sur le fond. Néanmoins, la juridiction d’appel a par la suite refait la même erreur bien que le recours du requérant fût clair à propos de l’action qu’il entendait engager. De plus, il faisait expressément mention de la décision rendue par le juge de première instance le 26 janvier 2016 (paragraphe 8 ci-dessus). Le Tribunal supérieur de justice n’a pas corrigé l’erreur malgré la demande adressée par le requérant. Il a cependant tranché au fond la demande principale (la demande en nullité du licenciement), exposant que dans tous les cas elle avait été formée au moyen d’une procédure inadéquate.
25. En ce sens, il y a lieu de noter que le refus du Tribunal supérieur de justice de corriger cette erreur a postérieurement entraîné l’irrecevabilité du pourvoi en cassation du requérant. En effet, dès lors que les arguments présentés par la juridiction d’appel pour trancher la demande en nullité formée à titre principal étaient des obiter dicta, le Tribunal suprême a conclu qu’il n’était pas possible d’examiner la contradiction jurisprudentielle alléguée par le requérant (paragraphe 11 ci-dessus).
26. En application des principes généraux exposés ci-dessus, la Cour relève que l’erreur commise par la juridiction interne a eu pour effet de priver le requérant d’un accès à la juridiction suprême. Elle estime que le requérant a dû supporter une charge excessive en raison de cette erreur, d’autant plus que celle-ci était exclusivement imputable à la juridiction en question. En effet, si la juridiction d’appel avait corrigé son erreur, les arguments présentés pour trancher l’action en justice du requérant n’auraient pas été des obiter dicta, et de ce fait le Tribunal suprême aurait tranché différemment le pourvoi en cassation de l’intéressé. Il s’ensuit qu’en raison de cette erreur de fait, imputable à la juridiction interne, une décision indéniablement erronée a été rendue en l’espèce. Ainsi, l’erreur commise par le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie a porté atteinte au droit du requérant à un accès effectif au Tribunal suprême (Laskowska c. Pologne, no 77765/01, §§ 60-61, 13 mars 2007 ; Šimecki, précité, §§ 46‑47 ; Sefer Yılmaz et Meryem Yılmaz, précité, §§ 72-73).
27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
DROIT D'ACCES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Cliquez sur un lien bleu pour accéder gratuitement à la JURISPRUDENCE DE LA CEDH sur :
- LA RESTRICTION DOIT ÊTRE PROPORTIONNÉE ENTRE LES DROITS DU JUSTICIABLE ET LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
- EN MATIÈRE FISCALE, IL EST POSSIBLE QUE LE TRIBUNAL NE PUISSE PAS MODULER UNE PÉNALITÉ FISCALE
- LA DIFFICULTÉ D'INTERPRÉTATION D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE
- LA NON EXÉCUTION DE LA DÉCISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST UN NON ACCES AU TRIBUNAL
LA RESTRICTION DOIT ÊTRE PROPORTIONNÉE ENTRE LES DROITS
DU JUSTICIABLE ET LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH BELGIQUE du 11 juillet 2023 Requêtes nos 1269/13 et 4 autres
cedh
Principes généraux
49. L’article 6 de la Convention ne s’oppose pas à ce que dans une procédure de nature administrative, une « peine » soit imposée d’abord par une autorité administrative. Il requiert cependant que la décision d’une autorité ne remplissant pas elle-même les conditions de l’article 6 §1 de la Convention subisse le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction (Segame SA précité, § 55, Grande Stevens et autres précité, § 139, A. Menarini Diagnostics S.r.l. précité, § 59, SA-Capital Oy c. Finlande, no 5556/10, § 72, 14 février 2019).
50. Parmi les caractéristiques d’un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l’organe inférieur. Cet organe doit notamment avoir la compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Grande Stevens et autres précité, §139, A. Menarini Diagnostics S.R.L. précité, §59, Chevrol c. France, no 49636/99, § 77, CEDH 2003‑III et Silvester’s Horeca Service c. Belgique, no 47650/99, § 27, 4 mars 2004).
51. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 6 n’a en principe pas pour objet de garantir l’accès à un tribunal qui pourrait substituer sa propre appréciation ou son propre avis à ceux des autorités administratives (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 178, 6 novembre 2018 et SA Patronale hypothécaire c. Belgique, no 14139/09, § 47, 17 juillet 2018).
52. Toutefois, un tribunal ne peut être considéré comme jouissant de la plénitude de juridiction au sens de l’article 6 § 1 de la Convention que s’il a le pouvoir d’apprécier la proportionnalité entre la faute commise et la sanction infligée (Diennet c. France, 26 septembre 1995, § 34, série A no 325‑A et Mérigaud c. France, no 32976/04, § 69, 24 septembre 2009).
53. Par ailleurs, si les exigences du procès équitable sont plus rigoureuses en matière pénale qu’en matière civile, la Cour n’exclut pas que, dans le cadre de certaines procédures pénales, les garanties offertes par l’article 6 ne doivent pas nécessairement s’appliquer dans toute leur rigueur (Jussila c. Finlande [GC], précité no 73053/01, §§ 43 - 44, CEDH 2006‑XIV, Vegotex International S.A., précité, § 76). À cet égard, la nature d’une procédure administrative peut différer sous plusieurs aspects, de la nature pénale au sens strict du terme. Si ces différences ne sauraient exonérer les États contractants de leur obligation de respecter toutes les garanties offertes par le volet pénal de l’article 6, elles peuvent néanmoins influencer les modalités de leur application (A. Menarini Diagnostics S.r.l., précité, § 62).
54. Afin d’évaluer si, dans un cas donné, les juridictions internes ont effectué un contrôle d’une étendue suffisante au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, il convient de prendre en considération les compétences attribuées à la juridiction en question et des éléments tels que : a) l’objet du litige ; b) les garanties procédurales existant dans le cadre de la procédure administrative soumise au contrôle juridictionnel ; c) l’office du juge, à savoir la méthode de contrôle, ses pouvoirs décisionnels et la motivation de sa décision, apprécié, dans le cadre de l’instance juridictionnelle en cause, eu égard la teneur du litige, aux questions qu’il soulève et aux moyens présentés à ce titre (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, §§ 179, 196 et 199 à 213).
b) Application au cas d’espèce
55. Le litige portait en l’espèce sur la contestation d’amendes administratives infligées à la requérante pour avoir commis des infractions aux normes de bruit définies par la Région de Bruxelles-Capitale et ce, après que le Procureur du Roi a décidé de ne pas engager de poursuites pénales à son encontre (paragraphe 23 ci-dessus). Les décisions furent contestées devant le Collège d’environnement – à partir du moment où un tel recours fut mis en place – et ensuite devant le Conseil d’État.
56. La Cour observe que l’IBGE et le Collège d’environnement sont des autorités administratives au regard du droit interne et ne peuvent être considérés comme des « tribunaux » offrant toutes les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention. Néanmoins, elle constate que la requérante a pu bénéficier d’un certain nombre de garanties devant ces autorités. Ainsi, la requérante disposait de la possibilité de consulter les données brutes à la base des procès-verbaux d’infraction et d’en contester la matérialité. Elle a pu faire valoir ses moyens de défense, en fait et en droit, devant ces instances tant par écrit qu’oralement. Elle a également été entendue par le Collège d’environnement et pouvait solliciter une audition auprès de l’IBGE. Elle a en outre pu communiquer l’ensemble des documents et moyens de preuve qu’elle souhaitait. Par ailleurs, les décisions tant de l’IBGE que du Collège d’environnement étaient motivées et répondaient, dans la limite de leurs compétences, aux différents moyens soulevés par la requérante.
57. La Cour note que la requérante avait la possibilité de contester les amendes administratives qui lui ont été infligées au moyen d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, ce qu’elle a fait (paragraphes 25 et suivants ci-dessus).
58. La requérante formule toutefois plusieurs critiques à l’endroit du contrôle tel qu’il a été pratiqué par le Conseil d’État en l’espèce.
59. Elle fait premièrement valoir que le contrôle effectué par le Conseil d’État n’était pas un contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 § 1 de la Convention eu égard au fait que celui-ci disposait uniquement de la possibilité d’annuler la décision litigieuse et ne pouvait substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative (paragraphe 43 ci-dessus).
60. Sur ce point, la Cour a déjà jugé, comme exposé ci-avant (paragraphe 51 ci-dessus), que le rôle de l’article 6 n’est en principe pas de garantir l’accès à un tribunal qui pourrait substituer sa propre appréciation ou son propre avis à ceux des autorités administratives. Partant, aux yeux de la Cour, le fait que la compétence du Conseil d’État se limitait, en l’espèce, à l’annulation des décisions litigieuses et ne s’étendait pas à leur réformation n’est pas un problème en soi au regard de l’article 6 de la Convention (voir, dans le même sens, à propos du Conseil d’État de Belgique : SA Patronale hypothécaire, précité, § 48, voir également à propos du Conseil d’État de France : Dahan c. France, no 32314/14, § 61, 3 novembre 2022).
61. La Cour relève qu’en droit belge, dans le cadre d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d’État exerce un contrôle de pleine légalité. Il est notamment habilité à contrôler l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité des motifs sur lesquels repose la sanction administrative attaquée et à vérifier si celle-ci n’est pas disproportionnée au regard des faits reprochés. La Cour note également que les trois plus hautes juridictions belges considèrent de manière constante et unanime que ce contrôle, ainsi circonscrit, répond aux exigences de l’article 6 de la Convention (paragraphes 27 et suivants ci-dessus).
62. La Cour a déjà jugé que le pouvoir conféré au Conseil d’État dans le cadre de la procédure en annulation était a priori de nature à rencontrer les exigences de l’article 6 de la Convention sous son volet « civil » (SA Patronale hypothécaire, précité, §§ 44-50). Elle ne voit pas de raisons la conduisant de parvenir à une conclusion différente s’agissant du volet « pénal » de l’article 6.
63. Néanmoins, il ne suffit pas d’apprécier les pouvoirs du Conseil d’État dans l’abstrait. Il revient en effet à la Cour de se concentrer sur le cas dont elle est saisie (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 56, CEDH 2002-X) et de s’assurer que le Conseil d’État a exercé un contrôle suffisant au regard des exigences de l’article 6 de la Convention dans le cas d’espèce. En effet, la Convention vise à protéger des droits concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32).
64. En l’espèce, la Cour relève à l’examen du dossier que, dans toutes les affaires en cause, le Conseil d’État a procédé à un examen approfondi, point par point, de l’ensemble des moyens soulevés par la requérante et y a répondu de manière précise et détaillée. Elle observe que, conformément aux exigences de l’article 6 § 1 (paragraphe 52 ci-dessus), le Conseil d’État a opéré un contrôle de la proportionnalité de l’amende infligée par rapport aux infractions constatées, chaque fois qu’elle y a été invitée par la requérante (arrêts no224.234 du 3 juillet 2013 et no227.801 du 23 juin 2014).
65. Deuxièmement, la requérante fait valoir le fait que le Conseil d’État s’est déclaré incompétent pour examiner certains moyens qu’elle a invoqués et qu’il n’aurait pas examiné tous les arguments de fait et de droit qu’elle estimait utiles à son recours (paragraphe 43 ci-dessus).
66. La Cour relève que les moyens invoqués par la requérante ont été examinés par le Conseil d’État mais ont été déclarés irrecevables, soit parce qu’ils revenaient à solliciter du Conseil d’État qu’il se substituât à l’autorité administrative, ce qu’il n’était pas habilité à faire, soit parce que ces moyens n’avaient pas été invoqués conformément aux règles de procédure applicables.
67. S’agissant de la compétence d’annulation du Conseil d’État et l’absence de pouvoir de substitution, la Cour renvoie aux développements qui précèdent et l’absence de contrariété à l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard (paragraphes 60 à 64 ci-dessus).
68. S’agissant des moyens déclarés irrecevables pour tardiveté, la Cour relève que, selon le Conseil d’État, la requérante n’a pas respecté les règles imposées par la procédure en droit interne. À cet égard, la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et que des limitations, notamment de délai, peuvent être prévues par la règlementation de l’État. Si les États contractants jouissent à cet égard d’une certaine marge d’appréciation, ces limitations ne peuvent restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Ronald Vermeulen c. Belgique, no 5475/06, § 43, 17 juillet 2018). En l’espèce, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ni de manifestement déraisonnable dans l’appréciation par le Conseil d’État du respect de la législation applicable qui vise à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice administrative (voir Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 149, 20 mars 2018, J.C. et autres c. Belgique, no 11625/17, § 55, 12 octobre 2021). Par conséquent, il ne peut être considéré qu’en déclarant irrecevables les moyens soulevés par la requérante pour cause de tardiveté, le Conseil d’État aurait porté atteinte de manière disproportionnée au droit d’accès à un tribunal de la requérante.
69. Quant au fait que le Conseil d’État s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur l’existence d’un faux en écriture, la Cour constate qu’il appartenait à la requérante, selon le droit interne, d’initier une procédure en inscription de faux et de solliciter du Conseil d’État qu’il sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure (paragraphe 31 ci-dessus), ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à se plaindre d’une violation de son droit d’accès à un tribunal.
70. En ce qui concerne le fait que la durée de la procédure devant le Conseil d’État n’était pas une cause d’annulation des décisions administratives déférées à son contrôle, la Cour rappelle qu’elle a rayé du rôle la partie des requêtes relative à la question du respect du délai raisonnable (paragraphe 37 ci-dessus).
71. Troisièmement et enfin, la requérante critique le fait que le Conseil d’État n’aurait pas procédé à un (nouvel) examen des faits et des preuves présentés devant lui (paragraphe 44 ci-dessus). Cependant, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que le Conseil d’État n’aurait pas procédé dans l’ensemble des affaires en cause à un examen des faits et des preuves présentés devant lui. La Cour constate à cet égard que la partie requérante se contente de formuler une allégation sans apporter des éléments concrets et pertinents pour l’étayer.
72. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le Conseil d’État a procédé, dans l’ensemble des affaires en cause, à un contrôle d’une portée suffisante au regard de l’article 6 § 1 de la Convention.
73. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
Dahan c. France du 3 novembre 2022 requête no 32314/14
L’étendue du contrôle juridictionnel exercé par le Conseil d’État sur la sanction de mise à la retraite d’office d’un ambassadeur garantit le respect des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention
Non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable / droit à un tribunal impartial) de la Convention européenne des droits de l’homme
L’affaire concerne la procédure disciplinaire engagée, en raison de son comportement jugé inadapté envers le personnel féminin, contre M. Dahan, alors qu’il était ambassadeur, et ayant débouché sur la sanction de mise à la retraite d’office prononcée par le président de la République. Elle porte sur le respect du principe d’impartialité dans le cours de la procédure interne. La Cour juge tout d’abord que le volet civil de l’article 6 § 1 de la Convention s’applique aux faits de l’espèce. Elle relève ensuite que ni l’autorité hiérarchique du requérant en charge de la procédure administrative, qui prévoyait l’intervention d’un avis rendu par un conseil de discipline ni l’autorité compétente pour prononcer la sanction ne sont pas des organes juridictionnels. Elle en déduit qu’il n’était pas nécessaire de rechercher si ces autorités administratives ont pris leurs décisions dans des conditions répondant aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. En revanche, la Cour précise qu’elle doit s’assurer que le requérant a bénéficié du contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de « pleine juridiction » respectant les exigences de l’article 6 § 1 et exerçant un contrôle juridictionnel sur la sanction d’une étendue suffisante. À cet égard, elle constate que le Conseil d’État a exercé, au bénéfice de l’évolution de jurisprudence qu’il a consentie à l’occasion du litige du requérant, un entier contrôle, y compris sur la proportionnalité de la décision de mise à la retraite d’office. L’étendue d’un tel contrôle juridictionnel coïncidant avec celle du contrôle de « pleine juridiction » au sens de la jurisprudence de la Cour, elle conclut que la cause du requérant a été examinée dans le respect des exigences posées par l’article 6 § 1 de la Convention.
FAITS
Le requérant, Paul Dahan, est un ressortissant français né en 1949. Il réside à Paris. En 2009, il fut nommé ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe. En juillet 2010, M. Dahan fit l’objet d’une évaluation à 360° (c’est-à-dire y compris de la part de ses subordonnés). Le commentaire sur sa manière de servir y indiquait qu’il remplissait correctement sa mission mais qu’il n’avait pas « pris la mesure des insatisfactions créées par des insuffisances dans le management du poste et surtout par ses attitudes déplacées vis-à-vis de l’autre sexe ». En août 2010, à la suite d’une plainte adressée par l’une de ses collaboratrices au ministère des Affaires étrangères et européennes, il fut convoqué par le directeur général de l’administration et de la modernisation de ce ministère (M.R.) et prit connaissance d’allégations relatives à son comportement à l’égard des femmes. En septembre 2010, l’Inspection générale du ministère envoya une mission sur place, à Strasbourg. Quelques jours plus tard, M.R., en sa qualité de directeur général de l’administration, demanda à M. Dahan de ne pas reprendre à son poste à Strasbourg et lui fit savoir qu’il était « placé en position de mission à l’administration centrale ». Le rapport d’inspection, daté du 17 septembre 2010, rapporta le comportement du requérant à l’égard du personnel féminin de la Représentation permanente, notamment ses agissements à l’encontre d’une agente contractuelle décrits comme constitutifs d’un acharnement particulier et ayant entraîné une détérioration de sa santé physique et psychologique. Ce rapport recommandait qu’il soit mis fin aux fonctions du requérant. Puis, par décret du 30 septembre 2010, le président de la République nomma un nouveau Représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe. Par la suite, M. Dahan demanda au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir ce décret ainsi que l’évaluation dont il avait fait l’objet. Puis, en novembre 2010, il fut informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son égard par M.R., en sa qualité de président de la commission administrative paritaire, et fut convoqué devant la commission réunie en conseil de discipline le 7 décembre 2010. Ce jour-là, la commission administrative, présidée par M.R., rendit son avis et se prononça en faveur de la mise à la retraite d’office du requérant. Finalement, le président de la République prononça la mise à la retraite d’office du requérant par décret du 3 février 2011, notifié le 1 er mars suivant. Puis, par arrêté du 8 mars 2011, le ministre décida la radiation du requérant du corps des ministres plénipotentiaires à compter du 4 mars 2011. En mars 2011, le requérant demanda au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 février 2011 et l’arrêté du 8 mars 2011. En juillet et novembre 2013, le Conseil d’État rejeta toutes les requêtes de M. Dahan, dont celle dirigée contre la sanction de mise à la retraite d’office.
ARTICLE 6-1
a) Principes généraux
50. La Cour rappelle en premier lieu sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu’une autorité administrative chargée d’examiner des contestations portant sur des « droits et obligations de caractère civil » ne remplit pas toutes les exigences de l’article 6 § 1, il n’y a pas de violation de la Convention si la procédure devant cet organe a fait l’objet du contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article (Ramos Nunes de Carvalho, précité, § 132 et les références citées ; voir, également, s’agissant d’une procédure administrative devant le conseil médical de l’aéronautique civile, Chaudet c. France, no 49037/06, § 36, 29 octobre 2009 et, en matière pénale, s’agissant d’une procédure relative à une sanction fiscale, Segame SA c. France, no 4837/06, §§ 54 et 55, CEDH 2012 (extraits)).
51. En second lieu, la Cour rappelle que, dans l’arrêt précité Ramos Nunes de Carvalho, tout en soulignant la définition autonome qu’il convient de retenir de la notion de « plénitude de juridiction » (§§ 177 et 178), elle a précisé les critères au regard desquels il convient d’apprécier l’étendue du contrôle juridictionnel. En premier lieu, s’agissant des litiges relevant du volet civil de l’article 6 § 1 de la Convention, il faut que le tribunal ait compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (§ 176). En deuxième lieu, une telle « plénitude de juridiction » implique que le tribunal saisi soit doté de compétences d’une étendue suffisante ou exerce un contrôle juridictionnel suffisant pour traiter l’affaire en cause (§ 177). En troisième lieu, afin d’évaluer si, dans un cas donné, le tribunal saisi a effectué un contrôle d’une étendue suffisante, il convient de prendre en considération les compétences attribuées à la juridiction en question ainsi que les éléments suivants : a) l’objet du litige ; b) les garanties procédurales existant dans le cadre de la procédure administrative soumise au contrôle juridictionnel ; c) l’office du juge, à savoir la méthode de contrôle, ses pouvoirs décisionnels et la motivation de sa décision (§§ 179, 196 et 199 à 213), apprécié, dans le cadre de l’instance juridictionnelle en cause, eu égard la teneur du litige, aux questions qu’il soulève et aux moyens présentés à ce titre.
b) Application en l’espèce
52. La question des suites disciplinaires à donner au comportement du requérant a d’abord fait l’objet d’une procédure administrative consultative menée par le conseil de discipline qui a proposé à l’autorité compétente, qui n’était pas liée par son avis, de prononcer la sanction de la mise à la retraite d’office. L’autorité compétente, le président de la République, a ensuite prononcé, par décret, cette sanction dont le requérant a demandé l’annulation pour excès de pouvoir au Conseil d’État. La Cour souligne que ni le conseil de discipline ni l’autorité compétente en matière disciplinaire ne sont des organes juridictionnels.
53. Dans ces conditions, alors même qu’était en cause un droit de caractère civil au sens de l’article 6 § 1, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si les autorités administratives en charge de la procédure disciplinaire répondaient aux exigences de cette disposition (Chaudet, précité § 36). En effet, quelles que soient l’organisation de la procédure administrative telle que prévue par les textes applicables et telle qu’elle a été assurée au cas d’espèce dans le cadre de leur mise en œuvre et les différentes fonctions qu’y a successivement exercées M. R. en sa qualité de directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères, il n’y a pas lieu, pour la Cour, de vérifier si le conseil de discipline a rendu son avis dans des conditions répondant aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. En revanche, elle doit s’assurer que le requérant a joui du droit à un tribunal et à une solution juridictionnelle du litige (Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], no 26374/18, § 219, 1er décembre 2020, Benthem c. Pays-Bas, 23 octobre 1985, § 40, série A no 97), tant pour les points de fait que pour les questions de droit (Chaudet précité § 36). À ce titre, il lui revient de vérifier si le requérant a bénéficié du contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de « pleine juridiction » respectant les exigences de cet article et exerçant un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante.
54. Dans la mesure où le respect, par la procédure juridictionnelle suivie devant le Conseil d’État, des exigences de l’article 6 § 1 n’est pas contesté par le requérant au soutien de son grief, la Cour limitera son examen, au regard des critères énoncés au paragraphe 51 ci-dessus, à la question de savoir si le Conseil d’État, organe judiciaire de contrôle dans la présente affaire, jouissait d’une plénitude de juridiction et si le contrôle qu’il a exercé sur la sanction litigieuse était suffisant.
55. La Cour relève que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du requérant visait à déterminer si ce dernier avait manqué à ses obligations professionnelles et, dans l’affirmative, à réprimer son comportement fautif. A l’appui de sa requête dirigée devant le Conseil d’État contre la sanction de mise à la retraite d’office finalement prononcée à son encontre, le requérant soulevait des questions concernant son comportement et les faits qui lui étaient reprochés vis-à-vis du personnel féminin de la Représentation permanente, qu’il contestait depuis le début de la procédure disciplinaire engagée contre lui. Les moyens du requérant portaient ainsi tant sur des questions de droit que des éléments de fait.
56. La Cour souligne par ailleurs que même lorsqu’elles ne relèvent pas du volet pénal de l’article 6 de la Convention, les sanctions disciplinaires peuvent avoir de lourdes conséquences sur la vie, la réputation et la carrière des diplomates. La gravité de la sanction infligée au requérant en l’espèce, l’exclusion du corps des ministres plénipotentiaires auquel il appartenait, devait donc faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité, seul à même de garantir, selon sa jurisprudence, un contrôle « suffisant » (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 201).
Les garanties de procédure devant l’instance disciplinaire
57. Alors même que, dans les circonstances particulières de l’espèce, ainsi qu’elle l’a exposé ci-dessus (paragraphe 53 ci-dessus), il n’y a pas lieu pour la Cour d’examiner les garanties qui ont entouré la conduite de la procédure administrative afin de se prononcer sur l’étendue du contrôle juridictionnel qu’il incombait au juge interne d’exercer sur la sanction infligée, au terme de celle-ci, au requérant, il lui paraît utile, pour la complète compréhension du litige, de relever les éléments suivants.
58. En vertu des textes applicables (paragraphes 23 et 27 ci-dessus), la sanction litigieuse a été prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à savoir le président de la République, au terme d’une procédure disciplinaire conduite par l’autorité hiérarchique du requérant, à savoir le ministre des Affaires étrangères ou, sur délégation, le directeur général de l’administration du ministère et au vu de l’avis rendu par un organe administratif consultatif, la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. La Cour relève que la procédure prévue devant ce conseil de discipline a contribué à garantir les droits de la défense du requérant tels qu’ils s’appliquent en droit interne. Elle note que celui-ci a été informé des poursuites déclenchées à son encontre, s’est vu notifier les griefs qui lui étaient reprochés et a pu présenter des observations écrites dans un délai suffisant avant la tenue du conseil de discipline. Devant ce dernier, il était assisté par un conseil et a disposé de la faculté de faire utilement valoir ses arguments en défense. Le conseil de discipline a en outre décidé de procéder à une confrontation du requérant avec les principaux protagonistes de l’affaire. La Cour relève par ailleurs que le conseil de discipline a rendu un avis motivé, en indiquant de manière précise les faits reprochés au requérant et en justifiant la sanction proposée pour les réprimer.
59. Par ailleurs, la Cour relève que tant l’autorité disciplinaire que le conseil de discipline sont soumis, dans l’ordre juridique interne, au principe général d’impartialité qui gouverne l’ensemble de l’action administrative (paragraphe 29 ci-dessus).
Le contrôle juridictionnel du Conseil d’État
60. S’agissant du caractère suffisant ou non du contrôle juridictionnel, la Cour relève qu’en ce qui concerne l’examen du bien-fondé de la sanction, le Conseil d’État a exercé, au bénéfice de l’évolution de jurisprudence qu’il a consentie à cette occasion, un entier contrôle, y compris sur la proportionnalité de la décision de mise à la retraite d’office (paragraphes 20 et 31 ci-dessus).
61. La sanction prononcée contre le requérant a ainsi fait l’objet d’un contrôle dit entier (autrement appelé contrôle normal) de la part du Conseil d’État, juge de l’excès de pouvoir (paragraphe 31 ci-dessus), susceptible d’aboutir, le cas échéant, à l’annulation de cette sanction. L’étendue d’un tel contrôle coïncide avec celle du contrôle de « pleine juridiction » au sens de la jurisprudence de la Cour (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 178 et les références citées).
62. S’agissant du bien-fondé de la sanction, le contrôle exercé par le Conseil d’État dans la présente affaire a porté, à la faveur de l’évolution de jurisprudence qu’elle a suscitée, sur l’exactitude matérielle des faits, la qualification juridique des faits et la proportionnalité de la sanction.
63. À cet égard, la Cour relève que le requérant a pu bénéficier de cette évolution de jurisprudence qui s’accorde avec les exigences du contrôle de « pleine juridiction » au sens de la jurisprudence de la Cour (comparer avec Diennet c. France, 26 septembre 1995, § 34, série A no 325‑A et Mérigaud c. France, no 32976/04, § 69, 24 septembre 2009).
64. La Cour rappelle ensuite que dans le contexte particulier d’une procédure disciplinaire, les points de fait revêtent, à l’égal des questions juridiques, une importance déterminante pour l’issue d’une procédure relative à « des droits et obligations de caractère civil » (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 203). Or, elle note qu’en l’espèce, le Conseil d’État a pris soin de vérifier que la sanction n’avait pas été prononcée « sur le fondement de faits matériellement inexacts » et que les manquements qui étaient reprochés au requérant justifiaient une sanction au vu « des pièces du dossier, et des nombreux témoignages recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire ». Ainsi, il ressort des motifs de sa décision qu’il s’est livré à une appréciation de la matérialité des faits pour s’assurer qu’ils étaient légalement de nature à justifier la sanction infligée. La Cour relève au surplus que le Conseil d’État a tenu une audience au cours de laquelle l’avocat du requérant a pu prendre la parole et revenir sur les faits et la version de ce dernier à leur propos. Elle note enfin que sa décision énumère de manière explicite les faits qui ont motivé la sanction (paragraphe 20 ci-dessus, point 4).
65. La Cour souligne enfin que la sanction infligée au requérant a fait l’objet d’un entier contrôle de proportionnalité qui a porté sur l’appréciation du degré de gravité de cette sanction par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. Ce contrôle a ainsi permis une mise en balance des impératifs d’efficacité de l’action administrative et des intérêts du requérant. À cet égard, elle note que le Conseil d’État a pris en compte tant le passé et la manière de servir du requérant que la gravité des faits qui lui étaient reprochés et sa place dans la hiérarchie pour considérer que la mesure de radiation choisie par l’administration n’était pas excessive.
66. Il résulte de ce qui précède que le recours pour excès de pouvoir présenté par le requérant a conduit le Conseil d’État à exercer, dans le cadre de la plénitude de juridiction, un contrôle d’une étendue suffisante.
Conclusion
67. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent la Cour conclut que la cause du requérant a été examinée dans le respect des exigences posées par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
Edizioni Del Roma Societa Cooperativa A.R.L. et Edizioni del Roma S.R.L. c. Italie
du 10 décembre 2020 requête n° 68954/13
Article 6-1 : La procédure devant les juridictions administratives consécutive à l’application de sanctions pécuniaires par l’autorité administrative a respecté la Convention
Ces deux affaires concernent les sanctions pécuniaires infligées par l’autorité italienne de régulation des télécoms (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – « l’AGCOM ») aux sociétés requérantes, qui exerçaient des activités dans le domaine de l’édition. A la suite de ces sanctions, ces sociétés perdirent les financements publics dont elles bénéficiaient, ce qui provoqua la faillite de l’une d’entre elles. La Cour considère donc que la procédure devant l’AGCOM n’a pas satisfait à toutes les exigences de l’article 6 de la Convention, notamment en ce qui concerne l’égalité des armes entre l’accusation et la défense, et la tenue d’une audience publique permettant une confrontation orale. Cependant, les juridictions administratives – le tribunal administratif régional et le Conseil d’Etat – ont pu vérifier si, par rapport aux circonstances particulières de l’affaire, l’AGCOM avait fait un usage approprié de ses pouvoirs et ont pu examiner le bien-fondé et la proportionnalité de ses choix.
Art 6 § 1 (pénal) • Contrôle judiciaire suffisant des sanctions imposées à l’issue d’une procédure défaillante par une autorité administrative exerçant consécutivement des fonctions d’enquête et de jugement • Partialité de l’autorité administrative de régulation des télécoms (« l’AGCOM ») • Le responsable de la procédure menant les enquêtes et la commission décidant des sanctions étaient des branches d’un même organe administratif, agissant sous l’autorité et la supervision d’un même président • Pas d’égalité des armes entre l’accusation et la défense • Absence d’audience publique • Contrôle ultérieur d’organes judiciaires de pleine juridiction
FAITS
La première requérante Edizioni Del Roma Società Cooperativa A.R.L. est une société coopérative italienne et la deuxième requérante Edizioni Del Roma S.R.L. est une société italienne à responsabilité limitée (S.R.L.). Le département pour l’information et la publication de la Présidence du Conseil des Ministres (DIP), qui octroie des subventions aux sociétés d’édition, demanda à l’AGCOM de lui communiquer la position (sur le registre des opérateurs de télécommunications) des éditeurs qui sollicitaient des subventions, et de vérifier l’existence d’une éventuelle situation de contrôle ou d’association d’entreprises au sens de l’article 2359 du code civil. Le 7 mars 2011, l’AGCOM ouvrit contre les sociétés une procédure de sanction pour violation, sur la période 2008-2010, de l’obligation de déclarer une situation de contrôle conformément à l’article 1 § 8 de la loi no 416 de 1981. Les sociétés eurent accès au dossier de la procédure, et des auditions eurent lieu les 2 et 11 mai 2011. Le 30 mai 2011, l’AGCOM émit une ordonnance d’injonction par laquelle elle infligea à la deuxième requérante une sanction administrative d’un montant de 103 300 euros (EUR) au motif qu’elle avait omis de déclarer avoir exercé un contrôle sur les requérantes au cours de la période 2008-2010, et qu’elle avait donc agi en violation de l’article 8 § 1 de la loi no 416 de 1981.
Par deux recours séparés, les requérantes saisirent le tribunal administratif de Rome pour contester la décision de l’AGCOM. Par un jugement du 25 juin 2012, le tribunal administratif régional de Rome (TAR) rejeta les recours introduits après avoir ordonné la jonction des deux recours. Les requérantes firent appel du jugement afin de contester le rejet des recours qu’elles avaient introduits contre la sanction qui leur avait été infligée par l’AGCOM. Par un arrêt du 22 avril 2013, le Conseil d’État rejeta l’appel formé par les requérantes. Le Conseil d’État rejeta également les griefs formulés par les requérantes concernant l’interprétation par le tribunal de la « situation de contrôle ». Enfin, par un jugement rendu le 26 mars 2016, le tribunal de Rome acquitta les administrateurs de deux sociétés requérantes du délit d’escroquerie, considérant que ce n’était pas dans le but d’obtenir les subventions en question pour les périodes 2008/2009 et 2009/2010 que les sociétés avaient dissimulé une situation de contrôle.
Article 6 § 1
La Cour note que, dans le cadre de la procédure devant l’AGCOM, les requérantes se sont vu offrir la possibilité de présenter des éléments pour leur défense. Cependant, le rapport de la police financière relatif aux mesures d’enquête, sur lequel la commission a fondé sa décision, n’a pas été communiqué aux requérantes, et celles-ci n’ont donc pas eu la possibilité de se défendre par rapport au document finalement soumis par les organes d’enquête de l’AGCOM à l’organe chargé de statuer sur le bien-fondé des accusations. La Cour relève également que la procédure devant l’AGCOM était essentiellement écrite, aucune audience publique n’étant prévue. S’il est vrai que l’obligation de tenir une audience publique n’est pas absolue et que l’article 6 n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures, en ce qui regarde la présente affaire, la Cour considère qu’une audience publique, orale et accessible aux requérantes était nécessaire. Il y avait une controverse sur les faits, notamment sur la question de l’existence d’une situation de contrôle entre les sociétés requérantes, et, au-delà de sa sévérité financière, la sanction que les requérantes encouraient était de nature à porter atteinte à leur honorabilité professionnelle et à leur crédit. La Cour note que le règlement de l’AGCOM prévoit une certaine séparation entre les organes chargés des enquêtes et l’organe compétent pour se prononcer sur l’existence ou non d’une infraction et l’application de sanctions. Elle observe notamment que c’est le responsable de la procédure qui formule les accusations et qui mène les enquêtes et que la décision finale quant aux sanctions devant être appliquées revient exclusivement à la commission. Il n’en demeure pas moins que le responsable de la procédure et la commission ne sont que des branches d’un même organe administratif, agissant sous l’autorité et la supervision d’un même président. Pour la Cour, cette situation s’analyse en un exercice consécutif de fonctions d’enquête et de jugement au sein d’une même institution ; or en matière pénale un tel cumul n’est pas compatible avec l’exigence d’impartialité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour considère donc que la procédure devant l’AGCOM n’a pas satisfait à toutes les exigences de l’article 6 de la Convention, notamment en ce qui concerne l’égalité des armes entre l’accusation et la défense, et la tenue d’une audience publique permettant une confrontation orale. En ce qui concerne la question de savoir si les requérantes ont eu accès à un tribunal doté de la plénitude de juridiction, la Cour observe que le constat de non-conformité de la procédure devant l’AGCOM avec les principes du procès équitable ne suffit pas pour conclure à la violation de l’article 6. En l’espèce, les requérantes ont pu contester la sanction litigieuse devant le TAR et faire appel de la décision de ce dernier devant le Conseil d’État. Les audiences ayant été tenues publiquement devant ces deux juridictions, une confrontation orale entre les parties et le respect du principe de l’égalité des armes ont été rendus possibles. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le TAR et le Conseil d’État satisfont aux exigences d’indépendance et d’impartialité qu’un « tribunal » doit posséder au sens de l’article 6 de la Convention. De ce fait, la Cour note que la compétence des juridictions administratives n’était pas limitée à un simple contrôle de légalité. Les juridictions administratives ont pu vérifier si, par rapport aux circonstances particulières de l’affaire, l’AGCOM avait fait un usage approprié de ses pouvoirs. Elles ont pu examiner le bien-fondé et la proportionnalité des choix de l’AGCOM. La décision de l’AGCOM ayant été ultérieurement soumise au contrôle d’organes judiciaires de pleine juridiction, il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
CEDH
56. La Cour note que les requérantes se sont vu offrir la possibilité de présenter des éléments pour leur défense dans le cadre de la procédure devant l’AGCOM : elles ont été informées de ce qui leur était reproché par le responsable de la procédure, et elles ont été invitées à se défendre. Elles ont en outre disposé d’un délai de trente jours pour présenter d’éventuelles observations en réponse. Ce délai, dont les requérantes n’en ont pas demandé la prolongation, n’apparaît pas manifestement insuffisant.
57. Il n’en demeure pas moins que le rapport de la police financière relatif aux mesures d’enquête prises à la suite de l’audition des requérantes, sur lequel la commission a fondé sa décision, n’a pas été communiqué aux requérantes, et que celles-ci n’ont donc pas eu la possibilité de se défendre par rapport au document finalement soumis par les organes d’enquête de l’AGCOM à l’organe chargé de statuer sur le bien-fondé des accusations.
58. La Cour relève également que la procédure devant l’AGCOM était essentiellement écrite, aucune audience publique n’étant prévue. À cet égard, elle rappelle que la tenue d’une audience publique constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 (Jussila, précité, § 40).
59. Pourtant, il est vrai que l’obligation de tenir une audience publique n’est pas absolue (Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 66, série A no 171-A) et que l’article 6 n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits rendant nécessaire une confrontation orale, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions écrites des parties et des autres pièces du dossier (voir, par exemple, Döry c. Suède, no 28394/95, § 37, 12 novembre 2002, Pursiheimo c. Finlande (déc.), no 57795/00, 25 novembre 2003, Jussila, précité, § 41, et Suhadolc c. Slovénie (déc.), no 57655/08, 17 mai 2011).
60. Même si les exigences du procès équitable sont plus rigoureuses en matière pénale, la Cour n’exclut pas que, dans le cadre de certaines procédures pénales, les tribunaux saisis puissent, en raison de la nature des questions qui se posent, se dispenser de tenir une audience. S’il faut garder à l’esprit que les procédures pénales, qui ont pour objet la détermination de la responsabilité pénale et l’imposition de mesures à caractère répressif et dissuasif, revêtent une certaine gravité, il va de soi que certaines d’entre elles ne comportent aucun caractère infamant pour ceux qu’elles visent et que les « accusations en matière pénale » n’ont pas toutes le même poids (Jussila, précité, § 43).
61. Il convient également de préciser que l’importance considérable que l’enjeu de la procédure litigieuse peut avoir pour la situation personnelle d’un requérant n’est pas décisive pour la question de savoir si une audience est nécessaire (Pirinen c. Finlande (déc.), no 32447/02, 16 mai 2006). Il n’en demeure pas moins que le rejet d’une demande tendant à la tenue d’une audience ne peut se justifier qu’en de rares occasions (Miller c. Suède, no 55853/00, § 29, 8 février 2005, et Jussila, précité, § 42).
62. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour considère qu’une audience publique, orale et accessible aux requérantes était nécessaire. À cet égard, elle observe qu’il y avait une controverse sur les faits, notamment sur la question de l’existence d’une situation de contrôle entre les sociétés requérantes, et que, au-delà de sa sévérité sur le plan financier, la sanction que les requérantes encouraient était de nature à porter atteinte à leur honorabilité professionnelle et à leur crédit.
63. La Cour note que le règlement de l’AGCOM prévoit une certaine séparation entre les organes chargés des enquêtes et l’organe compétent pour se prononcer sur l’existence ou non d’une infraction et l’application de sanctions. Elle observe notamment que c’est le responsable de la procédure qui formule les accusations et qui mène les enquêtes, dont les résultats sont résumés dans un rapport contenant des conclusions et des propositions quant aux sanctions à appliquer, et que la décision finale quant aux sanctions devant être appliquées revient exclusivement à la commission.
64. Il n’en demeure pas moins que le responsable de la procédure et la commission ne sont que des branches d’un même organe administratif, agissant sous l’autorité et la supervision d’un même président. À cet égard, la Cour note que le Gouvernement n’a prouvé ni l’existence de garde-fous au sein des différents départements ni la nature formelle de l’une ou l’autre des fonctions du président. À ses yeux, ceci s’analyse en un exercice consécutif de fonctions d’enquête et de jugement au sein d’une même institution ; or en matière pénale un tel cumul n’est pas compatible avec l’exigence d’impartialité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment et mutatis mutandis, Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, §§ 30-32, série A no 53, De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, §§ 24-30, série A no 86, et Grande Stevens, précité § 137).
65. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la procédure devant l’AGCOM n’a pas satisfait à toutes les exigences de l’article 6 de la Convention, notamment en ce qui concerne l’égalité des armes entre l’accusation et la défense, et la tenue d’une audience publique permettant une confrontation orale (Grande Stevens, précité § 123).
Sur la question de savoir si les requérantes ont eu accès à un tribunal doté de la plénitude de juridiction
66. Le constat de non-conformité de la procédure devant l’AGCOM avec les principes du procès équitable ne suffit pourtant pas pour conclure à la violation de l’article 6 en l’espèce. À cet égard, la Cour observe que les sanctions dont les requérantes se plaignent ont été infligées non pas par un juge à l’issue d’une procédure judiciaire contradictoire, mais par une autorité administrative. Si confier à une telle autorité la tâche de poursuivre et de réprimer des infractions n’est pas incompatible avec la Convention, il faut malgré tout souligner que l’intéressé doit pouvoir saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de l’article 6 (Kadubec c. Slovaquie, 2 septembre 1998, § 57, Recueil 1998-VI, Čanády c. Slovaquie, no 53371/99, § 31, 16 novembre 2004, et A. Menarini Diagnostics S.r.l., précité, § 58).
67. Le respect de l’article 6 de la Convention n’exclut donc pas que dans une procédure de nature administrative, une « peine » soit imposée d’abord par une autorité administrative (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 254 28 juin 2018). Il suppose cependant que la décision d’une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de l’article 6 subisse le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 132, 6 novembre 2018). Parmi les caractéristiques d’un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l’organe inférieur. Cet organe doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Chevrol c. France, no 49636/99, § 77, CEDH 2003-III, Silvester’s Horeca Service c. Belgique, nº 47650/99, § 27, 4 mars 2004, et A. Menarini Diagnostics S.r.l., précité, § 59).
68. En l’espèce, les requérantes ont eu la possibilité, dont elles se sont prévalues, de contester les sanctions infligées par l’AGCOM devant le tribunal administratif et le Conseil d’État. Il reste à établir si ces deux juridictions étaient des « organes judiciaires de pleine juridiction » au sens de la jurisprudence de la Cour.
(-)
78. Pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de l’article 6 § 1, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997, § 73, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). La Cour rappelle le rôle croissant de la notion de séparation du pouvoir exécutif et de l’autorité judiciaire dans sa jurisprudence (Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 78, CEDH 2002-IV). Cela étant, ni l’article 6 ni aucune autre disposition de la Convention n’oblige les États à se conformer à telle ou telle notion constitutionnelle théorique concernant les limites admissibles à l’interaction entre l’un et l’autre (Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98 et 3 autres, § 193, CEDH 2003-VI).
79. La Cour rappelle que l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris et peut s’apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c’est-à-dire en recherchant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans le cas d’espèce, ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, par exemple, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 118, CEDH 2005-XIII, et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 93, CEDH 2009).
80. Dans la très grande majorité des affaires soulevant des questions relatives à l’impartialité, la Cour a eu recours à la démarche objective (Micallef, précité, § 95, et Morice c. France [GC], no 29369/10, § 75, 23 avril 2015). La frontière entre l’impartialité subjective et l’impartialité objective n’est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective), mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective) (Kyprianou, précité, § 119). Ainsi, dans des cas où il peut être difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la présomption d’impartialité subjective du juge, la condition d’impartialité objective fournit une garantie importante supplémentaire (Pullar c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 32, Recueil 1996-III).
81. Pour ce qui est de l’appréciation objective, il convient de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge ou d’une juridiction collégiale un défaut d’impartialité, l’optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (Micallef, précité, § 96, et Morice, précité, § 76).
82. L’appréciation objective porte essentiellement sur les liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d’autres acteurs de la procédure (Micallef, précité, § 97). Il faut en conséquence décider dans chaque cas d’espèce si la nature et le degré du lien en question sont tels qu’ils dénotent un manque d’impartialité de la part du tribunal (Pullar, précité, § 38).
83. Les concepts d’indépendance et d’impartialité objective sont étroitement liés et, selon les circonstances, peuvent appeler un examen conjoint (Sacilor-Lormines c. France, no 65411/01, § 62, CEDH 2006 XIII).
84. La Cour note tout d’abord sur la question de la dualité des fonctions du président de l’AGCOM que l’intéressé avait certes reçu le titre de président honoraire du Conseil d’État mais qu’il n’y a jamais exercé de fonctions judiciaires.
85. La Cour rappelle en outre qu’elle a déjà souligné dans la décision Predil Anstalt S.A. c. Italie ((déc.), no 31993/96, 8 juin 1999) que la majorité des magistrats administratifs sont nommés à l’issue d’un concours public et qu’aux termes de la Constitution italienne, la loi assure l’indépendance du Conseil d’État à l’égard du gouvernement.
86. Force est aussi de constater que les requérantes n’ont pas allégué que les membres du Conseil d’État ayant connu de leur cas avaient agi sur les instructions du président honoraire. Elles n’ont pas non plus allégué que le président honoraire pouvait, d’une autre manière, influencer les juges. En l’espèce, il n’existe pas d’éléments de nature à faire naître dans le chef des requérantes des craintes objectivement justifiées (Sacilor-Lormines, précité, § 74, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal précité, § 155).
87. Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que le fait que le président de l’AGCOM ait aussi été nommé président honoraire du Conseil d’État n’est pas de nature à mettre en cause l’indépendance et l’impartialité objective de la haute juridiction qui a été amenée à statuer sur les recours formés par les requérantes contre la sanction de l’AGCOM.
88. La Cour observe en outre que les griefs des requérantes ont trait d’une part au droit d’accéder à un tribunal doté de la plénitude de juridiction et d’autre part au réexamen judiciaire, incomplet selon elles, de la sanction prononcée par l’AGCOM.
89. En l’espèce, les requérantes ont pu contester la sanction litigieuse devant le TAR et faire appel de la décision de ce dernier devant le Conseil d’État. La Cour note que les audiences se sont tenues publiquement devant ces deux juridictions (voir paragraphes 15 et 18 ci-dessus), ce qui a permis une confrontation orale entre les parties et le respect du principe de l’égalité des armes. Selon la jurisprudence de la Cour, le TAR et le Conseil d’État satisfont aux exigences d’indépendance et d’impartialité qu’un « tribunal » doit posséder au sens de l’article 6 de la Convention (Predil Anstalt S.A., précité, A. Menarini Diagnostics S.r.l., précité).
90. La Cour rappelle, tout d’abord, que seul mérite l’appellation de «tribunal » au sens de l’article 6 § 1 un organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d’exigences telles que l’indépendance à l’égard de l’exécutif comme des parties en cause (voir, entre autres, les arrêts Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 95, série A no 13, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981, § 55, série A no 43, Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, § 64, série A no 132, et Beaumartin c. France, 24 novembre 1994, §§ 38-39, série A no 296 B).
91. Par ailleurs, la Cour rappelle que la nature d’une procédure administrative peut différer, par plusieurs aspects, de celle d’une procédure pénale au sens strict du terme. Si ces différences ne sauraient exonérer les États contractants de leur obligation de respecter toutes les garanties offertes par le volet pénal de l’article 6, elles peuvent néanmoins influencer les modalités de leur application (A. Menarini Diagnostics S.r.l précité § 62).
92. La Cour note que dans le cas d’espèce, les juridictions administratives se sont penchées sur les différentes allégations de fait et de droit des sociétés requérantes. Elles ont dès lors examiné les éléments de preuve recueillis par l’AGCOM.
93. De ce fait, la Cour note que la compétence des juridictions administratives n’était pas limitée à un simple contrôle de légalité. Les juridictions administratives ont pu vérifier si, par rapport aux circonstances particulières de l’affaire, l’AGCOM avait fait un usage approprié de ses pouvoirs. Elles ont pu examiner le bien-fondé et la proportionnalité des choix de l’AGCOM.
94. La décision de l’AGCOM ayant été soumise au contrôle ultérieur d’organes judiciaires de pleine juridiction, aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce.
SA PATRONALE HYPOTHÉCAIRE c. BELGIQUE du 17 juillet 2017 requête n° 14139/09
Non violation de l'article 6-1 de la Convention, la requérante se plaint que le Conseil d'État n'avait pas pleine juridiction. La CEDH répond que le Conseil d'État a pu répondre avec minutie à tous les moyens de la requérante.
LES FAITS
6. La requérante, la SA Patronale hypothécaire, est une société anonyme de droit belge ayant son siège à Bruxelles.
7. La requérante octroyait des hypothèques et exerçait des activités de capitalisation au sens de l’arrêté royal no 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation (ci-après, « l’arrêté royal no 43 »). La loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit prévit la suppression du statut de société de capitalisation. La mise en œuvre de cette loi fut prévue par l’arrêté royal du 20 mars 2007 portant exécution de l’article 27bis de l’arrêté royal no 43 qui dispose qu’à compter du 1er janvier 2008, seuls les établissements de crédit et les entreprises d’assurance qui disposaient de l’agrément requis pourraient exercer des activités de capitalisation.
8. Ainsi, il revenait à la requérante de demander le statut d’établissement de crédit ou d’entreprise d’assurance, sans quoi elle devrait cesser toutes ses activités de capitalisation.
9. Entre novembre 2006 et mars 2007, la Commission bancaire, financière et des assurances (ci-après, la « CBFA » - désormais dénommée l’Autorité des services et marchés financiers, FSMA) contacta à plusieurs reprises la société requérante pour attirer son attention sur la modification législative dont question ainsi que pour l’informer qu’elle devait introduire une demande pour obtenir le statut d’établissement de crédit ou d’entreprise d’assurance.
La SA déposa la demande mais elle fut rejetée pour cause de membres du Conseil d'Administration dont le CV est incompatible pour gérer une société de crédit.
26. La société requérante allègue ne pas avoir pu faire entendre sa cause par un tribunal disposant d’une compétence de pleine juridiction tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
CEDH
a) Principes généraux applicables
36. L’article 6 § 1 de la Convention exige en principe l’existence d’un recours de pleine juridiction, c’est-à-dire un recours dans le cadre duquel le tribunal a compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi. Cela implique notamment que le juge doit disposer du pouvoir de se pencher point par point sur chacun des moyens du plaignant sur le fond, sans refuser d’examiner aucun d’entre eux, et donner des raisons claires pour leur rejet (Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], no 5809/08, § 128, CEDH 2016).
37. L’exigence que le « tribunal » visé par l’article 6 dispose d’une « plénitude de juridiction » sera satisfaite si l’organe en question est doté de compétence d’une « étendue suffisante » ou exerce un « contrôle juridictionnel suffisant » pour traiter l’affaire en cause (Tsanova-Gecheva c. Bulgarie, no 43800/12, § 97, 15 septembre 2015, et références citées). Il ressort de cette jurisprudence que le rôle de l’article 6 n’est pas de garantir l’accès à un tribunal qui pourrait substituer son propre avis à celui des autorités administratives. À cet égard, la Cour a en particulier souligné le respect dû aux décisions prises par l’administration sur des questions d’opportunité qui souvent ont trait à des domaines spécialisés du droit (voir Sigma Radio Television Ltd c. Chypre, nos 32181/04 et 35122/05, § 153, 21 juillet 2011, et Fazia Ali c. Royaume-Uni, no 40378/10, § 77, 20 octobre 2015, et références citées) ou les affaires de droit administratif où la compétence de l’instance de recours était restreinte en raison de la nature technique de l’objet du litige (Al-Dulimi et Montana Management Inc., précité, § 130).
38. Afin d’évaluer si, dans un cas donné, les juridictions internes ont effectué un contrôle d’une étendue suffisante, la Cour doit prendre en considération les compétences attribuées à la juridiction en question et des éléments tels que : a) l’objet de la décision attaquée, plus particulièrement si celle-ci a trait à un domaine spécifique exigeant des connaissances spécialisées ou si, et dans quelle mesure, elle implique l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration ; b) la méthode suivie pour parvenir à cette décision et, en particulier, les garanties procédurales existantes dans le cadre de la procédure devant l’autorité administrative ; et c) la teneur du litige, y compris les moyens de recours, tant souhaités que réellement développés (Bryan c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 45, série A no 335‑A, § 45, Sigma Radio Television Ltd, précité, § 154, et Galina Kostova c. Bulgarie, no 36181/05, § 59, 12 novembre 2013). La question de savoir si un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante a été effectué dépendra donc des circonstances de chaque affaire : la Cour doit dès lors se borner autant que possible à examiner la question soulevée par la requête dont elle est saisie et à déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, le contrôle opéré était adéquat (Sigma Radio Television Ltd, précité, § 155, et Potocka et autres c. Pologne, no 33776/96, § 54, CEDH 2001‑X).
39. En outre, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi d’autres, Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 49, 20 octobre 2011). La Cour n’est pas une instance d’appel des juridictions nationales et il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par ces juridictions, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
b) Application au cas d’espèce
40. Dans la mesure où la requérante se plaint de ce que la procédure devant la CBFA ayant abouti aux décisions de refus d’agrément des 21 décembre 2007 et du 29 janvier 2008 ne respectait pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle qu’aucune violation de la Convention ne peut être constatée si les procédures devant cet organe subissent le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article (parmi d’autres, Albert et Le Compte, précité, § 29, et Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, § 32, CEDH 2002‑IV).
41. Le droit interne prévoit en l’espèce la possibilité d’obtenir, au moyen d’un recours devant le Conseil d’État, le contrôle judiciaire de la légalité des décisions de la CBFA (paragraphe 21, ci-dessus). La Cour doit donc vérifier si la procédure à laquelle la requérante a eu accès a, prise dans son ensemble, respecté les exigences de l’article 6 de la Convention et, plus particulièrement, si le Conseil d’État a opéré un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante.
i. L’objet du litige
42. Le litige portait sur le refus de la demande d’agrément de la société requérante en tant qu’établissement de crédit. La Cour accepte – tel que cela a été indiqué par le Gouvernement et sans que cela n’ait été contesté par la requérante – qu’il s’agissait là d’une question qui impliquait l’exercice d’un certain pouvoir discrétionnaire de la CBFA, autorité spécialement chargée d’octroyer cet agrément. Ce pouvoir était toutefois encadré par les dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit qui prévoient les conditions qu’un établissement doit remplir pour obtenir l’agrément convoité (paragraphe 20, ci-dessus).
ii. La méthode suivie pour parvenir à la décision litigieuse
43. S’agissant ensuite de la méthode suivie pour parvenir à la décision litigieuse, la Cour constate que si la CBFA ne constituait pas un « tribunal » indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention respectant toutes les exigences de cette disposition, la requérante a toutefois bénéficié d’un certain nombre de garanties procédurales devant cette autorité administrative suite à sa demande d’agrément (dans le même sens, par exemple, Sigma Radio Television Ltd, précité, § 162, et Biagioli c. Saint-Marin (déc.), no 64735/14, § 65, 13 septembre 2016). Ainsi, elle a eu – à sa demande – accès à son dossier, elle a pu faire valoir ses arguments tant oralement au cours de rencontres avec des représentants de la CBFA que par écrit, et elle a eu la possibilité d’introduire une demande de retrait ou de modification de la première décision négative de la CBFA, ce dont elle a fait usage (paragraphes 12 à 16, ci-dessus). La requérante fut également entendue par le comité de direction de la CBFA suite à sa demande de retrait ou de modification de la première décision (paragraphe 16, ci‑dessus). La Cour note en outre que les décisions de la CBFA étaient soigneusement motivées et qu’elles répondaient à chacun des arguments avancés par la requérante.
iii. La teneur du litige
44. S’agissant ensuite des moyens de recours souhaités et réellement développés par la requérante devant le Conseil d’État, la Cour constate que la requérante se plaint du refus du Conseil d’État de se prononcer « sur le fond » de l’affaire, au motif que cela n’entrait pas dans le champ de ses compétences dans le cadre du contentieux d’annulation (paragraphes 17 et 30, ci-dessus).
45. S’agissant de la contestation entre les parties quant à la nature du recours prévu par la loi devant le Conseil d’État pour contester une décision de la CBFA, la Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Nejdet Şahin et Perihan Şahin, précité, § 49). Aussi, eu égard à la motivation donnée par le Conseil d’État à ce propos (paragraphe 19, ci-dessus), elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion de ce dernier selon laquelle il s’agissait bien en l’espèce d’un recours en annulation encadré par l’article 14, § 1, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d’État (paragraphe 22, ci-dessus).
46. En droit belge, dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil d’État a compétence pour procéder à un contrôle juridictionnel au regard de la loi et des principes généraux du droit. Il examine notamment si la décision contestée est fondée en fait, si elle procède de qualifications juridiques correctes, et si la mesure n’est pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits établis (paragraphes 23, 24, 25 et 33, ci‑dessus). Aussi, si le Conseil d’État avait accueilli un des moyens de la requérante, il aurait pu annuler les décisions prises par la CBFA et renvoyer le dossier à la CBFA afin qu’elle se prononce de nouveau en conformité avec les directives que le Conseil d’État aurait pu formuler concernant les irrégularités éventuellement constatées (dans le même sens, Bryan, précité, § 44, et Biagioli, décision précitée, § 68).
47. La Cour a déjà jugé que le rôle de l’article 6 n’est pas de garantir l’accès à un tribunal qui puisse substituer son opinion à celle de l’autorité administrative (Bryan, précité, § 44, et Sigma Radio Television Ltd, précité, § 153). En adoptant cette approche, la Cour a eu égard au fait que dans le cadre des recours administratifs organisés dans les États membres du Conseil de l’Europe, l’étendue du contrôle juridictionnel sur les faits d’une affaire était souvent limitée et qu’il tenait à la nature même de ces recours que l’autorité de recours se limite à contrôler la procédure antérieure plutôt que de prendre des décisions factuelles (Fazia Ali, précité, § 77).
48. La Cour considère dès lors que le fait que la compétence du Conseil d’État se limitait, dans les circonstances particulières de l’espèce, à l’annulation des décisions litigieuses et non pas à leur réformation n’est pas un problème en soi au regard de l’article 6 de la Convention (mutatis mutandis, Chaudet c. France, no 49037/06, § 37, 29 octobre 2009).
49. Pour le surplus, la Cour relève que, dans son arrêt du 8 septembre 2008, le Conseil d’État procéda à un examen approfondi, point par point, des moyens de la requérante, sans jamais se voir contraint de décliner sa compétence pour y répondre (paragraphe 19, ci-dessus). Il étudia notamment en détail les allégations de violation de la Constitution et de la Convention avant de conclure de manière motivée à l’absence de violation des dispositions invoquées par la requérante (dans le même sens, Potocka et autres, précité, § 57, et Chaudet, précité, § 37).
50. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le Conseil d’État a procédé en l’espèce à un contrôle d’une portée suffisante au regard de l’article 6 de la Convention. Cette conclusion ne préjuge pas de la décision de la Cour dans d’autres affaires soulevant un grief similaire.
51. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
VATHAKOS c. GRÈCE du 28 juin 2018 requête Requête no 20235/11
Violation article 6-1 : Le non accès au tribunal est disproportionné aux droits du requérant.
LES FAITS
6. Le requérant est théologien et professeur dans l’enseignement secondaire depuis 2001. Il a le statut de fonctionnaire.
7. Le 19 avril 2005, le conseil disciplinaire régional de l’enseignement secondaire infligea au requérant une sanction disciplinaire de suspension de ses fonctions pendant trois mois avec privation totale de salaire pendant cette période, pour manquement aux devoirs de sa fonction et attentats aux mœurs. Au cours de la procédure, tant écrite qu’orale, le requérant assuma lui-même sa défense.
8. La décision, qui fut notifiée au requérant le 22 avril 2005, précisait qu’il avait le droit de former une objection devant le conseil disciplinaire de deuxième instance dans un délai de vingt jours à compter de la notification, soit jusqu’au 12 mai 2005. Le requérant n’usa cependant pas de cette possibilité. Il allègue qu’il avait accepté la sanction qui lui avait été imposée.
9. En revanche, le 16 mai 2005, le ministre de l’Éducation nationale forma une objection en faveur de l’administration dans le but de faire imposer une sanction supérieure à celle prononcée par le conseil disciplinaire régional.
10. Le 16 mai 2006, le conseil disciplinaire de deuxième instance infirma la décision susmentionnée et infligea au requérant une sanction de suspension de six mois avec privation totale de salaire (décision no 214/2006). Le requérant, qui était représenté par son avocat, était présent à l’audience et répondit à des questions.
11. Le 11 janvier 2007, le requérant introduisit un recours en annulation de la décision no 214/2006 devant la cour administrative d’appel d’Athènes. Il déposa auprès de la cour d’appel un document notarié par lequel il désignait Me A. Prousanidis pour le représenter devant cette juridiction.
12. Le 24 août 2009, la cour administrative d’appel d’Athènes se déclara territorialement incompétente et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel de Tripoli.
13. L’audience devant la cour administrative d’appel de Tripoli eut lieu le 14 juin 2010. Toutefois, le requérant ne fut pas représenté à l’audience. Parmi les documents du dossier se trouvait un pouvoir établi devant notaire précisant que le requérant habilitait Me A. Prousanidis et un autre avocat à le représenter devant toutes les juridictions du pays et, notamment, devant la cour administrative d’appel lors de l’audience consacrée à l’examen de son action contre les ministres de l’Intérieur et de l’Éducation nationale afin de faire annuler ou faire modifier de manière plus favorable la décision du conseil disciplinaire de deuxième instance.
14. Le requérant indique que, le 14 juin 2010 à 7 h 30, son avocat, Me A. Prousanidis, sortant de son cabinet pour se rendre à Tripoli, s’évanouit dans la rue et fut transporté par des passants à l’hôpital. Les médecins, craignant que Me A. Prousanidis ait eu une crise cardiaque, lui firent subir divers examens pendant quatre heures avant de diagnostiquer une colique néphrétique avec hématurie. L’intéressé serait sorti de l’hôpital à 13 heures après avoir reçu des soins et la recommandation de rester chez lui. Il lui aurait été impossible de charger un confrère de le remplacer à l’audience. À l’appui de ses dires, le requérant fournit un certificat médical établi par l’hôpital en question.
15. Le 23 juin 2010, le requérant demanda à la cour administrative d’appel de Tripoli de tenir une nouvelle audience afin de pouvoir comparaître avec son avocat et présenter ses arguments. Il invoqua un cas de force majeure quant à l’absence de son avocat à l’audience du 14 juin 2010 et joignit un certificat médical à l’appui de ses dires.
16. Par un arrêt no 353/2010 du 14 septembre 2010, la cour administrative d’appel de Tripoli déclara l’appel du requérant irrecevable au motif que celui-ci n’avait pas formé auparavant des objections devant le conseil disciplinaire de deuxième instance contre la décision initiale du conseil disciplinaire régional de l’enseignement secondaire.
17. Par un arrêt no 354/2010 du même jour, la cour administrative d’appel de Tripoli rejeta aussi la demande de réouverture de la procédure au motif que cette demande était seulement prévue pour les cas d’irrecevabilité tirée du défaut d’habilitation (νομιμοποίηση) de l’avocat alors que, en l’espèce, l’avocat du requérant avait reçu une habilitation par acte notarié, lequel se trouvait dans le dossier. Plus particulièrement, elle se prononça ainsi :
« En l’occurrence, le recours dont il s’agit est signé par l’avocat d’Athènes Me Anastasios Prousanidis, en sa qualité de représentant du demandeur, et il est également signé par le demandeur. Ce dernier n’a pas comparu à l’audience du 14 juin 2010. Le dossier contient le pouvoir du notaire d’Athènes M.P., établi le 10 février 2009, et par lequel le demandeur mandate cet avocat pour le représenter, entre autres, devant toutes les juridictions du territoire. Par conséquent, aucune question d’habilitation de l’avocat signataire du recours ne se pose en l’espèce et la demande doit être rejetée. »
LA CEDH
33. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non pas théorique et illusoire (voir, en ce sens, Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A no 333‑B). L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (Nunes Dias c. Portugal (déc.), nos 2672/03 et 69829/01, CEDH 2003-IV, et Bellet, précité, § 36). De même, le droit d’accès à un tribunal comprend non seulement le droit d’engager une action mais aussi le droit à une solution juridictionnelle du litige (voir, par exemple, Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, § 86, Fălie c. Roumanie, no 23257/04, §§ 22 et 24, 19 mai 2015, et Kutić c. Croatie, no 48778/99, § 25, CEDH 2002‑II).
34. Le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012). En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, § 89 ; Baka, précité, § 120 ; Papaioannou c. Grèce, no 18880/15, § 40, 2 juin 2016 ; Kallergis c. Grèce, no 37349/07, § 16, 2 avril 2009).
35. La Cour note que les articles 142 et 164 du code des fonctionnaires en vigueur à l’époque des faits prévoyaient une certaine procédure à suivre par le fonctionnaire sanctionné par le conseil disciplinaire et qui souhaitait introduire un recours contre la décision lui imposant une sanction : le fonctionnaire devait saisir le conseil disciplinaire de deuxième instance et, par la suite, le cas échéant, les juridictions administratives. La saisine du conseil disciplinaire de deuxième instance était une condition préalable de la saisine des juridictions administratives (paragraphes 19-20 ci-dessus).
36. À l’instar du Gouvernement, la Cour considère que la procédure susmentionnée poursuit le but légitime de réduire la charge du travail des juridictions administratives et de permettre à l’intéressé de régler au plus vite sa situation sans se lancer dans des procédures judiciaires longues et coûteuses.
37. Reste à déterminer si les restrictions qu’impliquait la procédure suivie en l’espèce étaient proportionnelles au but légitime précité.
38. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a fait l’objet de la sanction disciplinaire de suspension de ses fonctions pendant trois mois avec privation de salaire pendant cette période. Cette décision a été prononcée à son encontre par le conseil disciplinaire régional de l’enseignement secondaire à la suite d’une procédure écrite et orale au cours de laquelle le requérant avait assumé lui-même sa défense. La décision, qui a été notifiée à l’intéressé le 22 avril 2005, précisait qu’il avait le droit de former une objection devant le conseil disciplinaire de deuxième instance dans un délai de vingt jours à compter de la notification, soit jusqu’au 12 mai 2005.
39. Le requérant dit avoir accepté la sanction qui lui a été imposée et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas saisi le conseil disciplinaire de deuxième instance. La Cour ne met pas en doute cette déclaration car le requérant a laissé passer le délai de vingt jours précité sans réagir, alors qu’il aurait pu faire appel de la décision le sanctionnant soit lui-même, soit en étant représenté par un avocat.
40. La Cour constate en revanche que, le 16 mai 2005, soit à un moment où le délai de vingt jours précité était déjà expiré, l’administration a formé une objection contre la décision du conseil disciplinaire régional dans le but d’obtenir une sanction plus sévère du requérant. Par la suite, le 16 mai 2006, le conseil disciplinaire de deuxième instance a imposé au requérant une sanction de six mois de suspension de ses fonctions avec privation de salaire. Face à cette aggravation de sa sanction, le requérant a alors introduit un recours en annulation de cette décision devant la cour administrative d’appel, recours que celle-ci a rejeté au motif que le requérant n’avait pas formé d’objection devant le conseil disciplinaire de deuxième instance.
41. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel il aurait été loisible au requérant de saisir le conseil disciplinaire de deuxième instance car, en cas de saisine de cet organe par le fonctionnaire, il ne pouvait pas y avoir aggravation de la sanction en deuxième instance. Cet argument ne convainc pas la Cour car le grief du requérant concerne son accès aux juridictions administratives à la suite de l’aggravation de sa peine. Or, dans l’hypothèse où il aurait tenté un recours devant le conseil disciplinaire de deuxième instance et obtenu une réduction ou une annulation de sa peine, il n’aurait eu aucune raison de saisir ces juridictions.
42. En outre, la Cour note que les arrêts du Conseil d’État produits par le Gouvernement pour démontrer que la saisine du conseil disciplinaire de deuxième instance constitue une condition de recevabilité de celle des juridictions administratives (paragraphe 20 ci-dessus), ne correspondent pas aux circonstances de la présente affaire. Ces arrêts concernent des cas dans lesquels l’intéressé avait soit introduit son recours tardivement, soit il n’avait pas été informé de son droit de former une objection devant le conseil disciplinaire de deuxième instance, soit la notification de la décision lui était parvenue tardivement. Aucun des arrêts du Conseil d’État soumis à la Cour par le Gouvernement n’a tranché un cas, comme celui du requérant, dans lequel la décision du conseil disciplinaire de première instance lui avait été notifiée dans les délais et la possibilité d’un recours devant le conseil disciplinaire de deuxième instance avait été portée à son attention, mais l’administration introduit un recours après l’écoulement du délai de vingt jours ouvert au fonctionnaire et alors que celui-ci était déjà forclos pour l’introduire lui-même. Autrement dit, le Conseil d’État n’a jamais tranché la question de la forclusion de l’intéressé lorsque l’administration forme une objection devant le conseil disciplinaire de deuxième instance après l’expiration du délai ouvert à celui-ci et lorsque cette objection aboutit à l’aggravation de la sanction imposée en première instance.
43. À titre surabondant, la Cour relève que ce type de situation ne risque pas de se reproduire à l’avenir, à la suite de l’adoption de l’article 141 du nouveau code des fonctionnaires (paragraphe 21 ci-dessus). Cet article, en son paragraphe 4, prévoit que, en cas d’imposition d’une peine d’amende équivalente à un à quatre mois de salaire, lorsqu’une objection est formée en faveur de l’administration, le délai pour que le fonctionnaire puisse aussi former de son côté une objection commence à courir à compter de la notification à celui-ci d’une copie de la décision disciplinaire et de l’objection formée en faveur de l’administration. Si une objection n’est pas formée en faveur de l’administration, le délai pour que le fonctionnaire saisisse la cour administrative d’appel commence à courir à compter de la notification à celui-ci d’une copie de la décision disciplinaire accompagnée d’une attestation précisant que l’administration n’a pas formé d’objection.
44. La Cour constate que, dans les circonstances de la cause et de par l’effet de la législation en vigueur à l’époque, il a été impossible au requérant de contester une décision qui avait aggravé sa sanction et ce alors qu’il n’était pas lui-même à l’origine de la procédure ayant abouti à cette aggravation.
45. Dans les circonstances précises de la cause, la Cour estime que le requérant a subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal du fait de l’impossibilité de saisir les juridictions administratives pour contester l’aggravation de sa sanction.
46. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner le deuxième grief du requérant relatif au rejet par la cour administrative d’appel de la demande de réouverture de la procédure.
47. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Nesterenko et Gaydukov c. Russie du 24 octobre 2017 requête n° 20199/14 et 20655/14
Article 6-1 pour non accès à un tribunal : Les requérants s'astreignent à un recours pré contentieux avant de saisir le tribunal administratif. Ils reçoivent une réponse qui n'est pas positive mais qui n'est pas explicitement négative. Le tribunal rejette les recours car ils n'ont pas de réponse négative. Il s'agit d'un non accès à un tribunal car les requérants ne peuvent pas contrôler la qualité de la réponse de l'administration !
29. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX). Chaque justiciable dispose du droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès – à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile – ne constitue qu’un aspect (Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, § 54, CEDH 2010, et Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18). Cependant, le droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient en revanche à la Cour de vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation au droit d’accès à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], no 5809/08, § 129, CEDH 2016).
30. En l’espèce, la Cour considère que l’obligation d’introduire un recours précontentieux est indubitablement une limitation au droit d’accès à un tribunal ; dès lors, elle se doit d’examiner si celle-ci n’a pas atteint le droit en question dans sa substance même (Momčilović, précité, § 45).
31. La Cour relève que le Gouvernement ne mentionne pas un but légitime particulier poursuivi par les décisions judiciaires contestées. Elle estime cependant que, en se référant à l’arrêt Momčilović (précité), il renvoie, implicitement, aux buts indiqués dans ce dernier, notamment la bonne administration de la justice et, plus particulièrement, le désengorgement du rôle des tribunaux de demandes susceptibles d’être réglées à l’amiable (idem, § 46).
32. La Cour note que, en l’espèce, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si les requérants ont satisfait à leur obligation d’exercer un recours précontentieux. Le Gouvernement estime que tel n’est pas le cas, au motif que la réponse de l’administration n’était pas explicitement négative. Les requérants affirment au contraire que l’absence de réponse positive s’analysait en un rejet de leurs demandes.
33. La Cour considère que, en l’absence d’un règlement administratif précis, les requérants ont agi de bonne foi en introduisant un recours précontentieux auprès de l’autorité administrative qu’ils estimaient être compétente et en saisissant ensuite le tribunal à la réception de la réponse implicitement négative – ce qui était d’ailleurs préconisé par l’administration elle-même (paragraphe 8 ci-dessus).
34. La Cour estime que, dans les circonstances particulières de cette affaire, la réaction des juridictions nationales (paragraphes 10 et 12 ci‑dessus) consistant à exiger la présentation d’une réponse négative, qui plus est, sous une forme particulière revient à faire dépendre le droit d’accès à un tribunal d’un élément qui échappe complètement au pouvoir des requérants. De ce point de vue, la possibilité, préconisée par le Gouvernement, de la réintroduction du même recours une fois le recours précontentieux rejeté, cette fois-ci de manière explicite, est à même de faire courir le risque d’un nouveau rejet pour le même motif (voir, a contrario, Momčilović, précité, § 50, affaire dans laquelle les requérants avaient retiré leur premier recours judiciaire et en avaient déposé un second sept ans plus tard sous le régime du nouveau code de procédure civile. Dans la situation bien particulière de cette affaire, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas de continuité entre la première et la seconde procédure judiciaire, et que, par conséquent, les requérants auraient dû encore une fois exercer un recours précontentieux avant de saisir la justice).
35. En l’occurrence, la Cour considère que les refus judiciaires d’examiner les demandes de privatisation n’ont pas été proportionnés au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d’accès des requérants à un tribunal.
Décision Antoine de MORTEMART contre la France du 15 juin 2017 requête 67386/13
Article 6-1 pour non accès à un tribunal : Même si le requérant n'a pas eu copie de la décision concernant son terrain classé en zone naturelle soit comme « sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général » non constructible, la publicité publique par voie de presse d'affichage à la mairie est suffisante, pour que le requérant connaisse la décision pour pouvoir agir en justice.
24. La Cour rappelle que le droit d’accès aux tribunaux – qui constitue un aspect du « droit à un tribunal » – peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 89, CEDH 2016 (extraits)).
25. Cela étant rappelé, la Cour estime que, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant disposait d’une possibilité adéquate de contester devant le juge interne le décret du 18 juillet 2003, qui procède au classement du secteur où se trouve sa propriété.
26. En effet, d’une part, il ressort des observations du Gouvernement et des pièces qu’il produit que ce décret a été publié au Journal Officiel le 25 juillet 2003 (il était précisé dans le Journal Officiel que le texte intégral du décret et les plans annexés pourraient être consultés à la préfecture et aux mairies concernées), et a été notifié par le préfet aux maires des onze communes concernées le 12 septembre 2003.
Le Gouvernement indique par ailleurs que les communes ont affiché le décret en mairie durant un mois. La Cour note à cet égard que le Gouvernement produit des certificats d’affichages pour quatre de ces mairies, qui montrent que, selon les cas, les affichages ont eu lieu des 16, 17 ou 18 septembre aux 16, 18 ou 19 octobre 2003. Elle relève aussi que la mairie de la commune où se trouve la propriété du requérant ne figure pas parmi ces quatre mairies, mais observe que le requérant n’en tire aucune conclusion ; en particulier, il ne soutient pas qu’il faudrait en déduire que l’affichage n’y aurait pas été effectué. Elle constate du reste, plus largement, qu’il ne conteste pas que l’affichage a été effectué selon les modalités indiquées par le Gouvernement dans les mairies des onze communes concernées. Elle tient donc ce fait pour avéré.
La Cour constate en outre, qu’un extrait de la décision de classement et la mention que le texte intégral pouvait être consulté à la préfecture et en mairie a été publié le 18 septembre 2003 dans deux journaux distribués localement.
Comme le souligne le Gouvernement, ces mesures s’ajoutent à la publicité qui a eu lieu lors de la procédure précédant le classement.
27. Ces modalités sont comparables à celles qui ont été mises en œuvre dans l’affaire Geffre précitée, dans laquelle la Cour a conclu que le mécanisme de publicité collective mis en œuvre constituait un système cohérent, ménageant un juste équilibre entre les intérêts de l’administration et ceux des personnes concernées. Elle a en particulier noté qu’il offrait à ces dernières une possibilité claire, concrète et effective de contester l’acte administratif dont il était question.
28. D’autre part, l’allégation du requérant selon lequel le délai dont il a disposé après la réalisation de ces mesures de publicité pour saisir le juge interne était très court est erronée. Il fait valoir à cet égard que, le décret du 18 juillet 2003 ayant été publié au Journal Officiel le 25 juillet 2003, le délai de recours de deux mois a expiré le 26 septembre 2003 ; or, souligne-t-il, les affichages en mairie et la publication dans des journaux n’ont été réalisés qu’environ une semaine avant cette dernière date. Le Gouvernement indique cependant qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que, les plans annexés au décret n’ayant pas été publiés au Journal Officiel, le délai de recours contre celui-ci ne courait pas à compter de cette publication, mais à compter de la mise à disposition en préfecture ou en mairie du décret dans son intégralité et des plans et cartes y afférents. Le délai de recours n’a ainsi expiré qu’à la mi-novembre 2003. Le requérant a donc disposé d’un délai d’environ deux mois à partir de la mise en œuvre des mesures de publicité sus-décrites pour saisir le juge administratif d’un recours contre le décret de classement.
29. La Cour en déduit que, comme dans l’affaire Geffre précitée, bien que, conformément au droit interne, le décret du 18 juillet 2003 ne lui ait pas été notifié, le requérant a eu une possibilité claire, concrète et effective de saisir le juge administratif d’un recours contre celui-ci. Il ne saurait donc soutenir qu’il y a eu en sa cause atteinte à la substance du droit à un tribunal que garantit l’article 6 § 1.
30. La requête est en conséquence manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
MIESSEN c. BELGIQUE du 18 octobre 2016 requête 31517/12
Violation de l'article 6-1 de la Conv EDH : L'examen en cassation devant le Conseil d'État est trop restreint et porte atteinte aux droits du requérant, dans sa substance même. l’interprétation particulièrement stricte par le Conseil d’État de l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 a restreint de façon disproportionnée le droit du requérant à voir son recours en cassation examiné au fond.
Sur la recevabilité
i. Rappel des principes applicables
42. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, entre autres, Micallef c. Malte[GC], no 17056/06, § 74, CEDH 2009, Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, § 90, CEDH 2012, Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 42, CEDH 2015, et Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 100, CEDH 2016). Enfin, ce droit doit revêtir un caractère civil.
43. La Cour rappelle ensuite que l’esprit de la Convention commande de ne pas prendre le terme « contestation » dans une acception trop technique, au sens de deux prétentions ou demandes contradictoires, et d’en donner une définition matérielle plutôt que formelle (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981, § 45, série A no 43).
44. L’article 6 § 1 n’assure aux « droits et obligations » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants : la Cour ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné (voir, par exemple, Fayed c. Royaume-Uni, 21 septembre 1994, § 65, série A no 294‑B, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 119, CEDH 2005‑X, et Boulois, précité, § 91). Il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes (Masson et Van Zon c. Pays-Bas, 28 septembre 1995, § 49, série A no 327‑A, Roche, précité, § 120, et Boulois, précité, § 91). La Cour doit avoir des motifs très sérieux de prendre le contre-pied des juridictions nationales supérieures en jugeant, contrairement à elles, que la personne concernée pouvait prétendre de manière défendable qu’elle possédait un droit reconnu par la législation interne (ibidem).
45. Dans cette appréciation, il faut toutefois, par-delà les apparences et le vocabulaire employé, s’attacher à cerner la réalité (Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 38, série A no 50, Roche, précité, § 121, et Boulois, précité, § 92).
ii. Application des principes en l’espèce
46. À la lumière des principes ci-dessus, la Cour estime tout d’abord qu’il y avait une « contestation » sur le prétendu droit du requérant à être indemnisé au titre de la loi du 1er août 1985. Certes, saisie par l’intéressé, la commission, qui est une instance juridictionnelle (voir paragraphe 27, ci‑dessus), déclara sa demande en indemnisation irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été introduite dans le délai de trois ans prenant cours à partir de la décision de classement sans suite. Cela n’empêche pas que le requérant avait soumis à la commission une demande, et qu’il y avait de ce fait une contestation sur le point de savoir s’il avait droit à une indemnisation (voir, mutatis mutandis, Rolf Gustafson c. Suède, 1er juillet 1997, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, et Szal c. Pologne, no 41285/02, § 30, 18 mai 2010). Par ailleurs, la Cour rappelle que l’existence d’une « contestation » ne présuppose pas la présence de deux prétentions ou demandes contradictoires (voir paragraphe 43, ci‑dessus). Enfin, rien ne permet de douter que la contestation était réelle et sérieuse.
47. Pour ce qui est de savoir si le droit interne reconnaît, au moins de manière défendable, un tel « droit », la Cour constate que plusieurs éléments plaident en faveur de la thèse du Gouvernement de la non-applicabilité de l’article 6 § 1. L’intervention de l’État prévue par la loi du 1er août 1985 ne repose pas sur une présomption de faute qui pèserait sur l’État au motif qu’il n’a pu empêcher l’infraction mais trouve son fondement dans un « principe de solidarité collective ». De plus, il ressort du texte de l’article 31 de la loi que la commission « peut octroyer » une aide financière, les travaux préparatoires de la loi indiquant à ce sujet que l’octroi de l’indemnité prévue par cette disposition « ne peut jamais être réclamé comme un droit » (voir paragraphe 23, ci-dessus). En outre, selon l’article 33 § 1 de la loi, le montant de l’aide à accorder « est fixé en équité ». Le Conseil d’État a lui aussi affirmé que, même si les conditions légales étaient remplies, la commission disposait d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de l’octroi de l’aide et la fixation de son montant (voir paragraphe 27, ci‑dessus).
48. Cela étant, la Cour rappelle qu’elle a déjà accepté que la seule existence d’un élément discrétionnaire dans le libellé d’une disposition légale n’excluait pas en soi l’existence d’un « droit » au sens de la Convention (Camps c. France, (déc.), no 42401/98, 23 novembre 1999, Lambourdière c. France, no 37387/97, § 24, 2 août 2000, et Ellès et autres c. Suisse, no 12573/06, § 16, 16 décembre 2010 ; voir également, a contrario, Boulois, précité, § 99).
49. De plus, la Cour constate que l’autorité compétente en l’espèce ne dispose pas, en pratique, d’un pouvoir discrétionnaire illimité pour décider s’il y a lieu d’accorder au requérant une indemnité (voir, a contrario, Masson et Van Zon, précité, § 51, Ankarcrona c. Suède (déc.), no 35178/97, CEDH 2000‑VI, et Mendel c. Suède, no 28426/06, § 50, 7 avril 2009). Au contraire, la commission doit exercer son pouvoir d’appréciation dans les limites légales : la loi du 1er août 1985, en ses articles 31 et 31bis (voir paragraphe 23, ci-dessus), prévoit que les demandeurs d’intervention doivent remplir plusieurs conditions de recevabilité ainsi que des conditions de fond liées à leur qualité de victime d’un acte intentionnel de violence. La commission doit se baser sur des faits dont les demandeurs doivent établir la réalité et qui varient selon les individus, et chiffrer, parfois de façon très précise, le montant à octroyer. Enfin, des critères d’éligibilité tangibles se dégagent du corpus des décisions de la commission, lesquelles forment d’ailleurs une jurisprudence accessible au public.
50. La Cour observe ensuite que, eu égard aux conditions posées par la loi du 1er août 1985 et à la pratique de la commission (voir paragraphes 23 et 25, ci-dessus), le requérant a pu soutenir qu’il remplissait les conditions légales et qu’il avait dès lors « droit » à une aide financière. S’il est vrai que sa demande a été rejetée, on peut remarquer que le délégué du ministre de la Justice dans son avis du 25 mars 2010 l’avait estimée partiellement fondée et que rien dans le dossier ne laisse à penser que la commission n’aurait pas examiné le bien-fondé de sa demande si elle n’avait eu à se prononcer sur le respect du délai d’introduction de la demande.
51. À cela s’ajoute que les décisions de la commission sont par la suite soumises au contrôle juridictionnel du Conseil d’État, recours que le requérant a exercé et qui dans un premier stade a été déclaré admissible (voir paragraphe 18, ci‑dessus).
52. Au vu de ces considérations, la Cour estime que, quelle que soit la qualification donnée à l’indemnisation en droit interne (voir, mutatis mutandis, Woś c. Pologne, no 22860/02, § 75, CEDH 2006‑VII), le requérant pouvait prétendre, au moins de manière défendable, avoir un « droit » à se voir octroyer l’indemnité réclamée, même si la commission jouissait à cet égard d’un certain pouvoir discrétionnaire.
53. Tenant compte enfin du fait que le droit en question était patrimonial par nature, la Cour considère qu’il revêtait un caractère « civil » (voir, mutatis mutandis, Rolf Gustafson, précité, § 41, Mennitto c. Italie [GC], no 33804/96, § 28, CEDH 2000‑X, et Woś, précité, § 76).
54. Certes, le Gouvernement fait valoir le caractère « politique » et non « civil » du droit en litige, tirant argument du fait que les demandes d’intervention au titre de la loi du 1er août 1985 ne reposent pas sur les notions classiques de responsabilité civile, domaine de compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, mais sur la solidarité collective pouvant donner lieu à la saisine d’une juridiction administrative.
55. Compte tenu du caractère autonome de la notion de « droits et obligations de caractère civil », la Cour ne juge pas ces éléments déterminants. Elle estime au contraire qu’il y a des similitudes entre le système d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et un système classique d’indemnisation ou d’assurance. Dans tous les cas, il s’agit d’apporter une aide financière à des personnes qui, touchées par des aléas de la vie, ont subi un dommage. La Cour note également qu’à l’instar d’un régime d’assurance, l’intervention au titre de l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence est subsidiaire en ce sens qu’on ne peut s’adresser à la commission que dans le cas où la victime ne peut pas obtenir une réparation effective, l’auteur des faits étant insolvable ou inconnu, ou parce que la victime n’a pas pu ou ne pourra pas obtenir une réparation adéquate par d’autres voies (article 31bis alinéa 1, 5o, de la loi du 1er août 1985).
56. Eu égard aux éléments ci-dessus, la Cour considère que l’article 6 § 1 s’applique en l’espèce.
3. Conclusion
57. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.
Au fond, la CEDH constate la violation
63. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18). Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient en revanche à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle se doit de vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation au droit d’accès à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, §§ 54-55, CEDH 2010, Sabeh El Leil c. France [GC], no 34869/05, §§ 46-47, 29 juin 2011, Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, §§ 229-230, CEDH 2012, Baka, précité, § 120).
64. L’article 6 § 1 n’astreint pas les États à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (voir, entre autres, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 122, CEDH 2000‑XI, RTBF c. Belgique, no 50084/06, § 70, CEDH 2011 (extraits), et Morice c. France [GC], no 29369/10, § 88, 23 avril 2015), notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour faire statuer sur les contestations relatives à leurs droits et obligations de caractère civil (voir, parmi d’autres, Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 44, Recueil 1996‑V, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 39, CEDH 2000‑II, Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 97, CEDH 2009, et L’Erablière A.S.B.L. c. Belgique, no 49230/07, § 36, CEDH 2009 (extraits)). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause, et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, § 37, CEDH 1999‑IX, Eliazer c. Pays-Bas, no 38055/97, § 30, CEDH 2001‑X, et L’Erablière A.S.B.L., précité, § 36).
65. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000‑I, Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 46, CEDH 2002‑IX, Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002‑IX, et L’Erablière A.S.B.L., précité, § 37).
66. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 27, 27 juillet 2006, L’Erablière A.S.B.L., précité, § 38, et RTBF, précité, § 71).
67. En l’espèce, la tâche de la Cour consiste à examiner si la raison pour laquelle le Conseil d’État rejeta le recours du requérant a privé l’intéressé de son droit à voir son recours examiné au fond. Pour ce faire, elle examinera la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.
68. La Cour constate que le Conseil d’État a déclaré le recours en cassation administrative du requérant irrecevable au motif que son mémoire en réplique se bornait à reproduire le contenu de sa requête, sans répondre aux arguments de la partie adverse. Le mémoire en réplique ne répondait, selon le Conseil d’État, dès lors pas au prescrit de l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État (voir paragraphe 28, ci-dessus).
69. La Cour observe que le texte de l’article 14, alinéa 3 n’oblige pas le requérant à répondre aux arguments de la partie adverse. Il se limite à exiger que le mémoire en réplique ordonne « l’ensemble des arguments de la partie requérante ». Il ne s’oppose donc pas formellement à ce que le contenu du mémoire en réplique ou de synthèse soit identique à celui de la requête en cassation, dans le cas où le requérant ne voudrait ou ne pourrait pas répondre aux moyens du défendeur. Le critère de recevabilité énoncé par le Conseil d’État dans la présente espèce s’appuie sur le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 30 novembre 2006 (voir paragraphes 29-30, ci‑dessus). Selon ce rapport, le but de l’obligation de déposer un mémoire en réplique sous la forme d’un mémoire de synthèse « est d’alléger le travail du Conseil d’État », qui « n’a plus, en principe, à statuer au vu de l’exposé des faits et des moyens figurant dans la requête ».
70. La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 80, 25 mars 2014), le rôle de la Cour se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 49, 20 octobre 2011).
71. La Cour est d’avis que si l’on peut admettre, comme le soutient le Gouvernement, que l’accélération et la simplification de l’examen des affaires par le Conseil d’État constituent des buts légitimes, elle s’interroge sur le point de savoir si le fait de déclarer un recours irrecevable au motif que le mémoire en réplique se borne à reproduire la requête en cassation, « sans chercher à répondre aux arguments de la partie adverse », n’est pas disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi.
72. La Cour n’est pas convaincue que le respect de la condition imposée, à savoir celle d’inclure dans le mémoire en réplique une réponse aux arguments de la partie adverse, ait été indispensable pour que le Conseil d’État puisse exercer son contrôle dans le cas d’espèce (voir, mutatis mutandis, Kemp et autres, précité, § 58), même de manière simplifiée. À cet égard, elle constate que les développements des moyens invoqués par le requérant dépassaient à peine une page, que le contenu du mémoire en réplique était identique à celui de la requête en cassation, et que ces moyens avaient été examinés par l’auditorat dans son rapport écrit. Dans ces circonstances, la Cour considère que la lecture du seul mémoire en réplique aurait suffi au Conseil d’État de prendre connaissance de « l’ensemble des arguments » du requérant et de statuer au vu d’un seul acte de procédure.
73. À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’interprétation particulièrement stricte par le Conseil d’État de l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 a restreint de façon disproportionnée le droit du requérant à voir son recours en cassation examiné au fond.
74. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAPAIOANNOU c. GRÈCE du 2 juin 2016 requête 18880/15
Non violation de l'article 6-1 : la limitation qui impose au justiciable de démontrer qu'il n'y a aucune jurisprudence spécifique ou que la décision critiquée est contraire à la jurisprudence habituelle du Conseil d'État est spécifique est proportionnée au droit d'accès à un tribunal.
39. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours (Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Les intéressés doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, §§ 33, CEDH 2000-I).
40. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir l’arrêt Guérin c. France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 37).
41. La Cour relève que la loi no 3900/2010 cristallise en termes législatifs les propositions faites par le Conseil d’Etat lui-même en vue de modifier la procédure devant lui afin de l’accélérer et désengorger son rôle. Le but de cette loi est de permettre au Conseil d’Etat de juger dans de brefs délais des affaires qui posent des problèmes d’un intérêt général et de créer ainsi rapidement une ligne jurisprudentielle que les juridictions administratives inférieures pourront utiliser dans des affaires similaires. Parmi les nombreuses modifications introduites par cette loi, son article 12 a été conçu de manière à limiter l’usage inconsidéré du pourvoi qui avait encombré le rôle du Conseil d’Etat et créé des retards importants dans l’administration de la justice (paragraphe 16 ci-dessus). Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là des buts légitimes qui visent à favoriser une bonne administration de la justice et permettre au Conseil d’Etat d’exercer efficacement ses fonctions judiciaires.
42. L’adoption de l’article 12 a suscité des critiques de la part des parties de l’opposition au Parlement, du service juridique du Parlement, de la Commission nationale des droits de l’homme et d’une partie de la doctrine (paragraphes 17-18 et 24-25 ci-dessus). Toutefois, la Cour ne peut pas prendre position sur ces critiques, dont certaines sont reprises par le requérant. La tâche de la Cour consiste à examiner les faits de la présente affaire en s’inspirant du principe de la subsidiarité et de sa jurisprudence en matière de mécanismes de filtrage, relatifs aux voies de recours devant les juridictions suprêmes.
43. La Cour rappelle à cet égard qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité des choix de politique jurisprudentielle opérés par les juridictions internes et que son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences de ces choix. Elle rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, § 31, 19 décembre 1997, Recueil 1997‑VIII et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil 1998‑I). En l’espèce, la Cour observe que le requérant se borne à exprimer son désaccord avec les nouvelles modalités du pourvoi devant le Conseil d’Etat et qu’il reproche à cette haute juridiction d’avoir péché par excès de formalisme.
44. Il peut ne pas être contraire à la Convention qu’une juridiction supérieure dotée de cette compétence rejette un recours en se bornant à citer les dispositions légales qui prévoient une telle procédure, si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière ou si le recours ne présente pas de perspectives suffisantes de succès (voir, mutatis mutandis, les décisions suivantes, relatives à des décisions d’irrecevabilité de recours constitutionnels (Verfassungsbeschwerden) du Tribunal constitutionnel fédéral allemand : Simon c. Allemagne (déc.), no 33681/96, 6 juillet 1999, Teuschler c. Allemagne (déc.), no 47636/99, 4 octobre 2001, Greenpeace E.V. et autres c. Allemagne (déc.), no 18215/06, 12 mai 2009, et John c. Allemagne (déc.), no 15073/03, 13 février 2007 ainsi que l’arrêt Arribas Antón c. Espagne, no 16563/11, § 47, 20 janvier 2015 en ce qui concerne le Tribunal constitutionnel espagnol).
45. La Cour rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès (Gorou c. Grèce (no. 2) [GC], no. 12686/03, § 29, 20 mars 2009 et Wnuk c. Pologne (déc.), no 38308/05, 1er septembre 2009). D’autre part, de manière plus générale, la Cour a jugé, sous l’angle de l’article 6, que les cours suprêmes ou constitutionnelles ou autres juridictions de dernière instance ne sont pas tenues de fournir une motivation détaillée lorsqu’elles refusent de se saisir d’un recours dans le contexte d’une procédure de filtrage (voir notamment, E.M. c. Norvège (déc.), no 20087/92, 26 octobre 1995 ; Société anonyme Immeuble Groupe Kosser c. France (déc.), no 38748/97, 9 mars 1999 ; Nerva et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 42295/98, 11 juillet 2000 ; Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001‑VI ; Bufferne c. France (déc.), no 5436700, CEDH 2002‑III (extraits)) ; Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, CEDH 2003‑II ; Sale c. France, no 39765/04, 21 mars 2006 ; Øvlisen c. Danemark (déc.), no16469/05, 30 août 2006 et Hansen c. Norvège, no 15319/09, § 74, 2 octobre 2014.
46. La Cour note d’emblée que l’article 12 de la loi no 3900/2010 exige que pour qu’une voie de recours devant le Conseil d’Etat soit désormais recevable, le demandeur démontre, dans l’acte introductif d’instance, de manière précise et circonstanciée, que chacun des moyens du pourvoi soulève une question juridique spécifique déterminante pour la solution du litige et que l’aspect juridique de cette solution est en contradiction avec la jurisprudence bien établie du Conseil d’État, d’une autre juridiction suprême ou avec une décision définitive des tribunaux administratifs, ou que pour la question juridique litigieuse il n’existe aucune jurisprudence. La Cour note aussi que l’article 12 de la loi précitée a fait l’objet d’une jurisprudence abondante du Conseil d’Etat qui a précisé le sens des dispositions de cet article (paragraphes 21-23 ci-dessus). Il en ressort que les formalités pour introduire un pourvoi devant le Conseil d’Etat sont claires et prévisibles et de nature à assurer le principe de sécurité juridique. À cet égard, la Cour rappelle que la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle que joue le Conseil d’Etat, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (voir, entre autres, Khalfaoui c. France, no 34791/97, § 37, CEDH 1999-IX et Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 62, 12 novembre 2002).
47. En l’espèce, en saisissant le Conseil d’Etat et afin de se conformer aux exigences de l’article 12, le requérant précisait dans son pourvoi, dans une section spécifique de celui-ci, qu’il n’y avait pas de jurisprudence du Conseil d’Etat relative à la question sous examen. En outre, il soutenait que cet article, dans la mesure où il posait comme condition de recevabilité du pourvoi, la divergence avec la jurisprudence des juridictions suprêmes grecques et des tribunaux administratifs, méconnaissait l’article 26 de la Constitution car il élevait la jurisprudence au rang de source de droit. Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi (arrêt no 4588/2014) au motif que les conditions de recevabilité, prévues par l’article 12 de la loi no 3900/2010, ne se trouvaient pas remplies en l’espèce.
48. Le Conseil d’Etat a souligné que la question de la conformité des dispositions de l’article 12 avec l’article 26 de la Constitution avait déjà été résolue et faisait l’objet d’une jurisprudence abondante (paragraphes 12 et 20 ci-dessus). À cet égard, la Cour relève que le requérant a introduit son pourvoi le 1er octobre 2012, et que l’arrêt no 2456/2012 par lequel le Conseil d’Etat s’était prononcé sur la constitutionnalité de cette nouvelle disposition était rendu depuis le 5 juillet 2012 (paragraphe 19 ci-dessus). Quant au moyen relatif à l’absence de jurisprudence, il a été formulé de manière affirmative et succincte sans préciser, comme l’a souligné le Conseil d’Etat, à l’égard de quelle question notamment juridique, il y avait absence de jurisprudence.
49. Eu égard à la spécificité du rôle que joue le Conseil d’Etat en tant juridiction chargée de la cohérence de la jurisprudence, la Cour estime que l’on peut admettre que la procédure suivie devant la haute juridiction administrative soit assortie davantage de conditions de recevabilité. Par ailleurs, elle estime que le fait de subordonner la recevabilité d’un pourvoi à l’existence de circonstances objectives et à leur justification par l’auteur du pourvoi, qui sont des critères prévus par la loi et interprétés par la jurisprudence administrative n’est pas, en tant que tel, disproportionné ou bien contraire au droit d’accès au Conseil d’Etat (voir, mutatis, mutandis, Arribas Antón, précité, § 50).
50. À la lumière de qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas été privé de la substance de son droit d’accès à un tribunal. En outre, les limitations appliquées poursuivaient un but légitime. L’application des limitations en cause n’a pas porté atteinte au caractère raisonnable du rapport entre les moyens employés et le but visé. Pour ces raisons, la Cour estime que le requérant n’a pas subi d’entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
51. Par conséquent, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
MOTTOLA et autres C. ITALIE arrêt du 4 février 2014 requête 29932/07
La loi n'est pas assez précise pour que les demandeurs puissent savoir s'il faut saisir le tribunal administratif ou le juge du travail. Cet arrêt est confirmé par l'arrêt Staibano et autres C. Italie requête 29907/07 du 4 février 2014.
C
EDH27. La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès – à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile – constitue un aspect, n’est pas absolu, mais qu’il peut donner lieu à des limitations implicitement admises. Néanmoins, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Khalfaoui c. France, no 34791/97, §§ 35-36, CEDH 1999-IX ; Papon c. France, no 54210/00, § 90, CEDH 2002-VII ; et Pennino c. Italie, no 43892/04, § 73, 24 septembre 2013 ; voir également le rappel des principes pertinents dans Fayed c. Royaume-Uni, 21 septembre 1994, § 65, série A no 294-B).
28. La Cour observe que l’irrecevabilité du recours administratif des requérants était la conséquence de l’application des règles sur la répartition des compétences et les délais de procédure prévues à l’article 69 § 7 du texte unifié sur l’emploi public. Cette disposition poursuivait un but d’intérêt général, en l’occurrence celui d’une répartition cohérente et rationnelle de la compétence en matière de « rapport d’emploi public » entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. Par ailleurs, la fixation de délais de procédure poursuivait le but légitime d’assurer une bonne administration de la justice.
29. La Cour rappelle également que c’est d’abord aux autorités nationales, et tout spécialement, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter le droit interne, et qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire. C’est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant l’introduction de recours. C’est en principe aux juridictions internes de veiller à l’observation des règles de délai dans le déroulement de leurs propres procédures (Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII).
30. Il n’en demeure pas moins que les requérants, qui avaient saisi les juridictions administratives de bonne foi et dans un cadre légal pouvant donner lieu à une pluralité d’interprétations, ont été privés de la possibilité de réintroduire leurs recours devant la juridiction finalement considérée comme compétente, à savoir le juge du travail (voir également, dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, les paragraphes 54-56 ci-après).
31. Leur droit d’accès à un tribunal s’en est trouvé atteint dans sa substance. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
KEMPET ET AUTRES c. LUXEMBOURG du 24 AVRIL 2008 Requête 17140/05
Les requérants se plaignent que la Cour de cassation rejette leur moyen sans l'examiner en le considérant comme une simple doléance contre les juridictions administratives. La CEDH démontre l'intérêt du moyen.
CEDH
47. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 34). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente.
48. La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, §§ 25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
49. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
50. A ce jour, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi, quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX). Cela étant, la Cour a déjà admis que les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvaient être plus rigoureuses que pour un appel (Běleš et autres, précité, § 62).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
51. Dans le cas d’espèce, la tâche de la Cour consiste à examiner si le motif du rejet du pourvoi en cassation par la Cour de cassation a privé les requérants de leur droit de voir examiné le moyen présenté dans leur pourvoi. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.
52. Tout d’abord, la Cour constate que la règle appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur le caractère recevable du pourvoi en cause est une construction jurisprudentielle. En effet, l’article 10 de la loi du 18 février 1885 se borne à prévoir que, pour introduire un pourvoi en cassation, l’intéressé doit déposer au greffe de la Cour de cassation « un mémoire (...) lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée ». C’est la haute juridiction qui a introduit la distinction entre l’énoncé du moyen de cassation, d’une part, et « la discussion qui développe le moyen [et qui] ne peut suppléer à l’absence de formulation de moyen », d’autre part.
53. La Cour estime que la limitation imposée par cette règle jurisprudentielle tend à un but légitime. En effet, la précision exigée dans la formulation des moyens de cassation a clairement pour objectif de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle en droit.
54. Reste à savoir si cette exigence de précision dans la formulation des moyens de cassation répond à la condition de la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La Cour examinera donc de quelle manière les requérants présentèrent leur grief à la Cour de cassation, d’une part, et pour quelles raisons leur pourvoi fut rejeté, d’autre part.
55. Les requérants annoncèrent, dans leur mémoire en cassation, que leur pourvoi était dirigé contre l’arrêt du 5 novembre 2003 de la cour d’appel en ce qu’il avait réformé le jugement de première instance et avait rejeté leur demande introductive d’instance. Ils indiquèrent ensuite que le moyen de cassation, tel qu’il est en cause dans la présente affaire, était tiré de la violation de l’article 1 du Protocole no 1. En développant ce moyen sous une rubrique « C. Quant à la violation (...) de l’article 1er du [Protocole no 1] », ils rappelèrent la jurisprudence de la Cour en la matière, et indiquèrent que le refus de rétrocéder les terrains les privait de manière arbitraire de leurs biens, alors que le but d’utilité publique avait disparu, suite au changement du tracé de l’autoroute. Ils estimèrent que l’Etat cherchait ainsi à s’approprier, à leur détriment, la plus-value desdits terrains, dans un but de spéculation foncière. Ils conclurent comme suit :
« (...) Vu sous l’angle de la plus-value dont se trouvent privés les [requérants], le rejet en bloc par la cour d’appel de la demande introductive d’instance s’analyse en une privation de propriété pure et simple au sens de la seconde phrase du 1er alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 de la CEDH.
N’étant de surcroît, pas justifiée en l’espèce par des circonstances exceptionnelles, cette privation de propriété constitue une atteinte excessive au droit fondamental exprimé par la première phrase dudit alinéa et fait peser sur les [requérants] une charge disproportionnée.
En considération des développements qui précèdent et plus particulièrement de ceux relatifs à la plus-value des biens dont les [requérants] se trouvent indûment dépossédés par la cour d’appel, il y a donc lieu de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la CEDH, ce que la Cour de cassation est appelée à constater et à sanctionner par la cassation. (...) »
56. La Cour de cassation décida que les énonciations du mémoire réunies sous l’intitulé « Moyens de cassation » consistaient, après le visa des dispositions légales invoquées, en une succession de considérations de fait et de droit qui constitueraient une discussion mais n’articuleraient pas avec la précision requise des moyens de cassation au sens de l’article 10 de la loi du 18 février 1885.
57. Aux yeux de la Cour, l’on ne saurait soutenir que les requérants auraient omis de soumettre à la connaissance des juges suprêmes les éléments déterminants de l’affaire ainsi que leurs doléances à l’égard de l’arrêt de la cour d’appel attaqué. En effet, ils se sont plaints, au titre de l’article 1 du Protocole no 1, que la cour d’appel faisait peser sur eux une charge disproportionnée en rejetant leur demande en rétrocession des terrains litigieux et demandèrent à la Cour de cassation de casser l’arrêt attaqué.
58. Ainsi, la Cour estime que la précision exigée par la Cour de cassation dans la formulation du moyen de cassation litigieux n’était pas indispensable pour que la haute juridiction suprême puisse exercer son contrôle. Pareille exigence affaiblit à un degré considérable la protection des droits des justiciables devant la haute juridiction nationale, surtout si l’on tient compte du fait que le Luxembourg ne connaît pas le système des avocats aux Conseils spécialisés.
59. Dans ces conditions, prononcer l’irrecevabilité du moyen en question au motif qu’il n’avait pas été articulé avec la précision requise s’inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché les requérants de voir la Cour de cassation se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen (mutatis mutandis Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 33, 27 juillet 2006).
60. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’en l’espèce, la limitation imposée au droit d’accès des requérants à un tribunal n’a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
61. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit des requérants d’avoir accès à un tribunal.
Arrêt GUILLARD c. FRANCE du 15 janvier 2009 Requête 24488/04
Un fonctionnaire avait contesté le calcul de sa retraite devant le Conseil d'Etat et avait posé une formule qui indiquait qu'il se réservait le droit de soumettre un mémoire ampliatif. Comme il ne l'a pas soumis le Conseil d'Etat a cru qu'il pouvait conclure à son désistement. La CEDH constate un non accès au juge.
cedh
"33. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Par ailleurs, le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir parmi d'autres García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II et Annoni di Gussola et autres c. France, nos 31819/96 et 33293/96, § 48, CEDH 2000-XI).
34. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. García Manibardo précité, § 36 et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 47, CEDH 2002-IX).
35. La Cour réaffirme que la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (voir notamment Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3255, § 45, Cañete de Goñi c. Espagne, no 55782/00, § 36, CEDH 2002-VIII, Kaufmann c. Italie, no 14021/02, § 32, 19 mai 2005 et Melnyk c. Ukraine, no 23436/03, § 23, 28 mars 2006).
36. Il résulte de ces principes que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Kadlec et autres c. République tchèque, no 49478/99, § 26, 25 mai 2004 et Walchli c. France, no 35787/03, § 29, 26 juillet 2007).
37. La Cour relève que, dans la présente affaire, selon les règles de compétence des juridictions administratives, le Conseil d'Etat était appelé à statuer en premier et dernier ressort sur le recours du requérant. Ce dernier soulevait la non-conformité du décret du 26 février 2001 avec le « protocole Durafour » et faisait valoir le manque à gagner qui en résultait pour lui, notamment en termes de retraite. Toutefois, son recours n'a pas été examiné au fond par le Conseil d'Etat, qui a estimé qu'il s'en était désisté d'office.
38. Il ne fait pas de doute pour la Cour qu'un mécanisme tel que celui du désistement d'office, qui a pour but de réduire le délai d'instruction des recours devant les juridictions administratives, vise une bonne administration de la justice. Reste à établir si l'application qui en a été faite en l'espèce a respecté un rapport raisonnable de proportionnalité.
39. La Cour note qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, le requérant qui, dans sa requête initiale, a mentionné l'intention de présenter un mémoire complémentaire et ne le fait pas dans un certain délai est réputé s'être désisté d'office. En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré que la phrase « je me réserve le droit d'amplifier le présent recours si besoin est » indiquait l'intention du requérant de produire un tel mémoire et en a tiré les conséquences.
40. Le requérant, pour sa part, a précisé que cette phrase était inspirée de la formule d'usage par laquelle se terminaient les rapports de mer qu'il rédigeait en qualité de capitaine de port (« le capitaine se réserve le droit d'amplifier le présent rapport si besoin est »).
41. Le Gouvernement fait valoir que ces termes laissaient supposer « sans ambiguïté » l'intention de produire un mémoire ampliatif.
42. La Cour ne partage pas cette approche. Elle observe en effet que le requérant, non juriste, n'était pas représenté par un avocat au stade de l'introduction de son recours, comme le droit français le lui permet (en l'espèce l'article R. 432-2 du CJA). Si l'on peut légitimement attendre d'un professionnel du droit qu'il soit particulièrement rigoureux dans la rédaction d'un recours, et en particulier dans le choix des mots qu'il emploie, un tel degré d'exigence ne peut être appliqué sans flexibilité à un requérant qui n'est pas représenté.
43. La Cour rappelle que la spécificité d'une procédure devant une haute juridiction ne peut justifier qu'il ne soit pas offert au demandeur, auquel il est reconnu en droit interne le droit de se représenter personnellement, des moyens de procédure qui lui assureront le droit à un procès équitable devant cette juridiction (cf. mutatis mutandis Voisine c. France (no 27362/95, §§ 32-33, 8 février 2000).
44. Or en l'espèce, le requérant, s'il utilisait le terme « amplifier », ne faisait aucune référence à un éventuel mémoire qu'il entendait produire (cf. a contrario les arrêts cités au paragraphe 20 ci-dessus). La Cour relève d'ailleurs qu'il a utilisé la même mention à la fin de son mémoire en réplique (« je me réserve d'amplifier le présent mémoire si besoin est »), ce qui souligne qu'il l'utilisait comme une formule d'usage.
45. La Cour observe par ailleurs que la jurisprudence du Conseil d'Etat sur ce point peut paraître d'une relative complexité à un non professionnel du droit puisque, notamment, l'expression « (le demandeur) se réserve le droit de produire tout mémoire », proche de celle employée par le requérant, n'a pas été interprétée par la haute juridiction comme annonçant la présentation d'un mémoire complémentaire (voir l'arrêt Yepes cité au paragraphe 21 ci-dessus).
46. La Cour attache également une particulière importance au fait qu'aucun des ministres défendeurs n'a soulevé le désistement d'office, alors que cet argument est souvent invoqué par l'administration devant le Conseil d'Etat. Cela signifie que les défendeurs eux-mêmes, qui sont familiers de la procédure administrative, n'ont pas vu dans la formule employée par le requérant, alors qu'ils y avaient pourtant tout intérêt, l'annonce « sans ambiguïté » d'un mémoire complémentaire.
47. La Cour tient également compte des conséquences du désistement d'office pour le requérant : ce dernier, qui se plaignait des effets du décret, notamment sur sa retraite, n'a pas pu faire examiner son recours par le Conseil d'Etat, seul juge qu'il pouvait saisir en raison de sa compétence en premier et dernier ressort (cf. a contrario, Société civile des Néo-Polders c. France (déc.), no 71463/01, 22 février 2005, où le recours avait été examiné par trois degrés de juridiction).
48. En dernier lieu, la Cour observe que l'objectif poursuivi, à savoir réduire le délai d'instruction des recours, peut être atteint par des moyens moins rigoureux, tels que l'envoi d'une mise en demeure, comme c'est le cas devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (voir paragraphe 17 ci-dessus).
49. En conclusion, la Cour est d'avis que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant s'est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d'autre part, le droit d'accès au juge (Kadlec précité §§ 23-30 et Walchli précité, §36).
50. Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 § 1 de la Convention."
ARRÊT BLONDEAU c. FRANCE du 21 décembre 2010 requête 48000/07
Les requérants n'ont pas pu faire valoir, par voie d'intervention et après la clôture des opérations, l'illégalité de l'arrêté ordonnant le remembrement mais ils pouvaient agir contre les décisions de réattribution des parcelles prises par les commissions d'aménagement foncier qui, elles, peuvent être contestées devant les juridictions administratives même après la clôture des opérations. Ce fut d'ailleurs le cas en l'espèce puisque la CDAF réattribua aux requérants leur parcelle sur laquelle se trouvait un puits par une décision du 8 juin 2000, postérieure à la clôture des opérations. Il n'y a pas de violation de l'article 6-1 de la Convention.
CEDH
47. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal, reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention, n'est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient en revanche à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle se doit de vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation au droit d'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d'autres, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I ; Fogarty c. Royaume-Uni [GC], no 37112/97, § 33, CEDH 2001-XI, et, en dernier lieu, Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, § 55, 23 mars 2010).
48. La Cour constate dans un premier temps qu'il existe bien une ingérence dans le droit d'accès au tribunal des requérants. En effet, ceux-ci n'ont pas pu faire valoir, par voie d'intervention et après la clôture des opérations, l'illégalité de l'arrêté ordonnant le remembrement. La Cour observe que les requérants ont néanmoins pu contester devant les juridictions administratives les décisions de réattribution des parcelles prises par la CDAF après la clôture des opérations et qu'en vertu de la solution adoptée par le Conseil d'Etat, le personnes intéressées conservent la faculté de mettre en cause la légalité de l'arrêté ordonnant le remembrement par voie d'action, au besoin en référé, dans les deux mois suivant sa publication.
49. De plus, la Cour observe qu'en l'espèce, les requérants ont pu contester la validité de l'arrêté ordonnant le remembrement plusieurs années après qu'il soit entré en vigueur dans la mesure où les autorités administratives n'ont pas pu démontrer que cet arrêté avait été régulièrement publié. Elle constate toutefois que les requérants ont été informés dès 1991 de l'existence de cet arrêté, mais que ce n'est qu'en 1999 et après la procédure engagée devant les juridictions administratives pour contester les décisions de la CDAF, qu'ils ont fait valoir l'irrégularité de cet acte.
50. La Cour est donc appelée à rechercher si l'ingérence dans le droit des requérants d'accès à un tribunal poursuivait un but légitime. A cet égard, elle observe que l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement aurait eu pour effet de remettre en cause les trois cent cinquante-quatre transferts de propriété intervenus après la clôture des opérations en 1994. Cette remise en cause générale des opérations de remembrement, plusieurs années après qu'elles soient devenues définitives, et alors que les attributaires ont recommencé à cultiver les parcelles qui leur avait été attribuées, y ont entre-temps réalisé des investissements, les ont cédées ou données à bail, porterait une atteinte non négligeable aux droits des autres propriétaires et serait source d'insécurité juridique en raison des bouleversements importants qu'elle pourrait susciter compte tenu du temps écoulé.
51. La Cour en conclut que cette limitation du droit de demander l'annulation de l'arrêté initial poursuit un but légitime, à savoir la préservation des droits des autres propriétaires concernés par le remembrement et la sécurité juridique. Reste à savoir si elle est proportionnée au but recherché.
52. La Cour observe que la solution adoptée par le Conseil d'Etat n'a pas privé les requérants de la possibilité d'ester en justice pour obtenir l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement, mais qu'elle limite simplement cette action dans le temps. La Cour doit donc rechercher si les possibilités d'action des requérants se concilient avec les délais de recours dont ils disposent.
53. Les requérants soutiennent que les délais de traitement des actions en annulation par les juridictions administratives sont généralement plus longs que les opérations de remembrement. Cette affirmation n'est pas contestée par le Gouvernement. La Cour n'a pas à spéculer sur la durée de la procédure en annulation des arrêtés si celle-ci avait, en l'espèce, été introduite avant l'arrêté de clôture des opérations. Elle observe simplement que la solution retenue par le Conseil d'Etat permet aux personnes concernées par un remembrement de saisir le juge administratif, en référé, d'une demande tendant à l'annulation ou à la suspension de l'arrêté en cas d'illégalité. Même si ce recours ne permet de constater l'illégalité de l'arrêté qu'en cas d'erreur manifeste, comme le font valoir les requérants puisque le juge des référés est juge de l'évidence, la Cour constate, à l'instar du commissaire du Gouvernement, que cette illégalité ne peut guère résulter que d'un vice de procédure. Dès lors, il apparaît que la saisine du juge des référés ouvre une possibilité réelle pour les personnes concernées par un remembrement de demander l'annulation, ou la suspension, du texte avant que les opérations de remembrement ne soient achevées.
54. La Cour note également que la limitation du droit d'accès opposée aux requérants a une portée limitée dans la mesure où elle ne concerne que la légalité de l'arrêté ordonnant le remembrement et non les décisions de réattribution des parcelles prises par les commissions d'aménagement foncier qui, elles, peuvent être contestées devant les juridictions administratives même après la clôture des opérations. Ce fut d'ailleurs le cas en l'espèce puisque la CDAF réattribua aux requérants leur parcelle sur laquelle se trouvait un puits par une décision du 8 juin 2000, postérieure à la clôture des opérations. Or, en pratique, ce sont le plus souvent les décisions de réattribution des parcelles qui sont susceptibles de léser les propriétaires.
55. La Cour constate également que dans pareille situation, les requérants conservent la faculté d'invoquer l'illégalité de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement à l'appui d'un recours indemnitaire si cette illégalité est source de préjudice pour eux.
56. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l'ingérence dans le droit de recours des requérants est proportionnée au but poursuivi.
57. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
ARRET TRITSIS C. GRECE REQUETE 3127/08 DU 10 JUIN 2010
Le fait qu'un recours soit accepté pour certains qui ont une habitation principale et pas pour d'autres alors qu'ils ont une maison secondaire est un non accès au tribunal pour ces derniers
CEDH
22. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Lionarakis c. Grèce, no 1131/05, § 26, 5 juillet 2007.
23. La Cour rappelle en outre que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I). Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste des règles applicables faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX).
24. En dernier lieu, la Cour note que le droit d’accès à un tribunal présente des affinités avec l’obligation des tribunaux de motiver leurs décisions. En effet, juger consiste à trancher au fond le litige porté devant une juridiction et l’article 6 § 1 ne permet pas l’emploi de subterfuges visant à éviter l’examen de la substance des griefs soulevés par l’intéressé (N.T. Giannousis et Kliafas Brothers S.A. c. Grèce, no 2898/03, § 26, 14 décembre 2006), l’absence totale de motivation (Annoni di Gussola et autres c. France, nos 31819/96 et 33293/96, § 57, CEDH 2000-XI) ou l’usage par le tribunal compétent de motifs manifestement illégaux pour justifier sa décision (De Moor c. Belgique, 23 juin 1994, § 55, série A no 292-A). Lorsque de tels défauts entachent la décision du tribunal compétent quant à la recevabilité du recours exercé, l’attitude du juge peut équivaloir à un déni de justice, ce qui porterait atteinte au droit d’accès à un tribunal. Il est à noter que l’exigence de motivation requiert une importance particulière dans le cadre du contentieux administratif, puisque dans ce domaine, l’acte administratif contesté par le justiciable entraîne souvent des effets irréversibles sur ses activités personnelles ou professionnelles (N.T. Giannousis et Kliafas Brothers S.A. c. Grèce, loc. cit.).
Application des principes en l’espèce
25. La Cour observe d’emblée que, comme il ressort clairement de l’arrêt no 4046/2006 du Conseil d’Etat, le recours en annulation en cause a été rejeté, en ce qui concerne le requérant, pour un motif manifestement distinct de celui retenu par la haute juridiction administrative à l’égard des deux autres demandeurs en cassation. En particulier, le Conseil d’Etat a constaté que le requérant manquait de communauté d’intérêts avec les deux autres demandeurs du fait qu’il possédait une résidence secondaire dans la zone en cause, tandis que ceux-ci basaient leur intérêt pour agir sur l’existence d’une résidence permanente. Quant à ces derniers, il a été constaté qu’ils n’étaient pas parvenus à établir leur intérêt pour agir en l’espèce. Or, la Cour note que le rejet du recours en annulation du requérant pour manque de communauté d’intérêts n’était pas conforme à l’article 45 du décret législatif no 18/1989 tel que modifié par l’article 22 de la loi no 3226/2004 ; ladite disposition prévoit explicitement que lorsque les demandeurs en annulation ne sont pas liés par une communauté d’intérêts, leur recours n’est pas rejeté, mais il est examiné à l’égard du premier requérant et de ceux qui ont une communauté d’intérêts avec lui. En ce qui concerne les autres demandeurs, l’affaire est disjointe.
26. La Cour note que la haute juridiction administrative n’a exposé dans son arrêt no 4046/2006 aucune raison spécifique pour justifier l’inapplicabilité éventuelle de la disposition pertinente du droit interne dans la cause qui lui était soumise. Sur ce point, la Cour prend note de l’argument avancé par le Gouvernement, à savoir que le Conseil d’Etat avait tacitement constaté que le requérant manquait d’intérêt pour agir à l’instar des deux autres demandeurs en cassation et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire d’ordonner la disjonction de son recours en annulation. Néanmoins, cet argument n’est aucunement corroboré par les motifs retenus par le Conseil d’Etat dans son arrêt no 4046/2006. Au contraire, en rejetant le recours en annulation du requérant pour manque de communauté d’intérêts avec les autres demandeurs, le Conseil d’Etat a explicitement admis que son intérêt pour agir n’était pas le même que celui de ces derniers, auxquels la haute juridiction n’a pas reconnu d’intérêt pour agir au motif qu’ils n’avaient pas précisé de quelle manière leurs conditions de vie en tant que résidents permanents se trouvaient atteintes. Partant, il serait contradictoire que ladite juridiction admette tacitement au sein de la même décision que l’intérêt pour agir du requérant, qui fondait celui-ci sur le fait de maintenir une résidence secondaire dans la zone concernée par l’acte ministériel attaqué, coïncidait de fait avec celui des autres demandeurs en cassation.
27. La Cour est consciente qu’il appartient en premier lieu aux juridictions nationales de vérifier si les règles de recevabilité régissant l’exercice des recours internes ont été respectées par le justiciable, mais rappelle aussi que la Convention ne garantit pas des droits théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi beaucoup d’autres, Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 34, CEDH 1999-I). Or, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la formulation retenue par le Conseil d’Etat à l’égard du requérant a méconnu l’article 45 du décret législatif no 18/1989 tel que modifié par l’article 22 de la loi no 3226/2004 et que la haute juridiction administrative a employé en l’espèce des motifs manifestement illégaux pour justifier sa décision.
28. Partant, la Cour estime que la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée par le Conseil d’Etat n’était pas proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
Il y a eu donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit du requérant d’avoir accès à un tribunal.
Linnekogel contre Suisse du 01/03/2005 requête 43874/98
La CEDH sanctionne un recours administratif dont l'efficacité n'était pas prouvée par le Gouvernement.
CEDH
"31. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36).
32. Par ailleurs, la Cour rappelle que des impératifs de souplesse et d’efficacité peuvent justifier, en matière civile ou pénale, l’intervention d’organes non juridictionnels ne satisfaisant a priori pas aux garanties de l’article 6 (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, p. 23, § 51). Dans cette hypothèse, le justiciable doit disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, doté de la plénitude de juridiction et offrant les garanties de l’article 6 § 1 (voir, notamment, les arrêts Albert et Le Compte c. Belgique, arrêt du 10 février 1983, série A no 58, p. 16, § 29 ; Öztürk c. Allemagne, arrêt du 21 février 1984, série A no 73, p. 21 et s, § 56 ; Fischer c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 312, p. 17, § 28 ; Schmautzer c. Autriche, arrêt du 23 octobre 1995, série A no 328-A, p. 15, § 34 ; Riepan c. Autriche, no 35115/97, § 39, CEDH 2000-XII).
33. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales (Bulena c. République tchèque, no 57567/00, § 28, 20 avril 2004).
34. Or, la Cour rappelle sa jurisprudence pertinente selon laquelle il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu’un recours était effectif et disponible à l’époque des faits, tant en théorie qu’en pratique ; c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, entre autres, Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, § 37, CEDH 2003-III, qui fait référence à l’affaire V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).
35. En l’occurrence, la Cour constate d’abord qu’il ressort clairement des dispositions pertinentes de la loi fédérale d’organisation judiciaire, en particulier des articles 98 et 100, qu’à l’époque des faits, le recours de droit administratif n’était pas disponible contre la décision du Conseil fédéral en date du 26 juin 1998. A ce sujet, il convient de rappeler que la police fédérale suisse a communiqué au requérant, dans une lettre du 4 septembre 1998, qu’« (...) aucun recours ordinaire ne peut être présenté contre les décisions judiciaires du Conseil fédéral – l’une des plus hautes instances de justice administrative de la Confédération. »
36. Ensuite, la Cour constate que l’arrêt du Tribunal fédéral (arrêt Kaptan, ATF 125 II 417), invoqué par le Gouvernement à l’appui de sa thèse selon laquelle le recours de droit administratif au Tribunal fédéral aurait été disponible, est intervenu le 26 juillet 1999, soit après les événements pertinents pour la présente affaire. En tant que tel, il ne peut pas être pris en compte dans l’appréciation de la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes.
37. En même temps, la Cour estime que les trois autres affaires invoquées par le Gouvernement ne sont pas non plus pertinentes en l’espèce, étant donné qu’elles concernaient la question plus générale de la primauté du droit international sur le droit interne, mais n’abordaient pas celle de la recevabilité du recours de droit administratif dirigé à l’encontre des décisions du Conseil fédéral (voir « Le droit et la pratique internes pertinents »). De surcroît, dans l’affaire ATF 118 Ib 277 du 28 juillet 1992, le Tribunal fédéral a explicitement confirmé l’irrecevabilité du recours de droit administratif contre les décisions du Gouvernement fédéral touchant à la sécurité de l’Etat, en raison du libellé clair de l’article 100 lettre a) de la loi fédérale d’organisation judiciaire.
38. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’est pas parvenu à démontrer que le recours de droit administratif était disponible à l’époque des faits pertinents pour la présente affaire et qu’on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir saisi le Tribunal fédéral d’un recours de droit administratif à l’encontre de la décision du Conseil fédéral du 26 juin 1998.
39. Dès lors, il échet de constater que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
40. Il s’ensuit que le requérant n’a pas joui du droit d’accès à un tribunal, étant donné que la contestation sur ses droits civils n’a fait l’objet d’un contrôle que de la part des autorités administratives, à savoir du Département fédéral de justice et police et, en dernier lieu, du Conseil fédéral, autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
EN MATIÈRE FISCALE IL EST POSSIBLE QUE LE TRIBUNAL
NE PUISSE PAS MODULER UNE PÉNALITÉ FISCALE
Arrêt Segame SA C. France requête n° 4837/06 du 7 juin 2012
L’absence de modulation de la pénalité fiscale relative à la taxe sur les objets d’art n’est pas contraire à la Convention
54. La Cour rappelle qu’un système d’amendes administratives, telles les pénalités fiscales dans la présente affaire, n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de cet article (Bendenoun c. France, 24 février 1994, § 46, série A no 28 et Silvester’s Horeca Service c. Belgique, nº 47650/99, § 25, 4 mars 2004).
55. Le respect de l’article 6 § 1 de la Convention suppose en effet que la décision d’une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de cet article subisse le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction (Schmautzer précité, § 34, et Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro et Pfarrmeier c. Autriche, arrêts du 23 octobre 1995, série A nos 328 A-C et 329 A-C, §§ 37, 42 et 39, 41 et 38 respectivement). Parmi les caractéristiques d’un tel organe judiciaire figure le pouvoir de réformer en tous points la décision entreprise rendue par l’organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Chevrol c. France, no 49636/99, § 77, CEDH 2003-III, Silvester’s Horeca Service précité, § 27 et A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italie, no 43509/08, § 59, 27 septembre 2011).
56. La Cour relève que dans la présente affaire, la requérante a pu former devant le tribunal administratif un recours visant la décharge du rappel de taxe et des pénalités, et saisir ensuite la cour administrative d’appel et le Conseil d’État d’un appel et d’un pourvoi en cassation. Il s’agissait en l’espèce d’un recours de plein contentieux, dans le cadre duquel le juge administratif dispose de pouvoirs étendus : il apprécie tous les éléments de fait et de droit et peut non seulement annuler ou valider un acte administratif, mais également le réformer, voire substituer sa propre décision à celle de l’administration et se prononcer sur les droits de l’intéressé ; en matière fiscale, il peut décharger le contribuable des impôts et pénalités mis à sa charge ou en modifier le montant dans la limite de l’application de la loi, et en matière de pénalités, substituer un taux inférieur à un taux supérieur pour autant que la loi le prévoie (paragraphes 29-30 ci-dessus ; a contrario Silvester’s Horeca Service précité, § 28).
57. Il en résulte que, devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, juridictions satisfaisant aux exigences de l’article 6 § 1, la requérante a pu faire valoir tous les arguments de fait et de droit qu’elle estimait utiles au soutien de sa demande de décharge de la taxe et des pénalités (cf. mutatis mutandis Malige, précité, § 48), et notamment soulever la contrariété de la taxe avec le droit communautaire et en discuter de façon détaillée l’assiette, dont elle a d’ailleurs obtenu la réduction par la cour administrative d’appel (paragraphe 17 ci-dessus).
58. Le grief de la requérante porte sur le fait qu’en l’espèce les juridictions administratives n’avaient pas le pouvoir de moduler l’amende fiscale, en l’absence de disposition légale le permettant.
59. La Cour observe tout d’abord que la loi elle-même proportionne dans une certaine mesure l’amende à la gravité du comportement du contribuable, puisque celle-ci est fixée en pourcentage des droits éludés, dont en l’espèce la requérante a pu amplement discuter l’assiette (cf. mutatis mutandis Valico S.r.l. c. Italie (déc.), no 70074/01, CEDH 2006-III). La Cour admet par ailleurs, comme le souligne le Gouvernement, le caractère particulier du contentieux fiscal impliquant une exigence d’efficacité nécessaire pour préserver les intérêts de l’Etat et observe, en outre, que ce contentieux ne fait pas partie du noyau dur du droit pénal au sens de la Convention (cf. mutatis mutandis Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 43, CEDH 2006-XIII). Elle considère enfin que le taux de l’amende, fixé à 25% par l’ordonnance du 7 décembre 2005, n’apparaît pas disproportionné (Malige précité, § 49 ; a contrario et mutatis mutandis Mamidakis c. Grèce, no 35533/04, § 48, 11 janvier 2007 et Grifhorst c. France, no 28336/02, § 105, 26 février 2009).
60. Dès lors, en l’absence d’arbitraire, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1.
DIFFICULTÉ D'INTERPRÉTATION D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE
Arrêt Beaumartin contre France du 24/11/1994 Hudoc 479; requête 15287/89
Le Conseil d'Etat a dû faire interpréter une convention internationale par le Ministre des affaires étrangères et a appliqué strictement l'interprétation de la dite autorité exécutive
"La Cour rappelle que la pratique en question obligeait le juge administratif, confronté à une difficulté sérieuse d'interprétation d'une convention internationale, à demander au ministre des affaire étrangères d'indiquer le sens de la disposition contestée pour ensuite s'y conformer en toutes circonstances; le Gouvernement le concède.
Elle prend acte du récent changement du droit français à cet égard: désormais () l'interprétation des traités ne ressortit plus à la compétence exclusive du ministre des affaire étrangères () en l'espèce, le Conseil d'Etat s'en remit à une autorité relevant du pouvoir exécutif pour résoudre le problème juridique qui lui était posé : il rejeta la requête de M. et Mme Beaumartin parce que le ministre avait confirmé l'interprétation retenue par la Commission. Elle relève de surcroît que l'interposition de l'autorité ministérielle, décisive pour l'issue du contentieux juridique, ne se prêtait à aucun recours de la part des intéressés, qui n'avaient d'ailleurs eu aucune possibilité de s'exprimer sur l'utilisation du renvoi préjudiciel et sur le libellé de la question.
Or seul mérite l'appellation de "tribunal" au sens de l'article 6§1 de la Convention, un organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d'exigences telles que l'indépendance à l'égard de l'exécutif comme des parties en cause () La cause des requérants n'a pas été entendue par un "tribunal" indépendant et de pleine juridiction"
Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention.
Arrêt Chevrol contre France du 13 février 2003 Hudoc 4169 requêtes 49636/99
"Une appréciation de l'application d'un accord international par un Etat étranger est une composante nécessaire de la fonction de juger.
Le Conseil d'Etat s'en remit entièrement à une autorité relevant du pouvoir exécutif pour résoudre le problème d'applicabilité des traités qui lui était posé : il rejeta la requête soumise par la requérante au seul motif que le ministre des affaires étrangères avait affirmé que l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 ne pouvait être regardée comme étant en vigueur à la date pertinente, faute d'application par l'Algérie.
Or, même si la consultation du ministre par le Conseil d'Etat pour l'application de la condition de réciprocité peut paraître nécessaire, cette juridiction, par sa pratique actuelle du renvoi préjudiciel, utilisée en l'espèce, l'oblige à suivre obligatoirement l'avis du ministre, c'est à dire d'une autorité qui lui est extérieure et qui se trouve en outre relever du pouvoir exécutif, sans soumettre cet avis à la critique ni à un débat contradictoire.
"Le Conseil d'Etat s'est considéré comme lié par cet avis; il s'est ainsi privé volontairement de la compétence qui permettant d'examiner et de prendre en compte des éléments de fait qui pouvaient être cruciaux pour le règlement in concreto du litige qui lui était soumis"
Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention pour non accès réel et concret à un tribunal.
LA NON EXÉCUTION DE LA DÉCISION DE LA JURIDICTION
ADMINISTRATIVE EST UN NON ACCES AU TRIBUNAL
CAMARA c. BELGIQUE du 18 juillet 2023 Requête no 49255/22
Art 6 (civil) • Accès à un tribunal • Refus des autorités nationales d’exécuter une ordonnance immédiatement exécutoire exigeant que l’État fournisse un hébergement et l’assistance matérielle à un demandeur de protection internationale • Art 6 applicable • Prise en charge du requérant que suite à la mesure provisoire prononcée par la Cour européenne • Situation difficile de l’État défendeur au regard de l’augmentation importante du nombre de demandes de protection internationale et de l’insuffisante capacité d’accueil des demandeurs • Carence systémique des autorités nationales d’exécuter les décisions de justice définitives relatives à leur accueil grevant lourdement les fonctionnements d’une juridiction nationale et de la Cour européenne
Art 46 • Mesures générales • État défendeur tenu de remédier au problème systémique de la capacité des autorités nationales à se conformer à la loi interne sur le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile, y compris aux décisions de justice définitives en ordonnant le respect
CEDH
Rappel des principes généraux
103. La Cour a souligné à maintes reprises le rôle particulier que le pouvoir judiciaire exerce dans la société : comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit, il doit jouir de la confiance de chacun pour mener à bien sa mission (Guômundur Andri Àstraôsson c. Islande [GC], no 26374/18, § 283, 1 décembre 2020, et références citées).
104. La Cour rappelle également sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’une décision de justice, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention. À défaut, les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention seraient privées de tout effet utile (voir, parmi d’autres, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 196, CEDH 2006-V, et Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 65, CEDH 2009).
105. Cela s’applique, par définition, à la mise en œuvre des décisions judiciaires sur les mesures provisoires qui restent en vigueur jusqu’à ce qu’une décision finale statuant sur l’affaire devant un tribunal ait été rendue (Sharxhi et autres c. Albanie, no 10613/16, §§ 92-96, 11 janvier 2018). Le contraire reviendrait à rendre une décision judiciaire contraignante, bien que transitoire, dépourvue d’objet et de sens (Dolińska-ficek et Ozimek c. Pologne, nos 49868/19 et 57511/19, § 328, 8 novembre 2021).
106. La Cour considère que c’est au premier chef aux autorités de l’État qu’il incombe de garantir l’exécution d’une décision de justice rendue contre celui-ci, et ce dès la date à laquelle cette décision devient obligatoire et exécutoire (Bourdov, précité, § 69). Une personne qui a obtenu un jugement contre l’État n’a normalement pas à ouvrir une procédure distincte pour en obtenir l’exécution forcée (Sharxhi et autres, précité, § 93, Bourdov, précité, § 68, et Nikoloudakis c. Grèce, no 35322/12, § 35, 26 mars 2020). Pareil jugement doit être signifié en bonne et due forme à l’autorité concernée de l’État défendeur, laquelle est alors à même de faire toutes les démarches nécessaires pour s’y conformer ou pour le communiquer à une autre autorité de l’État compétente pour les questions d’exécution des décisions de justice (Bourdov, précité, § 68).
107. Ces affirmations revêtent encore plus d’importance dans le contexte d’un contentieux qui implique l’administration. La Cour rappelle à cet égard que l’administration constitue un élément de l’État de droit et que son intérêt s’identifie donc avec celui d’une bonne administration de la justice. Si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être (Hornsby, précité, § 41).
108. Dans les affaires où le principe de la sécurité juridique est en cause, la Cour insiste sur la nécessité impérieuse de respecter le principe de l’autorité de la chose jugée en ce sens qu’il préserve le caractère définitif des jugements et les droits des parties à la procédure et sert à garantir la stabilité du système juridictionnel et favorise la confiance du public dans la justice (Guômundur Andri Àstraôsson, précité, § 238). Par ailleurs, la Cour réaffirme qu’aux termes de sa jurisprudence constante, une autorité de l’État ne peut prétexter du manque de fonds ou d’autres ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (voir, parmi d’autres, Bourdov, précité, § 35, Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 53, CEDH 2004‑III (extraits), Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 90, CEDH 2006-V, Tchokontio Happi c. France, no 65829/12, § 50, 9 avril 2015, Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. c. Italie, no 67944/13, § 54, 13 décembre 2018, et M.K. et autres, précité, § 153).
109. Enfin, la Cour considère qu’un délai d’exécution déraisonnablement long d’un jugement obligatoire peut emporter violation de la Convention, le caractère raisonnable du délai devant s’apprécier en tenant compte en particulier de la complexité de la procédure d’exécution, du comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que du montant et de la nature de la somme accordée par le juge. Un retard peut se justifier dans des circonstances particulières mais, en tout état de cause, il ne peut avoir pour conséquence une atteinte à la substance même du droit protégé par l’article 6 § 1 (Bourdov, précité, §§ 66-67).
b) Application en l’espèce
110. En l’espèce, le requérant a saisi la Présidente du tribunal du travail de Bruxelles sur requête unilatérale (paragraphe 12 ci-dessus). Il a obtenu une décision le 22 juillet 2022 condamnant l’État belge à lui octroyer un hébergement et l’assistance matérielle (paragraphe 13 ci-dessus). La Présidente s’est prononcée au provisoire par une ordonnance exécutoire par provision, nonobstant tout recours. Cette décision, signifiée par huissier, le 29 juillet 2022 est devenue définitive le 29 août 2022 (paragraphe 15 ci‑dessus). Elle a été exécutée le 4 novembre 2022 quand le requérant s’est vu assigner une place dans un centre d’accueil (paragraphe 19 ci-dessus), suite à l’indication de la Cour, sous l’angle de l’article 39 du règlement de la Cour, au Gouvernement belge de fournir le requérant un hébergement d’urgence et de lui permettre de faire face à ses besoins élémentaires, et ainsi d’exécuter l’ordonnance du tribunal du travail (paragraphes 17-18 ci-dessus).
111. La Cour constate que le caractère exécutoire de l’ordonnance impliquait son exécution d’office par l’État en vertu du droit interne (paragraphes 13 et 39 ci-dessus).
112. Afin d’évaluer le délai d’exécution de l’ordonnance à l’aune des exigences de l’article 6 rappelées ci-dessus (paragraphe 109 ci-dessus), la Cour doit tenir compte du comportement des autorités compétentes, de la complexité de la procédure d’exécution, et du comportement du requérant.
113. S’agissant premièrement du comportement des autorités belges, la Cour note que Fedasil et l’État belge n’ont pas contesté devant le tribunal du travail l’existence du droit à l’accueil réclamé par le requérant. Postérieurement à l’ordonnance enjoignant la prise en charge du requérant, Fedasil n’a pas formé tierce opposition et n’a pas exécuté cette ordonnance avant l’intervention de la mesure provisoire prononcée par la Cour. Il s’ensuit, comme le soutient le requérant, qu’il s’est retrouvé à devoir agir en justice et ensuite à saisir la Cour en vue d’obtenir la reconnaissance d’un droit qui ne lui a jamais été contesté. De plus, l’exécution n’a pas, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, revêtu de caractère spontané et n’a pu avoir lieu qu’à la suite d’une mesure provisoire prononcée par la Cour (voir, mutatis mutandis, M.K. et autres, précité, § 163).
114. Concernant deuxièmement la complexité de la procédure d’exécution, le Gouvernement fait état d’obstacles logistiques à l’augmentation de la capacité des centres d’accueil et de l’absence de collaboration voire même de la résistance des pouvoirs locaux (paragraphe 98 ci-dessus). Notamment le Gouvernement invoque une saturation du réseau d’accueil géré par Fedasil depuis l’été 2021. Il explique que la capacité d’accueil du réseau s’est trouvée insuffisante pour faire face à l’augmentation du nombre de demandeurs de protection internationale. L’exécution des ordonnances, telles que celle rendue à l’endroit du requérant, étant tributaire des places disponibles dans les centres d’accueil, l’État belge s’est retrouvé dans l’impossibilité matérielle de faire suite auxdites décisions de justice.
115. La Cour ne peut que constater une augmentation importante en ce qui concerne la Belgique du nombre de demandes de protection internationale en 2022. Celui-ci était de 36 871, soit une augmentation de plus de 42 % par rapport à 2021 (paragraphe 53 ci-dessus). À cette pression migratoire, s’ajoute qu’entre le 10 mars 2022 et le 31 décembre 2022, la Belgique a accueilli 65 000 ressortissants ukrainiens (paragraphe 56 ci-dessus).
116. Ces éléments témoignent à suffisance de l’ampleur des défis que l’État belge a été appelé à affronter. Par ailleurs, la Cour ne saurait critiquer le choix des autorités belges d’avoir concentré la capacité d’accueil du réseau sur les personnes les plus vulnérables retardant ainsi l’hébergement des demandeurs de protection internationale présentant le même profil que le requérant. Il s’agissait là d’un choix de priorisation qui a permis à la grande majorité des familles avec enfants, des mineurs non accompagnés et des personnes souffrant de problèmes de santé spécifiques d’être hébergées et prises en charge pour la durée d’examen de leur procédure d’asile. La Cour ne saurait enfin manquer de constater les importants efforts consentis par les autorités belges pour intervenir dans le financement des dispositifs associatifs, créer des places d’hébergement supplémentaires, recruter du personnel et raccourcir les délais de traitement des demandes d’asile (paragraphes 55, 59-60 ci-dessus).
117. La Cour estime cependant nécessaire de rappeler que le droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États parties. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999‑VII, et Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l., précité, § 54,).
118. À cet égard, la Cour ne peut ignorer que les circonstances de la présente affaire ne sont pas isolées et qu’elles révèlent une carence systémique des autorités belges d’exécuter les décisions de justice définitives relatives à l’accueil des demandeurs de protection internationale (paragraphes 81 et 83 ci-dessus).
119. Même si elle est consciente de la situation difficile à laquelle l’État belge était confronté (paragraphes 114-116 ci-dessus), la Cour ne pourrait juger raisonnable le délai mis en l’espèce par les autorités belges pour exécuter une décision de justice visant à protéger la dignité humaine (voir, mutatis mutandis, M.K. et autres, précité, § 161). Elle ne peut manquer d’ajouter que cette carence systémique a eu pour effet de grever lourdement le fonctionnement d’une juridiction nationale et celui de la Cour elle-même.
120. Concernant troisièmement le comportement du requérant, la Cour ne décèle aucun manque de diligence qui aurait contribué à retarder l’exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2022.
121. Eu égard aux éléments qui précèdent, la Cour considère que les autorités belges ont opposé non pas un « simple » retard mais plutôt un refus caractérisé de se conformer aux injonctions du juge interne qui a porté atteinte à la substance même du droit protégé par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, M.K. et autres, précité, § 163).
122. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
ARTICLE 46
145. En tout état de cause, la Cour note que la présente affaire n’est qu’une des nombreuses affaires similaires introduites récemment contre la Belgique pour non-exécution des ordonnances du tribunal de travail relatives à l’accueil des demandeurs de protection internationale. Les éléments produits devant la Cour révèlent un problème systémique dans l’État défendeur concernant la capacité des autorités à se conformer à sa propre législation interne sur le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile, y compris aux décisions de justice définitives en ordonnant le respect. Même si elle n’ignore pas les difficultés auxquelles les autorités belges ont été confrontées, la Cour estime qu’une telle pratique est incompatible avec le principe de l’État de droit qui sous-tend l’ensemble du système de la Convention. Conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 46 de la Convention, il revient à l’État défendeur de prendre les mesures adéquates en vue d’y mettre un terme.
M.K. ET AUTRES c. FRANCE du 8 décembre 2022 Requêtes nos 34349/18, 34638/18 et 35047/18
Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Refus des autorités administrative d’exécuter des ordonnances de référé enjoignant à l’État d’héberger en urgence des demandeurs d’asiles et leurs enfants • Art 6 § 1 applicable à l’octroi et refus d’une place en hébergement d’urgence constituant un droit civil • Entière passivité des autorités administratives malgré le fait que les ordonnances étaient le fruit d’une procédure d’urgence • Prise en charge des requérants que suite aux mesures provisoires prononcées par la Cour européenne
149. Le Défenseur des droits soutient que l’absence d’exécution par les autorités étatiques d’une décision de justice définitive et exécutoire leur enjoignant de désigner un lieu d’hébergement à des demandeurs d’asile porte atteinte au droit de ceux-ci à l’exécution des décisions de justice, tel que prévu par l’article 6 de la Convention et prive cette disposition de tout effet utile.
150. Il rappelle que l’État ne peut prétexter d’un manque de logement, de fonds ou d’autres ressources pour ne pas exécuter une décision de justice.
CEDH
Principes applicables
151. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (voir, parmi d’autres précédents, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 196, CEDH 2006-V).
152. La Cour considère que c’est au premier chef aux autorités de l’État qu’il incombe de garantir l’exécution d’une décision de justice rendue contre celui-ci, et ce dès la date à laquelle cette décision devient obligatoire et exécutoire (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 69, CEDH 2009).
153. Par ailleurs, la Cour réaffirme qu’aux termes de sa jurisprudence constante, une autorité de l’État ne peut prétexter du manque de fonds ou d’autres ressources pour ne pas honorer, par exemple, une dette fondée sur une décision de justice (Tchokontio Happi, précité, § 50).
154. Enfin, la Cour considère qu’un délai d’exécution déraisonnablement long d’un jugement obligatoire peut emporter violation de la Convention, le caractère raisonnable du délai devant s’apprécier en tenant compte en particulier de la complexité de la procédure d’exécution, du comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que du montant et de la nature de la somme accordée par le juge (Bourdov, précité, § 66). Un retard peut se justifier dans des circonstances particulières mais, en tout état de cause, il ne peut avoir pour conséquence une atteinte à la substance même du droit protégé par l’article 6 § 1 (Bourdov, précité, § 67).
Application de ces principes aux cas d’espèce
155. La Cour entend, en premier lieu, analyser la complexité de la procédure d’exécution des ordonnances de référé. À cet égard, elle note que le Gouvernement se prévaut d’une saturation des structures d’accueil dans le département de la Haute-Garonne, en particulier au mois de juillet 2018, pour des foyers familiaux tels que ceux des requérants, et d’un défaut de crédits pour recourir à des prestations hôtelières privées. La Cour relève que si les requérants demandent à connaître les sources des informations utilisées par le Gouvernement, celui-ci ne les fournit pas.
156. La Cour constate que le Gouvernement ne précise pas si l’hébergement dans d’autres départements était envisageable. En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucune action positive de la préfecture de la Haute‑Garonne pour signaler à l’administration centrale les difficultés rencontrées concernant l’hébergement d’urgence des personnes à la rue, en particulier dans le cadre de l’exécution des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
157. La Cour en conclut que le Gouvernement ne démontre pas la complexité de la procédure d’exécution des ordonnances de référé dont bénéficiaient les requérants.
158. En deuxième lieu, la Cour, analysant le comportement des requérants, ne peut que noter leur diligence particulière en ce qui concerne leurs démarches tendant à obtenir l’exécution des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif. En particulier, ils ont multiplié les appels auprès de la veille sociale (paragraphes 15, 17 (M.K.), 45, 47 (A.D.), 69, 71 (I.K.) ci-dessus) et de la permanence d’accueil, d’information et d’orientation (paragraphes 16 (M.K.), 39 (A.D.) ci-dessus). Ils ont contacté la préfecture en vue de l’exécution des ordonnances (paragraphe 40 (A.D.) ci-dessus). Ils ont également introduit de nouvelles procédures juridictionnelles en vue de l’exécution des premières ordonnances portant injonction d’hébergement, dans le cadre de la phase administrative d’exécution prévue par l’article L. 911-4 du CJA (paragraphes 18 (M.K.), 41 (A.D.), 70 (I.K.) ci‑dessus) et dans le cadre d’un nouveau référé liberté (paragraphes 19 (M.K.), 43 (A.D.) ci-dessus).
159. Il ne saurait ainsi leur être reproché une quelconque négligence alors au demeurant que le caractère exécutoire de ces ordonnances de référé impliquait leur exécution d’office par l’État, tant en vertu du droit interne (paragraphe 82 ci-dessus) que des exigences attachées à l’article 6 de la Convention (paragraphe 152 ci-dessus).
160. En troisième lieu, la Cour doit évaluer le comportement des autorités compétentes. Elle relève à cet égard que, postérieurement aux premières ordonnances enjoignant à l’hébergement des requérants, le préfet, représentant de l’État dans le département, n’a pas apporté les explications sollicitées par le tribunal administratif en phase administrative d’exécution (paragraphes 18 (M.K.), 41 (A.D.) et 70 (I.K.) ci-dessus), n’a pas défendu dans le cadre du référé liberté tendant à l’exécution des premières ordonnances (paragraphes 20 (M.K.) et 46 (A.D.) ci-dessus), n’a pas répondu aux sollicitations des requérants (paragraphe 40 (A.D.) ci-dessus) et n’a pas exécuté ces ordonnances avant l’intervention des mesures provisoires prononcées par la Cour. Enfin, la Cour note que l’État n’a jamais fait appel desdites ordonnances (paragraphes 21 (M.K.), 48 (A.D.) et 72 (I.K.) ci‑dessus).
161. La Cour déplore l’entière passivité des autorités administratives compétentes en ce qui concerne l’exécution des décisions de la juridiction administrative dans le ressort de laquelle elles se trouvaient, en particulier pour des litiges portant sur la protection de la dignité humaine.
162. En quatrième lieu, la Cour retient que le Gouvernement ne démontre pas suffisamment qu’il ne pouvait s’acquitter du montant des prestations d’hébergement.
163. En conclusion, la Cour est consciente que les durées d’inexécution réelles des premières ordonnances de référé peuvent ne pas paraître excessivement longues (27 jours (M.K.), 22 jours (A.D.) et 12 jours (I.K.)). Toutefois, elle tient à souligner que les autorités administratives de l’État ont opposé non pas un retard mais un refus caractérisé de se conformer aux injonctions du juge interne et que l’exécution n’a pas, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, revêtu de caractère spontané mais n’a pu avoir lieu qu’à la suite de mesures provisoires prononcées par la Cour (paragraphes 23 (M.K.), 50 (A.D.) et 74 (I.K.) ci-dessus). La Cour tient à souligner que revêt, pour l’appréciation du respect des exigences de l’article 6, une importance particulière le fait qu’en l’espèce les ordonnances non exécutées étaient le fruit d’une procédure d’urgence portant sur l’hébergement d’urgence.
164. La Cour en conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Bursa Barosu Başkanlığı et autres c. Turquie du 19 juin 2018 requête n° 25680/05
Article 6-1 pour délai non raisonnable : non-exécution des décisions judiciaires prononcées à l’encontre de la société américaine « Cargill » : violation du droit à une protection judiciaire effective des requérants.
L’affaire concerne la non-exécution de nombreuses décisions judiciaires annulant les actes administratifs autorisant la construction et l’exploitation d’une usine d’amidon sur un terrain agricole situé à Orhangazi (Bursa, Turquie) par une société américaine (« Cargill »). La Cour relève que la requête est recevable pour six requérants uniquement. La Cour juge en particulier qu’en s’abstenant pendant plusieurs années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à plusieurs décisions judiciaires définitives et exécutoires, les autorités nationales ont privé les requérants d’une protection judiciaire effective.
FAITS
Les requérants sont, d’une part, Bursa Barosu Başkanlıǧı (le barreau de Bursa) et l’Association pour la protection de la nature et de l’environnement dont le siège est à Bursa et, d’autre part, 21 ressortissants turcs, nés entre 1947 et 1980 et résidant à Bursa (Turquie). En 1997, la société Cargill obtint une autorisation d’investissement, puis en juin 1998, un permis de construire pour la construction d’une usine d’amidon sur un terrain agricole. Parallèlement, les autorités modifièrent à plusieurs reprises le plan d’urbanisme pour permettre la construction de l’usine. D’autres permis de construire furent également délivrés, ainsi qu’une autorisation de production et de gestion de déchets, laquelle fut annulée en 2004. Entre 1998 et 2000, l’usine d’amidon fut construite, en dépit, d’une part, de l’annulation, par le tribunal administratif de Bursa et le Conseil d’État, des nombreuses modifications du plan d’urbanisme et, d’autre part, de la suspension et/ou annulation des différents permis de construire délivrés successivement par le Conseil des ministres. Ces décisions, rendues à la suite de recours introduits par certains des requérants, ne furent pas exécutées par les autorités. Actuellement, l’usine, qui débuta sa production en 2000, est toujours en activité. En 2005, certains des requérants introduisirent une action en dommages-intérêts pour nonexécution des décisions judiciaires. Ils obtinrent partiellement gain de cause en avril 2009, le tribunal de grande instance (TGI) condamnant le maire de Gemlik au paiement d’un dédommagement moral. Le TGI rejeta cependant les demandes des requérants dirigées contre le Premier ministre et le ministre des Travaux publics. Les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation, laquelle conclut que les jugements des tribunaux administratifs n’avaient pas été dûment exécutés alors que le Premier ministre, le ministre des Travaux publics ainsi que le maire de Gemlik en avaient la possibilité. Le TGI refusa cependant à plusieurs reprises de se ranger à l’avis de la Cour de cassation. La procédure est en cours actuellement. En 2007 et 2008, deux amendements législatifs à la loi relative à la protection des terres et à l’utilisation des terrains furent déposés par le Gouvernement à l’Assemblée nationale pour permettre la régularisation de la situation des terrains agricoles utilisés pour des activités non agricoles. La Cour constitutionnelle valida le second amendement (adopté le 26 mars 2008). Cela permit à la société Cargill de poursuivre ses activités en dépit des décisions de justice définitives rendues depuis 1998 et non exécutées à ce jour.
CEDH : RECEVABILITÉ
118. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique tout d’abord que les requérants ont saisi la Cour alors que les différentes procédures auraient été pendantes devant les juridictions internes. Par ailleurs, il précise qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie par la loi no 6384. Il ajoute que la compétence de la commission d’indemnisation établie par cette loi concerne non seulement la durée excessive des procédures internes, mais aussi la non-exécution des jugements. Estimant que les requérants doivent faire usage de cette nouvelle voie de droit devant les instances nationales, le Gouvernement considère que leur requête doit maintenant être déclarée irrecevable.
119. Les requérants contestent cette thèse.
120. S’agissant de l’exception du Gouvernement tirée du caractère prématuré des griefs des requérants, la Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence selon laquelle, si un requérant a, en principe, l’obligation de tenter loyalement divers recours internes avant de saisir la Cour, elle tolère que le dernier échelon de ces recours soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (Rafaa c. France, no 25393/10, § 33, 30 mai 2013). En l’espèce, elle observe que les requérants ont introduit la requête devant elle alors que les diverses procédures étaient pendantes devant les juridictions internes, mais après avoir obtenu plusieurs décisions ordonnant le sursis à l’exécution des actes administratifs. Par ailleurs, il n’est pas contesté que toutes les procédures relatives à l’annulation des actes administratifs en question se sont achevées avant que la Cour eût statué sur la recevabilité de l’affaire. Cette branche de l’exception ne saurait donc être retenue.
121. Quant à l’exception du Gouvernement relative à la voie instaurée par la loi no 6384, la Cour souligne que le présent grief ne concerne pas seulement la question du non-respect allégué d’un délai raisonnable dans les procédures visant à l’annulation des actes administratifs en question, mais aussi et surtout celle de savoir si, en raison de l’inexécution prolongée des décisions annulant les actes administratifs concernés, les requérants ont subi un déni de justice. La Cour relève dans ce contexte que les requérants ont sollicité à plusieurs reprises l’application des mesures d’exécution prévues par le code de procédure civile et par la loi sur l’exécution administrative pour forcer l’administration à s’exécuter. Elle relève en outre que les requérants ont également introduit une action en dommages et intérêts afin d’être indemnisés pour la non-exécution prolongée des décisions de justice. Ce recours, qui est pendant devant les juridictions nationales depuis le 6 juin 2005, n’a abouti que partiellement, la juridiction de première instance ayant examiné seulement la responsabilité du maire de Gemlik, alors que la Cour de cassation a considéré que le Premier ministre et le ministre des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire avaient pris des mesures rendant ces décisions non exécutoires (paragraphe 78 ci-dessus). La Cour note que le recours invoqué à présent par le Gouvernement est de nature essentiellement similaire à celui que les requérants ont déjà exercé. Elle rappelle également avoir jugé que, s’agissant de griefs relatifs à la non-exécution de décisions judiciaires définitives contraignantes suspendant la mise en œuvre d’actes administratifs annulés, l’indemnisation ne constituait pas une réparation suffisante au titre de la Convention (Genç et Demirgan c. Turquie, nos 34327/06 et 45165/06, § 41, 10 octobre 2017). À la lumière de ces observations, la Cour estime que les requérants ne sont pas tenus de s’adresser à la commission d’indemnisation instituée par la loi no 6384.
Par conséquent, la Cour rejette les exceptions du Gouvernement relatives au caractère prématuré de la requête et au non-épuisement des voies de recours internes.
CEDH : NON ACCÈS A UN TRIBUNAL
a) Principes pertinents en l’espèce
133. La Cour a dit à maintes reprises que le droit à l’exécution d’une décision de justice était un des aspects du droit à un tribunal (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 42, 31 mars 2009). À défaut, les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention seraient privées de tout effet utile. La protection effective du justiciable implique l’obligation pour l’État ou l’un de ses organes d’exécuter le jugement. Si l’État refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être (Hornsby, précité, § 41). Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III). L’exécution doit, en outre, être complète, parfaite et non partielle (Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, §§ 68-76, 2 mars 2004, et Matheus c. France, no 62740/00, § 58, 31 mars 2005). En effet, une fois qu’une décision interne définitive est rendue par les juridictions nationales, elle doit être mise en œuvre avec une clarté et une cohérence raisonnables par les autorités publiques, afin d’éviter autant que possible l’insécurité juridique et l’incertitude pour les sujets de droit concernés par son application (Apanasewicz, précité, § 73).
134. Par ailleurs, la sécurité juridique présuppose le respect du principe de l’autorité de la chose jugée (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 62, CEDH 1999‑VII), c’est-à-dire du caractère définitif des décisions de justice. En effet, un système judiciaire caractérisé par la possibilité de remises en cause perpétuelles et d’annulations répétées de jugements définitifs méconnaît l’article 6 § 1 de la Convention (Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, §§ 74, 77 et 82, CEDH 2002-VII). De telles remises en cause sont inadmissibles venant tant de juges que de membres de l’exécutif (Tregoubenko c. Ukraine, no 61333/00, § 36, 2 novembre 2004) ou d’autorités non judiciaires (Agrokompleks c. Ukraine, no 23465/03, §§ 150‑151, 6 octobre 2011). Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
135. La Cour rappelle enfin que son rôle consiste à examiner si, dans un cas donné, les autorités ont respecté les obligations positives qui leur incombent en vertu de l’article 6 de la Convention, et plus particulièrement si les mesures adoptées par les autorités pour assurer la mise en œuvre d’une décision de justice ont été adéquates et suffisantes. Il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect de ses obligations positives (Apanasewicz, précité, § 74).
b) Application de ces principes à l’espèce
136. En l’espèce, la Cour note que le litige porte essentiellement sur l’exécution des jugements rendus par les tribunaux administratifs au sujet de l’annulation de nombreux actes administratifs modifiant les plans d’urbanisme de différentes échelles et des autorisations administratives relatives à l’implantation d’une usine d’amidon à Orhangazi (Bursa) dans une zone agricole. À la suite de l’adoption d’un amendement législatif le 26 mars 2008, la préfecture de Bursa a délivré, le 21 novembre 2008, une nouvelle autorisation à la société Cargill (paragraphe 94 ci-dessus), qui est, selon les éléments du dossier, toujours en activité.
137. La Cour observe que la construction de l’usine en 1998-2000 et la poursuite de ses activités à partir de l’année 2000 étaient fondées sur divers actes administratifs, à savoir les modifications des plans d’urbanisme de différentes échelles et les autorisations administratives adoptées conformément à ces modifications. Cependant, il n’est pas contesté que, au cours des procédures internes, à partir du 12 janvier 1999 (paragraphe 29 ci‑dessus), de nombreuses injonctions provisoires suspendant l’exécution de ces actes administratifs ont été émises par les juridictions internes. Les actes en question ont, par la suite, été annulés définitivement.
138. La Cour relève que les observations des parties sont divergentes sur la question de savoir si les jugements précités ont été effectivement exécutés. Alors que, d’après le Gouvernement, les activités de l’usine ont été interrompues le 20 octobre 2006, les requérants soutiennent qu’elles n’ont été arrêtées qu’en 2000, et ce pendant seulement quarante-cinq jours.
139. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de s’attarder sur cette divergence, dans la mesure où, dans son arrêt du 21 novembre 2009, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière des chambres civiles, a établi que les jugements en question n’avaient pas été dûment exécutés par les autorités (paragraphe 78 ci-dessus). Après avoir examiné en détail le comportement des autorités eu égard aux jugements en question, la haute juridiction a conclu qu’il « [pouvait] passer pour établi que le Premier ministre, le ministre des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire et le maire de Gemlik n’[avaient] pas exécuté les jugements des tribunaux administratifs, alors qu’ils en avaient la possibilité ». Pour arriver à cette conclusion, elle a notamment considéré que :
« Avant et après que les jugements des tribunaux administratifs soient devenus définitifs, les recourants ont adressé des avertissements oraux et écrits aux autorités compétentes en vue d’obtenir l’exécution de ces jugements. Selon les principes généraux du droit administratif, l’annulation d’un acte administratif impliquait que cet acte était réputé n’être jamais intervenu. Or, en l’espèce, les autorités n’avaient pas rempli le devoir qui leur incombait à la suite de ces décisions de justice. Alors qu’elles auraient dû suspendre les activités de l’usine d’amidon, elles se sont contentées d’adresser à celle-ci des avertissements formels, ce qui n’équivaut pas à une exécution de ces jugements. Le ministre des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire, qui a délivré les autorisations requises pour la construction et l’installation de l’usine, n’a fourni aucun élément donnant à penser qu’il avait agi en vue de retirer les autorisations en question. Alors que le Conseil supérieur de la planification auprès du Premier ministre a octroyé une autorisation d’investissement et que l’exécution de cet acte a été suspendue par les décisions de justice, l’usine a été informée par une lettre signée par le Premier ministre lui-même qu’elle pouvait poursuivre ses activités. De même, il ressort de cette lettre que de nouvelles tentatives avaient été entreprises en vue de fournir une base administrative et légale à la poursuite de ces activités nonobstant l’annulation ultérieure définitive dudit acte. »
La Cour ne peut que souscrire aux constats de la haute juridiction, lesquels lient les juridictions inférieures, qui doivent s’y conformer en vertu de l’article 429 in fine du code de procédure civile (paragraphe 104 ci-dessus).
140. La Cour ne saurait par ailleurs suivre le Gouvernement lorsqu’il estime que la question de l’exécution des décisions rendues avant l’adoption de l’amendement législatif de 2007 n’a plus d’intérêt et que les recours des requérants contre l’administration sont sans objet. En effet, elle observe que, par un jugement du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Bursa a également annulé l’autorisation de poursuite des activités délivrée à la suite de l’amendement législatif du 31 janvier 2007 et que ce jugement est devenu définitif le 21 mai 2015 (paragraphes 90-91 ci-dessus). Or les parties ne contestent pas que ce jugement n’a jamais été exécuté.
141. La Cour conclut par conséquent qu’à partir du 12 janvier 1999 et jusqu’au 21 novembre 2008, date à laquelle la préfecture de Bursa a délivré une nouvelle autorisation de poursuivre ses activités à la société Cargill, les jugements des juridictions administratives n’ont pas été réellement exécutés.
142. Quant à la phase postérieure à l’amendement législatif adopté le 26 mars 2008 (loi no 5751, paragraphe 92 ci-dessus), il est vrai que, comme le Gouvernement le souligne, cet amendement a ouvert la possibilité de régulariser la situation des terrains agricoles utilisés pour des activités non agricoles. En effet, le 21 novembre 2008, la société Cargill a obtenu une autorisation fondée sur ce nouveau texte, qui a été ultérieurement validée par la Cour constitutionnelle (paragraphes 92-99 ci-dessus).
143. La Cour observe que les requérants ont également introduit un recours en annulation devant les tribunaux administratifs (paragraphe 95 ci‑dessus). Par conséquent, elle estime qu’il n’est nécessaire ni de spéculer sur l’issue de cette procédure, qui est, d’après les informations dont elle dispose, toujours pendante devant les juridictions nationales, ni d’examiner d’office la question de savoir si cet amendement législatif avait ou non pour but d’empêcher l’exécution des jugements définitifs.
144. Cela étant, dans les circonstances particulières de l’affaire, la Cour se doit d’observer que, dans son arrêt précité ci-dessus (paragraphes 78 et 139), la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière des chambres civiles, avait critiqué la lettre signée par le Premier ministre, qui informait la société Cargill que de nouvelles tentatives avaient été entreprises en vue de fournir une base administrative et légale à la poursuite de ses activités, nonobstant l’annulation ultérieure définitive de l’autorisation d’investissement relative à l’usine. Il ressort également de l’amendement en question que l’usine avait pu poursuivre ses activités sur la base des nouvelles autorisations délivrées en vertu de ce nouveau texte. La Cour rappelle qu’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61). Or l’amendement en question pourrait avoir pour conséquence de priver d’effet les nombreuses décisions judiciaires définitives et, de surcroît, non exécutées (comparer avec Gorraiz Lizarraga et autres, précité, § 72 avec les références citées).
145. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, en s’abstenant pendant plusieurs années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à plusieurs décisions judiciaires définitives et exécutoires, les autorités nationales ont privé les requérants d’une protection judiciaire effective et que les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Par conséquent, il y a eu violation de cette disposition.
VASILIADOU c. GRÈCE du 6 avril 2017 requête n° 32884/09
Violation de l'article 6-1 : Le retard avec lequel, l'administration exécute la décision de la Cour d'Appel n'est pas compatible avec le droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6-1 de la Conv EDH.
29. La requérante soutient que le retard de l’administration à se conformer à l’arrêt précité de la cour administrative d’appel ne pouvait pas être justifié par l’absence d’un terrain disponible pour lui être cédé. La disponibilité d’un tel terrain après 2004 ressort clairement de la décision no 15/2010 de la commission d’expropriation (paragraphe 23 ci‑dessus). Or, il a fallu une bataille juridique de vingt ans environ et la saisine du comité des trois juges du Conseil d’Etat pour qu’elle obtienne gain de cause.
30. Le Gouvernement expose que, en vertu des dispositions applicables en droit interne, il n’existe pas de droit d’acquérir un terrain mais seulement un « droit d’espérer » s’en voir céder un. Il précise que l’application de ces dispositions dépend de la disponibilité de terrains dans la région concernée. Il estime que, en l’espèce, l’obligation de l’administration de se conformer à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel de Thessalonique consistait seulement à réexaminer la demande de la requérante afin de déterminer le droit de cette dernière à bénéficier, le cas échéant, d’un terrain.
31. Le Gouvernement indique encore que la commission d’expropriation n’avait pas procédé, depuis 2004, à l’examen de demandes similaires en raison du manque de terrains disponibles à Nea Flogita. Il ajoute que le terrain finalement cédé à la requérante était le seul disponible. Il soutient que le retard de la commission d’expropriation à examiner la demande était justifié et qu’il était sans conséquence sur le fond de la demande. Qui plus est, selon le Gouvernement, l’administration n’a jamais refusé de se conformer à l’arrêt no 800/2004 et la requérante était tenue informée des difficultés concernant l’exécution de celui-ci. Dès lors, de l’avis du Gouvernement, le délai de l’administration à se conformer à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel n’a pas porté atteinte au droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
32. Le Gouvernement plaide par ailleurs que le recours devant le comité du Conseil d’État est accessible et effectif et que la requérante a introduit une demande devant ledit comité quatre ans après la publication de l’arrêt no 800/2004 du tribunal administratif d’appel. Il ajoute que, par sa décision no 9/2009 du 6 juillet 2009, la commission d’expropriation a reconnu que la requérante avait droit à un terrain, se conformant ainsi à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel. Il argue que la commission d’expropriation n’avait pas adressé sa décision au comité du Conseil d’État et que ce dernier, qui n’en avait dès lors pas eu connaissance, a constaté la non-exécution de l’arrêt en cause.
33. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie (Buyan et autres c. Grèce, no 28644/08, § 33, 3 juillet 2012). L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’État en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). De surcroît, elle souligne l’importance particulière que revêt l’exécution des décisions de justice dans le contexte du contentieux administratif (Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 34, 22 décembre 2005).
34. S’agissant de l’exécution de l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel, rendu le 12 janvier 2004, la Cour observe que cette juridiction a fait droit à l’appel interjeté par la requérante et qu’elle a renvoyé l’affaire devant la commission d’expropriation afin que celle-ci statuât de nouveau sur la demande de l’intéressée du 29 janvier 1991. La Cour note que rien dans cet arrêt n’obligeait l’administration à céder un terrain à la requérante dans l’immédiat. L’administration était néanmoins tenue d’examiner de nouveau la demande de l’intéressée.
35. La Cour observe également que la commission d’expropriation n’a publié sa décision relative à cette demande que le 6 juillet 2009, soit cinq ans et six mois environ après la publication de l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel rendu le 12 janvier 2004, et quatre ans et six mois environ après réception, le 30 décembre 2004, de l’arrêt en cause. Elle prend en considération l’argument du Gouvernement selon lequel l’examen de la demande par la commission d’expropriation n’a pas eu lieu dans un délai plus court en raison de l’absence de terrains disponibles. Toutefois, elle souligne que l’obligation de l’administration de se conformer à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel n’était pas liée à la disponibilité éventuelle d’un terrain. En effet, cette circonstance n’empêchait pas la commission d’expropriation d’examiner la demande de la requérante puis d’attendre qu’un terrain devienne disponible, comme cela a d’ailleurs été finalement le cas.
36. À ce sujet, la Cour remarque que le comité du Conseil d’État, par son procès-verbal no 23/2010 du 11 février 2010, a constaté que l’administration ne s’était pas conformée à l’arrêt en cause (paragraphe 21 ci-dessus). Elle note qu’il ressort du dossier que ce procès-verbal a été délivré avant que le comité de trois juges du Conseil d’État ait été informé de la décision no 9/2009 de la commission d’expropriation donnant gain de cause à la requérante. Ce procès-verbal constitue cependant un indice du retard d’exécution de l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel. La Cour note également que la requérante avait introduit sa demande initiale de cession d’un terrain en 1991.
37. En conséquence, rien n’explique pourquoi la commission d’expropriation a mis cinq ans et six mois environ avant d’examiner la demande en cause, et pourquoi cette décision n’a été prise qu’après saisine du comité du Conseil d’État par la requérante. Il apparaît donc que l’administration a omis de se conformer dans un délai raisonnable à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel, ce qui est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Prodan c. Moldova, no 49806/99, §§ 54-55, CEDH 2004-III, Chmalko c. Ukraine, no 60750/00, § 46, 20 juillet 2004, et Georgoulis et autres c. Grèce, no 38752/04, 21 juin 2007). Partant, il y a eu violation de cette disposition à cet égard.
IDAL ESCOLL et GUILLÁN GONZÁLEZ c. ANDORRE
du 29 juillet 2008 Requête 38196/05
Les requérants se plaignent que des décisions définitives interdisant la construction d'un immeuble trop haut, ne soient pas appliquées alors que les voies d'accès sont trop petites pour permettre l'accès à plusieurs familles.
"69. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (voir les arrêts Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63 in fine, CEDH 1999-V, et Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40). Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (Jasiūnienė c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003).
70. Ces affirmations revêtent encore plus d’importance dans le contexte du contentieux administratif, à l’occasion d’un différend dont l’issue est déterminante pour les droits civils du justiciable. En présentant un recours devant le Tribunal supérieur de justice, soit la plus haute juridiction administrative de l’État, celui-ci vise à obtenir non seulement la disparition de l’acte litigieux, mais aussi et surtout la levée de ses effets. Or, la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par une telle juridiction. La Cour rappelle à cet égard que l’administration constitue un élément de l’État de droit et que son intérêt s’identifie donc avec celui d’une bonne administration de la justice. Si l’arrêt définitif n’est pas exécuté ou encore s’il n’est pas exécuté dans les meilleurs délais, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être (cf. arrêt Hornsby précité, § 41).
71. Certes, le droit à l’exécution des jugements ne peut cependant obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances ; il lui appartient en revanche de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003 et Vasile c. Roumanie, no 40162/02, § 53, 29 avril 2008), car lorsque celles-ci sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, § 44). En matière d’aménagement du territoire et de politique d’urbanisme, les Etats jouissent par ailleurs d’une grande marge d’appréciation. (Hamer c. Belgique, no 21861/03, § 78, CEDH 2007-... (extraits) et Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69
72. Bien que le Gouvernement estime que l’arrêt du Tribunal supérieur de justice du 28 mai 2003 n’est devenu exécutoire qu’à partir du 19 janvier 2004, date à laquelle le Tribunal constitutionnel admit à examen le recours d’empara sans effets suspensifs, la Cour relève que depuis le 28 mai 2003, la commune d’Escaldes-Engordany aurait dû prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire et a, en ne le faisant pas, privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
73. En effet, les décisions de justice en faveur des requérants ont été dénuées de toute portée par un acte du Conseil général qui a régularisé a posteriori la situation des immeubles litigieux, les soustrayant à la démolition, au moyen de l’expropriation d’une partie de la propriété de chaque requérant. Aucune mesure n’a été prise par les autorités communales en vue de l’exécution de l’arrêt du 28 mai 2003, mis à part, et à supposer que cela puisse entrer en ligne de compte, l’adoption par le tribunal des batlles de l’ordonnance du 1er septembre 2004, qui, comme le Gouvernement le souligne, désigna un expert chargé de déterminer la nature des travaux de démolition de la partie des bâtiments concernés et sollicita un rapport sur le prix de marché des appartements affectés par la démolition. Le Gouvernement ne précise toutefois pas si ces expertises eurent bien lieu et quels furent leurs résultats éventuels, mais se limite à exposer que cette ordonnance témoigne de la volonté d’exécuter l’arrêt.
Or, de l’avis de la Cour, les autorités compétentes auraient dû agir avec plus de diligence pour ne pas porter préjudice à l’exécution du jugement rendu au fond.
74. Bien qu’elle admette qu’un changement dans la situation de fait constaté par une décision de justice puisse justifier de manière exceptionnelle la non-exécution d’une décision, la Cour doit s’assurer que les changements essentiels en cause ne sont pas le résultat d’une action ou d’une inaction de l’Etat (mutatis mutandis, Ioachimescu et Ion c. Roumanie, no 18013/03, § 31, 12 octobre 2006 et Monory c. Roumanie et Hongrie, no 71099/01, § 83, 5 avril 2005). En l’espèce, elle relève que la procédure d’expropriation entamée exclusivement à l’encontre des requérants a débuté par une décision du conseil communal d’Escaldes-Engordany adoptée suite aux réunions des 5 mars et 8 avril 2004, ultérieures donc aux décisions faisant droit aux demandes des requérants quant à la démolition partielle des immeubles litigieux. A cet égard, la Cour estime que la décision d’exproprier les propriétés des requérants ne peut pas être considérée comme une situation exceptionnelle tendant à justifier la non-exécution d’un arrêt définitif, au sens de la jurisprudence susvisée, mais constitue un acte de déclaration d’utilité publique qui a été adopté par le Conseil général en décembre 2004 (voir paragraphe 32 ci-dessus) suite à la proposition de la commune et dont le résultat a été la privation pour les requérants de leur droit à voir exécuter un arrêt définitif qui leur était favorable. La Cour observe à cet égard que la construction des immeubles litigieux avait commencé en 1999 et que l’arrêt du Tribunal supérieur de justice faisant droit aux requérants et ordonnant la démolition partielle des immeubles en cause avait été adopté le 28 mai 2003.
Elle ne saurait accepter au regard de la Convention que de telles situations se produisent.
La Cour note en outre qu’en l’espèce, l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 25 avril 2005 a constaté que le droit des requérants à voir démolir la partie concernée des immeubles litigieux du lotissement Vilars en exécution de l’arrêt du Tribunal supérieur de justice s’était transformé en un droit à indemnisation s’ajoutant, le cas échéant, à celui qui découlerait de l’expropriation à raison de la valeur des terrains expropriés aux requérants. La Cour constate que le Gouvernement n’a toutefois pas démontré que les requérants se soient effectivement vus accorder une indemnisation à cet égard.
75. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
ARRET TILEC CONTRE BULGARIE DU 27 MAI 2010 REQUETE N°25051/02
Le requérant se plaint que le ministre de l'agriculture ne lui rend pas ses terrains malgré une décision de justice.
39. Le Gouvernement a également souligné qu’en adressant sa demande de reprise de possession des terrains en cause au maire de Tervel, l’intéressé n’a pas saisi l’organe administratif compétent. Or, la Cour note que le requérant a aussi adressé sa demande au ministre de l’Agriculture et que, sans donner une quelconque explication, ce dernier ne s’est pas exécuté non plus (voir paragraphes 15 et 17 ci-dessus). La Cour estime que cette attitude passive des autorités a eu comme résultat de pratiquement priver de tout effet la décision définitive du tribunal régional de Dobrich qui était en faveur du requérant.
40. Il est à noter également que les tentatives de l’intéressé de contester devant les tribunaux administratifs les refus des autorités de s’exécuter ont échoué. La raison principale de cet échec s’est avérée être la jurisprudence des tribunaux selon laquelle les actions ou les omissions de l’administration dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice n’étaient assujettis à aucun contrôle judiciaire (voir paragraphe 16 ci-dessus). Il en ressort que l’exécution des décisions de la justice administrative rendues à l’encontre des organes de l’exécutif était laissée entièrement à la discrétion de ces derniers et que l’intéressé ne disposait pas d’un contrôle judiciaire effectif sur les refus de ces organes d’exécuter la décision de justice rendue en sa faveur (voir mutatis mutandis l’arrêt Immobiliare Saffi, précité, §§ 72 et 74).
41. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les autorités de l’État ont failli à leur obligation d’exécuter une décision de justice définitive et que de ce fait elles ont privé de tout effet utile le droit d’accès du requérant à un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
SÜZER ET EKSEN HOLDİNG A.Ş. c.TURQUIE du 23 octobre 2012 Requête no 6334/05
Il incombe aux autorités de garantir l’exécution d’une décision de justice rendue contre l’État
a) Principes généraux
114. La Cour réaffirme que le droit à un tribunal garanti par l’article 6 serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Hornsby, précité, § 40, Bourdov (no 2), précité, § 65, Okyay et autres c. Turquie, no 36220/97, § 72, CEDH 2005‑VII, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999‑V, et Costin c. Roumanie, no 57810/00, § 26, 26 mai 2005).
115. Ce principe revêt encore plus d’importance dans le contexte du contentieux administratif, à l’occasion d’un différend dont l’issue est déterminante pour les droits civils de l’administré. En introduisant un recours en annulation – devant, qui plus est, la plus haute juridiction administrative de l’Etat, en l’espèce –, celui-ci vise à obtenir non seulement la disparition de l’acte litigieux, mais aussi et surtout la levée de ses effets. Or la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier au jugement ou à l’arrêt qui sera éventuellement rendu contre elle en dernier ressort. Si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby, précité, § 41, Okyay et autres, précité, ibidem, Niţescu c. Roumanie, no 26004/03, § 32, 24 mars 2009, Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 34, 22 décembre 2005, et Costin, précité, § 27).
116. Quelle que soit la complexité de ses procédures d’exécution ou de son système administratif, l’Etat demeure tenu par la Convention de garantir à toute personne le droit à ce que les jugements obligatoires et exécutoires rendus en sa faveur soient exécutés dans un délai raisonnable. Une autorité de l’Etat ne peut pas non plus prétexter du manque de fonds ou d’autres ressources pour ne pas honorer, par exemple, une dette fondée sur une décision de justice (Bourdov (no 2), précité, § 70, et les références qui y figurent ; Société de gestion du port de Campoloro et Société fermière de Campoloro c. France, no 57516/00, § 62, 26 septembre 2006).
117. Certes, les intéressés peuvent devoir effectuer certaines démarches procédurales de manière à permettre ou à accélérer l’exécution d’un jugement. L’obligation faite aux individus de coopérer ne doit toutefois pas excéder ce qui est strictement nécessaire et, quoi qu’il en soit, elle n’exonère pas l’administration de l’obligation que fait peser sur elle la Convention d’agir de sa propre initiative et dans les délais prévus, en se fondant sur les informations à sa disposition, afin d’honorer le jugement rendu contre elle (Akachev c. Russie, no 30616/05, § 22, 12 juin 2008, Bourdov (no 2), précité, § 69, Chvedov c. Russie, no 69306/01, §§ 29-37, 20 octobre 2005, et Kosmidis et Kosmidou c. Grèce, no 32141/04, § 24, 8 novembre 2007).
118. En tout état de cause, une personne qui a obtenu un jugement contre l’Etat n’a pas à ouvrir une procédure distincte pour en obtenir l’exécution forcée : c’est au premier chef aux autorités de l’Etat qu’il incombe de garantir l’exécution d’une décision de justice rendue contre celui-ci, et ce dès la date à laquelle cette décision devient obligatoire et exécutoire. Pareil jugement doit être signifié en bonne et due forme à l’autorité concernée de l’Etat défendeur, laquelle est alors à même de faire toutes les démarches nécessaires pour s’y conformer ou pour le communiquer à une autre autorité de l’État compétente pour les questions d’exécution des décisions de justice. Il s’agit là d’un élément particulièrement important dans une situation où, du fait des complexités et du chevauchement possible des procédures de mise en œuvre volontaire ou d’exécution forcée, le justiciable peut raisonnablement être dans le doute quant au point de savoir quelle autorité est responsable en la matière (Metaxas, précité, § 19, Akachev, précité, § 21, Bourdov (no 2), précité, § 68, et Gjyli c. Albanie, no 32907/07, § 44, 29 septembre 2009).
b) Application des principes susmentionnés à la présente affaire
119. Contrairement à ce que le Gouvernement suggère (paragraphe 109 ci-dessus), la Cour doit examiner la situation dénoncée en l’espèce à la lumière des principes exposés ci-dessus, et qui, par ailleurs – il faut le préciser – cadrent parfaitement avec les principes du droit turc (paragraphes 68-72 ci-dessus).
En l’espèce, il ne prête pas à controverse que les deux jugements rendus le 21 juin 2004 par la 10e chambre du Conseil d’Etat et portant annulation des arrêtés nos 382 et 552 (paragraphes 27 et 28 ci-dessus) étaient obligatoires et exécutoires (paragraphe 116 ci-dessus), et indiquaient sans équivoque le motif des annulations prononcées, à savoir essentiellement le fait que les mesures administratives en cause n’avaient pas été prises dans un but légitime (paragraphe 24 ci-dessus).
Partant, l’argument selon lequel les actes litigieux, au moment où ils avaient été décidés, n’étaient pas contraires à la loi (paragraphe 102 in fine ci-dessus), n’a pas de poids, d’autant que ceux-ci ont été annulés ex tunc, comme étant illégitimes.
120. En outre, la Cour observe que les questions soulevées devant elle relativement aux crises économiques ayant par le passé fait rage en Turquie (paragraphe 101 ci-dessus), à l’incapacité financière d’une Kentbank ressuscitée à survivre dans le secteur bancaire actuel (paragraphe 107 ci‑dessus) et au prétendu « chaos juridique » qui pourrait survenir si l’on tentait d’inverser les opérations de fusion effectuées jusqu’à ce jour (paragraphe 108 ci-dessus) sont des éléments qui – comme les requérants le font valoir (paragraphe 110 ci-dessus) – ont déjà été discutés, sans succès, devant les juridictions administratives.
La Cour ne se penchera donc pas sur ces questions, qui ne relèvent pas du fond de l’affaire et ne peuvent être examinées, s’il y a lieu, que dans le cadre de la satisfaction équitable.
121. Face aux jugements rendus à son encontre, l’ARSB était constitutionnellement tenue de prendre toutes les mesures requises pour rétablir la situation de fait et de droit qui aurait vraisemblablement existé si Kentbank n’avait pas été illicitement transférée au FADE (paragraphe 115 ci-dessus). Or, l’ARSB n’a nullement réagi.
A cet égard, que cette entité n’ait pas sciemment cherché à entraver l’exécution desdits jugements (paragraphe 102 in limine, ci-dessus) ou qu’elle ne soit pas habilitée par la loi à « ressusciter d’office et unilatéralement une banque dissoute » (paragraphe 105 ci-dessus) n’est pas déterminant.
Même à supposer qu’en sa qualité de détenteur de la puissance publique en la matière et de débiteur de l’obligation faite par lesdits jugements, l’ARSB ne pût s’exécuter seule, rien ne l’empêchait d’honorer ses obligations en coopération avec d’autres entités habilitées à cet effet (paragraphe 118 ci-dessus), sachant qu’en tout état de cause, c’est à l’Etat turc qu’il incombait d’organiser son système interne de telle sorte que ses diverses autorités puissent s’acquitter de leurs obligations (mutatis mutandis, Bourdov (no 2), précité, § 70, Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000‑IV, et Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 45, CEDH 2000‑VII).
122. Or, devant la passivité totale de l’administration, les requérants durent rappeler par écrit à l’ARSB son obligation de s’exécuter conformément aux règles de droit dont le non-respect avait entraîné les annulations en cause. Dans un premier temps, l’ARSB a prétexté de l’impossibilité tant matérielle que juridique de restaurer Kentbank dans son état antérieur à son transfert (paragraphes 53 et 54 ci-dessus) ; par la suite, saisie à nouveau par les requérants, elle demeura silencieuse et ces derniers durent introduire contre ce refus tacite une nouvelle série d’actions en annulation administratives devant la 13e chambre du Conseil d’Etat (paragraphe 55 ci-dessus).
Pour la Cour, il s’agit là d’un élément décisif au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors qu’il n’est pas acceptable qu’un requérant ayant obtenu une décision judiciaire définitive contre l’État se voie obligé d’intenter à nouveau des actions contre l’autorité en vue d’obtenir l’exécution de l’obligation initiale (paragraphe 118 ci-dessus ; voir également S.C. Ruxandra Trading SRL c. Roumanie, no 28333/02, § 58, 12 juillet 2007).
123. La Cour ne saurait toutefois asseoir son appréciation uniquement sur cet élément, eu égard à l’argument de l’impossibilité d’exécuter tels quels ces jugements – thèse défendue par l’ARSB et que le Gouvernement reprend devant la Cour, en s’appuyant pour sa part sur les jugements de la 13e chambre du Conseil d’État (paragraphes 62 et 103 ci-dessus).
Effectivement, la Cour a déjà admis qu’il pouvait exister des circonstances qui justifient l’échec de l’exécution en nature d’une obligation imposée par une décision judiciaire définitive (voir Costin, précité, § 28, et Niţescu, précité, § 35 ; voir aussi Sabin Popescu, précité, § 72, et Ştefanescu c. Roumanie, no 9555/03, §§ 25 et 26, 11 octobre 2007). A cet égard, force est d’observer que, dans ses arrêts formels du 26 juin 2008, sur lesquels reposent les jugements de la 13e chambre (paragraphe 59 ci-dessus), l’Assemblée plénière a reconnu qu’il n’était « pas possible de restaurer la situation juridique et financière de [Kentbank] antérieure à la date [de l’arrêté portant sa cession] et de restituer celle-ci aux intéressés dans l’état où elle se trouvait à la date en question ».
En l’absence de données convaincantes qui puissent l’amener à s’écarter des constatations de fait des juges administratifs sur ce point précis (parmi d’autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, §§ 29 et 30, série A no 269), la Cour estime que la situation de fait ainsi décrite révèle l’existence d’une « impossibilité objective » (mutatis mutandis, S.C. Ruxandra Trading SRL, précité, § 57) ou, en d’autres termes, d’un « obstacle insurmontable » (paragraphe 72 ci-dessus) à l’exécution en nature des jugements en cause.
Le Gouvernement est donc recevable à se prévaloir d’une justification à ce titre.
124. Pour apprécier le bien-fondé de cette justification, la Cour doit donc se pencher maintenant sur l’épisode subséquent aux arrêts formels susmentionnés.
A cet égard, la Cour rappelle à titre liminaire que l’obligation d’exécuter un arrêt de justice ne se limite pas au dispositif de celui-ci : c’est simultanément le fond de l’arrêt qui doit être respecté et appliqué (Niţescu, précité, § 34, et Zazanis et autres c. Grèce, no 68138/01, § 36, 18 novembre 2004) ; en d’autres termes, il convient d’avoir égard aux motifs qui en sous‑tendent le dispositif. Dans ce contexte, si elle reconnaît qu’il ne lui appartient pas de confirmer ou d’infirmer le contenu d’une décision de justice interne, la Cour ne peut cependant se dispenser de constater la situation juridique établie entre les parties, en l’occurrence par les arrêts du 26 juin 2008 et les jugements du 6 janvier 2009 qui s’ensuivirent (par exemple, S.C. Ruxandra Trading SRL, précité, § 56, et Niţescu, précité, §§ 37 et 38).
De par la motivation sur laquelle elles sont appuyées, ces décisions de justice s’analysent en de véritables correctifs du manquement de l’administration à proposer aux requérants une solution de rechange équitable. En effet, après avoir évalué toutes les preuves présentées par les parties, les juges administratifs ont conclu qu’à défaut d’une exécution en nature, les requérants devaient pouvoir fonder une nouvelle banque opérationnelle et que les autorisations d’exploitation nécessaires à cette fin devaient leur être délivrées (paragraphe 59 ci-dessus) :
« (...) conformément à ce que le jugement d’annulation exige et à moins qu’il y ait un autre obstacle juridique quelconque, l’administration est tenue d’assurer les conditions nécessaires pour que les intéressés puissent à nouveau exercer des activités bancaires et d’autoriser ces derniers à fonder une banque qui sera habilitée à effectuer des opérations bancaires ainsi qu’à accepter des dépôts, dans le cadre des dispositions de la loi sur les banques. »
125. La Cour marque son désaccord avec l’interprétation que le Gouvernement fait de ce texte, selon laquelle la modalité d’exécution qui y est définie serait conditionnelle et ne jouerait qu’en l’absence d’obstacle juridique – le Gouvernement estimant à ce titre qu’en admettant l’impossibilité de réhabiliter Kentbank, l’Assemblée plénière aurait elle‑même confirmé l’existence d’un tel obstacle (paragraphe 104 ci‑dessus). En effet, l’impossibilité établie par l’Assemblée plénière est uniquement celle d’une restitution en nature de Kentbank (paragraphe 123 ci-dessus), et non pas celle de la solution de rechange qu’elle a elle-même retenue à la charge de l’administration.
126. Concernant justement la portée de cette solution, s’il est vrai que les juges n’ont pas ordonné expressis verbis à l’administration de créer une banque pour le compte des requérants, il n’en demeure pas moins qu’ils l’ont exhorté à « assurer » les conditions et les autorisations nécessaires pour que les intéressés puissent exercer à nouveau dans le secteur bancaire, en conformité avec les lois qui régissent la matière.
Aux yeux de la Cour, en vertu de ces jugements, les requérants étaient devenus titulaires d’une créance exigible et non d’un simple droit général à recevoir une « assistance » de l’Etat (mutatis mutandis, Bourdov, précité, § 40).
127. La Cour peut comprendre qu’une divergence d’interprétation ait pu exister jusqu’à ce jour au niveau interne quant aux possibilités et mesures à envisager dans le cadre de la règlementation bancaire pour que l’administration puisse s’exécuter dans ce sens ; il lui paraît également normal que les autorités aient pu avoir besoin d’un délai raisonnable, pour choisir les moyens les plus adéquats pour donner effet à ces derniers jugements (mutatis mutandis, Hornsby, précité, § 43).
Cependant, rien ne saurait expliquer l’absence totale d’initiative de la part de l’administration pour mettre en œuvre cette solution de rechange, l’administration n’ayant jusqu’à ce jour fait preuve d’aucune volonté ni entrepris une démarche quelconque à ce titre (paragraphe 72 in fine, ci‑dessus).
128. Il s’agit là d’un second élément, encore davantage décisif (paragraphe 122 ci-dessus).
A ce sujet, le Gouvernement avance que l’ARSB n’est pas compétente pour délivrer d’office une licence d’opérations bancaires au nom d’une entité commerciale inexistante ; par conséquent, selon lui, les requérants doivent, d’abord, saisir l’ARSB pour obtenir la permission de fonder une banque et, s’ils y parviennent, demander par la suite d’être admis au bénéfice d’une licence d’opération bancaire, étant entendu que l’octroi de ces deux permissions relève du pouvoir discrétionnaire de l’ARSB (paragraphes 99 et 106 ci-dessus).
129. La Cour en disconvient, pour les motifs suivants.
Outre la question récurrente de l’incompétence de l’ARSB à laquelle elle a déjà répondu (paragraphe 121 in fine ci-dessus), la Cour fait remarquer, en premier lieu, que les juges administratifs n’ont posé aucune condition de démarche préalable semblable à la charge des requérants, ce qui, de toute façon, serait allé bien au-delà du devoir de coopération qu’on peut faire peser sur les justiciables pour mener à bien l’exécution d’un jugement (paragraphe 117 ci-dessus).
Deuxièmement, la Cour précise que cette thèse va également à l’encontre, d’abord, des principes du droit administratif turc qui a priori prohibe toute entrave à l’exécution d’un jugement par l’assujettissement de celle-ci à une forme quelconque d’autorisation d’une entité administrative (paragraphe 71 ci-dessus) ; elle contrevient aussi à la jurisprudence établie de la Cour, selon laquelle, les actes ou omissions de l’administration qui viennent à la suite d’une décision de justice ne peuvent avoir comme conséquence ni d’empêcher l’exécution ni, encore moins, de remettre en question le fond de cette décision (voir, parmi d’autres, Niţescu, précité, § 31, et Immobiliare Saffi, précité, § 74).
Or, rendre l’exécution des jugements en question – qui puisent dans un constat d’illégalité, par manque de justification, des mesures prises par l’ARSB – tributaire de la discrétion de cette même entité est bel et bien susceptible d’entraîner une telle conséquence, au mépris de l’état de droit, fondé sur la prééminence du droit et la sécurité des rapports juridiques (mutatis mutandis, Okyay et autres, précité, § 73, et Taşkın et autres c. Turquie, no 46117/99, § 136, CEDH 2004‑X). Cela équivaudrait à priver ces jugements de tout effet utile, l’ARSB devenant, dans cette hypothèse, à même d’en apprécier la pertinence et de remettre ainsi en question le fond de la chose jugée.
130. A ces considérations objectives s’ajoute une observation subjective par rapport à la conduite antérieure de l’ARSB. Il faut se rappeler la position récalcitrante de cette entité face à son obligation d’honorer les deux séries de jugements rendus à son encontre (paragraphes 27, 28 et 59-62 ci-dessus) ainsi que de sa persistance à ne pas répondre aux demandes répétées des requérants (paragraphes 52 et 55 ci-dessus). Partant, la Cour ne voit pas comment les requérants peuvent raisonnablement escompter qu’une démarche officielle auprès de cette entité puisse par elle-même prospérer (mutatis mutandis, Hornsby, précité, ibidem), sans une volonté franche de l’Etat défendeur d’user de toutes les voies ouvertes en droit national pour assurer l’exécution des jugements rendus et ainsi empêcher que la Convention ne soit méconnue (voir, mutatis mutandis, Bourdov (no 2), précité, § 98, et Metaxas, précité, §§ 21-22).
Or, une telle volonté ne transparaît guère de la position adoptée jusqu’à ce jour par l’administration au niveau national ni de l’argumentation ferme du Gouvernement devant la Cour.
131. En bref, les requérants n’avaient pas à faire d’autres diligences, notamment auprès de l’ARSB, afin de bénéficier de la solution de rechange que la justice administrative a dû imposer à l’administration qui n’avait pas été en mesure de le faire d’office.
Aussi la Cour écarte-t-elle l’exception y afférente du Gouvernement, en tant qu’elle porte sur l’article 6 § 1 (paragraphe 99 ci-dessus).
132. Reste l’ultime question de savoir quel impact pourrait avoir la remarque de l’Assemblée plénière selon laquelle il n’était pas exclu qu’un autre « obstacle juridique » puisse entraver l’exécution de ses arrêts (paragraphe 124 in fine, ci-dessus). Aussi importante soit-elle, la Cour n’a pas à spéculer sur cette question, qui n’entrerait en compte que si l’État défendeur avait décidé de mettre en branle ses procédures pour s’exécuter. Toutefois, une chose demeure certaine : en vertu de la Convention et du droit turc, l’administration ne peut avoir une totale latitude pour exciper d’un tel « obstacle juridique » sans prouver qu’il est objectif et réellement insurmontable (paragraphe 123 ci-dessus).
Pour la Cour, en l’état actuel des choses, cette question ne relève donc pas non plus du fond de la présente affaire et ne saurait être considérée, le cas échéant, que dans le cadre de l’article 41.
133. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’en s’abstenant jusqu’à ce jour de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des jugements administratifs définitifs et exécutoires rendus à son encontre, l’Etat défendeur a méconnu le droit des requérants à un tribunal et a ainsi privé les dispositions l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
Par conséquent, il y a eu violation de cet article.
BOUSIOU C GRÈCE du 24 octobre 2013 requête 21455/10
L'ADMINISTRATION NE PEUT PRÉTEXTER UN MANQUE DE DOCUMENT TECHNIQUE POUR NE PAS EXÉCUTER UN JUGEMENT
30. Le Gouvernement soutient qu’il ressort de l’arrêt Kosmidis et Kosmidou c. Grèce (no 32141/04, §§ 24-25, 8 novembre 2007) que, l’on ne peut prétendre, en l’espèce, que les autorités ont refusé de se conformer à une décision de justice. En revanche, selon lui, tous les éléments du dossier montrent que ce sont les requérantes qui ont refusé de fournir à l’administration les documents qu’elle leur aurait demandés et que c’est pour cette raison que celle-ci n’aurait pas pu procéder à la levée de l’expropriation.
31. Le Gouvernement indique ensuite que les requérantes ont évité tout contact avec l’administration malgré l’invitation pressante de celle-ci à collaborer avec elle, notamment en lui soumettant les documents nécessaires à la modification du plan d’alignement. Selon le Gouvernement, les requérantes n’ont pas justifié leur refus catégorique de produire ces documents en expliquant, par exemple, qu’elles ne possédaient pas ces documents ou que leur établissement était difficile et onéreux. D’après le Gouvernement, la production de ces documents incomberait aux requérantes ; exiger de celles-ci qu’elles produisent les titres de propriété et les certificats y relatifs qui sont sûrement en leur possession, ainsi que les différents rapports techniques dont l’établissement nécessite peu de temps et de frais, n’est pas une demande excessive.
32. Les requérantes exposent que l’article 154 § 7 du décret présidentiel du 14 juillet 1999, selon lequel les particuliers demandant la modification du plan d’alignement seraient tenus de faire établir eux-mêmes, à leurs frais et avec diligence, les éléments techniques nécessaires à cette modification, concerne exclusivement les cas où la demande de modification se fait à l’initiative d’un particulier et non ceux où la modification est imposée afin de se conformer à une décision de justice. Quant à l’article 32 de la loi no 4067/2012, il ne couvrirait pas, d’après elles, l’omission de l’administration de se conformer au jugement no 1544/2009 pendant la période allant du 9 octobre 2009 à la date de l’entrée en vigueur de cet article. Les requérantes soutiennent que ce même article dispenserait en réalité l’administration de son obligation de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision de justice et qu’il imposerait aux particuliers la charge de l’obligation de faire modifier le plan d’alignement en en assumant les frais, frais qui s’élèveraient en l’espèce à 18 000 euros.
33. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’une telle décision, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention. La Cour rappelle aussi avoir déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’Etat en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, §§ 40 et suivants, 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–II, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 29, 11 décembre 2003). De surcroît, elle souligne l’importance particulière que revêt l’exécution des décisions de justice dans le contexte du contentieux administratif (Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 34, 22 décembre 2005).
34. En la matière, la Cour a considéré qu’il n’est en principe pas déraisonnable que l’administration demande aux intéressés des documents complémentaires afin qu’elle puisse se conformer dans les meilleurs délais à une décision de justice lui imposant la prise de certaines mesures. Une telle exigence se justifie lorsque les services administratifs ne sont pas en possession des documents nécessaires à l’exécution rapide de la décision de justice. Un tel motif est, à n’en pas douter, favorable au justiciable. Dans cet esprit, la Cour a jugé qu’il semble logique de demander aux propriétaires concernés de fournir leurs titres de propriété ou un certificat attestant qu’ils n’avaient pas perçu d’indemnité pour cette propriété, car il s’agit de documents qui sont sans aucun doute en possession des intéressés et dont la recherche par l’administration s’avérerait plus longue et compliquée (Kosmidis et Kosmidou, précité, § 26).
35. En revanche, lorsque l’examen du dossier permet de déduire que l’administration a sollicité la production d’actes juridiques ou de tout autre document comme prétexte pour se soustraire à l’exécution d’une décision de justice définitive ou, de manière dilatoire, pour en retarder la mise en œuvre, l’effet utile de l’article 6 § 1 de la Convention peut s’en trouver gravement diminué (Rompoti et Rompotis c. Grèce, no 14623/04, § 26, 25 janvier 2007 et Kosmidis et Kosmidou, précité, § 26).
36. En l’espèce, la Cour constate que la production des documents demandés aux requérantes ne leur incombait que partiellement (titres et certificats de propriété). La production des autres documents (proposition de modification du plan de la ville faite par un ingénieur, rapports techniques concernant les règles d’urbanisme du secteur, extraits du cadastre), comportant un grand nombre d’éléments techniques, semble plutôt être de la responsabilité de l’administration, et la Cour ne voit pas pourquoi les requérantes auraient dû faire établir ou rechercher elles-mêmes ces documents (voir, mutatis mutandis, Rompoti et Rompotis, précité, § 28). La Cour ne voit pas non plus pour quelle raison les autorités, pourvues des services compétents ayant à leur disposition tous les éléments techniques, topographiques et cadastraux nécessaires, auraient dû être assistées par des particuliers devant faire appel, à leurs frais, à des experts extérieurs pour fournir ces éléments.
37. La Cour ne perd d’ailleurs pas de vue que le 31 décembre 2012, le comité de trois membres du tribunal administratif de Patras a souligné, en constatant que l’administration ne s’était pas conformée au jugement no 1544/2009, que l’obligation du particulier se limitait à communiquer les éléments en sa possession (en l’occurrence, le relevé topographique portant indication de la superficie du terrain et les titres de propriété). Cette obligation n’exigeait pas que le particulier soumît une proposition de modification du plan ou des éléments qui étaient à la disposition des différents services de l’Etat. Le comité a invité l’administration à se conformer au jugement dans un délai de trois mois mais il apparait qu’aucune suite n’a été donnée à cette invitation.
38. Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que les autorités nationales ont omis, au moins pendant trois ans selon les dernières informations portées à sa connaissance, de se conformer au jugement no 1544/2009 du tribunal administratif de Patras, privant ainsi l’article 6 § 1 de la Convention de son effet utile.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
DROIT D'ACCES AUX JURIDICTIONS DE CASSATION
JUSTINE c. FRANCE requête n° 78664/17 du 21 novembre 2024
Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Pourvoi en cassation déclaré irrecevable en raison de la remise tardive au greffe du jugement de première instance confirmé par l’arrêt attaqué, un autre jugement ayant été transmis à la place dans le délai imparti • Erreur commise par l’avocat, correspondant à une simple confusion dans la transmission d’une pièce à la place d’une autre, rectifiée avec célérité à la demande du greffe et n’ayant pas retardé l’examen du pourvoi • Finalité poursuivie par la règle procédurale pleinement atteinte • Interprétation et application particulièrement rigoureuses de la règle qui n’étaient pas nécessaires à la bonne administration de la justice et à la sécurité juridique • Atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal devant la Cour de cassation qui a commis un rejet pour une cause sans intérêt pour une bonne administration de la justice.
a) Principes généraux
32. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Cela étant, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 195, 25 juin 2019, Grzęda c. Pologne [GC], no 43572/18, § 343, 15 mars 2022, et Xavier Lucas c. France, no 15567/20, § 42, 9 juin 2022).
33. L’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil (Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 80, 5 avril 2018 et références citées, et Gil Sanjuan c. Espagne, no 48297/15, § 30, 26 mai 2020).
34. Toutefois, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’opportunité des choix opérés par les États contractants relativement aux restrictions à l’accès à un tribunal ; son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent. Il ne lui appartient pas non plus de trancher les différends relatifs à l’interprétation du droit interne régissant l’accès à un tribunal, son rôle étant plutôt de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Zubac, précité, § 81, et références citées).
35. À cet égard, il convient de rappeler que la manière dont l’article 6 § 1 s’applique aux cours d’appel ou de cassation dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (ibidem, § 82, et références citées).
36. Lorsqu’elle est amenée à apprécier si la procédure devant une juridiction d’appel ou de cassation a respecté les exigences de l’article 6 § 1, la Cour tient compte de la mesure dans laquelle l’affaire avait été examinée par les juridictions inférieures, du point de savoir si la procédure devant ces juridictions soulevait des questions concernant l’équité, et du rôle de la juridiction concernée (ibidem, § 84, et références citées).
37. Par ailleurs, en ce qui concerne l’application de restrictions légales à l’accès aux juridictions supérieures, la Cour prend en considération, à différents degrés, certains autres facteurs : i) la prévisibilité de la restriction, ii) le point de savoir si c’est le requérant ou l’État défendeur qui doit supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure et qui ont eu pour effet de priver le requérant d’un accès à la juridiction supérieure, et iii) celui de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif » (ibidem, § 85, et références citées).
38. Pour déterminer si les juridictions internes ont fait preuve d’un formalisme excessif, la Cour examine en principe l’affaire dans son ensemble, eu égard aux circonstances particulières de celle-ci. En procédant à cet examen, la Cour insiste souvent sur la « sécurité juridique » et la « bonne administration de la justice », deux éléments centraux permettant de distinguer entre formalisme excessif et application acceptable des formalités procédurales. Elle a notamment jugé que le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (ibidem, § 98 et références citées, et Gil Sanjuan, précité, § 31).
b) Application en l’espèce
39. La Cour constate que le pourvoi de la requérante a été déclaré irrecevable en raison de la tardiveté de la production du jugement confirmé par l’arrêt attaqué en application de l’article 979 du CPC (paragraphe 18 ci‑dessus). Afin de s’assurer que cette sanction procédurale n’a pas porté atteinte à la substance même du droit de la requérante à un tribunal, la Cour recherchera si elle était prévisible, si elle poursuivait un but légitime et si elle était proportionnée.
Sur la prévisibilité de la restriction
40. La Cour constate qu’il résulte des termes même du premier alinéa de l’article 979 du CPC que le demandeur au pourvoi en cassation doit, à peine d’irrecevabilité, produire la décision attaquée ainsi que la décision confirmée ou infirmée par celle-ci dans un délai de quatre mois à compter du pourvoi (paragraphe 18 ci-dessus). Cette exigence claire fait, de surcroît, l’objet d’une pratique judiciaire constante et cohérente (paragraphe 23 ci-dessus), que le conseil de la requérante ne pouvait ignorer (voir, déjà, Levages Prestations Services, précité, § 42, et Henrioud c. France, no 21444/11, § 60, 5 novembre 2015) – et ce d’autant que son omission était susceptible d’engager sa responsabilité civile (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour en déduit que la restriction litigieuse était prévisible aux yeux du justiciable. La circonstance que le rapporteur initialement désigné n’ait pas envisagé de soulever d’office ce moyen d’irrecevabilité est sans incidence à cet égard.
Sur la légitimité du but poursuivi
41. La Cour note que la restriction en cause vise à permettre aux magistrats de la Cour de cassation de disposer rapidement des pièces utiles à l’examen du pourvoi en cassation dont ils sont saisis. Elle convient que cette formalité poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et qu’elle vise à garantir la sécurité juridique.
Sur la proportionnalité de la restriction
42. Il reste à la Cour à déterminer si la Cour de cassation, en faisant application en l’espèce des règles précitées, a ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence et respecté un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, au regard des facteurs précités (paragraphes 37 et 38 ci-dessus).
α) Sur la charge de l’erreur procédurale et ses conséquences
43. En l’espèce, la requérante admet que son avocat a commis une erreur en transmettant le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 13 juin 2006, alors qu’il aurait dû produire le jugement rendu par le tribunal d’instance de Fort‑de-France le 29 avril 2013, qui correspond à la décision confirmée par l’arrêt attaqué. Elle souligne cependant qu’elle s’est acquittée de l’ensemble de ses autres obligations procédurales avec diligence.
44. À cet égard, la Cour relève que la requérante a complété ses productions dès le 17 novembre 2016, à la demande expresse du greffe de la Cour de cassation et sans délai, avant même qu’un rapporteur soit désigné pour instruire l’affaire. Concrètement, l’erreur commise par la requérante n’a donc pas eu pour effet de retarder l’examen du pourvoi, le rapporteur ayant disposé dès sa désignation d’un dossier complet et ayant pu procéder à un examen approfondi de l’affaire, comme en atteste le rapport du 12 janvier 2017. La Cour considère donc que l’erreur commise par le conseil de la requérante est minime, et correspond à une simple confusion dans la transmission d’une pièce à la place d’une autre ; elle ne traduit donc ni de la désinvolture ni une volonté quelconque de dissimulation, lesquelles doivent évidemment pouvoir être sanctionnées procéduralement. En l’espèce, elle observe que la finalité poursuivie par la règle procédurale litigieuse a pleinement été atteinte. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime que l’erreur commise par le conseil de la requérante n’a eu aucune incidence sur la bonne administration de la justice et sur la sécurité juridique.
β) Sur l’excès de formalisme
45. La Cour rappelle que l’observation des règles formelles de procédure civile, qui permettent aux parties de faire trancher un litige civil, est utile et importante, car elle est susceptible de limiter le pouvoir discrétionnaire, d’assurer l’égalité des armes, de prévenir l’arbitraire, de permettre qu’un litige soit tranché et jugé de manière effective et dans un délai raisonnable, et de garantir la sécurité juridique et le respect envers le tribunal (Zubac, précité, § 96). Elle estime que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 n’impose pas aux autorités judiciaires d’inviter les parties à régulariser la procédure chaque fois que la méconnaissance d’une formalité est constatée.
46. Pour autant, la Cour observe en premier lieu que le second alinéa de l’article 979 du CPC permet de compléter des productions incomplètes ou erronées dans certaines conditions (paragraphe 18 ci-dessus). Ces dispositions ont été introduites par un décret du 6 novembre 2014 dans le but d’éviter de prononcer une sanction procédurale disproportionnée en cas de défaut de remise de certaines pièces (paragraphe 20 ci-dessus).
47. Or, la Cour de cassation a refusé de considérer la production du jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 13 juin 2006 comme une « erreur matérielle » susceptible de régularisation au sens du second alinéa de l’article 979 du CPC.
48. La Cour constate en second lieu que cette cause d’irrecevabilité a été soulevée d’office et à un stade avancé de la procédure, après qu’un rapport détaillé avait été déposé et à la suite d’un changement de rapporteur, et ce alors même que le dossier avait été complété avec célérité dès la demande du greffe de la Cour de cassation. Or, le droit interne n’imposait pas de relever d’office un tel moyen. La règle procédurale a donc été appliquée comme une barrière empêchant de trancher une affaire pourtant prête à être jugée.
49. La Cour de cassation a donc effectué une interprétation et une application particulièrement rigoureuses de la règle procédurale en cause. La Cour estime que celles-ci n’étaient pas nécessaires à la bonne administration de la justice et à la sécurité juridique dans les circonstances particulières de l’espèce (paragraphe 44 ci‑dessus) et en conclut que la requérante a dû supporter une charge excessive.
γ) Conclusion sur la proportionnalité
50. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour conclut que l’irrecevabilité du pourvoi en cassation de la requérante a porté une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal.
51. Cette conclusion suffit à constater la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
C.N. c. LUXEMBOURG du 12 octobre 2021 Requête no 59649/18
Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Absence de formalisme excessif de la Cour de cassation ayant déclaré irrecevable le pourvoi d’un mineur qui a omis de signifier son mémoire en cassation à ses parents ayant agi comme ses représentants légaux • Importance du respect de la signification du mémoire en cassation faisant entrer dans la procédure les parties censées y figurer
24. Le requérant estime avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal. Il critique la Cour de cassation en ce qu’elle lui a reproché de ne pas avoir signifié son mémoire en cassation à ses père et mère, quand bien même il était sous leur autorité et qu’il est évident qu’ils avaient connaissance de ce mémoire en tant que représentants légaux.
25. Le Gouvernement soulève en substance une exception d’irrecevabilité tirée d’un défaut de qualité au titre de l’article 34 de la Convention. Il expose que les parents, privés de l’autorité parentale envers leur fils au moment de la signature et du dépôt de la requête, n’étaient pas habilités à mandater Me Mbonyumutwa de déposer un recours devant la Cour. Il explique que la requête, qui porte en cachet la date de son dépôt le 3 décembre 2018, a été déposée au nom du mineur et signée en date du 16 novembre 2018 par les parents de ce dernier, en leur qualité de représentants légaux du mineur. Or, à la date de la signature de la requête par les parents – autorisant par ce biais Me Mbonyumutwa à représenter leur fils devant la Cour – les parents n’étaient pas titulaires de l’autorité parentale à l’égard de leur fils, dès lors que par mesure de garde provisoire du 1er octobre 2018 (paragraphe 18 ci-dessus), le mineur avait été placé dans le foyer d’accueil Caritas. Ainsi, selon l’article 11 de la loi sur la protection de la jeunesse, le placement, même provisoire, d’un mineur emporte transfert de l’autorité parentale à l’institution à laquelle le mineur se trouve confié (paragraphe 23 ci-dessus). Le Gouvernement estime que la décision de déposer le recours aurait dû être prise par – sinon du moins de concert avec – le détenteur de l’autorité parentale, à savoir l’association Caritas. Or, tel n’aurait manifestement pas été le cas. Eu égard aux circonstances entourant la présente affaire, le Gouvernement est même amené à se demander si le mineur a donné son accord pour introduire la présente requête et si ce sont bien les intérêts de l’enfant que Me Mbonyumutwa entend défendre en déposant une requête devant la Cour ou plutôt ceux des parents, signataires de la requête.
26. Le requérant réplique que le fait que la requête soit signée par ses parents ne pose aucun problème. Premièrement, en choisissant de demander aux parents du requérant de signer la requête, il s’agissait simplement pour Me Mbonyumutwa d’obtenir leur signature pour la bonne forme – le mineur n’ayant pas la capacité de signer lui-même la requête – et éviter toute décision d’irrecevabilité prima facie de la part de la Cour à cet égard. Deuxièmement, concernant l’absence de consultation du foyer avant le dépôt de la requête, le requérant estime qu’il aurait été oiseux de demander la signature ou l’autorisation du foyer avec lequel il était en litige suite à son placement. Enfin, le requérant rappelle que les intérêts de ses parents se confondent majoritairement avec les siens, certains actes posés par le mandataire du mineur étant également dans l’intérêt de ses parents, à savoir la recherche d’un retour de l’enfant auprès de sa famille.
27. La Cour rappelle sa jurisprudence relative aux « victimes » au titre de l’article 34 de la Convention, ainsi que les principes qui s’en dégagent, entre autres dans les arrêts Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, §§ 96 à 100, CEDH 2014 et Lambert et autres c. France [GC], no 46043/14, §§ 89 à 95, CEDH 2015 (extraits)).
28. En l’espèce, Me Mbonyumutwa a reçu mandat de la part des parents du requérant qui ont signé le formulaire de requête introduit pour le mineur. Le Gouvernement a fourni une information qui n’était pas portée à la connaissance de la Cour avant la communication de la requête, à savoir qu’au moment de la signature apposée sur le formulaire de requête, les parents n’étaient plus titulaires de l’autorité parentale à l’égard du mineur en raison du placement de celui-ci ordonné le 1er octobre 2018 (paragraphe 18 ci‑dessus).
29. La Cour observe que la décision de déchéance de l’autorité parentale a ainsi conduit à la rupture des liens juridiques entre les parents et le requérant. Elle rappelle qu’elle a toutefois dit que ce facteur ne revêtait pas de caractère décisif lorsqu’il s’agissait de définir si un parent pouvait avoir qualité pour la saisir au nom de l’enfant (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 157, 10 septembre 2019).
30. Elle rappelle également que, dans le contexte de l’article 8 de la Convention, elle a admis à plusieurs reprises que des parents qui n’avaient pas de droits parentaux puissent la saisir au nom de leurs enfants mineurs. Le critère essentiel qu’elle a retenu dans ces affaires était le risque que certains intérêts des mineurs ne soient pas portés à son attention et que ceux-ci soient privés d’une protection effective des droits qu’ils tirent de la Convention (ibidem, § 157).
31. Dans la présente affaire, le grief communiqué – et donc actuellement soumis à l’examen de la Cour – concerne le formalisme allégué excessif de la Cour de cassation. Il est donc tiré non pas de l’article 8 mais de l’article 6 de la Convention. Toujours est-il que le litige qui est à la base du grief porte sur la vie familiale du requérant. En effet, l’affaire soumise au contrôle de la Cour de cassation concernait les conditions auxquelles était subordonné le maintien en milieu familial de l’enfant. Vus sous cet aspect, les principes développés pour l’examen de griefs tirés de l’article 8 de la Convention peuvent dès lors s’appliquer en l’espèce.
32. La Cour a précédemment estimé que la situation des enfants au regard de l’article 34 devait faire l’objet d’un examen attentif, étant donné que les enfants doivent généralement compter sur d’autres personnes pour présenter leurs demandes et représenter leurs intérêts, et qu’ils peuvent ne pas avoir l’âge ou la capacité d’autoriser que des mesures soient prises en leur nom dans un sens réel (C. c. Croatie, no 80117/17, § 56, 8 octobre 2020). Réitérant qu’il convient d’éviter une approche restrictive ou purement technique en ce qui concerne la représentation des enfants devant elle (Strand Lobben et autres, précité, § 156), la Cour rappelle qu’il existe en l’espèce un lien biologique entre les parents et le mineur (voir, a contrario, Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, § 33, 27 avril 2010). Par ailleurs, concernant l’objet de la requête, à savoir l’accès à la justice, plus précisément le contrôle de l’arrêt de la Cour d’appel par la Cour de cassation, elle ne décèle pas d’intérêts conflictuels, au sens de sa jurisprudence, entre les parents et le requérant (voir, mutatis mutandis, Strand Lobben et autres, précité, §§ 158 et 159). Enfin, elle peut rejoindre le requérant lorsqu’il affirme qu’en raison du conflit existant avec le foyer – dans lequel il avait été placé deux mois avant l’introduction de la requête –, il ne saurait lui être reproché d’avoir introduit la requête par le biais de ses parents.
33. Dans ces circonstances, la Cour décide de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.
34. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
SUR LE FOND
40. De prime abord, la Cour ne saurait avaliser l’argument du requérant quant à une « scission artificielle » de l’affaire. La Cour de cassation était saisie de deux pourvois séparés, formés par l’intermédiaire de deux avocats distincts, le premier par les parents et le second par le requérant, chaque fois par une déclaration au greffe (paragraphe 12 ci-dessus). S’étant bornée à analyser la recevabilité de chacun de ces pourvois, la Cour de cassation ne saurait encourir le reproche d’avoir statué par deux arrêts distincts.
41. La question centrale, dans cette affaire, consiste à savoir si l’interprétation de la part de la Cour de cassation quant à la qualité à accorder aux parents du requérant – et qui avait comme corollaire l’obligation pour ce dernier de leur signifier son mémoire –, était de nature à porter atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal du requérant tel que garanti par l’article 6 § 1. Dans ce contexte, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de trancher des différends relatifs à l’interprétation du droit interne régissant l’accès à un tribunal, son rôle étant plutôt de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 81, 5 avril 2018).
42. La Cour note que le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable au motif que le requérant n’avait pas signifié son mémoire à ses parents, de sorte qu’une restriction a été appliquée à son accès à la Cour de cassation. Il s’agit d’analyser si pareille restriction était légale, si elle poursuivait un but légitime et était proportionnée au but recherché (voir, mutatis mutandis, Dos Santos Calado et autres, précité, § 120).
43. Il ressort des développements du ministère public (paragraphe 14 ci‑dessus) et de l’arrêt même de la Cour de cassation (paragraphe 17 ci‑dessus) qu’une difficulté provient de ce qu’en matière de protection de la jeunesse, la loi procède par un renvoi général, concernant la procédure, à la matière répressive. Or, en matière pénale, l’article 43 de la loi sur la cassation dispose que le mémoire en cassation doit être, avant d’être déposé, signifié « au défendeur au civil » et que le mémoire du défendeur civil devra être signifié « à la partie civile » avant d’être déposé (paragraphe 22 ci-dessus).
44. Pour juger de la compatibilité avec la Convention des effets de l’interprétation telle qu’elle a été faite par la Cour de cassation, la Cour estime devoir accorder une importance particulière au point de savoir si les modalités d’exercice du pourvoi pouvaient passer pour prévisibles aux yeux du justiciable (Zubac, précité, § 87). En principe, une pratique judiciaire constante au niveau national et l’application cohérente de celle-ci satisfont au critère de prévisibilité d’une restriction à l’accès à la juridiction supérieure (ibidem, § 88).
45. La Cour note que le Gouvernement n’allègue pas que le raisonnement tel qu’adopté par la Cour de cassation dans la présente affaire serait le résultat de l’application cohérente d’une pratique judiciaire constante au niveau national. Le contraire semble même se dégager des conclusions du ministère public qui, comme il vient d’être rappelé, mentionnent la « difficulté provena[n]t de ce que la loi sur la protection de la jeunesse ne prévoyait aucune règle procédurale concernant le recours en cassation et se contentait de renvoyer de manière générale aux règles de la procédure pénale » (paragraphe 14 ci-dessus).
46. La Cour ne saurait cependant faire abstraction de ce qu’elle a eu l’occasion de préciser qu’il faut bien qu’une norme juridique donnée soit un jour appliquée pour la première fois (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 115, CEDH 2015). Il ne peut être exclu que tel ait pu être le cas en l’espèce. En effet, au regard des éléments fournis par les parties, il est possible qu’avant la présente affaire, la Cour de cassation n’ait pas eu à procéder, dans des circonstances similaires, par une application combinée des différentes dispositions légales en cause. Il n’en reste pas moins qu’il faut que l’interprétation en cause n’apparaisse ni comme arbitraire, ni comme imprévisible (voir, mutatis mutandis, Kudrevičius et autres, précité, § 114).
47. Le litige en cause concernait les conditions sous lesquelles le mineur pouvait être maintenu en milieu familial à l’issue de la levée d’un placement provisoire initial. Plus précisément, sur initiative d’une citation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse par le ministère public, les magistrats avaient ordonné que l’enfant reste dans sa famille sous certaines conditions. Ces dernières furent contestées par le requérant et ses parents, qui se pourvurent chacun en cassation de l’arrêt qu’avait rendu la chambre d’appel de la jeunesse en la matière (paragraphe 12 ci-dessus).
48. De toute évidence, dans la procédure concernant les modalités du maintien de leur fils en milieu familial, les parents n’étaient à considérer ni comme « défendeurs au civil » ni comme « parties civiles » dans une instance pénale.
49. C’est par une combinaison de plusieurs dispositions législatives internes que la Cour de cassation a estimé que les parents du requérant avaient, en tant que « parties à l’instance », un intérêt propre au sort du pourvoi en cassation formé par le mineur (paragraphe 17 ci-dessus). Le fait que le mémoire en cassation eût été déposé au nom du requérant « représenté en justice pour autant que de besoin et pour la bonne forme par ses parents » (paragraphe 13 ci-dessus), n’affecta pas la conclusion de la Cour de cassation, selon laquelle le requérant aurait dû signifier son mémoire à ses parents en leur qualité de « parties à l’instance ».
50. Au vu de ce que, comme il vient d’être mentionné plus haut, le litige en cause concernait les conditions sous lesquelles le requérant pouvait être maintenu en milieu familial à l’issue de la levée d’un placement provisoire initial, l’intérêt du mineur ne se confondait ainsi pas nécessairement avec celui de ses parents. Or, tant en matière civile qu’en matière répressive, le mémoire en cassation doit être signifié aux parties ayant un intérêt différent du demandeur en cassation. D’ailleurs, pour autant que le requérant indique que les parents sont « civilement responsables de leur fils », la Cour note que, même en cette qualité, ils peuvent avoir des intérêts différents de ceux de leur fils. C’est donc par une combinaison des articles mentionnés dans l’arrêt du 31 mai 2018 (paragraphe 17 ci-dessus), que l’on peut estimer que la conclusion à laquelle arriva la Cour de cassation – que les parents du mineur étaient à considérer comme parties à l’instance auxquelles il y avait lieu d’appliquer les règles procédurales concernant celles-ci – n’était ni imprévisible ni arbitraire.
51. Un pourvoi en cassation en matière répressive est formé par simple déclaration au greffe, comme ce fut le cas, en l’espèce, séparément pour le requérant et ses parents (paragraphe 12 ci-dessus). Il n’apparaît pas du dossier qu’en formant le pourvoi pour le requérant, Me Mbonyumutwa eût indiqué que le mineur était représenté par ses parents. Ces derniers n’étaient partant pas parties au pourvoi du requérant en qualité de demandeurs en cassation.
Le premier acte mentionnant que le requérant était représenté par ses parents était le mémoire en cassation déposé par la suite (paragraphe 13 ci-dessus), qui ne fut pas signifié aux parents. Or, la Cour de cassation estimait qu’il n’était pas suppléé à l’absence de signification du mémoire en cassation par la précision, dans le mémoire en question, que le demandeur en cassation était représenté en justice par ses parents. La Cour de cassation a ainsi appliqué le principe que ne fait partie de la procédure de cassation, outre le demandeur, que celui qui s’est vu signifier le mémoire en cassation par ce dernier.
52. L’argument du requérant selon lequel ses parents auraient également personnellement formé un pourvoi séparé par le biais de Me A. ne saurait convaincre. En effet, les parents ne peuvent pas, de ce seul fait, être considérés comme parties à l’autre pourvoi (celui du requérant), qui aboutissait à une instance et un arrêt séparés.
La Cour considère aussi, avec le Gouvernement, que la notification par voie électronique, avancée par le requérant, ne saurait suppléer à l’absence de signification du mémoire en cassation, puisqu’un justiciable ne peut substituer ses propres procédés à une formalité légalement prévue en la matière. À cet égard, la Cour rappelle que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles relatives aux formalités à observer pour former un recours soient appliquées (voir, parmi de nombreux autres, Cañete de Goñi c. Espagne, no 55782/00, § 36, CEDH 2002‑VIII).
54. La Cour peut admettre que la restriction appliquée à la Cour de cassation poursuivait comme but légitime celui d’une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de sécurité juridique (ibidem, § 36).
Si la signification n’a pas seulement comme effet d’informer les autres parties, mais d’en faire des « parties à l’instance », elle veille ainsi à ce que toutes les parties figurent dans l’instance de cassation, surtout si elles ont ou sont susceptibles d’avoir des intérêts différents du demandeur en cassation.
Il y a lieu d’ajouter que tant en matière civile qu’en matière pénale, le droit commun des pourvois en cassation exige une signification du mémoire du demandeur en cassation aux parties adverses, hormis le représentant du ministère public, les parties adverses étant celles ayant figuré dans l’instance précédente et ayant ou pouvant avoir un intérêt distinct de celui du demandeur en cassation (paragraphe 22 ci-dessus).
Certes, le requérant affirme que ses parents ont des intérêts identiques aux siens. Toutefois, la législation relative à la protection de l’enfance a comme but de protéger l’enfant auquel un intérêt propre est reconnu. La législation en question met même au centre de ses préoccupations l’intérêt supérieur de l’enfant qui peut, le cas échéant, être contraire à celui de ses père et mère. Ainsi, ce qui comptait en l’espèce, n’était pas que les intérêts du requérant eussent été le cas échéant identiques à ceux de ses parents mais qu’ils eussent pu être différents voire contraires.
55. Enfin, la restriction à l’accès à la Cour de cassation n’apparaît pas disproportionnée. Même s’il est vrai que le Luxembourg ne connaît pas le système des avocats spécialisés exerçant devant les juridictions suprêmes, la Cour estime qu’il y a lieu de tenir compte de la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit. La Cour peut dès lors admettre l’importance du respect de la règle procédurale de la signification du mémoire en cassation, dans la mesure où la signification est considérée comme élément central de la procédure de cassation en faisant entrer dans la procédure de cassation les parties qui sont censées y figurer.
56. La Cour estime que l’affirmation du requérant, selon laquelle il aurait été privé de sa « dernière chance » de pouvoir contester l’arrêt de la Cour d’appel, ne change rien à cette conclusion et doit, en tout état de cause, être nuancée. Tout d’abord, dans la matière concernée, les juridictions peuvent être saisies à nouveau dès que les circonstances changent. La preuve en est d’ailleurs que d’autres procédures ont suivi l’arrêt de la Cour de cassation litigieux. Ensuite, il se dégage du mémoire en cassation que le requérant entendait essentiellement remettre en question l’appréciation en fait à la base de l’arrêt de la Cour d’appel, une mission qui n’entre pourtant pas dans le champ de compétence de la Cour de cassation.
57. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut que la Cour de cassation n’a pas versé dans un formalisme excessif en estimant que le fait que les parents du requérant aient agi comme ses représentants légaux, ne dispensait pas le mineur de leur signifier le mémoire en cassation.
58. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention
DYLUŚ c. POLOGNE du 23 septembre 2021 requête 12210/14
Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Refus de la Cour suprême de connaître du pourvoi en cassation d’un avocat, formé devant elle par l’intermédiaire d’un autre avocat • Approche de la haute juridiction trop formaliste et disproportionnée
Faits
4. Le requérant, avocat de profession, ne s’était pas pourvu en cassation pour l’une de ses clientes, bien que celle-ci en eût exprimé le souhait. Pour cette raison, des poursuites disciplinaires furent engagées contre lui pour conduite contraire à la déontologie.
5. Par une décision du 8 février 2012, le tribunal disciplinaire du barreau de Poznań le déclara coupable de l’infraction disciplinaire de conduite contraire à la déontologie, en vertu de l’article 80 de la loi sur l’ordre des avocats combiné à l’article 57 du code de déontologie des avocats (paragraphes 11 et 15 ci-dessous), et lui infligea un blâme. Il le condamna également à rembourser à l’ordre des avocats les frais de procédure, soit 2 000 zlotys (PLN) – environ 500 euros (EUR). Dans les motifs de sa décision, il nota que le requérant était d’avis qu’un éventuel pourvoi en cassation dans le dossier en question aurait été voué à l’échec, mais qu’il aurait dû alors se décharger du dossier en temps utile pour permettre à sa cliente de mandater un autre représentant, ce qu’il n’avait pas fait, en conséquence de quoi le délai pour former un pourvoi avait expiré. Par une décision du 20 octobre 2012, le tribunal disciplinaire d’appel de l’ordre des avocats confirma cette décision.
6. Le 27 mars 2013, le requérant forma auprès de la chambre criminelle de la Cour suprême un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal disciplinaire d’appel.
7. Le 9 avril 2013, le tribunal disciplinaire d’appel invita le requérant, en vertu de l’article 95n de la loi sur l’ordre des avocats (paragraphe 13 ci‑dessous), à rectifier sous sept jours les vices de forme de ce recours. Il lui demanda en particulier de faire rédiger et signer le recours par un avocat ou un conseil et précisa qu’à défaut, il ne serait pas recevable.
8. Le 15 avril 2013, le requérant mandata un avocat pour le représenter devant la Cour suprême. Le lendemain, cet avocat forma pour le compte de l’intéressé un pourvoi en cassation, qu’il signa lui-même.
9. Le 25 avril 2013, la Cour suprême, appliquant l’article 531 § 1 (paragraphe 18 ci-dessous) du code de procédure pénale (CPP) combiné à l’article 95n de la loi sur l’ordre des avocats, refusa de connaître (pozostawił bez rozpoznania) du pourvoi en cassation et condamna le requérant au paiement des frais de procédure, soit 20 PLN. Dans les motifs de sa décision, elle observa ce qui suit.
– Le pourvoi en cassation formé par le requérant lui-même et celui formé par l’avocat de l’intéressé étaient libellés de manière identique, et ils étaient tous deux datés du 27 mars 2013. Il y avait lieu d’en déduire que le second pourvoi n’avait pas été rédigé par l’avocat du requérant, qui n’avait été mandaté que le 15 avril 2013. Ce dernier recours n’était donc pas conforme à l’article 526 § 2 du CPP (paragraphe 17 ci-dessous). Cet article disposait que, pour être recevable, un pourvoi en cassation devait impérativement être rédigé et signé par un avocat ou un conseil mandaté pour représenter le demandeur en cassation, à moins que celui-ci ne soit procureur. L’obligation du ministère d’avocat s’appliquait à l’ensemble des demandeurs en cassation, avocats et conseils compris. Dès lors, un pourvoi en cassation formé par un avocat ou un conseil contre une décision prise dans une procédure disciplinaire engagée contre lui était irrecevable. Il découlait de la lettre de l’article 526 § 2 que l’obligation qui y était énoncée n’était pas remplie si l’avocat ou le conseil mandaté pour représenter le demandeur en cassation reprenait les termes du pourvoi que son mandant avait rédigé ou, comme en l’espèce, se contentait d’ajouter ses coordonnées professionnelles sur le recours rédigé par son mandant.
– L’obligation du ministère d’avocat dans la procédure de cassation était bien ancrée dans la jurisprudence et la doctrine juridique pertinentes. Elle avait pour but de garantir une séparation dans la procédure pénale entre les rôles respectifs d’avocat ou de conseil, d’une part, et d’accusé, de partie civile ou d’accusateur subsidiaire, d’autre part. Elle avait en outre pour finalité de permettre à chaque demandeur en cassation de présenter sa cause à la Cour suprême de la manière la plus objective possible. Une approche dépassionnée et un professionnalisme dépourvu de subjectivité (que le demandeur en cassation pouvait difficilement avoir) étaient nécessaires au bon exposé des moyens de cassation, lesquels portaient uniquement sur des questions de droit. Autoriser un avocat visé par une procédure disciplinaire à rédiger et signer un pourvoi en cassation dans le cadre de sa propre affaire aurait eu pour effet de contourner l’article 526 § 2 du CPP. En pareille situation, l’avocat demandeur n’était pas à même de présenter convenablement sa cause.
– En vertu de l’article 91a § 1 de la loi sur l’ordre des avocats (paragraphe 12 ci-dessous), seuls pouvaient se pourvoir en cassation le ministre de la Justice, le médiateur (Rzecznik Praw Obywatelskich), le bâtonnier du barreau national et les parties à la procédure, parmi lesquelles l’accusateur, l’avocat mis en cause et la victime de celui-ci. De plus, l’avocat mis en cause avait le droit de mandater un défenseur, et celui-ci devait être lui-même avocat. Dès lors, un cumul dans la même procédure des qualités respectives d’avocat mis en cause et d’avocat défenseur aurait été inadmissible.
– Même si, en l’espèce, le requérant avait formellement respecté l’article 526 § 2 du CPP, le pourvoi en cassation que son avocat avait formé en son nom n’avait pas été rédigé par cet avocat, mais reproduisait simplement le contenu du recours que l’intéressé avait lui-même rédigé. Par conséquent, ce pourvoi devait être rejeté.
Article 6-1
34. La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil, et consacre ainsi le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect. Ce droit n’est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature même une réglementation de la part de l’État. Toutefois, si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Kreuz c. Pologne (no 1), no 28249/95, § 53, CEDH 2001‑VI, et V.M. c. Bulgarie, no 45723/99, § 41, 8 juin 2006).
35. Il a ainsi été admis, dans un certain nombre d’affaires, que l’accès à un tribunal pouvait faire l’objet de limitations de nature diverse (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 33, Recueil 1997‑VIII, et Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, §§ 61 et suivants, série A no 316‑B). Dans chacune de ces affaires, la Cour a toutefois vérifié si les limitations appliquées n’avaient pas restreint l’accès ouvert au justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en serait trouvé atteint dans sa substance même.
36. À cet égard, la Cour réaffirme qu’une limitation de l’accès à une cour ou à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Kreuz, précité, §§ 54-55, et Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, 10 juillet 1998, § 72, Recueil 1998-IV).
37. Elle rappelle en outre que la réglementation relative aux formes et délais à observer pour introduire un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (Cañete de Goñi c. Espagne, no 55782/00, § 36, 15 octobre 2002).
38. La Cour rappelle également que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter les règles de nature procédurale (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). Toutefois, l’interprétation et l’application d’une législation ne doivent pas empêcher les justiciables de se prévaloir d’une voie de recours disponible. La Cour doit vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ou application, en particulier lorsqu’il s’avère que, par suite de celles-ci, un requérant aurait pu subir un déni de justice (voir, mutatis mutandis, Tejedor García, précité, § 31, et Ben Salah, Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), no 45023/98, 27 avril 2000). Le rejet d’un recours prononcé en raison d’un vice de forme qui ne saurait être imputé à l’auteur du recours est susceptible de porter atteinte au droit de l’intéressé à un tribunal (Sotiris c. Grèce, no 39442/98, 16 novembre 2000).
39. La Cour rappelle enfin que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 48, 24 avril 2008, et Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11) mais que, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 de la Convention doivent y être respectées, notamment en ce qui concerne le droit effectif d’accès aux tribunaux à l’égard des décisions relatives à des « droits et obligations de caractère civil » (Brualla Gómez de la Torre, précité, § 37). La compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 dépend des particularités de la procédure en cause, et il faut prendre en compte pour l’apprécier l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que celles d’un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
40. En l’espèce, la Cour observe que, appliquant l’article 526 § 2 du CPP, la Cour suprême a refusé de connaître du pourvoi en cassation que le requérant, avocat de profession, avait formé devant elle par l’intermédiaire d’un autre avocat contre les décisions rendues en sa défaveur par les juridictions disciplinaires de l’ordre des avocats. Elle note qu’en conséquence, le droit du requérant à un tribunal a été, de toute évidence, restreint.
41. Elle observe ensuite que, à l’appui de cette décision, la Cour suprême a invoqué l’impératif de bonne administration de la justice, en insistant en particulier sur le fait que l’article 526 § 2 du CPP faisait obligation à l’intéressé de faire rédiger le pourvoi en cassation dans l’affaire le concernant par un professionnel du droit autre que lui-même, afin que ce recours respectât les exigences qualitatives prescrites (paragraphe 10 ci‑dessus).
42. Eu égard aux motifs exposés dans la décision de la Cour suprême, la Cour considère que le but en tant que tel de la restriction litigieuse était légitime. Cela étant, elle s’interroge sur la nécessité et le caractère proportionné de cette restriction au regard du but recherché.
43. Elle observe dans ce contexte qu’à l’issue de la procédure diligentée contre lui par les juridictions ordinales, le requérant s’est vu infliger un blâme. Cette mesure était certes l’une des moins sévères dans l’échelle des sanctions disponibles mais, à l’évidence, elle était néanmoins susceptible d’avoir des répercussions sur la réputation professionnelle de l’intéressé. Elle était par ailleurs la toute première mesure disciplinaire dont il ait jamais fait l’objet. Dans ces conditions, la Cour estime que l’intéressé avait un intérêt légitime à voir la Cour suprême examiner son pourvoi en cassation, d’autant qu’en l’espèce, la haute juridiction était la seule instance « extérieure » aux juridictions qui avaient jusque-là participé à l’examen de l’affaire.
44. Dans un premier temps, le requérant s’est pourvu en cassation personnellement. La juridiction ordinale d’appel l’ayant invité à rectifier les vices de forme du pourvoi en cassation ainsi formé, il a mandaté un avocat pour le représenter devant la Cour suprême. Cet avocat a introduit un pourvoi en cassation, qu’il a lui-même signé, au nom du requérant. La Cour suprême a refusé d’examiner ce pourvoi, au motif que, contrairement aux exigences découlant de l’article 526 § 2 du CPP, il avait été rédigé par l’intéressé lui-même et non par son avocat.
45. Il ne ressort pas de la motivation de la décision de la Cour suprême sur ce point que le pourvoi en cassation que le requérant, avocat de profession, avait formé par l’intermédiaire de son avocat valablement mandaté aux fins de sa représentation devant la Cour suprême ne respectât pas les conditions de forme ou de fond prescrites pour ce type de recours ou qu’il fût de qualité inférieure aux standards applicables en la matière. Il ne ressort pas non plus de cette décision qu’il y ait eu en l’espèce des motifs raisonnables de considérer que le requérant n’avait pas l’approche objective et dépassionnée qui, selon la Cour suprême, était nécessaire au bon exposé de sa cause dans la procédure de cassation (voir, a contrario, Correia de Matos c. Portugal [GC], no 56402/12, § 154, 4 avril 2018). En signant le pourvoi en cassation, l’avocat mandaté par le requérant avait certifié que le recours respectait l’ensemble des conditions de forme et de fond dont la législation nationale pertinente faisait dépendre l’examen par la Cour suprême des pourvois en cassation.
46. Dans ces conditions, la Cour estime que l’approche qui a amené la haute juridiction nationale à rejeter le pourvoi en cassation dont l’avait saisie le requérant par l’intermédiaire de son avocat est par trop formaliste et, ainsi, disproportionnée au regard du but légitime visé.
47. Elle observe que dans sa version antérieure à la modification de 2000, l’article 526 § 2 du CPP ne prévoyait pas d’obligation du ministère d’avocat analogue à celle qui est en cause en l’espèce (paragraphe 16 ci‑dessus). Elle note de plus que, dans l’arrêt cité aux paragraphes 22 et 23 ci-dessus, la Cour constitutionnelle polonaise a déclaré que, dans sa version en vigueur depuis la modification législative en question, cette disposition était contraire à la Constitution polonaise. Elle constate enfin que ni le CPC, ni la loi Ppsa, ni la loi régissant la procédure devant la Cour constitutionnelle ne prévoient d’obligation du ministère d’avocat similaire à celle dont se plaint le requérant (paragraphes 19-21 ci-dessus).
48. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le refus de la Cour suprême de connaître du pourvoi en cassation dont le requérant l’avait saisie par l’intermédiaire de son avocat a porté atteinte au droit de l’intéressé à un tribunal.
49. Partant, il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.
WILLEMS ET GORJON c. BELGIQUE du 21 septembre 2021 requête n° 74209/16
Art 37 § 1 • Rejet par la Cour de cassation de la demande en réouverture de la procédure rendant vain les engagements du Gouvernement contenus dans sa déclaration unilatérale • Circonstance exceptionnelle conduisant à la réinscription au rôle des requêtes initiales
Art 6 § 1 (pénal) • Accès à un tribunal • Formalisme excessif de la Cour de Cassation ayant décidé de l’irrecevabilité des pourvois en l’absence de la mention par l’avocat de son attestation requise
Art 6-1
a) Principes généraux
76. La Cour rappelle les principes généraux relatifs au droit d’accès à un tribunal en matière civile (Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, §§ 112‑116, 15 mars 2018, et Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 76‑79, 5 avril 2018 ; voir aussi Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, §§ 49-58, 20 octobre 2011, et Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c Roumanie [GC], no 76943/11, §§ 84‑90 et 116, 29 novembre 2016).
77. En particulier, la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif et non pas théorique et illusoire. L’effectivité de l’accès au juge suppose qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres, précité, § 86).
78. La Cour rappelle qu’elle accorde une importance particulière au point de savoir si les règles portant restriction de l’accès à un tribunal et, en particulier, les modalités d’exercice d’un recours sont prévisibles aux yeux du justiciable (voir, mutatis mutandis, Zubac, précité, § 87, et, dans le même sens, Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, nos 65101/16 et 2 autres, § 106, 23 octobre 2018, et Vermeersch c. Belgique, no 49652/10, § 58, 16 février 2021).
79. Le droit d’accès aux tribunaux n’étant toutefois pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière. Cependant, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres, précité, § 89, Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 115, 15 mars 2018, Zubac, précité, § 78, et Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 195, 25 juin 2019).
80. En ce qui concerne l’accès à une juridiction supérieure, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6. À cet égard, pour déterminer la proportionnalité de restrictions légales appliquées à l’accès aux juridictions supérieures, la Cour se montre particulièrement attentive à trois critères, à savoir i) la prévisibilité des modalités d’exercice du pourvoi, ii) le point de savoir qui doit supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure et iii) la question de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif » (Zubac, précité, §§ 85 et 109).
b) Application des principes au cas d’espèce
81. En l’espèce, par son arrêt du 1er juin 2016, la Cour de cassation a déclaré irrecevables les pourvois introduits par les requérants contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège qui les avait déclarés coupables de plusieurs infractions pénales et leur avait infligé des peines de confiscation à ce titre. Le motif de cette décision tenait à ce qu’il n’apparaissait pas des pièces déposées par les requérants à l’appui de leurs pourvois que leur représentant était titulaire de l’attestation de formation en cassation visée à l’article 425 § 1er alinéa 2 du CIC. Pour le même motif, la Cour de cassation n’a pas examiné les mémoires déposés par le même avocat (paragraphe 11 ci-dessus).
82. Invitée à la suite de la décision de radiation de la Cour du 13 mars 2018 à rouvrir la procédure pénale dont se plaignaient les requérants, la Cour de cassation a considéré, dans son arrêt du 7 novembre 2018, qu’exiger que la qualité d’avocat attesté soit ainsi prouvée ne posait pas de problème en termes de droit d’accès à un tribunal. Selon la Cour de cassation, cette exigence vise à éviter l’encombrement de son rôle par des pourvois irrecevables ou manifestement mal fondés, ainsi que des recherches en fait qui la distrairaient du jugement des affaires régulièrement déférées à sa juridiction. Rendre ainsi tributaire la recevabilité du recours de la seule affirmation dans l’acte de pourvoi ou dans le mémoire de la possession de l’attestation doit être regardé, de l’avis de la haute juridiction, comme un formalisme minimal proportionné à cet objectif. L’arrêt du 1er juin 2016 était donc conforme, selon la Cour de cassation, aux exigences de la Convention (paragraphes 24-26 ci-dessus).
83. La Cour observe que le problème soulevé en l’espèce concerne une condition de recevabilité des pourvois en cassation en matière pénale. Il n’est pas contesté devant elle que la condition relative à la qualité de l’avocat représentant un demandeur en cassation, qui s’applique depuis le 1er février 2016, date de l’entrée en vigueur de la loi ayant modifié l’article 425 § 1er alinéa 2, du CIC sur ce point, était remplie par l’avocat des requérants. Celui-ci avait en effet suivi la formation à la procédure en cassation, s’était vu délivrer l’attestation le 22 janvier 2016, et disposait de l’attestation requise pour introduire des pourvois en cassation au moment où il avait formé ceux des requérants, le 10 février 2016.
84. La Cour constate qu’il a été reproché aux requérants d’avoir commis une erreur procédurale en ne prouvant pas la qualité d’avocat attesté de leur représentant par la mention de sa possession dans les écrits auxquels la Cour de cassation pouvait avoir égard.
85. Sans contester que l’exigence d’une attestation pour introduire une procédure en cassation poursuit en soi un objectif de bonne administration de la justice, les requérants se plaignent que l’application de cette exigence en l’espèce et l’irrecevabilité de leurs pourvois qui en a résulté étaient imprévisibles et disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi.
86. La Cour note à cet égard que les termes de l’article 425 § 1er alinéa 2 du CIC n’imposent pas qu’il apparaisse des pièces de la procédure que l’avocat est titulaire de l’attestation de la formation requise (paragraphe 30 ci-dessus). Elle constate en outre que ni le site internet de la Cour de cassation ni le règlement de la formation ne contient d’information au sujet d’une telle exigence (paragraphes 32-33 ci-dessus). De plus, les requérants font valoir, sans être contesté par le Gouvernement, qu’au moment où leur avocat a formé les pourvois – soit dix jours après l’entrée en vigueur des modifications apportées à l’article 425 § 1er alinéa 2 du CIC – et pendant les deux mois qui ont suivi, aucune autre décision n’est intervenue qui leur aurait permis de prévoir la nécessité d’indiquer que leur avocat était titulaire de l’attestation.
87. Cela étant dit, un élément qui pèse lourdement dans l’appréciation de la proportionnalité de la sanction appliquée aux requérants pour non-respect de l’exigence formelle précitée est que le site internet de la Cour de cassation explique que la liste des avocats titulaires de l’attestation peut être consultée sur les sites internet respectifs des ordres des barreaux des avocats et contient un lien direct vers lesdits sites. En d’autres termes, la Cour de cassation fournissait elle-même la possibilité de rechercher par une simple consultation via son propre site internet si la règle nouvellement introduite pour accéder à son office était respectée en l’espèce.
88. Dans ces circonstances, au vu des conséquences qu’a entraînées l’irrecevabilité des pourvois en cassation pour les requérants – lesquels n’ont pas pu dans le contexte d’un procès pénal faire entendre leurs moyens de cassation par la haute juridiction interne –, la Cour estime que lorsqu’elle a ainsi sanctionné l’erreur procédurale commise par eux, la Cour de cassation a rompu le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des exigences procédurales entourant l’introduction d’un pourvoi en cassation et, d’autre part, le droit d’accès au juge (voir, mutatis mutandis, Walchli c. France, no 35787/03, § 36, 26 juillet 2007, et Evaggelou c. Grèce, no 44078/07, § 24, 13 janvier 2011), faisant ainsi preuve d’un formalisme excessif en ce qui concerne les exigences procédurales entourant la recevabilité des pourvois en cassation (voir, mutatis mutandis, Walchli, précité, § 36).
89. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
ORZHAK c. RUSSIE du 30 mars 2021 Requête no 4830/18
Art 6 (civil) • Atteinte au droit d’accès à un tribunal lors du rejet du pourvoi en cassation sans examen au fond pour non-respect d’une exigence dictée par la loi • Absence de but légitime visé par la mesure contesté • Bonne foi du requérant ayant donné toutes les informations pour comprendre la nature de son recours
16. L’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de cette disposition doivent être respectées, notamment en ce qu’elle assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil. La Cour n’a toutefois pas pour tâche d’apprécier l’opportunité des choix opérés par les États contractants relativement aux restrictions à l’accès à un tribunal ; son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent. Il ne lui appartient pas non plus de trancher des différends relatifs à l’interprétation du droit interne régissant l’accès à un tribunal, son rôle est plutôt de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 80-81, 5 avril 2018).
17. La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. Enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I).
18. La Cour rappelle à cet égard que la réglementation relative aux formalités à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et 9 autres, § 33, CEDH 2000-I).
19. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation trop formaliste des règles applicables faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX, Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX, Nikolaos Kopsidis c. Grèce, no 2920/08, § 22, 18 mars 2010, Miessen c. Belgique, no 31517/12, § 66, 18 octobre 2016, Zubac, précité, § 98, et Gil Sanjuan c. Espagne, no 48297/15, § 31, 26 mai 2020).
20. En l’espèce, la Cour note que les parties n’ont pas la même lecture du droit national. Le Gouvernement soutient que l’exigence d’indiquer la formation précise de la cour de l’entité fédérée est dictée par une norme précise du code de procédure civile, alors que la partie requérante, faisant sa propre lecture de la même norme, affirme l’inverse. Il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre interprétation du droit interne à celle faite par les juridictions nationales. Cependant, même en admettant que le juge ait agi en stricte conformité avec le code de procédure civile, il n’en resterait pas moins que le Gouvernement n’indique pas quel serait le but légitime poursuivi par la norme ainsi appliquée : il ne précise pas par exemple s’il s’agit d’assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l’attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d’examen des dossiers. La Cour accorde du poids aux explications du requérant. Celui-ci a indiqué que, agissant de bonne foi, il avait donné toutes les informations qui permettaient de comprendre que son recours était un pourvoi en cassation (paragraphe 12 ci-dessus).
21. Ainsi, les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée. En revanche, cette mesure a porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, le pourvoi de l’intéressé n’ayant pas été examiné au fond. Compte tenu de l’absence de but légitime déclaré, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de la mesure.
22. Ces considérations amènent la Cour à conclure que le droit du requérant à avoir accès à une juridiction de cassation a été méconnu.
23. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
VERMEERSCH c. BELGIQUE du 16 février 2021 Requête no 49652/10
Art 6 (civil) • Accès à un tribunal • Irrecevabilité pour prescription d’une demande de dommages et intérêts contre une autorité publique • Formalisme devant la Cour de cassation • Règles relatives à la recevabilité des pourvois en cassation, des mémoires ampliatifs et des moyens en cassation • Lacune non comblée par la Cour de Cassation • Règles ayant cessé de servir les buts de la « sécurité juridique » et de la « bonne administration de la justice »
CEDH
a) Principes généraux applicables
56. Les principes généraux relatifs au droit d’accès à un tribunal tel qu’il est garanti par l’article 6 § 1 de la Convention sont exposés dans l’arrêt Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, §§ 76-99, 5 avril 2018 ; voir aussi, Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, §§ 49-58, 20 octobre 2011, et Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, §§ 94-90 et 116, 29 novembre 2016).
57. En particulier, la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif et non pas théorique et illusoire. L’effectivité de l’accès au juge suppose qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres, précité, § 86).
58. La Cour rappelle qu’elle accorde une importance particulière au point de savoir si les règles portant restriction d’accès à un tribunal et, en particulier, les modalités d’exercice d’un recours sont prévisibles aux yeux du justiciable (mutatis mutandis, Zubac, précité, § 87, et, dans le même sens, Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, nos 65101/16 et 2 autres, § 106, 23 octobre 2018).
59. Le droit d’accès aux tribunaux n’étant toutefois pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, § 89, et Zubac, précité, § 78).
60. La Cour rappelle enfin que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Sauf si l’interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 149, 19 décembre 2018). Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 60, CEDH 2002‑IX).
b) Application au cas d’espèce
61. Le requérant allègue que les dispositions relatives à la prescription des créances à charge de l’État n’étaient pas claires et prévisibles lorsqu’il a introduit son recours en annulation devant le Conseil d’État. Cela a eu pour conséquence que son action en indemnisation a été déclarée irrecevable car prescrite, le requérant ayant attendu l’issue de la procédure devant le Conseil d’État avant d’introduire son action civile. Il soutient ensuite que l’arrêt de la Cour de cassation, en particulier le fait par celle-ci d’avoir rejeté son mémoire ampliatif et de n’avoir pas appliqué l’article 2244 du code civil tel que modifié par la loi du 25 juillet 2008, a constitué un formalisme excessif ayant porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Il allègue, en somme, que l’application des règles procédurales relatives à l’introduction d’un pourvoi en cassation l’ont empêché de bénéficier de la loi nouvelle du 25 juillet 2008 qui lui était favorable.
62. Le requérant soulève ainsi au regard de l’article 6 § 1 de la Convention deux griefs relatifs à la procédure civile qu’il a intentée en vue d’obtenir une indemnisation pour le dommage causé par un acte administratif annulé par le Conseil d’État. La Cour procédera à l’examen conjoint de ces griefs.
63. La Cour note d’abord que si le requérant n’était pas tenu d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État avant de saisir le juge civil pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État, ce recours pouvait néanmoins s’avérer utile. En effet, l’éventuelle annulation de l’acte administratif litigieux démontrait son illégalité, et donc, en principe, la faute de l’autorité concernée au sens de l’article 1382 du code civil. En revanche, le recours devant le Conseil d’État ne permettait pas, à l’époque des faits, d’obtenir une indemnisation pour le dommage subi du fait de l’acte administratif illégal (voir, sur ce point, paragraphe 15 ci-dessus). C’est pour cela que les deux recours coexistaient et se complétaient. Il ne peut donc pas être affirmé que ces deux voies de recours avaient pratiquement le même but (a contrario, Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 177, 25 juin 2019, et S.A. Bio d’Ardennes c. Belgique, no 44457/11, § 36, 12 novembre 2019).
64. En l’espèce, le requérant a attendu que le Conseil d’État se prononce sur son recours en annulation avant d’introduire son action en indemnisation. En raison de l’arriéré du Conseil d’État, celui-ci a rendu son arrêt huit ans après avoir été saisi par le requérant. L’action civile du requérant a dès lors été déclarée prescrite, le recours en annulation n’ayant, selon les juridictions internes, ni suspendu ni interrompu le délai de prescription.
65. La question se pose ainsi de savoir si, compte tenu de la loi en vigueur et de la jurisprudence des tribunaux, le requérant savait ou devait raisonnablement savoir que le délai de prescription de cinq ans pour l’introduction d’une action en réparation ne serait pas suspendu ou interrompu par la procédure devant le Conseil d’État lors de l’introduction de son recours en annulation en octobre 1996.
66. Au moment des faits litigieux, l’article 101 alinéa 2 des lois sur la comptabilité de l’État prévoyait que l’introduction d’une action en justice suspendait le délai de prescription des créances à charge de l’État (paragraphe 17 ci-dessus). Il ne précisait cependant pas quelles actions tombaient sous la notion « d’intentement d’une action en justice ». L’interprétation de cette disposition, et notamment la question de savoir si l’introduction d’un recours en annulation devant le Conseil d’État était considérée comme tel, était laissée aux juridictions.
67. La Cour ne partage pas l’avis du Gouvernement lorsqu’il affirme que sur cette question la loi et la jurisprudence étaient claires et prévisibles. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (paragraphe 28 ci-dessus) et des travaux préparatoires de la loi du 25 juillet 2008 (paragraphe 23 ci-dessus) qu’il existait une certaine incertitude sur la prescription de la créance à charge de l’autorité administrative en cause lorsque le requérant a introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État avant d’introduire une action en dommages et intérêts devant le juge civil. C’est d’ailleurs pour cela que beaucoup d’avocats conseillaient à leurs clients d’engager une action civile à titre conservatoire sans attendre l’issue de la procédure devant le Conseil d’État et en prenant le risque que cette action devienne inutile en cas de rejet de leur recours en annulation (paragraphe 23 ci-dessus).
68. La Cour relève que le fait que la jurisprudence n’était pas encore consolidée n’a pas été pris en compte par les juridictions ayant statué en la cause du requérant.
69. Les dispositions des lois sur la comptabilité de l’État telles qu’interprétées par les juridictions civiles inférieures à l’époque des faits n’empêchaient ainsi pas la survenance de malentendus quant aux modalités de l’exercice combiné des deux recours, respectivement en annulation et en dommages et intérêts, offerts par le droit belge.
70. La Cour note toutefois que l’incertitude sur l’état du droit ne portait pas sur le calcul du délai pour l’introduction d’une action en dommages et intérêts contre une personne de droit public comme la Région flamande en tant que tel, mais seulement sur les actes pouvant mener à la suspension ou l’interruption de ce délai et, en particulier, sur la notion « d’intentement d’une action en justice ».
71. La Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur cette question dans des arrêts du 16 février 2006 (paragraphe 20 ci‑dessus), mettant fin à l’incertitude juridique. Il ne s’agissait pas d’un revirement de jurisprudence, tel que l’allègue le requérant, puisque c’était la première fois que la Cour de cassation était appelée à se prononcer sur la question de savoir si l’introduction d’un recours en annulation devant le Conseil d’État suspendait ou interrompait le délai de prescription pour l’introduction d’une demande en indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Or le rôle d’une juridiction suprême est précisément de régler les éventuelles contradictions ou incertitudes résultant d’arrêts contenant des interprétations divergentes (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, précité, § 123, et les affaires qui y sont citées).
72. Compte tenu, d’une part, de la clarté du délai de prescription de cinq ans, et d’autre part, des divergences dans la jurisprudence des juridictions civiles inférieures au sujet de la suspension ou de l’interruption éventuelle de ce délai par l’introduction d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, la Cour estime que le requérant ne pouvait pas partir du principe que les juridictions civiles déclareraient recevable une demande introduite plus de cinq ans après le 1er janvier 1996 (voir et comparer avec Allègre c. France, no 22008/12, § 60, 12 juillet 2018).
73. La Cour note ensuite que la position prise par la Cour de cassation dans ses arrêts du 16 février 2006, défavorable aux justiciables qui étaient victimes de la longueur des procédures devant le Conseil d’État, a amené le législateur à modifier le droit applicable (paragraphes 24 et suivants ci‑dessus).
74. Les dispositions de cette loi prévoient explicitement qu’un recours en annulation d’un acte administratif devant le Conseil d’État a, à l’égard de l’action en réparation du dommage causé par l’acte administratif dont l’annulation est demandée, les mêmes effets interruptifs de la prescription qu’une citation en justice devant les juridictions de l’ordre judiciaire (paragraphes 24 et 25 ci-dessus). Le législateur souhaitait ainsi se départir de la position adoptée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 16 février 2006, position qui était également celle adoptée par les juridictions du fond dans l’affaire du requérant.
75. La Cour note enfin que la loi du 25 juillet 2008 est entrée en vigueur alors que le pourvoi en cassation du requérant était pendant devant la Cour de cassation (paragraphe 12 ci-dessus).
76. Tel que cela ressort du texte de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2008 (paragraphe 26 ci-dessus) et de l’interprétation donnée à cette disposition par la Cour constitutionnelle (paragraphes 28 et 29 ci-dessus), les dispositions modifiées par la loi du 25 juillet 2008 avaient vocation à s’appliquer de manière rétroactive aux situations telles que celles du requérant pourvu qu’il n’y ait pas encore de décision définitive déclarant l’action civile prescrite.
77. Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation était la seule juridiction compétente pour encore se prononcer sur la demande du requérant après l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 2008 et, le cas échéant, appliquer cette loi qui était favorable au requérant (a contrario, Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 48, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, Mohr c. Luxembourg (déc.), no 29236/95, 20 avril 1999, Papaioannou c. Grèce, no 18880/15, 2 juin 2016, et Zubac, précité, § 125).
78. Or il apparaît qu’alors que l’intention du législateur était de rendre la loi du 25 juillet 2008 immédiatement applicable aux affaires en cours, y compris les affaires telles que la présente dans laquelle un pourvoi en cassation était encore pendant, cet objectif n’a pas pu être réalisé en pratique en raison des règles procédurales applicables à l’introduction d’un pourvoi en cassation.
79. Sur ce point, la Cour rappelle que l’observation de règles formelles de procédure civile, qui permettent aux parties de faire trancher un litige, est utile et importante, car elle est susceptible de limiter le pouvoir discrétionnaire, d’assurer l’égalité des armes, de prévenir l’arbitraire, de permettre qu’un litige soit tranché et jugé de manière effective et dans un délai raisonnable, et de garantir la sécurité juridique et le respect envers le tribunal (Zubac, précité, § 96). Toutefois, le droit d’accès à un tribunal peut se trouver atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Zubac, précité, § 98).
80. En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté le mémoire ampliatif du requérant au motif que celui-ci avait été déposé en dehors du délai prévu par l’article 1087 du code judiciaire (paragraphe 14 ci-dessus). Ce faisant, la Cour de cassation a appliqué le code judiciaire qui prévoit que tous les moyens en cassation doivent être invoqués dans la requête ou dans un mémoire ampliatif lequel doit être déposé au plus tard 15 jours après la signification du pourvoi en cassation (paragraphe 34 ci-dessus).
81. Les règles de procédure devant la Cour de cassation telles que prévues par le code judiciaire étaient claires et prévisibles, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par le requérant. La Cour considère en outre que ces règles visent en général la bonne administration de la justice dans la mesure où, tel que l’explique le Gouvernement, elles visent la concentration et la célérité de l’échange des écritures des parties.
82. Toutefois, il apparaît qu’aucune disposition du code judiciaire ne permettait à un demandeur en cassation de faire valoir un moyen nouveau tiré de la violation d’une disposition légale applicable aux litiges en cours si cette disposition était entrée en vigueur alors que son pourvoi était pendant devant la Cour de cassation et que le délai pour la soumission d’un mémoire ampliatif avait expiré, et cela, même s’il s’agissait de donner effet à une loi rétroactive.
83. Or en l’espèce, la Cour est d’avis que le requérant a fait ce qu’il pouvait dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation compte tenu des règles procédurales en vigueur. En effet, dans sa requête en cassation, il avait déjà fait mention de la proposition de loi qui était en cours d’examen par le parlement et il s’était réservé la possibilité d’invoquer un moyen nouveau si la loi proposée entrait en vigueur en cours de procédure (paragraphe 11 ci‑dessus). Puis, environ un mois après l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 2008, il a déposé un mémoire ampliatif dans lequel il a explicitement demandé que les dispositions de la loi nouvelle lui soient appliquées et argué que ce mémoire devait être déclaré recevable en l’espèce, malgré l’expiration du délai prévu par l’article 1087 du code judiciaire (paragraphe 13 ci-dessus). Le requérant a ainsi fait preuve de diligence (voir, dans le même sens, Gil Sanjuan c. Espagne, no 48297/15, § 43, 26 mai 2020 et, a contrario, Rodriguez Valin c. Espagne, no 47792/99, § 28, 11 octobre 2001).
84. Le Gouvernement allègue que le requérant aurait pu se désister de son pourvoi en cassation pour introduire un nouveau pourvoi à l’appui duquel il aurait pu invoquer les dispositions de la loi du 25 juillet 2008 (paragraphe 53 ci-dessus). La Cour estime toutefois qu’on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir procédé de cette façon. En effet, le désistement du pourvoi déjà introduit et l’introduction d’un nouveau pourvoi lui auraient fait perdre l’avantage du premier pourvoi et l’auraient obligé à supporter des frais supplémentaires. La Cour note par ailleurs que la démarche suggérée n’était en tout cas possible qu’aussi longtemps que le délai de trois mois pour se pourvoir en cassation (paragraphe 32 ci-dessus) n’avait pas expiré, d’où il suit qu’elle dépendait entièrement de la signification ou non de l’arrêt de la cour d’appel, à la requête de la Région flamande.
85. La Cour estime que le droit d’accès à un tribunal exigeait, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le requérant pût inviter la Cour de cassation à se prononcer sur l’incidence de l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 2008 sur la légalité de l’arrêt qu’il avait attaqué devant elle. Il en était ainsi eu égard au fait que les dispositions de cette loi avaient un effet rétroactif et étaient d’application dans les litiges en cours, sauf s’il y avait déjà eu une décision passée en force de chose jugée (comme une décision rendue par une instance d’appel) et contre laquelle un pourvoi en cassation n’avait pas été introduit.
86. Ainsi, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour conclut que la présente affaire a fait apparaître une lacune dans les règles relatives à la recevabilité des pourvois en cassation, des mémoires ampliatifs et des moyens en cassation, règles qui ne sont pas en soi contraires à l’article 6 § 1. Il peut en effet y avoir des cas exceptionnels où, alors qu’un pourvoi en cassation est pendant, une loi entre en vigueur qui est immédiatement applicable aux instances en cassation et dont le demandeur en cassation peut de manière défendable faire valoir qu’elle a des conséquences pour la solution du litige devant la Cour de cassation.
87. Comme illustré par la présente affaire, un moyen fondé sur une telle loi nouvelle ne peut pas être soumis à la Cour de cassation. Cette lacune n’a pas été comblée par la Cour de cassation qui, en se référant au caractère d’ordre public des règles de procédure précitées, a considéré que ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable ne justifiaient de s’en écarter. En toute hypothèse, si une autre interprétation des dispositions procédurales n’était pas légalement possible, le système légal belge ne permettait pas au requérant de soumettre utilement à la Cour de cassation le moyen tiré de la nouvelle loi. Il en a résulté une situation qui n’était pas adaptée aux circonstances particulières de l’espèce (dans le même sens, mutatis mutandis, Gajtani c. Suisse, no 43730/07, § 75, 9 septembre 2014).
88. Dans ces circonstances, la Cour estime que la réglementation a cessé de servir les buts de la « sécurité juridique » et de la « bonne administration de la justice ». Combinée à l’incertitude juridique relative à la suspension et l’interruption du délai de prescription par l’introduction d’un recours en annulation telle qu’elle existait à l’époque des faits, cette réglementation a constitué une sorte de barrière qui a empêché le requérant de voir son litige tranché au fond. Son droit d’accès à un tribunal s’est donc trouvé atteint dans sa substance même.
89. Ce constat suffit à conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
90. La Cour est consciente du fait que, par un arrêt rendu le 3 septembre 2010, c’est-à-dire postérieurement au prononcé de l’arrêt rendu dans l’affaire du requérant, la Cour de cassation a examiné un moyen alléguant la violation des dispositions modifiées par la loi du 25 juillet 2008 par un arrêt rendu avant l’entrée en vigueur de celle-ci (paragraphe 30 ci-dessus). La Cour de cassation y a précisé que la loi nouvelle n’avait pas d’incidence sur la légalité de la décision judiciaire rendue sous l’empire de la loi ancienne. Il est très probable que si le moyen invoqué par le requérant dans son mémoire ampliatif avait été examiné par la Cour de cassation, il aurait été rejeté pour le même motif. Une telle décision aurait pu soulever d’autres questions sous l’angle du droit d’accès à un tribunal. Toutefois, comme cette hypothèse ne s’est pas présentée en l’espèce, la Cour estime qu’il ne lui incombe pas de se prononcer sur celle-ci.
Sultan c. République de Moldava du 5 juin 2018 requête n° 17047/07
Article 6-1 pour non accès à la Cour suprême : La CEDH constate que le Gouvernement a reconnu dans ses observations que le greffe de la Cour suprême avait commis une erreur en renvoyant le recours sans qu’il soit examiné par la haute juridiction. L’omission de la Cour suprême de justice d’examiner le recours susmentionné a privé le requérant du droit d’accès à cette juridiction en vue de faire examiner son recours par elle.
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il argue que, après avoir reçu la lettre de la Cour suprême de justice du 7 novembre 2006 (paragraphe 9 ci-dessus), le requérant aurait dû réitérer sa demande de recours en vertu de l’article 438 (3) du CPC (paragraphe 10 ci‑dessus). Il ajoute que, selon la législation en vigueur au moment des faits, l’instance judiciaire avait le droit de renvoyer le recours par lettre si la demande n’était pas conforme aux dispositions légales, sans adopter de décision ou de jugement avant dire droit en ce sens. Il indique que le courrier n’avait pas été porté à l’attention d’une formation judiciaire de la Cour suprême de justice mais qu’il avait été signé par un juge président de section en tant que correspondance à caractère administratif et non judiciaire. Il estime que le requérant avait la possibilité soit de réintroduire sa demande de recours, soit de signaler à la Cour suprême de justice l’erreur commise par le personnel du greffe. En conclusion, le Gouvernement soutient que cette situation résulte d’une simple erreur administrative au sein du greffe et ne représente en aucun cas une pratique établie par la Cour suprême.
13. Le requérant affirme s’être prévalu d’un recours effectif devant la Cour suprême de justice mais que celle-ci a refusé de l’examiner.
14. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Remli c. France, 23 avril 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V, et Vučković et autres c. Serbie, no 17153/11 et 29 autres requêtes, § 68, 28 août 2012). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI).
15. Cependant, l’obligation découlant de l’article 35 de la Convention se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement effectifs, suffisants et accessibles (voir, parmi beaucoup d’autres, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 45, CEDH 2006‑II). En particulier, la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Paksas c. Lituanie [GC], no 34932/04, § 75, CEDH 2011 (extraits)). Il incombe à l’État défendeur, s’il plaide le non-épuisement, de démontrer que ces conditions se trouvaient réunies à l’époque des faits (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil 1996‑IV, Selmouni, précité, § 75, et Vučković et autres, précité, § 69).
16. En l’espèce, la Cour constate que, par sa lettre du 7 novembre 2006, la Cour suprême a informé le requérant que la décision de la cour d’appel était passée en force de chose jugée et qu’elle n’était plus susceptible de recours devant la Cour suprême de justice (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour suprême n’a informé le requérant d’aucune omission au sens de l’article 438 (3) du CPC, invoqué par le Gouvernement, ni de la possibilité de réitérer sa demande de recours. La Cour constate ensuite que le Gouvernement admet dans ses observations qu’une erreur s’était produite au sein du greffe de la Cour suprême.
17. La Cour constate également que le requérant a formé un recours contre la décision de la cour d’appel en vertu des dispositions du CPC et que la lettre de la Cour suprême de justice était signée par sa vice-présidente et non pas par un simple membre du greffe (paragraphe 9 ci-dessous). Elle considère que, dans ces circonstances, le requérant n’était pas tenu de réitérer sa demande de recours, ni de signaler à la Cour suprême l’erreur commise par le personnel du greffe. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes.
18. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
19. Le requérant soutient qu’il avait le droit de former un recours contre la décision rendue en appel le 5 septembre 2006 par la cour d’appel de Chișinău. Il ajoute que l’affaire n’a pas été traitée dans le cadre de la procédure du contentieux administratif et que la Cour suprême n’avait pas le droit de lui renvoyer son recours.
20. Le Gouvernement ne se prononce pas sur le fond de l’affaire.
21. La Cour rappelle que les garanties de procédure énoncées à l’article 6 de la Convention assurent à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; l’article 6 consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, §§ 28-36, série A no 18). En l’espèce, force est de constater que le requérant a pu emprunter la voie de recours qu’offrait le système judiciaire interne, à savoir une action civile en dommages et intérêts dirigée contre la mairie et le conseil local de Holercani.
22. En soi, cela ne satisfait pas à tous les impératifs de l’article 6 § 1 de la Convention : encore faut-il constater que le degré d’accès procuré par la législation nationale suffisait pour assurer à l’individu le « droit à un tribunal », eu égard au principe de la « prééminence du droit » dans une société démocratique (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A no 93). La Cour rappelle que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32, et García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 43, CEDH 2000-II).
23. À cet égard, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention garantit le droit d’accès à un tribunal pour la résolution de différends à caractère civil. La Cour estime que ce droit d’accès à un tribunal comprend non seulement le droit d’engager une action, mais aussi le droit à une « solution » juridictionnelle du litige. Il serait illusoire que l’ordre juridique interne d’un État contractant permette qu’un individu engage devant un tribunal une action au civil sans veiller à ce que la cause fasse l’objet d’une décision définitive à l’issue de la procédure judiciaire (Kutić c. Croatie, no 48778/99, § 25, CEDH 2002‑II).
24. La Cour rappelle également que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6. De graves conséquences risqueraient de découler de la solution contraire. Dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’article 6 § 1 ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition (voir, entre autres, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no11).
25. En l’espèce, la Cour observe que l’affaire a été examinée au fond par le tribunal de Dubăsari et en appel par la cour d’appel de Chișinău. La Cour note ensuite que, selon le droit moldave, le requérant avait la possibilité de contester la décision de la cour d’appel et qu’il s’en est prévalu en formant un recours contre ladite décision devant la Cour suprême de justice (paragraphe 8 ci-dessus). La Cour constate en outre que le Gouvernement a reconnu dans ses observations que le greffe de la Cour suprême avait commis une erreur en renvoyant le recours sans qu’il soit examiné par la haute juridiction. En effet, l’omission de la Cour suprême de justice d’examiner le recours susmentionné a privé le requérant du droit d’accès à cette juridiction en vue de faire examiner son recours par elle (voir, par exemple, Platakou c. Grèce, no 38460/97, §§ 36-39, CEDH 2001‑I, Anghel c. Italie, no 5968/09, § 61, 25 juin 2013, et Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, §§ 61-62, CEDH 2015; et comparer avec Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 90-95 et 114-121, 5 avril 2018 ).
26. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
CİHANGİR YILDIZ c. TURQUIE du 17 avril 2018 Requête n° 39407/03
Violation de l'article 6-1 : Les documents sont déclarés irrecevables par le Conseil d'État qui les rejette.
"48. Néanmoins, rien n’indique que, en l’espèce, l’absence de prise en compte des documents litigieux soit la conséquence de l’application d’une telle règle d’irrecevabilité, ni même qu’une telle règle existe en pratique, contrairement à ce que le Gouvernement semble soutenir. Sur ces points, la Cour constate d’ailleurs que le Conseil d’État n’a pas indiqué que ces documents avaient été soumis de façon tardive et qu’ils ne pouvaient, de ce fait, être pris en compte.
49. Dès lors, même à supposer, comme le suggère le Gouvernement, que le Conseil d’État ait implicitement considéré les documents présentés à un stade avancé de la procédure comme irrecevables et ne pouvant être pris en compte, la haute juridiction n’a exposé aucun motif pour justifier une telle approche et n’a pas répondu au principal moyen de pourvoi du requérant."
CEDH
39. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention, les décisions des cours et des tribunaux doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, de manière à montrer que les parties ont été entendues et à garantir la possibilité d’un contrôle public de l’administration de la justice (Salov c. Ukraine, no 65518/01, § 89, CEDH 2005‑VIII (extraits)).
40. Bien qu’une juridiction interne dispose d’une certaine marge d’appréciation dans le choix des arguments et l’admission des preuves, elle doit justifier ses activités en précisant la motivation de ses décisions (Suominen c. Finlande, no 37801/97, §36, 1er juillet 2003).
41. Si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cela ne signifie pas qu’il exige une réponse détaillée à chaque argument (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288). L’étendue de l’obligation de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce : il faut tenir compte notamment de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les États contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts (Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 27, série A no 303-B).
42. Toutefois, dès lors qu’un argument soulevé par une partie est décisif pour l’issue de la procédure, il exige une réponse spécifique et explicite (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 30, série A no 303‑A, Buzescu c. Roumanie, no 61302/00, § 67, 24 mai 2005, et Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, § 35, 7 mars 2006).
43. En l’espèce, la Cour observe que l’objet de la procédure devant les juridictions administratives était de déterminer si le requérant pouvait prétendre à l’attribution d’un terrain. Pour trancher cette question, il fallait déterminer si le requérant avait bien présenté une demande d’amnistie pour infraction urbanistique à la mairie métropolitaine d’Ankara en 1983. Si cette administration a indiqué avoir reçu une telle demande le 6 avril 1983 et fourni une copie du registre concerné (paragraphe 14 ci-dessus), le tribunal administratif a finalement estimé que, en l’absence notamment d’une copie du formulaire de demande et d’un reçu bancaire, la réalité de la demande n’était pas établie, et a rejeté l’action pour ce motif.
44. Elle observe également que le principal moyen de pourvoi du requérant consistait en substance à reprocher au tribunal administratif de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires pour obtenir des administrations concernées la production de l’ensemble des documents pouvant permettre de vérifier les allégations de l’intéressé quant au dépôt d’une demande d’amnistie en bonne et due forme en 1983, ni d’avoir pris une quelconque mesure d’instruction susceptible d’infirmer ou de confirmer l’allégation de la mairie de Çankaya au sujet de la prétendue falsification du registre des demandes d’amnistie (voir paragraphe 24 ci-dessus).
Dans ce cadre, en fournissant les documents qu’il avait pu se procurer entre-temps, le requérant entendait démontrer que s’il avait procédé aux démarches nécessaires, le tribunal administratif aurait disposé de ces documents qui infirmaient les allégations de l’administration défenderesse et confirmaient les siennes.
45. Or, la Cour observe que le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur ce moyen, bien qu’il ait été invité à le faire à deux reprises, une fois par le parquet général et une fois le magistrat rapporteur. La haute juridiction n’a donc pas répondu à l’un des arguments essentiels exposés par le requérant.
46. La Cour relève toutefois que les documents précités ont été présentés au moment du pourvoi et que le Gouvernement soutient que le Conseil d’État ne pouvait de ce fait les prendre en compte.
47. À cet égard, la Cour rappelle que l’admissibilité des éléments de preuve relève normalement de la compétence des autorités nationales (Gerö Almeida Freitas c. Portugal (déc.), no 81375/12, 28 novembre 2017) et estime que, en principe, un système prévoyant l’irrecevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois en cassation n’est pas en soi contraire à la Convention.
48. Néanmoins, rien n’indique que, en l’espèce, l’absence de prise en compte des documents litigieux soit la conséquence de l’application d’une telle règle d’irrecevabilité, ni même qu’une telle règle existe en pratique, contrairement à ce que le Gouvernement semble soutenir. Sur ces points, la Cour constate d’ailleurs que le Conseil d’État n’a pas indiqué que ces documents avaient été soumis de façon tardive et qu’ils ne pouvaient, de ce fait, être pris en compte.
49. Dès lors, même à supposer, comme le suggère le Gouvernement, que le Conseil d’État ait implicitement considéré les documents présentés à un stade avancé de la procédure comme irrecevables et ne pouvant être pris en compte, la haute juridiction n’a exposé aucun motif pour justifier une telle approche et n’a pas répondu au principal moyen de pourvoi du requérant.
50. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, la Cour estime que des arguments essentiels présentés par le requérant n’ont pas reçu de réponse spécifique et explicite alors qu’ils l’auraient méritée, et que la solution donnée au litige ne peut, de ce fait, passer pour avoir été suffisamment motivée.
51. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
STURM c. LUXEMBOURG du 27 juin 2017 Requête no 55291/15
Article 6 : La réforme à minima du pourvoir en cassation, inspirée par l'article 978 du CPC français pour imposer le triptyque du cas d’ouverture invoqué, de la partie critiquée de la décision et ce en quoi elle encourt le reproche allégué, est conforma à la Convention.
LES FAITS
5. Il ressort de l’exposé des motifs du projet de loi no 6108 ayant abouti à la loi du 3 août 2010 que la réforme de la loi de 1885 faisait suite aux critiques formulées par la Cour dans son arrêt Kemp et autres c. Luxembourg (no 17140/05, 24 avril 2008). Les passages pertinents en l’espèce du rapport de la commission juridique de la Chambre des Députés sur ledit projet de loi se lisaient comme suit :
« (...) Le présent projet de loi entend tirer les conséquences de [l’arrêt Kemp et autres], même si ses auteurs annoncent dès le départ qu’il s’agit d’une „réforme a minima“ (...).
(...)
Dans le souci d’éviter d’autres condamnations du Luxembourg par la CEDH, il est proposé d’insérer, à l’endroit de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un nouvel alinéa 2 insérant trois précisions obligatoires qui devront figurer dans chaque moyen ou élément de moyen (inspirées de l’article 978 du Nouveau code de procédure civile français) et un nouvel alinéa 3 comportant une référence au développement du moyen. Le cadre législatif relatif au pourvoi en cassation est ainsi davantage précisé.
(...)
Sous peine d’irrecevabilité, le moyen de cassation devra indiquer le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi elle encourt le reproche allégué. Ces précisions remplacent ce que la CEDH a pu considérer comme un aléa pour le justiciable par un cadre législatif clairement déterminé, qui rend les décisions à intervenir plus prévisibles.
En outre, le nouvel article 10 admet désormais explicitement que l’énoncé du moyen puisse être complété par des développements en droit qui sont pris en considération. (...) »
16. Le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable et à l’accès à un tribunal. Il reproche à la Cour de cassation d’avoir déclaré irrecevables les quatorze moyens soulevés dans le cadre de son pourvoi sans avoir pris en considération les développements qui complétaient leurs énoncés, et ce alors que, selon lui, elle s’était précédemment départie de la rigueur formaliste excessive qui aurait été appliquée à son cas.
17. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner les allégations du requérant uniquement sous l’angle de la question de l’accès à un tribunal.
LE DROIT
a) Rappel des principes applicables
28. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000‑II). Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours (Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Les intéressés doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et 9 autres, § 33, CEDH 2000‑I, et Tziovanis et autres c. Grèce, no 27462/09, § 29, 19 janvier 2017).
29. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo, précité, § 36, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37, Recueil 1998‑V).
30. La compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause. Il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y joue la juridiction de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (voir, entre autres, Khalfaoui c. France, no 34791/97, § 37, CEDH 1999‑IX, et Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 62, 12 novembre 2002).
31. La tâche de la Cour consiste à vérifier si le rejet pour irrecevabilité du pourvoi en cassation n’a pas porté atteinte à la substance même du « droit » du requérant « à un tribunal ». Pour ce faire, la Cour recherchera d’abord si les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation poursuivaient un but légitime, pour se pencher ensuite sur la proportionnalité de la limitation imposée (voir, parmi beaucoup d’autres, Papaioannou, précité, § 49, et Trevisanato, précité, § 35).
b) Application des principes en l’espèce
32. La Cour constate que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant par application de l’article 10 de la loi de 1885. Celle-ci constatait qu’il manquait dans chacun des quatorze moyens de cassation des éléments dont la précision était requise sous peine d’irrecevabilité. Elle jugeait que les « développements en droit » ne pouvaient pas pallier cette carence originaire des moyens.
33. Pour analyser si cette manière d’appliquer l’article 10 de la loi de 1885 se concilie avec l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour juge utile de rappeler d’abord la genèse de la nouvelle formulation de cette disposition.
34. Dans l’affaire Kemp et autres (précitée), la Cour avait constaté que l’article 10 de la loi de 1885, tel qu’en vigueur à l’époque, se bornait à prévoir que, pour introduire un pourvoi en cassation, l’intéressé devait déposer au greffe de la Cour de cassation « un mémoire (...) lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée ». La règle telle qu’elle était appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur le caractère recevable du pourvoi en cause était une construction jurisprudentielle (Kemp et autres, précité, § 52). La Cour avait conclu que la limitation imposée par cette règle jurisprudentielle n’était pas proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice (idem, §§ 53 et 60). Cette conclusion a été confirmée dans trois autres arrêts (Dattel c. Luxembourg (no 2), no 18522/06, § 44, 30 juillet 2009, Nunes Guerreiro c. Luxembourg, no 33094/07, § 38, 5 novembre 2009, et Ewert c. Luxembourg, no 49375/07, § 94, 22 juillet 2010). Dans un autre arrêt, en revanche, la Cour a constaté que le requérant avait omis de soumettre à la connaissance de la Cour de cassation ses doléances à l’égard de l’arrêt de la Cour d’appel attaqué, et elle a conclu que « rejeter le moyen de cassation au motif qu’il n’avait pas été articulé avec la précision requise ne s’inscri[vai]t pas dans une approche trop formaliste » (Petrovic c. Luxembourg, no 32956/08, § 32, 17 février 2011).
35. À la suite de l’arrêt Kemp et autres (précité), la procédure en cassation luxembourgeoise a été réformée en 2010.
Ainsi, un deuxième alinéa a été inséré à l’article 10 de la loi de 1885. Cette nouvelle disposition, inspirée de l’article 978 du code de procédure civile français, énumère trois précisions qui doivent obligatoirement figurer dans chaque moyen. Dorénavant, sous peine d’irrecevabilité, le moyen de cassation doit indiquer « le cas d’ouverture invoqué », « la partie critiquée de la décision » et « ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ». Le rapport de la commission juridique de la Chambre des Députés sur le projet de loi ayant abouti à la réforme de 2010 explique que « ces précisions remplacent ce que la [Cour] a pu considérer comme un aléa pour le justiciable par un cadre législatif clairement déterminé, qui rend les décisions à intervenir plus prévisibles ».
36. La Cour considère que la limitation imposée par cette disposition législative poursuit un but légitime. En effet, la précision exigée dans la formulation des moyens de cassation a pour objectif de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle en droit, et elle obéit aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, Trevisanato, précité, § 37).
37. Il reste à savoir si cette exigence de précision a répondu, en l’espèce, à la condition de la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Pour cela, la Cour examinera de quelle manière le requérant a présenté son grief à la Cour de cassation et pour quelles raisons son pourvoi a été rejeté.
38. Pour chacun des quatorze moyens de cassation présentés par le requérant, la Cour note que l’énoncé indiquait « le cas d’ouverture invoqué » et qu’ensuite une partie « développement du moyen » contenait les critiques portées contre l’arrêt de la Cour d’appel (paragraphe 8 ci‑dessus).
La Cour de cassation, se basant sur le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi de 1885, n’a pas admis cette manière de présenter les moyens. Après avoir constaté que chacun des quatorze moyens se limitait à indiquer le « cas d’ouverture invoqué », elle a jugé que les « développements en droit » ne pouvaient pas pallier cette carence originaire des moyens (paragraphe 13 ci-dessus).
39. La Cour observe que le texte de l’article 10 de la loi de 1885, tel qu’il résulte de la réforme de 2010, est clair, puisque le deuxième alinéa énumère désormais, sans ambiguïté, les trois précisions qui sont exigées « sous peine d’irrecevabilité » (voir, a contrario, Miessen c. Belgique, no 31517/12, § 69, 18 octobre 2016). Certes, le troisième alinéa de l’article 10 de la loi de 1885 indique que « l’énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération », et la Cour n’ignore pas que le parquet général avait considéré que le fait que les moyens ne respectaient pas strictement les critères dudit article ne devrait pas porter à conséquence en l’espèce. Toutefois, eu égard aux termes clairs du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi de 1885, il n’apparaît pas excessif qu’une cour suprême juge que les « développements en droit » peuvent être pris en considération lorsqu’ils complètent un moyen qui se suffit en lui-même, mais qu’ils ne peuvent remplacer un moyen qui ne respecte pas les exigences prévues en amont et sous peine d’irrecevabilité. La Cour peut ainsi admettre, avec le Gouvernement, qu’en l’espèce la Cour de cassation n’a fait qu’appliquer à la lettre l’article 10 de la loi de 1885 et que, contrairement à ce que prétend le requérant, elle n’a pas agi en non-conformité avec cet article ni sur le fondement d’une construction jurisprudentielle.
40. La Cour est d’avis que, en s’appuyant sur le libellé suffisamment clair du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi de 1885, le conseil professionnel du requérant était en mesure de connaître et prévoir ses obligations en la matière. Il est vrai que le Luxembourg ne connaît pas le système des avocats aux Conseils spécialisés. Il ressort cependant des travaux préparatoires de la loi ayant abouti à la réforme en 2010 que les trois précisions requises selon le deuxième alinéa « sous peine d’irrecevabilité » (à savoir que chaque moyen doit contenir « le cas d’ouverture invoqué », « la partie critiquée de la décision » et « ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ») ont justement été introduites pour permettre aux auteurs de pourvois de ne pas se tromper sur les obligations procédurales en la matière. Dans ces conditions, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire ni de formalisme excessif dans le raisonnement par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant.
41. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, il n’y a pas eu atteinte à la substance de ce droit.
42. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
Arrêt TREVISANATO c. ITALIE du 15 septembre 2016, requête 32610/07
Non violation de l'article 6-1 de la Convention, le pourvoi en cassation du requérant a été jugé non admis, en application d'une nouvelle règle suffisamment connue puisque déjà ancienne et qui ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des justiciables.
32. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000‑II). Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours (Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Les intéressés doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, §§ 33, CEDH 2000-I).
33. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, précité, § 36, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir l’arrêt Guérin c. France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 37).
34. La compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 dépend des particularités de la procédure en cause. Il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y joue la juridiction de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (voir, entre autres, Khalfaoui c. France, no 34791/97, § 37, CEDH 1999-IX, et Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 62, 12 novembre 2002).
35. La Cour rappelle que sa tâche consiste à vérifier si le rejet pour irrecevabilité du pourvoi en cassation n’a pas porté atteinte à la substance même du « droit » du requérant « à un tribunal ». Pour ce faire, elle recherchera, d’abord, si les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation poursuivaient un but légitime, se penchant ensuite sur la proportionnalité de la limitation imposée (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, et Papaioannou c. Grèce, no 18880/15, § 49, 2 juin 2016).
36. En ce qui concerne la finalité de cette disposition, la Cour prend note de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure au pourvoi du requérant (voir paragraphe 23), selon laquelle la question en droit représentait le point de jonction entre la solution du cas spécifique et la formulation d’un principe juridique général applicable à des cas similaires. Le but de cet article était donc à la fois de protéger l’intérêt de la partie à obtenir, le cas échéant, la réforme de la décision attaquée et de préserver la fonction de la Cour de cassation dans son rôle de juge de l’interprétation uniforme de la loi.
37. Par conséquent, la Cour estime que la limitation imposée par l’article 366bis CPC poursuivait un but légitime, en obéissant tout à la fois aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice (Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 53, 24 avril 2008).
38. Reste à savoir si cette exigence de précision répond, en l’espèce, à la condition de la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I). En effet, la Cour a déjà conclu à plusieurs reprises qu’une interprétation par trop formaliste des conditions de forme d’un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal (Běleš et autres c. République tchèque, précité, § 69, Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX, et Viard c. France, no 71658/10, § 38, 9 janvier 2014). La Cour examinera donc, d’une part, de quelle manière le requérant présenta son grief à la Cour de cassation, et, d’autre part, pour quelles raisons son pourvoi fut rejeté.
39. Dans son mémoire en cassation, le requérant se plaignit d’une violation ou mauvaise application des dispositions de la loi no 223/1991. Il argua notamment que l’exclusion du champ d’application de cette loi de la catégorie des dirigeants était contraire à la directive CE 98/59 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs. Pour ce faire, il s’appuya en particulier sur un arrêt de la CJUE.
40. À conclusion de son unique moyen, le requérant ne formula pas la question en droit dans laquelle il aurait dû indiquer le principe de droit qu’il assumait violé. Dans ses conclusions, après avoir résumé son raisonnement, il invita la Cour de cassation à infirmer la décision de la cour d’appel de Milan et à formuler le principe de droit à appliquer dans la procédure de renvoi.
41. La Cour de cassation rejeta le pourvoi faute de formulation adéquate et appropriée d’une question en droit permettant l’identification du contenu du pourvoi et le raisonnement de la partie. Elle rappela, en outre, sa jurisprudence consolidée en la matière, selon laquelle si la question en droit pouvait être déduite de la formulation du moyen de cassation, une telle interprétation produirait une abrogation implicite de la condition de recevabilité des pourvois en cassation prévue à l’article 366bis CPC.
42. La Cour relève que le pourvoi du requérant manque en effet d’une question en droit à conclusion du moyen de cassation, tel que demandée par l’article susmentionné et dont la finalité répond à une exigence légitime (voir paragraphe § 37 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, le fait de demander au requérant de conclure son moyen de cassation avec un paragraphe de synthèse, résumant le raisonnement suivi et explicitant le principe de droit qu’il assume violé, n’aurait requis aucun effort particulier ultérieur de la part de ce dernier. Partant, la décision d’irrecevabilité ne saurait passer pour une interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire empêchant, effectivement, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (voir, a contrario, Kemp et autres, précité, § 59 ; RTBF c. Belgique, no 50084/06, § 71, CEDH 2011 (extraits)).
43. En outre, contrairement à ce que la Cour a constaté dans l’arrêt Běleš et autres (précité, § 63), en l’espèce le requérant et son avocat pouvaient préalablement évaluer les chances de voir leur pourvoi en cassation admis, la recevabilité de celui-ci dépendant d’une jurisprudence interne fournie. En effet, la Cour de cassation demandait la formulation explicite d’une question en droit, à conclusion de chaque moyen, qui devait être la « clé de lecture des raisons présentées (...) et permettre à la Cour (de cassation) de répondre à celle-ci en fixant la « regula iuris » (...) susceptible de trouver application dans des cas similaires » (voir paragraphe 23 ci-dessus).
44. La Cour relève que la règle appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur la recevabilité du pourvoi n’est pas de construction jurisprudentielle mais introduite par le législateur à travers l’article 366bis du code de procédure civile (voir, a contrario, Kemp et autres, précité, § 52, et Dattel c. Luxembourg (no 2), no 18522/06, § 37, 30 juillet 2009).
45. Sur ce point, la Cour observe également que la nouvelle condition de recevabilité avait été introduite le 2 février 2006, bien avant la présentation, le 13 novembre 2007, du pourvoi litigieux. Le conseil du requérant était donc en mesure de connaître ses obligations en la matière, en s’appuyant sur le libellé de l’article susmentionné et à l’aide de l’interprétation de la Cour de cassation, laquelle présentait une clarté et une cohérence suffisantes (voir Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). La Cour rappelle par ailleurs que les avocats attitrés à représenter les parties devant la Cour de cassation italienne doivent obligatoirement être inscrits dans une liste spéciale sur la base de certaines qualités requises (voir, a contrario, Dattel c. Luxembourg (no 2), précité, § 43).
46. Enfin, la Cour ne saurait douter de l’affirmation du Gouvernement défendeur selon laquelle l’abrogation de l’article susmentionné, faite par la loi no 69 du 18 juin 2009, résulte de la réorganisation de la procédure devant la Cour de cassation et n’est pas la conséquence d’une évaluation négative de la disposition citée (voir paragraphe 31).
47. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’a pas subi une entrave disproportionnée à son droit à un tribunal et que, dès lors, il n’y a pas eu atteinte à la substance de ce droit. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
REICHMAN c. FRANCE du 12 juillet 2016 Requête no 50147/11
Violation de l'article 6-1 et 10 : le non accès à la Cour de Cassation est disproportionné aux droits du requérant et serait contraire à la Convention. Il lui est reproché d'avoir signé un pouvoir spécial à son avocat avant qu'il n'ait eu connaissance de l'arrêt critiqué de la Cour d'Appel. D'ailleurs cette obligation de pouvoir spécial est abandonnée, par la loi nouvelle.
Au sens de l'article 10, sa condamnation est disproportionnée à sa liberté d'expression en sa qualité de journaliste.
ARTICLE 6-1
a) Les principes généraux
27. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97 § 36, CEDH 2000‑II). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales. La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier de la sécurité juridique (Walchli c. France, no 35787/03, § 27, 26 juillet 2007, et Poirot c. France, no 29938/07, § 38, 15 décembre 2011).
28. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998‑I).
29. La Cour rappelle en outre que l’article 6 n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de cette disposition (Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11), notamment en ce qu’elle assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives au « bien-fondé de toute accusation en matière pénale » (Viard c. France, no 71658/10, § 30, 9 janvier 2014). La manière dont l’article 6 § 1 s’y applique dépend toutefois des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 48, 24 avril 2008, et Viard, précité, § 30).
30. Il résulte de ces principes que, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli, précité, § 29).
31. À ce jour, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de certaines formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, effectivement, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Kempf précité, § 59, 24 avril 2008, RTBF c. Belgique, no 50084/06, § 71, CEDH 2011 (extraits), et Henrioud c. France, no 21444/11, § 58, 5 novembre 2015).
32. La Cour rappelle enfin avoir déjà jugé que les dispositions de l’article 576 du CPP, telles qu’applicables à l’espèce, visaient un but légitime au sens de la Convention, à savoir s’assurer que l’auteur du pourvoi en cassation a donné mandat pour l’exercice de cette voie de recours extraordinaire (Bertogliati c. France (déc.), no 40195/98, 4 mai 2000, et Marschner c. France (déc.) no 51360/99, 13 mai 2003).
33. Elle précise toutefois que, pour être conforme à la Convention, l’application des dispositions précitées ne doit pas seulement poursuivre un but légitime et être accessible et prévisible, mais également ne pas avoir porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès du requérant à un tribunal (Bertogliati, précitée).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
34. La question qui se pose en l’espèce est donc de savoir si l’application des dispositions de l’article 576 précité n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant d’accéder au juge de cassation.
35. Au regard des circonstances particulières de l’espèce, la Cour n’est pas convaincue de ce que le seul fait que le pouvoir ait été donné par le requérant à son avocat avant que la cour d’appel ne rende son arrêt soit de nature à permettre de conclure à l’absence de volonté réelle de celui-ci de se pourvoir en cassation. Elle relève qu’il résulte au contraire des termes du mandat une volonté non équivoque et circonstanciée de se pourvoir en cassation en cas de condamnation (paragraphe 14 ci-dessus).
36. La Cour note en outre que le délai pour se pourvoir en cassation dans cette matière est de cinq jours francs, ce qui constitue un délai particulièrement court qui doit être pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de la déclaration d’irrecevabilité du pourvoi.
37. La Cour constate, avec le Gouvernement, que l’abrogation ultérieure par le législateur français de cette exigence de production d’un mandat spécial au profit d’un avocat (paragraphe 17 ci-dessus) ne tenait pas au caractère prétendument excessif de cette condition de recevabilité des pourvois. Elle considère toutefois que cette abrogation signifie, à tout le moins, que cette règle ne jouait pas un rôle fondamental dans la régulation de l’admission des pourvois devant la Cour de cassation.
38. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’en déclarant irrecevable le pourvoi en cassation du requérant, les autorités ont fait preuve d’un formalisme excessif ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au tribunal.
39. Le requérant a en effet été privé de tout examen au fond de son recours, alors qu’il avait fait l’objet d’une condamnation pénale et que sa liberté d’expression était en cause.
40. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
ARTICLE 10
a) Les principes généraux
53. La Cour rappelle que les principes généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence donnée dans l’exercice de la liberté d’expression, maintes fois réaffirmés par la Cour depuis l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni (7 décembre 1976, série A no 24), ont été récemment résumés dans l’arrêt Morice c. France ([GC], no 29369/10, §§ 124-127, 23 avril 2015).
54. La Cour rappelle en outre que la liberté de la presse joue un rôle fondamental et essentiel dans le bon fonctionnement d’une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui se rapportent à l’administration de la justice. La marge d’appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, parmi beaucoup d’autres, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 45, CEDH 2001‑III, et Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, no 37840/10, § 25, 3 avril 2014). Les journalistes doivent cependant agir de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournir des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 37, CEDH 2004-II, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, § 69, CEDH 2008). Une certaine dose « d’exagération » ou de « provocation » est alors permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (Fressoz et Roire, précité, § 45, Mamère c. France, no12697/03, § 25, CEDH 2006-XIII, et De Carolis et France Télévisions c. France, no 29313/10, §§ 45-46, 21 janvier 2016).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
55. La Cour relève d’emblée que les parties s’accordent à considérer que la condamnation pénale du requérant constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 de la Convention. C’est également l’opinion de la Cour.
56. Elle constate ensuite que l’ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, et qu’elle poursuivait la protection de la réputation ou des droits d’autrui, l’un des « buts légitimes » reconnus par le paragraphe 2 de l’article 10.
57. Il reste donc à examiner si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », ce qui requiert de vérifier si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les juridictions internes étaient pertinents et suffisants.
58. Selon le Gouvernement, les thèmes abordés par le requérant lors de l’émission en cause portaient sur des sujets d’intérêt général, à savoir le contrôle de la ligne éditoriale et la santé financière de la radio. La Cour partage cette analyse et constate en outre que le tribunal correctionnel a admis que le requérant était principalement animé d’une intention d’informer ses auditeurs sur la situation de la radio et son évolution depuis le décès de son fondateur (paragraphe 12 ci-dessus).
59. Elle relève ensuite que le requérant était depuis près de quinze ans le responsable de l’émission « Libre journal » diffusée sur cette radio. La qualité de journaliste lui a par ailleurs été reconnue par le tribunal correctionnel, même si cette juridiction a considéré que le requérant ne s’était en l’espèce exprimé qu’à titre personnel et que cela devait être pris en compte pour apprécier de manière plus souple l’existence de sa bonne foi.
60. La Cour considère cependant que si le requérant a personnellement été impliqué par les difficultés rencontrées par la radio au sein de laquelle il exerce son activité d’animateur, elle ne voit pas en quoi cela empêcherait que lui soit reconnue la qualité de journaliste, dès lors, qu’en l’espèce, il s’exprimait en cette qualité à l’antenne.
61. Elle estime dès lors que le propos litigieux s’inscrivait dans un débat d’intérêt général et relevait également de la liberté de presse dans le cadre de laquelle s’exprimait le requérant. Il en résulte que la marge d’appréciation de l’État dans la restriction du droit à la liberté d’expression de ce dernier s’en trouvait notablement amoindrie.
62. La Cour rappelle ensuite qu’une certaine dose « d’exagération » ou de « provocation » est permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (paragraphe 54 ci-dessus). Elle précise en outre que l’impossibilité de prouver la véracité d’un propos ne saurait impliquer, en soi, un manquement de la part de son auteur à ses devoirs déontologiques. Pour autant, la Cour rappelle que la protection que l’article 10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition qu’ils agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect des principes d’un journalisme responsable (Goodwin c. Royaume‑Uni, 27 mars 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999‑I, et Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 50, 29 mars 2016).
63. La Cour relève à ce titre qu’il convient de distinguer entre déclarations de fait et jugements de valeur (Morice, précité, § 126). En l’espèce, le propos jugé diffamatoire a été exprimé ainsi : « (...) la situation financière de la radio a donné lieu à certaines (...) j’allais dire acrobaties (...) enfin, disons, à certains comportements dont l’orthodoxie demande à être vérifiée, et tout ceci me plonge dans une grande inquiétude (...) ».
64. Si les interrogations du requérant sont de nature à suggérer la possible existence d’irrégularités dans la gestion financière de la radio, elles ne visaient toutefois aucun fait précis. Le requérant exprimait ainsi une impression d’ensemble relative à la gestion de la radio sur une période englobant la présidence de la partie civile. Il concluait même son intervention par la nécessité de pousser plus loin les vérifications à ce sujet. La Cour note d’ailleurs que le tribunal correctionnel a lui-même qualifié ce propos d’« allusif » et que c’est, notamment, son caractère abstrait qui a conduit les juridictions internes à retenir l’existence d’une diffamation.
65. La Cour ne partage donc pas la position des autorités internes selon laquelle ce propos caractérisait nécessairement l’existence d’une fraude ou d’une malhonnêteté. Elle en conclut au contraire que le propos litigieux constituait un jugement de valeur et non des déclarations de fait.
66. Elle rappelle que, à la différence des jugements de fait, les jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, l’obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 (Morice, précité). Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux : à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif. Pour distinguer une imputation de fait d’un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce et de la tonalité générale des propos, étant entendu que des assertions sur des questions d’intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait (ibidem).
67. La Cour note à ce titre que ce propos n’était pas dénué de tout fondement, puisque le requérant a pu produire deux documents émanant respectivement de la trésorerie et de l’expert-comptable de la radio attestant de la mauvaise situation financière de cette dernière (paragraphe 10 ci-dessus). Elle rappelle également que lorsque la presse contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes (Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 65, CEDH 2002‑V).
68. La Cour constate dès lors que le propos du requérant ne relevait pas de l’invective gratuite, mais qu’il se fondait au contraire sur une base factuelle au sens de sa jurisprudence.
69. De plus, ce propos est resté relativement mesuré. Le tribunal correctionnel a d’ailleurs pris soin de préciser que celui-ci n’était mû par aucune animosité personnelle à l’encontre de la partie civile.
70. Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal correctionnel, le propos du requérant s’inscrivait dans un contexte de dissensions au sein de la radio et faisait suite à des incidents survenus peu de temps auparavant entre des membres du personnel et la partie civile, lors d’une manifestation à l’occasion du 19ème anniversaire, dont l’existence et le déroulement, tels que relatés par le requérant, n’ont pas été sérieusement contestés.
71. La Cour relève qu’en l’espèce les juridictions internes se sont contentées de caractériser les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation, sans procéder à un examen des différents critères mis en œuvre par la Cour dans sa jurisprudence (paragraphes 53-54 ci-dessus) pour apprécier le caractère justifié et proportionné de toute ingérence dans le droit à la liberté d’expression, et ce dans une matière dans laquelle la marge d’appréciation de l’État était particulièrement restreinte.
72. La Cour considère que de tels motifs ne peuvent dès lors passer pour pertinents et suffisants. Elle note à cet égard, en particulier, que le juge national n’a pas distingué entre déclarations de fait et jugements de valeur, alors que des violations similaires avaient déjà été constatées dans des affaires dirigées contre la France concernant l’article 10 de la Convention (cf., parmi beaucoup d’autres, Paturel c. France, no 54968/00, § 35, 22 décembre 2005, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos21279/02 36448/02, § 55, 22 octobre 2007, Recueil des arrêts et décisions 2007-IV, et De Lesquen du Plessis-Casso c. France, no 54216/09, 12 avril 2012 ; voir également, plus récemment, Morice, précité, §§ 126 et 155, et De Carolis et France Télévisions c. France, no 29313/10, § 54, 21 janvier 2016).
73. Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont des éléments à prendre en considération lorsque l’on évalue la proportionnalité de l’ingérence. En l’espèce, le requérant a été condamné à une amende de 1 000 EUR assortie d’un sursis, ainsi qu’à payer des dommages-intérêts d’un montant de 1 500 EUR. Or, même lorsque la sanction est la plus modérée possible, à l’instar d’une condamnation accompagnée d’une dispense de peine sur le plan pénal et à ne payer qu’un « euro symbolique » au titre des dommages-intérêts, elle n’en constitue pas moins une sanction pénale qui peut avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression, lequel doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 35, série A no 298, Brasilier c. France, no 71343/01, § 43, 11 avril 2006, et Morice, précité, § 176). Elle rappelle ainsi que le prononcé même d’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression, eu égard à l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies de droit civiles (Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 273, CEDH 2015 (extraits)). Pour cette raison, elle a invité à plusieurs reprises les autorités internes à faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale (Morice, précité, §§ 127 et 176, avec les références citées).
74. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression du requérant, qui n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 de la Convention.
75. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
DATTEL c. LUXEMBOURG du 30 juillet 2009 Requête no 18522/06
LA COUR DE CASSATION LUXEMBOURGEOISE EXIGE UN FORMALISME ENTRE LA PRESENTATION DU MOYEN DE CASSATION ET L'ARGUMENTATION DE CE MOYEN ALORS QU'IL N'EXISTE PAS D'AVOCAT A LA COUR DE CASSATION COMME DANS D'AUTRES ETATS. LA COUR CASSE POUR FORMALISME EXCESSIF QUI EQUIVAUT A UN NON ACCES A UN TRIBUNAL
36. La Cour rappelle que sa tâche consiste à examiner si le motif du rejet du pourvoi en cassation par la Cour de cassation a privé les requérants de leur droit de voir examiné le moyen présenté dans leur pourvoi. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.
37. Ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt Kemp et autres c. Luxembourg, (no 17140/05, § 52, 24 avril 2008,), la règle appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur le caractère recevable du pourvoi en cause est une construction jurisprudentielle. En effet, l’article 10 de la loi du 18 février 1885 se borne à prévoir que, pour introduire un pourvoi en cassation, l’intéressé doit déposer au greffe de la Cour de cassation « un mémoire (...) lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée ». C’est la haute juridiction qui a introduit la distinction entre l’énoncé du moyen de cassation, d’une part, et « la discussion qui développe le moyen [et qui] ne peut suppléer à l’absence de formulation de moyen », d’autre part.
38. Aussi, la Cour a-t-elle estimé que la limitation imposée par cette règle jurisprudentielle poursuit un but légitime. En effet, la précision exigée dans la formulation des moyens de cassation a clairement pour objectif de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle en droit (Kemp et autres, précité, § 53).
39. Reste à savoir si cette exigence de précision dans la formulation du moyen de cassation répond à la condition de la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. A ce sujet, la Cour estime que le mémoire en cassation doit être considéré dans son ensemble, en ce sens que les requérants doivent avoir formulé leurs doléances à l’égard de l’arrêt d’appel soit dans l’énoncé du moyen de cassation même, soit au besoin dans la discussion qui développe le moyen.
40. La Cour examinera donc de quelle manière les requérants présentèrent, en l’espèce, leurs doléances à la Cour de cassation, d’une part, et pour quelles raisons leur pourvoi fut rejeté, d’autre part.
41. Dans leur mémoire en cassation, les requérants retracèrent le dispositif de l’arrêt attaqué, à savoir celui de la cour d’appel du 10 juin 2004. Ils formulèrent ensuite un unique moyen de cassation divisé en trois branches et tiré de la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
Dans la première branche du moyen, les requérants reprochèrent à la cour d’appel de ne pas avoir répondu à leurs moyens relatifs à la violation par les premiers juges de leurs droits garantis par la Convention ; ils rappelèrent en effet avoir demandé à la cour d’appel de constater la violation de la Convention et de déclarer bonne et valable leur créance résultant du compte no 45. Ils conclurent qu’en refusant de répondre à ces moyens, la cour d’appel avait violé leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.
Dans la deuxième branche, ils reprochèrent à la cour d’appel d’avoir refusé d’analyser leurs droits sur le compte no 45 au motif que d’autres juges auraient déjà analysé leurs droits sur le compte no 49. Estimant avoir invoqué des droits de propriété séparés sur le compte no 45 et différents de ceux invoqués sur le compte no 49, ils conclurent que la cour d’appel avait violé leur droit à la protection de la propriété garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Dans la troisième branche, ils reprochèrent à la cour d’appel de les avoir condamnés à de lourdes indemnités pour procédure abusive et vexatoire.
Ils demandèrent à la Cour de cassation de casser et annuler l’arrêt du 10 juin 2004 dans toutes ses dispositions attaquées.
42. La Cour de cassation, après avoir rappelé sa jurisprudence en la matière, rejeta le moyen faute de précision. Elle estima que le moyen était constitué d’un amalgame de cas d’ouverture de cassation partiellement reproduits dans les différentes branches et sans lien logique entre eux, qui ne permettait pas d’en saisir le sens et la portée.
43. Aux yeux de la Cour, l’on ne saurait soutenir que les requérants auraient omis de soumettre à la connaissance des juges suprêmes les éléments déterminants de l’affaire ainsi que leurs doléances à l’égard de l’arrêt de la cour d’appel attaqué. En effet, ils ont reproché principalement aux juges d’appel d’avoir refusé d’analyser leur demande à l’égard du compte no 45 et d’avoir ainsi violé leur droit à un procès équitable au titre de l’article 6 de la Convention, d’une part, et leur droit à la protection de la propriété garanti par l’article 1 du Protocole no 1, d’autre part.
Sur ce point, la Cour estime que la précision exigée par la Cour de cassation dans la formulation du moyen de cassation n’était pas indispensable pour que la haute juridiction suprême puisse exercer son contrôle. Pareille exigence affaiblit à un degré considérable la protection des droits des justiciables devant la haute juridiction nationale, surtout si l’on tient compte du fait que le Luxembourg ne connaît pas le système des avocats aux Conseils spécialisés (mutatis mutandis, Kemp et autres, précité, § 58).
44. Dans ces conditions, prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble du moyen de cassation au motif qu’il n’avait pas été articulé avec la précision requise s’inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché les requérants de voir la Cour de cassation se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen (mutatis mutandis, Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 33, 27 juillet 2006, et Kemp et autres, précité, § 59).
45. Pour autant que le Gouvernement indique que l’unique moyen de cassation aurait en tout état de cause été écarté, la Cour rappelle qu’elle ne saurait spéculer sur les conclusions auxquelles la Cour de cassation aurait abouti si elle n’avait pas rejeté ledit moyen pour les motifs avancés.
46. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’en l’espèce, la limitation imposée au droit d’accès des requérants à un tribunal n’a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
47. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit des requérants d’avoir accès à un tribunal.
Nunes Guerreiro c. Luxembourg du 05 novembre 2009 Requête no 33094/07
29. La Cour rappelle que sa tâche consiste à examiner si le motif du rejet du pourvoi en cassation par la Cour de cassation a privé le requérant de son droit de voir examiné le moyen présenté dans son pourvoi. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.
30. Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt Kemp et autres, précité, § 52, et rappelé dans l'arrêt Dattel c. Luxembourg(no 2) (no 18522/06, § 37, 30 juillet 2009), la règle appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur le caractère recevable du pourvoi en cause est une construction jurisprudentielle. En effet, l'article 10 de la loi du 18 février 1885 se borne à prévoir que, pour introduire un pourvoi en cassation, l'intéressé doit déposer au greffe de la Cour de cassation « un mémoire (...) lequel précisera les dispositions attaquées de l'arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l'adjudication sera demandée ». C'est la haute juridiction qui a introduit la distinction entre l'énoncé du moyen de cassation, d'une part, et « la discussion qui développe le moyen [et qui] ne peut suppléer à l'absence de formulation de moyen », d'autre part.
31. Aussi, la Cour a-t-elle estimé que la limitation imposée par cette règle jurisprudentielle poursuit un but légitime. En effet, la précision exigée dans la formulation des moyens de cassation a clairement pour objectif de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle en droit (Kemp et autres, précité, § 53 ; Dattel (no 2), précité, § 38).
32. Reste à savoir si cette exigence de précision dans la formulation du moyen de cassation répond à la condition de la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. A ce sujet, la Cour a estimé que le mémoire en cassation doit être considéré dans son ensemble, en ce sens que le requérant doit avoir formulé ses doléances à l'égard de l'arrêt d'appel soit dans l'énoncé du moyen de cassation même, soit au besoin dans la discussion qui développe le moyen (Dattel (no 2), précité, § 39).
33. La Cour examinera donc de quelle manière le requérant présenta, en l'espèce, ses doléances à la Cour de cassation, d'une part, et pour quelles raisons son pourvoi fut rejeté, d'autre part.
34. Dans son mémoire en cassation, le requérant retraça le dispositif de l'arrêt attaqué, à savoir celui du conseil supérieur des assurances sociales du 1er février 2006. Il formula ensuite un unique moyen de cassation tiré de la violation de différentes dispositions du code des assurances sociales qu'il énuméra. Dans ce moyen de cassation, il exposa qu'en ayant déclaré son appel non fondé pour les motifs avancés, le conseil supérieur des assurances sociales avait procédé à une fausse interprétation de la loi en question. Dans la rubrique « discussion du moyen », il exposa que, pour parvenir à la solution retenue dans l'arrêt litigieux, le conseil supérieur des assurances sociales avait fait une lecture des dispositions légales incompatible avec l'économie générale de la loi sur l'invalidité et dans le seul but de soutenir une jurisprudence devenue insoutenable. Après avoir indiqué dans quel sens les dispositions légales devraient, selon lui, être lues (voir paragraphe 12 ci-dessus), il demanda à la Cour de cassation de casser et annuler l'arrêt du 1er février 2006.
35. La Cour de cassation, après avoir rappelé sa jurisprudence en la matière, rejeta le moyen faute de précision. Elle estima que le moyen ne précisait pas en quoi les dispositions légales y visées auraient été violées ou faussement appliquées
36. Aux yeux de la Cour, l'on ne saurait soutenir que le requérant aurait omis de soumettre à la connaissance des juges suprêmes les éléments déterminants de l'affaire ainsi que ses doléances à l'égard de l'arrêt du conseil supérieur des assurances sociales attaqué. En effet, dans le moyen de cassation, il a reproché aux juges d'avoir fait une mauvaise interprétation de la loi pour déclarer son appel non fondé et, dans la discussion du moyen, il a indiqué dans quel sens les dispositions légales pertinentes devraient être lues.
37. La Cour estime que la précision exigée par la Cour de cassation dans la formulation du moyen de cassation n'était pas indispensable pour que la haute juridiction suprême puisse exercer son contrôle. Pareille exigence affaiblit à un degré considérable la protection des droits des justiciables devant la haute juridiction nationale, surtout si l'on tient compte du fait que le Luxembourg ne connaît pas le système des avocats aux Conseils spécialisés (mutatis mutandis, Kemp et autres, précité, § 58, et Dattel (no 2), précité, § 43).
38. Dans ces conditions, prononcer l'irrecevabilité du moyen de cassation au motif qu'il n'avait pas été articulé avec la précision requise s'inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché le requérant de voir la Cour de cassation se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen (mutatis mutandis, Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 33, 27 juillet 2006 ; Kemp et autres, précité, § 59 ; Dattel (no 2), précité, § 44).
39. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que la limitation imposée au droit d'accès du requérant à un tribunal n'a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
40. Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit du requérant d'avoir accès à un tribunal.
DROIT D'ACCES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Albuquerque Fernandes c. Portugal du 12 janvier 2021 requête no 50160/13
Le rejet, pour vice de forme, du recours constitutionnel d’une juge contestant sa sanction disciplinaire n’a pas violé le droit d’accès à un tribunal
L’affaire concerne une procédure disciplinaire engagée contre une juge, à la suite de laquelle le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) décida de la mettre à la retraite d’office et la procédure judiciaire subséquente. Mme Albuquerque Fernandes reprochait au Tribunal constitutionnel d’avoir fait preuve d’un excès de formalisme lorsqu’il avait rejeté son recours constitutionnel, en estimant qu’elle n’avait pas respecté une exigence posée par l’article 79–C de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel : dans son recours, la requérante s’était référée à la décision du CSM au lieu de celle de la Cour suprême. La Cour juge en particulier que les décisions d’irrecevabilité rendues par le Tribunal constitutionnel ne témoignent pas d’un excès de formalisme en l’espèce. Au contraire, elle estime que celles-ci ont assuré la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Ainsi, le Tribunal constitutionnel a rétabli la prééminence du droit après un acte de procédure erroné accompli par Mme Albuquerque Fernandes. Les limitations appliquées à cette dernière n’ont donc pas porté atteinte à la substance de son droit d’accès à un tribunal.
Art 6 § 1 • Accès à une juridiction constitutionnelle • Conditions de recevabilité d’un recours contre un arrêt de la Cour suprême • Absence de formalisme excessif • Rétablissement par le Tribunal constitutionnel de la prééminence du droit après un acte de procédure erroné accompli par la requérante
La requérante, Cristina Maria Albuquerque Fernandes, est une ressortissante portugaise née en 1963. Elle réside à Coimbra (Portugal). À l’époque des faits, elle était juge. En février 2011, le CSM ouvrit une procédure disciplinaire contre Mme Albuquerque Fernandes, lui reprochant entre autres d’avoir emporté, au moment de sa mutation vers le tribunal de Leiria en septembre 2010, des dossiers dont elle était en charge au tribunal d’Alcobaça et de ne pas les avoir rendus. En avril 2011, la juge instructrice invita Mme Albuquerque Fernandes à lui remettre les dossiers en cause. N’ayant pas reçu de retour favorable, la juge instructrice en informa le CSM qui décida d’appliquer à l’intéressée une mesure de suspension provisoire pour une durée de 30 jours. En juillet 2011, la juge instructrice dressa un acte d’accusation, reprochant à Mme Albuquerque Fernandes d’avoir méconnu son devoir de zèle et d’obéissance aux instructions du CSM, d’avoir empêché l’administration de la justice et d’avoir porté atteinte de façon irrémédiable au prestige de la magistrature et à l’image du tribunal d’Alcobaça. Entre autres, les faits imputés à Mme Albuquerque Fernandes étaient les suivants : avoir accusé des retards dans le traitement de dossiers, notamment urgents ; n’avoir pas encore rendu de décisions dans 210 affaires ; avoir quitté e tribunal d’Alcobaça, en emportant 19 dossiers de procédures, sans demander l’autorisation du CSM et sans informer la présidente ou les greffières du tribunal , et ne les avoir restitués qu’après que le CSM lui eut appliqué une suspension de l’exercice de ses fonctions, sans avoir statué sur ces affaires. En septembre 2011, Mme Albuquerque Fernandes présenta sa défense et contesta les faits qui lui étaient reprochés. Elle allégua, entre autres, avoir informé les greffières du tribunal qu’elle emportait quelques dossiers au moment de son départ du tribunal ; et elle ajouta qu’elle avait des problèmes de santé et souffrait d’anxiété. En décembre 2011, l’Assemblée plénière du CSM rendit sa décision et appliqua la sanction proposée par la juge instructrice, à savoir la mise à la retraite d’office de Mme Albuquerque Fernandes. En janvier 2012, Mme Albuquerque Fernandes forma un recours devant la section du contentieux de la Cour suprême. Elle y alléguait, entre autres, qu’elle n’avait pu anticiper la sanction qu’elle encourait et qu’elle avait par conséquent été prise au dépourvu par la décision du CSM. Elle y voyait une atteinte à son droit de se défendre garanti par la Constitution, ainsi qu’à son droit d’être entendue, garanti par l’article 110 § 2 du Statut des magistrats du siège (« le Statut »)2 . La Cour suprême rejeta ce recours le 19 septembre 2002. Enfin, Mme Albuquerque Fernandes forma un recours devant le Tribunal constitutionnel, faisant valoir que l’acte d’accusation au regard duquel elle avait présenté sa défense s’orientait vers l’application d’une amende ou d’un transfert, tel que l’indiquaient les dispositions qui y étaient citées. Elle estimait, dès lors, avoir été prise au dépourvu par la décision du CSM de lui appliquer la sanction de mise à la retraite d’office, invoquant l’inconstitutionnalité de l’article 117 § 1 du Statut, au regard des articles 13, 20 § 4, 32 §§ 1, 2 et 10 et 269 § 3 de la Constitution Statuant en formation de juge unique, le Tribunal constitutionnel déclara ce recours irrecevable par une décision sommaire, le 28 novembre 2012, au motif que la décision du CSM n’avait pas appliqué l’article 117 § 1 du Statut dans le sens allégué par la requérante, tel qu’exigé par l’article 79-C de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel (« la LOTC »). Mme Albuquerque Fernandes forma une opposition contre cette décision devant le comité de trois juges du Tribunal constitutionnel, invoquant un excès de formalisme. Le comité confirma la décision juge unique.
Article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) – grief portant sur le rejet du recours par le Tribunal constitutionnel
Mme Albuquerque Fernandes dit avoir souhaité un contrôle quant à la conformité avec l’article 32 de la Constitution de l’interprétation normative de l’article 117 § 1 du Statut selon laquelle l’acte d’accusation n’impliquait pas qu’il fût fait référence aux peines applicables, surtout lorsqu’étaient en jeu des peines emportant exclusion de la magistrature. Elle précise que la question qu’elle tirait de l’inconstitutionnalité alléguée de l’interprétation normative de l’article 117 § 1 du Statut était claire et étayée par tous les arguments possibles. Elle ajoute avoir fait référence à toutes les dispositions légales pertinentes en l’espèce dans le but de prouver que l’acte d’accusation devait faire référence aux sanctions applicables, pour permettre à l’accusé de se défendre en connaissance de cause et, ainsi, éviter de donner lieu à une « décision surprise ». La Cour constate que, en vertu de l’article 75-A de la LOTC, pour saisir valablement le Tribunal constitutionnel, tout mémoire en recours doit préciser l’alinéa de l’article 70 § 1 de la LOTC sur lequel il se fonde et la norme dont l’inconstitutionnalité ou l’illégalité doit être appréciée. L’article 79-C précise quant à lui que la norme en cause doit avoir été appliquée dans la décision litigieuse. La restriction appliquée, en l’espèce, au droit d’accès de la requérante au Tribunal constitutionnel était donc légale. La Cour estime aussi qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir le respect de la prééminence du droit et la bonne administration de la justice constitutionnelle. Il reste donc à apprécier la proportionnalité de cette restriction au but légitime poursuivi en l’espèce. Eu égard à la nature spécifique du recours devant le Tribunal constitutionnel, la Cour accepte que les conditions d’accès à cette juridiction puissent être rigoureuses pour garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice constitutionnelle au plus haut degré de la hiérarchie judiciaire. La Cour tient également compte du fait que le Tribunal constitutionnel n’intervient qu’en dernier ressort, après que la question de constitutionnalité a été examinée par les tribunaux inférieurs dans la hiérarchie judiciaire. En l’espèce, aucune voie de recours autre que celle devant le Tribunal constitutionnel, dans la limite des pouvoirs de cette juridiction en matière de contrôle de constitutionnalité, n’était ouverte à la requérante après l’arrêt de la Cour suprême. Dans son arrêt du 19 septembre 2012, la Cour suprême a jugé que l’interprétation normative de l’article 117 § 1 du Statut selon laquelle la sanction applicable ne devait pas être spécifiée dans l’acte d’accusation était conforme à la Constitution étant donné que le juge accusé dans le cadre d’une procédure disciplinaire pouvait anticiper la sanction disciplinaire encourue à partir des faits litigieux figurant dans l’acte d’accusation. Plus particulièrement, elle a jugé que cette interprétation ne portait pas atteinte au droit à l’égalité garanti par l’article 13 de la Constitution, au droit à un procès équitable consacré à l’article 20 § 4 de la Constitution et aux droits procéduraux garantis par les articles 32 §§ 1 et 2 et 269 § 3 de la Constitution, répondant ainsi au fond de la question. Or, ce n’est pas l’interprétation faite par la Cour suprême dans son arrêt du 19 septembre 2012 de l’article 117 § 1 du Statut que la requérante a dénoncé devant le Tribunal constitutionnel, mais celle qu’elle avait extraite de la décision du CSM du 13 décembre 2011. Ainsi, comme l’a relevé le Tribunal constitutionnel, l’interprétation faite par la Cour suprême était beaucoup plus large puisqu’elle indiquait que, même si elle n’était pas mentionnée, la sanction encourue découlait de l’exposé des faits litigieux figurant dans l’acte d’accusation.
Ainsi, en ne précisant pas le sens de l’interprétation normative dénoncée telle qu’elle avait été suivie par le tribunal a quo, à savoir en l’occurrence la Cour suprême, la requérante n’a pas respecté l’exigence posée par l’article 79–C de la LOTC, confirmée par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel3 . À titre subsidiaire, la Cour est d’avis que la requérante disposait des éléments nécessaires pour soumettre valablement cette question en tenant compte de l’arrêt de la Cour suprême. En effet, elle observe que le Tribunal constitutionnel s’était déjà prononcé sur l’inconstitutionnalité d’interprétations normatives des articles 117 § 1 et 122 du Statut. Il appartenait donc à la requérante de formuler la question de l’inconstitutionnalité de l’interprétation normative de l’article 117 § 1 du Statut, telle qu’elle avait été faite par la Cour suprême, dans son arrêt du 19 septembre 2012. Par conséquent, on ne saurait affirmer que les décisions d’irrecevabilité rendues, en l’espèce, par le Tribunal constitutionnel témoignent d’un excès de formalisme. Au contraire, la Cour estime que celles-ci ont assuré la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Le Tribunal constitutionnel a ainsi rétabli la prééminence du droit après un acte de procédure erroné accompli par la requérante. Dès lors, les limitations appliquées à la requérante n’ont pas porté atteinte à la substance de son droit d’accès à un tribunal et il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
Article 6 (droit à un procès équitable) – grief portant sur la procédure disciplinaire
La Cour réitère son constat selon lequel le Tribunal constitutionnel a déclaré le recours de la requérante irrecevable au motif que celle-ci n’avait pas rempli la condition exigée par l’article 79-C de la LOTC. Cette juridiction ne s’est donc pas prononcée sur le fond de la question tirée de l’inconstitutionnalité alléguée de l’interprétation normative de l’article 117 § 1 du Statut. Par conséquent, la requérante n’a pas exercé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, une voie de recours qui lui était ouverte et aurait pu permettre de remédier à son grief. Ce grief tiré est donc rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
CEDH
a) Principes généraux
64. Les principes généraux relatifs à l’accès à un tribunal ont été rappelés récemment dans les arrêts Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], no 76943/11, §§ 84-90, 29 novembre 2016) et Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, §§ 76-79, 5 avril 2018).
65. La Cour rappelle, en particulier, que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes ; c’est effectivement au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 80, 25 mars 2014). Sous réserve d’une interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable, le rôle de la Cour se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 49, 20 octobre 2011 et Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 149, 19 décembre 2018).
66. Cependant, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, précité, § 89, Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 115, 15 mars 2018, Zubac, précité, § 78 et Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 195, 25 juin 2019).
67. L’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation, et encore moins des juridictions compétentes en matière d’amparo (Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, nos 65101/16 et 2 autres, § 99, 23 octobre 2018). Toutefois, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (Zubac, précité, § 80, et Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11). Cette jurisprudence a, en l’occurrence, été appliquée à des tribunaux constitutionnels (voir, notamment, Arrozpide Sarasola et autres, précité, §§ 107-108, et Dos Santos Calado et autres c. Portugal, no 55997/14 et 3 autres, §§ 121-125, §§ 129-130 et §§ 133-136, 31 mars 2020).
68. Compte tenu du fait que la juridiction du Tribunal constitutionnel est limitée aux questions de constitutionnalité, on peut admettre que les conditions de recevabilité pour un recours constitutionnel puissent être plus rigoureuses que pour un appel. Cela dit, les autorités nationales ne jouissent pas d’un pouvoir discrétionnaire illimité à cet égard (Zubac, précité, § 82 et §§ 108‑109). Il convient donc de prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle que le Tribunal constitutionnel y a tenu (Arrozpide Sarasola et autres, précité, § 99, et les références qui y sont citées). N’appartient pas à la Cour d’interpréter et d’appliquer le droit interne, elle ne peut mettre en cause l’appréciation des autorités internes quant à des erreurs de droit prétendument commises que lorsque celles-ci sont arbitraires ou manifestement déraisonnables (ibid., § 100).
69. Pour déterminer la proportionnalité de restrictions légales appliquées à l’accès aux juridictions supérieures, il y a lieu de prendre en considération trois facteurs, tel que rappelé dans l’affaire Zubac (précitée, §§ 85-99) et appliqué dans l’affaire Dos Santos Calado et autres (précitée, §§ 114-116).
Premièrement, la Cour doit rechercher si les modalités d’exercice du recours peuvent passer pour prévisibles aux yeux d’un justiciable (Zubac, § 87 et les références qui y sont citées).
Deuxièmement, après avoir identifié les erreurs procédurales qui ont été commises au cours de la procédure et qui, en définitive, ont empêché le requérant d’accéder à un tribunal, il convient de déterminer si l’intéressé a dû supporter une charge excessive en raison de ces erreurs. Lorsque l’erreur procédurale en question n’est imputable qu’à un côté, selon le cas celui du requérant ou celui des autorités compétentes, notamment la juridiction (ou les juridictions), la Cour a habituellement tendance à faire peser la charge sur celui qui a commis l’erreur (Zubac, précité, § 90 et les exemples qui y sont cités).
Troisièmement, il s’agira de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif ». Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour qu’un « formalisme excessif » peut nuire à la garantie d’un droit « concret et effectif » d’accès à un tribunal découlant de l’article 6 § 1 de la Convention. Pareil formalisme peut résulter d’une interprétation particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale, qui empêche l’examen au fond de l’action d’un requérant et constitue un élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux (Zubac, précité, § 97). La Cour a ainsi constaté, à plusieurs reprises, sur ce fondement, une violation du droit d’accès à un tribunal (voir les exemples cités au paragraphe 116 de l’arrêt Dos Santos Calado et autres, précité, et les violations du droit d’accès à un tribunal constatées dans ce même arrêt aux paragraphes 125 et 130).
70. Au demeurant, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, no 35787/03, § 29, 26 juillet 2007). Le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Zubac, précité, § 98, et Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 24, 27 juillet 2006).
b) Application à la présente espèce
71. La Cour relève que la requérante ne conteste pas les arguments du Gouvernement s’agissant de la nature du contrôle concret de constitutionnalité en droit interne et, plus particulièrement, le fait que ce contrôle ne peut porter que sur une question normative, avec une portée générale donc, ce qui le distingue ainsi du contrôle exercé dans le cadre du recours d’amparo (paragraphe 60 ci-dessus). La requérante ne met pas non plus en cause la prévisibilité et la clarté des restrictions à l’accès à la juridiction constitutionnelle. Ce qu’elle dénonce, c’est une application trop formaliste des conditions de recevabilité du recours constitutionnel par le Tribunal constitutionnel dans le cadre de son recours devant cette haute juridiction (paragraphes 57 et 58 ci-dessus). L’intéressée se plaint aussi de ne pas avoir été invitée à corriger sa demande introductive de recours, comme le prévoyait l’article 75-A de la LOTC (paragraphe 59 ci-dessus).
72. La Cour constate, quant à elle que, en vertu de l’article 75-A de la LOTC, pour saisir valablement le Tribunal constitutionnel, tout mémoire en recours doit préciser l’alinéa de l’article 70 § 1 de la LOTC sur lequel il se fonde et la norme dont l’inconstitutionnalité ou l’illégalité doit être appréciée. L’article 79-C précise quant à lui que la norme en cause doit avoir été appliquée dans la décision litigieuse (paragraphe 32 ci-dessus). La restriction appliquée, en l’espèce, au droit d’accès de la requérante au Tribunal constitutionnel était donc légale. La Cour ne doute pas non plus qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir le respect de la prééminence du droit et la bonne administration de la justice constitutionnelle. Il reste donc à apprécier la proportionnalité de cette restriction au but légitime poursuivi au regard des circonstances de l’espèce.
73. La Cour relève que la requérante a saisi le Tribunal constitutionnel d’un recours en excipant de l’inconstitutionnalité de l’article 117 § 1 du Statut, au regard des articles 13, 20 § 4, 32 §§ 1, 2 et 10 et 269 § 3 de la Constitution, « lorsque [cet article], notamment concernant la partie « indiquant les dispositions légales applicables » [était] interprété et intégré, concrètement, avec un sens (restrictif) selon lequel la norme n’impliqu[ait] pas ou dispens[ait] que, dans l’acte d’accusation, il [fût] fait référence aux sanctions qui [étaient] applicables à l’accusé ou [fût] porté à la connaissance de [celui-ci] les[dites] sanctions, surtout lorsque [étaient] en cause des sanctions emportant exclusion » (paragraphe 23 ci-dessus).
La requérante entendait donc exciper de l’inconstitutionnalité d’une interprétation normative, autrement dit une interprétation de la disposition susmentionnée avec une portée générale, au sens de la jurisprudence interne (paragraphes 46, 47 et 48 dessus).
74. La Cour note que, par une décision sommaire du 28 novembre 2012 prise en formation de juge unique, confirmée par un arrêt du 31 janvier 2013 adopté par un comité de trois juges, le Tribunal constitutionnel a déclaré le recours de la requérante irrecevable au motif que la décision litigieuse du tribunal a quo, en l’occurrence la Cour suprême, n’avait pas appliqué l’article 117 § 1 du Statut avec l’interprétation alléguée par l’intéressée, tel qu’exigé par l’article 79–C de la LOTC. Plus particulièrement, le Tribunal constitutionnel a jugé que l’interprétation normative dénoncée était beaucoup plus restrictive que celle qui avait effectivement été suivie par la Cour suprême (paragraphes 25 et 27 ci‑dessus). Il ne s’est donc pas prononcé sur le fond de la question que la requérante tirait de l’inconstitutionnalité alléguée de l’interprétation normative de l’article 117 § 1 du Statut, restreignant ainsi l’accès de l’intéressée à sa juridiction.
75. Eu égard à la nature spécifique du recours devant le Tribunal constitutionnel, la Cour accepte que les conditions d’accès à cette juridiction puissent être rigoureuses pour garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice constitutionnelle au plus haut degré de la hiérarchie judiciaire. La Cour tient également compte du fait que le Tribunal constitutionnel n’intervient qu’en dernier ressort, après que la question de constitutionnalité a été examinée par les tribunaux inférieurs dans la hiérarchie judiciaire, conformément aux articles 70 et 72 § 2 de la LOTC (paragraphe 32 ci-dessus). En effet, en l’espèce, aucune voie de recours autre que celle devant le Tribunal constitutionnel, dans la limite des pouvoirs de cette juridiction en matière de contrôle de constitutionnalité, n’était ouverte à la requérante après l’arrêt de la Cour suprême du 19 septembre 2012.
76. La Cour note que l’intéressée avait déjà soulevé la question fondée sur l’interprétation normative litigieuse de l’article 117 § 1 du Statut dans le cadre de son recours devant la Cour suprême contre la décision disciplinaire du CSM (paragraphe 20 ci-dessus). Or, dans son arrêt du 19 septembre 2012, la Cour suprême a jugé que l’interprétation normative de l’article 117 § 1 du Statut selon laquelle la sanction applicable ne devait pas être spécifiée dans l’acte d’accusation était conforme à la Constitution étant donné que le juge accusé dans le cadre d’une procédure disciplinaire pouvait anticiper la sanction disciplinaire encourue à partir des faits litigieux figurant dans l’acte d’accusation. Plus particulièrement, elle a jugé que cette interprétation ne portait pas atteinte au droit à l’égalité garanti par l’article 13 de la Constitution, au droit à un procès équitable consacré à l’article 20 § 4 de la Constitution et aux droits procéduraux garantis par les articles 32 §§ 1 et 2 et 269 § 3 de la Constitution (paragraphe 22 ci-dessus), répondant ainsi au fond de la question.
77. Force est donc de constater que ce n’est pas l’interprétation faite par la Cour suprême dans son arrêt du 19 septembre 2012 (paragraphe 22 ci‑dessus) de l’article 117 § 1 du Statut que la requérante a dénoncé devant le Tribunal constitutionnel, mais celle qu’elle avait extraite de la décision du CSM du 13 décembre 2011 (paragraphe 18 ci-dessus). Or, comme l’a relevé le Tribunal constitutionnel, l’interprétation faite par la Cour suprême était beaucoup plus large puisqu’elle indiquait que, même si elle n’était pas mentionnée, la sanction encourue découlait de l’exposé des faits litigieux figurant dans l’acte d’accusation.
En ne précisant pas le sens de l’interprétation normative dénoncée telle qu’elle avait été suivie par le tribunal a quo, à savoir en l’occurrence la Cour suprême, la requérante n’a pas respecté l’exigence posée par l’article 79–C de la LOTC, confirmée par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, notamment dans ses arrêts nos 82/92 du 25 février 1992 et 178/95 du 5 avril 1995 (paragraphes 32, 45 et 46 ci-dessus). À titre subsidiaire, la Cour est d’avis que la requérante disposait des éléments nécessaires pour soumettre valablement cette question en tenant compte de l’arrêt de la Cour suprême. En effet, elle observe que le Tribunal constitutionnel s’était déjà prononcé sur l’inconstitutionnalité d’interprétations normatives des articles 117 § 1 et 122 du Statut (paragraphes 41, 42, 43 et 44 ci-dessus). Il appartenait donc à la requérante de formuler la question de l’inconstitutionnalité de l’interprétation normative de l’article 117 § 1 du Statut, telle qu’elle avait été faite par la Cour suprême, dans son arrêt du 19 septembre 2012.
78. On ne saurait donc affirmer que les décisions d’irrecevabilité rendues, en l’espèce, par le Tribunal constitutionnel témoignent d’un excès de formalisme. Au contraire, la Cour estime que celles-ci ont assuré la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Le Tribunal constitutionnel a ainsi rétabli la prééminence du droit après un acte de procédure erroné accompli par la requérante (voir, mutatis mutandis, Zubac, précité, § 123).
79. Quant à savoir si cette dernière aurait dû être invitée à corriger sa demande introductive de recours, la Cour note qu’une telle possibilité n’est ouverte que lorsque ce sont les formalités de la demande introductive du recours constitutionnel mentionnées à l’article 75-A §§ 1-4 de la LOTC qui ne sont pas respectées, tel qu’indiqué par l’article 75-A § 5 de la LOTC et constaté par une jurisprudence interne (paragraphes 32 et 49 ci-dessus). Or, en l’espèce, c’est la condition de recevabilité du recours constitutionnel prévue à l’article 79-C de la LOTC qui n’était pas remplie. La possibilité prévue à l’article 75-A § 5 de la LOTC n’était donc pas ouverte à la requérante.
80. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les limitations appliquées à la requérante n’ont pas porté atteinte à la substance de son droit d’accès à un tribunal.
81. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
Dos Santos Calado et autres c. Portugal du 31 mars 2020
requêtes nos 55997/14, 68143/16, 78841/16 et 3706/17
Article 6-1 : Le formalisme excessif du Tribunal constitutionnel a privé des requérants de leur droit d’accès à un tribunal
Les affaires concernent des requérants portugais qui se plaignent de l’irrecevabilité de recours qu’ils ont introduits devant le Tribunal constitutionnel. Les requêtes nos 55997/14 et 68143/16 concernent aussi un défaut allégué d’impartialité du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel. La Cour juge en particulier que, dans les deux affaires où la violation a été constatée, le Tribunal constitutionnel a fait preuve d’un formalisme excessif dans l’application des dispositions législatives fondant sa compétence à connaître des recours introduits devant lui. Par conséquent, la juridiction portugaise a privé les requérants de leur droit d’accès à un tribunal.
Art 35 § 1 • Épuisement des voies de recours internes • Nécessité d’introduire un recours devant le Tribunal constitutionnel dans toute affaire soulevant une question tirée d’une inconstitutionnalité ou interprétation normative • Recours constitutionnel ne soulevant aucune question d’inconstitutionnalité sans pertinence pour le calcul du délai de six mois • Nécessité de former une opposition devant un comité de trois juges du Tribunal constitutionnel contre la décision sommaire d’irrecevabilité d’un recours constitutionnel, rendue par un juge unique
Art 6 § 1 • Accès à un tribunal • Tribunal constitutionnel ayant fait preuve d’un formalisme excessif en déclarant irrecevables des recours constitutionnels pour non-respect des conditions légales • Irrecevabilité d’un recours, faute pour le requérant d’avoir soulevé une inconstitutionnalité tirée d’une interprétation normative, ne portant pas atteinte à la substance du droit d’accès à un tribunal
Art 6 § 1 • Tribunal impartial • Présence du juge ayant rendu la décision d’irrecevabilité attaquée, dans la composition du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel • Inapplicabilité des principes de l’impartialité objective, le comité de trois juges n’étant pas une entité à part entière et autonome
FAITS
Dans la première requête, la requérante contestait le montant de sa pension de retraite devant les juridictions administratives, qui rejetèrent ses prétentions. La requérante fit un recours devant le Tribunal constitutionnel, qui le déclara irrecevable. Elle forma une opposition devant le comité de trois juges du Tribunal constitutionnel qui rejeta également sa demande. Dans la deuxième, les requérants, agents de la Direction générale des routes, exerçaient des fonctions d’inspecteurs. Ils se plaignaient de l’absence de réglementation de leurs carrières. Leur demande fut rejetée par le tribunal central administratif du Nord et la Cour suprême administrative. Les requérants introduisirent un recours devant le Tribunal constitutionnel qui le déclara irrecevable. Cette décision fut confirmée par le comité des trois juges. Dans la troisième requête, le requérant, condamné pour fraude aggravée, se plaignait d’une atteinte au principe non bis in idem. Sa demande fut rejetée par les tribunaux de première et seconde instances. Il présenta un recours devant le Tribunal constitutionnel, qui le déclara irrecevable. Le comité des trois juges confirma cette décision. Enfin, dans la quatrième requête, condamné à trois ans et deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence domestique, le requérant contestait, entre autres, l’établissement des faits qui avait abouti à sa condamnation, l’interprétation de la loi et arguait également que l’action publique ouverte à son égard pour les faits de violence domestique était prescrite. Il estimait enfin que sa condamnation avait porté atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, ainsi qu’au principe de la présomption d’innocence. Les juridictions de première et seconde instances rejetèrent sa demande. Le requérant introduisit alors un recours devant le Tribunal constitutionnel, qui le déclara irrecevable. Il ne forma pas d’opposition devant le comité de trois juges.
Article 6 § 1 (accès à un tribunal)
Requête no 55997/14 (Dos Santos Calado c. Portugal)
La requérante a posé deux questions dans son recours formé devant le Tribunal constitutionnel : l’une concernant l’inconstitutionnalité normative et l’autre l’illégalité de la norme litigieuse. Pour ces deux questions, la requérante a invoqué le même alinéa de l’article 70 § 1 de la loi organique sur le tribunal constitutionnel (« la LOTC »), fondant la compétence du Tribunal constitutionnel pour connaître d’un recours introduit devant lui. La Cour relève que le Tribunal constitutionnel a déclaré la partie du recours de la requérante concernant l’illégalité normative irrecevable au motif que son mémoire s’était fondé sur le mauvais alinéa de la disposition de la LOTC. La Cour considère que l’obligation de préciser l’alinéa de cette disposition est légale car prévue par cette même loi. Elle poursuit, en outre, un but légitime, à savoir le respect de la prééminence du droit ainsi que la bonne administration de la justice constitutionnelle. La Cour recherche donc si, en l’espèce, la restriction était proportionnée. La Cour note ainsi que le Tribunal constitutionnel a identifié les deux moyens de la requérante. L’irrecevabilité a donc été justifiée uniquement par l’omission rédactionnelle, bien que le moyen ressortît clairement du mémoire de la requérante et a été identifié par les juges. Par conséquent, et conformément à sa jurisprudence, la Cour conclut que l’approche du Tribunal constitutionnel relève d’un formalisme excessif, ayant conduit à priver la requérante d’une voie de recours offerte par le droit interne sur la question litigieuse. A titre subsidiaire, la Cour note que le Tribunal constitutionnel aurait pu inviter la requérante à corriger l’omission, comme le prévoit la LOTC, puisque le moyen ressortait clairement de son mémoire. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Requête no 68143/16 (Amador de Faria e Silva et autres c. Portugal)
La Cour relève tout d’abord que l’irrecevabilité déclarée par le Tribunal constitutionnel a été justifiée par le manquement des requérants à l’obligation de soulever l’inconstitutionnalité qu’ils dénonçaient au cours de la procédure devant le tribunal central administratif du Nord. Si la Cour admet que cette obligation s’explique par le fait que le Tribunal constitutionnel n’intervient qu’en dernier ressort, elle constate toutefois que les requérants ont bien soulevé une inconstitutionnalité en raison de la différence de traitement qui existait entre les agents des régions autonomes de Madère et des Açores et du continent dans le cadre de leur mémoire en réponse aux ministères. En revanche, le tribunal central administratif du Nord n’a pas retenu cette question et a distingué entre les catégories d’agents plutôt que de retenir la différence de traitement entre les agents inspecteurs du Portugal continental et ceux des régions autonomes de Madère et des Açores, comme l’avançaient les intéressés. La Cour observe ensuite que le Tribunal constitutionnel a considéré que les requérants auraient pu anticiper la décision du tribunal central administratif du Nord, car l’inconstitutionnalité normative dont ils se plaignaient figuraient dans un arrêt récent rendu par la Cour suprême. Or, en l’espèce, la Cour relève que l’affaire ne les concernait pas et que l’arrêt avait été rendu quelques mois avant le premier jugement ayant statué en leur faveur, sans procéder à une distinction entre les catégories d’agents. Les requérants ont donc pu être surpris par la décision du tribunal central administratif du Nord. Par conséquent, la Cour conclut que le Tribunal constitutionnel a fait preuve d’un formalisme excessif et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Requête no 78841/16 (Antunes Cardoso)
La Cour constate que le requérant n’a pas soulevé une inconstitutionnalité tirée d’une interprétation normative, son recours était donc hors du champ de la compétence du Tribunal constitutionnel. La Cour admet que, compte-tenu de la spécificité de ce tribunal, les exigences d’admission d’un recours peuvent être plus rigoureuses. Ainsi, l’interprétation d’une norme jugée non conforme à la Constitution doit présenter un degré de généralité ou d’abstraction. Or, en l’espèce, l’atteinte au principe non bis in idem soulevée par le requérant concernait son application par les tribunaux de première et seconde instances aux faits qui lui étaient reprochés. Par conséquent, aucun critère normatif n’était mis en cause au sens de la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1.
Article 6 § 1 (défaut d’impartialité du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel)
Les requérants des requêtes nos 55997/14 et 68143/16 se plaignaient du défaut d’impartialité de ce comité en raison de la présence d’un juge dans cette instance qui avait déjà rendu la décision d’irrecevabilité attaquée et était en outre le juge rapporteur. Les requérants mettaient donc en cause l’impartialité objective du comité des trois juges ayant statué sur la recevabilité de leurs recours constitutionnels. La Cour relève que le comité constitue l’instance statuant définitivement sur la recevabilité du recours constitutionnel, la décision du juge rapporteur n’en constituant qu’une étape. Le comité n’est donc pas une entité à part entière, autonome, amenée à se prononcer sur la question litigieuse. Par conséquent, la Cour conclut à l’irrecevabilité des griefs tirés de l’impartialité du comité des trois juges.
CEDH
a) Rappel des principes
Principes généraux relatifs à l’accès à un tribunal
108. Les principes généraux relatifs à l’accès à un tribunal ont été rappelés récemment dans les arrêts Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], no 76943/11, §§ 84-90, 29 novembre 2016) et Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, §§ 76-79, 5 avril 2018).
109. La Cour rappelle, en particulier, que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes ; c’est effectivement au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Vučković, précité, § 80). Sous réserve d’une interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable, le rôle de la Cour se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 49, 20 octobre 2011 et Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 149, 19 décembre 2018).
110. Cependant, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, précité, § 89, Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 115, 15 mars 2018, Zubac, précité, § 78 et Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 195, 25 juin 2019).
Principes généraux relatifs à l’accès à une juridiction supérieure
111. L’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation, et encore moins, des juridictions compétentes en matière d’amparo (Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, nos 65101/16 et 2 autres, § 99, 23 octobre 2018). Toutefois, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (Zubac, précité, § 80, et Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11).
112. Vu que la juridiction du Tribunal constitutionnel est limitée aux questions de constitutionnalité, on peut admettre que les conditions de recevabilité pour un recours constitutionnel puissent être plus rigoureuses que pour un appel. Cela dit, les autorités nationales ne jouissent pas d’un pouvoir discrétionnaire illimité à cet égard (voir, Zubac, précité, §§ 108-109). Il convient donc de prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle que le Tribunal constitutionnel y a tenu (Arrozpide Sarasola et autres, précité, § 99, et les références qui y sont citées).
113. Pour déterminer la proportionnalité de restrictions légales appliquées à l’accès aux juridictions supérieures, tel que rappelé dans l’affaire Zubac (précitée, §§ 85-99), il y a lieu de prendre en considération trois facteurs.
114. Premièrement, la Cour doit rechercher si les modalités d’exercice du recours peuvent passer pour prévisibles aux yeux d’un justiciable (voir, Zubac, § 87 et les références qui y sont citées).
115. Deuxièmement, après avoir identifié les erreurs procédurales commises au cours de la procédure et qui, en définitive, ont empêché le requérant d’accéder à un tribunal, il convient de déterminer si l’intéressé a dû supporter une charge excessive en raison de ces erreurs. Lorsque l’erreur procédurale en question n’est imputable qu’à un côté, selon le cas celui du requérant ou celui des autorités compétentes, notamment la juridiction (ou les juridictions), la Cour a habituellement tendance à faire peser la charge sur celui qui a commis l’erreur (voir, Zubac, précité, § 90 et les exemples qui y sont cités).
116. Troisièmement, il s’agira de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif ». Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour qu’un « formalisme excessif » peut nuire à la garantie d’un droit « concret et effectif » d’accès à un tribunal découlant de l’article 6 § 1 de la Convention. Pareil formalisme peut résulter d’une interprétation particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale, qui empêche l’examen au fond de l’action d’un requérant et constitue un élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux (Zubac, précité, § 97). La Cour a, ainsi, constaté, à plusieurs reprises, sur ce fondement, une violation du droit d’accès à un tribunal (voir, par exemple, Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et 9 autres, § 38, CEDH 2000‑I, Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, §§ 50-51, CEDH 2002‑IX, Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, §§ 48‑55, CEDH 2002-IX, Bulena c. République tchèque, no 57567/00, §§ 30-31, 20 avril 2004, Henrioud c. France, no 21444/11, § 67, 5 novembre 2015, Meggi Cala c. Portugal, no 24086/11, § 49, 2 février 2016, et Miessen c. Belgique, no 31517/12, §§ 72-74, 18 octobre 2016).
117. Au demeurant, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, no 35787/03, § 29, 26 juillet 2007). Le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Zubac, précité, § 98, Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 24, 27 juillet 2006).
b) Application à la présente espèce
Requête no 55997/14 (Dos Santos Calado)
118. La requérante se plaint de l’irrecevabilité de la partie de son recours formé devant le Tribunal constitutionnel qui se fondait sur le caractère non conforme à ses yeux de l’article 101 du décret-loi no 187/2007 à l’article 66 § 2 b) de la loi no 4/2007 du 16 janvier 2007 régissant la LSS (paragraphes 5, 6, 8 et 101 ci-dessus). Il s’agissait donc d’un moyen tiré de l’illégalité, au sens de l’article 280 § 1 d) de la Constitution (paragraphe 41 ci-dessus), de l’article 101 du décret-loi no 187/2007.
119. La Cour note que, par une décision sommaire du 10 décembre 2013, confirmée par un arrêt du comité de trois juges du 6 décembre 2014, cette partie de son recours a été déclarée irrecevable au motif que, dans son mémoire de recours, la requérante s’était uniquement fondée sur l’alinéa b) de l’article 70 § 1 de la LOTC qui prévoit le motif de recours tiré de l’inconstitutionnalité normative alors qu’elle aurait dû se fonder sur l’alinéa f) de cette disposition (paragraphes 6 et 8 ci-dessus).
120. Elle constate que, en vertu de l’article 75-A de la LOTC, pour saisir valablement le Tribunal constitutionnel, tout mémoire en recours doit préciser l’alinéa de l’article 70 § 1 de la LOTC sur lequel il se fonde (paragraphe 44 ci-dessus). La restriction appliquée à l’accès au Tribunal constitutionnel était donc légale. La Cour ne doute en outre pas qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir le respect de la prééminence du droit et la bonne administration de la justice constitutionnelle. Il reste donc à apprécier la proportionnalité de cette restriction au regard des circonstances de l’espèce.
121. La Cour relève que la requérante était représentée par un avocat de son choix à qui il incombait de faire preuve de la diligence requise pour l’accomplissement des actes de procédure pertinents (sur ce point, voir Zubac, précité, § 93). L’irrecevabilité de la partie du recours tirée de l’illégalité de l’article 101 du décret-loi no 187/2007 en raison de l’erreur procédurale commise au moment de la saisine du Tribunal constitutionnel est donc, à première vue, de l’entière responsabilité de la requérante (voir, a contrario, Henrioud, précité, § 65 et Gregório de Andrade c. Portugal, no 41537/02, § 41, 14 novembre 2006).
122. La Cour constate, néanmoins, que, dans sa décision sommaire du 10 décembre 2013 et son arrêt du 12 février 2014, le Tribunal constitutionnel avait bien relevé que la requérante soulevait deux moyens, l’un tiré de l’inconstitutionnalité normative et l’autre tiré de l’illégalité de la norme litigieuse (paragraphe 6 ci-dessus). L’irrecevabilité de cette deuxième partie du recours se fonde donc uniquement sur une simple omission rédactionnelle concernant un moyen de recours qui ressortait pourtant de façon claire et évidente du mémoire en recours de la requérante. Celui-ci avait, de surcroît, été identifié par le Tribunal constitutionnel.
123. Aux yeux de la Cour, une telle approche est excessivement formaliste (voir, en ce sens, Dakir c. Belgique, no 4619/12, §§ 80-81, 11 juillet 2017). Si la réglementation des formalités de recours poursuit un but légitime, à savoir la bonne administration de la justice, d’autant s’agissant du Tribunal constitutionnel, l’interprétation particulièrement stricte de l’article 75-A de la LOTC suivie en l’espèce a restreint de façon disproportionnée le droit de la requérante à voir son recours tiré d’une illégalité normative examiné au fond. Elle n’a donc pas pu se prévaloir d’une voie de recours que lui offrait le droit interne par rapport à la question litigieuse.
124. À titre subsidiaire, faisant droit à l’argument de la requérante, la Cour est d’avis que, à défaut de pouvoir requalifier son moyen de recours, le Tribunal constitutionnel aurait pu l’inviter à corriger l’omission en cause, comme le prévoyait l’article 75-A § 5 de la LOTC vu que la question litigieuse tirée d’une illégalité normative ressortait, en substance, de façon claire et évidente du mémoire en recours de la requérante.
125. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut d’accès de la requérante à un tribunal.
Requête no 68143/16 (Amador de Faria e Silva et autres)
126. La Cour constate que les requérants ont formé un recours devant le Tribunal constitutionnel dans lequel ils se plaignaient d’une atteinte aux articles 13 et 59 § 1 a) de la Constitution en raison de l’interprétation qui avait été faite de l’article 14 § 3 du décret-loi no 112/2001 du 6 avril (paragraphe 19 ci-dessus).
127. Elle note que ce recours a été déclaré irrecevable par une décision sommaire du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2016, confirmée par un arrêt du comité de trois juges du 4 mai 2016, au motif que les requérants n’avaient pas soulevé l’inconstitutionnalité alléguée devant le tribunal central administratif du Nord, faisant ainsi défaut à l’obligation qui leur revenait en vertu des articles 70 et 72 § 2 de la LOTC (paragraphes 21, 23 et 44 ci-dessus).
128. La Cour observe que, en vertu des articles 70 § 1 b) et 75 § 2 de la LOTC, toute personne souhaitant porter une question devant le Tribunal constitutionnel doit l’avoir soulevée au cours de la procédure. En effet, comme elle l’a relevé ci-dessus au paragraphe 80 s’agissant du contrôle concret de constitutionnalité prévu par l’article 280 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel n’intervient qu’en dernier ressort, après que la question de constitutionnalité ait été examinée par les tribunaux en vertu de leur obligation de ne pas appliquer une norme non conforme à la Constitution ou aux principes qui y sont consignés, en vertu de l’article 204 de la Constitution (paragraphe 41 ci-dessus).
129. En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont bien soulevé une question tirée de l’inconstitutionnalité d’une interprétation normative (voir, à cet égard, le paragraphe 78 ci-dessus) dans le cadre de leur mémoire en réponse au recours qui avait été interjeté par les ministères contre le jugement du tribunal administratif et fiscal de Coimbra (paragraphes 14, 15, 16 ci-dessus). Cela dit, cette question était différente de celle qui a finalement été retenue par le tribunal central administratif du Nord. En effet, alors que les requérants soulevaient une inconstitutionnalité en raison d’une interprétation normative faisant une différence de traitement entre les agents inspecteurs au Portugal continental et dans les régions autonomes des Açores et de Madère, le tribunal central administratif du Nord a opéré une distinction entre deux catégories d’agents, à savoir d’une part les inspecteurs de carrières et d’autre part les agents exerçant des fonctions d’inspecteur sans intégrer pour autant la carrière d’inspecteur au sein de l’administration, jugeant que le devoir de réglementation en vertu de l’article 14 du décret-loi no 112/2001 (paragraphe 57 ci-dessus) ne concernait que le premier groupe. D’après le Tribunal constitutionnel, les requérants auraient été en mesure de soulever la question d’inconstitutionnalité normative dont ils se plaignaient devant le tribunal central administratif du Nord puisqu’elle était déjà ressortie d’un arrêt rendu par la Cour suprême dans une autre affaire (paragraphe 23 ci-dessus). Or, d’une part, il s’agissait d’une affaire qui ne les concernait pas. D’autre part, l’arrêt en cause avait été rendu quelques mois avant le jugement du tribunal administratif et fiscal de Coimbra qui leur avait été favorable et n’avait, en outre, fait aucune distinction entre les catégories d’agents. Aussi, les requérants ont-ils pu être surpris par le revirement rendu par le tribunal central administratif du Nord (paragraphe 17 ci-dessus).
130. Eu égard à ces constatations, la Cour conclut que le Tribunal constitutionnel a fait preuve d’un formalisme excessif en ce qui concerne l’application des articles 70 et 72 § 2 de la LOTC posant l’obligation d’épuisement préalable de la question tirée de l’inconstitutionnalité, ce qui les a privés de voir examiner au fond la question de l’inconstitutionnalité portée devant le Tribunal constitutionnel. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Requête no 78841/16 (Antunes Cardoso)
131. S’agissant de la requête no 78841/06, la Cour note que le requérant a été condamné pour associations de malfaiteurs et fraude qualifiée par un jugement du tribunal de Tondela du 6 juin 2014, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Coimbra du 9 septembre 2015 (paragraphes 25 et 27 ci-dessus). Elle constate que, dans le cadre de son appel devant le tribunal de Tondela, le requérant a soulevé une atteinte au principe non bis in idem consacré à l’article 29 § 5 de la Constitution en raison de l’interprétation qui avait été faite de l’article 127 du CPP (paragraphes 40 et 28 ci-dessus). N’ayant pas obtenu gain de cause concernant cette question, le requérant a soulevé cette question devant le Tribunal constitutionnel (paragraphe 30 ci-dessus).
132. La Cour constate que, par une décision sommaire du Tribunal constitutionnel du 4 mai 2016, confirmée par un arrêt du comité de trois juges du 8 juin 2016, le recours constitutionnel fut déclaré irrecevable au motif que le requérant n’avait pas soulevé une inconstitutionnalité normative ou une inconstitutionnalité concernant l’interprétation d’une norme. Le recours du requérant ne rentrait pas dans le champ de compétence du Tribunal constitutionnel étant donné qu’il concernait la décision judiciaire (paragraphes 31 et 33 ci-dessus).
133. Eu égard à la nature spécifique du recours devant le Tribunal constitutionnel, identifiée comme telle au paragraphe 78 ci-dessus et, en particulier, aux conditions devant être remplies pour saisir la plus haute juridiction portugaise, la Cour accepte que les formalités procédurales puissent être rigoureuses pour garantir la bonne administration de la justice constitutionnelle au plus haut degré de la hiérarchie judiciaire (paragraphe 112 ci-dessus). Or, en l’espèce, eu égard aux observations faites au paragraphe 79 ci-dessus, lorsque c’est l’interprétation d’une norme qui est jugée non conforme à la Constitution, celle-ci doit présenter un degré de généralité ou d’abstraction démontré de manière précise (paragraphes 58-60 et 69 ci-dessus). D’après la jurisprudence interne, ceci est particulièrement valable lorsque c’est une atteinte au principe de la légalité consacré à l’article 29 § 1 de la Constitution qui est soulevée (voir les arrêts du Tribunal constitutionnel nos 587/2014, 341/2019 et 374/2019 cités aux paragraphes 70, 63 et 72 ci-dessus) ou, comme dans la présente espèce, une atteinte au principe non bis in idem consacré à l’article 29 § 5 de la Constitution (voir l’arrêt no 319/2012 cité au paragraphe 64 ci-dessus). Partant, le Tribunal constitutionnel doit éviter que des recours fondés sur l’inconstitutionnalité d’une interprétation normative soient rejetés en raison d’une interprétation excessivement restrictive ou formaliste, et que, par conséquent, la Cour soient appelée à décider en première instance des questions faisant l’objet de ces recours.
134. En l’espèce, la Cour note que, dans le cadre de son recours devant le Tribunal constitutionnel le requérant soulevait une atteinte au principe non bis in idem (paragraphe 30 ci-dessus). Cependant, l’interprétation normative qu’il dénonçait se rapportait, en réalité, à la manière dont les tribunaux de première et deuxième instance avaient appliqué les dispositions du code pénal sanctionnant les infractions d’association de malfaiteurs et de fraude qualifiée en vertu de l’article 127 du CPP qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves (paragraphe 52 ci-dessus). Le recours du requérant portait donc bien essentiellement sur l’examen des faits qui lui étaient reprochés et aucun critère normatif au sens de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel n’était donc mis en cause en l’espèce.
135. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, faute pour le requérant d’avoir soulevé une inconstitutionnalité tirée d’une interprétation normative, comme l’exigeait la jurisprudence interne, on ne saurait conclure que les limitations appliquées au requérant ont porté atteinte à la substance du droit d’accès de celui-ci à un tribunal.
136. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut d’impartialité du comité de trois juges du tribunal constitutionnel (grief spécifique aux requêtes nos 55997/14 et 68143/16)
41. Dans son arrêt récent Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal ([GC], nos 55391/13 et 2 autres, 6 novembre 2018), la Cour a rappelé les principes concernant l’impartialité d’un tribunal :
« 145. La Cour rappelle que l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris et peut s’apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c’est-à-dire en recherchant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans le cas d’espèce, ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, par exemple, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 118, CEDH 2005-XIII, et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 93, CEDH 2009).
146. Dans la très grande majorité des affaires soulevant des questions relatives à l’impartialité, la Cour a eu recours à la démarche objective (Micallef, précité, § 95, et Morice c. France [GC], no 29369/10, § 75, 23 avril 2015). La frontière entre l’impartialité subjective et l’impartialité objective n’est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective), mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective) (Kyprianou, précité, § 119). Ainsi, dans des cas où il peut être difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la présomption d’impartialité subjective du juge, la condition d’impartialité objective fournit une garantie importante supplémentaire (Pullar c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 32, Recueil 1996-III).
147. Pour ce qui est de l’appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge ou d’une juridiction collégiale un défaut d’impartialité, l’optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (Micallef, précité, § 96, et Morice, précité, § 76).
148. L’appréciation objective porte essentiellement sur les liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d’autres acteurs de la procédure (Micallef, précité, § 97). Il faut en conséquence décider dans chaque cas d’espèce si la nature et le degré du lien en question sont tels qu’ils dénotent un manque d’impartialité de la part du tribunal (Pullar, précité, § 38).
149. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance ou, comme le dit un adage anglais, « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous) (De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 26, série A no 86). Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables. Tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité doit donc se déporter (Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil 1998-VIII, et Micallef, précité, § 98). »
142. En l’espèce, les requérants ne mettent en doute que l’impartialité objective du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel, en raison de la participation du juge rapporteur qui avait rendu la décision d’irrecevabilité de leur recours constitutionnel dans le cadre du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel.
143. Eu égard aux constatations faites ci-dessus aux paragraphes 91, 92 et 93 ci-dessus, la Cour estime que les principes tirés de sa jurisprudence concernant l’impartialité objective ne sauraient être appliqués à la présente espèce étant donné la nature de l’intervention du comité de trois juges dans le cadre d’une opposition formée au titre de l’article 78-A § 3 de la LOTC. En l’occurrence, la Cour relève que le comité de trois juges est l’instance statuant définitivement sur la question de la recevabilité d’un recours constitutionnel, la décision sommaire adoptée par le juge rapporteur n’est donc qu’une étape préalable, celle-ci ne devient au demeurant définitive que si l’intéressé ne forme pas d’opposition contre elle, c’est-à-dire, s’il ne demande pas au rapporteur de reconsidérer sa décision avec, cette fois, l’assistance des deux autres juges du comité (paragraphe 73 ci-dessus). La procédure devant le juge rapporteur fait ainsi entièrement partie de la procédure d’admissibilité des recours constitutionnels prévue à l’article 78-A de la LOTC, le comité de trois juges n’est donc pas une entité à part entière et autonome appelée à se prononcer sur la question litigieuse (comparer avec San Leonard Band Club c. Malte, no 77562/01, § 61-63, CEDH 2004‑IX, Driza c. Albanie, no 33771/02, § 78-79, CEDH 2007‑V (extraits), Kayasu c. Turquie, nos 64119/00 et 76292/01, § 121, 13 novembre 2008, Pereira da Silva c. Portugal, no 77050/11, § 59-60, 22 mars 2016, Warsicka c. Pologne, no 2065/03, § 41, 16 janvier 2007, et Binder c. Allemagne (déc.), no 44455/07, 20 septembre 2011).
144. Il s’ensuit que les griefs tirés du défaut d’impartialité du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Aumatell i Arnau c. Espagne irrecevabilité du 4 octobre 2018 requête n° 70219/17
Articles 6 § 1 et 7 : L’astreinte imposée par le Tribunal constitutionnel aux membres des bureaux électoraux après la suspension du référendum sur la Catalogne n’a pas porté atteinte à la Convention. Elle a été levée après leur démission.
L’affaire concerne la participation de la requérante à l’organisation d’un référendum, prévu pour le 1er octobre 2017, qui proposait l’indépendance de la Catalogne.
La Cour constate tout d’abord que l’absence de notification personnelle de la décision du Tribunal constitutionnel n’a pas empêché Mme Aumatell i Arnau de prendre connaissance de celle-ci et de soumettre ses allégations au Tribunal Constitutionnel. L’astreinte financière infligée à Mme Aumatell i Arnau était en elle-même prévue par la loi.
Par ailleurs, Mme Aumatell i Arnau fut notifiée personnellement des ordonnances du Tribunal Constitutionnel statuant sur la suspension du référendum. De ce fait, elle savait que son comportement pouvait se heurter à l’imposition des astreintes ainsi qu’à des poursuites pénales.
LES FAITS
La requérante, Mme Montserrat Aumatell i Arnau, est une ressortissante espagnole née en 1975 et résidant à Valls.
Le 6 septembre 2017, le Parlement de Catalogne adopta la loi « du référendum de l’autodétermination » prévoyant notamment la désignation des membres du Bureau électoral central de la Catalogne chargés d’organiser le référendum.
L’avocat de l’État, représentant le Gouvernement espagnol, jugea cette loi inconstitutionnelle et sollicita sa suspension à titre provisoire.
Par une ordonnance du 7 septembre 2017, le Tribunal constitutionnel rendit la loi inapplicable et l’organisation du référendum illégale.
Le 8 septembre 2016, ignorant l’ordonnance du Tribunal constitutionnel, le Bureau électoral central nomma les membres des bureaux électoraux. Mme Aumatell i Arnau fut nommée membre du bureau électoral de Tarragone. Par une ordonnance du 13 septembre 2017, le Tribunal constitutionnel rappela aux membres des bureaux électoraux la suspension de la loi « du référendum de l’autodétermination ».
Le 20 septembre 2017, constatant la non-application de ses ordonnances, le Tribunal constitutionnel imposa une astreinte journalière d’un minimum de 6 000 euros (EUR) à tous les membres des bureaux électoraux.
Le 22 septembre 2017, Mme Aumatell i Arnau fut informée de cette décision par le Journal officiel. Elle démissionna de son poste le jour même. Par une décision du 14 novembre 2017, le Tribunal Constitutionnel leva l’astreinte imposée aux membres des bureaux électoraux, compte tenu des démissions présentées.
Article 6 § 1
Compte-tenu et au regard des divers aspects de l’affaire, la Cour conclut au caractère pénal de l’astreinte fixée à la requérante. La décision du Tribunal constitutionnel du 20 septembre 2017 imposa à Mme Aumatell i Arnau une astreinte journalière de 6 000 EUR. Préalablement, le 13 septembre 2017, Mme Aumatell i Arnau avait été notifiée personnellement des ordonnances du 7 et du 13 septembre 2017 rendant l’organisation du référendum illégale et suspendant la loi « du référendum de l’autodétermination », avec une mise en demeure judiciaire. L’imposition de l’astreinte trouve donc son origine dans la passivité de Mme Aumatell i Arnau pour s’acquitter desdites ordonnances du Tribunal constitutionnel. La décision fut publiée au Journal officiel de l’Etat (BOE), le 22 septembre 2017. Les parties bénéficièrent d’un délai de trois jours pour faire des allégations avant que l’astreinte ne fût effectivement exécutée. Une fois que la démission fut reçue par la haute juridiction, le tribunal prit la décision de lever l’astreinte. Mme Aumatell i Arnau reçut personnellement les ordonnances du Tribunal constitutionnel l’avertissant de son devoir de prévenir ou d’arrêter toute initiative qui ignorerait ou éluderait la suspension du référendum convenue par le Tribunal Constitutionnel.
La Cour constate par conséquent que l’absence de notification personnelle de la décision du 20 septembre 2017 n’a pas empêché Mme Aumatell i Arnau de prendre connaissance de celle-ci et de soumettre ses allégations au tribunal Constitutionnel. Le grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé.
Article 7
L’astreinte infligée à Mme Aumatell i Arnau était en elle-même prévue par la loi. La loi organique 2/1979 relative au Tribunal Constitutionnel espagnol (LOTC), depuis sa modification du 16 octobre 2015, prévoit que le Tribunal Constitutionnel, lorsqu’il y a un risque qu’une de ses décisions puisse ne pas être respectée, peut décider de notifier personnellement ses décisions à toute autorité ou fonctionnaire public, s’il l’estime nécessaire. Par ailleurs, le Tribunal est habilité à exiger des explications aux institutions, autorités, fonctionnaires publics ou particuliers concernés par l’exécution et la décision dans le délai fixé. Finalement, si la désobéissance persiste au-delà du délai fixé, le Tribunal peut prendre certaines mesures parmi lesquelles l’imposition d’une astreinte pour les responsables de l’infraction.
La Cour ne peut conclure à une absence de prévisibilité dans la mesure où l’astreinte, comme la procédure y relative, étaient prévues dans la LOTC.
Par ailleurs, Mme Aumatell i Arnau fut notifiée personnellement des ordonnances du Tribunal Constitutionnel statuant sur la suspension du référendum. De ce fait, elle savait que son comportement pouvait se heurter à l’imposition des astreintes ainsi qu’à des poursuites pénales. De plus, la Cour constate qu’une fois que Mme Aumatell i Arnau eut démissionné, le Tribunal Constitutionnel leva l’astreinte sans que cette dernière n’ait subi aucune atteinte économique effective, aucune somme ne lui ayant été prélevée. Rien ne permet par conséquent de conclure que la formulation de la LOTC au moment des faits manquait de clarté ou de prévisibilité ou que la juridiction constitutionnelle aurait donné une interprétation arbitraire des dispositions. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant mal fondée.
Article 13
La CEDH constate que l’article 93 de la LOTC prévoit un recours de súplica contre les décisions du Tribunal constitutionnel. En effet, les autres membres des bureaux électoraux concernés interjetèrent un recours de súplica contre la décision du Tribunal constitutionnel du 20 septembre 2017 imposant les astreintes. Et le 14 novembre 2017, le Tribunal constitutionnel répondit à l’ensemble de leurs griefs et leva les astreintes. Le grief d’absence de recours doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé.
Article 14
Mme Aumatell i Arnau invoque cette disposition de manière isolée et n’étaye pas ses prétentions. Elle n’apporte aucun terme de comparaison qui pourrait permettre à la Cour d’examiner une éventuelle analogie entre deux situations laissant supposer une discrimination. Cette partie de la requête est également mal fondée et doit être rejetée.
CEDH
ARTICLE 6-1 : IRRECEVABILITÉ
1. Épuisement des voies des recours internes
45. La Cour note premièrement que, contrairement à la requérante, les autres membres des bureaux électoraux -tant ceux appartenant au bureau central, que ceux appartenant aux bureaux territoriaux- ont interjeté un recours de súplica contre la décision du Tribunal constitutionnel du 20 septembre 2017 imposant les astreintes. Par une décision du Tribunal constitutionnel du 14 novembre 2017, ils ont tous reçu une réponse détaillée à l’ensemble de leurs griefs. Cette même décision leva les astreintes imposées.
46. Cependant, outre le fait que la requérante allègue ne pas avoir été personnellement notifiée de la décision du 20 septembre et, par conséquent, ne pas avoir pu présenter des allégations à son encontre, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher plus en avant sur la question relative à l’épuisement des voies de recours par la requérante, dans la mesure où la requête se heurte à un autre motif d’irrecevabilité.
2. Le caractère pénal des astreintes
47. La Cour rappelle que le point de départ de l’examen de l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 de la Convention repose sur les critères énoncés dans l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas, §§ 82-83, et réaffirmés plus récemment dans l’arrêt Jussila c. Finlande [GC], § 30) :
1. la qualification en droit interne,
2. la nature de l’infraction,
3. la sévérité de la peine que la personne concernée risque d’encourir
48. S’agissant du premier critère, la Cour observe qu’en l’espèce le Tribunal Constitutionnel considéra que les astreintes ne constituaient pas une sanction au sens strict (voir § 35 ci-dessus). Elle note néanmoins que la Commission de Venise s’est prononcée sur le sujet (voir §40 ci-dessus) signalant que :
« ces astreintes peuvent être assimilées, notamment en raison de leur montant, (de 3.000€ à 30.000€) à une accusation d’infraction au sens de l’article 6 ».
49. À cet égard, la Cour rappelle que la qualification en droit interne n’est qu’un simple point de départ et n’est cependant pas déterminante aux fins de la Convention, eu égard au sens autonome et matériel qu’elle attribue aux termes « accusation en matière pénale » (voir par exemple les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 26-27, § 19, et Demicoli c. Malte du 27 août 1991, série A no 210, pp. 15-16, § 31). L’indication ainsi fournie par le droit national n’a qu’une valeur formelle et relative; la « nature même de l’infraction représente un élément d’appréciation d’un plus grand poids » (arrêt Engel et autres précité, pp. 34-35, § 82).
50. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Pour que l’article 6 s’applique, il suffit que l’infraction en cause soit, par nature, pénale ou ait exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la matière pénale (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 86, CEDH 2003‑X).
51. Quant au deuxième critère, à savoir l’appréciation de la nature même de l’infraction en cause, la Cour a toujours pris en compte l’étendue du cercle de personnes auxquelles est adressée la règle transgressée, le type et la nature des intérêts protégés, ainsi que l’existence d’un objectif de dissuasion et de répression (Kadubec c. Slovaquie, 2 septembre 1998, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI ; Lauko c. Slovaquie, 2 septembre 1998, § 58, Recueil 1998‑VI ; Ezeh et Connors, précité, §§ 103-105 ; Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], no 14939/03, § 55, CEDH 2009, et Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (no 2), no 2376/03, § 49, 14 janvier 2010).
52. À cet égard la Cour note premièrement que, même si en l’espèce la LOTC avait une portée générale, les destinataires de la disposition qui a servi de base légale à l’astreinte imposée à la requérante font partie d’un cercle spécifique de personnes, physiques ou juridiques, décrites à l’article 92 § 4 de la LOTC, (voir, a contrario, Stanchev c. Bulgarie, no 8682/02, § 45, 1er octobre 2009). La Cour doit ensuite examiner si la norme générale poursuit un but « à la fois dissuasif et répressif ». Sur ce point, la Cour estime que les astreintes, qui, en l’espèce, revêtent la forme d’amendes, ne tendent pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice, mais ont un caractère essentiellement punitif et dissuasif (A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, 29 août 1997, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V).
53. Plus concrètement, la Cour note que l’astreinte prévue à l’article 92 § 4. a) de la LOTC vise pour l’essentiel à empêcher la réitération de manquements aux décisions du Tribunal Constitutionnel (voir, mutatis mutandis et à propos de la notion d’« accusation en matière pénale », Bendenoun c. France, 24 février 1994, § 47, série A no 284). Ainsi, l’astreinte imposée en l’espèce visait notamment à contraindre la requérante à s’acquitter de la décision du Tribunal dont elle était redevable, et non à la punir de ne point l’avoir fait. L’objectif poursuivi par la sanction était donc principalement la dissuasion.
54. Le troisième critère devant enfin être examiné est celui relatif au degré de sévérité de la sanction encourue. À cet égard, la Cour estime devoir attribuer un poids important à la gravité de la sanction encourue. Elle note que, selon la LOTC, celle-ci peut aller jusqu’ à 30,000 EUR par jour, et ne peut en aucun cas être inférieure à 3,000 EUR. En l’espèce, l’astreinte appliquée par le Tribunal s’éleva à 6,000 EUR par jour. Certes, cette astreinte ne pouvait être convertie en peine d’emprisonnement en cas de non-paiement, mais cela n’est pas déterminant quant à la qualification « pénale » de l’infraction (Lauko c. Slovaquie, 2 septembre 1998, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI).
55. Compte tenu des divers aspects de l’affaire, et ayant examiné leur poids respectif, la Cour se doit de constater la prédominance de ceux qui présentent une coloration pénale, (voit mutatis mutandis Valico S.r.l. c. Italie (déc.), no 70074/01, CEDH 2006‑III) et décide de conclure au caractère pénal de l’astreinte fixée à la requérante en l’espèce.
56. De ce fait, la Cour devra ensuite rechercher si la requérante a bénéficié des droits garantis par le volet pénal de l’article 6 de la Convention devant la juridiction constitutionnelle. Par conséquent, il conviendra de rechercher, en tenant dûment compte des circonstances de la cause, notamment des éléments pertinents du cadre constitutionnel dans lequel celle-ci s’inscrit, si la procédure dont la requérante a fait l’objet a bien respecté les exigences de l’article 6.
3. La procédure devant le Tribunal Constitutionnel
57. La Cour rappelle que la décision du Tribunal Constitutionnel du 20 septembre 2017 imposa à la requérante une astreinte journalière de 6,000 EUR. Préalablement, le 13 septembre 2017, elle avait été notifiée personnellement des ordonnances du Tribunal Constitutionnel du 7 et du 13 septembre 2017 (procédure constitutionnelle no 4332/17), statuant sur la suspension de la Résolution no 807/XI avec une mise en demeure judiciaire (voir paragraphes 27-28 ci-dessus). L’imposition de l’astreinte trouve ainsi son origine dans la passivité de la requérante pour s’acquitter desdites ordonnances du Tribunal constitutionnel (voir paragraphe 15 ci-dessus).
58. Selon les dires de la requérante, la décision du 20 septembre 2017 lui imposant l’astreinte ne lui aurait pas été notifiée, n’ayant par conséquent pas eu l’occasion de soulever des allégations, La Cour admet à cet égard que, la décision d’imposer des astreintes sans audition préalable des parties, et notamment de la partie concernée par l’astreinte, pourrait soulever un problème du point de vue de l’article 6 de la Convention (Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 40-49, CEDH 2006‑XIV). Cependant, elle constate que la décision litigieuse fut publiée dans le BOE le 22 septembre 2017 et les parties, incluant la requérante ainsi que le Ministère Public, bénéficièrent d’un délai de trois jours pour faire des allégations avant que l’astreinte ne fût effectivement exécutée. En effet, une fois que la démission de la requérante fut reçue par la haute juridiction, le Tribunal prit la décision, le 14 novembre 2017, de lever l’astreinte.
59. La Cour rappelle de surcroit que la requérante fut notifiée personnellement des ordonnances du Tribunal Constitutionnel l’avertissant de son devoir de prévenir ou d’arrêter toute initiative qui ignorerait ou éluderait la suspension convenue par le Tribunal Constitutionnel.
60. La Cour constate par conséquent que l’absence de notification personnelle de la décision du 20 septembre 2017 n’a pas empêché la requérante de prendre connaissance de celle-ci et de soumettre ses allégations au Tribunal constitutionnel.
61. Eu égard à la procédure dans son ensemble, à la nature du litige et à la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales, la Cour estime que les limitations subies par la requérante ne portent aucune atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, §161, CEDH 2017 (extraits).
62. A la lumière des arguments qui précèdent, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
ARTICLE 7
63. Pour autant que la requérante invoque l’article 7 de la Convention, la Cour note que le triple critère établi dans l’affaire Engel et autres c. Pays-Bas, § 82 (réaffirmé dans l’arrêt Jussila c. Finlande [GC], § 30) pour qualifier une accusation de « pénale » au sens de l’article 6 doit être adopté aussi pour ce qui est de l’article 7 (Brown c. Royaume-Uni (déc.) ; Société Oxygène Plus c. France (déc.), § 43 , et Žaja c. Croatie, § 86).
64. À cet égard, à supposer même que la sanction infligée à la requérante puisse être considérée comme rentrant dans le champ d’application de l’article 7, il convient de noter que l’astreinte était en elle-même prévue par la loi au sens de l’article 7 de la Convention si on tient compte du droit interne « dans son ensemble » (Del Río Prada c. Espagne, no 42750/09, 21 octobre 2013, § 91). En effet, la LOTC, depuis sa modification du 16 octobre 2015, prévoit dans ses dispositions pertinentes que, lorsqu’il y a un risque qu’une de ses décisions puisse ne pas être respectée, le Tribunal Constitutionnel pourra décider de notifier personnellement ses décisions à toute autorité ou fonctionnaire public, s’il l’estime nécessaire (article 92 § 2 de la LOTC). Par ailleurs, si l’on constate qu’une décision rendue dans l’exercice de sa juridiction pourrait être enfreinte, il est habilité à exiger des explications aux institutions, aux autorités, aux fonctionnaires publics ou particuliers concernés par l’exécution de la décision dans le délai fixé (article 92 § 4 de la LOTC). Finalement, si la désobéissance persiste au-delà du délai fixé, le Tribunal peut prendre certaines mesures, parmi lesquelles l’imposition d’une astreinte pour les responsables de l’infraction (faculté déjà accordée avant la réforme de 2015 par l’article 95 § 4 LOTC).
65. Partant, la Cour ne peut conclure à une absence de prévisibilité à la lumière de l’article 7 de la Convention, dans la mesure où tant l’astreinte que la procédure y relative étaient prévues dans la LOTC.
66. La Cour rappelle en outre que la requérante fut notifiée personnellement des ordonnances du Tribunal Constitutionnel statuant sur la suspension de la Résolution no 807/XI. De ce fait, elle savait – ou devait savoir – que son comportement pouvait se heurter à l’imposition des astreintes ainsi qu’à des poursuites pénales.
67. La Cour constate par ailleurs qu’une fois que la requérante démissionna, le Tribunal Constitutionnel leva l’astreinte, sans que la requérante n’ait subi aucune atteinte économique effective, aucune somme lui ayant été prélevée.
68. A la lumière des principes établis en la matière par la Cour, rien ne permet de conclure que la formulation de la LOTC au moment des faits litigieux manquait de clarté ou de prévisibilité ou que la juridiction constitutionnelle aurait donné une interprétation arbitraire des dispositions.
69. Il convient donc de déclarer aussi cette partie de la requête irrecevable comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
ARTICLE 13
70. La requérante se plaint d’une violation de l’article 13 de la Convention résultant de l’absence de recours contre la décision du Tribunal Constitutionnel. Elle maintient que l’absence d’une voie de recours contre une décision du Tribunal Constitutionnel portant atteinte à son droit à un procès équitable est contraire à l’article 13 de la Convention.
71. La Cour rappelle que l’article 13 reconnaît à toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, le droit à un recours effectif devant une instance nationale. En l’espèce, elle note que le grief de la requérante est dirigé contre le Tribunal Constitutionnel, qui est l’autorité judiciaire la plus élevée dans le système interne espagnol, ainsi que l’unique autorité judiciaire constitutionnelle. La Cour estime que lorsqu’il est allégué, comme en l’espèce, qu’une violation d’un droit reconnu par la Convention a été commise par la plus haute juridiction de l’ordre juridique interne, l’application de l’article 13 subit une limitation implicite, (voir, mutatis mutandis, Stoyanova-Tsakova c. Bulgarie, no 17967/03, § 32, 25 juin 2009; Amihalachioaie c. Moldavie (déc.), no 60115/00 23 avril 2002, et Crociani et autres c. Italie (déc.), nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, 18 décembre 1980). En tout état de cause, la Cour constate, en ce qui concerne la présente affaire, que l’article 93 de la LOTC prévoit un recours de súplica contre les décisions du Tribunal constitutionnel rendues en la matière. En effet, comme a été noté ci-dessus (voir §45), les autres membres des bureaux électoraux interjetèrent un recours de súplica contre la décision du Tribunal constitutionnel du 20 septembre 2017 imposant les astreintes. La décision du Tribunal Constitutionnel du 14 novembre donna réponse à l’ensemble de leurs griefs et leva les astreintes.
72. La Cour note également qu’en ce qui concerne l’un de ces recours de súplica, le Tribunal constitutionnel fit droit aux prétentions d’un membre d’un autre bureau électoral, celui de la démarcation électorale d’Aran. En effet le Tribunal constitutionnel considéra que ce membre avait respecté les ordonnances du 7 et 13 septembre 2017 dans la mesure où il avait démissionné le jour même de sa nomination en tant que membre du bureau électoral d’Aran, et qu’il avait communiqué cette décision au Parlement de la Catalogne. La haute juridiction décida de revenir sur sa décision et laissa sans effet l’imposition des astreintes.
73. Dès lors, le grief de la requérante doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
ARTICLE 14
74. Pour ce qui est du grief de la requérante tiré de la prétendue discrimination dont elle aurait fait l’objet, en raison de son implication dans le referendum, la Cour rappelle que l’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante et ne peut être invoqué qu’à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses protocoles (arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 27 § 62). En tout état de cause, la Cour note que cette disposition interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en la matière dans des situations comparables, et note que ce précepte exige d’apporter un élément de comparaison (Graziani-Weis c. Autriche, no 31950/06, 18 octobre 2011).
75. La Cour constate à cet égard qu’en l’espèce, outre le fait que la requérante invoque cette disposition de façon isolée, elle n’étaye pas ses prétentions, n’apportant aucun terme de comparaison qui pourrait permettre à la Cour d’examiner une éventuelle analogie entre deux situations.
76. Il s’ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Jureša c. Croatie du 22 mai 2018 requête n° 24079/11
Le changement dans l’application faite par la Cour suprême croate du droit en matière d’héritage est conforme à la Convention européenne.
Non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. La requérante, Mme Jureša, se plaignait de ne pas avoir été autorisée à porter devant la Cour suprême un litige relatif à un héritage. Dans un revirement de jurisprudence, la Cour suprême avait déclaré irrecevable le pourvoi dont Mme Jureša l’avait saisie, au motif que la valeur du litige n’atteignait pas le seuil légal. La Cour estime que pareille évolution dans la manière dont les juges interprètent et appliquent la loi relève de l’appréciation souveraine des juridictions internes à moins qu’elle ne soit arbitraire ou manifestement déraisonnable. Tel n’étant pas le cas de la décision litigieuse, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation des droits de Mme Jureša.
EXPLICATIONS DE LA CEDH
Article 6 § 1 La Cour note que la question centrale de l’affaire est la manière dont la Cour suprême croate a interprété l’article 37 § 2 de la loi sur la procédure civile, qui disposait notamment que lorsqu’une action comprenait plusieurs griefs, la valeur du litige devait s’apprécier pour chacun des griefs pris séparément. Au moment du pourvoi, en février 2009, la Cour suprême considérait comme un seul et même grief ceux soulevés dans les actions du type de celle engagée par le proche de Mme Jureša (c’est-à-dire les actions qui tendaient à l’obtention de la reconnaissance d’un droit de propriété et de l’inscription de ce droit dans les registres). Cependant, à partir de février 2010, elle a adopté une nouvelle interprétation de la loi, selon laquelle de telles actions étaient constituées de deux griefs distincts. Cette interprétation semble avoir persisté dans la pratique après mai 2010. La décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire de Mme Jureša constituait donc un revirement de jurisprudence plutôt qu’un cas d’interprétation divergente de la loi qui eût été de nature à créer une incertitude juridique. La Cour rappelle que pareille évolution dans la manière dont les juges interprètent la loi relève de l’appréciation souveraine des juridictions internes à moins qu’elle ne soit arbitraire ou manifestement déraisonnable, et ce a fortiori dans les pays tels que la Croatie, qui ont un système de droit écrit et où les tribunaux ne sont en théorie pas liés par la règle du précédent. Au vu des circonstances de la cause, elle conclut à la non-violation des droits de Mme Jureša.
Renard et autres C. France décision d'irrecevabilité du 17 septembre 2015 requête 3569/12
Irrecevabilité au sens de l'article 6-1 : Le refus d'accès au Conseil Constitutionnel par voie de QPC n'est pas contraire à la CEDH en cas d'absence d'arbitraire.
15. S’agissant de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que la question qui lui est posée en l’espèce est celle de savoir si les garanties du procès équitable doivent être respectées lors de l’examen de la QPC par les juridictions ordinaires, c’est-à-dire, par opposition au Conseil constitutionnel, les juridictions du fond et de cassation.
16. Or, la Cour constate que l’issue des procédures au fond était déterminante au regard des droits garantis par l’article 6 de la Convention, les QPC ayant été posées à l’occasion de litiges portant, soit sur des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, devant les juridictions ordinaires saisies des affaires au principal (mutatis mutandis, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, §§ 114-116, CEDH 2000 VII).
17. Partant, à ce stade, cela suffit à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention trouve bien à s’appliquer.
18. La Cour relève d’emblée que les requérants n’ont pas interjeté appel des jugements rendus à leur encontre en première instance (requêtes nos 9145/12 et 9161/12) ou que leur instance est encore pendante devant les juridictions internes (requête no 3569/12). Or, elle n’entend pas séparer l’examen des conditions du refus de renvoi d’une QPC par la Cour de cassation ou le Conseil d’État de celui de l’équité du litige principal que la Cour apprécie au regard de l’ensemble de la procédure et de son issue (mutatis mutandis, Tisset c. France (déc.), no 60681/10, 12 avril 2011).
19. La Cour estime dès lors qu’il y a de forts doutes quant au fait que les requérants aient épuisé les voies de recours internes dans ces trois affaires, mais elle ne juge pas nécessaire de trancher cette question dans la mesure où les griefs sont de toute manière irrecevables pour les raisons qui suivent.
20. S’agissant des griefs dirigés contre la Cour de cassation, tirés de la substitution par celle-ci de son appréciation à celle du Conseil constitutionnel, de son défaut d’impartialité et du manque de motivation de ses arrêts, la Cour considère que les requérants se plaignent pour l’essentiel d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au Conseil constitutionnel, compte-tenu du refus par la Cour de cassation de lui renvoyer les QPC.
21. Elle rappelle que l’article 6 de la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit d’accès à un tribunal pour contester la constitutionnalité d’une disposition légale, notamment lorsque le droit national prévoit que le contrôle de constitutionnalité n’est pas déclenché directement par un requérant, mais par un renvoi effectué par la juridiction devant laquelle l’inconstitutionnalité alléguée est soulevée (Previti c. Italie (déc.), 12 avril 2007, no 35201/06).
22. La Cour n’exclut toutefois pas que, lorsqu’un tel mécanisme de renvoi existe, le refus d’un juge interne de poser une question préjudicielle puisse, dans certaines circonstances, affecter l’équité de la procédure. Il en va ainsi lorsque le refus s’avère arbitraire, c’est-à-dire lorsqu’il y a refus alors que les normes applicables ne prévoient pas d’exception au principe de renvoi préjudiciel ou d’aménagement de celui-ci, lorsque le refus se fonde sur d’autres raisons que celles qui sont prévues par ces normes, et lorsqu’il n’est pas dûment motivé au regard de celles-ci (voir, notamment, Coëme et autres, précité, § 114, et Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, nos 3989/07 et 38353/07, §§ 57-59, 20 septembre 2011, avec la jurisprudence citée).
23. À ce titre, si la procédure de QPC permet à un justiciable de contester, à l’occasion d’un litige devant une juridiction ordinaire, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d’une disposition législative, la Cour note que la Cour de cassation et le Conseil d’État ne sont pas tenus, en dernier lieu, de renvoyer la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, notamment si ces juridictions estiment que celle-ci n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux (paragraphe 9 ci-dessus). Ce faisant, le droit interne leur confère un certain pouvoir d’appréciation, visant à réguler l’accès au Conseil constitutionnel. La Cour relève que ce pouvoir n’est pas en contradiction avec la Convention et qu’elle se doit par ailleurs d’en tenir compte dans l’exercice de son contrôle.
24. En l’espèce, la Cour constate que la Cour de cassation a motivé ses décisions au regard des critères de non-renvoi d’une QPC tels qu’énoncés par l’article 23-5 de la loi organique. Elle ne relève dès lors aucune apparence d’arbitraire de nature à affecter l’équité des procédures en cause et considère en conséquence qu’il n’y a pas eu d’atteinte injustifiée au droit d’accès au Conseil constitutionnel.
25. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être déclarés irrecevables et rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
ARRIBAS ANTÓN c. ESPAGNE du 20 janvier 2015 requête 16563/11
Non violation de l'article 6-1 : Les Etats ont le droit d'imposer que le recours devant le Conseil Constitutionnel (ici l'amparo) soit assujetti à la démonstration qu'il s'agit d'une question d'importance.
41. La Cour rappelle d’emblée que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, et Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 61, CEDH 2002‑IX).
42. La Cour rappelle également que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des juridictions d’appel ou de cassation et, encore moins, des juridictions compétentes en matière d’amparo. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (voir, mutatis mutandis, Khalfaoui c. France, no 34791/97, § 37, CEDH 1999-IX). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par cette disposition dépend des particularités de la procédure en cause. La Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres, précité, § 69, Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX, et Ferré Gisbert c. Espagne, no 39590/05, § 28, 13 octobre 2009). Il convient de prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle que le Tribunal constitutionnel y a tenu, les conditions de recevabilité d’un recours d’amparo pouvant toutefois être plus rigoureuses que pour un appel ordinaire (voir, mutatis mutandis, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, § 37, 19 décembre 1997, Recueil 1997‑VIII, et Běleš et autres, précité, § 62).
43. La Cour estime que ces principes sont applicables en l’espèce. Elle observe que la décision du Tribunal constitutionnel était fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre la recevabilité du recours d’amparo, au sens de l’article 50 § 1 b) de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel, tel que modifié par la Loi organique no 6/2007 du 24 mai 2007.
44. Elle note que le requérant soutient avoir été privé de son droit d’accès au Tribunal constitutionnel en raison d’un motif d’irrecevabilité, introduit par les articles 49 § 1 et 50 § 1 b) de la Loi organique no 6/2007 du 24 mai 2007, portant sur l’obligation incombant à tout auteur d’un recours d’amparo de démontrer que celui-ci revêt une importance constitutionnelle spéciale, motif que l’intéressé estime excessivement formel.
45. Elle relève que le requérant a introduit son recours d’amparo le 9 juillet 2010, après que le Tribunal constitutionnel eut rendu les décisions no 188/2008 du 21 juillet 2008 et no 289/2008 du 22 septembre 2008 et après l’arrêt du Tribunal constitutionnel no 155/2009 du 25 juin 2009 (paragraphes 20 et suivants ci-dessus). Les décisions et l’arrêt en cause n’ont fait que préciser davantage les termes des nouveaux articles 49 § 1 et 50 § 1 b) de la Loi organique no 6/2007 du 24 mai 2007, dont l’exposé des motifs se faisait déjà l’écho puisqu’il y était précisé que l’auteur du recours devait « alléguer et (...) prouver que le contenu de son recours [requérait] une décision au fond du Tribunal constitutionnel en raison de l’importance constitutionnelle spéciale que revêt[ait] ce recours pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la Constitution » (paragraphe 20 ci-dessus). Depuis cette modification législative, pour qu’un recours d’amparo soit déclaré recevable, son auteur doit remplir les critères de recevabilité prévus aux articles 41 à 46 et 49 LOTC, et notamment respecter l’obligation impérative énoncée à l’article 49 § 1 in fine LOTC consistant à démontrer que son recours revêt une importance constitutionnelle spéciale.
46. À cet égard, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité des choix de politique jurisprudentielle opérés par les juridictions internes et que son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences de ces choix. Elle rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Brualla Gómez de la Torre, précité, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil 1998‑I). Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter – ou, comme c’est le cas dans la présente affaire, de conditions de recevabilité – pour le dépôt des documents ou pour l’introduction des recours (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Ce principe exige, d’une part, que le Tribunal constitutionnel définisse le contenu et la portée du critère d’importance constitutionnelle spéciale, ce qu’il s’emploie à faire depuis la modification de sa Loi organique en 2007 (paragraphes 20 et suivants ci-dessus) et, d’autre part, qu’il explicite son application aux affaires déclarées recevables en vue d’assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les décisions prises à cet égard par le Tribunal constitutionnel soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000‑I). En l’espèce, la Cour observe que le requérant se borne à exprimer son désaccord avec les nouvelles modalités du recours d’amparo et qu’il reproche au Tribunal constitutionnel d’avoir péché par excès de formalisme.
47. La Cour rappelle à cet égard qu’il peut ne pas être contraire à la Convention qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se bornant à citer les dispositions légales qui prévoient une telle procédure, si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière ou si le recours ne présente pas des perspectives suffisantes de succès (voir, mutatis mutandis, les décisions suivantes, relatives à des décisions d’irrecevabilité de recours constitutionnels (Verfassungsbeschwerden) du Tribunal constitutionnel fédéral allemand : Simon c. Allemagne (déc.), no 33681/96, 6 juillet 1999, Teuschler c. Allemagne (déc.), no 47636/99, 4 octobre 2001, Greenpeace E.V. et autres c. Allemagne (déc.), no 18215/06, 12 mai 2009, et John c. Allemagne (déc.), no 15073/03, 13 février 2007).
48. En ce qui concerne un défaut allégué de motivation du Tribunal constitutionnel dans des décisions d’irrecevabilité de recours d’amparo, la Cour rappelle avoir jugé que le rejet d’un recours motivé par la seule référence à la disposition de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel applicable à l’affaire avait satisfait aux exigences de l’article 6 de la Convention et était dénué d’arbitraire (Almenara Alvarez c. Espagne, no 16096/08, § 27, 25 octobre 2011, Varela Geis c. Espagne (déc.), no 61005/09, § 38, 20 septembre 2011, et Rupprecht c. Espagne (déc.), no 38471/10, § 17, 19 février 2013).
49. La Cour estime que le but poursuivi par le changement législatif de 2007 est légitime : en effet, comme le mentionne le Gouvernement, ce changement vise à améliorer le fonctionnement du Tribunal constitutionnel et à renforcer la sauvegarde des droits fondamentaux, et ce pour éviter un encombrement excessif du rôle du Tribunal constitutionnel par des affaires de moindre importance. Encore faut-il que l’irrecevabilité d’un recours d’amparo ne porte pas atteinte à la substance même du droit du requérant à un « tribunal », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
50. Eu égard à la spécificité du rôle que joue le Tribunal constitutionnel en tant que juridiction de protection ultime des droits fondamentaux (Ferré Gisbert, précité, § 39), la Cour estime que l’on peut admettre que la procédure suivie devant ledit tribunal soit assortie davantage de formalisme. Par ailleurs, elle estime que le fait de subordonner la recevabilité d’un recours d’amparo à l’existence de circonstances objectives et à leur justification par l’auteur du recours, qui sont des critères prévus par la loi et interprétés par la jurisprudence constitutionnelle – tels que l’importance de la cause pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la Constitution ou pour la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux (paragraphe 29 ci-dessus) –, n’est pas, en tant que tel, disproportionné ou bien contraire au droit d’accès au Tribunal constitutionnel. Elle observe que le Tribunal constitutionnel applique les critères en question en faisant preuve de souplesse (paragraphe 23 ci-dessus) : en effet, il tient compte de la date d’introduction du recours d’amparo par rapport au prononcé de son arrêt no155/2009 (paragraphe 22 ci-dessus) qui énumérait de façon non exhaustive des situations susceptibles d’être considérées comme revêtant une importance constitutionnelle spéciale. La Cour souligne que les critères objectifs, que le Tribunal constitutionnel doit préciser et appliquer dans sa jurisprudence, étaient néanmoins déjà mentionnés dans l’exposé des motifs de la Loi organique no 6/2007 entrée en vigueur dès le 25 mai 2007 (paragraphe 20 ci-dessus). Par ailleurs, elle relève qu’en l’espèce la procédure devant le Tribunal constitutionnel succédait à l’examen de la cause du requérant par deux instances judiciaires devant lesquelles il a pu se défendre et qui se sont prononcées par des décisions motivées et non arbitraires, à savoir le juge du contentieux administratif de Bilbao en première instance et le Tribunal supérieur de justice du Pays basque en appel.
51. La Cour rappelle par ailleurs qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour définir la politique la plus opportune en matière de réglementation d’accès aux recours, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Sa tâche ne consiste donc point à contrôler in abstracto la loi et la pratique pertinentes, mais à rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant a enfreint la Convention. Par conséquent, elle tient à souligner que le fait que le Tribunal constitutionnel a déclaré un recours d’amparo irrecevable au motif qu’il ne revêtait pas l’importance constitutionnelle spéciale requise ou, le cas échéant, que son auteur n’avait pas démontré l’existence de pareille importance n’empêche pas la Cour de se prononcer sur la recevabilité et le fond d’une requête dont elle serait saisie à ce sujet (voir, parmi d’autres, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, CEDH 2013, Varela Geis c. Espagne, no 61005/09, 5 mars 2013, Manzanas Martín c. Espagne, no 17966/10, 3 avril 2012, et R.M.S. c. Espagne, no 28775/12, 18 juin 2013, arrêts rendus par la Cour à la suite de décisions d’irrecevabilité des recours d’amparo par le Tribunal constitutionnel espagnol).
52. À la lumière de qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas été privé de la substance de son droit d’accès à un tribunal. En outre, les limitations appliquées poursuivaient un but légitime. L’application des limitations en cause n’a pas porté atteinte au caractère raisonnable du rapport entre les moyens employés et le but visé. Pour ces raisons, la Cour estime que le requérant n’a pas subi d’entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il n’y pas eu violation de cette disposition.
Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH, lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.