ARTICLE 6 DE LA CEDH
Pour plus de sécurité, fbls moyen de se défendre est sur : https://www.fbls.net/6-1defense.htm
"Le respect des moyens de défense, est un droit fondamental dans une société
démocratique"
Frédéric Fabre docteur en droit.
Article 6§1 en ses termes compatibles en matière pénale et civile :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement () par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle"
En ce sens l'article 6-1 est doublé par l'article 6-3d pour les accusés en matière pénale :
Article 6-3/d en ses termes compatibles en matière pénale :
"Tout accusé a droit notamment à:
d/ interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge"
Il s'agit des rares cas où les requérants ont été placés en net désavantage par rapport à leur adversaire.
 Cliquez sur un bouton ou un lien bleu pour accéder à la jurisprudence gratuite sur :
Cliquez sur un bouton ou un lien bleu pour accéder à la jurisprudence gratuite sur :
- soit ils n'ont pas eu accès au dossier
- soit ils ne sont pas entendus par le tribunal malgré le principe d'immédiateté
- soit ils ne sont pas libres d'employer le système de défense qu'ils ont choisi
- soit ils n'ont pas eu accès au rapport et aux réquisitions du parquet
- soit ils n'ont pas eu accès aux conclusions de la partie adverse
- soit ils n'ont pas accès au dossier médical car le secret médial leur est opposé
- soit ils n'ont pas de réponse à leurs moyens de défense
- soit ils subissent à l'audience des débats trop longs qui les fatiguent
CLIQUEZ SUR LES BOUTONS CI-DESSOUS POUR ACCEDER A LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH.
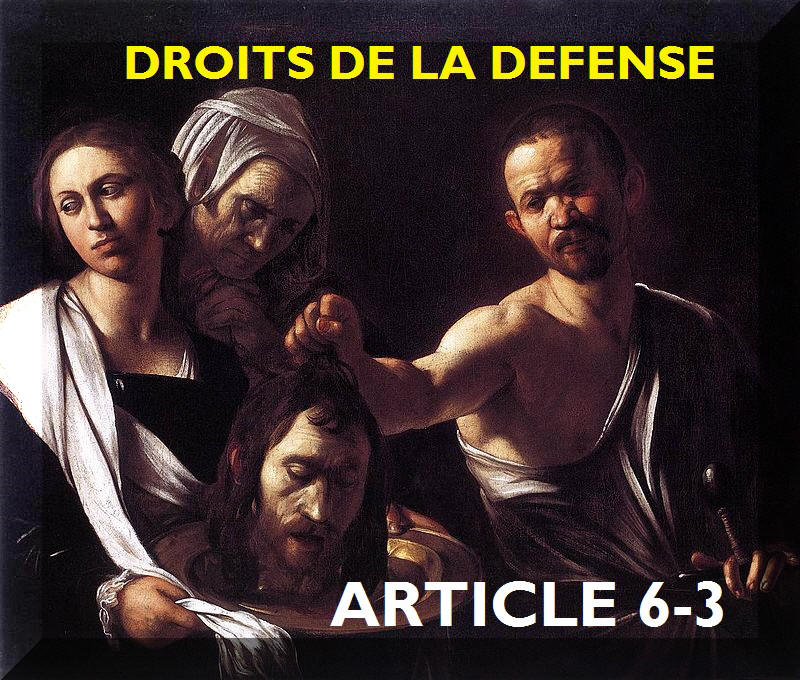
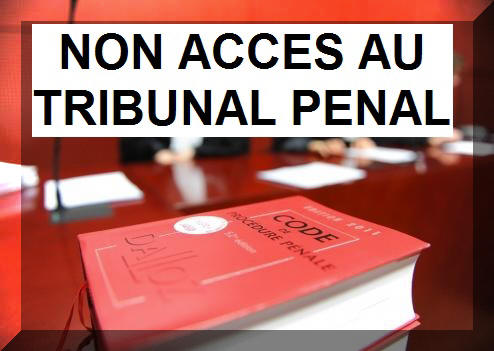

Cliquez sur le bouton ci dessous pour accéder gratuitement à l'analyse de l'article 6 par la CEDH au format PDF
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
LE DROIT D'ACCÉDER A SON DOSSIER
D ET AUTRES c. ROUMANIE arrêt 14 janvier 2020 Requête no 75953/16
Sur la présence des documents secrets dans le dossier pénal
113. La Cour rappelle que les principes pertinents en l’espèce ont été résumés dans les arrêts Fitt c. Royaume-Uni [GC] (no 29777/96, §§ 44-46, CEDH 2000‑II) et M. c. Pays-Bas (no 2156/10, § 66, 25 juillet 2017). En particulier, lorsque des preuves ont été dissimulées à la défense au nom de l’intérêt public, il n’appartient pas à la Cour de dire si pareille attitude était absolument nécessaire car, en principe, c’est aux juridictions internes qu’il revient d’apprécier les preuves produites devant elles (Fitt, précité, § 46).
114. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que le parquet s’est référé aux documents secrets qui, sans pouvoir justifier à eux seuls l’inculpation du premier requérant, étaient susceptibles d’être pris en considération (paragraphe 12 ci‑dessus). La Cour note que les tribunaux internes qui ont condamné le premier requérant ne se sont nullement appuyés sur ces documents pour fonder la condamnation de l’intéressé. Ainsi, la cour d’appel n’en a fait nullement mention dans sa décision du 29 septembre 2014 (paragraphes 21‑23 ci‑dessus). En outre, la Haute Cour a observé que ces éléments avaient servi à justifier l’inculpation du premier requérant, mais elle ne les a pas pris en compte pour motiver la condamnation de l’intéressé (paragraphe 28 ci‑dessus). La Cour conclut que ces éléments de preuve secrets n’ont pas été utilisés pour justifier la condamnation du premier requérant et, par conséquent, n’ont eu aucune incidence sur l’équité de la procédure menée contre lui.
115. Il s’ensuit que cette branche du grief est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Ilinca c. Roumanie du 24 octobre 2019 requête n° 50882/15
Irrecevabilité article 6-1 : La CEDH déclare mal fondée une requête portant sur le retrait d’une autorisation de port d’armes à feu
M. Ilinca estimait que les décisions des tribunaux internes étaient insuffisamment motivées et qu’elles se fondaient sur des informations à caractère secret, auxquelles il n’avait pas eu accès. La Cour relève que les juridictions internes ont examiné la question cruciale qui était celle de savoir si M. Ilinca représentait un danger pour l’ordre public justifiant le retrait de son autorisation et elles y ont répondu par l’affirmative. Elle constate aussi qu’une note de la police nationale n’a pas été divulguée à M. Ilinca car il s’agissait d’un document classifié. Cette note n’a toutefois pas été déterminante pour justifier le rejet du pourvoi de M. Ilinca. Par conséquent, la Cour ne décèle aucune apparence de violation des principes du procès équitable. Elle déclare donc la requête mal fondée
LES FAITS
En 2008, M. Ilinca obtint une autorisation d’acquisition et de détention d’armes à feu et se procura un pistolet, un fusil de chasse, ainsi que des munitions. En 2013, le bureau des armes (« le bureau ») à feu l’informa que l’autorisation lui avait été retirée car il représentait une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale et l’intégrité physique des personnes. M. Ilinca contesta cette décision, mais il fut débouté par le tribunal d’Argeş qui nota qu’entre 2007 et 2010, M. Ilinca avait été sanctionné par deux amendes pour des troubles à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la circulation routière. En 2015, la Cour d’appel de Piteşti confirma ce jugement, relevant entre autres que les infractions en question, bien que commises sans violence, démontraient que M. Ilinca représentait un danger pour l’ordre public. Elle nota également que des informations à caractère secret avaient été prises en compte par le bureau des armes à feu pour justifier le retrait de l’autorisation. Ces informations furent versées au dossier mais M. Ilinca ne fut pas autorisé à y accéder. La cour d’appel s’y référa en des termes généraux en vue de respecter leur confidentialité.
1. Le grief portant sur l’insuffisance de la motivation des décisions judiciaires
La Cour constate que les tribunaux internes ne se sont pas contentés d’entériner purement et simplement les arguments sur lesquels le bureau s’était fondé pour retirer l’autorisation de M. Ilinca. Au contraire, les juridictions internes ont examiné elles-mêmes la question cruciale pour l’issue de l’affaire, qui était celle de savoir si M. Ilinca représentait un danger pour l’ordre public justifiant le retrait de son autorisation, et elles y ont répondu par l’affirmative. Ainsi, le tribunal d’Argeș a estimé que ce danger ressortait de la condamnation du requérant pour troubles à l’ordre public, pour atteinte aux bonnes mœurs et pour une infraction liée à la circulation routière. Quant à la cour d’appel, elle a jugé que ces sanctions démontraient que l’intéressé représentait un danger pour l’ordre public. En outre, elle a répondu aux arguments soulevés par le requérant. Rappelant que l’appréciation des preuves et l’application du droit interne relève au premier chef des juridictions nationales, la Cour estime que, en l’espèce, il ne peut être considéré que le raisonnement des tribunaux internes était insuffisamment motivé et que la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement.
2. Le grief portant sur la méconnaissance du principe du contradictoire en raison du défaut d’accès à des informations classifiées
La Cour relève que seule la note de la police nationale produite devant la cour d’appel n’a pas été divulguée à M. Ilinca car il s’agissait d’un document classifié. Toutefois, ce document n’a pas été déterminant pour justifier le rejet du pourvoi du requérant. En effet, la cour d’appel ne s’y est référée qu’en des termes généraux et pour souligner que, en vertu de la législation sur les armes à feu, le bureau était habilité à procéder à de telles vérifications. En outre, la cour d’appel a estimé, au regard des circonstances concrètes de l’espèce, qu’il était nécessaire de préserver la confidentialité de ces informations. Par conséquent, la Cour ne décèle aucune apparence de violation des principes du procès équitable. Au contraire, elle estime que la possibilité, pour M. Ilinca, de discuter devant les juridictions internes les pièces versées au dossier, de produire ses observations et les moyens nécessaires à ses yeux pour étayer son action était en l’espèce suffisante pour assurer le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes. En conclusion, la requête est manifestement mal fondée.
CEDH
19. Le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure concernant la contestation du retrait de l’autorisation d’acquérir et de détenir des armes à feu. Il invoque l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. La Cour rappelle d’emblée qu’elle a déjà jugé l’article 6 § 1 de la Convention applicable sous son volet civil à des contestations portant sur l’application des règles de droit interne concernant l’acquisition et la détention des armes à feu (Užukauskas c. Lituanie, no 16965/04, §§ 32-39, 6 juillet 2010).
21. Elle rappelle également que l’article 6 de la Convention implique notamment, à la charge du tribunal, l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 80, CEDH 2004-I, et Oţet c. Roumanie, no 14317/04, § 39, 25 mars 2014).
22. Dans la présente affaire, la Cour constate que la décision de retrait de l’autorisation a fait l’objet d’une procédure judiciaire. Elle relève que les tribunaux internes ne se sont pas contentés d’entériner purement et simplement les arguments sur lesquels le bureau s’était fondé pour retirer l’autorisation du requérant.
23. Au contraire, la Cour note que les juridictions internes ont examiné elles-mêmes la question cruciale pour l’issue de l’affaire, qui était celle de savoir si le requérant représentait un danger pour l’ordre public justifiant le retrait de son autorisation, et qu’elles y ont répondu par l’affirmative. Ainsi, le tribunal d’Argeș a estimé que ce danger ressortait de la condamnation du requérant pour troubles à l’ordre public, pour atteinte aux bonnes mœurs et pour une infraction liée à la circulation routière (paragraphe 8 ci-dessus). Quant à la cour d’appel, elle a jugé que ces sanctions démontraient que l’intéressé représentait un danger pour l’ordre public (paragraphe 14 ci‑dessus).
24. La Cour note également que la cour d’appel a répondu aux arguments soulevés par le requérant dans son pourvoi. Elle relève que la cour d’appel a notamment écarté les allégations de l’intéressé selon lesquelles il n’était pas au courant des sanctions qui lui avaient été infligées en 2007 et 2010 (paragraphe 14 ci-dessus) et qu’elle a rejeté l’argument tiré de l’octroi de l’habilitation pour exercer le métier d’agent de sécurité (paragraphe 16 ci-dessus).
25. Rappelant que l’appréciation des preuves et l’application du droit interne relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, parmi beaucoup d’autres, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I), la Cour estime que, en l’espèce, il ne peut être considéré que le raisonnement des tribunaux internes était insuffisamment motivé et que la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement.
26. S’agissant de la partie du grief concernant la méconnaissance alléguée du principe du contradictoire en raison du défaut d’accès à des informations classifiées, la Cour rappelle que les principes pertinents ont été résumés dans l’arrêt Regner c. République tchèque ([GC], no 35289/11, §§ 146-149, 19 septembre 2017).
27. Lorsque des preuves ont été dissimulées à la défense au nom de l’intérêt public, il n’appartient pas à la Cour de dire si pareille attitude était absolument nécessaire car, en principe, c’est aux juridictions internes qu’il revient d’apprécier les preuves produites devant elle (Fitt c. Royaume-Uni [GC] (no 29777/96, § 46, CEDH 2000‑II).
28. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour relève que seule la note de la police nationale produite devant la cour d’appel n’a pas été divulguée au requérant dès lors qu’il s’agissait d’un document classifié (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour doit donc examiner si et dans quelle mesure la cour d’appel en a tenu compte.
29. Au vu de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel du 6 avril 2015, la Cour constate que ce document n’a pas été déterminant pour justifier le rejet du pourvoi du requérant. La cour d’appel ne s’y est référée qu’en termes généraux et pour souligner que, en vertu de la législation sur les armes à feu, le bureau était habilité à procéder à de telles vérifications (paragraphe 15 ci-dessus). En outre, la cour d’appel a estimé, au regard des circonstances concrètes de l’espèce, qu’il était nécessaire de préserver la confidentialité de ces informations (paragraphe 15 ci-dessus ; voir également, mutatis mutandis, Regner, précité, § 154).
30. Dans ces conditions, la Cour estime que le fait que le requérant n’a pas eu accès à la note de la police nationale ne saurait déceler aucune apparence de violation des principes du procès équitable. Au contraire, elle estime que la possibilité, pour le requérant, de discuter devant les juridictions internes les pièces versées au dossier, de produire ses observations et les moyens nécessaires à ses yeux pour étayer son action était en l’espèce suffisante pour assurer le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes.
31. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
GÜNANA ET AUTRES c. TURQUIE du 20 novembre 2018
Requêtes nos 70934/10, 6560/11, 23599/12, 39367/12 et 66687/12
Violation de l'article 6-1 de la convention : Le requérant n'a pas reçu les avis du procureur.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
70. Le requérant Turan Günana allègue dans le cadre des requêtes nos 70934/10, 39367/12 et 66687/12 que l’absence de communication des avis du procureur de la République lors des procédures devant le juge de l’exécution et devant la cour d’assises porte atteinte au principe de l’égalité des armes. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention
71. Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité, l’une tirée du non-épuisement des voies de recours internes, l’autre relative à la condition de préjudice important prévue à l’article 35 § 3 b) de la Convention.
1. Exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
72. Le Gouvernement considère que, le requérant n’ayant pas soulevé devant la cour d’assises son grief relatif à l’absence de communication des avis du procureur de la République émis avant les décisions du juge de l’exécution, le grief doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
73. Le requérant ne se prononce pas sur cette exception.
74. La Cour note que le requérant a pris connaissance des avis du procureur de la République émis avant les décisions du juge de l’exécution lors de la communication de ces décisions. Elle note ensuite que le requérant avait, comme le souligne le Gouvernement, la possibilité de soulever devant la cour d’assises son grief tenant à l’absence de communication de ces avis. Or l’intéressé n’a pas présenté un tel grief lorsqu’il a formé opposition contre les décisions du juge de l’exécution devant la cour d’assises (paragraphes 11, 19 et 27 ci-dessus).
75. Il s’ensuit que la partie du grief qui concerne l’absence de communication des avis du procureur de la République émis avant les décisions du juge de l’exécution doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
2. Exception relative à la condition de préjudice important
76. Le Gouvernement soutient que les avis du procureur de la République émis lors des procédures d’opposition demandaient simplement le rejet des oppositions du requérant sans comporter aucun nouvel argument. Partant, considérant que le requérant n’a subi aucun préjudice important en raison de la non-communication de ces avis, il invite la Cour à déclarer le grief irrecevable.
77. Le requérant conteste l’argument du Gouvernement.
78. En ce qui concerne les avis du procureur de la République émis le 27 octobre 2011 et le 21 mars 2012 dans le cadre des requêtes no 39367/12 et no 66687/12, la Cour constate qu’aucune question nouvelle pouvant appeler des commentaires de la partie requérante n’était soulevée par ces avis. En effet, le procureur de la République se bornait à y indiquer que la décision du juge de l’exécution était conforme à la procédure et à la loi (paragraphes 20 et 28 ci-dessus). La Cour relève également que le requérant, quant à lui, n’a pas démontré qu’il aurait pu apporter, en réplique auxdits avis du procureur de la République, des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de son opposition devant la cour d’assises.
79. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et déclaré irrecevable un grief similaire dans l’affaire Kılıç et autres c. Turquie au motif que les requérants n’avaient pas subi un « préjudice important » du fait de l’absence de communication des avis du ministère public près le Conseil d’État (Kılıç et autres c. Turquie (déc.), no 33162/10, § 32, 3 décembre 2013 ; voir aussi, mutatis mutandis, Tamer c. Turquie (déc.), no 60108/10, § 54, 28 août 2014). En l’absence d’argument ou de fait pouvant la conduire à une conclusion différente dans la présente espèce, la Cour déclare ce grief irrecevable en ce qui concerne les avis émis par le procureur de la République le 27 octobre 2011 et le 21 mars 2012 dans le cadre des requêtes no 39367/12 et no 66687/12, en application de l’article 35 §§ 3 b) et 4 de la Convention.
80. Quant à l’avis du procureur de la République émis le 1er avril 2010 dans le cadre de la requête no 70934/10, la Cour constate que, dans cet avis, le procureur de la République soutenait que le manuscrit saisi comportait des notes et remarques de nature à motiver les détenus liés aux organisations terroristes à commettre des actions militantes et qu’il leur permettait de communiquer entre eux (paragraphe 12 ci-dessus).
Elle constate que cet avis, eu égard à son contenu, comportait des arguments nouveaux pouvant appeler des commentaires de la partie requérante. Elle estime dès lors qu’on ne peut considérer que le requérant n’a subi aucun préjudice important du fait de la non-communication de cet avis. Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement s’agissant de l’avis émis par le procureur de la République le 1er avril 2010 dans le cadre de la requête no 70934/10.
81. Constatant que le grief relatif à l’absence de communication de l’avis du procureur de la République émis le 1er avril 2010 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
82. Le requérant soutient que, en vertu du principe de l’égalité des armes, lui-même et son avocat devaient pouvoir obtenir tous les documents contenus dans le dossier aux fins de préparer sa défense.
83. Le Gouvernement soutient que le contenu de l’avis en question ne plaçait pas le requérant dans une situation de désavantage. Il considère dès lors que la non-communication de cet avis n’a pas porté atteinte au principe de l’égalité des armes.
84. La Cour rappelle avoir souvent examiné de tels griefs et conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la non-communication de l’avis d’un procureur près une juridiction, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour le justiciable d’y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d’autres, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 55-58, CEDH 2002-V, et Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, §§ 65-66, 6 juillet 2010). Elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant susceptible de mener en l’espèce à une conclusion différente de celle prononcée pour des griefs identiques.
85. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
AKBAL c. TURQUIE du 16 janvier 2018 Requête no 43190/05
Violation de l'article 6 : non accès au dossier d'accusation : une procédure administrative avec des sanctions aussi graves qu'une procédure pénale. Le juge condamne le requérant, à la vue d'une pièce que le requérant n'a pas pu voir pour cause de secret défense.
1. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant en soutenant que ce dernier n’a jamais présenté devant les autorités internes une demande visant à obtenir une copie du document no 5257 ni un grief relatif à la restriction de son accès à ce document, bien qu’il ait eu connaissance de son existence. Il soutient à cet égard que la décision du tribunal administratif du 11 décembre 2000, par laquelle ce dernier a demandé à l’entreprise publique de lui présenter des documents et des informations sur lesquels se fondait le document no 5257, a été notifiée au requérant le 24 janvier 2001 et que le requérant a donc eu connaissance de l’existence du document en question à cette dernière date. Il fait observer en outre qu’il n’y avait aucune disposition légale ou décision judiciaire interdisant la communication dudit document au requérant ni l’accès de ce dernier à ce document, et que la législation en vigueur à l’époque des faits permettaient aux parties ou à leurs avocats de consulter le dossier de leur affaire au greffe du tribunal en présence du greffier. Il ajoute enfin que le contenu du document a été décrit en détail dans les arrêts du tribunal administratif et du Conseil d’État. Par conséquent, le Gouvernement considère que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
27. Le requérant conteste l’exception soulevée par le Gouvernement. Il soutient que le tribunal était tenu de lui communiquer le document no 5257, versé au dossier de l’affaire par la partie adverse, afin de lui permettre de faire valoir ses droits de défense. Indiquant qu’il n’a connu le contenu de ce document que lorsque le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 2001 lui a été notifié le 5 avril 2002, il souligne qu’il a demandé dans son pourvoi en cassation l’infirmation du jugement du tribunal administratif, rendu sur le fondement de ce document, dont il n’était pas au courant de l’existence avant la notification de ce jugement. Il ajoute qu’il n’était pas obligé de se déplacer au greffe du tribunal, situé loin de son domicile, pour vérifier si un nouveau document avait été versé au dossier de l’affaire, d’autant plus qu’il n’était pas sûr d’obtenir la copie du document litigieux, classé secret par son ancien employeur.
28. La Cour note que le requérant a dénoncé, dans son pourvoi en cassation, le caractère secret, attribué par l’entreprise au document no 5257 dont il avait connu le contenu tel qu’il a été décrit dans le jugement du tribunal administratif et a fait grief du fait que le tribunal s’était essentiellement fondé sur ce document pour rejeter sa demande (paragraphe 16 ci-dessus). Elle considère qu’eu égard à la formulation de ce pourvoi en cassation, le requérant s’y plaignait essentiellement de ne pas avoir eu la possibilité de présenter ses arguments contre ce document, qui ne lui a pas été communiqué. Elle note enfin que cette doléance n’a pas été prise en compte par le Conseil d’État (paragraphe 17 ci-dessus).
29. La Cour rejette donc l’exception du gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes s’agissant du pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Pour ce qui concerne le stade de la procédure qui s’est déroulé devant le tribunal administratif, elle estime que l’exception soulève des questions étroitement liées au respect du principe du contradictoire par les juridictions internes, partant, au bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. Elle décide donc de la joindre au fond.
2. Sur le fond
30. Le requérant indique qu’il n’a jamais vu ni consulté le document no 5257, classé secret, et que, par conséquent, il n’a pas pu présenter ses arguments contre son contenu à aucun stade de la procédure. Il soutient que le tribunal administratif ne lui a pas communiqué ce document, alors que l’article 16 de la loi no 2577 prévoyait sa communication (paragraphe 19 ci‑dessus). Il estime donc que l’absence de communication du document no 5257 constitue une violation de son droit à un procès équitable.
31. Le Gouvernement expose que le requérant conteste, dans son pourvoi en cassation du 15 avril 2002, l’utilisation de ce document par le tribunal administratif comme fondement de sa décision et que, dès lors, il a forcément eu accès au document no 5257.
32. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (Kress c. France [GC], no 39594/98, § 65, CEDH 2001-VI, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, et Martinie, c. France [GC], no 58675/00, § 46, CEDH 2006‑VI).
33. En l’espèce, la Cour observe que lors de la procédure administrative intentée par le requérant contre son ancien employeur afin de contester son licenciement, le document no 5257 a été présenté au tribunal administratif par l’entreprise défenderesse pour la première fois avec son mémoire en défense soumis le 20 mars 1997 (paragraphe 9 ci-dessus). Elle observe ensuite que les documents et les informations sur lesquels se fondait le document interne no 5257 ont aussi été présentés au tribunal le 8 février 2001 à la suite de la demande formulée par le tribunal à cet égard le 11 décembre 2000 (paragraphe 13 et 14 ci-dessus). Elle observe en outre que le tribunal administratif a rejeté la demande du requérant en s’appuyant dans son jugement sur le fond, entre autres, sur le document litigieux (paragraphe 15 ci-dessus).
34. La Cour note que le dossier de la requête ne contient aucune pièce relative à la notification du document no 5257 ni d’autres documents présentés en annexe du mémoire en défense de l’entreprise défenderesse au requérant à aucun stade de la procédure. Le Gouvernement ne conteste pas non plus l’allégation du requérant relative à la non-communication du document litigieux, mais il soutient que le requérant aurait dû avoir accès à ce document. Partant, la Cour ne peut que conclure en l’occurrence à l’absence de communication au requérant du document en question, qui a été déterminant pour l’issue de la procédure.
35. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant n’a jamais présenté devant le tribunal administratif, une demande visant à obtenir une copie du document no 5257 ni une demande de consultation au greffe du tribunal, bien qu’il ait eu connaissance de son existence au plus tard à la date de la notification de la décision du 11 décembre 2000, la Cour note d’abord que le Gouvernement ne présente aucune pièce relative à la notification au requérant de cette dernière décision. Ensuite, à supposer que le requérant ait reçu notification de la décision du 11 décembre 2000, la Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire implique en principe le droit pour les parties à un procès civil ou pénal de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (voir, parmi beaucoup d’autres, J.J. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-II, p. 613, § 43). Elle considère qu’en l’espèce, en l’absence de communication au requérant du document no 5257, qui constitue en soi une méconnaissance du droit à une procédure contradictoire, on ne saurait reprocher à l’intéressé de ne pas avoir pris l’initiative pour formuler une demande visant à obtenir une copie de ce document afin de pouvoir présenter ses arguments à cet égard, d’autant plus que le requérant ne semble jamais avoir été informé avant le jugement du tribunal administratif que la résiliation de son contrat de travail était fondé sur le document litigieux, classé secret par son employeur.
36. La Cour estime par ailleurs qu’attendre du requérant qu’il aille consulter le document en question au greffe du tribunal administratif équivaudrait à lui imposer une charge disproportionnée et ne lui aurait pas nécessairement garanti une réelle possibilité de présenter ses observations sur ce document (voir, mutatis mutandis, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 57, CEDH 2002‑V). Elle rappelle à cet égard que le contradictoire doit pouvoir s’exercer dans des conditions satisfaisantes de telle sorte que le plaideur dispose de la possibilité de se familiariser avec les documents en question, de les commenter d’une façon appropriée et d’un délai suffisant pour rédiger ses arguments (voir, à cet égard, Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, § 42, 3 mars 2000, et Immeubles Groupe Kosser c. France, no 38748/97, § 26, 21 mars 2002).
37. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la procédure devant les juridictions internes a manqué d’équité en raison de la non-communication au requérant du document no 5257. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce.
VAN WESENBEECK c. BELGIQUE du 23 mai 2017 Requêtes nos 67496/10 et 52936/12
Non accès au dossier confidentiel d'infiltration de la police dans un réseau de trafic de drogue.
Non violation de l'article 6-1 de la Convention car ce dossier a été contrôlé à priori par des magistrats indépendants et les policiers infiltrés ainsi qu leur famille doivent être contrôlés.
i. Principes généraux pertinents
62. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention ne souffre aucune dérogation ; toutefois, la définition de cette notion ne saurait être soumise à une règle unique et invariable mais elle est au contraire fonction des circonstances propres à chaque affaire. Lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a globalement revêtu un caractère équitable (voir, parmi d’autres, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 84, CEDH 2010, Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, § 101, CEDH 2015, et Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, § 250, CEDH 2016).
63. Les exigences générales d’équité posées à l’article 6 s’appliquent à toutes les procédures pénales, quel que soit le type d’infraction concerné. Il est hors de question que les droits tenant à l’équité du procès soient atténués pour la seule raison que les personnes concernées sont soupçonnées de faire parti d’une organisation criminelle. Il reste que, pour déterminer si la procédure dans son ensemble a été équitable, le poids de l’intérêt public à la poursuite de l’infraction particulière en question et à la sanction de son auteur peut être pris en considération (voir, mutatis mutandis, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 97, CEDH 2006‑IX, et Ibrahim et autres, précité, § 252).
64. La Cour est consciente des difficultés inhérentes au travail d’enquête et d’investigation de la police, chargée de rechercher et recueillir les éléments de preuve des infractions commises. Pour y parvenir, les enquêteurs doivent recourir de plus en plus souvent, notamment dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, aux agents infiltrés, aux informateurs et aux pratiques « sous couverture ». La Cour a jugé que le recours à de telles méthodes – et en particulier les techniques d’infiltration − ne saurait en lui-même emporter violation du droit à un procès équitable (Ramanauskas c. Lituanie [GC], no 74420/01, §§ 49-51, CEDH 2008). Toutefois, les préoccupations d’intérêt général ne sauraient justifier des mesures vidant de leur substance même les droits de la défense d’un requérant (Jalloh, précité, § 97, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 93, 10 mars 2009, Aleksandr Zaichenko c. Russie, no 39660/02, § 39, 18 février 2010, et Ibrahim et autres, précité, § 252).
65. De plus, il y a lieu de rappeler que la tâche de la Cour, conformément à l’article 19 de la Convention, consiste à s’assurer du respect des engagements pris par les États parties à la Convention. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer, par principe, sur la recevabilité des éléments de preuve retenus par les juridictions internes pour établir la culpabilité du requérant (voir, mutatis mutandis et parmi d’autres, Allan c. Royaume‑Uni, no 48539/99, § 42, CEDH 2002‑IX, Jalloh, précité, § 95, Bykov, précité, § 89, et Ibrahim et autres, précité, § 254). Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente en effet pas la recevabilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 162 et 175, CEDH 2010, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011).
66. La Cour, quant à elle, doit, pour mener à bien sa tâche, déterminer si la procédure pénale a globalement revêtu un caractère équitable (voir paragraphe 62, ci-dessus). Pour ce faire, elle envisage la procédure dans son ensemble, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, et vérifie le respect non seulement des droits de la défense mais aussi de l’intérêt du public et des victimes à ce que les auteurs de l’infraction soient dûment poursuivis ainsi que, si nécessaire, des droits des témoins (Al-Khawaja et Tahery, précité, § 118, et Schatschaschwili, précité, § 101).
67. Dans ce contexte, la Cour rappelle que tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. En matière pénale, le droit à un procès contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie, ainsi que de les discuter (Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, § 51, 16 février 2000, Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], no 28901/95, § 60, CEDH 2000‑II, Fitt c. Royaume‑Uni [GC], no 29777/96, § 44, CEDH 2000‑II, Edwards et Lewis c. Royaume-Uni [GC], nos 39647/98 et 40461/98, §§ 46 et 48, CEDH 2004‑X, et Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 146, CEDH 2005‑IV). De surcroît, l’article 6 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (Jasper, Rowe et Davis, Fitt, et Edwards et Lewis, précités).
68. Cela dit, le droit à une divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions – qui doivent être mis en balance avec les droits de l’accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense de façon à préserver les droits fondamentaux d’un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l’article 6 § 1 les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires. De plus, si l’on veut garantir un procès équitable à l’accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (Jasper, précité, § 52, Rowe et Davis, précité, § 61, Fitt, précité, § 45, et Edwards et Lewis, précité, §§ 46 et 48 ; voir également Al‑Khawaja et Tahery, précité, § 145).
ii. Application de ces principes à la présente espèce
69. La Cour observe que la requête pose la question de savoir si, telles qu’elles sont organisées en droit belge, la tenue d’un dossier, séparé et confidentiel, consignant les autorisations et rapports de mise en œuvre de méthodes particulières de recherche (observation et infiltration en l’espèce) et l’impossibilité pour la défense de le consulter tout au long de la procédure – pendant l’information par le ministère public, l’instruction judiciaire et le procès au fond – est compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention et les droits de la défense en particulier.
70. Tout d’abord, la Cour relève, à l’examen des dispositions pertinentes du code d’instruction criminelle (voir paragraphes 50-55, ci-dessus) et ainsi que cela a été rappelé par les juridictions internes en l’espèce (voir paragraphe 27, ci-dessus), que la raison d’être du dossier confidentiel est la nécessité de protéger l’anonymat et donc la sécurité des agents infiltrés et de garder secrètes les méthodes utilisées. La Cour rappelle que ce motif est conforme à sa jurisprudence (voir paragraphe 68, ci-dessus).
71. La Cour note ensuite que le législateur belge a limité les éléments qui figurent dans le dossier confidentiel, et qui ne peuvent être consultés par les parties, à ceux qui sont de nature à compromettre l’identité et la sécurité des personnes concernées et l’utilisation même des méthodes particulières de recherche (voir paragraphes 44 et 45, ci-dessus).
72. La Cour en déduit que toutes les autres informations doivent figurer dans le dossier répressif. Celui-ci contient en effet des renseignements concernant la mise en œuvre et la nature des méthodes de recherche utilisées, les motifs justifiant cette utilisation et les étapes de leur mise en œuvre, éléments sur la base desquels la défense a la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’une procédure contradictoire, tous les moyens légaux à l’encontre des méthodes de recherche utilisées, y compris, le cas échéant, des moyens relatifs à la provocation. Il s’agit là, selon la Cour, de garanties fondamentales (voir, a contrario, Edwards et Lewis c. Royaume-Uni, nos 39647/98 et 40461/98, § 58, 22 juillet 2003, et Leas c. Estonie, no 59577/08, § 88, 6 mars 2012).
73. Le requérant se plaint que le dossier confidentiel est tenu par le ministère public. Il revient en effet à l’officier de police judiciaire chargé de diriger l’exécution de l’observation ou de l’infiltration de trier parmi les éléments des rapports confidentiels de la police ceux qui peuvent apparaître dans les procès-verbaux qui sont ensuite versés au dossier répressif (voir paragraphe 44, ci-dessus).
74. La Cour rappelle, à cet égard, avoir jugé contraire à l’article 6 § 1 de la Convention un système dans lequel l’accusation, sans l’accord du juge du fond de première instance et à son insu, pouvait décider que certaines preuves pertinentes pour la défense étaient couvertes par une immunité d’intérêt public (Rowe et Davis, précité, §§ 36-37 et 63-67). Elle estime qu’à la différence de cette affaire, dans laquelle elle avait considéré que le contrôle judiciaire opéré par la juridiction d’appel n’avait pas été suffisant pour remédier à la situation (ibidem), en droit belge, le contrôle judiciaire est effectué par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel, lorsqu’elle est chargée de contrôler la régularité de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche. Il reste à voir si ce contrôle présente des garanties suffisantes.
75. La Cour examine, pour commencer, la portée du contrôle exercé sur le dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation.
76. En l’espèce, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers, a, après avoir consulté le dossier confidentiel, ordonné par son arrêt du 20 mai 2010 que ce dossier soit complété avec les documents confidentiels relatifs à la recherche proactive, et que certains éléments relatifs à cette recherche soient ajoutés au dossier répressif ouvert. Cette démarche s’est soldée notamment par l’ajout au dossier répressif des décisions du procureur du Roi du 18 septembre 2008 confirmant l’existence d’autorisations d’observation et d’infiltration et du procès-verbal du 25 septembre 2008 relatif à ces autorisations (voir paragraphe 18, ci‑dessus). Au final, la chambre des mises en accusation a décidé par son arrêt du 24 juin 2010 que, dans le cadre du contrôle sur la base des articles 235bis et 235ter du CIC, le dossier répressif était complet et qu’aucune nullité, irrégularité ou violation de dispositions légales ou conventionnelles ne pouvait être retenue ni davantage que des irrégularités aient été commises dans la mise en œuvre de la recherche proactive ou des méthodes particulières de recherche (voir paragraphe 19, ci-dessus).
77. Le requérant soutient que le contrôle ainsi opéré n’a pas permis l’appréciation par un juge de la nécessité ou de l’opportunité d’une divulgation à la défense des informations figurant dans le dossier confidentiel.
78. La Cour constate cependant que la chambre des mises en accusation a estimé en l’espèce, dans son arrêt du 24 juin 2010, que le dossier répressif était complet. Elle a donc pu examiner si des éléments figurant dans le dossier confidentiel, plus particulièrement des éléments qui n’étaient pas de nature à compromettre les moyens techniques et les techniques d’enquête policière utilisées ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat des fonctionnaires de police chargés de l’exécution de l’observation ou de l’infiltration, ne devaient pas faire partie du dossier répressif, alors qu’ils ne s’y trouvaient pas. La juridiction d’instruction avait donc à sa disposition tous les éléments pour considérer, de manière indépendante et impartiale, que le dossier répressif, parmi lesquels devaient figurer le procès-verbal de mise en œuvre et les éléments non-confidentiels de l’instruction proactive, correspondait aux éléments du dossier confidentiel (voir, a contrario, Baltiņš c. Lettonie, no 25282/07, § 63, 8 janvier 2013).
79. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le contrôle par la chambre des mises en accusation, juridiction indépendante et impartiale, sur l’état complet du dossier répressif, et donc indirectement sur la nécessité de tenir les données du dossier confidentiel à l’écart de la défense, constitue une garantie importante (voir, mutatis mutandis, Jasper, précité, § 56, et Fitt, précité, § 49).
80. En ce qui concerne ensuite et en particulier l’impossibilité alléguée par le requérant de vérifier s’il y a eu provocation de la part des agents infiltrés, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 interdit la provocation policière et que l’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière. Les principes relatifs à cette question ont été résumés dans l’arrêt Ramanauskas précité (§§ 49-61). Les critères que la Cour a énoncés, au fil de sa jurisprudence, pour distinguer entre une provocation portant atteinte à l’article 6 § 1 et une mise en œuvre légitime de techniques particulières d’investigation sont, quant à eux, résumés dans l’arrêt Bannikova c. Russie (no 18757/06, §§ 37-65, 4 novembre 2010).
81. La Cour estime qu’elle n’a pas besoin d’entrer en l’espèce dans l’analyse détaillée de ces critères. Force est en effet de constater que, devant les juridictions internes, le requérant a soulevé la provocation mais n’a aucunement étayé ses allégations au moyens d’indices factuels qui auraient permis aux juridictions de supposer qu’il avait été victime d’une provocation. Dans ces circonstances, la Cour n’est pas convaincue que la situation sous examen relève de la catégorie des affaires de provocation (voir, mutatis mutandis, Trifontsov c. Russie (déc .), no 12025/02, § 32, 9 octobre 2012, et Lyubchenko c. Ukraine (déc.), no 34640/05, § 33, 31 mai 2016). Du reste, le caractère sommaire du moyen de défense du requérant n’a pas empêché les juridictions d’exercer un contrôle et de procéder à un examen des faits de la cause sous l’angle de la provocation pour rejeter lesdites allégations sur base des éléments du dossier répressif (voir paragraphes 28, 29 et 34, ci-dessus).
82. Enfin, et cela est au moins aussi important aux yeux de la Cour, la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 20 mars 2012 dans l’affaire du requérant que les pièces du dossier confidentiel ne peuvent être utilisées à titre de preuve au détriment du prévenu (voir paragraphe 32, ci-dessus). De fait, en l’espèce, la chambre des mises en accusation a pu constater, sur base des procès-verbaux versés au dossier répressif, que le 17 septembre 2008 des indices suffisamment concrets des faits mis à charge du requérant étaient réunis pour lancer une recherche proactive ; ce sont alors ces indices qui avaient été traduits dans les conclusions écrites du ministère public, qui faisaient partie du dossier répressif (voir paragraphe 19, ci-dessus).
83. Eu égard à ce qui précède, la Cour n’estime pas utile d’examiner plus avant le grief du requérant en ce qu’il se plaint qu’au cours de l’instruction sur le fond, ni lui-même ni les juridictions de jugement n’ont pu consulter le dossier confidentiel. Elle estime en effet, avec la Cour de cassation (voir paragraphe 32, ci-dessus), que la restriction ab initio des droits de défense était justifiée et a été suffisamment compensée par la procédure de contrôle effectuée en amont par une juridiction indépendante et impartiale, à savoir la chambre des mises en accusation.
84. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Matanović c. Croatie du 4 avril 2017 requête no 2742/12
Violation de l'article 6-1 Le requérant n’a pas été incité à commettre un délit de corruption, mais ses droits ont été restreints au cours de son procès pénal car il n'a pas eu accès aux éléments de preuve.
LES FAITS
Le requérant, Josip Matanović, est un ressortissant croate né en 1949 et purgeant actuellement une peine de onze ans d’emprisonnement à Lepoglava (Croatie), pour des délits de corruption. En avril 2007, J.K., le représentant d’un projet d’investissement dans la région de Zadar, fut le premier à lancer des accusations de corruption contre M. Matanović, qui était alors vice-président du Fonds croate de privatisation. J.K., qui avait contacté M. Matanović en tant que ce dernier était un responsable du Fonds, le dénonça au parquet, alléguant notamment que M. Matanović avait demandé un paiement illicite en échange d’assurances que le projet serait réalisé. Le parquet demanda alors à un juge d’instruction l’autorisation de prendre des mesures de surveillance secrète de M. Matanović. Les mesures comprenaient notamment des écoutes téléphoniques et une surveillance clandestine et prévoyaient que J.K. jouerait le rôle d’informateur. Le juge donna son autorisation en vertu du code de procédure pénale, précisant dans sa décision que l’enquête sur les infractions en cause serait soit impossible soit extrêmement difficile par d’autres moyens. À la suite de l’opération secrète, M. Matanović fut arrêté et détenu, puis inculpé en février 2008. Il fut reconnu coupable en mai 2009 de plusieurs chefs de corruption passive, d’incitation à la corruption passive et d’abus du pouvoir et de l’autorité qu’il détenait pour soutenir certains projets d’investissement et de privatisation. Le tribunal de première instance s’appuya en grande partie sur les enregistrements issus de la surveillance secrète et notamment ceux relatifs à la première réunion prévue après que J.K. eut consenti à devenir informateur. Lors de cette réunion, M. Matanović avait expliqué à J.K. quel était le montant du paiement qu’il attendait et que c’était une pratique habituelle de rémunérer les efforts entrepris pour faire pression dans tel ou tel sens. M. Matanović forma un recours devant la Cour suprême, alléguant que les mesures de surveillance secrète avaient été illégales, qu’il avait été piégé et que des éléments de preuve pertinents n’avaient pas été communiqués à la défense. Cependant, la Cour suprême jugea que ces griefs étaient dépourvus de fondement et confirma la condamnation pour corruption passive et abus de pouvoir et d’autorité. Quant au grief tiré de la non-communication de certains éléments de preuve, la Cour suprême nota que la défense avait reçu des transcriptions des enregistrements de surveillance secrète (sans distinction entre ceux qui avaient été utilisés pour condamner M. Matanović et ceux qui ne l’avait pas été) et considéra qu’elle n’avait pas le droit d’avoir accès à d’autres éléments concernant des individus qui, en fin de compte, n’avaient pas été inculpés.
Par la suite, la Cour constitutionnelle souscrivit aux conclusions de la Cour suprême.
Article 8 (en ce qui concerne les mesures de surveillance secrète)
La Cour constate que la loi croate (à savoir le code de procédure pénale), telle qu’interprétée par les juridictions nationales, n’était pas assez claire quant au pouvoir des autorités d’ordonner des mesures de surveillance et n’a pas offert dans la pratique – dans le cas de M. Matanović – des garanties suffisantes contre des abus éventuels. Le juge d’instruction s’est contenté de reprendre les mots de la loi pour dire qu’il y avait impossibilité de mener l’enquête par d’autres moyens, sans indiquer pourquoi, en l’espèce, l’enquête ne pouvait pas être conduite à l’aide d’autres méthodes moins attentatoires à la vie privée. Par conséquent, la procédure relative à l’autorisation et au contrôle des écoutes téléphoniques visant M. Matanović n’avait pas été prévue par la loi, au mépris de l’article 8.Article 6 § 1 (en ce qui concerne l’allégation de guet-apens)
La Cour observe qu’il ressort clairement des documents du dossier que M. Matanović était impliqué dans des faits de corruption. De plus, elle estime que, en définitive, les autorités de poursuite n’ont pas été à l’origine de ces actes illégaux, mais s’y sont plutôt « associées ». Premièrement, rien n’indique que J.K. ait agi pour le compte du parquet lorsqu’il a commencé à prendre contact avec M. Matanović. En effet, J.K. était le représentant d’un projet d’investissement et c’est en cette qualité qu’il a pris contact avec M. Matanović en tant que responsable du fonds de privatisation. En outre, le parquet n’a donné à J.K. l’instruction de se comporter en informateur qu’à partir du moment où celui-ci avait dénoncé M. Matanović. Il ressort clairement de l’enregistrement – sur lequel s’est appuyé le tribunal de première instance – de la conversation des deux hommes lors de leur première rencontre ayant eu lieu après que J.K. avait consenti à devenir informateur que M. Matanović était la personne qui dirigeait tous les actes de corruption : c’est M. Matanović qui a donné des instructions à J.K. sur la manière de procéder avec les pots-de-vin et c’est aussi lui qui a cherché à justifier ces derniers. L’enquête menée par le parquet a donc été essentiellement passive et n’a pas dépassé ce qui était nécessaire à la conduite d’une opération secrète. La manière dont l’enquête s’est déroulée n’a pas incité M. Matanović à commettre des infractions qu’il n’aurait pas commises autrement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’allégation de guet-apens.
Article 6 § 1 (en ce qui concerne la non-communication et l’utilisation d’éléments de preuve obtenus grâce à la surveillance secrète)
Les griefs tirés par M. Matanović quant au manque d’équité de la procédure concernent l’accès qu’il n’aurait pas eu à trois catégories principales de preuves obtenues par l’utilisation de mesures de surveillance secrète. La première catégorie de preuves a trait aux enregistrements de surveillance qui ont été versés au dossier par le parquet et qui ont servi à condamner M. Matanović. La deuxième catégorie concerne des enregistrements issus de la surveillance secrète de M. Matanović et d’une autre personne accusée, qui ont été inclus dans le dossier, mais qui n’ont pas été utilisés à l’appui de la condamnation. La troisième catégorie est constituée d’enregistrements de surveillance secrète, obtenus dans le cadre de la même affaire, mais relatifs à d’autres individus qui, en définitive, n’ont pas été inculpés. Ces derniers enregistrements n’ont pas servi à faire condamner M. Matanović, ni été versés au dossier ou communiqués à la défense. Rien ne permet à la Cour de conclure que M. Matanović n’a pas pu préparer sa défense de manière adéquate en ce qui concerne les enregistrements de surveillance utilisés comme preuves à charge. Des transcriptions des enregistrements, préparées par un expert indépendant et impartial, ont été mises à la disposition de la défense dès l’inculpation de M. Matanović. Bien qu’il n’ait pas reçu des copies des enregistrements eux-mêmes, ces derniers ont été entendus au cours de l’audience et M. Matanović a eu largement le temps de comparer les transcriptions à ce qui a été entendu à l’audience et de demander des clarifications sur toute divergence. En outre, il n’a jamais mis en cause l’authenticité des enregistrements ni contesté que les conversations avaient effectivement eu lieu. Sur ce point, la Cour ne constate donc aucun élément inéquitable dans la procédure. Quant aux enregistrements versés au dossier mais non utilisés à l’appui de la condamnation de M. Matanović, la Cour constate qu’à aucun stade de la procédure interne ce dernier n’a avancé d’argument relatif à l’éventuelle pertinence de cette deuxième catégorie de preuves. Il n’est donc pas possible de conclure qu’une restriction de l’accès à ces enregistrements précis ait pu être contraire au droit à un procès équitable. Cependant, la défense s’est vu refuser l’accès à une troisième catégorie de preuves, issues de la surveillance secrète effectuée dans le cadre de la même affaire, mais relatives à d’autres individus qui, en définitive, n’ont pas été inculpés. Cette décision était celle du parquet, qui n’y a pas associé la défense. En effet, le droit interne ne prévoyait aucune procédure permettant d’apprécier la pertinence des éléments de preuve obtenus par les autorités de poursuite, ni la nécessité de les communiquer. En conséquence, M. Matanović n’a pas été en mesure de déterminer si les éléments de preuve détenus par le parquet et exclus du dossier auraient pu permettre la réduction de sa peine ou la remise en question de l’ampleur des activités dont il était accusé. Les tribunaux internes n’ont pas non plus énoncé de motifs convaincants qui, fondés sur une mise en balance des intérêts en jeu, auraient justifié la restriction apportée aux droits de la défense. La Cour suprême s’est contentée de rejeter le grief au motif qu’il n’y avait pas de droit d’accès à de tels enregistrements. La Cour considère qu’une telle situation, qui permet au parquet d’apprécier ce qui est pertinent ou non dans une affaire, sans aucune garantie procédurale, est contraire aux exigences de l’article 6 § 1. Les lacunes de la procédure relative à la communication des éléments de preuve et les restrictions qui en ont découlé pour les droits de la défense amènent la Cour à conclure que, dans son ensemble, le procès de M. Matanović n’a pas été équitable, au mépris de l’article 6 § 1.
SARIDAŞ c. TURQUIE du 7 juillet 2015 requête 6341/10
Violation de l'article 6-1 de la Convention, le requérant n'a pas obtenu une contre expertise, le tribunal n'a même pas répondu à cette demande. Le requérant n'a pas eu accès à l'expertise médicale avant l'audience, le greffe n'ayant pas prévenu l'avocat du requérant.
37. La Cour relève que le rapport du conseil de la santé de l’hôpital militaire GATA a été déterminant pour la Haute Cour administrative militaire, qui s’est fondée principalement sur les conclusions du conseil pour décider que le requérant était médicalement apte à faire le service militaire.
38. Elle constate qu’il existe dans la pratique une corrélation étroite entre la décision de la Haute Cour administrative militaire et le rapport du conseil de la santé de l’hôpital militaire GATA et que la haute juridiction a souscrit à ce rapport sans envisager d’ordonner une nouvelle expertise par des médecins autres que des médecins militaires. Même si, en droit turc, les juges ne sont pas directement liés du point de vue juridique par les conclusions des rapports d’expertise, il en va assurément autrement dans le domaine médical où les conclusions des médecins sont le plus souvent décisives.
39. En l’espèce, le fait que la Haute Cour administrative militaire n’a donné aucune suite à la demande du requérant d’être examiné par un organe ne dépendant pas du commandement de l’état-major de l’Armée ou du ministère de la Défense pose problème. De plus, sa décision est totalement muette sur les raisons pour lesquelles elle a ignoré la demande en question. La Haute Cour administrative militaire s’est bornée à ajouter foi à un unique rapport d’expertise médicale émanant d’un hôpital militaire qui s’était pourtant déjà prononcé auparavant sur le cas du requérant (paragraphe 10 ci-dessus).
40. De plus, outre cette défaillance, la Cour constate que le rapport d’expertise médicale litigieux n’a pas été notifié au requérant. Or la notification de ce rapport au requérant était d’une importance capitale pour lui afin que l’intéressé puisse le contester et faire entendre sa cause.
41. En effet, le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir, parmi d’autres, Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, § 63, série A no 262, Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil 1996-I, Morel c. France, no 34130/96, § 27, CEDH 2000‑VI, et Gereksar et autres c. Turquie, nos 34764/05, 34786/05, 34800/05 et 34811/05, § 27, 1er février 2011).
42. Dans les circonstances de la cause, la Cour rappelle avoir relevé que les juges de la Haute Cour administrative militaire se sont très largement fondés sur le rapport d’expertise médicale établi par le conseil de la santé de l’hôpital militaire GATA pour débouter le requérant.
43. Elle estime probable que le défaut de communication de ce rapport médical poursuivait en l’espèce un but d’économie et d’accélération de la procédure, d’autant que le requérant, qui avait subi un examen médical à l’hôpital militaire GATA dans le cadre de cette expertise, avait reçu une copie des conclusions du rapport provisoire (paragraphe 17 ci-dessus). Comme en témoigne sa jurisprudence, la Cour attache une grande importance à cet objectif, lequel, toutefois, ne saurait justifier de méconnaître un principe aussi fondamental que le droit à une procédure contradictoire (Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 30, Recueil 1997‑I).
44. Quant à l’argument selon lequel le requérant aurait pu consulter le dossier au greffe de la Haute Cour administrative militaire et obtenir une copie de la pièce litigieuse, la Cour est d’avis qu’une telle possibilité ne constitue pas en soi une garantie suffisante pour assurer le droit des intéressés à une procédure contradictoire.
45. Elle estime en effet que l’équité voulait que ce fût le greffe de la Haute Cour administrative militaire qui informât le requérant du dépôt de cette pièce. À cet égard, elle réaffirme que le fait d’attendre de l’avocat d’un requérant qu’il prenne l’initiative et qu’il s’informe périodiquement du point de savoir si de nouveaux éléments ont été versés au dossier équivaudrait à lui imposer une charge disproportionnée (voir, dans le même sens, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 57, CEDH 2002‑V).
46. Aussi la Cour estime-t-elle que le respect du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, exigeait que le greffe de la Haute Cour administrative militaire notifiât au requérant l’intégralité du rapport d’expertise médicale définitif afin que celui-ci eût la possibilité de le commenter, ce qui n’a pas été fait.
47. Ces considérations suffisent à la Cour pour conclure que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant la Haute Cour administrative militaire.
48. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Arrêt MENET c.FRANCE du 14 juin 2005 Requête no 39553/02
La CEDH considère qu'une partie civile qui ne peut pas accéder au dossier d'instruction consécutive à sa plainte
sans la présence d'un avocat n'est pas une atteinte excessive à ses droits au sens de l'article 6-1 de la Convention:
" 43. La Cour estime que la question qui se pose dans la présente affaire, le requérant étant une partie civile ayant choisi de ne pas
être représentée par un avocat, est de savoir si l’impossibilité pour lui d’accéder au dossier de l’instruction a constitué une violation de l’article 6 §
1 de la Convention.
44. La Cour observe en effet que dans le système français, un choix s’offre à la partie civile: elle peut décider d’être représentée, ou non, par un avocat. Ce choix influe toutefois sur ses droits au cours de la procédure et notamment lors de l’instruction, puisque seul un avocat, et non la partie civile elle-même, peut accéder au dossier de l’instruction.
45. La Cour rappelle tout d’abord qu’il n’est pas incompatible avec les droits de la défense de réserver à l’avocat de l’accusé l’accès au dossier de l’instruction (Kremzow c. Autriche, arrêt du 21 septembre 1993, série A no 268-B, p. 42, § 52 ; Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 39, § 88). Ce principe vaut à fortiori pour l’avocat de la partie civile, qui a seulement droit aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention, et non à celles de l’article 6 § 3 puisque les droits qui y sont énumérés ne bénéficient qu’à l’accusé.
46. La Cour admet ensuite que, selon les circonstances particulières de la cause, l’impossibilité d’accéder à son dossier, pour un accusé qui a choisi de se défendre sans avocat, peut être contraire aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention (Foucher c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 36).
47. Elle précise toutefois que si le principe de l’égalité des armes, au sens d’un juste équilibre entre les parties, vaut en principe aussi bien au civil qu’au pénal (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, § 33), les droits de l’accusé et ceux de la partie civile peuvent être différenciés.
Ainsi, dans l’arrêt Berger c. France (no 48221/99, § 38, 3 décembre 2002, CEDH 2002-X (extraits)), la Cour a jugé compatible avec le principe de l’égalité des armes l’article 575 du code de procédure pénale, qui pourtant limite les possibilités de recours de la partie civile, sans limiter les possibilités de recours de l’accusé et du ministère public. Par la suite, dans l’arrêt Perez c. France ([GC], no 47287/99, § 68, CEDH 2004-...), elle a distingué, en se référant à l’arrêt Berger précité, le rôle et les objectifs de la partie civile de ceux du ministère public, tout en insistant sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à la constitution de partie civile, sous son volet civil uniquement.
48. En l’espèce, la Cour note que le requérant, qui n’a jamais été représenté par un avocat, à la différence de l’affaire Frangy précitée, n’a eu aucune possibilité de consulter les pièces du dossier. Elle reconnaît, en conséquence, que la présentation de sa cause aux juridictions internes a pu être affectée par la limitation de l’accès au dossier de l’instruction aux avocats.
49. Toutefois, la Cour relève qu’en droit français, les accusés et les parties civiles, en tant que personnes privées, ne sont pas soumises au secret professionnel, à la différence des avocats. Or, le fait que l’accès au dossier de l’instruction est réservé aux avocats, soit directement, soit par leur intermédiaire, et qu’en conséquence le requérant n’a pu le consulter, découle précisément de la nécessité de préserver le caractère secret de l’instruction.
50. La Cour rappelle que le caractère secret de la procédure d’instruction peut se justifier par des raisons relatives à la protection de la vie privée des parties au procès et aux intérêts de la justice, au sens de la deuxième phrase de l’article 6 § 1 de la Convention et que, si cet article peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond, les modalités de son application durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause (voir entre autres précédents, Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 68, 15 juillet 2003).
51. Finalement, la Cour relève que la présente affaire diffère de l’affaire Foucher précitée, d’une part parce qu’en l’espèce le requérant n’était pas « accusé en matière pénale » au sens de l’article 6 § 3 de la Convention, d’autre part parce que, dans l’affaire Foucher, la question de la protection du secret de l’instruction ne se posait pas (arrêt Foucher, § 35), l’intéressé ayant fait l’objet d’une citation directe devant la juridiction de jugement.
52. Eu égard à l’ensemble des circonstances et compte tenu des intérêts en jeu, la Cour estime que la restriction apportée aux droits du requérant n’a pas apporté une atteinte excessive à son droit à un procès équitable.
53. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
AUGUSTO c. FRANCE Requête no 71665/01 du 11 janvier 2007
"50. La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire, au sens de l'article 6 § 1, « implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter » (voir, parmi beaucoup d'autres, Morel c. France, no 34130/96, § 27, CEDH 2000-VI ; Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 51, CEDH 2002-VII). Elle rappelle également avoir déjà jugé qu'une expertise médicale, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer de manière prépondérante leur appréciation des faits et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être efficacement commenté par les parties au litige (cf. Feldbrugge c. Pays-Bas, arrêt du 29 mai 1986, série A no 9, § 44 ; Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 437, § 36).
51. La Cour relève le caractère déterminant de la mission confiée au médecin qualifié, qui consiste dans un examen du dossier médical soumis à la CNITAAT, et qui a pour finalité de conclure, ou non, à la réunion des conditions médicales pour l'attribution de la prestation sociale réclamée. En l'espèce, elle observe que la CNITAAT s'est essentiellement fondée sur cet avis, qu'elle cite au soutien de sa motivation, pour rejeter la demande de pension de la requérante. A cet égard, la Cour n'est pas convaincue par la pertinence de la distinction opérée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 mars 2000, entre l'avis du médecin qualifié et le rapport d'un expert médical, pour justifier la soumission de ce dernier seulement à la discussion contradictoire des parties. En outre, s'il est vrai que l'avis du médecin qualifié, en droit, ne liait pas la CNITAAT, il était susceptible, comme le relève la présente affaire, d'exercer une influence décisive sur la décision de cette juridiction.
52. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue équitablement, faute de communication contradictoire de l'avis du médecin désigné par la CNITAAT permettant à la requérante de le discuter.
53. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention."
NOVO ET SILVA c. PORTUGAL du 25 septembre 2012 Requête no 53615/08
Les requérants n'ont pas eu accès à un rapport social durant la procédure d'adoption alors que le tribunal s'est fondé sur ce rapport pour rejeter la demande sans faire référence à cette information.
46. La Cour estime d’emblée qu’il est opportun d’examiner d’abord si l’absence de communication de l’information versée au dossier de la procédure par le tribunal de Torres Vedras a pu rendre la procédure inéquitable.
47. Les requérants font valoir à cet égard que le tribunal avait accepté leur demande de verser au dossier une information sur la procédure mentionnée par les services sociaux, dans le cadre de laquelle l’adoption de l’enfant en question aurait été ordonnée. Ils n’ont ensuite pris connaissance de ladite information qu’à une phase tardive de la procédure, alors que le tribunal aurait dû la porter à leur connaissance, afin de leur permettre de se prononcer en la matière. Plus grave encore, aux yeux des requérants, a été le raisonnement du tribunal dans son jugement du 17 avril 2008, lequel a statué sur l’affaire sans faire aucune référence à l’information en cause. Les requérants soulignent, à cet égard, que le tribunal a, par la suite, omis d’expliquer pourquoi l’information concernée n’était pas pertinente pour la bonne décision de la cause.
48. Le Gouvernement renvoie à l’ordonnance du juge du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne du 30 septembre 2008, laquelle a clarifié que l’information en question ne correspondait pas à celle que les requérants avaient demandée et qu’elle n’avait eu aucune influence sur l’issue du litige. Les requérants n’ont ainsi pas été mis dans une situation de net désavantage mettant en cause le principe du contradictoire.
49. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I ; Vermeulen c. Belgique, 20 février 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I ; Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, §§ 23-24, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I).
50. En l’espèce, il y a lieu de partir du constat que les requérants n’ont pris connaissance de l’information en cause qu’à un moment tardif de la procédure, lorsque le tribunal avait déjà rendu sa décision sur le bien-fondé de leur demande. Par ailleurs, le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne, après avoir reconnu qu’il était « important » de savoir si l’enfant en cause avait été confié à une autre famille, a lui-même décidé qu’il fallait inviter les services sociaux à verser au dossier copie de la décision ayant confié l’enfant à un autre couple en vue de son adoption (paragraphe 15 ci‑dessus). En procédant de la sorte, le tribunal a démontré que l’information en question pouvait avoir une incidence sur l’issue du litige (voir, a contrario, Verdu Verdu c. Espagne, no 43432/02, § 27, 15 février 2007).
51. Ce tribunal a par la suite rejeté la demande des requérants sans faire référence à l’information pourtant reçue de la part du tribunal de Torres Vedras. Il a fallu en effet que les requérants aient pris connaissance de l’existence de ladite information, lors d’une consultation du dossier, pour que le tribunal précise que l’information en cause n’était en tout état de cause pas celle sollicitée par les requérants et qu’elle n’avait eu aucune influence sur l’issue de l’affaire.
52. La Cour estime que cette précision – fournie, il convient de le rappeler, après la décision sur le bien-fondé de la demande des requérants – ne saurait compenser le manque d’information dont ont souffert les requérants. Comme la Cour l’a dit à maintes reprises dans des situations comparables, c’est aux seules parties au litige qu’il appartient d’apprécier si un document appelle des commentaires. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce au dossier (Ferreira Alves c. Portugal (no 3), no 25053/05, § 41, 21 juin 2007 ; Nideröst-Huber, précité, §§ 27 et 29).
53. En l’occurrence, les requérants auraient dû avoir l’opportunité de se prononcer ne serait-ce que sur la pertinence de l’information versée au dossier par le tribunal de Torres Vedras pour la bonne décision de la cause. Le fait que le tribunal de Lisbonne ait demandé l’information en cause à titre « confidentiel » (paragraphe 15 ci-dessus) n’y change rien : premièrement, le tribunal aurait pu en fournir copie en omettant les noms des intéressés ; deuxièmement, le tribunal n’a ni pris soin d’enlever ladite information du dossier lorsque les requérants ont eu à le consulter, ni justifié de son caractère « confidentiel » pour y nier l’accès.
54. Pareillement, peu importe la question de savoir si l’information litigieuse correspondait ou non à celle que les requérants avaient mentionnée dans leurs écritures et que le tribunal de Lisbonne avait sollicitée : il appartenait aux requérants de se prononcer sur la question et au tribunal de motiver sa décision à cet égard.
55. Tel n’ayant pas été le cas, les requérants n’ont pas bénéficié d’un procès équitable.
56. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
MARTINS SILVA c. PORTUGAL du 28 mai 2014 requête 12959/10
Violation de l'article 6-1 de la Convention : Le rapport du comité médical apportait des éléments nouveaux et importants à la procédure, ces derniers ayant permis au tribunal du travail de Maia de trancher le litige. Par conséquent le requérant aurait dû avoir accès à son dossier médical et pouvoir le discuter.
36. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I ; Vermeulen c. Belgique, 20 février 1996, § 33, Recueil 1996‑I ; Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, §§ 23-24, Recueil 1997‑I et, récemment, Novo et Silva c. Portugal, no 53615/08, § 54, 25 septembre 2012). Comme elle l’a dit à maintes reprises, c’est à elles seules qu’il appartient d’apprécier si un document appelle des commentaires, peu important l’effet réel des observations sur la décision du tribunal (Ziegler c. Suisse, no 33499/96, § 38, 21 février 2012). Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce au dossier (Ferreira Alves c. Portugal (no 3), no 25053/05, § 41, 21 juin 2007 ; Nideröst-Huber, précité, §§ 27 et 29 ; H.A.L. c. Finlande, no 38267/97, §§ 44-47, 7 juillet 2004). Ce principe vaut pour les observations et pièces présentées par les parties, mais aussi pour celles présentées par un magistrat indépendant tel que le commissaire du Gouvernement (actuellement rapporteur public) (Kress c. France [GC], no 39594/98, CEDH 2001-VI), par une administration (Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, 3 mars 2000) ou par la juridiction auteur du jugement entrepris (Nideröst-Huber c. Suisse, précité). La Cour rappelle aussi avoir déjà jugé qu’une expertise médicale, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer de manière prépondérante leur appréciation des faits et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être efficacement commenté par les parties au litige (Feldbrugge c. Pays-Bas, 29 mai 1986, § 44, série A no 99 ; Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II ; Augusto c. France, no 71665/01, § 51, 11 janvier 2007).
37. En l’espèce, la Cour observe que le rapport médical en question avait été ordonné par le tribunal à la demande des parties, lesquelles avaient par ailleurs adressé des questions spécifiques aux experts (voir ci-dessus paragraphe 16). Si le rapport du comité médical a confirmé le bilan médical précédent, il donne des informations précises s’agissant de la question litigieuse en répondant à chacune des questions qui avaient été formulées par les parties. Contrairement au Gouvernement, la Cour estime qu’il a ainsi apporté des éléments nouveaux à la procédure. Or, le requérant n’a pris connaissance des réponses apportées à ses questions qu’au moment où il a reçu le jugement du tribunal du travail de Maia.
38. La Cour ne partage pas non plus le point de vue du Gouvernement selon lequel la contestation du requérant portait uniquement sur des points de droit. En effet, la question litigieuse concernait l’aggravation du handicap auditif du requérant. Il s’agissait d’une question technique à laquelle seuls les médecins pouvaient répondre. En outre, celle-ci constituait un élément capital dans la décision du tribunal. Le rapport du comité médical et, en particulier, les réponses des experts étaient donc déterminants pour la reconnaissance du droit du requérant à la révision de son IPP en raison de l’aggravation de son infirmité auditive.
39. Par ailleurs, la Cour note que, selon l’article 145 § 5 du code de procédure du travail, le juge peut ordonner la réalisation d’autres actes de procédures, il peut aussi demander des clarifications en cas d’imprécisions ou contradictions, ceci s’est d’ailleurs vérifié en ce qui concerne le premier rapport du comité médical. En l’occurrence, n’ayant pas eu connaissance du rapport du comité médical, le requérant n’a pu demander des clarifications ou autres actes de procédure.
40. Pour le Gouvernement (ci-dessus paragraphe 31), le défaut de communication du rapport du comité médical et l’impossibilité d’y répondre n’ont fait subir au requérant aucun préjudice important dans l’exercice de son droit de participer de manière adéquate à la procédure litigieuse.
41. La Cour rappelle que conformément à l’article 35 § 3 b) de la Convention, elle peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».
42. Certes, la Cour a déjà eu recours à l’absence de préjudice important pour déclarer irrecevables des requêtes similaires pour non-communication d’observations d’autorités internes au requérant (Holub c. République Tchèque (déc.), no 24880/05, 14 décembre 2010, et Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal, précité). La présente affaire doit cependant être distinguée de ces dernières car en l’occurrence, comme elle l’a déjà observé auparavant, le rapport du comité médical apportait des éléments nouveaux et importants à la procédure, ces derniers ayant permis au tribunal du travail de Maia de trancher le litige. Par conséquent, la Cour estime que le requérant aurait dû se voir offrir l’opportunité de discuter le contenu du rapport et les réponses du comité médical aux questions qu’il avait formulées.
43. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement dans le cadre de la procédure visant la révision de son incapacité permanente partielle, faute de communication contradictoire du rapport du comité médical.
44. Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
EL MENTOUF c. SUISSE du 22 avril 2014 requête 28334/08
Non violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention: le versement tardif d'une pièce n'est pas une violation de la Convention, puisque la tardivité du versement de cette pièce est explicable et ne concerne pas directement le requérant qui a pu en débattre à l'audience. Nous espérons que ce précédent ne devienne pas une méthode d'enquête dans toute l'Europe.
21. La Cour rappelle avoir, dans plusieurs affaires contre la Suisse, conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que le requérant n’avait pas été invité à s’exprimer sur les observations d’une autorité judiciaire inférieure, d’une autorité administrative ou de la partie adverse (voir Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 24, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 36, 28 juin 2001, Ziegler c. Suisse, no 33499/96, § 33, 21 février 2002, Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005, Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005, Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 30, 13 juillet 2006, Kessler c. Suisse, no 10577/04, § 32, 26 juillet 2007, Werz c. Suisse, no 22015/05, § 52, 17 décembre 2009, et Locher et autres c. Suisse, no 7539/06, § 28, 25 juillet 2013).
22. Par ailleurs, concernant la matière pénale, la Cour a jugé que tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie (Brandstetter c. Autriche, 28 août 1991, §§ 66-67, série A no 211). De surcroît, l’article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge, (Edwards, précité, § 36, Previti c. Italie (déc.), no 45291/06, § 178, 8 décembre 2009). Enfin, comme la Commission l’avait précisé dans l’affaire Jespers c. Belgique précitée, § 58, « en définitive, l’article 6 § 3 b), reconnaît à l’accusé le droit de disposer de tous les éléments pertinents pour servir à se disculper ou à obtenir une atténuation de sa peine, qui ont été ou peuvent être accueillis par les autorités compétentes. S’il s’agit d’un document, la Commission estime que l’accès à celui-ci est une « facilité nécessaire » dès l’instant où il fait état, comme en l’espèce, de faits reprochés à l’accusé, de la foi qu’on peut ajouter à un témoignage, etc. ».
23. Dans la présente affaire, le requérant soutient, en premier lieu, qu’on lui a caché une pièce du dossier pénal, à savoir le procès-verbal d’audition du témoin X. daté du 4 février 2005. Sur ce point, la Cour constate, tout d’abord, que la pièce en question ne concerne en rien les faits reprochés au requérant mais concerne exclusivement les faits pour lesquels un autre coaccusé a été jugé et condamné. En outre, s’il est vrai que ce procès-verbal n’a pas été versé au dossier d’instruction de X. qui avait fait l’objet d’une précédente procédure pénale ayant débouché sur sa condamnation pénale, cette pièce, dès lors qu’elle a été invoquée par l’enquêteur dans l’instance pénale litigieuse, puis versée au dossier, a été soumise à la défense et a pu être débattue contradictoirement tant en première instance que devant les juridictions d’appel. Enfin, force est de constater que le témoin X. a été entendu à l’audience concernant le requérant et ses coaccusés, dont les déclarations avaient été consignées dans le procès-verbal en question.
24. En second lieu, le requérant déduit de la communication tardive du procès-verbal du 4 février 2005 qu’on lui a dissimulé d’autres pièces du dossier de l’instruction. A cet égard, la Cour observe d’emblée que le requérant n’affirme pas que le dossier de l’instruction contenait des preuves à charge contre lui dont il n’aurait pas pu avoir connaissance. En effet, il ne conteste pas que tous les éléments sur lesquels les juridictions nationales ont fondé sa condamnation ont été produits lors des débats publics de la procédure le concernant. Le requérant soutient que le dossier incriminé contenait d’autres pièces qu’il n’identifie pas précisément, mais qui, selon lui, lui auraient été favorables. La Cour constate que le seul élément invoqué par le requérant au soutien de ses allégations est la non-communication initiale du procès-verbal d’audition établi le 4 février 2005. La Cour observe à cet égard que les juridictions internes ont jugé, à chaque degré d’instance, que tous les éléments pertinents du dossier avaient été communiqués au requérant. Elle estime, en outre, que le contenu de l’éventuelle partie cachée du dossier de l’instruction n’est pas connu et que toute spéculation à l’égard des pièces qui s’y trouveraient est vouée à demeurer une hypothèse invérifiable. Elle relève encore que le requérant n’indique pas en quoi des éléments qui n’auraient pas été versés au dossier pénal auraient pu contribuer à sa défense. Enfin, rien ne prouve que les jugements motivés des juges nationaux qui rejettent la demande du requérant comme « purement exploratoire » aient été dictés par l’intention de cacher des documents à la défense ; à cet égard, en l’absence d’indices clairs d’une telle intention, la Cour estime qu’on ne peut que présumer la bonne foi des juridictions nationales.
25. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.
LOCHER ET AUTRES c. SUISSE du 30 juillet 2013 requête 7539/06
NON ACCES AU DOSSIER DEPOSE PAR LA COMMUNE DE RARON
27. La Cour rappelle que les garanties relatives à un procès équitable impliquent en principe le droit, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Joos c. Suisse, no 43245/07, § 27, 15 novembre 2012 ; Ellès et autres c. Suisse, no 12573/06, § 25, 16 décembre 2010 ; Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V ; Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996‑I, pp. 206-207, § 31).
28. Dans plusieurs affaires concernant la Suisse, la Cour a constaté une violation de l’article 6 § 1 au motif que le requérant n’avait pas été invité à s’exprimer sur les observations d’une autorité judiciaire inférieure, d’une autorité administrative ou de la partie adverse (voir les arrêts Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 24, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I ; F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 36, 28 juin 2001 ; Ziegler c. Suisse, no 33499/96, § 33, 21 février 2002 ; Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005 ; Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005 ; Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 30, 13 juillet 2006 ; Kessler c. Suisse, no 10577/04, § 29, 26 juillet 2007 ; Ellès et autres c. Suisse, précité, § 29).
29. Dans ces affaires, la Cour a déclaré que l’effet réel des observations importe peu et que les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : celle-ci se nourrit, entre autres, de l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier (voir, à titre d’exemple, Ziegler, précité, § 38).
30. Force est de constater qu’en l’espèce les versions des parties divergent de manière manifeste quant aux faits. Il ressort du dossier que la seule expression de position proprement dite de la commune de Raron date du 19 avril 2004 et qu’elle ne fait pas expressément mention – ni dans le texte, ni dans les pièces jointes – des extraits des procès-verbaux des séances du 16 décembre 2003 et du 6 avril 2004 de son conseil municipal. Partant, rien n’indique l’existence d’une seconde position de cette commune.
31. Pourtant, dans son arrêt du 11 mars 2005, le tribunal cantonal du canton du Valais avait bien fait référence à une position de la commune de Raron du 28 mai 2004. De même, le Tribunal fédéral a mentionné dans son jugement du 9 août 2005 une position du 28 mai 2004, et, à un autre endroit du jugement, les positions du 19 avril et du 28 mai 2004. Et précisément, le Tribunal fédéral n’a pas exclu l’hypothèse que, par mégarde, cette seconde position n’ait pas été envoyée aux requérants.
32. Comme le gouvernement suisse le soutient, probablement à juste titre, l’absence de certitude des parties et des tribunaux quant à l’existence d’une ou de deux prises de position de la commune de Raron tient vraisemblablement au fait que la date du 28 mai 2004 était celle à laquelle les extraits des procès-verbaux des séances susmentionnées avaient été signés avec la mention « pour copie conforme » (« für getreue Abschrift »). Pour autant, cela n’explique pas pourquoi les tribunaux suisses font mention d’une position du 28 mai 2004.
33. La Cour considère que le respect du droit à un procès équitable, plus particulièrement le principe de l’égalité des armes, garanti par l’article 6 § 1, exigeait que les requérants eussent la faculté de prendre au moins connaissance des extraits des procès-verbaux des séances du 16 décembre 2003 et du 6 avril 2004 du conseil municipal de la commune de Raron, et, s’ils l’estimaient opportun, de soumettre leurs commentaires (voir aussi Ressegatti, précité, § 33). Le Gouvernement n’a pas apporté la preuve que cette possibilité leur a été donnée.
34. La Cour rappelle que le Tribunal fédéral a estimé que les requérants auraient pu se rendre compte de l’erreur commise ou demander l’autorisation de consulter le dossier. La Cour observe que les requérants étaient représentés par un avocat devant les instances internes, mais rappelle néanmoins qu’elle a, dans des circonstances certes différentes de celles de l’espèce, posé le principe selon lequel il appartient aux Etats contractants d’organiser leurs services et de former leurs agents de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 142, CEDH 2007‑V ; Dammann c. Suisse, no 77551/01, § 55, 25 avril 2006 ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 183, CEDH 2006‑V ; Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V). Dès lors, la Cour estime que le fait que les requérants auraient pu constater, sur la base de la lecture de l’arrêt du tribunal cantonal du Valais, qu’il existait apparemment une seconde expression de position de leur commune, datée du 28 mai 2004, ne dégage nullement les autorités internes de leurs obligations découlant de la Convention, même si les agents responsables de la non-transmission des documents ont agi de bonne foi.
35. Compte tenu de ce qui précède, surtout au vu des incertitudes et imprécisions sur les circonstances, ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention a été violé en l’espèce.
WYSSENBACH c. SUISSE du 22 octobre 2013 Requête 50478/06
Le requérant qui est avocat aurait dû chercher les observations de la partie adverse pour y répondre dans les délais.
35. La Cour rappelle que les garanties relatives à un procès équitable impliquent en principe le droit, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Joos c. Suisse, no 43245/07, § 27, 15 novembre 2012 ; Ellès et autres c. Suisse, no 12573/06, § 25, 16 décembre 2010 ; Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V ; et Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I).
36. Elle rappelle également avoir conclu, dans plusieurs arrêts concernant la Suisse, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que le requérant n’avait pas été invité à s’exprimer sur les observations d’une autorité judiciaire inférieure, d’une autorité administrative ou de la partie adverse (voir, par exemple, Nideröst‑Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 24, Recueil 1997‑I ; F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 36, 28 juin 2001 ; Ziegler c. Suisse, no 33499/96, § 33, 21 février 2002 ; Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005 ; Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005 ; Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 30, 13 juillet 2006 ; Kessler c. Suisse, no 10577/04, § 29, 26 juillet 2007 ; Schaller-Bossert c. Suisse, no 41718/05, § 43, 28 octobre 2010 ; et Ellès et autres, précité, § 29).
37. Dans ces arrêts, la Cour a déclaré que l’effet réel des observations importe peu et que les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier (voir, à titre d’exemple, Schaller-Bossert, précité, § 40).
38. En l’espèce, la Cour note que, les observations litigieuses n’ayant pas été notifiées par courrier recommandé, il n’est pas possible de vérifier si celles-ci sont effectivement parvenues aux requérants. Cela étant, elle rappelle que, selon sa jurisprudence, elle exige de l’organe de jugement qu’il apporte seulement la preuve de l’envoi des observations (« forward observations ») d’une partie à la partie adverse (Bartenbach c. Autriche, no 39120/03, § 33, 20 mars 2008). Or, dans la présente affaire, force est de constater qu’il ressort d’une mention figurant sur l’exemplaire des observations versé au dossier que celui-ci a été expédié aux parties. Comme le relève le président de la première cour civile du Tribunal fédéral dans sa lettre du 14 juin 2006 (paragraphe 19 ci-dessus), les observations de la partie adverse, reçues par le Tribunal fédéral le 12 décembre 2005, portent la mention apposée par tampon « pour information », complétée par la date manuscrite (« 13.12.05 ») et les initiales de la personne responsable à la chancellerie du Tribunal fédéral. Certes, les observations de la cour d’appel, reçues par le Tribunal fédéral le 13 décembre 2005, ne portaient que la mention apposée par tampon, mais, selon la lettre susmentionnée, le personnel de la chancellerie du Tribunal fédéral affirme avoir immédiatement transmis celles-ci.
39. De plus, la Cour prend acte de la lettre des requérants du 15 février 2006, dont il ressort que ceux-ci n’avaient pas connaissance de la lettre du 28 novembre 2005 du Tribunal fédéral, lettre dans laquelle celui-ci avait imparti à la cour d’appel ainsi qu’à la partie adverse un délai échéant le 13 décembre 2005 pour prendre position sur les mesures provisionnelles demandées par les requérants ainsi qu’un délai échéant le 11 janvier 2006 pour la soumission de leurs observations sur le fond (paragraphes 11 et 15 ci-dessus). Tenant compte du fait que la décision sur l’effet suspensif a été rendue le 29 décembre 2005, soit seize jours après l’échéance du délai en question, la Cour voit mal pourquoi les requérants ont attendu plus d’un mois après l’échéance du second délai pour réclamer les éventuelles observations des autres parties. Elle partage l’avis du Gouvernement selon lequel cette négligence est à imputer aux intéressés et non pas au Tribunal fédéral. En outre, elle observe que les requérants n’ont jamais contesté qu’ils n’ignoraient pas l’existence des observations en question.
40. Partant, compte tenu des preuves apportées dans la présente espèce qui relève d’un litige purement civil, la Cour est convaincue que le Tribunal fédéral ait effectivement communiqué les observations aux requérants et que ceux-ci, même à supposer qu’ils ne les eussent pas reçues, ont ou auraient pu avoir connaissance de leur existence. En cela, la présente affaire peut être distinguée de Ferreira Alves c. Portugal (no 5) (no 30381/06, 14 avril 2009), de Ferreira Alves c. Portugal (no 3) (no 25053/05, 21 juin 2007), ainsi que d’Antunes et Pires c. Portugal (no 7623/04, 21 juin 2007).
41. Certes, la Cour a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans l’arrêt Schaller-Bossert où la requérante, qui n’était pas représentée par un avocat, aurait – selon le Tribunal fédéral – dû répondre de manière spontanée aux observations litigieuses (reçues avec la mention apposée par tampon « pour information ») déposées devant cette instance pour ne pas renoncer à ses droits découlant de l’article 6 § 1 de la Convention (Schaller-Bossert, précité, §§ 42-43 ; voir aussi Joos, précité, § 29). Il faut cependant distinguer la présente affaire de l’affaire Schaller‑Bossert en ce que le requérant en l’espèce est un avocat expérimenté qui avait saisi le Tribunal fédéral dans la présente cause à maintes reprises, et qui connaissait ou aurait dû connaître la pratique du Tribunal fédéral (cf. également l’affaire Joos, précitée, § 32, dans laquelle la Cour a considéré « que l’on aurait pu attendre du requérant, en sa qualité d’avocat, qu’il ait connaissance de la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral et agisse en conséquence »).
42. Les éléments qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce.
JANYR c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE du 31 octobre 2013 requête 42937/08
LE REQUERANT N'A PAS EU ACCES AUX ELEMENTS PRESENTES PAR LA HAUTE COUR AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
56. La Cour rappelle que la notion de procès équitable comprend le droit à un procès contradictoire qui implique le droit pour les parties de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir, parmi beaucoup d’autres, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 24 ; Milatová et autres c. République tchèque, no 61811/00, § 59, CEDH 2005‑V).
57. En l’espèce, comme la Cour l’a déjà dit ci-dessus (voir paragraphe 51), les observations que la haute cour a présentées à la Cour constitutionnelle contenaient certains éléments additionnels par rapport à ses décisions précédentes. Il n’est en outre pas possible de conclure que ces observations étaient superfétatoires ou qu’elles n’avaient aucune incidence sur la décision de la juridiction constitutionnelle. Partant, la Cour estime que le respect du droit à un procès équitable, pris sous l’angle en particulier du respect du principe du contradictoire, exigeait que le requérant eût la possibilité de soumettre ses commentaires aux observations de la haute cour ou, pour le moins, qu’il en soit informé pour décider, le cas échéant, d’y répondre (voir, mutatis mutandis, 3A.CZ s.r.o. c. République tchèque, no 21835/06, § 39, 10 février 2011). Or, cette faculté ne lui a pas été donnée.
58. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
MESSIER C. FRANCE DU 30 JUIN 2011 REQUÊTE 25041/07
LES FAITS
Le requérant, Jean-Marie Messier, est un ressortissant français né en 1956 et résidant à New York. Il était, jusqu’au 1er juillet 2002, date de sa démission, président-directeur général de la société Vivendi Universal.
En juillet 2002, une procédure fut ouverte par la Commission des opérations de bourse (COB) concernant Vivendi Universal. Cette procédure, qui s’inscrivait dans le cadre d’une crise de confiance dans l’entreprise et sa direction, concernait la régularité de l’information financière délivrée au marché depuis la fusion avec un groupe canadien en décembre 2000. Il s’agissait notamment de déterminer si le management avait, le plus tôt possible, informé le public de tout fait important susceptible, s’il était connu, d’avoir une incidence significative sur le cours de l’action. Des griefs furent communiqués à M. Messier le 12 septembre 2003. La COB précisa que compte tenu du volume exceptionnel de pièces de la procédure et des nécessités de leur reproduction, ces pièces seraient mises à sa disposition pour trois mois, ce qui fut fait à compter du 29 octobre 2003.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, l’Autorité des marchés financiers (AMF) succéda à la COB et les procédures en cours devant la COB se poursuivirent de plein droit devant la « commission des sanctions » de l’AMF.
M. Messier déposa ses premières observations en mars 2004. A sa demande, le rapporteur convoqua la directrice de la presse et des relations publiques de Vivendi Universal ; celle-ci ne se présenta pas, mais le rapporteur estima qu’elle pourrait être entendue par la commission des sanctions en séance. D’autres échanges de mémoires eurent lieu au cours des mois suivants, M. Messier se plaignant en particulier du fait que des pièces (notes, comptes-rendus, avis...) ne lui auraient pas été communiquées par l’AMF. La commission des sanctions de l’AMF examina cette affaire dans sa séance du 28 octobre 2004. Entre autres, M. Messier et la directrice de la presse et des relations publiques furent entendus. La commission rendit sa décision le 3 novembre 2004, rejetant les griefs de M. Messier au motif qu’il avait reçu communication du dossier, avait été entendu et avait pu produire les documents qu’il estimait utiles à sa défense.
S’agissant des témoignages qu’il avait demandés, la Commission nota qu’elle y avait satisfait : outre les témoignages recueillis en séance, elle avait pris connaissance par écrit des témoignages de deux autres personnes citées par M. Messier et qui ne s’étaient pas présentées en séance. La commission condamna M. Messier à une sanction pécuniaire d’un million d’euros.
En appel devant la Cour d’appel de Paris, M. Messier fit à nouveau valoir ses arguments relatifs à la dissimulation d’éléments du dossier. L’AMF admit que certains supports informatiques n’avaient pas été remis à M. Messier au moment de la remise de la photocopie des dizaines de milliers de pages composant le dossier, mais souligna que l’existence de ces supports n’avait pas été cachée, que M. Messier ne pouvait en ignorer le contenu puisqu’il s’agissait de ses propres agendas et e-mails, et qu’il n’en avait pas demandé de copie ; elle ajoutait qu’elle répondrait favorablement à toute demande de communication de ces supports. Le 28 juin 2005, la cour d’appel rendit son arrêt. Elle nota que l’AMF avait nécessairement collecté des documents sans rapport avec des griefs notifiés et qu’il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir versé au dossier la totalité des documents qu’elle détenait concernant le groupe, pas plus que les notes de travail établies dans l’accomplissement de sa mission et qui n’avaient pas vocation à être publiées. En outre, même en admettant que des pièces aient disparu, ce qui n’était pas établi, M. Messier ne précisait pas en quoi ces pièces auraient été de nature à influer sur l’appréciation des faits. Sur le fond, la cour d’appel fixa la sanction à 500 000 euros.
Le 19 décembre 2006, la Cour de cassation approuva en tout point le raisonnement de la cour d’appel et rejeta le pourvoi de M. Messier.
NON VIOLATION DES ARTICLES 6-1 ET 6-3 DE LA CONVENTION
Concernant l’argument selon lequel des pièces collectées au cours de la procédure n’auraient pas été communiquées, la Cour note que la COB et l’AMF ont mis en exergue le « volume exceptionnel des pièces de la procédure », qui se comptaient par « dizaines de milliers de pages ». Comme la cour d’appel l’a relevé, des documents sans rapport avec l’enquête furent nécessairement collectés et il ne saurait dès lors être reproché à l’AMF de ne pas avoir versé au dossier la totalité des documents qu’elle détenait.
Concernant en particulier le contenu des messageries électroniques de Vivendi Universal (auxquelles M. Messier indiquait n’avoir plus accès depuis sa démission), la Cour note entre autres qu’au cours de la procédure nationale, l’intéressé n’a pas soutenu que l’intégralité de ces messageries n’aurait pas été imprimée et versée au dossier. En outre, il n’a pas indiqué en quoi les éléments qui n’auraient pas été versés au dossier auraient pu contribuer à sa défense. Enfin, et même si cette voie ne fut pas fructueuse pour lui, il a disposé de recours pour demander le versement de ces pièces au dossier (il a en effet pu faire valoir ses griefs devant la cour d’appel puis la Cour de cassation).
Concernant les témoignages, la Cour relève que M. Messier n’a fourni aucun argument à l’appui de sa thèse selon laquelle l’audition de la directrice de la presse et des relations publiques de Vivendi Universal seulement au stade de l’audience devant la Commission des sanctions de l’AMF aurait nuit à sa défense. Qui plus est, il n’a pas demandé à ce que celle-ci soit à nouveau entendue en appel, pas plus que les deux autres témoins qui n’avaient déposé que par écrit devant la commission des sanctions.
Il ne ressort donc pas des éléments dont dispose la Cour que la non-communication de pièces ou les conditions d’audition des témoins aient porté atteinte aux droits de la défense et à l’égalité des armes. Il n’y a ainsi pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3.
LA COUR
52. Tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la défense : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie (Brandstetter c. Autriche, 28 août 1991, série A no 211, §§ 66-67). De surcroît, l'article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (Edwards précité, § 36).
53. Ce principe vaut pour les observations et pièces présentées par les parties, mais aussi par un magistrat indépendant tel que le commissaire du Gouvernement (Kress c. France [GC], no 39594/98, § 74, CEDH 2001-VI, et APBP c. France, no 38436/97, 21 mars 2002), par une administration (Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, § 44, 3 mars 2000) ou par la juridiction auteur du jugement entrepris (Nideröst-Huber c. Suisse, § 24, 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I).
54. Par ailleurs, les parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier (voir Nideröst-Huber, précité, §§ 27 et 29, F.R. c. Suisse, no 37292/97, §§ 37 et 39, 28 juin 2001, et Güner Çorum c. Turquie, no 59739/00, §§ 31-32, 31 octobre 2006).
55. La Cour relève que, dans la présente affaire, le requérant se plaint, d'une part, de ne pas avoir eu accès à certains documents et, d'autre part, de ne pas avoir pu entendre certains témoins.
56. Pour ce qui est des documents, elle constate que le requérant soutient que des pièces du dossier rassemblées par l'AMF en ont été retirées ou n'y ont pas été versées (paragraphe 37 ci-dessus). Celui-ci ajoute que, du fait qu'il avait démissionné avant la saisie des pièces, il n'avait plus de possibilité d'y avoir accès et que cela l'a privé du droit de disposer d'éléments de preuve à décharge.
57. La Cour l'a affirmé à maintes reprises, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil 1997-III, Morel c. France (no2), no43284/98, § 63, 12 février 2004 et Ünel c. Turquie, no 35686/02, § 45, 27 mai 2008).
58. En ce qui concerne tout d'abord le fait que tous les documents collectés n'auraient pas été versés au dossier, la Cour relève qu'il ressort des différentes écritures que la COB puis l'AMF rassemblèrent de très nombreux documents au cours de leur enquête. Ainsi, le rapporteur de la COB se référa lui-même au volume exceptionnel des pièces de la procédure réunies au cours de l'enquête et accorda aux mis en cause un délai de trois mois pour étudier le dossier et présenter leurs observations (paragraphe 9 ci-dessus). L'AMF quant à elle, mentionna « des dizaines de milliers de pages » composant le dossier et dont la photocopie avait été remise aux mis en cause (paragraphe 17 ci-dessus).
La cour d'appel quant à elle, constata que l'enquête avait porté sur l'ensemble de la communication du groupe Vivendi Universal depuis le 31 décembre 2000 et que l'AMF avait nécessairement collecté des documents sans rapport avec l'enquête en cours, qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir versé au dossier la totalité des documents qu'elle détenait concernant le groupe ou les notes établies pour la réalisation de sa mission et qui n'avaient pas vocation à être rendues publiques.
59. Pour ce qui est des pièces figurant au dossier, la Cour note que la Commission des sanctions de l'AMF précisa que tous les mis en cause avaient eu accès au dossier (paragraphe 15 ci-dessus).
Elle constate d'ailleurs sur ce point que le requérant ne soutient pas que le dossier communiqué à la commission des sanctions de l'AMF contenait des documents auxquels l'accès lui aurait été refusé.
60. Concernant en particulier le contenu des messageries électroniques de l'entreprise, le requérant a signé un procès-verbal attestant de la remise des disques sur lesquels leur contenu avait été copié. Or, il ne ressort pas du dossier qu'il ait émis des réserves sur le fait que l'intégralité du contenu de ces disques n'avait pas été imprimée et versée au dossier.
Ainsi, dans ses observations devant la cour d'appel, l'AMF fit remarquer que les supports en cause étaient des copies, que les requérants détenaient les originaux des courriels et des agendas ainsi que des supports informatiques. Elle indiqua également qu'elle répondrait positivement à toute demande, émanant notamment du requérant, tendant à la communication de ces supports.
Or, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait formulé une telle demande devant la cour d'appel.
61. Elle relève encore que le requérant n'indique pas en quoi des éléments qui n'auraient pas été versés au dossier auraient pu contribuer à sa défense. Il convient de noter sur ce point que la cour d'appel releva que le requérant fournissait la liste détaillée des pièces manquantes mais n'indiquait pas en quoi elles auraient été de nature à influer sur l'issue de l'affaire (paragraphe 19 ci-dessus).
En outre, selon la cour d'appel, le requérant, qui connaissait les auteurs des pièces « prétendument » manquantes, aurait pu demander leur audition devant la commission des sanctions ou devant elle, ce qu'il n'a pas fait.
62. La Cour note enfin que le requérant a eu l'occasion de faire valoir ces griefs successivement devant la cour d'appel et la Cour de cassation, juridictions judiciaires qui ont examiné les arguments soulevés avant de les rejeter.
63. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n'a pas démontré que le fait que certaines pièces aient été collectées au cours de l'enquête et non versées au dossier aurait porté atteinte au contradictoire et à l'équité de la procédure et qu'il ne disposait d'aucun recours pour obtenir le versement au dossier de pièces qui auraient été nécessaires pour sa défense.
64. Pour ce qui est de l'audition des témoins, la Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, § 49, série A no 238).
65. Dans la présente affaire, la Cour note que le requérant se plaint de ce que Mme G. aurait été entendue par les enquêteurs de l'AMF en août 2002, sans qu'un procès-verbal ait été dressé. Il ajoute que le fait que l'audition de ce témoin ait été reportée pour avoir lieu finalement le jour de l'audience devant la Commission des sanctions ne lui a pas permis de tirer le meilleur parti de ce témoignage.
66. La Cour constate qu'en l'espèce, pour ce qui est de Mme G., celle-ci a bien été entendue à l'audience devant la commission des sanctions de l'AMF, à laquelle le requérant participa, assisté de ses avocats.
Or, le requérant ne fournit aucun argument à l'appui de sa thèse selon laquelle l'audition de ce témoin seulement au stade de l'audience aurait nui à sa défense. Il ne demanda par ailleurs pas à ce que celle-ci soit à nouveau entendue devant la cour d'appel, pas plus que MM. G. et M., qui avaient déposé par écrit devant la commission des sanctions de l'AMF.
67. En conclusion, il ne ressort pas des éléments dont dispose la Cour que la non-communication de pièces ou les conditions d'audition des témoins aient porté atteinte aux droits de la défense et à l'égalité des armes. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3.
Wagner C. Luxembourg requête 43490/08 du 06 octobre 2011
26. Le requérant soutient que le retrait de points d’un permis de conduire est une sanction de nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention. A ce titre, le requérant aurait dû être informé qu’il encourait cette sanction à un niveau de la procédure où il avait encore les moyens de contester sa culpabilité. Invoquant l’arrêt Malige (Malige c. France, 23 septembre 1998, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII), le requérant soutient qu’à défaut d’information quant au retrait de points, préalablement à l’ordonnance pénale, il n’aurait pas été en mesure de contester les éléments constitutifs de l’infraction. Il estime que, dans la mesure où la jurisprudence luxembourgeoise exige qu’un élément intentionnel soit retenu dans le chef d’une personne pour qu’elle puisse être condamnée, il aurait parfaitement pu contester les éléments constitutifs de l’infraction. Or, s’il avait su qu’il encourait un retrait de points de son permis, il n’aurait pas manqué de contester l’infraction qui lui était reprochée.
27. Le Gouvernement avance que le retrait de points du permis n’est pas en droit interne une peine pénale, mais une sanction administrative ; il ne conteste cependant pas qu’un tel retrait constitue une peine au sens de l’article 6 de la Convention. Le Gouvernement estime que cette qualification interne de sanction administrative, justifie l’absence de toute référence au retrait de points durant la procédure pénale suivie à l’encontre du requérant, et partant toute information préalable à sa condamnation. Le Gouvernement conteste encore que le requérant ait subi un grief découlant du défaut d’information préalable relatif au retrait de points. En effet, au vu de la nature objective de l’infraction de surcharge d’un véhicule et de l’absence de contestation de la part du requérant sur le bien-fondé de celle-ci, une information préalable quant au retrait de points n’aurait pas changé le résultat de la procédure pénale suivie à son encontre quant à son principe. Or, au vu du caractère automatique du retrait des points, suite à une condamnation pénale, l’automaticité de la condamnation engendre celle du retrait.
28. La Cour rappelle que dès lors qu’une sanction relève du domaine pénal, elle doit pouvoir être contrôlée par un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1, même si la Convention ne s’oppose pas à ce que les poursuites et les sanctions relatives aux délits mineurs relèvent en premier lieu des autorités administratives (Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 21–22, série A no 73).
29. Dans l’affaire Malige précitée, la Cour a constaté qu’un contrevenant était mis en mesure de contester les éléments constitutifs de l’infraction pouvant servir de fondement à la sanction pénale du retrait de points. Elle a relevé que l’intéressé avait aussi pu contester la réalité de l’infraction pénale, et soumettre aux juges répressifs tous les moyens de fait et de droit qu’il a estimés utiles à sa cause, sachant que sa condamnation entraînerait en outre le retrait d’un certain nombre de points (Malige c. France, précité, §§ 47 et 48). Cette information, dès le début de la procédure pouvant aboutir à un retrait de points, avait ainsi mis le contrevenant dans une situation lui permettant d’apprécier l’opportunité des moyens de défense à adopter face à l’accusation dont il faisait l’objet.
30. La Cour constate qu’en droit luxembourgeois, la sanction du retrait de points intervient automatiquement, dès lors qu’est établie la réalité d’une des infractions énumérées à l’article 2 § 2 de la loi de 1955, telle la surcharge d’un véhicule, par le biais d’une condamnation devenue définitive.
31. En l’espèce, contrairement à l’affaire Malige, le requérant n’a pas été informé du retrait de points dans le cadre de la procédure pénale. En effet, le simple fait que la législation prévoit le retrait de points, ne saurait, en l’absence d’un renvoi à cette législation au moment où le requérant disposait encore de la faculté de contester les faits qui lui étaient reprochés, être considéré comme portant suffisamment à sa connaissance l’étendue des sanctions qu’il encourait. Dès lors, la Cour retient que le requérant n’a été informé du retrait de points qu’à l’issue de la procédure pénale, c’est-à-dire au moment où l’ordonnance pénale était devenue irrévocable. Or, à ce stade, il ne pouvait plus, au regard de l’automaticité du retrait de points, utilement contester les faits qui lui étaient reprochés. Partant, cette information tardive n’a pas mis le requérant dans une situation lui permettant de préparer utilement et en connaissance de tous les éléments, et plus particulièrement de l’intégralité de la sanction encourue, sa défense contre l’infraction qui lui était reprochée.
32. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Foucher contre France du 18 mars 1997 Hudoc 604 requête 22209/93
"§36: La Cour estime donc, avec la Commission, qu'il était si important pour le requérant d'avoir accès à son dossier et d'obtenir la communication des pièces le composant, afin d'être en mesure de contester le procès-verbal établi à son encontre ()
Faute d'avoir eu cette position, l'intéressé n'était pas en mesure de préparer sa défense d'une manière adéquate et n'a pas bénéficié de l'égalité des armes, contrairement aux exigences de l'article 6§1 de la Convention, combiné avec l'article 6§3"
COUR DE CASSATION FRANÇAISE
LE JUSTICIABLE DOIT AVOIR ACCES AUX PIECES SOUMISES AU JUGE POUR POUVOIR LES DISCUTER
Cour de Cassation chambre civile 1, arrêt du 12 février 2014 pourvoi n°13-13581 Cassation
Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la
faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 15 novembre 2007, M. X... a été placé sous curatelle renforcée, l'Entraide sociale de la Loire, étant
désignée en qualité de curateur ; que par jugement du 28 octobre 2011, un juge des tutelles a maintenu cette mesure pour une période de cinq ans ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X..., qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été
avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant
l'audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait
aux exigences des textes susvisés
LE REFUS D'ACCES A DES PIECES DU DOSSIER PEUT ÊTRE JUSTIFIEE
POUR MAINTENIR UN EQUILIBRE ENTRE INTERETS DIVERGENTS
Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 15 janvier 2020 Pourvoi n° 19-80.891 rejet et irrecevabilité
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
26. Concernant la mise à disposition des pièces de la procédure, l’arrêt attaqué
énonce qu’en application de l’article 706-150 du code de procédure pénale, en
cas de recours contre une décision de saisie pénale immobilière prise dans le
cadre d’une enquête préliminaire, le propriétaire appelant ne peut prétendre
qu’à la mise à la disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à
la saisie qu’il conteste, l’accès limité à certaines pièces de la procédure, en
l’espèce les pièces se rapportant à la saisie, conciliant de façon satisfaisante
le respect du droit de propriété et des exigences liées à la manifestation de la
vérité avec l’efficacité des enquêtes pénales. En application de l’article 6 de
la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article préliminaire du code
de procédure pénale, il incombe à la juridiction saisie de veiller au respect du
principe du procès équitable qui implique le respect du contradictoire et que
l’appelant ait connaissance des pièces susceptibles d’avoir une influence
prépondérante sur sa décision et donc d’avoir une incidence sur l’issue du seul
litige dont elle est saisie.
27. Les juges ajoutent que figurent au dossier de la procédure, outre l’ordonnance appelée, la requête du procureur national financier et la décision de saisie de ce dernier, diverses autres pièces relatives à la saisie contestée qu’ils énumèrent de façon détaillée avant de souligner que les pièces auxquelles peut prétendre la partie intéressée appelante d’une autorisation de saisie pénale immobilière ordonnée en enquête préliminaire sont complètes et suffisantes et se rapportent directement à la décision contestée.
28. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision.
29. En effet, la restriction apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l’enquête et de l’instruction, la jurisprudence de la Cour de cassation favorisant le maintien de cet équilibre.
30. D’une part, sont considérées comme les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, la requête du ministère public aux fins de saisie ainsi que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et, antérieurement à la loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, la décision de saisie du ministère public.
31. D’autre part, la chambre de l’instruction, saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d’une telle mesure, s’appuie, dans ses motifs décisoires, sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.
32. Par ailleurs, si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est exigeante au regard du respect des droits de la défense, il en découle également que le droit à une divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu en présence d’intérêts concurrents, et notamment la nécessité de garder secrètes les investigations policières, les mesures restreignant les droits de la défense devant être absolument nécessaires (CEDH, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 58) et suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (CEDH, Doorson c. Pays-Bas,26 mars 1996, § 72 ; CEDH, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 54).
33. En conséquence, les griefs ne peuvent qu’être écartés.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
34. Pour confirmer l’ordonnance de saisie pénale immobilière l’arrêt relève, s’agissant de la proportionnalité de cette mesure, que dans le cadre de l’enquête préliminaire, la chambre de l’instruction est saisie d’une dizaine de recours formés contre les autorisations de saisies immobilières de dix propriétés viticoles acquises pour un montant total de 22 672 097, 65 euros et dont la valeur a été estimée par le service des domaines à la somme totale de 22 917 000 euros.
35. Les juges soulignent également qu’il n’est pas contesté que la société Lamont a obtenu un prêt d’un montant de 30 000 000 euros de la banque ICBC à Paris en produisant 12 faux actes notariés d’achats de châteaux et que si la somme de 12 000 000 euros a été versée à des études notariales pour des propriétés viticoles, le reliquat de 18 000 000 euros a été transféré par cette société à la société PHL au prétexte d’autres faux achats de propriétés.
36. Les juges constatent que la saisie pénale immobilière a été sollicitée et autorisée au motif que l’immeuble a été acquis le 23 février 2013 par la société Major Cheer Ltd pour un prix de 5 150 000 euros intégralement financé par la société Lamont à l’aide des fonds provenant du prêt de 30 millions d’euros.
37. Ils relèvent qu’il est suffisamment établi que cet immeuble a été financé avec le produit des infractions, objet de l’enquête préliminaire.
38. Ils ajoutent que le bien saisi, qui constitue le produit de l’infraction, est susceptible de confiscation en application de l’article 131-21, alinéa 3, du code pénal, la peine complémentaire de confiscation du produit de l’infraction étant prévue tant par les articles 313-7, 4°, 319-9,131-39, 7° du même code réprimant l’escroquerie que par les articles 324-7, 8°, 324-9, 131-39 dudit code, s’agissant du blanchiment de ce délit.
39. Ils concluent que le principe de proportionnalité ne peut s’appliquer à la saisie provisoire aux fins de garantir la confiscation d’un bien qui, dans sa totalité, est le produit ou l’objet des infractions d’escroquerie, de blanchiment et d’abus de biens sociaux objet de la poursuite.
40. En conséquence, en prononçant ainsi, et dès lors que la juridiction d’instruction doit apprécier et vérifier, sur la base des indices dont elle dispose, la nature de produit de l’infraction du bien saisi chaque fois qu’elle statue sur cette mesure ou sur une demande de restitution, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
41. D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
42. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme ;
LE PRINCIPE D'IMMÉDIATETÉ IMPOSE AUX JUGES D'ÉCOUTER LES PREVENUS
CAMACHO CAMACHO c. ESPAGNE du 24 septembre 2019 Requête no 32914/16
Violation article 6-1 : En première instance, le requérant est relaxé. En appel il est condamné sans l'entendre et sans entendre les témoins. Le juge en appel, avant d'apporter une appréciation différente, aurait dû entendre les témoins et le requérant.
a) Principes généraux
29. La Cour observe d’une part que la problématique juridique soulevée dans la présente affaire correspond à celle examinée dans les arrêts Hernández Royo c. Espagne, no 16033/12, §§ 32 à 35, 20 septembre 2016, Igual Coll c. Espagne, no 37496/04, 10 mars 2009, Marcos Barrios c. Espagne, no 17122/07, 21 septembre 2010, Vilches Coronado et autres c. Espagne, no 55517/14, 13 mars 2018, entre autres. Par conséquent, elle renvoie aux principes qui y sont établis.
30. Elle rappelle, d’autre part, que comme elle a déclaré dans l’affaire Lacadena Calero c. Espagne (no 23002/07, 22 novembre 2011) lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des moyens de preuve présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte considéré comme une infraction pénale (Dondarini c. Saint-Marin, no 50545/99, § 27, 6 juillet 2004, Ekbatani c. Suède, § 32, 26 mai 1988, série A no 134, Constantinescu c. Roumanie, § 55, 27 juin 2000). Dans ce type de cas, le réexamen de la culpabilité de l’accusé devrait conduire à une nouvelle audition intégrale des parties intéressées (Ekbatani c. Suède, précité, § 32).
b) Application de ces principes en l’espèce
31. La Cour constate qu’une audience a eu lieu en l’espèce devant l’Audiencia provincial, à laquelle était présent le requérant ainsi que son représentant.
32. Elle relève toutefois que l’examen direct, personnel et contradictoire du requérant ainsi que de certains témoins n’a pas eu lieu au cours de l’audience. À cet égard, la Cour observe qu’il avait déjà été proposé par le ministère public comme moyen de preuve à pratiquer au sein de l’audience en appel et que l’Audiencia provincial de Castellón l’avait refusé dans une décision du 7 octobre 2013.
33. Par conséquent, l’Audiencia provincial a infirmé le jugement rendu par le juge pénal et condamné le requérant en appel sans jamais entendre contradictoirement ce dernier et sans examiner les témoins. Force est de constater que l’Audiencia provincial a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de fait, non seulement objectifs, mais aussi subjectifs –en l’espèce, l’intention du requérant de se venger de l’avocate de son ex‑compagne–. Par ailleurs, contrairement au jugement d’instance, elle considéra prouvé que le requérant avait pris connaissance de l’existence du jugement dans la procédure civile sur la garde de sa fille et de son résultat défavorable à ses intérêts avant l’agression à l’avocate de son ex-compagne. Or, la Cour observe qu’aucune preuve figurant ni dans le dossier de la première instance ni dans celui de la juridiction d’appel ne permettait d’établir ce fait avec certitude. Cette conclusion ne peut donc pas être considérée une inférence et nécessite du témoignage de référence. En effet, lorsque l’inférence d’un tribunal a trait à des éléments subjectifs, il n’est pas possible de procéder à l’appréciation juridique du comportement de l’accusé sans avoir au préalable essayé de prouver la réalité de ce comportement, ce qui implique nécessairement la vérification de l’intention de l’accusé par rapport aux faits qui lui sont imputés (Lacadena Calero c. Espagne, précité, § 47).
34. En l’espèce, il s’agit de l’avis de la Cour, d’une nouvelle appréciation des éléments subjectifs des délits en question qui se traduit en une altération des faits déclarés prouvés en première instance. Cette altération s’est effectuée sans que le requérant ait eu l’occasion d’être entendu personnellement afin de contester, moyennant un examen contradictoire, la nouvelle appréciation effectuée par l’Audiencia Provincial (Roman Zurdo et autres c. Espagne, nos 28399/09 et 51135/09, § 39, 8 octobre 2013).
35. La Cour observe en outre que l’interprétation de l’Audiencia provincial mit également en doute la crédibilité d’un des témoins qui avait exprimé un alibi en faveur du requérant et signala qu’un autre témoin, dont la déclaration ne pouvait pas être prise en compte à cause de son lien familial avec l’accusé, avait démontré une crédibilité remarquable. Pourtant, aucun témoin n’a été entendu par l’Audiencia directement en appel, ce qui empêcha d’apprécier leur crédibilité et de modifier les inférences faites par le juge de première instance.
36. À la lumière des arguments qui précèdent, la Cour conclut qu’en l’espèce l’étendue de l’examen effectué par l’Audiencia provincial rendait nécessaire l’audition du requérant et des témoins. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
ATUTXA MENDIOLA ET AUTRES c. ESPAGNE du 13 juin 2017 Requête no 41427/14
Article 6-1 et Pays Basque : Le premier requérant est l’ancien président du Parlement de la Communauté autonome du Pays basque. Le deuxième requérant et la troisième requérante étaient respectivement le vice-président et la greffière dudit Parlement à l’époque à laquelle le premier requérant en était le président. Les intéressés avaient commis un délit de désobéissance à l’autorité judiciaire en refusant notamment de se conformer à la décision du Tribunal suprême qui avait ordonné, le 27 mars 2003, la dissolution de tous les groupes parlementaires présents au sein des différentes institutions des communautés autonomes du Pays Basque et de la Navarre qui porteraient le nom de Batasuna. Cette décision faisait suite à la déclaration d’illégalité des partis politiques Herri Batasuna,Euskal Herritarrok et Batasuna, et à la décision de dissolution de ces partis.
La Cour suprême a interprété les éléments de preuve recueillis par l'instance inférieure sans attendre les prévenus. Comme elle a dépassé son rôle du juge du droit par un rôle d'interprétation des faits, elle aurait dû entendre les requérants pour entendre leurs explications sur le manque d'intention frauduleuse, avant de les condamner.
a) Principes généraux
38. En ce qui concerne les principes généraux pertinents, la Cour renvoie aux paragraphes 36 à 38 de l’arrêt Lacadena Calero(précité).
b) Application de ces principes en l’espèce
39. La Cour souligne d’emblée que la présente affaire repose sur la même problématique que celle qui est exposée dans les arrêts Lacadena Calero(précité) et Serrano Contreras c. Espagne (no 49183/08, 20 mars 2012).
40. Elle relève qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le Tribunal suprême s’est livré à une nouvelle interprétation, distincte de celle opérée par le Tribunal supérieur, de la notion de « refus net » d’exécuter des décisions de justice, prévue à l’article 410 § 1 du code pénal. Elle note que cette interprétation a débouché sur la condamnation des intéressés pour délit de désobéissance.
41. Elle constate que les parties sont également d’accord pour dire que le Tribunal suprême a reproduit dans son arrêt les faits qui avaient été considérés comme prouvés par le Tribunal supérieur. Elle relève cependant que, contrairement au tribunal a quo, le Tribunal suprême a conclu que les accusés avaient refusé « de manière consciente et délibérée » de se conformer à sa décision qui ordonnait la dissolution de tous les groupes parlementaires présents au sein des différentes institutions des communautés autonomes du Pays Basque et de la Navarre qui porteraient le nom de Batasuna. Elle estime pertinent de relever que, pour parvenir à cette conclusion, la juridiction de cassation s’est fondée sur une nouvelle appréciation des différents éléments de preuve qui avaient déjà été examinés par le Tribunal supérieur : d’une part, des moyens à caractère documentaire et, d’autre part, des témoignages, proposés tant par la partie accusatrice que par les requérants, et les déclarations de ces derniers. Ces éléments de preuve ont été administrés lors de l’audience publique devant le Tribunal supérieur, les parties ayant pu présenter leurs griefs dans le respect des principes d’immédiateté, de publicité et de contradiction. Le Tribunal suprême a procédé à cette nouvelle appréciation sans avoir eu un contact direct avec les parties et, surtout, sans avoir permis à ces dernières d’exposer leurs arguments en réponse aux conclusions exposées (Serrano Contreras, précité, § 36).
42. La Cour note que le Tribunal suprême, pour arriver à une nouvelle interprétation juridique du comportement des requérants, s’est prononcé sur des circonstances subjectives concernant les intéressés, à savoir la conscience par ceux-ci de l’irrégularité de leurs actions (paragraphe 18 ci‑dessus). Cet élément subjectif a été décisif dans l’établissement de la culpabilité des requérants. En effet, pour être qualifié de tel, le délit de désobéissance exige un « refus net ». La Cour constate que, après la tenue d’une audience publique au cours de laquelle les requérants ont été entendus, le Tribunal supérieur avait considéré que cet élément subjectif était absent, que ce fût directement ou indirectement (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). En revanche, le Tribunal suprême a, quant à lui, conclu à l’existence d’une intention de la part des requérants sans apprécier directement leur témoignage : ce jugement est en contradiction avec les conclusions du tribunal d’instance, qui, lui, avait entendu les accusés et d’autres témoins.
43. Aux yeux de la Cour, le Tribunal suprême s’est écarté du jugement d’instance après s’être prononcé sur des éléments de fait et de droit qui lui ont permis d’établir la culpabilité des accusés. À cet égard, force est de constater que, lorsque le raisonnement d’un tribunal repose sur des éléments subjectifs (comme, en l’espèce, l’existence d’une volonté rebelle), il est impossible de procéder à l’appréciation juridique du comportement de l’accusé sans avoir au préalable essayé de prouver la réalité de ce comportement, ce qui implique nécessairement la vérification de l’intention de l’accusé relativement aux faits qui lui sont imputés (Lacadena Calero, précité, § 47).
44. Certes, le Tribunal suprême a apprécié l’intention des requérants après avoir examiné des faits prouvés par l’instance inférieure (dont les documents du dossier). Cependant, il est parvenu à sa conclusion par déduction, sans avoir entendu les intéressés, qui n’ont ainsi pas eu l’opportunité d’exposer devant lui les raisons pour lesquelles ils niaient avoir eu une intention frauduleuse (Lacadena Calero, précité, § 48). La Cour note à cet égard qu’une telle opportunité est inexistante dans la procédure en cassation.
45. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les questions qui devaient être examinées par le Tribunal suprême nécessitaient l’appréciation directe du témoignage des requérants (Serrano Contreras, précité, § 39).
46. Eu égard à l’ensemble des circonstances du procès, la Cour conclut que les requérants ont été privés de leur droit de se défendre dans le cadre d’un débat contradictoire. Partant, elle juge qu’il y a eu violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
PORCEL TERRIBAS ET AUTRES c. ESPAGNE du 8 mars 2016 Requête no 47530/13
Violation de l'article 6-1 : Après avoir été relaxé en première instance, au sens du principe de l'immédiateté, les requérants auraient dû être entendus par la Cour d'Appel qui les a condamné.
a) Principes généraux
22. En ce qui concerne les principes généraux pertinents en l’espèce, la Cour renvoie aux paragraphes 36 à 38 de l’arrêt Lacadena Calero c. Espagne (no 23002/07, 22 novembre 2011).
b) Application de ces principes en l’espèce
23. La Cour souligne d’emblée que la présente affaire repose sur la même problématique que celle exposée dans l’arrêt Valbuena Redondo c. Espagne (no 21460/08, 13 décembre 2011).
24. La Cour note qu’il n’est pas contesté en l’espèce que les requérants, qui furent acquittés en première instance, ont été condamnés par l’Audiencia Provincial de Grenade sans la tenue d’une audience publique.
25. Dès lors, afin de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, il échoit d’examiner le rôle de l’Audiencia et la nature des questions dont elle avait à connaître. Dans les autres affaires examinées par la Cour portant sur la même problématique (voir, pour tous, l’arrêt Valbuena Redondo, précité), la Cour statua qu’une audience s’avérait nécessaire lorsque la juridiction d’appel « effectue une nouvelle appréciation des faits estimés prouvés en première instance et les reconsidère », se situant ainsi au-delà des considérations strictement de droit. Dans de tels cas, une audience s’imposait avant de parvenir à un jugement sur la culpabilité du requérant (voir l’arrêt Igual Coll c. Espagne, no 37496/04, § 36, 10 mars 2009).
26. En somme, il incombera essentiellement de décider, à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, si la juridiction chargée de se prononcer sur l’appel a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de fait (voir également Spînu c. Roumanie, no 32030/02, § 55, 29 avril 2008).
27. En l’espèce, l’Audiencia Provincial de Grenade, pour arriver à une nouvelle interprétation juridique du comportement des accusés, s’est prononcée sur des circonstances subjectives les concernant, à savoir leur conscience de l’irrégularité de l’octroi des permis urbanistiques (paragraphe 7 ci-dessus). Cet élément subjectif a été décisif dans l’établissement de la culpabilité des accusés. En effet, le délit de corruption urbanistique exige que l’accusé ait agi de manière intentionnelle. Après la tenue d’une audience publique au cours de laquelle les requérants ainsi que plusieurs témoins ont été entendus, le juge pénal a considéré que cette exigence subjective quant au délit en cause n’était pas remplie. L’Audiencia Provincial a, quant à elle, conclu à l’existence d’une telle intentionnalité des requérants, et ce sans avoir procédé à l’appréciation directe des témoignages des requérants et en contradiction avec les conclusions du tribunal d’instance. En particulier, contrairement au juge a quo, elle considéra que les dépositions des trois employés de la municipalité devaient être interprétées comme impliquant clairement les requérants dans la commission du délit, dans la mesure où leur connaissance sur l’illégalité des permis urbanistiques ne faisait aucun doute. Cette nouvelle appréciation de l’élément subjectif du délit de corruption urbanistique s’est effectuée sans que les requérants aient eu l’occasion d’être entendus personnellement afin de contester, moyennant un examen contradictoire, la nouvelle appréciation effectuée par l’Audiencia Provincial.
28. Les arguments ci-dessus permettent à la Cour d’observer que la juridiction d’appel a réinterprété les faits déclarés prouvés et en a effectué une nouvelle qualification juridique, sans respecter les exigences du principe d’immédiateté (voir, a contrario, Bazo González c. Espagne, no 30643/04, § 36, 16 décembre 2008). À cet égard, force est de constater que, lorsque l’inférence d’un tribunal a trait à des éléments subjectifs (comme, en l’espèce, l’existence d’une intentionnalité), il n’est pas possible de procéder à l’appréciation juridique du comportement des accusés sans avoir au préalable essayé de prouver la réalité de ce comportement, ce qui implique nécessairement la vérification de l’intention des accusés par rapport aux faits qui leur sont imputés (Lacadena Calero, précité, § 47).
29. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’en l’espèce l’étendue de l’examen effectué par l’Audiencia rendait nécessaire l’audition des requérants en audience publique. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
ROMAN ZURDO ET AUTRES c. ESPAGNE du 8 octobre 2013 Requêtes 29399/09 et 51135/09
L'AFFAIRE DES ELUS LOCAUX DE MARBELLA QUI ONT ACCORDE DES PERMIS DE CONSTRUIRE FACILEMENT
Les juges en appel ont condamné les prévenus sans les écouter alors qu'ils avaient été relaxés en première instance après avoir été écoutés.
31. La Cour souligne d’emblée que la présente affaire repose sur la même problématique que celle exposée dans l’arrêt Valbuena Redondo c. Espagne (no 21460/08, 13 Décembre 2011).
32. En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants, qui furent acquittés en première instance, ont été condamnés par l’Audiencia Provincial de Malaga sans avoir été entendus en personne. À cet égard, s’agissant de l’argument du Gouvernement relatif au fait qu’en l’espèce une audience eut lieu, la Cour se doit de constater que les requérants n’ont pas été entendus au cours de cette audience. De même, les témoins, dont la déposition fut un des éléments pris en compte par le juge pénal pour parvenir à la condamnation des requérants, n’ont pas non plus été entendus par l’Audiencia Provincial.
33. Dès lors, afin de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, il échoit d’examiner le rôle de l’Audiencia et la nature des questions dont elle avait à connaître. Dans les autres affaires examinées par la Cour portant sur la même problématique (voir, pour tous, l’arrêt Valbuena Redondo c. Espagne susmentionné), la Cour statua qu’une audience s’avérait nécessaire lorsque la juridiction d’appel « effectue une nouvelle appréciation des faits estimés prouvés en première instance et les reconsidère », se situant ainsi au-delà des considérations strictement de droit. Dans de tels cas, une audience s’imposait avant de parvenir à un jugement sur la culpabilité du requérant (voir l’arrêt Igual Coll précité, § 36).
34. En somme, il incombera essentiellement de décider, à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, si la juridiction chargée de se prononcer sur l’appel a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de fait (voir également Spînu c. Roumanie, no 32030/02, § 55, 29 avril 2008).
35. En l’espèce, le juge pénal no 2 de Malaga a statué sur la base de plusieurs preuves, dont l’examen des dossiers administratifs relatifs aux permis de construire ainsi que les dépositions des accusés et de plusieurs témoins dont celle du secrétaire et du chef du service juridique de la mairie de Marbella.
36. Après la tenue d’une audience publique, au cours de laquelle les requérants ont été présents, le juge conclut, outre à la confusion normative existante dans la matière, à ce que les requérants ignoraient l’illégalité des permis de construire.
37. De son côté, l’Audiencia Provincial de Malaga avait la possibilité, en tant qu’instance de recours, de rendre un nouveau jugement sur le fond, ce qu’elle a fait le 25 avril 2007. Elle pouvait décider soit de confirmer l’acquittement des requérants soit de les déclarer coupables, après s’être livrée à une appréciation de la question de la culpabilité ou de l’innocence des intéressés.
38. L’Audiencia infirma le jugement entrepris. Sans entendre personnellement les requérants, elle effectua une nouvelle appréciation des moyens de preuve qui, à son avis, étaient essentiels pour parvenir à la conclusion sur la culpabilité des requérants, à savoir, les dépositions des accusés et des témoins, pour conclure à ce qu’ils devaient forcément être au courant de l’illégalité des permis. Par ailleurs, l’Audiencia se référa à la question de la « confusion normative » et conclut que les requérants, conseillers municipaux, avaient contribué à ladite confusion. Afin de parvenir à sa conclusion, l’Audiencia modifia tant les faits déclarés prouvés par le jugement contesté que la partie en droit de ce dernier.
39. Dans la mesure où l’Audiencia s’est prononcée sur des circonstances subjectives des requérants, à savoir qu’ils avaient connaissance de l’illégalité des permis de construire litigieux, sans une appréciation directe de leur témoignages, elle s’est écartée du jugement d’instance après s’être prononcée sur des éléments de fait et de droit qui l’ont conduit à déterminer la culpabilité des accusés. En effet, il ne s’agit pas, de l’avis de la Cour, d’une modification dans la qualification juridique du résultat des preuves administrées en première instance, mais d’une nouvelle appréciation de l’élément subjectif du délit de corruption urbanistique qui se traduit en une altération des faits déclarés prouvés en première instance. Cette altération s’est effectuée sans que les requérants aient eu l’occasion d’être entendus personnellement afin de contester, moyennant un examen contradictoire, la nouvelle appréciation effectuée par l’Audiencia Provincial.
40. Les arguments ci-dessus permettent à la Cour d’observer que l’Audiencia Provincial a fondé sa conclusion sur une nouvelle appréciation des éléments de preuve administrés au cours de l’audience publique devant le juge pénal no 2 de Malaga et sur lesquels les parties avaient pu présenter leurs allégations. L’Audiencia a procédé à cette nouvelle appréciation sans avoir eu un contact direct avec elles. Ainsi, la juridiction d’appel a réinterprété les faits déclarés prouvés et en a effectué une nouvelle qualification juridique, sans respecter les exigences du principe d’immédiateté (voir a contrario, Bazo González c. Espagne, no 30643/04, § 36, 16 décembre 2008).
41. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’en l’espèce l’étendue de l’examen effectué par l’Audiencia Provincial rendait nécessaire l’audition des requérants. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
LE SYSTÈME DE DÉFENSE INTERDIT
DECISION G. c ROYAUME UNI requête 37334/08 du 08 septembre 2011
La loi peut interdire à un prévenu de soutenir qu'il ne connaissait pas l'âge de la personne avec qui il a une relation sexuelle.
Article 6 §§ 1 et 2
La Cour constate qu’il ne lui appartient pas, en vertu de l’article 6 §§ 1 ou 2, d’imposer au Royaume-Uni quoi que ce soit touchant au contenu de son droit pénal. Le Parlement britannique a institué l’infraction de viol prévue par l’article 5 de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles afin de protéger les enfants d’abus sexuels et des conséquences de rapports sexuels prématurés. La Cour estime que la décision du Parlement d’interdire à tout prévenu de fonder sa défense sur le fait qu’il avait des motifs raisonnables de croire que la victime avait 13 ans ou plus ne saurait poser problème sous l’angle de l’article
6 §§ 1 ou 2.
Partant, le grief de G. au regard de l’article 6 §§ 1 ou 2 est irrecevable.
PAS ACCES AUX RAPPORTS ET AUX REQUISITIONS DU PARQUET
SCAVETTA c. MONACO du 30 MAI 2017 requête 33301/13
Article 6-1 : Le rapport du conseiller n'a été communiqué ni au requérant ni a parquet, par conséquent il n'y a pas violation en revanche le défaut de communication des réquisitions du parquet est non conforme à la Convention.
a) Sur l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur
40. La Cour rappelle que dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, elle a jugé qu’étant donné l’importance du rapport du conseiller rapporteur, principalement du second volet qui contient un avis sur le mérite du pourvoi et le projet d’arrêt, le rôle de l’avocat général et les conséquences de l’issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé par sa communication au ministère public, faute d’une communication identique du rapport aux conseils des requérants, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (31 mars 1998, § 105, Recueil 1998-II).
41. La question de l’absence de communication de ce rapport du conseiller rapporteur au justiciable ne soulève donc un problème au regard de l’article 6 § 1 de la Convention que dans la mesure où ledit rapport a été communiqué à l’avocat général avant l’audience (Reinhardt et Slimane-Kaïd, précité, § 105, et Pascolini c. France, no 45019/98, § 20, 26 juin 2003).
42. En l’espèce, la Cour constate que la pratique de la Cour de révision consiste à soumettre le rapport du conseiller rapport au secret du délibéré et, partant, à ne jamais le communiquer, partiellement ou en intégralité, aux parties ou au ministère public. Or, le requérant n’établit aucunement qu’il en aurait été autrement dans le cadre de la procédure le concernant.
43. Dès lors, aucune atteinte aux exigences de l’article 6 de la Convention, et plus spécialement aux droits de la défense et à l’égalité des armes, ne peut être constatée dans la présente affaire.
44. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Sur le défaut de transmission des conclusions du procureur général et l’impossibilité pour le requérant d’y répondre
45. La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, tel qu’interprété par la jurisprudence, « implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision » (voir, en matière pénale, J.J. c. Pays-Bas, 27 mars 1998, § 43, Recueil 1998-II).
46. Elle rappelle également qu’elle a eu l’occasion d’examiner ce type de grief et de conclure à la violation de l’article 6 § 1 dans le contexte de la procédure devant différentes cours suprêmes (voir, notamment, Vermeulen c. Belgique, 20 février 1996, § 33, Recueil 1996-I, Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil 1996-I, J.J., précité, et Reinhardt et Slimane-Kaïd, précité, § 106).
47. Dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd (précité), la Cour a déclaré que l’« absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est (...) sujette à caution », tout en relevant cependant que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, il existe une pratique « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes ». En revanche, elle a par la suite constaté que lorsque les parties avaient choisi de se défendre seules, elles ne bénéficiaient pas de cette pratique et, dès lors, elle a considéré que l’impossibilité d’accéder aux conclusions de l’avocat général et d’y répondre méconnaissait leur droit à une procédure contradictoire (Voisine c. France, no 27362/95, § 31, 8 février 2000, et Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 51, Recueil 2002-VII).
48. En l’espèce, la Cour constate qu’il existe une pratique devant la Cour de révision consistant pour le greffe général soit à déposer une copie des conclusions du procureur général dans le cartonnier des avocats, c’est-à-dire dans leurs boîtes à lettres professionnelles situées dans les locaux du palais de justice de Monaco, soit à en envoyer une copie à l’adresse personnelle des parties lorsqu’elles ne sont pas représentées (paragraphe 37 ci-dessus).
49. Aux yeux de la Cour, une telle pratique est de nature à offrir aux parties la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes.
50. Il n’est toutefois pas avéré que le requérant ait pu effectivement en bénéficier dans les circonstances de l’espèce.
51. La Cour note en effet que tant la requête en révision du requérant que l’arrêt de la Cour de révision ne font référence qu’au requérant lui-même et à son avocat plaidant, inscrit au barreau de Nice. Ce dernier n’étant pas avocat-défenseur et n’ayant pas de boîte à lettres au Palais de justice de Monaco, les conclusions auraient donc dû être envoyées par courrier à l’adresse personnelle du requérant. Or, le Gouvernement ne le prétend pas, se contentant de relever que le greffe général a déposé lesdites conclusions dans le cartonnier « des avocats concernés » le 5 décembre 2012 (paragraphe 38 ci-dessus). La Cour note cependant que les avocats destinataires des conclusions étaient, selon les lettres produites par le Gouvernement, deux avocats-défenseurs (paragraphes 17 et 38 ci-dessus) : or, outre le fait qu’aucun d’entre eux n’était désigné dans la requête en révision, un seul est cité dans l’arrêt de la Cour de révision, en sa qualité de représentant des parties civiles (paragraphes 16 et 18 ci-dessus). Quant à l’autre avocat destinataire, selon le courrier, des conclusions du Procureur général, il n’apparaît à aucun stade des procédures en révision ou en appel, mais est simplement mentionné en tant qu’avocat-stagiaire intervenant au côté du requérant devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la même affaire jugée en première instance. Il ne peut donc pas être considéré comme un « avocat concerné » au sens où l’entend le Gouvernement en faisant référence à la procédure en révision. Le courrier daté du 5 décembre 2012 émanant du greffier en chef et transmis à Me C. Lecuyer, absent de l’instance en révision, à défaut du requérant pourtant seul à l’origine de la requête, relève manifestement d’une erreur humaine (paragraphe 17 ci‑dessus).
52. Par conséquent, la Cour constate que le requérant, n’ayant pas bénéficié de la pratique invoquée par le Gouvernement, n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes, ce qui a méconnu son droit à une procédure contradictoire.
53. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAS D'ACCES AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE ADVERSE
C.M. c. SUISSE du 17 janvier 2017 requête 7318/09
Violation de l'article 6-1 : la communication des conclusions à la partie adverse à quelques jours de l'audience, sans que le requérant ne puisse y répondre atteintt ses droits à un jugement équitable, dans leur substance même.
38. La Cour rappelle que les garanties relatives à un procès équitable impliquent en principe le droit, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (voir, par exemple, Martinie c. France [GC], no 58675/00, § 46, CEDH 2006‑VI, et Locher et autres c. Suisse, no 7539/06, § 27, 25 juillet 2013).
39. Dans plusieurs affaires concernant la Suisse, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que le requérant n’avait pas été invité à s’exprimer sur les observations d’une autorité judiciaire inférieure, d’une autorité administrative ou de la partie adverse (Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, §§ 31-32, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, F.R. c. Suisse, no 37292/97, §§ 40-41, 28 juin 2001, Ziegler c. Suisse, no 33499/96, § 39, 21 février 2002, Contardi c. Suisse, no 7020/02, §§ 45-46, 12 juillet 2005, Spang c. Suisse, no 45228/99, §§ 33‑34, 11 octobre 2005, Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 33, 13 juillet 2006, Kessler c. Suisse, no 10577/04, § 32, 26 juillet 2007, Ellès et autres c. Suisse, no 12573/06, §§ 28-29, 16 décembre 2010, et Locher et autres, précité, § 35).
40. La Cour rappelle encore que les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier (voir, par exemple, Kök c. Turquie, no 1855/02, § 52, 19 octobre 2006).
41. En l’espèce, la Cour note que le Gouvernement admet dans ses observations que la réponse écrite du 19 décembre 2007 a été envoyée au requérant le 4 mars 2008. Par ailleurs, elle relève que le Gouvernement ne se prononce ni sur l’allégation du requérant selon laquelle il a obtenu la réponse écrite de la partie adverse le 10 mars 2008 par « courrier B » (avec lequel, d’après la Poste suisse, les lettres parviennent à leur destinataire dans un délai maximal de trois jours ouvrables) ni sur la précision apportée par l’intéressé dans ses observations, selon laquelle ladite réponse écrite était accompagnée d’une ordonnance datée du 29 février 2008 énonçant que l’échange d’écritures était clos. La Cour observe en outre que le tribunal des assurances sociales a rendu sa décision le 12 mars 2008.
42. La Cour estime dès lors que le tribunal des assurances sociales, en mettant explicitement fin à l’échange d’écritures (voir, cependant, Joos, précité, § 29) et en rendant son jugement si peu de temps après avoir communiqué les observations de la partie adverse au requérant – lequel n’était pas représenté par un avocat à l’époque –, n’a pas respecté le principe de l’égalité des armes.
43. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
44. La Cour rappelle qu’elle a pour tâche de rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère « équitable » au sens de l’article 6 § 1 (voir, par exemple, Ankerl c. Suisse, 23 octobre 1996, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 197, CEDH 2012).
45. Après avoir constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 43 ci-dessus), la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief du requérant tiré de l’absence d’échange d’écritures devant le Tribunal fédéral.
MUNCACIU c. ROUMANIE du 26 janvier 2016 requête 12433/11
Violation de l'article 6-1 : Pas de communication du mémoire en défense au requérant durant le pourvoi. Pas de renvoi d'audience pour qu'il puisse présenter ses observations. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement, faute de débat contradictoire dans la procédure de recours.
40. La Cour note d’emblée que les parties ne contestent pas le fait que le mémoire en défense versé par l’A.F.P. Turda au stade du pourvoi en recours n’a pas été communiqué au requérant et que ce dernier n’a été ni présent en personne ni représenté lors de la seule audience tenue par le tribunal départemental de Cluj, le 1er septembre 2010. En conséquence, cette situation de fait amène la Cour à aborder deux questions distinctes, qui malgré leur connexité, soulèvent des aspects à examiner séparément.
41. La Cour se penchera d’abord sur la question liée à la non‑communication du mémoire en défense au requérant.
42. La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 23, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, et Lagardère c. France, no 18851/07, § 45, 12 avril 2012). Cette notion implique aussi en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et d’en discuter (Nideröst-Huber précité, § 24, Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 51, CEDH 2002‑VII, et Augusto c. France, no 71665/01, § 50, 11 janvier 2007). Dans ces conditions, les parties à un litige doivent donc avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : celle-ci se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce au dossier (Nideröst-Huber précité, §§ 27 et 29, et Werz c. Suisse, no 22015/05, § 53, 17 décembre 2009).
43. La Cour observe qu’à l’époque des faits il n’y avait pas de disposition expresse rendant obligatoire la communication du mémoire en défense de la partie adverse au demandeur. Elle note en revanche que la pratique des tribunaux nationaux allait vers l’imposition d’une telle obligation (paragraphes 26-27 ci-dessus). Cette pratique était fondée sur les dispositions de l’article 116 du CPC qui prévoyait l’obligation de déposer plusieurs exemplaires du mémoire en défense, ainsi que sur l’absence d’une obligation pour le demandeur de consulter ce mémoire auprès du greffe du tribunal. Il apparaît que cette pratique a été consacrée dans le nouveau CPC entré en vigueur le 15 février 2013 (paragraphe 29 ci-dessus). Toutefois, la Cour n’entend pas se prononcer sur la clarté et la qualité des dispositions légales nationales ou sur l’existence d’une application constante et cohérente des règles y énoncées.
44. Pour les besoins de la présente affaire, force est de constater que le tribunal départemental de Cluj a rejeté le recours formé par le requérant sur le fond. Dans ces conditions, il ne saurait être dit que la position de la partie adverse contenue dans son mémoire en défense n’a eu aucun impact sur l’issue du procès (Hudáková et autres c. Slovaquie, no 23083/05, § 29, 27 avril 2010). À cet égard, la Cour estime qu’il est sans incidence que, dans son arrêt du 1er septembre 2010, le tribunal départemental n’a fait aucune mention des arguments présentés dans le mémoire en défense, ce qui avait amené le Gouvernement à conclure que le tribunal n’avait pas accordé d’importance audit mémoire. Elle rappelle à ce titre que le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge et d’en discuter s’applique aussi bien au stade de l’appel qu’à celui de la première instance, même si de nouveaux arguments ne sont pas soulevés (Hudáková et autres, précité, § 29, et Trančíková c. Slovaquie, no 17127/12, § 45, 13 janvier 2015). En tout état de cause, la Cour souligne qu’elle ne doit pas décider si, en l’espèce, l’omission de communiquer le document litigieux a causé un quelconque tort au requérant puisque l’existence d’une violation est concevable même en l’absence d’un préjudice (Walston c. Norvège, no 37372/97, § 58, 3 juin 2003). Elle rappelle qu’il appartient aux parties à un litige d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part (Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 32, 13 juillet 2006, et Grozescu, précité, § 25).
45. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il incombait au tribunal départemental de Cluj d’offrir au requérant la possibilité de présenter ses commentaires sur les arguments contenus dans le mémoire en défense de la partie adverse. Elle relève que, en l’espèce, le tribunal n’a pas communiqué ledit mémoire en défense au requérant, qui, de plus, n’était ni présent ni représenté par un avocat lors de la seule audience publique tenue par lui. Or, il n’a pas été établi que des circonstances particulières justifiaient cette omission.
46. Dans la mesure où l’article 6 § 1 de la Convention vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d’une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, Acquaviva c. France, 21 novembre 1995, § 66, série A no 333‑A), ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement, faute de débat contradictoire dans la procédure de recours.
47. Eu égard à cette conclusion, la Cour considère qu’il n’est plus nécessaire d’examiner séparément le volet du grief concernant l’absence du requérant à l’audience publique du 1er septembre 2010 (Trančíková, précité, § 48).
48. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention
Werz contre Suisse du 17 décembre 2009 requêtes 22015/05
Violation de l'article 6-1 : le requérant n'a pas eu accès aux dupliques ou réquisitions du ministère public
B. Sur le grief fondé sur le droit d’être entendu équitablement
48. Le requérant allègue également n’avoir pas reçu les dupliques du ministère public et de la Cour suprême concernant son recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Dès lors, il aurait été lésé dans son droit d’être entendu équitablement. Il s’appuie sur l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
52. La Cour rappelle que les garanties d’un procès équitable impliquent en principe le droit, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Elle rappelle également avoir, dans plusieurs affaires contre la Suisse, conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que le requérant n’avait pas été invité à s’exprimer sur les observations d’une autorité judiciaire inférieure, d’une autorité administrative ou de la partie adverse (voir, dans l’ordre chronologique, Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 24, Recueil 1997-I, F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 36, 28 juin 2001, Ziegler c. Suisse, no 3499/96, § 33, 3 mai 1993, Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005, Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005, Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 30, 13 juillet 2006, et Kessler c. Suisse, no 10577/04, § 32, 26 juillet 2007).
53. Dans sa jurisprudence, la Cour a notamment affirmé que l’effet réel des observations d’une autorité importe peu, mais que les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : cette confiance se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier (voir, à titre d’exemple, l’arrêt Ziegler, précité, § 38).
54. La présente requête se distingue des affaires citées dans la mesure où elle ne porte pas sur la branche « civile » de l’article 6, mais sur une procédure pénale intentée contre le requérant. Or il ressort de la jurisprudence de la Cour que la faculté, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée et de pouvoir en discuter revêt une importance particulière lorsqu’est en cause le volet « pénal » de l’article 6, dans un Etat de droit soucieux d’un système judiciaire transparent.
55. A la lumière de cette jurisprudence bien établie, la Cour estime que le requérant n’a pas été entendu équitablement. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
C. Sur le grief fondé sur le droit d’interroger ou de faire interroger un témoin à charge
56. Le requérant reproche enfin aux autorités de ne pas avoir bénéficié du droit d’être confronté directement à la personne ayant fourni des informations à sa charge (Z.M.). A l’appui de son grief, il invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, libellé comme suit :
« Tout accusé a le droit notamment à (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...). »
57. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de sa déposition ou plus tard (voir, par exemple, Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, § 49, série A no 238, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 51, Recueil 1997-III). Elle rappelle en outre que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (Unterpertinger c. Autriche, 24 novembre 1986, §§ 31-33, série A no 110, Saïdi c. France, 20 septembre 1993, §§ 43 et suivants, et Van Mechelen et autres, précité, § 55).
58. En l’espèce, la Cour observe que ni le requérant ni son avocat n’ont eu l’opportunité d’interroger Z.M., témoin à charge dans la présente procédure. En revanche, les autorités internes compétentes ont donné à l’intéressé la possibilité d’interroger Z.M. par écrit, ce que l’avocat du requérant a explicitement refusé, ayant estimé cette manière de procéder insuffisante à la lumière de l’article 6.
59. Toutefois, la Cour note qu’il ressort, notamment de l’arrêt du tribunal d’arrondissement du canton de Berne, que la condamnation du requérant pour assassinat ne se fondait pas exclusivement ou dans une mesure déterminante sur les informations litigieuses fournies par Z.M. (voir, a contrario, Windisch c. Autriche, arrêt du 27 septembre 1990, § 31, série A no 186), mais sur tout un ensemble de preuves et d’indices susceptibles de renforcer la crédibilité des allégations de Z.M.
60. De surcroît, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral à juste titre, le requérant n’a fait aucunement valoir qu’il aurait été empêché de contester la véracité des renseignements provenant de Z.M. devant les juridictions internes.
61. Enfin, celles-ci ont suffisamment motivé leur décision de ne pas confronter Z.M. au requérant, dans la mesure où Z.M., qui craignait pour sa sécurité et sa vie, a pratiquement rendu impossible, malgré les efforts considérables déployés par les autorités d’enquête et judiciaires du canton de Berne, une confrontation directe avec l’accusé ou son avocat.
62. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
COUR DE CASSATION
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 14 janvier 2016 pourvoi n° 14-23100 cassation
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, des réquisitions ont été formulées pour le parquet général et que le procureur général a requis la confirmation du jugement ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater qu e le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale
DROIT D'ACCÉDER AU DOSSIER EN MATIÈRE DE SECRET MÉDICAL
ARRET BACCICHITTI c. FRANCE Requête no 22584/06 du 18 février 2010
NON ACCES AU PRES RAPPORT QUI A SERVI A CONDAMNER UN MEDECIN DEVANT SON ORDRE
30. Au pénal comme au civil, les garanties du procès équitable impliquent, selon le principe du contradictoire, le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter, le cas échéant (voir, parmi tant d’autres, Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Il en va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice, cette confiance se fondant, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier (voir notamment Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, §§ 27 et 29, Recueil 1997-I).
31. Certes, comme le souligne le Gouvernement, le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu, et son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures en cause. Dans les affaires Salé, Stepinska et Verdú Verdú citées par le Gouvernement, dont les circonstances sont très particulières, la Cour a en effet estimé que la non-communication d’une pièce de la procédure et l’impossibilité pour le requérant de la discuter n’avait pas porté atteinte à l’équité de la procédure, dans la mesure où elle a jugé que cette faculté n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige et où la solution juridique retenue ne prêtait guère à discussion.
32. Or, la Cour est d’avis que de telles circonstances ne sont pas entièrement réunies en l’espèce. Elle constate que le pré-rapport établi par le docteur D. était une pièce clairement défavorable au requérant puisqu’il mentionnait expressément, d’une part, que les interventions chirurgicales n’avaient pas été pratiquées conformément aux données acquises de la science et, d’autre part, que le requérant avait manqué à son obligation d’information envers sa patiente.
33. La Cour constate également que le conseil national de l’ordre des médecins a pris connaissance du contenu de ce pré-rapport avant de rendre sa décision. A l’appui de ce constat, elle relève que le Gouvernement confirme cette approche dans la mesure où, dans ses conclusions concernant le grief tiré de l’absence d’examen par le conseil de l’ordre de deux rapports d’expertise fournis par le requérant, il indique que le juge a pris connaissance de ces pièces avant de statuer, puisqu’il les a reprises en tant que telles dans les visas de sa décision (voir infra, § 44).
34. Dans ces conditions, eu égard notamment au contenu de la pièce litigieuse, la Cour n’est pas assurée que ce document n’ait pas eu d’incidence sur l’issue du litige. Elle estime que le respect du droit à un procès équitable, pris sous l’angle particulier du respect du principe du contradictoire, exigeait que le requérant – partie défenderesse à la procédure disciplinaire – eût la possibilité de soumettre ses commentaires en réponse au contenu du pré-rapport ou, pour le moins, qu’il en soit informé pour décider, le cas échéant, d’y répondre. Or, cette faculté ne lui a pas été donnée puisque le requérant n’a eu connaissance du contenu de ce pré-rapport que postérieurement à la sanction disciplinaire.
35. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
ETERNIT C. FRANCE du 19 avril 2012 Requête n°20041/10
En matière de contentieux des maladies professionnelles, le droit de l’employeur à une discussion contradictoire des pièces médicales du salarié doit se concilier avec le droit au secret médical.
31. La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison du fait qu’elle n’a pas eu accès aux pièces médicales lui faisant grief. Elle invoque l’article 6 § 1, dont les extraits pertinents se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
32. La Cour considère, tout d’abord, que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable, en son volet civil, à la contestation par l’employeur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, en raison des aspects de droit privé que comporte le système de sécurité sociale en matière de maladie professionnelle et accident du travail (mutatis mutandis, Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 décembre 1994, §§ 59-60, série A no 304). En effet, la relation entre un employeur et la caisse d’assurance maladie est comparable, à beaucoup d’égards, à la relation entre un assuré et son assureur (mutatis mutandis, Schouten et Meldrum, précité, § 59) : l’employeur paie des cotisations à la caisse d’assurance maladie, laquelle prend en charge la maladie professionnelle et impute en retour à l’employeur un taux de cotisation qui dépend en partie du volume de maladies et d’accidents professionnels pris en charge (voir « droit et pratique internes pertinents »).
A. Quant au grief relatif au principe du contradictoire
33. La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire, au sens de l’article 6 § 1, implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir, parmi beaucoup d’autres, Augusto c. France, no 71665/01, § 50, 11 janvier 2007 ; Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 51, CEDH 2002-VII). Il en va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice, cette confiance se fondant, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier (voir, notamment, Baccichetti c. France, no 22584/06, § 30, 18 février 2010). Elle rappelle également avoir déjà jugé qu’une « expertise médicale, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer de manière prépondérante leur appréciation des faits et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être efficacement commenté par les parties au litige » (Augusto, précité, § 50 ; Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
34. Cependant, le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu, et son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures en cause (Baccichetti, précité, § 31). Dans des circonstances particulières, en effet, la Cour a estimé que la non-communication d’une pièce et l’impossibilité pour le requérant de la discuter ne portaient pas atteinte à l’équité de la procédure, dans la mesure notamment où cette faculté n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige (Baccichetti, ibid. ; Stepinska c. France, no 1814/02, § 18, 15 juin 2004).
35. En l’espèce, la Cour relève que l’avis du médecin-conseil, en tant qu’il ressortit à un domaine technique qui échappe à la connaissance des juges, est susceptible d’avoir influencé leur appréciation des faits (mutatis mutandis, Mantovanelli, précité, § 36) et d’avoir emporté leur conviction s’agissant de l’origine professionnelle de la maladie. Cependant, la nature particulière du contentieux opposant la CPAM et l’employeur en cas de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie amène à formuler plusieurs réserves sur le principe d’une discussion contradictoire des pièces médicales par les parties.
36. En premier lieu, l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. La présente affaire se distingue, de ce point de vue, de l’affaire Augusto c. France (précitée), dans laquelle la Cour a sanctionné l’absence de communication à la requérante des observations médicales du médecin qualifié près la cour nationale de l’incapacité et de la tarification sur ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle. En effet, dans cette dernière affaire, il s’agissait de la transmission à la requérante d’observations médicales concernant son propre état de santé (dans le même sens, Mantovanelli, précité).
37. En l’espèce, le problème se pose sous un angle différent puisque l’employeur souhaiterait avoir connaissance et pouvoir discuter des pièces et observations médicales se rapportant à l’état de santé de son salarié. Dès lors, la Cour estime que, dans l’appréciation du grief portant sur le caractère contradictoire de la procédure, elle doit également prendre en considération le droit du salarié victime au respect du secret médical. A cet égard, la Cour souligne que la protection des données à caractère personnel, et spécialement des données médicales, revêt une importance fondamentale pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention (M.S. c. Suède, 27 août 1997, § 41, Recueil 1997-IV). Certes, le droit au respect du secret médical n’est pas absolu, mais il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire. En d’autres termes, ces deux droits doivent coexister de manière à ce qu’aucun ne soit atteint dans sa substance même. Cet équilibre est réalisé, de l’avis de la Cour, dès lors que l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie peut solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties.
38. En second lieu, la Cour constate que la procédure aux termes de laquelle la CPAM se prononce sur le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident déclaré par le salarié est, dans son ensemble, soumise aux principes du contradictoire et de l’obligation d’information de l’employeur dont le respect est prévu en droit interne et assuré par les juridictions de la sécurité sociale (voir « droit et pratique internes pertinents »).
39. La Cour estime donc que la possibilité pour l’employeur d’avoir accès, par l’intermédiaire d’un expert médecin, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit. A cet égard, la Cour souligne que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable. La Cour rappelle, en effet, que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil 1997-III). La mission confiée à la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si une expertise médicale était nécessaire en l’espèce, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, a revêtu un caractère équitable (mutatis mutandis, Van Mechelen et autres, précité, § 50). A cet égard, la Cour doit examiner le grief de la requérante ayant trait au respect du principe de l’égalité des armes dans le procès l’opposant à la CPAM (mutatis mutandis, Helle c. Finlande, 19 décembre 1997, § 53, Recueil 1997-VIII).
B. Quant au grief relatif au principe de l’égalité des armes
40. Le principe de l’égalité des armes requiert que la procédure ait fourni à la requérante une occasion de présenter sa cause dans des conditions ne la plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Helle, ibid.).
41. La Cour relève que la CPAM ne disposait, pour prendre sa décision, que de l’avis médico-administratif du médecin-conseil, lequel ne relève pas, par ailleurs, de l’autorité hiérarchique de la CPAM mais de celle de la CNAMTS (voir « droit et pratique internes pertinents »). A l’instar de la requérante, la CPAM n’était donc pas en possession de l’examen tomodensitométrique du salarié. Ce constat ressort tant de l’indépendance statutaire du médecin-conseil vis-à-vis des services administratifs de la CPAM que du secret médical auquel il est tenu. Dès lors que les services administratifs de la CPAM n’étaient pas non plus en possession des pièces médicales sollicitées par la requérante, la Cour estime que la CPAM n’a pas été placée en situation de net avantage, vis-à-vis de la requérante, dans la procédure.
C. Conclusion
42. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
43. Quant au grief tiré de la violation de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour constate que celui-ci était intimement lié par la requérante au constat, le cas échéant, de la méconnaissance des principes garantis par l’article 6 § 1. Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut qu’en constater le caractère également manifestement mal fondé et le déclarer irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.
DROIT D'AVOIR UNE RÉPONSE A SES MOYENS
Cliquez sur un lien bleu pour accéder gratuitement à LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH SUR :
- Les obligations de motiver des juridictions du fond quant à la réponse des moyens
- Les limites des obligations des juges du fond
- Les obligations des juridictions suprêmes et cour de cassation sont plus légères
OBLIGATIONS DE MOTIVER DES JUGES DU FOND
Uche c. Suisse du 17 avril 2018 requête n o 12211/09
non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) de la Convention européenne des droits de l’homme, et violation de l’article 6 § 1 (droit à un jugement motivé). L’affaire concerne un requérant condamné pour trafic de drogue qui se plaint de violations de son droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation ainsi que de son droit à un jugement motivé. La Cour observe en particulier que, dans son arrêt du 20 juin 2008, le Tribunal fédéral n’a pas répondu au grief du requérant tiré de la violation du principe accusatoire. A défaut de réponse explicite à ce grief qui avait pourtant été suffisamment étayé dans le mémoire de recours déposé devant le Tribunal fédéral, il est impossible de savoir si le Tribunal fédéral a simplement négligé le moyen tiré du principe accusatoire ou bien s’il a voulu le rejeter et, en cette dernière hypothèse, pour quelles raisons. Le jugement qui a condamné le requérant n’a donc pas été correctement motivé.
Principaux faits Le requérant, Magma Uche, est un ressortissant suisse et nigérian, né en 1967 et résidant à Gampelen. Condamné pour trafic de drogue, il se plaint principalement de violations du principe accusatoire et du droit à un jugement motivé. En 2002, soupçonné de trafic de drogue, M. Uche fut placé sous écoutes téléphoniques par la police cantonale. Le 19 novembre 2004, le tribunal de district de Berne-Laupen le reconnut coupable de blanchiment d’argent, d’importation, d’achat et de vente de 4,4 kilos de cocaïne et de 153 grammes d’héroïne et le condamna à 69 mois de peine de réclusion. M. Uche interjeta recours contre cette décision, arguant que le tribunal avait violé le principe accusatoire en ne déterminant pas la quantité de drogue dans l’acte d’accusation. La Cour suprême du canton de Berne rejeta le recours et confirma la décision du tribunal de district. Le 28 janvier 2008, M. Uche interjeta un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il invoquait une violation du principe accusatoire, faisant valoir que l’acte d’accusation était incomplet, le procureur ayant mentionné une quantité de 1 748,80 grammes de cocaïne et d’héroïne alors que la condamnation reposait finalement sur 4, 4 kilos. Il affirmait ne pas avoir pu préparer sa défense. Par un arrêt rendu le 20 juin 2008, le Tribunal fédéral débouta le requérant.
Article 6 §§ 1 et 3 a) (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation)
La Cour relève que M. Uche savait, sur la base de l’acte d’accusation, que la quantité de drogue en cause était considérable (supérieure à 1 748,80 grammes) et constate qu’il n’est pas déterminant de savoir s’il pouvait évaluer précisément cette quantité. En effet, M. Uche disposait d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. A cet égard, il a eu l’occasion de présenter son grief tiré d’une violation du principe accusatoire devant la Cour suprême du canton de Berne et celle-ci a pu se livrer à un examen complet de la cause. La Cour juge dès lors que les vices ayant pu entacher la procédure devant le tribunal de district ont été purgés devant la Cour suprême. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a).
Article 6 § 1 (droit à un jugement motivé)
La Cour constate que, dans son arrêt du 20 juin 2008, le Tribunal fédéral n’a pas répondu au grief tiré de la violation du principe accusatoire présenté par M. Uche assisté de son avocat. Ledit grief avait pourtant été suffisamment étayé dans le mémoire de recours déposé devant le Tribunal fédéral. Si le Tribunal fédéral avait jugé fondé le grief de M. Uche, il aurait dû admettre le recours. S’il l’avait en revanche jugé mal fondé, il aurait dû le rejeter en énonçant des motifs d’irrecevabilité. A défaut de réponse explicite, il est impossible de savoir si le Tribunal fédéral a simplement négligé le moyen tiré du principe accusatoire ou bien s’il a voulu le rejeter et, en cette dernière hypothèse, pour quelles raisons. La Cour conclut qu’il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
Article 6 §§ 1 et 3 d) (droit d’interroger des témoins)
La Cour relève que les tribunaux suisses ont soigneusement analysé les faits et que leurs décisions ont été motivées en détail. M. Uche s’est vu offrir la possibilité de contester la traduction des écoutes téléphoniques, de la confronter avec les enregistrements et de présenter devant la juridiction cantonale les passages qu’il aurait souhaité ajouter. La Cour estime que M. Uche, qui n’a pas fait usage de cette possibilité, s’est vu offrir les moyens suffisants de se défendre. Ce grief, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
CEDH au sens de l'article 6 §§ 1 et 3 a)
2. Appréciation de la Cour
29. La Cour rappelle que la portée du paragraphe 3 a) de l’article 6 de la Convention doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 52, 25 mars 1999, et Pérez Martinez c. Espagne, no 26023/10, § 23, 23 février 2016). Si l’étendue de l’information « détaillée » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause, l’accusé doit en tout cas disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense (Mattoccia c. Italie, no 23969/94, § 60, 25 juillet 2000, Gomez Cespon c. Suisse (déc.), no 45343/08, 5 octobre septembre 2010, et Mandelli c. Italie (déc.), no 44121/09, § 45, 20 octobre 2015). La Cour rappelle également que, si le droit à une procédure contradictoire a été méconnu à un stade déterminé de la procédure, il n’est pas exclu qu’une juridiction supérieure soit à même de redresser toute défaillance (Dallos c. Hongrie, no 29082/95, §§ 47-53, CEDH 2001-II, Amirov c. Azerbaijan (déc.), no 25512/06, 18 janvier 2011, et Čepek c. République tchèque, no 9815/10, § 50, 5 septembre 2013).
30. En l’espèce, la Cour relève que le requérant savait, sur la base de l’acte d’accusation, que la quantité de drogue était supérieure à 1 748,80 grammes et que la drogue vendue correspondait à au moins 180 700 CHF. Il devait par conséquent se douter que la quantité de drogue était considérable. Il n’est toutefois pas déterminant de savoir si le requérant, qui était assisté par une avocate et qui n’a pas allégué avoir soulevé cette question devant le tribunal de district VIII Berne-Laupen, pouvait évaluer la quantité de drogue. En effet, la cause de l’accusation n’a pas évolué et le requérant, au plus tard suite à l’arrêt du tribunal de district du 19 novembre 2004, qui a déterminé la quantité de drogue finalement retenue, disposait d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. À cet égard, le requérant, outre le fait qu’il était en mesure de saisir la nature de l’accusation portée contre lui dès l’acte d’accusation, a eu l’occasion de présenter son grief tiré d’une violation du principe accusatoire devant la Cour suprême du canton de Berne et celle-ci a pu se livrer à un examen complet de la cause du requérant. La Cour juge dès lors que les vices ayant pu entacher la procédure devant le tribunal de district ont été purgés devant la Cour suprême (Dallos, précité, §§ 47-53, et Mulosmani c. Albanie, no 29864/03, § 132, 8 octobre 2013).
31. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention.
CEDH au sens de l'article 6 § 1
37. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999‑I, et Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 84, CEDH 2017). Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose que la partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (voir, parmi d’autres exemples, Moreira Ferreira, précité, § 84, et Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, §§ 29-30, série A no 303‑A). Il doit ressortir d’une décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées (Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 91, 16 novembre 2010, et Lebedinschi c. République de Moldova, no 41971/11, § 31, 16 juin 2015).
38. La Cour rappelle également que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États à créer des cours d’appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées (Pedro Ramos c. Suisse, no 10111/06, § 34, 14 octobre 2010, et Lebedinschi, précité, § 32).
39. La Cour réitère qu’il ne lui appartient pas d’examiner le bien-fondé d’un certain moyen soulevé devant une juridiction interne, une telle tâche incombant aux juridictions nationales. Un pareil examen ne s’impose pas pour constater que le moyen en cause était du moins pertinent (Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 28, série A no 303-B, Ruiz Torija, précité, § 30, et Vojtěchová c. Slovaquie, no 59102/08, § 40, 25 septembre 2012).
40. En l’espèce, la Cour constate que, dans son arrêt du 20 juin 2008, le Tribunal fédéral n’a pas répondu au grief du requérant tiré de la violation du principe accusatoire. Or, ledit grief a été étayé de manière suffisamment claire et précise dans le mémoire de recours déposé par le requérant, représenté par un avocat, devant le Tribunal fédéral. Il y était d’ailleurs fait référence à l’article 6 § 3 de la Convention. Relevant d’une catégorie juridique complètement distincte du grief tiré des écoutes téléphoniques, la Cour considère qu’il a été suffisamment élaboré comme premier grief dans le recours. Il s’agit de plus d’un aspect essentiel de l’issue du procès et il est de nature à tomber par ailleurs sous le coup de l’article 6 § 3 lettre a) de la Convention qui a été examiné sur le fond par l’instance cantonale. Si le Tribunal fédéral l’avait jugé fondé, il aurait dû admettre le recours. Si par contre le Tribunal fédéral l’avait jugé mal fondé, il aurait dû le rejeter en énonçant des motifs d’irrecevabilité (voir, mutatis mutandis, Fomin c. Moldova, no 36755/06, § 31, 11 octobre 2011).
41. Faute de réponse explicite, il est impossible de savoir si le Tribunal fédéral a simplement négligé le moyen tiré du principe accusatoire ou bien s’il a voulu le rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons (Ruiz Torija, précité, § 30, Hiro Balani, précité, § 28, et Nichifor c. République de Moldova, no 52205/10, § 30, 20 septembre 2016).
42. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
CEDH au sens de l'rticle 6 §§ 1 et 3 d)
43. Le requérant se plaint des modalités et de la qualité de la traduction des écoutes téléphoniques, ainsi que du fait que l’identité du traducteur ne lui a pas été divulguée. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
44. La Cour relève que les tribunaux suisses ont soigneusement analysé les faits et que leurs décisions ont été motivées en détail. Elle souligne en particulier qu’il ressort du dossier que le requérant s’est vu offert la possibilité de contester la traduction des écoutes téléphoniques, de la confronter avec les enregistrements et de présenter devant la juridiction cantonale les passages qu’il aurait souhaité ajouter. Elle estime dès lors que le requérant, qui n’a pas fait usage de cette possibilité, s’est vu offert les moyens suffisants de se défendre.
45. Il s’ensuit que ce grief, manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
ERFAR-AVEF c. GRÈCE du 27 mars 2014 requête 31150/09
NON REPONSE AUX MOYENS DU REQUERANT PAR LA COUR D'APPEL, CAR SOULEVES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE
ALORS QUE L'EXECUTION FORCEE EST ORDONNEE POUR UNE DETTE PRESCRITE, LA CEDH NE CONSTATE PAS DE VIOLATION
39. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Platakou c. Grèce, no 38460/97, § 37, 11 janvier 2001 ; Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, § 25, 6 décembre 2001 ; Stamouli et autres c. Grèce, no 1735/07, § 19, 28 mai 2009). Par ailleurs, la Cour réaffirme que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (ibid. § 38).
40. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I).
41. La Cour rappelle à cet égard que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
42. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste des règles applicables faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX et Nikolaos Kopsidis c. Grèce (no 2920/08, § 22, 18 mars 2010).
43. Ces principes rappelés, la Cour doit maintenant se tourner vers les faits de l’espèce.
44. En premier lieu, la Cour ne peut pas souscrire à l’argument de la requérante selon lequel l’arrêt de la cour d’appel n’était pas suffisamment motivé. L’arrêt mentionnait les conditions d’application des dispositions invoquées par la requérante et expliquait plus loin les raisons pour lesquelles ces conditions n’étaient pas réunies dans son cas. Plus précisément, après avoir examiné les éléments du dossier, la cour d’appel a conclu que la créance de la banque à l’encontre de la requérante, qui était échue à la date de la notification du commandement de payer, le 5 février 1999, ne dépassait pas le triple de la somme créditée et dont le remboursement devait être effectué sous forme de mensualités (comme cela avait été convenu en 1986) ; cette créance ne dépassait pas non plus le triple du montant des dettes réglées en 1990. De plus, l’arrêt constatait que certaines autres dettes de la requérante, qui avaient fait l’objet d’une transaction en 1993, avaient été acquittées avant le 28 avril 1998.
45. Quant au grief relatif au formalisme excessif dont aurait fait preuve la Cour de cassation, la Cour rappelle que dans l’affaire Dilintas, les requérants avaient réclamé certaines allocations supplémentaires pour la première fois devant la cour d’appel, ce qui était en nette contradiction avec l’article 12 du code de procédure civile, qui prévoit qu’une prétention ne peut pas être soumise pour la première fois lorsque l’affaire est au stade de l’appel. La Cour avait en outre constaté que les requérants avaient la possibilité d’introduire, avant de saisir la cour d’appel, une action devant le tribunal de première instance afin de revendiquer ces allocations.
46. La Cour note que dans la présente affaire, dans ses oppositions des 24 juin et 18 octobre 1999, la requérante demandait l’annulation d’une traite au profit de l’ETVA d’un montant de 171 118 858 drachmes (502 183 euros) et de la saisie d’un bien lui appartenant, ainsi que l’annulation de la vente aux enchères projetée de ce bien (paragraphe 11 ci-dessus). La requérante soulignait à cet égard que toutes ses dettes envers la banque étaient éteintes à la suite des remboursements effectués par elle aux dates qu’elle indiquait.
47. Le 4 août 2004, alors que l’appel de la requérante était pendant depuis le 29 mai 2001, l’article 39 de la loi no 3259/2004 est entré en vigueur. Cet article précisait que les dettes étaient considérées comme éteintes si elles dépassaient le triple du capital emprunté. La requérante s’est prévalue de cet article le 9 mars 2006 lors de l’audience devant la cour d’appel. Il lui était impossible de le faire avant l’examen de l’affaire par la cour d’appel, la loi susmentionnée n’étant entrée en vigueur que bien après l’introduction de l’appel. La cour d’appel a rejeté l’appel parce que les conditions d’application de cet article ne se trouvaient pas réunies. De son côté, la Cour de cassation a aussi rejeté le pourvoi de la requérante au motif que l’allégation concernant l’annulation de la procédure de vente forcée était irrecevable car elle a été présentée pour la première fois lors de la deuxième audience devant la cour d’appel.
48. La Cour relève que d’après l’article 527 du code de procédure civile, les allégations factuelles qui n’ont pas été soulevées en première instance et qui sont soulevées pour la première fois en appel sont irrecevables sauf si elles ont pris naissance après la dernière audience devant la juridiction de première instance (paragraphe 25 ci-dessus). Quant à l’article 585 § 2 du même code, il fait obstacle à l’ajout de moyens nouveaux après l’acte d’opposition initiale sauf dans certains cas limitativement énumérés dans ce même article et tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (paragraphes 25-27 ci-dessus). La Cour considère que ces articles qui comportent une réglementation relative aux formalités pour former un recours ont pour objet de garantir la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Ces articles se concilient, en outre, avec les principes de l’égalité des armes et du contradictoire et visent à assurer que toute opposition soit notifiée à la partie adverse pour lui donner la possibilité d’y réagir à temps et ne pas être prise au dépourvu. Les dispositions litigieuses en l’espèce poursuivaient donc un but légitime.
49. Quant au respect du principe de la proportionnalité, la Cour note que même si la cour d’appel n’a pas formellement appliqué la nouvelle loi no 3259/2004, elle a néanmoins constaté que les conditions posées par celle-ci (somme due dépassant le triple de la somme empruntée) n’étaient pas remplies. La Cour note, de surcroît, que la requérante avait la possibilité d’intenter une autre action pour faire reconnaître que toutes les prétentions de la banque étaient satisfaites, ce qu’elle a du reste fait le 29 avril 2009 (paragraphes 23-24 ci-dessus).
50. Compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux États quant aux conditions de recevabilité d’un recours, et eu égard aux circonstances de l’affaire, la requérante n’a pas subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. La Cour conclut qu’il n’y a pas eu atteinte à la substance du droit d’accès à un tribunal et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Vyerentsov c. Ukraine du 11 avril 2013, requête no 20372/11
Un tribunal ne peut condamner sans examiner auparavant la pertinence des arguments du prévenu.
Premièrement, la Cour note que quelques heures seulement se sont écoulées entre la rédaction par la police du procès-verbal constatant l’infraction administrative et l’examen de l’affaire par le tribunal de première instance. Dès lors, M. Vyerentsov n’a pas pu étudier l’accusation portée contre lui ni préparer sa défense en conséquence.
Deuxièmement, alors que M. Vyerentsov avait demandé à être représenté par un avocat comme le prévoit le code des infractions administratives, le tribunal de première instance a rejeté sa demande en raison de son passé de militant de la cause des droits de l’homme, ce que la Cour juge illégal et arbitraire. Troisièmement, le tribunal de première instance a principalement fondé ses conclusions sur les rapports établis par la police sans interroger aucun témoin, alors que M. Vyerentsov avait demandé leur audition.
De surcroît, la cour d’appel n’a pu remédier à ces manquements étant donné que, au moment où elle a examiné l’affaire, M. Vyerentsov avait déjà purgé sa peine de détention administrative.
Enfin, en dépit de leur pertinence, les arguments de M. Vyerentsov ont été complètement ignorés par les tribunaux ukrainiens, lesquels ont adopté un raisonnement totalement inadéquat dans leurs décisions. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d).
Kraska contre Suisse du 19 avril 1993 Hudoc 412 requête 13942/88
"L'article 6§1 implique notamment, à la charge du "tribunal" l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre () Il échet de déterminer si cette condition se trouva rempli en l'espèce"
Van de Hurk contre Pays-Bas du 19 avril 1994 Hudoc 461 requête 16034/90
"L'article 6§1 implique notamment, à la charge du "tribunal" l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à prendre (voir l'arrêt Kraska contre Suisse)"
Le requérant reprochait le choix de paramètre qui lui était défavorable pour fixer le prix d'un mètre carré de terrain. Il en proposait un autre:
"Il n'appartient pas à la Cour de critiquer semblable choix, en règle générale, l'appréciation des faits relève des juridictions nationales"
Hentrich contre France du 22 septembre 1994 Hudoc 485 requête 13616/88
"Une des exigences d'un "procès équitable" est "l'égalité des armes" laquelle implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire () Or en l'espèce, la procédure sur le fond n'a pas offert à la requérante une telle possibilité : d'un coté, les juges du fond ont permis à l'administration de se borner à motiver sa décision d'exercice du droit de préemption en qualifiant "d'insuffisant" le prix de cession déclaré dans l'acte; motivation trop sommaire et générale pour permettre à Madame Hentrich de présenter une contestation raisonnée de cette appréciation; de l'autre, les juges du fond n'ont pas voulu permettre à la requérante d'établir que le prix convenu entre les parties correspondait la valeur vénale réelle du bien"
Arrêt de règlement amiable
Fouquet contre France du 31 janvier 1996 Hudoc 559 requête 20398/92
"La commission est d'avis qu'un plaideur n'est pas effectivement entendue lorsqu'un moyen de défense essentiel est méconnu. Elle considère qu'en se basant sur une constatation manifestement inexacte relative à la position prise par le requérant, la Cour de Cassation ne lui a pas assuré son droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention () La commission rappelle que la Convention ne vise pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs. IL en résulte que le droit de présenter ses observations garanti aux parties par l'article 6§1 de la Convention ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment "entendues", c'est à dire dûment examinées par le Tribunal saisi ()
La commission relève que l'article 6§1 de la Convention implique notamment, à la charge du "tribunal" l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre () Il échet donc de déterminer si cette condition se trouva remplie dans la présente affaire"
Arrêt Quadrelli contre Italie du 11/01/2000 Hudoc 1416 requête 28168/95
"Compte tenu de se qu'était l'enjeu pour l'intéressé dans la procédure et de la nature des conclusions du parquet général, le défaut d'examen du mémoire du requérant a méconnu le droit de celui-ci à une procédure contradictoire; celui-ci implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce et observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer la décision"
Perez contre France du 12/02/2004 Hudoc 4919 requête 47287/99
La Cour considère que la Cour de cassation a répondu aux moyens du requérant constitué partie civile dans un procès pénal et qu'en conséquence, il n'y a pas violation de l'article 6§1 de la Convention.
FODOR c. ROUMANIE du 16 septembre 2014 requête n° 45266/07
Violation de l'article 6 : les critiques du requérant contre le rapport d'expertise, ne sont pas examinées par le tribunal.
27. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas généralement de connaître des erreurs de fait et de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf appréciation indéniablement inexacte, ayant porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I ; Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 29, série A no 140 ; Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296‑C, et Dulaurans c. France, no 34553/97, § 38, 21 mars 2000).
28. En outre, le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique notamment, à la charge du « tribunal », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 59, série A no 288).
29. En l’espèce, la Cour note que dans son arrêt définitif du 30 mai 2007, le tribunal départemental de Cluj a affirmé que le requérant n’avait pas contesté les conclusions du rapport d’expertise médicolégale.
30. Or, la Cour observe que le requérant a contesté formellement et de manière explicite ce rapport et il a demandé que les observations cliniques sur lesquelles s’est fondée ce rapport soit écartées dès lors qu’elles étaient, selon lui, tardives (paragraphes 12, 14 et 16 ci-dessus).
31. La Cour constate que selon les propres mots du tribunal départemental, ce rapport médicolégal était essentiel pour accréditer la version des faits présentée par le plaignant. En effet, il s’agissait de la seule pièce du dossier qui établissait une connexion entre la prétendue agression du 4 octobre 2005 et les blessures constatées en mai 2006. En outre, la Cour relève que l’expertise médicolégale a été déterminante non seulement pour l’établissement des faits, mais également pour leur qualification juridique et la fixation de la peine (paragraphes 19 et 20 ci-dessus).
32. Quant à l’examen médical pratiqué le 6 octobre 2005, la Cour constate qu’il ne s’agissait que d’un diagnostic présumé et que le médecin traitant ne se prononçait pas sur la cause des éventuelles blessures. Bien qu’il ait estimé qu’un examen médicolégal était nécessaire pour confirmer le diagnostic, la victime a omis de suivre cette recommandation et ne s’est présenté à l’Institut de médecine légale qu’à la demande du tribunal, en juin 2006 (paragraphes 7, 8 et 11 ci-dessus).
33. Dans ces conditions, la Cour constate que l’arrêt du 30 mai 2007 était entaché d’une appréciation inexacte du caractère incontesté d’une pièce essentielle pour l’issue du litige (mutatis mutandis, Udorovic c. Italie, no 38532/02, § 58, 18 mai 2010).
34. Tout en se gardant de spéculer sur les conséquences qu’aurait eues la prise en compte, par le tribunal départemental, des critiques du requérant à l’égard du rapport d’expertise médicolégale, la Cour ne saurait accepter la thèse du Gouvernement selon laquelle les arguments présentés par le requérant et négligés par le tribunal étaient sans incidence sur l’issue du litige.
35. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le tribunal départemental n’a pas assuré au requérant un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
36. Partant il y a eu violation de cette disposition.
Arrêt Abdelali Contre France du 11 octobre 2012 requête n° 43353/07
L’impossibilité pour un accusé de contester les preuves retenues contre lui était contraire à la notion de procès équitable.
Une application stricte au sens de la poursuite des articles 175 et 385 du Code de Procédure Pénale est contraire à la Convention.
35. La Cour a fréquemment rappelé que les garanties de l’article 6 pouvaient s’appliquer à l’ensemble de la procédure, y compris aux phases de l’information préliminaire et de l’instruction judiciaire (voir, notamment, les arrêts Pandy c. Belgique, no 13583/02, § 50, 21 septembre 2006 et Vera Fernández-Huidobro c. Espagne, no 74181/01, § 109, 6 janvier 2010).
36. L’article 6 – spécialement son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès et où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès (Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36, série A no 275 et Vera Fernández-Huidobro, précité, § 111). Ainsi qu’il est établi dans la jurisprudence de la Cour, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (Brennan c. Royaume-Uni, no 39846/98, § 45, CEDH 2001‑X, et Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 50, 27 novembre 2008).
37. La Cour n’a pas à se prononcer, par principe, sur l’admissibilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne, ou encore sur la culpabilité du requérant. Elle doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’« illégalité » en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation (voir, notamment, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 76, CEDH 2001-IX, Heglas c. République tchèque, n o5935/02, §§ 89-92, 1er mars 2007).
38. Pour déterminer si la procédure dans son ensemble a été équitable, il faut se demander si les droits de la défense ont été respectés. Il faut rechercher notamment si le requérant s’est vu offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité de l’élément de preuve et de s’opposer à son utilisation. Il faut prendre également en compte la qualité de l’élément de preuve, y compris le point de savoir si les circonstances dans lesquelles il a été recueilli font douter de sa fiabilité ou de son exactitude (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, §§ 89-90, 10 mars 2009).
39. La Cour relève en l’espèce que l’information fut ouverte en juin 2004 à la suite d’un renseignement anonyme.
Des surveillances téléphoniques furent mises en place, qui permirent l’identification des membres d’un réseau de trafic de stupéfiants, dont le requérant, et l’interpellation de plusieurs d’entre eux. Des perquisitions furent également effectuées.
C’est à la suite de ces différents actes d’enquête que le juge d’instruction ordonna le renvoi de six personnes, y compris le requérant, devant le tribunal.
40. La Cour note encore que, pour condamner le requérant, la cour d’appel de Versailles a fondé sa décision sur l’identification des participants au trafic faite grâce aux écoutes téléphoniques et le dispositif de surveillance mis ensuite en place et ayant permis de voir le requérant entrer et sortir d’un immeuble où la drogue était stockée. Elle prit également en compte les déclarations de deux personnes interpellées, celles d’une quarantaine de consommateurs dont « certains » mettaient le requérant en cause et celles de l’épouse du requérant. Celle-ci avait notamment indiqué qu’elle ignorait où le requérant résidait et qu’il ne « connaissait que le métier de trafiquant de drogue », activité qu’il avait reprise dès sa sortir de prison.
La cour d’appel mentionna enfin les déclarations faites par le requérant lui-même qui indiqua notamment qu’il « n’était nullement le cerveau de l’organisation » mais agissait sur un pied d’égalité avec deux amis, qu’ils s’approvisionnaient et vendaient chacun de leur côté, qu’il n’était « ni le chef ni le seul fournisseur du groupe » et que toutes les relations « avec les autres personnes impliquées dans le trafic, les fournisseurs ou la clientèle étaient fondées sur l’amitié et la confiance ».
41. Il ressort de ces éléments que la quasi-totalité des éléments de preuve fut recueillie pendant l’instruction du dossier, avant le renvoi de l’affaire devant le tribunal par le juge d’instruction. De surcroît, tous les actes d’enquête découlèrent des écoutes téléphoniques auxquelles il fut procédé au cours de l’été 2004.
42. Or, c’est précisément la légalité de ces écoutes que le requérant contesta tout au long de la procédure qui se déroula après son opposition au jugement qui l’avait condamné par défaut.
43. Le tribunal de grande instance de Nanterre statuant sur l’opposition du requérant, fut saisi de l’exception de nullité soulevée par celui-ci, concernant les réquisitions envoyées aux opérateurs de téléphonie.
Il annula certaines de ces réquisitions qui avaient été faites sans l’autorisation préalable du procureur de la République. En conséquence, il annula tous les actes d’enquête qui avaient pour support les réquisitions annulées et ordonna la remise en liberté du requérant.
44. Toutefois, la cour d’appel, puis la Cour de cassation considérèrent que le requérant ne pouvait se prévaloir de la nullité de certains actes d’information car il était en fuite et ne pouvait être considéré comme une partie au sens de l’article 175 du code de procédure pénale.
45. En conséquence, les juridictions internes ne prirent pas en compte le fait que l’ordonnance de clôture n’avait pas été communiquée au requérant.
46. La question se pose dès lors de savoir si, du fait de son incapacité à contester la validité des preuves, le requérant a bénéficié d’un procès équitable et des droits de la défense.
En effet, la Cour observe qu’en l’espèce l’instruction a constitué une phase cruciale de la procédure litigeuse, en particulier dans la mesure où tous les actes tendant à rassembler les éléments de preuve ont été accomplis par les autorités à ce stade (Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00, § 87, 2 mars 2010 et mutatis mutandis Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 73, CEDH 2010). Le fait même que le requérant ait fait des aveux partiels devant la cour d’appel découle de la procédure d’instruction.
47. La Cour prend note du souci exposé par le Gouvernement d’éviter les manœuvres dilatoires en réglementant la possibilité d’invoquer les nullités des actes d’instruction.
48. Elle relève toutefois qu’une exception est prévue dans le droit interne à l’article 385 alinéa 3 du code de procédure pénale qui dispose que, lorsque les formalités de notification de la fin de l’instruction n’ont pas été respectées à l’égard d’une partie, celle-ci peut soulever les nullités de la procédure devant le tribunal correctionnel. En l’espèce, le requérant n’a pas bénéficié de cette disposition car il était considéré comme ayant été en fuite lors de la clôture de l’instruction.
49. La Cour note que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 4 janvier 2012, a rejeté la demande de renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce point précis. Elle a en effet considéré que le bénéfice de cette disposition constituerait un avantage injustifié par rapport à un prévenu qui a comparu normalement aux actes de la procédure (voir § 18 ci-dessus).
50. La Cour rappelle sa jurisprudence constante sur la notion de « fuite » d’un inculpé, telle que réaffirmée dans l’affaire Sejdovic c. Italie([GC], no 56581/00, CEDH 2006‑II) :
« 87. La Cour a estimé que, lorsqu’il ne s’agissait pas d’un inculpé atteint par une notification à personne, la renonciation à comparaître et à se défendre ne pouvait pas être inférée de la simple qualité de « latitante », fondée sur une présomption dépourvue de base factuelle suffisante (Colozza précité, § 28). Elle a également eu l’occasion de souligner qu’avant qu’un accusé puisse être considéré comme ayant implicitement renoncé, par son comportement, à un droit important sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il doit être établi qu’il aurait pu raisonnablement prévoir les conséquences du comportement en question (Jones, décision précitée). » (...)
« 99. Dans de précédentes affaires de condamnation par contumace, la Cour a estimé qu’aviser quelqu’un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d’une telle importance qu’il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l’exercice effectif des droits de l’accusé, et qu’une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire (T. c. Italie précité, § 28, et Somogyi précité, § 75). La Cour ne saurait pour autant exclure que certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l’accusé sait qu’une procédure pénale est dirigée contre lui et connaît la nature et la cause de l’accusation et qu’il n’a pas l’intention de prendre part au procès ou entend se soustraire aux poursuites. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un accusé déclare publiquement ou par écrit ne pas souhaiter donner suite aux interpellations dont il a eu connaissance par des sources autres que les autorités ou bien lorsqu’il parvient à échapper à une tentative d’arrestation (voir, notamment, Iavarazzo c. Italie (déc.), no 50489/99, 4 décembre 2001), ou encore lorsque sont portées à l’attention des autorités des pièces prouvant sans équivoque qu’il a connaissance de la procédure pendante contre lui et des accusations qui pèsent sur lui.
100. Aux yeux de la Cour, de telles circonstances ne se trouvent pas établies en l’espèce. La thèse du Gouvernement ne s’appuie sur aucun élément objectif autre que l’absence de l’accusé de son lieu de résidence habituel, lue à la lumière des preuves à charge ; elle présuppose que le requérant était impliqué dans le meurtre de M. S. ou bien responsable de ce crime. La Cour ne saurait donc souscrire à cet argument, qui va également à l’encontre de la présomption d’innocence. L’établissement légal de la culpabilité du requérant était le but d’un procès pénal qui, à l’époque de la déclaration de fuite, était au stade des investigations préliminaires.
101. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que le requérant avait une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre. Elle ne peut donc conclure qu’il a essayé de se dérober à la justice ou qu’il a renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître à l’audience. (...) »
51. La même approche a été retenue dans l’arrêt Hu c. Italie (no 5941/04, 28 septembre 2006, §§ 53 à 56).
52. Dans la présente affaire, la Cour constate qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer avec certitude que le requérant avait connaissance du fait qu’il était recherché.
53. En effet, comme le démontrent les procès-verbaux produits par le Gouvernement, le requérant n’a jamais été informé de ce que des poursuites étaient en cours contre lui. En outre, l’ordonnance de clôture de l’instruction ne lui a pas été signifiée.
Enfin, il ne ressort pas non plus du dossier que le requérant ait fait des déclarations écrites ou orales prouvant qu’il aurait indiqué ne pas souhaiter donner suite à des interpellations dont il aurait eu connaissance et ait ainsi clairement renoncé à se présenter à son procès (voir Sejdovic, précité, § 99). La Cour note en outre que les deux tentatives de signification du jugement du 2 juin 2005, faites respectivement les 15 décembre 2005 et 23 janvier 2006, ont eu lieu alors que le requérant se trouvait en détention.
54. La Cour estime que la simple absence du requérant de son lieu de résidence habituel ou du domicile de ses parents ne suffit pas pour considérer que le requérant avait connaissance des poursuites et du procès à son encontre. On ne saurait donc en déduire qu’il était « en fuite » et a essayé de se dérober à la justice.
55. Dans ces conditions, la Cour est d’avis qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant et disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable.
56. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
LES LIMITES DES OBLIGATIONS DES JUGES DU FOND
Les tribunaux n'ont pas à répondre à chaque "détail" des arguments des parties
Higgins et autres contre France du 19 février 1998 Hudoc 749 requête 20124/92
"L'article 6§1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions mais il ne peut se comprendre en exigeant une réponse détaillée à chaque argument ()
L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce ()
Ni la procédure en rectification d'erreur matérielle ni celle en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel du 07/12/1989 n'ont fourni aux requérants une réponse explicite et spécifique sur les circonstances à tirer de l'arrêt du 22 mars 1990. Faute de cette dernière, il est impossible de savoir si la Cour de Cassation a simplement négligé d'évoqué la troisième affaire ou bien n'a pas voulu en ordonner le renvoi, et dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons"
LES OBLIGATIONS PLUS LÉGÈRES EN CASSATION
1/ Le principe est que les cours suprêmes et de cassation sont déchargées de l'obligation de motiver
Levages Prestations Services C. France du 23 octobre 1996 Hudoc 653 requête 21920/93
"La Cour a admis que les impératifs inhérents à la notion de "procès équitable" ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale:
Les Etats contractants jouissent d'une latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil que pour les poursuites pénales () Vu la spécificité du rôle joué par la Cour de Cassation dont le contrôle est limité au respect du droit, la Cour peut admettre qu'un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant celle-ci d'autant qu'il suppose, dans les procédures avec représentation obligatoire, le recours à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ()
En outre, la procédure en cassation succédait, en l'occurrence, à l'examen en cause de la requérante par un Tribunal de commerce puis une Cour d'Appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction"
2/ Les juridictions suprêmes doivent tout de même justifier leurs décisions
MURAT AKIN c. TURQUIE du 9 octobre 2018 requête n° 40865/05
Article 6-1 : La question posée à la Cour de Cassation est que le juge du fond s'est écartée de sa jurisprudence. La Cour de Cassation ne répond pas et viole l'article 6-1
A. Sur le grief tiré de la motivation de l’arrêt du 3 mars 2005 de la Cour de cassation
38. Le requérant se plaint que la Cour de cassation ait rejeté son pourvoi sans avoir égard à l’arrêt du 19 juin 2002 de l’assemblée des chambres civiles, et ce alors même qu’il aurait cité cet arrêt dans son pourvoi. Selon le requérant, la haute juridiction était parvenue dans cet arrêt à une conclusion contraire à celle du tribunal du travail et de la 9e chambre de la Cour de cassation dans son affaire.
39. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, dans la mesure où celui-ci porterait essentiellement sur l’appréciation opérée par les tribunaux nationaux. Si la Cour devait en décider autrement, il argue que l’arrêt du 19 juin 2002 n’entrait pas dans la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation. Il précise également que cet arrêt n’était pas un arrêt d’harmonisation de la jurisprudence et que, dès lors, il n’avait force obligatoire qu’à l’égard des parties au litige qu’il tranchait.
40. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
41. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (voir, entre autres, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999‑I).
42. En outre, sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose que la partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (voir, parmi d’autres exemples, Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 84, 11 juillet 2017.
43. En l’espèce, la Cour observe que le requérant se plaint que la 9e chambre de Cour de cassation ait rejeté son pourvoi sans avoir égard à l’arrêt du 19 juin 2002 de l’assemblée des chambres civiles, alors même qu’il aurait attiré l’attention de la haute juridiction sur cet arrêt. La question principale qui se posait à l’assemblée des chambres civiles dans l’affaire citée par le requérant était celle de savoir si les augmentations de rémunération prévues par la convention collective pertinente devaient s’appliquer à l’ancienne ou à la nouvelle rémunération d’un salarié qui s’était vu muter à un nouveau poste au sein de la direction. Cette juridiction avait statué dans son arrêt que la non-application des augmentations en cause au montant de la rémunération antérieure de l’intéressé n’était pas compatible avec le principe d’égalité ni avec la règle de l’interdiction de revoir un salaire à la baisse. Or, dans le cas du requérant, le jugement du tribunal du travail avait conclu que celui-ci n’était pas fondé à demander l’application des augmentations au montant de sa rémunération antérieure. La Cour note que le Gouvernement n’a pas contesté l’argument du requérant selon lequel la solution retenue par le tribunal du travail et confirmée ensuite par la 9e chambre de la Cour de cassation était contradictoire avec celle adoptée par l’assemblée des chambres civiles. Elle relève toutefois que, dans son arrêt du 3 mars 2005, la 9e chambre de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant sans présenter de motivation substantielle (paragraphe 27 ci-dessus) et, en tout état de cause, sans prêter une attention explicite à la divergence prétendument existant entre les conclusions du tribunal du travail et celles de l’assemblée des chambres civiles dans des affaires similaires, bien que son attention eût été explicitement attirée sur ce point. Même si, en rejetant le pourvoi du requérant, la Cour de cassation pouvait, en principe, se borner à faire siens les motifs du tribunal du travail, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’argument du requérant tiré de l’arrêt du 19 juin 2002 exigeait que la 9e chambre de la Cour de cassation fournît une réponse adéquate (Emel Boyraz c. Turquie, no 61960/08, § 75, 2 décembre 2014).
44. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de l’absence d’une motivation adéquate dans l’arrêt du 3 mars 2005 de la Cour de cassation.
ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1
56. Sur la base des mêmes faits, le requérant dénonce également une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
57. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
58. La Cour rappelle que la notion de « biens » évoquée à la première partie de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII, et Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004‑IX).
59. En outre, on ne peut conclure à l’existence d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (Kopecký, précité, § 50). Lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux (ibidem, § 52).
60. En l’espèce, la Cour observe d’emblée que l’intérêt patrimonial évoqué par le requérant concernait l’application des augmentations au montant de son salaire antérieur à sa mutation, et qu’il ne porte pas dès lors sur un « bien actuel », mais qu’il relève de la créance. La question essentielle pour la Cour est donc de savoir s’il existait une base suffisante en droit interne tel qu’interprété par les juridictions nationales pour que l’on puisse qualifier la créance du requérant de « valeur patrimoniale » aux fins de l’article 1 du Protocole no 1.
61. À cet égard, la Cour observe que le tribunal du travail a estimé que, même si le montant de sa rémunération ne pouvait pas être revu à la baisse après sa mutation, le requérant n’était pas fondé à réclamer les augmentations sur le montant de son salaire antérieur, ce dernier correspondant à un poste qui n’était plus le sien durant la période concernée.
62. La Cour note que la juridiction du fond a ainsi décidé qu’il n’y avait pas de base légale pour les augmentations demandées par le requérant. Elle note également que par la suite, c’est-à-dire pour la première fois dans son pourvoi en cassation, le requérant s’est référé à l’arrêt de l’assemblée des chambres civiles de cette juridiction du 19 juin 2002, pour en tirer un argument contre la décision de la juridiction du fond. À cet égard, la Cour note que son constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus) ne porte que sur l’absence d’une motivation adéquate dans l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2005 et qu’elle ne peut spéculer sur l’issue qu’aurait eue la procédure dans l’hypothèse où la 9e chambre de la Cour de cassation aurait répondu à l’argument tiré par le requérant de l’arrêt l’assemblée des chambres civiles.
63. Dans ces conditions, le requérant n’ayant pas démontré l’existence en l’espèce d’une base suffisante en droit interne, la Cour estime qu’il ne disposait pas d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
64. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.
LEBEDINSCHI c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA du 16 juin 2015 Requête 41971/11
Violation de l'article 6, les tribunaux internes doivent motiver leur décision.
29. Le requérant allègue que la procédure interne a été inéquitable à cause du refus non motivé des tribunaux nationaux d’appliquer à son égard les dispositions du Règlement et de lui octroyer l’indemnité unique de perte de capacité de travail. Il estime que, à partir du moment où il a fourni la preuve d’avoir été embauché par contrat par le Ministère, les juridictions internes devaient lui reconnaître les bénéfices de l’indemnité en question. Il déplore l’absence de réponse de la part des tribunaux nationaux relativement au moyen tiré de son statut de contractuel.
30. Le Gouvernement considère que le grief du requérant a principalement trait à l’application et à l’interprétation de la législation interne et il rappelle que cette tâche incombe, en premier lieu, aux instances judiciaires nationales. Il soutient également que les juridictions internes ont motivé à suffisance leurs décisions. Il considère que la cour d’appel de Chișinău a répondu aux arguments du requérant et que le Cour suprême de justice, agissant en tant qu’instance de recours, n’était pas tenue de motiver sa décision. Pour ce qui est plus précisément du moyen du requérant tiré de l’existence d’un rapport contractuel avec le Ministère, il rappelle que l’article 6 de la Convention n’oblige pas les instances judiciaires de répondre de façon détaillée à chaque argument des parties au procès. Il argue enfin que le procès dans son ensemble a été équitable.
31. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les juridictions internes doivent motiver leurs décisions (Van de Hurk c. Pays‑Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288). L’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303‑A). Si l’article 6 § 1 de la Convention ne peut se comprendre comme exigeant des tribunaux d’apporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé, il doit néanmoins ressortir de la décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées (Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 91, CEDH 2010).
32. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (voir, parmi d’autres, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11, et Erfar-Avef c. Grèce, no 31150/09, § 39, 27 mars 2014).
33. En l’espèce, la Cour relève que la cour d’appel de Chișinău rejeta la prétention du requérant relativement au paiement de l’indemnité unique de perte de capacité de travail au motif que les dispositions du Règlement n’étaient pas applicables aux agents de police, hormis le personnel embauché par contrat. Dans son recours devant la Cour suprême de justice, le requérant articula d’une manière suffisamment claire et précise un moyen tiré de son statut de contractuel qu’il étayait par des preuves. La Cour remarque également que, selon le droit procédural applicable à l’époque des faits, la Haute juridiction devait apprécier des éléments de fait et de droit (paragraphe 22 ci-dessus), au moins dans la mesure où ceux-ci étaient invoqués dans le recours.
34. La Cour observe que le moyen tiré du statut de contractuel du requérant était pertinent et décisif. Si la Cour suprême de justice l’avait jugé fondé, elle aurait dû accueillir la prétention de l’intéressé tendant au paiement de l’indemnité unique de perte de capacité de travail.
35. Il reste à la Cour de rechercher si, en l’occurrence, le silence de la Cour suprême de justice par rapport au moyen susmentionné du requérant peut raisonnablement s’interpréter comme un rejet implicite. Elle relève que la question de savoir si le requérant pouvait tirer avantage de l’exception selon laquelle les dispositions du Règlement étaient applicables au personnel contractuel se distingue juridiquement et logiquement de celle de savoir si, en règle générale, le texte litigieux s’applique ou non aux agents de police. Elle exigeait donc une réponse spécifique et explicite. La Cour suprême est restée en défaut de le faire et il est impossible de savoir si celle‑ci a simplement négligé le moyen tiré du statut de contractuel ou bien a voulu le rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons.
36. À la lumière de ce qui précède, la Cour juge que la procédure n’a pas été équitable et que, par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
3/ Les juridictions suprêmes doivent motiver leur refus de saisir la CJUE en cas de doute d'arbitraire
Coeme et autres contre Belgique du 22 juin 2000 Hudoc 1974 requêtes 32492/96; 32547/96; 33209/96; 33210/96,
La Cour rappelle que le refus de poser une question préjudicielle est non prévue par la Convention et qu'il ne peut y avoir violation de l'article 6§1 sauf dans le cadre d'une exception:
"Il n'est pas exclu que, dans certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale appelée à se prononcer en dernière instance, puisse porter atteinte au principe de l'équité de la procédure, tel qu'énoncé à l'article 6§1 de la Convention en particulier lorsqu'un tel refus apparaît comme entaché d'arbitraire (Dotta contre Italie 07/09/1999 non publié; Bedil Anstalt SA contre Italie du 08/06/1999 non publié)
SCHIPANI ET AUTRES c. ITALIE du 21 juillet 2015 Requête no 38369/09
Violation de l'article 6-1 : La Cour de Cassation n'a pas dit pourquoi il refuse le renvoi préjudicielle à la CJCE sur l'application d'une directive.
69. La Cour rappelle que, dans la décision Vergauwen et autres (précitée, §§ 89-90), elle a exprimé les principes suivants (voir également Dhahbi, précité, § 31) :
– l’article 6 § 1 de la Convention met à la charge des juridictions internes une obligation de motiver au regard du droit applicable les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle ;
– lorsqu’elle est saisie sur ce terrain d’une allégation de violation de l’article 6 § 1, la tâche de la Cour consiste à s’assurer que la décision de refus critiquée devant elle est dûment assortie des motifs requis ;
– s’il lui revient de procéder rigoureusement à cette vérification, il ne lui appartient pas de connaître d’éventuelles erreurs qu’auraient commises les juridictions internes dans l’interprétation ou l’application du droit pertinent ;
– dans le cadre spécifique du troisième alinéa de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne (soit l’actuel article 267 du TFUE), cela signifie que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne sont tenues, lorsqu’elles refusent de saisir la CJCE à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’UE soulevée devant elles, de motiver leur refus au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la CJCE. Il leur faut donc indiquer les raisons pour lesquelles elles considèrent que la question n’est pas pertinente, ou que la disposition de droit de l’UE en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la CJCE, ou encore que l’application correcte du droit de l’UE s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
70. En l’espèce, pour le cas où leur pourvoi ne serait pas accueilli, les requérants ont demandé à la Cour de cassation de poser à la CJCE la question préjudicielle de savoir : a) si la non-transposition, par l’État italien, des directives nos 363 du 16 juin 1975 et 82 du 26 janvier 1976 dans le délai fixé à cet effet s’analysait en une violation grave et manifeste du droit communautaire, entraînant l’obligation de l’État de réparer le préjudice subi par les personnes lésées ; et b) si les conditions prévues par le décret législatif no 257 de 1991 rendaient impossible ou excessivement difficile l’obtention de ce dédommagement (paragraphe 23 ci-dessus). Ses décisions n’étant susceptibles d’aucun recours juridictionnel en droit interne, la Cour de cassation avait l’obligation de motiver son refus de poser la question préjudicielle au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la CJCE (Dhahbi, précité, § 32).
71. La Cour a examiné l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2008 sans y trouver aucune référence à la demande de renvoi préjudiciel formulée par les requérants et aux raisons pour lesquelles il a été considéré que la question soulevée ne méritait pas d’être transmise à la CJCE (paragraphe 27 ci-dessus). Il est vrai que, dans la motivation de l’arrêt, la Cour de cassation a indiqué que le retard dans la transposition des directives litigieuses faisait naître, selon la jurisprudence de la CJCE, le droit à la réparation des dommages subis par les particuliers (paragraphe 25 ci-dessus). Le Gouvernement soutient, en substance, que cette affirmation peut s’analyser en une motivation implicite du rejet de la première branche de la question préjudicielle sollicitée par les requérants (paragraphe 67 ci-dessus). Cependant, à supposer même que cela soit le cas, l’affirmation dont il s’agit n’explique pas les raisons pour lesquelles la deuxième branche de la question préjudicielle – la question de savoir si les conditions prévues par le décret législatif no 257 de 1991 rendaient l’obtention du dédommagement impossible ou excessivement difficile – était irrecevable.
72. La motivation de l’arrêt litigieux ne permet donc pas d’établir si cette dernière branche de la question a été considérée comme non pertinente ou comme relative à une disposition claire ou comme déjà interprétée par la CJCE, ou bien si elle a été simplement ignorée (voir,
mutatis mutandis, Dhahbi, précité, § 33 ; voir également, a contrario, Vergauwen, précité, § 91, où la Cour a constaté que la Cour constitutionnelle belge avait dûment motivé son refus de poser des questions préjudicielles).73. Ce constat suffit pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
COUR DE CASSATION FRANÇAISE
Des pièces annulées dans une autre procédure emportent l'annulation des actes subséquents.
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 21 octobre 2015 pourvoi n° 15-83395 cassation
Vu les articles 174 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la personne mise en examen est recevable à proposer des moyens de nullité visant des actes de l'information se référant à des pièces annulées, fût-ce dans une procédure à l'origine distincte, dès lors qu'il en résulte une atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X...a été mis en examen le 13 mai 2014, des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, après que le juge d'instruction eut ordonné, le 19 mars 2014, la jonction de deux informations distinctes portant sur des trafics de cocaïne ; que, par requête déposée le 7 novembre 2014, il a sollicité la cancellation, d'une part, des quatrième et cinquième paragraphes d'un procès-verbal d'investigation établi par les enquêteurs le 4 juin 2013, d'autre part, du dernier paragraphe d'un procès-verbal de synthèse, en date du 5 mai 2014, reproduisant et commentant des déclarations faites au cours de sa garde à vue par un autre mis en examen, M. Jérémy D...; qu'il résulte du procès-verbal du 4 juin 2013 que celui-ci aurait désigné comme l'un des commanditaires d'un transport de cocaïne l'utilisateur d'un véhicule Twingo, identifié par les enquêteurs comme pouvant être M. Ludovic X...; qu'il ressort du procès-verbal du 5 mai 2014 que M. Jérémy D...a formulé des accusations pouvant impliquer M. Ludovic X...pour un autre transport de drogue ; qu'à l'appui de sa requête, M. X...a fait valoir que ces mentions méconnaissaient un arrêt devenu définitif, rendu le 25 juin 2013 dans l'une des deux procédures jointes, par la chambre de l'instruction, qui, pour violation des droits de la défense, a annulé le procès-verbal d'audition de M. Jérémy D...lors de sa garde à vue ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ce moyen de nullité, l'arrêt énonce qu'il incombait à M. D..., qui, interrogé le 7 mai 2014, avait la possibilité de connaître l'existence de ces procès-verbaux, d'en poursuivre l'annulation, et que M. X...ne pouvait se substituer à M. D...dès lors que le motif d'annulation invoqué ne concernait pas la violation de ses droits ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si des actes de l'information se référaient à des pièces annulées, fût-ce dans la procédure distincte avant jonction, dans des conditions susceptibles d'avoir porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé
DES DÉBATS TROP LONGS FATIGUENT LA DÉFENSE ET CREENT UN DÉSÉQUILIBRE
Makhfi contre France du 19 octobre 2004 requête 59335/00
"I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 et 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Il se plaint de ce que l'heure à laquelle a plaidé son avocat et la durée des débats ont violé ses droits de la défense. L'article 6 se lit comme suit dans ses dispositions pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial, (...), qui décidera, (...) soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à :
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) »
21. Le requérant rappelle que le principe de continuité des débats devant la cour d'assises interdit l'interruption et non la suspension et qu'en l'absence de précision de la loi, c'est au président de cette juridiction qu'il revient de décider des suspensions.
22. Il expose qu'en l'espèce la partie civile et l'avocat général ont présenté leurs observations entre une heure du matin et deux heures et demi environ, alors que son conseil a plaidé à environ cinq heures du matin.
23. Il estime que, dans ces conditions, il ne peut être considéré comme équivalent de plaider à une heure du matin, heure encore supportable du début de la nuit, et cinq heures du matin, heure plus proche du réveil du lendemain que de la nuit de la veille, et souligne que l'attention des jurés n'est pas la même.
24. Il en conclut que ce procès a violé l'exigence d'un procès équitable et de l'égalité des armes.
25. Le Gouvernement souligne tout d'abord que le requérant n'explique pas en quoi, en l'espèce, le fait de plaider à une heure tardive aurait rendu son procès inéquitable.
26. Il rappelle qu'une des exigences du procès équitable est l'égalité des armes, laquelle implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
27. Le Gouvernement ajoute que le 4 décembre 1998, les débats concernant l'instruction de l'affaire à l'audience ont repris à 9 h 15 et se sont achevés à 0 h 30, soit après 15 heures. Ils avaient toutefois été interrompus à trois reprises, soit presque quatre heures, pour permettre à chacun de se restaurer et de se reposer.
28. Après une suspension d'audience d'une demi-heure, l'audience reprit à une heure du matin et la partie civile, le ministère public et le conseil d'un coaccusé présentèrent leurs plaidoiries et réquisitions.
29. A quatre heures, une suspension de vingt-cinq minutes fut accordée.
30. A la reprise, le conseil d'un coaccusé puis celui du requérant plaidèrent. Le jury se retira pour délibérer à 6 heures.
31. Le Gouvernement en conclut que le conseil de la partie civile, le ministère public et les conseils des accusés ont tous plaidé et requis dans les mêmes conditions. Il relève d'ailleurs que les autres conseils se sont opposés à la demande de renvoi présentée par l'avocat du requérant.
32. La Cour rappelle les exigences des paragraphes 2 et 3 b) de l'article 6 représentent des éléments de la notion générale de procès équitable consacrée par le paragraphe 1 (voir, parmi d'autres, les arrêts Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I, et Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A no 277-A, p. 13, § 29). La Cour estime qu'il est approprié d'examiner les griefs à la lumière du paragraphe 1 de l'article 6, en le combinant au besoin avec ses autres paragraphes (voir Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 93, CEDH 2000-VII).
Elle rappelle également que le but de la Convention « consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ; la remarque vaut spécialement pour [les droits] de la défense eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable, dont ils dérivent, joue dans une société démocratique » (arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 15-16, § 33 et Coëme et autres c. Belgique précité, § 98).
33. La notion d'égalité des armes n'épuise pas le contenu du paragraphe 3 d) de l'article 6. Les exigences du paragraphe 3 d) s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 (voir notamment les arrêts Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 15, § 28, et Isgrò c. Italie du 21 février 1991, série A no 194-A, pp. 11-12, § 31). La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (voir notamment les arrêts Delta c. France du 19 décembre 1990, série A no 191, p. 15, § 35 et Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A no 235-B, § 33).
34. La Cour note qu'en l'espèce le requérant était accusé de viols et de vol en réunion en état de récidive et comparaissait devant la cour d'assises.
35. L'audience devant la cour d'assises reprit le 4 décembre à 9 h 15. En cette journée, les débats eurent lieu de 9 h 15 à 13 h 00, puis de 14 h 30 à 16 h 40, de 17 h 00 à 20 h 00 et de 21 h 00 à 00 h 30. Lors de cette dernière interruption, l'avocat du requérant déposa une demande de suspension en invoquant les droits de la défense.
36. Cette demande ayant été rejetée par la cour, les débats reprirent à 1 h 00 du matin le 5 décembre et se poursuivirent jusqu'à 4 h 00.
37. La Cour note ainsi que l'avocat du requérant plaida à la reprise de l'audience à 4 h 25 du matin, après son confrère défendant l'autre accusé, vers 5 h du matin, après une durée cumulée des débats de 15 h 45. Les accusés, dont le requérant, eurent la parole en dernier.
38. Les débats s'étalèrent sur cette journée sur une durée totale de 17 h 15 à l'issue desquelles la cour se retira pour délibérer. La Cour note encore que la cour d'assises, juges et jurés, délibéra entre 6 h 15 et 8 h 15 le 5 décembre au matin. Le requérant fut finalement condamné à huit ans de réclusion criminelle.
39. La Cour rappelle qu'elle a déjà estimé qu'un état de fatigue avait dû placer des accusés dans un état de moindre résistance physique et morale au moment où « ils abordèrent une audience très importante pour eux, vu la gravité des infractions qu'on leur reprochait et des peines qu'ils encouraient. Malgré l'assistance de leurs conseils, qui eurent l'occasion de présenter leurs arguments, ce fait par lui-même regrettable affaiblit sans nul doute leur position à un moment crucial où ils avaient besoin de tous leurs moyens pour se défendre, et notamment pour affronter leur interrogatoire dès l'ouverture de l'audience et pour se concerter efficacement avec leurs avocats » (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, § 70).
40. La Cour est d'avis qu'il est primordial que, non seulement les accusés, mais également leurs défenseurs, puissent suivre les débats, répondre aux questions et plaider en n'étant pas dans un état de fatigue excessif. De même, il est crucial que les juges et jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d'attention pour suivre les débats et pouvoir rendre un jugement éclairé.
41. La Cour estime que cette situation s'est produite en l'espèce. Elle est d'avis que les conditions décrites ci-dessus (paragraphes 34-38) ne peuvent répondre aux exigences d'un procès équitable et notamment de respect des droits de la défense et d'égalité des armes.
42. Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1"
Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH, lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédigervotre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.