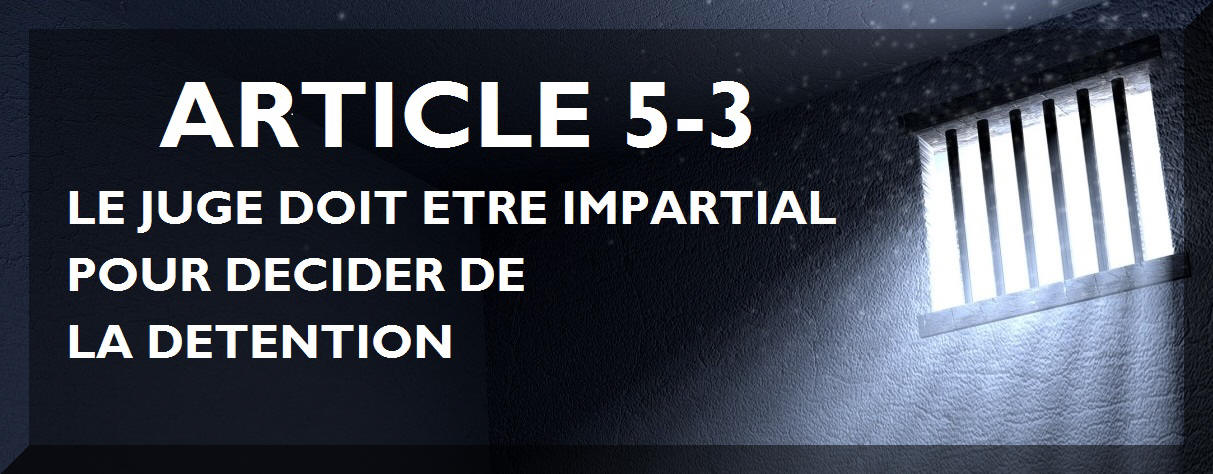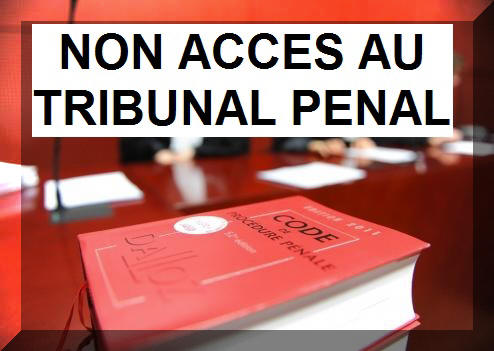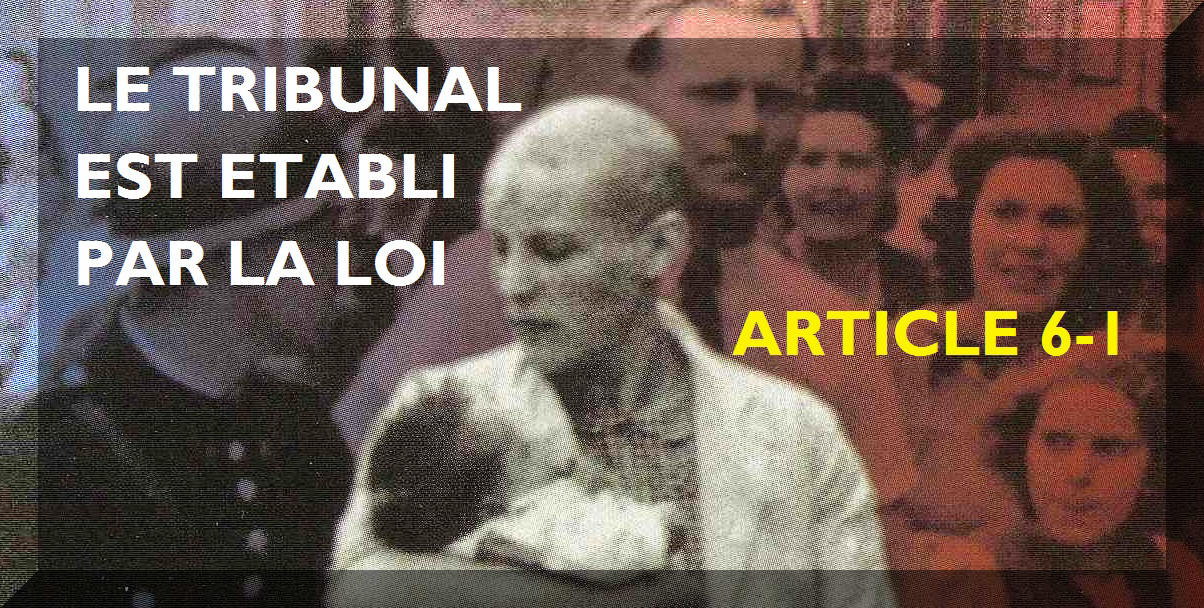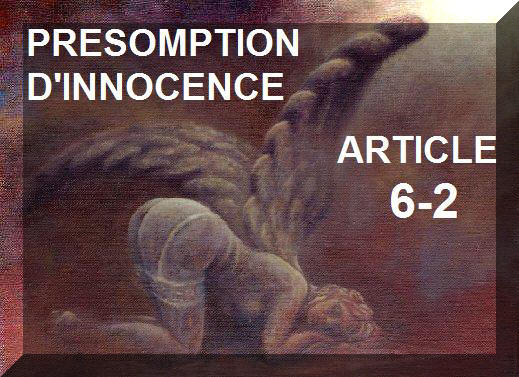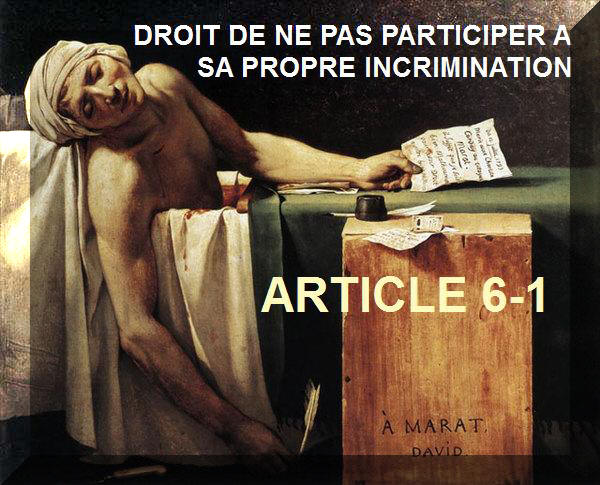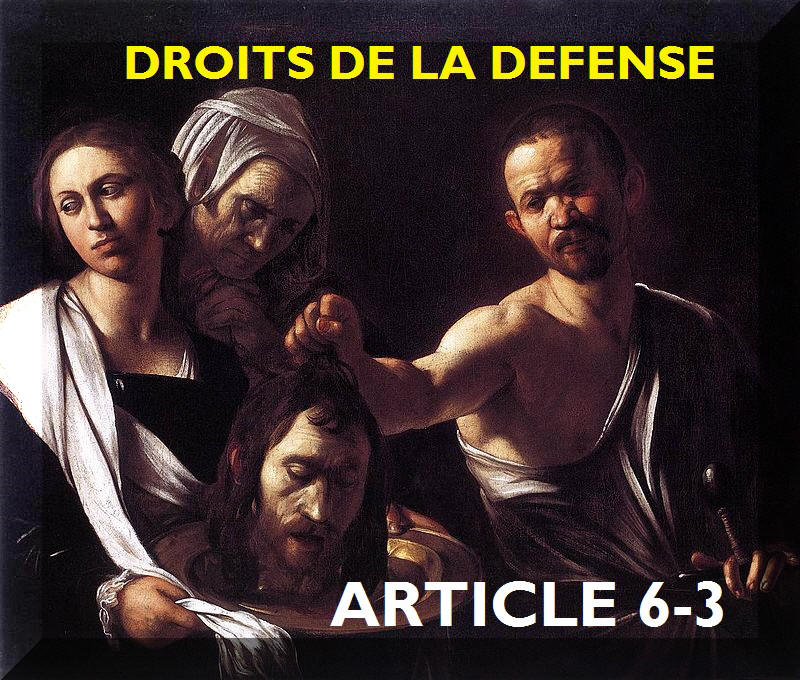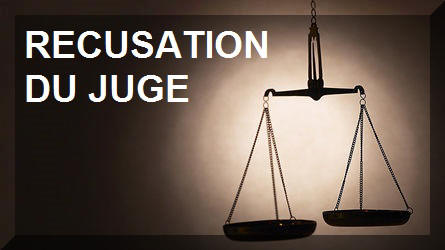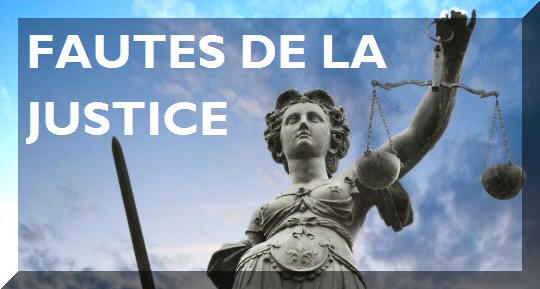DÉLAI NON RAISONNABLE
DÉLAI NON RAISONNABLE
D'UNE PROCÉDURE FRANÇAISE
ARTICLE 6-1 DE LA CEDH
Pour plus de sécurité, fbls délai non raisonnable d'une procédure française est sur :
https://www.fbls.net/6-1delai1.htm
"Le délai non raisonnable est qualifié de déni de justice en France."
Frédéric Fabre docteur en droit.
ARTICLE 6§1 en ses termes compatibles :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ()
dans un délai raisonnable, par un tribunal () qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle"
 Cliquez
sur un bouton ou un lien bleu pour accéder à la jurisprudence gratuite et les modèles gratuits sur :
Cliquez
sur un bouton ou un lien bleu pour accéder à la jurisprudence gratuite et les modèles gratuits sur :
- LE SCANDALE DE LA DURÉE DES PROCÉDURES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
- LE DÉLAI NON RAISONNABLE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
- LE DÉLAI NON RAISONNABLE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
- LES CAS OU LE REQUÉRANT PEUT SAISIR DIRECTEMENT LA CEDH.
Cliquez sur le bouton ci dessous pour accéder gratuitement à l'analyse de l'article 6 par la CEDH au format PDF

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables
devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme
de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances,
vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel,
pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.



LE SCANDALE DE LA DURÉE
DES PROCÉDURES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
HISTORIQUE DU CHANGEMENT DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites :
- LA JURISPRUDENCE CONTRE LE DELAI NON RAISONNABLE DES PROCEDURES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
- L'ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2014 DE LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION
- LES CINQ REQUÊTES QUI MODIFIENT LE DROIT EN FRANCE EN FAVEUR DES DÉBITEURS
- LES CINQ DÉCISIONS DE LA CEDH négociées avec l'État français.
- L'ARRÊT HISTORIQUE INSUFFISANT POUR CHANGER LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
- LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH TABOURET C. FRANCE
LA PROTECTION LIMITEE DES DEBITEURS DANS LE DROIT FRANCAIS
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites :
- LA LOI ET LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION FRANÇAISE PROTEGENT FAIBLEMENT LES DEBITEURS
- LE DROIT DE SUITE DES CREANCIERS
HISTORIQUE DU CHANGEMENT DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
LA JURISPRUDENCE CONTRE LE DELAI NON RAISONNABLE
Les opérations de liquidation judiciaire contre les personnes physiques, sont un
véritable scandale. Sous l'apparence de légalité, elles permettent de ruiner des familles entières et de spolier les héritages des enfants, en laissant
durer les procédures pendant 5, 7, 10, 15, 20 ou 25 ans. Pendant ce temps, le débiteur est privé de la gestion patrimoniale de ses biens et ne peut pas
reconstruire sa vie. Il subit une "mort civile". Ce scandale est l'une des causes du chômage de masse en France.
QUE DEVEZ VOUS FAIRE SI VOUS SUBISSEZ UN DÉLAI NON RAISONNABLE
D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE ?
Quand la procédure de liquidation judiciaire subit un délai non raisonnable, vous avez droit
à une réparation morale et matérielle et à une clôture immédiate de la procédure de liquidation judiciaire, même s'il reste encore des biens à vendre.
Cependant la Cour de cassation s'y oppose avec la complicité de la CEDH qui fait
tout pour ne pas répondre aux questions posées.
Vous pouvez agir
vous-même, sans la nomination d'un administrateur ad hoc, puisqu'il s'agit d'un droit propre qui vous appartient.
Vous assignez Monsieur l'agent judiciaire de l'État devant le TGI près du tribunal qui gère la liquidation judiciaire ou devant le
TGI de Paris, pour réclamer la réparation du préjudice matériel et moral pour cause de délai non raisonnable de la procédure de liquidation judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République sera appelé par les juges. Vous demandez que le TGI lui impose de demander
la clôture des opérations de liquidation judiciaire, pour cause de délai non raisonnable, à la juridiction qui gère la procédure de liquidation.
Si vous voulez contraindre le liquidateur judiciaire à demander la clôture
des opérations de liquidation judiciaire, vous pouvez
l'assigner devant le TGI.
La juridiction qui gère la liquidation judiciaire vous appellera, avant même la décision du TGI.
Vous demandez la clôture en l'état, des opérations de liquidation judiciaire pour cause de délai non raisonnable. Le
liquidateur judiciaire sera appelé par la juridiction.
Si la liquidation judiciaire est gérée par un TGI, vous pouvez faire les deux demandes devant le même TGI.
Vous pouvez nous contacter à fabre@fbls.net
pour des informations complémentaires.
Le Gouvernement français nous a envoyé dans le cadre d'un
échange devant un comité de l'ONU, les statistiques françaises de l'année 2018 :
9 recours ont été exercés devant les TGI, pour délai non
raisonnable d'une procédure de liquidation judiciaire, 5 ont abouti à une
condamnation de l'Etat dont 3 de chez nous. Nous avons donc participé à la bonne
statistique de 55 % de taux de réussite.
LES SOURCES DU DROIT APPLICABLE :
PATRICE POULAIN
- Le 19 janvier 2017, l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai prononce la clôture de la liquidation judiciaire pour délai non raisonnable de la procédure. Le requérant sauve une partie de son héritage.
- Le jugement du TGI de Paris en date du 29 octobre 2018 répare et indemnise le délai non raisonnable de la liquidation judiciaire
personnelle de Monsieur Poulain. Il bénéficie de l'exécution provisoire.
- La décision de référence de la CEDH est directement ici sous le lien bleu des cinq décisions devant la CEDH.
TAVARES
- Le 18 juillet 2018, le Tribunal de Commerce d'Annecy a rendu une décision mettant fin en l'état à la procédure de liquidation
judiciaire, pour cause de délai non raisonnable de la procédure. Le requérant sauve sa maison et un appartement pour pouvoir y finir sa vie et les transmettre à ses enfants.
- Le jugement du TGI de Paris en date du 29 octobre 2018, répare et indemnise le délai non raisonnable de la liquidation
judiciaire personnelle de Monsieur Tavares. Il bénéficie de l'exécution provisoire et ne fera pas appel. L'agent judiciaire de l'État non plus
- La décision de référence de la CEDH est directement ici sous le lien bleu des cinq décisions devant la CEDH.



L'ARRÊT DEVENU EN PARTIE OBSOLÈTE DU 16 DÉCEMBRE 2014
PUIS A NOUVEAU REAPPLIQUE PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION
HISTORIQUEMENT
La décision de la Cour de Cassation 16 décembre 2014,
est des plus curieuses. Les débiteurs ont un droit propre pour se faire indemniser pour le délai non raisonnable d'une procédure de liquidation
judiciaire, mais ils ne peuvent pas exiger que la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Cette dernière interdiction a été annulée par les
procédures appliquées par Frédéric Fabre et fbls.net.
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 16 décembre 2014 pourvois n° 13-19402 Cassation
Vu l'article L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et 1er du protocole n° 1 additionnel à cette Convention ;
Attendu que, lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit
du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est
pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L.
141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres ;
Attendu que pour prononcer la clôture de la procédure de liquidation des biens de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que le comportement
du débiteur a été dilatoire à l'extrême mais qu'en parallèle, le mandataire n'a pas rempli sa mission en usant de ses pouvoirs de
contrainte pour poursuivre la vente forcée des immeubles, retient que la durée totale de trente-trois ans de la procédure est excessive au
regard des exigences d'un procès équitable, qu'elle a privé la procédure de sa justification économique qui est de désintéresser les
créanciers de sorte que la privation du débiteur de ses droits sur son patrimoine ne se justifie plus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'actifs immobiliers réalisables, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LES DECISION DE PROLONGATION DES PROCÉDURES DE LIQUIDATION JUDICIAIRES NE SONT MÊME PAS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 22 mars 2016 pourvois n° 14-21919 irrecevabilité
Vu l'article 537 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 avril 2014), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 5 juillet 2006 ; qu'à l'audience à laquelle l'affaire
avait été renvoyée pour examiner la clôture de la procédure, le liquidateur a demandé le report de son examen ; que le débiteur s'y est opposé en demandant la
clôture ; que le tribunal a rejeté la demande de clôture et ordonné la prorogation du délai de son examen ; que M. X... s'est pourvu en cassation
contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel qu'il a formé contre ce jugement ;
Mais attendu que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de
l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce
report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; qu'en conséquence, M. X..., dont l'appel de cette
décision n'était pas recevable, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation ;
Au visa de l'article 537 du code de procédure civile qui prévoit : "Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun
recours.", la Cour de cassation interdit tout examen d'appel d'une décision de prolongation des opérations de liquidation judiciaire, fût-ce pour excès de pourvoir !
L'arrêt complet de la cour de cassation du 22 mars 2016
est lisible ici au format WORD.
AUJOURD'HUI
DEPUIS LES REQUÊTES QUE J'AI DEPOSÉES A LA CEDH PUIS L'ASSIGNATION AU TGI DE PARIS, LA
LOI ET JURISPRUDENCE A
UN PEU CHANGÉ
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du
7 novembre 2018 pourvois n° 17-16.176 irrecevabilité
Mais attendu que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure
de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite
par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, contrairement à la
décision qui rejetterait la demande de clôture de la procédure formée par le débiteur à tout autre moment, en application de l'article L. 643-9, alinéa 4, du
même code ; qu'en conséquence, M. X..., dont l'appel de cette décision n'était pas recevable, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation ;
Article L 643-9 alinéa1 du Code de Commerce
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si
la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Article L 643-9 alinéa 4 du Code de Commerce
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
LE RETOUR EN ARRIERE DE LA COUR DE CASSATION SUR LES
CLÔTURES DES LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
MALGRE DES DELAIS NON RAISONNABLES - LES DOMICILES PEUVENT ÊTRE SAISIS
La Cour de Cassation impose le paragraphe IV de l'article 206 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 qui prévoit :
"IV.-Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du
même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à
l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité
professionnelle après la publication de la présente loi.
Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la
résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent
de produire leurs effets."
UN REFUS DE LA COUR DE CASSATION DE PRESENTER UNE QPC
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 12 avril 2018 pourvois n° 18-40.004 non lieu à QPC inédit
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa
rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015, protégeant la résidence
principale du débiteur en liquidation judiciaire, sont-elles contraires au
préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'elles semblent
introduire une discrimination entre les débiteurs en liquidation judiciaire
selon qu'ils se trouvent dans une situation procédurale antérieure ou
postérieure à la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, en ce
qu'elles privent les débiteurs en liquidation judiciaire au moment de la
promulgation de la loi du 6 août 2015 du principe de l'application immédiate de
la loi dans le temps et introduisent ainsi une discrimination entre les
débiteurs en état de liquidation judiciaire, et en ce qu'elles introduisent un
principe discriminatoire entre les débiteurs en liquidation judiciaire dont les
créanciers ont des droits nés avant la promulgation de ladite loi du 6 août 2015 ? » ;
Attendu que l'article L. 526, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, énonce que, par dérogation aux
articles 2284 et 2285 du code civil, les droits qu'a une personne physique
immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou
exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où
est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les
créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle
de la personne ; que l'article 206 IV de la même loi dispose que ce texte n'a
d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de
l'activité professionnelle après la publication de la loi ;
Attendu que cette disposition est applicable au litige, en ce qu'il concerne la
vente forcée, ordonnée par le juge-commissaire, de l'immeuble appartenant à Mme
Y..., débitrice en liquidation judiciaire répondant aux critères légaux ;
qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et
le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation
d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas
encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose
ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes,
ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que,
dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la question n'est pas
sérieuse en ce que, d'abord, l'entrepreneur individuel mis en liquidation
judiciaire avant la publication de la loi du 6 août 2015, et qui n'avait pas
estimé nécessaire de déclarer insaisissables ses droits sur sa résidence
principale, n'est pas dans la même situation que celui qui s'endette, après
cette date, pour les besoins de son activité professionnelle, et qui bénéficie
de plein droit de cette insaisissabilité, et en ce que, ensuite, les
dispositions critiquées résultant d'une loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques ont pour objet de promouvoir la création
d'entreprises individuelles tout en assurant la protection de la résidence
principale des entrepreneurs et que la différence de traitement ainsi instituée
est donc en rapport direct avec cet objet ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
L'ARRÊT CONSEQUENT DU REFUS DU QPC
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 14 novembre 2019 pourvois n° 17-16.058 rejet inédit
Mais attendu que, lorsqu'il existe un actif réalisable de
nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit
du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte,
de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par
la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mais lui ouvre l'action en
réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire,
qu'il peut exercer au titre de ses droits propres ; qu'après avoir énuméré les
nombreuses créances imputables aux appelants, qui ont presque toutes fait
l'objet de leur part de contestations et de recours, l'arrêt relève que la
détermination de l'actif réalisable a dû faire l'objet d'une estimation par un
expert, toujours en cours du fait de la résistance des débiteurs ; qu'ayant
ainsi fait ressortir qu'existait un actif réalisable de nature à désintéresser
en tout ou partie les créanciers, rendant impossible la clôture de la
liquidation au seul motif de sa durée, c'est à bon droit que la cour d'appel a
rejeté la demande de clôture de la liquidation judiciaire de M. et Mme B... ; que le moyen n'est pas fondé ;
L'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale
du débiteur résultant de l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa
rédaction issue de la loi du 6 août 2015, n'a d'effet, en application de
l'article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les
droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication
de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage
de l'immeuble indivis constituant la résidence principale de l'indivisaire en
liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des
créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur
l'immeuble étant alors appréhendés par le gage commun. C'est, dès lors,
exactement qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en
licitation-partage d'un tel immeuble formée par un liquidateur qui soutient que
l'essentiel des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi, et non leur totalité
UNE LEGERE EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE
CASSATION CONTRE LA LETTRE DU PARAGRAPHE IV DE L'ARTICLE 206 DE LA LOI
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 13 avril 2022 pourvois n°
20-23.165 rejet
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20
novembre 2020), M. [I] et Mme [H] sont propriétaires indivis d'un bien
immobilier qui constitue leur résidence principale. Par un jugement du 10 août
2016, M. [I], exerçant la profession de peintre, a été mis en liquidation
judiciaire, la société Franklin Bach étant désignée liquidateur.
2. Mme [H] s'opposant à la vente de l'immeuble, le liquidateur l'a assignée
devant le tribunal aux fins de partage judiciaire de l'indivision et de vente
aux enchères publiques de l'immeuble. Mme [H] lui a opposé l'insaisissabilité de
plein droit des droits du débiteur sur sa résidence principale prévue par
l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015.
REPONSE COUR DE LA CASSATION
4. L'insaisissabilité de plein droit de la résidence
principale du débiteur résultant de l'article L. 526-1 du code de commerce dans
sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n'a d'effet, en application de
l'article 206, IV, alinéa 1er, de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont
les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la
publication de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en
licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence principale de
l'indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la
procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du
débiteur sur l'immeuble étant alors appréhendés par le gage commun.
5. Dès lors qu'il est soutenu par le liquidateur que l'essentiel des créances
déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi,
et
non leur totalité, l'arrêt retient exactement qu'il n'est pas opérant de la part
du liquidateur, en l'espèce, d'invoquer l'opposabilité de l'insaisissabilité de
droit de la résidence principale du débiteur aux seuls créanciers dont les
droits sont nés postérieurement, et que l'action est irrecevable.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
ATTENTION AU
DIVORCE EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE, LE DOMICILE PEUT ÊTRE VENDU !
Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 255, 3° et 4°, du code civil que, lorsque, au cours de la procédure
de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de
l'entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l'entrepreneur, à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure
collective, n'est plus située dans l'immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu'il détient sur ce bien
ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de son activité professionnelle. Par conséquent, a violé
ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur tendant à la réalisation de l'immeuble au titre des opérations de
liquidation, retient que la décision judiciaire attribuant la jouissance exclusive de la résidence de la famille à l'épouse de l'entrepreneur est
sans effet sur les droits de ce dernier sur le bien et sur son insaisissabilité légale
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 18 mai 2022 pourvoi n° 20-22.768 cassation
Vu les articles L. 526-1 du code de commerce et 255, 3° et 4°, du code civil :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante,
le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l'entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence
principale de l'entrepreneur, à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n'est plus située dans l'immeuble appartenant aux deux
époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu'il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont
les droits naissent à l'occasion de son activité professionnelle.
5. Pour déclarer la demande du liquidateur tendant à la réalisation de l'immeuble au titre des opérations de liquidation irrecevable, l'arrêt retient
que la décision judiciaire attribuant la jouissance exclusive de la résidence de la famille à Mme [X] est sans effet sur les droits de M. [K] sur le bien et sur
son insaisissabilité légale.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

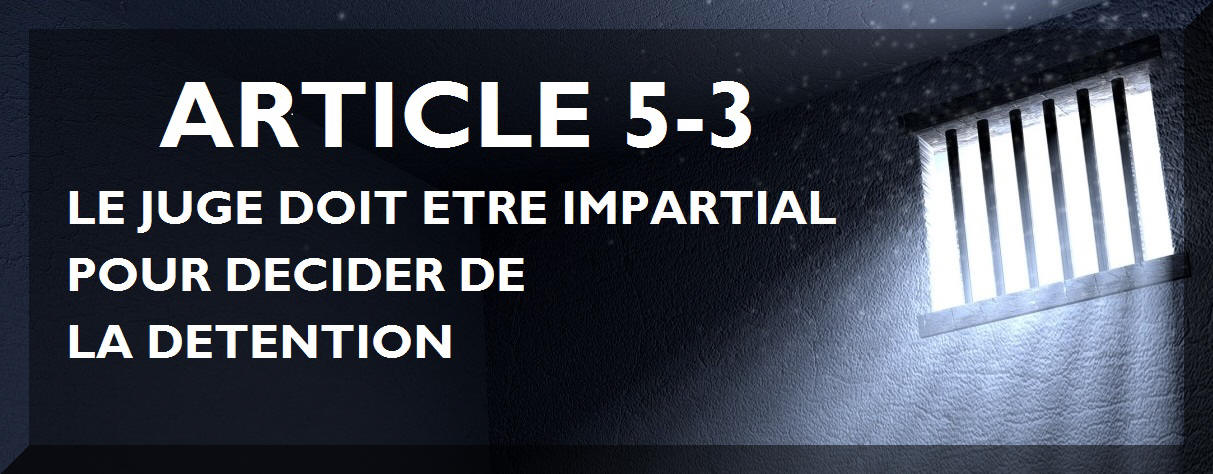

LES CINQ REQUÊTES QUI MODIFIENT LE DROIT EN FRANCE
POUR RENDRE AUX DÉBITEURS LEURS DROITS FONDAMENTAUX
Frédéric Fabre a introduit cinq requêtes devant la CEDH,
la première le 9 septembre 2014 (Rodrigues Tavares), la seconde le 30 janvier 2015 (Sabadie), la troisième en avril 2015 (Poulain), la quatrième (Nogues)
le 10 juin 2015 et la cinquième (Subtil) le 7 octobre 2016.
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites :
- L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 19 JANVIER 2017 MODIFIE LE DROIT EN FRANCE
- LA PROCÉDURE CONTRE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT DEVANT LE TGI DE PARIS
L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 19 JANVIER 2017 MODIFIE LE DROIT EN FRANCE
L'AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DE LA COUR DE CASSATION DU 13 JANVIER 2017
Ces cinq requêtes avaient créé un émoi lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de Cassation, en date du 13 janvier 2017
tenue en présence de Monsieur le Président de la CEDH. Le Premier Président de la Cour de Cassation a déclaré qu'il aurait un sentiment de honte si la France
était condamnée par la CEDH dans ces cinq affaires.
Monsieur le Procureur Général avait fait un avertissement en déclarant que parfois les membres du parquet général ne
sont pas assez écoutés. Sur ce dernier point et sur les affaires concernées, je ne peux que souscrire à sa déclaration. Dans son avis rendu à l'occasion de
l'arrêt du 16 décembre 2014 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, l'avocat général avait proposé la bonne solution soit l'arrêt immédiat des
opérations de liquidation judiciaire et l'indemnisation du délai non raisonnable.
L'ARRÊT POULAIN C. SOINNE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 19 JANVIER 2017
La requête Poulain c. France en avril 2015 a fait l'objet d'une procédure interne complète. Elle est devenue la décision de principe de la CEDH reproduite ci-dessous.
Le 19 janvier 2017 SOUS LA PRESSION DE LA CEDH, nous avons enfin obtenu un arrêt de la Cour d'Appel de Douai,
pour clore les opérations de liquidation judiciaire contre l'avis du mandataire
judiciaire, venu à la rescousse du mandataire, quelques heures avant l'audience de la Cour d'Appel.
L'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 19 janvier 2017
n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation et il est devenu définitif créant le droit en France.
Cependant, il n'est pas indemnisé du délai non raisonnable de la procédure. Il est Invité à assigner Monsieur l'agent judiciaire de l'État,
pour faute du service public de la justice.
Les trois requêtes suivantes ont subi le même sort le 23 mai 2017, sous prétexte d'une part que l'arrêt du 16 décembre 2014 de la Chambre Commerciale de la
Cour de Cassation, ouvre une voie interne d'indemnisation et que d'autre part, l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 19 janvier 2017
leur permet d'accéder au tribunal, pour obtenir la clôture la procédure de liquidation judiciaire. La cinquième requête dans laquelle le débiteur principal est décédé, a été rendue
le 8 juin 2017 par un juge unique. Les cinq décisions d'irrecevabilité sont reproduites ci-dessous.
UN AUTRE EXEMPLE DE NÉGOCIATION ENTRE LA FRANCE ET LA CEDH AU PROFIT DES PERSONNES MISES SOUS CURATELLE
IRRECEVABILITÉ DELECOLLE c. FRANCE du 25 octobre 2018 Requête n° 37646/13
Article 12 : Un
autre type de négociation entre la France et la CEDH.
Celle-ci déclare irrecevable la requête contre la requérante, alors que maîtresse de la qualification, elle pourrait requalifier au sens de l'article 8
de la convention. En contrepartie, le même jour, la secrétaire d'État Sophie Cluzel et le Premier
ministre Edouard Philippe présentent, dans le cadre d'un comité interministériel, les mesures du gouvernement en faveur des personnes handicapées. Parmi
les priorités de l'exécutif figure l'extension du droit de vote aux personnes sous tutelle, ainsi que la possibilité de se marier sans l'accord d'un juge.
La requérante poursuit le recours en qualité de concubine. Elle est reconnue par la CEDH. Le requérant qui n'a pas eu le droit de se marier est décédé.
47. Le requérant soutient que la liberté du mariage est une liberté fondamentale, garantie par
l’article 12 de la Convention et l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
57. Par ailleurs, contrairement à l’article 8, qui
énonce le droit au respect de la vie privée et familiale, et avec lequel le droit « de se marier et de fonder une famille » a des liens étroits, l’article
12 ne prévoit aucun motif admissible d’ingérence par l’État comme ceux qui peuvent être invoqués sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 8 pour autant
que l’ingérence soit « prévue par la loi » et qu’elle soit « nécessaire dans une société démocratique » pour parvenir au but légitime recherché, tel que par
exemple « la protection de la santé ou de la morale » ou « la protection des droits et libertés d’autrui ». Partant, lorsqu’elle examine une affaire sous
l’angle de l’article 12, la Cour n’applique pas les critères de « nécessité » ou de « besoin social impérieux » utilisés dans le cadre de l’article 8, mais elle
doit déterminer si, compte tenu de la marge d’appréciation de l’État,
l’ingérence litigieuse était arbitraire ou disproportionnée (Frasik, précité, § 90).
66. Compte tenu de ce qui précède, au vu des circonstances de l’espèce et de la marge d’appréciation dont disposaient les
autorités internes, la Cour estime que les limitations apportées aux droits du requérant de se marier n’ont pas restreint ou réduit ce droit d’une manière
arbitraire ou disproportionnée. Partant, il n’y a pas eu de violation de l’article 12 de la Convention.



LA PROCÉDURE CONTRE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT DEVANT LE TGI DE PARIS
Les cinq requérants ont accepté de saisir le TGI de Paris, courant octobre 2017 :
PATRICE POULAIN
- Les conclusions de Patrice Poulain devant le TGI de Paris sont lisibles ici au format PDF.
- Les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'État contre Patrice Poulain sont lisibles ici au format PDF.
- L'arrêt du TGI de Paris en date du 29 octobre 2018 répare et indemnise le
délai non raisonnable de la liquidation judiciaire personnelle de Monsieur Poulain. Il bénéficie de l'exécution provisoire et ne fera pas appel.
NOGUES
- Le 26 avril 2017, le
Tribunal de Commerce d'Annecy prononce la clôture de la liquidation judiciaire, alors que des procédures sont encore en cours.
- Les conclusions de Christian Nogues devant le TGI de Paris sont lisibles ici au format PDF.
- Les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'État contre Christian Nogues sont lisibles ici au format PDF.
- L'arrêt du TGI de Paris en date du 29 octobre 2018
refuse de réparer le délai non raisonnable de la liquidation judiciaire de la SARL de Monsieur Nogues.
La procédure est en appel.
GAETAN SABADIE
- Le 24 novembre 2015, le TGI de Carcassonne prononce la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
- Les conclusions de Gaetan Sabadie devant le TGI de Paris sont lisibles ici au format PDF.
- Les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'État contre Gaetan Sabadie sont lisibles ici au format PDF.
- L'arrêt du TGI de Paris en date du 29 octobre 2018, répare et indemnise le délai non raisonnable de la liquidation
judiciaire personnelle de Monsieur Sabadie. Il bénéficie de l'exécution provisoire.
TAVARES
- Les conclusions de Joachim Tavares pour mettre fin en l'état, à la procédure de liquidation judiciaire et pour obtenir une indemnisation du délai non raisonnable
de la liquidation judiciaire devant le TGI de Paris sont lisibles ici au format PDF.
- Les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'État devant le TGI de Paris sont lisibles ici au format PDF.
- Le 18 juillet 2018, le Tribunal de Commerce d'Annecy
a rendu une décision mettant fin en l'état à la procédure de liquidation judiciaire. Le requérant sauve sa maison et un appartement pour pouvoir y finir
sa vie et les transmettre à ses enfants.
- L'arrêt du TGI de Paris en date du 29 octobre 2018, répare et indemnise le délai non raisonnable de la liquidation
judiciaire personnelle de Monsieur Tavares. Il bénéficie de l'exécution
provisoire et ne fera pas appel. L'Etat français n'a pas fait appel.
SUBTIL
- Les conclusions des consorts Subtil devant le TGI de Paris
pour demander l'arrêt en l'état d'une procédure de liquidation judiciaire et une
expertise pour calculer le préjudice subi par le délai non raisonnable, sont lisibles ici au format PDF.
- Les conclusions en réponse de l'Agent Judiciaire de l'État sont lisibles ici au format PDF.
- L'arrêt du TGI de Paris en date du 29 octobre 2018, a préparé l'affaire pour qu'elle soit examinée par la Cour
d'Appel de Paris. Cette affaire est grave, plusieurs dizaines de millions sont en jeu du fait de la faute lourde du service public de la justice. La procédure est en appel.
- Le 8 juin 2021, à la lecture des conclusions en appel,
la Cour d'Appel de Paris rejette la demande réparation.
La famille Subtil saisit la cour de cassation dernière étape avant les recours internationaux.



LES CINQ DÉCISIONS DE LA CEDH
Patrice POULAIN Irrecevabilité du 13 avril 2017 Requête no 16470/15 contre la France
Le débiteur dispose d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure de liquidation judiciaire.
Sous la pression de la CEDH, le requérant a pu obtenir la clôture de la procédure des opérations de liquidation judiciaire,
par un arrêt du 19 janvier 2017, rendu par la Cour d'Appel de Douai.
Il doit maintenant saisir le TGI de Paris contre Monsieur l'agent judiciaire de l'État, pour
demander réparation du délai non raisonnable de la procédure de liquidation judiciaire, déjà reconnu.
LA DÉCISION DE LA CEDH :
1. Le requérant, M. Patrice Poulain, est un ressortissant français né en 1937 et résidant à
Dainville. Il est représenté devant la Cour par M.
F. Fabre. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des
affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 6 décembre 1995, le requérant, éleveur de chevaux, fit l’objet d’une procédure de
redressement judiciaire.
4. Le 7 février
1996, le tribunal de grande instance d’Arras prononça la liquidation judiciaire
du requérant. Le 11 avril 1996, les chevaux de l’exploitation du requérant
furent vendus.
5. Le 7
septembre 2006, le requérant se vit communiquer un tableau des créances
déclarées pour un montant de 149 444,89 euros (EUR). Après contestation
judiciaire de plusieurs créances, le montant des créances définitivement admises
s’éleva à 80 651,51 EUR.
6. Le juge
commissaire statua par ordonnances des 23 mars 2009, 30 juin 2010, 28 octobre
2011, 6 mars 2012, 26 avril 2012, 19 octobre 2012 et 31 octobre 2012. En outre,
par deux ordonnances du tribunal de grande instance d’Arras en date des 13
janvier 2009 et 10 juillet 2012, la vente de deux parcelles de terrain fut
autorisée.
7. Le tribunal
de grande instance d’Arras convoqua le requérant, en sa qualité de débiteur, et
le liquidateur judiciaire pour l’audience du 9 juillet 2014, afin de vérifier
l’avancement des opérations et d’examiner la clôture éventuelle de la procédure.
8. Lors de cette
audience, le requérant fut représenté par un tiers. L’affaire fut renvoyée à
l’audience du 10 décembre 2014 en vue d’un nouvel examen de la question de la
clôture de la procédure.
9. Par un
courrier adressé le 1er
décembre 2014, le requérant sollicita le renvoi à une « date ultérieure en 2015
», compte tenu de son état de santé.
10. Le 10
décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Arras renvoya l’affaire à
l’audience du 11 mars 2015.
11. Le 11 mars
2015, le requérant comparut seul, sans son conseil, expliquant que celui-ci,
n’avait pas été prévenu de la date d’audience. Le liquidateur judiciaire
sollicita la prorogation du délai de clôture, compte tenu du passif restant à
régler et de l’actif dont disposait le requérant. L’affaire fit l’objet d’un
nouveau renvoi, afin de permettre au requérant d’être assisté de son conseil.
12. Le 12 mars
2015, le conseil du requérant fut convoqué pour l’audience du 8 avril 2015 par
courrier recommandé, l’accusé de réception ayant été signé le 14 mars. Le
requérant fut convoqué le même jour.
13. Le 8 avril
2015, ni le requérant ni son conseil ne se présentèrent. Dans ces conditions et
compte tenu des multiples renvois déjà accordés dans ce dossier, l’examen de
l’affaire fut maintenu. Le liquidateur judiciaire confirma sa demande de
prorogation du délai de clôture, en se prévalant d’un recouvrement en cours et
en expliquant que le requérant, représenté par sa fille, avait perçu une somme
de 29 765 EUR courant 2014 à la suite de la signature d’un protocole d’accord,
montant qui lui avait été dissimulé alors qu’il aurait dû transiter par lui.
14. Par un
jugement en date du 24 avril 2015, le tribunal de grande instance d’Arras
prorogea le délai du liquidateur judiciaire pour achever les opérations de
liquidation judiciaire, cette décision valant convocation à l’audience du 14
octobre 2015.
15. Le 26
novembre 2015, le tribunal prorogea la date de clôture de la liquidation
judiciaire pour une période de six mois, afin de recueillir les observations du
requérant.
16. Le 28
novembre 2016, la juge déléguée par le premier président de la cour d’appel de
Douai rendit une ordonnance de taxe pour le mandataire judiciaire, dans le cadre
de laquelle elle rejeta également des demandes d’annulation soumises par le
requérant.
17. Par un arrêt
du 19 janvier 2017, statuant sur l’appel du requérant à l’encontre du jugement
du 26 novembre 2015, la cour d’appel de Douai ordonna la clôture des opérations
de la procédure de liquidation judiciaire. S’agissant de l’argument du requérant
relatif à la durée excessive de la procédure et à la violation de son droit de
propriété, la cour d’appel se référa expressément aux articles 6 et 13 de la
Convention, ainsi qu’à l’article 1 du Protocole no
1, souligna notamment qu’« en droit français, l’article L. 141-1 du code de
l’organisation judiciaire permet d’engager la responsabilité de l’État en raison
de la durée excessive de la procédure, action en réparation que le débiteur en
liquidation judiciaire peut exercer au titre de ses droits propres. »
B. Le droit
interne pertinent
18. L’article L.
643-9 du code de commerce tel que créé par la loi no
2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est ainsi libellé :
« Dans le
jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le
délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la
clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger
le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il
n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes
suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des
opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de
l’insuffisance de l’actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée
par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal est
saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il
peut se saisir d’office. À l’expiration d’un délai de deux ans à compter du
jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le
tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan
de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir
constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »
19. L’article L.
141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ) se lit ainsi :
« L’État est
tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de
la justice.
Sauf
dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute
lourde ou par un déni de justice. »
20. Dans un
arrêt du 12 juillet 2004 (Cass. Com., 12 juillet 2004, Bull. IV, no
154), la Cour de cassation a considéré que l’action en responsabilité dirigée
par un débiteur en liquidation judiciaire contre l’État, qui tend non à
sanctionner une atteinte personnelle à ses droits, mais à obtenir la réparation
d’un préjudice résultant d’une faute lourde qu’aurait commise l’État sur le
fondement de l’article L. 141-1 (alors L. 781-1) du code de l’organisation
judiciaire, revêt un caractère patrimonial susceptible d’affecter les droits des
créanciers. Elle en a conclu que le débiteur ne pouvait exercer cette action.
21. Toutefois,
par un arrêt du 16 décembre 2014, tirant les conséquences de l’arrêt
Tetu c. France (no
60983/09, 22 septembre 2011), la chambre commerciale de la Cour de cassation
a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que le débiteur à la
liquidation peut désormais agir sur le fondement de l’article L. 141-1 du COJ,
au titre de ses droits propres, pour se plaindre de la durée de la procédure de
liquidation (Cass. Com., 16 décembre 2014, Bull. IV, no
187). Son arrêt, notamment diffusé le jour même sur le site internet de la Cour
de cassation et commenté par la doctrine dès le mois de janvier 2015 (F.
Pérochon, « Non à la clôture pour durée excessive de la procédure », Lettre
d’actualité des Procédures collectives civiles et commerciales, janvier 2015, no
1, et C. Lebel, « Durée excessive d’une procédure de liquidation », La Semaine
Juridique Entreprise et Affaires, 15 janvier 2015, no
3, 1010), est motivé comme suit :
« Vu l’article
L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet
2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er
du Protocole no
1 additionnel à cette Convention ;
(...) lorsqu’il
existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les
créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai
raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et
d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de
liquidation des biens mais lui ouvre l’action en réparation prévue à l’article
L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’il peut exercer au titre de
ses droits propres ; (...) »
GRIEF
22. Invoquant
l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de la
procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
EN DROIT
23. Le requérant
allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable », tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. Les
dispositions pertinentes de cet article sont ainsi libellées :
« Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) »
24. Le
Gouvernement soulève l’irrecevabilité de ce grief sur le fondement de l’article
35 § 1 de la Convention, au motif du non-épuisement des voies de recours
internes, le requérant n’ayant pas exercé l’action spécialement prévue par
l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il souligne que ce
recours est ouvert au requérant, le dessaisissement du débiteur soumis à une
procédure collective n’empêchant dorénavant plus l’intéressé d’engager cette
action en responsabilité, compte tenu du revirement de jurisprudence opéré par
la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2014. Il précise que cet
arrêt était connu et diffusé avant l’introduction de la requête devant la Cour,
puisqu’il avait été publié sur le site internet de la Cour de cassation le
jour-même, puis fait l’objet de commentaires dans des revues juridiques dès le
mois de janvier 2015. Il ajoute que dès le prononcé de l’arrêt
Tetu, des juges du fond
avaient déjà jugé que l’action du débiteur devant le juge indemnitaire en raison
de la durée excessive de la procédure devait être jugée recevable (tribunal de
grande instance de Paris, jugements des 12 septembre 2012, 16 octobre et 18
décembre 2013, respectivement nos
RG 10/17539, 11/03426 et 11/17828 ; cour d’appel de Rouen, 19 février 2014, no
RG 13/00934).
25. Le requérant
indique que, selon lui, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de
cassation du 16 décembre 2014 ne semble pas répondre à la jurisprudence de la
Cour en matière de délai raisonnable. Quant aux décisions des juges du fond
invoquées par le gouvernement défendeur, il estime qu’elles sont incertaines et
non prévisibles. Il en déduit qu’un recours fondé sur l’article L. 141-1 du COJ
ne peut lui être opposé.
26. La Cour
rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être
saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. À cet égard, elle
souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes
l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États
contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot
c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no
200, et, plus récemment, Colonna c. France
(déc.), no
4213/13, 15 novembre 2016).
27. Elle
rappelle également qu’il existe un recours fondé sur l’article L. 141-1 du COJ
pour engager la responsabilité de l’État en raison de la durée excessive de la
procédure (paragraphe 19 ci-dessus). Dans une affaire similaire, elle avait
cependant relevé que le droit interne empêchait le débiteur soumis à une
liquidation judiciaire d’engager ce type d’action, celle-ci revêtant un
caractère patrimonial susceptible d’affecter les droits des créanciers (Tetu
c. France, précité, § 69).
28. Or, la Cour
constate que la chambre commerciale de la Cour de cassation, tirant les
conséquences de l’arrêt Tetu
(précité), a opéré un revirement de jurisprudence. Dans un arrêt du 16 décembre
2014, elle a en effet jugé que le débiteur à la liquidation pouvait désormais
agir sur le fondement de l’article L. 141-1 du COJ, au titre de ses droits
propres, pour se plaindre de la durée de la procédure de liquidation (paragraphe 21 ci‑dessus).
29. S’agissant
de la date à laquelle en droit interne ce recours est devenu effectif au sens de
la Convention, mais aussi de la date de prise de « connaissance de manière
effective » de ce recours par le justiciable, la Cour rappelle qu’il peut
correspondre à une date ultérieure à l’adoption de l’arrêt, en fonction des
circonstances, en particulier de la publicité dont ladite décision a fait
l’objet (Broca et Texier-Micault c. France,
nos
27928/02 et
31694/02, § 20, 21 octobre 2003). En l’espèce, elle relève que l’arrêt du 16
décembre 2014 a été diffusé le jour même sur le site internet de la Cour de
cassation, avant d’être commenté par la doctrine dès le mois de janvier 2015
(paragraphe 21 ci-dessus). La Cour juge dès lors raisonnable de retenir que cet
arrêt ne pouvait plus être ignoré du public après le mois de janvier 2015. Tel
était notamment le cas du requérant, à la date d’introduction de sa requête, le 28 mars 2015.
30. Dans ces
conditions, la Cour estime que le requérant dispose d’un recours effectif pour
faire redresser le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et que, faute
de l’avoir exercé, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être accueillie.
31. Il s’ensuit
que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
RODRIGUES TAVARES contre la France du 23 mai 2017 requête n° 62019/14
La CEDH s'est écartée de sa jurisprudence dans
la requête déposée le 29 septembre 2014. Sous sa pression, l'artisan a pu sauver sa maison familiale.
"Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «
délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, et il ne dispose pas d’un recours effectif, faute de pouvoir exercer une action en responsabilité contre l’État.
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour rappelle avoir jugé qu’à la suite d’un arrêt de la chambre commerciale
de la Cour de cassation, en date du 16 décembre 2014, qui a opéré un revirement
de jurisprudence en jugeant qu’un débiteur à la liquidation peut désormais agir
sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire au
titre de ses droits propres pour se plaindre de la durée de la procédure de
liquidation, les requérants disposent d’un recours effectif pour faire redresser
le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et ce depuis janvier 2015 (Poulain c. France (déc.), n
o
16470/15, 21 mars 2017). Or, la Cour rappelle également que si l’épuisement
des voies de recours internes s’apprécie en règle générale à la date
d’introduction de la requête devant la Cour (Baumann
c. France, no33592/96,
§ 47, CEDH 2001-V (extraits)), cette règle ne va pas sans exceptions (voir,
parmi beaucoup d’autres, Ivan Todorov c. Bulgarie,
no
71545/11, § 49, 19 janvier 2017), qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce, en particulier s’agissant de la
durée excessive des procédures judiciaires (cf., notamment,
Brusco c. Italie (déc.),
no
69789/01, CEDH 2001-IX, Nogolica c. Croatie,
no
77784/01, 5 septembre 2002, et Grzincic c.
Slovénie, no
26867/02, 3 mai 2007). Partant, et compte tenu du fait que la possibilité d’exercer le nouveau recours existe en l’espèce, la Cour conclut que le
requérant est tenu par l’article 35 § 1 de la Convention d’agir sur le fondement de l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes,
et que celui tiré de l’article 13 doit l’être comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention."
Sabadie C. France du 23 mai 2017 requête n° 7115/15 déposée le 2 février 2015
Sous la pression de la CEDH,
le requérant a pu obtenir, le 24 novembre 2015, la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire devant le TGI de Carcassonne. Il doit maintenant saisir
le TGI de Paris contre Monsieur l'agent judiciaire de l'État, pour demander
réparation du délai non raisonnable de la procédure.
Pour rejeter la requête, la CEDH a fait une exception à sa jurisprudence habituelle. Elle a considéré non pas la date
d'envoi du 30 janvier 2015 mais la date de réception du 2 février 2015 pour dire que la requête n'a pas été envoyée en janvier 2015.
LA DÉCISION DE LA CEDH :
"Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, et
il ne dispose pas d’un recours effectif, faute de pouvoir exercer une action en responsabilité contre l’État.
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour rappelle avoir jugé qu’à la suite d’un arrêt de la chambre commerciale
de la Cour de cassation, en date du 16 décembre 2014, qui a opéré un revirement
de jurisprudence en jugeant qu’un débiteur à la liquidation peut désormais agir
sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire au
titre de ses droits propres pour se plaindre de la durée de la procédure de
liquidation, les requérants disposent d’un recours effectif pour faire redresser
le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et ce depuis janvier 2015 (Poulain
c. France (déc.), no
16470/15, 21 mars 2017).
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, et que celui tiré de l’article 13
doit l’être comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention.
Nogues C. France du 23 mai 2017 requête 29790/15, envoyée le 10 juin 2015
Dans cette l'affaire, la CEDH a considéré que les opérations de liquidation judiciaire d'une SARL permet à son gérant d'agir devant elle, en sa qualité de caution.
Sous la pression de la CEDH, le requérant a pu obtenir, le 25 avril 2017, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devant le Tribunal de Commerce d'Annecy.
La CEDH a décrit les faits particulièrement graves, avant de rejeter la requête, pour non épuisement des voies de recours. Le requérant
doit saisir le TGI de Paris contre Monsieur l'agent judiciaire de l'État, pour demander réparation du délai non raisonnable de la procédure de liquidation judiciaire.
LA DÉCISION DE LA CEDH :
"Le requérant, M. Christian Nogues,
est un ressortissant français né en 1956 et résidant à Seynod. Il a été
représenté devant la Cour par M. F. Fabre, qui réside à Saint-Geniès des
Mourgues. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par
son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des
Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le 10 juin 1991, le requérant créa avec son épouse une société dont il est le
gérant.
Le 12 juillet 2002, il déposa le bilan de sa société.
Le 16 juillet 2002, la société fut admise au régime simplifié de redressement
judiciaire.
Par un jugement du 16 juillet 2002, le tribunal de grande instance d’Annecy
ouvrit une procédure de redressement judiciaire.
Le 16 décembre 2003, la société fut mise en liquidation judiciaire et un
liquidateur judiciaire fut désigné.
Le 20 janvier 2004, le juge commissaire admit une créance bancaire déclarée par
la caisse de Crédit mutuel d’Annecy Bonlieu pour un montant de 76 180,71 euros
(EUR) à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76 196,33 EUR à titre
chirographaire (compte courant débiteur).
Par un arrêt du 18 janvier 2005, la cour d’appel de Chambéry confirma
partiellement l’ordonnance du 20 janvier 2004 en ce qu’elle avait admis la
créance à titre privilégié de 76 180,71 EUR. Elle rejeta la déclaration de la
seconde créance.
Le 6 juin 2006, le tribunal de grande instance d’Annecy condamna le requérant,
en sa qualité de caution solidaire de la société, à verser à la banque les
sommes de 45 375 EUR au titre du prêt professionnel et 56 756,79 EUR au titre du
solde débiteur du compte courant. À une date inconnue, la cour d’appel de
Chambéry confirma ce jugement.
Le 19 juin 2007, le requérant et le liquidateur introduisirent des recours en
révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005. Par des arrêts respectivement rendus
les 12 février 2008 et 5 avril 2012, les cours d’appel de Chambéry et de
Grenoble rejetèrent ces recours.
Le 10 juin 2009, le tribunal de commerce d’Annecy rendit une ordonnance
concernant une substitution de créance. En juin 2011, la Cour de cassation
annula cette ordonnance.
Le 24 novembre 2010, le requérant et le liquidateur formèrent une action en
inscription de faux contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la cour d’appel
de Chambéry.
Les 30 novembre et 2 décembre 2010, ils assignèrent l’agent judiciaire du Trésor
et deux agences du crédit mutuel pour contester l’arrêt rendu le 18 janvier 2005
par la cour d’appel de Chambéry, en particulier pour le faire qualifier de faux
en écriture publique.
Le 19 février 2014 le requérant forma une requête en suspicion légitime contre
la formation de jugement chargée d’examiner sa demande d’inscription de faux. Le
18 juin 2014, la cour d’appel de Paris rejeta cette requête.
Le 8 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris rejeta la requête en
inscription de faux formée le 24 novembre 2010.
La procédure de liquidation judiciaire est toujours pendante.
EN DROIT
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «
délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, et il ne
dispose pas d’un recours effectif, faute de pouvoir exercer une action en
responsabilité contre l’État.
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour rappelle avoir jugé qu’à la suite d’un arrêt de la chambre commerciale
de la Cour de cassation, en date du 16 décembre 2014, qui a opéré un revirement
de jurisprudence en jugeant qu’un débiteur à la liquidation peut désormais agir
sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire au
titre de ses droits propres pour se plaindre de la durée de la procédure de
liquidation, les requérants disposent d’un recours effectif pour faire redresser
le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et ce depuis janvier 2015 (Poulain
c. France (déc.), no
16470/15, 21 mars 2017).
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 doit être rejeté pour
non‑épuisement des voies de recours internes, et que celui tiré de l’article 13
doit l’être comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention".
SUBTIL C. France décision du 8 juin 2017 Requête n° 59457/16
La décision Subtil est une décision du juge unique. Depuis juin 2017, les décisions du juge unique ne sont plus rendues par lettre type mais par lettre motivée.
En l'espèce, la CEDH a fait référence directement à l'arrêt Poulain contre France ci-dessous.
La CEDH s'est écartée de sa jurisprudence habituelle car la requête a été introduite le 7 octobre 2016 AVANT ET NON APRÈS l'arrêt de la
Cour d'Appel de Douai du 19 janvier 2017 qui a reconnu définitivement pour la
première fois en France qu'un débiteur peut réclamer la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
La décision de la CEDH Subtil c. France du 8 juin 2017 est lisible au format PDF.
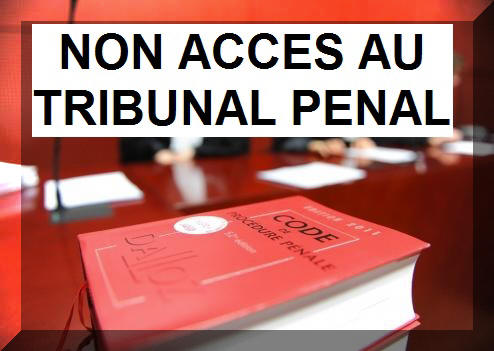


ARRÊT HISTORIQUE MAIS INSUFFISANT POUR CHANGER LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
TETU C. FRANCE du 22 SEPTEMBRE 2011 Requête 60983/09
Les durées scandaleuses des liquidations judiciaires des entreprises en France
35. Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant. Il soutient que la
durée de la procédure litigieuse n’est pas excessive. Selon lui, l’affaire présentait une complexité juridique, en raison de la nature même de la
procédure collective et de la rigueur de la législation applicable. Avant
l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le requérant se
trouvait en indivision avec des membres de sa famille, dans le cadre de la
succession d’une parente décédée. Le Gouvernement souligne que ce n’est que
le 6 décembre 1996 qu’un état liquidatif de la succession a été déposé et
que le liquidateur n’a pu en prendre connaissance que le 4 février 1997.
Selon lui, les difficultés liées au règlement de la succession à laquelle le
requérant était partie en tant qu’héritier ont eu des incidences sur la
durée de la procédure en liquidation.
36. Le Gouvernement soutient que le requérant a contribué à allonger la
durée de la procédure, en s’abstenant de toute diligence lors de la période
d’observation et en se désintéressant de la procédure de liquidation
judiciaire. Il souligne que le dessaisissement du débiteur prévu par la loi
de 1985 ne le prive pas de la possibilité de faire valoir ses droits et
d’être un véritable acteur de la procédure. Le requérant aurait pu
solliciter lui-même la clôture de la procédure collective (Cass. Com, 5 mars
2002, no 98-226465). Le Gouvernement ajoute que le liquidateur
lui a vainement proposé la vente amiable de ses biens et que, devant
l’inertie du requérant, il a requis le notaire afin de rechercher des
acquéreurs et de vendre les biens dans les meilleures conditions.
37. Il ajoute que les juridictions ont pleinement exercé leur mission de
contrôle de la procédure. Le Gouvernement explique que lorsqu’une procédure
de liquidation judiciaire est ouverte, la plupart des diligences sont
accomplies par le liquidateur ; la loi de 1985 n’offre au juge commissaire
qu’un rôle résiduel dans la procédure afin de surveiller les opérations et
la gestion de la liquidation judiciaire. Il souligne que le requérant n’a
jamais signalé aux autorités judiciaires l’existence de difficultés du fait
du liquidateur.
38. Concernant la complexité de l’affaire, le requérant fait valoir que
Me D., agissant comme représentant des créanciers puis comme
liquidateur, n’a pas saisi le notaire chargé de la succession d’I.M. pour
faire accélérer la procédure. Ayant été dessaisi de ses biens, il n’aurait
pu prendre une quelconque initiative procédurale. Il ajoute que l’état
liquidatif a été déposé le 6 décembre 1996 et que ce n’est que le 17
septembre 1998 que le juge commissaire a autorisé la vente de ses parcelles.
La procédure collective serait ensuite retombée en inertie. Le requérant
rappelle que le dessaisissement du débiteur lui interdit toute action
procédurale et que c’est le liquidateur qui le représentait pendant les
opérations de liquidation successorale et qui a requis le juge commissaire
d’ordonner ensuite la vente. Il ajoute qu’il avait bien tenté de s’y opposer
et d’obtenir une expertise, mais que sa demande a été écartée le 6 novembre
2008.
39. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une
procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de
l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes
ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup
d’autres,
Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH
2000-VII).
40. En l’espèce, la Cour constate que le Gouvernement ne conteste pas
que la procédure de liquidation judiciaire est toujours pendante à ce jour.
Ayant débuté en juillet 1990, elle dure donc depuis plus de vingt ans.
41. La Cour admet que les opérations de liquidation et de partage de la
succession de la parente du requérant I.M. ont pu retarder la réalisation
des actifs du requérant et la procédure de liquidation judiciaire.
42. S’agissant du manque de diligence reproché au requérant, elle
constate que celui-ci s’est montré peu coopératif avec Me D. à
certaines périodes de la procédure de redressement et de liquidation
judiciaires, notamment, au moment où celui-ci cherchait des acquéreurs
potentiels pour la vente des biens du requérant. Cependant, en dehors de ces
périodes, le Gouvernement ne démontre pas en quoi le requérant aurait, par
son comportement, retardé la procédure entre le 11 octobre 1990, date du
prononcé de la liquidation judiciaire, et aujourd’hui. La Cour relève par
ailleurs qu’aux termes de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le
requérant n’est pas, en tant que débiteur, partie à la procédure de
liquidation judiciaire (paragraphe 30 ci-dessus). En effet, pendant toute la
durée de la procédure, les droits et actions du débiteur concernant son
patrimoine sont exercés par le liquidateur, mandataire de justice désigné
par le juge. A cet égard, la Cour note que le Gouvernement reconnaît que la
plupart des diligences sont accomplies par le liquidateur. Elle constate en
outre que le juge commissaire n’a pas été saisi d’éventuelles difficultés
rencontrées avec le débiteur. La Cour relève enfin que le Gouvernement ne
donne pas d’explication sur les périodes d’inactivité judiciaire, se
limitant à indiquer que « les juridictions ont pleinement exercé leur
mission de contrôle de la procédure » et à produire une liste des courriers
établis par le liquidateur.
43. La Cour rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats contractants
d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions
puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur
les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (Caillot c. France, no 36932/97, § 27, 4 juin 1999).
44. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et des
affaires similaires où la Cour a conclu au non-respect du délai raisonnable,
et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime
que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la
condition du délai raisonnable (à titre de comparaison, voir, par exemple,
Bertolini c. Italie, no 14448/03, 18 décembre 2007,
Carbè et autres c. Italie, no 13697/04, 23 juin 2009, et
Cavalleri c. Italie, no 30408/03, 26 mai 2009, où les
procédures de faillite ont duré plus de seize ans).
45. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
65. Le requérant soutient que le droit interne ne lui permet pas
d’obtenir réparation du préjudice que cause la violation de son droit au
jugement dans un délai raisonnable.
66. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour et sur un arrêt du 2 mai
2006 de la Cour de justice des Communautés européennes, le Gouvernement fait
valoir que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et que le
dessaisissement du débiteur soumis à une procédure collective est consacré
comme un principe communautaire des procédures d’insolvabilité. Il ne
conteste pas que l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ne permet pas au
débiteur en liquidation judiciaire d’engager la responsabilité de l’Etat sur
le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et
constitue ainsi une limitation au droit d’accès au tribunal. Toutefois, une
telle limitation apparaît proportionnée au regard du but légitime poursuivi.
Le Gouvernement explique que l’impossibilité pour le débiteur d’engager une
telle action se justifie par le fait qu’en cas de condamnation, le requérant
se verrait privé des sommes allouées en réparation du préjudice subi, sommes
qui seraient intégrées à la procédure de liquidation judiciaire. A cet
égard, il cite un extrait d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com., 12
juillet 2004, Bull. 2004 IV No 154 p. 168). Le Gouvernement
ajoute que le débiteur ne peut donc, provisoirement, le temps de la
procédure collective, exercer seul les droits et actions à caractère
personnel. Enfin, il fait valoir que le droit interne ne prive pas
définitivement le requérant de son recours, mais l’empêche temporairement de
l’exercer en raison de la spécificité de la procédure de liquidation judiciaire.
67. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 13
de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance
de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable. Pour être « effectif », au sens de cette disposition, un
tel recours doit permettre d’« empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou [de] fournir à l’intéressé un redressement
approprié pour toute violation s’étant déjà produite » (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 156-158, CEDH 2000-XI).
68. Eu égard à sa conclusion concernant le caractère excessif de la
durée de la procédure (paragraphe 45 ci-dessus), la Cour estime que le requérant disposait d’un « grief défendable » fondé sur la méconnaissance de
l’article 6 § 1 et que l’article 13 trouve donc à s’appliquer.
69. En l’espèce, la Cour constate qu’il existe un recours fondé sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judicaire pour engager la
responsabilité de l’Etat en raison de la durée excessive de la procédure (paragraphe 31 ci-dessus). Cependant, elle relève que le droit interne
empêche le débiteur soumis à une liquidation judiciaire d’engager ce type d’action, celle-ci revêtant un caractère patrimonial susceptible d’affecter
les droits des créanciers (paragraphes 30 et 32 ci-dessus).
70. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant, qui est en état de liquidation judiciaire depuis le 11 octobre 1990, n’a pas disposé
d’un recours effectif pour faire redresser le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention.
71. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.
MATHURIN c. FRANCE requête 63648/12 du 5 juin 2014
Les négociations préalables ont
échoué. Il a fallu la menace de l'arrêt concernant le scandale des procédures en redressement judiciaires pour que l'Etat accepte de payer.
9. Invoquant l’article 6 de la
Convention, le requérant dénonce la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Sous l’angle des articles 6 et 13 de la
Convention, il se plaint – en tant que débiteur en liquidation judiciaire – de
l’interdiction qui lui est faite d’agir en justice pour engager la
responsabilité de l’État en raison de la durée excessive de la procédure.
10. La Cour constate d’emblée que
la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de
la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
11. La Cour relève qu’après
l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a, par une lettre
du 15 novembre 2013, informé la Cour qu’il envisageait de formuler une
déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il
a, en outre, invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article
37 de la Convention.
12. La déclaration était ainsi
libellée :
« Je soussignée, Nathalie Ancel,
agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de
verser à M. Jacques Mathurin la somme globale de 15.300 euros (quinze mille
trois cents euros), au titre de la requête enregistrée sous le no
63648/12.
Cette somme ne sera soumise à aucun
impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les
trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le
fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement
définitif de la cause.
Le Gouvernement reconnaît, qu’en
l’espèce, d’une part, la durée de la procédure de liquidation judiciaire dont le
requérant, débiteur, a été l’objet a été excessive au regard des exigences du
délai raisonnable posées par l’article 6 § 1 de la Convention et, d’autre part,
que l’impossibilité pour le requérant d’exercer une action en réparation du
dommage causé par la durée de la procédure de liquidation a porté atteinte à ses
droits garantis par les articles 6§1 et 13 de la Convention. »
13. Par une lettre du 2 décembre
2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes
de la déclaration unilatérale. Elle a rappelé que, malgré la reconnaissance du
Gouvernement de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la
procédure de liquidation judiciaire litigieuse n’était toujours pas clôturée. En
outre, le requérant considère que la somme de 15 300 euros (EUR) proposée par le
Gouvernement ne couvre ni son préjudice moral, ni son préjudice matériel.
14. La Cour rappelle qu’en vertu
de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut
décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une
des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet
article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la
Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la
requête ».
15. La Cour rappelle aussi que,
dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle
en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du
gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
16. A cette fin, la Cour doit
examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa
jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar
(Tahsin Acar c.
Turquie (question préliminaire) [GC],
no 26307/95,
§§ 75-77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c.
Pologne (déc.) no 11602/02,
26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne
(déc.) no 28953/03,
18 septembre 2007). Parmi les facteurs à prendre en considération à cet égard
figurent notamment « la nature des griefs formulés, le point de savoir si les
questions soulevées sont analogues à celles déjà tranchées par la Cour dans des
affaires précédentes » ainsi que le point de savoir si le Gouvernement a, dans
sa déclaration, reconnu l’existence des violations alléguées et proposé des
modalités de redressement appropriées (Tahsin
Acar, précité, § 76).
17. En l’espèce, la Cour prend
acte de la déclaration formelle du Gouvernement. Elle note qu’elle s’est déjà
prononcée sur la question de la durée raisonnable dans une affaire de
liquidation judiciaire ainsi que sur celle de l’existence d’un recours effectif
pour un requérant en état de liquidation judiciaire pour faire redresser le
grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (Tetu
c. France, no
60983/09, §§ 33-45 et §§ 62-71, 22 septembre 2011).
18. La Cour relève que le
Gouvernement français a, dans sa déclaration, reconnu sans équivoque qu’en
l’espèce, la durée de la procédure de liquidation judiciaire était excessive au
regard des exigences de délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention et que l’impossibilité pour le requérant d’exercer une action en
réparation du dommage causé par la durée de la procédure de liquidation
judiciaire avait porté atteinte à ses droits garantis par les articles 6 § 1 et
13. Pour y remédier, le Gouvernement a proposé de verser la somme de 15 300 EUR
au requérant. La Cour considère, au regard des circonstances de l’espèce et de
la jurisprudence en la matière, qu’il s’agit d’une somme d’un montant approprié.
19. Compte tenu de ce qui précède,
la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a lieu dès lors de rayer la requête du rôle. La somme de 15 300 EUR devra
être versée dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention européenne des droits
de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra
verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de
la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
20. Enfin, la Cour souligne que,
dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration
unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article
37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie(déc.), nº
18369/07, 4 mars 2008).
LA PROTECTION LIMITEE DES DEBITEURS DANS LE DROIT FRANCAIS
LA LOI ET LA JURISPRUDENCE PERTINENTE DE LA COUR DE CASSATION FRANÇAISE
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites :
- LA CLÔTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
- LES POUVOIRS DU FAILLI A TITRE PERSONNEL MALGRÉ SA MORT PATRIMONIALE : DROITS PROPRES ET DROITS PATRIMONIAUX
- LA PROTECTION DES DOMICILES ET DES BIENS IMMOBILIERS DU DEBITEUR
- LA RESPONSABILITE DU DEBITEUR POUR CAUSE DE FAUTE DE GESTION
- LA DECLARATION DE CREANCE ET SA CONTESTATION
LA CLÔTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
La saisine du tribunal se fait par voie de requête
Article L643-9 du code de commerce
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal
fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si
la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de
sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite
des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de
l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est
disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels
la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant
un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de
répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque
cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le
ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai
de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut
également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure
qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
LES AUTORITES JUDICIAIRES ONT UN DEVOIR DE SURVEILLANCE DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
Article L 641-7 du Code de Commerce
Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois,
le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Le juge-commissaire et le ministère public peuvent à toute
époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
CE DEVOIR DE SURVEILLANCE EST NECESSAIRE CAR LE DEBITEUR PERD SES DROITS PATRIMONIAUX
Alinéa 1 de l'Article L 641-9 du Code de Commerce
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation
judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le
débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux
qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire
n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine
sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
JURISPRUDENCE
Cour de cassation chambre commerciale et financière arrêt du 24 mai 2023 pourvoi n° 21-22.398 cassation
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce :
6. Le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens,
dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur,
conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision
fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
7. Pour déclarer irrecevable l'intervention de la société CAP, l'arrêt énonce
que l'instance n'est plus en cours si les débats ont déjà eu lieu avant le
jugement d'ouverture, puis retient que si le tribunal des affaires de sécurité
sociale a été saisi d'une opposition à la contrainte formée par la société CAP
alors qu'elle était in bonis, l'instance n'était plus en cours à la date du
prononcé de la liquidation judiciaire puisque les débats étaient clos. Il en
déduit que, compte tenu de sa liquidation judiciaire, la société CAP est
irrecevable à se défendre et doit être représentée par son liquidateur.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société
CAP avait été mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2019, soit après que
l'URSSAF avait relevé appel du jugement la condamnant à paiement, de sorte que
l'instance était en cours et que la société CAP avait un droit propre à y défendre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et 125
du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est
irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que
cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office
par le juge. Cependant, celle-ci peut être régularisée par l'intervention du
liquidateur dans le délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile
Cour de cassation chambre commerciale
et financière arrêt du 18 janvier 2023 pourvoi n° 21-17.581 rejet
10. Il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et
125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire
est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et
que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée
d'office par le juge. Cependant, celle-ci peut être régularisée par
l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel, conformément aux
dispositions de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.
11. Même lorsqu'il est d'ordre public, le moyen invoqué pour la première fois
devant la Cour de cassation n'est recevable que s'il résulte d'un fait dont la
cour d'appel a été mise à même d'avoir connaissance.
12. Selon les énonciations de l'arrêt, la société débitrice Bâti GSB, après sa
mise en liquidation judiciaire, a relevé appel, seule, du jugement entrepris,
puis son liquidateur est intervenu volontairement à l'instance d'appel.
13. En l'état des conclusions et pièces soumises à la cour d'appel par le seul
liquidateur, eu égard à l'irrecevabilité des conclusions de la Sagim, entraînant
l'irrecevabilité des pièces qu'elle a produites, dont il ne ressortait ni
précision ni aucune justification sur la signification du jugement au
liquidateur, la cour d'appel n'a pas été mise à même de constater que le délai
d'appel avait couru à l'égard du liquidateur et avait expiré à la date de son
intervention volontaire.
14. En conséquence, le moyen, pris en sa seconde branche, étant irrecevable,
l'intervention du liquidateur à l'instance d'appel a régularisé la fin de
non-recevoir affectant l'appel du débiteur.
15. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
La mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire
en application de l'article L. 631-12 du code de commerce ne vient pas priver le
débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre
à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait
également été dirigée contre son administrateur. Il n'en résulte, en cette
hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par
l'irrecevabilité de telles conclusions, ni aucune nullité de fond de ces mêmes conclusions
Cour de cassation chambre commerciale et financière arrêt du 18 janvier 2023 pourvoi n° 21-18.492 cassation
Vu les articles 1844-7, 7° du code civil, dans sa rédaction
antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, 1844-8 de ce code, L. 641-9, II et L. 662-1 du code de commerce :
15. Il résulte du premier de ces textes que la société prend fin par l'effet
d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire ce qui, en application du
deuxième, se traduit par sa dissolution sur laquelle le jugement de clôture pour
extinction du passif est sans incidence, rendant ainsi nécessaire la désignation
d'un liquidateur amiable pour en achever les opérations. En application du
dernier de ces textes, aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque
nature qu'elle soit sur les sommes versées par un liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
16. Pour valider la saisie-attribution, l'arrêt retient que les dispositions de
l'article L. 662-1 du code de commerce sont sans application dès lors que les
opérations de liquidation amiable de la société HAH ne sont pas régies par les
dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives.
17. En statuant ainsi, alors que la clôture de la procédure collective de la
société HAH pour extinction du passif était restée sans incidence sur la
nécessité impérative d'achever les opérations tendant à la dissolution de cette
société provoquée par sa mise en liquidation judiciaire, justifiant ainsi la
désignation par le jugement de clôture d'un mandataire ad hoc puis ensuite d'un
liquidateur ayant notamment pour mission de répartir les fonds déposés par le
liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations où ils étaient insaisissables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du
code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
IL FAUT POURSUIVRE POUR LA FAUTE DES AUTORITES JUDICIAIRES ET NON LA FAUTE DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 30 janvier 2013 pourvoi n° 11-26056 REJET
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors,
selon le moyen, que les fautes commises par l'administrateur judiciaire et le
liquidateur judiciaire engagent la responsabilité de l'État au titre du
dysfonctionnement du service public de la justice ; qu'en retenant pourtant que
les fautes de l'administrateur et du liquidateur judiciaire n'étaient
susceptibles que d'engager leur responsabilité personnelle, à l'exclusion de la
responsabilité de l'État, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que les prétendues
défaillances de l'administrateur et du liquidateur judiciaires, lesquels sont
des collaborateurs du service public de la justice, distincts de l'institution
judiciaire, ne peuvent avoir pour conséquence que d'engager leur responsabilité personnelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
L'ARRÊT DE PRINCIPE ENCORE APPLIQUE PERMET LA REPARATION UNIQUEMENT
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 16 décembre 2014 pourvoi n° 13-19402 Cassation
Vu l'article L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et 1er du protocole n° 1 additionnel à cette Convention ;
Attendu que, lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit
du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est
pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L.
141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres ;
Attendu que pour prononcer la clôture de la procédure de liquidation des biens de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que le comportement
du débiteur a été dilatoire à l'extrême mais qu'en parallèle, le mandataire n'a pas rempli sa mission en usant de ses pouvoirs de
contrainte pour poursuivre la vente forcée des immeubles, retient que la durée totale de trente-trois ans de la procédure est excessive au
regard des exigences d'un procès équitable, qu'elle a privé la procédure de sa justification économique qui est de désintéresser les
créanciers de sorte que la privation du débiteur de ses droits sur son patrimoine ne se justifie plus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'actifs immobiliers réalisables, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Sous la pression de la CEDH, Patrice Poulain a pu obtenir définitivement la fin de la procédure des opérations de liquidation judiciaire,
par un arrêt du 19 janvier 2017 rendu par la Cour d'Appel de Douai et par conséquent la réforme de l'arrêt de principe de la Cour de Cassation.
Aucun pourvoi n'a été déposé contre cet arrêt, pourtant objet de toutes les attentions.



LES POUVOIRS DU FAILLI A TITRE PERSONNEL MALGRÉ SA MORT PATRIMONIALE
DROITS PROPRES ET DROITS PATRIMONIAUX
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 8 février 2023 pourvoi n° 21-16.954 Rejet
5. Si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, par l'effet du jugement prononçant
la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu'il l'exerce contre le liquidateur ou en sa présence, de former un appel, puis le cas échéant, un pourvoi en cassation,
contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire, il n'est, en revanche, pas recevable à agir en
responsabilité contre l'avocat qu'il a mandaté pour le représenter et l'assister dans l'exercice de ce droit propre.
6. Une telle action n'ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective, mais poursuivant une
finalité patrimoniale consistant en l'obtention de dommages et intérêts, elle ne peut se rattacher à l'exercice d'un droit propre et la fin de non-recevoir
opposée au débiteur n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
dès lors que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, seuls
atteints par le dessaisissement, sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure collective.
7. En conséquence, l'arrêt a exactement retenu que M. [B] exerçait contre son avocat une action en responsabilité de nature patrimoniale entrant dans le champ
d'application de l'article L. 641-9 du code de commerce, de sorte qu'il n'avait pas qualité pour agir contre M. [F].
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 8 septembre 2015 pourvois n° 14-14192 Rejet
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 641-9 I du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation
du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce
jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de
condamnation ; qu'ayant relevé que la société CI avait relevé appel, le 14 octobre 2011, du jugement la condamnant solidairement avec M. X..., avant d'être
mise en liquidation judiciaire le 26 octobre suivant, tandis que son liquidateur, assigné en intervention forcée par M. et Mme Y... en cause d'appel,
avait fait savoir qu'il ne se constituerait pas pour le compte de la société CI, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées par la troisième
branche, a décidé à bon droit de statuer sur l'appel formé, au titre de son droit propre, par la société CI, peu important l'absence de constitution de son
liquidateur pourtant appelé en la cause ; que le moyen n'est pas fondé
Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 22 janvier 2013 pourvoi n° 11-18904 cassation, inédit
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde
des entreprises et l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme X... au nom de la société Suberdine et de ses quatre filiales, l'arrêt retient que le
jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de
la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que l'action en réparation, qui présente un caractère patrimonial,
fait partie des droits et actions du débiteur frappés par le dessaisissement et n'entre pas dans la sphère des droits propres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en
prévaloir de sorte que les sociétés Orange n'ont pas qualité pour l'invoquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 14 décembre 2010 pourvoi n°10-10774 rejet, inédit
Attendu, en second lieu, que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir,
de sorte que la société La Mondiale n'a pas qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par le mandataire ad hoc en faisant
valoir que le droit invoqué par lui à l'appui de l'appel n'était propre à la société débitrice que pour partie ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense,
substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié.
Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 13 avril 2010 pourvoi n° 09-11851 cassation, inédit
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des
créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir de sorte que les sociétés Orange n'ont pas qualité pour soulever cette fin de non-recevoir tirée
de l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de Cassation chambre 1ere civile, arrêt du 28 mai 2009 pourvoi n° 07-14075 07-14644 rejet
Mais attendu que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur
peut s'en prévaloir de sorte que la société Azurex et M. Z... n'ont pas qualité pour soulever cette exception ; que le moyen n'est pas recevable.



LA PROTECTION DES DOMICILES ET DES BIENS IMMOBILIERS DU DEBITEUR
Article L 526-1 du Code de Commerce
Par dérogation aux articles
2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique
immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est
fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les
créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité
professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée
en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage
professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de
division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local
d'habitation en application de l'article
L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de
droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code
civil, une personne physique immatriculée au registre national des
entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier,
bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette
déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à
l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à
l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien
foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie
non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la
déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de
division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers
alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale
lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres
frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations
fiscales.
Article L 526-2 du Code de
Commerce
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1, reçue
par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des
biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis.L'acte
est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
Lorsque la personne est immatriculée au registre du commerce et des
sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre
spécial des entreprises à responsabilité limitée, la déclaration doit y
être mentionnée.
A défaut d'une telle immatriculation, la déclaration est mentionnée
au registre national des entreprises.
L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et
l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires
d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
Article L 526-3 du Code de Commerce
En cas de cession des droits immobiliers sur la
résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la
condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la
personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où
est fixée sa résidence principale.
L'insaisissabilité des droits sur
la résidence principale et la déclaration d'insaisissabilité portant sur
tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l'usage professionnel
peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux
conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. La
renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite
au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1
désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de
cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de
celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les
conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. Cette
révocation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L.
526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
Les
effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la
dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du
même article L. 526-1 est attributaire du bien. Ils subsistent également en
cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L.
526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1
jusqu'à la liquidation de la succession.
RAPPEL
L'article 206 de la loi 2015-990 du 6 août
2015 prévoit :
IV.-Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L.
526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a
d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de
l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la
résidence principale publiées avant la publication de la présente loi
continuent de produire leurs effets.
Par conséquent la protection automatique du
domicile ne débute que pour les liquidations judiciaires prononcées à partir
du 8 août 2015.
EN CAS DE SAISIE D'UN DOMICILE COMMUN LA VENTE NE VAUT PAS TITRE D'EXPULSION A L'EGARD DU CONJOINT DU DEBITEUR
Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 17 novembre 2022 pourvoi n° 20-18.047 cassation
6. Vu l'article L. 322-13 du code des procédures civiles
d'exécution et les articles 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile :
7. S'il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de
procédure civile relatives à la vente sur licitation que de nombreuses règles
régissant la procédure de saisie immobilière s'appliquent, par renvoi de texte,
à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, l'article L.
322-13 du code des procédures civiles d'exécution ne lui est pas applicable.
8. Il en résulte qu'un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d'expulsion.
9. Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de nullité du commandement
d'avoir à quitter les lieux, l'arrêt retient, d'abord, que la vente des
immeubles d'une personne physique en liquidation judiciaire est régie par
l'article L. 642-18 du code de commerce, lequel renvoie aux articles L. 322-5 à
L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution à l'exception des articles
L. 322-6 et L. 322-9, R. 642-27 et suivants du code de commerce renvoyant aux
dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière.
10. L'arrêt retient, ensuite, que l'article L. 322-13 du code des procédures
civiles d'exécution précise que le jugement d'adjudication sur licitation
constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi conformément à l'article L. 311-6 de ce code.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du
code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte des paragraphes 7 et 8 que le jugement d'adjudication sur
licitation ne valant pas titre d'expulsion, il convient d'annuler le commandement de quitter les lieux du 21 juin 2018.
LA VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER N'EST PAS UNE OBLIGATION POUR QUE LE DÉBITEUR
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SORTE D'UNE INDIVISION
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 20 septembre 2017 pourvoi n° 16-14295 cassation partielle
Vu les articles 815-17, 822 et 831-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Stéphane X... a été mis en liquidation judiciaire le 19 février 2010 ; que ce dernier étant propriétaire indivis d'un
immeuble avec Mme Josiane X..., sa mère, et avec Mme Magali X..., sa soeur, le liquidateur a assigné ces dernières en partage et licitation de l'immeuble ;
qu'elles ont formé une opposition à l'arrêt qui, statuant par défaut, a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision et
préalablement, la licitation de l'immeuble ;
Attendu que pour écarter les demandes de Mme Josiane X... fondées sur les articles 822 et 831-2 du code civil, l'arrêt retient que ces dispositions ne
sont pas applicables lorsque le bien concerné est soumis à une vente forcée qui intervient en exécution des dispositions spéciales, d'ordre public, relatives à la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la licitation de l'immeuble indivis, qui était l'une des opérations de liquidation et partage de l'indivision préexistante au
jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. Stéphane X..., échappait aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure
collective et ne pouvait être ordonnée qu'après examen des demandes formées par Mme Josiane X... tendant au maintien dans l'indivision et à l'attribution
préférentielle de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
MÊME SI LA VENTE DU DOMICILE EST PREVUE PAR DECISION DEFINITIVE
IL APPARTIENT AU JUGE D'EXAMINER UN MOYEN FONDAMENTAL S'IL N'A PAS ETE EXAMINE
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de
l'Union européenne rendue en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du
5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs, que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à
ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou
d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une
mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à
l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision
revêtue de l'autorité de la chose jugée (v. not. CJUE, arrêt du 26 janvier 2017,
Banco Primus, C-421/14 ; CJUE, arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C-600/19 ;
CJUE, arrêt du 17 mai 2022, SPV Project 1503 Srl et Banco di Desio e della
Brianza e.a, C-693/19 et C-831/19).
Par conséquent, un débiteur soumis à une procédure
collective contre lequel a été rendue une décision, irrévocable, admettant à son
passif une créance au titre d'un prêt immobilier, qu'il avait souscrit
antérieurement en qualité de consommateur, peut, à l'occasion de la procédure de
saisie immobilière d'un bien appartenant à ce débiteur, mise en oeuvre par le
créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la
résidence principale du débiteur est inopposable, nonobstant l'autorité de la
chose jugée attachée à cette décision, soulever, à l'audience d'orientation
devant le juge de l'exécution, une contestation portant sur le caractère abusif
d'une ou plusieurs clauses de l'acte de prêt notarié dès lors qu'il ressort de
la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge ne s'est pas livré à cet examen.
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 8 février 2023, pourvoi n°21-17.763 cassation
Vu les articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil
du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec
les consommateurs, L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation :
16. Aux termes du premier de ces textes, les États membres veillent à ce que,
dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des
moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
17. Selon le second de ces textes, dans les contrats conclus entre
professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses
qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou
du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties au contrat.
18. Par un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a
dit pour droit que, dans l'hypothèse où, lors d'un précédent examen d'un contrat
litigieux ayant abouti à l'adoption d'une décision revêtue de l'autorité de la
chose jugée, le juge national s'est limité à examiner d'office, au regard de la
directive 93/13 susvisée, une seule ou certaines des clauses de ce contrat,
cette directive impose à un juge national d'apprécier, à la demande des parties
ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires
à cet effet, le caractère éventuellement abusif des autres clauses dudit contrat
(CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14).
19. En outre, par un arrêt du 4 juin 2020, la Cour de justice de l'Union
européenne a dit pour droit qu'il appartient aux juridictions nationales, en
tenant compte de l'ensemble des règles du droit national et en application des
méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle
mesure une disposition nationale est susceptible d'être interprétée en
conformité avec la directive 93/13 sans procéder à une interprétation contra
legem de cette disposition nationale. À défaut de pouvoir procéder à une
interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux
exigences de cette directive, les juridictions nationales ont l'obligation
d'examiner d'office si les stipulations convenues entre les parties présentent
un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d'instruction
nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou
jurisprudence nationales qui s'opposent à un tel examen (CJUE, arrêt du 4 juin
2020, Kancelaria Médius, C-495/19).
20. Il résulte d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en
grande chambre le 17 mai 2022, que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7,
paragraphe 1, de la directive 93/13, doivent être interprétés en ce sens qu'ils
s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité
de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office
le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure
d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour
former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette
procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites
clauses ont déjà fait l'objet, lors de l'ouverture de la procédure d'exécution
hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement
abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution
hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de
cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit
examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans
ledit délai (CJUE, arrêt du 17 mai 2022, C-600/19 Ibercaja Banco).
21. Il résulte en outre d'un arrêt rendu le même jour que ces mêmes dispositions
doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation
nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge
à la demande d'un créancier n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le
débiteur, le juge de l'exécution ne peut pas, au motif que l'autorité de la
chose jugée dont cette injonction est revêtue couvre implicitement la validité
de ces clauses, excluant tout examen de la validité de ces dernières,
ultérieurement, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui
ont servi de fondement à ladite injonction (CJUE, arrêt du 17 mai 2022, affaires
jointes C-693/19 SPV Project 503 Srl, et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza
e.a.).
22. Il s'en déduit que l'autorité de la chose jugée d'une décision du
juge-commissaire admettant des créances au passif d'une procédure collective,
résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de
procédure civile, ne doit pas être susceptible de vider de sa substance
l'obligation incombant au juge national de procéder à un examen d'office du
caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles.
23. Il en découle que le juge de l'exécution, statuant lors de l'audience
d'orientation, à la demande d'une partie ou d'office, est tenu d'apprécier, y
compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses
contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu'il ressort
de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge
s'est livré à cet examen.
24. Il en résulte qu'un débiteur soumis à une procédure collective contre lequel
a été rendue une décision, irrévocable, admettant à son passif une créance au
titre d'un prêt immobilier, qu'il avait souscrit antérieurement en qualité de
consommateur, peut, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière d'un bien
appartenant à ce débiteur, mise en oeuvre par le créancier auquel la déclaration
d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur
est inopposable, nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à cette
décision, soulever, à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution,
une contestation portant sur le caractère abusif d'une ou plusieurs clauses de
l'acte de prêt notarié dès lors qu'il ressort de la décision revêtue de
l'autorité de la chose jugée que le juge ne s'est pas livré à cet examen.
25. Pour rejeter la contestation de M. [T], qui soutenait que la créance de la
banque n'était pas liquide et exigible, au motif que la clause d'exigibilité
anticipée stipulée dans chacun des prêts était abusive, au sens des articles L.
212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, l'arrêt retient que, les décisions
d'admission des créances du 7 novembre 2013 ont autorité de la chose jugée à
l'égard de M. [T] relativement aux créances qu'elles fixent, que celui-ci,
débiteur convoqué à l'audience du juge-commissaire pour qu'il soit statué sur
ses contestations, se présente en la même qualité devant le juge de l'exécution
statuant en saisie immobilière que devant le juge-commissaire, et il relève que,
devant ce juge, le débiteur n'a formulé aucune observation concernant la
première créance et qu'il n'a pas davantage contesté la seconde. L'arrêt en
déduit que les moyens développés par M. [T] pour contester la validité de
certaines clauses des contrats de prêts, en particulier celle portant
exigibilité anticipée de ceux-ci, sont inefficaces pour remettre en cause la
procédure de saisie immobilière.
26. En statuant ainsi, après avoir constaté que, dans ses décisions d'admission,
le juge-commissaire n'avait pas examiné, à la demande de M. [T] ou d'office, le
caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée des prêts notariés fondant
la saisie immobilière litigieuse, de sorte qu'il appartenait au juge de
l'exécution, saisi d'une contestation formée sur ce point pour la première fois
devant lui par M. [T] lors de l'audience d'orientation, de procéder à cet
examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
LA PÉREMPTION DU JUGE COMMISSAIRE ORDONNANT LA VENTE D'UN IMMEUBLE EST DE DEUX ANS
Cour de cassation chambre commerciale avis du 18 avril 2018, demande d'avis n° Q18-70005
Vu les articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile;
Vu la demande d’avis formulée le 11 janvier 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, dont le dossier complet
a été reçu le 7 février 2018 , dans une instance opposant M. X..., en qualité de liquidateur de M.Mohammed Y..., Mme Samira Z... épouse Y... et le syndicat des
copropriétaires de la résidence [...] , et ainsi libellée:
"Au regard des renvois opérés par l’article R. 642-27 du code de commerce au livre III du code des procédures civiles d’exécution, la
sanction de la péremption de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution est-elle applicable à l’ordonnance du juge commissaire ?
Dans l’affirmative, le juge de l’exécution est-il compétent pour proroger cette ordonnance ?"
Sur le rapport de Mme le conseiller Vaissette et les conclusions de M. Le Mesle ,premier avocat général, entendu en ses observations orales
Vu les observations écrites déposées par la SCP Foussard et Froger, pour M.X..., ès qualités
MOTIFS
Lorsque le juge-commissaire ordonne, en application de l’article L. 642-18 du code de commerce, la vente d’un immeuble appartenant à un
débiteur en liquidation judiciaire par voie d’adjudication judiciaire , cette vente a lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des
procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, et sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du code
de commerce. L’article R. 642-27 du code de commerce dispose que la vente par voie d’adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres 1 et Il
du livre Ill du code des procédures civiles d’exécution et, dans la mesure où il n’y est pas dérogé, par les dispositions du présent livre.
L’ordonnance du juge-commissaire, aux termes de l’article R. 642-23, alinéa 2,du code de commerce, produit les effets du commandement prévu à
l’article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution et est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant
dans les conditions prévues pour ledit commandement.
Il en résulte, conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en l’absence de
dispositions dérogatoires ou
incompatibles du livre VI du code de commerce, l’ordonnance du juge-commissaire, en dépit de son caractère juridictionnel, cesse de plein droit de produire effet
si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné, en marge de cette publication, un jugement constatant la vente du bien saisi.
En conséquence, à l’expiration du délai prévu par l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée
peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption de l’ordonnance du juge-commissaire.
Enfin, à défaut de disposition du code de commerce excluant sa compétence ou incompatible avec cette dernière, il appartient au juge de l’exécution, désigné
par l’article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution pour constater la péremption, de se prononcer sur une demande de prorogation des
effets de l’ordonnance du juge-commissaire, formée conformément à l’article R. 321-22 du même code.
En conséquence,
LA COUR EST D’AVIS QUE :
La sanction de la péremption prévue par les articles R.321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution s’applique à
l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d’un immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire .
Le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d’une telle ordonnance.



RESPONSABILITE DU DEBITEUR POUR CAUSE DE FAUTE DE GESTION
LA NÉGLIGENCE DU CHEF D'ENTREPRISE NE PEUT PLUS ÊTRE POURSUIVIE EN COMBLEMENT DE PASSIF A TITRE PERSONNEL
Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour condamner un dirigeant sur
ce fondement, relève que celui-ci a manqué de vigilance en engageant la société qu'il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique, lequel lui a
imposé des investissements lorsque le dirigeant pouvait légitimement croire à une expansion de sa société, avant de rompre brutalement les relations
commerciales à sa seule initiative, de tels motifs étant impropres à établir une faute de gestion du dirigeant excédant sa simple négligence
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 13 avril 2022, pourvoi n° 20-20.137 cassation
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2020),
la société CDV, ayant pour objet le commerce de viande et dont M. [P] était le
dirigeant, a bénéficié d'une procédure de sauvegarde le 28 février 2011. Elle a
été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2011 à la suite de la rupture
brutale de ses relations commerciales avec son client unique, M. [E] étant
désigné liquidateur. Celui-ci a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant.
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :
3. Il résulte de ce texte qu'en cas de simple négligence dans la gestion de la
société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif est écartée.
4. Pour condamner M. [P] au titre de sa responsabilité pour insuffisance
d'actif, l'arrêt , après avoir constaté que le cocontractant unique de la
société CDV avait imposé à cette dernière des investissements destinés à adapter
sa capacité de production à ses demandes dans un secteur d'activité et à une
période où M. [P] pouvait légitimement croire à l'expansion de sa société,
constate que ce cocontractant a brutalement rompu, à sa seule initiative, leurs
relations commerciales, et relève que M. [P] a manqué de vigilance en engageant
la société qu'il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique sans
trouver le moyen de garantir la pérennité des relations commerciales.
5. En statuant par de tels motifs tirés seulement d'un manque de vigilance de M.
[P], impropres à établir que celui-ci aurait commis une faute de gestion non
susceptible d'être analysée en une simple négligence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-15031 rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2017), que la société DM Finances a été mise en liquidation judiciaire
le 2 décembre 2011 ; que le liquidateur a assigné Mme Y..., en qualité de dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d’actif de cette société ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que selon l’article L. 651-2 du
code de commerce, dans sa rédaction applicable en l’espèce antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 146 de la loi du 9 décembre 2016, une négligence pouvait
constituer une faute de gestion ; qu’en affirmant cependant que la responsabilité du dirigeant ne pouvait être engagée en cas de négligence dans la
gestion de sa société, de sorte que Mme Y... ne pouvait se voir reprocher une faute dans la gestion de la société DM Finances, la cour d’appel a violé le
texte ci-dessus&
Mais attendu que, selon les articles 1 et 2 du code civil, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés
avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis ; que le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à
supporter, en tout ou partie, l’insuffisance d’actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a
contribué par sa faute de gestion ; qu’il en résulte qu’en l’absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en
cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux
procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ;
que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ;
LES LIMITES ENTRE LA PROCEDURE COLLECTIVE ET LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-22013 cassation
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu les articles L. 526-6 du code de commerce et L. 333-7 du code de la consommation, devenu l’article L. 711-7 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un
patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ; qu’il résulte du second, que les dispositions régissant le traitement
des situations de surendettement sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article
L. 526-7 du code de commerce ; que ces dispositions s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non
professionnelles ; qu’en ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf
dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté ; que celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du
débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X..., le jugement retient
qu’elle exerce son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ce qui la rend éligible aux procédures collectives ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure
instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises n’était pas de nature à exclure le
patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement, le juge du tribunal d’instance a violé les dispositions susvisées ;
Et sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 330-1 et L. 333-7 du code de la consommation, devenus les articles L. 711-1 et L. 711-7 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... en raison de son
absence de bonne foi, le jugement retient d’une part, qu’est versé aux débats un document intitulé « modèle de déclaration d’affectation par un entrepreneur à
responsabilité limitée » aux termes duquel Mme X... indique être propriétaire de deux mobiles homes ayant vocation à être loués dans le cadre de l’EIRL X...
blue vacances et d’autre part, qu’elle a sciemment caché la réalité de sa situation patrimoniale et financière en ne déclarant pas en être propriétaire ;
Qu’en statuant ainsi sans rechercher si les mobiles homes n’étaient pas affectés au patrimoine professionnel de Mme X..., le
juge du tribunal d’instance a privé sa décision de base légale

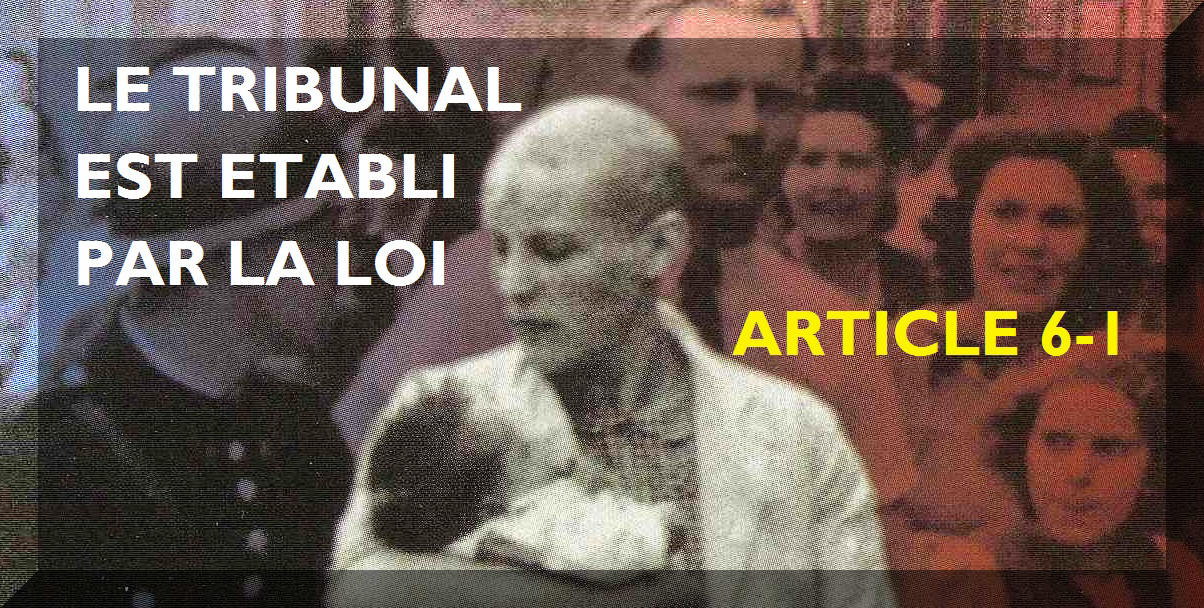

LA DECLARATION DE CREANCE ET SA CONTESTATION
LE DEBITEUR PEUT POURSUIVRE LE CREANCIER PUISQUE LA DECLARATION DE CREANCE AU PASSIF N'A PAS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
La déclaration d’une créance au passif d’un débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu’à la constatation de
l’existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au jour de l’ouverture de la procédure. La contestation de cette créance, au cours
de la procédure de vérification du passif, n’a pas le même objet que la demande en paiement d’une somme d’argent formée par le débiteur contre le créancier
déclarant. Par conséquent, doit être approuvée la cour d’appel qui, ayant relevé qu’à l’occasion de la contestation de la créance déclarée par un créancier, le
débiteur ne s’était pas prévalu de la compensation avec ses propres créances, ce qu’il n’avait pas à faire, en déduit que la demande en paiement de ces créances
formée par le débiteur ultérieurement, devant le juge de droit commun, ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la vérification des créances.
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-17730 rejet
Mais attendu que la déclaration d’une créance au passif d’un
débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu’à la constatation de
l’existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au
jour de l’ouverture de la procédure ; que la contestation de cette créance, au
cours de la procédure de vérification du passif, n’a pas le même objet que la
demande en paiement d’une somme d’argent formée contre le créancier déclarant ;
qu’ayant relevé qu’à l’occasion de la contestation de la créance de la société
BMW, la société
Oustric ne s’était pas prévalue de la compensation avec ses propres
créances, ce qu’elle n’avait pas à faire, la cour d’appel en a exactement déduit
que la demande en paiement de celles-ci , qui ne se heurtait pas à l’autorité de
la chose jugée dans le cadre de la vérification des créances, était recevable ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur ce moyen, pris en sa seconde branche, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
INSCRIPTION DES CREANCES DES PROCEDURES COLLECTIVES ET EXAMEN DU TITRE PAR LE JEX
Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 14 janvier 2021 pourvoi n° 18-23.238 cassation
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 706-11 du code de procédure pénale :
7. La décision rendue par une juridiction, qui
se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d’une
procédure collective, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors,
servir de fondement à une mesure d’exécution forcée, et le fonds de garantie des
victimes d’actes de terrorisme et d’infraction, subrogé dans les droits de la
victime, ne peut se prévaloir que du titre exécutoire de condamnation de
l’auteur de l’infraction au bénéfice de la victime des faits.
8. Pour rejeter la contestation de la
saisie-attribution formée par M. X..., l’arrêt retient que le texte même de
l’article 706-11 précité indique bien que le FGTI est en droit d’obtenir auprès
de la personne déclarée responsable du dommage le remboursement des
indemnisations versées à la victime, que M. X... a bénéficié d’un plan de
continuation adopté le 21 novembre 2012, soit antérieurement à la décision
fixant le montant précis de l’indemnisation, que l’adoption du plan a mis fin à
la période d’observation et a remis le débiteur en capacité de gérer son
entreprise sous réserve des mesures imposées par ce plan, que dès lors, les
créances nées après l’adoption du plan relèvent du droit commun et doivent être
payées à l’échéance.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait
par ailleurs que le jugement du 2 octobre 2014 avait seulement fixé les créances
d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
LES CREANCES DOIVENT ÊTRE CONTESTEES AU MOMENT DE L'ADMISSION DES CREANCES ET NON PAS PLUS TARD DURANT LA PROCEDURE
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 20
janvier 2021 pourvoi n° 19-13.539 cassation
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 583 du code de procédure civile et R. 624-8, alinéa 4, du code de commerce :
6. L’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une
société civile s’impose à ses associés, de sorte que, s’il n’a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du code
de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l’associé d’une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce-opposition à la
décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise.
7. Pour déclarer recevable la tierce-opposition formée par les consorts X..., l’arrêt retient que c’est en vain que la banque
prétend qu’à défaut pour ceux-ci d’avoir exercé un recours contre l’état des créances dans le délai d’un mois à compter de sa publication au BODACC le 28
février 2015, la créance en litige a acquis l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous, de sorte qu’ils seraient irrecevables à former toute nouvelle
contestation portant sur l’existence, la nature ou le quantum de la créance ainsi admise définitivement, dès lors que l’admission définitive de la créance
de la banque, dans le cadre et pour les besoins de la liquidation judiciaire de la SCI, n’interdisait nullement aux associés, qui n’étaient ni plus ni moins
parties à cette procédure collective qu’à l’instance précédente devant cette cour, d’exercer devant un juge le recours effectif reconnu par le texte précité,
qu’au demeurant l’examen du bordereau de déclaration de créance montre que la banque n’a pas déclaré d’autre créance que celle résultant précisément de
l’arrêt du 24 mars 2011, qui était déjà définitive suite au rejet, le 28 juin 2012, du pourvoi formé contre cet arrêt et qu’ainsi les consorts X..., qui ont
un intérêt manifeste à voir rétracter le jugement dès lors qu’ils sont poursuivis en paiement par la banque pour répondre des dettes sociales de la SCI
à proportion de leurs parts dans le capital social, doivent être déclarés recevables en leur tierce-opposition.
8. En statuant ainsi, alors que les consorts X... ne contestaient pas ne pas avoir, en tant qu’intéressés au sens de
l’article R. 624-8, alinéa 4, du code de commerce, présenté contre l’état des créances dans le délai d’un mois à compter de sa publication au BODACC, la
réclamation prévue par ce texte, lequel leur ouvrait un accès effectif au juge au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que, faute d’intérêt, leur tierce-opposition à l’arrêt condamnant la SCI, n’était pas recevable, la cour
d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l’arrêt déclarant recevable
la tierce-opposition formée par les consorts X... entraîne la cassation de toutes les autres dispositions de l’arrêt, qui s’y rattachent par un lien de
dépendance nécessaire.
LE DEBITEUR PEUT FAIRE APPEL DES CREANCES
Il résulte de la combinaison des articles L.
624-1, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce que le débiteur en redressement
judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge commissaire
statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette
contestation. Dès lors que le débiteur a contesté la créance, quel que soit le
motif de cette contestation, il est recevable à un invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 29 mars 2023 pourvoi n° 21-21.258 rejet
Vu les articles L. 624-1, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur en redressement
judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire
statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation.
5. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 10 février 2020 et
admettre la créance de l'URSSAF, à titre privilégié, pour un montant de 52
220,59 euros et, à titre chirographaire, pour un montant de 61 309 euros,
l'arrêt relève que la contestation de créance de la société SOS Micro 57 du 8
décembre 2018 n'était pas totale et ne visait pas les sommes dues au titre de
cotisations pour le 4e trimestre 2013, les quatre trimestres 2014 et l'année 2014, dont elle demandait désormais l'annulation.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société débitrice, par
l'intermédiaire du mandataire judiciaire, avait contesté la créance de l'URSSAF,
de sorte que, peu important le motif de cette contestation, elle était recevable
à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
LES CREANCES DES SALARIES DOIVENT ÊTRE PROTEGEES ET ILS DOIVENT POUVOIR FAIRE LEUR
DECLARATION
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 22 mars 2023 pourvoi n° 21-14.604 cassation
Vu les articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce :
6. Selon le premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en
tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail
établi par le mandataire judiciaire peut saisir, à peine de forclusion, le
conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de
publicité de ce relevé.
7. Aux termes du second de ces textes, le mandataire judiciaire informe par
tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou
rejetées, lui indique la date du dépôt du relevé des créances au greffe et lui
rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 du code du
commerce, court à compter de la publication du relevé.
8. En application de ces textes, l'information délivrée par le mandataire
judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction
compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement
du conseil de prud'hommes compétent et la possibilité de se faire assister et
représenter par le représentant des salariés.
9. Il s'ensuit qu'en l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées,
le délai de forclusion ne court pas.
10. Pour déclarer le salarié irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que
le liquidateur judiciaire justifie que le dépôt du relevé des créances
salariales de la société GDSP a fait l'objet d'une mesure de publicité dans le
quotidien Ouest France édition des Côtes d'Armor du 21 octobre 2014, qu'il
avait préalablement informé le salarié le 14 octobre 2014 par courrier
recommandé du dépôt du relevé des créances salariales effectué le 23 septembre
2014 auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc et que
contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le courrier
d'information du 14 octobre 2014 comportait les précisions exigées par la loi
s'agissant du délai de forclusion, de la date de la publication, du nom du
journal, du nom de la juridiction compétente et des modalités d'assistance et
de représentation devant le conseil de prud'hommes. Il relève qu'il a
également averti le salarié qu'en cas de contestation de sa part sur le
montant et/ou la nature de ses créances inscrites sur le relevé, il lui
appartenait de saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes
compétent dans un délai de deux mois à compter de la publicité du 21 octobre 2014.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le
liquidateur n'avait pas indiqué au salarié la nature et le montant de ses
créances admises ou rejetées ni le lieu et les modalités de saisine de la
juridiction compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence
celle des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en
fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une indemnité pour travail
dissimulé et de sa demande de délivrance, sous astreinte, de bulletins de
salaire rectificatifs, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.;
EXCEPTION AU DÉLAI DE 30 JOURS POUR CONTESTER LE REFUS DE LA CRÉANCE
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-14960 rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2016), que la société TLS France (la société TLS) a été mise en
redressement judiciaire le 24 avril 2014, tandis qu’était en cours devant le tribunal de commerce de Paris une instance l’opposant à la société Leasecom à
propos de l’exécution de contrats de location financière ; que la société Leasecom ayant déclaré sa créance, objet de l’instance en cours, au passif de la
société TLS, Mme X..., désignée mandataire puis liquidateur judiciaire, l’a informée que sa créance était discutée et qu’elle entendait proposer son rejet
au juge-commissaire, l’invitant à répondre dans le délai de trente jours, ce dont la société Leasecom s’est abstenue ; que la société Leasecom a demandé au
tribunal de commerce de Paris de fixer sa créance ; que cette demande ayant été déclaré irrecevable, la société Leasecom a relevé appel ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l’arrêt statuant sur cet appel de déclarer la demande recevable et de fixer la créance
de la société Leasecom alors, selon le moyen, que le créancier qui s’abstient de contester dans les trente jours la proposition de rejet de sa créance par le
mandataire est irrecevable à contester ensuite cette proposition, peu important qu’elle ait été justifiée ou non ; qu’en décidant que la sanction prévue par
l’article L. 622-7 [lire L. 622-27] du code de commerce ne s’applique pas au motif inopérant que le mandataire judiciaire avait à tort proposé le rejet de la
créance quand il aurait dû proposer au juge-commissaire de constater qu’une instance était en cours, la cour d’appel a violé l’article L. 622-27 du code de commerce ;
Mais attendu que c’est à bon droit que l’arrêt retient que l’article L. 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier,
qui n’a pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n’a pas
vocation à s’appliquer lorsqu’une instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur ; que le moyen n’est pas fondé ;
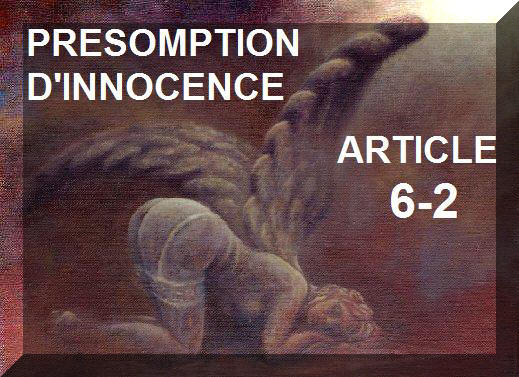
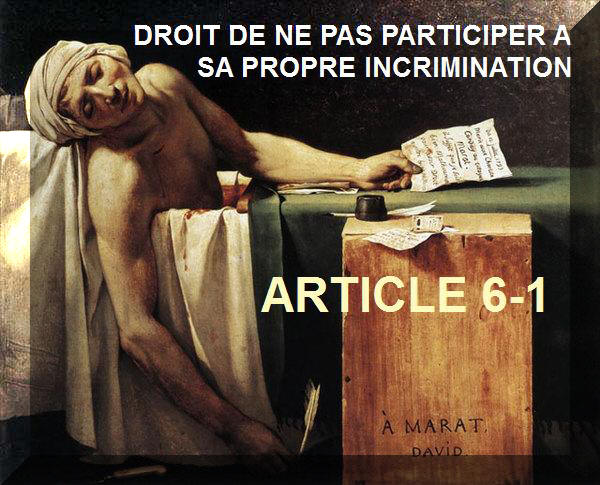
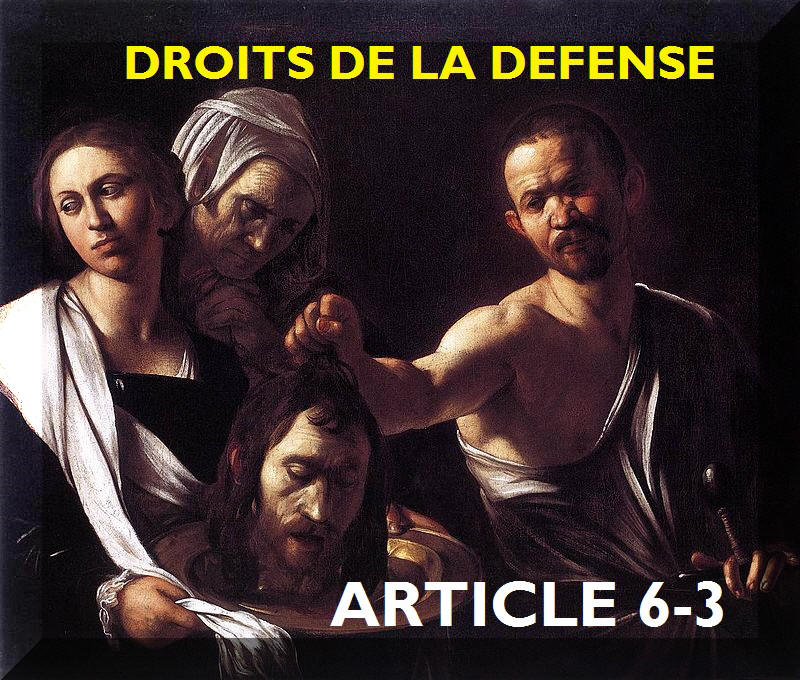
LE DROIT DE SUITE DU CREANCIER
Durant la procédure de liquidation judiciaire :
Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation
judiciaire par L. 641-3 de ce code, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part
de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme
d'argent. Les dispositions de ce texte ne profitant qu'au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en
raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 30 mars 2023 pourvoi n° 21-21.005 rejet
6. Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce,
rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 de ce code,
que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit
toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est
pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
7. Les dispositions de ce texte ne profitant qu'au seul débiteur en procédure
collective, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les actions poursuivies
contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont
pas soumises à la suspension des poursuites individuelles et que
l'administration des douanes ne s'est pas affranchie de cette règle en
poursuivant M. [H], sur le fondement des articles 1799 et 1799 A du code général
des impôts, en sa qualité de personne solidaire ayant permis de commettre ou de faciliter la fraude.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Après la fin des opérations de liquidation judiciaire, le droit de suite est très limitée pour les créances déclarées
Selon l'article L. 645-11 du code de commerce, la clôture de
la procédure de rétablissement professionnel d'un débiteur entraîne l'effacement
de ses dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au
jugement d'ouverture de cette procédure, a été portée à la connaissance du juge
commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L.
645-8 de ce code. Selon l'article R. 645-15 du même code, le jugement de clôture
comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas,
du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers. Il en
résulte qu'une dette n'est susceptible d'être effacée par la clôture de la procédure qu'à concurrence du montant indiqué dans cet état chiffré des créances
Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 19 avril 2023 pourvoi n° 21-19.743 cassation
Vu les articles L. 645-11 et R. 645-17 du code de commerce :
8. Selon le premier de ces textes, la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la
créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de
l'information prévue à l'article L. 645-8 du code de commerce.
9. Selon le second, le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances
effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.
10. Il en résulte qu'une dette n'est susceptible d'être effacée par la clôture
de la procédure qu'à concurrence du montant indiqué dans cet état chiffré des créances.
11. Pour rejeter les demandes de constat de la résiliation du bail et de
paiement de l'arriéré des loyers formées par la SCI, l'arrêt retient que la
dette de loyer de la locataire existait avant le 8 novembre 2019, date du
commandement de payer, que, par une lettre du 6 avril 2020, le mandataire au
rétablissement professionnel de Mme [G] a invité la SCI à lui adresser sa
déclaration de créance dans les délais légaux, lui exposant que la débitrice
avait indiqué lui devoir la somme de 18 330,58 euros, et que la créance de loyers ne fait pas partie des créances exclues de l'effacement.
12. En statuant ainsi, alors que la créance portée à la connaissance du juge
commis et faisant l'objet du jugement de clôture de la procédure de
rétablissement professionnel de Mme [G], emportant son effacement, était de 18
330,58 euros, tandis que la SCI se prévalait d'un commandement de payer portant
sur un arriéré de loyers d'un montant supérieur, de 36 429,40 euros en
principal, la cour d'appel, en retenant l'effacement intégral de la dette de Mme [G], a violé les textes susvisés.
Les créanciers ne peuvent plus poursuivre le débiteur et n'ont donc pas de droit de suite sauf
exceptions prévues à l'article L643-11 du code de commerce
Article L 643-11 du code de commerce
I.- Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions
contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant
la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle
la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits
attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au
préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article
L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la
créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction
prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles
L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou
ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils
ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans
les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une
personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de
liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de
cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le
débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des
dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du
paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29
mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de
l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers,
le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à
l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure
après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les
contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout
intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et
dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir
obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans
avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent
article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et
dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les
conditions du droit commun.
VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un
débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un
patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de
plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur
les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il
statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits
qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions
prévues au V.
VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un
débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n'avait pas été affecté,
le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article
L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des
organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles
L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans.



DÉLAI NON RAISONNABLE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Cliquez sur un lien bleu pour accéder gratuitement aux informations juridiques :
- LE DÉLAI NON RAISONNABLE DOIT ÊTRE LE FAIT DE LA JURIDICTION
- L'OBLIGATION D'ÉPUISER LES VOIES DE RECOURS INTERNES
- LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ÉTAT FRANÇAIS
- LE MODÈLE GRATUIT DE RECOURS GRACIEUX AU MINISTRE DE LA JUSTICE
- LE RECOURS AU CONSEIL D'ÉTAT
- UNE REQUÊTE PEUT ENSUITE ÊTRE POSTÉE A LA LA CEDH
LE DÉLAI NON RAISONNABLE DOIT ÊTRE LE FAIT DE LA JURIDICTION
Gobry contre France du 06/07/2004 Hudoc 5180 requête 71367/01
La Cour condamne le laps de temps entre chaque acte du Conseil d'Etat :
"§40 : La Cour relève, par contre, plusieurs périodes d'inactivité imputables au Conseil d'Etat et, notamment, du 11 mai
1994, date de la communication du recours du ministre défendeur, au 13 mai 1996, date d'une première demande de retour du dossier. De cette date au 15 novembre
1996, puis au 4 février 1997, dates d'une seconde demande de retour du dossier puis d'une mise en demeure. Elle relève également une période de latence entre
le 4 mai 1998, date de l'affectation du dossier à un rapporteur, au 12 juillet 1999, date de dépôt de ce rapport.
§41 : En conséquence, la Cour estime que les juridictions internes n'ont pas agi avec la diligence particulière requise par
l'article 6§1 de la Convention en pareil cas"
Carries contre France du 20/07/2004 Hudoc 5248, requête 74628/01
la Cour condamne un délai de trois ans et six mois pour que la
Cour d'Appel Administrative de Marseille rende son arrêt dans un litige suite à un licenciement d'un personnel communal. Le dommage moral a été fixé à 6000 euros.
Donnadieu c. France (no 2) du 7 février 2006 Requête no 19249/02
EN MATIÈRE DE DEMANDE DE DOCUMENTS ET DE PROCÉDURE DEVANT LA CADA
"44. La Cour rappelle en premier lieu que l’article 6 est applicable à la procédure en
annulation du refus de communication par le CHU de documents administratifs et médicaux concernant l’internement du requérant (voir
Loiseau c. France (déc.), no 46809/99, § 7, 18 novembre 2003). Elle rappelle
ensuite que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par
sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige
pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c.
France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
1. Détermination de la durée de la procédure
administrative en annulation du refus de communication par le CHU de
documents relatifs à l’internement du requérant
45. La Cour
relève que seule la décision prise par la CADA dans le cadre d’une troisième
saisine par le requérant, le 4 janvier 1999, qui lui avait été notifiée le 6
avril 1999, a fait l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif le
19 avril 1999. La saisine de la CADA ne revêt le caractère de recours
préalable obligatoire que dans le cadre de cette troisième saisine (X.
c. France, précité, § 31) et seule la durée de trois mois qui y est
relative doit donc être prise en considération. Quant à la phase
juridictionnelle de cette procédure, elle s’est achevée le 3 janvier 2005
par l’arrêt de la cour administrative de Marseille.
La Cour observe
que la première instance a connu une période d’inactivité de deux ans et
trois mois après la réception du dernier mémoire du requérant et que la
durée globale de la procédure est de six ans pour un recours préalable et
deux degrés d’instance.
2. Détermination de la durée de la procédure administrative en réparation
du préjudice subi du fait de la communication tardive des documents précités
46. La Cour
constate que cette procédure a débuté le 14 avril 1999, date du recours
préalable en indemnisation auprès du CHU (X.,
précité, § 31) et s’est achevée le 3 janvier 2005. Elle relève en
particulier que la première instance a duré trois ans et six mois. La durée
globale de la procédure est donc de cinq ans et plus de huit mois pour une
demande préalable et deux degrés d’instance.
47. La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables aux
deux procédures visées en l’espèce et a constaté la violation de l’article 6
§ 1 de la Convention. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été
soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en
l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas
à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

L'OBLIGATION D'ÉPUISER LES VOIES DE RECOURS INTERNES
Broca et Texier-Micault contre France du 21/10/2003; Hudoc 4655; requêtes 27928/02 et 31694/02
"§18: La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35§1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux
juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de
ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux.
Cette règle se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne
offre un recours effectif quant à la violation alléguées (voir par exemple
décision d'irrecevabilité Mifsud contre France; 11/09/2002; requête 57200/00)
En matière de "délai raisonnable" au sens de l'article 6§1 de la Convention, un
recours purement indemnitaire - tel le recours en responsabilité de l'Etat pour
fonctionnement défectueux du service public de la justice dont il est question
en l'espèce - est en principe susceptible de constituer une voie de recours à
épuiser au sens de l'article 35§1, même lorsque la procédure est pendante au
plan interne au jour de la saisine de la Cour (voir en particulier la décision Mifsud précitée)
§19: Les dispositions de
l'article 35§1 de la Convention ne prescrivent cependant que l'épuisement des
recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats.
Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie
mais aussi, en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et
l'accessibilité voulues; il incombe à l'État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (ibidem,notamment)
A cet égard, dans les affaires relatives à la durée de procédures devant les
juridictions administratives qu'elles a examinées antérieurement, la Cour a
constamment jugé que, nonobstant la jurisprudence Daimont du Conseil d'Etat, les
jugements du Tribunal Administratif de Paris des 24 juin et 30 septembre 1999
auxquels se réfère le Gouvernement ne suffisent "manifestement pas à faire la
démonstration du caractère effectif et accessible de la voie de recours invoquée
s'agissant d'un grief tiré de la durée d'une procédure devant le juge
administratif, d'autant moins qu'ils émanent d'une jurisprudence de première
instance" () l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 11/07/2001 dans
l'affaire Magiera fait en revanche clairement droit à des conclusions
indemnitaires en réparation de préjudices nés d'un dépassement du "délai
raisonnable" de l'article 6§1 de la Convention et alloue au
demandeur une indemnité de
30 000 FF pour une instance ayant duré 7ans et 6 mois.
Assurément, la Cour l'a
d'ailleurs déjà reconnu (voir Lutz contre France (n° 1) requête n°48215/99;
26 mars 2002 §20) cet arrêt apporte plus de poids à l'argumentation du
Gouvernement. Cependant, frappé de pourvoi à l'initiative du Garde des Sceaux,
il était susceptible d'être annulé par le Conseil d'Etat, de sorte qu'aucune
conclusion définitive ne pouvait être tirée.
Par un arrêt du 28/06/2002 ( Garde
des Sceaux ministre de la justice contre Magiera; paragraphe 12 ci dessus)
l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat a confirmé cette décision de la
Cour Administrative d'Appel de Paris. Rendu par la formation la plus solennelle
de la haute juridiction administrative, cet arrêt se réfère expressément à
l'article 6§1 de la Convention et au droit "des justiciables () à ce
que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable", et reconnaît à
ceux-ci, "lorsque la méconnaissance de (ce droit) leur a causé un préjudice (la
possibilité d')obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le
fonctionnement défectueux du Service Public de la justice"
Il souligne en particulier ce qui suit:
"l'action en responsabilité engagée par le
justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit
permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux,
directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se
trouve pas assurées par la décision rendue sur le litige principal () peut
ainsi, notamment, trouver réparation du préjudice causé par la perte d'un
avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit ()
peuvent aussi donner lieu à réparation des désagréments provoqués par la durée
abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et
vont au delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte
tenu notamment de la situation personnelle de l'intéressé"
Il ressort ainsi clairement de
cet arrêt que le recours en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement
défectueux du service public de la justice permet aux justiciables, parties à
une procédure devant les juridictions administratives, d'obtenir un constat de
violation de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai "raisonnable"
et l'indemnisation du préjudice qui en résulte. La Cour Juge en outre
convaincante la thèse du Gouvernement selon laquelle cela vaut pour les
procédures pendantes comme pour les procédures achevées au plan interne (voir, par analogie, la décision Mifsud précitée)
Les arrêts du Conseil d'Etat sont définitifs et s'imposent aux juridiction du
fond, rendu par l'assemblée du contentieux, l'arrêt Magiera s'impose en outre,
sinon en droit, du moins en pratique, à la section du contentieux et aux sous
sections du contentieux de la haute juridiction. La Cour déduit de ce qui
précède que le recours dont il est question se trouve "établie" à un degré
suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique pour
pouvoir et devoir être utilisée aux fins de l'article 35§1 de la
Convention, ceci à première vue, dès le jour du prononcé de l'arrêt Magiera soit
dès le 28 juin 2002 (en vertu du brocard "res judicata pro veritate habetur")
§20: Il ne serait cependant pas équitable d'opposer une voie de recours
nouvellement intégrée dans le système juridique d'un Etat cocontractant aux
individus qui se portent requérantes devant la Cour, avant que les justiciables
concernés en aient eu connaissance de manière effective () l'équité commande de
prendre en compte un laps de temps raisonnable, nécessaire aux justiciables pour
avoir effectivement connaissance de la décision interne qui la consacre
() S'agissant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 2002 dont il est
présentement question, il semble qu'à ce jour, il n'a pas encore été publié au
"recueil Lebon", qui est le recueil "officiel" des arrêts du Conseil
d'Etat, du Tribunal des conflits et des juridictions administratives; le
Gouvernement indique cependant qu'il figure sur le site internet du Conseil
d'Etat depuis le 1er juillet 2002 et a été publié et commenté (date de
publications dans divers chroniques) il avait acquis un degré de certitude
juridique suffisant à une période qui se situe aux alentours de la fin de
l'année 2002, soit environ six mois après sa lecture. Elle rappelle à toutes
fins utiles qu'elle a suivi un raisonnement comparable s'agissant de l'évolution
jurisprudentielle consacrant la possibilité pour les justiciables
d'obtenir une indemnisation à raison de la durée d'une procédure judiciaire, par
le biais d'un recours fondé sur l'article L 781-1 du C.O.J (voir,
notamment la décision d'irrecevabilité Giummarra et autres contre France du 12 juin 2001; requête
n°61166/00) le problème était analogue, puisque, si cet arrêt est issu d'une
loi, insérée dans le code par décret du 16 mars 1978, c'est l'évolution récente
de l'interprétation jurisprudentielle au dit article qui a conduit la Cour à
considérer, par la décision Giummara, qu'il instituait une voie de recours
interne à épuiser. Quant à la différence entre l'espèce Giummara et la présente
affaire, tenant à ce qu'ici il s'agit d'un arrêt du Conseil d'Etat et non d'un
arrêt de cour d'appel, elle ne vaut pas, car dans la décision Giummara, la Cour
avait retenu comme date de l'arrêt le jour où celui-ci, faute de pourvoi en cassation, était devenu définitif.
La Cour juge en conséquence raisonnable de retenir que l'arrêt Magiera du
Conseil d'Etat ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 01/01/2003.
Elle en conclut que c'est à partir de cette date, et non du 28 juin 2002 qu'il
doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35§1 de la Convention.
§21: Enfin la Cour rappelle que
l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en règle générale à la
date d'introduction de la requête (voir par exemple la décision de recevabilité Van der Kar et
Lissaur van West contre France du 7 novembre 2000;
requêtes n°44952/98 et 44953/98 et la décision de recevabilité Malve contre France du 20
janvier 2001; requête n° 46051/99) ()
En conséquence, dès lors qu'une
requête dénonçant la durée d'une procédure devant les juridictions
administratives françaises a été introduite devant la Cour avant le 1er janvier
2003, elle est recevable, peu importe que le requérant ait, par la suite,
pour une raison ou une autre, la possibilité d'engager au plan interne le recours dont il est question.
§22: En résumé, tout grief tiré
de la durée d'une procédure devant les juridictions administratives introduit
devant la Cour le 1er janvier 2003 ou après cette date sans avoir préalablement
été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours en
responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du Service Public de la
justice est irrecevable, quelque soit l'état de la procédure au plan interne"
Maugee contre France du 14/09/2004 requête 65902/01
"A. Sur la recevabilité:
§23: Le
Gouvernement soutient, à titre principal, que le grief est irrecevable en
raison du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le
requérant disposait en droit interne d’un recours efficace permettant de
dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation, à savoir le recours
en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public
de la justice. Il se réfère à la jurisprudence du Conseil d’Etat (Darmont,
Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542 et Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice c. Magiera, Assemblée, 28 juin 2002), et de la Cour (Brusco c. Italie
(déc.), no
69789/01, 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX) et Nogolica c. Croatie (déc.), no
77784/01, 5 septembre 2002, CEDH 2002-VIII).
§24: Le requérant
conclut au rejet de l’exception.
§25: La Cour
renvoie à l’arrêt Broca et Texier-Micault c. France du 21 octobre 2003 (nos
27928/02 et 31694/02), dans lequel elle a jugé que, pour les griefs tirés de
la durée d’une procédure devant les juridictions administratives françaises,
le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du
service public de la justice a acquis, le 1er janvier 2003, le
degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux
fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Tout grief de cette nature
introduit devant la Cour le 1er janvier 2003 ou après cette date
sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre
d’un tel recours est irrecevable ; il en va à l’inverse des griefs introduits
avant cette date.
§26: La
Cour ayant été saisie de la présente affaire le 6 novembre 2000, soit avant le
1er janvier 2003, il ne saurait être reproché au requérant de ne
pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception
soulevée par le Gouvernement"
B. Sur
le fond
§37: La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par
sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige
pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC],
no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
§38: La
Cour constate en premier lieu qu’une part importante des ressources du
requérant est constituée de sa pension d’invalidité. Le litige, qui tendait à
une amélioration de celle-ci au vu de la dégradation de l’état de santé de
l’intéressé, avait en conséquence pour lui un enjeu important, justifiant une
diligence particulière de la part des autorités (voir, mutatis mutandis
l’arrêt Mocie c. France du 8 avril 2003, no 46096/99, § 22).
§39: La
Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté sérieuse. Elle
constate que le requérant, en demandant une contre-expertise en première
instance, n’a pas provoqué de retard notable dans le déroulement de la
procédure (un peu plus de quatre mois en l’occurrence, puisque le rapport
aurait dû être établi dans un délai de trois mois), et qu’aucun autre délai ne
lui est imputable. En particulier, il ne ressort pas du dossier que le
requérant, qui a fait appel et auquel on ne saurait reprocher d’avoir tiré
pleinement parti des voies de recours internes existantes (voir notamment
Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117,
p. 63, § 68), ait retardé le déroulement de la procédure devant la cour
d’appel. La Cour relève, par contre, plusieurs périodes d’inactivité
imputables aux juridictions internes, outre celles évoquées par le
Gouvernement (§ 31 ci-dessus). De tels retards peuvent notamment être
constatés dans le délai de onze mois et vingt-cinq jours entre la saisine du
tribunal départemental et la désignation d’un expert par ce tribunal, le
25 mars 1993, dans le délai de dix mois et deux jours pris par l’expert,
désigné le 27 janvier 2004, pour déposer son rapport (qui devait être établi
en trois mois), le 29 novembre 1994, et dans le délai de neuf mois et
vingt-neuf jours qui sépare ce dépôt du jugement, rendu le 28 septembre 1995.
Il en va de même du délai d’un an et dix sept jours pris, en appel, entre le
21 février 1997, date à laquelle fut ordonné le rapport d’expertise (devant
être établi en deux mois) et le dépôt de ce rapport, le 10 mars 1998.
§40: En
second lieu, la Cour est d’avis qu’une durée globale de plus de neuf ans dans
ce type d’affaire ne saurait, en soi, être considérée comme répondant aux
exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention"
Watt contre France du 28/09/2004, requête 71377/01
17. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par
sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige
pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18. La Cour estime
que la présente affaire ne présentait aucune complexité particulière. Elle
relève, par contre, de longues périodes d'inactivité imputables aux
juridictions internes (voir paragraphes 8 et 9 ci-dessus).
19. La Cour a
traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à
celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention (voir Frydlender précité).
20. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
Braillon contre France du 24/01/2006, requête 32929/02
"17. La Cour renvoie à l’arrêt
Broca et Texier-Micault c.
France du 21 octobre 2003 (nos 27928/02 et
31694/02), dans lequel elle a jugé qu’en matière de durée d’une procédure
devant les juridictions administratives françaises, le recours en
responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de
la justice a acquis, le 1er janvier 2003, le degré de certitude
juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article
35 § 1 de la Convention. Tout grief de cette nature introduit devant la Cour
à compter du 1er janvier 2003 sans avoir préalablement été soumis
aux juridictions internes dans le cadre d’un tel recours est irrecevable ;
il en va autrement des griefs introduits avant cette date.
En
l’espèce, la Cour ayant été saisie de la présente affaire le
30 juillet 2002, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir
usé de ce recours.
18. Il convient donc de rejeter cette exception préliminaire.
19. La
Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de
l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le
fond
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une
procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de
l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes
ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup
d’autres, Frydlender c.
France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions
semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6
§ 1 de la Convention (voir
Frydlender, précité).
22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et en
particulier la complexité du cas soumis en l’espèce aux juridictions
internes et l’enjeu pour la requérante, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa
jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai
raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Donnadieu contre France du 7/02/2006, requête 19249/02
"44. La Cour
rappelle en premier lieu que l’article 6 est applicable à la procédure en
annulation du refus de communication par le CHU de documents administratifs
et médicaux concernant l’internement du requérant (voir
Loiseau c. France (déc.), no
46809/99, § 7, 18 novembre 2003). Elle rappelle ensuite que le caractère
raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances
de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en
particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et
celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les
intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres,
Frydlender c. France [GC],
no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
1. Détermination de la durée de la procédure
administrative en annulation du refus de communication par le CHU de
documents relatifs à l’internement du requérant
45. La Cour
relève que seule la décision prise par la CADA dans le cadre d’une troisième
saisine par le requérant, le 4 janvier 1999, qui lui avait été notifiée le 6
avril 1999, a fait l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif le
19 avril 1999. La saisine de la CADA ne revêt le caractère de recours
préalable obligatoire que dans le cadre de cette troisième saisine (X.
c. France, précité, § 31) et seule la durée de trois mois qui
y est relative doit donc être prise en considération. Quant à la phase
juridictionnelle de cette procédure, elle s’est achevée le 3 janvier 2005
par l’arrêt de la cour administrative de Marseille.
La Cour observe
que la première instance a connu une période d’inactivité de deux ans et
trois mois après la réception du dernier mémoire du requérant et que la
durée globale de la procédure est de six ans pour un recours préalable et
deux degrés d’instance.
2. Détermination de la durée de la procédure administrative en réparation
du préjudice subi du fait de la communication tardive des documents précités
46. La Cour
constate que cette procédure a débuté le 14 avril 1999, date du recours
préalable en indemnisation auprès du CHU (X.,
précité, § 31) et s’est achevée le 3 janvier 2005. Elle relève en
particulier que la première instance a duré trois ans et six mois. La durée
globale de la procédure est donc de cinq ans et plus de huit mois pour une
demande préalable et deux degrés d’instance.
47. La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables aux
deux procédures visées en l’espèce et a constaté la violation de l’article 6
§ 1 de la Convention. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été
soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en
l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas
à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de
l’article 6 § 1 de la Convention."
Barillon contre France du 09/02/2006, arrêt 22897/02
"1. Sur la
recevabilité
16. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement de la voie de recours interne en
responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de
la justice.
17. La Cour
renvoie à l’arrêt Broca et
Texier-Micault c. France du 21 octobre 2003 (nos
27928/02 et 31694/02), dans lequel elle a jugé qu’en matière de durée d’une
procédure devant les juridictions administratives françaises, le recours en
responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de
la justice a acquis, le 1er janvier 2003, le degré de certitude
juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article
35 § 1 de la Convention. Tout grief de cette nature introduit devant la Cour
à compter du 1er janvier 2003 sans avoir préalablement été soumis
aux juridictions internes dans le cadre d’un tel recours est irrecevable ;
il en va autrement des griefs introduits avant cette date.
En l’espèce, la
Cour ayant été saisie de la présente affaire le 7 juin 2002, il ne saurait
être reproché à la requérante de ne pas avoir usé de ce recours.
18. Il
convient donc de rejeter cette exception.
19. La
Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de
l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
2. Sur
le fond
20. La période
à considérer a débuté le 24 juillet 1997 et s’est terminée le 25 mai 2004,
durant ainsi plus de six ans et dix mois pour trois instances.
21. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par
sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige
pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres,
Frydlender c. France [GC],
no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22. Après
avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, en particulier la
complexité du cas soumis en l’espèce aux juridictions internes, et compte
tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la
procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention"

LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ÉTAT FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat a, dans son arrêt "Garde des Sceaux ministre
de la justice contre Magiera du 28 juin 2002" intégralement reproduit ci dessous définit clairement l'étendue matérielle de sa jurisprudence.
Il ne s'agit pas seulement de
considérer les procédures qui concerne des "contestations sur des droits et
obligations de caractère civil" dans le cadre de l'article 6§1 de la
Convention mais de toutes les procédures pourvu qu'elles aient causé un dommage moral ou matériel à l'intéressé.
Matériellement, la simple perte de
chance suffit. Moralement, la simple préoccupation trop longue causée par la
durée "non raisonnable", suffit. Le préjudice matériel est réparé
alors que la C.E.D.H ou les juridictions judiciaires ne réparent que le préjudice moral.
Conseil d'Etat
statuant au contentieux
N° 239575 Publié au Recueil Lebon
EN ASSEMBLEE
Mlle Vialettes, Rapporteur
M. Lamy, Commissaire du gouvernement
M. Denoix de Saint Marc, Président
Lecture du 28 juin 2002
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu le recours, enregistré le 31 octobre 2001 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA
JUSTICE ; le GARDE DE SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, sans renvoi, l'arrêt en date du 11 juillet 2001
par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 24
juin 1999 du tribunal administratif de Paris et a condamné l'Etat à verser à M.
Pierre X... une indemnité de 30 000 F à raison du préjudice né du délai excessif
de jugement d'un précédent litige et une somme de 10 000 F au titre des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. X... devant la cour
administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative
d'appel de Paris, après avoir constaté que la procédure que M. X... avait
précédemment engagée à l'encontre de l'Etat et de la société "La Limousine" et
qui avait abouti à la condamnation de ces défendeurs à lui verser une indemnité
de 78 264 F, avait eu une durée excessive au regard des exigences de l'article
6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, a condamné l'Etat à verser à M. X... une
indemnité de 30 000 F pour la réparation des troubles de toute nature subis par
lui du fait de la longueur de la procédure ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que l'arrêt énonce avec précision les raisons pour
lesquelles la cour a estimé que la durée de la procédure avait été excessive et
que l'Etat devait réparation à M. X... du préjudice qui avait pu en résulter ;
que la cour administrative d'appel a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité de l'arrêt attaqué :
Sur le moyen relatif aux conditions d'engagement de la
responsabilité de l'Etat :
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
soutient, d'une part, que la cour a commis une erreur de droit en estimant la
responsabilité de l'Etat automatiquement engagée dans le cas où la durée d'une
procédure aurait été excessive, d'autre part, qu'elle a commis une autre erreur
de droit ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier en ce qui concerne les
critères qu'elle a retenus pour juger anormalement longue la durée de la
procédure en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (.) qui
décidera (.) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(.)" ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : "toute personne
dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention, ont été violés
a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles" ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations, lorsque le
litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des
principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions
administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient
jugées dans un délai raisonnable ;
Considérant que si la méconnaissance de cette obligation est
sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue
de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le
respect ; qu'ainsi lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de
jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage
ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Considérant qu'après avoir énoncé que la durée de la procédure
avait été excessive, la cour administrative d'appel en a déduit que la
responsabilité de l'Etat était engagée vis-à-vis de M. X... ; que, ce faisant,
loin de violer les textes et les principes sus rappelés, elle en a fait une
exacte application ;
Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement
d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale - compte tenu,
notamment, de l'exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en
compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en
particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi,
dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments,
l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation
particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa
nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ;
Considérant que pour regarder comme excessif le délai de
jugement du recours de M. X..., la cour administrative d'appel de Paris énonce
que la durée d'examen de l'affaire devant le tribunal administratif de
Versailles a été de 7 ans et 6 mois pour "une requête qui ne présentait pas de
difficulté particulière" ; qu'en statuant ainsi, la cour, contrairement à ce que
soutient le ministre, a fait une exacte application des principes rappelés
ci-dessus ;
Sur le moyen relatif aux conditions d'appréciation de
l'existence d'un préjudice :
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
soutient que la cour ne pouvait se borner à constater "une inquiétude et des
troubles dans les conditions d'existence" mais devait rechercher si un préjudice
pouvait être caractérisé compte tenu de la nature et de l'enjeu du litige ainsi
que de l'issue qui lui avait été donnée ;
Considérant que l'action en responsabilité engagée par le
justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit
permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux,
directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se
trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que peut
ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d'un
avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit ;
que peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la
durée abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel
et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte
tenu notamment de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a
estimé, par une appréciation souveraine, que M. X... avait subi, du fait de
l'allongement de la procédure, "une inquiétude et des troubles dans les
conditions d'existence" dont elle a chiffré la somme destinée à en assurer la
réparation à 30 000 F ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que,
contrairement à ce que soutient le ministre, la cour administrative d'appel de
Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE
DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à demander l'annulation de
l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 2001 ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est
rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Pierre X....
|

MODÈLE GRATUIT DE RECOURS GRACIEUX AU MINISTRE
Vous pouvez saisir le ministre de la justice garde des sceaux d'un recours gracieux. Quelque soit la décision
du ministre de la justice, votre recours gracieux aura pour conséquence de faire "avancer" votre dossier devant les juridictions administratives.
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou
modifiez le texte comme vous le souhaitez.
|
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DU
RECOURS
GRACIEUX A MADAME LA MINISTRE DE LA JUSTICE
A: MADAME LA
MINISTRE DE LA JUSTICE
13 Place
Vendôme
75042 Paris
cedex 01
Pour :
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le:
à:
demeurant:
EXPOSE DE LA
DEMANDE
Les faits:
Le droit:
L'article 6§1
de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme prévoit en ses
termes compatibles:
"Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue () dans un délai raisonnable () par un Tribunal
() qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre
elle"
La célèbre
jurisprudence Magiera contre ministre de la justice rendue par le Conseil d'Etat
le 28 juin 2002 prévoit la réparation du préjudice moral et matériel causé
par un délai non raisonnable d'une procédure administrative.
Cet arrêt ne concerne
pas seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger
les affaires en état de l'être, mais aussi plus largement, de tout manquement de
l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le
droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai
raisonnable conformément à l'article 6§1 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme.
L'existence d'un tel
délai s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce.
Il y a lieu en
particulier, de prendre en considération:
-le délai global de
l'affaire par rapport à sa nature;
-son degré de
complexité;
-le comportement de la
partie qui se plaint de la durée de la procédure,
-le comportement et les
délais de latence commis par les autorités judiciaires
-l'enjeu de la
procédure pour la partie qui se plaint.
DISCUSSION:
La procédure a
débuté le
pour se
terminer le
(ou n'est pas
encore terminée)
le délai
global pris dans son ensemble est de
Il est
beaucoup trop long pour une affaire de cette nature et la simple constatation de
ce délai global suffit à le qualifier de "non raisonnable".
L'AFFAIRE
N'EST PAS COMPLEXE:
Il s'agit
simplement de:
NOUS N'AVONS
RIEN FAIT QUI PUISSE PROLONGER LA PROCÉDURE:
Nous avons
seulement usé de nos droits de recours:
Cet usage ne
peut pas nous être reproché, sans partialité.
Bien au
contraire, nous avons essayé de faire accélérer la procédure:
EN REVANCHE
LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ONT COMMIS DES "DELAIS DE LATENCE" ENTRE CHAQUE
ACTE:
Entre le
Et le
Il y a eu un
délai de
Entre le
Et le
Il y a eu un
délai de
L'addition de
ces délais fait apparaître un délai total de :
pendant lequel
il ne s'est strictement rien passé !
L'ENJEU DU LITIGE EST IMPORTANT POUR MOI :
PAR CES CONSIDÉRATIONS:
Et tous autres à déduire et suppléer même d'office, il est sollicité qu'il vous plaise (Madame
Monsieur le la) ministre
de la Justice d'organiser une inspection du service devant lequel, le délai non raisonnable
est commis.
Il est sollicité qu'il vous plaise de m'accorder la somme de:
en réparation du préjudice moral subi par le délai non raisonnable de la procédure;
la somme de:
en réparation du préjudice matériel subi par le délai non raisonnable de la procédure.
Il est aussi sollicité qu'il vous plaise, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs,
de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour mettre fin à la procédure.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre de la justice, l'expression de mon profond respect.
signature du demandeur
BORDEREAU DE COPIES DE PIECES
DE LA PROCEDURE POUR DEMONTRER SON "DELAI NON RAISONNABLE
1/
2/
3/ |

LE RECOURS AU CONSEIL D'ÉTAT
Après un délai de deux mois mais avant un délai de quatre mois, il faut déposer une requête au Conseil
d'État pour délai non raisonnable d'une procédure administrative et demander des dommages et intérêts.
UN RECOURS DOIT ÊTRE INTRODUIT AUPRÈS DU CONSEIL D'ÉTAT PAR MINISTÈRE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR DE CASSATION
Article R 311-1 du Code de Justice Administrative
Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
(-)
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
Article R 431-2 du code de justice administrative :
"Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité,
être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les
conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le
paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui."
 <
<
UNE REQUÊTE PEUT ENSUITE ÊTRE POSTÉE A LA LA CEDH
Sarl le Club et autres c. France du 20 juillet 2017 Requêtes n° 31386/09 et 22854/11
Délai non raisonnable, la CEDH condamne après un recours au Conseil d'État contre la longueur d'une procédure administrative française.
Si la procédure interne n'a pas permis la réparation, vous pouvez saisir la CEDH.
Épuisement des voies de recours
68. Le Gouvernement soutient que les requérants dans la
requête no31386/09
n’ont pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où ils n’ont pas
formé de pourvois en cassation contre les arrêts de la cour administrative
d’appel de Marseille des 22 janvier 2001 et 30 mars 2004 (paragraphes 15 et 19 ci-dessus).
69. Les requérants rappellent que le principe de
l’épuisement des voies de recours internes ne concerne que la procédure de
réparation des violations alléguées, et non pas les procédures elles-mêmes à
propos desquelles il est demandé réparation. Ils soulignent qu’en l’espèce,
après avoir adressé une demande préalable d’indemnisation au ministre de la
justice, ils ont saisi la juridiction administrative d’une action au terme de
laquelle le Conseil d’État a reconnu le non-respect du délai raisonnable
concernant la procédure engagée le 24 juin 1996.
70. La Cour relève que l’exception du Gouvernement vise
les deux procédures principales engagées par les requérants (paragraphes 10-19
ci‑dessus). Elle observe que ces derniers ont, conformément à sa jurisprudence (Broca
et Texier-Micault c. France, nos27928/02
et31694/02,
§ 22, 21 octobre 2003) porté devant les juridictions administratives leur grief
relatif à la durée de ces procédures et que le Conseil d’État a statué en
dernier lieu sur leurs demandes d’indemnisation. Ils ont dès lors épuisé les
voies de recours internes.
71. Il y a donc lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
3. Conclusion
72. La Cour constate que le surplus des requêtes n’est
pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et
qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
SUR LE FOND
73. Les requérants réitèrent leur grief selon lequel la
durée des procédures litigieuses a dépassé le délai raisonnable, sans qu’ils y
contribuent par leur comportement.
74. Le Gouvernement considère que, pour ce qui est de la
requête no31386/09,
la durée de la première procédure principale, évaluée par le Conseil d’État à
quatre ans et sept mois pour deux degrés de juridiction, n’était pas excessive
au regard des critères posés par la jurisprudence de la Cour. S’agissant de la
requête no22854/11,
le Gouvernement reconnaît la violation du droit à un délai raisonnable de
jugement, mais estime que les juridictions nationales l’ont redressée de manière
appropriée et suffisante.
75. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité
de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes
ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres,
Frydlender c. France
[GC], no30979/96,
§ 43, CEDH 2000-VII).
76. S’agissant de la requête no31386/09,
la Cour relève que la première procédure principale a débuté le 14 septembre
1995, date de la demande préalable d’indemnisation et a pris fin le 22 janvier
2001, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel, soit une durée de cinq
ans et plus de quatre mois pour deux degrés de juridiction. La Cour note par
ailleurs que l’affaire n’était pas particulièrement complexe et que le
comportement des requérants n’a pas contribué aux délais.
77. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir
Frydlender précité).
78. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
79. Pour ce qui est de la requête no22854/11,
la Cour observe que la procédure principale a débuté le 5 octobre 1995, date de
la demande préalable d’indemnisation et a pris fin le 16 novembre 2005, soit une
durée de dix ans et plus d’un mois pour trois niveaux de juridiction. La Cour
relève également que le Conseil d’État a considéré excessive la durée de cette
procédure, qui ne présentait pas de difficulté particulière et dans laquelle le
requérant n’avait pas eu de comportement dilatoire. Le Gouvernement a également
reconnu la violation du droit du requérant à un délai raisonnable de jugement.
80. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et
ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle conclut en conséquence qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
GOUTTARD C.FRANCE DU 30 juin 2011 Requête 57435/08
LA PROCEDURE INTERNE DE REPARATION DU DELAI
25. Le 15 janvier 2007, le requérant adressa un recours gracieux au
Garde des Sceaux tendant à l'indemnisation des différents chefs de
préjudices subis en raison du caractère excessivement long de la procédure.
26. Le 15 mars 2007, une décision implicite de rejet intervint. Le
requérant forma alors un pourvoi devant le Conseil d'Etat à l'encontre de
cette décision.
27. Puis, par une décision du 15 mai 2007, le Garde des Sceaux fit
partiellement droit à la demande du requérant et proposa une indemnisation
de 1 000 euros (EUR) au titre du préjudice subi par le requérant dans ses
conditions d'existence en raison de la longueur excessive de la procédure
devant les juridictions administratives. Il estima cette somme eu égard au
« caractère limité du dépassement du délai » de la procédure. Le requérant
forma un pourvoi à l'encontre de cette décision.
28. Par un arrêt du 21 mai 2008, le Conseil d'Etat, se prononçant sur
les décisions des 15 mars et 15 mai 2007, débouta le requérant au motif que
la durée de six ans et onze mois pour trois instances n'était pas excessive.
LA DÉCISION DE LA CEDH
34. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de
l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes
ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres,
Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
35. La Cour rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans
un délai raisonnable. Une telle célérité est particulièrement nécessaire en
matière de litiges relatifs à l'emploi, appelant par nature une décision
rapide, compte tenu de l'enjeu de la procédure pour l'intéressé, sa vie
personnelle et familiale ainsi que sa carrière professionnelle (Kalfon c. France, no 23776/07, § 34, 29 octobre 2009).
36. En l'espèce, la Cour constate que l'affaire ne présentait pas de
complexité particulière et que l'enjeu du litige pour le requérant était
important puisqu'il a dû attendre presque sept années pour s'installer comme
exploitant agricole. Par ailleurs, la Cour note que celui-ci n'a pas
contribué à ralentir le cours de la procédure. Enfin, s'agissant du
comportement des autorités, si les délais écoulés devant le tribunal
administratif et devant le Conseil d'Etat ne présentent pas de retards
significatifs, celui de trois ans et demi pour la procédure devant la cour
administrative d'appel a dépassé le délai raisonnable.
Eu égard à ce qui précède, il y a eu violation de l'article 6 § 1.



DÉLAI NON RAISONNABLE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites sur :
- LE DÉLAI NON RAISONNABLE DOIT ÊTRE LE FAIT DE LA JURIDICTION
- L'OBLIGATION D'ÉPUISER LES VOIES DE RECOURS INTERNES
- LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
- LE MODÈLE GRATUIT DE RECOURS GRACIEUX AU MINISTRE DE LA JUSTICE
ET A L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
- L'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL
JUDICIAIRE POUR FAUTE LOURDE DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
- APRÈS ÉPUISEMENT, UNE REQUÊTE PEUT ENSUITE ÊTRE POSTÉE A LA LA CEDH
LE DÉLAI NON RAISONNABLE DOIT ÊTRE LE FAIT DE LA JURIDICTION
Arrêt J.M.F contre France du 01/06/2004; Hudoc
5107; requête 42268/98 qui concerne un délai de 14 ans pour une affaire devant
le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Arrêt Mutimura contre France 08/06/2004; Hudoc 5120; requête 46621/99 concernant une information pénale de 9 ans.
Arrêt Authouart contre France du 8 novembre 2005 Requête no 45338/99
"44. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent. En particulier, elle relève que
l’affaire n’était pas particulièrement complexe, que l’affaire a été confiée
à cinq magistrats instructeurs successifs, dont aucun n’a eu la charge du
dossier plus de deux ans et que certains d’entre eux se sont abstenus de
tout acte pendant de longues périodes : ainsi, le premier magistrat chargé
de l’affaire n’a rendu aucun acte en un an, six mois et vingt-deux jours ;
le troisième a juste ordonné une commission rogatoire et adressé une réponse
à l’avocat de la partie civile en un an et sept mois. Par ailleurs, le délit
d’abus de confiance, infraction principale visée dans la plainte de 1985,
n’a fait l’objet d’un réquisitoire supplétif du parquet que le 20 octobre
1992 (suite à la demande en ce sens du quatrième juge d’instruction), tandis
que l’escroquerie, seule visée dans le réquisitoire introductif du 31
juillet 1987, a finalement été écartée avant renvoi devant le tribunal
correctionnel. Enfin, le requérant ne saurait se voir reprocher son
comportement qui, nonobstant le fait qu’il ait opposé son activité
professionnelle à l’étranger pour ne pas se rendre aux convocations et qu’il
ait formulé des demandes de renvoi, ne suffit pas à expliquer une durée
d’instruction de presque cinq ans dans les circonstances de l’espèce.
45. Compte tenu
de sa jurisprudence en la matière, eu égard aux circonstances de la cause et
à la procédure prise dans son ensemble, la Cour estime qu’en l’espèce la
durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1."
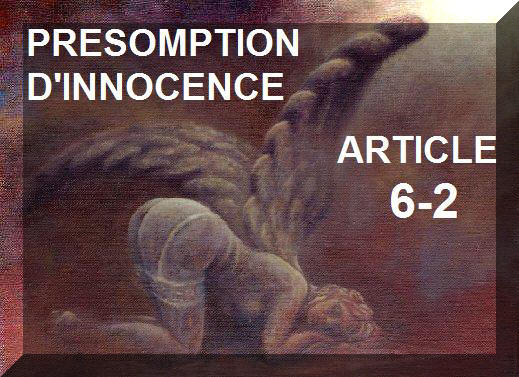
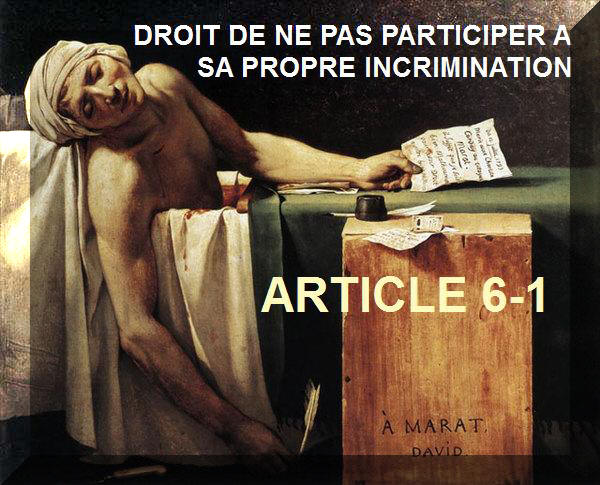
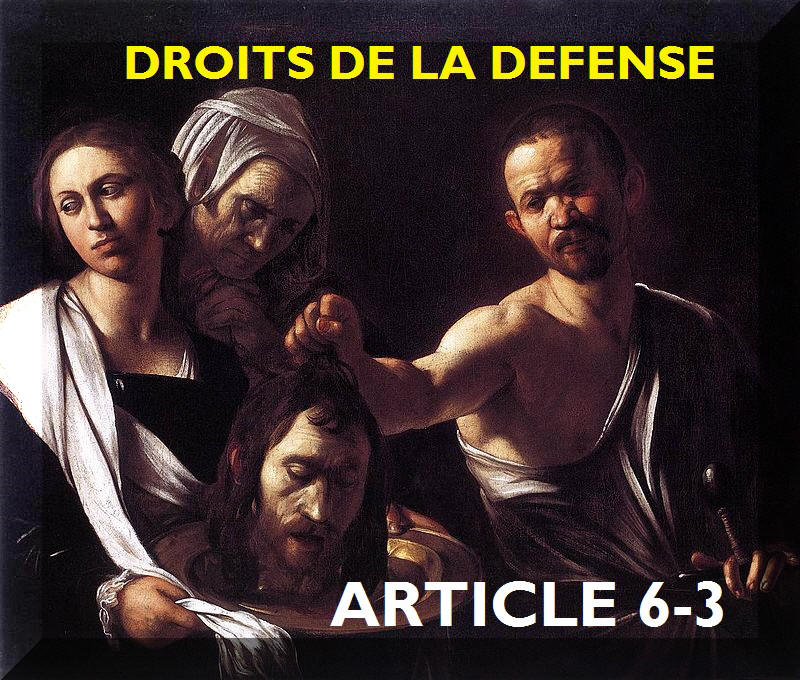
L'OBLIGATION D'ÉPUISER LES VOIES DE RECOURS INTERNES
La C.E.D.H a constaté
l'existence de l'arrêt Gauthier rendu par la Cour d'Appel de Paris le 20 janvier 1999 en matière de délai non
raisonnable d'une procédure concernant l'application d'un contrat de travail.
Elle l'a considéré définitif le 20 mars 1999 puisque, dans le délai de deux
mois, aucun pourvoi en cassation n'a été formé.
Elle l'a considéré définitif
devant sa juridiction le 20 septembre 1999 puisque l'article 35§1 de la
Convention édicte :
"la Cour ne peut être saisie que () dans le délai de six
mois à partir de la date de la décision interne définitive".
Monsieur
Gauthier n'a pas saisi la C.E.D.H après l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.
Décision de recevabilité Van der Kar et Lissaur
Van West contre France
du
07/11/2000 requêtes 44952/98 et 44953/98
"La
Cour rappelle que l'épuisement des recours internes s'apprécie, sauf exceptions,
à la date d'introduction de la requête devant la Cour. Or, en l'espèce, elle
note que l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris (arrêt Gauthier) du
20/01/1999 ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement sont
postérieurs à l'introduction des requêtes, à savoir le 2 décembre 1998.
Par conséquent, il ne saurait
être reproché aux requérantes de n'avoir pas épuisé, avant de saisir la Cour, un
recours qui ne présentait pas, à ce moment là, les caractères de certitude et
l'efficacité requis.
Partant, l'exception de non
épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue"
Décision d'irrecevabilité Giummara
contre France du 12/06/2001 requête 61166/00
"Les dispositions de l'article 35 de la
Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux
violations incriminées, disponibles, adéquats. Ils doivent exister à un degré
suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans
quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ()
Elle (la Cour)
considère que, à la date du 20 septembre 1999, l'arrêt Gauthier
(d'ailleurs commenté dans les revues juridiques dès février 1999) avait fait
jurisprudence, et que le recours de l'article L 781-1 du C.O.J avait acquis à
cette même date un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir
être utilisé aux fins du même article 35§1 de la Convention"
Décision
d'irrecevabilité Mifsud contre France du 11/09/2002 requête 57220/00
"Les dispositions de l'article 35§1 de la Convention même
prescrivent cependant que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux
violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré
suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans
quoi leur manquent l'effectivité voulues, il incombe à l'Etat défendeur de
démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Vermillo contre France et
Dalia contre France)
Au vu de l'évolution
jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours
fondé sur l'article L 781-1 du C.O.J peuvent se remédier à une violation
alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un "délai raisonnable" au sens
de l'article 6§1 de la Convention lorsque la procédure litigieuse est achevée au
plan interne (Van der Kar et Lissaur Van West contre France) voir ci-dessus.
Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le
degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux
fins de l'article 35§1 de la Convention.
Il est donc établi que, lorsqu'une
procédure judiciaire est achevée au plan interne au jour de la saisine de la
Cour et que cette saisine est postérieure au 20/09/1999, un grief tiré de la
durée de cette procédure est irrecevable si le requérant ne l'a pas
préalablement vainement soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un
recours fondé sur l'article L 781-1 du C.O.J.
Il ressort clairement des
jugements et arrêts auxquels se réfèrent le Gouvernement, que le droit positif
ne distingue pas les procédures pendantes des procédures achevées : quelque soit
l'état de la procédure dont la durée apparaît excessive, l'article L 781-1 du C.O.J permet au justiciable d'obtenir un constat de manquement à son droit de
voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ainsi que la réparation du préjudice en résultant.
La circonstance que ce recours, purement
indemnitaire, ne permet pas d'accélérer une procédure en cours n'est pas
déterminante. La Cour rappelle à cet égard qu'elle a jugé que les recours dont
un justiciable dispose au plan interne pour se plaindre de la durée d'une
procédure sont "effectifs" au sens de l'article 13 de la Convention lorsqu'il
permettent "d'empêcher la survenance ou la continuation de la violation
alléguée ou (de) fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute
violation s'étant déjà produite" (Kudla contre Pologne)
L'article 13 ouvre donc une option en la
matière; un recours est "effectif" dès lors qu'il permet soit de faire
intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au
justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés. Selon la
Cour, vu les "étroites affinités" que présentent les articles 13 et 35§1 de la
Convention () il en va nécessairement de même pour la notion de recours
"effectif" au sens de cette seconde disposition"
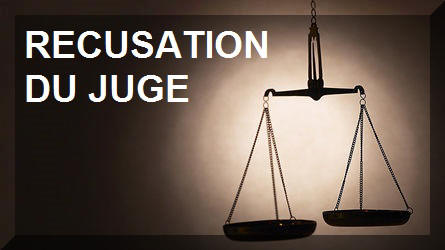

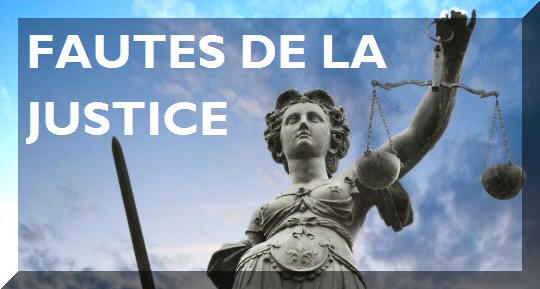
LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
La loi du 20 décembre 2007 a inséré de nouveaux articles dans le Code de l'Organisation judiciaire:
Art. L. 141-1 du COJ
L'État est tenu de
réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions
particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou
par un déni de justice.
Art. L. 141-2 du COJ
La responsabilité des
juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
- s'agissant des
magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature
- s'agissant des autres
juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Art. L. 141-3 du COJ
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours
de l'instruction, soit lors des jugements ;
2° S'il y a déni de justice.
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
L'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui
sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre
ces derniers.
La loi
du 20 décembre 2007 fait la différence entre les magistrats professionnels du
corps judiciaires et les autres juges judiciaires qui eux, peuvent être
poursuivis personnellement. L'État garantit alors civilement les condamnations
au profit du justiciable lésé. Quand la faute est causée par un magistrat
professionnel de l'ordre judiciaire, le justiciable n'a qu'un seul recours fondé
sur l'article L141 -1 du C.O.J. Il ne peut saisir que le Tribunal d'Instance ou
le Tribunal de Grande Instance de Paris contre l'Agent Judiciaire de l'État.
Pour en savoir plus sur la différence entre les magistrats et les autres juges,cliquez ici
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION EST PLUS RESTRICTIVE QUE CELLE DU CONSEIL D'ÉTAT
COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE. 31 janvier 2006. Pourvoi N° 04-10803 REJET
Justifie légalement sa décision au regard
de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire la cour d'appel,
qui a caractérisé la complexité d'un litige résultant de la mise en œuvre de
la coopération judiciaire internationale, l'absence de retard particulier à
la dénonciation d'un crime aux autorités étrangères et précisé que rien ne
permet d'imputer les lenteurs de la procédure à la justice française.
COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE. 4 novembre 2010. Pourvoi N° 09-69776 REJET
Attendu que M. X..., maire de la
commune de Toul et, à ce titre, président de l'office public d'habitation à
loyer modéré de cette ville, a été inculpé le 15 décembre 1989, des chefs de
complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce, complicité
d'abus de biens sociaux, recel de biens sociaux et corruption active et
passive de citoyens chargé d'une mission de service public et a été placé
sous mandat de dépôt; qu'il a été remis en liberté le 29 juin 1990 ; que par
arrêts des 27 octobre 2000 et 7 juin 2001, il a été constaté que les faits
qui avaient pour finalité le financement d'un parti politique et des
campagnes électorales de ses représentants et qui avaient été commis avant
le 11 mars 1988, entraient dans le champ d'application de la loi d'amnistie
du 10 juillet 1988 ; que l'action publique a été déclarée éteinte ; que M.
X... a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L
781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même
code en invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice
Attendu que M. X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2009) de l'avoir débouté de ses demandes
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il n'apparaissait pas des
pièces versées aux débats qu'il était possible, avant le prononcé de l'arrêt
du 27 octobre 2000, de constater qu'aucun enrichissement à des fins
personnelles ne pouvait en définitive être imputé à M. X..., et, par motifs
propres, que c'était l'information et les investigations auxquelles il avait
été procédé qui avaient permis la décision constatant l'extinction de
l'action publique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne saurait
être reproché aux magistrats de ne pas avoir appliqué d'emblée la loi
d'amnistie ; que le grief n'est pas fondé
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, l'importance de l'enquête, les
nombreuses auditions, les rapports des services de police pour démonter les
mécanismes de fausses factures aux fins de recueillir de manière occulte
d'importantes sommes d'argent servant à financer parti politique et
campagnes électorales et pour rechercher la destination précise de ces
sommes, d'autre part, la difficulté pour les juridictions saisies
d'apprécier la portée distributive de l'annulation d'actes d'information, la
cour d'appel a caractérisé la complexité de l'affaire et justement constaté
que la durée de la procédure n'était pas déraisonnable au sens de l'article
6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme
COUR DE CASSATION 1ère
CHAMBRE CIVILE. 4 novembre 2010. Pourvoi N° 09-69955 CASSATION
Attendu que, le 21
février 1991, une plainte avec constitution de partie civile désignant
nommément M. X... a été déposée pour abus de biens sociaux ; que le 27
octobre 1992 le procureur de la République près le tribunal de grande
instance d'Evreux a requis l'ouverture d'une information "contre toute
personne que l'information fera connaître" ; que le 29 mars 1993 un juge
d'instruction a donné une commission rogatoire au SRPJ de Rouen qui, le 5
octobre 1993, a entendu M. X... en qualité de témoin ; que M. X... a été mis
en examen le 4 décembre 1997 et entendu le 12 mars 1998 ; que, par
ordonnance du 12 mai 1999, le juge d'instruction a renvoyé M. X... devant le
tribunal correctionnel d'Evreux qui, par jugement du 16 janvier 2001,l'a
déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné ; que,
par arrêt du 17 décembre 2001, la cour d'appel de Rouen a infirmé ce
jugement et prononcé la relaxe de M. X... ; que le pourvoi formé contre cet
arrêt a été déclaré non admis par un arrêt du 11 juin 2002 ; que M. X... a
recherché la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service
public de la justice au motif que les délais de traitement de la procédure
avaient été anormalement longs et constituaient un déni de justice ; qu'un
tribunal a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. X... la somme
de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour réduire à 4 000 euros le montant des dommages-intérêts,
l'arrêt attaqué retient que le délai à prendre en compte n'a commencé à
courir que le 4 décembre 1997 date à laquelle M. X... a été mis en examen ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été entendu le 5 octobre 1993
par les services de police agissant sur commission rogatoire du juge
d'instruction et que, même s'il l'avait été en qualité de témoin, il s'était
trouvé, dès cette date, en situation de s'expliquer sur la portée des
accusations dont il faisait l'objet, de sorte que l'accusation, au sens de
l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel
qu'interprété à cet égard par la Cour européenne des droits de l'homme dans
son arrêt du 11 février 2010, résultait de cette audition qui avait eu une
répercussion importante sur sa situation, la cour d'appel a violé les textes
susvisés
Un délai non raisonnable n'a aucune
incidence sur le fond du litige. Il ne peut y avoir indemnisation sur le
fond, par le service public de la justice, à la place de la partie adverse.
En matière pénale, un délai non raisonnable ne peut avoir pour conséquence
la nullité de la procédure.
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 24 avril 2013 pourvoi n° 12-82863 Cassation
Attendu qu'il se déduit de ces textes que, si la méconnaissance du délai
raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la
validité des procédures
Attendu qu'après avoir rappelé la réalité des faits reprochés aux prévenus
mais portés devant la cour d'appel dix ans plus tard, l'arrêt attaqué énonce que
la procédure n'a pas suivi un cours normal, en ce que des périodes d'inactivité
sont imputables à l'autorité judiciaire qui n'a, à aucun moment, pris en compte
la situation des prévenus, que cette situation est contraire à l'article 6 § 1
de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il convient d'annuler la
procédure, en faisant droit aux conclusions de la défense ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes
susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
Seules les conséquences du délai non-raisonnable, peuvent être réparées par le service public de la justice.
QUAND LES MOYENS DONNÉS A LA JUSTICE SONT EN CAUSE, L'ÉTAT PEUT ÊTRE CONDAMNÉ
Cour de Cassation chambre civile 1,
arrêt du 6 juillet 2011 N° de pourvoi 10-23897 cassation
Vu l'article
L. 141-1 du code de
l'organisation judiciaire ;
Attendu que lorsqu'elles ont le même objet, une procédure pénale et une
procédure civile qui se sont succédé doivent être considérées dans leur ensemble
pour apprécier le caractère raisonnable des délais de jugement ;
Attendu que M. X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 21 mars
1993, a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 27 mars 1996 ;
que par arrêt du 17 mai 2001, M. Y..., gérant de fait de la société qui
l'employait, a été pénalement condamné pour le délit de blessures involontaires
; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 22 juin 2002 ; que le 12
septembre 1997, M. X... a parallèlement saisi un tribunal des affaires de
sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
que par arrêt confirmatif du 3 février 2005 la cour d'appel de Nîmes a reconnu
le caractère inexcusable de la faute commise par Mme Y..., gérante de droit de
la société ; que, par jugement du 13 avril 2006, un tribunal des affaires de
sécurité sociale a ordonné une nouvelle expertise médicale ; que M. X... a fait
assigner l'agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice pour déni
de justice ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que la
preuve d'une déficience du service public de la justice n'était rapportée ni en
ce qui concernait la procédure pénale ni en ce qui concernait la procédure
devant les juridictions des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, en analysant séparément et non globalement les deux
procédures qui tendaient aux mêmes fins, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009,
entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Cour de cassation chambre civile 1
Arrêt du 4 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-69955 Cassation
Vu l'article
L. 141-1 du code de
l'organisation judiciaire, ensemble l'article
6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, le 21 février 1991, une plainte avec constitution de partie civile
désignant nommément M. X... a été déposée pour abus de biens sociaux ; que le 27
octobre 1992 le procureur de la République près le tribunal de grande instance
d'Evreux a requis l'ouverture d'une information "contre toute personne que
l'information fera connaître" ; que le 29 mars 1993 un juge d'instruction a
donné une commission rogatoire au SRPJ de Rouen qui, le 5 octobre 1993, a
entendu M. X... en qualité de témoin ; que M. X... a été mis en examen le 4
décembre 1997 et entendu le 12 mars 1998 ; que, par ordonnance du 12 mai 1999,
le juge d'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel
d'Evreux qui, par jugement du 16 janvier 2001,l'a déclaré coupable des faits qui
lui étaient reprochés et l'a condamné ; que, par arrêt du 17 décembre 2001, la
cour d'appel de Rouen a infirmé ce jugement et prononcé la relaxe de M. X... ;
que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis par un arrêt du 11
juin 2002 ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour
dysfonctionnement du service public de la justice au motif que les délais de
traitement de la procédure avaient été anormalement longs et constituaient un
déni de justice ; qu'un tribunal a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer
à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
Attendu que, pour réduire à 4 000 euros le montant des dommages-intérêts,
l'arrêt attaqué retient que le délai à prendre en compte n'a commencé à courir
que le 4 décembre 1997 date à laquelle M. X... a été mis en examen
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été entendu le 5 octobre 1993 par
les services de police agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction
et que, même s'il l'avait été en qualité de témoin, il s'était trouvé, dès cette
date, en situation de s'expliquer sur la portée des accusations dont il faisait
l'objet, de sorte que l'accusation, au sens de l'article
6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété à cet
égard par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 11 février
2010, résultait de cette audition qui avait eu une répercussion importante sur sa situation, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LA FAUTE PERSONNELLE D'UN MAGISTRAT EST ENFIN RECONNUE
Si le délai avec lequel répond le juge d'instruction est trop long, il y a un délai non raisonnable
qualifié de déni de justice par le TGI de Paris, dans son arrêt de condamnation de l'Agent Judiciaire de
l'Etat du 28 mai 2018.
La motivation de cet arrêt est sans appel pour un délai de cinq ans sans réponse à la partie civile :
"Un tel délai de cinq ans est manifestement excessif et engage ainsi la responsabilité
de l'Etat pour déni de justice, peu important que X ait ou non adressé des relances dès lors que l'institution judiciaire, une fois saisie, est tenue de
répondre spontanément"
LA JURISPRUDENCE ANTERIEURE NE RECONNAISSAIT PAS LA FAUTE PERSONNELLE D'UN MAGISTRAT
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du 17 février 2010 N° de pourvoi 09-10815 Rejet
Attendu que M. et Mme X... ont
emprunté diverses sommes par l'intermédiaire de M. Y..., notaire ; qu'à la suite
d'une saisie-arrêt pratiquée par un de leurs créanciers, porteur d'une copie
exécutoire d'un acte authentique, ils ont, le 28 février 1989, déposé une
plainte avec constitution de partie civile des chefs d'exercice illégal de la
profession de banquier, de faux en écriture authentique et de tentative
d'extorsion de fonds ; que M. Y..., renvoyé le 21 février 1997 devant le
tribunal correctionnel, a été relaxé le 2 juin 1998 ; que, sur appel des seules
parties civiles, ce jugement a été confirmé par une décision cassée par un arrêt
de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 mai 2000 ; que, par un
arrêt du 14 novembre 2001, la cour d'appel de renvoi a constaté que l'action
publique avait été définitivement jugée par le jugement ayant relaxé les
prévenus, infirmé le jugement en ses dispositions civiles, dit que les éléments
constitutifs des délits d'exercice illégal de la profession de banquier et de
faux en écriture authentique étaient réunis à l'encontre de M. Y... et débouté
les parties civiles de leurs demandes après avoir constaté qu'elles ne
justifiaient pas d'un préjudice découlant directement de ces infractions; qu'au
cours de la procédure pénale, des saisies immobilières ont été pratiquées sur
les biens des époux X... ; que ceux-ci ont recherché la responsabilité de l'Etat
pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en invoquant le délai déraisonnable de l'instance pénale ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 25 janvier
2007) d'avoir rejeté leur action en responsabilité contre l'Etat sur le
fondement de l'article L. 781-1 du
code de l'organisation
judiciaire, devenu l'article L.
141-1 du même code ;
Attendu qu'en énonçant que la longueur de la procédure trouvait sa cause dans la
recherche minutieuse de la vérité et dans la mise en jeu des règles protectrices
du droit en faveur du mis en examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre
les parties dans le détail de leur argumentation, a, implicitement mais
nécessairement, jugé que le rapport de MM. Z... et A... déposé en 1988, puis
celui de M. B... déposé en 1992, étaient insuffisants à caractériser les charges
pesant sur M. Y... et que les consultations ordonnées par le juge d'instruction
étaient utiles ; que le moyen ne peut être accueilli
Cour de cassation chambre civile 1
Arrêt du 4 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-69776 Rejet
Attendu que M. X..., maire de
la commune de Toul et, à ce titre, président de l'office public d'habitation à
loyer modéré de cette ville, a été inculpé le 15 décembre 1989, des chefs de
complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce, complicité d'abus
de biens sociaux, recel de biens sociaux et corruption active et passive de
citoyens chargé d'une mission de service public et a été placé sous mandat de
dépôt ; qu'il a été remis en liberté le 29 juin 1990 ; que par arrêts des 27
octobre 2000 et 7 juin 2001, il a été constaté que les faits qui avaient pour
finalité le financement d'un parti politique et des campagnes électorales de ses
représentants et qui avaient été commis avant le 11 mars 1988, entraient dans le
champ d'application de la loi d'amnistie du 10 juillet 1988 ; que l'action
publique a été déclarée éteinte ; que M. X... a recherché la responsabilité de
l'Etat sur le fondement de l'article L 781-1 du
code de l'organisation
judiciaire devenu l'article L.
141-1 du même code
en invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2009) de
l'avoir débouté de ses demandes ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il n'apparaissait pas des pièces
versées aux débats qu'il était possible, avant le prononcé de l'arrêt du 27
octobre 2000, de constater qu'aucun enrichissement à des fins personnelles ne
pouvait en définitive être imputé à M. X..., et, par motifs propres, que c'était
l'information et les investigations auxquelles il avait été procédé qui avaient
permis la décision constatant l'extinction de l'action publique, la cour d'appel
en a exactement déduit qu'il ne saurait être reproché aux magistrats de ne pas
avoir appliqué d'emblée la loi d'amnistie ; que le grief n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, l'importance de l'enquête, les nombreuses
auditions, les rapports des services de police pour démonter les mécanismes de
fausses factures aux fins de recueillir de manière occulte d'importantes sommes
d'argent servant à financer parti politique et campagnes électorales et pour
rechercher la destination précise de ces sommes, d'autre part, la difficulté
pour les juridictions saisies d'apprécier la portée distributive de l'annulation
d'actes d'information, la cour d'appel a caractérisé la complexité de l'affaire
et justement constaté que la durée de la procédure n'était pas déraisonnable au
sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme
UNE AFFAIRE DITE ET QUALIFIÉE DE COMPLEXE N'EST JAMAIS RÉPARÉE POUR UN
DÉLAI NON RAISONNABLE
Cour de Cassation, chambre civile 1,
arrêt du 1er juin 2011 pourvoi n° 09-72350 Rejet
Sur le moyen unique, ci-après
annexé :
Attendu qu'au cours d'une information ouverte en 1994, André X... a été mis en
examen le 22 juin 2000 du chef de complicité d'escroquerie ; qu'il est décédé le
30 décembre 2000 ; que le 8 juillet 2002, le juge d'instruction a rendu une
ordonnance renvoyant un mis en examen devant le tribunal correctionnel et
ordonnant un non-lieu pour le surplus ; que, M. Claude X..., fils d'André X...,
a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor aux fins de condamnation de l'État
en réparation du préjudice résultant du fonctionnement défectueux du service de
la justice
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt confirmatif (Paris, 22 septembre
2009) de l'avoir débouté de sa demande
Attendu que les juges du fond ont relevé qu'André X... n'a acquis la qualité
d'usager du service public de la justice qu'à compter de la date de sa mise en
examen, son audition par les enquêteurs le 30 mars 1999 l'ayant été en qualité
de témoin sans qu'aucun autre acte d'instruction ne fasse apparaître son
implication dans les faits poursuivis, que la lecture du dossier ne permet pas
d'affirmer qu'il n'y avait aucun délit ni aucun élément le reliant aux faits
poursuivis et que le délai écoulé est d'autant moins déraisonnable qu'il y avait
70 parties civiles et que plusieurs expertises ont été nécessaires ; que, de ces
constatations et énonciations, et alors que ne pouvait être prise en compte la
période postérieure au décès d'André X..., la cour d'appel a pu déduire que la
responsabilité de l'État n'était pas engagée du fait du fonctionnement
défectueux du service de la justice ; que le moyen, qui est inopérant en ce
qu'il porte, d'une part, sur la période antérieure à la mise en examen d'André
X... et, d'autre part, sur la période postérieure à son décès, n'est pas fondé
pour le surplus.
Cour de Cassation, chambre
civile 1, arrêt du 23 mars 2011 pourvoi n° 10-11013 Rejet
Attendu que des salariés du
groupe de sociétés DCI ont introduit une action le 22 mai 1992 devant le
tribunal de grande instance de Paris pour obtenir leur part dans la réserve
spéciale de participation et le redressement de cette réserve afin de prendre en
compte les salaires de tous les salariés expatriés du groupe ; que d'autres
salariés ont formé les mêmes demandes le 26 mai 1999 ; que la première
procédure, a fait l'objet de deux décisions avant-dire-droit, l'une du 1er mars
1993, pour enjoindre aux demandeurs de préciser leurs prétentions et produire
les pièces utiles, la seconde du 28 mars 1993 ordonnant le sursis à statuer
jusqu'à l'Intervention d'une décision définitive de la juridiction
administrative sur une question préjudicielle, laquelle est intervenue le 9 mai
1995 ; que par jugement du 7 mai 1996, il a été fait droit à la demande des
salariés, la société DCI étant condamnée à leur payer leur part avec un arriéré
de 30 ans et un expert étant désigné avec mission de reconstituer la réserve
spéciale de participation ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour
d'appel de Paris du 4 décembre 1998, renvoyant à la mise en état, devenu
irrévocable à la suite du rejet par la cour de cassation le 22 mai 2001 du
pourvoi formé par société la DCI ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7
janvier 2000 ordonnant la réouverture des débats et condamnant la société DCI à
effectuer les calculs nécessaires, a été cassé par un arrêt du 29 octobre 2002
de la Cour de cassation renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de
Versailles, laquelle, par arrêt du 26 janvier 2005, a ordonné avant-dire-droit
une expertise ; que sur requêtes des demandeurs à l'instance, la cour d'appel de
Paris a rendu le 5 avril 2001 un arrêt en interprétation de ses arrêts des 4
décembre 1998 et 7 janvier 2000 ; que dans la seconde procédure engagée en 1999,
il a été constaté par jugement du 5 décembre 2000 que les demandeurs avaient
droit à leur part de réserve spéciale de participation pour toutes les années
durant lesquelles ils avaient été détachés en Arabie Saoudite, dans la limite de
trente ans, et il a été ordonné une expertise afin de reconstituer la réserve
spéciale de participation, ce jugement étant confirmé le 10 février 2005 par la
cour d'appel de Paris ; que par ordonnance du 3 juillet 2001, le juge de la mise
en état a apporté des précisions techniques quant à la mission de l'expert
remplacé par ordonnance du 5 mars 2002, puis a complété la mission de l'expert
le 1er octobre 2002 ; que le 23 septembre 2003, il a étendu les opérations
d'expertise en cours à trois parties intervenantes, puis le 21 septembre 2004 a
complété la mission de l'expert, avant, le 5 juillet 2005, de préciser à ce
dernier les modalités de calcul et de répartition de la réserve en référence à
l'arrêt du 29 octobre 2002 de la Cour de cassation ; que le 26 janvier 2005, la
cour d'appel de Paris a déclaré que les salariés expatriés des sociétés du
groupe DCl ont droit à leur part dans la réserve spéciale de participation pour
les périodes travaillées en France et à l'étranger et a ordonné une expertise
afin de reconstituer fictivement la réserve spéciale de participation des
sociétés et de déterminer la part de cette réserve revenant à chacun des
salariés ; que par ordonnance du 6 septembre 2005, complétée le 11 octobre
suivant, le juge de la mise en état a fixé la date limite du dépôt du rapport
définitif d'expertise au 15 mars 2006, avec dépôt d'un rapport d'étape au 1er
décembre 2005 ; que par ordonnance du 4 avril 2006, ce magistrat a imparti à
l'expert un nouveau délai au 1er juin 2006 pour le rapport d'étape sur le
redressement et la distribution de la réserve des exercices 1986 à 1993 inclus,
le rapport d'expertise étant déposé le 19 février 2007 ; que les salariés ont
saisi le tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2005 pour rechercher la
responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article
L. 781-1 du code de l'organisation
judiciaire devenu l'article L.
141-1 du même code
en invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 2009), d'avoir rejeté cette
demande, alors, selon le moyen, que :
1°/ le délai anormalement long
d'une procédure pour obtenir le paiement de créances salariales suffit à
caractériser un déni de justice et engage la responsabilité de l'Etat ; qu'en
l'espèce, il n'est pas contesté que les salariés expatriés qui ont assigné les
22 mai 1992 et 26 mai 1999 le groupe de sociétés DCI aux fins d'obtenir leur
part dans la réserve spéciale de participation de la société DCI, n'en ont
obtenu le paiement que le 6 août 2008 par le biais d'une transaction qui a mis
fin aux procédures engagées, soit plus de seize ans et de neuf ans après les
assignations ; qu'en décidant cependant qu'une telle durée de procédure qu'elle
qualifie de « manquement », ne « constitue pas à elle seule la démonstration
d'un caractère fautif et anormal du déroulement de l'instance », la cour d'appel
a violé l'article 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme et l'article L.
141-1 du code de l'organisation
judiciaire ;
2°/ la défaillance du juge de
la mise en état dans le suivi de l'expertise qui se traduit par un retard
anormal, quand bien même celle-ci serait elle complexe en raison de l'importance
des calculs, caractérise l'inaptitude du service public de la justice à remplir
la mission dont il est investi et engage la responsabilité de l'Etat ; qu'en
l'espèce, les exposants, salariés expatriés, ont fait valoir que le juge de la
mise en état n'avait jamais su imposer un délai de rigueur à l'expert pour le
dépôt de son rapport, qu'il avait été défaillant dans le suivi de ses travaux et
que de surcroît il n'avait jamais mis en demeure la société DCI de fournir à
l'expert les pièces comptables ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants
tirés de ce que l'expertise, en raison de sa complexité n'a pu commencer qu'en
2002, que le juge de la mise en état a rendu de nombreuses décisions et « n'a
pas failli dès lors que le dépôt du rapport d'expertise a toujours fait l'objet
d'un calendrier »- éléments insuffisants à rendre compte du suivi effectif de
l'expertise par le juge de la mise en état-, sans s'expliquer sur les
défaillances précitées mises en exergue par les salariés, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article
6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article
L. 141-1 du code de
l'organisation judiciaire ;
3°/ en se fondant sur la
prétendue « très grande complexité du litige »- en réalité inexistante puisque
le principe même du droit des salariés expatriés à la réserve spéciale de
participation était acquis dès 1982 par la juridiction administrative et a fait
l'objet dans le présent litige de décisions constamment unanimes-et sur «
l'importance des calculs à effectuer »- dont les données avaient été fixées dès
1977 lors de la création de la réserve spéciale de participation, et ne visaient
qu'un groupe de six cent personnes-sans rechercher ni constater que le délai de
procédure de plus de seize ans était proportionné à cette soi-disant complexité,
la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la
Convention européenne des droits de l'homme et l'article
L. 141-1 du code de
l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant constaté
que la solution du litige dépendait du résultat d'opérations d'expertise d'une
rare complexité qui appelaient une reconstitution comptable portant sur une
période de trente ans et intéressant plusieurs sociétés dont l'effectif total
atteignait six cents personnes, la cour d'appel a relevé que le juge de la mise
en état, qui s'était attaché à maîtriser la durée de la mesure d'instruction,
avait été contraint de rendre de nombreuses décisions en raison tant de
contestations relatives à la personne comme à la mission de l'expert que de la
multiplication d'incidents de procédure ; que de l'ensemble de ces éléments elle
a pu déduire que la durée de la procédure n'était pas déraisonnable au sens de
l'article 6, § 1, de la Convention européenne des
droits de l'homme et que ne pouvait être reprochée au juge de la mise en état
aucune faute au sens de l'article L.
141-1 du code de l'organisation
judiciaire, susceptible d'engager la responsabilité de l'État ; que le moyen
n'est pas fondé
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 23
mars 2011 N° de pourvoi: 10-14740 Rejet
Attendu que Mme Mauricette
X..., veuve A..., a été placée sous tutelle par jugement du 31 janvier 2003 à la
requête de sa fille, Mme Y... ; que par ordonnance du 22 octobre 2003, le juge
des tutelles de Marseille a désigné l'UDAF des Bouches du Rhône comme gérant de
tutelle en remplacement de M. Z..., sur sa demande ; que par requête du 4 juin
2004, l'UDAF a demandé à être dessaisie de sa mission ; que M. A... , fils de la
majeure protégée, a saisi le juge des tutelles suivant requête du 20 décembre
2004 aux fins de changement de gérant de tutelle, un médecin expert étant
désigné en avril 2005 ; qu'à la suite d'un conflit né en septembre 2005 entre M.
A... et sa soeur, Mme Y..., relatif au droit de visite de celle-ci envers sa
mère, le juge des tutelles a, par ordonnance du 16 février 2006, homologué
l'accord intervenu entre eux à ce sujet, déchargé l'UDAF de son mandat à cause
du comportement d'obstruction de M. A... et désigné un administrateur spécial en
la personne de M. B...; que par acte du 31 juillet 2006, M. A... a recherché la
responsabilité de l'Etat au visa des articles L.
781-1 devenu L. 141-1 du
code de l'organisation judiciaire et 6 § 1
de la Convention européenne des droits de l'homme pour dysfonctionnement du
service public de la justice
Attendu que M. A... fait grief
à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 novembre 2009), de l'avoir débouté de
sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice
résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice
Attendu qu'après avoir relevé,
par motifs propres et adoptés, que, d'une part, il devait être tenu compte de la
nature de l'affaire et de la nécessité pour le juge des tutelles de concilier
les intérêts divergents des enfants de la personne protégée et de celle-ci et
que le dossier de tutelle avait fait l'objet d'un suivi régulier et attentif,
une expertise médicale étant ordonnée avant d'envisager un changement de mesure,
que, d'autre part, M. A... avait manifesté une attitude d'obstruction
systématique à l'égard des gérants de tutelle qui s'étaient succédés imposant à
l'UDAF, notamment, de nombreuses démarches auprès du juge des tutelles pour
faire respecter tant sa mission, devenue de plus en plus compliquée, que la
sauvegarde de la personne et des biens de Mme A... , la cour d'appel, qui s'est
déterminée par une appréciation des éléments de la cause et hors toute
dénaturation, a ainsi caractérisé les circonstances particulières justifiant que
la durée de la procédure ne soit pas considérée comme excédant un délai
raisonnable au sens des dispositions de l'article
6, 1°, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé
Cour de cassation chambre civile 1
Arrêt du 23 février 2011 N° de pourvoi 09-71164 Rejet
Attendu que, le 20 janvier
1992, un avion s'est écrasé à proximité du Mont Sainte-Odile ; que le 31 janvier
suivant s'est créée l'association ECHO (l'association) regroupant des familles
de victimes ; que l'information pénale ouverte immédiatement a été clôturée le 8
décembre 2005 par une ordonnance renvoyant plusieurs prévenus devant le tribunal
correctionnel de Colmar qui, par jugement en date du 7 novembre 2006, a relaxé
les prévenus et a accordé à l'association une somme de 500 000 euros au titre
des frais irrépétibles ; que, par arrêt en date du 14 mars 2008, la cour d'appel
a confirmé cette décision sur le plan pénal et a débouté l'association de
l'ensemble de ses demandes ; que cette dernière a recherché la responsabilité de
l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 18
septembre 2009) d'avoir rejeté son action en responsabilité contre l'État sur le
fondement de l'article L. 781-1 du
code de l'organisation
judiciaire, devenu l'article L.
141-1 du même code
Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à aucun moment la procédure
pénale n'est restée en souffrance sans qu'aucune diligence ne soit accomplie,
que c'est au contraire la multiplication des diligences, et plus
particulièrement des expertises, qui est à l'origine de la longueur de la
procédure critiquée, que le rapport final de la commission d'enquête ainsi que
l'ordonnance de renvoi permettent d'établir que de telles expertises étaient
néanmoins indispensables en raison du caractère éminemment et exclusivement
technique des faits ainsi qu'en l'absence de cause évidente susceptible
d'expliquer l'accident survenu et que l'analyse de la chronologie des faits ne
permet pas de stigmatiser une lenteur fautive imputable aux experts dans
l'accomplissement de leur mission ; qu'ayant ainsi caractérisé la complexité de
l'affaire, la cour d'appel a pu en déduire que le délai de traitement de la
l'affaire n'était pas déraisonnable ; qu'elle a, dès lors, par ce seul motif et
abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les autres branches du moyen, légalement justifié sa décision
LES DÉLAIS NON RAISONNABLES NE POSENT PAS DE PROBLÈME EN MATIÈRE DE PRESCRIPTION
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 18 mai 2011 pourvoi n° 10-17098 Rejet
Attendu que M. X... a fait l'objet de deux mesures d'hospitalisation d'office en exécution d'arrêtés du
maire de Mulhouse confirmés par le préfet du Haut-Rhin ; que ces mesures ont été
exécutées, d'abord, au Centre hospitalier de Rouffach, du 17 juillet au 2
octobre 1997, puis, à celui de Mulhouse, du 22 juillet au 19 août 1999 ; que par
jugement du 17 mai 2005 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé
l'ensemble des arrêtés municipaux et préfectoraux ; que la plainte avec
constitution de partie civile que M. X... avait déposée le 13 juin 2000 pour des
faits d'accusations mensongères, placement abusif et séquestration a fait
l'objet d'une ordonnance de non-lieu du 31 août 2007 ; qu'en juin 2006, M. X...
a recherché la responsabilité de l'Etat, de la ville de Mulhouse et des Centres
hospitaliers de Rouffach et de Mulhouse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ces griefs ne sont
pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen du
pourvoi principal, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief
à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2009), d'avoir déclaré irrecevable l'action
engagée par lui contre l'agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article
L. 141-1 du code de
l'organisation judiciaire pour cause de prescription de sa créance ;
Attendu que la plainte avec
constitution de partie civile déposée par M. X... ayant fait l'objet d'une
ordonnance de non-lieu non frappée de recours, l'interruption de la prescription
qu'elle avait entraînée doit être regardée comme non avenue ; que par ce motif
de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, la décision
déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen du
pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa
demande tendant à l'indemnisation des préjudices nés du caractère non nécessaire
des deux mesures d'internement d'office prises à son encontre ;
Attendu que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... ayant fait l'objet d'une
ordonnance de non-lieu non frappée de recours, l'interruption de la prescription
qu'elle avait entraînée doit être regardée comme non avenue ; que par ce motif
de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, la décision
déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli



MODÈLE GRATUIT DE RECOURS GRACIEUX AU MINISTRE DE LA JUSTICE
ET A L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Il faut d'abord saisir le ministre de la justice garde des sceaux
et l'Agent Judiciaire de l'Etat d'un recours gracieux. Quelque soit la
décision du ministre de la justice et de l'Agent Judiciaire de l'Etat, votre recours gracieux aura pour conséquence de
remplir l'obligation de négociation préalable, avant de saisir le Tribunal
Judiciaire. Cette formalité est suspensive du délai non raisonnable.
Notre Conseil: Copiez
collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou
modifiez le texte comme vous le souhaitez.
|
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DU
RECOURS GRACIEUX A MADAME LA MINISTRE DE LA JUSTICE
ET MONSIEUR L'AGENT
JUDICIAIRE DE L'ETAT
A: MADAME LA MINISTRE DE LA JUSTICE
13 Place Vendôme
75042 Paris cedex 01
A: MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
6 rue louise Weiss
75703 Paris cedex 13
Pour :
Nom et Prénoms:
de nationalité: profession:
né le: à:
demeurant:
EXPOSE DE LA DEMANDE
Les faits:
Le droit:
L'article 6§1 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme prévoit en ses termes compatibles:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ()
dans un délai raisonnable () par un Tribunal () qui décidera soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle"
La jurisprudence de la Cour de cassation prévoit la réparation
du préjudice moral causé
par un délai non raisonnable d'une procédure judiciaire.
La jurisprudence de la Cour de cassation concerne tout manquement de l'Etat à son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de
voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable conformément à
l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
L'existence d'un tel délai s'apprécie à la lumière
des circonstances propres à chaque espèce.
Il y a lieu en particulier, de prendre en considération:
-le délai global de l'affaire par rapport à sa nature;
-son degré de complexité;
-le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la
procédure,
-le comportement et les délais de latence commis par les
autorités judiciaires
-l'enjeu de la procédure pour la partie qui se plaint.
En droit français, le délai non raisonnable est considéré
comme un déni de justice au sens de l'article L 141-1 du COJ
DISCUSSION:
La procédure a débuté le
pour se terminer le
(ou n'est pas encore terminée)
le délai global pris dans son ensemble est de
Il est beaucoup trop long pour une affaire de
cette nature et la simple constatation de ce délai global suffit à le qualifier
de "non raisonnable".
L'AFFAIRE N'EST PAS COMPLEXE:
Il s'agit simplement de:
NOUS N'AVONS RIEN FAIT QUI PUISSE PROLONGER LA
PROCEDURE:
Nous avons seulement usé de nos droits de
recours:
Cet usage ne peut pas nous être reproché, sans
partialité.
Bien au contraire, nous avons essayé de faire
accélérer la procédure:
EN REVANCHE LES AUTORITÉS JUDICIAIRES ONT
COMMIS DES "DELAIS DE LATENCE" ENTRE CHAQUE ACTE:
L'AFFAIRE EST EN ÉTAT D'ÊTRE
JUGÉE DEPUIS LE........ ET ELLE N'EST TOUJOURS PAS JUGÉE A CE JOUR !
Alors que l'article L 143 -3 du
C.O.J prévoit en son alinéa 2:
"Il y a déni de justice lorsque les
juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les
affaires en état et en tour d'être jugées"
Entre le
Et le
Il y a eu un délai de
Entre le
Et le
Il y a eu un délai de
L'addition de ces délais fait apparaître un
délai total de :
pendant lequel il ne s'est strictement rien
passé !
L'ENJEU DU LITIGE EST IMPORTANT POUR MOI :
PAR CES CONSIDÉRATIONS:
Et tous autres à déduire et suppléer même
d'office, il est sollicité qu'il vous plaise (Madame Monsieur le la) ministre
de la Justice de saisir
l'inspection générale de la justice pour connaître la cause de ce délai non
raisonnable.
Il est sollicité qu'il
vous plaise de m'accorder la somme de :
en réparation du préjudice moral
subi par le délai non raisonnable de la procédure.
Il est aussi sollicité qu'il vous
plaise, dans le respect du principe de la
séparation des pouvoirs, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour mettre fin à la procédure.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre de la
justice, l'expression de mon profond respect.
signature du demandeur
BORDEREAU DE COPIES DE PIECES
DE LA PROCEDURE POUR DEMONTRER SON "DELAI NON RAISONNABLE"
1/
2/
3/ |



L'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
POUR FAUTE LOURDE DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
En cas de silence de deux mois, il faut assigner Monsieur l'agent judiciaire de
l'État si possible devant le Tribunal Judiciaire de Paris, sachant que le Tribunal Judiciaire du lieu de la faute est aussi compétent.
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
6 rue louise Weiss
75703 Paris cedex 13
Devant le Tribunal Judiciaire de Paris, vous devez constituer avocat, qui vous rédigera l'assignation qui sera signifiée par un huissier parisien.

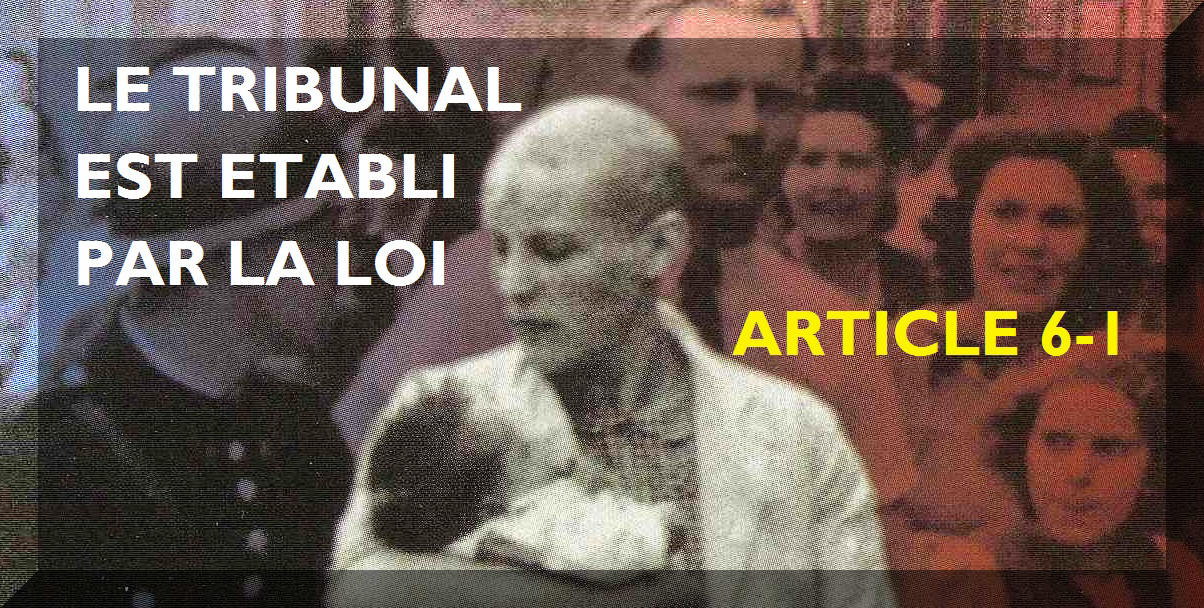

UNE REQUÊTE PEUT ENSUITE ÊTRE ENVOYÉE A LA LA CEDH
Si la procédure interne n'a pas permis la réparation, vous pouvez saisir la CEDH.
MALLET c. FRANCE du 11 FEVRIER 2010 Requête no 24997/07
LA PROCÉDURE INTERNE
9. Le 9 septembre 2003, dénonçant la durée de
la procédure, le requérant saisit le tribunal de grande instance de
Saint-Denis de la Réunion d’une action en responsabilité fondée sur
l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire.
10. Par un jugement du 22 juin 2004, le
tribunal débouta le requérant de ses demandes, au motif que, bien que
visé par la plainte du 3 octobre 1991, il n’était devenu un « usager
effectif du service public de la justice » qu’à la date de sa mise en
examen, le 17 septembre 1996 ; prenant cette date comme point de
départ de la période à considérer, le tribunal conclut que la durée de
la procédure n’était pas excessive.
11. Le 18 novembre 2005, la cour d’appel de
Saint-Denis de la Réunion confirma ce jugement.
12. Par un arrêt du 10 mai 2007, la Cour de
cassation (première chambre civile) rejeta le pourvoi du requérant.
SUR LA RECEVABILITÉ
14. Le Gouvernement soulève une exception
d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois prévu par
l’article 35 de la Convention entre la date de la décision interne
définitive et la saisine de la Cour. Il expose que, sous réserve
qu’une lettre introductive d’instance ait été antérieurement adressée
à la Cour, la requête n’a été reçue au greffe de la Cour que le
5 décembre 2007. Or il fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation
mettant fin à la procédure d’indemnisation pour durée excessive de la
procédure a été rendu publiquement et en présence de l’avocat aux
Conseils du requérant le 10 mai 2007.
15. Le requérant estime avoir saisi la Cour
dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive,
dès lors qu’il a introduit sa requête le 29 mai 2007, soit dix-neuf
jours après l’arrêt de la Cour de cassation.
16. La Cour note que la première lettre envoyée
par le requérant au greffe de la Cour, porte la date du 26 mai 2007 et
qu’elle a été postée le 29 mai 2007, c’est-à-dire dans le délai de six
mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour observe en
outre que dans cette lettre, le requérant se référait à une précédente
requête concernant la durée (no PP9194) de la procédure
pénale intentée contre lui et indiquait avoir épuisé les voies de
recours internes, avec mention précise des décisions de justice
rendues. La Cour estime dès lors que la première lettre contenait le
grief tiré de la méconnaissance du « délai raisonnable » que le
requérant entendait soulever devant la Cour. Partant, il y lieu de
rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
17. Par
ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en
outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
SUR LE FOND
24. Concernant la durée à prendre en
considération sous l’angle du « délai raisonnable », la Cour rappelle
qu’en matière pénale, ce délai débute dès l’instant qu’une personne se
trouve « accusée ». L’« accusation », au sens de l’article 6 § 1, qui
revêt un caractère autonome (voir, entre autres,
Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 42, série A no 35),
peut se définir « comme la notification officielle, émanant de
l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction
pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions
importantes sur la situation » du suspect (voir, entre autres,
Janosevic c. Suède, no 34619/97, § 91, 23 juillet
2002, CEDH 2002-VII, Eckle c.
Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, , § 73, série A no
51,
Deweer, précité, § 42, et
Salov c. Ukraine, no 65518/01, § 65, CEDH 2005-VIII).
25. En l’espèce, la Cour considère, à l’instar
des parties, que ni le dépôt de plainte, même visant nommément le
requérant, ni la saisine, par le procureur de la République, de la
chambre criminelle de la Cour de cassation, ne pouvaient conférer au
requérant la qualité d’ « accusé », dans la mesure où ces actes
n’impliquaient, en tout état de cause, nullement l’engagement de
poursuites à son endroit.
26. S’agissant de l’arrêt de la Cour de
cassation du 4 août 1992, porté à la connaissance du requérant le
14 septembre 1992, la Cour observe qu’il désigne la juridiction
susceptible d’instruire l’affaire, sans se prononcer sur l’opportunité
de l’ouverture d’une information, en relevant tant le caractère
potentiel des poursuites que la nature hypothétique des faits imputés
au requérant. La Cour relève que consécutivement à la signification de
cet arrêt, qui l’avisait officiellement que la chambre d’accusation de
la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion était chargée de se
prononcer sur les suites à donner à une plainte le visant nommément,
le requérant s’est trouvé en situation de s’expliquer, devant cette
juridiction, sur la portée des accusations dont il faisait l’objet. En
effet, le 15 décembre 1992, la chambre d’accusation a entendu non
seulement l’avocat de l’auteur de la plainte, mais également celui du
requérant, avant de désigner un juge d’instruction. Partant, la Cour
estime que ces circonstances ont eu une répercussion importante sur la
situation du requérant et que la période à considérer débute au plus
tard le 15 décembre 1992.
27. Quant à la fin de la période, la Cour
estime qu’il y a lieu de prendre en compte, ce qui n’est pas contesté,
l’arrêt du 15 novembre 2000 par lequel la Cour de cassation a rejeté
le pourvoi du requérant contre l’arrêt de cour d’appel le déclarant
coupable des faits qui lui étaient reprochés.
28. En l’espèce, la Cour constate que la
procédure litigieuse a dès lors duré huit ans pour trois degrés de
juridiction.
29. S’agissant de l’appréciation du caractère
raisonnable de la durée en cause, la Cour rappelle qu’il incombe aux
États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte
que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, y
compris l’obligation de trancher les causes dans des délais
raisonnables (voir, entre autres,
Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94,
§ 74, CEDH 1999-II).
30. A cet égard, le caractère raisonnable de la
durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et au regard des critères dégagés par la jurisprudence, parmi lesquels
la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres,
Beljanski c. France (déc.), no 44070/98, 5 juillet
2001).
31. En l’espèce, la Cour considère que la
procédure litigieuse ne présentait pas de complexité particulière.
Quant au comportement du requérant, qui a formé deux pourvois en
cassation, l’un contre l’arrêt le renvoyant devant le tribunal
correctionnel, l’autre contre l’arrêt de la cour d’appel prononçant sa
condamnation, la Cour estime qu’il n’a pas contribué à ralentir le
cours de la procédure.
32. S’agissant en revanche du comportement des
autorités, la Cour constate d’emblée que si un premier magistrat
instructeur fut rapidement désigné le 15 décembre 1992, force est de
constater qu’il n’a accompli aucun acte d’instruction jusqu’à la
désignation de son successeur intervenue presque dix-huit mois plus
tard. Celui-ci, pour sa part, s’est borné à délivrer aux services
d’enquête une commission rogatoire dont les termes, s’ils se réfèrent
à la procédure de révision du plan d’occupation des sols et au rôle du
requérant, ne présentent pas de rapport évident avec la prise
d’intérêt personnel qui était reprochée à ce dernier. Ce n’est que le
troisième magistrat instructeur qui a procédé à la mise en examen du
requérant le 17 septembre 1996, soit plus de quatre ans après le début
de la période litigieuse. Le délai qui s’est écoulé ensuite, entre la
mise en examen du requérant et la décision définitive rejetant son
pourvoi en cassation, n’apparaît pas devoir être mis en cause.
33. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
34. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.



LE REQUÉRANT SAISIT DIRECTEMENT LA CEDH
QUAND LA PROCÉDURE PRINCIPALE EST LONGUE
Les autorités françaises ont cru pouvoir dénier l'évidence et ne réparent pas les délais non
raisonnables. Les justiciables saisissent alors la CEDH qui dans un premier temps a rejeté toutes les requêtes puis devant l'affût, a commencé à les accepter à partir de 2010.
Depuis 2010, si la procédure principale a été particulièrement longue, le justiciable est toujours
dispensé de faire un recours interne et peut s'adresser directement à la CEDH.
LA PROCÉDURE EST PARTICULIÈREMENT LONGUE
VERITER c. FRANCE du 14 OCTOBRE 2010 Requête no31508/07
En l'espèce la procédure principale a duré 18 ans jusqu'au Conseil d'Etat
54. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité du grief tiré de la durée de la procédure qui a pris fin le
25 mai 2007. Il estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, dans la mesure où il
n’a pas fait usage du recours prévu par l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
55. Le requérant considère qu’il ne lui appartenait
pas d’exercer le recours prévu par l’article R. 311-1 précité, dès lors que
celui-ci est de création récente et que son utilisation est limitée en
raison de l’exigence d’une faute lourde.
56. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 §
1 précité, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de
recours internes. Toutefois, ces recours doivent exister non seulement en
théorie mais aussi en pratique. De même, ces dispositions doivent
s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif et,
selon les « principes de droit international généralement reconnus »,
certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de
l’obligation d’épuiser les recours internes s’offrant à lui (voir, parmi
beaucoup d’autres,
Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, CEDH 2003-IV).
57. La Cour rappelle également qu’elle a déjà jugé
que le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du
service public de la justice permettait aux justiciables parties à une
procédure devant les juridictions administratives d’obtenir, le cas échéant,
un constat de violation de leur droit à voir leur cause entendue dans un
délai raisonnable, ainsi que l’indemnisation du préjudice en résultant. Cela
vaut pour les procédures pendantes comme pour les procédures achevées au
plan interne (arrêt
Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et
31694/02, § 19, 21 octobre 2003).
58. Cependant, en l’espèce, le requérant se plaint de
la durée excessive du recours en responsabilité de l’Etat qu’il a engagé
pour obtenir réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de
la longueur déraisonnable des procédures administratives antérieures.
59. La Cour rappelle que, dans l’affaire
Vaney c. France (no 53946/00, arrêt du 30 novembre 2004),
dans laquelle le requérant soulevait un grief similaire relativement au
recours prévu par l’article L.781-1 (devenu l’article L.141-1) du code de
l’organisation judiciaire, elle a considéré qu’exiger du requérant qu’il
forme un nouveau recours en responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement
du service de la justice devant les juridictions internes, comme le
suggérait le Gouvernement, serait déraisonnable et constituerait un obstacle
disproportionné à l’exercice efficace de son droit de recours individuel,
tel que défini à l’article 34 de la Convention. Elle estime que cette
approche peut être transposée à la présente affaire, où le requérant a saisi
la juridiction administrative pour la première fois le 11 juillet 1988, soit
plus de dix-huit ans et neuf mois avant l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 mai
2007.
60. En conséquence, et sans remettre en cause l’arrêt
Broca et Texier-Micault précité sur l’effectivité du recours en
responsabilité de l’Etat, la Cour estime que les circonstances particulières
de la cause étaient telles que le requérant était dispensé de l’obligation
d’épuiser le recours interne qui s’offrait à lui (Vaney
précité, § 53). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement
doit être rejetée.
61. Constatant que la requête ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
PALMERO c. FRANCE Requête n° 77362/11 du 30 octobre 2014
Violation article 6 pour délai non raisonnable : Un Arrêt
pour que le requérant ne puisse pas saisir le CDH de Genève.
Le requérant demande une
indemnité pour partialité du juge d'instruction et délai non raisonnable durant
une procédure d'accusation pénale. Il subit un rejet devant les juridictions
internes. Il présente ses griefs devant la CEDH. Il rajoute le grief de délai
non raisonnable de la procédure d'indemnisation, sans auparavant, avoir épuisé
les voies de recours internes concernant le délai de cette procédure
compensatoire. La CEDH condamne pour délai non raisonnable de la procédure
d'indemnisation pourtant échouée en droit interne car la Cour d'Appel a rendu
son arrêt avec un délai de 3 ans. La CEDH ne répond pas sur le grief concernant le
délai non raisonnable de la procédure d'accusation pénale. Elle répond ensuite
de manière succincte (2 lignes) et générale sur le grief tiré de la
partialité du juge d'instruction. Comme la CEDH a examiné la requête contre la
France. Du fait de la clause de réserve de la France, le Comité
des Droits de l'Homme de Genève est incompétent pour statuer sur les griefs
tirés de la procédure pénale, au sens de l'article 14 du Pacte International
relatif aux droits civils et politiques.
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le
père du requérant, André Palmero, exerçait de son vivant des fonctions
d’administrateur de biens du prince de Monaco. Le 30 mars 1999, il fut
entendu pour la première fois en qualité de témoin dans une
information judiciaire ouverte en France en 1994, concernant des faits
d’escroquerie liés à la vente de timbres de collection de la
Principauté.
7. Le 22
juin 2000, il fut mis en examen du chef de complicité d’escroquerie.
Il décéda le 30 décembre 2000 et, le 8 juillet 2002, le juge
d’instruction constata l’extinction de l’action publique à son
bénéfice en raison de ce décès. En 2005, une ordonnance de non-lieu
général concernant l’ensemble des personnes mises en examen fut
rendue.
8. Le 28
décembre 2004, le requérant engagea une action en responsabilité de
l’État, au nom de son père, sur le fondement de l’article L.781-1 du
code de l’organisation judiciaire, alors en vigueur, en réparation des
fautes qui auraient été commises dans le cadre de la procédure pénale
diligentée contre ce dernier. Le requérant invoqua, notamment, le
défaut d’impartialité du juge d’instruction, ainsi que le caractère
déraisonnable de la durée de la procédure pénale.
9. Par
un jugement du 26 avril 2006, le tribunal de grande instance de Paris
déclara la demande du requérant recevable - rappelant notamment que le
droit à réparation du dommage moral subi par une personne défunte,
entré dans son patrimoine, se transmettait à ses héritiers – mais la
rejeta. Le 22 septembre 2009, la cour d’appel de Paris confirma ce
jugement. Les juges du fond estimèrent que les accusations de
partialité dirigées contre le juge d’instruction n’étaient pas fondées
et considérèrent que le point de départ de la période à envisager sous
l’angle de l’exigence d’un délai raisonnable devait être fixé au 22
juin 2000, date de mise en examen du père du requérant, compte tenu de
l’absence d’éléments dans le dossier le mettant en cause au moment du
dépôt de plainte initial ainsi que lors de sa première audition comme
témoin en 1999.
10. Par un arrêt du 1er
juin 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en
estimant, en outre, que le terme de la période à considérer sous
l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention devait être fixé au décès
du père du requérant en décembre 2000.
EN DROIT
11. Le
requérant se plaint de la durée déraisonnable tant de la procédure
pénale dirigée contre son père, que de la procédure d’indemnisation
exercée par lui sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de
l’organisation judiciaire, devenu l’article L. 141-1 du code de
l’organisation judiciaire. Il met par ailleurs en cause l’impartialité
du juge d’instruction chargé de l’information dans laquelle son père
fut mis en examen. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par
un tribunal (...) impartial (...), qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. »
I. SUR LA VIOLATION
ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE
LA PROCÉDURE PÉNALE
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement s’en
remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la durée de la
procédure d’indemnisation. Il admet que la procédure devant la cour
d’appel, d’une durée supérieure à trois ans, ne semble manifestement
pas répondre à l’exigence du délai raisonnable.
19. La Cour rappelle que
le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères
consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la
complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres,
Pélissier et Sassi c. France
[GC], no
25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
20. La période à
considérer a débuté le 28 décembre 2004, date de l’assignation en
responsabilité de l’Etat pour s’achever le 1er
juin 2011, date de l’arrêt de la Cour de cassation. La procédure en
indemnisation a dès lors duré six années, cinq mois et quatre jours
pour trois degrés de juridictions, dont trois ans et cinq mois au
niveau de la seule cour d’appel, puis un an et neuf mois au niveau de
la Cour de cassation.
21. Tout en ayant à
l’esprit que le requérant a engagé l’action en responsabilité de
l’État au nom de son père, la Cour rappelle l’importance pour les
juridictions internes de porter une attention particulière à ce type
de procédures d’indemnisation, notamment pour ce qui est de la durée
raisonnable de leur examen (Gouveia da
Siva Torrado c. Portugal, décision, no
65305/01, 22 mai 2003, Cocchiarella
c. Italie [GC], précité, § 89,
Sartory c. France,
précité, § 24). Elle estime que la durée de la procédure litigieuse
est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
22. Partant, il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’IMPARTIALITÉ DU TRIBUNAL
23. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune
apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard du grief allégué. Partant, cette partie de la requête doit être
rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

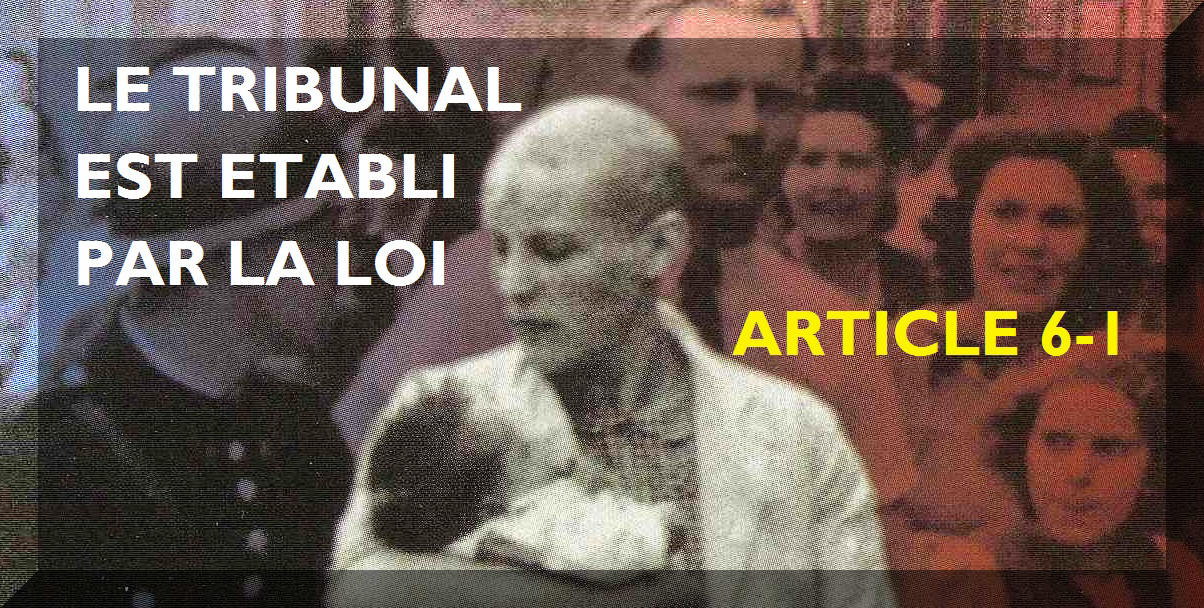

L'AFFAIRE TABOURET CONTRE FRANCE
TABOURET c. FRANCE du 12 mai 2022 Requête no 43078/15
Art 6
§ 1 (pénal) • Durée raisonnable • Durée excessive de la procédure
juridictionnelle sur près de dix-huit ans, du fait des délais, la
requérante a subi une liquidation judiciaire et la perte de son étude
d'huissier quia été définitivement fermée par décision ministérielle.
FAITS
1. À
l’origine de l’affaire se trouve la cession d’une étude d’huissier
entre la requérante et son prédécesseur, A.C. Une procédure pénale
avec constitution de partie civile fut engagée à l’encontre de ce
dernier pour escroquerie et abus de confiance. Invoquant l’article 6 §
1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de
cette procédure, en particulier de la durée de l’expertise ordonnée
dans le cadre du règlement de l’action civile.
Sur la
recevabilité
-
Le recours en responsabilité exercé sur le
fondement de l’article L. 781-1 du code de
l’organisation judiciaire (devenu L. 141-1 du même
code)
65. Le 29 juin
2010, la requérante fit assigner l’agent judiciaire du Trésor, dans le cadre
d’une action en responsabilité de l’État, aux fins d’obtenir la condamnation de
celui‑ci à lui payer la somme d’un million d’euros à titre de dommages et
intérêts pour préjudice moral.
66. Le 26 octobre
2012, le tribunal de grande instance de Beauvais rejeta son recours.
67. Le 3 avril 2014,
la cour d’appel d’Amiens rendit un arrêt confirmatif dont les motifs pertinents
sont les suivants :
« (...)
- sur la
recevabilité des demandes :
Considérant que
l’Agent Judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité des demandes formées par
[la requérante] en faisant valoir que celle-ci est, en raison du prononcé de sa
liquidation judiciaire, dessaisie de l’administration de son patrimoine,
conformément aux dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, alors
qu’elle sollicite désormais la réparation de ses préjudices tant moral que
matériel ;
Que sur le
fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de
l’Etat soulève également l’irrecevabilité, comme étant nouvelles en appel, des
demandes de [la requérante] et de Me L., ès qualités, tendant à la réparation du
préjudice matériel de celle-là et à la condamnation de l’Etat « in solidum » au
paiement des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du
30 mars 2011 et au passif produit à l’encontre de [la requérante] ;
Considérant,
cependant, que comme l’a exactement retenu le tribunal, la demande de réparation
de son préjudice moral formée par [la requérante] constitue une action qui lui
est personnelle et qu’elle peut exercer elle-même ;
Qu’en revanche, les
demandes présentées par elle et Me L., ès qualités, tendant à la réparation du
préjudice matériel de celle-là et à la condamnation de l’Etat « in solidum » au
paiement des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du
30 mars 2011 et au passif produit à l’encontre de [la requérante], qui n’ont pas
le même objet, ne tendent pas aux mêmes fins que l’indemnisation du seul
préjudice moral et qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, sont
effectivement des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de
procédure civile ; qu’en application de ces mêmes dispositions, elles sont donc
irrecevables, étant ici observé que les appelants n’ont présenté aucun moyen de
défense sur cette fin de non-recevoir ;
- sur la demande de
réparation du préjudice moral :
Considérant que
pour rechercher la responsabilité de l’Etat en raison d’un fonctionnement
défectueux du service de la justice, [la requérante] invoque, comme en première
instance, les fautes commises par le « juge taxateur » du tribunal de grande
instance de Beauvais, le Garde des Sceaux lors de la délivrance de son agrément,
le Procureur de la République de Beauvais et les chambres nationale et
départementale des huissiers de justice, de même que les « délais non
raisonnables de procédure » et « l’absence de satisfaction équitable dans le
procès » en étant résultés ;
* sur les fautes
reprochées au juge du tribunal de grande instance de Beauvais chargé du contrôle
de l’expertise ordonnée le 29 avril 1999 et confiée [au premier expert, M. D.] :
Considérant que [la
requérante] reproche au juge du tribunal de grande instance de Beauvais chargé
du contrôle de l’expertise ordonnée le 29 avril 1999 et confiée à M. D.,
d’avoir, entre 2001 et 2005, accordé à ce dernier des délais excessifs pour
déposer son rapport ainsi que d’avoir mis à sa charge des consignations d’un
montant aussi excessif alors qu’il avait connaissance de sa situation financière
obérée ; qu’elle rappelle à cet égard qu’à la consignation initiale de 50 000
francs qu’elle a versée le 25 janvier 2001, se sont ajoutées celle de 100 000
francs ordonnée le 1er
août 2001 qu’elle a versée le 16 janvier 2002 après avoir dû contracter un
emprunt, puis, les 22 juillet 2002 et 11 janvier 2005, celles de 30 000 euros et
de 17 600 euros et qu’elle a ainsi consigné une somme totale de 52 867,35 euros
alors que M. D. sera finalement récusé le 20 juillet 2006 sans avoir déposé son
rapport définitif et que le retard dans ce dépôt l’a privée de la possibilité
d’obtenir la réparation de son préjudice avant que sa situation ne se dégrade de
façon irrémédiable ;
Considérant,
cependant, qu’il ressort des mentions du jugement du tribunal correctionnel de
Beauvais du 29 avril 1999 et de l’arrêt du 31 octobre 2000 de la cour d’appel
d’Amiens que c’est [la requérante] qui a sollicité l’organisation d’une
expertise comptable afin d’évaluer ses préjudices découlant des infractions
commises à son détriment par [son prédécesseur] ; que comme les premiers juges
l’ont relevé, les provisions à valoir sur la rémunération de l’expert ont été
normalement mises à sa charge dès lors que [son prédécesseur] n’avait pas
intérêt à ce que soit diligentée cette mesure d’instruction à laquelle il
s’opposait ;
Que [la requérante]
ne peut pas valablement dénier la complexité des opérations confiées à M. D. et
donc la nécessité de lui accorder un délai conséquent pour les mener à leur
terme eu égard aux nombreuses anomalies affectant le système informatique de
l’office et à l’insuffisance de sa comptabilité ; qu’elle indique en effet
elle-même, à la page 52 de ses conclusions, avoir fourni « un travail colossal »
pour communiquer à cet expert « le recensement des produits illégaux » et
d’autres éléments ;
Que « l’état de ses
travaux lors de la demande de récusation » rédigé par M. D. (pièce no14
de l’Agent judiciaire de l’État), qui récapitule en détail le déroulement de ses
opérations entre 2001 et la fin de l’année 2004 ne permet pas de relever une
inaction manifeste de ce dernier alors que sa récusation n’est liée qu’à une
faute personnelle quant au respect de son obligation d’impartialité ;
Qu’en outre et même
s’il n’a pas achevé ses travaux, arrêtés au 21 avril 2005, date du dépôt de la
requête en récusation, ses pré‑rapports d’avril 2002 et juillet 2004 n’en ont
pas moins fourni au tribunal correctionnel de Beauvais puis à la cour d’appel
d’Amiens des éléments utiles à la détermination des préjudices subis par [la
requérante], ainsi que ces juridictions l’ont énoncé dans leurs décisions ;
Qu’enfin, [la
requérante] à qui av[ait] été allou[ée] par le jugement du 29 avril 1999 une
provision de 160 071, 47 euros, ne justifie ni même ne prétend avoir fait part
au juge chargé du contrôle de l’expertise de ses critiques quant au déroulement
des opérations d’expertise, à leur lenteur et au montant trop élevé des
provisions sollicitées ;
Qu’à l’inverse,
dans sa décision du 20 juillet 2006 ayant fait droit à la demande de récusation
de M. D., le tribunal correctionnel de Beauvais a notamment relevé que [la
requérante] avait une responsabilité dans « la longueur de la procédure »,
n’ayant pas réglé la consignation supplémentaire mise à sa charge le 11 janvier
2005 alors que « si elle l’avait fait, l’expert aurait pu déposer son rapport
définitif avant la demande de récusation présentée par le prévenu (...) » tandis
qu’elle « ne démontrait pas par les pièces qu’elle produit, qu’elle est dans un
état d’impécuniosité ne lui permettant pas de faire face à ses obligations
judiciaires » ; que le recours exercé par [la requérante] contre cette décision
a été déclaré irrecevable par un arrêt du 20 juin 2007 de la cour d’appel
d’Amiens à défaut pour elle d’avoir déposé la requête prévue à l’article 507 du
code de procédure pénale ;
Considérant que
dans ces conditions et même si la durée des opérations menées par M. D. jusqu’à
sa récusation, de l’ordre de quatre années, et le montant des consignations
mises à la charge de [la requérante] par le juge chargé du contrôle de
l’expertise peuvent en définitive paraître excessifs au regard, en particulier,
de l’ordonnance du 27 mars 2012 ayant fixé les honoraires de cet expert à la
somme de 17 940 euros, les décisions prises par le juge du tribunal de grande
instance de Beauvais chargé du contrôle de l’expertise quant aux prorogations de
délais et aux consignations ne sont pas de nature à caractériser une faute
lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État, étant rappelé que ne
constitue une telle faute, au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du
code de l’organisation judiciaire, qu’une déficience traduisant l’inaptitude du
service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
(...)
* sur « les délais
non raisonnables de procédure » et « l’absence de satisfaction équitable dans le
procès » :
Considérant que les
appelants font valoir que plus de vingt ans après l’escroquerie dont [la
requérante] a été victime en 1993 et dont [son prédécesseur] a été déclaré
coupable en 1999, celle-là n’a toujours pas été indemnisée de ses préjudices en
raison des fautes précitées, alors que s’agissant d’un litige se rapportant à
son exercice professionnel, il appartenait aux autorités judiciaires de faire
preuve d’une particulière diligence ;
Qu’ils soulignent
que l’absence de décision judiciaire fixant le montant de ses préjudices et
rendue dans un délai raisonnable, notamment consécutive aux manquements dans le
contrôle de l’expertise, a permis [au prédécesseur de la requérante] d’organiser
son insolvabilité et a aggravé ses difficultés financières ;
Qu’ils rappellent
que jusqu’au 11 mai 2010, n’était intervenue aucune décision de justice ayant
octroyé à [la requérante] « une indemnisation substantielle, nécessaire au
redressement de sa situation » ;
Qu’ils estiment de
la sorte caractérisé un manquement du service de la justice à son devoir de
protection de la victime et ajoute que ce manquement et le dysfonctionnement de
ce service doit être apprécié au regard de l’ensemble des fautes commises par
les différents intervenants et non en fonction de celles‑ci prises isolément ;
Mais considérant
que s’agissant de la procédure pénale suivie à l’encontre [du prédécesseur de la
requérante], les appelants n’invoquent aucun fait précis de nature à mettre en
évidence un retard fautif dans la conduite de l’enquête puis de l’information
judiciaire ouverte le 21 avril 1994, ni davantage dans les délais mis pour juger
pénalement [le prédécesseur de la requérante], étant rappelé que celui-ci a été
reconnu coupable des infractions lui étant reprochées le 29 avril 1999 et qu’il
ressort des pièces versées aux débats, en particulier du réquisitoire définitif
de renvoi devant le tribunal correctionnel daté du 28 mai 1998, que la réunion
des preuves nécessaires à la caractérisation de ces infractions complexes a
nécessité de nombreuses investigations en raison, notamment, des anomalies
affectant le système informatique de l’office et de l’absence partielle de
comptabilité ;
Considérant, de
plus, que comme cela a déjà été dit, la durée des opérations d’expertise qui,
avec les recours exercés par [le prédécesseur de la requérante], expliquent ceux
pour statuer sur les intérêts civils, ne peuvent pas non plus caractériser une
faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État, étant en outre
rappelé que des provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ont
été allouées à [la requérante] pour des montants significatifs, soit le 29
octobre 1997 à hauteur de 36 435,32 euros et le 2[9] avril 1999 à hauteur de
169 071, 47 euros ;
Qu’en outre, les
difficultés rencontrées par [la requérante] pour obtenir de [son prédécesseur]
l’exécution des condamnations mises à sa charge, imputables à ce dernier dont
elle indique qu’il a organisé son insolvabilité, ne peuvent pas non plus engager
la responsabilité de l’État alors qu’elle avait, avant la liquidation de ses
préjudices, la possibilité de prendre des mesures conservatoires ou des sûretés
sur les biens de son débiteur afin de garantir ses créances, ce qu’elle ne
prétend pas avoir fait ;
Que pour les motifs
précédemment énoncés, ne peuvent pas non plus être prises en compte les
difficultés rencontrées par [la requérante] pour obtenir la prise en charge du
sinistre par la chambre nationale des huissiers de justice en tant qu’assureur ;
Considérant que
n’étant pas établie par [la requérante] l’existence d’un déni de justice et de
fautes lourdes du service de la justice à l’origine du préjudice moral dont elle
demande réparation, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions. (...) »
68
. Par une décision notifiée le 3
décembre 2014, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta
la demande d’aide juridictionnelle de la requérante au motif qu’elle ne
formulait aucun moyen sérieux de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.
Le
18 mars 2015, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de
cassation rejeta le recours formé contre cette décision pour les mêmes motifs,
ajoutant par ailleurs que la Cour de cassation n’exerce pas son contrôle sur
l’appréciation par les juges du fond des faits et des éléments de preuve. Le 5
novembre 2015, le conseiller référendaire délégué par le premier président de la
Cour de cassation constata la déchéance du pourvoi formé par la requérante et
son liquidateur, en l’absence de production dans le délai légal d’un mémoire
contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
- Sur la recevabilité
72.Constatant que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas manifestement
mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
-
Le recours en responsabilité formé à l’encontre de
l’expert
69. Le 12 mai 2016, la cour
d’appel de Douai statua sur renvoi après cassation sur une action en
responsabilité pour faute engagée par la requérante et son mandataire judiciaire
à la liquidation à l’encontre du premier expert judiciaire. Elle condamna
notamment ce dernier, en raison de son manquement au devoir d’impartialité, à
verser à la requérante une somme de 5 000 EUR en réparation de son préjudice
moral et au mandataire judiciaire une somme de 10 000 EUR en réparation du
préjudice matériel.
Sur le fond
a)
Principes généraux
83. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie à
la lumière des circonstances de l’affaire et selon les critères suivants
consacrés par une jurisprudence bien établie : la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu
du litige pour l’intéressé (Frydlender c. France
[GC], no 30979/96,
§ 43, CEDH 2000‑VII). Ces critères s’appliquent également dans le cas où est en
cause la durée de la procédure d’exécution d’un jugement définitif (Bendayan
Azcantot et Benalal Bendayan c. Espagne, no
28142/04, § 71, 9 juin 2009).
84. Elle a plus spécifiquement
jugé qu’il incombe aux États contractants de traiter avec célérité les litiges
relatifs à l’emploi, compte tenu de l’enjeu de la procédure pour l’intéressé, sa
vie personnelle et familiale ainsi que sa carrière professionnelle (Gouttard
c. France, no 57435/08,
§ 35, 30 juin 2011).
85. La Cour
rappelle, s’agissant des procédures ayant donné satisfaction au demandeur, que
le point de départ du délai est en principe la date de saisine de la juridiction
compétente (Poiss c. Autriche,
23 avril 1987, § 50, série A no 117)
et que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit,
devant être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de
l’article 6 (Hornsby c. Grèce,
19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et
décisions 1997‑II), ce n’est qu’au moment où le
droit revendiqué dans la procédure trouve sa réalisation effective que le délai
arrive à son terme (Estima Jorge c. Portugal,
21 avril 1998, §§ 35‑38, Recueil des arrêts et
décisions 1998‑II,
Martins Moreira c. Portugal,
26 octobre 1988, § 44, série A no
143).
86. Lorsque la collaboration d’un
expert s’avère nécessaire au cours de la procédure, la Cour retient qu’il
incombe au juge d’assurer la mise en état et la conduite rapide du procès (Capuano
c. Italie, 25 juin 1987, §§ 30‑31, série A no
119, Versini c. France,
no 40096/98,
§ 29, 10 juillet 2001, et Sürmeli c. Allemagne
[GC], no 75529/01,
§ 129, CEDH 2006‑VII).
87. La Cour estime enfin que le
comportement du défendeur ne dispense pas le juge d’assurer le respect des
exigences de l’article 6 en matière de délai raisonnable, notamment en exerçant
les pouvoirs mis à sa disposition par la loi afin de remédier à d’éventuelles
manœuvres dilatoires de la part d’une partie à la procédure (Costa
Ribeiro c. Portugal, no
54926/00, § 29, 30 avril 2003) mais elle entend néanmoins rappeler que
seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à
l’inobservation du « délai raisonnable » (Humen
c. Pologne [GC], no
26614/95, § 66, 15 octobre 1999).
b)
Application des principes au cas d’espèce
-
Période à prendre en considération
88. La Cour constate que les
parties s’accordent pour considérer que la période à prendre en compte a débuté
en juillet 1993, avec le signalement effectué par la requérante auprès du
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais. La
Cour relève quant à elle que si les pièces du dossier ne permettent pas
d’établir avec exactitude la date à laquelle la requérante s’est constituée
partie civile devant la juridiction pénale, l’intéressée a néanmoins, dès le 14
octobre 1994, commencé à chiffrer son préjudice dans le cadre de l’instruction
et a ainsi exercé son droit de demander réparation des préjudices subis du fait
de l’infraction commise par A.C. (Perez c. France
[GC], no 47287/99,
§ 64, CEDH 2004 I). La Cour en déduit que le point de départ du délai de la
procédure litigieuse doit être fixé, au plus tard, le 14 octobre 1994.
89. En ce qui concerne le terme de
la procédure litigieuse, la Cour relève que le volet pénal du procès a pris fin
avec le jugement correctionnel du 29 avril 1999, dont il n’a été fait appel que
des seules dispositions civiles. Elle note par ailleurs que le volet civil de la
procédure juridictionnelle s’est achevé avec l’intervention de l’arrêt de la
Cour de cassation du 27 juin 2012 (paragraphe 42 ci-dessus).
90. La Cour considère toutefois,
que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le délai de la procédure
qu’il convient d’appréhender dans son ensemble comprend également la phase
d’exécution consécutive à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2012
(paragraphe 85 ci-dessus).
91. Il s’agit certes d’une seconde
phase dont le déclenchement dépendait de l’initiative de la requérante (Martins
Moreira c. Portugal, 26 octobre 1988, § 44, série
A no
143). Toutefois, en l’espèce, cette dernière a, tout au long de la procédure,
pris des initiatives visant au recouvrement des sommes qui lui étaient dues
(paragraphes 45, 48, 49, 50 et 51 ci-dessus).
92. Il s’ensuit que la phase
juridictionnelle de la procédure en litige doit être regardée comme s’étant
déroulée du 14 octobre 1994 au 27 juin 2012, soit sur une période de dix-sept
ans et huit mois. La phase ultérieure d’exécution demeure quant à elle inachevée
et a ainsi duré à tout le moins neuf années et onze mois.
-
Caractère raisonnable de la durée de la procédure
α)
Complexité de l’affaire
93. La Cour note que, le 29 avril
1999, le tribunal correctionnel de Beauvais, a, dans un jugement devenu
définitif sur ce point, reconnu A.C. coupable d’escroquerie au préjudice de la
requérante, pour des faits commis entre 1990 et le 13 janvier 1993.
94. La Cour relève que, dans
l’arrêt précité du 3 avril 2014, la cour d’appel d’Amiens a distingué, dans
l’analyse de la complexité de l’instance, « la procédure pénale suivie à
l’encontre [du prédécesseur de la requérante] » de la procédure relative à la
détermination des intérêts civils.
95. Elle retint en particulier que
la partie pénale de la procédure présentait un caractère de complexité certain
attesté par les « nombreuses investigations » requises en vue de « la réunion
des preuves nécessaires à la caractérisation [d’] infractions complexes ». Elle
jugea également que la requérante ne pouvait valablement contester la complexité
des opérations d’expertise ordonnées aux fins d’évaluer les préjudices civils
subis par elle (paragraphe 67 ci-dessus).
96. La Cour constate que
l’instruction pénale a effectivement exigé, d’une part, une analyse approfondie
de comptabilité effectuée sur un logiciel informatique défaillant et en dépit
d’éléments comptables manquants et, d’autre part, de nombreuses auditions et
confrontations dont le caractère utile n’est pas contesté. Toutefois, se
concentrant sur la procédure d’indemnisation des préjudices civils de la
requérante, la Cour constate que si sa complexité découlait des constats
effectués au cours de l’instruction pénale, d’une part, la détermination des
nombreux préjudices subis était susceptible d’être menée à la lumière des
éléments recueillis dans le cadre de ce volet pénal et, d’autre part, le travail
d’expertise était circonscrit à une seule étude et à un peu plus de trois années
de comptabilité.
97. Dans ces conditions, la Cour
considère que, prise dans son ensemble, la procédure civile présentait un degré
de complexité qui ne saurait justifier à lui-seul sa longueur depuis son
déclenchement au plus tard le 14 octobre 1994.
β)
Comportement de la requérante
‒
Au cours de la phase juridictionnelle
98. La Cour constate que la
requérante signala au procureur de la République le comportement de son
prédécesseur, M. A. C., très rapidement après avoir acquis l’étude, laquelle
était dans une situation financière bien plus défavorable que celle présentée
lors de la cession.
99. En ce qui concerne la phase
procédurale s’étant déroulée jusqu’à la condamnation pénale prononcée le 29
avril 1999, la Cour relève que la requérante a contribué à l’évaluation de ses
propres préjudices et de ceux des clients institutionnels de l’étude.
100. En ce qui concerne la phase
juridictionnelle ultérieure, la Cour constate que si la requérante n’a réglé les
consignations d’expertise mises à sa charge en octobre 2000, janvier 2002 et
novembre 2002 que plusieurs mois après qu’elles ont été ordonnées (paragraphes
23, 24 et 26 ci-dessus), engendrant un retard total d’environ une année pour les
trois premières consignations, elle n’est pas en mesure d’en tirer des
conséquences en ce qui concerne le comportement de l’intéressée, en l’absence au
dossier d’éléments permettant d’établir, de manière certaine, la date de
notification de ces ordonnances.
101. Par ailleurs, la Cour relève
que la requérante n’a pas réglé les consignations d’expertise mises à sa charge
le 11 janvier 2005 et le 20 juillet 2006, contribuant de ce fait à l’allongement
de la procédure.
102. À cet égard, la Cour constate
que la cour d’appel d’Amiens a jugé le 3 avril 2014 (paragraphe 67 ci-dessus)
que la requérante n’établissait pas avoir fait utilement part de difficultés
financières au juge en charge des expertises. La Cour relève que ce point n’est
pas sérieusement contesté par l’intéressée.
103. La Cour estime qu’il en
résulte que s’il est constant que la requérante faisait face à d’importantes
difficultés financières, notamment à partir de décembre 2005, date de cessation
des paiements dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’intéressée a tout de
même une part de responsabilité dans le délai pris par les juridictions pour
statuer sur le volet civil de la procédure. Contrairement à ce qu’elle soutient,
la requérante ne pouvait attendre de la juridiction saisie qu’elle analyse sa
situation financière d’office quand bien même celle-ci avait eu à connaître de
litiges disciplinaires résultant de l’insuffisance d’actifs de l’étude ou encore
de demandes de suppléance de l’office.
104. Dans ces conditions, la Cour
considère, à l’instar des juges internes, que le comportement de la requérante
doit être regardé comme ayant partiellement contribué à la longueur de la
procédure litigieuse.
105. Il est vrai toutefois que,
dès 2005, la durée de cette procédure ne pouvait plus, au vu des faits de
l’espèce, passer pour raisonnable. La Cour en déduit que le comportement de la
requérante lié au défaut de consignation à compter de cette date ne peut revêtir
qu’une importance marginale dans la mise en balance des critères énoncés
précédemment (paragraphe 83 ci-dessus).
106. En outre, la Cour relève
qu’il ne peut être reproché à la requérante d’avoir investi dans l’office les
provisions obtenues en 1997 et 1999 alors qu’elle faisait par ailleurs l’objet
d’une procédure disciplinaire liée à la situation financière de l’étude.
107. Le Cour constate également
que la requérante a contribué à la détermination de ses préjudices en produisant
devant les juridictions internes en charge de statuer sur les intérêts civils
deux rapports d’expertise qu’elle fit elle-même réaliser, datés de juin 1997 et
d’octobre 2000 (paragraphes 12 et 21 ci-dessus), ainsi qu’un rapport d’expertise
daté de 2003 sollicité par la juridiction d’appel statuant en matière
disciplinaire (paragraphe 55 ci-dessus).
108. La Cour relève enfin que les
multiples requêtes formées par la requérante n’ont pas significativement retardé
le règlement du volet civil de la procédure en litige.
‒
Au cours de la phase d’exécution
109. En ce qui concerne la
procédure d’exécution des décisions juridictionnelles prononçant l’indemnisation
des préjudices de la requérante, la Cour constate que la cour d’appel d’Amiens,
statuant sur la durée de la procédure (paragraphe 67 ci-dessus), a relevé que
les difficultés de recouvrement de la créance, y compris le défaut de prise en
charge du sinistre dans le cadre assurantiel, ne pouvaient être imputées à
l’État et que l’intéressée ne justifiait pas des diligences accomplies sur les
biens de son débiteur pour garantir ses créances.
110. La Cour relève toutefois que
la requérante obtint le paiement intégral des deux provisions mises à la charge
de son prédécesseur en décembre 1997 et avril 1999.
111. La Cour constate également
que la requérante sollicita le versement d’une provision complémentaire le 8
juin 2005 qui lui fut refusée par jugement du 20 juillet 2006 (paragraphes 31 et
32 ci-dessus).
112. La Cour observe par ailleurs
que, le 24 novembre 2009, la requérante perçut une somme de 4 101 EUR de la part
de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction au motif qu’elle se
trouvait dans l’impossibilité d’obtenir de l’auteur des faits une indemnisation
effective et suffisante de son préjudice (paragraphe 48 ci-dessus).
113. La Cour note que, bénéficiant
d’une décision juridictionnelle partiellement exécutoire le 11 mai 2010, la
requérante fit procéder immédiatement à des saisies sur les comptes bancaires et
le patrimoine immobilier de son prédécesseur, notamment sur ses pensions de
retraite, ces procédures ne permettant toutefois pas de recouvrer l’intégralité
de la créance (paragraphe 49 ci-dessus).
114. La Cour constate également
que la requérante entreprit deux procédures judiciaires tendant à faire
reconnaître que son prédécesseur avait organisé son insolvabilité par le biais
d’un divorce contre lequel elle formait alors tierce opposition (paragraphes 50
et 51 ci-dessus).
115. La Cour relève toutefois qu’à
l’occasion de ces instances, qui n’aboutirent pas favorablement pour
l’intéressée, les juridictions indiquèrent à la requérante qu’elle disposait
d’une action oblique envers l’ex-épouse de son prédécesseur pour recouvrement
d’une soulte d’un montant de 200 000 EUR, action qu’elle n’allègue pas avoir
entreprise (paragraphe 52 ci-dessus).
116. Au vu de ce qui précède, la
Cour se sépare en partie de l’appréciation des juges internes et conclut
qu’alors même qu’il n’apparaît pas que la requérante ait effectué toutes les
diligences à sa disposition elle doit être regardée comme s’étant efforcée, dans
la mesure du possible, d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
γ)
Comportement des autorités compétentes
‒
Au cours de la phase juridictionnelle
117. La Cour estime tout d’abord
que la chronologie de la procédure, appréhendée de l’instruction pénale des
faits jusqu’à l’intervention du jugement du 29 avril 1999, ne révèle aucune
inaction manifeste des autorités nationales (paragraphes 7 à 18 ci-dessus).
118. La Cour relève ensuite que si
l’expertise sollicitée dans le cadre du volet pénal de la procédure par A.C. aux
fins d’établissement des préjudices subis par la requérante a été définitivement
refusée en appel en octobre 1997, au motif notamment de l’insuffisance et de
l’absence partielle de comptabilité de l’étude (paragraphe 13 ci-dessus), en
revanche, le tribunal de grande instance de Beauvais statuant sur l’action
civile le 29 avril 1999, confirmé, sur ce point, par la cour d’appel d’Amiens le
31 octobre 2000, a ordonné, avant-dire droit, une telle expertise.
119. En ce qui concerne cette
expertise, la Cour relève que le juge en charge de son contrôle n’a pas
pleinement fait usage des outils à sa disposition pour la faire avancer et
assurer la conduite rapide du procès. À cet égard, il est intéressant de relever
que la cour d’appel d’Amiens, statuant sur l’action civile le 30 mars 2011, fit
elle-même mention du « déroulement, pour le moins aléatoire, de[s] opérations
d’expertise ».
120. Concernant, en premier lieu,
les délais accordés à l’expert, la Cour constate que l’expertise a débuté après
le versement de la première consignation, en février 2001. Elle relève que
l’appréciation des juridictions internes a été variable en ce qui concerne le
respect des délais, le juge taxateur ayant retenu dans l’ordonnance du 27 mars
2012, devenue définitive, qu’« il n’est pas discutable que l’expert n’a, en
aucune façon, respecté les délais impartis » tandis que le juge statuant
définitivement sur le recours en responsabilité formé contre l’expert, le 12 mai
2016, a considéré qu’aucune faute ne peut être imputée à l’expert sur ce point.
La Cour souligne qu’il ressort des pièces du dossier que quatre prorogations ont
été accordées, parfois sollicitées hors délai par l’expert, et que, par
ailleurs, des temps de latence significatifs, de l’ordre de plusieurs mois, ont
été recensés entre la fin de chaque délai et les différentes ordonnances de
prorogation prises par le juge.
121. Concernant, en deuxième lieu,
la maîtrise du montant de l’expertise, le juge, accueillant les demandes
successives de l’expert fondées, selon ce dernier, sur « la nature et
l’importance de l’affaire », a mis à la charge de la requérante, sans aucunement
motiver ses décisions, des consignations complémentaires pour un montant global
qui s’est avéré être bien supérieur à la taxation définitive. Le 11 janvier
2005, date à laquelle une quatrième consignation d’un montant de 17 600 EUR lui
était demandée, la requérante avait ainsi déjà consigné près de trois fois le
montant de la taxation définitive.
122. Concernant, en troisième
lieu, la maîtrise du comportement des parties et de l’expert, la Cour note que
si le juge en charge des expertises les avait convoqués à une réunion devant se
tenir le 28 avril 2005, il annula cette dernière au vu de la demande de
récusation présentée par A.C.
123. Concernant, en quatrième
lieu, les diligences accomplies à la suite de la demande de récusation du
premier expert, la Cour retient que si cette demande n’était pas imputable aux
autorités compétentes mais à A.C., dix mois se sont toutefois écoulés entre
celle-ci et la tenue d’une première audience puis, après renvoi à la demande des
parties, une nouvelle période de cinq mois avant que ne soit rendu le jugement
de récusation. La Cour constate également qu’alors que la première expertise
durait depuis le mois de février 2001, le juge ordonna tout de même une nouvelle
expertise sans rechercher s’il était envisageable de statuer en l’état, au vu
des éléments déjà versés au dossier, ce qu’il sera finalement décidé de faire en
mai 2010. Enfin, la Cour relève que le tribunal de grande instance de Beauvais
mit plus de trois ans et demi à tirer les conséquences du défaut de règlement
par la requérante de la dernière consignation mise à sa charge en constatant la
caducité de la seconde expertise (paragraphe 37 ci-dessus).
124. La Cour rappelle que,
concernant les faits relevés ci-dessus, la cour d’appel d’Amiens statuant le 3
avril 2014 a jugé que « les décisions prises par le juge du tribunal de grande
instance de Beauvais chargé du contrôle de l’expertise quant aux prorogations de
délais et aux consignations ne sont pas de nature à caractériser une faute
lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État » (paragraphe 67
ci-dessus).
125. Toutefois, au vu de
l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, la Cour considère pour sa part,
retenant une vision globale de la procédure, que la conduite des opérations
d’expertises, telle qu’effectuée par les juges internes qui n’en ont pas
suffisamment assuré la maîtrise, explique pour une très large part la longueur
de la procédure juridictionnelle. Elle se sépare donc des conclusions auxquelles
est parvenue la cour d’appel d’Amiens dans l’appréciation du comportement des
autorités compétentes.
126. Par ailleurs, et en dernier
lieu, la Cour n’est pas convaincue par l’argumentation du Gouvernement, qui
invoque, pour exonérer les autorités compétentes de leur responsabilité, la
circonstance selon laquelle les recours exercés par le prédécesseur de la
requérante expliqueraient en partie la durée de la phase juridictionnelle. En
effet, il ressort des pièces du dossier que ces recours n’ont pas
substantiellement allongé les délais, les décisions intervenant dans une période
comprise entre douze et dix-huit mois après l’instance précédente (paragraphes
19, 22, 37, 39 et 42 ci-dessus).
127. Dans ces conditions, la Cour
conclut, contrairement aux juridictions internes, que l’écoulement d’un délai de
jugement excessif est principalement imputable au comportement des autorités
compétentes.
‒
Au cours de la phase d’exécution
128. La Cour rappelle que l’on ne
saurait déduire de l’article 6 § 1 de la Convention qu’en matière civile les
États contractants doivent être tenus pour responsables du défaut de paiement
d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur « privé » (Sanglier
c. France, no
50342/99, § 39, 27 mai 2003).
129. Les États ont toutefois l’obligation positive de mettre en place un système
effectif, en pratique comme en droit, qui assure l’exécution des décisions
judiciaires définitives entre personnes privées (Fouklev
c. Ukraine, no
71186/01, § 84, 7 juin 2005).
130. En l’espèce, la Cour constate
qu’à la suite de sa demande du 22 avril 2009, la requérante a pu bénéficier, le
24 novembre 2009, de l’octroi d’une somme de 4 101 EUR versée par un fonds de
garantie d’indemnisation des victimes dont le débiteur est défaillant
(paragraphe 48 ci-dessus).
131. La Cour rappelle par ailleurs
que la cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 14 mars 2014, a indiqué à la
requérante qu’elle disposait d’une action oblique envers l’ex-épouse de son
prédécesseur pour recouvrement d’une soulte de 200 000 EUR prévue dans la
convention de divorce en cas de non-paiement effectif de celle-ci à l’ex-époux
(paragraphe 52 ci-dessus).
132. La Cour estime que, dans les
circonstances de l’espèce, l’intervention des autorités compétentes en vue de
contribuer à l’exécution de la décision judiciaire condamnant A.C., personne
privée, à indemniser la requérante doit être regardée comme répondant à
l’obligation positive susmentionnée (paragraphe 129 ci-dessus). Elle en conclut
qu’aucun élément ne permet d’imputer à l’État une part de responsabilité
s’agissant du délai pendant lequel l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du
30 mars 2011 est resté, pour l’essentiel, inexécuté.
δ) Enjeu
du litige pour l’intéressée
133. La Cour note
que la procédure litigieuse ne pouvait avoir d’effet utile pour la requérante
que si elle aboutissait à une indemnisation rapide des préjudices nés de
l’escroquerie afin de permettre a minima
le renflouement du déficit de l’office, la préservation des intérêts des clients
et la continuation d’une activité professionnelle viable.
134. La Cour
relève que ce déficit a provoqué la naissance de litiges disciplinaires à
l’encontre de l’intéressée. Si les suspensions sollicitées par la chambre
départementale des huissiers de justice furent rejetées, l’intéressée fit tout
de même l’objet d’un rappel à l’ordre, après onze années de procédure
(paragraphe 55 ci-dessus).
135. La Cour
constate que l’écoulement du temps a amplifié l’ampleur du préjudice subi, tant
en raison de l’inflation que de l’augmentation parallèle du déficit de l’étude,
de l’épuisement psychologique de la requérante engendrant son arrêt pour
maladie, la suppléance en son office, puis, les charges n’étant plus payées, le
redressement et la liquidation judiciaires de l’étude et, enfin, sa démission
d’office suivie de la suppression de l’étude par arrêté ministériel.
136. La Cour en
déduit que l’indemnisation des préjudices civils nés de l’escroquerie
représentait un enjeu crucial pour la continuité de l’activité professionnelle
de la requérante ainsi que pour sa vie privée et son équilibre personnel.
c) Conclusion
137. Compte-tenu
de l’enjeu du litige pour la requérante, la Cour considère que la procédure
juridictionnelle en cause requérait une particulière diligence de la part des
autorités compétentes.
138. La Cour
estime qu’en l’espèce la complexité de l’affaire ne pouvait à elle-seule
justifier la longueur de la procédure juridictionnelle considérée dans son
ensemble. Elle note qu’à la date à laquelle la première expertise était
ordonnée, le nombre d’années écoulées depuis l’engagement de la procédure, au
plus tard le 14 octobre 1994, commandait de statuer avec une particulière
célérité sur l’action civile. Était ainsi requise une diligence certaine des
juridictions et en particulier du juge en charge des expertises, ce qui ne fut
manifestement pas le cas.
139. Eu égard à
l’ensemble de ces éléments, la Cour se sépare de l’appréciation retenue par les
juges internes et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention en ce qui concerne la procédure juridictionnelle, prise dans son
ensemble, laquelle se déroula sur près de dix-huit années, alors même que la
phase juridictionnelle conduite jusqu’au 29 avril 1999 ne saurait à elle-seule
révéler une telle violation.
140. En revanche,
la Cour considère que la durée de la période pendant laquelle l’arrêt de la cour
d’appel d’Amiens du 30 mars 2011 est resté, pour l’essentiel, inexécuté ne peut
être imputée à l’État et qu’il ne saurait, en conséquence, être reconnu, à ce
titre, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.



Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH,
lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles
d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous
assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel,
pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.