Pour plus de sécurité, fbls garde à vue est sur : https://www.fbls.net/garde-a-vue.htm
Aucun cookie garanti = liberté préservé pour chacun !
"Toutes les erreurs judiciaires commencent en Garde en Vue,
sachez vous taire !"
Frédéric Fabre docteur en droit.
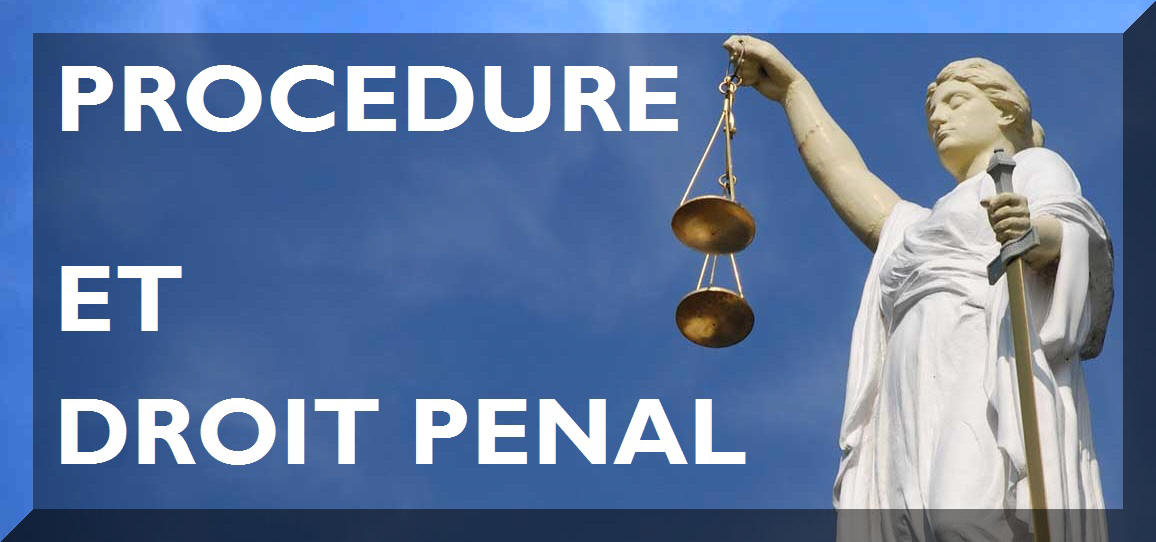 Cliquez
sur un lien bleu pour accéder aux INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES sur :
Cliquez
sur un lien bleu pour accéder aux INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES sur :
- LES ARRÊTS DE LA CEDH SUR LA GARDE A VUE
- AUDITION LIBRE, LA CEDH RECLAME LES MÊMES DROITS QU'UNE GARDE A VUE
- L'APPLICATION IMMEDIATE DE LA REFORME DE LA GARDE A VUE
- LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LES GARDES A VUE
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH
Erarslan et autres c. Turquie du 19 juin 2018 Requêtes nos 55833/09 55837/09, 55838/09 et 55843/09
"24... la Cour estime que, en l’espèce, l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à l’arrestation et au placement en garde à vue des requérants un caractère irrégulier et arbitraire."
FRANCE : Les Recommandations du 19 juillet 2021 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatives aux conditions matérielles de garde à vue dans les services de police
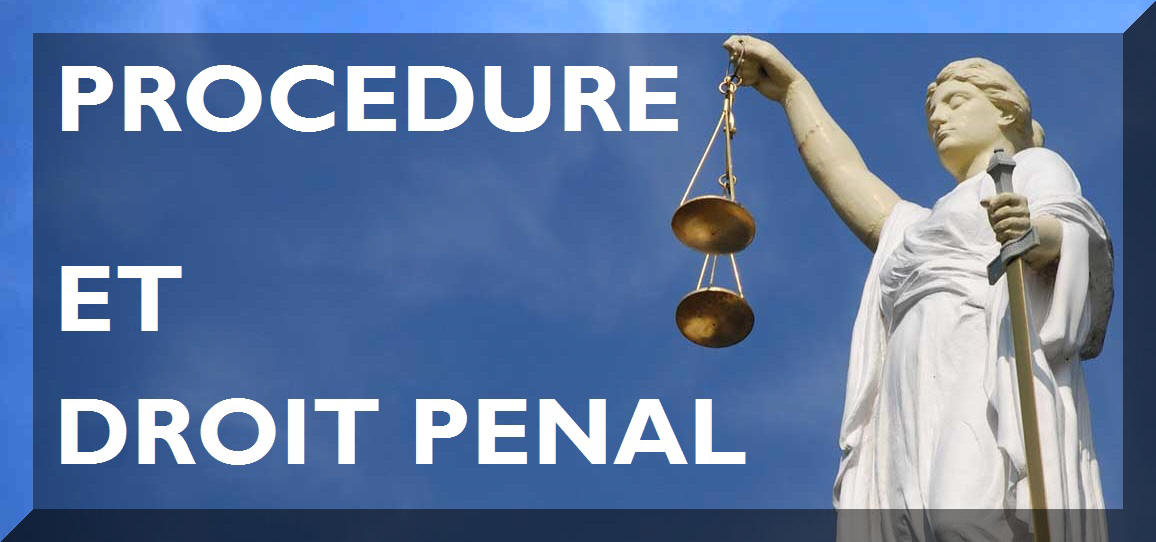 Cliquez
sur un lien bleu pour accéder aux INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES sur :
Cliquez
sur un lien bleu pour accéder aux INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES sur :
- LES DROITS DE LA PERSONNE EN GARDE A VUE
- LE CONTRÔLE D'IDENTITÉ
- LA COMMISSION ROGATOIRE, LE MANDAT D'AMENER ET LE MANDAT D'ARRÊT
- LA PROCEDURE DE LA GARDE A VUE
- LA DETENTION SOUS ECROU EXTRADITIONNEL
LES DROITS DE LA PERSONNE EN GARDE A VUE
La LOI n° 2014-535 du 27 mai 2014 porte transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. Les articles du Code de Procédure Pénale ci-dessous sont actualisés.
La LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 devait être appliquée le 1er juin 2011 selon la loi, mais la Cour de Cassation a décidé son application immédiate, sans attendre la règle d'un jour franc, dès le 15 avril 2011 puisque la loi est parue dans le JO du 15 avril 2011, pour assurer la sécurité juridique et éviter les sanctions de la CEDH.
Le Décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 est relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière.
Article Préliminaire du Code de Procédure pénale
I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code.
En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.
MEDIATISATION D'UNE ENQUÊTE OU GARDE A VUE
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 9 mars 2021 requête n° 20-83.304 cassation
Vu les articles 11 et 28 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ces textes que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées à l’article 28 du code de procédure pénale attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l’enquête. La présence d’un tiers ayant obtenu d’une autorité publique l’autorisation de capter, par le son ou l’image, fût-ce dans le but d’informer le public, le déroulement des actes d’enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
9. Pour écarter l’exception de nullité prise de la présence d’une équipe de télévision équipée d’une caméra lors du contrôle effectué dans le restaurant par les agents de la DDPP, l’arrêt attaqué énonce qu’il se déduit de l’article 11 du code de procédure pénale que la présence d’une équipe de télévision aux côtés d’enquêteurs agissant en flagrance, en préliminaire ou sur commission rogatoire serait de nature à vicier la procédure. Les juges retiennent toutefois que tel n’est pas les cas des services de la DDPP qui procèdent non à des enquêtes mais à de simples contrôles qui n’aboutissent que rarement à des poursuites, mais plus souvent à de simples avertissements ou à des transactions, de sorte que si la discrétion est souhaitable, le contrôle fait en présence de caméra ne viole ni le secret de l’enquête ni aucune forme prescrite par la loi à peine de nullité.
10. La cour d’appel ajoute que la société Fihr ne justifie en outre d’aucun grief tiré de la forme des constatations puisque le procès-verbal du contrôle, mené exclusivement sur pièces et documents, ne s’appuie sur aucun élément testimonial qui aurait pu être dicté par l’émotion due à la présence d’une caméra.
11. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
 CARACTÈRE NON OBLIGATOIRE DE LA GARDE A VUE
CARACTÈRE NON OBLIGATOIRE DE LA GARDE A VUE
Article 73 du Code de Procédure pénale
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été sous contrainte par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
Article L 3341-1 du Code de la Santé Publique
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics
est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue
jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison,
elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle.
Article L 3341-2 du Code de la Santé Publique
Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.
Article L 234-18 du Code de la Route
Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.
Article L 235-5 du Code de la Route
Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l'article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.
UNE GARDE A VUE SANS PV OU AVEC UN PV INCOMPLET EST ILLEGALE
UNE RETENUE A LA GENDARMERIE EN DEHORS DES CONDITIONS DE LA GARDE A VUE EST ARBITRAIRE
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 24 mai 2016, pourvoi N° 15-80848 rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et des pièces de procédure que M. Y..., représentant du syndicat Sud-santé-sociaux de l'Allier, a porté plainte au motif que, le 25 novembre 2010, alors qu'il souhaitait aller manifester contre la réforme des retraites à l'occasion d'un déplacement du Président de la République et de membres du gouvernement prévu en fin de matinée au Mayet-de-Montagne (Allier), deux gendarmes l'ont invité, vers 9 heures 30, à les suivre à la brigade locale, où il a fait l'objet d'une vérification d'identité, d'une fouille ainsi que, de 10 heures 45 à 12 heures 30, d'une audition sur son activité syndicale et sa prétendue participation à un collage d'affiches pour le Nouveau parti anticapitaliste, et qu'il n'a finalement été autorisé à quitter les lieux que vers 13 heures 45, une fois la visite présidentielle achevée ; qu'à l'issue d'une enquête préliminaire confiée à l'inspection générale de la gendarmerie nationale, une information judiciaire a été ouverte sur les faits, au terme de laquelle le commandant du groupement de gendarmerie de l'Allier ainsi que son adjoint, le capitaine X..., qui étaient responsables localement de l'organisation et de la sécurité du déplacement du chef de l'Etat, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables des faits ; que les prévenus ont relevé appel de la décision ainsi que, à titre incident, le ministère public et M. Y..., constitué partie civile ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus, qui soutenaient que M. Y... n'avait subi aucune atteinte à sa liberté d'aller et venir, et confirmer le jugement déféré sur la culpabilité, l'arrêt, par motifs propres et adoptés incomplètement repris au moyen, énonce, notamment, que les deux officiers de gendarmerie ont donné l'ordre de mettre l'intéressé hors d'état de manifester à la vue du Président de la République, sous couvert d'une vérification d'identité et d'une enquête sur un collage d'affiches, M. X... ayant lui-même indiqué lors d'une conversation téléphonique avec ses subordonnés, qui s'interrogeaient sur le cadre légal de la mesure, qu'il s ‘ agissait d'une " interpellation déguisée " et qu'en l'état des directives reçues notamment du préfet, M. Y... devait être " gardé à la brigade ", tandis que le commandant de groupement a reconnu avoir demandé d'" extraire " l'intéressé pour le conduire à la gendarmerie du Mayet-de-Montagne et de tout faire pour l'y retenir avant l'arrivée du chef de l'Etat prévue à 12 heures ; que les juges ajoutent que ce n'est pas spontanément, mais sur une injonction des gendarmes invoquant " une vérification à faire ", que M. Y... a consenti à les suivre à la brigade et qu'au cours des quatre heures qu'il y est demeuré, il s'est trouvé constamment sous surveillance, que des camarades, qui s'enquerraient de sa situation, ont été éconduits sans pouvoir le rencontrer, que le contenu de ses poches lui a été confisqué et que, lorsqu'il a manifesté son intention de quitter les lieux, il en a été dissuadé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, dont il résulte que le demandeur au pourvoi, officier de gendarmerie, a fait conduire et retenir pendant plusieurs heures une personne dans des locaux dépendant de son autorité, en connaissance de l'absence de fondement légal de la mesure, la cour d'appel a caractérisé le délit d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, dont elle a déclaré l'intéressé coupable
EN CAS D'ABSENCE D'UNE PAGE D'UN PROCES VERBAL CONCERNANT LES FORMALITES SUBSTANTIELLES
LA COUR DE CASSATION NE PEUT PAS CONTROLER ET DOIT CASSER
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 29 janvier 2014 N° de pourvoi 13-81479 Cassation
Vu l'article 378 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par
le président et ledit greffier ;
Attendu qu'en raison de l'absence de sa onzième page, le procès-verbal des débats ne constate pas les formalités accomplies le 30 janvier 2013,
postérieurement à l'audition du témoin M. Y..., et le lendemain avant 14 heures ;
Attendu qu'en l'état de cette omission, la Cour de cassation n'est pas en mesure de connaître quels ont été les actes de procédure effectués et, par là-même,
de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi, relatives à ces actes, ont été respectées ;
D'où il suit que la cassation est encourue.
LES FAUTES DE PROCEDURE DANS LES GARDES A VUE DOIVENT ÊTRE EVOQUEES IMMEDIATEMENT
LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH OU DU CDH DE GENEVE DOIT ÊTRE EVOQUEE IMMEDIATEMENT
SI L'AVOCAT MÊME COMMIS D'OFFICE NE LE FAIT PAS, IL VOUS VOLE UNE RELAXE,
ENGAGEZ SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
En l'espèce, l'avocat a tout fait, le juge n'a pas statué au fond, il peut donc à nouveau faire valoir les fautes de procédures devant la chambre d'instruction.
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 4 juin 2014, pourvoi n° 14-81097 cassation
Attendu que le tribunal correctionnel, devant lequel M. X... a comparu sur convocation par le procureur de la République, au vu des
résultats d'une enquête préliminaire, aux fins qu'il soit jugé pour agressions sexuelles, s'est déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits
; que la cour d'appel a confirmé cette décision, après avoir également déclaré irrecevable l'exception de nullité présentée pour la première fois devant elle
par le prévenu ; que le pourvoi en cassation formé par celui-ci a été rejeté ; qu'ultérieurement le procureur de la République a ouvert une information contre
M. X... qui a été mis en examen notamment du chef de viol ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée par la personne mise en examen, visant les actes relatifs à sa garde à vue lors de
l'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué retient que la juridiction correctionnelle ayant auparavant statué sur ce moyen de nullité et le pourvoi
formé contre cette décision ayant été rejeté, l'autorité de chose jugée s'oppose à ce que la personne mise en examen soulève à nouveau ce moyen devant la chambre
de l'instruction, sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que la personne mise en examen dans une information ouverte après
décision d'incompétence d'une juridiction correctionnelle, en raison de la nature criminelle des faits, présente devant la chambre de l'instruction, en
application de l'article 173 du code de procédure pénale, un moyen de nullité auparavant déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 385 dudit code,
par ladite juridiction correctionnelle, dès lors que celle-ci n'a pas été saisie par ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction, qu'elle n'a pas statué au
fond, et que sa décision, même non censurée par la Cour de cassation, ne saurait donc être revêtue à cet égard de l'autorité de chose jugée opposable dans la
procédure d'information ultérieure, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision
Article 706-88 du Code de Procédure pénale
Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire. Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3.
Le présent article n'est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l'article 706-73 ou, lorsqu'elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14° à 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l'article 410-1 du code pénal ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies. Les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables.
Article 706-88-1 du Code de Procédure pénale
S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.
S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
Code de procédure pénale : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité (Articles 78-1 à 78-7)
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 1er septembre 2020 pourvoi n° 19-87.499 cassation
Vu l’article 78-2-1 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit de ce texte qu’excèdent les pouvoirs qu’ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et poursuite des infractions visées audit texte les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu’une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d’investigation.
10. Pour rejeter le moyen de nullité des opérations de contrôle dans le garage de la société KDM autos, pris de ce qu’aucune activité n’était en cours, l’arrêt attaqué énonce que le seul fait que le portail d’accès au lieu soit fermé lors de l’arrivée des fonctionnaires requis ne démontre pas une absence d’activité dès lors que les infractions de travail dissimulé sont, par nature, des infractions qui se commettent à l’abri des regards.
11. Les juges ajoutent que plusieurs véhicules étaient stationnés à l’extérieur du bâtiment, ce qui pouvait laisser supposer la réalité d’une activité de réparation, se déroulant à l’intérieur de celui-ci.
12. Ils relèvent encore qu’une fois ouvert le portail d’accès au lieu, les enquêteurs ont pénétré dans le bâtiment lui-même, par un portail ouvert à l’arrière de celui-ci.
13. Ils en déduisent que ces éléments permettaient aux enquêteurs de présumer l’existence d’une activité réelle dans les locaux lors de leur arrivée sur les lieux et d’y pénétrer légalement.
14. Ils énoncent encore que le simple contrôle visuel du numéro de série d’un véhicule en travaux, dont le capot est ouvert, ne constitue ni une perquisition de celui-ci ni une fouille.
15. Ils ajoutent en substance que les opérations contestées avaient pour objet la possible constatation d’une activité dissimulée, la vérification des véhicules sur lesquels il est procédé à des réparations et celle de leur provenance licite ou non, étant nécessaires pour contrôler le volume d’activité ainsi que la véracité des déclarations faites à l’administration fiscale et des registres tenus.
16. Ils en déduisent que les actes contestés n’outrepassaient pas les pouvoirs que les officiers de police judiciaire tenaient des réquisitions du procureur de la République.
17. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
18. En effet, si c’est à bon droit que la chambre de l’instruction a constaté, au vu des circonstances qu’elle a relevées, que les enquêteurs étaient entrés régulièrement dans les locaux de la société KDM autos, il se déduit du procès-verbal de contrôle qu’aucune activité de réparation n’était en cours, de sorte que lesdits enquêteurs ne pouvaient s’y maintenir et procéder à des actes d’investigation, hors le cas de flagrance.
19. Il s’ensuit que les opérations ainsi effectuées sont irrégulières.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Article 75-3 du Code de Procédure pénale
La durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans
à compter du premier acte de l'enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans
le cadre d'une enquête de flagrance.
L'enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée
maximale d'un an à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur
autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au
dossier de la procédure.
Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la
procédure au procureur de la République en application de l'article 19 avant
l'expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois
ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de l'action publique, le cas
échéant par l'ouverture d'une information judiciaire, soit la mise en œuvre
d'une procédure alternative aux poursuites, soit le classement sans suite de la
procédure. Tout acte d'enquête intervenant après l'expiration de ces délais est
nul, sauf s'il concerne une personne qui a été mise en cause au cours de la
procédure, au sens de l'article 75-2, depuis moins de deux ans ou, en cas de
prolongation, de trois ans.
Lorsque l'enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73
ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République
antiterroriste, les délais de deux ans et d'un an prévus au présent article sont
portés respectivement à trois ans et à deux ans.
Pour la computation des délais prévus au présent article, il n'est pas tenu
compte, lorsque l'enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite
puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant
laquelle l'enquête a été suspendue. Il n'est pas non plus tenu compte, en cas
d'entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande
par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces
d'exécution. Lorsqu'il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le
cadre d'une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais
prévus au présent article, de la date de commencement de l'enquête la plus
ancienne.
Article 77 du Code de Procédure pénale
Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.
UN MINEUR A DROIT AUSSI A LA PROTECTION DE LA GARDE AVUE
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 6 novembre 2013 pourvoi n° 13-84320, cassation
Vu l'article 593 du code de procédure pénale
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs
propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des
mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs
équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Moïse X..., mineur âgé de
plus de 13 ans, suite à la plainte d'une éducatrice dénonçant des coups et des
menaces, a été remis, par la directrice de son foyer d'accueil, aux policiers,
qui l'ont conduit au commissariat sans procéder à son menottage ; qu'il a été
entendu par un officier de police judiciaire sans avoir été placé en garde à vue
et sans avoir été informé de son droit de quitter le commissariat ; que
l'intéressé a quitté les locaux de police, de sa propre initiative, à l'insu du policier, qui sollicitait des instructions du ministère public ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de cette audition, l'arrêt
attaqué énonce que Moïse X... avait accepté de suivre les policiers jusqu'à leur
service sans que la pose d'entraves soit nécessaire, le quittant ensuite
librement après son audition, sans même en aviser les forces de l'ordre, depuis
la simple salle d'attente où il se trouvait ; que les juges ajoutent que dans ce
contexte, nonobstant l'absence de mention expresse quant à l'information du
requérant de son droit de quitter à tout moment les locaux de police, il résulte
de la procédure un faisceau d'indices établissant qu'il avait bien connaissance
de cette faculté et qu'il avait parfaitement conscience, lors de son audition,
de ne pas s'être trouvé dans une situation de contrainte pouvant imposer son
placement en garde à vue ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mineur, conduit par les
policiers auprès d'un officier de police judiciaire pour être entendu sur une
infraction qu'il était soupçonné d'avoir commise, se trouvait nécessairement
dans une situation de contrainte et devait bénéficier des droits attachés au
placement en garde à vue, prévus par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février
1945, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations
Article 77-1 du Code de Procédure pénale
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 17 décembre 2019, pourvoi n° 19-83.358 cassation
Vu l’article 77-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques doit être donnée dans le cadre de la procédure d’enquête préliminaire en cours et non par voie d’autorisation générale et permanente préalable ; que cette interprétation est commandée par la nécessité de garantir la direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 mars 2017, un vol à main armée a été commis au préjudice d’une bijouterie par deux hommes, masqués, gantés et porteurs chacun d’une arme de poing ; que, dans le cadre d’une enquête de flagrance, ont été effectuées des mesures de police technique et scientifique, dont le prélèvement par écouvillonnage de traces de sang découvertes sur les lieux ; que, le 5 avril 2017, au visa de l’article 60-1 du code de procédure pénale, l’institut national de la police scientifique (INPS) a été saisi par un officier de police judiciaire de l’analyse de ces prélèvements ; que dans le cadre de l’enquête poursuivie dans la forme préliminaire, ce même institut a été saisi le 12 septembre 2017, sur le fondement de l’article 77-1 du code de procédure pénale par un officier de police judiciaire, conformément à des instructions permanentes du procureur de la République du 23 mars 2017, afin de rapprochement entre les prélèvements biologiques et le profil génétique de M. A... X... ; que, dans le cadre de l’information ouverte sur ces faits, ce dernier a été interpellé le 24 avril 2018 puis mis en examen pour vol à main armée et placé en détention provisoire ; que, le 25 octobre 2018, M. X... a présenté une requête aux fins d’annulation de pièces de la procédure ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l’examen technique et scientifique réalisé par l’INPS et des actes subséquents, l’arrêt relève que, le 23 mars 2017, le procureur de la République a, par instruction permanente, expressément autorisé les enquêteurs « à requérir l’INPS ou l’IRCGN aux fins d’analyse des prélèvements effectués sur une scène d’infraction, un objet ou une victime, et de comparaison avec les données du FNAEG aux fins de confirmation des rapprochements réalisés par le FNAEG » et qu’il n’est ainsi donné aucune marge d’appréciation aux enquêteurs dans une telle situation ; que les juges en déduisent que le parquet a ainsi exercé son pouvoir de direction des enquêtes préliminaires diligentées par les officiers de police judiciaire ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 18 juin 2019, pourvoi n° 19-80.105 rejet
Vu l’article 77-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de ce texte, qui permet au procureur de la République, ou sur son autorisation, à l’officier de police judiciaire, de confier des constatations ou des examens techniques et scientifiques à des personnes qualifiées, sont édictées en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une enquête préliminaire ouverte du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, plusieurs saisies de stupéfiants ont été réalisées dans un parc public de Lyon (Rhône) les 15 et 26 septembre, ainsi que les 11 et 13 octobre 2016, puis dans les parties communes d’un immeuble voisin dudit parc, le 20 janvier 2017, où ont été également découverts du matériel utilisé pour la confection de lots de résine de cannabis, ainsi qu’un emballage ayant contenu ces substances ; que deux autres saisies de stupéfiants ont été effectuées dans les parties communes du même immeuble, le 25 janvier 2017 et dans l’enceinte du parc public, le 13 mars 2017 ; que le 11 avril suivant, la perquisition d’un local utilisé comme atelier de conditionnement de stupéfiant a permis d’y constater la présence du matériel employé à cette fin, de cinq cents grammes de cannabis et d’une arme de poing ; que des réquisitions ayant été adressées par les enquêteurs au laboratoire de police scientifique aux fins d’analyse des stupéfiants et de recherches d’empreintes papillaires ainsi que de profils génétiques à partir des matériels et substances saisis lors de ces interventions, les empreintes papillaires de M.X... ont été mises en évidence sur un emballage saisi le 25 janvier 2017 ; que ce dernier a été mis en examen des chefs susvisés le 16 octobre 2017 ; qu’il a adressé à la chambre de l’instruction le 1er février 2018 une requête aux fins d’annulation de pièces de la procédure ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité desdites réquisitions au motif que ces dernières n’avaient pas été autorisées par le procureur de la République contrairement aux prescriptions de l’article 77-1 du code de procédure pénale, l’arrêt énonce que la méconnaissance de cette exigence ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’actes ou de pièces de procédure que par une partie titulaire d’un droit sur les biens objet de l’examen ou qui établit qu’il a, à l’occasion d’une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée ; que les juges relèvent que le mis en examen n’a pas qualité à invoquer la nullité des réquisitions attaquées et des actes subséquents dès lors que, d’une part, les saisies réalisées les 15 septembre 2016, 11 octobre 2016, 13 octobre 2016, 20 janvier 2017 et 13 mars 2017 ne le concernent pas, d’autre part, si les réquisitions délivrées aux fins d’analyse d’un emballage ayant contenu des stupéfiants, saisi le 25 janvier 2017 dans le sous-sol de l’immeuble où il réside, ont abouti à la mise en évidence de ses empreintes papillaires sur ce support, l’intéressé ne dispose de droit ni sur cet emballage, ni sur le lieu de sa découverte ; qu’ils ajoutent que M.X... ne justifie d’aucune atteinte à sa vie privée résultant de ladite réquisition ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors
qu’elle avait constaté que les réquisitions en cause avaient été délivrées sans
qu’il soit justifié d’une autorisation du procureur de la République et que
l’absence d’une telle autorisation peut être invoquée par toute partie y ayant
intérêt, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 13 juin 2017, pourvoi n° 17-80641 rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite du décès de l'enfant Enolla Guille, survenu le 20 décembre 2013, après qu'elle eût été découverte inconsciente, le bras droit pris dans le rouleau constitué par la grille d'accès au parking souterrain de la résidence où elle demeurait à Nouméa, le procureur de la République agissant sur le fondement des dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale a demandé à l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête de saisir et sceller la grille en cause, et de requérir un " expert " chargé de répondre aux questions ainsi formulées : Y-a-t-il des normes applicables sur le territoire ?- Quelles sont elles ?- Si elles existent, le système est il aux normes ? ; que M. Y..., requis, a déposé son rapport le 23 janvier 2014 ; qu'une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée, le 15 avril 2014 du chef d'homicide involontaire, à la suite de laquelle, ont été mis en examen, la société Batical ayant assuré la pose du portail, représentée par M. François X..., le 2 août 2016, M. Henri X..., directeur de la société Batical, et M. François X..., en son nom propre, le 30 août 2016 ; que par requête déposée le 10 novembre 2016, les mis en examen ont demandé à la chambre de l'instruction de prononcer la nullité des réquisitions du parquet du 21 décembre 2013, celles de l'officier de police judiciaire, " l'expertise réalisée ", et tous actes subséquents ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction a retenu que la recherche des normes techniques applicables à la fourniture et à la pose d'un système de fermeture impliqué dans un accident n'excède pas les limites d'un examen technique susceptible d'être donné à un professionnel du bâtiment ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors, d'une part, que la mission confiée, conformément à l'article 77-1 du code de procédure pénale, à une personne qualifiée, de recenser l'ensemble des normes techniques applicables au dispositif mis en cause dans la survenance d'un décès, n'emporte aucune délégation de ses fonctions par le magistrat qui l'ordonne, d'autre part, que les parties peuvent en discuter les conclusions, qui ne lient ni le juge d'instruction désormais saisi ni la juridiction de jugement susceptible de l'être, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté
Article 77-1-1 du Code de Procédure pénale
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 et l'article 60-1-1 sont également applicables.
Article 77-1-2 du Code de Procédure pénale
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier ou l'agent de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.
Article 77-2 du Code de Procédure pénale
A tout moment de l'enquête préliminaire, le procureur de
la République peut, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter
atteinte à l'efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en
cause, à la victime ou à leurs avocats qu'une copie de tout ou partie du dossier
de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur
disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu'elles ont la
possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.
Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure,
sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère
éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de
nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur
les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à
la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
II. - Sans préjudice du I, toute personne à l'encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle
a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, une infraction
punie d'une peine privative de liberté peut demander au procureur de la
République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de
la procédure afin de formuler ses observations lorsqu'au moins l'une des
conditions suivantes est remplie :
1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une
garde à vue qui s'est tenue il y a plus d'un an ;
2° S'il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d'un an ;
3° S'il a été porté atteinte à la présomption d'innocence de la personne par un
moyen de communication au public. Le présent 3° n'est pas applicable lorsque
les révélations émanent de la personne elle-même ou de son avocat, directement
ou indirectement, ou que l'enquête porte sur des faits relevant des articles
706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République
antiterroriste.
Lorsqu'une telle demande lui a été présentée et qu'il estime qu'il existe à
l'encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, une
infraction punie d'une peine privative de liberté, le procureur de la République
avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou
à sa disposition si elle n'est pas assistée par un avocat, d'une copie de la
procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I du
présent article, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de
six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République
peut refuser à la personne la communication de tout ou partie de la procédure si
l'enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter
atteinte à l'efficacité des investigations. Il statue dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au
dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à
l'origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui
statue également dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, par une
décision motivée versée au dossier. Lorsque l'enquête porte sur des crimes ou
délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence
du procureur de la République antiterroriste, le délai de six mois prévu au
présent alinéa est porté à un an.
Dans la période d'un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de
la République ne peut prendre aucune décision de poursuites hors l'ouverture
d'une information, l'application de l'article 393 ou le recours à la procédure
de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles
495-7 à 495-13.
Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de
la personne certaines pièces de la procédure en raison des risques de pression
sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les
témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la
procédure.
III. - Lorsqu'une enquête préliminaire fait l'objet d'une demande de communication dans les conditions prévues au II, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu'elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l'origine de la demande.
IV. - Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S'il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.
V. - Lorsqu'une période de deux ans s'est écoulée après l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l'enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l'égard des personnes ayant fait l'objet de l'un de ces actes et à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu'à celui du plaignant.
Article 77-3 du Code de Procédure pénale
La demande mentionnée au II de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.
Article 78 du Code de Procédure pénale
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
L'article 62 est applicable.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.
LE PROCUREUR DOIT ÊTRE AUTORISE PAR UN JUGE DU SIEGE POUR DONNER L'AUTORISATION AU POLICIER
COUR DE CASSATION, chambre criminelle arrêt du 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-84.885 cassation
Vu l’article 78 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il se déduit de ce texte qu’il n’appartient pas à l’officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la nécessité ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d’une enquête préliminaire, le procureur de la République a délivré une autorisation de comparution sous la contrainte visant Mme X..., soupçonnée d’appels téléphoniques et de messages électroniques malveillants et réitérés, qui ne s’était pas présentée à une précédente convocation écrite ; que, se trouvant à son domicile, les policiers ont constaté que Mme X... ne répondait pas à leur demande d’ouverture de la porte ; qu’ayant aperçu un homme regardant par la fenêtre de l’intéressée, en l’absence de réponse à leur nouvelle demande d’ouverture, ils ont pris l’initiative de défoncer la porte d’entrée du domicile à l’aide d’un bélier ; que, présente dans les lieux, Mme X... a été placée en garde à vue ; que poursuivie des chefs susvisés, le tribunal correctionnel de Caen a jugé irrégulière la pénétration des policiers dans le domicile de la prévenue et a annulé les procès-verbaux d’interpellation, de garde à vue et d’audition de Mme X... et l’a déclarée coupable de certains des faits reprochés ; que la prévenue, le procureur de la République et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour rejeter l’exception de nullité de la mesure de garde à vue du 3 octobre 2016 et condamner Mme X... des chefs susvisés, l’arrêt retient que les policiers avaient à juste titre fait usage de la force pour défoncer la porte après avoir constaté la présence d’au moins une personne dans l’appartement de Mme X..., qui restait silencieuse ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé ; D’où il suit que la cassation est encourue ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONFIRME QUE CETTE CONVOCATION ARTICLE 78 PEUT CONCERNER DES PERSONNES NON SUSPECTES ET DES SIMPLES TEMOINS
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2167 du 11 avril 2012), dans
les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité posée par la société Olano Carla et M. Éric
P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit
de l'article 78 du code de procédure pénale.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano,
avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation enregistrées le 7 mai 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 mai 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 5 juin 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 78 du code de
procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 9 mars 2004 susvisée : «
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les
nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police
judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec
l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont
pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne
répondent pas à une telle convocation.
« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de
soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent
être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
« L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous
le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes
convoquées.
« Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles
62 et 62-1 » ;
2. Considérant que, selon les requérants, en permettant à un officier de police
judiciaire de convoquer et, le cas échéant, de contraindre à comparaître une
personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, sans
limiter cette faculté aux seules personnes suspectées d'avoir commis une
infraction pour laquelle elles pourraient être placées en garde à vue, et sans
que soit notifié à la personne ainsi entendue son droit de se taire ou de
quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie, les dispositions
contestées méconnaissent les droits de la défense et le principe de rigueur
nécessaire des mesures de contrainte mises en œuvre au cours de la procédure
pénale ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni
détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en
vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance »
; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit
être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
4. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution
l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que,
s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter
une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;
5. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation
entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche
des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et
de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des
droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'au nombre de ceux-ci
figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la
Déclaration de 1789, la liberté d'aller et venir, protégée par ses articles 2 et
4, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la
protection de l'autorité judiciaire ;
6. Considérant que le premier alinéa de l'article 78 est applicable à toutes les
personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de
l'enquête ; que, par suite, cet article est applicable aussi bien aux personnes
à l'encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elles
ont commis ou tenté de commettre une infraction qu'aux simples témoins,
spécialement visés par le deuxième alinéa de cet article ;
7. Considérant, d'une part, qu'en imposant que toute personne convoquée par un
officier de police judiciaire soit tenue de comparaître et en prévoyant que
l'officier de police judiciaire puisse, avec l'autorisation préalable du
procureur de la République, imposer cette comparution par la force publique à
l'égard des personnes qui n'y ont pas répondu ou dont on peut craindre qu'elles
n'y répondent pas, le législateur a assuré entre la prévention des atteintes à
l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d'une part, et
l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, une
conciliation qui n'est pas déséquilibrée ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte nécessairement des dispositions du
premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale qu'une personne à
l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être
entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors
qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte ;
9. Considérant que, toutefois, le respect des droits de la défense exige qu'une
personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de
celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être
entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et
de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de
quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette
réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de
la présente décision, les dispositions du premier alinéa de l'article 78 du code
de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ;
10. Considérant que les dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale
ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;
qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 9, le premier alinéa de
l'article 78 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.
Article 2.- Le surplus de l'article 78 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 juin 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Article 803-3 du Code de Procédure pénale
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l'intéressé
est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge
d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant
l'expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.
LES PERQUISITIONS LORS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE
ARTICLE 76 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables.
Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
COUR DE CASSATION, chambre criminelle, arrêt du 7 décembre 2021 pourvoi n° 20-82.733 rejet
8. L'article 75 du code de procédure pénale prévoit que les
officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de
police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur
les instructions du procureur de la République.
9. Il se déduit de ce texte et de l'article 76 du même code que les agents de
police judiciaire peuvent, en enquête préliminaire, et au contraire de l'enquête
de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu'ils agissent sous le
contrôle de l'officier de police judiciaire.
10. L'existence de ce contrôle est établie par une mention expresse au
procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d'une mention
spécifique dans les pièces de procédure.
11. L'exercice de ce contrôle est une condition de la régularité de la recherche
de la preuve et son absence relève des dispositions de l'article 802 du code de
procédure pénale. L'existence du grief exigé par ce texte est établie lorsque
l'irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice, qui ne peut
résulter de sa seule mise en cause par l'acte critiqué (Crim., 7 septembre 2021,
pourvoi n° 20-87.191, en cours de publication).
12. En l'espèce, c'est à tort que les juges ont déduit du seul visa du
commissaire de police, chef de service, apposé sur le soit-transmis de clôture
de la procédure au procureur de la République, l'existence du contrôle d'un
officier de police judiciaire sur les perquisitions litigieuses sans mentionner
aucune autre pièce de nature à en établir la réalité.
13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que Mme [K], qui n'a
pas contesté la présence du compresseur dans les lieux de la perquisition, ne se
prévaut d'aucun autre grief que les poursuites dont elle a été l'objet.
UNE PERQUISITION EN PRESENCE DES JOURNALISTES APPELES PAR LE PARQUET EST ANNULEE
COUR DE CASSATION, chambre criminelle, arrêt du 9 janvier 2019 pourvoi n° 17-84026 cassation
Vu les articles 11 et 56, 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 76 de ce code;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, que constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, la présence au cours de l’exécution de cet acte, d’un tiers étranger à la procédure, ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d’une information du public&;
Attendu, selon les articles 56 et 76 du code de procédure pénale, qu’à peine de nullité de la procédure, l’officier de police judiciaire a seul le droit, lors d’une perquisition, de prendre connaissance des papiers, documents ou données trouvés sur place, avant de procéder à leur saisie ;
Attendu, enfin, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence;
Attendu que le 24 avril 2012, la SNCF a déposé plainte contre l’auteur d’une série de dégradations volontaires par graffitis et gravures portant la signature “OREAK” sur de nombreux équipements, commises entre le 18 mai 2011 et le 13 avril 2012, que M. X... a reconnu la plupart des faits qui lui ont été reprochés, qu’il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dégradation de monument destiné à l’utilité ou à la décoration publique en récidive et pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 15 octobre 2014, a rejeté ses demandes en nullité d’actes de la procédure et a ordonné un supplément d’information, que le prévenu et le ministère public en ont relevé appel ; que par jugement au fond du 16 juin 2016, M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite s’agissant de la période située entre le 28 mars et le 13 avril 2012 et déclaré coupable pour les faits commis entre le 18 mai 2011 et le 27 mars 2012 ; que la partie civile a formé appel de la décision, et le prévenu a formé un appel incident ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la perquisition et de la saisie de documents au domicile de M. X..., réalisée en présence de journalistes, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la présence alléguée de journalistes ne peut constituer à elle seule un motif d’annulation sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies par le code de procédure pénale, ce qui en l’espèce n’est pas démontré;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que des journalistes ont assisté, avec l’autorisation des enquêteurs, à une perquisition au domicile de M. X..., ont pris connaissance de documents utiles à la manifestation de la vérité, qui ont été immédiatement saisis et placés sous scellés, la cour d’appel qui, de surcroît, n’a pas répondu comme elle le devait aux conclusions présentées par le conseil de M. X..., a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés;
ARTICLE 76-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
ARTICLE 76-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.
ARTICLE 77 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.
COUR DE CASSATION, chambre criminelle, arrêt du 3 avril 2013 pourvoi n° 12-86275 Rejet
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le juge des libertés et de la détention n'avait pas autorisé l'intervention de la société requise pour opérer l'ouverture d'un coffre-fort découvert au cours de la perquisition, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'était assortie d'aucune restriction, qu'elle ne fixait aucune date limite d'exécution et qu'elle n'imposait nullement une information préalable du juge mandant que les juges ajoutent que l'ouverture du coffre-fort entrait dans le cadre des opérations autorisées
Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'article 77-1 du code de procédure pénale concernant les constatations et examens techniques ou scientifiques, inapplicable en l'espèce, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que l'officier de police judiciaire tenait de ses pouvoirs propres la faculté de requérir un serrurier pour procéder à l'opération contestée
Article 60 du Code de Procédure Pénale
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
Article 706-94 du Code de Procédure Pénale
Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 7 juin 2023 pourvoi n° 22-84.442 cassation
Vu l'article 706-94 du code de procédure pénale :
9. Selon ce texte, lorsqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une
information relative à l'une des infractions visées par les articles 706-73 et
706-73-1 du même code, la personne au domicile de laquelle est effectuée une
perquisition est en garde à vue ou détenue dans un autre lieu et que son
transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de troubles à
l'ordre public, d'évasion ou de disparition des preuves pendant le temps
nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord
préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de
deux témoins requis ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.
10. Il se déduit de ces dispositions, qui dérogent au principe énoncé par
l'article 57 du même code, selon lequel la perquisition a lieu en présence de la
personne au domicile de laquelle elle est opérée, que l'accord du magistrat doit
faire l'objet d'un écrit motivé, ou bien de son accord à une demande d'un
enquêteur, mentionné dans un procès-verbal, indiquant les circonstances de
nature à justifier le recours à ces modalités dérogatoires.
11. Une telle obligation vise à garantir du caractère contradictoire du
déroulement des opérations ainsi que de l'authentification de la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis.
12. Pour rejeter l'exception de nullité prise de la violation des dispositions
de l'article 57 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient que
l'autorisation de perquisition donnée par le procureur de la République relève
nécessairement de l'application de l'article 706-94 du même code.
13. Les juge ajoutent qu'après la notification supplétive de la garde à vue pour
des infractions visées à l'article 706-73, 3° de ce code sur instruction du
procureur de la République, ce dernier a manifestement, en application des
dispositions susvisées et compte tenu du risque d'évasion que le comportement de
M. [V] pouvait légitimement laisser craindre, autorisé la perquisition du box en
présence de deux témoins, laquelle a été régulièrement réalisée.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a substitué sa propre appréciation à
celle du procureur de la République, a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation portant sur le rejet, par la cour d'appel, de l'exception de
nullité relative à la perquisition, entraînera celle de la déclaration de
culpabilité pour infraction à la législation sur les stupéfiants et détention
sans justificatif de marchandises dangereuses pour la santé, en récidive et aux
peines, y compris l'amende douanière. Les autres dispositions de l'arrêt,
relatives à la déclaration de culpabilité pour les autres infractions et au
rejet de l'exception concernant la pose du dispositif de géolocalisation, seront maintenues.
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 31 mars 2020 pourvoi n° 19-85.756 rejet
Enoncé du moyen
11. Le moyen est pris de la violation des articles 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, 16 du code civil et 60 du code de procédure pénale.
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a écarté l’exception de nullité tiré de l’irrégularité de la réquisition aux fins de prélèvement sanguin pour dosage de l’alcoolémie et dépistage de stupéfiants
Réponse de la Cour
13. Pour écarter le moyen de nullité des prélèvement sanguins opérés sur réquisition sans que le consentement de M. M... ait été recueilli, et l’atteinte ainsi portée aux principes d’inviolabilité du corps humain et du droit au respect de la vie privée, l’arrêt attaqué retient que les fonctionnaires de police sont intervenus à la demande de la directrice de la clinique suite à une rixe entre deux médecins, au visa des articles 53 et 73 du code de procédure pénale.
14. Les juges énoncent que bien que les signes caractéristiques d’ivresse aient été négatifs, M.M... se trouvait en possession de deux tubes de morphine qu’il a remis aux enquêteurs et que les fonctionnaires notaient, par ailleurs, que l’individu, excité, titubant, avait un air hagard, les mains tremblantes et tenait des propos incohérents.
15. Ils ajoutent qu’a été établie une réquisition manuscrite, " sur instructions de M. le procureur de la République", aux fins de prélèvements sanguins pour dosage de l’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants, la seule détention de produits stupéfiants devant entraîner le contrôle de l’hypothèse d’une consommation desdits produits.
16. Ils en concluent que les vérifications biologiques ordonnées et l’analyse effectuée après instructions étaient parfaitement fondées dans le cadre des dispositions de l’article 60 du code de procédure pénale, qui n’imposent pas le consentement de l’intéressé et alors que l’infraction flagrante de violences pouvait comporter des circonstances aggravantes relatives à un état alcoolique ou à la consommation de stupéfiants.
17. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdisant pas en tant que tel le recours à une intervention médicale sans le consentement d’un suspect en vue de l’obtention de la preuve de sa participation à une infraction dans toutes ses circonstances.
COMMISSION ROGATOIRE, MANDAT D'AMENER ET MANDAT D'ARRÊT
Article 154 du Code de Procédure pénale
Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi
que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.
Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information
prévue à l'article aux articles 61-1 et 63-1, il est précisé que l'audition ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Article 127 du Code de Procédure pénale
Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.
Article 133 du Code de Procédure pénale
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables.
Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.
Article 135-2 du Code de Procédure pénale
Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application de l'article 133-1. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706-71, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne.
La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.
LA PROCEDURE DE LA GARDE A VUE
La Cour de Cassation invente la possibilité de la détention non autorisée par la loi quand elle est "brève" pour palier au manque d'organisation des magistrats. La jurisprudence de la CEDH rejette cette curieuse interprétation
Article 51 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 22 juillet 2015 pourvoi n° 15-82749 rejet
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme,
7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 145 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la détention de la personne mise en examen entre la fin de son interrogatoire par le juge d'instruction et sa
comparution devant le juge des libertés et de la détention et a en conséquence confirmé son placement en détention provisoire ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 51, alinéa 3, du code de procédure pénale et de la jurisprudence le juge d'instruction peut recourir à la force publique
pour faire conduire le mis en examen devant le juge des libertés et de la détention à l'issue de la saisine de ce juge ; qu'aucune disposition légale ne
prévoit de délai de comparution devant le juge des libertés et de la détention ; que M. Y... a été conduit au dépôt du palais de justice de 15 heures 50 jusqu'à
18 heures, heure à laquelle il a pu être présenté au juge des libertés et de la détention dès la disponibilité de ce magistrat ; que le mis en examen a donc été
momentanément et légitimement retenu dans un lieu sécurisé pour une durée n'excédant pas un délai raisonnable ;
" alors que nul ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi ; que lorsque le placement en détention provisoire d'un individu est
envisagé, aucune disposition législative ne prévoit la possibilité de le priver de sa liberté entre la fin de son interrogatoire par le juge d'instruction et sa
comparution devant le juge des libertés et de la détention ; que le maintien sous contrainte durant ce temps est dès lors dépourvu de tout fondement légal ;
qu'en considérant néanmoins que l'arrestation et la détention de M. Y... le temps qu'il puisse comparaître devant le juge des libertés et de la détention
étaient régulières, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 7 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen qui garantissent le droit à la liberté individuelle et à la sûreté " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a été mis en examen des chefs susvisés le 27 mars 2014 puis placé sous
contrôle judiciaire ; qu'au vu des résultats d'une expertise génétique concluant à la présence de son ADN sur certains des objets ayant servi à la commission des
faits qui lui sont reprochés, le magistrat instructeur, le 26 mars 2015, après avoir, procédé à son interrogatoire, a saisi le juge des libertés et de la
détention aux fins de son placement en détention provisoire et l'a fait conduire à 15 heures 50, en requérant la force publique, devant ce magistrat qui l'a reçu
à 18 heures ; que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Attendu que pour écarter l'argumentation du mis en examen tendant à l'irrégularité de sa privation de liberté dans l'attente de sa présentation au
juge des libertés et de la détention, l'arrêt relève que le juge d'instruction peut recourir à la force publique en vertu de l'article 51, alinéa 3, du code de
procédure pénale et que le mis en examen a été momentanément et légitimement retenu dans un lieu sécurisé pour une durée n'excédant pas un délai raisonnable,
compte tenu de la disponibilité nécessaire du magistrat auquel il devait être présenté ;
Article 803-6 du Code de procédure pénale
Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure
privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit
remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans
des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les
droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du
présent code :
1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de
l'infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations,
de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;
4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités
consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure
privative de liberté dont elle fait l'objet ;
7° Le droit d'être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée
de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de
l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander
sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa
privation de liberté.
Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne,
celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une
langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un
procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.
Article 61 du Code de Procédure pénale
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.
L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Article 61-1 du Code de Procédure pénale
Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux
mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être
entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle
est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont
posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni
d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition
ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et
63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le
bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa
charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle,
qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de
poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils
juridiques dans une structure d'accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est
mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est
adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique
l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat
ainsi que les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les
procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle, les modalités de
désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils
juridiques avant cette audition.
Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous
contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
Article 60-1-1 du Code de Procédure pénale
Lorsque les réquisitions prévues à l'article
60-1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à
l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il
s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent
être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention,
saisi à cette fin par le procureur de la République.
Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a
commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui
fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203
ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la
gravité des faits.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.
Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.
Article 61-2 du Code de Procédure pénale
Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans
les conditions prévues à l'article 61-1 pour un crime ou un délit puni d'une
peine d'emprisonnement, elle peut demander à être également assistée, selon les
modalités prévues à l'article 63-4-3, par un avocat choisi par elle ou par son
représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
Elle est également informée que les frais seront à sa charge sauf si elle
remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Article 61-3 du Code de Procédure pénale
Toute personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant
qu'auteur ou complice, à la commission d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat de son choix ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner
un, qu'un avocat commis d'office par le bâtonnier :
1° L'assiste lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de l'infraction ;
2° Soit présent lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie.
La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à ces opérations.
L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces
observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.
Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l'assister dans les conditions prévues à l'article 61-2.
Article 62 du Code de Procédure pénale
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une
infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition,
sans que cette durée puisse excéder quatre heures.
Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les
informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2.
Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la
disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63-1.
Article 62-1 du Code de Procédure pénale
Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Article 62-2 du Code de Procédure pénale
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de
l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Une personne qui se présente spontanément, peut se retrouver en garde à vue pour garantir les investigations et sa présentation
Cour de Cassation chambre criminelle Arrêt du 28 mars 2017 pourvoi N° 16-85018 rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte au mois de février 2014 sur des faits datant des années 2012 et 2013 et susceptibles de recevoir les qualifications susvisées, Mme Y..., maire de Montauban, de même que trois autres personnes qui avaient, comme elle, été précédemment entendues dans le cours des investigations, a, sur convocation des enquêteurs, été placée en garde à vue le 16 juin 2015, pour, selon le procès-verbal de notification, permettre l'exécution des investigations impliquant sa participation ou sa présence et garantir sa présentation devant le procureur de la République ; qu'elle a été entendue, avant que, le soir-même, la garde à vue ne soit levée, puis reprise le lendemain matin ; que, dans la journée du 17 juin 2015, l'intéressée a été confrontée à l'une des autres personnes gardées à vue, puis présentée, avec celles-ci, au procureur de la République, qui a requis l'ouverture d'une information ; que, mise en examen le même jour du chef de soustraction, détournement ou destruction de bien d'un dépôt public par le dépositaire ou l'un de ses subordonnés et placée sous contrôle judiciaire, Mme Y... a déposé, le 28 août 2015, une requête en nullité de pièces de la procédure, notamment de celles relatives à sa garde à vue et des actes subséquents ;
Attendu que, pour rejeter ces requêtes et dire la garde à vue régulière, l'arrêt énonce que des confrontations devaient être vraisemblablement organisées, de sorte que cette mesure était justifiée par l'objectif d'empêcher d'éventuelles concertations ; qu'une de ces confrontations a eu lieu avant que la garde à vue ne soit levée, pour la nuit, et que le fait que les autres n'ont été organisées que le lendemain n'est pas significatif de ce que les auditions réalisées auraient pu, avec la même efficacité, être menées en dehors de toute coercition ; que les juges ajoutent qu'au vu des données recueillies au cours de l'enquête, le procureur de la République pouvait, avant même le début des gardes à vue, considérer comme possible, voire vraisemblable, que certaines des personnes entendues lui soient déférées, et que ce magistrat a effectivement décidé à la fin de la mesure d'ouvrir une information et de présenter les personnes déférées à un juge d'instruction ; que la chambre de l'instruction conclut que la garde à vue était logique et nécessaire et que ces mesures ont pu valablement être décidées au regard des 1°, 2° et 5° de l'article 62-2 précité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la mesure de garde à vue était l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, il lui incombe de contrôler que la mesure de garde à vue remplit les exigences de l'article 62-2 précité, d'autre part, dans l'exercice de ce contrôle, elle a la faculté de relever un autre critère que celui ou ceux mentionnés par l'officier de police judiciaire ;
Cour de Cassation chambre criminelle Arrêt du 18 novembre 2014 pourvoi N° 14-81332 cassation
Vu l'article 62-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon cet article, une mesure de garde à vue peut être décidée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle routier le 25 mai 2013, ayant révélé que Mme X... conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'intéressée a été convoquée le 30 mai 2013 à la gendarmerie, placée en garde à vue à 7 h 45 et déférée à 9 h, après son audition, au procureur de la République qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate ; qu'avant toute défense au fond, la prévenue a soulevé la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents ; que le tribunal a fait droit à cette demande et renvoyé le dossier au procureur de la République ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que l'enquête était achevée dès le 25 mai 2013, que la mesure de garde à vue, prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de l'intéressée, n'était pas justifiée, qu'une comparution immédiate aurait pu être envisagée le 25 mai 2013 et qu'elle ne nécessitait pas un placement en garde à vue et un défèrement immédiat, alors que la personne mise en cause s'est présentée volontairement devant les enquêteurs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé
LA GARDE A VUE DOIT ÊTRE L'UNIQUE MOYEN POUR OBTENIR LA VÉRITÉ
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 7 juin 2017 pourvoi N° 16-87588 rejet
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 62-2 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une dénonciation au sein d'une étude notariale, imputant à l'un des notaires, M. Marc X..., plusieurs agissements susceptibles d'être qualifiés de faux en écriture publique aggravé, faux et usage et escroquerie, le procureur de la République a confié une enquête à la gendarmerie à compter du 20 novembre 2014 ; que dans le cours de cette enquête, M. X... a remis aux officiers de police judiciaire, à deux reprises et sans faire de déclaration, diverses pièces utiles à la procédure ; que le 22 septembre2015, sur réquisitions du procureur de la République, les enquêteurs ont fait comparaître X... et l'ont placé en garde à vue au seul motif que cette mesure constituait l'unique moyen de garantir sa présentation devant ce magistrat afin que celui-ci puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; que cette garde à vue a pris fin le 23 septembre 2015, sans que l'intéressé ait été présenté au procureur de la République ; qu'à la suite de l'ouverture d'une information, le 25 septembre 2015, M. X... a été mis en examen le 25 janvier 2016 des chefs susvisés ; qu'il a déposé, le 26 avril 2016, une requête en nullité des pièces de la procédure, notamment de celles relatives à sa garde à vue, ainsi que des actes subséquents ;
Attendu que, pour dire cette requête bien-fondée et déclarer nuls les actes établis lors de la garde à vue du mis en examen, l'arrêt énonce que M. X... avait, sans difficulté, déféré à une première réquisition aux fins de remise de pièces, s'étant de surcroît rendu une seconde fois à la gendarmerie de sa propre initiative aux mêmes fins ; que les juges ajoutent que l'intéressé s'est présenté le 22 septembre 2015 afin d'être entendu ; qu'ils relèvent que, disposant d'une famille et d'une situation connue, il n'existait pas de raisons objectives de penser que celui-ci ne se présenterait pas devant un magistrat, quelle que soit la décision du procureur de la République quant à la suite réservée à la procédure ; qu'ils en déduisent que la garde à vue de M. X... n'était pas l'unique moyen de parvenir à l'objectif susénoncé et que cette irrégularité a nécessairement occasionné un grief à l'intéressé, dès lors que ce dernier a été retenu sous la contrainte alors qu'une audition libre aurait été suffisante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, dont il résulte que, lors du placement en garde à vue de M. X..., seul moment à prendre en considération pour le contrôle de légalité de la mesure, celle-ci, dans le cadre de laquelle il a été procédé aux auditions de l'intéressé, n'était pas, en l'état des éléments dont disposaient alors les officiers de police judiciaire ayant décidé d'y recourir, l'unique moyen de garantir sa comparution éventuelle devant le procureur de la République au terme de ces investigations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale ;
Une garde à vue ne peut être décidée que si les faits reprochés sont passibles d'un emprisonnement. Un étranger ne peut pas être en garde à vue sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cour de Cassation chambre criminelle avis n°9002 du 5 juin 2012
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille douze, a rendu l’avis suivant :
Vu la demande d’avis formulée le 3 avril 2012 par la première chambre civile à l’occasion de l’examen des pourvois B1119250, Q1121792, R1119378, C1119251, N1130530, D1130384, Q11130371 et ainsi libellée : "A la lumière des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 avril 2011(ElDridi) et du 6 décembre 2011 (Achugbabian) ainsi que, d’une part, de l’article 63 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 14 avril 2011, d’autre part, des articles 62-2 et 67 du code de procédure pénale dans leur rédaction actuellement en vigueur, un ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne peut-il être placé en garde à vue, sur le fondement du seul article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?" ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ;
Vu les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 avril 2011(El Dridi) et du 6 décembre 2011 (Achugbabian) ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Spinosi, et les conclusions de M. l’avocat général Mathon, Me Spinosi ayant eu la parole en dernier ;
A émis l’avis suivant :
“Il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 qu’une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement ; qu’en outre, la mesure doit obéir à l’un des objectifs nécessaires à la conduite de la procédure pénale engagée ; qu’à la suite de l’entrée en application de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants d’Etats tiers en séjour irrégulier, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, le ressortissant d’un Etat tiers mis en cause, pour le seul délit prévu par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’encourt pas l’emprisonnement lorsqu’il n’a pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l’article 8 de ladite directive ; qu’il ne peut donc être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée de ce seul chef ;
Pour les mêmes raisons, il apparaît que le ressortissant d’un Etat tiers ne pouvait, dans l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée pour entrée ou séjour irréguliers selon la procédure de flagrant délit, le placement en garde à vue n’étant possible, en application des articles 63 et 67 du code de procédure pénale alors en vigueur, qu’à l’occasion des enquêtes sur les délits punis d’emprisonnement. Le même principe devait prévaloir lorsque l’enquête était menée selon d’autres formes procédurales.”
Article 62-3 du Code de Procédure pénale
La garde à vue s'exécute sous le
contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge
des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2
en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et
de report de l'intervention de l'avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à
vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à
l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée
d'avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Article 63 du Code de Procédure pénale
I. - Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II. - La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III. - Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
Article 63-1 du Code de Procédure pénale
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle
de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée
d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue.
3° Du fait qu'elle bénéficie :
― du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat
dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2
― du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3
― du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3
― s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
― du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
― du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se
prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le
magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue
sur la prolongation de la mesure ;
― du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute
personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif
technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis
pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue.
En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
LA NOTIFICATION DE LA GARDE A VUE DOIT ÊTRE FAITE AU DÉBUT DE LA MESURE SAUF CAS DE FORCE MAJEURE
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 29 septembre 2020 pourvoi n° 20-82.509 cassation
Vu l’article 63-1 du code de procédure pénale :
11. Il résulte de ce texte que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre.
12. Pour écarter le moyen de nullité des deux requérants, pris de ce que seule la qualification délictuelle de faux en écriture publique leur a été notifiée lors de leur garde à vue, l’arrêt retient que s’il ressort de certaines pièces de la procédure que le ministère public a pu envisager de retenir une qualification criminelle, il résulte des réquisitoires introductif et supplétifs qu’il a finalement opté, en opportunité, pour une qualification délictuelle.
13. Les juges ajoutent que les faits pour lesquels M. X... et Mme Y... ont été placés en garde à vue étant de nature délictuelle, les auditions des intéressés ne devaient pas faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel en application des dispositions de l’article 64-1 du code de procédure pénale.
14. Ils relèvent enfin que le juge d’instruction a, au stade de la mise en examen des mis en cause, restitué aux faits dont il était saisi la qualification criminelle qu’il estimait être la plus juste juridiquement.
15. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. En effet, il se déduit de la motivation précitée que, dès le début de la garde à vue, la circonstance aggravante tenant à la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de M.X... était établie.
17. En conséquence, le juge d’instruction, sous le contrôle duquel était placée la mesure de garde à vue et qui a mis en examen les intéressés du chef criminel de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique et complicité, devait, conformément au second alinéa du I de l’article 63, applicable par renvoi de l’article 154 du code de procédure pénale, leur faire notifier cette qualification criminelle par l’officier de police judiciaire.
18. Le défaut de notification de cette qualification criminelle a nécessairement porté atteinte aux intérêts des personnes concernées dès lors que leurs auditions n’ont pas été enregistrées, comme elles auraient dû l’être en application de l’article 64-1 du code de procédure pénale.
19. La cassation est dès lors encourue.
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 6 décembre 2016 N° de pourvoi 15-85519 rejet
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue est intervenue le 20 janvier 2014 à 13 heures 45 alors qu'elle a été interpellée le 20 janvier 2014 à 0 heure 30, la cour d'appel constate que le taux d'alcoolémie est de 1, 32 mg par litre d'air expiré et relève, pour caractériser la circonstance insurmontable, qu'à 14 heures, M. X... était toujours positif à l'éthylotest mais a déclaré se sentir apte à répondre aux questions des enquêteurs ; que les juges ajoutent que l'alcoolémie diminue de 0, 10 à 0, 15 grammes d'alcool par litre de sang par heure écoulée et que le délai respecté par les enquêteurs au regard du taux d'alcoolémie présenté par M. X..., était nécessaire pour que ce dernier soit en mesure de comprendre ses droits ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief visé au moyen, dès lors qu'il constate, par des motifs concrets et non hypothétiques, l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ;
D'où il suit que le grief sera écarté
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 24 mai 2016 N° de pourvoi 16-80564 cassation partielle
Vu les articles 63, alinéa 1er, et 63-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, et que, selon le second de ces textes, la personne concernée doit être immédiatement informée des droits attachés à son placement en garde à vue, tout retard dans la mise en oeuvre de ces deux obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, faisant nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X... a été interpellé à son domicile et immédiatement placé en garde à vue le 17 novembre 2015, à 10 heures 30, puis que, jusqu'à 10 heures 50, une perquisition a été effectuée en ce lieu, qui a permis de saisir l'ordinateur du mis en cause ; que, de retour au service, l'officier de police judiciaire a, de 11 heures à 11 heures 05, procédé à la notification de ses droits à la personne gardée à vue, puis donné au procureur de la République, à 11 heures 15, l'avis légalement exigé ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la mesure de garde à vue et la procédure subséquente, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun élément de la procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 9 février 2016 N° de pourvoi 15-84277 Rejet
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que, contrairement aux prescriptions de l'article 154 du code de procédure pénale, M. X... n'aurait pas été informé, lors de son placement en garde à vue, que cette mesure était prise en exécution d'une commission rogatoire, l'arrêt relève, notamment, que dix minutes après le début de la mesure, l'intéressé a signé le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits y afférents, lequel portait l'indication de la commission rogatoire, ainsi que du nom et de la qualité du juge d'instruction mandant, de sorte qu'il en a pris connaissance à ce moment ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle une obligation de porter cette information à la connaissance de la personne gardée à vue selon une formalité spécifique, d'autre part que M. X... a eu connaissance, lors de son placement en garde à vue, du cadre dans lequel se déroulait cette mesure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision
LE DROIT DE GARDER LE SILENCE DURANT LA GARDE A VUE
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 7 mars 2012 N° de pourvoi 11-88118 Cassation partielle
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. François X..., dirigeant de droit de la société Hôtelière du Camp Rambaud (HCR), mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux et recel, travail dissimulé, présentation de bilan inexact, a déposé à la chambre de l'instruction une requête en annulation de l'ensemble des actes de procédure relatifs à des enregistrements audio réalisés de sa propre initiative par M. François Y..., ancien salarié de la société, lors d'entretiens avec ses employeurs, au motif qu'un tel enregistrement, réalisé à l'insu de la personne concernée, constituait un procédé déloyal, méconnaissant le droit à un procès équitable ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges énoncent qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de manière illicite ou déloyale et que la jurisprudence européenne ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui relève du droit interne ; qu'en en tout état de cause, l'élément de preuve procuré par un particulier ne peut faire I'objet d'une annulation dès lors que n'émanant pas d'un magistrat ou d'un service d'enquête, il ne constitue pas un acte de procédure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que les enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes des actes ou pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale et comme tels susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement, et que la transcription de ces enregistrements qui a pour seul objet d'en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen pris de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 171, 174, 206, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la garde à vue des 16 et 17 février 2011 ;
" aux motifs que M. François X...a été
placé en garde à vue le 16 février 2011 de 8 heures 30 à 22 heures 10 et a reçu
immédiatement notification de ses droits ; que son avocat, Me Z..., a été avisé
à 8 heures 40 et s'est entretenu avec lui de 9 heures 40 à 10 heures 10 ; que M.
François X...a été à nouveau placé en garde à vue le 17 février 2011 de 8 heures
30 à 14 heures 30, a reçu immédiatement notification de ses droits, son avocat a
été avisé à 8 heures 37 et s'est entretenu avec lui de 9 heures 35 à 10 heures
10 ;
que M. Jean-François X...a été placé en garde à vue le 16 février 2011 à 8
heures 35, la garde à vue a été prolongé à compter du 17 février à 7 heures 10
avec notification le 16 février à 22 heures 45, elle a pris fin le 17 février à
14 heures 30, et ses droits lui ont été notifiés immédiatement tant lors du
placement que lors de la prolongation ; que lors du placement en garde à vue, M.
Jean-François X...a déclaré renoncer à son droit de s'entretenir avec un avocat
; que, lors de la notification de la prolongation de la garde à vue, il a
demandé à s'entretenir avec son avocat, Me A..., entretien qui a eu lieu le 17
février de 13 heures à 13 heures 15 ; que le conseil de M. François X...demande
l'annulation de la totalité des procès verbaux d'audition en garde à vue tant de
lui même que de son fils M. Jean-François X..., des procès-verbaux
d'investigation faisant référence aux déclarations effectuées en garde à vue,
des procès verbaux de mise en examen de M. François X...et de M. Jean-François
X...ainsi que des ordonnances de placement sous contrôle judiciaire, pour
violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme en ce que toute personne placée en garde à vue
doit, dès le début de cette mesure être avisée de son droit de se taire et
bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'il se réfère à la
jurisprudence en la matière de la cour européenne des droits de l'homme et de la
chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'aux termes de l'article 62 de la
Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs
publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que par
décision n° 2010-14/ 22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a
déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 631, 63-4, alinéas 1er
à 6, et 77 du code de procédure pénale pour méconnaissance des articles 9 et 16
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et faisant
application de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution qui l'habilite à
aménager les effets de sa décision concernant les actes accomplis
antérieurement, a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité prendrait
effet le 1er juillet 2011 ; que le considérant 30 spécifie notamment qu'il y a
lieu de reporter au 1er juillet 2011 la date de l'abrogation des articles
concernés afin de permettre au législateur de remédier à cette
inconstitutionnalité, et que les mesures prises avant cette date en application
des dispositions déclarées contraires à la constitution ne peuvent être
contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable en
France depuis le 3 mai 1974 conformément à l'article 55 de la Constitution qui
pose le principe de la suprématie des traités régulièrement ratifiés sur les
lois internes ;
que l'interprétation que donne la Cour européenne des droits de l'homme de la
convention à travers l'élaboration de sa jurisprudence, de l'article 6 relatif
au procès équitable, est de portée générale ; que, par ailleurs, dans l'arrêt
C...contre France du 14 octobre 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a
condamné la France pour violation de l'article 6 paragraphes 1 et 3 de la
Convention en ce que la personne concernée n'a pas été avisée dès le début de
son interrogatoire du droit de se taire et de bénéficier immédiatement de
l'assistance d'un avocat de sorte qu'il a été porté atteinte à son droit de ne
pas contribuer à sa propre incrimination ; que s'il est acquis que les
juridictions internes assurent un contrôle de conventionnalité, se pose
néanmoins le problème des conséquences procédurales de cette jurisprudence ;
que, selon l'article 34 de la constitution, la loi fixe les règles concernant la
procédure pénale et aucune disposition constitutionnelle ou conventionnelle ne
prévoit que la Cour européenne puisse se substituer à cet égard au législateur
national par des arrêts de règlement ; qu'il appartient, en conséquence, au
législateur de se conformer aux principes élaborés par la cour européenne, par
la voie législative ; qu'en l'espèce, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011
relative à la garde à vue, qui intègre notamment le droit de se taire, de
bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et de ne
pas contribuer à sa propre incrimination, prévoit, d'une part, son entrée en
vigueur au plus tard le 1er juillet 2011, d'autre part, son application aux
mesures de gardes à vue prises à compter de son entrée en vigueur, ce
conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 ; que,
selon l'article 112-4 du code pénal conforme à la Constitution, l'application
immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes
régulièrement accomplis conformément à la loi ancienne ; que cette disposition
législative est également conforme à la jurisprudence de la Cour européenne, qui
dans un arrêt B... contre Belgique du 13 juin 2009, a jugé que « le principe de
sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la convention comme au
droit communautaire, dispense l'état belge de remettre en cause des actes ou
situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt » ; que la
sécurité juridique est donc garantie par la Cour européenne de sauvegarde des
droits de l'homme, le Conseil constitutionnel et le législateur, ce dans
l'intérêt général ; qu'à cet égard, les décisions du Conseil constitutionnel
notamment en ce qu'elles aménagent lorsque cela s'avère nécessaire, les effets
de sa décision concernant les actes accomplis antérieurement, s'imposent aux
pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et judiciaire, ce
conformément à l'article 32 de la constitution ; qu'en conséquence, les actes
accomplis en garde à vue dans la présente procédure ne sauraient encourir
l'annulation dès lors qu'ils ont été réalisés conformément à la loi ancienne, de
manière régulière, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle fixée par le
conseil constitutionnel au 1 juillet 2011 ; qu'il appartiendra aux juridictions
de jugement statuant au fond d'apprécier la valeur probante des déclarations
faites en garde à vue sans que la personne concernée ait été avisée de son droit
de se taire et sans avoir bénéficié dès le début de l'assistance d'un avocat ;
que le moyen de nullité sera en conséquence rejeté ;
" alors qu'il se déduit de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en rejetant les moyens de nullité de la garde à vue tirés de ce que MM. François et Jean-François X...n'avaient pas été informés de leur droit de se taire dès le début de cette mesure et n'avaient pu bénéficier de l'assistance d'un avocat au cours de leurs interrogatoires aux motifs que les actes accomplis en garde à vue dans la présente procédure ont été réalisés conformément à la loi ancienne, de manière régulière, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle fixée par le Conseil constitutionnel au 1er juillet 2011 et qu'il appartiendra aux juridictions de jugement statuant au fond d'apprécier la valeur probante des déclarations faites en garde à vue sans que la personne concernée ait été avisée de son droit de se taire et sans avoir bénéficié dès le début de l'assistance d'un avocat alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen, en ce qu'il concerne l'annulation des auditions de M. Jean-François X...:
Attendu que ce moyen présenté par M. François X...est inopérant, dès lors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir d'un droit qui appartient en propre à une autre personne ;
Mais sur le moyen, en ce qu'il concerne l'annulation des auditions de M. François X...:
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne, placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la garde à vue présentée par M. François X..., qui soutenait ne pas avoir été informé de son droit de se taire et n'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure, I'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé
LES ACTES SUBSEQUENTS A LA GARDE A VUE SONT ANNULES MAIS PAS LES ACTES CONSEQUENTS
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 14 mai 2014 pourvoi 13-84 075 cassation
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité des
procès-verbaux d'audition en garde à vue du prévenu, prise de la violation du défaut de notification du droit de se taire et du droit de bénéficier d'un
avocat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur
le caractère incriminant des déclarations annulées, a justifié sa décision
Vu les articles 174 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être
annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ;
Attendu que, pour relaxer M. X... et débouter la société Sojuor de ses demandes, l'arrêt, après avoir annulé ses déclarations recueillies en garde à vue, énonce
que les enregistrements téléphoniques litigieux, s'ils ont été réalisés par la partie civile antérieurement, ont été écoutés en présence du prévenu gardé à
vue, de sorte que, constituant des éléments de preuve à charge, ils doivent également être annulés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la régularité de ces enregistrements ne pouvait être affectée par l'annulation des auditions du
prévenu en garde à vue, qui sont postérieures, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 27 mai 2014 pourvoi n° 13-87095 cassation
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure,
seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ;
Attendu que, pour annuler le procès-verbal de comparution de MM. Y... et X... devant le procureur de la République, valant saisine du tribunal, et
ordonner le retour du dossier au ministère public, l'arrêt attaqué énonce que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue s'étend nécessairement aux
procès-verbaux notifiant la fin de cette mesure, de sorte qu'il n'est plus possible de vérifier si les intéressés ont comparu le jour- même devant le
magistrat du parquet qui a ordonné leur déferrement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la régularité du procès-verbal
récapitulatif du déroulement de la garde à vue permettant de vérifier l'heure de la levée de cette mesure n'est pas affectée par l'absence de notification des
droits aux personnes gardées à vue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue.
GARDER LE SILENCE PEUT EVITER D'ÊTRE ACCUSE DEVANT LES ASSISES
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 12 février 2012 N° de pourvoi 12-84500 et 13-87836 rejet
Attendu que, d'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour retenir, à l'encontre de M. X..., des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction, qui ne prononce pas sur la culpabilité, ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur ses déclarations recueillies en garde à vue et que, d'autre part, l'accusé conserve la faculté de discuter contradictoirement la valeur probante de ses déclarations devant la juridiction de jugement
Article 63-2 du Code de Procédure pénale
I. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.
II. - L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue.
Article 63-3 du Code de Procédure pénale
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Article 63-3-1 du Code de Procédure pénale
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander
à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un
ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en
soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est
informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en
application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit
toutefois être confirmée par la personne.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le
contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de
la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation
d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et
l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur
l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le
procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le
bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
Article. D. 15-5-2 du Code de Procédure Pénale
L'officier ou l'agent de police judiciaire responsable des modalités de déroulement de la garde à vue peut requérir par tout moyen d'un
officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service territorialement compétent autre que celui chargé de l'enquête de faire procéder aux diligences suivantes :
1° Prévenir par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l'article 63-2 ;
2° Contacter l'avocat désigné ou commis d'office pour assister la personne en garde à vue en application des articles 63-3-1 et suivants, et l'informer des
lieux et horaires des auditions ;
3° Contacter le médecin devant examiner la personne en garde à vue en application de l'article 63-3 ;
4° Contacter l'interprète conformément aux dispositions de l'article 63-1.
L'officier ou l'agent de police judiciaire requis mentionne, dans un rapport transmis à l'officier de police judiciaire requérant, les modalités d'exécution
de ces diligences, qui peuvent être effectuées par tout personnel de la police ou de la gendarmerie nationale, y compris n'ayant pas la qualité d'agent de
police judiciaire adjoint, placé sous sa responsabilité et son contrôle.
Article. D. 15-5-3 du Code de Procédure Pénale
Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits.
LE CHOIX DE L'AVOCAT APPARTIENT A LA PERSONNE EN GARDE A VUE
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 21 octobre 2015, pourvoi N° 15-81.032 cassation partielle
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ;
Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat de Mme X...a été entendu en ses observations sans préciser, comme pour les autres personnes mises en examen, qu'elle-même ou son avocat a eu la parole en dernier ;
Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef
DEVANT LA CHAMBRE D'INSTRUCTION
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ;
Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat de Mme X...a été entendu en ses observations sans préciser, comme pour les autres personnes mises en examen, qu'elle-même ou son avocat a eu la parole en dernier ;
Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef
Les déclarations prises en garde à vue hors de la présence de l'avocat pourtant demandée, ne peuvent être considérées
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 7 février 2012, pourvoi N° 11-83.676 Rejet
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite des blessures subies par M. Z..., MM. Angelo et Christopher X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour violences en réunion ; qu’avant toute défense au fond, ils ont sollicité l’annulation de l’intégralité de la procédure, faute d’avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue
Attendu qu’après avoir fait droit à cette demande en ce qui concerne les seuls procès-verbaux retranscrivant les déclarations de M. Christopher X..., les juges du second degré sont entrés en voie de condamnation à l’égard des deux prévenus ;
Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à annuler les procès-verbaux d’audition de M. Angelo X..., l’arrêt retient que l’avocat choisi par ce dernier a été avisé dès la notification des droits et qu’il ne s’est jamais présenté
Attendu que M. Angelo X... ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n’aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d’appel ne s’est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli
LE GARDE A VUE PEUT DEMANDER LA PRESENCE D'UN AVOCAT A TOUT MOMENT
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 5 novembre 2013 pourvoi n° 13-82682, cassation partielle
Vu l'article 63-3-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue
doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M.
Reimond X... a été placé en garde à vue le 7 avril 2012, ses droits lui étant
notifiés à 15 h 50 ; qu'il n' a pas alors choisi d'être assisté par un avocat;
que, lors d'une audition ultérieure, le 8 avril 2012 à 10 h 50, il a sollicité
cette assistance ; que, sans qu'une suite soit donnée à cette demande,
l'officier de police judiciaire a poursuivi son audition; que M. X... a réitéré
sa demande, lors de la prolongation de sa garde à vue, le même jour à 14 h 50,
le service du barreau en étant informé à 15 h 25 ; que mis en examen des chefs
de meurtre aggravé et vol en réunion, l'intéressé a déposé une requête en vue de
l'annulation, notamment, des auditions qui avaient été effectuées en garde à vue;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que, lors de la
notification de la garde à vue, M. X... n'a pas demandé à être assisté d'un
conseil et que ce choix ne lui était à nouveau ouvert qu'au moment de la prolongation de la mesure ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir
constaté que les auditions recueillies postérieurement au moment où le mis en
examen avait sollicité l'assistance d'un avocat étaient irrégulières, de les
annuler et, le cas échéant, d'étendre les effets de cette annulation aux actes
dont elles étaient le support nécessaire, la chambre de l'instruction a méconnu
le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue
Article 63-4 du Code de Procédure pénale
L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article
63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation,
dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 2 mars 2021, pourvoi n° 20-85.491 REJET
8. Il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3, § 3, a) de la directive n° 2013/48/UE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013, préliminaire, 63-3-1, 63-4 et 65 du code de procédure pénale que pour que soit garanti le droit effectif et concret à l’assistance d’un avocat au stade de l’enquête, toute personne entendue sur des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d’un avocat, de s’entretenir au préalable et confidentiellement avec celui-ci.
9. Il s’ensuit que la personne gardée à vue qui est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une infraction autre que celle ayant justifié le placement en garde à vue et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction bénéficie, après avoir été avertie de son droit d’être assistée d’un avocat et si elle a déclaré vouloir l’exercer, du droit de communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits.
10. La personne gardée à vue peut renoncer à ce droit, expressément ou tacitement, notamment lorsqu’elle accepte, en présence de son avocat, qu’il soit immédiatement procédé à son audition sans entretien préalable.
11. L’avocat peut aussi estimer qu’il n’y a pas lieu à entretien préalable et y renoncer tacitement, notamment lorsqu’il ne demande pas à communiquer confidentiellement avec la personne gardée à vue avant son audition.
12. Pour faire droit à la requête en annulation de pièces de M. X..., l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte de l’article 65 du code de procédure pénale, qui renvoie aux articles 63-3-1 à 63-4-3 s’agissant du droit d’être assisté d’un avocat, que lorsqu’au moment de la notification à la personne gardée à vue d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, cette personne demande à être assistée par un avocat, elle doit pouvoir communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.
13. Les juges ajoutent qu’il est constant que M. X... a demandé à être assisté d’un avocat au moment de la notification de l’extension de la poursuite initiale mais qu’il n’a pu s’entretenir avec lui avant son audition sur les faits nouveaux imputés et que cette situation a nécessairement fait grief aux droits de celui-ci.
14. En l’état de ces énonciations, l’arrêt n’encourt pas la censure.
15. En effet, dès lors que le droit de la personne gardée à vue à un entretien confidentiel avec un avocat avant son audition dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction, tel qu’énoncé ci-dessus, ne résultait pas de façon évidente de la lettre des articles 65, 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale, le fait que, d’une part, l’avocat n’ait pas expressément demandé à s’entretenir confidentiellement avec son client, d’autre part, celui-ci, en présence de son avocat, ait accepté d’être entendu sur les nouveaux faits sans entretien préalable, ne peut être interprété comme une renonciation tacite par l’avocat à cette prérogative de sa fonction ou par M. X... au bénéfice de ce droit.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-84.045 REJET
7. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel Mme X... a été entendue hors la présence de son avocat, l’arrêt attaqué énonce que le procès verbal d’exploitation du téléphone de l’intéressée n’a pas le caractère d’une audition dès lors que celle-ci n’a fait aucune déclaration et qu’aucune question sur les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue ne lui a été posée.
8. Les juges ajoutent, par ailleurs, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, dès lors que ce droit ne s’étend pas à l’usage de données que l’on peut obtenir de la personne en recourant à des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect.
9. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En premier lieu, aucune disposition légale ne prévoit la présence de l’avocat lors de l’exploitation d’un téléphone portable, assimilable à une perquisition.
11. En second lieu, la communication à un officier de police judiciaire, sur sa sollicitation, d’une information permettant l’accès à un espace privé préalablement identifié, qu’il soit ou non dématérialisé, pour les besoins d’une perquisition, ne constitue pas une audition au sens de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 1er décembre 2015, pourvoi n° 14-84874 REJET
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-4 et 803-6 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information judiciaire ouverte à la suite de la découverte d'un
cadavre, Mme X... a été placée en garde à vue le 6 mai 2015 à 16 heures 40 ; que, lors du placement en garde à vue, les droits afférents à cette mesure lui
ont été notifiés verbalement par un officier de police judiciaire, qui lui a aussi remis un document intitulé " formulaire de notification des droits d'une
personne gardée à vue " ; qu'après que Mme X... lui a été présentée, le juge d'instruction l'a informée que sa garde à vue serait prolongée à compter du 7
mai 2015 à 16 heures 40 ; qu'il a été avisé, le même jour, à 18 heures 15, par un officier de police judiciaire, qu'en raison de l'audition de l'intéressée, en
présence de son avocat, de 16 heures 10 à 18 heures 15, les droits attachés à la prolongation de la garde à vue n'avaient pas été notifiés dans les délais
impartis ; que le magistrat instructeur a ordonné la levée de la garde à vue, qui a pris fin le 7 mai 2015 à 19 heures 00, et mis en examen Mme X... pour
meurtre aggravé ; qu'il a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de l'audition de Mme X... recueillie le 7 mai 2015 de 16 heures 10 à 18 heures 15 ;
Attendu que, pour constater l'irrégularité de l'audition recueillie postérieurement à la prolongation de la garde à vue de la personne mise en
examen, l'annuler et étendre les effets de cette annulation aux actes énumérés à son dispositif, l'arrêt énonce que si Mme X... a été présentée au magistrat
instructeur, qui a prolongé de 24 heures la mesure de garde à vue le 7 mai 2015, et si la notification initiale des droits mentionne l'hypothèse d'une
prolongation de cette mesure, l'audition du 7 mai 2015 à 16 heures 10 s'est prolongée le même jour jusqu'à 18 heures 05 sans que les droits attachés à la
prolongation de la garde à vue ne fussent notifiés à la personne concernée, qui, de ce fait, n'a pas été mise en mesure de solliciter un second examen médical et
un entretien avec son avocat ; que les juges ajoutent que cette absence de notification a nécessairement fait grief à Mme X... et ce, même si son audition
a été réalisée en présence d'un avocat qui n'a formulé aucune observation;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la notification à la personne concernée des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est
une condition d'effectivité de leur exercice, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales invoquées
Article 63-4-1 du Code de Procédure pénale
A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa du présent article ou une copie de ceux-ci.
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 17 novembre 2015, pourvoi N° 15-83437 cassation
Vu l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avocat d'une personne gardée à vue peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical résultant de l'examen de la personne gardée à vue par un médecin ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ; que toute méconnaissance de ces prescriptions porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation fondée sur la méconnaissance, par un officier de police judiciaire, du droit de l'avocat à la communication du procès-verbal de notification du placement en garde à vue, l'arrêt énonce qu'il résulte de la chronologie des actes résultant de la procédure qu'il a été satisfait aux exigences posées par l'article 63-4-1 précité dès que l'avocat s'est présenté au lieu où étaient détenues les pièces de procédure, soit au commissariat de police, ce qui n'avait pas été possible lorsqu'il avait demandé la communication de ce procès-verbal au lieu où il avait rencontré son client, dans une geôle distante de trois cents mètres ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire que l'avocat du requérant avait, dès l'entretien confidentiel avec celui-ci, formulé la demande expresse de consultation à laquelle il a droit et qu'aucune circonstance insurmontable ne faisait obstacle à ce que la pièce demandée puisse être mise à sa disposition, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 19 septembre 2012, pourvoi N° 11-88111 cassation
Vu l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avocat assistant une personne gardée à vue peut consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en
garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué, et les procès-verbaux d'audition de la personne
qu'il assiste ;
Attendu que, placé en garde à vue, du 27 au 29 juin 2011, M. X... a sollicité l'assistance d'un avocat, lequel a vainement demandé à prendre connaissance de
l'intégralité de la procédure d'enquête ; qu'ultérieurement poursuivi devant le tribunal correctionnel, il a demandé l'annulation du procès-verbal établi lors
de son audition, motif pris de ce refus ; que, le tribunal ayant, notamment, refusé de faire droit à cette exception, appel a été interjeté ;
Attendu que, pour infirmer, sur ce point, le jugement, et annuler le procès-verbal contesté, l'arrêt énonce que l'effectivité du droit à l'assistance
d'un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l'entier dossier de la procédure, et que, cette règle n'ayant pas été respectée, la garde à vue de M. X... n'a pas
été conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, qui n'est pas incompatible avec l'article 6 § 3 de la Convention européenne des
droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne
d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement
Article 63-4-2 du Code de Procédure pénale
La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à
ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle
porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence
de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux
heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de
la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat.
Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.
Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa
alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est
interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de
s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que
celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la
personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci
peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service
de police judiciaire ou à la confrontation.
Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la
personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et
motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute
sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le
procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les
distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite
et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou
confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons
impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour
permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à
la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux
personnes.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que
pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue
pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale
à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du
procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat,
au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les
autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la
détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à
l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des
faits de l'espèce.
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le
procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé
à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut
également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes
alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Article 63-4-3 du Code de Procédure pénale
L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de
l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la
République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut
s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des
observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat
peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
Article 63-4-3-1 du Code de Procédure pénale
Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61-3, son avocat en est informé sans délai.
Article 63-4-4 du Code de Procédure pénale
Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.
Article 63-4-5 du Code de Procédure pénale
Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou
par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.
L'article 63-4-3 est applicable.
Article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
L'avocat désigné d'office qui intervient dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes a droit à une rétribution.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.
Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office.
Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue.
Article 63-5 du Code de Procédure pénale
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions
assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de
sécurité strictement nécessaires.
Article 63-6 du Code de Procédure pénale
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer
que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour
elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité
ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille
intégrale.
La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets
dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant
en application des articles 141-4, 712-16-3, 716-5 et 803-3.
Article 63-7 du Code de Procédure pénale
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de
l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue,
celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et
réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la
personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est
possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de
détection électronique ne peuvent être réalisées.
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à
des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue,
celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
Article 63-8 du Code de Procédure pénale
A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur
instruction du procureur de la République sous la direction duquel
l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce
magistrat.
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans
qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur
l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa
connaissance.
Article 63-9 du Code de Procédure pénale
Le procureur de la République compétent pour être avisé
des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la
prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la
direction duquel l'enquête est menée.
Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde
à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la
prolongation.
Article 64-1 du Code de Procédure pénale
I. - L'officier de police judiciaire établit un
procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1°
à 6° de l'article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont
séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour
et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et
l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le
magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées
dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des
articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations
corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à
vue. En cas de refus, il en est fait mention.
II. - Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les
dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des
auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des
fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent
également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de
police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à
vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont
astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements
prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce
carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
Article 65 du Code de Procédure pénale
Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.
LA COMPARUTION IMMEDIATE DEVANT UN TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le prévenu peut attendre 20 Heures entre la levée de sa garde à vue et sa comparution devant le tribunal correctionnel
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 5 juillet 2012 pourvoi n° 11-30371 REJET
Vu l’article 395 du code de procédure pénale :
8. Selon cet article, lorsque les conditions d’une comparution immédiate sont remplies, le procureur de la République peut traduire, sur le champ devant le tribunal, le prévenu qui est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même.
9. Pour déclarer le tribunal correctionnel non saisi des faits reprochés à M. X..., l’arrêt attaqué énonce que ces faits ne pouvaient être jugés suivant la procédure de comparution immédiate, dès lors qu’il résulte des notes d’audience qu’ils n’ont pas été examinés le jour même du défèrement, soit le 1er juin 2018, avant minuit.
10. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, en premier lieu, le tribunal correctionnel est irrévocablement saisi par le procès-verbal de notification établi par le procureur de la République.
12. En second lieu, l’exigence d’une comparution « le jour même » de la présentation de l’intéressé au parquet ne saurait être interprétée comme la nécessité de le juger impérativement avant minuit, mais comme celle de le faire comparaître au cours de l’audience considérée, quand bien même celle-ci se terminerait après minuit en raison de contraintes diverses.
13. Enfin, il a été satisfait à la réserve posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 décembre 2010 (n° 2010-80-QPC), dès lors que l’intéressé a été présenté à la formation du siège avant l’expiration du délai de 20 heures couru à compter de la levée de sa garde à vue.
LA
GARDE A VUE DES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERELa garde à vue pour uniquement contrôler l'identité d'un étranger sans papier, est illégale
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 5 juillet 2012 pourvoi n° 11-30371 REJET
Sur le moyen unique, après avis de la chambre criminelle :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Rennes, 9 mai 2011) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a été interpellé, en état de flagrance, le 4 mai 2011 et placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que, le même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu’un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ;
Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Rennes fait grief à l’ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, qu’aucune disposition de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ne s’oppose à ce que la réglementation d’un État membre prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié, qu’une telle interprétation résulte d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 28 avril 2011 concernant l’Italie dont la législation n’est pas identique à la législation française ;
Mais attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s’oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d’une peine d’emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n’a pas été préalablement soumis à l’une des mesures coercitives prévues à l’article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l’objet d’un placement en rétention, mais n’a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu’en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n’est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la date des faits, qu’à l’occasion d’enquêtes sur les délits punis d’emprisonnement ; qu’il s’ensuit que le ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n’encourt pas l’emprisonnement prévu par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’il se trouve dans l’une ou l’autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ;
Et attendu que l’ordonnance constate que M. X... a été placé en garde à vue au seul motif d’une infraction de séjour irrégulier, sur le fondement de l’article L. 621-1 du code susvisé, et qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. X... ait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l’article 8 de la directive ; que, dès lors, c’est à bon droit que le premier président a retenu que sa garde à vue était irrégulière ; que le moyen n’est pas fondé.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 5 juillet 2012 pourvoi n° 11-30530 REJET
Sur le moyen unique, après avis de la chambre criminelle :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 3 août 2011), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a, le 27 juillet 2011, été interpellé et placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que, le lendemain, le préfet des Yvelines a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ainsi qu’une décision de placement en rétention administrative ; qu’un juge des libertés et de la détention a ordonné sa remise en liberté immédiate ;
Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Versailles fait grief à l’ordonnance attaquée de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que l’incrimination prévue à l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sanctionne le fait, pour un étranger, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire national sans être muni d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité, situation différente de celle d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier qui s’est soustrait à un ordre de quitter le territoire national dans un délai déterminé ; que l’incrimination est donc indépendante de toute procédure d’éloignement, de sorte que les dispositions de la directive invoquée, et notamment ses articles 15 et 16, qui concernent un champ différent, ne peuvent lui être opposées ; que c’est seulement une fois qu’une mesure d’éloignement a été prise que la directive fait obstacle au prononcé d’une peine d’emprisonnement ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des articles 15 et 16 de la directive 2008/115, ensemble l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Mais attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s’oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d’une peine d’emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n’a pas été préalablement soumis à l’une des mesures coercitives prévues à l’article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l’objet d’un placement en rétention, mais n’a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu’en outre, il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable à la date des faits qu’une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement et qu’au surplus cette mesure doit obéir à l’un des objectifs nécessaires à la conduite de la procédure pénale ; qu’il s’ensuit que le ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n’encourt pas l’emprisonnement prévu par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’il se trouve dans l’une ou l’autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ;
Et attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. X..., qui a été placé en garde à vue pour la seule infraction de séjour irrégulier, ait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l’article 8 de cette directive ; que, dès lors, c’est à bon droit que le premier président a retenu que le placement en garde à vue de l’intéressé était irrégulier ; que le moyen n’est pas fondé.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 5 juillet 2012 pourvoi n° 11-19250 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
Vu les articles 8 et 15 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la date des faits ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s’oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d’une peine d’emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n’a pas été préalablement soumis à l’une des mesures coercitives prévues à l’article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l’objet d’un placement en rétention, mais n’a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu’en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n’est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu’à l’occasion d’enquêtes sur les délits punis d’emprisonnement ; qu’il s’ensuit que le ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n’encourt pas l’emprisonnement prévu par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il se trouve dans l’une ou l’autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. C... X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, à l’encontre duquel avait été pris et notifié, le 14 avril 2011, un arrêté de reconduite à la frontière, lui laissant un délai de sept jours pour quitter le territoire national, a, le 1er mai de la même année, été interpellé en état de flagrance, sous une autre identité, d’alias A... Y..., et placé en garde à vue, pour séjour irrégulier en France ; que, le lendemain, le préfet de Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; qu’un juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ordonnance attaquée retient que la directive n° 2008/115/CE n’exclut pas la compétence pénale des Etats membres dans le domaine de l’immigration clandestine ou du séjour irrégulier ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, au vu des pièces de la procédure suivie devant lui, si l’intéressé avait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l’article 8 de la directive n° 2008/115/CE et, dans l’hypothèse où ce dernier aurait fait l’objet d’un placement en rétention, si la durée de celle-ci avait été maximale, le premier président a privé sa décision de base légale ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger
Un ou une étrangère en situation irrégulière peut être renvoyée suite à une garde à vue en cas d'enquête de flagrance
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 6 juin 2012 pourvoi n° 10-20602 CASSATION
Vu les articles 63 3 du code de procédure pénale et L. 552 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, qu’au cours d’une enquête en flagrance ouverte pour des faits de viol, une personne disant se nommer M. Robertas Y... a été interpellée et placée en garde à vue, le 23 novembre 2010 à 7h15 par les services de la gendarmerie ; qu’à la suite d’une demande de sa famille, elle a fait l’objet, le même jour, d’un examen par un médecin en application de l’article 63 3 du code de procédure pénale ; que la mesure de garde à vue a été prolongée à compter du 24 novembre à 7h15 avant d’être levée le même jour à 15h ; qu’à la suite de vérifications des services enquêteurs, il s’est avéré que les documents d’identité lituaniens présentés par la personne gardée à vue au nom de M. Y... étaient faux et qu’il se nommait M. Arman X..., de nationalité arménienne et était en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’une première procédure incidente a été ouverte pour détention et usage de faux documents administratifs et l’intéressé a fait l’objet d’un deuxième placement en garde à vue, à l’issue de la précédente mesure, le 24 novembre 2010, de 15h à 18h15 ; qu’une seconde procédure incidente a été ouverte pour entrée et séjour irréguliers d’un étranger en France et M. X... a fait l’objet d’une troisième garde à vue, à l’issue de la deuxième mesure, le 24 novembre 2010 de 18h15 à 19h30, heure à laquelle la garde à vue a été levée et l’intéressé placé en rétention administrative ; que le même jour, le préfet d’Eure et Loir a pris deux arrêtés à l’encontre de M. X..., le premier prononçant sa reconduite à la frontière et le deuxième décidant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de Versailles, par ordonnance du 26 novembre 2010, a accueilli l’exception de nullité, présentée par M. X... et tirée du défaut de versement au dossier du certificat établi par le médecin pendant la première garde à vue, et a ordonné sa remise en liberté ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise et prononcer la nullité de la procédure, l’ordonnance énonce que le certificat médical n’a pas été versé à la procédure en infraction à l’article 63 3, alinéa 3, du code de procédure pénale et que cette défaillance a privé le gardé à vue de la possibilité de prouver que son état de santé n’était, effectivement, pas compatible avec la mesure de contrainte et n’a pas permis au juge de vérifier cette compatibilité de sorte qu’elle a nécessairement porté atteinte à l’exercice des droits de la défense ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’irrégularité alléguée affectait une garde à vue qui ne précédait pas immédiatement la mesure de rétention litigieuse, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l’article L. 411 3 du code de l’organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger
LE DEFEREMENT AU PROCUREUR OU AU JUGE D'INSTRUCTION PEUT SE FAIRE 24 HEURES
APRES LA GARDE A VUE POUR FAIRE PLAISIR AUX AVOCATS QUI DOIVENT PREPARER LA DEFENSE
Article 803-3 du Code de Procédure pénale
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 21 février 2023 pourvoi n° 22-83.695 rejet
8. Il résulte de l'article 803-3 du code de procédure pénale que la personne qui
fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue peut, dès lors que
celle-ci n'a pas duré plus de soixante-douze heures et en cas de nécessité,
comparaître le jour suivant, à la condition que cette comparution intervienne au
plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde
à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
9. Ce texte n'interdit pas que l'interrogatoire de première comparution,
régulièrement commencé avant l'expiration du délai de vingt heures, se poursuive
postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d'instruction.
10. En l'espèce, pour rejeter la requête en nullité, faisant valoir que
l'interrogatoire de première comparution a eu lieu après l'expiration du délai
de vingt heures, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a commencé à 13 heures 55, soit avant l'expiration dudit délai.
11. Les juges ajoutent qu'il importe peu que l'interrogatoire de première
comparution ait été suspendu jusqu'à 15 heures 15, afin de permettre la présence de l'avocat de l'intéressé.
12. En se déterminant ainsi, et dès lors que la comparution de la personne
déférée devant le juge d'instruction a mis fin à la période de rétention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13. En effet, il importe peu que l'avocat de l'intéressé n'ait pas été présent
lors de la constatation de l'identité de ce dernier, l'article 116 du code de
procédure pénale ne prévoyant la désignation d'un avocat par la personne déférée que lors d'une phase ultérieure de l'interrogatoire de première comparution.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
LA DETENTION SOUS ECROU EXTRADITIONNEL
Article 627-5 du Code de Procédure Pénale
Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 du présent code lui sont applicables.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.
S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, le juge des libertés et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. L'article 696-21 est applicable.
L'EXTRADITION NE CONCERNE QUE LES RELATIONS D'ETAT A ETAT
Cour de Cassation CHAMBRE CRIMINELLE arrêt du 14 février 2012 pourvoi n° 11-87.679 Cassation sans renvoi
Vu les articles 696-1, 696-2 et 696-15 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’est privé de l’une des conditions essentielles de son existence légale l’avis de la chambre de l’instruction rendu sur une demande d’extradition n’émanant pas d’un Etat souverain ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., de nationalité paraguayenne, a fait l’objet d’une demande d’extradition présentée par les autorités judiciaires de la région administrative spéciale de Hong-Kong après qu’un mandat d’arrêt eut été émis contre lui le 15 juin 2010 par un juge d’une cour de ladite région, pour des faits qualifiés de trafic de drogue dangereuse qui auraient été commis le 9 juin 2010 à Hong-Kong ;
Attendu que, pour donner un avis favorable à la demande d’extradition en cause, assorti de la réserve selon laquelle M. X... ne sera ni remis ni réextradé vers la République populaire de Chine pour la poursuite ou le jugement des faits visés ou pour l’exécution de la peine qui serait appliquée, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine ne constitue pas un Etat souverain au sens des articles susvisés et qu’aucune convention d’extradition n’existe entre la France et ladite région, pourtant habilitée, en application de l’article 96 de la Loi fondamentale adoptée le 4 avril 1990, à conclure, avec l’aide ou l’autorisation du Gouvernement de la République populaire de Chine, de telles conventions, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
Qu’ainsi, l’arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire
LES RECOURS CONTRE UN ACTE ARBITRAIRE
SONT PROPRES ET DOIVENT PORTER GRIEFS
Article 802 du Code de Procédure Pénale
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Cour de Cassation arrêt du 14 févier 2012 pourvoi n° 11-84694 Cassation
Vu les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale
Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. François-Xavier X... et Alan Y... ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel ; que le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire à signifier, le premier, à deux ans d’emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l’épreuve, le second, à trois mois d’emprisonnement avec sursis ; que M. X... ainsi que le procureur de la République, à titre incident, ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive, l’arrêt retient que l’audition de ce dernier l’incrimine et lui fait grief ; que les juges ajoutent que le droit au silence n’a pas été notifié à ce coprévenu et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ; qu’ils en concluent que sa garde à vue, ainsi que la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives, doivent être annulées ;
Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d’un droit qui appartient en propre à une autre personne, la cour d’appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites sur :
- LA GARDE A VUE EST UNE DÉTENTION QUI DOIT ÊTRE AUTORISÉE PAR LA LOI ET CONFORME A LA CEDH
- LA JURISPRUDENCE EN FAVEUR DE LA PRÉSENCE D'UN AVOCAT EN GARDE A VUE
- UNE DETENTION ADMINISTRATIVE PRETEXTE D'UNE GARDE A VUE SANS AVOCAT
- LES RESTRICTIONS A LA PRÉSENCE D'UN AVOCAT DURANT LA GARDE A VUE
- LES MINEURS EN GARDE A VUE
- LES MORTS ET LES VIOLENCES DE LA POLICE DURANT LES GARDES A VUE
- LA JURISPRUDENCE SUR LA GARDE A VUE EXPLIQUÉE PAR LA CEDH.
LA GARDE A VUE EST UNE DÉTENTION
QUI DOIT ÊTRE AUTORISÉE PAR LA LOI ET CONFORME A LA CEDH
Jarrand c. France du 9 décembre 2021 requête no 56138/16
Art 5 : Intervention au domicile du requérant dans le cadre d’une enquête de flagrance : non-violation de l’article 8 ; audition libre du requérant alors qu’il avait été conduit sous la contrainte au commissariat de police : violation de l’article 5
L’affaire concerne l’intrusion des forces de l’ordre au domicile de M. Jarrand qui y retenait sa mère, une personne âgée dépendante en situation de grande vulnérabilité, en violation d’une décision de placement, son interpellation et les modalités de son audition libre dans un commissariat de police. Le requérant contestait d’abord la nécessité de l’ingérence dans son droit au respect de la vie privée que constitue l’intervention des forces de l’ordre à son domicile. La Cour considère que le comportement du requérant a rendu nécessaire l’intervention de la police dans le cadre de l’enquête de flagrance ouverte pour « mauvais traitements à personne vulnérable ». Eu égard à la marge d’appréciation dont dispose, dans un tel cas de figure, l’État défendeur et compte tenu des circonstances particulières de l’affaire ainsi que du besoin social impérieux auquel répondait l’intrusion domiciliaire litigieuse, la Cour en admet la « nécessité dans une société démocratique ». Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention. Le requérant contestait ensuite les modalités de son audition libre qui a suivi son arrestation. La Cour considère que la mesure litigieuse constitue une « privation de liberté » au sens de l’article 5 de la Convention. Après avoir relevé qu’il existait en droit interne, déjà à l’époque des faits litigieux, une exigence de niveau constitutionnel selon laquelle toute personne entendue, après avoir été conduite devant un officier de police judiciaire sous la contrainte, devait pouvoir bénéficier des garanties particulières liées au placement en garde à vue, la Cour constate que le requérant a été entendu sous le statut de l’audition libre alors qu’il avait été conduit au commissariat de police sous la contrainte. Elle en déduit qu’elle ne s’est pas déroulée selon les « voies légales » en violation de l’article 5 § 1. Dans les circonstances très particulières de l’espèce où les juridictions saisies ont omis d’examiner la question de la conformité de la détention à l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour conclut que le requérant n’a pas pu obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il alléguait avoir subi du fait d’une privation de liberté contraire à l’article 5 § 1, en violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
Art 5 § 1 • Privation de liberté • Voies légales • Audition sans placement en garde à vue du requérant conduit sous la contrainte au commissariat de police
Art 5 § 5 • Absence d’examen par les juridictions nationales de la conformité de la détention à l’art 5 § 1 ayant fait obstacle à l’indemnisation du préjudice allégué
Art 8 • Obligations positives • Nécessité de l’intervention par la force de policiers au domicile du requérant pour l’interpeler dans le cadre de l’enquête de flagrance ouverte pour « mauvais traitements à personne vulnérable » et porter assistance à sa mère
FAITS
Le requérant, M. Daniel Jarrand, est un ressortissant français, né en 1954 et résidant à Fontaine. Le 23 novembre 2009, un médecin du centre hospitalier universitaire de Grenoble où la mère de M. Jarrand avait été admise à la demande du médecin de famille, signala au procureur du tribunal de grande instance de Grenoble qu’elle se trouvait dans un état sanitaire et mental très dégradé. Après l’admission de sa mère à l’hôpital, M. Jarrand eut une attitude virulente envers le personnel de l’établissement et menaça de s’armer d’un révolver. Le 26 novembre 2009, le centre communal d’action sociale adressa un signalement au procureur, indiquant que la situation de la mère de M. Jarrand « sembl[ait] être très problématique », qu’elle vivait dans des « conditions d’hygiène inacceptables » et que son fils s’opposait à toute aide et tout suivi. Le 21 décembre 2009, le juge des tutelles de Grenoble saisi par le procureur, ordonna le placement de la mère sous sauvegarde de justice et désigna une association familiale en qualité de mandataire spécial. La mère de M. Jarrand fut admise dans une maison de retraite le 4 mai 2010. Parallèlement, une enquête fut ouverte pour délaissement de personne vulnérable. Le 31 mars 2011, M. Jarrand fut déclaré coupable de ces faits et condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Grenoble. La cour d’appel de Grenoble confirma ce jugement sur la culpabilité et ajouta à la peine une amende de 2 000 euros dont 1 500 avec sursis. La Cour de cassation cassa cependant cet arrêt sans renvoi. Le 10 juin 2010, M. Jarrand, qui accueillait sa mère pour l’après-midi dans le cadre d’un arrangement avec la directrice de cet établissement, refusa de la reconduire à la maison de retraite. Il se laissa finalement convaincre par des employés de l’association mandataire. Le 11 juillet 2010, le requérant refusa une nouvelle fois de reconduire sa mère dans l’établissement où elle avait été placée après qu’elle eut passé l’après-midi dans la maison familiale. Deux employées de l’association mandataire se rendirent sur place le lendemain. Vers 13 heures 15, elles tentèrent de joindre le requérant, qui était de retour. Celui-ci s’enferma à clé avec sa mère. À 14 heures 10, la directrice de l’association mandataire déposa plainte contre le requérant pour ces faits au commissariat de police de Fontaine. Une enquête de flagrance pour « mauvais traitements à personne vulnérable » fut ouverte par un officier de police judiciaire de la brigade de protection de la famille de Grenoble, qui en avisa le procureur de la République de Grenoble. Cinq équipages de policiers furent envoyés sur les lieux, sous l’autorité d’une commissaire de police. Celle-ci tenta vainement d’établir un contact avec M. Jarrand afin qu’il ouvre la porte de son domicile. Vers 16 heures 45, le procureur de la République donna l’ordre de forcer la porte d’entrée. Une dizaine de policiers pénétrèrent dans la maison. Des policiers braquèrent leurs armes sur M. Jarrand en lui intimant de montrer la main qu’il dissimulait et de se mettre au sol. Ce dernier obtempéra. Les policiers procédèrent à une « visite domiciliaire de sécurité » ou à une « rapide visite visuelle des lieux » afin de vérifier si une arme s’y trouvait. M. Jarrand fut interpellé, fouillé, menotté et, selon ses dires, brutalisé, puis conduit au commissariat de police de Grenoble où il fut entendu par un officier de police judiciaire de 17 heures 55 à 18 heures 55. M. Jarrand indique que, relâché dans la nuit, il dut rentrer en taxi. Il soutient que son domicile avait été fouillé de fond en comble alors qu’il était retenu au commissariat, et signale que sa mère avait été ramenée dans l’établissement spécialisé où elle avait été placée. M. Jarrand indique dans sa requête que sa mère a réintégré le domicile familial en janvier 2011, où elle a résidé avec lui jusqu’à sa mort, le 14 mars 2014. Le 15 juillet 2010, M. Jarrand déposa plainte devant les services de police de Grenoble pour violences et dégradation. La plainte fut classée sans suite par le procureur de la République, motif pris de l’absence d’infraction, les forces de l’ordre étant intervenues sur sa réquisition.
Le 21 janvier 2011, M. Jarrand et sa mère déposèrent plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Grenoble, du chef de violation de domicile, violences, menaces avec arme, arrestation illégale, séquestration, vol et dégradation de biens. Le 18 décembre 2014, le juge d’instruction prit une ordonnance de non-lieu. L’appel du requérant fut rejeté. Le requérant forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Article 5 § 1
La Cour relève que, le 12 juillet 2010, le requérant a été interpellé à son domicile par les forces de l’ordre, menotté, puis transporté, sous la contrainte, au commissariat de police de Grenoble où il a été interrogé entre 17 heures 55 et 18 heures 55. La Cour retient qu’entre son arrestation et sa sortie du commissariat, le requérant a été privé de liberté au sens de l’article 5 de la Convention. La Cour souligne qu’aux termes de l’article 5 § 1 de la Convention, nul ne peut être privé de liberté que dans les cas énumérés par cette disposition et « selon les voies légales ». Toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 mais aussi avoir une base légale en droit interne et être conforme aux règles de fond comme de procédure qui y sont posées. En l’espèce, l’arrestation du requérant ne soulève pas en elle-même de difficulté au regard de ces exigences : l’arrestation est intervenue dans le cadre d’une enquête de flagrance, ouverte à la suite d’une plainte déposée par la directrice de l’association à laquelle la mère du requérant avait été confiée, pour des faits susceptibles de caractériser le délit de délaissement de personne vulnérable, prévu par l’article 223-3 du code pénal et passible notamment de cinq ans d’emprisonnement. S’agissant de la privation de liberté qui a suivi cette arrestation, la Cour prend note de la position du Gouvernement selon laquelle, nonobstant l’article 62 du code de procédure pénale dans sa version alors en vigueur (soit la version applicable du 10 mars 2004 au 1er juin 2011), « la privation de liberté du requérant consécutive à son interpellation n’a pas été faite dans le respect des formes légales » étant donné qu’il « a été interpellé, menotté et, dès lors conduit sous la contrainte devant l’officier de police judiciaire [et qu’] il a, de ce fait, été privé de liberté au cours de son transport sans bénéficier, par la suite, du régime de la garde à vue et des droits qui y étaient associés ». La Cour déduit des observations du Gouvernement qu’à l’époque des faits litigieux et avant même la modification de la législation interne sur ce point, une personne interpellée en flagrance par les forces de l’ordre pour des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit passible d’une peine d’emprisonnement puis conduite sous la contrainte par celles-ci devant un officier de police judiciaire en vue de son audition, devait être formellement placée en garde à vue afin de bénéficier dans le cadre de sa privation de liberté des garanties des articles 63 et suivant du code de procédure pénale. La Cour relève en outre que, le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions du chapitre du code de procédure pénale relatif à la flagrance, dont l’article 62. À la suite de cette décision, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 a modifié le code de procédure pénale en prévoyant notamment que l’audition de personnes contre lesquelles il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’elles avaient commis ou tenté de commettre une infraction devait se faire sous le régime de la garde à vue, sans exclure qu’elles puissent être entendues endehors de ce régime dès lors qu’elles n’étaient pas maintenues à la disposition des enquêteurs sous la contrainte. Par une décision du 18 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que ce dispositif était conforme au principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, sous réserve que les intéressés soient informés de la date et de la nature de l’infraction qu’on les soupçonnait d’avoir commise et de leur droit de quitter à tout moment les locaux de la police ou de la gendarmerie. Il se déduit de la décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011 l’existence, en droit interne, déjà à l’époque des faits litigieux, d’une exigence de niveau constitutionnel selon laquelle toute personne entendue, après avoir été conduite devant un officier de police judiciaire sous la contrainte, doit pouvoir bénéficier des garanties particulières liées au placement en garde à vue. Il s’ensuit que l’audition du requérant au commissariat de police de Grenoble, le 12 juillet 2010, qui a eu lieu sans placement en garde à vue alors qu’il y avait été conduit sous la contrainte, est constitutive d’une privation de liberté qui ne s’est pas déroulée « selon les voies légales ». Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
Article 5 § 5
Les juridictions internes saisies à la suite de la plainte avec constitution de partie civile ne se sont pas prononcées sur la question du respect de l’article 5 § 1 de la Convention alors même que cette plainte dénonçait la rétention arbitraire et que l’appel et le recours en cassation exercés ultérieurement invoquaient la méconnaissance de cette disposition, faisant ainsi obstacle à l’indemnisation du préjudice allégué. Dans ces circonstances très particulières, où les juridictions saisies par le requérant ont omis d’examiner la question de la conformité de sa détention à l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5.
CEDH
57. La Cour relève que, le 12 juillet 2010, le requérant a été interpellé à son domicile par les forces de l’ordre vers 16 heures 45, menotté, puis transporté, sous la contrainte, au commissariat de police de Grenoble où il a été interrogé entre 17 heures 55 et 18 heures 55 ; le Gouvernement précise qu’il y a été retenu durant deux heures et cinquante-cinq minutes (paragraphe 15 ci-dessus). Il est manifeste qu’entre son arrestation et sa sortie du commissariat, le requérant a été privé de sa liberté, au sens de l’article 5 de la Convention, étant entendu que la relative brièveté de la période concernée n’est pas de nature à remettre en cause ce constat, qui ne prête d’ailleurs pas à controverse entre les parties. La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 5 § 1 peut également s’appliquer aux privations de liberté de très courte durée (parmi beaucoup d’autres, M.A. c. Chypre, no 41872/10, § 190, CEDH 2013).
58. La Cour souligne ensuite qu’aux termes de l’article 5 § 1 de la Convention, nul ne peut être privé de liberté que dans les cas énumérés par cette disposition et « selon les voies légales ». Elle renvoie aux principes généraux tels qu’il se trouvent énoncés dans l’arrêt Denis et Irvine c. Belgique [GC] (nos 62819/17 et 63921/17, § 123-133, 1er juin 2021), dont il ressort en particulier que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 mais aussi avoir une base légale en droit interne et être conforme aux règles de fond comme de procédure qui y sont posées.
59. En l’espèce, l’arrestation du requérant ne soulève pas en elle-même de difficulté au regard de ces exigences. Il ressort en effet du dossier qu’elle est intervenue dans le cadre d’une enquête de flagrance, ouverte à la suite d’une plainte déposée par la directrice de l’association à laquelle la mère du requérant avait été confiée, pour des faits susceptibles de caractériser le délit de délaissement de personne vulnérable, prévu par l’article 223-3 du code pénal et passible notamment de cinq ans d’emprisonnement. Des employées de cette association s’étaient en effet rendues chez le requérant le 12 juillet 2010 vers 12 heures pour s’enquérir de la situation de sa mère, qu’il avait accueillie à son domicile la veille et qu’il avait refusé de reconduire à la maison de retraite où elle avait été placée. Il apparaît qu’elles avaient constaté que le requérant avait laissé sa mère seule alors qu’il faisait très chaud et qu’elle n’était pas capable de s’hydrater par elle-même, et que le requérant avait refusé de les recevoir lorsqu’elles étaient retournées sur place une heure plus tard (paragraphe 13 ci-dessus). Or, il résulte de l’article 73 du code de procédure pénale (paragraphe 32 ci-dessus) qu’en cas notamment de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
60. S’agissant de la privation de liberté qui a suivi cette arrestation, la Cour relève tout d’abord que les juridictions internes saisies à la suite de la plainte avec constitution de partie civile ne se sont pas prononcées sur la question du respect de l’article 5 § 1 de la Convention, alors même que cette plainte dénonçait la rétention arbitraire dont le requérant aurait fait l’objet et que l’appel et le recours en cassation exercés ultérieurement invoquaient la méconnaissance de cette disposition.
61. La Cour note ensuite que le Gouvernement évoque la décision Ursulet (précitée), dans laquelle elle a conclu à la non-violation de l’article 5 § 1. Dans cette affaire, le requérant avait été contrôlé par trois fonctionnaires de police alors qu’il circulait en scooter. Ils lui avaient reproché des infractions routières et avaient constaté que le certificat d’immatriculation de son véhicule ne correspondait pas à la plaque minéralogique. Ils l’avaient interpellé à 14 heures 20 et l’avaient emmené au commissariat en vue de sa présentation à un officier de police judiciaire ; le suivant à vélo, ils l’avaient autorisé à conduire son scooter jusqu’au commissariat. Ils étaient arrivés au commissariat à 14 h 40, où le requérant avait été menotté. Le requérant avait été entendu par un officier de police judiciaire à 15 h 05, qui avait décidé de ne pas le placer en garde à vue. Il avait quitté le commissariat à l’issue de son audition, à 15 h 45.
62. La Cour a estimé dans cette affaire que le requérant avait été privé de sa liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention mais que cette privation de liberté s’était déroulée « selon les voies légales », sur le fondement de l’article 62 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable (il s’agissait comme en l’espèce de la version applicable du 10 mars 2004 au 1er juin 2011). Elle a constaté à cet égard qu’à l’époque des faits, les officiers de police judiciaire avait deux possibilités face à des personnes soupçonnées d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction : les retenir, en application de cette disposition, ou les placer en garde à vue, en application de l’article 63 du même code. La Cour a ensuite recherché si cette privation de liberté était justifiée et si un équilibre raisonnable avait été ménagé entre les intérêts en cause. Elle a constaté à cet égard que le requérant avait été interpellé pour des faits susceptibles de caractériser le délit d’usage de fausses plaques d’immatriculation, que les policiers qui avaient procédé à son interpellation n’avaient usé d’aucune mesure de contrainte et qu’un témoin avait attesté de son attitude agressive et hautaine. Elle en a déduit que « l’interpellation [du requérant et sa] privation de liberté subséquente [n’avaient pas excédé] les impératifs de sécurité et étaient conformes aux buts poursuivis par l’article 5 § 1 ». La Cour a ensuite relevé que, dans les circonstances de l’espèce, la rétention du requérant, qui avait duré une heure et vingt-cinq minutes, avait été limitée à ce qui était strictement nécessaire.
63. La Cour prend note de la position du Gouvernement selon laquelle, nonobstant l’article 62 du code de procédure pénale dans sa version alors en vigueur (soit la version applicable du 10 mars 2004 au 1er juin 2011), « la privation de liberté du requérant consécutive à son interpellation n’a pas été faite dans le respect des formes légales » étant donné qu’il « a été interpellé, menotté et, dès lors conduit sous la contrainte devant l’officier de police judiciaire [et qu’] il a, de ce fait, été privé de liberté au cours de son transport sans bénéficier, par la suite, du régime de la garde à vue et des droits qui y étaient associés ».
64. La Cour déduit des observations du Gouvernement qu’à l’époque des faits litigieux et avant même la modification de la législation interne sur ce point, une personne interpellée en flagrance par les forces de l’ordre pour des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit passible d’une peine d’emprisonnement puis conduite sous la contrainte par celles-ci devant un officier de police judiciaire en vue de son audition, devait être formellement placée en garde à vue afin de bénéficier dans le cadre de sa privation de liberté des garanties des articles 63 et suivant du code de procédure pénale, qui comprenaient notamment son information immédiate de la nature de l’infraction sur laquelle portait l’enquête ainsi que de ses droits, dont celui de s’entretenir avec un avocat (paragraphe 32 ci-dessus).
65. À ce titre, la Cour relève que, le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions du chapitre du code de procédure pénale relatif à la flagrance, dont l’article 62 (décision no 2010-14/22 QPC). À la suite de cette décision, la loi no 2011-392 du 14 avril 2011 a modifié le code de procédure pénale en prévoyant notamment que l’audition de personnes contre lesquelles il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’elles avaient commis ou tenté de commettre une infraction devait se faire sous le régime de la garde à vue, sans exclure qu’elles puissent être entendues en-dehors de ce régime dès lors qu’elles n’étaient pas maintenues à la disposition des enquêteurs sous la contrainte. Par une décision du 18 novembre 2011 (no 2011-191/194/195/196/197 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé que ce dispositif était conforme au principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, sous réserve que les intéressés soient informés de la date et de la nature de l’infraction qu’on les soupçonnait d’avoir commise et de leur droit de quitter à tout moment les locaux de la police ou de la gendarmerie (paragraphes 34-35 ci-dessus). Depuis sa modification par la loi no 2014-535 du 27 mai 2014, l’article 61-1 du code de procédure pénale prévoit que les personnes à l’égard desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être entendues librement sur ces faits qu’après avoir été informées, notamment, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction dont il est question, du droit de quitter à tout moment les locaux où elles sont entendues, du droit de se taire et, si l’infraction est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistées par un avocat (paragraphe 36).
66. Il se déduit de la décision précitée du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011 l’existence, en droit interne, déjà à l’époque des faits litigieux, d’une exigence de niveau constitutionnel selon laquelle toute personne entendue, après avoir été conduite devant un officier de police judiciaire sous la contrainte, doit pouvoir bénéficier des garanties particulières liées au placement en garde à vue. Il s’ensuit que l’audition du requérant au commissariat de police de Grenoble, le 12 juillet 2010, qui a eu lieu sans placement en garde à vue alors qu’il y avait été conduit sous la contrainte, est constitutive d’une privation de liberté qui ne s’est pas déroulée « selon les voies légales ».
67. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
Article 5-5
89. Le requérant soutient qu’il n’a pas disposé d’un recours en réparation répondant aux exigences de l’article 5 § 5 de la Convention, aux termes duquel :
« 5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
90. Renvoyant à ses observations relatives à l’épuisement des voies de recours internes s’agissant des griefs tirés des articles 5 § 1 et 8 de la Convention, le Gouvernement fait valoir que l’action en responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire était en l’espèce une voie de droit effective et suffisante pour obtenir réparation en cas de détention arbitraire dans le respect des exigences de l’article 5 § 5 de la Convention.
91. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
92. Sur le fond, la Cour rappelle que l’article 5 § 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4. Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les organes de la Convention. À cet égard, la jouissance effective du droit à réparation garanti par cette dernière disposition doit se trouver assurée à un degré suffisant de certitude (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 182, CEDH 2012, et N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X).
93. La Cour rappelle par ailleurs que pour qu’elle conclue à la violation de l’article 5 § 5, il doit être établi que le constat de violation d’un des autres paragraphes de l’article 5 ne pouvait, avant l’arrêt concerné de la Cour, ni ne peut, après cet arrêt, donner lieu à une demande d’indemnité devant les juridictions nationales (Stanev, précité, § 184).
94. Le cinquième paragraphe de l’article 5 de la Convention ne requiert pas que les victimes d’une privation de liberté contraire au premier paragraphe de cette disposition aient spécifiquement accès à une procédure en indemnisation dirigée contre l’État. Comme l’illustre en particulier l’affaire Houtman et Meeus c. Belgique (no 22945/07, 17 mars 2009), il suffit, lorsque des responsabilités personnelles peuvent être déterminées, que les victimes aient la possibilité d’engager une action civile en indemnisation.
95. Au cas d’espèce, la Cour a conclu à une violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Le requérant est donc en mesure de se prévaloir de l’article 5 § 5.
96. Comme la Cour l’a précédemment constaté (paragraphe 60 ci-dessus), les juridictions internes saisies à la suite de la plainte avec constitution de partie civile ne se sont pas prononcées sur la question du respect de l’article 5 § 1 de la Convention alors même que cette plainte dénonçait la rétention arbitraire dont aurait fait l’objet le requérant et que l’appel et le recours en cassation exercés ultérieurement invoquaient la méconnaissance de cette disposition, faisant ainsi obstacle à l’indemnisation par cette voie du préjudice allégué par le requérant.
97. Dans ces circonstances très particulières, où les juridictions saisies par le requérant ont omis d’examiner la question de la conformité de sa détention à l’article 5 § 1 de la Convention, il y a eu violation de l’article 5 § 5, sans qu’il soit besoin de trancher la question de savoir si l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire aurait permis de respecter les exigences de cette disposition.
Erarslan et autres c. Turquie du 19 juin 2018 Requêtes nos 55833/09 55837/09, 55838/09 et 55843/09
Article 5-1 : les requérants se plaignent d'une garde à vue sous le prétexte de la participation à une association pour renverser le gouvernement. Il n'y avait aucun indice sérieux pour condamner le requérant. La CEDH introduit la règle de l'interprétation déraisonnable du droit interne qui conduit un caractère arbitraire à la détention.
"24... la Cour estime que, en l’espèce, l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à l’arrestation et au placement en garde à vue des requérants un caractère irrégulier et arbitraire."
CEDH
19. Les requérants soutiennent que leur placement en garde à vue avait un caractère arbitraire au motif qu’il n’existait aucun fait ni aucune information susceptibles de persuader un observateur objectif de leur appartenance à une organisation terroriste.
20. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer que l’article 5 § 1 de la Convention n’a pas été violé dans la présente affaire. Il déclare d’abord que les requérants ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête pénale portant sur la criminalité organisée. À ses dires, les intéressés ont été privés de leur liberté en raison de l’existence de soupçons selon lesquels l’Association était contrôlée par l’organisation terroriste présumée Ergenekon. Le Gouvernement soutient qu’il était objectivement possible de parvenir à la conviction qu’il existait des raisons plausibles de les soupçonner d’avoir pu commettre l’infraction reprochée, eu égard aux objectifs fondamentaux présumés de l’organisation criminelle Ergenekon et aux plans d’action de celle-ci concernant les organisations non gouvernementales, aux éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête et aux relations entre les accusés. Le Gouvernement indique que, dans le cadre de la même enquête pénale, plusieurs membres et dirigeants de l’Association ont été placés en garde à vue le même jour et que des perquisitions ont été effectuées au siège social et dans les locaux de plusieurs succursales de l’Association. Il ajoute que, compte tenu des éléments de preuve obtenus lors de l’enquête, une procédure pénale a été engagée à l’encontre de huit personnes et une ordonnance de non-lieu a été rendue à l’égard des autres suspects.
21. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de plausibilité des soupçons sur lesquels doit se fonder une privation de liberté, lesquels sont résumés notamment dans ses arrêts Murray c. Royaume-Uni (28 octobre 1994, § 55, série A no 300‑A) et Ayşe Yüksel et autres (nos 55835/09 et 2 autres, §§ 51-53, 31 mai 2016).
22. La Cour note qu’elle s’est déjà prononcée sur les privations de liberté des membres et dirigeants du ÇYDD dans le cadre des enquêtes menées contre l’organisation Ergenekon. Dans ce contexte, elle a estimé, dans ses arrêts Mergen et autres (précité, § 54) et Ayşe Yüksel et autres (précité, § 59), que l’arrestation et le placement en garde à vue des requérantes étaient arbitraires car le Gouvernement n’avait pas fourni d’éléments de preuve concernant l’existence d’un lien entre les intéressées elles-mêmes et l’organisation Ergenekon.
23. En l’occurrence, eu égard au contenu des dossiers, la Cour considère pareillement que les faits à l’origine des soupçons pesant sur les requérants s’apparentent à des actes liés, d’une part, aux travaux effectués pour l’Association que les intéressés ont accomplis en relation avec certains accusés du procès Ergenekon et, d’autre part, à la participation de ceux-ci à certaines manifestations politiques. Elle rappelle que la seule allégation selon laquelle certains membres de l’association en question faisaient également partie d’une organisation illégale ne peut pas être considérée comme suffisante pour convaincre un observateur objectif que les requérants pouvaient avoir accompli l’infraction d’appartenance à une organisation illégale. De plus, la Cour note que, par un arrêt du 2 octobre 2015, la cour d’assises d’Anadolu a acquitté tous les membres de l’Association à l’encontre desquels une action pénale avait été engagée au motif qu’ils n’avaient commis aucune infraction. Elle relève en outre que, dans les attendus de sa décision, cette juridiction a constaté qu’une partie des preuves contenues dans le dossier avaient été falsifiées et qu’elle a par conséquent décidé de porter plainte contre les responsables présumés de cette falsification.
24. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que, en l’espèce, l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à l’arrestation et au placement en garde à vue des requérants un caractère irrégulier et arbitraire.
25. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
GASPAR c. PORTUGAL du 28 novembre 2017 Requête no 3155/15
Non violation de convention en matière de garde à vue : Quand le droit interne prévoit 48 heures, il s'agit du délai dans lequel le prévenu doit être présenté à un juge d'instruction qui a selon la jurisprudence de la CEDH, 4 jours pour rendre sa décision sur la légalité de la détention provisoire.
i. Principes généraux
46. L’article 5 § 3 de la Convention vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt « physiquement conduite » devant une autorité judiciaire, ce « contrôle judiciaire rapide et automatique » assurant aussi une protection contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements. Il vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Pour ce qui est du premier volet, la jurisprudence de la Cour établit qu’il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d’avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité, des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s’exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites (voir, notamment, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, §§ 118‑120, CEDH 2010).
47. Le contrôle juridictionnel doit tout d’abord répondre à une exigence de « promptitude », car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. Sauf « circonstances exceptionnelles », il doit intervenir dans un délai maximum de quatre jours après l’arrestation. Par ailleurs, un délai inférieur à quatre jours peut se révéler incompatible avec l’exigence de promptitude que pose l’article 5 § 3 si aucune difficulté particulière ou circonstance exceptionnelle n’empêchaient les autorités de traduire plus tôt la personne arrêtée devant le juge ou lorsque des circonstances spécifiques justifiaient une présentation plus rapide devant un magistrat (Kiril Zlatkov Nikolov c. France, nos 70474/11 et 68038/12, § 39, 10 novembre 2016 et les références qui y sont citées).
48. Ensuite, le contrôle ne peut être rendu tributaire d’une demande formée par la personne détenue : il doit être automatique (voir, notamment, Medvedyev et autres, précité, § 122).
49. Enfin, le contrôle doit être confié à un magistrat présentant les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et ce magistrat doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention. Il doit « entendre personnellement l’individu traduit devant lui » ; il doit examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, ordonner l’élargissement. Autrement dit, il faut que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention ». Le contrôle automatique initial portant sur l’arrestation et la détention doit donc permettre d’examiner les questions de régularité et celle de savoir s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c’est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l’article 5 § 1 c) de la Convention ; s’il n’en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d’ordonner la libération. Destiné à établir si la privation de liberté de l’individu est justifiée, le contrôle requis par l’article 5 § 3 de la Convention doit être suffisamment ample pour couvrir les diverses circonstances militant pour ou contre la détention (Kiril Zlatkov Nikolov, précité, § 41, voir aussi Medvedyev et autres, précité, §§ 123-126 et les références qui y sont citées).
ii. Application de ces principes à la présente espèce
50. En l’espèce, la Cour relève que le 26 mars 2014 à 11 h 30, au terme d’une perquisition effectuée à son domicile, la requérante a été arrêtée et placée en garde à vue en exécution d’un mandat d’arrêt émis la veille (paragraphe 6 ci-dessus). Elle note que cette dernière a comparu devant le juge d’instruction criminelle du tribunal d’Almada le 27 mars 2014 à 22 h 25, soit environ trente-quatre heures après son arrestation (paragraphe 8 ci-dessus) et que son placement en détention provisoire a été ordonné le 29 mars 2014 à 14 h 20, soit environ trois jours et trois heures après son arrestation (paragraphe 11 ci-dessus). Or, selon la requérante, le juge d’instruction aurait dû valider sa détention dans le délai de quarante-huit heures fixé par l’article 28 § 1 de la Constitution et par l’article 141 § 1 du CPP.
51. La Cour constate que les dispositions susmentionnées prévoient effectivement que la garde à vue ne peut dépasser quarante-huit heures (paragraphes 37 et 38 ci-dessus). Cela dit, conformément à la pratique interne, il apparaît que ce délai maximum se rapporte au moment de la comparution de l’accusé devant le juge et non pas au moment où celui-ci rend sa décision ordonnant le placement en détention provisoire ou la libération (paragraphes 39 et 40 ci-dessus), comme le déclare le Gouvernement. Accueillant l’argument de ce dernier sur ce point, la Cour conclut que la garde à vue de la requérante était régulière au regard du droit interne.
52. Par ailleurs, elle observe que le juge d’instruction s’est prononcé sur le bien-fondé de la détention de la requérante dans un délai inférieur au délai maximum de quatre jours qui ressort de la jurisprudence de la Cour (paragraphe 47 ci-dessus). En outre, l’affaire présentait une certaine complexité notamment compte tenu du nombre de personnes mises en examen qu’il fallait entendre, ce qui peut justifier que la validation de la détention de la requérante n’ait pu avoir lieu plus tôt (paragraphe 47 in fine, ci-dessus). Pour finir, la Cour ne décèle aucune circonstance spécifique qui justifiait une présentation plus rapide devant un magistrat (voir, a contrario, Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, §§ 66 et 67, 6 novembre 2008, İpek et autres c. Turquie, nos 17019/02 et 30070/02, §§ 36 et 37, 3 février 2009, et Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 159, CEDH 2013 (extraits)).
53. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, en l’espèce, la requérante a été traduite aussitôt après son arrestation devant un juge, comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition sur ce point.
LYKOVA c. RUSSIE du 22 décembre 2015 requête 68736/11
Violation des article 5, 3 et 2 de la CEDH : Au moment qu'il a été détenu au commissariat de police, aucun soupçon pesait sur lui. Bien à l'abri d'un enregistrement, les policiers l'ont torturé. Pour échapper à ses souffrances, il s'est suicidé.
69. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Ce droit revêt une très grande importance dans « une société démocratique », au sens de la Convention (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 169, CEDH 2004‑II).
70. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5 § 1, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n’y a qu’une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, §§ 92 et 93, série A no 39, et Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 57, CEDH 2012).
71. La Cour rappelle aussi que l’article 5 § 1 précise explicitement que les garanties qu’il consacre s’appliquent à « toute personne ». Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs.
De plus, en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi d’autres arrêts, A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, §§ 162-164, 19 février 2009, et Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 84, 23 février 2012).
72. La Cour souligne que la détention non reconnue d’un individu constitue une totale négation de ces garanties et une violation extrêmement grave de l’article 5 (voir, parmi beaucoup d’autres, El‑Masri c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 237, Çakıcı, précité, § 104, et Loulouïev et autres c. Russie, no 69480/01, § 122, CEDH 2006‑XIII (extraits)).
73. Elle rappelle que le second volet de l’article 5 § 1 b), auquel semble se référer le Gouvernement (paragraphe 80 ci-dessous), autorise la détention d’une personne « en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ». Cette disposition concerne les cas où la loi autorise à détenir quelqu’un pour le forcer à exécuter une obligation spécifique et réelle qui lui incombe déjà et qu’il a jusque-là négligé de remplir. Pour relever du champ d’application de cet article, l’arrestation et la détention doivent en outre viser à assurer l’exécution de l’obligation en question ou y contribuer directement, et ne doivent pas revêtir un caractère punitif. Dès que l’obligation a été exécutée, la détention devient infondée au regard de l’article 5 § 1 b). Enfin, il faut ménager un équilibre entre l’importance qu’il y a dans une société démocratique à assurer l’exécution immédiate de l’obligation dont il s’agit et l’importance du droit à la liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Schwabe et M.G. c. Allemagne, nos 8080/08 et 8577/08, § 73, CEDH 2011, et Ostendorf c. Allemagne, no 15598/08, §§ 69-71, 94, 99 et 101, 7 mars 2013).
74. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’il faut rechercher : (a) si Sergueï Lykov a été privé de sa liberté, au sens de l’article 5 de la Convention ; et, dans l’affirmative, (b) si cette privation de liberté relevait des exceptions autorisées par le paragraphe 1.
a) Sur la question de savoir si Sergueï Lykov a été privé de sa liberté
75. La Cour rappelle que lorsque le requérant produit des indices prima facie concordants de nature à démontrer qu’il se trouvait bien sous le contrôle exclusif des autorités le jour des faits, à savoir qu’il a été convoqué officiellement par les autorités et est entré dans un lieu sous leur contrôle, la Cour peut considérer que l’intéressé n’était pas libre de partir, en particulier lorsque des mesures d’enquête étaient en cours d’exécution. Elle peut alors en conséquence attribuer au Gouvernement la responsabilité de livrer un compte rendu horaire précis de ce qui s’est passé dans les locaux concernés et de s’expliquer quant au temps que le requérant y a passé. Le Gouvernement devra alors fournir des pièces satisfaisantes et convaincantes à l’appui de sa version des faits, faute de quoi la Cour pourra en tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant (Creangă, précité, § 90).
76. La Cour observe qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que le 9 septembre 2009 Sergueï Lykov est entré dans un commissariat de police accompagné de policiers entre 13 et 15 heures, selon ces derniers. De même, il n’est pas contesté que les autorités n’étaient pas à la recherche de M. Lykov, jusque-là inconnu des services de police, mais uniquement de P. (paragraphe 9 ci-dessus). Il n’est pas non plus contesté que M. Lykov, comprenant qu’il avait affaire à des policiers, a obtempéré à leur ordre de les suivre. Les parties s’accordent également sur le fait qu’il est demeuré dans les locaux de la police jusqu’à sa défenestration à 18 h 50.
Ainsi, la Cour estime que Sergueï Lykov doit bien être regardé comme étant entré, sur convocation des autorités, dans un lieu se trouvant sous leur contrôle.
77. Il incombe dès lors au gouvernement défendeur de livrer un compte rendu horaire précis de ce qui s’est passé dans les locaux concernés, et de s’expliquer quant au temps que le requérant y a passé.
La Cour constate à cet égard que le Gouvernement n’a produit ni le registre des entrées et sorties du commissariat de police, censé être en la possession des autorités, ni les procès-verbaux éventuellement dressés à la suite des « explications » données par Sergueï Lykov. Elle constate en outre que l’heure d’arrivée de M. Lykov dans les locaux de la police n’a été précisée ni par le Gouvernement ni par l’enquête pénale interne. En effet, les explications des acteurs principaux sont discordantes : P. dit que leur interpellation le 9 septembre a eu lieu entre midi et 13 heures (paragraphe 22 ci-dessus) tandis que les policiers Sa. et T. indiquent respectivement 14 et 15 heures (paragraphes 19 et 18 ci-dessus). En revanche, les parties ne contestent pas que la victime s’est défenestrée à 18 h 50 (paragraphes 12 et 68 ci-dessus).
En l’absence de registre des entrées, la Cour conclut que la victime est demeurée au commissariat de police pendant au moins quatre heures – entre, au plus tard, 15 heures, et 18 h 50. La Cour rappelle à cet égard que l’article 5 § 1 s’applique également aux privations de liberté de courte durée (Foka c. Turquie, no 28940/95, § 75, 24 juin 2008, Shimovolos précité, § 50, et Ostendorf, précité, § 75).
78. Le Gouvernement semble attacher de l’importance au fait que la victime avait accepté de suivre les policiers de son plein gré, pour en déduire qu’elle n’a pas été privée de sa liberté.
La Cour ne saurait souscrire à cet argument. Elle rappelle que le caractère non forcé de la comparution ne constitue pas un élément permettant de statuer définitivement sur l’existence ou non d’une privation de liberté. En effet, à supposer même que les évènements se soient déroulés comme les décrit le Gouvernement, il existe une obligation légale d’obtempérer aux ordres de la police (paragraphe 56 ci‑dessus). L’absence de réticence de M. Lykov prouve simplement qu’il s’est conformé à cette obligation légale et nullement qu’il consentait de son plein gré à être privé de liberté, encore moins pour une période prolongée.
Reste maintenant la question de savoir si M. Lykov était libre de quitter les locaux de police. Le Gouvernement semble l’affirmer (paragraphe 67 ci‑dessus). Toutefois, cette thèse est contredite par certaines déclaration du Gouvernement lui‑même, puisqu’il affirme par ailleurs que Sergueï Lykov avait été invité pour donner des renseignements, qu’il a discuté avec le policier T. et qu’il est, finalement, passé aux aveux (ibidem). En outre, cette thèse est contredite par la déclaration concordante de P. niant le caractère volontaire tant de leur venue dans les locaux de la police que du déroulement de cette « visite » (paragraphes 6 et 7 ci‑dessus). Au vu de ces éléments, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas démontré que Sergueï Lykov est à un quelconque moment sorti des locaux de la police et qu’il était libre de le faire à son gré (Osypenko c. Ukraine, no 4634/04, § 49, et 9 novembre 2010, Creangă, précité, § 99). La Cour est donc d’avis que la victime a bien été privée de liberté, au sens de l’article 5 de la Convention.
b) Sur la compatibilité de la privation de liberté de Sergueï Lykov avec l’article 5 § 1 de la Convention
79. La Cour note d’emblée que le Gouvernement a souligné qu’aucun soupçon relatif à une infraction commise ne pesait sur M. Lykov avant que celui‑ci ne passât aux aveux.
80. Le Gouvernement explique que M. Lykov a été invité au commissariat de police en vue de « présenter des informations utiles » (paragraphe 10 ci‑dessus). La Cour estime que l’on ne peut y voir, de la part du Gouvernement, que le seule invocation en substance du second volet de l’article 5 § 1 b), qui autorise la détention d’une personne « en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ».
81. La Cour note toutefois que le Gouvernement est resté en défaut d’expliquer en quoi consistait concrètement l’obligation supposée que Sergueï Lykov aurait jusque‑là négligé de remplir. Comme aucune autre raison susceptible d’expliquer sa privation de liberté n’a été avancée, force est de conclure que M. Lykov a bien été dépouillé de sa liberté de façon arbitraire, puisque sa détention ne relevait ainsi d’aucun des cas admis par l’article 5 § 1 de la Convention.
82. Dès lors, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de la privation de liberté dont Sergueï Lykov a été victime dans l’après-midi du 9 septembre 2009.
TORTURE
125. En outre, la Cour a déjà dit qu’il n’y a pas de garantie légale contre les mauvais traitements plus importante que l’exigence de consigner sans tarder toute information relative à une arrestation dans les registres de garde à vue pertinents (Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 105, CEDH 2000‑VI). Elle rappelle que les trois droits pertinents – le droit, pour la personne détenue, de pouvoir informer de sa détention un tiers de son choix, le droit d’avoir accès à un avocat et le droit de demander un examen par un médecin de son choix – doivent s’appliquer dès le tout début de la privation de liberté, quelle que soit la description qui peut en être donnée dans le système juridique concerné (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 54, CEDH 2008, Martin c. Estonie, no 35985/09, § 79, 30 mai 2013, et Zayev c. Russie, no 36552/05, § 86, 16 avril 2015). La Cour conclut que ces droits, dont le but est précisément de prévenir les abus policiers, n’ont pas été respectés pour M. Lykov.
126. Pour apprécier la gravité des faits établis, la Cour prend en considération l’intensité des actes en cause, le fait qu’ils aient, le cas échéant, été infligés de manière intentionnelle par des agents de l’État agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces traitements ont eu lieu.
S’agissant de l’intensité des actes de violence, la Cour observe que, selon la version de P., sur laquelle la Cour s’est fondée (paragraphe 122 ci‑dessus), les policiers ont infligé à la victime plusieurs coups en lui cognant la tête contre des surfaces dures – le sol, une armoire et une table (paragraphes 7 et 122 ci‑dessus). Ces coups, déjà suffisamment douloureux par eux-mêmes, se sont accompagnés de plusieurs séances d’asphyxie (ibidem), traitement de nature lui aussi à provoquer chez les victimes des douleurs et des souffrances aiguës. La Cour note qu’un élément d’humiliation s’est ajouté aux souffrances physiques de la victime, puisque Sergueï Lykov a subi ces traitements déshabillé, avec les mains et les pieds liés (paragraphes 7, 8 et 122 ci‑dessus).
La Cour rappelle que les traitements dénoncés ont eu lieu au cours d’une détention non enregistrée, ce qui n’a fait qu’aggraver la vulnérabilité de la victime, détenue au commissariat de police et privée pendant plusieurs heures des garanties procédurales normalement attachées à son état (paragraphe 125 ci-dessous).
La Cour observe de surcroît que les mauvais traitements susmentionnés ont été infligés avec l’intention d’arracher des aveux (paragraphes 7 et 11 ci‑dessus).
Eu égard à ces éléments, la Cour est convaincue que les actes de violence commis sur la personne de Sergueï Lykov, pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et des souffrances « aiguës » et revêtent un caractère particulièrement grave et cruel. De tels agissements doivent être regardés comme des actes de torture au sens de l’article 3 de la Convention (Lyapin, précité, § 115).
127. Ces éléments permettent à la Cour de conclure que les traitements subis par la victime le 9 septembre 2009 ont emporté violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel.
LE SUICIDE DU DÉTENU
128. La Cour note que la présente affaire ne contient aucun élément permettant de juger au‑delà de tout doute raisonnable que la mort a été infligée à M. Lykov par les agents de l’État de manière intentionnelle. En effet, la requérante et le Gouvernement s’accordent sur le fait que la victime s’est défenestrée. Leur seul point de désaccord est la question de savoir si cet acte était soudain et imprévisible pour les policiers, de sorte que les autorités seraient exonérées de toute responsabilité, ou bien si cet acte était un geste de désespoir provoqué par les mauvais traitements. La Cour estime nécessaire de se focaliser sur la question de savoir si les autorités pourraient être tenues responsables pour la défenestration de la victime.
129. Face à des personnes détenues ou placées en garde à vue, donc se trouvant dans un rapport de dépendance comparable à celui dans lequel s’est trouvé M. Lykov, la Cour a admis une obligation positive de protection de l’individu, y compris contre lui‑même. En outre, même quand les preuves sont insuffisantes pour permettre à la Cour de constater que les autorités savaient ou auraient dû savoir que la personne détenue courait un risque de suicide, les policiers doivent prendre certaines précautions de base propres à réduire à son minimum tout risque potentiel (Keller, précité, § 82, et Mižigárová, précité, § 89).
130. En l’occurrence, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’établir si les autorités qui ont arrêté M. Lykov avaient ou non des informations sur l’existence de circonstances personnelles de nature à le pousser au suicide, informations qui dans l’affirmative eussent dû les inciter à agir en prévention d’un éventuel passage à l’acte. La Cour estime en effet que la vulnérabilité de la victime au moment précis de la défenestration tenait avant tout et surtout à la torture qu’elle subissait de la part des policiers. La Cour a déjà été amenée à examiner le cas de mauvais traitements dont l’intensité avait poussé la victime à se défenestrer pour échapper aux souffrances (Mikheïev, précité, § 135). Dans la présente affaire, la Cour a établi que M. Lykov avait été torturé en présence de P. (paragraphe 127 ci‑dessus). En outre, il n’est pas exclu que la victime ait été torturée après, dans la mesure où P. affirme avoir entendu ses cris au cours de l’heure suivante (paragraphe 8 ci‑dessus). De surcroît, la Cour relève également que pendant cette période, M. Lykov est passé aux aveux et s’est défenestré (paragraphes 11 et 12 ci‑dessus). La Cour constate que la victime est entrée dans le bâtiment étant en vie et a trouvé la mort en raison de la chute du cinquième étage du commissariat. D’une part, la Cour estime que la version du Gouvernement tenant au suicide pour des raisons personnelles n’est pas satisfaisante. En effet, elle n’a aucunement tenu compte ni de la torture avérée du requérant (paragraphes 120-127 ci-dessous), ni de sa détention non reconnue (paragraphes 75-82 ci-dessus). D’autre part, la Cour ne saurait tirer aucune conclusion probante de l’enquête qu’elle vient de juger ineffective (paragraphe 109 ci-dessus). Dès lors, après avoir constaté que ni le Gouvernement, ni l’enquête nationale n’ont donné aucune explication satisfaisante quant au décès de la victime, la Cour considère que les autorités russes sont responsables pour la défenestration de Sergueï Lykov.
131. La Cour rappelle que sa compétence se limite à statuer sur la responsabilité de l’État au titre de la Convention ; la responsabilité individuelle des protagonistes ne relève que des juridictions internes. La Cour considère, par conséquent, qu’il ne lui revient pas de discuter dans le cas d’espèce de la responsabilité individuelle de tel ou tel des policiers présents pour la négligence qu’aurait constituée leur surveillance insuffisante de la conduite de la victime.
Cette précision étant faite, la Cour est d’avis que les autorités russes doivent être tenues pour responsables, au regard de la Convention, du décès de M. Lykov qui, au cours d’une détention non reconnue où il se trouvait privé de tous les droits qui auraient normalement dû être attachés à son état (paragraphe 125 ci-dessous), a été torturé.
Corbet et autres c. France du 19 mars 2015 Requêtes nos 7494/11, 7493/11 et 7989/11
Violation de l'article 5§1 : une garde à vue de plus de 48 heures est une violation du droit interne et par conséquent de la CEDH.
48. La Cour estime qu’il faut distinguer deux phases consécutives dans la détention subie par le requérant du 22 au 24 juillet 2003. La première, qui a débuté le 22 juillet 2003 à 14 heures et a pris fin le 24 juillet 2003 à 14 heures, correspond à une mesure de garde à vue, dont les modalités sont prévues par les articles 62-2 et suivants du code de procéder pénale notamment. Comme observé précédemment, le requérant ne la met pas en cause. Quant à la seconde, qui a débuté le 24 juillet 2003 à 14 heures et a pris fin le même jour, le Gouvernement admet qu’elle n’avait pas de base légale, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Telle est en effet la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans une affaire similaire, après avoir constaté qu’aucune disposition de droit interne ne réglementait la détention d’une personne entre le moment de la fin de sa garde à vue et celui de sa présentation devant le juge d’instruction (Zervudacki c. France, no 73947/01, § 47, 27 juillet 2006). Or le droit interne n’avait pas évolué sur ce point à l’époque des faits de la présente affaire.
49. Par conséquent, renvoyant aux motifs de l’arrêt Zervudacki précité (§§ 39-49), la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
Maire d'église c. France arrêt du 20 novembre 2008 Requête 20335/04
La CEDH condamne une garde à vue de 53 heures alors que pour les faits reprochés, la garde à vue ne pouvait durer plus de 48 heures.
38. La Cour estime que la seule question litigieuse en l’espèce sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention est celle de la durée de la privation de liberté ayant fait suite à la mesure de garde à vue légalement ordonnée c’est-à-dire à la période comprise entre le 12 juin 2002 à 21 heures et le 13 juin 2002 à 12 heures.
39. La Cour relève à ce titre que cette privation de liberté relève de l’article 5 § 1 c) de la Convention. En effet, le requérant a été arrêté et placé en garde à vue « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente », au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis un délit.
40. La question à trancher est donc celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté, entre le 12 juin 2002 à 21 heures et le 13 juin 2002 à 12 heures, « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
41. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Ce droit revêt une très grande importance dans « une société démocratique », au sens de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 65, série A no 12 ; Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, et Assanidzé c. Georgie [GC], no 71503/01, § 69, CEDH 2004-II).
42. Tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5. La liste des exceptions que dresse l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV, et Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311), et seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22 ; Amuur c. France, 25 juin 1996, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, et Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil 1997-IV).
43. Les termes « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions législatives ou jurisprudence – a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000-III).
44. De surcroît, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52, Baranowski, précité, § 52, et Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 40, 28 octobre 2003).
45. En l’espèce, la Cour note que la durée de la garde à vue n’a pas excédé le délai légal maximal de quarante-huit heures prévu par l’article 154 du code de procédure pénale et, qu’à la différence de l’affaire Zervudacki précitée, il a été mis fin à la mesure de garde à vue avant le terme fixé par la prolongation de la mesure.
46. Pour autant, le requérant n’a pas été remis en liberté à l’issue de sa garde à vue et est resté entre le 12 juin 2002 à 21 heures et le 13 juin 2002 à 12 heures dans des locaux spécialement aménagés à cet effet au tribunal de grande instance de Créteil, dans l’attente de sa comparution devant le juge d’instruction.
47. La Cour ne peut que constater, comme elle l’a fait dans l’affaire Zervudacki précitée, qu’aucun texte du droit interne ne réglementait à cette époque la détention d’une personne entre le moment de la fin de sa garde à vue et celui de sa présentation devant le juge d’instruction.
48. La Cour estime dès lors, qu’en l’espèce, la privation de liberté qu’a subie le requérant, du 12 juin 2002 à 21 heures au 13 juin 2002 à 12 heures, n’avait pas de base légale en droit interne et a donc enfreint l’article 5 § 1 c) de la Convention.
ARRÊT GRANDE CHAMBRE
MEDVEDYEV ET AUTRES C. FRANCE 29 MARS 2010 3394/03
Un individu arrêté doit être conduit avec promptitude devant un magistrat indépendant
117. La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l'importante série de justifications prévues par d'autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l'accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).
118. La Cour rappelle également l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).
119. L'article 5 § 3, en tant qu'il s'inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).
120. Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l'espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :
i. Promptitude
121. Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes).
ii. Caractère automatique du contrôle
122. Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d'une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l'article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu'une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l'impossibilité de saisir le juge d'une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d'autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d'une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).
iii. Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat
123. Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).
124. Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l'affaire Schiesser précitée (§ 31) :
« (...) [A] cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).
125. Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération (McKay précité, § 40).
126. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (Brogan et autres, précité, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, et Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 78), mais cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste (Öcalan, précité, § 104). Le même constat s'impose s'agissant de la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer, dont la Cour a rappelé l'importance (paragraphe 81 ci-dessus) et qui pose également à n'en pas douter des problèmes particuliers.
2. Application de ces principes
127. La Cour relève que l'arrestation et la détention des requérants ont débuté avec l'interception du navire en haute mer le 13 juin 2002. Les requérants n'ont été placés en garde à vue que le 26 juin 2002, après leur arrivée à Brest. Devant la Grande Chambre, et pour la première fois durant la procédure, ce que la Cour ne peut que regretter, le Gouvernement a apporté des informations étayées sur la présentation des requérants, le jour même, à des juges d'instruction chargés de l'affaire (paragraphe 19 ci-dessus).
128. Reste que cette présentation aux juges d'instruction, lesquels sont assurément susceptibles d'être qualifiés de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, n'est intervenue que treize jours après leur arrestation.
129. Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, précité, § 62). Elle a également jugé contraire à l'article 5 § 3 une période de sept jours avant d'être traduit devant un juge (Öcalan, précité, §§ 104-105).
130. La Cour rappelle cependant qu'elle a déjà admis, dans sa décision Rigopoulos (précitée), qui concernait l'interception en haute mer par la police des douanes espagnoles, dans le cadre d'une enquête judiciaire portant sur un trafic international de stupéfiants, d'un navire battant pavillon panaméen, et la détention de son équipage le temps de son convoiement vers un port espagnol, qu'un délai de seize jours n'était pas incompatible avec la notion d'« aussitôt traduit » énoncée à l'article 5 § 3 de la Convention, compte tenu de l'existence de « circonstances tout à fait exceptionnelles » qui justifiaient un tel délai. Dans sa décision la Cour a relevé que la distance à parcourir était « considérable » (le navire se trouvait à 5 500 km du territoire espagnol au moment de son interception) et qu'un retard de quarante-trois heures, qui avait été provoqué par des actes de résistance de membres de l'équipage, ne « saurait être imputable aux autorités espagnoles ». Elle en a déduit qu'il existait « une impossibilité matérielle d'amener physiquement le requérant devant le juge d'instruction dans un délai plus court », tout en prenant en compte le fait qu'à son arrivée sur le sol espagnol, le requérant avait immédiatement été transféré à Madrid par avion et, dès le lendemain, traduit devant l'autorité judiciaire. Enfin, elle a jugé « peu réaliste » la possibilité évoquée par le requérant que, plutôt que d'être convoyé vers l'Espagne, le navire fût dérouté vers l'île britannique de l'Ascension, en raison de l'accord souscrit entre l'Espagne et le Royaume-Uni tendant à la répression du trafic illicite de stupéfiants, celle-ci se trouvant à environ 1 600 km du lieu de l'interception.
131. En l'espèce, la Cour relève qu'au moment de son interception, le Winner se trouvait lui aussi en haute mer, au large des îles du Cap Vert et donc loin des côtes françaises, à une distance de celles-ci du même ordre que celle dont il était question dans l'affaire Rigopoulos. Par ailleurs, rien n'indique que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu notamment des conditions météorologiques et de l'état de délabrement avancé du Winner qui rendaient impossible une navigation plus rapide. En outre, les requérants ne prétendent pas qu'il était envisageable de les remettre aux autorités d'un pays plus proche que la France, où ils auraient pu être rapidement traduits devant une autorité judiciaire. Quant à l'hypothèse d'un transfert sur un navire de la Marine nationale pour un rapatriement plus rapide, il n'appartient pas à la Cour d'évaluer la faisabilité d'une telle opération dans les circonstances de la cause.
132. La Cour note enfin que les requérants ont été placés en garde à vue le 26 juin 2002 à 8 h 45 et que leur présentation effective à un juge d'instruction dans les locaux du commissariat de Brest s'est déroulée, au vu des procès-verbaux produits par le Gouvernement, de 17 h 05 à 17 h 45 pour le premier juge d'instruction, et à des heures inconnues s'agissant du second juge d'instruction (paragraphe 19 ci-dessus), mais étant entendu qu'il n'est pas contesté par les requérants que les auditions par ce dernier ont été concomitantes. En conséquence, la durée de la garde à vue des requérants avant leur traduction devant un juge n'a été que d'environ huit à neuf heures après leur arrivée en France.
133. Force est de constater que cette période de huit à neuf heures était compatible avec la notion d'«aussitôt traduit » énoncée à l'article 5 § 3 de la Convention et la jurisprudence de la Cour.
134. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3.
LA PRÉSENCE D'UN AVOCAT EN GARDE A VUE
Les arrêts de la CEDH sont dans l'ordre chronologique inversé du plus récent au plus ancien
Tonkov c. Belgique du 8 mars 2022 requête n o 41115/14
6§1 et 6§3 Les restrictions d’accès à un avocat au stade initial de la procédure pénale ont violé le droit à un procès équitable du requérant
Dans cette affaire, M. Tonkov se plaint d’avoir été privé de son droit d’accès à un avocat au stade initial de l’enquête pénale, en particulier pendant sa garde à vue ainsi que lors des auditions, des interrogatoires et des autres actes de l’instruction. Au terme de la procédure pénale, il fut condamné à la perpétuité. Rappelant le caractère très strict du contrôle auquel elle doit procéder en l’absence de raisons impérieuses justifiant la restriction du droit d’accès à un avocat en matière pénale, et à l’instar de l’arrêt de la Grande Chambre dans Beuze c. Belgique2 , la Cour estime qu’en l’espèce la procédure pénale n’a pas été équitable dans son ensemble. Elle tient compte de ce que la cour d’assises n’a pas examiné les arguments de M. Tonkov au sujet de l’incidence de l’absence d’un avocat sur la qualité des dépositions faites par le co-accusé, alors que la condamnation du requérant repose de façon déterminante sur celles-ci. La Cour juge aussi que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Tonkov.
Art 6 § 1 (pénal) (+ Art 6 § 3 c) • Procès équitable • Condamnation du requérant reposant sur le contenu de ses déclarations et celles de son co‑accusé réalisées dès le stade initial de l’enquête sans la présence d’un avocat • Portée générale et obligatoire des restrictions au droit d’accès à un avocat découlant de la loi applicable et de son interprétation par les tribunaux
FAITS
Le requérant, M. Tonislav Tonkov, est un ressortissant bulgare, né en 1983. Il est actuellement détenu à la prison de Hasselt (Belgique) où il purge une peine de prison à perpétuité. M. Tonkov fut entendu à deux reprises en 2009 par la police belge en qualité de « source » dans le cadre d’une enquête pour le meurtre d’un certain B.V., survenu le soir du 14 septembre 2009. Il fut une nouvelle fois auditionné le 20 janvier 2010 en qualité de « suspect ». Puis, entretemps, il retourna en Bulgarie où il fut arrêté et extradé vers la Belgique. Dès son arrivée, le 18 août 2010, M. Tonkov fut interrogé par la police en qualité de suspect du meurtre de B.V. puis entendu par le juge d’instruction. Le mandat d’arrêt lui fut signifié à la fin de cet interrogatoire. Les procès-verbaux établis ce jour-là précisent que M. Tonkov a fait part de son souhait d’être assisté par un avocat en vue d’être éclairé sur le droit belge et de lui permettre de faire part de sa version des faits. À cette occasion, il apparut que M. Tonkov connaissait N.I., qui avait également été arrêté et interrogé, et que les enquêteurs présentèrent comme étant suspecté d’avoir exécuté le meurtre.
En septembre et octobre 2010, M. Tonkov fut à nouveau entendu à plusieurs reprises. En outre, un test polygraphique fut organisé le 25 novembre 2010, suivi, le 8 décembre 2010, par une audition par la police au cours de laquelle il y eut un contact téléphonique entre les enquêteurs et l’avocat de M. Tonkov qui demanda que son client soit informé de son droit à garder le silence. M. Tonkov ne répondit ensuite à aucune question posée par les enquêteurs. Une autre audition fut menée le 21 décembre 2010 dont le procès-verbal précise que M. Tonkov avait préalablement consulté son avocat. Plusieurs auditions furent réalisées en 2011 et un interrogatoire récapitulatif fut organisé. Conformément au droit interne en vigueur à l’époque des faits, M. Tonkov ne fut pas assisté d’un avocat durant ces auditions et interrogatoires, à l’exception de l’interrogatoire récapitulatif, ni pendant le test polygraphique. Par la suite, M. Tonkov fut renvoyé, avec un co-accusé, devant la cour d’assises de Flandre orientale. Le 21 mai 2013, à l’ouverture du procès, M. Tonkov fit valoir, entre autres, une atteinte irrémédiable au droit de la défense et à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention au motif qu’il n’avait pas été assisté d’un avocat durant les auditions et interrogatoires menés au cours de l’instruction et que des déclarations avaient été obtenues à charge auprès du co-accusé et de témoins qui n’avaient pas non plus bénéficié de l’assistance d’un avocat. La cour d’assises rejeta cette demande. Finalement, le 30 mai 2013, le jury déclara M. Tonkov et le co-accusé coupables notamment d’homicide volontaire avec préméditation et intention de donner la mort. En ce qui concerne M. Tonkov, les motifs du jury étaient fondés, entre autres, sur les déclarations détaillées et maintenues du co-accusé selon lesquelles il avait tué B.V. à coups de couteau sur les instructions expresses de M. Tonkov. Le 26 novembre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. Tonkov.
Article 6 §§ 1 et 3 c) : droit à un procès équitable / droit à l’assistance d’un avocat
La Cour constate que lors des deux premières auditions, le requérant a été entendu comme « source » et qu’il n’a été auditionné formellement comme « suspect » qu’au cours de la troisième. Le requérant n’a pas bénéficié de la présence d’un avocat au cours de ces trois auditions, alors même que ses déclarations se sont avérées déterminantes pour la suite de l’enquête. En réalité, aux yeux de la Cour, le requérant avait acquis, dès ce stade initial de l’enquête, la qualité d’accusé entraînant l’application des garanties de l’article 6 de la Convention. Au total, entre sa remise aux autorités belges et l’arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand du 26 avril 2012, le requérant a été entendu à une dizaine de reprises par la police et par le juge d’instruction au sujet des faits pour lesquels il a été condamné, sans la présence de son avocat. Ce dernier n’a pas non plus participé au test polygraphique. Ainsi, le requérant, qui pouvait prétendre à la protection de l’article 6 de la Convention dès le stade initial de l’enquête, n’a pas bénéficié du droit d’accès à un avocat alors même qu’il était « accusé », et ce droit a été ensuite restreint tout au long de la phase d’instruction. À cet égard, la Cour observe que les restrictions litigieuses ne reposaient pas sur des raisons impérieuses. Elle rappelle que, dans ce cas, il lui revient d’examiner soigneusement si la procédure pénale menée à l’égard du requérant, considérée dans son ensemble, a permis de remédier aux lacunes survenues au stade préliminaire de la procédure. Elle note, à cet effet, notamment ce qui suit.
En ce qui concerne le dispositif légale encadrant la procédure antérieure à la phase de jugement, la Cour rappelle que dès lors que le droit belge tel qu’appliqué à l’époque n’était pas compatible avec les exigences de l’article 6 § 3 de la Convention3 , ce ne sont pas des dispositions légales prévoyant in abstracto certaines garanties qui auraient pu assurer, à elles seules, l’équité globale de la procédure. Encore faut-il que leur application ait un effet compensatoire rendant la procédure équitable dans son ensemble. Elle note à cet égard que la libre communication avec l’avocat en dehors des auditions et interrogatoires n’était pas suffisante pour porter remède au défaut survenu au stade initial de l’enquête. Elle relève que le Gouvernement se fonde sur d’autres garanties dont le requérant a pu bénéficier ; toutefois, s’il est vrai que ces garanties ont permis au requérant de bénéficier, pendant la phase d’instruction, de certaines interventions propres au conseil, la Cour estime que celles-ci n’ont pas eu un effet compensateur suffisant. Dès lors, l’application d’autres garanties – dont le requérant a bénéficié en vertu du dispositif légal à l’époque des faits – ne suffisait pas à rendre la procédure équitable.
En ce qui concerne la nature des dépositions faites par le requérant en l’absence d’avocat, la Cour note que si les déclarations faites par le requérant au cours des auditions et interrogatoires litigieux sans l’assistance d’un avocat ne comportaient pas d’aveux à strictement parler, il s’agissait de déclarations circonstanciées qui ont influé de manière déterminante sur la suite de la procédure. De plus, et même si le droit en vigueur à l’époque prévoyait que l’intéressé devait donner son consentement pour y être soumis, le requérant a fourni des réponses, à l’occasion du test polygraphique, qui ont été considérées comme mensongères et retenues à sa charge. Lors de la clôture de l’instruction et du renvoi du requérant devant la cour d’assises, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles ne s’est pas penchée, le cas échéant d’office, sur les irrégularités procédurales en cause en l’espèce. Par conséquent, l’intégralité des procès-verbaux contenant les dépositions litigieuses faites par le requérant sans l’assistance d’un avocat sont restés au dossier pénal
Ensuite, si le requérant a déposé, devant la cour d’assises, des conclusions par lesquelles il sollicitait que les procès-verbaux des auditions et des interrogatoires menés sans l’assistance d’un avocat soient écartés et les poursuites déclarées irrecevables, la cour d’assises a rejeté cette demande et a admis l’ensemble des procès-verbaux, considérant que le requérant pourrait encore jouir d’un procès équitable devant le jury. La cour d’assises a concentré son examen sur le fait que les interrogatoires et auditions n’avaient pas été coercitifs ni oppressifs et sur la circonstance que le requérant n’avait pas fait de déclarations pouvant être retenues à sa charge. Toutefois, l’affirmation par la cour d’assises selon laquelle le requérant n’aurait rien dit de nature à être retenu à sa charge est contredite par l’acte d’accusation dont il ressort que les déclarations faites par le requérant dès le stade initial de l’enquête et les résultats du test polygraphique ont fourni aux enquêteurs une trame qui a inspiré l’accusation. Dès lors, les juridictions belges n’ont pas procédé à une analyse suffisante de l’incidence de l’absence d’un avocat sur la recevabilité des dépositions du requérant.
En ce qui concerne l’admissibilité des dépositions faites par le co-accusé en l’absence d’un avocat, la Cour relève que le requérant ne s’est pas contenté de se plaindre que les déclarations l’incriminant ont été faites par le co-accusé sans la présence d’un avocat et sans consultation préalable. Il a précisément mis en cause les conditions dans lesquelles les auditions du co-accusé se sont déroulées en soutenant que la fiabilité des déclarations l’incriminant pouvait avoir été compromise du fait que le co-accusé avait pu céder aux pressions des enquêteurs et avoir trouvé un intérêt à témoigner contre le requérant comme il l’a fait. Cependant, dans son arrêt avant dire-droit, la cour d’assises n’a pas examiné les arguments soulevés par le requérant au sujet de l’incidence de l’absence d’un avocat sur la qualité des dépositions faites par le co-accusé, alors que la condamnation du requérant repose de façon déterminante sur celles-ci. La Cour précise qu’il appartient aux juridictions internes de s’assurer notamment que ces déclarations ne résultent pas de pressions ni d’actes contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour note à cet égard que, postérieurement à la présente affaire, la Cour de cassation a considéré qu’un prévenu pouvait invoquer la méconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat concernant des déclarations incriminantes faites par un coprévenu, lorsqu’il est porté atteinte à la fiabilité de ces déclarations et que son usage violerait les droits de la défense du prévenu mis en cause, dès lors que ces déclarations ont été obtenues au moyen de pression, contrainte ou torture.
En ce qui concerne l’utilisation des dépositions faites par le requérant en l’absence d’un avocat, la Cour observe tout d’abord que si l’acte d’accusation, dont la lecture est intervenue au début du procès devant la cour d’assises, s’est appuyé sur divers éléments, à savoir les déclarations des témoins, les constatations des enquêteurs et les enregistrements téléphoniques, il s’est également fondé sur les déclarations du requérant faites en l’absence d’un avocat. Elle relève ensuite que, pour déclarer le requérant coupable du meurtre en tant que commanditaire, le jury s’est référé à des éléments qui n’ont pu être mis en concordance que sur la base de l’ensemble des déclarations recueillies auprès du requérant, du co-accusé et des personnes entendues en tant que « témoins ». S’il apparaît certes que ce sont les déclarations faites par le coaccusé et incriminant le requérant qui ont pesé d’un poids prépondérant dans le verdict, cela ne suffit pas, de l’avis de la Cour, à occulter le fait que les déclarations faites par le requérant sans l’assistance d’un avocat ont occupé une place importante dans la motivation des jurés.
En conclusion, rappelant le caractère très strict du contrôle auquel elle doit procéder en l’absence de raisons impérieuses justifiant la restriction du droit d’accès à un avocat en matière pénale, la Cour estime, compte tenu de la conjonction des différents facteurs précités, que la procédure pénale menée à l’égard du requérant n’a pas été équitable dans son ensemble. Il y a donc eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
CEDH
37. Un résumé de l’évolution de la jurisprudence de la Cour relative au droit à l’assistance d’un avocat durant la phase préalable au procès pénal depuis l’arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, CEDH 2008) et des principes généraux applicables à ce jour, figure dans l’arrêt Beuze c. Belgique ([GC], no 71409/10, §§ 119-150, 9 novembre 2018 ; voir également, plus récemment, Doyle c. Irlande, no 51979/17, §§ 67-78, 23 mai 2019).
38. Ces principes généraux ont été appliqués dans l’arrêt Beuze aux restrictions au droit d’accès à un avocat en vigueur en Belgique à l’époque des faits. La Cour souligne toutefois qu’à la différence de cette dernière affaire, l’ensemble de la procédure concernant le requérant s’est déroulé après le prononcé de l’arrêt Salduz dans lequel la Cour posa, en règle, le droit d’accès à un avocat dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police.
39. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le test applicable pour évaluer la conformité à l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention comporte plusieurs étapes. Après avoir déterminé la nature et l’ampleur des restrictions, la Cour va rechercher s’il existait ou non des raisons impérieuses justifiant les restrictions du droit d’accès à un avocat, puis examiner l’équité globale de la procédure (Beuze, précité, §§ 138 et 141).
a) Existence et ampleur des restrictions
40. La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que les restrictions en vigueur à l’époque étaient d’une ampleur particulière et que, résultant du silence de la loi belge et de l’interprétation qui en avait été faite par les juridictions internes, elles avaient une portée générale et obligatoire (Beuze, précité, §§ 160-165).
41. Le Gouvernement fait valoir qu’en l’espèce, avant son arrestation et son voyage en Bulgarie, le requérant avait été auditionné à trois reprises par la police et qu’il pouvait dès ce moment contacter un avocat pour préparer sa défense.
42. La Cour constate que lors des deux premières auditions, le requérant a été entendu comme « source » et qu’il n’a été auditionné formellement comme « suspect » qu’au cours de la troisième. En tout état de cause, quand bien même le requérant aurait pu se douter à ce stade que les autorités avaient des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir participé au crime, et donc prendre l’initiative de s’adresser à un avocat, force est de constater qu’il n’a pas bénéficié de la présence d’un avocat au cours de ces trois auditions, alors même que ses déclarations se sont avérées déterminantes pour la suite de l’enquête (paragraphes 58 et 69 ci‑dessous). En réalité, aux yeux de la Cour, le requérant avait acquis, dès ce stade initial de l’enquête, la qualité d’« accusé » entraînant l’application des garanties de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Truten c. Ukraine, no 18041/08, § 66, 23 juin 2016, et Knox c. Italie, no 76577/13, § 152, 24 janvier 2019). L’information apportée au dossier par le requérant, et non contredite par le Gouvernement, selon laquelle le magistrat instructeur avait, dès le lendemain du meurtre, recherché le nom du requérant dans le registre des condamnations conforte, au besoin, ce constat.
43. La Cour relève ensuite que le requérant ne s’est vu reconnaître le droit de consulter un avocat, conformément à l’article 20 de la loi sur la détention préventive, qu’une fois la décision de le placer en détention préventive prise par le juge d’instruction à la fin du premier interrogatoire (voir, mutatis mutandis, Beuze, précité, § 155). Le requérant indique qu’il a été effectivement en contact avec l’avocat de son choix pour la préparation de sa défense à la fin du mois de septembre 2010.
44. Indépendamment de ce qui précède, la Cour note qu’au total, entre sa remise aux autorités belges et l’arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand du 26 avril 2012, le requérant a été entendu à une dizaine de reprises par la police et par le juge d’instruction au sujet des faits pour lesquels il a été condamné, sans la présence de son avocat. Ce dernier n’a pas non plus participé au test polygraphique.
45. Selon le Gouvernement, il conviendrait de tenir compte du contact téléphonique avec l’avocat du requérant durant l’audition qui a suivi le test polygraphique (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour estime toutefois que ce contact, intervenu après que le requérant eut été arrêté, auditionné et interrogé à plusieurs reprises mais aussi après qu’il ait été soumis au test polygraphique, n’est pas de nature à relativiser l’ampleur des restrictions préalablement subies. Il en est de même de la présence de l’avocat du requérant durant l’interrogatoire récapitulatif (paragraphe 9 ci-dessus ; voir dans le même sens, Brus, précité, § 31).
46. Eu égard à ce qui précède, la Cour constate que le requérant, qui pouvait prétendre à la protection de l’article 6 de la Convention dès le stade initial de l’enquête, n’a pas bénéficié du droit d’accès à un avocat alors même qu’il était « accusé » au sens de cette disposition, et que ce droit a été ensuite restreint tout au long de la phase d’instruction.
b) Existence de raisons impérieuses
47. La Cour relève que le Gouvernement n’a pas davantage que dans l’affaire Beuze établi l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier les restrictions litigieuses. Par conséquent, la Cour considère que celles-ci ne reposaient pas sur des raisons impérieuses.
c) Respect de l’équité globale de la procédure
48. En l’absence de raisons impérieuses justifiant les restrictions litigieuses, la Cour doit évaluer l’équité de la procédure en opérant un contrôle très strict. Ce contrôle doit être d’autant plus strict que ces restrictions découlaient de la loi applicable à l’époque et revêtaient par conséquent un caractère général et obligatoire. La charge de la preuve visant à démontrer de manière convaincante que le requérant a néanmoins bénéficié globalement d’un procès pénal équitable pèse sur le Gouvernement (Beuze, précité, §§ 160-165).
49. Lorsqu’elle est ainsi amenée à apprécier l’équité globale de la procédure, la Cour rappelle qu’elle ne s’érige pas en juge de quatrième instance (idem, § 193, et Brus, précité, § 36). Il lui revient d’examiner soigneusement si la procédure pénale menée à l’égard du requérant, considérée dans son ensemble, a permis de remédier aux lacunes survenues au stade préliminaire de la procédure. Dans cet exercice, elle examinera, dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, les différents facteurs découlant de sa jurisprudence (Beuze, précité, § 150).
La vulnérabilité alléguée du requérant
50. Le requérant fait valoir qu’il était vulnérable puisqu’étant de nationalité bulgare, il a été interrogé en néerlandais avec l’assistance d’un interprète et n’avait pas connaissance du droit belge.
51. La Cour note que le requérant était un adulte et était établi depuis plusieurs années en Belgique avant son arrestation. S’il est attesté qu’il ne parlait pas le néerlandais, langue de la procédure, le requérant a pu s’exprimer en bulgare et a bénéficié des services d’une interprète chaque fois qu’il a été entendu. Au surplus, le requérant n’établit pas qu’il aurait eu des difficultés à s’exprimer et, plus largement, à exercer ses droits de la défense en raison de la langue.
52. Dans ces circonstances, le Cour ne peut considérer que le requérant était dans une situation de vulnérabilité particulière le distinguant d’autres inculpés (voir, a contrario, Knox, précité, §§ 160 et 184).
53. La Cour rappelle que dès lors que le droit belge tel qu’appliqué à l’époque n’était pas compatible avec les exigences de l’article 6 § 3 de la Convention (Beuze, précité, § 171), ce ne sont pas des dispositions légales prévoyant in abstracto certaines garanties qui auraient pu assurer, à elles seules, l’équité globale de la procédure. Encore faut-il que leur application ait eu un effet compensatoire rendant la procédure équitable dans son ensemble (Beuze, précité, § 171, et plus récemment Olivieri c. France, no 62313/12, § 36, 11 juillet 2019).
54. Comme il l’avait déjà fait valoir dans l’affaire Beuze précitée (§ 170), le Gouvernement observe que le requérant a eu le droit de communiquer librement avec son avocat dès l’issue du premier interrogatoire avec le juge d’instruction. La Cour relève toutefois que le Gouvernement, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas que l’avocat du requérant aurait été prévenu, avant l’audition du 21 décembre 2010 (paragraphe 10 ci-dessus), des dates des auditions et des interrogatoires, en sorte que le requérant aurait pu préparer à l’avance, avec son avocat, ses auditions et interrogatoires. Dans ces conditions, la libre communication avec l’avocat en dehors des auditions et interrogatoires n’était pas suffisante pour porter remède au défaut survenu au stade initial de l’enquête (voir, mutatis mutandis, Beuze, précité, § 171).
55. Le Gouvernement s’appuie en outre sur d’autres garanties dont le requérant a pu bénéficier en l’espèce, à savoir : la possibilité de contacter un avocat au stade initial de l’enquête, la présence de l’avocat du requérant lors de l’interrogatoire récapitulatif, et le contact téléphonique à l’occasion de l’audition qui a suivi le test polygraphique. S’il est vrai que ces garanties ont permis au requérant de bénéficier, pendant la phase d’instruction, de certaines interventions propres au conseil, la Cour estime pour les raisons déjà indiquées ci-dessus (paragraphes 42 et 45 ci-dessus) que ces garanties n’ont pas eu un effet compensateur suffisant.
56. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’application des garanties dont le requérant a bénéficié en vertu du dispositif légal à l’époque des faits ne suffisait pas à rendre la procédure équitable.
La nature des dépositions faites par le requérant en l’absence d’un avocat
57. La Cour constate que si les déclarations faites par le requérant au cours des auditions et interrogatoires litigieux sans l’assistance d’un avocat ne comportaient pas d’aveux à strictement parler, il s’agissait de déclarations circonstanciées qui ont influé de manière déterminante sur la suite de la procédure.
58. La Cour note en effet que, dès la phase initiale de l’enquête, le requérant a longuement parlé de sa relation avec la victime et de ce qu’il savait des faits (paragraphe 5 ci-dessus). Lorsqu’il a été entendu le jour de son arrestation, le requérant s’est à nouveau livré de façon détaillée aux enquêteurs y compris sur ses problèmes financiers, ce qui a été retenu plus tard comme mobile du crime et a pesé dans sa condamnation (paragraphes 7‑8 et 19 ci-dessus). Il a également tenu des propos de nature à éveiller des soupçons sur sa réelle implication dans le déroulement des faits (paragraphe 7 ci-dessus). De plus, et même si le droit en vigueur à l’époque prévoyait que l’intéressé devait donner son consentement pour y être soumis, le requérant a fourni des réponses, à l’occasion du test polygraphique, qui ont été considérées comme mensongères et retenues à sa charge (paragraphe 9 ci‑dessus).
L’admissibilité des dépositions faites par le requérant en l’absence d’un avocat
59. La Cour rappelle que, conformément au principe de subsidiarité qui fonde la Convention, il appartient aux juridictions nationales de donner plein effet aux exigences de l’article 6 de la Convention, telles qu’interprétées par la Cour. Le juge interne a en effet la responsabilité de veiller au respect du droit à un procès équitable de ceux qui comparaissent devant lui et, en particulier, de s’assurer que l’équité de la procédure n’est pas compromise par les conditions dans lesquelles les éléments sur lesquels il se fonde ont été recueillis (El-Haski c. Belgique, no 649/08, § 89, 25 septembre 2012).
60. À cet égard, la Cour relève tout d’abord, que lors de la clôture de l’instruction et du renvoi du requérant devant la cour d’assises, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles ne s’est pas penchée, le cas échéant d’office, sur les irrégularités procédurales en cause dans la présente affaire (paragraphes 13 et 23 ci-dessus). Par conséquent, l’intégralité des procès-verbaux contenant les dépositions litigieuses faites par le requérant sans l’assistance d’un avocat sont restés au dossier pénal.
61. Ensuite, si le requérant a déposé, devant la cour d’assises, des conclusions par lesquelles il sollicitait, sur pied de la jurisprudence Salduz, que les procès-verbaux des auditions et des interrogatoires menés sans l’assistance d’un avocat soient écartés et les poursuites déclarées irrecevables, la cour d’assises a rejeté cette demande et a admis l’ensemble des procès‑verbaux, considérant que le requérant pourrait encore jouir d’un procès équitable devant le jury (paragraphe 15 ci-dessus).
62. S’il est vrai que la cour d’assises a examiné précisément chacun des procès-verbaux, elle a concentré son examen sur le fait que les interrogatoires et auditions n’avaient pas été coercitifs ni oppressifs et sur la circonstance que le requérant n’avait pas fait de déclarations pouvant être retenues à sa charge (paragraphes 15-16 ci-dessus). La cour d’assises n’a ainsi tiré aucune conclusion de son constat selon lequel le requérant n’a fait usage de son droit à garder le silence qu’après le contact téléphonique avec son avocat (paragraphe 15 ci‑dessus). Par ailleurs, l’affirmation par la cour d’assises selon laquelle le requérant n’aurait rien dit de nature à être retenu à sa charge est contredite par l’acte d’accusation dont il ressort que les déclarations faites par le requérant dès le stade initial de l’enquête et les résultats du test polygraphique ont fourni aux enquêteurs une trame qui a inspiré l’accusation (paragraphe 58 ci-dessus).
63. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les juridictions belges n’ont pas procédé à une analyse suffisante de l’incidence de l’absence d’un avocat sur la recevabilité des dépositions du requérant.
L’admissibilité des dépositions faites par le co-accusé en l’absence d’un avocat
64. Le requérant se plaint ensuite de ce que la cour d’assises a admis aux débats les déclarations l’incriminant faites par le co-accusé. Le Gouvernement se réfère à l’arrêt avant dire droit de la cour d’assises dans lequel celle-ci a rappelé que le droit à l’assistance d’un avocat était lié à des droits valant à titre personnel et qu’en l’espèce le co-accusé n’avait pas invoqué la méconnaissance de son droit à l’assistance d’un avocat ni retiré ses déclarations (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour de cassation a confirmé cette approche qui était conforme à sa jurisprudence (paragraphes 21 et 24 ci‑dessus).
65. La Cour rappelle sa juriprudence bien établie selon laquelle l’équité de la procédure se mesure non seulement à l’aune de la possibilité pour le requérant de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation, mais également en tenant compte de la qualité des preuves, notamment du point de savoir si les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues font douter de leur fiabilité ou de leur exactitude (voir, parmi d’autres, Erkapić c. Croatie, no 51198/08, § 72, 25 avril 2013). À cet égard, elle a déjà considéré que l’utilisation de preuves obtenues par un comportement contraire à l’article 6 § 1 (comme l’incitation) n’est pas nécessairement contraire aux exigences d’équité garanties par l’article 6 § 1 (voir, par exemple, Matanović c. Croatie, no 2742/12, 4 avril 2017). Il en est de même de la non-assistance d’un avocat durant les interrogatoires menés à l’endroit de co-accusés (Stephens c. Malte (no 3), no 35989/14, 14 janvier 2020).
66. Encore faut-il pour retenir l’élément de preuve litigieux que le juge interne ait préalablement examiné les arguments de l’« accusé » et se soit convaincu que, nonobstant ces arguments, un tel doute n’existe pas. Cela découle de sa responsabilité de veiller au respect du droit à un procès équitable rappelée ci-dessus (paragraphe 59 ci-dessus, et El-Haski, précité, § 89).
67. La Cour relève qu’en l’espèce le requérant ne s’est pas contenté de se plaindre que les déclarations l’incriminant ont été faites par le co-accusé sans la présence d’un avocat et sans consultation préalable. Il a précisément mis en cause les conditions dans lesquelles les auditions du co-accusé se sont déroulées en soutenant que la fiabilité des déclarations l’incriminant pouvait avoir été compromise du fait que le co-accusé avait pu céder aux pressions des enquêteurs et avoir trouvé un intérêt à témoigner contre le requérant comme il l’a fait. Cependant, dans son arrêt avant dire-droit (paragraphes 15‑16 ci-dessus), la cour d’assises n’a pas examiné les arguments soulevés par le requérant au sujet de l’incidence de l’absence d’un avocat sur la qualité des dépositions faites par le co-accusé (voir, a contrario, Stephens, précité, §§ 76-77), alors que la condamnation du requérant repose de façon déterminante sur celles-ci (paragraphe 70 ci‑dessous).
68. À l’estime de la Cour, l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ne peut être interprété comme impliquant l’exclusion automatique de déclarations incriminantes faites par un tiers sans l’assistance d’un avocat. Cependant, une prudence toute particulière s’impose à l’égard de telles déclarations. Il appartient en effet aux juridictions internes de s’assurer notamment que ces déclarations ne résultent pas de pressions (Stephens, précité, § 76) ni d’actes contraires à l’article 3 de la Convention (El Haski, précité, § 85, Kormev c. Bulgarie, no 39014/12, §§ 89-90, 5 octobre 2017). La Cour note à cet égard que, postérieurement à la présente affaire, la Cour de cassation a considéré qu’un prévenu pouvait invoquer la méconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat concernant des déclarations incriminantes faites par un co‑prévenu, lorsqu’il est porté atteinte à la fiabilité de ces déclarations et que son usage violerait les droits de la défense du prévenu mis en cause, dès lors que ces déclarations ont été obtenues au moyen de pression, contrainte ou torture (paragraphe 24 ci-dessus).
L’utilisation des dépositions faites par le requérant en l’absence d’un avocat
69. La Cour observe tout d’abord que si l’acte d’accusation, dont la lecture est intervenue au début du procès devant la cour d’assises, s’est appuyé sur divers éléments, à savoir les déclarations des témoins, les constatations des enquêteurs et les enregistrements téléphoniques, il s’est également fondé sur les déclarations du requérant faites en l’absence d’un avocat (voir, mutatis mutandis, Beuze, précité, § 184).
70. La Cour relève ensuite que, pour déclarer le requérant coupable du meurtre en tant que commanditaire (paragraphe 18 ci-dessus), le jury s’est référé à des éléments qui n’ont pu être mis en concordance que sur la base de l’ensemble des déclarations recueillies auprès du requérant, du co-accusé et des personnes entendues en tant que « témoins ». S’il apparaît certes que ce sont les déclarations faites par le co-accusé et incriminant le requérant qui ont pesé d’un poids prépondérant dans le verdict, cela ne suffit pas, de l’avis de la Cour, à occulter le fait que les déclarations faites par le requérant sans l’assistance d’un avocat ont occupé une place importante dans la motivation des jurés (voir, mutatis mutandis, Beuze, précité, § 185).
71. Rappelant le caractère très strict du contrôle auquel elle doit procéder en l’absence de raisons impérieuses justifiant la restriction du droit d’accès à un avocat en matière pénale (paragraphe 48 ci-dessus), la Cour estime, compte tenu de la conjonction des différents facteurs précités, que la procédure pénale menée à l’égard du requérant n’a pas été équitable dans son ensemble.
72. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
Akdağ c. Turquie du 17 septembre 2019 requête n° 75460/10
Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable / droit d’accès à un avocat) : les autorités turques n’ont pas démontré que la requérante avait valablement renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue.
L’affaire concernait le droit d’accès à un avocat pendant une garde à vue. La requérante alléguait qu’elle avait avoué être membre d’une organisation illégale après avoir été menacée et maltraitée par la police, sans avoir eu accès à un avocat. Faute de preuves des mauvais traitements subis, la Cour déclare irrecevable le grief tiré par la requérante de sa condamnation sur la base de déclarations qu’elle disait avoir faites à la police sous la contrainte. La Cour conclut toutefois que le Gouvernement n’a pas démontré qu’un « X » imprimé à côté de la mention « n’a pas demandé d’avocat » sur le formulaire de déposition de l’intéressée pouvait s’analyser en une renonciation valable de celle-ci à son droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue. Dès qu’elle a eu accès à un avocat au terme de sa garde à vue, la requérante est de fait revenue sur ses déclarations. La Cour n’est pas non plus convaincue par la réponse des juridictions nationales au grief de la requérante. Celles-ci n’ont pas examiné la validité de la renonciation alléguée ou des déclarations faites par l’intéressée à la police en l’absence d’un avocat. Aucune autre garantie procédurale n’a compensé l’absence de contrôle constatée. L’équité globale de la procédure n’a donc pas été assurée.
LES FAITS
La requérante, Hamdiye Akdağ, est une ressortissante turque née en 1974. Au moment du dépôt de sa requête devant la Cour européenne, elle purgeait une peine de prison pour appartenance à une organisation illégale, le PKK/KADEK (le Parti des travailleurs du Kurdistan). Mme Akdağ fut arrêtée près de son domicile en novembre 2003 et maintenue en garde à vue pendant quatre jours aux fins d’être interrogée par la police. Pendant cette période, elle reconnut appartenir au PKK/KADEK et fit une description détaillée de ses activités et de sa formation au sein de cette organisation illégale. Elle ne bénéficia pas de l’assistance d’un avocat, la mention « n’a pas demandé d’avocat » étant cochée à l’aide d’un « X » imprimé sur son formulaire de déposition. Lorsque, à la fin de sa garde à vue, elle fut présentée à un procureur et à un juge d’instruction et qu’elle eut accès à un avocat, Mme Akdağ revint toutefois immédiatement sur les déclarations qu’elle avait faites à la police. Elle fut également examinée par un médecin auquel elle relata que la police l’avait frappée sur la tête et l’avait menacée de la violer et de la tuer.
Elle maintint ses déclarations devant le tribunal de jugement, alléguant qu’elle avait signé sa déposition à la police sous la contrainte et que de toute façon, elle était analphabète. En 2009, elle fut finalement reconnue coupable d’appartenance à une organisation terroriste et condamnée à six ans et trois mois d’emprisonnement. Cette décision fut prise sur la base de sa déposition à la police. En 2010, la Cour de cassation confirma sa condamnation. Dans l’intervalle, Mme Akdağ avait officiellement déposé une plainte pour brutalités policières mais les autorités décidèrent de ne pas ouvrir de poursuites, faute de preuves.
CEDH
Le Gouvernement arguait qu’au moment de l’arrestation de Mme Akdağ, il n’existait plus en Turquie de restriction généralisée au droit d’accès à un avocat pendant la garde à vue pour les personnes accusées d’une infraction qui relevait de la compétence des cours de sûreté de l’État, et que les personnes soupçonnées de telles infractions pouvaient donc avoir accès à un avocat si elles en faisaient la demande. Il soutenait toutefois que Mme Akdağ ayant indiqué sur son formulaire de déposition qu’elle ne demandait pas l’assistance d’un avocat, elle avait valablement renoncé à son droit à un avocat lorsqu’elle avait fait ses déclarations à la police. La Cour estime, au contraire, que des indications sérieuses s’opposent à la conclusion selon laquelle Mme Akdağ aurait renoncé à son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat. Tout d’abord, dès qu’elle a eu accès à un avocat, elle est immédiatement revenue sur les déclarations qu’elle avait faites à la police, tant devant le ministère public que devant le juge d’instruction, et elle a maintenu ses déclarations devant le tribunal de jugement. Par ailleurs, aucune annotation manuscrite ne se trouvait sur son formulaire de déposition, qui portait juste un « X » imprimé à côté de la mention « n’a pas demandé d’avocat ». Le tribunal de jugement n’a pas non plus examiné l’allégation de l’intéressée selon laquelle elle était analphabète. De surcroît, le Gouvernement n’a pas démontré que Mme Akdağ avait expressément été informée des conséquences du fait de ne pas demander l’assistance d’un avocat.
La Cour considère donc que le Gouvernement n’a pas démontré que Mme Akdağ avait valablement renoncé à son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsqu’elle avait fait ses déclarations à la police. Le Gouvernement n’a pas non plus présenté de raisons impérieuses qui auraient pu justifier la restriction apportée au droit d’accès à un avocat de Mme Akdağ pendant sa garde à vue, telles qu’un besoin urgent de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique. Enfin, même si Mme Akdağ a été représentée par un avocat tout au long du procès, la Cour n’est pas convaincue qu’elle a pu utilement contester les éléments de preuve retenus pour la déclarer coupable et la condamner. En particulier, les juridictions nationales n’ont à aucun moment examiné la validité de la renonciation alléguée ou des déclarations faites par l’intéressée à la police en l’absence d’un avocat. Aucune autre garantie procédurale n’a compensé l’absence de contrôle constatée. L’équité globale de la procédure n’a pas été assurée. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c). La Cour déclare irrecevable le grief que la requérante tirait de l’utilisation de ses déclarations à la police, qu’elle disait avoir faites sous la contrainte. La Cour considère que l’intéressée n’a soumis aucun élément permettant de prouver qu’elle avait fait l’objet de brutalités pendant sa garde à vue. Les deux rapports médicaux présents dans son dossier, qu’elle n’a jamais contestés devant les juridictions internes ni devant la Cour, n’indiquaient aucune trace sur son corps de mauvais traitements. En outre, les autorités de poursuite ont décidé de ne pas ouvrir de poursuites, faute de preuves.
Bloise c. France du 11 juillet 2019 n° 30828/13
Article 6-1 et 6-3 c) rappel de l’importance du droit au silence et de l’assistance d’un avocat durant une garde à vue
Les deux affaires se rapportent à des gardes à vue antérieures à la réforme législative du 14 avril 2011. Elles concernent, d’une part, le défaut de notification du droit au silence et, d’autre part, l’absence d’assistance d’un avocat, dans le cadre de la garde à vue. La loi en vigueur à l’époque des faits excluait la possibilité, au cours d’une garde à vue, de se voir notifier le droit de garder le silence et d’être assisté par un avocat pendant les interrogatoires. Dans le cas de M. Olivieri, et s’agissant du droit de ce dernier de ne pas s’incriminer lui-même, la Cour relève notamment l’existence de déclarations et de réponses faites aux enquêteurs qui ont manifestement affecté sa position dans la procédure. Tout d’abord, M. Olivieri a été interrogé par la police environ 10 heures pendant sa garde à vue à l’issue de laquelle il a reconnu sa responsabilité. Ensuite, rien dans la motivation des décisions internes ne permet de considérer que d’autres éléments pourraient être regardés comme des parties intégrantes et importantes sur lesquelles reposait sa condamnation. La Cour estime donc que la procédure pénale considérée dans son ensemble n’a pas permis de remédier aux lacune procédurales survenues durant la garde à vue. Dans le cas de M. Bloise, la Cour constate en particulier que les juridictions du fond se sont fondées sur des éléments extérieurs aux déclarations faites au cours de la garde à vue, à savoir sur les éléments établis lors de l’instruction alors que le requérant était assisté d’un avocat, sur les débats devant le juge de première instance ou encore sur les témoignages précis et circonstanciés de tiers en lien direct avec son activité et sur l’examen des documents comptables et bancaires. La Cour estime en l’espèce que la procédure pénale, considérée dans son ensemble, a permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue.
a) Principes généraux
45. La Cour renvoie aux principes généraux maintes fois réaffirmés par elle (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 56 et 61-62, CEDH 2008, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, 13 septembre 2016, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, 12 mai 2017 (extraits)), et rappelés récemment dans l’affaire Beuze c. Belgique ([GC], no 71409/10, §§ 119 et s., 9 novembre 2018).
46. Elle souligne en particulier que, quelle que soit la restriction concernée, même si cette dernière découle directement de la loi applicable, elle procède à un examen en deux étapes : d’une part, en vérifiant tout d’abord l’existence ou non de raisons impérieuses, puis, d’autre part, en examinant l’équité du procès dans son ensemble. Par ailleurs, si l’absence de raisons impérieuses ne suffit pas à entraîner une violation de l’article 6, elle entraîne un contrôle très strict de la Cour, dès lors qu’une telle absence pèse lourdement dans la balance lorsqu’il s’agit d’apprécier globalement l’équité du procès, ce qui peut faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation (Beuze, précité, § 145). Tel est d’autant plus le cas lorsqu’il y a cumul du défaut d’accès à un avocat et du défaut de notification des droits, en particulier du droit de garder le silence : le gouvernement, à qui il incombe d’expliquer de façon convaincante pourquoi, à titre exceptionnel et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la restriction à l’accès à un avocat n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès, pourra alors plus difficilement prouver que le procès a été équitable.
47. Elle rappelle également qu’un certain nombre de facteurs, non limitatifs, doivent être pris en compte s’il y a lieu (Beuze, précité, § 150).
48. Par ailleurs, dans l’arrêt Beuze (précitée), la Cour a précisé que la désignation d’un conseil doit impérativement s’accompagner des deux exigences minimales suivantes : d’une part, le suspect doit pouvoir entrer en contact avec son avocat dès sa privation de liberté, ce qui implique qu’il puisse consulter son avocat préalablement à un interrogatoire, voire en l’absence d’un interrogatoire et que l’avocat puisse s’entretenir avec lui en privé et en recevoir des instructions confidentielles (Simeonovi, précité, § 111, et Beuze, précité, § 133) ; d’autre part, le suspect doit également bénéficier de la présence physique de son avocat durant les auditions initiales menées par la police et durant les interrogatoires ultérieurs menés au cours de la procédure antérieure à la phase de jugement, cette présence devant permettre à l’avocat de fournir une assistance effective et concrète, notamment pour éviter les atteintes aux droits de la défense, et non seulement abstraite (ibidem, § 134).
49. Enfin, s’agissant des déclarations du suspect, elle rappelle que le droit de ne pas s’incriminer soi‑même ne se limite pas aux aveux au sens strict ou aux remarques le mettant directement en cause : il suffit, pour qu’il y ait auto‑incrimination, que ses déclarations soient susceptibles d’affecter substantiellement sa position de celui-ci, à l’instar de déclarations circonstanciées qui orientent la conduite des auditions et interrogatoires, qui affectent la position du suspect ou sa crédibilité (Beuze, précité, §§ 178 et 179).
b) Application au cas d’espèce
50. La Cour note tout d’abord que si le requérant a pu s’entretenir avec un avocat durant sa garde à vue, la loi l’y autorisant pour une durée de trente minutes, et ce de nouveau lors de la prolongation de la mesure, il n’a bénéficié ni de l’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires ni de la notification du droit au silence. Le Gouvernement le reconnaît.
51. Elle relève ensuite qu’il n’est pas contesté que les restrictions litigieuses résultaient de la loi française applicable au moment des faits. Or, la Cour rappelle que les restrictions à l’accès à un avocat pour des raisons impérieuses ne sont permises durant la phase préalable au procès que dans des cas exceptionnels, et qu’elles doivent être de nature temporaire et reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d’espèce (Beuze, précité, § 161). Une appréciation individuelle de cette nature était clairement absente en l’espèce, la restriction ayant été de portée générale et obligatoire (ibidem). Quant aux arrêts de la Cour de cassation du 15 avril 2011 et à la loi no 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, le requérant n’a pas pu en bénéficier durant sa garde à vue. En outre, le Gouvernement n’a pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier les restrictions dont a fait l’objet le droit du requérant et il n’appartient pas à la Cour d’en chercher de son propre chef (Simeonovi, précité, § 130, et Beuze, précité, § 163). Aucune raison impérieuse ne justifiait donc en l’espèce les restrictions susmentionnées.
52. La Cour doit dès lors évaluer l’équité de la procédure en opérant un contrôle très strict et ce, à plus forte raison, dans le cas de restrictions d’origine législative ayant une portée générale et obligatoire. La charge de la preuve pèse ainsi sur le Gouvernement, qui doit démontrer de manière convaincante que le requérant a néanmoins bénéficié globalement d’un procès pénal équitable (Beuze, précité, § 165). Ainsi qu’il a été rappelé (paragraphe 46 ci-dessus), l’incapacité du Gouvernement à établir des raisons impérieuses pèse lourdement dans la balance et peut faire pencher la Cour dans le sens d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c).
53. Examinant, dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, les différents facteurs découlant de sa jurisprudence tels qu’ils ressortent des arrêts Ibrahim et autres, Simeonovi et Beuze (précités, respectivement §§ 274, 120 et 150), la Cour note en premier lieu l’absence tant de vulnérabilité particulière du requérant que de coercition exercée sur lui durant la garde à vue. Elle estime ensuite que des considérations d’intérêt public justifiaient la poursuite du requérant, celui-ci étant poursuivi pour des faits d’abus de biens sociaux.
54. En outre, la Cour constate que le requérant, assisté cette fois d’un avocat, dès l’instruction, a pu faire valoir ses arguments devant les juridictions du fond, notamment pour discuter des différents éléments de preuve, en première instance comme en appel, dans le cadre du recours qui lui était ouvert et qu’il a pu exercer, puis devant la Cour de cassation, qui était saisie de son pourvoi.
55. Elle relève cependant que l’exception de nullité soulevée par le requérant, sur le fondement de l’article 6 de la Convention, en raison du défaut d’assistance d’un avocat durant sa garde à vue, a été rejetée par le tribunal de première instance et la cour d’appel de Papeete pour cause de forclusion (paragraphes 13 et 16 ci-dessus). En l’espèce, le Gouvernement indique lui-même qu’un tel recours devant la chambre de l’instruction avait très peu de chances d’être accueilli favorablement et que le requérant bénéficiait en principe d’un second recours, devant les juges du fond (paragraphes 30-32 ci-dessus). Or, des dispositions légales susceptibles d’être invoquées par le Gouvernement et prévoyant in abstracto certaines garanties qui auraient pu assurer, à elles seules, l’équité globale de la procédure, ne suffisent pas : la Cour doit examiner si l’application de ces dispositions légales au cas d’espèce a eu concrètement un effet compensatoire rendant la procédure équitable dans son ensemble (Beuze, précité, § 161), en particulier si les juridictions internes ont procédé à l’analyse nécessaire de l’incidence de l’absence d’un avocat à un moment crucial de la procédure (ibidem, §§ 174 et 176). Un tel examen n’a pas été explicitement réalisé par les juges nationaux en l’espèce.
56. Cependant, s’agissant du droit du requérant de ne pas s’incriminer lui‑même et de l’utilisation des différents éléments de preuve du dossier par les juges du fond, la Cour constate que si, au cours de sa garde à vue, le requérant avait reconnu une partie des faits (paragraphe 7 ci-dessus), le jugement de première instance et l’arrêt de la cour d’appel de Papeete ne font aucune référence à ces déclarations, et ce alors même que leurs décisions sont longuement motivées. Elle note en effet que le tribunal s’est fondé sur les seules déclarations faites par le requérant devant le juge d’instruction alors qu’il était assisté d’un avocat, et sur les faits qu’il a reconnus devant lui au cours des débats sur le fond (paragraphe 13 ci‑dessus). Quant à la cour d’appel, elle n’a pas non plus mentionné les déclarations faites par le requérant au cours de la garde à vue, mais elle s’est largement référée aux déclarations circonstanciées du commissaire aux comptes, à l’origine de la procédure avec son signalement circonstancié au procureur de la République qui était un élément important de l’accusation, de l’expert-comptable de la société, du représentant des créanciers (dans le cadre du redressement judiciaire de l’entreprise) et de l’ancien dirigeant de la société qui a finalement été désigné comme nouveau représentant légal de celle-ci, en remplacement du requérant, durant la procédure de redressement judiciaire. Elle s’est en outre fondée sur les résultats de l’instruction, ainsi que sur les déclarations du requérant devant le tribunal de première instance, qui ressortaient des notes d’audience, et ce en relevant toute une série de faits délictueux attestés par des documents comptables et l’examen des relevés de comptes, caractéristiques de l’infraction d’abus de biens sociaux (paragraphe 17 ci‑dessus).
57. Or, la Cour rappelle qu’il ressort clairement de sa jurisprudence que les restrictions au droit d’accès à un avocat, même systématiques, au droit de ne pas témoigner contre soi-même et au droit à être informé de la possibilité de garder le silence ne peuvent pas entraîner ab initio la violation de la Convention mais donnent lieu à un examen en deux étapes. La première consiste à vérifier l’existence de raisons impérieuses de restreindre ces droits : même dans l’hypothèse où celles-ci feraient défaut, il ne saurait y avoir de constat de violation automatique de la Convention, la Cour devant, lors d’une seconde étape, effectuer un contrôle de l’équité de la procédure dans son ensemble (Ibrahim et autres, précité, § 262, 269 et 273, et Beuze, précité, § 141). Parmi les facteurs susceptibles d’établir que la procédure a été équitable dans son ensemble, figure « l’utilisation faite des preuves, et en particulier le point de savoir si elles sont une partie intégrante ou importante des pièces à charge sur lesquelles s’est fondée la condamnation, ainsi que la force des autres éléments du dossier » (Ibrahim et autres, précité, § 274, Simeonovi, précité, § 120, et Beuze, précité, § 150). Dans certaines hypothèses et, surtout, dans le cadre de l’examen au cas par cas auquel la Cour se livre, ce qui implique nécessairement une appréciation susceptible de varier en fonction des circonstances particulières de chaque affaire, ce facteur peut s’avérer crucial. Aux yeux de la Cour, tel est le cas en l’espèce. Elle vient en effet de constater que les juridictions du fond se sont fondées sur des éléments extérieurs aux déclarations faites par le requérant au cours de la garde à vue, à savoir sur les éléments établis par l’instruction, pendant laquelle le requérant était assisté d’un avocat, sur les débats devant le juge de première instance, ou encore sur les témoignages particulièrement précis et circonstanciés de tiers en lien direct avec son activité, ainsi que sur l’examen des documents comptables et bancaires (paragraphe 56 ci‑dessus).
58. Ainsi, bien que les juges internes n’aient pas explicitement apprécié les conséquences de l’absence de l’assistance d’un avocat et de notification du droit de garder le silence lors de la garde à vue pour les droits de la défense du requérant, la Cour constate qu’ils ont néanmoins veillé à se fonder sur d’autres éléments que les propos tenus par le requérant au cours de la garde à vue et que les déclarations faites à ce stade ont été ignorées durant le procès au fond, pour finalement n’occuper aucune place dans la motivation des juges du fond : compte tenu de l’existence d’autres preuves considérées comme étant décisives, qui ont été discutées contradictoirement dans le cadre de la procédure, les déclarations litigieuses faites en garde à vue ne constituaient à l’évidence pas une partie intégrante et importante des preuves sur lesquelles reposait la condamnation du requérant (voir, a contrario, Ibrahim et autres, précité, § 309, Rodionov c. Russie, no 9106/09, § 168, 11 décembre 2016, et Beuze, précité, § 193).
59. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il est en l’espèce indifférent que les autres garanties procédurales évoquées par le Gouvernement, à savoir le fait que le requérant aurait pu faire prévenir un proche, qu’il ait été examiné par un médecin et que sa garde à vue se soit déroulée sous le contrôle du procureur de la République (paragraphe 44 ci-dessus), ne soient, malgré leur importance, pas de nature à compenser l’absence d’assistance d’un avocat et le défaut de notification du droit de garder le silence durant la garde à vue.
60. Compte tenu de ce qui précède et dans le cadre du contrôle auquel elle doit procéder en l’absence de raisons impérieuses, la Cour estime que la procédure pénale menée à l’égard du requérant, considérée dans son ensemble, a permis, dans les circonstances de l’espèce, de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue. La Cour estime important de souligner, comme elle l’a fait dans d’autres affaires relatives à l’article 6 § 1 de la Convention dans lesquelles un examen de l’équité globale de la procédure était en cause, qu’elle ne doit pas s’ériger en juge de quatrième instance (Beuze, précité, § 193). Lors de l’examen de l’équité globale de la procédure tel que celui exigé par l’article 6 § 1, elle est toutefois appelée à examiner soigneusement le déroulement de la procédure au niveau interne, un contrôle très strict s’imposant lorsque la restriction au droit d’accès à un avocat ne repose sur aucune raison impérieuse. En l’espèce, c’est la conjonction des différents facteurs précités et non chacun d’eux pris isolément qui la conduit à considérer que la procédure a été équitable dans son ensemble. La Cour souligne à ce titre que la motivation des décisions des juges du fond, qui n’est ni stéréotypée ni laconique, mais au contraire circonstanciée, lui permet d’assurer le contrôle européen qui lui est confié (cf., mutatis mutandis, X. c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 107, CEDH 2013).
61. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
OLIVIERI c. FRANCE du 11 juillet 2019 Requête n° 62313/12
Article 6-1 et 6-3 c) rappel de l’importance du droit au silence et de l’assistance d’un avocat durant une garde à vue
Les deux affaires se rapportent à des gardes à vue antérieures à la réforme législative du 14 avril 2011. Elles concernent, d’une part, le défaut de notification du droit au silence et, d’autre part, l’absence d’assistance d’un avocat, dans le cadre de la garde à vue. La loi en vigueur à l’époque des faits excluait la possibilité, au cours d’une garde à vue, de se voir notifier le droit de garder le silence et d’être assisté par un avocat pendant les interrogatoires. Dans le cas de M. Olivieri, et s’agissant du droit de ce dernier de ne pas s’incriminer lui-même, la Cour relève notamment l’existence de déclarations et de réponses faites aux enquêteurs qui ont manifestement affecté sa position dans la procédure. Tout d’abord, M. Olivieri a été interrogé par la police environ 10 heures pendant sa garde à vue à l’issue de laquelle il a reconnu sa responsabilité. Ensuite, rien dans la motivation des décisions internes ne permet de considérer que d’autres éléments pourraient être regardés comme des parties intégrantes et importantes sur lesquelles reposait sa condamnation. La Cour estime donc que la procédure pénale considérée dans son ensemble n’a pas permis de remédier aux lacune procédurales survenues durant la garde à vue. Dans le cas de M. Bloise, la Cour constate en particulier que les juridictions du fond se sont fondées sur des éléments extérieurs aux déclarations faites au cours de la garde à vue, à savoir sur les éléments établis lors de l’instruction alors que le requérant était assisté d’un avocat, sur les débats devant le juge de première instance ou encore sur les témoignages précis et circonstanciés de tiers en lien direct avec son activité et sur l’examen des documents comptables et bancaires. La Cour estime en l’espèce que la procédure pénale, considérée dans son ensemble, a permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue.
a) Principes généraux
26. La Cour renvoie aux principes généraux maintes fois réaffirmés par elle (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 56 et 61-62, CEDH 2008, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, 13 septembre 2016, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, 12 mai 2017 (extraits)), et rappelés récemment dans l’affaire Beuze c. Belgique ([GC], no 71409/10, §§ 119 et s., 9 novembre 2018).
27. Elle souligne en particulier que, quelle que soit la restriction à l’accès à l’assistance d’un avocat concernée, même si celle-ci découle directement de la loi applicable, elle procède à un examen en deux étapes : d’une part, en vérifiant tout d’abord l’existence ou non de raisons impérieuses de restreindre ce droit, puis, d’autre part, en examinant l’équité du procès dans son ensemble. Par ailleurs, si l’absence de raisons impérieuses ne suffit pas à entraîner une violation de l’article 6, elle commande un contrôle très strict de la Cour, dès lors qu’une telle absence pèse lourdement dans la balance lorsqu’il s’agit d’apprécier globalement l’équité du procès, ce qui peut faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation (Beuze, précité, § 145). Tel est d’autant plus le cas lorsqu’il y a cumul du défaut d’accès à un avocat et du défaut de notification des droits, en particulier du droit de garder le silence : le gouvernement, à qui il incombe d’expliquer de façon convaincante pourquoi, à titre exceptionnel et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la restriction à l’accès à un avocat n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès, pourra alors plus difficilement prouver que le procès a été équitable.
28. Elle rappelle également qu’un certain nombre de facteurs, non limitatifs, doivent être pris en compte s’il y a lieu (Beuze, précité, § 150).
29. Par ailleurs, dans l’arrêt Beuze (précité), la Cour a précisé que la désignation d’un conseil doit impérativement s’accompagner des deux exigences minimales suivantes : d’une part, le suspect doit pouvoir entrer en contact avec son avocat dès sa privation de liberté, ce qui implique qu’il puisse consulter son avocat préalablement à un interrogatoire, voire en l’absence d’un interrogatoire et que l’avocat puisse s’entretenir avec lui en privé et en recevoir des instructions confidentielles (Simeonovi, précité, § 111, et Beuze, précité, § 133) ; d’autre part, le suspect doit également bénéficier de la présence physique de son avocat durant les auditions initiales menées par la police et durant les interrogatoires ultérieurs menés au cours de la procédure antérieure à la phase de jugement, cette présence devant permettre à l’avocat de fournir une assistance effective et concrète, notamment pour éviter les atteintes aux droits de la défense, et non seulement abstraite (ibidem, § 134).
30. Enfin, s’agissant des déclarations du suspect, elle rappelle que le droit de ne pas s’incriminer soi‑même ne se limite pas aux aveux au sens strict ou aux remarques le mettant directement en cause : il suffit, pour qu’il y ait auto‑incrimination, que ses déclarations soient susceptibles d’affecter substantiellement la position de celui-ci ; il en est notamment ainsi de déclarations circonstanciées qui orientent la conduite des auditions et interrogatoires (Beuze, précité, §§ 178 et 179).
b) Application au cas d’espèce
31. La Cour note tout d’abord que si le requérant a pu s’entretenir avec un avocat durant sa garde à vue, la loi l’y autorisant pour une durée de trente minutes, il n’a bénéficié ni de l’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires ni de la notification du droit de garder le silence. Le Gouvernement le reconnaît.
32. Elle relève ensuite qu’il n’est pas contesté que les restrictions litigieuses résultaient de la loi française applicable au moment des faits. Or, la Cour rappelle que les restrictions à l’accès à un avocat pour des raisons impérieuses ne sont permises durant la phase préalable au procès que dans des cas exceptionnels, et qu’elles doivent être de nature temporaire et reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d’espèce (Beuze, précité, § 161). Une appréciation individuelle de cette nature était clairement absente en l’espèce, la restriction ayant été de portée générale et obligatoire (ibidem). Quant aux arrêts de la Cour de cassation du 15 avril 2011 et à la loi no 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, le requérant n’a pas pu en bénéficier durant sa garde à vue, qui s’est déroulée en 2007. En outre, le Gouvernement n’a pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier les restrictions dont a fait l’objet le droit du requérant et il n’appartient pas à la Cour d’en chercher de son propre chef (Simeonovi, précité, § 130, et Beuze, précité, § 163). Aucune raison impérieuse ne justifiait donc en l’espèce les restrictions susmentionnées.
33. La Cour doit dès lors évaluer l’équité de la procédure en opérant un contrôle très strict et ce, à plus forte raison, dans le cas de restrictions d’origine législative ayant une portée générale et obligatoire. La charge de la preuve pèse ainsi sur le Gouvernement, qui doit démontrer de manière convaincante que le requérant a néanmoins bénéficié globalement d’un procès pénal équitable (Beuze, précité, § 165). Ainsi qu’il a été rappelé (paragraphe 27 ci-dessus), l’incapacité du Gouvernement à établir des raisons impérieuses pèse lourdement dans la balance et peut faire pencher la Cour dans le sens d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c).
34. Examinant, dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, les différents facteurs découlant de sa jurisprudence tels qu’ils ressortent des arrêts Ibrahim et autres, Simeonovi et Beuze (précités, respectivement §§ 274, 120 et 150), la Cour note en premier lieu l’absence tant de vulnérabilité particulière du requérant que de coercition exercée sur lui durant la garde à vue. Elle estime ensuite que des considérations d’intérêt public justifiaient la poursuite du requérant, celle-ci ayant pour objet des faits de banqueroute.
35. En outre, la Cour constate que le requérant, assisté cette fois d’un avocat, a pu faire valoir ses arguments, d’abord devant les juridictions du fond, notamment pour discuter des différents éléments de preuve, en première instance comme en appel, dans le cadre du recours qui lui était ouvert et qu’il a pu exercer, puis devant la Cour de cassation, qui était saisie de son pourvoi.
36. Elle relève cependant que l’exception de nullité soulevée par le requérant, sur le fondement de l’article 6 de la Convention, en raison du défaut d’assistance d’un avocat durant sa garde à vue, d’abord retenue par le tribunal correctionnel d’Ajaccio, fut ensuite rejetée par la cour d’appel de Bastia le 30 mai 2011 (paragraphe 9 ci-dessus). Celle-ci a a en effet jugé que la nullité ne pouvait être prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 et, partant, en l’absence d’une loi (paragraphe 11 ci-dessus). Elle a ainsi suivi la position retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans ses arrêts du 19 octobre 2010, et ce malgré les quatre arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation prononcés quelques semaines plus tôt, le 15 avril 2011 (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour est consciente des difficultés que le passage du temps et l’évolution de sa jurisprudence peuvent entraîner pour les juridictions nationales. Toutefois, s’agissant de l’article 6 §§ 1 et 3 c), elle souligne que cette évolution a été linéaire depuis l’arrêt Salduz (précité ; cf. Beuze, précité, §§ 142 et 161). Or, des dispositions légales susceptibles d’être invoquées par le Gouvernement et prévoyant in abstracto certaines garanties qui auraient pu assurer, à elles seules, l’équité globale de la procédure, ne suffisent pas : la Cour doit examiner si l’application de ces dispositions légales au cas d’espèce a eu concrètement un effet compensatoire rendant la procédure équitable dans son ensemble (Beuze, précité, § 161), en particulier si les juridictions internes ont procédé à l’analyse nécessaire de l’incidence de l’absence d’un avocat à un moment crucial de la procédure (ibidem, §§ 174 et 176). Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
37. S’agissant du droit du requérant de ne pas s’incriminer lui‑même et de l’utilisation des différents éléments de preuve du dossier, la Cour relève l’existence de déclarations et de réponses faites aux enquêteurs qui ont manifestement affecté sa position de manière substantielle dans la procédure. Tout d’abord, le requérant a été interrogé par la police durant environ dix heures au cours de la garde à vue, à la fin de laquelle il a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il reconnaissait sa responsabilité (paragraphe 7 ci-dessus). Ensuite, rien dans la motivation des décisions internes ne permet de considérer que d’autres éléments pourraient être regardés comme des parties intégrantes et importantes sur lesquelles reposaient la condamnation.
38. En conséquence, rappelant qu’en l’absence de raisons impérieuses justifiant les restrictions constatées, elle est appelée à opérer un contrôle très strict, la Cour considère que ces éléments doivent peser lourdement dans son appréciation de l’équité de la procédure dans son ensemble (Beuze, précité, §§ 178-179). Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que le requérant a été privé à la fois du droit de bénéficier de la présence physique de son avocat durant les interrogatoires menés par la police et de la notification de son droit à garder le silence, ce qui rend encore plus difficile, pour le Gouvernement, de démontrer que le procès a été équitable (Ibrahim etautres, précité, § 273, et Beuze, précité, § 146).
39. Enfin, s’agissant de l’existence éventuelle d’autres garanties procédurales, la Cour estime que les mesures évoquées à ce titre par le Gouvernement, à savoir le fait que le requérant ait pu faire prévenir son épouse et qu’il aurait pu se faire examiner par un médecin s’il l’avait souhaité (paragraphe 25 ci-dessus), ne sont pas, malgré leur importance, de nature à compenser l’absence d’assistance d’un avocat et le défaut de notification du droit de garder le silence durant la garde à vue.
40. Compte tenu de ce qui précède et du contrôle auquel elle doit procéder en l’absence de raisons impérieuses, la Cour estime que la procédure pénale menée à l’égard du requérant, considérée dans son ensemble, n’a pas permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue. La Cour estime important de souligner, comme elle l’a fait dans d’autres affaires relatives à l’article 6 § 1 de la Convention dans lesquelles un examen de l’équité globale de la procédure était en cause, qu’elle ne doit pas s’ériger en juge de quatrième instance (Beuze, précité, § 193). Lors de cet examen, elle est toutefois appelée à examiner soigneusement le déroulement de la procédure au niveau interne, un contrôle très strict s’imposant lorsque la restriction au droit d’accès à un avocat ne repose sur aucune raison impérieuse. En l’espèce, c’est la conjonction des différents facteurs précités et non chacun d’eux pris isolément qui a rendu la procédure inéquitable dans son ensemble.
41. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
Doyle c. Irlande du 23 mai 2019 requête n° 51979/17
Article 6§1 et 6§3 : La restriction au droit d’accès à un avocat au cours d’interrogatoires de police n’a pas emporté violation du droit à un procès équitable
Dans cette affaire, le requérant alléguait que son droit d’accès à un avocat avait été restreint lorsque la police l’avait interrogé dans le cadre d’une affaire de meurtre. Il avait pu s’entretenir avec son avocat avant et après sa première audition, mais les règles de la police en vigueur à l’époque des faits interdisaient la présence d’avocats lors des interrogatoires. La Cour juge qu’un examen très attentif est nécessaire dans des affaires où, comme en l’espèce, aucune raison impérieuse ne justifiait une restriction au droit du requérant à bénéficier de l’assistance d’un avocat. Elle conclut néanmoins, après examen de la procédure dans son ensemble, que l’équité globale du procès n’a pas été compromise.
LES FAITS
Le requérant, Barry Doyle, est un ressortissant irlandais né en 1985 et résidant à Dublin (Irlande). Il purge actuellement une peine perpétuelle à la prison de Mountjoy (Dublin). M. Doyle fut arrêté en février 2009 en lien avec le meurtre d’un homme, S.G., commis en novembre 2008. Il fut conduit dans un commissariat, où il fut informé de ses droits et put immédiatement bénéficier de l’assistance d’un avocat, qu’il consulta avant sa première audition par la police. Il fut par la suite interrogé à de nombreuses reprises et put consulter un avocat entre chaque audition, aussi longtemps que lui ou son avocat le souhaitait, en personne et par téléphone. À sa demande, un interrogatoire fut interrompu afin qu’il puisse s’entretenir à nouveau avec son avocat.
Néanmoins, son avocat n’assista jamais en personne aux interrogatoires. Au cours du quinzième interrogatoire, le requérant avoua avoir tué S.G. et communiqua un certain nombre d’informations à propos du meurtre. Par la suite, la police l’interrogea de nouveau à plusieurs reprises. Après qu’un jury se fut trouvé dans l’incapacité d’aboutir à un verdict en 2011, il fut jugé à nouveau en 2012.
Arguant qu’il avait été incité à faire des aveux, qu’il avait reçu des menaces et qu’on lui avait refusé l’accès à un avocat, il sollicita l’exclusion de ses aveux du dossier. Le juge du fond rejeta cette exception et, en février 2012, le jury déclara le requérant coupable du meurtre de S.G. et le condamna à une peine perpétuelle.
Le requérant saisit ensuite la cour d’appel et la Cour suprême, en vain. Les juges de la Cour suprême, qui en janvier 2017 le déboutèrent par six voix contre une, procédèrent à un examen approfondi de la question du droit d’accès à un avocat au cours des interrogatoires de police.
LE DROIT
Article 6 §§ 1 et 3 c)
La Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat constitue l’un des éléments fondamentaux du droit à un procès équitable (Beuze c. Belgique). Sa jurisprudence a établi sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) une analyse en deux étapes, la première consistant à vérifier l’existence ou non de raisons impérieuses justifiant une restriction au droit d’accès à un avocat, et la deuxième à apprécier l’équité globale de la procédure. Concernant la première étape de l’analyse, la Cour observe que M. Doyle avait le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et qu’il a eu accès à un avocat après son arrestation et avant que la police ne l’interroge.
Après ce premier interrogatoire, il put demander à consulter son avocat à tout moment. Néanmoins, conformément aux règles de la police en vigueur à l’époque, son avocat ne fut pas autorisé à assister en personne aux interrogatoires. La restriction imposée à son droit d’accès à un avocat était donc générale par nature, et n’était justifiée par aucune raison impérieuse.
Concernant la deuxième étape, qui consiste à apprécier l’équité globale de la procédure, la Cour considère, premièrement, que M. Doyle, un adulte locuteur natif de la langue en usage, n’était pas particulièrement vulnérable. Les autorités internes ayant procédé à un examen très attentif de la question de savoir si, au cours des interrogatoires, la police avait menacé le requérant ou l’avait incité à faire des aveux, elle n’aperçoit aucune raison sérieuse de remettre en cause leur appréciation sur ce point. Les trois juridictions internes ont établi que les aveux du requérant n’avaient pas été obtenus au moyen d’incitations ou de menaces.
M. Doyle a eu la possibilité de contester la recevabilité des éléments de preuve et de s’opposer à leur utilisation à tous les stades de la procédure, notamment dans le cadre d’une procédure de voir dire (c’est-à-dire un « procès dans le procès » visant à statuer sur l’admissibilité de preuves) qui dura dix jours. P
ar ailleurs, de solides considérations d’intérêt public justifiaient la poursuite de M. Doyle, qui était accusé de meurtre. Le procès faisait suite au meurtre d’un innocent — tué en marge d’une querelle entre deux gangs parce qu’il avait été pris pour un autre – qui appelait des mesures appropriées de l’État défendeur.
La Cour relève par ailleurs l’existence d’autres garanties procédurales, comme le fait que l’ensemble des interrogatoires de la police furent filmés et que ces enregistrements furent remis aux juges et au jury.
Enfin, le jury a reçu du juge du fond des instructions détaillées concernant la prise en compte des éléments de preuve jugés recevables. La Cour observe que si la Cour suprême s’est largement appuyée sur la jurisprudence de la Cour relative au droit d’accès à un avocat, la majorité a conclu à tort que ce droit ne s’étendait pas au droit à bénéficier de la présence physique d’un avocat au cours des auditions par la police.
Elle note également que les règles de la police en vigueur dans l’État défendeur ont évolué depuis. Après examen de l’impact de la restriction au droit d’accès à un avocat au cours de la phase préalable au procès, la Cour conclut que l’équité globale de la procédure pénale n’a pas été compromise de manière irrémédiable. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c).
Grande Chambre Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018 requête n° 71409/10
Les restrictions au droit d’accès à un avocat pendant la phase préalable au procès pénal ont violé le droit du requérant à un procès équitable
Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable / droit à l’assistance d’un avocat) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne la non-assistance de l’avocat pendant la phase préalable au procès pénal. La Cour juge que la procédure pénale, considérée en son ensemble, n’a pas permis de remédier aux lacunes procédurales qui ont affecté la phase préalable au procès. Les restrictions au droit d’accès à un avocat ont été particulièrement importantes et dans ces circonstances, sans être suffisamment informé du droit de garder le silence, le requérant a fait au cours de la garde à vue des déclarations circonstanciées. Ces déclarations ont été admises par la cour d’assises au titre de preuves sans examen adéquat des circonstances ni de l’incidence de l’absence d’un avocat. La Cour de cassation s’est concentrée sur l’absence de l’avocat durant la garde à vue sans apprécier les conséquences pour les droits de la défense du requérant de l’absence de l’avocat lors des auditions, interrogatoires et autres actes ayant eu lieu pendant l’instruction. La Cour conclut que la conjonction de ces différents facteurs a rendu la procédure inéquitable dans son ensemble.
LES FAITS
Le requérant, M. Philippe Beuze est un ressortissant belge, né en 1974 et actuellement détenu à la prison de Marche-en-Famenne où il purge une peine de prison à perpétuité. M. Beuze fut arrêté le 17 décembre 2007 par la gendarmerie française dans un village du département français du Nord. Il fut placé en garde à vue en exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par un juge du tribunal de première instance de Charleroi (Belgique). Il était inculpé du chef d’homicide volontaire avec intention de donner la mort et préméditation sur M.B. son ex-compagne, le 5 novembre 2007. Le procès-verbal d’audition dressé par les gendarmes français indiquait que M. Beuze avait renoncé au droit de s’entretenir avec un avocat de son choix, ou à défaut, commis d’office. La chambre d’instruction de la cour d’appel de Douai ordonna sa remise aux autorités judiciaires belges. Remis aux autorités belges le 31 décembre 2007, M. Beuze fut auditionné par la police judiciaire de 11h50 à 15h55, puis, le même jour, par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Charleroi à 16h45. Sur le point de savoir s’il avait fait le choix d’un conseil, M. Beuze répondit par la négative. A 17h42, terme de l’interrogatoire, le juge d’instruction fit état de la nécessité de requérir immédiatement un médecin psychiatre. Un mandat d’arrêt fut délivré le même jour et il fut placé en détention préventive. M. Beuze n’eut pas le droit de communiquer avec un avocat entre le moment de sa remise aux autorités belges et la fin de sa garde à vue le 31 décembre 2007. Le droit de consulter un avocat ne 1 Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations lui fut reconnu, conformément aux dispositions légales, qu’une fois la décision de le placer en détention préventive prise par le juge d’instruction. S’il fut assisté ensuite par un avocat tout au long de la phase d’instruction, celui-ci n’était pas présent lors des auditions, interrogatoires et autres actes d’instruction qui eurent lieu durant cette phase. Le 11 janvier 2008, M. Beuze fit l’objet d’une nouvelle audition par la police judiciaire. Aucune mention n’indique dans le procès-verbal que le requérant se serait vu désigner un avocat ou aurait été en contact avec un avocat avant l’audition. Parallèlement à l’instruction relative au meurtre de M.B., M. Beuze fut auditionné par la police à quatre reprises les 6 et 7 mars 2008 pour « association de malfaiteurs » à propos de vols de voitures. Le 6 juin 2008, l’avocat de M. Beuze était absent lors de la reconstitution des faits organisée sur les lieux. Le 8 août 2008, un mandat d’arrêt fut délivré étendant la saisine du juge d’instruction à trois infractions supplémentaires : tentative d’homicide le 25 octobre 2007 à l’encontre de M.B., et faits de vols avec violence ou menace et fraude commis le 17 septembre 2007 au préjudice de C.L. A l’issue de l’instruction, M. Beuze fut renvoyé devant la cour d’assises de la province du Hainaut.
Le 1 er février 2010, à l’ouverture de la session d’assises, M. Beuze assisté de son conseil demanda que les procès-verbaux des auditions et des interrogatoires menés sans l’assistance d’un avocat et les actes qui en découlaient fussent déclarés nuls et les poursuites irrecevables. Il soutenait que l’absence d’un avocat durant sa garde à vue, le 31 décembre 2007, ainsi que lors des auditions et interrogatoires emportait violation de ses droits de la défense et viciait irréversiblement le mandat d’arrêt. La cour d’assises rejeta la demande de déclarer les poursuites irrecevables. Elle souligna que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’entendait pas garantir de manière absolue la présence d’un avocat à tous les stades de la procédure pénale dès la première audition et qu’elle avait rappelé la nécessité de tenir compte de la procédure en son ensemble pour apprécier le respect du droit à un procès équitable. La cour d’assises constata que le requérant n’avait pas procédé à son incrimination pour les faits reprochés, qu’il n’avait allégué aucune forme de pression de la part des enquêteurs, qu’il n’avait pas été entendu en état de vulnérabilité particulière et qu’il avait pu s’exprimer librement sur les faits sans être en aucune façon contraint de s’incriminer. M. Beuze avait pu se concerter avec son avocat après chaque audition et interrogatoire pour discuter sa défense et avait eu, au cours de l’instruction, toute possibilité de discuter avec celui-ci. Il avait pu également pendant ses deux années de détention préventive, préparer sa défense en concertation avec son avocat chaque fois qu’il avait comparu devant les juridictions d’instruction mais il s’était abstenu de soulever alors l’omission qu’il dénonçait devant la cour d’assises. La cour d’assises releva que M. Beuze avait été renvoyé devant elle au vu d’indices de culpabilité résultant avant tout d’éléments étrangers à ses déclarations. Elle conclut que les droits de la défense avaient été respectés et qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité des procès-verbaux d’audition, d’interrogatoire ou des poursuites. Le 9 février 2010, à l’issue des débats, le jury déclara M. Beuze coupable notamment d’homicide volontaire avec préméditation et intention de donner la mort sur la personne de M.B. le 5 novembre 2007, et de tentative d’homicide volontaire avec préméditation et intention de donner la mort sur la personne de C.L. le 17 septembre 2007. M. Beuze se pourvut en cassation en insistant sur le droit de se faire assister par un avocat et sur le fait que durant les auditions la présence d’un avocat était rendue obligatoire par la Convention. La Cour de cassation rejeta son pourvoi par un arrêt rendu le 26 mai 2010.
CEDH
b) Principes généraux
i. Applicabilité de l’article 6 sous son volet pénal
119. La Cour rappelle que les garanties offertes par l’article 6 § 1 et 3 c) de la Convention, qui sont au cœur de la présente affaire, s’appliquent à tout « accusé » au sens autonome que revêt ce terme sur le terrain de la Convention. Il y a « accusation en matière pénale » dès lors qu’une personne se voit officiellement notifier, par les autorités compétentes, le reproche d’avoir commis une infraction pénale, ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent contre l’intéressé ont des répercussions importantes sur sa situation (Ibrahim et autres, précité, § 249, et Simeonovi, précité, §§ 110-111, et jurisprudence y citée).
ii. Méthodologie générale suivie à l’égard de l’article 6 sous son volet pénal
120. L’équité d’un procès pénal doit être assurée en toutes circonstances. Toutefois, la définition de la notion de procès équitable ne saurait être soumise à une règle unique et invariable mais elle est, au contraire, fonction des circonstances propres à chaque affaire (Ibrahim et autres, précité, § 250). Lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a globalement revêtu un caractère équitable (voir, parmi de nombreux précédents, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, §§ 94-105, 10 mars 2009, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, §§ 84, et 93‑100, CEDH 2010, Al‑Khawaja et Tahery c. Royaume Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, §§ 118, et 152-165, CEDH 2011, Dvorski, précité, §§ 81‑82, et 103‑113, Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, §§ 101, et 161‑165, CEDH 2015, Blokhin c. Russie [GC], no 47152/06, §§ 194, et 211‑216, 23 mars 2016, Lhermitte c. Belgique [GC], no 34238/09, §§ 69, et 83‑85, 29 novembre 2016, Ibrahim et autres, précité, §§ 274, 280‑294, et 301 311, Correia de Matos c. Portugal [GC], no 56402/13, §§ 118, 120, et 160-168, 4 avril 2018).
121. Ainsi que la Cour l’a relevé à maintes reprises, le respect des exigences du procès équitable s’apprécie au cas par cas à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l’examen isolé de tel ou tel point ou incident, bien que l’on ne puisse exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette de juger de l’équité du procès à un stade précoce. Pour apprécier l’équité globale d’un procès, la Cour prend en compte, s’il y a lieu, les droits minimaux énumérés à l’article 6 § 3, qui montre par des exemples ce qu’exige l’équité dans les situations procédurales qui se produisent couramment dans les affaires pénales. On peut donc voir dans ces droits des aspects particuliers de la notion de procès équitable en matière pénale contenue à l’article 6 § 1 (voir, par exemple, Salduz, précité, § 50, Al‑Khawaja et Tahery, précité, § 118, Dvorski, précité, § 76, Schatschaschwili, précité, § 100, Blokhin, précité, § 194, et Ibrahim et autres, précité, § 251).
122. Ces droits minimaux garantis par l’article 6 § 3 ne sont toutefois pas des fins en soi : leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l’équité de la procédure pénale dans son ensemble (Ibrahim et autres, précité, §§ 251 et 262, et Correia de Matos, précité, § 120).
iii. Droit d’accès à un avocat
123. Le droit reconnu par l’article 6 § 3 c) à tout « accusé » d’être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz, précité, § 51, et Ibrahim et autres, précité, § 255).
α) Point de départ du droit d’accès à un avocat
124. Le point de départ du droit d’accès à un avocat en cas de privation de liberté ne fait pas de doute. Ce droit est applicable dès qu’il existe une « accusation en matière pénale » au sens donné à cette notion par la jurisprudence de la Cour (voir paragraphe 119, ci-dessus) et, en particulier, dès l’arrestation d’un suspect, indépendamment du fait que l’intéressé ait ou non été interrogé ou qu’il ait fait l’objet d’une autre mesure d’enquête pendant la période pertinente (Simeonovi, précité, §§ 111, 114 et 121).
β) Objectifs poursuivis par le droit d’accès à un avocat
125. L’accès à un avocat durant la phase préalable au procès contribue à la prévention des erreurs judiciaires et, surtout, à la réalisation des buts poursuivis par l’article 6, notamment l’égalité des armes entre l’accusé et les autorités d’enquête ou de poursuite (Salduz, précité, §§ 53‑54, Blokhin, précité, § 198, Ibrahim et autres, précité, § 255, et Simeonovi, précité, § 112).
126. La Cour a reconnu à maintes reprises depuis l’arrêt Salduz que l’accès à bref délai à un avocat constitue un contrepoids important à la vulnérabilité des suspects en garde à vue. Un tel accès est également de nature préventive, offrant à ces derniers une protection essentielle contre la coercition et les mauvais traitements dont ils peuvent être l’objet de la part de la police (Salduz, précité, § 54, Ibrahim et autres, précité, § 255, et Simeonovi, précité, § 112).
127. Elle a par ailleurs relevé que la vulnérabilité des suspects peut se trouver amplifiée par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l’utilisation des preuves (Salduz, précité, § 54, et Ibrahim et autres, précité, § 253).
128. Enfin, l’une des tâches principales de l’avocat au stade de la garde à vue et de l’enquête consiste à veiller au respect du droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même (Salduz, précité, § 54, Dvorski, précité, § 77, et Blokhin, précité, § 198) et de garder le silence.
129. À cet égard, la Cour a considéré comme inhérent au droit de ne pas témoigner contre soi-même, au droit de garder le silence et au droit d’accès à un avocat, le droit pour tout « accusé » au sens de l’article 6 d’être informé de ces droits, sans quoi la protection offerte par ces droits ne serait pas concrète et effective (Ibrahim et autres, précité, § 272, et Simeonovi, précité, § 119 ; la complémentarité de ces droits était déjà soulignée dans John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, Brusco c. France, no 1466/07, § 54, 14 octobre 2010, et Navone et autres, précité, §§ 73‑74). Par conséquent, l’article 6 § 3 c) de la Convention doit être interprété comme garantissant le droit pour un accusé d’être informé immédiatement du contenu du droit à un avocat, indépendamment de l’âge ou de la situation particulière de l’intéressé, et indépendamment du point de savoir s’il est représenté par un avocat d’office ou un avocat de son choix (Simeonovi, précité, § 119).
130. Compte tenu de la nature du droit de ne pas témoigner contre soi‑même et du droit de garder le silence, la Cour considère que, en principe, il ne peut y avoir de justification au défaut de signification de ces droits à un suspect. Toutefois, dans l’hypothèse où l’information a fait défaut, la Cour doit rechercher si, malgré cette lacune, la procédure dans son ensemble a été équitable. L’accès immédiat à un avocat à même de fournir des renseignements sur les droits procéduraux est vraisemblablement de nature à prévenir tout manque d’équité qui découlerait de l’absence de notification officielle de ces droits. Si l’accès à un avocat est retardé, la nécessité pour les enquêteurs de signifier au suspect son droit à un avocat et son droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre soi-même prend une importance particulière (Ibrahim et autres, précité, § 273, et jurisprudence y citée).
γ) Contenu du droit d’accès à un avocat
131. L’article 6 § 3 c) ne précise pas les conditions d’exercice ni le contenu du droit d’accès à un avocat. S’il laisse aux États le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, il convient de définir les contours et le contenu dudit droit en fonction du but poursuivi par la Convention qui est de protéger des droits concrets et effectifs (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 135, CEDH 2005‑IV, Salduz, précité, § 51, Dvorski, précité, § 80, et Ibrahim et autres, précité, § 272).
132. La désignation d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé (Öcalan, précité, § 135, Sakhnovski c. Russie [GC], no 21272/03, § 95, 2 novembre 2010, et M c. Pays-Bas, no 2156/10, § 82, 25 juillet 2017 (extraits)), laquelle suppose en effet le respect des exigences minimales suivantes.
133. Premièrement, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus (paragraphe 124), le suspect doit pouvoir entrer en contact avec son avocat dès sa privation de liberté. Cela implique que le suspect puisse consulter son avocat préalablement à un interrogatoire (Brusco, précité, § 54, et A.T. c. Luxembourg, précité, §§ 86‑87), voire en l’absence d’un interrogatoire (Simeonovi, précité, §§ 111 et 121). L’avocat doit pouvoir s’entretenir avec son client en privé et en recevoir des instructions confidentielles (Lanz c. Autriche, no 24430/94, § 50, 31 janvier 2002, Öcalan, précité, § 135, Rybacki c. Pologne, no 52479/99, § 56, 13 janvier 2009, Sakhnovski, précité, § 97, et M c. Pays‑Bas, précité, § 85).
134. Deuxièmement, la Cour a jugé à plusieurs reprises que les suspects devaient bénéficier de la présence physique de leur avocat durant les auditions initiales menées par la police et durant les interrogatoires ultérieurs menés au cours de la procédure antérieure à la phase de jugement (Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00, § 87, 2 mars 2010, Brusco, précité, § 54, Mađer c. Croatie, no 56185/07, §§ 151 et 153, 21 juin 2011, Šebalj c. Croatie, no 4429/09, §§ 256-257, 28 juin 2011, et Erkapić c. Croatie, no 51198/08, § 80, 25 avril 2013). Cette présence doit permettre à l’avocat de fournir une assistance effective et concrète, et non seulement abstraite de par sa présence (A.T. c. Luxembourg, précité, § 87), et notamment de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense du suspect interrogé (John Murray, précité, § 66, et Öcalan, précité, § 131).
135. La Cour a estimé, par exemple, qu’en fonction des circonstances spécifiques à chaque espèce et du système juridique concerné, les restrictions suivantes pouvaient compromettre l’équité de la procédure :
– le défaut ou les difficultés d’accès par l’avocat au dossier pénal aux stades de l’ouverture de la procédure pénale, de l’enquête et de l’instruction (Moïsseïev c. Russie, no 62936/00, §§ 217-218, 9 octobre 2008, Sapan c. Turquie, no 17252/09, § 21, 20 septembre 2011, et, a contrario, A.T. c. Luxembourg, précité, §§ 79-84) ;
– l’absence d’un avocat lors des mesures d’enquête telles qu’une parade d’identification (Laska et Lika c. Albanie, nos 12315/04 et 17605/04, § 67, 20 avril 2010) ou une reconstitution des faits (Savaş c. Turquie, no 9762/03, § 67, 8 décembre 2009, Karadağ c. Turquie, no 12976/05, § 47, 29 juin 2010, et Galip Doğru c. Turquie, no 36001/06, § 84, 28 avril 2015).
136. Au-delà des éléments précités qui jouent un rôle crucial pour déterminer si l’accès à un avocat durant la phase préalable au procès a été concret et effectif, la Cour a indiqué qu’il fallait tenir compte, au cas par cas, dans le cadre de l’appréciation de l’équité globale de la procédure, de toute la gamme d’interventions propres au conseil : la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention (Hovanesian c. Bulgarie, no 31814/03, § 34, 21 décembre 2010, Simons, décision précitée, § 30, A.T. c. Luxembourg, précité, § 64, Adamkiewicz, précité, § 84, et Dvorski, précité, §§ 78 et 108).
iv. Articulation entre la justification de la restriction au droit d’accès à un avocat et l’équité globale de la procédure
137. Le principe selon lequel, en règle générale, tout suspect a le droit d’accès à un avocat dès son premier interrogatoire par la police a été formulé dans l’arrêt Salduz (précité, § 55) en ces termes :
« (...) pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif » (...), il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6 (...). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. »
138. L’arrêt Salduz a également précisé que l’application sur une « base systématique », à savoir sur une base législative, d’une restriction au droit de se faire assister par un avocat durant la phase préalable au procès pénal ne pouvait constituer une raison impérieuse (ibidem, § 56). Malgré l’absence de raisons impérieuses, dans cette affaire, la Cour a néanmoins analysé les conséquences de l’admission des déclarations faites par l’accusé en l’absence d’un avocat sur l’équité globale de la procédure. Elle a considéré que cette lacune n’avait pas pu être compensée par les autres garanties procédurales prévues par le droit interne (ibidem, §§ 52 et 57‑58).
139. Les étapes de l’analyse énoncées dans l’arrêt Salduz – examen de l’existence ou non de raisons impérieuses pour justifier la restriction au droit d’accès à un avocat, suivi par un examen de l’équité globale de la procédure – ont été suivies par les chambres de la Cour dans des affaires mettant en cause soit des restrictions d’origine législative ayant une portée générale et obligatoire, soit des restrictions résultant de décisions prises au cas par cas par les autorités compétentes.
140. Dans quelques affaires, qui concernaient la Turquie, la Cour ne s’est toutefois pas interrogée sur l’existence de raisons impérieuses et n’a pas davantage procédé à un examen de l’équité de la procédure, mais a constaté que les restrictions systématiques du droit d’accès à un avocat entraînaient ab initio la violation de la Convention (voir, notamment, Dayanan, précité, § 33, et Boz c. Turquie, no 2039/04, § 35, 9 février 2010). Néanmoins, dans la majorité des affaires, la Cour a opté pour une approche moins absolue, procédant à un examen tantôt bref (voir, parmi d’autres, Çarkçı c. Turquie (no 2), no 28451/08, §§ 43-46, 14 octobre 2014), tantôt détaillé de l’équité globale de la procédure (voir, parmi d’autres, A.T. c. Luxembourg, précité, §§ 72‑75).
141. Confrontée à une certaine divergence dans la démarche à suivre, la Cour a consolidé, dans l’arrêt Ibrahim et autres, le principe établi par l’arrêt Salduz, confirmant que cette démarche se déclinait en deux étapes et apportant certains éclaircissements sur chacune de ces deux étapes et sur la manière dont elles s’articulent (Ibrahim et autres, précité, §§ 257, et 258‑262).
α) Notion de raisons impérieuses
142. Le critère des « raisons impérieuses » est un critère strict, compte tenu du caractère fondamental et de l’importance d’un accès précoce des suspects à un avocat, en particulier lors de leur premier interrogatoire. Les restrictions au droit d’accès à un avocat ne sont permises que dans des cas exceptionnels, elles doivent être de nature temporaire et reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d’espèce (Salduz, précité, §§ 54 in fine et 55, et Ibrahim et autres, précité, § 258). Les raisons impérieuses ne sauraient résulter de la seule existence d’une loi interdisant la présence d’un avocat. En effet, l’existence d’une restriction au droit d’accès à un avocat de portée générale et obligatoire, ayant son origine dans la loi, ne saurait dispenser les autorités nationales de procéder à une appréciation individuelle et circonstanciée d’éventuelles raisons impérieuses.
143. La Cour a également précisé que dès lors qu’un gouvernement défendeur avait démontré de façon convaincante l’existence d’un besoin urgent de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique dans un cas donné, ce besoin pouvait s’analyser en une raison impérieuse de restreindre l’accès à un avocat aux fins de l’article 6 de la Convention (Ibrahim et autres, précité, § 259, et Simeonovi, précité, § 117).
β) Équité de la procédure dans son ensemble et relation entre les deux étapes de l’analyse
144. Dans l’arrêt Ibrahim et autres, la Cour a également confirmé que l’absence de raisons impérieuses ne suffit pas en elle-même à entraîner une violation de l’article 6. Qu’il y ait ou non des raisons impérieuses, il convient de statuer dans chaque cas sur le respect de l’équité globale de la procédure (précité, § 262). Ce dernier point revêt une importance particulière dans la présente affaire, dès lors que le requérant s’appuie sur une certaine lecture de la jurisprudence de la Cour relative au droit d’accès à un avocat (voir paragraphe 97, ci-dessus) selon laquelle l’origine législative et systématique d’une restriction audit droit suffit, en l’absence de raisons impérieuses, à conclure à un manquement aux exigences de l’article 6. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Ibrahim et autres, suivi par l’arrêt Simeonovi, la Cour a rejeté l’argument des requérants selon lequel l’arrêt Salduz pose une règle absolue de cette nature. La Cour s’est donc écartée du principe énoncé notamment dans l’affaire Dayanan ainsi que dans d’autres arrêts rendus contre la Turquie (voir paragraphe 140, ci‑dessus).
145. En l’absence de raisons impérieuses, la Cour doit évaluer l’équité du procès en opérant un contrôle très strict : une telle absence pèse lourdement dans la balance lorsqu’il s’agit d’apprécier globalement l’équité du procès et elle peut faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation. C’est alors au gouvernement défendeur qu’il incombe d’expliquer de façon convaincante pourquoi, à titre exceptionnel et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la restriction à l’accès à un avocat n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès (Ibrahim et autres, précité, § 265).
146. La Cour souligne en outre que dans l’hypothèse où l’accès à un avocat est retardé et où l’information relative au droit d’accès à un avocat et au droit de ne pas témoigner contre soi-même ainsi que de garder le silence a fait défaut, il sera encore plus difficile au gouvernement de démontrer que le procès a été équitable (Ibrahim et autres, précité, § 273 in fine).
147. Il importe enfin de rappeler que la démarche consistant à mettre l’équité de la procédure dans son ensemble au cœur de l’appréciation à effectuer n’est pas limitée au droit d’accès à un avocat prévu à l’article 6 § 3 c) mais se situe dans le cadre d’une jurisprudence plus large relative aux droits de la défense consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention (voir la jurisprudence relative à l’article 6 § 1 citée au paragraphe 120, ci‑dessus).
148. Une telle démarche correspond en outre au rôle de la Cour qui ne consiste pas à se prononcer in abstracto ni à uniformiser les différents systèmes juridiques, mais à établir des garanties assurant que les procédures suivies dans chaque cas respectent les exigences du procès équitable, eu égard aux circonstances propres à chaque accusé.
149. Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, moyennant le respect de l’équité globale du procès, les modalités d’application de l’article 6 §§ 1 et 3 c) durant la garde à vue et la procédure antérieure à la phase de jugement dépendent des particularités de celles-ci et des circonstances de la cause.
γ) Facteurs pertinents pour l’appréciation de l’équité globale de la procédure
150. Lorsque la procédure est examinée dans son ensemble de manière à mesurer les conséquences de lacunes procédurales survenues durant la phase préalable au procès sur l’équité globale du procès pénal, les facteurs non limitatifs énumérés ci-dessous, qui découlent de la jurisprudence de la Cour, doivent être pris en compte s’il y a lieu (voir Ibrahim et autres, précité, § 274, et Simeonovi, précité, § 120) :
a) la vulnérabilité particulière du requérant, par exemple en raison de son âge ou de ses capacités mentales ;
b) le dispositif légal encadrant la procédure antérieure à la phase de jugement et l’admissibilité des preuves au cours de cette phase, ainsi que le respect ou non de ce dispositif, étant entendu que, quand s’applique une règle dite d’exclusion, il est très peu vraisemblable que la procédure dans son ensemble soit jugée inéquitable ;
c) la possibilité ou non pour le requérant de contester l’authenticité des preuves recueillies et de s’opposer à leur production ;
d) la qualité des preuves et l’existence ou non de doutes quant à leur fiabilité ou à leur exactitude compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues ainsi que du degré et de la nature de toute contrainte qui aurait été exercée ;
e) lorsque les preuves ont été recueillies illégalement, l’illégalité en question et, si celle-ci procède de la violation d’un autre article de la Convention, la nature de la violation constatée ;
f) s’il s’agit d’une déposition, la nature de celle-ci et le point de savoir s’il y a eu prompte rétractation ou rectification ;
g) l’utilisation faite des preuves, et en particulier le point de savoir si elles sont une partie intégrante ou importante des pièces à charge sur lesquelles s’est fondée la condamnation, ainsi que la force des autres éléments du dossier ;
h) le point de savoir si la culpabilité a été appréciée par des magistrats professionnels, par des juges non professionnels ou par des jurés et la teneur des instructions et éclaircissements qui auraient été donnés à ces derniers ;
i) l’importance de l’intérêt public à enquêter sur l’infraction particulière en cause et à en sanctionner l’auteur ;
j) l’existence dans le droit et la pratique internes d’autres garanties procédurales.
c) Application des principes généraux aux faits de l’espèce
151. À titre liminaire, la Cour souligne que les auditions, interrogatoires et autres actes d’instruction intervenus sans que le requérant ait d’abord eu accès à un avocat et ensuite sans la présence physique de son avocat ont eu lieu avant le prononcé de l’arrêt Salduz. Cela étant, elle constate que, devant la cour d’assises, le requérant s’y est référé pour demander l’annulation des procès-verbaux des auditions et des interrogatoires menés sans cette assistance juridique. De même, la cour d’assises, dans son arrêt avant dire droit du 1er février 2010, a pris l’enseignement de l’arrêt Salduz en compte dans l’appréciation de la situation en l’espèce, et la Cour de cassation a également cherché à répondre au moyen fondé sur cette jurisprudence (voir paragraphes 37-39 et 48, ci‑dessus).
152. De plus, le procès du requérant s’est déroulé bien avant l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Ibrahim et autres. S’il y a lieu de tenir compte de cet arrêt dès lors qu’il confirme et consolide la jurisprudence Salduz, la Cour est cependant consciente des difficultés que le passage du temps et l’évolution de sa jurisprudence peuvent entraîner pour les juridictions nationales, même si s’agissant de l’article 6 §§ 1 et 3 c), cette évolution a été, depuis l’arrêt Salduz, linéaire.
153. La Cour reconnaît également les efforts entrepris par la Cour de cassation belge pour tenir compte de l’évolution de sa jurisprudence malgré les restrictions au droit d’accès à un avocat prévues à l’époque par le droit interne. En effet, ainsi que cela ressort d’un examen des arrêts pertinents rendus entre 2010 et 2011 (voir paragraphes 66-70, ci-dessus), la Cour de cassation a entendu interpréter le droit national de manière à le rendre, dans la mesure du possible, conforme au principe énoncé par l’arrêt Salduz et appliqué ultérieurement par la Cour. À cette fin, elle a cherché, pour l’essentiel, à évaluer les effets de la restriction au droit d’accès à un avocat dans le cadre d’un examen de l’équité globale de la procédure dans l’affaire concernée.
i. Existence et ampleur des restrictions
154. La Cour observe que les restrictions au droit d’accès à un avocat dont il est question en l’espèce ont été d’une ampleur particulière.
155. Le requérant n’a pas pu communiquer avec un avocat entre le moment de sa remise aux autorités belges à 10h40 le 31 décembre 2007 et l’audition par la police à 11h50, ni entre cette audition et l’interrogatoire par le juge d’instruction à 16h45 le même jour. Le droit de consulter un avocat ne lui a été reconnu, conformément à l’article 20 de la loi sur la détention préventive, qu’une fois la décision de le placer en détention préventive prise par le juge d’instruction en fin d’interrogatoire à 17h42 et l’avertissement par celui-ci de l’ordre des avocats en vue de la désignation d’un avocat (voir paragraphes 13 et 54, ci-dessus).
156. Même s’il a pu communiquer librement avec son avocat désigné par la suite, le requérant n’a pas non plus bénéficié de la présence d’un avocat au cours des auditions, interrogatoires et autres actes d’instruction qui suivirent durant la phase d’instruction. Outre que cette restriction était déduite du silence de la loi et du secret de l’instruction imposé par le CIC et donc de l’interprétation des dispositions législatives applicables à l’époque (voir paragraphes 54 et 59, ci-dessus), elle a été appliquée tout au long de la phase d’instruction. Au total, entre sa remise aux autorités belges le 31 décembre 2007 et l’arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons du 31 août 2009, le requérant a été entendu sans la présence de son avocat, au sujet des faits pour lesquels il a été condamné, à cinq reprises par la police judiciaire – exclusion faite des auditions des 6 et 7 mars 2008 relatives aux vols de voitures – , à trois reprises par le juge d’instruction, et à deux reprises par le procureur du Roi. L’avocat du requérant n’a pas non plus participé à la reconstitution des faits qui a été organisée le 6 juin 2008.
157. La Cour constate en outre qu’une incertitude existe sur le point de savoir à partir de quel moment le requérant a effectivement été en contact avec un avocat pour la préparation de sa défense, après que le juge d’instruction avait, le 31 décembre 2007, en fin de garde à vue, fait les démarches requises pour qu’un avocat soit désigné (voir paragraphe 21, ci‑dessus). Aucune mention n’est faite à ce sujet dans le procès-verbal de la première audition qui a suivi le 11 janvier 2008, ni ailleurs dans le dossier (voir paragraphe 25, ci‑dessus). La seule information certaine dont dispose la Cour figure dans le procès-verbal de l’interrogatoire par le juge d’instruction du 17 mars 2008 selon lequel le requérant avait, à ce moment‑là, fait le choix d’un avocat et l’avait rencontré (voir paragraphe 27, ci‑dessus). En réponse à des questions posées lors de l’audience, le Gouvernement n’a pas été en mesure de fournir des informations plus précises à ce sujet.
158. Eu égard à ce qui précède et aux principes généraux énoncés ci‑dessus (paragraphes 119, 125-130, et 131-136), la Cour constate que le requérant, qui pouvait prétendre à la protection de l’article 6 de la Convention dès sa remise aux autorités belges, n’a pas bénéficié du droit d’accès à un avocat en vertu de cette disposition lors de la garde à vue et que ce droit a été ensuite restreint tout au long de la phase d’instruction.
159. De l’avis de la Cour, la circonstance, sur laquelle s’appuie le Gouvernement, que le requérant a été assisté par un avocat dans le volet français de la procédure, ne change rien à ce constat. En effet, cette procédure et l’assistance juridique fournie en France ne concernaient que les questions entourant l’exécution du mandat d’arrêt européen par les autorités françaises.
ii. Existence de raisons impérieuses
160. Il n’est pas contesté qu’à l’époque des faits, les restrictions litigieuses résultaient du silence de la loi belge et de l’interprétation qui en a été faite par les juridictions internes (voir paragraphes 49-60, ci-dessus).
161. La Cour rappelle que les restrictions à l’accès à un avocat pour des raisons impérieuses ne sont permises durant la phase préalable au procès que dans des cas exceptionnels, et qu’elles doivent être de nature temporaire et reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d’espèce (voir paragraphe 142, ci-dessus). Une appréciation individuelle de cette nature était clairement absente en l’espèce, la restriction ayant été de portée générale et obligatoire.
162. Certes, la législation belge a été modifiée par la loi Salduz, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, et ensuite par la loi Salduz bis, entrée en vigueur le 27 novembre 2016. La législation ainsi modifiée confère, à certaines conditions, aux personnes entendues et aux personnes privées de liberté, des droits tels que celui de consulter un avocat préalablement à la garde à vue et le droit d’être assisté par lui pendant les auditions et les interrogatoires (voir paragraphes 72-77, ci-dessus). Force est toutefois de constater que le requérant n’a pas pu bénéficier de ces dispositions durant la phase préalable au procès.
163. Le Gouvernement n’a par ailleurs pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier les restrictions dont a fait l’objet le droit du requérant. Il n’appartient pas à la Cour d’en chercher de son propre chef (Simeonovi, précité, § 130).
164. Aucune raison impérieuse ne justifiait en l’espèce les restrictions susmentionnées.
iii. Respect de l’équité globale du procès
165. Dans de telles circonstances, la Cour doit évaluer l’équité de la procédure en opérant un contrôle très strict et ce, à plus forte raison, dans le cas de restrictions d’origine législative ayant une portée générale et obligatoire. La charge de la preuve pèse ainsi sur le Gouvernement qui, comme il en convient, doit démontrer de manière convaincante que le requérant a néanmoins bénéficié globalement d’un procès pénal équitable. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus (voir paragraphe 145, ci-dessus, et la jurisprudence y citée), l’incapacité du Gouvernement à établir des raisons impérieuses pèse lourdement dans la balance et peut faire pencher la Cour dans le sens d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c).
166. Dans cet exercice, la Cour examinera, dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, les différents facteurs découlant de sa jurisprudence tels qu’ils ressortent des arrêts Ibrahim et autres et Simeonovi et sont rappelés au paragraphe 150, ci-dessus.
α) La vulnérabilité du requérant
167. Le Gouvernement fait valoir l’absence de vulnérabilité particulière du requérant. Ce dernier soutient en revanche qu’il était vulnérable du fait de sa détention et que cette vulnérabilité était aggravée par un quotient intellectuel et des aptitudes verbales extrêmement faibles, ainsi qu’en atteste l’évaluation neuropsychologique réalisée en avril 2008 (voir paragraphe 29, ci-dessus).
168. La Cour constate, quant à elle, que cette dernière évaluation concluait que si le requérant avait des capacités intellectuelles limitées, ses raisonnements étaient néanmoins dans la norme. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que le contenu des procès‑verbaux d’auditions et d’interrogatoires attesterait qu’il aurait rencontré des difficultés pour s’exprimer. De plus, aucune autre circonstance particulière ne peut être relevée qui indiquerait que le requérant aurait été dans un état de vulnérabilité particulière plus important que celui dans lequel se trouvent généralement les personnes interrogées par des enquêteurs. Les auditions et interrogatoires menés durant la garde à vue et au cours de l’instruction n’étaient pas inhabituels ni excessifs dans leur durée.
β) Les circonstances dans lesquelles les preuves ont été obtenues
169. La Cour note que le requérant n’a allégué ni devant les juridictions nationales ni devant elle que les enquêteurs belges auraient exercé une quelconque coercition sur lui. La prétendue pression qu’auraient exercée les gendarmes français pour qu’il accuse ensuite un mineur lors de sa première audition par la police belge a été écartée par la cour d’assises. Ensuite, cette allégation a été contredite par le requérant lui‑même qui l’a attribuée à d’autres circonstances dans une version ultérieure des faits (voir paragraphes 30 et 40, ci-dessus).
γ) Le dispositif légal encadrant la procédure antérieure à la phase de jugement et l’admissibilité des preuves ainsi que la possibilité de contester les preuves recueillies et leur production
170. Le Gouvernement s’appuie sur les garanties générales dont le requérant aurait bénéficié en vertu du dispositif légal qui encadrait la phase préalable au procès à l’époque des faits, et en particulier sur le fait que, hormis durant les auditions et interrogatoires, le requérant a eu le droit de communiquer librement et de façon illimitée avec son avocat dès l’issue de la garde à vue. Ensuite, à l’exception du procès-verbal d’audition par la police le 31 décembre 2007 dont copie lui a été remise à l’issue de l’interrogatoire par le juge d’instruction, le requérant a reçu copie de tous les procès-verbaux d’audition et d’interrogatoire, ce qui lui a permis d’en discuter avec son avocat et d’élaborer sa stratégie de défense.
171. Il est vrai que ces garanties ont permis au requérant de bénéficier, pendant la phase d’instruction, des interventions propres au conseil et de préparer sa stratégie de défense. Étant donné, toutefois, que le droit belge tel qu’appliqué à la procédure dont le requérant a fait l’objet n’était pas en conformité avec les exigences de l’article 6 § 3 (voir entre autres les paragraphes 160 et 161, ci-dessus), ce ne sont pas des dispositions légales prévoyant in abstracto certaines garanties qui auraient pu assurer, à elles seules, l’équité globale de la procédure. La Cour doit en effet examiner si l’application de ces dispositions légales au cas d’espèce a eu concrètement un effet compensatoire rendant la procédure équitable dans son ensemble. Dans le cadre de cet examen, qui est le cœur de la seconde étape de l’analyse prévue par les arrêts Salduz et Ibrahim et autres, la Cour estime que l’attitude du requérant durant les auditions et les interrogatoires était susceptible d’avoir des conséquences telles pour les perspectives de sa défense ultérieure qu’il ne pouvait être assuré que l’assistance fournie ultérieurement par un avocat ou la nature contradictoire de la suite de la procédure suffiraient pour porter remède au défaut survenu durant la garde à vue (voir, mutatis mutandis, Salduz, précité, § 58). En outre, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 157 ci-dessus, il ne ressort pas du dossier à partir de quelle date le requérant a bénéficié de l’assistance juridique. S’il est clair que le conseil du requérant a changé à plusieurs reprises, le dossier ne fait toutefois pas apparaître la fréquence des consultations, ni que l’avocat aurait été prévenu des dates des auditions et des interrogatoires. Le requérant ne pouvait donc pas préparer à l’avance, avec son avocat, ses auditions et interrogatoires et il devait se contenter de rapporter à ce dernier comment l’audition ou l’interrogatoire s’était déroulé, éventuellement à l’aide du procès-verbal, et d’en tirer des conclusions pour l’avenir.
172. Toujours selon le Gouvernement, l’instruction était placée sous le contrôle de la chambre des mises en accusation qui pouvait être saisie à tout moment par le requérant pour en contester la légalité et plaider, avec l’assistance de son avocat, les irrégularités procédurales (voir paragraphe 107, ci-dessus). Cette garantie n’a cependant pas joué un rôle important en l’espèce. D’une part, le requérant n’a pas soulevé à ce stade les lacunes qu’il a ensuite dénoncées devant la cour d’assises, la Cour de cassation et la Cour et, d’autre part, les juridictions d’instruction ne se sont pas penchées, le cas échéant d’office, sur les irrégularités procédurales en cause dans la présente affaire.
173. Ainsi que cela a été rappelé dans l’arrêt Ibrahim et autres (précité, § 254), les griefs tirés, sur le terrain de l’article 6, de la phase de l’enquête se matérialisent souvent pendant la phase de jugement elle-même lorsque l’accusation demande l’admission d’éléments recueillis pendant ladite phase – phase pendant laquelle les restrictions aux droits consacrés à l’article 6 sont intervenues – et que la défense s’y oppose. De fait, en l’espèce, la recevabilité des déclarations faites par le requérant au titre de preuves a été débattue devant la cour d’assises à l’ouverture de la session d’assises le 1er février 2010. Le requérant, assisté de son conseil, a déposé des conclusions par lesquelles il sollicitait que les procès-verbaux des auditions et des interrogatoires menés sans l’assistance d’un avocat soient déclarés nuls et les poursuites déclarées irrecevables. S’appuyant sur l’arrêt Salduz, il concluait que la privation systématique du droit d’accès à un avocat dès la première audition suffisait pour constater une violation de l’article 6. Dans un arrêt rendu le même jour, la cour d’assises a rejeté la thèse du requérant et a admis l’ensemble des procès-verbaux, considérant que le requérant pourrait encore jouir d’un procès équitable devant elle malgré l’absence d’un avocat au cours des auditions et interrogatoires préalables (voir paragraphe 41, ci‑dessus).
174. Il y a toutefois lieu de constater que la cour d’assises n’a examiné plus précisément ni les procès-verbaux ni les circonstances dans lesquelles les auditions et interrogatoires litigieux se sont déroulés et les déclarations ont été recueillies (voir a contrario, Ibrahim et autres, précité, §§ 69‑84, et 282). Aussi, rien ne démontre que cette juridiction ait procédé à une analyse, pourtant nécessaire, de l’incidence de l’absence d’un avocat à des moments cruciaux de la procédure. Pareille lacune revêt d’autant plus d’importance qu’en raison de l’oralité des débats devant la cour d’assises et de l’absence de compte-rendu détaillé des audiences, il n’est pas possible d’évaluer l’impact des débats devant le jury.
175. En ce qui concerne l’évaluation faite ensuite par la Cour de cassation, le Gouvernement explique que la jurisprudence constante à l’époque, qui consistait à casser systématiquement les jugements de condamnation fondés sur des déclarations auto-incriminantes faites en l’absence d’un avocat, pouvait être assimilée à une règle d’exclusion. La Cour de cassation examinait l’incidence des auditions et interrogatoires effectués hors de la présence d’un avocat sur le déroulement équitable de la procédure et était ainsi amenée à sanctionner les juges du fond qui retenaient des déclarations auto‑accusatrices faites sans l’assistance d’un avocat (voir paragraphes 66‑70, ci-dessus).
176. La Cour constate que la Cour de cassation a cassé un arrêt pour cette raison pour la première fois le 15 décembre 2010, donc postérieurement à l’arrêt rendu en l’espèce. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a fait valoir, par exemple, la nécessité d’évaluer l’influence des éléments de preuve obtenus irrégulièrement sur l’issue de l’action publique. En l’espèce, il ne ressort pas de l’arrêt de la Cour de cassation que celle-ci ait placé son évaluation de l’équité globale de la procédure dans une telle perspective. En effet, lors de son examen du déroulement de la procédure, la Cour de cassation s’est concentrée sur l’absence de déclaration auto-incriminante pendant la garde à vue, se limitant, s’agissant du reste de la phase d’instruction pendant laquelle le droit du requérant a également été restreint, à dire qu’il n’a jamais été contraint de s’incriminer lui-même et qu’il s’est toujours exprimé librement (voir paragraphe 48, ci-dessus).
δ) La nature des dépositions
177. Selon la cour d’assises et la Cour de cassation, les déclarations faites par le requérant au cours des auditions et interrogatoires litigieux n’étaient pas auto‑incriminantes et ne comportaient pas d’aveux. Le Gouvernement se prévaut également de cette thèse.
178. La Cour rappelle toutefois que le droit de ne pas s’incriminer soi‑même ne se limite pas aux aveux au sens strict ou aux remarques mettant l’accusé directement en cause mais qu’il suffit, pour qu’il y ait auto‑incrimination, que ses déclarations soient susceptibles d’affecter substantiellement la position de celui-ci (Schmid-Laffer c. Suisse, no 41269/08, § 37, 16 juin 2015 ; voir également A.T. c. Luxembourg, précité, § 72).
179. Or, en l’espèce, s’il est vrai que le requérant n’a jamais avoué les crimes dont il était accusé et ne s’est donc pas incriminé lui-même au sens strict, il n’en reste pas moins qu’il a fait aux enquêteurs des déclarations circonstanciées qui ont orienté la conduite des auditions et interrogatoires. Il a ainsi reconnu, le 31 décembre 2007, durant la garde à vue, avoir été présent sur les lieux du crime lors de l’homicide de M.B. et avoir menacé un témoin, ce qui a été confirmé par les témoins visuels (voir paragraphe 24, ci‑dessus). Lorsqu’il a été entendu le 25 mars 2008, il a en outre déclaré que C.L. était enceinte, qu’il était seul avec elle le 17 septembre 2007 et qu’il l’avait frappée. Ces derniers éléments, ne résultant d’aucun autre témoignage que celui de la victime (voir paragraphe 28, ci-dessus), ont nécessairement affecté la position du requérant. En effet, à partir de ce moment-là, les suspicions des enquêteurs à propos des coups portés à C.L. ne pouvaient que s’avérer fondées à leurs yeux. À cela s’ajoute le fait que le requérant a, tout au long de l’instruction, changé plusieurs fois de version des faits, compromettant ainsi sa crédibilité générale, de sorte que le premier interrogatoire revêtait une importance primordiale. Rappelant que, en l’absence de raisons impérieuses justifiant les restrictions constatées, elle est appelée à opérer un contrôle très strict, la Cour considère que ces éléments doivent peser lourdement dans son appréciation de l’équité de la procédure dans son ensemble.
180. Or, le requérant se plaint que les enquêteurs sont entrés en possession des éléments qu’il a fournis le 31 décembre 2007 durant sa garde à vue, alors qu’il n’avait pas rencontré d’avocat au préalable et n’avait pas bénéficié d’une notification préalable suffisamment explicite de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même. La Cour note à ce sujet que le requérant a reçu, au début de la première audition par la police, l’information expresse selon laquelle ses déclarations pouvaient être utilisées comme preuve en justice (voir paragraphe 14, ci-dessus). Cette information, qu’il a également reçue au début de chaque audition et interrogatoire ultérieurs, était considérée comme une consécration indirecte du droit au silence en droit belge, à défaut pour la législation de l’époque de prévoir ce droit de façon explicite (voir paragraphe 54, ci-dessus).
181. Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus (paragraphes 129‑130), et sachant que le requérant n’a pas bénéficié de consultation préalable ni de la présence d’un avocat durant la garde à vue, la Cour n’est pas convaincue, dans les circonstances de l’espèce, que l’information ainsi fournie par les enquêteurs était suffisamment claire pour assurer l’effectivité du droit du requérant de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui‑même. À cet égard, elle ne peut que noter que le requérant a fait des déclarations importantes et a fait un large usage de sa faculté de sélectionner ou de cacher des faits.
ε) L’utilisation faite des preuves et, dans le cas où la culpabilité est appréciée par des jurés, la teneur des instructions et éclaircissements donnés au jury
182. Le procès s’est déroulé devant la cour d’assises, juridiction non permanente composée de magistrats professionnels et siégeant avec l’assistance d’un jury (voir Taxquet c. Belgique, no 926/05, §§ 18-21, 13 janvier 2009, et Castellino c. Belgique, no 504/08, §§ 45-47, 25 juillet 2013, pour la composition de la cour d’assises et les règles régissant la désignation des jurés ; voir Taxquet, arrêt de chambre précité, §§ 25-31, et Lhermitte, précité, §§ 40-44, pour les règles relatives au déroulement du procès en assises).
183. La lecture de l’acte d’accusation est intervenue au début du procès, avant les débats. Il exposait, sur vingt-et-une pages, la vie familiale et le parcours de vie du requérant, les faits et leur déroulement, les actes et les éléments de l’enquête, ainsi que le contenu des expertises médico‑légales. Il reprenait les éléments que le requérant avait reconnus ainsi que ses différentes versions des faits.
184. Le Gouvernement conteste l’argument du requérant selon lequel l’acte d’accusation reposait dans une large mesure sur ses déclarations. La Cour observe que l’accusation s’est aussi appuyée sur divers éléments étrangers aux déclarations du requérant et indépendants de celles-ci, à savoir les déclarations des témoins, les constatations des enquêteurs, les éléments matériels recueillis avant son arrestation et les considérations médico‑légales et psychiatriques (voir paragraphe 43, ci-dessus). Il n’en reste pas moins, ainsi qu’elle l’a relevé ci-dessus (paragraphe 178), que les déclarations faites par le requérant dès la garde à vue contenaient un récit détaillé des évènements survenus le jour de l’homicide que ses déclarations ultérieures, également circonstanciées, sont venues compléter ou contredire, et qu’il n’a jamais démenti avoir été présent sur les lieux et avoir menacé un témoin. Il a également spontanément donné des informations à propos de C.L. de nature à l’incriminer. Ces déclarations ont fourni aux enquêteurs une trame qui a nécessairement inspiré l’acte d’accusation, même s’ils disposaient déjà de certains éléments avant la première audition du requérant.
185. Sur le point de savoir si ces éléments ont ou non influencé le délibéré et la décision à laquelle le jury est finalement parvenu, la Cour tient compte de ce que l’acte d’accusation a une portée limitée pour la compréhension du verdict du jury, puisqu’il intervient avant les débats qui seuls doivent permettre aux jurés de se forger leur intime conviction (Taxquet [GC], précité, § 95, et Lhermitte, précité, § 77).
186. Cela étant dit, en l’espèce, le jury a retenu la préméditation du requérant dans la tentative d’homicide de C.L., laquelle a pu être établie au moyen notamment de ses déclarations (voir paragraphes 45 et 179, ci‑dessus). La Cour accorde un poids considérable à ce constat qui lui permet de regarder les déclarations faites par le requérant sans la présence d’un avocat comme une partie intégrante des preuves sur lesquelles repose la condamnation du requérant pour ce chef d’accusation.
187. S’agissant des autres chefs d’accusation, et en particulier l’accusation principale du meurtre de M.B., la Cour convient avec le Gouvernement que le jury a retenu d’autres éléments étrangers aux déclarations du requérant, à savoir, les témoignages constants et concordants des jeunes gens qui n’ont vu que l’accusé et sa victime sur les lieux, hors la présence de toute autre personne, les menaces préalablement émises par l’accusé contre sa victime et les différents actes posés par lui en vue de la préparation du crime commis (voir paragraphe 45, ci-dessus).
188. Cela étant, la Cour relève, à l’examen du procès-verbal de l’audience du 1er février 2010, que le président de la cour d’assises n’a énoncé aucune mise en garde quant au poids à attribuer aux nombreuses déclarations du requérant dans le cadre de leur délibéré. S’il est vrai qu’il faut tenir compte des particularités de la procédure devant les cours d’assises avec la participation d’un jury populaire, qui décide seul de la culpabilité de l’accusé, la Cour rappelle avoir souligné, dans le contexte d’affaires concernant la compréhension par l’accusé de la motivation du verdict, l’importance des instructions ou éclaircissements donnés par le président de la cour d’assises aux jurés quant aux problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits (Taxquet [GC], précité, § 92, et Lhermitte, précité, § 68). Les instructions et éclaircissements donnés au jury peuvent revêtir de l’importance afin de permettre à ses membres de mesurer les conséquences de lacunes procédurales survenues au stade de l’enquête sur l’équité du procès pénal (Ibrahim et autres, précité, §§ 274, 292 et 310). Or, et malgré l’effort fait pour apprécier l’équité de la procédure dans son ensemble au vu de la jurisprudence à l’époque récente de la Cour (voir paragraphe 48, ci‑dessus), dans le cadre de son examen de l’espèce, la Cour de cassation ne semble pas avoir pris en considération l’impact sur la décision du jury de la circonstance que ce dernier n’avait pas été informé d’éléments qui pourraient le guider dans l’appréciation de la portée des déclarations faites par le requérant sans l’assistance d’un avocat.
189. Aussi la Cour estime-t-elle que le défaut total en l’espèce d’instructions et d’éclaircissements donnés au jury quant à la manière d’apprécier les déclarations du requérant par rapport aux autres éléments du dossier et leur valeur probante, alors qu’elles avaient été recueillies en l’absence d’un avocat et, s’agissant des déclarations faites en garde à vue, sans que le requérant ait reçu une information suffisamment claire de son droit de garder le silence, est une carence importante.
ζ) L’importance de l’intérêt public
190. Il ne fait aucun doute que de solides considérations d’intérêt public justifiaient la poursuite du requérant, celui-ci étant poursuivi notamment pour un homicide et de tentatives d’homicide.
η) L’existence dans le droit et la pratique internes d’autres garanties procédurales.
191. La Cour constate qu’à l’époque, la Cour de cassation belge tenait compte d’une série de garanties procédurales qui résultaient du droit belge pour apprécier la conformité à la Convention des restrictions légales à l’accès à un avocat pendant la garde à vue (voir paragraphes 48 et 67).
192. Ainsi que la Cour l’a souligné au paragraphe 171, ce n’est pas l’existence en soi de garanties prévues in abstracto par des dispositions légales qui peut assurer l’équité globale de la procédure. Seul l’examen de leur application au cas d’espèce permettait de déterminer si la procédure était équitable dans son ensemble. En tout état de cause, la Cour a pris en compte dans son examen de la présente espèce l’ensemble de ces garanties mentionnées par la Cour de cassation (paragraphes 165-190, ci-dessous).
θ) Conclusion quant au respect de l’équité de la procédure dans son ensemble
193. En conclusion, rappelant le caractère très strict du contrôle auquel elle doit procéder en l’absence de raisons impérieuses justifiant la restriction du droit d’accès, la Cour estime que la procédure pénale menée à l’égard du requérant, considérée dans son ensemble, n’a pas permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la phase préalable au procès, parmi lesquelles les suivantes apparaissent particulièrement importantes :
– les restrictions au droit du requérant à l’accès à un avocat ont été d’une ampleur particulière ; il a été interrogé durant sa garde à vue sans consultation préalable ni présence d’un avocat et a ensuite été interrogé durant l’instruction hors de la présence de son avocat, lequel n’a pas non plus participé aux autres actes de l’instruction ;
– dans ces circonstances, et sans information préalable suffisamment claire du droit de garder le silence, le requérant a fait au cours de la garde à vue des déclarations circonstanciées ; il a ensuite présenté des versions différentes des faits et a fait des déclarations qui, si elles n’étaient pas auto‑incriminantes au sens strict du terme, ont affecté substantiellement sa position en ce qui concerne notamment le chef d’accusation de tentative d’homicide sur la personne de C.L. ;
– l’ensemble desdites déclarations ont été admises par la cour d’assises au titre de preuves sans que la juridiction ait procédé à un examen adéquat des circonstances dans lesquelles les déclarations avaient été recueillies ni de l’incidence de l’absence d’un avocat ;
– si la Cour de cassation a examiné la recevabilité des poursuites, cherchant en outre à vérifier si le droit à un procès équitable a été respecté, elle s’est concentrée sur l’absence d’un avocat durant la garde à vue sans apprécier les conséquences pour les droits de la défense du requérant de l’absence de son avocat lors des auditions, des interrogatoires et des autres actes qui ont eu lieu pendant l’instruction ;
– les déclarations faites par le requérant ont occupé une place importante dans l’acte de l’accusation, et, s’agissant du chef de tentative d’homicide sur la personne de C.L., ont fait partie intégrante des preuves sur lesquelles reposait la condamnation du requérant ;
– dans la procédure devant la cour d’assises, les jurés n’ont reçu aucune instruction ni éclaircissement quant à la manière d’apprécier les déclarations du requérant et leur valeur probante.
194. La Cour estime important de souligner, comme elle l’a fait dans d’autres affaires relatives à l’article 6 § 1 de la Convention dans lesquelles un examen de l’équité globale de la procédure était en cause, qu’elle ne doit pas s’ériger en juge de quatrième instance (Schatschaschwili, précité, § 124). Lors de l’examen de l’équité globale de la procédure tel que celui exigé par l’article 6 § 1, elle est toutefois appelée à examiner soigneusement le déroulement de la procédure au niveau interne, un contrôle très strict s’imposant lorsque la restriction au droit d’accès à un avocat ne repose sur aucune raison impérieuse. En l’espèce, c’est la conjonction des différents facteurs précités et non chacun d’eux pris isolément qui a rendu la procédure inéquitable dans son ensemble.
iv. Conclusion générale
195. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
Borg c. Malte du 12 janvier 2016 requête no 37537/13
Violation de l'article 6 : La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu par le passé à des violations de la Convention en raison du fait que, parce que ce n’était pas possible en vertu du droit en vigueur à l’époque dans l’État concerné, le requérant n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat en garde à vue.
Elle observe aussi que le requérant n’avait pas renoncé à son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat à ce stade de la procédure – il ne jouissait pas de ce droit. Le gouvernement maltais n’a pas contesté qu’à l’époque des faits, le droit maltais interdisait à tous les individus accusés d’une infraction de bénéficier de l’assistance d’un avocat avant le procès. Il s’ensuit que le requérant a été privé de ce droit en raison d’une restriction systémique applicable à tous les accusés. En elle-même, cette situation n’est pas conforme à la règle impérative découlant de l’article 6 selon laquelle le droit à l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires policiers ne peut faire l’objet de restrictions que pour des motifs impérieux.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1.
Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief selon lequel le fait que les deux témoins qui ont déposé contre le requérant n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat aurait rendu le procès inéquitable.
La Cour note que l’interprétation de sa jurisprudence relative au droit à l’assistance d’un avocat en garde à vue faite par la Cour constitutionnelle maltaise a effectivement changé à partir de 2012 et que, en conséquence, un certain nombre de personnes ont, du fait de cette interdiction systémique appliquée à Malte, été privées de l’assistance d’un avocat lorsqu’elles ont été entendues, et ont ensuite fait l’objet d’une décision de justice défavorable. Elle souligne cependant que, comme elle l’a déjà dit dans de précédentes affaires, un tel revirement de jurisprudence relève de la marge d’appréciation des juridictions nationales en l’absence d’arbitraire de leur part. Elle conclut que la présente affaire ne fait pas apparaître de problème de sécurité juridique. Partant, il n’y a pas eu violation de l'article 6 § 1.
GALİP DOĞRU c. TURQUIE du 28 avril 2015 requête 36001/16
Violation de l'article 6-1 de la Convention : L'avocat doit assister à tous les actes d'enquête durant la garde à vue.
81. Le Gouvernement indique que le requérant a rencontré son avocat le 16 février 2003, le deuxième jour de sa garde à vue, et il fait observer que sa déposition a été recueillie par la police le jour suivant. Il ajoute que, devant le procureur de la République, le requérant a fait usage de son droit de garder le silence. Il en conclut que les allégations du requérant quant à l’absence d’un avocat sont mal fondées.
82. Le requérant rétorque que, s’il s’est entretenu avec son avocat le 16 février 2003, celui-ci n’était présent ni lorsque la police a recueilli sa déposition le 17 février 2003 ni lorsqu’il a été entendu par le procureur de la République.
83. La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur le grief tiré de l’absence d’un avocat durant la garde à vue d’un requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 et 3 c) de la Convention de ce fait (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 45-63, CEDH 2008). De même, elle rappelle avoir précisé que l’équité de la procédure requiert qu’un accusé puisse bénéficier de toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil (Dayanan c. Turquie, no 7377/03, § 32, 13 octobre 2009). À cet égard, l’absence d’un avocat lors de l’accomplissement des actes d’enquête constitue un manquement aux exigences de l’article 6 de la Convention (voir, notamment, İbrahim Öztürk c. Turquie, no 16500/04, §§ 48‑49, 17 février 2009, et Karadağ c. Turquie, no 12976/05, § 46, 29 juin 2010).
84. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour constate que le requérant a pu s’entretenir avec un avocat et bénéficier de l’assistance de celui‑ci durant une partie de sa garde à vue. Cela étant, au vu des pièces du dossier, il apparaît que l’intéressé n’a pas bénéficié d’une telle assistance à l’occasion de certains actes de procédure accomplis durant sa garde à vue, tels que le transport sur les lieux avec reconstitution des faits et sa déposition faite à la police. Le Gouvernement ne fournit par ailleurs aucune explication quant aux raisons d’être de ce défaut d’assistance.
85. Ayant examiné la présente affaire à la lumière des principes définis dans sa jurisprudence (paragraphe 83 ci-dessus), la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.
NAVONE ET AUTRES c. MONACO du 24 octobre 2013
Requêtes n° 62880/11 62892/11 62899/11
L'avocat est refusé durant la garde à vue
77. La Cour rappelle que la personne placée en garde à vue doit bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat dès le début de cette mesure, ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori, comme cela vient d’être rappelé, lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir, notamment, Salduz, précité, §§ 50-62, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010, et Brusco, précité, §§ 45 et 54).
78. Elle a ainsi jugé que l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil (Dayanan, précité, § 32). A cet égard, l’absence d’un avocat lors de l’accomplissement des actes d’enquêtes constitue un manquement aux exigences de l’article 6 (voir, en particulier, İbrahim Öztürk c. Turquie, no 16500/04, §§ 48-49, 17 février 2009, et Karadag c. Turquie, no 12976/05, § 46, 29 juin 2010).
79. La Cour souligne à ce titre qu’elle a plusieurs fois précisé que l’assistance d’un avocat durant la garde à vue doit notamment s’entendre, au sens de l’article 6 de la Convention, comme l’assistance « pendant les interrogatoires » (Karabil c. Turquie, no 5256/02, § 44, 16 juin 2009, Ümit Aydin c. Turquie, no 33735/02, § 47, 5 janvier 2010, et Boz, précité, § 34), et ce dès le premier interrogatoire (Salduz, précité, § 55, et Brusco, précité, § 54).
80. Par ailleurs, elle a déjà jugé qu’une application systématique de dispositions légales pertinentes qui excluent la possibilité d’être assisté par un avocat pendant les interrogatoires suffit, en soi, à conclure à un manquement aux exigences de l’article 6 de la Convention (voir, en premier lieu, Salduz, précité, §§ 56 et 61-62).
81. Or, en l’espèce, nul ne conteste qu’à l’époque des faits, le droit monégasque ne permettait pas aux personnes gardées à vue de bénéficier d’une assistance d’un avocat pendant les interrogatoires : une telle assistance était donc automatiquement exclue en raison des dispositions légales pertinentes. La Cour relève en effet que le droit interne ne prévoyait qu’une consultation avec un avocat au début de la garde à vue ou de la prolongation de celle-ci, pendant une heure maximum, l’avocat étant en tout état de cause exclu des interrogatoires dans tous les cas (paragraphes 14, 21 et 39 ci-dessus).
82. La Cour note que la situation a depuis été modifiée, dans un premier temps par une note du Procureur général en date du 30 mai 2011 (paragraphe 40 ci-dessus), puis par l’adoption de la loi no 1.399 portant réforme du code de procédure pénale en matière de garde à vue, adoptée le 25 juin 2013 (paragraphe 41 ci-dessus). Aux termes de celles-ci, l’avocat peut dorénavant assister la personne gardée à vue tout au long de la mesure, y compris pendant les interrogatoires. Force est cependant de constater que les requérants, dont la garde à vue était antérieure, n’ont pu bénéficier ni des mesures transitoires instituées par la note du 30 mai 2011 ni des nouvelles dispositions législatives.
83. Par conséquent, la Cour ne peut que constater que les requérants ont été automatiquement privés de l’assistance d’un conseil au sens de l’article 6 lors de leur garde à vue, la loi en vigueur à l’époque pertinente faisant obstacle à leur présence durant les interrogatoires (voir, parmi d’autres, Salduz, précité, §§ 27-28, Dayanan, précité, § 33, et Boz, précité, § 35). Dans ces conditions, la question de la renonciation au droit à l’assistance d’un avocat est sans objet.
84. La Cour rappelle enfin qu’elle a déjà jugé que, du fait de l’automaticité de la privation d’un tel droit en raison de la loi, la violation de l’article 6 est acquise, y compris lorsque le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue (Dayanan, précité). Un tel constat vaut donc, a fortiori, lorsque la personne gardée à vue a fait des déclarations circonstanciées, fut-ce pour nier les faits qui lui sont reprochés, à l’instar de M. Re en l’espèce, et ce même si le requérant a eu l’occasion de contester les preuves à charge à son procès devant les juridictions nationales (Savaş c. Turquie, no 9762/03, § 70, 8 décembre 2009). Il s’ensuit, concernant M. Re, qu’il ne saurait lui être opposé la perte de la qualité de victime du fait de l’annulation du procès-verbal de premier interrogatoire par la police, la possibilité d’une assistance d’un avocat durant les interrogatoires ultérieurs - détaillés et cadencés de telle sorte qu’il existe un lien étroit entre eux comme le relève le gouvernement italien - n’ayant pas été prévue par le droit interne applicable. Il convient donc de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement à ce titre.
85. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1.
AKSİN ET AUTRES c. TURQUIE du 1er octobre 2013 Requête 4447/05
Quand le requérant refuse l'assistance d'un avocat durant la garde à vue il ne peut plus se plaindre ensuite.
45. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants. En se référant aux faits, il soutient qu’il leur a été rappelé qu’ils pouvaient se faire
assister par un avocat de leur choix ou commis d’office. Le Gouvernement explique que les requérants ont déclaré ne pas vouloir être assistés par un avocat. Enfin, il précise que devant la cour d’assises et la Cour de cassation, les requérants étaient assistés par un avocat et qu’ils ont bénéficié de toutes les possibilités pour se défendre.46. La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-54, 27 novembre 2008). A cet égard, elle rappelle que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz, précité, § 55).
47. Toutefois, la Cour note que dans la présente affaire – qui se distingue en cela de l’affaire Salduz – l’absence d’avocat lors de la garde à vue du requérant n’était pas le résultat d’une application sur une base systématique des dispositions légales pertinentes. En l’espèce, les requérants avaient en principe le droit de demander l’assistance d’un avocat.
48. Cela étant, la Cour rappelle que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable (Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000, et Ananyev c. Russie, no 20292/04, § 38, 30 juillet 2009). Toutefois, pour être effective aux fins de la Convention, la renonciation au droit de prendre part au procès doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Salduz, précité, § 59).
49. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour note que les requérants ne contestent pas que le droit d’être assistés par un avocat leur a été rappelé pendant la garde à vue. A cet égard, il ressort du procès-verbal des interrogatoires que les requérants ont été avisés de leur droit de se faire assister par un avocat (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour observe que les requérants ont également refusé l’assistance d’un avocat déclarant vouloir se défendre eux-mêmes, devant le procureur et le juge de paix qui les a placés en détention provisoire. La Cour constate que dès l’ouverture de la procédure pénale et tout au long de celle-ci les requérants ont été assistés par un avocat. La Cour observe en dernier lieu que leurs allégations de mauvais traitements ont été examinées par la cour d’assises et jugées infondées (paragraphe 19 ci-dessus). Enfin, la Cour note que leur condamnation se fonde aussi bien sur leurs aveux réitérés et jugés sincères que sur d’autres preuves matérielles (mutatis mutandis, Coşar, précité, § 52).
50. Ainsi, alors qu’ils avaient droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue, les requérants ont refusé de se faire assister par un avocat. Il ressort clairement de leurs dépositions obtenues lors de la garde à vue que le choix des intéressés de renoncer à leur droit d’être assistés par un avocat doit être considéré comme libre et volontaire. Leur renonciation à ce droit était non équivoque et était bien entourée d’un minimum de garanties (Yoldaş, précité, § 52, 23 février 2010, a contrario, Padalov c. Bulgarie, no 54784/00, § 54, 10 août 2006, et Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 73, CEDH 2004‑IV).
51. Dans ces conditions, à la lumière des éléments en sa possession et des observations des parties, un examen global de la procédure amène la Cour à conclure que les requérants n’ont pas été privés d’un procès équitable au sens du paragraphe 1 combiné avec le paragraphe 3 c) de l’article 6 de la Convention.
52. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
VASSIS et autres c. FRANCE du 27 juin 2013 Requête no 62736/09
La Cour a rappelé que le contrôle juridictionnel lors de la première comparution d’une personne arrêtée devait être rapide et automatique afin de détecter tout mauvais traitement et de réduire les atteinte injustifiées à la liberté individuelle, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation.
2. Appréciation de la Cour
52. La Cour rappelle que, dans son arrêt Medvedyev et autres, la Grande Chambre s’est exprimée comme suit :
« 117. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l’importante série de justifications prévues par d’autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l’accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l’importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l’article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).
118. La Cour rappelle également l’importance des garanties de l’article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62‑63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).
119. L’article 5 § 3, en tant qu’il s’inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n’ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).
120. Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l’espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu’il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d’avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s’exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :
i. Promptitude
121. Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l’individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l’article 5 § 3, même dans le contexte spécial d’enquêtes sur des infractions terroristes).
ii. Caractère automatique du contrôle
122. Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d’une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l’article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu’une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l’impossibilité de saisir le juge d’une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d’autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d’une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).
iii. Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat
123. Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l’expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).
124. Le magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d’autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l’affaire Schiesser précitée (§ 31) :
« (...) [A] cela s’ajoutent, d’après l’article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l’obligation d’entendre personnellement l’individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d’examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).
125. Le contrôle automatique initial portant sur l’arrestation et la détention doit donc permettre d’examiner les questions de régularité et celle de savoir s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c’est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l’article 5 § 1 c). S’il n’en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d’ordonner la libération (McKay précité, § 40). »
53. La Cour relève d’emblée qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de se prononcer sur le point de savoir si les magistrats du ministère public peuvent être qualifiés de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens autonome des dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention, cette question ayant été tranchée dans son arrêt Moulin c. France (no 37104/06, 23 novembre 2010), mais de vérifier le respect par les autorités internes de l’exigence de promptitude qu’expriment les termes « aussitôt traduite » de l’article 5 § 3. Sur ce point, elle précise que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’intervention d’un membre du ministère public au début et pendant le déroulement de la garde à vue ne soulève pas, en soi, de difficulté, pourvu que la personne gardée à vue soit ensuite présentée à un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » dans un délai conforme aux exigences de l’article 5 § 3.
54. La Cour rappelle qu’elle a déjà admis, dans sa décision Rigopoulos (précitée) et son arrêt Medvedyev et autres (précité), que la détention d’un équipage le temps de son convoiement vers un port de l’Etat défendeur, pendant seize et treize jours respectivement, n’était pas incompatible avec la notion d’« aussitôt traduit » énoncée à l’article 5 § 3 de la Convention, compte tenu de l’existence de « circonstances tout à fait exceptionnelles » qui justifiaient un tel délai.
55. En l’espèce, la Cour relève qu’au moment de son interception, le Junior se trouvait lui aussi en haute mer, au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest, à des milliers de kilomètres des côtes françaises. Par ailleurs, rien n’indique que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu notamment de ce que le Junior est un navire initialement conçu pour le cabotage le long des côtes, et non pour naviguer sur de longues distances. En outre, les requérants se contentent d’évoquer la proximité des côtes sénégalaises le 11 février 2008 et l’existence d’une convention de coopération judiciaire entre la France et le Sénégal, sans accompagner leur propos d’aucun développement à ce titre. Quant aux autres hypothèses, il n’appartient pas à la Cour d’évaluer leur faisabilité dans les circonstances de la cause (Medvedyev et autres, précité, § 131).
56. Cependant, si la Cour a déjà jugé qu’une durée de deux ou trois jours avant la présentation à « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » répondait à l’exigence de promptitude qu’expriment les termes « aussitôt traduite », cela concernait des affaires dans lesquelles le début de la garde à vue coïncidait avec le début de la privation de liberté (voir, parmi d’autres, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 51, CEDH 1999-III, Ayaz et autres c. Turquie (déc.), no 11804/02, 27 mai 2004, et İkincisoy c. Turquie, no 26144/95, § 103, 27 juillet 2004). Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il faut examiner chaque cas d’espèce au regard de ses caractéristiques particulières (voir, notamment, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 52, série A no 77).
57. La Cour souligne ensuite que, dans l’affaire Rigopoulos (précitée), la privation de liberté subie par le requérant, qu’il s’agisse de son placement immédiat en garde à vue ou de la détention provisoire décidée au terme de la période légale de garde à vue, s’est déroulée sous le contrôle du tribunal central d’instruction de Madrid, une juridiction d’instruction spécialisée et indépendante de l’exécutif, qui a effectivement procédé à un contrôle juridictionnel de cette privation de liberté. Les membres de l’équipage du Winner (Medvedyev et autres, précité) avaient pour leur part été rapidement présentés aux juges d’instruction en charge de la procédure à l’issue de la traversée, à savoir entre huit et neuf heures après le début de leur garde à vue en France.
58. Or, en l’espèce, la garde à vue a succédé à une période de dix-huit jours de privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention (Medvedyev et autres, §§ 73-75). Malgré l’importance de ce délai, les requérants n’ont finalement comparu pour la première fois devant un « juge ou un autre magistrat », au sens autonome de l’article 5 § 3 de la Convention, en l’espèce un JLD, qu’après un délai supplémentaire d’environ quarante-huit heures, le commandant de bord du Ravi ayant été en mesure de remettre l’ensemble des éléments saisis, des actes rédigés, ainsi que les neuf membres d’équipage et le Junior lui-même au procureur de la République de Brest le 25 février 2008 à partir de 9 heures 45 (paragraphe 12 ci-dessus), ce qui suppose nécessairement une arrivée antérieure dans le port de Brest, les requérants ayant ensuite été placés en garde à vue à 10 heures 50 (paragraphe 14 ci-dessus) et leur présentation aux JLD ayant été mentionnée dans un procès-verbal rédigé le 27 février 2008 à 9 heures 30 (paragraphe 16 ci-dessus).
59. Aux yeux de la Cour, rien ne saurait justifier un tel délai supplémentaire d’environ quarante-huit heures dans les circonstances de l’espèce.
60. En effet, il apparaît tout d’abord que, non seulement l’opération d’interception était planifiée, mais encore que le Junior, soupçonné de se livrer au trafic international de stupéfiants, faisait l’objet d’une surveillance particulière depuis le mois de janvier 2008, notamment de la DEA, puis de l’OCRTIS. Certes, une interrogation pouvait subsister quant au moment de l’interception et quant au résultat de celle-ci. En revanche, il ne fait aucun doute, aux yeux de la Cour, qu’un délai de dix-huit jours pour l’acheminement des requérants permettait de préparer leur arrivée sur le territoire français en toute connaissance de cause. Or, non seulement un tel délai, sans contrôle juridictionnel, prive de justification la garde à vue de quarante-huit heures à laquelle les requérants ont ensuite été soumis mais, en outre, il constitue une circonstance particulière rendant l’exigence de promptitude, prévue à l’article 5 § 3 de la Convention, plus stricte que lorsque le début de la garde à vue coïncide avec la privation de liberté. Partant, les requérants auraient dû être traduits, dès leur arrivée en France et sans délai, devant un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
61. En particulier, elle rappelle que sa jurisprudence relative à des délais de deux ou trois jours, pour lesquels elle a pu juger que l’absence de comparution devant un juge n’était pas contraire à l’exigence de promptitude, n’a pas pour finalité de permettre aux autorités d’approfondir leur enquête et de réunir les indices graves et concordants susceptibles de conduire à la mise en examen des requérants par un juge d’instruction, au motif notamment qu’ils nieraient les faits qui leur sont reprochés. On ne saurait donc en déduire une quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités internes un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l’accusation : en effet, le but poursuivi par l’article 5 § 3 de la Convention est de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de protéger l’individu, par un contrôle automatique initial, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation (Medvedyev et autres, précité, § 121).
62. Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce à compter de l’arrivée des requérants en France, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Carine Simons C. Belgique irrecevabilité du 28 août 2012 requête n°71407/10
Le droit de se faire assister d'un avocat en garde à vue est protégé par l'article 6 et non pas l'article 5-1 de la Convention. En l'espèce comme la procédure en droit interne n'est pas terminée, l'article 6 ne peut être examinée. La CEDH ne peut qu'examiner l'article 5-1 qui n'a pas pour objet de protéger l'assistance d'un avocat. La requête est donc prématurée et par conséquent, irrecevable.
17. La requérante se plaint du fait qu’en raison de l’insuffisance du droit belge, elle n’était assistée par un avocat ni lors de sa garde à vue et de son audition par la police, ni lors de son premier interrogatoire par le juge d’instruction, et n’a pas été informée de son droit de se taire. Elle voit là une violation des articles 5 § 1 et 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, combinés ou pris isolément, aux termes desquels :
Article 5 § 1
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) ».
Article 6 §§ 1 et 3 c)
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) ».
18. Selon la Cour, prise sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, la requête est en tout état de cause prématurée. Elle constate en effet que la procédure interne est pendante au stade de l’instruction. Or, d’une part, la conformité d’un procès aux principes fixés à l’article 6 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de l’ensemble du procès (voir, parmi d’autres, Mitterrand c. France (déc.), no 39344/04, 7 novembre 2006). D’autre part, un « accusé » ne peut se dire victime d’une violation de son droit à un procès équitable en l’absence de déclaration de culpabilité et de condamnation (voir, par exemple, Bouglame c. Belgique (déc.), no 16147/08, 2 mars 2010).
La Cour déduit de ce qui précède que, prise sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
19. Il reste à examiner la question du respect de l’article 5 § 1 de la Convention.
20. A cet égard, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Il précise qu’il ne reproche pas à la requérante de ne pas s’être pourvue en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège du 3 juin 2010, mais d’avoir attendu l’ordonnance du 12 mai 2010 pour saisir cette juridiction de ses moyens tirés de la Convention. Il indique qu’elle aurait pu, dès le 14 mars 2010, demander sur ce fondement la mainlevée du mandat d’arrêt délivré contre elle à cette date ; elle aurait pu également le faire lorsqu’elle a comparu assistée de son avocat les 18 mars, 14 avril et 12 mai 2010 devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège, aux fin d’examen de la régularité du mandat d’arrêt puis de son renouvellement, ainsi que dans le cadre d’un appel contre les ordonnances des 18 mars et 14 avril 2010. Le Gouvernement ajoute que la requérante avait de plus la possibilité de saisir les juridictions interne d’une action en réparation du dommage qu’elle prétend avoir subi sur le fondement de l’article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive, qui ouvre un droit à réparation à toute personne qui a été privée de liberté dans des conditions contraires à l’article 5 de la Convention, ou dans le cadre d’une action en responsabilité de l’Etat pour faute du pouvoir législatif.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il souligne que la détention subie par la requérante correspond à l’hypothèse envisagée par l’article 5 § 1 c), et soutient que rien ne permet de considérer qu’elle n’était pas conforme aux « voies légales », au sens de cette disposition. Sur ce dernier point, il indique que, comme l’ont constaté les juridictions internes, la requérante a été détenue dans le respect des règles relatives à la détention préventive, lesquelles sont « claires et prévisibles dans leurs effets », de telle sorte que le principe de sécurité juridique est préservé. Il ajoute que la requérante a bénéficié de « garanties procédurales et substantielles » tout au long de sa détention, qui l’ont protégée contre tout risque de privation arbitraire de liberté : dès son audition par la police, le 13 mars 2010, elle a été informée, conformément à l’article 47 bis du code d’instruction criminelle, du fait que ses déclarations pouvaient être utilisées comme preuve de justice, qu’elle pouvait demander que toutes les questions et ses réponses soient actées dans les termes utilisés ou qu’il soit procédé à tel acte d’information complémentaire ou à une audition, qu’elle pouvait utiliser les documents en sa possession et exiger qu’ils soient joints au dossier ou déposés au greffe ; elle a reçu copie du procès-verbal de son audition ; elle a été entendue par un juge d’instruction indépendant et impartial dès le 14 mars 2010, qui l’a informée de ses droits dont celui de « choisir un avocat » pour la suite de la procédure ; elle a ensuite, les 18 mars, 14 avril et 12 mai, assistée de son avocat, comparu devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège afin qu’il statue sur son maintien en détention, et avait la possibilité d’interjeter appel des décisions prises. Le Gouvernement fait en outre valoir que la requérante ne prétend pas avoir subi des pressions lors de la première phase de sa détention destinées à la faire avouer, qu’elle avait elle-même spontanément reconnu les faits avant son audition initiale, qu’elle n’a demandé l’assistance d’un avocat ni à ce moment ni lors de son premier interrogatoire par le juge d’instruction et qu’elle n’a pas rétracté ses aveux.
21. S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la requérante réplique que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être pourvue en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège du 3 juin 2010 : d’une part, parce que cet arrêt ordonnait sa mise en liberté provisoire et qu’il ressort de l’article 31 de la loi sur la détention préventive que seuls peuvent faire l’objet d’un pourvoi les arrêts maintenant la détention préventive ; d’autre part, parce qu’il se serait de toute façon heurté à la constante jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’impossibilité d’être assisté par un avocat au cours de la garde à vue et de l’interrogatoire par le juge d’instruction qui suit celle-ci n’est pas contraire aux articles 5 et 6 de la Convention. Quant aux recours en responsabilité évoqués par le Gouvernement, ils ne seraient pas envisageables au stade de l’instruction, la responsabilité de magistrats ne pouvant être mise en cause par ce biais avant la clôture définitive de l’action publique.
Sur le fond, la requérante rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que les mots « selon les voies légales », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, renvoient au droit interne et exigent qu’il soit conforme à la Convention, y compris aux principes énoncés ou impliqués par elle. Selon la requérante, cela inclut les principes jurisprudentiels relatifs au droit à un procès équitable, dont celui résultant des arrêts Salduz (précité), Dayanan (précité) et Brusco c. France (no 7466/07, 14 octobre 2010) et de la décision Bouglame (précitée), selon lequel un « accusé » doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de sa privation de liberté. Elle rappelle tout particulièrement à cet égard que la Cour a jugé dans la décision Bouglame précitée que le fait que, comme en Belgique, le refus d’accès à un avocat, dans ce contexte est la conséquence de l’application sur une base systématique de dispositions légales, suffit pour conclure à un manquement aux exigences de l’article 6. La requérante invite en conséquence la Cour à conclure à la violation de l’article 5 § 1.
22. La Cour rappelle tout d’abord que l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention n’implique l’utilisation des voies de droit que pour autant qu’elles sont efficaces ou suffisantes, c’est-à-dire susceptibles de remédier à la situation dénoncée. Ainsi, en principe, s’agissant de griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention, seuls les recours visant à obtenir la cessation de la privation de liberté dont l’irrégularité au regard de cette disposition est alléguée sont à utiliser à cette fin. En corollaire, lorsque la privation de liberté n’a pas pris fin, ne constitue pas une voie de recours interne à épuiser s’agissant d’un tel grief, une action dont l’objet est la réparation du dommage résultant de la privation de liberté litigieuse (voir, notamment, De Donder et De Clippel c. Belgique, no 8595/06, § 100, 6 décembre 2006 et Włoch c. Pologne (déc.), no 27785/95, 30 mars 2000). Le Gouvernement ne peut donc valablement reprocher à la requérante de ne pas avoir usé de ce type de recours.
23. La Cour rappelle ensuite que la finalité de l’article 35 § 1 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi de nombreux autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII, et Slimani c. France, no 57671/00, § 38, CEDH 2004‑IX). Ce qui importe aux fins de cette disposition, c’est que les requérants aient donné cette opportunité aux juridictions internes en usant d’une voie de recours appropriée.
En l’espèce, la requérante a saisi la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège en appel de l’ordonnance du 12 mai 2010 qui maintenait son placement en détention préventive. Se référant aux arrêts Salduz et Dayanan précités ainsi qu’à la décision Bouglame précitée, son conseil a fait valoir que la circonstance qu’elle n’avait bénéficié de l’assistance d’un avocat ni lors de son audition ni lors de son premier interrogatoire par le juge d’instruction caractérisait une violation du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ainsi que de l’article 5 § 1 de la Convention, et a requis sur ce fondement la mise en liberté de sa cliente (paragraphe 7 ci-dessus). Ce faisant, il a mis la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège en mesure de se prononcer sur le grief dont la Cour est à présent saisie et, si elle avait constaté une violation de l’article 5 § 1 la Convention, de redresser celle-ci en ordonnant la libération de la requérante. La chambre des mises en accusation a au demeurant procédé à un examen de ce grief, qu’elle a rejeté en renvoyant aux motifs développés par l’avocat général (paragraphes 8-9 ci-dessus). La circonstance que la requérante a attendu jusqu’au 12 mai 2010 pour user de cette voie n’est pas déterminante s’agissant d’une allégation de violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
24. Au vu de ce qui précède et prenant acte du fait que le Gouvernement ne reproche pas à la requérante de ne pas s’être pourvue en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 3 juin 2010, ainsi que des explications de l’intéressée à cet égard, la Cour conclut au rejet de l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes.
25. Cela étant, la Cour constate que la requérante n’a eu la possibilité d’être assistée d’un avocat ni durant la garde à vue dont elle a fait l’objet et son audition par la police, ni durant son premier interrogatoire par le juge d’instruction. Comme la Cour l’a constaté dans la décision Bouglame précitée, cela résulte de « l’état de la législation en vigueur, à savoir l’article 16 § 2 de la loi du 20 juillet 1990 [relative à la détention préventive] qui ne prévoit pas l’assistance d’un avocat au cours de l’interrogatoire par le juge d’instruction [qui suit la garde à vue] ou avant celui-ci ».
26. La Cour rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 5 § 1, nul ne peut être privé de sa liberté que dans les cas qu’il énumère et « selon les voies légales ».
27. S’agissant du premier point, la Cour relève que la privation de liberté dont il est question en l’espèce relève indubitablement de l’article 5 § 1 c) de la Convention, qui prévoit notamment la détention d’un individu en vue de le conduire devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction. Cela n’a d’ailleurs pas prêté à controverse entre les parties.
28. Quant aux mots « selon les voies légales », la Cour rappelle qu’ils se réfèrent pour l’essentiel à la législation nationale : ils consacrent l’obligation de suivre la procédure fixée par celle-ci (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 45, Série A no 33) tout comme d’en observer les normes de fond (arrêt Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil des arrêts et décisions, 1998-VI). Il faut en outre que le droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux « principes généraux énoncés ou impliqués par elle » (arrêt Winterwerp, mêmes références).
La thèse de la requérante consiste ainsi à dire qu’en ce qu’il ne permet pas aux personnes privées de liberté de bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue et au cours de leur interrogatoire consécutif par le juge d’instruction, le droit belge ignore un de ces principes, de sorte que la condition de respect des « voies légales » posée par l’article 5 § 1 n’est pas remplie.
29. La question qui se pose à la Cour en l’espèce est donc celle de savoir si la Convention implique un « principe général » selon lequel toute personne privée de liberté doit avoir la possibilité d’être assisté d’un avocat dès le début de sa détention.
30. La Cour rappelle à cet égard que dans l’arrêt Salduz précité, elle a jugé que, pour qu’il demeure suffisamment « concret et effectif », le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 implique « en règle générale » que l’accès à un avocat soit consenti « dès le premier interrogatoire » par la police, « sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ». Elle a précisé que même dans un tel cas, le refus de l’accès à un avocat ne devait pas indûment préjudicier aux droits découlant de l’article 6, et qu’ « il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation » (§ 55). Elle a conclu à une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) nonobstant le fait que le requérant avait par la suite bénéficié de l’assistance d’un avocat et d’une procédure contradictoire, après avoir notamment relevé que la restriction au droit d’accès à un avocat dont il était question relevait de l’application systématique de dispositions légales (§§ 56 et 61).
Dans l’arrêt Dayanan précité (§§ 31-33), la Cour a confirmé que « l’équité d’une procédure pénale requiert d’une manière générale, aux fins de l’article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire », et indépendamment des interrogatoires qu’il subit. Elle a souligné à cet égard que « l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil », indiquant que « la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer ». Elle a jugé que le fait que le requérant n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un conseil lors de sa garde à vue parce que la loi y faisait obstacle de manière systématique suffisait pour conclure à un manquement aux exigences de l’article 6 de la Convention, alors même que le requérant avait gardé le silence au cours de sa garde à vue (voir aussi la décision Bouglame précitée, et les arrêts Boz c. Turquie, no 2039/04, § 35, 9 février 2010 et Fidanci c. Turquie, no 17730/07, §§ 37-38, 12 janvier 2008). Dans l’arrêt Brusco précité (§§ 45 et 54), la Cour a ajouté que le droit de la personne placée en garde à vue d’être assisté d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires vaut a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire.
31. De cette jurisprudence résulte incontestablement le principe suivant : d’une part, un « accusé », au sens de l’article 6 de la Convention, a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de sa garde à vue ou de sa détention provisoire et, le cas échéant, lors de ses interrogatoires par la police et le juge d’instruction ; d’autre part, si une restriction à ce droit peut dans certaines circonstances se trouver justifiée et être compatible avec les exigences de cette disposition (voir, pour un exemple, Hovanesian c. Bulgarie, no 31814/03, 21 décembre 2010), le fait que son exercice est impossible en raison d’une règle de droit interne systématique est inconciliable avec le droit à un procès équitable.
32. La Cour observe toutefois qu’il s’agit là d’un principe propre au droit à un procès équitable, qui trouve son fondement spécifique dans le troisième paragraphe de l’article 6 de la Convention, lequel envisage en particulier le droit de tout « accusé » d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix. Il ne s’agit pas d’un « principe général » impliqué par la Convention, les principes de cette nature étant par définition transversaux.
La Cour rappelle au surplus que les principes généraux impliqués par la Convention auxquelles renvoie la jurisprudence relative à l’article 5 § 1 sont le principe de la prééminence du droit (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004‑VII) et, lié au précédent, celui de la sécurité juridique (voir, parmi d’autres, Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 52, CEDH 2000‑III), le principe de proportionnalité (voir, par exemple, Enhorn c. Suède, no 56529/00, § 36, CEDH 2005-I) et le principe de protection contre l’arbitraire (la protection contre l’arbitraire étant de plus le but de l’article 5 ; voir, notamment, Erkalo précité, § 52).
33. Ainsi, si l’impossibilité légale pour un « accusé » privé de liberté d’être assisté par un avocat dès le début de sa détention affecte l’équité de la procédure pénale dont il est l’objet, on ne peut déduire de cette seule circonstance que sa détention est contraire à l’article 5 § 1 de la Convention en ce qu’elle ne répondrait pas à l’exigence de légalité inhérente à cette disposition.
34. Il résulte de ce qui précède que, prise sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
DİRİÖZ c. TURQUIE du 31 mai 2012 requête n° 38560/04
Si le prévenu renonce à un avocat durant la garde à vue, il ne peut pas se plaindre par la suite.
28. Le requérant soutient avoir demandé l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, sans apporter d’explication sur le fait d’avoir signé une déclaration refusant cette assistance.
29. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. En se référant aux faits, il soutient que dès que le requérant a été placé en garde à vue, il a été informé des charges retenues à son encontre ainsi que de ses droits. Il lui a été rappelé qu’il pouvait se faire assister par un avocat de son choix ou commis d’office et faire informer sa famille. Le Gouvernement explique que le requérant a déclaré avoir compris ses droits et ne pas vouloir être assisté par un avocat. Enfin, il précise que devant le procureur puis la cour d’assises et la Cour de cassation, le requérant était assisté par un avocat.
30. La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-54, CEDH 2008). A cet égard, elle rappelle que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz, précité, § 55).
31. Toutefois, à la différence de l’affaire Salduz, la Cour note que dans la présente affaire l’absence d’avocat lors de la garde à vue de l’intéressé n’était pas le résultat d’une application sur une base systématique des dispositions légales pertinentes. En l’espèce, la législation pertinente, à savoir l’article 144 du code de procédure pénale garantissait à l’intéressé le droit de demander l’assistance d’un avocat.
32. A cet égard, la Cour rappelle que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable (Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000, et Ananyev c. Russie, no 20292/04, § 38, 30 juillet 2009). Toutefois, pour être effective aux fins de la Convention, la renonciation au droit de prendre part au procès doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Salduz, précité § 59 ; Yoldaş c. Turquie, no 27503/04, § 51, 23 février 2010 ; Trymbach c. Ukraine, no 44385/02, § 61, 12 janvier 2012).
33. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour note que le droit du requérant d’être assisté par un avocat lui a été rappelé pendant sa garde à vue. A cet égard, la police a établi un procès-verbal faisant état de ses droits pendant la garde à vue, en particulier, celui de se faire assister par un avocat (paragraphe 8 ci-dessus). Après lecture du procès-verbal, un exemplaire signé par le requérant lui a été remis. En outre, la police a également rappelé à l’intéressé qu’il avait le droit de demander à ce que sa famille soit informée.
34. Le requérant a toutefois coché la case indiquant qu’il ne souhaitait pas être assisté par un avocat et signé le formulaire (paragraphe 9 ci-dessus).
35. La Cour retient que le requérant avait droit à l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue et que, bien que ce droit lui ait été rappelé, il a refusé de se faire assister par un avocat. Partant, la renonciation du requérant à ce droit était non équivoque et entourée du minimum de garanties requis (Yoldaş, précité, § 52). La Cour note à cet égard que le requérant n’étaye aucunement son allégation selon laquelle il avait bien demandé l’assistance d’un avocat, ni n’explique pour quel motif il a signé une déclaration attestant du contraire.
36. Par ailleurs, force est de constater que le requérant a déposé dans le même sens sans contester les faits qui lui étaient reprochés ni le contenu de ses dépositions devant le juge et le procureur de la République. Le requérant s’est en effet borné à contester la qualification des faits par les juges, sans remettre en cause sa version des faits qui est restée identique du début à la fin de la procédure. Partant, la Cour considère que les juges du fond ont sauvegardé scrupuleusement les droits de défense du requérant et qu’aucun élément de la procédure ne permet de suspecter que la renonciation du requérant à l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue n’était pas libre ou restait équivoque (Yoldaş, précité, § 53).
37. Dans ces conditions, à la lumière des éléments en sa possession et des observations des parties, un examen global de la procédure amène la Cour à conclure que le requérant ne s’est pas vu privé d’un procès équitable au sens du paragraphe 1 combiné avec le paragraphe 3 c) de l’article 6 de la Convention.
38. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
Mader C. Croatie du 21 juin 2011 Requête 56185/07
Suspect privé de sommeil et de nourriture, et interrogé par la police sans être assisté par un avocat
Principaux faits
Le requérant, Josip Mađer, est un ressortissant croate né en 1950 et purgeant actuellement une peine d’emprisonnement pour meurtre à la prison d’État de Lepoglava (Croatie).
Le 1er juin 2004, au petit matin, M. Mađer fut conduit au Département de la police de Zagreb. Si les documents soumis à la Cour ne précisent pas quel traitement lui a été réservé pendant les 25 heures consécutives à son arrestation, il ne prête pas à controverse qu’il est resté au poste de police. Au matin du 2 juin, il fut formellement arrêté au motif qu’il était soupçonné d’avoir tué un homme (dont le corps fut retrouvé le lendemain). Selon le procès-verbal de police, le 3 juin en fin de soirée un avocat fut appelé aux fins de la défense de M. Mađer ; l’interrogatoire de police commença à minuit passé, le 4 juin, après l’arrivée de l’avocat. Pendant cet interrogatoire, M. Mađer avoua le meurtre. Le même jour, il fut mis en accusation, conduit devant un magistrat instructeur en présence d’un avocat choisi par lui, puis transféré en prison ; aucune blessure ne fut signalée dans le registre médical de la prison.
Pendant la procédure qui s’ensuivit, M. Mađer fut représenté par un avocat commis d’office. Lors de la première audience, en décembre 2004, il plaida non coupable et, par la suite, déclara devant le tribunal qu’il n’avait pris connaissance du contenu de la déposition qu’il était censé avoir livrée à la police que lorsqu’il avait consulté le dossier de l’affaire, qu’à l’époque de l’interrogatoire il souffrait de diabète et d’hypertension et n’avait pas reçu ses médicaments, qu’on ne lui avait rien donné à manger pendant 20 heures et qu’il n’avait pas dormi pendant près de trois jours. Il se plaignit également d’avoir subi des mauvais traitements et d’avoir été forcé à rester assis sur une chaise durant tout l’interrogatoire de police, et du fait que sa prétendue déposition, signée de sa main, ne lui avait pas été lue à haute voix malgré son incapacité à la lire lui-même sans ses lunettes.
Lors d’une autre audience, M. Mađer se plaignit également devant le tribunal qu’aucun avocat n’eût été présent pendant l’interrogatoire. Le tribunal entendit un certain nombre de témoins, notamment l’un des policiers qui avaient interrogé M. Mađer et l’avocat que l’on avait appelé le 3 juin afin qu’il assistât à l’interrogatoire. Ce dernier attesta que M. Mađer avait été interrogé et avait livré des aveux avant son arrivée, mais que, lorsque le procès-verbal manuscrit avait été dicté à la dactylo en sa présence, le policier avait fait confirmer la déposition par M. Mađer, lequel n’avait pas formulé d’objections. A la suite de ces auditions, le tribunal rejeta la demande du nouvel avocat de M. Mađer tendant à ce que le procès-verbal d’interrogatoire fût écarté du dossier ; cette décision fut confirmée par la Cour suprême, qui estima que M. Mađer avait été interrogé en présence d’un avocat et avait été informé de ses droits à caractère procédural.
En janvier 2006, la juridiction de jugement, s’appuyant principalement sur les aveux que M. Mađer avait livrés à la police, déclara le requérant coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et le condamna à une peine de vingt-huit ans d’emprisonnement. Ce jugement fut confirmé par la Cour suprême en septembre 2006.
En mars 2009, la Cour constitutionnelle rejeta le recours formé par M. Mađer contre ledit jugement.
Article 3
La Cour estime qu’un certain nombre d’éléments donnent de la crédibilité à la thèse de M. Mađer. Singulièrement, son premier interrogatoire a eu lieu hors de la présence d’un avocat. Sa mise en détention formelle n’a été enregistrée qu’un jour après son arrivée au Département de la police. De plus, lors de son audition devant la juridiction de jugement, le policier qui avait interrogé M. Mađer n’a pas réfuté les allégations de mauvais traitements. La Cour note par ailleurs que la police n’a pas consigné d’informations précisant à quel moment M. Mađer avait été interrogé et à quel moment il avait été autorisé à dormir ou à s’alimenter. Dans ce contexte, et en l’absence de toute inscription officielle, la Cour admet la véracité des allégations de M. Mađer. Elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour indiquer qu’il a aussi été frappé par la police, mais estime que le traitement infligé a été assez sévère pour pouvoir être considéré comme un traitement inhumain. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3.
En se plaignant devant la juridiction de jugement, M. Mađer s’est conformé à son devoir de porter à la connaissance des autorités compétentes ses allégations de mauvais traitements. Aucune enquête officielle n’a été ouverte, alors que lesdites allégations étaient graves et appelaient un examen approfondi. Si la juridiction de jugement a entendu des témoins au sujet des circonstances de l’interrogatoire de M. Mađer par la police, les témoignages en question n’ont porté que sur la période postérieure à l’arrivée de l’avocat. La période comprise entre le 1er juin et la fin de la soirée du 3 juin n’a donné lieu à aucune évaluation. La Cour conclut qu’il y a également eu violation de l’article 3 sous son volet procédural en raison du défaut d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par M. Mađer.
Article 6
En ce qui concerne le grief relatif au défaut d’assistance juridique pendant l’interrogatoire de police, la Cour relève que M. Mađer a bénéficié de l’assistance d’un avocat à partir de 1 heure du matin environ, le 4 juin 2004. Même si la Cour se fonde sur le procès-verbal indiquant que M. Mađer a été arrêté le 2 juin, il demeure que pendant son premier interrogatoire de police il n’a pas été assisté par un défenseur. Ses aveux, qu’il a livrés sans avoir consulté un avocat, ont été utilisés lors de la procédure et sont largement à l’origine de sa condamnation.
S’il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur l’incidence que l’accès à un avocat lors de la garde à vue aurait eue sur la procédure consécutive, il est clair que ni l’assistance ultérieure d’un avocat ni le caractère contradictoire de la procédure n’étaient à même de remédier aux défaillances qui ont marqué l’interrogatoire initial. Par ailleurs, M. Mađer n’avait pas renoncé à son droit à l’assistance d’un défenseur pendant l’interrogatoire de police, puisqu’il s’est plaint de l’absence de cette assistance dès les débuts de la procédure. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 3 combiné avec l’article 6 § 1.
S’agissant du grief de M. Mađer selon lequel l’assistance d’un défenseur lui aurait fait défaut pendant son procès, la Cour note en revanche que l’avocat commis d’office ayant représenté M. Mađer pendant cette phase de la procédure a assisté à toutes les audiences de la juridiction de jugement et y a participé activement en formulant des propositions pertinentes et en interrogeant les témoins. Il a demandé que le procès verbal de police contenant les aveux de M. Mađer fût écarté du dossier et a déposé un recours contre le rejet de ladite demande. Il a par ailleurs interjeté appel du jugement de première instance.
Etant donné que le procès-verbal contenant les prétendus aveux de M. Mađer faisait partie intégrante du dossier de l’affaire, l’avocat a eu la possibilité, même sans consulter M. Mađer en personne, d’étudier le dossier et de préparer la défense sur cette base. Si, au stade de l’appel, M. Mađer a été représenté par un autre avocat – cette fois choisi par lui –, celui-ci n’a pas, dans son recours, avancé de nouveaux arguments non formulés précédemment par l’avocat commis d’office. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 pour ce qui concerne la représentation de M. Mađer lors de son procès.
NECHIPORUK ET YONKALO C UKRAINE REQUETE 42310/04 DU 21 AVRIL 2011
Torture durant une garde à vue sans avocat et détention irrégulière d’un suspect
Principaux faits
Les requérants sont deux ressortissants ukrainiens, Ivan Nechiporuk, né en 1982, qui purge actuellement une peine de 15 années de prison à Kolomïa, et son épouse, Natalya Yonkalo, née en 1981 et résidant à Kharkov (Ukraine).
Le 20 mai 2004, M. Nechiporuk fut appréhendé par la police et placé en « détention administrative » au motif qu’il était soupçonné de détenir des drogues illicites. Il est indiqué dans une note rédigée par l’un des policiers qui procédèrent à son arrestation qu’il se comportait de manière suspecte sur la voie publique. Ses proches ne furent pas informés de l’endroit où il se trouvait. Pendant sa première nuit au poste de police, deux policiers l’auraient exhorté, en le menaçant de recourir à la violence, à reconnaître le meurtre d’une femme qui avait été abattue par des personnes armées sur le seuil de son appartement à Khmelnytskï une semaine auparavant. Ayant refusé de reconnaître ce meurtre, il aurait été menotté et suspendu à une barre métallique, puis on lui aurait administré des décharges électriques aux chevilles et au coccyx. Les policiers l’auraient ensuite battu et menacé d’infliger les mêmes traitements à sa femme, qui était enceinte de huit mois et avait également été arrêtée pour être interrogée. M. Nechiporuk rédigea alors, selon lui sous la dictée d’un policier, des aveux dans lesquels il avouait avoir commis le meurtre avec un complice.
M. Nechiporuk dénonça les mauvais traitements allégués devant le parquet de la ville de Khmelnytskï et devant le tribunal qui examina ensuite la demande du procureur tendant
à son placement en détention provisoire. Ses proches et son avocat répétèrent ces allégations devant le procureur. Trois jours après les faits allégués, il fut examiné par un médecin légiste qui constata qu’il présentait des blessures aux chevilles, blessures qu’il estima toutefois « non caractéristiques ». Le médecin exprima par ailleurs des doutes quant à la plausibilité des allégations de M. Nechiporuk. Ces doutes furent confirmés dans un autre rapport médical établi quelques semaines plus tard. En juin 2004, le parquet décida de classer sans suite pour manque de preuves l’action engagée contre les policiers. A cette fin, il s’appuya principalement sur l’interrogatoire des policiers impliqués et sur les rapports médicaux. M. Nechiporuk contesta cette décision, qui fut annulée puis confirmée à trois reprises. Sa plainte fut versée au dossier de l’affaire relative aux poursuites pénales dirigées contre lui (voir ci-dessous). En juin 2005, deux experts d’un centre médico-légal privé, nommés par l’avocat de M. Nechiporuk, rendirent un rapport dans lequel ils concluaient notamment que les lésions qu’il présentait pouvaient avoir été causées par des fils électriques. Ce rapport fut présenté au tribunal examinant son affaire à cette époque.
Entre-temps, trois jours après sa première arrestation, en mai 2004, M. Nechiporuk fit l’objet d’une autre procédure pénale, pour agression visant à commettre un vol et un meurtre crapuleux. Le tribunal ordonna son placement en détention provisoire compte tenu de la gravité des charges retenues contre lui et du risque qu’il s’enfuie ou fasse obstruction à la justice. Le même jour, M. Nechiporuk revint sur ses aveux, affirmant qu’ils lui avaient été extorqués par la force. Cependant, deux jours plus tard, il les réitéra, prétendument après avoir été à nouveau battu par les policiers. Il répéta ensuite ces aveux en présence de son avocat. Les faits furent requalifiés en coups et blessures ayant entraîné la mort, et M. Nechiporuk fut acquitté en mai 2005 par le tribunal du fond, qui jugea notamment que ses aveux lui avaient été extorqués par la force.
Les proches de la victime ayant fait appel, le tribunal régional annula l’acquittement et renvoya l’affaire devant un autre tribunal du premier degré de la même région, lequel transmit l’affaire au procureur, en soulignant les nombreux manquements de l’enquête et en particulier le fait que les aveux de M. Nechiporuk et de son coaccusé et les dépositions des témoins n’étaient pas cohérents. En novembre 2006, M. Nechiporuk fut à nouveau arrêté par l’enquêteur et gardé à vue pendant deux jours pour assassinat. Après qu’il eut été formellement inculpé, le tribunal ordonna son placement en détention provisoire à la demande du procureur. Cette détention provisoire fut prolongée à deux reprises.
En août 2007, le tribunal régional jugea M. Nechiporuk coupable de plusieurs infractions dont un assassinat crapuleux commis en réunion, et le condamna à quinze années d’emprisonnement. Ce verdict reposait notamment sur le témoignage obtenu d’un chauffeur de taxi alors que celui-ci se trouvait en détention administrative pour infraction liée à la drogue. Ce chauffeur avait dit reconnaître M. Nechiporuk et avait indiqué qu’il avait emmené deux passagers à l’immeuble où le crime avait été commis, qu’il les y avait attendus environ une demi-heure et qu’il les avait ensuite remmenés. Le tribunal tint également compte du témoignage du fils de la victime et des aveux passés par M. Nechiporuk aux premiers stades de la procédure. Il estima par ailleurs que les allégations de mauvais traitements formulées par l’intéressé n’étaient appuyées par aucun élément tangible.
M. Nechiporuk recourut contre cette décision, se plaignant en particulier qu’il n’ait pas été tenu compte du rapport médico-légal qui corroborait ses allégations de torture à l’électricité et que le témoignage du chauffeur de taxi ait changé radicalement avec le temps, à son détriment et dans des circonstances suspectes. Il souligna que le dossier contenait une transcription – que le tribunal avait refusé de recevoir à titre de preuve – d’une conversation entre lui et le chauffeur de taxi, dans laquelle celui-ci disait que la police l’avait forcé à témoigner contre les accusés, dont M. Nechiporuk. En mars 2008, la Cour suprême confirma le verdict de culpabilité, essentiellement sur le fondement des
aveux passés par l’intéressé pendant l’instruction, y compris ceux formulés en présence de son avocat. Quant aux allégations de mauvais traitements, elle considéra, au vu de l’enregistrement vidéo des activités d’investigation, que l’accusé avait reconnu les faits librement, que ses aveux étaient circonstanciés et qu’il ne présentait pas de lésions corporelles.
Dans une procédure distincte, la femme de M. Nechiporuk dénonça sa propre détention le jour de l’interrogatoire de mai 2004. Le parquet n’ouvrit pas de poursuites.
Article 3
Il ne fait pas controverse entre les parties que deux examens médico-légaux réalisés à la demande de l’enquêteur trois jours puis deux semaines environ après les faits ont permis de constater des lésions sur le corps du requérant. La Cour n’est pas convaincue par l’explication du Gouvernement, fondée sur les documents médicaux officiels, selon laquelle ces lésions « peuvent avoir été causées par des instruments contondants », sans qu’il soit donné plus de détails. Elle n’admet pas non plus la thèse selon laquelle le fait que M. Nechiporuk ne se soit pas plaint des mauvais traitements allégués auprès de la direction de la maison d’arrêt où il était détenu rendrait moins plausibles les allégations en question : en effet, il a très bien pu craindre d’engager une telle démarche compte tenu du lien structurel entre l’administration de l’établissement et la police. L’important est qu’il ait rapidement porté ses griefs à l’attention des autorités de poursuite.
Compte tenu de cela et du manquement des autorités à contester ou à expliquer les éléments médicaux corroborant les allégations de mauvais traitements à l’électricité portées par M. Nechiporuk, la Cour juge établi au niveau de preuve requis dans les procédures fondées sur la Convention que les lésions constatées dans les rapports médicaux résultaient des traitements dénoncés par l’intéressé et que le Gouvernement en est responsable. Etant donné, d’une part, que le requérant a reconnu le meurtre pour la première fois alors qu’il avait officiellement été arrêté pour une infraction sans aucun rapport et qu’il a allégué avoir été battu par la police avant de réitérer ces aveux, la Cour juge probable que les policiers l’aient maltraité à dessein, dans le but de lui extorquer des aveux. Etant donné, d’autre part, que son épouse, enceinte, était détenue en même temps que lui, son allégation selon laquelle les policiers l’avaient menacé de la torturer est plausible. Ces menaces ont dû accroître considérablement sa souffrance morale.
A la lumière de ces considérations, la Cour estime que M. Nechiporuk a subi de très graves et cruelles souffrances qui peuvent être qualifiées de torture. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de ce chef.
Bien qu’il n’ait jamais été contesté que M. Nechiporuk avait été blessé alors qu’il se trouvait aux mains de la police, les autorités se sont toujours bornées à estimer que ses allégations de torture à l’électricité n’étaient pas plausibles. Ses recours contre le classement sans suite de sa plainte contre les policiers ont été rejetés notamment au prétexte que la question serait examinée lors de son propre procès. La Cour ne voit pas bien l’opportunité de cette approche, étant donné que la procédure pénale devait aboutir à le juger innocent ou coupable des charges retenues contre lui et non à imputer la responsabilité des violences alléguées ou à réparer une éventuelle violation de l’article 3.
Elle juge par ailleurs singulier que la juridiction du fond ait ignoré totalement les conclusions des experts du centre médical privé qui corroboraient les allégations de M. Nechiporuk. Lorsqu’elle a ensuite examiné l’affaire, la Cour suprême a limité son analyse à l’enregistrement vidéo des activités d’enquête, dans lequel aucune lésion n’apparaissait, et cela lui a suffi à conclure que le grief n’était pas fondé. La Cour considère que, globalement, M. Nechiporuk n’a pas bénéficié d’une enquête effective sur ses allégations de mauvais traitements aux mains de la police. Il y a donc eu violation du volet procédural de l’article 3.
Article 5
La Cour constate plusieurs violations du droit à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 5 § 1 dans le chef de M. Nechiporuk, en raison de la détention de l’intéressé pendant cinq périodes distinctes entre 2004 et 2007.
Notamment, alors que sa première détention de trois jours en mai 2004 était due selon les rapports de la police au fait qu’il était soupçonné d’avoir commis une infraction administrative, il a été traité pendant cette détention comme un suspect dans une affaire de meurtre, au mépris de ses droits procéduraux, notamment son droit à la défense. Sa deuxième période de détention de trois jours était contraire aux garanties posées dans la législation nationale, qui ne permettait de détenir un individu en l’absence d’une décision de justice motivée que pour un maximum de trois jours et en réponse à la nécessité urgente d’empêcher la commission d’une infraction. Le même défaut entache sa détention de novembre 2006, également appliquée en l’absence d’une décision de justice motivée. Sa détention provisoire ultérieure ordonnée par une décision de justice reposait sur des motifs qui ne semblent pas valables étant donné que ni la gravité des charges retenues contre lui ni le risque qu’il s’enfuie n’étaient devenus plus importants : cette décision n’est donc pas dénuée d’arbitraire.
En ce qui concerne les deux périodes de détention ordonnées par des décisions de justice en 2004-2005 et en 2007, les tribunaux n’ont pas motivé leurs décisions ni fixé de limites de temps. La législation en vigueur à l’époque n’imposait certes pas de le faire, mais la Cour a été amenée pour cette raison à constater des violations de l’article 5 relativement à d’autres griefs analogues formulés contre l’Ukraine. Un autre problème structurel réside dans le fait que la détention du requérant pendant environ un mois en 2007, après la clôture de l’instruction, ne reposait sur aucune décision, le droit interne de fixant pas alors de règles claires régissant cette situation.
La Cour constate également une violation dans le chef du requérant du droit d’être informé à bref délai des charges retenues contre lui garanti par l’article 5 § 2 : les soupçons pesant sur lui ne lui ont pas été communiqués clairement au moment de sa première arrestation, et il a été traité comme un suspect dans une affaire de meurtre alors qu’il était officiellement détenu parce qu’il était soupçonné d’avoir commis une infraction administrative.
Sa première détention de six jours a également emporté violation du droit d’être « aussitôt traduit devant un juge » garanti par l’article 5 § 3, et la durée globale de sa détention provisoire, soit un total d’un an et huit mois, a emporté violation du droit « d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure » garanti par la même disposition.
Il y a eu en outre violation de l’article 5 § 4 en raison de l’impossibilité pour le requérant d’obtenir qu’un juge statue à bref délai sur la légalité de sa détention pendant la procédure. En particulier, il n’existait pas de dispositions claires et prévisibles qui auraient prévu un contrôle juridictionnel de la détention pendant la phase de jugement.
Enfin, M. Nechiporuk a subi une violation du droit à indemnisation garanti par l’article 5 § 5 en cas de détention contraire aux droits protégés par la Convention, la législation interne ne prévoyant pas de droit exécutoire à réparation pour les cas tels que le sien.
Article 6
Les premiers aveux de M. Nechiporuk, qui lui ont été extorqués au moyen de mauvais traitements constitutifs de torture au sens de l’article 3, ont été admis à titre de preuve dans son procès. Aux yeux de la Cour, une telle situation anéantit la substance même du droit de ne pas s’accuser soi-même, indépendamment du poids des aveux en question au regard de l’ensemble des preuves à partir desquelles la condamnation est prononcée et du fait que l’intéressé ait réitéré ces aveux plusieurs fois au cours de l’enquête. Il y a donc eu violation du droit de ne pas s’accuser soi-même garanti par l’article 6 § 1.
Les parties ne contestent pas que M. Nechiporuk n’a pas eu d’avocat pendant les trois premiers jours de sa détention. En le traitant comme un suspect pénal alors qu’ils l’avaient officiellement placé en détention administrative, les policiers l’ont privé du droit d’être assisté d’un avocat, contournant ainsi la législation interne qui leur aurait fait obligation de le laisser voir un avocat s’il avait été arrêté pour l’infraction relativement à laquelle ils l’ont interrogé. Le requérant a reconnu le meurtre plusieurs fois au début de son interrogatoire, alors qu’il n’était pas assisté par un avocat, et le fait de ne pas avoir pu voir un avocat immédiatement lui a indéniablement été préjudiciable puisque ces aveux ont ensuite été utilisés pour le condamner. Les premières atteintes à ses droits de la défense n’ont pas été réparées au cours du procès, les tribunaux n’ayant pas dûment examiné ses allégations de mauvais traitements. Partant, la Cour conclut à la violation des droits de la défense garantis par l’article 6 § 3 c).
Enfin, la Cour est frappée par le caractère inapproprié des réactions des juridictions internes face aux arguments qu’a exposés M. Nechiporuk relativement à la déposition du témoin clé. Les juges n’ont pas dit un mot sur le fait incontesté que le témoin se trouvait en détention administrative au moment de sa déposition et ils ont ignoré l’enregistrement retranscrivant la conversation au cours de laquelle il aurait admis avoir porté de fausses accusations contre M. Nechiporuk sous la pression de la police. En n’examinant pas ces arguments précis et importants, ils ont manqué à leurs obligations au titre de l’article 6 § 1. Le raisonnement des juridictions internes a donc emporté violation de cet article.
Article 41
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que l’Ukraine doit verser au requérant 35 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 13 594 EUR pour frais et dépens.
FRANCE MOULIN C. FRANCE DU 23 NOVEMBRE 2010 requête 37104/06
Le procureur n'est pas un magistrat indépendant et ne peut contrôler seul une garde à vue
46. La Cour rappelle que, dans son arrêt Medvedyev et autres c. France ([GC], no 3394/03, CEDH 2010-...), elle s'est exprimée comme suit :
« 117. La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l'importante série de justifications prévues par d'autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l'accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).
118. La Cour rappelle également l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).
119. L'article 5 § 3, en tant qu'il s'inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).
120. Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l'espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :
i. Promptitude
121. Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes).
ii. Caractère automatique du contrôle
122. Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d'une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l'article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu'une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l'impossibilité de saisir le juge d'une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d'autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d'une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).
iii. Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat
123. Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).
124. Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l'affaire Schiesser précitée (§ 31) :
« (...) [A] cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).
125. Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération (McKay précité, § 40). »
47. En l'espèce, il apparaît que la requérante a rencontré les juges d'instruction chargés de l'information au cours de la perquisition effectuée à son cabinet. Il ressort toutefois du procès-verbal de perquisition, document détaillé produit par le Gouvernement et rédigé par les juges, que ces derniers se sont strictement contentés de procéder aux opérations de perquisition et de saisie, à l'exclusion de toute autre mesure, en particulier concernant l'audition de la requérante et l'examen de la légalité de sa détention (paragraphe 8 ci-dessus).
48. La Cour note que les juges d'instruction n'ont pas davantage procédé à une telle audition en se rendant à l'hôtel de police le 15 avril 2005 (paragraphe 10 ci-dessus), le procès-verbal semblant au contraire indiquer qu'ils ne se sont adressés qu'aux seuls policiers chargés de la garde à vue.
49. Elle considère qu'il est d'ailleurs pour le moins contradictoire pour le Gouvernement d'invoquer le respect de l'article 5 § 3 en raison de la « présentation » de la requérante aux juges d'instruction à l'occasion de la perquisition, pour ensuite prétendre que les deux juges d'instruction ne pouvaient pas l'entendre immédiatement après la perquisition ou la faire transférer immédiatement à Orléans. Sur ce dernier argument, la Cour considère que le besoin de repos des juges et de leur greffier invoqué par le Gouvernement ne saurait justifier une atteinte aux exigences de l'article 5 § 3.
50. Enfin, la Cour relève qu'en tout état de cause les juges d'instruction d'Orléans intervenaient en dehors de leur ressort de compétence territoriale, la garde à vue s'étant déroulée dans celui de la cour d'appel de Toulouse, ce qui excluait leur compétence pour se prononcer sur la légalité de la détention de la requérante. Pour cette raison, la garde à vue a été prolongée par un juge d'instruction de Toulouse, lequel n'a cependant pas non plus entendu la requérante pour examiner le bien-fondé de sa détention (paragraphe 9 ci-dessus).
51. Il s'ensuit que pendant la période qui s'est écoulée entre son placement en garde à vue le 13 avril 2005 à 14 h 35 (paragraphe 7 ci-dessus) et sa présentation aux deux juges d'instruction d'Orléans le 18 avril 2005 à 15 h 14 (paragraphe 15 ci-dessus), pour l'interrogatoire de « première comparution », la requérante n'a pas été entendue personnellement par les juges d'instruction en vue d'un examen par ces derniers des circonstances qui militent pour ou contre la détention, afin qu'ils se prononcent selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement, autrement dit sur le bien-fondé de la détention.
52. La Cour précise au demeurant que cette période de plus de cinq jours ne saurait être traitée en plusieurs périodes distinctes comme le prétend le Gouvernement. En effet, la détention de la requérante se fondait, dès son interpellation et jusqu'au 18 avril, sur « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle [avait] commis ou tenté de commettre » une ou des infractions au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée dans l'affaire A.C. (précitée) invoquée par le Gouvernement et qui concernait une audition par la police en qualité de témoin, dans le cadre d'un régime juridique différent et relevant de l'article 5 § 1 b) de la Convention. Elle rappelle d'ailleurs que l'article 5 § 3 vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition ; ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999, et Medvedyev et autres, précité, § 119) ; en l'espèce, la période litigieuse de cinq jours relève bien du premier aspect, à savoir des heures et des journées qui ont suivi l'arrestation du 13 avril 2005 au cours desquelles la requérante se trouvait aux mains des autorités ; le second aspect, relatif à la période avant procès, concerne la détention provisoire ordonnée le 18 avril 2005 et n'est pas en cause en l'espèce.
53. De l'avis de la Cour, il convient donc d'examiner la question de savoir si la requérante aurait néanmoins été « aussitôt » traduite devant un autre « juge ou (...) magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », conformément aux dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention.
54. Sur ce point, elle relève que la requérante a été présentée au procureur adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 avril 2005, après la fin de sa garde à vue, en raison de l'existence d'un mandat d'amener délivré par les juges d'instruction d'Orléans. Le procureur adjoint a finalement ordonné sa conduite en maison d'arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges (paragraphe 14 ci-dessus).
55. Il appartient donc à la Cour d'examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (paragraphe 46 ci-dessus), en particulier s'agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
56. La Cour constate tout d'abord que si l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire représente l'autorité judiciaire citée à l'article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d'un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l'article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l'article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s'il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
57. La Cour n'ignore pas que le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public fait l'objet d'un débat au plan interne (voir, notamment, paragraphes 25 et 28 ci-dessus). Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position dans ce débat qui relève des autorités nationales : la Cour n'est en effet appelée à se prononcer que sous le seul angle des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention, et des notions autonomes développées par sa jurisprudence au regard desdites dispositions. Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5 § 3 (Schiesser, précité, § 31, et, entre autres, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 49, série A no 77, ou plus récemment Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 238, CEDH 2003-VI (extraits)).
58. Par ailleurs, la Cour constate que la loi confie l'exercice de l'action publique au ministère public, ce qui ressort notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale. Indivisible (paragraphe 26 ci-dessus), le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et d'appel en vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev et autres, précité, § 124 ; paragraphe 46 ci-dessus). Il importe peu qu'en l'espèce le procureur adjoint exerçait ses fonctions dans un ressort territorial différent de celui des deux juges d'instruction, la Cour ayant déjà jugé que le fait pour le procureur d'un district, après avoir prolongé une privation de liberté, d'avoir ensuite transféré le dossier dans un autre parquet, n'emportait pas sa conviction et ne justifiait pas qu'elle s'écarte de sa jurisprudence consacrée par l'arrêt Huber c. Suisse précité (Brincat, précité, § 20).
59. Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
60. En conséquence, la Cour constate que la requérante n'a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges d'instruction d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue.
61. Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ce qui n'était au demeurant pas le cas en l'espèce (Brogan et autres, précité, § 62, et Medvedyev et autres, précité, § 129).
62. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
BRUSCO C. FRANCE du 14 OCTOBRE 2010 requête 1466/07
Durant la garde à vue, un individu a droit de garder le silence, cette possibilité prévue par la loi dite "présomption d'innocence" du 15 juin 2000 a été supprimée. La CEDH condamne la France pour non respect de ce droit.
LE GOUVERNEMENT TENTE DE SOUTENIR QU'UNE GARDE A VUE N'EST PAS UNE ACCUSATION PENALE
Selon le Gouvernement, l’applicabilité de l’article 6 en matière pénale suppose l’existence d’une « accusation ». Il fait valoir que cette notion a un caractère « autonome » et que l’accusation se définit comme la « notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » et renvoie à l’idée de « répercussions importantes sur la situation de l’intéressé » (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 42, série A no 35, et Serves c. France, 20 octobre 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI). Il s’agit donc soit de l’inculpation, soit d’un réquisitoire nominatif (Bertin-Mourot c. France, no 36343/97, 2 août 2000). Or, selon le Gouvernement, ce n’est pas le cas en l’espèce : lors de son interpellation par la police, le requérant ne s’est vu signifier aucun grief ; il n’était pas nommément visé par la commission rogatoire du 3 juin 1999 ordonnant aux autorités de police de prendre toutes les dispositions pour le recueil d’informations dans cette affaire ; il n’était pas non plus visé dans le réquisitoire introductif de 1998. A cet égard, le Gouvernement rappelle que le requérant n’a été placé en garde à vue que pour être entendu comme témoin et pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire. Par conséquent et contrairement aux affirmations du requérant, il n’existait, au moment de l’audition du 8 juin, aucun indice grave et concordant. Les seules raisons pour lesquelles le requérant a été auditionné à cette date étaient qu’il avait été cité par d’autres témoins au cours de leur déposition conformément à l’article 105 du code de procédure pénale. En tout état de cause, il est impossible, selon le Gouvernement, de démonter qu’existaient alors des indices graves et concordants permettant de le mettre en examen.
35. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que si, en vertu de l’actuel article 154 de ce même code, un individu ne peut être mis en garde à vue que s’il « existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction », il n’en était pas de même à l’époque des faits. Selon l’ancienne version de l’article 154, une personne pouvait être gardée à vue pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, sans que pèse nécessairement contre elle des indices graves et concordants. Ce qui était le cas en l’espèce. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait être regardé comme un « accusé » au sens de la jurisprudence de la Cour. S’il devait en être autrement, cela signifierait que toutes les personnes, témoins compris, entendues par les services de police pourraient être considérées comme étant en accusation. Cela serait disproportionné et rendrait impossible le bon fonctionnement des services de police. Le Gouvernement ajoute que cette conclusion n’est pas remise en cause par l’arrêt Serves c. France (précité, § 42) qui juge qu’une assignation à comparaître comme témoin peut s’analyser en une « accusation » au sens de l’article 6.
38. La Cour relève que les arguments avancés par le Gouvernement à l’appui de l’exception d’irrecevabilité sont étroitement liés à la substance du grief tiré de l’article 6 de la Convention. Dès lors, il y a lieu de joindre l’exception au fond. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
SUR LE FOND LE REQUERANT SE PLAINT QUE SON DROIT A NA PAS S'AUTO INCRIMINER DURANT UNE GARDE A VUE EST ILLEGAL
39. Le requérant fait valoir qu’aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour (Funke c. France, précité, § 44, John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, § 45 et Serves, précité, § 46), le droit de garder silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Précisément, l’obligation de prêter serment est manifestement incompatible avec le droit de ne pas participer à sa propre incrimination. Le requérant expose que le droit reconnu au gardé à vue n’est pas seulement un droit de refuser de répondre en bloc aux questions qui lui sont posées mais aussi celui de mentir, ne serait-ce que par omission, aux services de police ; le droit au silence est un droit à l’ellipse, à l’oubli volontaire et est radicalement inconciliable avec l’exigence de ne dire que la vérité et toute la vérité. Il ajoute que le Gouvernement serait d’autant plus mal venu à prétendre le contraire qu’il a lui-même formellement reconnu que la possibilité d’entendre des gardés à vue sous serment était contraire aux dispositions conventionnelles, ce qui a conduit à la modification, par une loi du 9 mars 2004, de l’article 153 du code de procédure pénale qui dispose, désormais, dans son alinéa 3, que « l’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l’article 154 ». Le requérant ajoute qu’il a été entendu sous serment alors qu’il était placé en garde à vue, c’est-à-dire alors même qu’il existait contre lui des raisons plausibles de soupçonner qu’il ait commis l’infraction poursuivie. Enfin, il souligne qu’à aucun stade de la procédure, les juridictions internes n’ont entendu reconnaître que la garantie de ne pas s’auto-incriminer avait été méconnue.
LA CEDH CONDAMNE LA FRANCE POUR VIOLATION DES ARTICLES 6-1 ET 6-3 DE LA CONVENTION
44. La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII).
45. La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010).
46. En l’espèce, la Cour relève que lorsque le requérant a dû prêter serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité », comme l’exige l’article 153 du code de procédure pénale, avant de déposer devant l’officier de police judiciaire, il était placé en garde à vue. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le juge d’instruction, les services de police ayant interpellé le requérant suite à une commission rogatoire délivrée le 3 juin 1999 par ce magistrat, qui les autorisait notamment à procéder à toutes les auditions et perquisitions utiles à la manifestation de la vérité concernant les faits de tentative d’assassinat commis sur la personne de B.M. le 17 décembre 1998. Ce placement en garde à vue était règlementé par l’article 154 du code de procédure pénale et n’était pas subordonné, à l’époque des faits, à l’existence d’ « indices graves et concordants » démontrant la commission d’une infraction par l’intéressé ou de « raisons plausibles » de le soupçonner de tels faits. La Cour note également que le requérant n’était pas nommément visé par la commission rogatoire du 3 juin 1999, ni par le réquisitoire introductif du 30 décembre 1998.
47. La Cour constate cependant que l’interpellation et la garde à vue du requérant s’inscrivaient dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le juge d’instruction contre E.L et J.P.G., tous deux soupçonnés d’avoir été impliqués dans l’agression de B.M. Or, d’une part, lors de sa garde à vue du 2 juin 1999, J.P.G. avait expressément mis en cause le requérant comme étant le commanditaire de l’opération projetée et, d’autre part, la victime avait déposé plainte contre son épouse et le requérant, et ce dernier avait déjà été entendu à ce sujet par les services de police le 28 décembre 1998. Dans ces circonstances, la Cour considère que, dès son interpellation et son placement en garde à vue, les autorités avaient des raisons plausibles de soupçonner que le requérant était impliqué dans la commission de l’infraction qui faisait l’objet de l’enquête ouverte par le juge d’instruction. L’argument selon lequel le requérant n’a été entendu que comme témoin est inopérant, comme étant purement formel, dès lors que les autorités judiciaires et policières disposaient d’éléments de nature à le suspecter d’avoir participé à l’infraction.
48. Par ailleurs, la Cour note que, depuis l’adoption de la loi du 15 juin 2000, lorsqu’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, tout témoin – cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire – ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
49. Enfin, selon la Cour, l’interpellation et le placement en garde à vue du requérant pouvaient avoir des répercussions importantes sur sa situation (voir, parmi d’autres, Deweer, précité, § 46, et Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A no 51). D’ailleurs, c’est précisément à la suite de la garde à vue décidée en raison d’éléments de l’enquête le désignant comme suspect, qu’il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
50. Dans ces circonstances, la Cour estime que lorsque le requérant a été placé en garde à vue et a dû prêter serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité », celui-ci faisait l’objet d’une « accusation en matière pénale » et bénéficiait du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
51. La Cour relève ensuite que, lors de sa première déposition le 8 juin 1999, le requérant a fourni certains éléments de preuve pouvant démontrer son implication dans l’agression de B.M : il a en effet livré des détails sur ses conversations avec l’un des individus mis en examen, J.P.G., sur leur entente « pour faire peur » à B.M. et sur la remise d’une somme d’argent de 100 000 francs français. La Cour note également que ces déclarations ont été ensuite utilisées par les juridictions pénales pour établir les faits et condamner le requérant.
52. La Cour estime que le fait d’avoir dû prêter serment avant de déposer a constitué pour le requérant – qui faisait déjà depuis la veille l’objet d’une mesure coercitive, la garde à vue – une forme de pression, et que le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger a assurément rendu la prestation de serment plus contraignante.
53. Elle note par ailleurs qu’en 2004, le législateur est intervenu pour revenir sur l’interprétation faite par la Cour de cassation de la combinaison des articles 105, 153 et 154 du code de procédure pénale et préciser que l’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue sur commission rogatoire d’un juge d’instruction (paragraphe 29 ci-dessus).
54. La Cour constate également qu’il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu’aux questions qu’il souhaitait. Elle relève en outre que le requérant n’a pu être assisté d’un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l’article 63-4 du code de procédure pénale (paragraphe 28 ci-dessus). L’avocat n’a donc été en mesure ni de l’informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer avant son premier interrogatoire ni de l’assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l’exige l’article 6 de la Convention.
55. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée et qu’il y a eu, en l’espèce, atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, tel que garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
B. Le droit d’accès à un juge du requérant
56. Le requérant soutient également, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, que par sa décision du 27 juin 2006, la Cour de cassation ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un juge, lui opposer le nouvel article 153 du code de procédure pénale pour le priver du droit de faire juger de la nullité de sa garde à vue. La Cour estime que cette question se confond en réalité avec le précédent grief examiné ci-dessus. Il doit donc être déclaré recevable et, eu égard à ce qu’elle a conclu précédemment (paragraphe 55 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire de l’examiner séparément.
Boz contre Turquie du 09 février2010 requête 2039/04
deuxième arrêt de confirmation
"33. En ce qui concerne le grief tiré de l'absence d'avocat pendant la phase d'enquête préliminaire, la Cour renvoie aux principes posés par l'arrêt Salduz qui fait autorité en la matière (précité, §§ 50-55).
34. En l'espèce, nul ne conteste que le requérant a été privé de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue – donc pendant ses interrogatoires – (paragraphe 5 ci-dessus) parce que la loi en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27 et 28).
35. En soi, une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention (Dayanan c.Turquie, no 7377/03, §§ 33-34, 13 octobre 2009).
36. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1."
Savas C.Turquie du 08 décembre2009 requête 9762/03
premier arrêt de confirmation
61. Le Gouvernement combat cette thèse. Soulignant que la garde à vue du requérant a duré moins de vingt-quatre heures, il affirme que l'intéressé, âgé à l'époque de vingt ans, a été informé de son droit de se faire assister par un avocat mais qu'il y a renoncé de son plein gré bien que la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office lui ait été clairement indiquée. Il ajoute que l'inculpé était représenté par un avocat pendant les procédures pénales engagées à son encontre et qu'il avait la faculté de contester ses dépositions faites pendant la garde à vue. La cour d'assises aurait pris en considération non seulement les dépositions faites par l'intéressé pendant sa garde à vue, devant le parquet et devant elle, mais également d'autres éléments de preuve ainsi que les dépositions d'autres témoins. De plus, se fondant sur l'article 135 a) du code de procédure pénale, le Gouvernement soutient que les dépositions obtenues par des moyens illégaux ne peuvent être utilisées comme preuves devant les juridictions nationales. Il ajoute que le droit turc n'attache pas de conséquences aux dépositions recueillies durant l'instruction préliminaire si elles ne sont pas confirmées par la suite devant la cour d'assises. Il rappelle que, durant l'instruction préliminaire, le requérant a reconnu avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées et qu'il a participé à la reconstitution des faits. Il soutient que les aveux de l'intéressé n'ont pas été obtenus sous la contrainte. Selon le Gouvernement, la présente affaire se distingue de l'affaire Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, 27 novembre 2008) dans la mesure où, dans cette dernière affaire, le requérant était âgé de moins de dix-huit ans lors de son arrestation et que sa condamnation avait été principalement fondée sur les dépositions recueillies en l'absence d'un avocat.
62. Le requérant réitère son allégation.
63. La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 constitue un élément parmi d'autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (Salduz, précité, §§ 50-55). A cet égard, elle rappelle que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz, précité, § 55).
64. La Cour note que la présente affaire diffère de l'affaire Salduz. En effet, dans cette dernière affaire, la restriction imposée au droit d'accès à un avocat relevait d'une politique systématique et était appliquée à toute personne placée en garde à vue en rapport avec une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat. Cela étant, il convient de rappeler que, depuis l'abolition, le 30 juin 2004, des cours de sûreté de l'Etat, les infractions relevant auparavant de la compétence de ces dernières relèvent désormais de la compétence des cours d'assises. Dans le cas d'espèce, en principe, le requérant avait donc le droit de demander l'assistance d'un avocat dans la mesure où il était poursuivi pour une infraction relevant de la compétence d'une cour d'assises.
65. Il ressort du procès-verbal de déposition du requérant du 30 septembre 2001 qu'il aurait été informé de son droit d'être assisté par un avocat. La case « ne réclame pas » l'assistance d'un avocat est cochée sur le procès-verbal de déposition (paragraphe 11 ci-dessus). Dès lors, à la lumière des faits de l'espèce et des observations des parties, la Cour doit rechercher si le requérant a renoncé de manière non équivoque à son droit d'être assisté par un avocat et si cette renonciation était entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006-II).
66. La Cour constate que, pendant la garde à vue du requérant, la police a recueilli sa déposition et a établi un procès-verbal de confrontation ainsi qu'un procès-verbal de reconstitution des faits (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Ces trois actes ont été établis alors que le requérant était sous le contrôle total de la police sans l'assistance d'un avocat. La Cour note que le Gouvernement, en se référant au procès-verbal de déposition du requérant établi sur un formulaire type pendant la garde à vue, soutient que le requérant, pourtant informé d'un tel droit, aurait renoncé d'être assisté par un avocat. A ce stade, il convient de préciser que le seul élément indiquant que le requérant aurait été informé de ce droit et y aurait renoncé est, comme mentionné ci-dessus, la case, cochée, du formulaire de déposition de l'intéressé. Cela étant, le Gouvernement n'a fait aucun commentaire concernant le droit du requérant d'être assisté par un avocat pour les deux autres actes également établis pendant la garde à vue. La Cour estime que ces faits affaiblissent considérablement la valeur de la case cochée « ne réclame pas » l'assistance d'un avocat en tant que manifestation de la volonté du requérant de renoncer à un droit garanti par l'article 6 de la Convention.
67. Plus particulièrement, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait renoncé, même implicitement, à se faire assister par un avocat pendant la reconstitution des faits ou la confrontation qui a eu lieu entre lui et les plaignants alors qu'il était encore placé en garde à vue. En effet, les deux derniers procès-verbaux établis par la police ne mentionnent pas si le requérant a été informé de son droit d'être représenté par un avocat. Tenant compte de la sévérité de la peine à laquelle le requérant a été condamné et dans la mesure où les éléments de preuves recueillies pendant la garde à vue, en l'absence d'un avocat, ont servis de fondement à sa condamnation, la Cour considère que les juges du fond auraient dû effectuer un contrôle scrupuleux pour déterminer si la renonciation à l'assistance d'un avocat était dénuée d'équivoque (Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 73, CEDH 2004-IV).
68. La Cour ne conteste pas que devant le juge du tribunal correctionnel, les juridictions de première instance puis la Cour de cassation, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un avocat. En particulier, devant la cour d'assises, lors des audiences du 3 novembre et du 5 décembre 2001, le requérant, mettant en exergue l'absence d'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue, a contesté sa déposition, les procès-verbaux de confrontation et de reconstitution des faits. La cour d'assises, quant à elle, a condamné le requérant en se fondant sur l'ensemble des éléments du dossier, y compris la déposition faite par le requérant pendant la garde à vue ainsi que d'autres actes effectués pendant cette même période. Elle ne s'est de fait jamais prononcée sur le point de savoir si le requérant avait renoncé de son plein gré à son droit d'être assisté par un avocat eu égard à la gravité des infractions reprochées (Padalov c. Bulgarie, no 54784/00, § 54, 10 août 2006). Par ailleurs, il est également significatif que l'une des victimes qui avait reconnu le requérant comme étant l'auteur d'une des infractions reprochées lors de l'établissement du procès-verbal de confrontation s'est rétractée lors du procès et l'a fait savoir à la Cour de cassation. Enfin, il convient de relever que, devant le juge du tribunal correctionnel de Balıkesir, l'avocat du requérant a déclaré que la déposition de l'intéressé n'avait pas été obtenue conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'avocat précisa en outre que le frère du requérant s'était rendu, la nuit de la garde à vue, au commissariat de police afin de lui fournir l'assistance d'un avocat (paragraphe 15 ci-dessus). Or, les juridictions du fond n'en ont tiré aucune conséquence. Quant à la Cour de cassation, elle n'a pas remédié à cette lacune.
69. Or toute renonciation au bénéfice des garanties de l'article 6 doit se trouver établie de manière non équivoque. A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'elle ne peut en l'espèce se fier à l'exactitude de la mention figurant sur le formulaire type de la déposition du requérant (Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 53, 2 août 2005). Il n'est donc pas établi que le requérant ait renoncé de manière non équivoque à son droit d'être assisté par un avocat lors de la garde à vue. Partant, il a été personnellement touché par cette impossibilité, dans la mesure où les actes établis pendant sa garde à vue, en l'absence d'un avocat, ont servi à fonder sa condamnation.
70. En conclusion, même si le requérant a eu l'occasion de contester les preuves à charge à son procès devant les juridictions nationales, l'impossibilité de se faire assister par un avocat alors qu'il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense (Dayanan c.Turquie, no 7377/03, § 34, 13 octobre 2009.
71. Eu égard à ce qui précède, il y a donc eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
Dayanan C. Turquie du 13 novembre2009 requête 7377/03
deuxième arrêt de principe
30. En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz, précité, § 51, Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A, et Demebukov c. Bulgarie, no 68020/01, § 50, 28 février 2008).
31. Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire.
32. Comme le souligne les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit (pour les textes de droit international pertinents en la matière, voir Salduz, précité, §§ 37-44). En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer.
33. En l'espèce, nul ne conteste que le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue parce que la loi en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27, 28). En soi, une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention, nonobstant le fait que le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue.
34. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
Salduz contre Turquie du 27 octobre 2008 requête 36391/02
C'est l'arrêt de principe
LA TURQUIE SE FAIT CONDAMNER POUR DÉFAUT D'AVOCAT DURANT UNE GARDE A VUE
a) Les principes généraux applicables en l'espèce
50. La Cour rappelle que si l'article 6 a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien-fondé de l'accusation », il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, l'article 6 – spécialement son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l'équité du procès (Imbrioscia, précité, § 36). Ainsi qu'il est établi dans la jurisprudence de la Cour, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 constitue un élément parmi d'autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (Imbrioscia, précité, § 37, et Brennan, précité, § 45).
51. La Cour réaffirme par ailleurs que, quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A, et Demebukov c. Bulgarie, no 68020/01, § 50, 28 février 2008). Cela étant, l'article 6 § 3 c) ne précise pas les conditions d'exercice du droit qu'il consacre. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable. A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (Imbrioscia, précité, § 38).
52. Une législation nationale peut attacher à l'attitude d'un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure. En pareil cas, l'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police. Ce droit, que la Convention n'énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit donc, dans chaque cas, de savoir si la restriction litigieuse est justifiée et, dans l'affirmative, si, considérée à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle a ou non privé l'accusé d'un procès équitable, car même une restriction justifiée peut avoir pareil effet dans certaines circonstances (voir John Murray, précité, § 63, Brennan, précité, § 45, et Magee, précité, § 44).
53. Les principes décrits au paragraphe 52 ci-dessus cadrent également avec les normes internationales généralement reconnues en matière de droits de l'homme (paragraphes 37-42 ci-dessus) qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable et dont la raison d'être tient notamment à la nécessité de protéger l'accusé contre toute coercition abusive de la part des autorités. Ils contribuent à la prévention des erreurs judiciaires et à la réalisation des buts poursuivis par l'article 6, notamment l'égalité des armes entre les autorités d'enquête ou de poursuite et l'accusé.
54. La Cour souligne l'importance du stade de l'enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction imputée sera examinée au procès (Can c. Autriche, no 9300/81, rapport de la Commission du 12 juillet 1984, § 50, série A no 96). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l'utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même. Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l'accusé (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 100, CEDH 2006-..., et Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 51, 2 août 2005). Un prompt accès à un avocat fait partie des garanties procédurales auxquelles la Cour prête une attention particulière lorsqu'elle examine la question de savoir si une procédure a ou non anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (voir, mutatis mutandis, Jalloh, précité, § 101). La Cour prend également note à cet égard des nombreuses recommandations du CPT (paragraphes 39-40 ci-dessus) soulignant que le droit de tout détenu à l'obtention de conseils juridiques constitue une garantie fondamentale contre les mauvais traitements. Toute exception à la jouissance de ce droit doit être clairement circonscrite et son application strictement limitée dans le temps. Ces principes revêtent une importance particulière dans le cas des infractions graves, car c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques.
55. Dans ces conditions, la Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif » (paragraphe 51 ci-dessus), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (voir, mutatis mutandis, Magee, précité, § 44). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation.
b) Application en l'espèce des principes énoncés ci-dessus
56. En l'espèce, le droit du requérant à bénéficier de l'assistance d'un avocat a été restreint pendant sa garde à vue, en application de l'article 31 de la loi no 3842, au motif qu'il se trouvait accusé d'une infraction qui relevait de la compétence des cours de sûreté de l'Etat. En conséquence, il n'était pas assisté d'un avocat lorsqu'il a effectué ses déclarations devant la police, devant le procureur et devant le juge d'instruction. Pour justifier le refus au requérant de l'accès à un avocat, le Gouvernement s'est borné à dire qu'il s'agissait de l'application sur une base systématique des dispositions légales pertinentes. En soi, cela suffit déjà à faire conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 à cet égard, telles qu'elles ont été décrites au paragraphe 52 ci-dessus.
57. La Cour observe par ailleurs que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un avocat après son placement en détention provisoire. Dans la suite de la procédure, il a également pu citer des témoins à décharge et combattre les arguments de l'accusation. La Cour relève également que le requérant a démenti à plusieurs reprises le contenu de sa déclaration à la police, tant au procès en première instance qu'en appel. Toutefois, ainsi qu'il ressort du dossier, l'enquête avait en grande partie été effectuée avant que le requérant ne comparaisse devant le juge d'instruction le 1er juin 2001. De surcroît, non seulement la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir s'est abstenue, avant d'examiner le fond de l'affaire, de prendre position sur l'opportunité d'admettre comme preuves les déclarations faites par le requérant pendant sa garde à vue, mais elle a fait de la déposition livrée à la police par l'intéressé la preuve essentielle justifiant sa condamnation, nonobstant la contestation par le requérant de son exactitude (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour observe à cet égard que, pour condamner le requérant, la cour de sureté de l'Etat d'İzmir a en réalité utilisé les preuves produites devant elle pour confirmer la déclaration faite par le requérant devant la police. Parmi ces preuves figuraient l'expertise datée du 1er juin 2001 et les dépositions faites par les coaccusés du requérant devant la police et devant le procureur. A cet égard, toutefois, la Cour est frappée par le fait que l'expertise mentionnée dans le jugement de première instance était favorable au requérant, puisque aussi bien elle concluait à l'impossibilité d'établir si l'écriture de l'inscription figurant sur la banderole était identique à celle du requérant (paragraphe 15 ci-dessus). Il est également significatif que tous les coaccusés du requérant qui avaient témoigné contre lui devant la police et devant le procureur rétractèrent leurs déclarations lors du procès et nièrent avoir participé à la manifestation.
58. Il est donc clair en l'espèce que le requérant a été personnellement touché par les restrictions mises à la possibilité pour lui d'avoir accès à un avocat, puisque aussi bien sa déclaration à la police a servi à fonder sa condamnation. Ni l'assistance fournie ultérieurement par un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure n'ont pu porter remède au défaut survenu pendant la garde à vue. Il n'appartient toutefois pas à la Cour de spéculer sur l'impact qu'aurait eu sur l'aboutissement de la procédure la possibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat pendant sa garde à vue.
59. La Cour rappelle par ailleurs que ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable (Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000). Toutefois, pour être effective aux fins de la Convention, la renonciation au droit de prendre part au procès doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (voir Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006-..., Kolu, précité, § 53, et Colozza c. Italie, 12 février 1985, § 28, série A no 89). Ainsi, en l'espèce, la Cour ne peut se fonder sur la mention figurant dans le formulaire exposant les droits du requérant selon laquelle l'intéressé avait été informé de son droit de garder le silence (paragraphe 14 ci-dessus).
60. La Cour relève enfin que l'un des éléments caractéristiques de la présente espèce était l'âge du requérant. Renvoyant au nombre important d'instruments juridiques internationaux traitant de l'assistance juridique devant être octroyée aux mineurs en garde à vue (paragraphes 32-36 ci-dessus), la Cour souligne l'importance fondamentale de la possibilité pour tout mineur placé en garde à vue d'avoir accès à un avocat pendant cette détention.
61. Or, en l'espèce, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, la restriction imposée au droit d'accès à un avocat relevait d'une politique systématique et était appliquée à toute personne, indépendamment de son âge, placée en garde à vue en rapport avec une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat.
62. En résumé, même si le requérant a eu l'occasion de contester les preuves à charge à son procès en première instance puis en appel, l'impossibilité pour lui de se faire assister par un avocat alors qu'il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense.
c) Conclusion
63. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 3 c de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
UNE DETENTION ADMINISTRATIVE PRETEXTE A UNE GARDE A VUE SANS AVOCAT
URAZBAYEV c. RUSSIE du 8 octobre 2019 Requête n° 13128/06
Article 6 : Une détention administrative sous un faux prétexte, se transforme en garde à vue sans avocat durant laquelle, le frère du requérant qui est passé aux aveux , aurait subi de la torture. Le requérant est condamné pour crime contre un policier, sur la foi de cet aveux.
a) Principes généraux
60. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne. La Cour n’a donc pas à se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve – par exemple des preuves obtenues de manière illégale au regard du droit interne, mais doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’illégalité en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, la nature de cette violation (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-95, CEDH 2006‑IX, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 163, CEDH 2010, et, dernièrement, par exemple, Kormev, précité, § 79).
61. Toutefois, des considérations particulières s’imposent lorsque sont utilisés dans une procédure pénale des éléments de preuve obtenus au moyen d’une mesure jugée contraire à l’article 3. L’utilisation de pareils éléments, recueillis grâce à une violation de l’un des droits absolus constituant le noyau dur de la Convention, suscite toujours de graves doutes quant à l’équité de la procédure, quand bien même le fait de les avoir admis comme preuves n’aurait pas été décisif pour la condamnation du suspect (Gäfgen, précité, § 165, avec les références citées). En particulier, l’utilisation dans un procès pénal de dépositions obtenues à la suite d’une violation de l’article 3 de la Convention – que ces méfaits soient qualifiés de torture, de traitement inhumain ou dégradant – prive automatiquement d’équité la procédure dans son ensemble et viole l’article 6 (Kormev, précité, § 81, avec les références citées). Ce principe s’applique tant aux déclarations auto-incriminantes faites par les accusés qu’aux déclarations des témoins obtenues en violation de l’article 3 et utilisées comme moyens de preuves (Haroutyounian, précité, § 64, et Huseyn et autres c. Azerbaïdjan, nos 35485/05 et 3 autres, § 202, 26 juillet 2011).
62. Pour déterminer si la procédure a été équitable dans son ensemble, il faut rechercher si les droits de la défense ont été respectés. Il y a lieu de se demander en particulier si le requérant a eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation. Il faut également prendre en compte la qualité des preuves et notamment vérifier si les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude (Gäfgen, précité, § 164, et Jannatov c. Azerbaïdjan, no 32132/07, § 74, 31 juillet 2014). Le principe de la présomption d’innocence et le droit de l’accusé de contester toute preuve contre lui veulent que la juridiction du jugement procède à un examen et à une évaluation complets, indépendants et exhaustifs des preuves à charge, et ce indépendamment de l’appréciation qui en a été faite dans d’autres procédures (Huseyn et autres, précité, § 212).
b) Application au cas d’espèce
63. La Cour relève que les déclarations de U., frère du requérant, faites les 12 et 14 mai 2002, ont été utilisées comme preuves pour fonder la condamnation de celui-ci pour meurtre. Lors du procès, le requérant a demandé à les faire déclarer irrecevables au motif qu’elles avaient été obtenues au moyen de torture par la police lors de la détention illégale de son frère. En outre, ce dernier, interrogé en tant que témoin à l’audience, a rétracté ses dépositions tout en réitérant ses allégations de torture (paragraphes 30-31 ci-dessus). Les juridictions internes ont cependant choisi de les maintenir au dossier. Ce faisant, elles se sont référées aux conclusions des enquêtes internes selon lesquelles U. s’était infligé lui-même les blessures relevées sur lui lors de sa détention par la police (paragraphes 35‑36 ci‑dessus).
64. La Cour rappelle d’emblée que, sauf s’il existe des raisons importantes pour conclure autrement, la notion de procès équitable exige qu’un plus grand poids soit attaché aux déclarations faites devant un tribunal qu’aux procès-verbaux d’interrogatoire d’un témoin avant le procès (Erkapić c. Croatie, no 51198/08, § 75, 25 avril 2013, avec les références citées). Or, en l’espèce, la juridiction de jugement a accordé un poids décisif aux dépositions faites par le témoin au stade de l’enquête tout en ignorant les dépositions de celui-ci à l’audience, sans en expliquer les raisons.
65. La Cour rappelle ensuite qu’en présence d’allégations crédibles selon lesquelles un témoignage à charge a été obtenu au moyen de mauvais traitements, il incombe à la juridiction de jugement de procéder à un examen complet, indépendant et exhaustif des conditions dans lesquelles de telles déclarations ont été recueillies, et cela indépendamment de l’appréciation qui en a été faite par les autorités de poursuite (paragraphe 62 ci-dessus). En l’espèce, un tel examen était d’autant plus important et devait être d’autant plus minutieux que le requérant, qui n’était pas partie à la procédure dans laquelle son frère avait soulevé ses griefs de mauvais traitements, était privé de la possibilité d’y participer et d’en contester les résultats (Huseyn et autres, précité, § 212).
66. La Cour note que, en l’espèce, en jugeant les déclarations d’U. faites les 12 et 14 mai 2002 recevables, la cour régionale s’est essentiellement contentée d’un simple renvoi aux conclusions des vérifications préliminaires par le parquet régional de Kourgan à la suite de la plainte pour mauvais traitements déposée par U. et aux témoignages des policiers selon lesquels ils n’avaient commis aucun acte illicite sur la personne de U. (paragraphe 35 ci-dessus). Elle n’a donc pas procédé à un examen séparé des circonstances dans lesquelles ces déclarations avaient été faites.
67. Or la Cour ne peut s’empêcher de relever, concernant ces circonstances, que, le 10 mai 2002, U. qui ne présentait pas de lésions corporelles a été arrêté en tant que suspect du vol de bétail. Il est resté entre les mains de la police d’abord au motif qu’il avait commis une contravention administrative, puis en tant que suspect au vol jusqu’au 16 mai 2002, date à laquelle il a été placé en maison d’arrêt. Lors de cette détention et à l’issue de certaines « discussions » avec les policiers, celui-ci a fait, le 12 mai 2002, des déclarations mettant en cause le requérant. Le 14 mai 2002, U., toujours entre les mains de la police et sans assistance par un avocat, a fait de nouvelles déclarations mettant de nouveau en cause le requérant et a dessiné un schéma à l’appui. Le même jour, plusieurs lésions à la tête ont été constatées chez U.
68. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de critiquer des situations similaires dans lesquelles une personne avait été arrêtée sous le prétexte qu’elle avait commis une contravention administrative afin de pouvoir la tenir à la disposition de la police et de l’interroger informellement en l’absence de toutes les garanties, et en particulier en l’absence d’un avocat, au sujet d’une infraction pénale (Menecheva c. Russie, no 59261/00, §§ 85-86, CEDH 2006‑III, Doronine c. Ukraine, no 16505/02, § 56, 19 février 2009, Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin c. Ukraine, no 1727/04, § 88, 24 juin 2010, Nechiporuk et Yonkalo c. Ukraine, no 42310/04, § 178, 21 avril 2011, et, dernièrement, Semenenko c. Ukraine [comité], no 52819/08, §§ 29-36, 20 octobre 2016). Ces circonstances à elles seules jettent un doute sérieux sur le caractère volontaire des déclarations obtenues dans de telles conditions et ont déjà dû alerter les juridictions sur la crédibilité et l’authenticité de déclarations ainsi faites.
69. Comme la Cour l’a déjà observé, un certain nombre de blessures avaient été relevées chez U. au terme de sa détention, blessures qui avaient été causées pendant le même laps de temps au cours duquel il avait livré les témoignages mettant en cause le requérant. S’agissant de l’origine de ces blessures, l’enquête menée à la suite de sa plainte s’est soldée par un refus d’ouvrir une instruction pénale au motif qu’U. s’était lui-même infligé ces lésions. A l’appui de cette thèse, les procureurs successifs se sont référés aux témoignages des policiers niant tout acte illicite commis sur U. ainsi qu’au rapport médico-légal du 14 mai 2002 concluant que les blessures relevées avaient été causées par un objet dur contondant et situant leur apparition trois jours avant l’examen (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour ne peut s’empêcher de relever l’absence dans ce rapport de toute conclusion quant au degré de probabilité de la thèse de l’automutilation soutenue par les autorités (mutatis mutandis, Mammadov c. Azerbaïdjan, no 34445/04, § 63, 11 janvier 2007, et Dvalishvili c. Géorgie, no 19634/07, § 48, 18 décembre 2012). En outre, il ne ressort pas du dossier que l’expert médico-légal ait été invité à se prononcer sur une telle hypothèse concernant l’apparition des blessures d’U. (paragraphe 24 ci-dessus).
70. Or, malgré les conditions douteuses dans lesquelles les déclarations d’U. avaient été obtenues par la police, conditions faisant apparaître un risque réel de mauvais traitements, et malgré l’absence d’une explication plausible sur les origines exactes de ses lésions par les enquêteurs et d’éléments crédibles en faveur de la thèse de l’automutilation, la juridiction de jugement n’a pas procédé à un examen séparé de l’authenticité et de la fiabilité des témoignages accablant le requérant ainsi obtenus.
71. La Cour considère par ailleurs que, même à supposer que l’enquête ait été exempte de tout reproche, la question de recevabilité des preuves ne doit pas être confondue avec la question de la responsabilité pénale individuelle. Ainsi, l’enquête pénale sur les allégations de mauvais traitements peut se solder par un échec pour des différentes raisons, par exemple à cause de l’impossibilité de prouver un lien entre les faits allégués et l’auteur présumé ou d’établir son intention ou un autre élément constitutif de l’infraction ou encore par le jeu de la prescription pénale (voir, par exemple, Örs et autres, précité, §§ 16 et 58). Or, lorsque dans le cadre d’un procès pénal un accusé demande l’exclusion de preuves parce que, selon lui, elles ont été obtenues au moyen de mauvais traitements, la juridiction de jugement est alors appelée à se prononcer non pas sur la question de la responsabilité pénale individuelle comme dans le cadre d’une enquête pénale pour violences policières mais sur la question d’admissibilité des preuves. Il en résulte que lorsque sont présentées devant elle des allégations crédibles et non réfutées faisant état de témoignages obtenus au moyen de mauvais traitements, ils doivent être écartés sous peine de rendre l’ensemble de la procédure inéquitable.
72. En l’espèce, la cour régionale a été appelée non pas à se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle des policiers et enquêteurs pour les mauvais traitements allégués, mais sur la question de savoir si les preuves recueillies l’avaient été dans des circonstances susceptibles de remettre en cause la crédibilité et l’authenticité de celles-ci. Pour ce faire, elle disposait de tous les pouvoirs nécessaires, à savoir celui d’interroger les témoins, les experts et les auteurs présumés sur les circonstances des mauvais traitements allégués et de l’obtention des déclarations de U. (voir, mutatis mutandis, par exemple, Markaryan c. Russie, no 12102/05, § 44, 4 avril 2013, et Shlychkov c. Russie, no 40852/05, § 37, 9 février 2016, où les tribunaux avaient entendu les requérants, les policiers et les experts). Or la cour régionale n’a ni interrogé les policiers mis en cause par U., sauf P. et Um. dont les dépositions ont été limitées aux circonstances du déroulement de l’enquête (paragraphe 32 ci-dessus), ni ordonné un complément d’expertise des blessures d’U., ni convoqué l’expert à l’audience pour de plus amples explications.
73. Dans ces conditions, la Cour constate que, en acceptant les dépositions d’U. faites au stade de l’enquête en tant que preuves à charge, alors que les circonstances de leur obtention révélaient un risque réel et non réfuté de mauvais traitements, ainsi qu’en faisant abstraction de ses rétractions lors du procès, au seul motif que ses allégations de mauvais traitements avaient été rejetées comme mal fondées par les procureurs dans le cadre de leurs vérifications, la cour régionale a privé d’équité le procès du requérant (Huseyn et autres, précité, § 212, Örs et autres, précité, § 61, Özcan Çolak c. Turquie, no 30235/03, § 49, 6 octobre 2009, Aydin Cetinkaya c. Turquie, no 2082/05, § 107, 2 février 2016, et Mehmet Duman, précité, § 46). Cette conclusion rend inutile l’examen de l’argument du Gouvernement selon lequel les déclarations d’U. n’étaient pas décisives pour fonder la condamnation du requérant pour meurtre.
74. Partant, la Cour rejette l’exception tirée par Gouvernement de l’irrecevabilité comme relevant de la « quatrième instance », et elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
LES RESTRICTIONS DE LA PRÉSENCE
D'UN AVOCAT DURANT LA GARDE A VUE
GRANDE CHAMBRE SIMEONOVI c. BULGARIE du 12 mai 2017 requête no 21980/04
non violation de l'article 6-1 et 6-3 de la Convention: L'absence de l'avocat durant la garde à vue n'a pas porté atteinte à l'équité de la procédure pénale vue dans son ensemble !
1. Principes généraux
a) L’applicabilité de l’article 6 sous son volet pénal
110. Les garanties offertes par l’article 6 §§ 1 et 3 s’appliquent à tout « accusé » au sens autonome que revêt ce terme sur le terrain de la Convention. Il y a « accusation en matière pénale » dès lors qu’une personne est officiellement inculpée par les autorités compétentes ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent contre elle ont des répercussions importantes sur sa situation (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 42-46, série A no 35, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A no 51, McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 143, 10 septembre 2010, et, plus récemment, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, § 249, CEDH 2016.
111. Ainsi, à titre d’exemple, une personne qui a été arrêtée parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale (voir, parmi d’autres, Heaney et McGuinness c. Irlande, no 34720/97, § 42, CEDH 2000‑XII, et Brusco c. France, no 1466/07, §§ 47-50, 14 octobre 2010), une personne soupçonnée, interrogée sur son implication dans des faits constitutifs d’une infraction pénale (Aleksandr Zaichenko c. Russie, no 39660/02, §§ 41-43, 18 février 2010, Yankov et autres c. Bulgarie, no 4570/05, § 23, 23 septembre 2010, et Ibrahim et autres, précité, § 296) ou une personne formellement inculpée, selon les modalités du droit interne, d’une infraction pénale (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 66, CEDH 1999‑II, et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 44, CEDH 2004‑XI) peuvent toutes être considérées comme « accusées d’une infraction pénale » et prétendre à la protection de l’article 6 de la Convention. C’est la survenance même du premier de ces événements, indépendamment de leur ordre chronologique, qui déclenche l’application de l’article 6 sous son volet pénal.
b) Le droit à l’assistance d’un avocat et l’équité globale de la procédure pénale
112. La Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, garanti à l’article 6 § 3 c), figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz, précité, § 51, et Dvorski c. Croatie [GC], no 25703/11, § 76, CEDH 2015). L’accès à bref délai à un avocat constitue un contrepoids important à la vulnérabilité des suspects en garde à vue, offre une protection essentielle contre la coercition et les mauvais traitements dont ils peuvent être l’objet de la part de la police et contribue à la prévention des erreurs judiciaires et à l’accomplissement des buts poursuivis par l’article 6, notamment l’égalité des armes entre l’accusé et les autorités d’enquête ou de poursuite (Salduz, précité, §§ 53‑54, et Ibrahim et autres, précité, § 255).
113. L’article 6 § 3 c) ne garantit donc pas un droit autonome, mais doit être lu et interprété à la lumière de l’exigence plus générale d’équité de la procédure pénale, vue dans son ensemble, garantie à l’article 6 § 1 de la Convention. En particulier, le respect des exigences du procès équitable s’apprécie au cas par cas à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l’examen isolé de tel ou tel point ou incident, bien que l’on ne puisse exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette de juger de l’équité du procès à un stade précoce (Ibrahim et autres, précité, §§ 250 et 251). L’article 6 § 3 c) laisse ainsi aux États contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire d’assurer son respect, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable (Salduz, précité, § 51).
114. Tout comme les autres garanties de l’article 6, le droit à l’assistance d’un avocat est applicable dès qu’il existe une « accusation en matière pénale » au sens donnée à cette notion par la jurisprudence de la Cour (paragraphes 110 et 111 ci-dessus), et il peut donc jouer un rôle à un stade antérieur à la phase de jugement si et dans la mesure où son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès (Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36, série A no 275, Dvorski, précité, § 76, et Ibrahim et autres, précité, § 253).
c) La renonciation au droit à l’assistance d’un avocat
115. La Cour rappelle que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable. Cela s’applique également au droit à l’assistance d’un avocat (voir, parmi d’autres, Dvorski, précité, §§ 100 et 101, et Sakhnovski c. Russie [GC], no 21272/03, § 90, 2 novembre 2010). Cependant, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la Convention, la renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité. Elle n’a pas besoin d’être explicite mais elle doit être volontaire, consciente et éclairée (Pishchalnikov c. Russie, no 7025/04, § 77, 24 septembre 2009 ; voir aussi le paragraphe 119 ci-dessous). Avant qu’un accusé puisse être réputé avoir implicitement renoncé, par son comportement, à un droit important énoncé à l’article 6, il doit être établi qu’il aurait pu raisonnablement prévoir les conséquences de son comportement (Pishchalnikov, précité, § 77 in fine). De plus, cette renonciation ne doit se heurter à aucun intérêt public important (Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 66, série A no 171‑A, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006‑II).
d) La restriction temporaire de l’accès à un avocat pour des « raisons impérieuses »
116. La Cour rappelle également que l’accès à un avocat pendant la phase de l’enquête peut être temporairement restreint lorsqu’il y a des « raisons impérieuses » de le faire. Au paragraphe 55 de son arrêt Salduz (précité), la Cour a dit ce qui suit concernant la restriction de l’accès à un avocat pour des « raisons impérieuses » pendant la garde à vue :
« (...) [L]a Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif » (...), il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6 (...) Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. »
117. Dans son récent arrêt Ibrahim et autres (précité), la Cour a complété et précisé les critères énoncés dans l’arrêt Salduz. Elle a notamment indiqué que les restrictions de l’accès à une assistance juridique ne sont permises que dans des cas exceptionnels, doivent être de nature temporaire et doivent reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d’espèce. Dès lors qu’un gouvernement défendeur a démontré de façon convaincante l’existence d’un besoin urgent de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique dans un cas donné, cette nécessité peut s’analyser en une raison impérieuse de restreindre l’accès à l’assistance juridique aux fins de l’article 6 de la Convention. En pareilles circonstances, les autorités doivent impérativement protéger les droits garantis aux victimes ou aux victimes potentielles par les articles 2, 3 et 5 § 1 de la Convention en particulier. Pour déterminer si l’existence de raisons impérieuses a été démontrée, il est important de vérifier si la décision de restreindre l’assistance juridique avait une base en droit interne et si la portée et la teneur de toutes les restrictions à cet accès étaient suffisamment encadrées par la loi de manière à aider les personnes chargées de leur application concrète dans leur prise de décisions (ibidem, §§ 258 et 259).
118. La Cour a ensuite rappelé que l’absence de « raisons impérieuses » de restreindre l’accès à un avocat n’emporte pas à elle seule violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (ibidem, § 262). En cas d’absence de « raisons impérieuses », la Cour doit opérer un contrôle très strict de l’équité de la procédure pénale : l’incapacité du gouvernement défendeur à établir l’existence de raisons impérieuses pèse lourdement dans la balance lorsqu’il s’agit d’apprécier globalement l’équité du procès et elle peut faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c). C’est alors au gouvernement défendeur qu’il incombe d’expliquer de façon convaincante pourquoi, à titre exceptionnel et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la restriction de l’accès à l’assistance juridique n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès (ibidem, § 265). Si, au contraire, l’existence de raisons impérieuses de restreindre l’accès à un avocat est jugée établie, un examen global de l’ensemble de la procédure doit être conduit de manière à déterminer si celle-ci a été « équitable » au sens de l’article 6 § 1 (ibidem, § 264).
e) Le droit d’être informé du droit à l’assistance d’un avocat
119. Dans le même arrêt Ibrahim et autres (précité, §§ 272 et 273), la Cour a jugé inhérent au droit de ne pas témoigner contre soi‑même, au droit de garder le silence et au droit à une assistance juridique que tout « accusé » au sens de l’article 6 ait le droit d’être informé de ces droits. Par conséquent, l’article 6 § 3 c) de la Convention doit être interprété comme garantissant également le droit pour un accusé d’être informé immédiatement du contenu du droit à un avocat, indépendamment de l’âge ou de la situation particulière de l’intéressé, et indépendamment du point de savoir s’il est représenté par un avocat d’office ou un avocat de son choix. Le respect de ce droit n’est d’ailleurs pas sans répercussions sur la validité d’une éventuelle renonciation au droit à l’assistance d’un avocat (paragraphe 115 ci-dessus).
f) Les facteurs pertinents pour l’analyse de l’équité globale de la procédure
120. L’appréciation de l’équité de la procédure pénale s’effectuant au cas par cas et à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble, dans son arrêt Ibrahim et autres (précité, § 274) la Cour a fourni une liste non exhaustive de facteurs devant être pris en compte, s’il y a lieu, pour mesurer les conséquences de lacunes procédurales survenues au stade de l’enquête sur l’équité globale du procès pénal. On y retrouve les facteurs suivants :
a) la vulnérabilité particulière du requérant, par exemple en raison de son âge ou de ses capacités mentales ;
b) le dispositif légal encadrant la procédure antérieure à la phase de jugement et l’admissibilité des preuves au cours de cette phase, ainsi que le respect ou non de ce dispositif, étant entendu que, quand s’applique une règle dite d’exclusion, il est très peu vraisemblable que la procédure dans son ensemble soit jugée inéquitable ;
c) la possibilité ou non pour le requérant de contester l’authenticité des preuves recueillies et de s’opposer à leur production ;
d) la qualité des preuves et l’existence ou non de doutes quant à leur fiabilité ou à leur exactitude compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues ainsi que du degré et de la nature de toute contrainte qui aurait été exercée ;
e) lorsque les preuves ont été recueillies illégalement, l’illégalité en question et, si celle-ci procède de la violation d’un autre article de la Convention, la nature de la violation constatée ;
f) s’il s’agit d’une déposition, la nature de celle-ci et le point de savoir s’il y a eu prompte rétractation ou rectification ;
g) l’utilisation faite des preuves, et en particulier le point de savoir si elles sont une partie intégrante ou importante des pièces à charge sur lesquelles s’est fondée la condamnation, ainsi que la force des autres éléments du dossier ;
h) le point de savoir si la culpabilité a été appréciée par des magistrats professionnels ou par des jurés et, dans ce dernier cas, la teneur des instructions qui auraient été données au jury ;
i) l’importance de l’intérêt public à enquêter sur l’infraction particulière en cause et à en sanctionner l’auteur ;
j) l’existence dans le droit et la pratique internes d’autres garanties procédurales.
2. Application de ces principes au cas d’espèce
a) Sur le point de départ de l’application de l’article 6 au cas d’espèce
121. En ce qui concerne les faits de l’espèce, la Cour observe que le requérant était recherché par les autorités chargées de l’enquête pénale et la police depuis le début du mois de juillet 1999 lorsque son arrestation a été ordonnée parce qu’il était soupçonné d’avoir commis un vol à main armé et deux meurtres et était en fuite depuis presque trois mois (paragraphe 13 ci‑dessus). La Cour considère cependant que c’est l’arrestation de l’intéressé par la police, le 3 octobre 1999, qui doit être prise comme point de départ pour l’application des garanties énumérées à l’article 6 de la Convention. L’arrestation reposait sur des soupçons selon lesquels le requérant avait commis des infractions pénales et elle a eu des répercussions importantes sur sa situation en permettant aux autorités de procéder à des mesures d’instruction avec sa participation. C’est donc à la date du 3 octobre 1999 que le droit à l’assistance d’un avocat, énoncé à l’article 6 § 3 c), est devenu applicable en l’espèce.
b) Sur le point de savoir si le requérant a renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat
122. La Cour constate que si le requérant n’a pas été assisté par un avocat pendant sa garde à vue, cette limitation ne découlait pas du droit interne puisque la législation bulgare l’autorisait à avoir accès à un avocat dès le moment de son arrestation, à savoir le 3 octobre 1999 (paragraphe 59 ci-dessus). Si le requérant avait demandé à s’entretenir avec un avocat les 3, 4, 5 et 6 octobre 1999 (avant 12 heures), les autorités auraient été dans l’obligation légale de donner suite à cette requête.
123. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le requérant a demandé à voir un avocat (paragraphes 97 et 102 ci-dessus). Force est de constater qu’aucun document du dossier pénal ne corrobore l’affirmation du requérant selon laquelle il a fait une telle demande. À l’époque des faits, la législation bulgare ne prévoyait pas encore que le souhait du détenu de consulter un avocat ou sa renonciation à ce droit devaient être consignés par écrit (paragraphes 60-62 ci-dessus).
124. La Cour rappelle que, pour l’établissement des faits, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, parmi beaucoup d’autres, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25). La Cour estime regrettable que l’on n’ait pas dûment consigné les trois premiers jours de détention du requérant de manière à dissiper tout doute sur le point de savoir s’il a demandé un avocat (voir, mutatis mutandis, Dvorski, précité, § 105 in fine). En conséquence, plusieurs années après les faits en cause, et en l’absence de tout commencement de preuve, la Cour n’est pas en mesure d’établir avec certitude si le requérant avait demandé à consulter un avocat.
125. La Cour se doit néanmoins de rechercher si, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, l’absence de tout indice objectif montrant que l’intéressé a demandé à être assisté par un avocat pendant sa garde à vue pourrait révéler une renonciation implicite à ce droit.
126. À cet égard, elle observe que dans un système où, comme dans le droit bulgare à l’époque des faits, l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue dépend de la demande expresse du suspect, il est essentiel que celui-ci soit informé de ce droit le plus tôt possible pour qu’il soit en mesure de s’en prévaloir (paragraphe 119 ci-dessus). À plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, l’accusé est soupçonné de crimes graves et encourt une lourde peine. En effet, c’est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques (Salduz, précité, § 54). Il se pose donc la question de savoir si le requérant a été dûment informé de son droit à l’assistance d’un avocat dès son arrestation, comme le prévoyait d’ailleurs le droit interne (paragraphe 59 ci-dessus).
127. Dans ses observations et à l’audience, le Gouvernement, se référant aux dispositions pertinentes du droit interne qui obligeaient les autorités à informer un accusé de ses droits (paragraphe 101 ci-dessus), a soutenu que le requérant avait reçu cette information juste après son arrestation. Or le dossier de l’affaire pénale ne contient aucune trace écrite à ce sujet et le Gouvernement n’a pas étayé son allégation par d’autres éléments de preuve. Force est de constater que l’ordonnance de détention du requérant, qui énonçait son droit à l’assistance d’un avocat, n’a pas été signée par lui et qu’aucun document ne permet de constater qu’elle lui a été remise après son arrestation (paragraphes 13 et 14 ci-dessus). Il faut donc en conclure qu’elle ne lui a pas été dûment notifiée. Il en résulte que le requérant n’a pas été informé de manière vérifiable de ses droits procéduraux avant le jour de son inculpation, à savoir le 6 octobre 1999 (paragraphe 21 ci-dessus).
128. La Cour rappelle que l’obtention de cette information par l’accusé constitue l’une des garanties qui permettent à celui-ci d’exercer les droits de la défense et aux autorités de veiller notamment à ce qu’une éventuelle renonciation par l’accusé au droit à l’assistance d’un avocat soit volontaire, consciente et éclairée. Cette information garantit donc la possibilité effective d’exercer ce droit et – en outre – la validité d’une éventuelle renonciation au regard de la Convention (paragraphes 115 et 119 ci-dessus). Dès lors, à supposer même que le requérant n’ait pas fait de demande expresse en vue d’obtenir l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue, comme le prévoyait le droit bulgare à l’époque, il ne saurait passer pour avoir implicitement renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat, faute pour lui d’avoir reçu promptement une telle information après son arrestation. Son droit à l’assistance d’un avocat a donc été restreint.
c) Sur le point de savoir s’il y avait des « raisons impérieuses » de restreindre l’accès à un avocat
129. La Cour rappelle que les restrictions de l’accès à un avocat pour des « raisons impérieuses » ne sont permises que dans des cas exceptionnels, doivent être de nature temporaire et doivent reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d’espèce (paragraphe 117 ci-dessus).
130. Or le Gouvernement n’a pas fait état de telles circonstances exceptionnelles et il n’appartient pas à la Cour de rechercher de son propre chef si elles existaient en l’espèce. La Cour ne voit donc aucune « raison impérieuse » qui aurait pu justifier de restreindre l’accès du requérant à un avocat pendant sa garde à vue : il n’a pas été allégué qu’il existait un risque imminent pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’autrui (voir, a contrario, Ibrahim et autres, précité, § 276). Par ailleurs, la législation interne régissant l’accès à un avocat pendant la garde à vue ne prévoyait pas explicitement d’exceptions à l’application de ce droit (paragraphes 59 et 64 ci-dessus). Il semble en effet que le déroulement des faits en l’espèce corresponde à une pratique des autorités qui a été vivement critiquée aussi par le CPT (voir la déclaration publiée par le CPT en 2015, paragraphe 80 ci‑dessus).
131. La Cour observe à cet égard qu’une telle pratique des autorités est difficilement conciliable avec la prééminence du droit, expressément mentionnée dans le préambule de la Convention et inhérente à tous les articles de celle-ci (Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 63, CEDH 2002‑IV).
d) Sur le point de savoir si l’équité globale de la procédure a été respectée
132. La Cour doit à présent rechercher si l’absence d’un avocat pendant la garde à vue a eu pour effet de nuire irrémédiablement à l’équité du procès pénal du requérant considéré dans son ensemble. L’absence en l’espèce de « raisons impérieuses » oblige la Cour à se livrer à un examen très strict de l’équité de la procédure. Il appartient au Gouvernement de démontrer de manière convaincante que le requérant a néanmoins bénéficié d’un procès pénal équitable (paragraphe 118 ci‑dessus).
133. À cet égard, le Gouvernement a invoqué les circonstances suivantes : le requérant n’aurait pas été formellement interrogé en l’absence d’un avocat lors de sa garde à vue ; aucune déclaration éventuellement faite par le requérant pendant cette période n’aurait été prise en compte ou utilisée par la suite pour motiver sa condamnation ; son comportement pendant la garde à vue n’aurait pas été pris en considération par les autorités de poursuite ou les juridictions saisies ; auprès des autorités, le requérant n’aurait jamais allégué avoir été contraint de passer aux aveux lors de sa garde à vue ; il aurait bénéficié d’un large éventail de garanties procédurales au cours d’une procédure pénale qui aurait présenté tous les attributs du procès équitable (paragraphes 103 ci-dessus).
134. La Cour note que les positions des parties divergent sur le point de savoir si le requérant a été interrogé en l’absence d’un avocat pendant la période comprise entre le 3 et le 6 octobre 1999. S’appuyant sur l’absence de tout document à ce sujet, le Gouvernement soutient qu’à supposer même qu’une conversation ou un interrogatoire aient pu avoir lieu pendant la garde à vue du requérant, ceux-ci auraient été informels et n’auraient pu avoir aucune incidence sur le cours des poursuites pénales (paragraphe 103 ci‑dessus). Le requérant, de son côté, affirme devant la Grande Chambre qu’il a été interrogé et estime qu’il aurait été illogique que les autorités ne saisissent pas cette occasion pour rassembler davantage de preuves (paragraphe 97 ci-dessus).
135. La Cour relève à cet égard que la version des faits présentée par le requérant au cours de la procédure devant elle a évolué au fur et à mesure de l’avancement de celle-ci : dans sa requête auprès de la Cour, le requérant a été très vague à ce sujet ; puis, dans son mémoire adressé à la Grande Chambre, il a pour la première fois exposé certains détails plus concrets, comme par exemple la circonstance qu’il aurait fait des déclarations pendant sa garde à vue, le contenu de celles-ci et le nom de l’avocat qu’il aurait demandé à voir. La Cour observe également que le requérant n’a pas plaidé l’absence d’un avocat pendant la garde à vue devant la cour d’appel de Burgas (paragraphe 34 ci-dessus) et que son pourvoi en cassation mentionnait l’absence d’un avocat pendant la journée du 4 octobre 1999 de manière tout à fait marginale et dans le contexte d’un autre argument ayant visé à exclure une preuve obtenue en la présence de son avocat commis d’office (paragraphe 42 ci-dessus). Par ailleurs, alors que la déclaration manuscrite de son complice présumé, A.S., en date du 3 octobre 1999, se trouve dans le dossier pénal (paragraphe 20 ci-dessus), il n’existe aucun commencement de preuve permettant à la Cour de conclure que le requérant a été interrogé de manière formelle ou informelle pendant sa garde à vue.
136. Quoi qu’il en soit, la Cour attache en l’espèce une importance décisive au fait que pendant cette période d’environ trois jours aucun élément de preuve qui aurait pu être utilisé contre le requérant n’a été obtenu et versé au dossier pénal. Aucune déclaration du requérant n’a été recueillie. Aucune pièce du dossier pénal ne permet d’affirmer que l’intéressé a pris part à d’autres mesures d’instruction pendant cette période, comme par exemple une parade d’identification ou le prélèvement de matériel biologique. Par ailleurs, le requérant lui-même n’a pas allégué devant la Cour que les tribunaux auraient disposé d’un quelconque élément de preuve produit pendant cette même période et qu’ils l’auraient utilisé dans le cadre de son procès pour motiver sa condamnation.
137. À cet égard il convient de souligner que le droit et la jurisprudence des tribunaux internes prévoyaient l’exclusion de toute preuve qui n’aurait pas été obtenue dans le respect des règles du code de procédure pénale (paragraphe 68 ci-dessus). Dans le cas du requérant, qui encourait la peine perpétuelle, l’assistance d’un avocat pendant l’interrogatoire aurait été une condition sine qua non de la recevabilité, en tant que preuve au cours du procès, d’une éventuelle déclaration de sa part (paragraphe 65 ci-dessus).
138. Qui plus est, l’espèce se distingue des affaires John Murray c. Royaume‑Uni (8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I) et Averill c. Royaume-Uni (no 36408/97, CEDH 2000‑VI) en ce que dans la présente affaire l’absence de déclaration de la part de l’inculpé n’aurait eu aucune incidence pendant les étapes suivantes de la procédure pénale. Le requérant aurait même pu tirer profit du fait qu’il avait gardé le silence, s’il n’avait pas choisi de passer aux aveux à un stade ultérieur de la procédure, alors qu’il était assisté par un avocat de son choix.
139. Le 21 octobre 1999, soit deux semaines après son inculpation formelle, le requérant est volontairement passé aux aveux (paragraphes 21 et 24 ci-dessus). Pour conclure au caractère volontaire de ces aveux, la Cour prend en compte le fait que le requérant avait déjà été interrogé à deux reprises, les 6 et 12 octobre 1999, en étant assisté par un avocat, et qu’il avait gardé le silence en ces deux occasions (paragraphes 21 et 23 ci‑dessus). Lors de chacun de ces interrogatoires, ainsi que lors des aveux du 21 octobre 1999, il était informé de ses droits procéduraux, notamment du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (paragraphe 21 ci‑dessus). Au surplus, à cette époque il bénéficiait des conseils et de l’assistance d’un avocat de son choix (paragraphes 23 et 24 ci-dessus).
140. Il n’est pas contesté que seuls les aveux livrés par le requérant le 21 octobre 1999 ont été utilisés pour motiver sa condamnation. Aucun lien de cause à effet n’a été évoqué, ni devant les tribunaux internes ni devant la Cour, entre l’absence d’un avocat du 3 au 6 octobre 1999 et les aveux formulés par le requérant deux semaines après la fin de cette période, en présence d’un avocat de son choix (voir, mutatis mutandis, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 180, CEDH 2010). Par conséquent, l’absence d’un avocat au cours de la garde à vue n’a aucunement nui au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
141. La Cour constate ensuite que le requérant a activement participé à toutes les étapes de la procédure pénale : il s’est rétracté de ses dépositions initiales en présentant une autre version des faits, ses défenseurs ont obtenu la collecte de preuves à décharge et ont contesté les preuves à charge (paragraphes 27, 29, 31, 35, 42 ci-dessus).
142. En outre, la condamnation du requérant ne reposait pas uniquement sur ses aveux du 21 octobre 1999, livrés en présence de l’avocat de son choix, mais sur un ensemble de preuves concordantes, parmi lesquelles les dépositions des multiples témoins interrogés pendant l’examen de l’affaire, les résultats d’expertises balistiques, comptables, techniques, médicales et psychiatriques, ainsi que les preuves matérielles et documentaires (paragraphes 26, 33, 36-41 et 43 ci-dessus).
143. L’affaire a été examinée au cours de trois instances : par un tribunal régional, par une cour d’appel et par la Cour suprême de cassation. Toutes ces juridictions ont dûment pris en compte les preuves recueillies, parmi lesquelles les dépositions des multiples témoins interrogés pendant l’examen de l’affaire, les résultats d’expertises balistiques, comptables, techniques, médicales et psychiatriques, ainsi que les preuves matérielles et documentaires rassemblées. Dans leurs décisions, qui étaient adéquatement motivées sur le plan factuel et juridique, elles ont aussi dûment examiné la question de savoir si les droits procéduraux du requérant avaient été respectés (paragraphes 31-44 ci‑dessus).
144. À la lumière de ces constatations, la Cour estime que le Gouvernement a présenté des éléments pertinents et suffisants pour démontrer qu’il n’a pas été porté une atteinte irrémédiable à l’équité de la procédure pénale contre le requérant considérée dans son ensemble du fait de l’absence d’assistance d’un avocat pendant sa période de garde à vue, du 3 au 6 octobre 1999.
e) Conclusion
145. En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
A - T C. Luxembourg du 9 avril 2015 requête 30460/13
Violation de l'article 6-1 : L'avocat doit pouvoir s'entretenir confidentiellement avec son client avant l'interrogatoire, mais les autorités peuvent interdire l'accès au dossier à l'avocat, avant le premier interrogatoire .
a) Les principes applicables
62. La Cour rappelle que si l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien-fondé de l’accusation », il peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès (Salduz, précité, § 50, et Panovits c. Chypre, no 4268/04, § 64, 11 décembre 2008). De plus, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 37, série A no 275 et Brennan c. Royaume-Uni, no 39846/98, § 45, CEDH 2001‑X).
63. Le droit d’un accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les attributs fondamentaux d’un procès équitable (Krombach c. France, no 29731/96, § 89, CEDH 2001‑II). Pour qu’il demeure suffisamment « concret et effectif », le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 implique en règle générale que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. La Cour a précisé que même dans un tel cas, le refus de l’accès à un avocat ne devait pas indûment préjudicier aux droits découlant de l’article 6, et qu’il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz, précité, § 55). Elle a conclu à une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) nonobstant le fait que le requérant avait par la suite bénéficié de l’assistance d’un avocat et d’une procédure contradictoire, après avoir notamment relevé que la restriction au droit d’accès à un avocat dont il était question relevait de l’application systématique de dispositions légales (Salduz, précité, §§ 56 et 61).
64. L’équité d’une procédure pénale requiert d’une manière générale, aux fins de l’article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire, et indépendamment des interrogatoires qu’il subit. La Cour a souligné à cet égard que l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil, indiquant que la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer (Dayanan, précité, §§ 31-33). Par ailleurs, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable au stade de l’enquête, ce qui a d’autant plus de conséquences que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l’utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l’assistance d’un avocat, dont la tâche consiste notamment à contribuer au respect du droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même (Pavlenko c. Russie, no 42371/02, § 101, 1er avril 2010).
65. La Cour a eu l’occasion de rappeler que, d’une part, un « accusé », au sens de l’article 6 de la Convention, a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de sa garde à vue ou de sa détention provisoire et, le cas échéant, lors de ses interrogatoires par la police et le juge d’instruction ; d’autre part, si une restriction à ce droit peut dans certaines circonstances se trouver justifiée et être compatible avec les exigences de cette disposition, le fait que son exercice est impossible en raison d’une règle de droit interne systématique est inconciliable avec le droit à un procès équitable (Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, § 31, 28 août 2012, et Navone et autres c. Monaco, nos 62880/11, 62892/11 et 62899/11, § 80, 24 octobre 2013).
66. Ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable (Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000, et Ananyev c. Russie, no 20292/04, § 38, 30 juillet 2009). Toutefois, pour être effective aux fins de la Convention, la renonciation au droit de prendre part au procès doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Salduz, précité, § 59, et Yoldaş, précité, § 51).
b) Application des principes en l’espèce
i. Absence d’assistance par un avocat lors de l’audition policière
67. Le procès-verbal de l’audition policière du 17 décembre 2009 mentionne que le requérant a réclamé son droit à l’assistance d’un avocat, mais qu’il a consenti à un interrogatoire sans une telle assistance, après avoir « reçu les explications nécessaires concernant la procédure prévue en la matière » (paragraphe 12 ci-dessus).
68. Devant la Cour, les parties sont en désaccord sur la question des dispositions légales applicables en l’espèce. Ainsi, le requérant conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les articles 39 et 52 du code d’instruction criminelle s’appliqueraient ipso facto en cas d’arrestation d’une personne sur base d’un mandat d’arrêt européen.
69. La Cour relève qu’au moment de l’audition litigieuse le 17 décembre 2009, la législation luxembourgeoise prévoyait le droit à l’assistance d’un avocat en cas d’interrogatoire de police d’une personne retenue dans une procédure de flagrant crime ou délit (article 39 (7) du Code d’instruction criminelle) et de celui d’un détenu préventif sur des faits autres que ceux pour lesquels il a été inculpé (article 52 (3) du Code d’instruction criminelle) (paragraphe 27 ci-dessus). Il résulte de la lettre du Procureur général du 15 juin 2011 qu’à l’époque des faits litigieux, le droit à l’assistance d’un avocat ne s’appliquait pas à l’interrogatoire de police dans le cadre d’une instruction préparatoire, sur commission rogatoire du juge d’instruction luxembourgeois, de la personne privée de liberté en exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par le juge luxembourgeois (paragraphe 33 ci-dessus). En effet, la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne prévoit l’assistance d’un avocat lors d’un interrogatoire par la police uniquement dans le cadre de l’exécution au Luxembourg d’un mandat d’arrêt européen émis par une autorité étrangère (paragraphe 28 ci-dessus). Or, force est de rappeler que l’audition policière du requérant a eu lieu à la suite de son arrestation au Royaume-Uni sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis par un juge d’instruction luxembourgeois. Il ne saurait dès lors prêter à controverse qu’à l’époque des faits, l’assistance d’un avocat pendant l’audition policière était explicitement prévue par la loi dans certaines hypothèses, mais implicitement exclue dans les circonstances telles que celle en l’espèce. C’est pourquoi, l’assistance était ainsi automatiquement exclue du fait des dispositions légales pertinentes existant en la matière (mutatis mutandis, Navone et autres c. Monaco, précité, § 81).
70. La Cour relève que la situation a été modifiée depuis, par une « note de service No 49/2011 » de la police grand-ducale du 20 juin 2011 (paragraphes 32 et 33 ci-dessus) ; elle note par ailleurs le dépôt d’un projet de loi visant à compléter le code d’instruction criminelle afin de consacrer le droit à l’assistance d’un avocat dans toute situation où une personne privée de liberté est soumise à un interrogatoire. Force est toutefois de constater que le requérant n’a pas pu bénéficier, lors de son audition le 17 décembre 2009, des dispositions instituées par la note susmentionnée.
71. Par conséquent, la Cour ne peut que constater qu’au regard de la loi en vigueur à l’époque pertinente, le requérant a été automatiquement privé de l’assistance d’un conseil au sens de l’article 6 lors de l’interrogatoire du 17 décembre 2009. Dans ces conditions, la question de la renonciation au droit à l’assistance d’un avocat est sans objet (mutatis mutandis, Navone et autres c. Monaco, précité, § 83).
72. Le requérant a fait des déclarations circonstanciées lors de l’audition litigieuse par la police. Certes, il a nié les faits dans leur intégralité et n’a pas fait de déclarations incriminantes. Toutefois, la Cour souligne l’importance du stade de l’enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès (Mehmet Şerif Öner c. Turquie, no 50356/08, § 21, 13 septembre 2011). En l’espèce, après avoir relaté les déclarations du requérant recueillies devant la police, le juge d’instruction et lors des audiences, le tribunal a mentionné que l’intéressé changeait constamment de « version ». De surcroît, la cour d’appel s’est référée expressément aux déclarations faites par le requérant lors de l’audition par la police pour conclure qu’il n’avait pas toujours été constant dans ses déclarations. La Cour ne saurait dès lors accepter l’argument du Gouvernement selon lequel les déclarations faites par le requérant durant la phase litigieuse n’ont eu aucune influence sur la décision finale.
73. Lorsque le requérant a critiqué le fait d’avoir été entendu par la police sans avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat devant la cour d’appel, celle-ci considéra qu’il avait été d’accord à déposer sans la présence d’un conseil. En se bornant à faire ce constat, la cour d’appel n’a, a fortiori, pas analysé la nécessité d’au moins exclure les déclarations recueillies lors de la phase litigieuse du procès ; bien au contraire, elle en a même tenu compte - certes parmi de nombreux autres éléments - dans son raisonnement ayant abouti à la condamnation du requérant. La Cour de cassation a ensuite rejeté le pourvoi du requérant, au motif que la cour d’appel avait retenu qu’il n’y avait pas violation des droits de la défense, dès lors que l’intéressé s’était déclaré d’accord à déposer sans la présence d’un conseil. La Cour est d’avis qu’en décidant de la sorte, l’arrêt de la cour d’appel, entériné ensuite par la Cour de cassation, n’a pas examiné la situation critiquée et n’a ainsi pas réparé les conséquences résultant de la non-assistance du requérant par un avocat lors de l’audition de police. Pour autant que le Gouvernement invite la Cour à adopter une approche souple fondée sur une lecture globale, la Cour estime qu’il ne saurait utilement invoquer les arrêts John Murray (précité) et Rupa c. Roumanie no 2 (précitée). Ainsi, dans le premier arrêt invoqué, antérieur à la jurisprudence Salduz, la Cour a constaté que le requérant avait gardé le silence du début de l’interrogatoire de police à la fin de son procès et a conclu à la non-violation du grief tiré de la violation du droit de garder le silence ; force est toutefois de constater qu’elle a conclu à la violation de l’article 6 quant au refus au requérant de l’accès à un solicitor pendant les quarante-huit premières heures de sa garde à vue. Quant à la deuxième affaire invoquée, les griefs sont d’une nature différente ; en effet, le requérant concerné a allégué que le procureur lui avait refusé l’assistance de l’avocat de son choix et que l’avocat commis d’office ne lui avait pas fourni d’assistance suffisante.
74. La Cour prend acte du fait qu’à la suite de la circulaire du Procureur général du 13 mai 2011, la situation en la matière a été clarifiée. En effet, une note de service de la police grand-ducale du 20 juin 2011 prévoit qu’il y a lieu de se conformer à la jurisprudence de la Cour, sous peine de voir annuler les procédures engagées (paragraphes 31 à 33 ci-dessus). Tel n’était cependant pas le cas à l’époque des faits.
75. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 faute pour le requérant d’avoir bénéficié de l’assistance d’un défenseur lors de son audition par la police et faute pour les juridictions d’avoir réparé les conséquences en résultant.
ii. Défaut allégué d’assistance effective par un avocat lors du premier interrogatoire devant le juge d’instruction
76. Le lendemain de son audition par la police sans l’assistance d’un avocat, le requérant a été interrogé de 9 heures 02 jusqu’à 10 heures 53 par le juge d’instruction, en présence d’un avocat commis d’office le matin même. Au cours de cet interrogatoire, le requérant a fait des déclarations circonstanciées et a maintenu ses déclarations faites devant la police. La Cour rappelle que, dans leurs décisions de condamnation, les juges du fond ont relaté les différentes déclarations et en ont tenu compte dans leur raisonnement, estimant que l’intéressé changeait constamment de « version » (paragraphe 72 ci-dessus).
77. Avant toute chose, la Cour se doit de rappeler que le grief du requérant - qui porte sur l’absence d’une assistance effective par son conseil lors de ce premier interrogatoire - concerne la garantie des droits de la défense sous l’angle de l’article 6 de la Convention. L’intéressé ne saurait donc utilement invoquer l’affaire Emilian-George Igna c. Roumanie (no 21249/05, 26 novembre 2013), qui traite d’une question de nature différente, celle de la légalité de la détention sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention.
78. Afin d’analyser les doléances du requérant à l’égard du premier interrogatoire devant le juge d’instruction, la Cour estime devoir distinguer la question de l’accès de l’avocat au dossier, d’une part, et celle de la communication entre l’avocat et son client, d’autre part.
α. Défaut d’accès au dossier
79. Par application de l’article 85 du code d’instruction criminelle, les autorités luxembourgeoises reportent l’accès au dossier pénal jusqu’après le premier interrogatoire (voir, à ce sujet, paragraphe 30 ci‑dessus). La Cour rappelle que des restrictions à l’accès au dossier aux stades de l’ouverture d’une procédure pénale, de l’enquête et de l’instruction peuvent se justifier par, notamment, la nécessité de préserver le secret des données dont disposent les autorités et de protéger les droits d’autrui (mutatis mutandis, Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin c. Ukraine, no 1727/04, § 72, 24 juin 2010). En l’espèce, vu les motifs avancés dans la jurisprudence nationale, la Cour n’estime pas déraisonnable que les autorités internes justifient le défaut d’accès au dossier par des raisons relatives à la protection des intérêts de la justice. À cela s’ajoute que dès avant son inculpation, la personne interrogée dispose de toute liberté d’organiser sa défense (y compris le droit de garder le silence, de consulter le dossier après le premier interrogatoire devant le juge d’instruction, et de choisir sa stratégie de défense tout au long du procès pénal). Un juste équilibre est ainsi assuré par la garantie de l’accès au dossier, dès la fin du premier interrogatoire, devant les juridictions d’instruction et tout au long du procès au fond.
80. La Cour est d’avis qu’il ne lui appartient pas de décider si le requérant peut tirer du récent projet de loi (paragraphe 52 in fine) ou de la directive 2012/13/UE (paragraphe 37 ci-dessus) un droit pour le conseil d’avoir accès au dossier dès avant le premier interrogatoire du juge d’instruction. En effet, quant au projet de loi, il ne lui revient pas d’exprimer une opinion au sujet d’une initiative du législateur, actuellement en cours d’examen. Pour ce qui est de la directive, elle se borne à constater que le premier paragraphe de l’article 7 de cette directive concerne la question de la légalité de l’arrestation et de la détention, couverte par l’article 5 de la Convention. Ce qui est en cause en l’espèce est la question du respect des droits de la défense de l’« accusé » au sens de l’article 6 de la Convention. Or, à cet égard, le paragraphe 3 de l’article 7 de la directive dispose que l’accès aux pièces est accordé « en temps utile pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu’une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation ».
81. La Cour estime que l’article 6 de la Convention ne saurait être interprété comme garantissant un accès illimité au dossier pénal dès avant le premier interrogatoire par le juge d’instruction, lorsque les autorités nationales disposent de raisons relatives à la protection des intérêts de la justice suffisantes pour ne pas mettre en échec l’efficacité des investigations.
82. De l’avis de la Cour, ce constat ne saurait utilement être mis en échec par l’arrêt Sapan (précité) invoqué par le requérant. Dans l’affaire en question, le grief du requérant portait sur l’absence de toute assistance légale du requérant lors de son interrogatoire par la police et par le procureur auprès de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Certes, l’arrêt mentionne le fait que l’avocat du requérant s’était vu refuser l’accès au dossier d’instruction par la cour de sûreté de l’État d’Istanbul. Toutefois, pour conclure à une violation de l’article 6, le comité de trois juges s’est uniquement basé sur les critères établis dans une jurisprudence considérée comme bien établie, à savoir l’absence de toute assistance légale du requérant qui était le résultat d’une application sur une base systématique des dispositions légales pertinentes (Salduz, précité).
83. Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère que l’assistance de l’avocat lors de l’interrogatoire du 18 décembre 2009 n’a pas été ineffective en raison d’un défaut d’accès au dossier avant cet interrogatoire.
84. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention de ce chef.
β. Absence alléguée de communication entre le requérant et son avocat
85. La Cour constate que les thèses des parties divergent au sujet de la possibilité pour le requérant de communiquer avec son avocat avant l’interrogatoire du 18 décembre 2009. Le requérant indique qu’aux termes même de l’article 84 du code d’instruction criminelle, aucune communication n’est possible entre l’intéressé et son conseil avant le premier interrogatoire devant le juge d’instruction. Le Gouvernement expose que l’absence de réglementation implique une totale liberté dans le domaine et que la pratique veut que le mandant peut communiquer avec son avocat à tout moment, sur simple demande.
86. La Cour relève l’importance d’une consultation entre l’avocat et son client, en amont du premier interrogatoire devant le juge d’instruction. En effet, c’est à cette occasion que des échanges cruciaux peuvent se faire, si ce n’est que pour l’avocat de rappeler à l’intéressé ses droits en la matière. Cela vaut d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, le requérant a été auditionné par la police la veille sans la présence d’un avocat et que celui-ci est fraichement commis d’office le matin même de l’interrogatoire du juge d’instruction.
87. L’avocat doit pouvoir fournir une assistance effective et concrète, et non seulement abstraite de par sa présence, lors du premier interrogatoire devant le juge d’instruction. À cette fin, la consultation entre l’avocat et son client en amont dudit interrogatoire doit être consacrée d’une manière non équivoque par le législateur. Or, tel n’est pas le cas dans la législation luxembourgeoise. L’article 84 du code d’instruction criminelle ne prévoit en effet pas que l’intéressé puisse consulter son avocat avant le premier interrogatoire devant le juge d’instruction, à l’instar de ce que préconise d’ailleurs l’article 3 de la directive 2013/48/UE (paragraphe 38 ci-dessus). Bien au contraire, vu sa formulation, la disposition en question donne l’impression qu’aucune communication n’est possible avant le premier interrogatoire. Au regard de cette situation législative, l’intéressé peut partir de l’hypothèse qu’il est vain de revendiquer une communication avec son avocat dès avant le premier interrogatoire.
88. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement d’après lequel la communication entre l’intéressé et son avocat serait possible selon une pratique en vigueur. En effet, il y a lieu de rappeler que la Cour doit pouvoir s’assurer que le droit garanti est concret et effectif, et non pas théorique et illusoire. Or, à défaut d’une réglementation claire en la matière, il est impossible de savoir si une pratique est bien établie et a été respectée.
89. Force est de constater qu’en l’espèce, le procès-verbal de l’interrogatoire du 18 décembre 2009 relate qu’un avocat a été commis d’office le matin même par le juge d’instruction, mais ne contient ensuite aucune mention d’un quelconque laps de temps pendant lequel le requérant aurait pu s’entretenir avec cet avocat. La Cour ne peut donc s’assurer - au vu des seules affirmations du Gouvernement et des éléments dont elle dispose - que le requérant a pu s’entretenir avec son avocat avant l’interrogatoire litigieux et qu’il a ainsi eu une assistance effective de ce dernier.
90. La Cour se doit d’ailleurs de constater que le rapport du CPT du 28 octobre 2010 confirme la précarité de la pratique invoquée par le Gouvernement. En effet, le rapport, dressé à la suite des visites effectuées précisément l’année où se sont déroulés les faits de l’espèce, relate que la quasi-totalité des détenus rencontrés par la délégation avaient indiqué avoir vu un avocat pour la première fois lors de leur comparution devant le juge d’instruction, et n’avoir pu s’entretenir de manière confidentielle avec l’avocat qu’après cette comparution (paragraphe 35 ci-dessus).
91. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 à cet égard.
Salduz contre Turquie du 27 octobre 2008 requête 36391/02
LES FAITS
12. Soupçonné d’avoir participé à une manifestation illégale de soutien au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale), le requérant fut arrêté le 29 mai 2001 vers 22 h 15 par des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’İzmir. On lui reprochait également d’avoir accroché une banderole illégale sur un pont à Bornova le 26 avril 2001.
13. Le 30 mai 2001 vers 0 h 30, le requérant fut emmené à l’hôpital universitaire Atatürk, où il fut examiné par un médecin. D’après le rapport médical établi à la suite de cet examen, le corps de l’intéressé ne présentait aucune trace de mauvais traitements.
14. Vers 1 heure le même jour, le requérant fut interrogé dans les locaux de la section antiterroriste en l’absence d’un avocat.
LE DROIT
52. Une législation nationale peut attacher à l'attitude d'un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure. En pareil cas, l'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police. Ce droit, que la Convention n'énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit donc, dans chaque cas, de savoir si la restriction litigieuse est justifiée et, dans l'affirmative, si, considérée à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle a ou non privé l'accusé d'un procès équitable, car même une restriction justifiée peut avoir pareil effet dans certaines circonstances (voir John Murray, précité, § 63, Brennan, précité, § 45, et Magee, précité, § 44).
55. Dans ces conditions, la Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif » (paragraphe 51 ci-dessus), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (voir, mutatis mutandis, Magee, précité, § 44). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation.
Ibrahim et autres c. Royaume-Uni du 16 décembre 2014
requête nos 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09
Non violation de l'article 6-1 : Attentat du 21 juillet 2005 à Londres : l’accès tardif à un avocat durant l’interrogatoire des poseurs de bombes et d’un complice était justifié et n’a pas nui à leur procès.
La Cour rappelle qu’elle a toujours reconnu que le droit à des conseils juridiques peut être soumis à des restrictions pour une bonne cause. Dans l’arrêt de Grande Chambre Salduz c. Turquie, elle a évoqué la possibilité de restreindre l’accès à un avocat pour des « raisons impérieuses » Toutefois, même lorsqu’une restriction à l’accès à un avocat est justifiée par des «raisons impérieuses», il peut néanmoins être nécessaire, dans l’intérêt de l’équité, d’exclure d’une procédure pénale ultérieure toute déclaration faite au cours d’un interrogatoire de police en l’absence d’un avocat. A ce stade de son appréciation, la Cour doit examiner si l’admission d’une déclaration faite sans l’assistance d’un avocat cause au requérant un préjudice injustifié dans le cadre de la procédure pénale, considérant l’équité de la procédure dans son ensemble.
Existait-il des raisons impérieuses justifiant de retarder l’accès à un avocat ?
Dans le cas des requérants, la Cour estime qu’au moment de leur interrogatoire initial par la police, il existait une menace exceptionnellement grave et imminente pour la sûreté publique, à savoir le risque d’autres attentats, et que cette menace constituait une raison impérieuse justifiant de retarder provisoirement l’accès des requérants à un avocat. En ce qui concerne les trois premiers requérants, la Cour souligne que les restrictions ne découlent pas de l’application systématique d’une disposition juridique prévoyant le refus de conseils juridiques, mais qu’elles résultent d’une décision prise individuellement dans chaque cas sur le point de savoir s’il était indiqué, exceptionnellement, compte tenu de l’ensemble des circonstances, de retarder l’accès à un avocat.
Elle note que la police a rigoureusement respecté le cadre législatif en vigueur, malgré de lourdes contraintes pratiques. En outre, la décision de ne pas arrêter le quatrième requérant, qui était fondée sur la crainte qu’une arrestation officielle l’amenât à ne plus divulguer d’informations de la plus haute importance pour la sécurité publique, n’était pas déraisonnable dans les circonstances de l’espèce. Les informations fournies par l’intéressé étaient d’autant plus importantes qu’à l’époque seul un des poseurs de bombes (M. Omar) avait été arrêté et que les trois autres étaient encore en liberté.
L’admission comme preuves des déclarations faites à la police sans assistance juridique a-t-elle porté atteinte à l’équité du procès des requérants ?
Les trois premiers requérants
La Cour rappelle d’abord qu’il existe un cadre législatif clair et précis qui énonce le droit général d’accès à un avocat au moment d’une arrestation, qui envisage la possibilité de retarder exceptionnellement cet accès et qui prévoit certaines garanties. Les conditions à remplir pour autoriser un retard d’accès à un avocat sont strictes et exhaustives. Les dispositions de la loi de 2000 sur le terrorisme ménagent donc un juste équilibre entre l’importance du droit d’accès à une assistance juridique et le besoin impérieux dans des cas exceptionnels de permettre à la police de recueillir des informations nécessaires à la protection de la collectivité. Ce cadre juridique a été rigoureusement appliqué dans le cas des trois premiers requérants. L’accès de ceux-ci à un avocat n’a été retardé que de quatre à huit heures, durée qui se situe dans la limite des 48 heures pendant lesquelles l’accès à un avocat peut être refusé, la restriction a été autorisée par un commissaire de police dans chaque cas, et les raisons, qui relevaient des exceptions légales autorisant de retarder l’accès à un avocat, ont été consignées. En outre, le but des interrogatoires de sécurité – recueillir des informations nécessaires à la protection de la collectivité – a été rigoureusement respecté.
Il importe de noter également qu’aucun des requérants n’a allégué avoir subi une quelconque contrainte, coercition ou autre comportement inopportun qui les aurait soumis à une pression propre à leur faire nier toute implication dans les événements du 21 juillet 2005.
La procédure a également offert aux requérants des possibilités de contester au procès l’admission et l’utilisation de leurs déclarations et le poids à leur donner. Le juge du fond a procédé à un examen rigoureux des circonstances ayant entouré l’interrogatoire de sécurité de chacun des requérants et a pris soin de leur expliquer pourquoi il estimait que l’admission des déclarations faites lors de ces interrogatoires ne porterait pas atteinte à leur droit à un procès équitable. Ce faisant, il a agi avec sérieux, diligence et équité, et a donné aux membres du jury des instructions détaillées, leur rappelant que les intéressés n’avaient pas bénéficié de la garantie d’accès à un avocat et les exhortant à tenir compte de la possibilité qu’il existe des explications innocentes aux mensonges des intéressés.
Enfin, les déclarations faites lors des interrogatoires de sécurité sont loin d’être les seuls éléments de preuve incriminant les requérants. Il existait un ensemble important de preuves indépendantes susceptible de compromettre la défense des requérants au procès. En particulier, il existait des preuves démontrant les opinions extrémistes des requérants, leurs nombreux contacts avant et après le 21 juillet 2005, leur achat de grandes quantités d’eau oxygénée qu’ils avaient patiemment concentrée, marquant les bouteilles d’une façon qui indiquait qu’ils estimaient avoir atteint une concentration suffisamment élevée pour réussir une explosion, et la façon dont les bombes avaient été construites, celles-ci contenant des circuits électriques en état de fonctionnement, des détonateurs et des shrapnels destinés à causer un impact maximum lors de l’explosion. Il y avait également les déclarations des passagers des trains où se trouvaient MM. Omar et Mohammed qui, d’après les témoins, eurent l’air stupéfaits en voyant que les bombes n’avaient pas explosé, et la déposition du cinquième poseur de bombes, qui contredit catégoriquement l’allégation selon laquelle les attentats étaient censés être un canular.
Le quatrième requérant
Pour ce qui est de M. Abdurahman, la Cour admet que le code de pratique applicable concernant les avertissements à donner aux suspects n’a pas été respecté. Toutefois, elle attache de l’importance au fait qu’il existait un cadre législatif clair régissant l’admissibilité au procès de preuves obtenues durant un interrogatoire de police. Le juge du fond a soigneusement examiné la contestation du quatrième requérant quant à l’admission de sa déclaration au procès et a conclu qu’il n’y avait eu aucune oppression et que rien n’indiquait que la déclaration n’était pas fiable. Il a motivé de façon circonstanciée sa conclusion selon laquelle il ne serait pas inéquitable d’admettre la déclaration dans sa globalité et de poursuivre le procès.
Il y a lieu de tenir compte également du fait que le quatrième requérant n’a subi aucune coercition en ce sens qu’il n’a pas été contraint de s’incriminer. Il s’est présenté de son plein gré au poste de police. Jusqu’à son arrestation, sa position formelle de témoin, et non de suspect, a dicté la manière et les circonstances dont sa déclaration a été recueillie. Il importe également de noter que l’interrogatoire de police ne visait pas à établir l’ampleur du rôle du quatrième requérant dans la commission d’une infraction pénale mais à obtenir des détails sur le complot terroriste et sa préparation, à identifier les poseurs de bombes présumés et ceux qui leur fournissaient une aide. La déclaration même du témoin, bien qu’incriminant son auteur, le disculpait également, dans la mesure où il expliquait comment il avait rencontré de façon fortuite le poseur de bombes et qu’il ignorait à l’origine l’implication de celui-ci dans l’attentat.
La Cour rappelle également que M. Abdurahman ne s’était pas rétracté. Lorsqu’il avait été arrêté et s’était vu offrir une assistance juridique, il avait d’abord refusé puis demandé l’assistance d’un avocat. Avant ses interrogatoires ultérieurs par la police, il avait eu amplement le temps de réfléchir à sa défense, avec le bénéfice de conseils juridiques, et il aurait alors pu décider de revenir sur son témoignage, en invoquant des arguments qu’il a ultérieurement avancés. Au contraire, il a développé cette déclaration, s’appuyant sur le fait qu’il avait volontairement offert son assistance à la police pour atténuer ses actes. À aucun stade au cours des interrogatoires suivants, qui furent tous conduits en présence d’un avocat, l’intéressé n’a donné une autre version des événements que celle qu’il avait fournie à la police durant son premier interrogatoire. En fait, l’assistance qu’il avait fournie à la police avant son arrestation lui a valu une diminution de deux ans de sa peine en appel.
Qui plus est, il existait de nombreuses autres preuves à charge, notamment des séquences filmées par des caméras de surveillance qui montraient le quatrième requérant en compagnie de l’un des poseurs de bombes et des analyses de site cellulaire indiquant que les deux hommes étaient en contact et appuyant l’argument du ministère public selon lequel M. Abdurahman s’était procuré un passeport pour permettre au poseur de bombes de quitter le pays après les attentats. Ce dernier avait fait des déclarations corroborant largement le témoignage du quatrième requérant. Tous ces éléments étaient en soi clairement incriminants et liaient le quatrième requérant à la tentative du poseur de bombes de se cacher de la police et de fuir le pays après l’échec des attentats.
Conclusion
Compte tenu des considérations susmentionnées, prises cumulativement, la Cour estime qu’il n’a pas été porté atteinte de manière injustifiée au droit des requérants à un procès équitable du fait qu’ils n’ont pas eu accès à un avocat avant et pendant les interrogatoires de sécurité pour ce qui concerne les trois premiers requérants et du fait que le quatrième requérant n’a pas reçu les avertissements requis et n’a pas eu accès à un avocat durant son interrogatoire initial par la police, puis du fait que ces déclarations ont ensuite été admises au procès. Dès lors, le Cour conclut à la non-violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention.
R.E. c. Royaume-Uni du 27 octobre 2015 requête no 62498/11
Violation de l'article 8 : La Cour juge que les garanties juridiques concernant la surveillance secrète des consultations d’un détenu en garde à vue mineur avec son avocat étaient insuffisantes au moment de la garde à vue de l’intéressé. En revanche, les conversations entre un mineur en garde à vue et un "adulte approprié" peuvent être écoutées au sens de la CEDH
Article 8 (concernant les consultations juridiques d'un mineur en garde à vue avec son avocat)
La Cour rappelle le raisonnement qu’elle a suivi dans son arrêt dans l’affaire Kennedy c. Royaume-Uni, (no 26839/05, 18 mai 2010) concernant l’interception de communications. Dans cet arrêt, elle a dit que les dispositions de la loi interne (partie I de la RIPA) concernant la nature des infractions pouvant donner lieu à une interception, les catégories de personnes dont les communications sont susceptibles de faire l’objet d’une interception et les dispositions relatives à la durée, au renouvellement et à l’annulation de mesures d’interception étaient suffisamment claires.
Le Gouvernement soutient qu’il y a lieu de distinguer l’affaire de M. R.E. de l’affaire Kennedy, considérant que la surveillance secrète est moins intrusive que l’interception de communications et que le niveau requis de garanties doit donc être moins strict.
Toutefois, la Cour estime que la surveillance de consultations juridiques constitue une intrusion extrêmement importante dans la vie privée et la correspondance et que, par conséquent, il faut mettre en place les mêmes garanties strictes pour protéger les individus contre des ingérences arbitraires dans l’exercice de leurs droits découlant de l’article 8, comme dans le cas de l’interception de communications, par exemple des communications téléphoniques entre un avocat et son client.
La Cour note que, comme dans l’affaire Kennedy, les dispositions internes relatives à la surveillance secrète (partie II de la RIPA) étaient suffisamment claires s’agissant de la nature des infractions pouvant donner lieu à de telles mesures, des catégories de personnes susceptibles de faire l’objet d’une surveillance et des dispositions relatives à la durée, au renouvellement et à l’annulation des mesures de surveillance. En outre, des directives prévoyant des mesures pour le traitement, le stockage et la destruction sécurisés d’éléments obtenus au moyen d’une surveillance secrète sont appliquées par la police d’Irlande du Nord depuis le 22 juin 2010.
Toutefois, à l’époque de la détention de M.R.E. en mai 2010, ces directives n’étaient pas encore en vigueur. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue que les dispositions législatives internes pertinentes en vigueur à l’époque des faits comportaient des garanties suffisantes pour la protection des éléments obtenus au moyen d’une surveillance secrète, notamment en ce qui concerne l’examen, l’utilisation et le stockage des éléments recueillis, les précautions à prendre pour la communication des éléments à d’autres parties et les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement et la destruction des éléments collectés.
Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne le grief de M. R.E. relatif à la surveillance secrète de ses consultations juridiques.
Article 8 (concernant les consultations entre un détenu mineur et un « adulte approprié »)
En ce qui concerne la surveillance des consultations entre un détenu vulnérable et un « adulte approprié », la Cour dit que ceux-ci, à la différence des consultations juridiques, ne sont pas protégés par le secret professionnel et qu’un détenu n’a donc pas les mêmes attentes quant au respect de leur caractère privé. La Cour est convaincue que les dispositions internes pertinentes, pour autant qu’elles concernent la surveillance éventuelle des consultations entre un détenu et un « adulte approprié », comportaient des «garanties suffisantes contre les abus », notamment s’agissant des autorisations, du contrôle et de la tenue des archives.
Partant, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 en ce qui concerne cette partie du grief de M. R.E.
François C. France du 23 avril 2015 requête 26690/11
Violation de l'article 5-1 : la police met en garde à vue un avocat qui défend un mineur qui a été battu pour le faire parler. L'avocat proteste, il est mis en garde à vue pour insultes à la police !
a) Principes généraux
47. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’État à sa liberté. En proclamant le « droit à la liberté », l’article 5 § 1 ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler, lesquelles relèvent de l’article 2 du Protocole no 4, mais vise la liberté physique de la personne ; il a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire. Par ailleurs, les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (parmi beaucoup d’autres arrêts, voir Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, §§ 76-78, CEDH 2010, et Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 84, 23 février 2012).
48. La Cour rappelle ensuite qu’en vertu de l’article 5 § 1 de la Convention, toute privation de liberté doit être « régulière », ce qui implique qu’elle doit être effectuée selon les « voies légales ». Sur ce point, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en respecter les dispositions de fond et de procédure (Medvedyev et autres, précité, § 79). S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 56, CEDH 2000-III). La Cour souligne à ce sujet que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel qu’en cette matière le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (parmi d’autres arrêts, voir Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, et Zervudacki c. France, no 73947/01, § 43, 27 juillet 2006).
49. Toutefois, la « régularité » de la détention au regard du droit interne est un élément essentiel mais non décisif. Le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il existe un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (voir, parmi d’autres, Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004-VII, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006-X, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 76, 9 juillet 2009, Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 66, CEDH 2008, Medvedyev et autres, précité, § 79, et Creangă, précité, § 84).
50. Cela implique en premier lieu que les motifs de la privation de liberté soient conformes aux buts de l’article 5 § 1 de la Convention. Ce qui n’est pas le cas lorsque la décision de placement en détention n’avait pas pour but d’accorder au requérant les garanties prévues par l’article 5 § 1 c) (Lutsenko c. Ukraine, no 6492/11, §§ 109-110, 3 juillet 2012, et Tymoshenko c. Ukraine, no 49872/11, §§ 300-301, 30 avril 2013) ou qu’elle n’était pas nécessaire au vu des circonstances (Nešťák c. Slovaquie, no 65559/01, § 74, 27 février 2007, et Lutsenko, précité, § 62).
51. La Cour souligne enfin l’importance et la protection particulière que la Convention accorde à l’avocat intervenant dans l’exercice de ses fonctions. La Cour rappelle régulièrement que les avocats occupent une position centrale dans l’administration de la justice en leur qualité d’intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux ; c’est d’ailleurs à ce titre qu’ils jouent un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l’action des tribunaux, dont la mission est fondamentale dans une démocratie et un État de droit (voir parmi d’autres, Schöpfer c. Suisse, no 25405/94, 20 mai 1998, §§ 29-30, Recueil 1998-III, Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 45, CEDH 2002-II, Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, § 27, CEDH 2004-III, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 173, CEDH 2005 XIII, André et autre c. France, no 18603/03, § 42, CEDH 2008, et Michaud c. France, no 12323/11, § 118, CEDH 2012).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
52. La Cour rappelle que la question qui lui est posée est celle de savoir si la privation de liberté du requérant a été effectuée régulièrement et de manière non arbitraire, conformément aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention et, plus spécialement au regard de l’article 5 § 1 c), si elle était justifiée en vue de la conduite du requérant devant une autorité judiciaire compétente, compte tenu du fait qu’il était soupçonné d’avoir commis des infractions. Il lui appartient donc d’apprécier à ce titre si le placement en garde à vue était, dans les circonstances de l’affaire, nécessaire et proportionné.
53. La Cour estime qu’il ne saurait être fait abstraction du contexte dans lequel se sont produits les faits ayant entraîné le placement et le maintien en garde à vue du requérant durant près de treize heures. Elle relève à ce titre que la présence du requérant au commissariat d’Aulnay-sous-Bois était initialement due à son intervention, en sa qualité d’avocat, pour assister une personne mineure placée en garde à vue (paragraphe 5 ci-dessus). Nonobstant les versions contradictoires quant au déroulement des faits litigieux (paragraphe 6 ci-dessus), il n’est pas contesté que l’altercation entre l’OPJ C.Z. et le requérant avait pour origine un différend sur les observations écrites que ce dernier voulait verser au dossier pour demander un examen médical de son client mineur, ce dernier déclarant avoir été victime de violences policières et présentant des lésions sur le visage (paragraphe 5 ci-dessus). Elle s’inscrivait donc directement dans le cadre de l’intervention de ce dernier au poste de police en sa qualité d’avocat (paragraphes 5-8 ci-dessus).
54. Or, la Cour constate que c’est dans ce contexte que C.Z., qui s’estimait victime du comportement du requérant, a elle-même décidé de placer le requérant en garde à vue. C’est également elle qui a, dans un premier temps, supervisé le déroulement de cette mesure en sa qualité d’OPJ de permanence. La Cour observe en particulier que si C.Z. a ensuite fait appel à un collègue d’un autre secteur et prévenu sa hiérarchie, ce n’est qu’après l’exécution de la décision d’effectuer une fouille à corps intégrale du requérant et de le soumettre à un test d’alcoolémie, et ce immédiatement après la notification du placement en garde à vue (paragraphes 9 et 25 ci‑dessus). La Cour attache ainsi de l’importance au cumul de deux circonstances en l’espèce : d’une part, le requérant intervenait au commissariat en sa qualité d’avocat pour l’assistance d’un mineur gardé à vue, qu’il estimait avoir subi des violences policières et, d’autre part, l’OPJ de permanence qui se déclarait personnellement victime du comportement du requérant a elle-même décidé de placer le requérant en garde à vue et de lui imposer en outre immédiatement non pas de simples palpations de sécurité, mais au contraire une fouille intégrale, ainsi qu’un contrôle d’alcoolémie non justifié par des éléments objectifs.
55. La Cour constate à ce titre qu’il n’existait pas à l’époque des faits de règlementation autorisant une telle fouille allant au-delà de simples « palpations de sécurité » (paragraphes 34-38 ci-dessus). De même, compte tenu de ce contexte, en particulier de l’implication personnelle de C.Z., la nécessité d’un contrôle d’alcoolémie, alors que le requérant venait d’effectuer une mission d’assistance à un client dans le commissariat, inspire de sérieux doutes à la Cour en l’absence d’éléments objectifs susceptibles d’évoquer la commission d’une infraction commise ou causée sous l’empire d’un état alcoolique. En effet, ni la tension consécutive à l’altercation entre le requérant et C.Z. ni le fait que les évènements se soient déroulés durant la nuit de la Saint-Sylvestre qui serait selon la cour d’appel « propice aux libations » (paragraphe 30 ci-dessus) ne permettent d’établir l’existence de tels indices, et ce indépendamment du résultat négatif du test d’alcoolémie.
56. Ainsi, de l’avis de la Cour, dans les circonstances particulières de l’espèce, le fait de placer le requérant en garde à vue et de le soumettre à de telles mesures excédait les impératifs de sécurité et établissait au contraire une intention étrangère à la finalité d’une garde à vue (paragraphe 33 ci‑dessus).
57. La Cour relève à ce sujet que tant le juge d’instruction (paragraphe 28 ci-dessus) que la CNDS (paragraphe 20 ci-dessus) ont émis des réserves sur le fait qu’une décision de placement soit prise par l’OPJ se présentant comme victime. Elle note en outre que la CNDS a par ailleurs expressément recommandé d’examiner les circonstances soulevant des difficultés dans la présente affaire, en vue notamment non seulement de rappeler aux services de police qu’un contrôle d’alcoolémie n’est justifié que lorsqu’il semble que l’infraction ait été « commise ou causée sous l’empire d’un état alcoolique », mais également de modifier le code de procédure pénale pour rendre obligatoire l’examen médical d’un gardé à vue à la demande d’un avocat et de mener une réflexion sur l’éventuelle protection à accorder aux avocats dans l’exercice de leurs fonctions. Enfin, elle constate que le recours à la fouille à corps est désormais encadré, depuis la loi no 2011-392 du 14 avril 2011 (paragraphes 38-40 ci-dessus).
58. La Cour considère que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le placement en garde à vue du requérant n’était ni justifié ni proportionné et que la privation de liberté subie par le requérant n’était pas conforme aux buts de l’article 5 § 1, et plus spécialement de l’article 5 § 1 c), de la Convention.
59. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
DUSHKA c.UKRAINE du 3 février 2011 Requête 29175/04
La détention illégale et l’interrogatoire d’un mineur de 17 ans en l’absence d’un avocat et de ses parents constituait un traitement inhumain et dégradant (l'affaire Patrick Dils n'est plus possible en Europe sans violation de l'article 3)
Mauvais traitements
La Cour estime que les déclarations de M. Dushka sur la cause de ses blessures, c’est-à-dire des mauvais traitements infligés par la police pendant son interrogatoire, étaient suffisamment détaillées et sont corroborées par les rapports médicaux de novembre 2002 et janvier 2005. Par ailleurs, le Gouvernement n’a donné aucune autre version des faits cohérente et étayée, malgré plusieurs années d’enquête. Partant, la Cour conclut que l’Etat doit répondre des blessures subies par M. Dushka en conséquence des mauvais traitements infligés à celui-ci.
En réalité, que la police ait eu recours à la violence physique ou non, l’arrestation de M. Dushka dans des circonstances ambiguës, ainsi que sa détention administrative déclarée par la suite illégale par les autorités judiciaires internes, donnent fortement à croire que la police avait arrêté M. Dushka et l’avait mis en détention dans le but de briser sa résistance morale et de lui extorquer des aveux. L’obtention de ces aveux dans un cadre dépourvu de garanties procédurales telles que la présence d’un avocat et leur rétractation dès la libération de l’intéressé amènent à conclure qu’ils n’ont pas été formulés librement.
Eu égard en particulier à la vulnérabilité de M. Dushka du fait de son âge, la Cour estime que cette pratique s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3.
Enquête
La Cour relève que, bien que M. Dushka ait informé rapidement les autorités des mauvais traitements qu’il prétendait avoir subis, l’enquête a duré plus de trois ans et n’a pas permis d’établir ce qui lui était arrivé lors de son arrestation et de sa garde à vue, ou d’identifier les responsables de ses blessures.
Il y a eu de nombreuses décisions administratives ou judiciaires de renvoi pour complément d’enquête, qui énonçaient que l’enquête était lacunaire et partiale. Toutefois, les autorités de poursuite se sont contentées de répondre à chaque fois par la même conclusion (manque de preuves) pour justifier leur refus de poursuivre la procédure. Malgré des instructions particulières émises par les tribunaux et les autorités de poursuite supérieures, l’enquête n’a donc pas répondu aux allégations de M. Dushka en permettant par exemple de dégager une explication plausible à l’origine de ses blessures ou une réponse étayée concernant la légalité de son arrestation et de sa détention, ainsi que de son interrogatoire mené au mépris des garanties procédurales requises (absence d’un avocat ou des parents de l’intéressé).
La Cour rappelle qu’elle a récemment été saisie de plusieurs affaires dirigées contre l’Ukraine, dans lesquelles elle a constaté une violation de l’article 3 du fait de l’absence d’enquête effective sur des allégations de mauvais traitements. Relevant que l’affaire de M. Dushka est similaire à ces affaires, elle conclut à une autre violation de l’article 3 à raison du défaut d’enquête effective sur les mauvais traitements qui, selon M. Dushka, lui avaient été infligés par des policiers.
Eu égard à cette conclusion, la Cour juge inutile d’examiner le grief de M. Dushka relatif à l’effectivité de l’enquête sous l’angle de l’article 13.
La Cour dit que l’Ukraine doit verser à la succession de M. Dushka une somme de 18 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 150 EUR à la mère de l’intéressé pour frais et dépens.
LES MORTS ET LES VIOLENCES POLICIERES DURANT UNE GARDE A VUE
KOTENOK c. RUSSIE du 23 Mars 2021 requête n° 50636/11
Art 2 (matériel) • Obligations positives • Suicide d’un homme lors de sa détention de courte durée au commissariat de police • Aucun élément à la disposition des policiers au moment des faits ne laissant présager un risque certain et immédiat de suicide • Policiers non tenus d’adopter des mesures particulières visant à prévenir la matérialisation d’un tel risque
Art 2 (procédural) • Enquête sur le décès effective, prompte, indépendante et suffisamment approfondie • Participation à l’enquête de la famille du défunt
a) Sur le volet matériel du grief
Les principes généraux
52. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 de la Convention impose aux États contractants l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (Kleyn et Aleksandrovich, précité, § 43, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 174, CEDH 2011 (extraits), et Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, § 104, 31 janvier 2019).
53. La Cour rappelle également que l’article 2 de la Convention peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Keenan, précité, § 89, De Donder et De Clippel c. Belgique, no 8595/06, § 70, 6 décembre 2011, et Fernandes de Oliveira, précité, § 110). Les obligations des États contractants prennent une dimension particulière à l’égard des personnes détenues, celles-ci se trouvant entièrement sous le contrôle des autorités : compte tenu de leur vulnérabilité, les autorités ont le devoir de les protéger.
54. Cela étant, il convient cependant d’interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Toute menace présumée contre la vie n’oblige donc pas les autorités à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Ainsi, dans le cas spécifique du risque de suicide en prison, il n’y a une telle obligation positive que lorsque les autorités savent ou devraient savoir sur le moment qu’existe un risque réel et immédiat qu’un individu donné attente à sa vie. Pour caractériser un manquement à cette obligation, il faut ensuite établir que les autorités ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute paré ce risque. Concrètement, il faut et il suffit que le requérant démontre que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance (Keenan, précité, § 93, Renolde c. France, no 5608/05, § 83, CEDH 2008 (extraits), et De Donder et De Clippel, précité, § 69). En ce qui concerne les risques de suicide, dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités (principalement dans le cadre d’un placement en garde à vue ou d’une détention), la Cour a pris en compte divers facteurs afin d’établir si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait pour la vie d’un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l’obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d’auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires, les signes de détresse physique ou mentale (Fernandes de Oliveira, précité, § 115).
55. La Cour constate que, bien que les parties aient présenté deux versions des évènements (paragraphes 5 et 6 ci-dessus), ces versions ne se contredisent pourtant pas. Constatant que la version de la partie requérante est plus complète étant fondée sur un enregistrement vidéo, la Cour fondera son analyse sur cette dernière version. Elle constate par ailleurs que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si un risque suicidaire chez V.K. avait ou devait avoir été détecté par les services de police. Elle doit rechercher si, compte tenu des éléments dont disposaient les policiers au moment des faits, le caractère réel et immédiat d’un risque de suicide aurait dû être identifié.
56. La Cour constate que, en l’espèce, la détention de V.K., en tant que délinquant administratif à la suite de son arrestation à son domicile pour violence domestique, était une détention de courte durée. Cette détention au commissariat de police ne dure que quelques heures, à compter du moment de l’arrestation et de la comparution devant le juge. La courte durée de la détention explique le fait que l’état mental du délinquant ne peut faire l’objet d’une étude aussi approfondie que celle effectuée en cas de détention en prison à la suite d’une condamnation pénale ou en cas de séjour dans un asile psychiatrique (voir, a contrario, Sellal c. France, no 32432/13, § 53, 8 octobre 2015, et Fernandes de Oliveira, précité, § 127). Ainsi, dans le cas de V.K., les policiers ne disposaient pas de l’avis médical d’un psychiatre, qui était l’instrument le plus fiable, susceptible de certifier la présence d’un risque réel et immédiat de suicide au moment des faits. Reste à examiner si les policiers disposaient d’autres éléments suffisants pour détecter un risque de suicide, comme le soutient la partie requérante.
57. Les requérants allèguent plus particulièrement que les policiers auraient dû consulter leur base de données, qui aurait comporté des informations relatives aux antécédents suicidaires de V.K. La Cour prend note de la position du Gouvernement reconnaissant que les policiers n’ont pas étudié cette base de données au moment du passage de V.K. au commissariat car ils auraient été occupés par d’autres tâches (paragraphes 44 et 45 ci-dessus). La Cour estime que, de toute manière, même si les policiers l’avaient fait, la dernière tentative de suicide consignée dans la base de données remontait à 2004, c’est-à-dire cinq ans avant les faits. Ces informations ne certifiaient pas qu’il existait un risque de suicide réel ni, surtout, immédiat (Sellal, précité, § 52).
58. La Cour ne dispose pas de données certifiant que V.K. a fait l’objet d’un suivi psychiatrique à la suite de ses tentatives de suicide ; aucune maladie psychique ne lui a été diagnostiquée (voir, a contrario, De Donder et De Clippel, précité, § 74 ; dans cette affaire, les fils décédés des requérants avaient été diagnostiqués comme souffrant de schizophrénie, maladie pour laquelle le risque de suicide est inhérent).
59. Par ailleurs, la Cour note que la famille du défunt, soutenant devant elle que le risque de suicide avait un caractère certain et immédiat, n’a pas averti l’équipe des policiers arrivés à leur domicile de l’état mental de leur parent. Dans le même esprit, il est étonnant que les requérants, informés mieux que les autres de l’état mental de leur parent, n’aient pas envisagé une réaction plus douce face à son comportement violent, comme, par exemple, une hospitalisation psychiatrique.
60. S’agissant des signes de détresse physique ou mentale de V.K., les requérants mettent en exergue son état d’ivresse important et le motif de son arrestation (violence domestique) (paragraphe 44 ci-dessus).
61. S’agissant de l’état d’ivresse (V.K. avait un taux d’alcoolémie égal à 3,2 ‰), les requérants estiment que ce facteur était révélateur d’un risque certain et immédiat de suicide. La Cour ne partage pas ce raisonnement. Si l’état d’ivresse est révélateur d’une vulnérabilité de l’individu (Taïs c. France, no 39922/03, § 89, 1er juin 2006), il ne peut, à lui seul, représenter un risque de suicide.
62. S’agissant du deuxième facteur évoqué par les requérants, à savoir l’arrestation pour violence domestique, la Cour estime que le motif de l’arrestation ne révèle pas de tendances suicidaires de la part de l’auteur de cette violence, celle-ci étant dirigée vers autrui et non contre lui-même (Sellal, précité, § 54).
63. En outre, les requérants soutiennent que même si, pour une raison ou pour une autre, les policiers n’y avaient pas prêté attention, les actes d’automutilation effectués par V.K. qui, alors qu’il se trouvait derrière les barreaux au commissariat, aurait tenté de se couper les veines et aurait confectionné un nœud pour se pendre, auraient dû les alerter quant à l’état mental du détenu et les inciter à prendre des mesures pour protéger sa vie en lui retirant tous les objets pouvant servir à un suicide.
64. La Cour rappelle que les policiers auraient été dans l’obligation de prévenir non pas toute menace présumée contre la vie de l’individu mais uniquement celle qui aurait présenté un risque réel et immédiat d’une atteinte à la vie. De ce point de vue, elle relève que le comportement des policiers était cohérent avec la tâche de protéger la vie et la santé du détenu. En effet, à la suite des actes d’automutilation commis par V.K., les policiers ont appelé une équipe médicale. La question qui se pose de savoir si celle-ci pouvait détecter le risque de suicide et prévenir ce dernier, par exemple en injectant des tranquillisants à V.K. ou en l’hospitalisant. La Cour estime que, pour exiger une prise en charge du patient, il convient que les médecins soient avisés de son état mental. Le Gouvernement insiste sur cette thèse (paragraphe 40 ci-dessus) en indiquant que les médecins, n’étant pas hiérarchiquement dépendants des policiers, n’avaient pas reçu un tel avertissement. La Cour rappelle sa position, bien qu’exprimée dans le contexte de l’article 3 de la Convention, selon laquelle il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court (Ketreb c. France, no 38447/09, § 109, 19 juillet 2012). Or, la Cour constate que, en l’espèce, V.K. ne présentait pas de signes de telles vulnérabilité et incapacité. En effet, il ressort des explications de la première requérante que V.K., en tant qu’ancien policier, connaissait ses droits et que, lors de son arrestation, il s’était disputé avec le policier de proximité G. en lui demandant de présenter sa carte professionnelle de policier, sans laquelle il aurait refusé de lui obéir (paragraphe 4 ci-dessus). Une telle pugnacité donne à penser que, d’une part, V.K. avait une forte personnalité qui savait à qui se plaindre et comment se protéger et, d’autre part, que son comportement n’avait pas laissé présager aux policiers son intention de se suicider (voir, a contrario, S.F. c. Suisse, no 23405/16, § 98, 30 juin 2020. Dans cette dernière affaire, les policiers ont assisté à des « expressions claires et explicites d’intention de suicide de la part de la victime ». La situation a en outre été accentuée par une vulnérabilité particulière de l’individu qui, malgré les signes apparents de vulnérabilité a été traité comme une personne capable de résister au stress et aux pressions subies). Ainsi, la Cour considère que, si l’équipe médicale n’avait ni hospitalisé V.K. ni averti les policiers d’un risque de suicide, c’est parce qu’elle l’avait jugé apte à rester en détention (voir, a contrario, S.F., précité. Dans cette affaire, un médecin à l’hôpital avait établi que le risque de suicide de l’individu était « aigu ». En outre, les médecins ont informé les policiers que l’individu présentait un danger pour lui-même S.F., précité, §§ 20, 24 et 86). Si les professionnels de la santé n’avaient détecté aucun risque de suicide, les policiers étaient encore moins aptes qu’eux à faire un bilan médical.
65. Aussi la Cour conclut-elle que les policiers ne disposaient pas d’éléments suffisants qui auraient pu faire craindre un risque de suicide réel et immédiat, risque qui aurait requis une vigilance accrue de leur part vis‑à‑vis du détenu. Elle note que les policiers ont accompli à l’égard de V.K. un protocole habituel, prescrit par l’arrêté no 62 (paragraphe 37 ci‑dessus), en effectuant des fouilles et en retirant le cordon de sa capuche et en le plaçant dans une cellule.
66. La partie requérante reproche à cet égard aux policiers d’avoir fait preuve d’une double négligence. D’une part, elle indique que le retrait du cordon de la capuche ne suffisait pas et qu’il aurait fallu, selon elle, retirer les élastiques de ses vêtements et de ses sous-vêtements ainsi que son pansement au poignet. D’autre part, elle reproche aux policiers d’avoir laissé leur parent sans surveillance pendant une trentaine de minutes.
67. La Cour rappelle que les autorités doivent s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné : elles doivent prendre des mesures et précautions générales afin de diminuer les risques d’automutilation tout en évitant d’empiéter sur l’autonomie individuelle (Keenan, précité, § 92, et De Donder et De Clippel, précité, § 70). Elle estime que, en l’espèce, le retrait de tous les cordons et élastiques des vêtements de V.K., notamment ceux de ses sous-vêtements, aurait pu être perçu comme extrêmement humiliant, tandis que le retrait du pansement aurait fait perdre le bénéfice de l’assistance médicale. Par ailleurs, le fait de laisser le détenu pendant une demi-heure sans surveillance n’est pas, en dehors d’un risque de suicide confirmé, révélateur d’une négligence.
68. La Cour ne perd pas de vue que l’incident lié au suicide de V.K. a donné lieu aux poursuites disciplinaires des policiers de permanence (paragraphe 13 ci-dessus). En même temps, l’enquête pénale a abouti à la conclusion que les policiers n’ont pas commis de délits de nature pénale à l’endroit de V.K. (paragraphe 32 ci-dessus). De même, la juridiction civile a considéré que la faute des policiers pour n’avoir pas prévenu le suicide imprévisible d’un délinquant n’était pas prouvée (paragraphe 35 ci-dessus).
69. La Cour ne peut pas, dans son analyse, s’appuyer sur le document prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre des policiers de permanence, car ce document n’est pas explicite sur les motifs de cette sanction (paragraphe 13 ci-dessus). D’autant plus que les conclusions de l’enquête disciplinaire vont à l’encontre de celles de l’enquête pénale et de la décision civile. De toute manière, la mise en jeu de la responsabilité de l’État au regard de la Convention ne dépend pas de la responsabilité individuelle des protagonistes au niveau interne (voir, mutadis mutandis, Lykova c. Russie, no 68736/11, § 131, 22 décembre 2015).
70. La Cour conclut que les éléments à la disposition des policiers au moment des faits ne laissaient pas présager qu’il existait un risque certain et immédiat de suicide. Dès lors, ces derniers n’étaient pas tenus d’adopter des mesures particulières visant à prévenir la matérialisation d’un tel risque.
71.
b) Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention
Les principes généraux
72. Dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes et que les causes de ce décès sont susceptibles d’être rattachées à une action ou une omission d’agents ou de services publics, les autorités ont l’obligation de mener d’office une « enquête officielle et effective » de nature à permettre d’établir les causes de la mort et d’identifier les éventuels responsables de celle-ci et d’aboutir à leur punition. L’effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès : elles doivent, d’une part, ne pas leur être subordonnées d’un point de vue hiérarchique ou institutionnel ; elles doivent, d’autre part, être indépendantes en pratique. Elle exige ensuite que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès ; toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme. Enfin, une célérité et une diligence raisonnables s’imposent aux enquêteurs, et les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (voir, parmi beaucoup d’autres, Slimani c. France, no 57671/00, § 29, CEDH 2004‑IX, Troubnikov c. Russie, no 49790/99, §§ 86-88, 5 juillet 2005, et De Donder et De Clippel, précité, § 86). Cependant, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens : l’enquête ne doit pas nécessairement arriver à une conclusion qui coïncide avec la version des faits présentée par le plaignant (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 71 CEDH 2002‑II).
Application aux faits de l’espèce
73. La Cour note que les autorités, ayant découvert le cadavre de V.K. pendu dans la cellule dans laquelle il avait été placé, ont immédiatement procédé à l’enquête en faisant le nécessaire pour recueillir les preuves. Elle note en outre que l’autopsie a été pratiquée le lendemain du drame (paragraphe 13 ci-dessus). La Cour est d’avis que l’enquête a été suffisamment prompte.
74. Elle note que l’enquête était indépendante. En effet, les enquêteurs appartenaient au Comité d’instruction, une entité indépendante de la police.
75. S’agissant de la participation à l’enquête de la famille du défunt, la Cour note que celle-ci a été associée à la procédure d’enquête. En effet, à la suite des plaintes déposées par elle, le procureur a plusieurs fois ordonné des compléments d’enquête pour satisfaire aux observations et suggestions de la partie requérante (paragraphes 22, 24, 27, 30 et 32 ci-dessus).
76. La Cour juge que l’enquête a été suffisamment approfondie dans la mesure où l’autorité compétente a expliqué la raison du décès – le suicide par pendaison – ainsi l’origine des lésions corporelles autres que celles liées à la pendaison. En effet, l’enquête a expliqué celles-ci par une résistance au policier G. au moment de l’arrestation et à la chute du corps par terre après la pendaison (paragraphe 29 ci-dessus). De son côté, la partie requérante, se limitant à remettre en question la version de l’enquête, ne présente aucune autre allégation fiable. Au contraire, devant la Cour, elle a insisté sur la version retenue par l’enquête, le suicide par pendaison (paragraphes 44-46 ci-dessus). Qui plus est, dans l’exposé de sa version des faits, la partie requérante s’appuie sur l’enregistrement des caméras de vidéosurveillance en place au commissariat de police (paragraphe 6 ci-dessus). Cette vidéo présentait minute par minute les actes de V.K. lors de son court séjour au commissariat. Si le moindre mauvais traitement avait eu lieu, cela aurait été filmé par ces caméras.
77. S’agissant de l’absence de reconstitution, il n’appartient pas à la Cour d’indiquer aux autorités nationales les mesures d’instruction à prendre dans un cas donné. La Cour est satisfaite de l’explication présentée par le Gouvernement soutenant que, sans reconstruction, les circonstances de l’incident établies lors de l’enquête n’ont pas suscité de doutes (paragraphe 47 ci-dessus). En outre, la partie requérante n’a pas formulé une telle demande auprès des autorités nationales. Qui plus est, face au refus du chef du département d’investigation, exprimé dans sa lettre du 11 mars 2011, d’ordonner un complément d’enquête (paragraphe 33 ci-dessus), la partie requérante n’a pas contesté cette décision. Ainsi, la Cour conclut que l’enquête a été approfondie.
78. Au demeurant, la Cour ne décèle dans le dossier aucun élément susceptible d’indiquer que l’instruction menée en l’espèce ne répondait pas aux exigences dégagées par sa jurisprudence.
79. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention dans son volet procédural.
Sarwari et autres c. Grèce du 11 avril 2019 requête n° 38089/12
L’affaire concerne dix ressortissants afghans qui se plaignaient d’avoir subi des mauvais traitements de la part de policiers qui étaient à la recherche d’un fugitif afghan qui s’était évadé de la salle d’audience d’un tribunal. Neuf requérants se plaignaient d’avoir subi des mauvais traitements dans le bâtiment où ils résidaient, et un requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements dans un commissariat de police.
LES FAITS
Les requérants sont dix ressortissants afghans nés entre 1975 et 1988. En décembre 2004, un certain R.A.N. (ressortissant afghan) s’échappa de l’une des salles d’audience du tribunal, alors qu’il se trouvait sous la surveillance des policiers H.D. et E.K. Par la suite, H.D. et E.K. recherchèrent le fugitif, seuls ou avec des collègues du commissariat de police, notamment dans un immeuble où habitaient des ressortissants afghans. Quelques jours plus tard, une chaîne de télévision diffusa un reportage contenant des allégations selon lesquelles des policiers avaient maltraité des ressortissants afghans après s’être violemment introduits dans un hôtel qui les hébergeait. Les faits, qui sont survenus les 14 et 15 décembre 2004, furent établis comme suit par la cour d’appel criminelle d’Athènes. Les deux policiers – ainsi que d’autres policiers qui n’avaient pas pu être identifiés et qui étaient en tenue civile – s’étaient rendus dans un bâtiment où résidaient des ressortissants afghans afin de rechercher le fugitif (R.A.N.). Ils avaient réveillé toutes les personnes qui y habitaient, les avaient conduites dans le salon du bâtiment et les avaient obligées à faire face au mur. Ensuite, ils leur avaient montré une photographie du fugitif, leur avaient demandé s’ils le connaissaient et s’ils l’avaient vu circuler dans la région. Enfin, ils les avaient frappées, notamment avec leurs mains, leurs pieds et des bâtons. Le lendemain, ils étaient retournés dans cet immeuble et avaient réitéré leurs agissements. Par ailleurs, l’un des requérants se plaignit d’avoir subi des mauvais traitements au commissariat de police, le 15 décembre 2004. À différentes dates, les requérants furent soumis à des examens médicaux. Des lésions corporelles furent constatées chez certains d’entre eux. Neuf requérants portèrent plainte. Tous les requérants intentèrent également une action en dommages et intérêts contre l’État. Une enquête administrative et une procédure disciplinaire furent menées. En juin 2006, le conseil de discipline imposa à H.D. et E.K. une peine de suspension temporaire de six mois. Ces peines ne furent pas exécutées, H.D. étant resté hors de service et E.K. ayant quitté le service. Une procédure pénale fut également engagée. En mars 2012, la cour d’appel condamna H.D. à 20 mois d’emprisonnement et E.K. à 25 mois d’emprisonnement pour coups et blessures infligés sans provocation de la part des victimes. Les deux policiers bénéficièrent d’un sursis.
a) Quant à l’effectivité des investigations menées par les autorités nationales
i. Principes généraux
106. La Cour rappelle que les États contractants ont une obligation positive de mettre en place une protection dissuasive suffisante contre les violations du droit énoncé à l’article 3 de la Convention. Dans le système de la Convention, il est reconnu depuis longtemps que le droit à ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. C’est un droit absolu qui ne souffre aucune dérogation en aucune circonstance (Derman c. Turquie, no 21789/02, § 27, 31 mai 2011).
107. La Cour rappelle ensuite que, en cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État au mépris de l’article 3 de la Convention, deux mesures s’imposent pour que la réparation soit suffisante. Premièrement, les autorités de l’État doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification et – le cas échéant – à la punition des responsables (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 116, CEDH 2010 ; voir aussi Armani da Silva c. Royaume‑Uni [GC], no 5878/08, § 233, CEDH 2016). Deuxièmement, le requérant doit, le cas échéant, percevoir une compensation (Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 79, 24 juillet 2008) ou, du moins, avoir la possibilité de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice que lui a causé le mauvais traitement (comparer, mutatis mutandis, Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03, § 56, 20 décembre 2007 (concernant une violation de l’article 2 de la Convention), Çamdereli c. Turquie, no 28433/02, § 29, 17 juillet 2008, Yeter c. Turquie, no 33750/03, § 58, 13 janvier 2009, et Gäfgen, précité, § 116). Pour qu’une enquête soit effective en pratique, la condition préalable est que l’État ait promulgué des dispositions de droit pénal réprimant les pratiques contraires à l’article 3 de la Convention (comparer, mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 150, 153 et 166, CEDH 2003‑XII, Nikolova et Velitchkova, précité, § 57, Çamdereli, précité, § 38, et Gäfgen précité, § 117).
108. En ce qui concerne l’effectivité de l’enquête, la Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans ses arrêts Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], no 39630/09, §§ 182‑185, CEDH 2012) et Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 316-326, CEDH (extraits)).
109. Encore faut-il préciser que, en la matière, les exigences procédurales de l’article 3 de la Convention s’étendent au-delà du stade de l’instruction préliminaire lorsque, comme en l’espèce, celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’interdiction posée par cette disposition. Ainsi, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes (Okkalı, précité, § 65, et Derman, précité, § 27).
110. Certes, les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation, soumise au contrôle de la Cour, pour déterminer les peines applicables aux infractions pénales. De même, le caractère dissuasif d’une peine relève du pouvoir discrétionnaire de l’État. Cela étant, dans le cas où les juridictions internes ont établi qu’un requérant a été torturé, la Cour, dans son examen des décisions ou des mesures disciplinaires adoptées par ces tribunaux contre les auteurs des faits, devra prendre en considération si celles-ci constituent un redressement approprié et si elles peuvent être considérées comme ayant un effet dissuasif pour l’avenir (voir, Zeynep Özcan c. Turquie, no 45906/99, § 42, 20 février 2007, Sidiropoulos et Papakostas c. Grèce, no 33349/10, § 88, 25 janvier 2018 et, mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, précité, § 166). Dans ce contexte, la Cour rappelle que, lorsque des agents de l’État sont inculpés d’infractions impliquant des mauvais traitements, il importe qu’ils soient suspendus de leurs fonctions pendant l’instruction ou le procès et en soient démis en cas de condamnation (Gäfgen, précité, § 125).
ii. Application de ces principes en l’espèce
111. En l’espèce, la Cour note tout d’abord que, telles qu’exposées devant les autorités internes, les allégations des requérants d’après lesquelles des policiers leur ont infligé des traitements contraires à l’article 3 de la Convention étaient défendables. Cette disposition obligeait donc lesdites autorités à mener une enquête effective.
112. La Cour constate qu’une procédure pénale a été engagée à l’encontre de H.D. et E.K. pour tortures et pour coups et blessures infligés sans provocation de la part de la victime. Elle observe encore que les circonstances ayant entouré les faits de l’espèce ont fait l’objet d’une enquête administrative et d’une procédure disciplinaire.
113. Il reste à savoir si les procédures en cause ont satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention.
α) Les requérants figurant sous les numéros 4, 7 et 8
114. La Cour rappelle, en premier lieu, que s’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, notamment, McKerr, précité, § 114, CEDH 2001‑III, et Mocanu et autres, précité, § 323).
115. La Cour note à cet égard que, en l’espèce, la procédure en cause s’est étendue sur une période de sept ans, à savoir du 19 décembre 2004, date à laquelle les requérants (excepté celui figurant sous le numéro 9) ont déposé la première plainte, au 19 décembre 2011, date à laquelle la cour d’assises a rendu ses arrêts nos 611/21-10-2011, 702,703/12-12-2011 et 725, 726, 727/19-12-2011. Elle observe en particulier que la phase préliminaire de l’enquête pénale a duré environ cinq ans. Or il n’apparaît pas que, au cours de cette phase, les autorités de poursuite aient effectué un quelconque acte d’enquête entre décembre 2004 et avril 2006.
116. La Cour répète que l’écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves disponibles, et que l’apparence d’un manque de diligence jette un doute sur la bonne foi avec laquelle les investigations sont menées (voir, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 86, CEDH 2002‑II). Il est vrai que, en l’espèce, l’enquête présentait une certaine complexité. Cela étant, la durée de la phase préliminaire, phase qui a comporté une période d’inactivité de plus d’un an, est susceptible d’avoir compromis l’effectivité de l’enquête.
117. En ce qui concerne la qualité des rapports médicolégaux, la Cour note que selon les normes du CPT, entérinée par sa jurisprudence (Akkoç c. Turquie, nos 22947/93 et 22948/93, § 118, CEDH 2000‑X), la réalisation d’examens médicaux appropriés est une garantie essentielle contre les mauvais traitements pour les personnes placées en garde à vue (paragraphe 61 ci-dessus). Ces examens doivent être effectués par des médecins dûment qualifiés, en dehors de la présence de la police, et le rapport d’examen doit faire état non seulement de toutes les lésions corporelles relevées, mais aussi des explications fournies par le patient quant à la façon dont elles sont survenues, et de l’avis du médecin sur la compatibilité des lésions avec ces explications (Mehmet Emin Yüksel c. Turquie, no 40154/98, § 29, 20 juillet 2004, Yananer c. Turquie, no 6291/05, § 41, 16 juillet 2009, Özgür Uyanık c. Turquie, no 11068/04, § 38, 23 mars 2010, Musa Yılmaz c. Turquie, no 27566/06, § 54, 30 novembre 2010, et Davitidze c. Russie, no 8810/05, § 115, 30 mai 2013). En particulier, les rapports médicaux établis à l’issue de l’examen de personnes déclarant avoir été victimes de torture ou de mauvais traitements doivent respecter toute la panoplie des exigences développées dans la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 3. La pratique consistant à effectuer des examens sommaires et collectifs sape l’efficacité et la solidité de cette garantie.
118. La Cour rappelle que les preuves obtenues lors des examens médicolégaux jouent un rôle crucial lors des enquêtes sur les allégations de mauvais traitements (Salmanoğlu et Polattaş c. Turquie, no 15828/03, § 79, 17 mars 2009). À cet égard, la Cour ne peut que noter que les rapports établis en l’occurrence par les médecins légistes manquaient de précision et étaient de qualité nettement inférieure à celle recommandée par les normes du CPT et par les lignes directrices du Protocole d’Istanbul (paragraphes 62‑65 et 68 ci‑dessus). Elle observe en particulier que ces rapports ne contenaient ni de comptes rendus des faits rapportés par les intéressés ni d’indications quant au moment de leur survenance, et qu’ils se contentaient de mentionner qu’aucune lésion n’était constatée. Elle note aussi qu’ils ne précisaient pas si les policiers accompagnant les requérants figurant sous les numéros 4 et 7 étaient présents lors de l’examen et, dans l’affirmative, quel était leur comportement (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour souligne enfin que lesdits rapports n’indiquaient pas si cet examen avait eu lieu avec l’assistance d’un interprète, les requérants ne parlant pas le grec. Elle prend note, à ce sujet, des allégations de ces derniers, non réfutées par le Gouvernement, selon lesquelles aucun interprète n’était présent.
119. Quant à l’examen par les autorités d’un éventuel mobile raciste, la Cour observe que, dans sa proposition du 4 janvier 2007 de renvoyer les accusés en jugement, le procureur a mentionné que « (...) [les accusés] ont agi de manière antisociale et vindicative, ayant comme seul critère la punition de tous ceux qui appartenaient [à un groupe racial en particulier], et ce sans qu’il existât un lien entre les auteurs et les victimes (...) » (paragraphe 46 ci-dessus).
120. Or la Cour relève que cet élément n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi par les juridictions internes, à savoir la cour d’assises et la cour d’appel. Qui plus est, H.D. et E.K. n’ont jamais été interrogés sur leur attitude générale envers le groupe ethnoculturel auquel appartenaient les victimes. Il apparaît que les organes d’enquête n’ont pas non plus recherché, à titre d’exemple, si les accusés avaient participé par le passé à des incidents violents à connotation raciale ou s’ils avaient des affinités, par exemple, avec des idéologies extrémistes ou racistes.
121. Pour la Cour, les organes chargés de l’enquête pénale auraient dû mener des investigations sur cet aspect particulier avec toute la diligence nécessaire. Or rien ne montre qu’ils aient examiné la question. La Cour considère que les autorités internes étaient tenues de procéder à un examen plus approfondi de l’ensemble des faits afin de mettre au jour un éventuel mobile raciste (voir, mutatis mutandis, Bekos et Koutropoulos c. Grèce, no 15250/02, § 69-75, CEDH 2005‑XIII (extraits)).
122. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur les autres défaillances alléguées de la procédure en cause. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour estime que les requérants figurant sous les numéros 4, 7 et 8 n’ont pas bénéficié d’une enquête effective. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural en ce qui les concerne.
β) Les requérants figurant sous les numéros 2, 3, 6 et 10
123. La Cour estime que le grief des requérants concerne principalement l’obligation positive de protéger l’intégrité physique et morale de la personne par la loi. Par conséquent, elle recherchera en l’espèce si l’obligation positive de l’État découlant de l’article 3 de la Convention, consistant à prendre des mesures propres à empêcher que les personnes placées sous son contrôle ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, a été respectée (Okkalı, précité, § 54).
124. La Cour note d’emblée que, eu égard aux critères découlant de sa jurisprudence bien établie (voir, parmi beaucoup d’autres, Cestaro c. Italie, no 6884/11, §§ 177-190, 7 avril 2015, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 104, CEDH 1999‑V, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 84, CEDH 2000‑VII, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 118-119, CEDH 2004-IV, Gäfgen, précité, § 88, El-Masri, précité, § 196, Alberti c. Italie, no 15397/11, § 40, 24 juin 2014, et Saba c. Italie, no 36629/10, §§ 71-72, 1er juillet 2014), l’on ne saurait sérieusement douter que les mauvais traitements en cause tombent sous l’empire de l’article 3 de la Convention. Elle observe que, aux yeux des requérants, les juridictions internes n’ont pas pris en considération les circonstances ayant entouré l’infliction des mauvais traitements dénoncés, ainsi que le fait que, selon eux, les auteurs de ces violences, des policiers, auraient dû être condamnés pour des traitements contraires à l’article 137 A § 3 du CP.
125. La Cour observe en outre que la Grèce a promulgué des dispositions de droit pénal réprimant les pratiques contraires à l’article 3 de la Convention. Ainsi, l’article 137 A du code pénal prévoit que tout fonctionnaire ou militaire dont les devoirs incluent les poursuites, l’interrogatoire ou l’enquête concernant des infractions pénales ou disciplinaires, l’exécution des sanctions, ou la garde ou la surveillance de détenus, est puni d’une peine de réclusion s’il soumet à la torture, dans l’exercice de ses fonctions, une personne placée sous son autorité. En ses paragraphes 2 et 3, cet article établit une distinction entre, d’une part, la torture – dont l’élément objectif consiste, notamment, en toute infliction « planifiée » d’une douleur physique aiguë – et, d’autre part, les atteintes graves à la dignité humaine, parmi lesquelles les blessures corporelles, les atteintes à la santé et les violences physiques ou psychologiques exercées illégalement. Dans ce deuxième cas de figure, la sanction prévue est la peine d’emprisonnement d’au moins trois ans.
126. La Cour relève ensuite qu’en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 2, 3, 6 et 10, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes a renvoyé H.D. et E.K. en jugement du chef de coups et blessures infligés sans provocation de la part de la victime (agissements qui relevaient des paragraphes 1 et 2 de l’article 308 A du CP, combinés avec le paragraphe 1 de l’article 308 du même code) (paragraphe 47 ci‑dessus). Ces policiers ont été condamnés tant en première instance qu’en appel sur la base de l’article 308 A du CP : leur culpabilité quant aux actes qui leur étaient reprochés a été reconnue par les juridictions nationales, et la procédure menée à leur encontre s’est conclue par un jugement de condamnation sur la base de cette disposition (paragraphe 10 ci-dessus).
127. La Cour ne saurait ignorer que, d’après la cour d’appel, les violences survenues dans le bâtiment situé à Athènes, dont les requérants ont été victimes, avaient été perpétrées par les policiers H.D. et E.K dans le cadre des efforts déployés par eux pour retrouver le fugitif R.A.N. En effet, selon la cour d’appel, les accusés avaient agi de la manière suivante au cours des évènements en cause : après être entrés de nuit dans le bâtiment en question, ils avaient réveillé toutes les personnes qui y résidaient et ils les avaient conduites dans le salon du bâtiment, où ils leur avaient imposé de faire face au mur ; par la suite, ils avaient demandé aux résidents des informations sur le fugitif qu’ils recherchaient, et ils avaient frappé à coups de pied, coups de poing et gifles ainsi qu’à l’aide de bâtons certains d’entre eux, « qui réagissaient » ; le lendemain, ils étaient retournés dans cet immeuble et avaient réitéré leurs agissements.
128. La Cour ne saurait sous-estimer les sentiments de peur et d’angoisse suscités chez les requérants : réveillés par des descentes de police effectuées pendant deux nuits consécutives, ceux-ci ont subi des coups, et ils ont vu les policiers frapper leurs compatriotes dans le seul but d’obtenir des informations. La Cour note que les policiers agissaient dans le cadre d’une opération informelle et qu’il ne ressort pas du dossier que ces agents avaient un mandat d’arrestation ou de recherche.
129. La Cour note en outre l’absence de tout lien de causalité entre la conduite des requérants et l’utilisation de la force par les agents de police. En effet, s’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que, le 14 décembre 2004, les policiers ont frappé certaines des personnes résidant dans l’immeuble susmentionné, à savoir celles « qui réagissaient », il n’est pas suggéré par les juridictions internes que les requérants ont essayé d’attaquer les policiers ou qu’ils ont montré un comportement violent quelconque. De même, il ne ressort pas du dossier que les requérants ont eu, lors de l’arrivée de la police, un comportement susceptible de mettre quiconque en danger. Au contraire, les éléments du dossier permettent de constater que les mauvais traitements en cause ont été infligés aux requérants dans le but d’obtenir des informations sur le fugitif R.A.N. Par ailleurs, il convient de souligner que le requérant figurant sous le numéro 2 était mineur à l’époque des faits.
130. Or la Cour observe que ces éléments n’ont pas été pris en compte à leur juste valeur par les juridictions internes.
131. S’agissant de la peine infligée aux policiers, la Cour note d’emblée que la cour d’appel a reconnu aux agents H.D. et E.K. des circonstances atténuantes. Cette juridiction a condamné ces derniers à des peines d’emprisonnement de dix mois pour chacune des infractions de coups et blessures, prononçant ainsi, après la confusion des peines, une peine d’emprisonnement de vingt mois au total, avec sursis, à l’encontre de H.D. et une peine d’emprisonnement de vingt-cinq mois au total, également assortie d’un sursis, à l’encontre de E.K. La Cour ne perd pas de vue que, par conséquent, H.D. et E.K. n’ont pas purgé des peines d’emprisonnement.
132. La Cour relève ensuite qu’une enquête administrative a été ouverte contre les policiers en cause. Par une décision du 15 juin 2006, une sanction disciplinaire de suspension temporaire de six mois a été imposée à H.D. et E.K. Toutefois, la Cour observe que les peines imposées n’ont pas été exécutées, au motif que H.D. était déjà resté hors du service du 15 janvier 2005 au 14 juillet 2006 et que E.K. avait entre-temps quitté le service. Par ailleurs, elle note que l’imposition de ces sanctions ne concernait pas uniquement les mauvais traitements subis par les requérants figurant sous les numéros 2, 3, 6 et 10. En effet, en imposant ces sanctions, le conseil de discipline de deuxième instance avait pris également en compte le fait que les intéressés avaient infligé des mauvais traitements au requérant figurant sous le numéro 1.
133. S’agissant de la célérité de l’enquête, la Cour note que la procédure en cause s’est étendue sur une période d’environ sept ans et trois mois, à savoir du 19 décembre 2004, date à laquelle les requérants (excepté celui figurant sous le numéro 9) ont déposé plainte, au 22 mars 2012, date à laquelle la cour d’appel a rendu ses arrêts nos 156, 157, 169 et 173/2012. Elle observe en particulier que la phase préliminaire de l’enquête pénale a duré environ cinq ans. Or il n’apparaît pas que, au cours de cette phase, les autorités de poursuite aient effectué un quelconque acte d’enquête entre décembre 2004 et avril 2006. Il est vrai que, en l’espèce, l’enquête présentait une certaine complexité. Cela étant, la durée de la phase préliminaire, phase qui a comporté une période d’inactivité de plus d’un an, est susceptible d’avoir compromis l’effectivité de l’enquête.
134. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur les autres défaillances alléguées de la procédure en cause. Elle considère que le système pénal et disciplinaire, tel qu’il a appliqué en l’espèce, s’est avéré loin d’être rigoureux et qu’il ne pouvait engendrer de force dissuasive susceptible d’assurer la prévention efficace d’actes illégaux, à l’instar de ceux dénoncés par les requérants. Elle parvient ainsi à la conclusion que l’issue de la procédure litigieuse n’a pas offert un redressement approprié de l’atteinte portée à la valeur consacrée dans l’article 3 de la Convention (Zeynep Özcan, précité, § 45, Okkalı, précité, §§ 76 et 78).
135. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 2, 3, 6 et 10.
γ) Le requérant figurant sous le numéro 1
136. La Cour constate que ses considérations relatives à la durée de la procédure pénale (paragraphe 133 ci-dessus), aux défaillances de la procédure ayant abouti à l’établissement des certificats médicolégaux (paragraphes 114-122 ci-dessus) et à l’examen par les autorités d’un éventuel mobile raciste (paragraphes 119-121 ci-dessus) sont également valables dans le cas du requérant figurant sous le numéro 1. En outre, elle observe que la cour d’appel a exprimé des doutes sur le fait de savoir si ce requérant avait subi la torture de la falaka, cette juridiction ayant relevé que ni le médecin légiste ni la médecin du centre de réadaptation médicale des victimes de la torture n’avaient constaté l’existence de lésions sur la plante des pieds de l’intéressé. La Cour note qu’il ressort de manière claire du certificat établi par le centre en question que ledit requérant présentait des ecchymoses, des lésions et des plaques œdémateuses au niveau de la plante des pieds et qu’il avait des difficultés à marcher (paragraphe 16 ci‑dessus). Dans ces circonstances, elle considère que ce certificat médical aurait au moins dû être attentivement évalué par les juridictions internes.
137. La Cour observe par ailleurs que la cour d’appel a exprimé des doutes sur le fait de savoir si les autres blessures du requérant susmentionné avaient été causées dans le garage du commissariat de police d’Aghios Panteleimonas. Cette juridiction a en effet estimé que, si ledit requérant avait subi des mauvais traitements, les passants, ainsi que les propriétaires et les clients des cafétérias, de même que les policiers qui étaient en service au commissariat, auraient dû être témoins de ces traitements. Elle a de plus relevé qu’il n’existait pas de témoignages de personnes ayant elles-mêmes eu connaissance des agissements dénoncés.
138. La Cour note enfin que l’accès à tout bâtiment ou autre lieu visé par l’enquête devrait être réservé aux enquêteurs et à leurs collaborateurs afin d’éviter la disparition ou la destruction de preuves matérielles ; les preuves matérielles devraient être recueillies, manipulées, emballées et étiquetées avec le plus grand soin et mises en sécurité de manière à prévenir tout risque d’altération ou de disparition ; et un croquis à l’échelle des lieux où les actes de torture sont censés avoir été commis devrait être effectué en y faisant figurer tous les détails pertinents (voir à cet égard les lignes directrices mentionnées aux paragraphes 66-68 ci-dessus). Or, en l’espèce, la Cour constate que les autorités n’ont entrepris aucune démarche en ce sens dans les locaux du commissariat d’Aghios Panteleimonas.
139. En conséquence, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour estime que le requérant figurant sous le numéro 1 n’a pas bénéficié d’une enquête effective. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural dans le chef de ce requérant.
δ) Le requérant figurant sous le numéro 5
140. En l’espèce, la Cour note tout d’abord que, telles qu’exposées devant les autorités internes, les allégations du requérant d’après lesquelles des policiers lui ont infligé des traitements contraires à l’article 3 de la Convention étaient défendables. Cette disposition obligeait donc lesdites autorités à mener une enquête effective.
141. En ce qui concerne le requérant figurant sous le numéro 5, la Cour observe qu’il a déposé une plainte pénale contre les policiers impliqués et qu’il a par la suite été examiné par un médecin légiste. Qui plus est, elle relève que ce requérant était présent lors de l’audience qui s’est tenue devant la cour d’assises et qu’il a déposé comme témoin. Il a par ailleurs décrit les mauvais traitements qu’il alléguait avoir subi (paragraphe 51 cidessus).
142. La Cour estime que la gravité des griefs présentés devant les juridictions internes exigeait que la cour d’assises vérifiât au moins si le requérant susmentionné avait perdu son intérêt à agir ou s’il avait renoncé à son droit à être entendu (voir, mutatis mutandis, Gjikondi et autres c. Grèce, no 17249/10, § 134, 21 décembre 2017), ce qui ne semble pas avoir été le cas en l’espèce. La Cour note par ailleurs que la cour d’assises n’a aucunement fait mention de la plainte pénale de l’interessé dans ses arrêts nos 611/21-10-2011, 702,703/12-12-2011 et 725, 726, 727/19-12-2011.
143. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que le requérant figurant sous le numéro 5 n’a pas été impliqué dans la procédure à un degré suffisant (voir, a contrario, Stojnšek c. Slovénie, no 1926/03, § 103, 23 juin 2009). Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural dans le chef de ce requérant.
iii. Conclusion
144. En conséquence, la Cour rejette les exceptions du Gouvernement tirées du défaut de la qualité de victime et du non-respect du délai des six mois, et elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural à l’égard de tous les requérants.
b) Quant aux allégations de tortures et mauvais traitements
i. Les requérants figurant sous les nos 1, 4, 5, 7 et 8
145. La Cour observe que la cour d’assises a acquitté E.K. et H.D. du chef des coups et blessures infligés aux requérants figurant sous les numéros 4, 7 et 8 (paragraphe 52 ci-dessus). Par ailleurs, elle note que la cour d’appel a acquitté les accusés du chef des tortures infligées au requérant figurant sous le numéro 1 (paragraphe 55 ci-dessus). Quant au requérant figurant sous le numéro 5, elle note qu’il n’a pas été impliqué dans la procédure à un degré suffisant et que les juridictions internes n’ont alors pas examiné ses allégations selon lesquelles il aurait subi de mauvais traitements (paragraphes 141 à 143 ci-dessus).
146. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au‑delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Labita, précité, § 121).
147. En l’espèce, la Cour note que les rapports médicaux ne sont pas concluants quant à l’origine possible des blessures que présentaient le requérants et que les éléments du dossier ne permettent pas d’avoir une certitude suffisante, au-delà de tout doute raisonnable, sur la cause des lésions constatées. À cet égard, elle tient toutefois à souligner que cette impossibilité découle en grande partie de l’absence d’une enquête approfondie et effective par les autorités nationales (B.S. c. Espagne, no 47159/08, § 55, 24 juillet 2012, Lopata c. Russie, no 72250/01, § 125, 13 juillet 2010, et Gharibashvili c. Géorgie, no 11830/03, § 57, 29 juillet 2008).
148. Eu égard à ses conclusions sous le volet procédural de l’article 3 de la Convention, la Cour considère qu’il n’existe pas en l’espèce d’éléments suffisants permettant de conclure au-delà de tout doute raisonnable que les requérants figurant sous les numéros 1, 4, 5, 7 et 8 ont fait l’objet des traitements allégués.
149. À la lumière de ce qui précède, la Cour ne peut conclure au-delà de tout doute raisonnable à une violation matérielle de l’article 3 s’agissant des mauvais traitements allégués par les requérants susmentionnés.
ii. Les requérants figurant sous les nos2, 3, 6 et 10
150. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, et parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil 1997–VIII, et Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 46, 27 juillet 2006).
151. En l’espèce, la Cour constate en premier lieu que la cour d’appel a clairement établi les faits des coups et blessures infligés aux requérants figurant sous les numéros 2, 3, 6 et 10 (paragraphes 10 et 55 ci-dessus). En particulier, la cour d’appel a constaté que H.D. et E.K. avaient frappé les intéressés avec leurs jambes et leurs mains ainsi qu’à l’aide de bâtons sur différentes parties de leurs corps, leur provoquant des lésions corporelles simples. Ainsi, ils ont causé des ecchymoses au dos au requérant figurant sous le numéro 6 ; une ecchymose de forme ellipsoïdale au bras gauche du requérant figurant sous le numéro 10 ; et une ecchymose de forme ellipsoïdale à la cuisse gauche du requérant figurant sous le numéro 3. Qui plus est, toujours selon la cour d’appel, E.K. a frappé le requérant figurant sous le numéro 2, lui causant une lésion à l’avant du tibia gauche avec une ecchymose autour.
152. La Cour note, en outre, que la cour d’appel a reconnu les auteurs des faits coupables des coups et blessures infligés aux requérants sans provocation de la part de la victime (actes qui relevaient de l’article 308 A du CP). La cour d’appel a ainsi qualifié les actes incriminés de « lésions corporelles ».
153. La Cour considère, à l’instar des constatations de la cour d’appel, que les traitements infligés en l’espèce aux requérants figurant sous les numéros 2, 3, 6 et 10 constituent des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.
154. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel à l’égard des requérants susmentionnés.
Olisov et autres c. Russie du 2 mai 2017 requête no 10825/09
Article 3 : Explications non satisfaisantes de la Russie pour des blessures subies par des détenus pendant leur garde à vue.
La Cour relève que, dans tous les cas, chacun des requérants a été mis en garde à vue pendant un intervalle de temps considérable, sans que son arrestation ne soit enregistrée, mais clairement dans des circonstances où ils ont été détenus et interrogés par la police parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis des infractions pénales. Les requérants ont allégué par la suite avoir été soumis à des violences. Les examens médicaux ultérieurs ont permis de constater qu’ils présentaient des blessures qui pouvaient résulter des sévices allégués que leur auraient infligés des policiers. Ces éléments suffisent à crédibiliser les allégations des requérants et à donner lieu à une présomption en faveur de leur version des faits. L’absence d’enregistrement des arrestations pèse également en faveur de la version des faits des requérants et renforce encore cette présomption. Dès lors, la charge de la preuve pesait sur le Gouvernement, qui devait fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des éléments de nature à jeter le doute sur les allégations des requérants. Dans tous les cas, les autorités ont refusé d’ouvrir des poursuites pénales contre les policiers et ces refus ont été confirmés par les juridictions internes. Les autorités ont adhéré aux explications données par la police selon lesquelles les blessures avaient été causées par les requérants eux-mêmes ou résultaient de leur résistance à l’arrestation. Ces conclusions sont problématiques pour diverses raisons. Par exemple, les autorités ont accordé un poids décisif aux témoignages des policiers qui étaient accusés de mauvais traitements : alors même que leurs explications étaient peu convaincantes et/ou non corroborées par d’autres éléments.
En l’absence d’enquête pénale, les mesures prises par les autorités dans leur examen des allégations des requérants se sont limitées à des investigations préliminaires. Or, ainsi que la Cour l’a conclu précédemment dans l’affaire Lyapin c. Russie (no 46956/09, §§ 129 et 132-136), pareilles investigations préliminaires, dans le cadre de la procédure russe, ne suffisent pas à satisfaire aux exigences de la Convention s’agissant d’examiner des allégations crédibles de violences commises par des policiers.
Il faut une enquête pénale à proprement parler, qui doit s’accompagner de toutes les mesures d’instruction substantielles que cela implique. Le Gouvernement a fait siennes les explications des autorités internes quant à l’origine des blessures des requérants. Cependant, ces explications n’étaient ni satisfaisantes ni convaincantes, et ont été avancées à l’issue d’une enquête qui ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 3. Partant, le Gouvernement n’a pas réussi à renverser la charge de la preuve en produisant des éléments de nature à jeter le doute sur la version des faits des requérants. La Cour a donc eu à établir les faits. Elle estime que les actes de violence auxquels les requérants ont été soumis pendant les interrogatoires de police, eu égard à leur gravité et au but d’obtenir des aveux, s’analysent en des actes de torture. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 tant sous son volet matériel que sous son aspect procédural.
Osman C. Roumanie du 11 avril 2017 requête 59362/14
Violence de la police au sens de l'article 3 : il n'y a pas que la France qui est pointée du doigt pour la violence de sa police, la Roumanie aussi. La différence est qu'en France, au nom de la lutte contre l'Islamiste, les bavures de quelques policiers sont excusées par la majorité de la population. En Roumanie, elles sont dénoncées par la majorité de la population.
1. Sur les mauvais traitements allégués
61. Le requérant soutient qu’il a été maltraité par les policiers lors de son interrogatoire du 16 avril 2010.
62. Se référant au constat des autorités judiciaires nationales fondé sur les preuves du dossier, le Gouvernement soutient qu’il n’a pas été démontré que les blessures constatées sur le requérant avaient été causées par les agents de police. Il déclare que, en l’occurrence, un registre était tenu et que celui-ci indiquait notamment le nom des personnes qui entraient et sortaient des locaux de la police. Il ajoute qu’aucune mention n’a été faite dans ce registre quant à l’état médical de l’intéressé ou quant à la présence d’éventuelles traces de violence sur son corps, que ce soit à son entrée ou à sa sortie des locaux de la police.
63. La Cour renvoie aux principes généraux applicables quant au volet matériel de l’article 3 de la Convention, qu’elle a récemment réitérés dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 81-90, CEDH 2015).
64. En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 16 avril 2010, le requérant s’est rendu au poste de police vers 9 h 10 (paragraphe 7 ci-dessus). Aucune des parties n’a soutenu que le requérant était blessé lorsqu’il est arrivé au poste de police.
65. La Cour constate que le requérant a été examiné par un médecin le même jour à 14 h 20, soit une heure ou, au plus tard, trois heures – selon les versions des parties – après avoir quitté le poste de police. Cet examen médical, dont la réalité et les conclusions n’ont pas été remises en cause, mentionnait que le requérant présentait une « fracture de la côte latérale C IX gauche » et une contusion à la jambe droite (paragraphe 18 ci-dessus). Ces conclusions ont été confirmées par un certificat médicolégal délivré le 19 avril 2010 (paragraphes 19 et 20 ci-dessus) lequel n’a pas non plus été contesté. Ultérieurement, des documents médicaux ont constaté une dégradation significative de l’état de santé de l’intéressé directement liée aux faits du 16 avril 2010 (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Il ne fait pas de doute que les blessures en question étaient d’une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
66. La Cour relève que le requérant a été examiné par un médecin le jour même des faits, peu de temps après sa sortie du poste de police, ce qui conforte le caractère probant des documents médicaux versés au dossier. Dès lors, elle estime qu’il incombe au Gouvernement de fournir une explication plausible quant à l’origine des blessures du requérant (voir, mutatis mutandis, Cheydaïev c. Russie, no 65859/01, § 53, 7 décembre 2006).
67. La Cour observe que, d’après les documents médicaux versés au dossier, les lésions du requérant pouvaient être le résultat de coups portés par exemple par un poing, un pied ou par d’autres éléments ayant une surface similaire (paragraphe 40 ci-dessus).
68. Elle réitère l’importance de consigner par écrit toutes les informations permettant d’éclairer ultérieurement, en cas de besoin, les circonstances relatives à la présence de personnes au poste de police (voir, mutatis mutandis, Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536/01, § 168, 24 juin 2008, et Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 105, CEDH 2000‑VI). En l’occurrence, l’interrogatoire du requérant a eu lieu le 16 avril 2010, après que des poursuites pénales avaient été engagées contre lui (paragraphe 6 ci-dessus). Or il ne ressort pas du dossier que le requérant a été informé de ses droits procéduraux lors de son interrogatoire et, notamment, de son droit de faire appel à un avocat (paragraphe 55 ci‑dessus). En outre, les policiers mis en cause ont omis d’indiquer sur la déclaration du requérant les heures de début et de fin de l’interrogatoire (paragraphes 23 et 56 ci-dessus), et le policier de service n’a pas noté dans le registre l’heure à laquelle l’intéressé a quitté le poste de police (paragraphe 42 ci-dessus). Le Gouvernement n’a donné aucune raison qui expliquerait pourquoi ces informations n’ont pas été consignées. De telles informations auraient pu permettre, d’une part, de mener une enquête effective et, d’autre part, de décharger le cas échéant les policiers de toute responsabilité directe quant à l’origine des blessures constatées sur le requérant si peu de temps après son départ du poste de police.
69. Certes, les policiers mis en cause ont, tout au long de la procédure interne, nié avoir agressé le requérant. Cependant, ce dernier a affirmé le contraire avec une constance comparable. Par ailleurs, dès lors que l’enquête menée en l’espèce présente des déficiences significatives (paragraphes 77 à 83 ci-dessous), on ne saurait déduire la véracité des déclarations desdits policiers du seul fait que l’enquête n’a pas apporté d’élément les contredisant.
70. Enfin, s’agissant de l’hypothèse retenue par les autorités internes selon laquelle le requérant aurait été agressé après son départ du poste de police, la Cour constate que le dossier ne contient aucun indice ou élément allant dans ce sens.
71. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les circonstances de l’espèce permettent de caractériser, en l’absence de production par les autorités internes d’une explication satisfaisante et convaincante de l’origine des lésions du requérant, l’existence d’un faisceau d’indices suffisant pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel (voir, par exemple et mutatis mutandis, Ersin Erkuş et autres c. Turquie, no 40952/07, § 73, 31 mai 2016).
72. Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition en raison des mauvais traitements allégués.
2. Sur le caractère effectif de l’enquête
73. Le requérant soutient que les autorités internes n’ont mené qu’une enquête formelle sur ses allégations de mauvais traitement.
74. Le Gouvernement rétorque qu’une enquête a été ouverte contre les policiers et qu’un grand nombre de preuves a été recueilli. Il soutient que, à la suite des décisions prises par le procureur en chef, l’affaire a été renvoyée à deux reprises au parquet de Galaţi aux fins de poursuite de l’enquête et que des confrontations ont été menées entre le requérant et les personnes mises en cause.
75. S’agissant de l’obligation pour les autorités nationales d’ouvrir une enquête et de mener des investigations effectives, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 182-185, CEDH 2012, et Bouyid, précité, §§ 115-123).
76. En l’espèce, il n’est pas contesté que les allégations de mauvais traitements étaient « défendables » au sens de la jurisprudence précitée. Une enquête ayant bien eu lieu dans la présente affaire, il reste à apprécier son caractère effectif.
77. À cet égard, la Cour constate d’abord que les autorités internes ne se sont aucunement penchées sur les circonstances dans lesquelles le requérant a été interrogé le 16 avril 2010. En effet, les enquêteurs n’ont pas recherché si les policiers avaient respecté les garanties procédurales dont aurait dû bénéficier le requérant lors de son interrogatoire (paragraphes 55 et 56 ci‑dessus) ; ils n’ont pas non plus éclairci les circonstances factuelles concrètes de cet interrogatoire en s’interrogeant sur le rôle des sept policiers qui, selon les déclarations de T.G., étaient présents (paragraphe 44 ci‑dessus) alors que, sur la déclaration de l’intéressé, il est mentionné que celui-ci a été effectué en présence de L.C.I. (paragraphe 23 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que, à aucun moment, il n’a été soutenu que le comportement de l’intéressé ait rendu nécessaire une présence policière si importante.
78. La Cour relève ensuite que S.A., d’après ses déclarations, est le principal témoin des mauvais traitements allégués. Cependant, les autorités internes ont conclu, en se fondant sur les déclarations des policiers et sur l’absence de mention de son nom dans le registre que, le 16 avril 2010, celle-ci n’était pas présente au poste de police. Or, étant donné que le témoin G.I. avait déclaré avoir vu S.A. au poste de police (paragraphe 28 ci‑dessus), la Cour est d’avis, comme le procureur en chef l’avait d’ailleurs relevé (paragraphe 37 ci-dessus), que les enquêteurs auraient dû agir avec plus de diligence pour éclaircir cet aspect important de l’affaire. Cependant, le parquet de Galaţi n’a entrepris aucune démarche pour identifier et entendre d’autres témoins oculaires qui auraient pu le renseigner sur l’emploi du temps de S.A. ce jour-là.
79. La Cour estime par ailleurs que, tant la présence de S.A. au poste de police que l’heure de sortie du requérant et l’état de santé de ce dernier au moment de son départ auraient pu être vérifiés au moyen des images enregistrées ce jour-là par la caméra de surveillance située à l’entrée du poste de police. Ces images auraient pu constituer une preuve déterminante permettant d’accréditer ou d’infirmer les allégations de mauvais traitements du requérant et faciliter ainsi l’avancement de l’enquête (voir, par exemple et mutatis mutandis, Gheorghe Dima c. Roumanie, no 2770/09, § 109, 19 avril 2016, et Ataun Rojo c. Espagne, no 3344/13, § 36, 7 octobre 2014). Cependant, bien qu’une enquête ait été rapidement ouverte à la suite de la plainte du requérant, les enquêteurs n’ont pas pris promptement les mesures nécessaires aptes à sauvegarder ces images, et celles-ci ont été détruites trente jours après les faits (paragraphes 41 et 42 ci-dessus).
80. Le parquet de Galaţi n’a pas non plus fait le nécessaire pour éclaircir le contenu des déclarations du requérant et de celles de S.A. et de D.N., alors que, dans sa décision du 12 décembre 2012, le procureur en chef avait relevé une contradiction entre lesdites déclarations et avait indiqué la nécessité de confronter les intéressés (paragraphe 37 ci-dessus). De surcroît, le parquet a ensuite utilisé cette contradiction afin d’écarter la déclaration du requérant (paragraphe 50 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour constate que la déclaration de D.N. n’a pas été remise en cause en ce qu’il a dit avoir retrouvé le requérant en très mauvais état de santé devant le poste de police (paragraphes 15 et 27 ci-dessus) et que le parquet de Galaţi n’a pas entrepris de démarches afin que les relevés téléphoniques du requérant et de D.N. soient conservés (paragraphe 48 ci-dessus). Toutefois, les autorités internes n’ont donné aucune explication à la présence de l’intéressé devant le poste de police, en mauvais état de santé, après avoir subi un interrogatoire.
81. Force est donc de constater que les autorités internes ont choisi de fonder principalement leurs décisions sur les déclarations des policiers mis en cause. En l’absence d’explication plausible pour l’ensemble des lésions subies par le requérant, la Cour ne voit aucune raison de donner la primauté à la version des agents de l’État sur celle du requérant (voir, en ce sens, Poede c. Roumanie, no 40549/11, § 58, 15 septembre 2015). À ce sujet, il convient de souligner que, à aucun moment, des poursuites pénales n’ont été ouvertes en l’espèce contre les policiers. Ainsi, la décision de non-lieu a été fondée sur de simples déclarations qui n’avaient pas le statut de preuve au sens des règles de procédure pénale du droit interne, dès lors que ces actes, qui ont un caractère sui generis, échappent aux garanties applicables dans le cadre des poursuites pénales. Cela est d’autant plus grave dans un cas comme celui de la présente affaire, où les blessures étaient attestées par un certificat médical (Poede, précité, §§ 37 et 60).
82. La Cour observe enfin que, bien que le dossier ait été transféré au parquet de Brăila en vue de la poursuite de l’enquête (paragraphe 52 ci‑dessus), les parties ne l’ont pas informée de l’existence d’actes d’enquête éventuellement effectués après ce transfert ou de l’existence d’obstacles d’ordre procédural qui s’opposeraient à la poursuite de l’enquête à présent, plus de six ans après les faits (voir, par exemple et mutatis mutandis, Chinez c. Roumanie, no 2040/12, § 52, 17 mars 2015).
83. La Cour en conclut que, en l’espèce, les autorités nationales n’ont pas mené une enquête effective. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
ÖZPOLAT ET AUTRES c. TURQUIE du 27 octobre 2015 requête 23551/10
Violation de l'article 3 non pas sur la préparation de l'opération d'arrestation, non pas sur la riposte aux violences contre les requérants mais pour ne pas avoir conduit l'un d'eux à l'hôpital alors qu'il subissait une hémorragie interne.
57. En ce qui concerne les principes concernant le recours à la force pouvant conduire à donner la mort à une personne, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (voir, parmi plusieurs autres, Giuliani et Gaggio c. Italie ([GC], no 23458/02, §§ 174-182, CEDH 2011 (extraits)).
58. La Cour rappelle en particulier que, pour apprécier les preuves, elle adopte le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, parmi d’autres, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII, et Giuliani et Gaggio, précité, § 181). Sensible à la nature subsidiaire de sa mission, la Cour reconnaît qu’elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (Giuliani et Gaggio, précité, § 180, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 182, 14 avril 2015). Toutefois, lorsque des allégations sont formulées sur le terrain de l’article 2 de la Convention, elle doit se montrer particulièrement vigilante, quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées au plan interne (Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 271, CEDH 2003-V, et Giuliani et Gaggio, précité, § 182).
59. La Cour note qu’en l’espèce une enquête officielle a été menée au sujet des événements litigieux. C’est ainsi que les fonctionnaires de police impliqués dans l’incident et un grand nombre de témoins civils, dont certains avaient été cités à la demande des requérants, ont été entendus et que des preuves techniques ont été recueillies. Sans préjudice de ses conclusions relatives à l’aspect procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour considère, à la lumière de l’ensemble des documents qui lui ont été présentés, qu’il existe suffisamment d’éléments factuels et de preuves lui permettant d’apprécier l’affaire, en prenant pour point de départ les constatations du parquet de Diyarbakır, confirmées par la cour d’assises de Siverek.
60. La Cour observe que les requérants critiquent notamment la planification et la conduite de l’opération et qu’ils soutiennent que les forces de l’ordre n’avaient pas déployé la vigilance voulue pour s’assurer que tout risque pour la vie avait été réduit au minimum. Par conséquent, la Cour examinera d’abord la question de la préparation et du contrôle de l’opération, pour ensuite se pencher sur l’usage de la force meurtrière à l’encontre de İskender Özpolat et sur les circonstances dans lesquelles est décédé Mehmet Özpolat.
i. Sur la préparation et l’exécution de l’opération
61. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie, pour que l’obligation de l’État de protéger la vie soit respectée, il est essentiel que la préparation d’une opération d’arrestation susceptible d’entraîner l’utilisation d’armes à feu s’accompagne d’une analyse de l’ensemble des informations disponibles sur les circonstances des événements, y compris – et il s’agit là d’un minimum – sur la nature de l’infraction commise par la personne devant être appréhendée et sur le danger qu’elle représente le cas échéant (voir Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 103, CEDH 2005‑VII).
62. En l’espèce, la Cour observe qu’il ressort du procès-verbal d’incident dressé le 13 juillet 2007 que, vers 14 h 20, à la suite d’une dénonciation selon laquelle une personne avait été blessée par une arme à feu, les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux de l’incident et ont pris les mesures nécessaires en encerclant notamment le domicile du suspect. Elle constate que, malgré ces mesures, l’opération des forces de l’ordre s’est soldée par le décès de İskender Özpolat et que, au cours de la même opération, un policier et le fils de İskender Özpolat, Mehmet Özpolat, ont été grièvement blessés et ont succombé à leurs blessures.
63. S’agissant du déroulement de l’opération, la Cour prend note des éléments suivants, établis par le parquet.
L’opération en question, pour autant qu’elle visait à permettre l’arrestation de İskender Özpolat, qui était armé et mentalement malade et qui aurait blessé une autre personne dans la même journée, avait été bien programmée et gérée jusqu’à l’intervention d’un des policiers pour arrêter Mehmet Özpolat. Au début de l’opération, les forces de l’ordre avaient essayé de mettre fin à l’incident par le dialogue et la persuasion. Toutefois, en raison de l’apparition de Mehmet Özpolat sur une terrasse, avec une arme qui se révéla ensuite être factice, la situation avait soudainement dégénéré. En effet, un des policiers, à savoir H.İ., agissant d’après le parquet sous l’emprise d’une crainte et d’une émotion, s’était jeté sur Mehmet Özpolat sans en informer ses supérieurs. Par la suite, İskender Özpolat avait commencé à tirer sur les policiers et avait mortellement blessé H.İ. Ensuite, nonobstant quelques tentatives de négociation, les policiers avaient décidé d’intervenir dans l’appartement et avaient usé de la force meurtrière à l’encontre de İskender Özpolat (paragraphe 21 ci-dessus).
64. La Cour observe que le parquet de Diyarbakır a indirectement admis que la réaction soudaine de H.İ. face au comportement inattendu de Mehmet Özpolat a provoqué un concours de circonstances, qui a fini par des échanges de tirs.
65. Pour la Cour, même si on devait admettre que l’agent concerné avait pris une initiative inconsidérée lors de l’opération, cela ne signifierait pas nécessairement que celle-ci n’avait pas été programmée et organisée de manière à réduire autant que possible tout risque pour la vie des proches des requérants. À cet égard, la Cour observe que les éléments du dossier ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité des supérieurs hiérarchiques du policier décédé, dans la mesure où il était établi, au plan interne, que ce dernier avait pris une initiative pour laquelle il n’avait pas l’autorisation desdits supérieurs. En effet, il ressort des éléments du dossier que l’opération a été menée sous la supervision du procureur de la République responsable qui, dans un premier temps, avait ordonné le recours à des moyens neutralisants et qui, par la suite, avait enjoint aux policiers en charge de l’opération de s’éloigner des lieux et aux agents en civil de poursuivre leurs tentatives de persuasion (paragraphes 9‑11 ci-dessus). Toutefois, comme l’a souligné le parquet, le comportement inattendu de Mehmet Özpolat et la réaction soudaine de H.İ. ont changé radicalement le cours de l’opération. Sur ce point, les requérants n’ont par ailleurs présenté aucun début de preuve susceptible de remettre en cause cette conclusion du parquet.
66. Partant, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que l’opération en question n’avait pas été programmée et organisée de manière à réduire autant que possible tout risque pour la vie des proches des requérants.
ii. Sur l’usage de la force meurtrière à l’encontre de İskender Özpolat
67. S’agissant de l’usage de la force meurtrière à l’encontre de İskender Özpolat, la Cour note d’emblée que nul ne conteste que celui-ci a été tué par balles par les forces de l’ordre. Il s’ensuit donc que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent démontrer que l’usage de la force meurtrière était rendu absolument nécessaire par la situation, au sens de l’article 2 § 2 de la Convention (Bektaş et Özalp c. Turquie, no 10036/03, § 57, 20 avril 2010, et Makbule Kaymaz et autres c. Turquie, no 651/10, § 103, 25 février 2014) ou, en d’autres mots, que la force meurtrière employée n’est pas allée au-delà de ce qu’exigeaient les circonstances (Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 87, Recueil 1998‑I, et Jaloud c. Pays-Bas [GC], no 47708/08, § 199, CEDH 2014)
68. La Cour observe, comme expliqué ci-dessus (paragraphes 62-66), que les autorités ont parfaitement compris qu’elles avaient affaire à une personne armée et mentalement malade, qui aurait blessé une autre personne dans la même journée, et qu’elles ont essayé de mettre fin à l’incident par le dialogue et la persuasion. Toutefois, à cause d’un concours de circonstances inattendu, qui a fini par des échanges de tirs, les policiers ont décidé d’intervenir dans l’appartement et ont usé de la force meurtrière à l’encontre de İskender Özpolat, qui avait blessé un policier.
69. La Cour ne perd pas de vue que l’usage de la force par les policiers dans les conditions décrites ci-dessus était le résultat direct de la réaction violente de İskender Özpolat lors de l’arrestation de son fils. En effet, le parquet de Diyarbakır a conclu, sur la base des éléments de preuve à sa disposition, que le policier ayant tué İskender Özpolat avait agi en état de légitime défense dans la mesure où il n’avait pas d’autre choix que de faire usage d’une arme à feu et où il avait agi de manière proportionnée à l’attaque (paragraphe 21 ci-dessus). La Cour admet que le policier en question croyait de bonne foi dans ces conditions qu’il était nécessaire d’utiliser la force contre İskender Özpolat pour sauver la vie des membres de la famille de ce dernier, sa propre vie ainsi que celle de ses collègues (Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 192, Recueil 1997‑VI).
70. La Cour estime dès lors que l’usage de la force meurtrière dans les conditions susmentionnées, tout regrettable qu’il fût, n’a pas dépassé ce qui était « absolument nécessaire » pour défendre la vie des membres de la famille Özpolat et celle des policiers et qu’il ne constituait pas une méconnaissance par l’État défendeur de ses obligations au regard de l’article 2 § 2 a) de la Convention.
Partant, il convient de conclure à l’absence de violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel, s’agissant du décès de İskender Özpolat.
iii. Sur le décès de Mehmet Özpolat
71. La Cour constate que l’autopsie de Mehmet Özpolat a permis de déceler l'existence de nombreuses blessures à la tête et sur les différentes parties du corps et qu’elle a également établi que le décès était dû à une hémorragie cervicale et du tronc cervical liée à un traumatisme général (paragraphe 17 ci-dessus). Par ailleurs, le parquet de Diyarbakır a admis que « H.İ. [avait] causé le décès de Mehmet Özpolat, en dépassant volontairement les limites entourant l’usage de la force légitime, en lui donnant plus d’une fois des coups avec la crosse de son pistolet » (paragraphe 21 ci-dessus) ; toutefois, aucune poursuite n’a pu être engagée contre H.İ. en raison de son décès. Même si l’affaire n’a pas donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale en raison du décès de H.İ., il convient d’observer que la décision du parquet a été confirmée par la cour d’assises.
72. La Cour observe que les conclusions de l'examen d'autopsie et celles du parquet sont concordantes. Elle note par ailleurs que ni les requérants ni le Gouvernement n'ont cherché à mettre en cause celles-ci. Pour sa part, elle ne voit pas non plus de raison de s'écarter desdites conclusions.
73. La Cour en retient que selon le parquet, H.İ. était l’auteur des actes de violence perpétrés sur la personne de Mehmet Özpolat et que les blessures infligées de la sorte à ce dernier ont constitué la cause du décès. Toujours selon le parquet, H.İ. avait volontairement dépassé les limites de l’usage de la force légitime. La Cour en déduit que le recours à la force ayant conduit au décès de Mehmet Özpolat n’était pas rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de H.İ. ou d’autres personnes présentes.
74. La Cour observe que H.İ. agissait au moment des faits en tant qu’organe de l’État défendeur. Il s’ensuit que ses actes doivent être attribués à l’État défendeur en tant que tel. C’est donc l'État qui doit être tenu pour responsable pour le recours à la force qui n’était pas rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de H.İ. ou d’autres personnes.
75. La Cour constate par ailleurs que les policiers ont tardé à fournir des soins médicaux à Mehmet Özpolat. Même s’il est impossible, vu les insuffisances de l’enquête relevées ci-dessous (paragraphes 90-94), de dire qu’un tel retard a concouru à l’issue fatale, il n’est pas déraisonnable de partir du principe que des soins administrés plus rapidement auraient pu avoir une influence décisive sur l’évolution de l’état de santé de Mehmet Özpolat. La Cour rappelle à cet égard, que ce n’est que deux heures et demie après avoir été blessé, suite à des coups répétés à la tête avec la crosse de l’arme du policier en cause et présentant de nombreuses blessures sur différentes autres parties du corps, que Mehmet Özpolat a finalement été conduit à l’hôpital.
76. La Cour a tenu compte de l’argument du parquet, qui a justifié un tel retard par le fait que le jeune homme ne présentait aucun signe de saignement, que ce soit au niveau de la tête ou d’autres parties du corps. Elle n’est cependant pas convaincue par cet argument : il est notoire que l’absence de saignement n’est pas un signe manifeste de l’absence de gravité d’une blessure au crâne, surtout lorsqu’une telle blessure survient dans des circonstances telles que celles de l’espèce, à savoir à la suite de coups répétés avec la crosse d’une arme (voir paragraphe 21 ci-dessus). La Cour relève, en outre, que les policiers avaient à faire avec un mineur, souffrant de surcroît d’une maladie mentale. Toutes ces circonstances auraient dû conduire les policiers à agir sans tarder.
77. Enfin, la Cour ne saurait non plus accepter l’argument du Gouvernement selon lequel le retard était dû au fait que İskender Özpolat s’était mis à tirer sur les policiers, qui avaient été obligés d’éloigner Mehmet Özpolat des lieux de l’incident en le plaçant dans un endroit sécurisé. Elle observe notamment qu’il ne s’agissait pas d’une opération spontanée et que les autorités avaient disposé du temps nécessaire pour faire les préparatifs qui s’imposaient. À cet égard, on peut légitimement se demander pourquoi Mehmet Özpolat n’a pu être transféré à l’hôpital qu’avec un certain retard alors que le policier H.İ., également blessé lors de l’opération, a pu y être conduit immédiatement par une ambulance (paragraphe 7 ci-dessus). En effet, alors que deux équipes de police ont été déployées pour sécuriser les lieux et arrêter le suspect, il ressort du dossier que ces policiers n’ont pris aucune mesure pour qu’une aide médicale soit dispensée sur les lieux à ce mineur blessé et n’ont pas songé à appeler une ambulance supplémentaire en vue d’assurer un transport immédiat du blessé à l’hôpital.
78. Partant, il convient de conclure que l’État défendeur est responsable de ce décès. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel quant au décès de Mehmet Özpolat.
STOYKOV c. BULGARIE du 6 octobre 2015 requête 38152/11
violation de l'article 3 : il appartient d'expliquer pourquoi le requérant est blessé durant son arrestation alors qu'il est convenu qu'il n'a fait aucune agression contre les policiers.
55. La Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas le contenu du certificat médical délivré le 27 février 2009 et du rapport d’expertise médicale du 15 janvier 2010, qui décrivent plusieurs ecchymoses et contusions à la tête, à l’abdomen, au dos et au niveau des membres inférieurs et supérieurs du requérant qui lui ont été probablement causés le 26 février 2009 de la manière décrite par celui-ci (paragraphes 13 et 24 ci‑dessus). Ces constats n’ont été remis en cause ni par le parquet d’appel de Plovdiv, ni par le Gouvernement défendeur (voir paragraphes 29, 47 et 48 ci-dessus).
56. Les observations des parties divergent quant au point de savoir si ces lésions ont été causées uniquement au cours de l'arrestation du requérant, comme l'affirme le Gouvernement (voir paragraphes 47 et 48 ci-dessus), ou pendant l'arrestation et au cours des quelques heures suivants celle-ci, selon les affirmations du requérant (voir paragraphe 44 ci-dessus).
57. Les éléments de preuve dont elle dispose ne permettent pas à la Cour de déterminer au-delà de tout doute raisonnable si le requérant a effectivement été maltraité de la façon dont il décrit, notamment s’il a été battu à plusieurs reprises tout au long de la journée et s’il a été plaqué sur le sol couvert de neige. De même, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer l’allégation du l’intéressé selon laquelle ses doigts ont été brûlés avec un allume-cigare. Cependant, les preuves médicales du dossier démontrent que l’intéressé a reçu plusieurs coups violents à la tête, à l’abdomen, au dos et au niveau des membres supérieurs et inférieurs, probablement le 26 février 2009. Il est à noter également que les documents médicaux attestent de la présence de sang coagulé sous les ongles du requérant, ce qui pourrait corroborer sa thèse selon laquelle on lui aurait introduit la pointe d’un couteau sous les ongles de ses doigts. La Cour estime que la gravité des lésions corporelles constatées démontre que le requérant a été soumis à des traitements dont les effets dépassent le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Tout au long de la journée du 26 février 2009, l’intéressé s’est trouvé aux mains des agents de la police (paragraphes 8-12 ci-dessus). Dans une telle situation, il revient au gouvernement défendeur de fournir une explication convaincante quant à l’origine des blessures en cause (voir, mutatis mutandis, Selmouni, précité, § 87).
58. Dans ses observations, le Gouvernement soutient la thèse selon laquelle les lésions du requérant ont été causées au cours de son arrestation et que le recours à la force physique se justifiait par la nécessité de préserver la vie et l’intégrité physique des agents participants dans l’opération. Le Gouvernement met l’accent sur le caractère particulièrement violent de l’infraction pénale reprochée au requérant, une circonstance qui aurait démontré le danger encouru par les policiers lors de l’arrestation de celui-ci. La Cour rappelle cependant qu’en vertu de sa jurisprudence constante, la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime. La nature de l’infraction qui était reprochée au requérant est donc dépourvue de toute pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3 (voir Labita, précité, § 119 in fine).
59. Le Gouvernement n’a pas allégué que le requérant a essayé de s’enfuir ou qu’il a opposé de la résistance aux forces de l’ordre. Il est vrai que l’ordonnance du procureur d’appel du 16 mai 2011 mentionnait que le recours à la force en l’occurrence avait été motivé par la nécessité de « briser toute résistance » (voir paragraphe 29 ci-dessus). La Cour observe cependant que l’expression employée par le procureur d’appel est assez floue et que l’ordonnance en cause ne décrit pas de manière concrète quels agissement du requérant auraient pu être perçus comme une agression physique vis-à-vis des policiers. Aucune autre pièce du dossier ne permet de conclure que l’intéressé s’est attaqué aux policiers qui sont intervenus dans son domicile ou encore qu’il les a menacés avec une arme. De surcroît, le Gouvernement n’a fourni aucune explication convaincante quant à l’origine du sang coagulé sous les ongles des doigts du requérant.
60. La Cour estime dès lors que l’État défendeur doit être tenu pour responsable des mauvais traitements infligés à l’intéressé le 26 février 2009. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des critères dégagés par sa jurisprudence (voir paragraphe 52 ci-dessus), la Cour considère que ces traitements doivent être qualifiés de torture.
61. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
GHEDIR ET AUTRES c. FRANCE du 16 juillet 2015, requête 20579/12
Violation de l'article 3 : L'État n'explique pas les lésions et le fait que le requérant s'est retrouvé dans le coma ! Son crime ? Jeter des pierres sur les trains !
108. La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 163, série A no 25, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V)
109. La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Irlande, précité, §162, et Măciucă c. Roumanie, no 25763/03, § 22, 26 mai 2009).
110. En cas d’allégations de violation de l’article 3 de la Convention, la Cour doit, pour apprécier les preuves, se livrer à un examen particulièrement approfondi. Elle a alors recours au critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Irlande, précité, § 161, Selmouni, précité, § 88, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006‑IX, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 117, CEDH 2006‑IX, et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 92, CEDH 2010).
111. Lorsque des procédures internes ont été menées, la Cour n’a pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles (Gäfgen, précité, § 93, et Alberti c. Italie, no 15397/11, § 41, 24 juin 2014). En effet, même si dans ce type d’affaires elle est disposée à examiner d’un œil plus critique les conclusions des juridictions nationales (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 155, CEDH 2012), il lui faut néanmoins disposer d’éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles celles-ci sont parvenues (voir, parmi beaucoup d’autres, Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 59, 24 juillet 2008, et Alberti, précité, § 41).
112. Par ailleurs, la Cour observe que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme). Elle renvoie à sa jurisprudence relative aux articles 2 et 3 de la Convention selon laquelle, lorsque les événements en cause sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, tout dommage corporel ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse dans ce cas sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Salman, précité, § 100, Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, §§ 97 et 100, 16 décembre 2008, et El-Masri, précité, § 152). En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au gouvernement défendeur (Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 274, 18 juin 2002). De plus, la Cour rappelle que quelle que soit l’issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non des protagonistes ne saurait dégager l’État défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 34, série A no 336) ; il lui appartient donc de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 trouve à s’appliquer (Selmouni, précité, § 87).
113. Enfin, en ce qui concerne la question particulière des violences survenues lors de contrôles d’identités ou d’interpellations opérés par des agents de police, la Cour rappelle que le recours à la force doit être proportionné et nécessaire au vu des circonstances de l’espèce. À cet égard, elle attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées aux personnes objet de l’intervention et aux circonstances précises dans lesquelles elles l’ont été (Alberti, précité, §§ 43 et 44).
ii. Application de ces principes au cas d’espèce
114. La Cour relève d’emblée que les blessures du requérant, qui a subi un hématome sous-dural ayant entraîné une perte de connaissance suivie d’un coma et qui présente des séquelles importantes, le privant d’autonomie pour tous les gestes élémentaires de la vie quotidienne, dépassent le seuil de gravité exigé pour que le traitement dont il se plaint tombe sous le coup de l’article 3 de la Convention.
115. Par ailleurs, elle observe que les circonstances de l’espèce ne renvoient pas uniquement au déroulement de la garde à vue du requérant, mais également aux conditions de son interpellation par les agents du SUGE et sa remise aux fonctionnaires de police en vue de sa conduite au commissariat. La Cour examinera dès lors la question de savoir si les faits allégués sont établis en recherchant l’existence d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants.
116. Elle constate tout d’abord que les lésions se sont manifestées au cours d’une mesure de garde à vue, à la suite d’une interpellation accompagnée d’un usage de la force, le requérant ayant été amené au sol.
117. Or, la Cour note que les juridictions internes ont considéré que l’enquête avait permis d’exclure que les gestes opérés par les agents du SUGE et les fonctionnaires de police aient pu être à l’origine du traumatisme subi par le requérant, la dernière expertise réalisée ayant estimé que le délai entre l’interpellation et la survenance des symptômes était trop court (paragraphes 83 et 89 ci-dessus), ce qui conduit à attribuer l’origine des lésions à des évènements antérieurs à l’interpellation du requérant.
118. À cet égard, la Cour relève que, comme le concède le Gouvernement, les investigations entreprises par les autorités internes n’ont pas permis d’établir la réalité de tels évènements. Elle note que l’hypothèse même de leur existence reposait exclusivement sur les révélations d’un témoin relatant les propos d’un tiers ayant lui-même reçu les confidences de proches du requérant et précisant ne pas avoir pris ces indications au sérieux (paragraphe 38 ci-dessus). Elle observe à ce titre que les derniers experts ont indiqué qu’ils n’avaient pu disposer d’aucun élément susceptible d’étayer la déclaration selon laquelle le requérant aurait reçu un coup de bouteille sur la tête dans l’après-midi précédant son interpellation (paragraphe 67 ci-dessus).
119. S’agissant des expertises médicales, la Cour constate qu’un premier médecin entendu au cours de l’enquête de flagrance a estimé que les lésions constatées sur le requérant pouvaient être compatibles avec un seul coup d’une violence importante, tel notamment, qu’un coup de genou ou porté avec un objet non contondant ni trop lourd, voire une chute mal réceptionnée (paragraphe 21 ci-dessus). Les auteurs d’une expertise datée du 25 avril 2005 ont ensuite estimé que les blessures pourraient avoir été secondaires à un plaquage au sol, des coups de genou ou une chute de l’intéressé de sa hauteur au cours de son interpellation par les agents du SUGE (paragraphe 50 ci-dessus). Lors d’une nouvelle expertise en date du 19 octobre 2006, les experts observèrent que, selon la chronologie des événements telle qu’elle leur avait été rapportée, les conditions d’arrestation en gare étaient très vraisemblablement, sinon certainement, à l’origine des lésions traumatiques (paragraphe 55 ci-dessus). Enfin, une expertise déposée le 9 mars 2009 a conclu au caractère peu probable, voire impossible, de la survenue de la fracture lors des événements qui s’étaient déroulés à la gare ou au commissariat, étant précisé que les différentes déclarations des personnes entendues étaient jugées non compatibles avec les constations médico-légales (paragraphes 65 et 66 ci-dessus). La Cour constate donc que les conclusions des différents experts étaient contradictoires.
120. Par ailleurs, elle observe que les déclarations des agents du SUGE et des fonctionnaires de police, sur lesquelles était exclusivement fondée la reconstitution servant de base à la dernière expertise, étaient également contradictoires entre elles, chaque service se renvoyant la responsabilité des blessures du requérant. À cet égard, elle rappelle que les premiers ont indiqué avoir remis l’intéressé en bon état aux seconds et avoir par la suite constaté sur lui des blessures importantes (paragraphes 20, 42 et 44 ci-dessus). Certains policiers ont, quant à eux, évoqué, d’une part, un heurt de la tête du requérant au sol lors de son interpellation par le service de sécurité de la SNCF et, d’autre part, un coup de genou porté au niveau de la tête par Y.F. (paragraphes 15 à 17, 20, 39 à 41, 61 et 62 ci-dessus). La Cour observe toutefois que les déclarations de certains fonctionnaires de police ont varié de manière importante au cours de l’enquête, le plus gradé d’entre eux ayant admis avoir passé sous silence le coup de genou lors de sa première audition, dans le but de laisser Y.F. prendre ses responsabilités (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour ne peut que s’étonner d’un tel silence et de ces revirements dans les témoignages et déclarations, s’agissant notamment de faits de violences volontaires subis par une personne ayant présenté des blessures graves au cours de sa garde à vue.
121. Enfin, en ce qui concerne la justification de l’usage de la force pendant l’interpellation, la Cour constate à nouveau l’existence de contradictions entre les différents témoignages, certains déclarant que le requérant avait eu un geste violent à l’encontre d’un agent du SUGE (paragraphes 43, 44 et 60 ci-dessus), d’autres contestant cette version en affirmant que l’intéressé n’avait fait preuve d’aucune violence, se contentant de repousser la main d’un des employés de la SNCF (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).
122. La Cour en conclut que les investigations internes ont conduit à la réunion d’éléments contradictoires et troublants, tant dans les rapports d’expertises successifs que dans les témoignages sur les motifs et les conditions de l’interpellation et de la prise en charge du requérant. Elle considère que l’hypothèse de violences subies par l’intéressé avant son interpellation, admise comme plausible par la chambre de l’instruction, n’apparait pas suffisamment étayée pour être convaincante au vu des circonstances de l’espèce.
123. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que les circonstances de l’espèce permettent de caractériser l’existence d’un faisceau d’indices suffisant pour retenir une violation de l’article 3 de la Convention, en l’absence de fourniture par les autorités internes d’une explication satisfaisante et convaincante à l’origine des lésions du requérant dont les symptômes se sont manifestés alors qu’il se trouvait entre les mains des fonctionnaires de police.
124. Partant, il y a eu violation de l’article 3 dans son volet matériel.
SUR LE DÉFAUT D'ENQUÊTE
i. Les principes généraux
129. La Cour rappelle que lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits des personnes soumises à leur contrôle (voir, parmi beaucoup d’autres, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998‑VIII, et El Masri, précité, § 182).
130. L’enquête qu’exigent des allégations graves de mauvais traitements doit être à la fois rapide et approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête ou fonder leurs décisions. Les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables à leur disposition pour obtenir les preuves relatives à l’incident en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et les expertises criminalistiques. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les causes du dommage ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise. De plus, l’enquête doit être menée en toute indépendance par rapport au pouvoir exécutif. L’indépendance de l’enquête suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (El Masri, précité §§ 183-184, et Alberti, précité, §§ 62-63).
131. Enfin, la victime doit être en mesure de participer effectivement, d’une manière ou d’une autre, à l’enquête (El Masri, précité § 185).
ii. Application de ces principes au cas d’espèce
132. La Cour relève qu’en l’espèce une enquête de flagrance a été ouverte dès la découverte des faits. Celle-ci a permis l’audition de plusieurs témoins, trois agents du SUGE ayant par ailleurs été placés en garde à vue. De plus, une mise en situation a été effectuée en présence de deux membres du ministère public.
133. La Cour constate ensuite qu’une instruction a été rapidement ouverte et qu’au cours de celle-ci, de nombreux actes ont été réalisés. Elle note que trois personnes ont été mises en examen, l’une d’entre elles ayant effectué plusieurs mois de détention provisoire. Elle considère que la durée de l’instruction s’explique par l’ampleur des investigations entreprises, de nombreuses auditions et pas moins de quatre expertises ayant été effectuées. Celle-ci ne peut dès lors être considérée comme excessive. De plus, la Cour observe que les témoignages de l’agente de la SNCF mentionnée par le requérant et de S.Gh. ont été recueillis par les enquêteurs sur commission rogatoire, même si ces personnes n’ont pas pu être entendues par le juge d’instruction lui-même du fait du décès de la première et de la carence de la seconde.
134. En outre, la Cour estime que la réalisation de la dernière expertise, de manière conjointe avec la reconstitution, paraissait justifiée par les exigences de la manifestation de la vérité, les médecins ayant notamment été amenés à se prononcer sur la question de « l’intervalle libre » entre le choc subi et les premières manifestations du traumatisme chez le requérant.
135. Enfin, la Cour relève que le requérant, qui s’était constitué partie civile et était représenté par un avocat, disposait de la possibilité de formuler des demandes d’actes et de faire valoir ses intérêts.
136. Par conséquent, la Cour considère qu’en l’espèce, le requérant ne démontre pas que les investigations n’auraient pas été conformes aux exigences de l’article 3.
137. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 sous son volet procédural.
Doicu c. Roumanie du 5 mai 2015 requête 1454/09
Violation de l'article 3 : La CEDH rappelle qu'une garde à vue ne doit pas se transformer en partie de torture. Il est essentiel pour un État de surveiller le comportement de ses forces de l'ordre. Il n'est pas incompatible avec une société démocratique.
a) Principes généraux
51. La Cour rappelle d’abord que, selon sa jurisprudence, un traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000‑XI ; Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001‑III et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006‑IX).
52. À ce titre, la Cour précise que, pour apprécier les éléments de preuve, elle adopte en général le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161, série A no 25). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII).
53. Lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d’autres services comparables de l’État, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle requise par l’article 2 de la Convention, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 199, CEDH 2003‑VI).
54. À cet égard, la Cour rappelle que les autorités ne doivent pas sous-estimer l’importance du message qu’elles envoient à toutes les personnes concernées, ainsi qu’au grand public, lorsqu’elles décident d’engager ou non des poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En particulier, elle considère qu’elles ne doivent en aucun cas donner l’impression qu’elles sont disposées à laisser de tels traitements impunis (Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 71, CEDH 2000‑XII).
55. Ainsi, pour déterminer si les autorités nationales ont mené contre les responsables une enquête approfondie et effective conformément aux exigences posées par sa jurisprudence, la Cour a pris en compte dans de précédentes affaires plusieurs critères. D’abord, d’importants facteurs pour apprécier l’effectivité de l’enquête, et permettant de vérifier si les autorités avaient la volonté d’identifier et de poursuivre les responsables, sont la célérité avec laquelle ladite enquête a été ouverte et celle avec laquelle elle a été conduite (entre autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §§ 78‑79, CEDH 1999‑V ; Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03, § 59, 20 décembre 2007 ; Mikheïev c. Russie, no 77617/01, § 109, 26 janvier 2006, et Dedovski et autres c. Russie, no 7178/03, § 89, 15 mai 2008). En outre, l’issue de l’enquête et des poursuites pénales auxquelles elle a donné lieu, y compris la sanction prononcée ainsi que les mesures disciplinaires prises, ont un caractère déterminant. Ces éléments sont essentiels si l’on veut préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est censé avoir dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais traitements (Ali et Ayşe Duran c. Turquie, no 42942/02, § 62, 8 avril 2008 ; Austrianu c. Roumanie, no 16117/02, § 74, 12 février 2013 ; Çamdereli c. Turquie, no 28433/02, § 38, 17 juillet 2008, et, mutatis mutandis, Nikolova et Velitchkova, précité, §§ 60 et suiv.).
b) Application de ces principes à la présente espèce
i) Sur le volet substantiel de l’article 3
56. La requérante se plaint de ce que le 3 janvier 2001, alors qu’elle avait été conduite dans un bureau du commissariat de Predeal, elle avait reçu des coups de la part d’un des quatre policiers présents dans ce bureau, le policier L.I., et avait été blessée en conséquence. La Cour constate que, le lendemain de l’agression dénoncée par l’intéressée, celle-ci avait été examinée par un médecin de l’institut de médecine légale, lequel avait constaté des lésions traumatiques produites par un impact avec un corps dur et nécessitant douze à quatorze jours de soins médicaux. Les déclarations de la requérante sont cohérentes et soutenues par le certificat établi par l’institut de médicine légale, nonobstant les déclarations contradictoires du policier L.I. (paragraphes 17, 19 et 24 ci-dessus).
57. En outre, la Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas les lésions constatées sur la personne de la requérante après son passage au commissariat de Predeal le 3 janvier 2001 et causées par le policier L. I. (paragraphe 46 ci-dessus). Or, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, la Cour considère que les mauvais traitements subis par la requérante (paragraphe 9 et 14 ci‑dessus) lui ont incontestablement causé des souffrances ayant atteint un minimum de gravité pour relever de l’article 3 de la Convention (comparer avec Stoica c. Roumanie, no 42722/02, § 62, 4 mars 2008 et E.M. c. Roumanie, no 43994/05, § 57, 30 octobre 2012).
58. Cela étant, la Cour observe que les procureurs et les juges, en décidant de l’arrêt des poursuites pénales au motif que les faits ne présentaient pas la gravité requise et en annulant la condamnation du policier mis en cause au paiement d’une amende administrative, ont validé la conclusion des procureurs d’après lesquels, les faits commis par le policier étaient déterminés par le comportement et l’attitude de la victime. Or, la Cour confirme que même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil 1996‑V ; Labita, précité, § 119 et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 87, CEDH 2010). Dès lors, la Cour ne peut pas accepter la thèse du Gouvernement, selon laquelle les lésions de la requérante se justifient par son propre comportement et par la réaction de défense du policier, comme conforme à l’interdiction absolue inscrite à l’article 3 de la Convention.
59. Il y a eu donc violation du volet substantiel de l’article 3 de la Convention.
ii) Sur le volet procédural de l’article 3
60. La Cour relève que la requérante dénonce sans conteste la tergiversation de l’enquête, en se référant aux périodes d’inactivité des autorités responsables de l’enquête (paragraphe 50 ci-dessus).
La Cour estime, à la lumière des allégations de la requérante et compte tenu des principes exposés ci-dessus (paragraphes 53 et 54 ci-dessus), que l’argument du Gouvernement relatif à l’absence de grief au sujet de l’enquête (paragraphe 47 ci-dessus) est dénué de fondement.
61. Elle note ensuite, à l’instar du Gouvernement, que les autorités internes ne sont pas restées totalement inactives face aux allégations défendables de mauvais traitements dans l’affaire de la requérante. Toutefois, cela ne saurait suffire à les dégager de toute responsabilité sur le terrain de l’article 3 de la Convention. La Cour doit en effet s’assurer que les autorités internes ont mené une enquête approfondie et effective conformément aux exigences rappelées ci-dessus.
62. Elle observe qu’en l’espèce, le parquet a procédé à la première audition de cinq policiers impliqués dans l’incident seulement plus de cinq mois après l’incident, en juin et juillet 2001. A cet égard, elle rappelle avoir constamment souligné l’importance de l’audition immédiate des témoins, avant que leurs souvenirs ne perdent de leur fraîcheur (mutatis mutandis, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 103, Recueil 1998‑VIII et Petruş Iacob c. Roumanie, no 3524/05, § 47, 4 décembre 2012).
63. Elle relève ensuite que les poursuites contre le policier dénoncé par la requérante comme étant son agresseur, du chef de comportement abusif, ont été engagées le 19 février 2002, soit plus d’un an et un mois après l’incident et que le procureur du parquet militaire territorial de Bucarest a arrêté ces poursuites deux mois plus tard. Enfin, l’enquête devant le parquet s’est achevée le 18 décembre 2007, date à laquelle le parquet près la cour d’appel de Brașov a décidé que les faits ne présentaient pas la gravité requise par la loi pénale. La procédure a pris fin le 30 juin 2008 par un arrêt du tribunal départemental de Braşov confirmant la décision du 18 décembre 2007.
64. La Cour constate ainsi que l’enquête s’est déroulée pendant presque sept ans à partir du dépôt de plainte par la requérante, avec de longues périodes d’inactivité, sans qu’une justification ait été avancée pour ces périodes. Par conséquent, elle estime que, quelle que soit le degré de complexité de l’affaire, une telle durée entache inévitablement son effectivité (R.I.P. et D.L.P. c. Roumanie, no 27782/10, § 61, 10 mai 2012).
65. La Cour observe par ailleurs que l’indépendance des procureurs militaires ayant mené l’enquête est sujette à caution eu égard à la réglementation nationale en vigueur à l’époque des faits. En effet, elle a déjà eu l’occasion de conclure à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention en raison du manque d’indépendance des procureurs militaires chargés de la conduite d’enquêtes pénales ouvertes sur des allégations de mauvais traitements dirigées contre des policiers (Barbu Anghelescu, précité, § 67, et Bursuc, précité, § 107). Elle a ainsi constaté que, à l’époque pertinente, ces derniers étaient des officiers militaires actifs, au même titre que les procureurs militaires, qu’ils bénéficiaient donc de grades militaires, qu’ils jouissaient de tous les privilèges attachés à leurs fonctions, qu’ils devaient répondre de la violation des règles de la discipline militaire et qu’ils faisaient partie de la structure militaire fondée sur le principe de la subordination hiérarchique (Barbu Anghelescu, précité, §§ 40-43). La Cour réitère son constat antérieur et ne décèle aucune raison de s’en écarter dans la présente affaire (Melinte c. Roumanie, no 43247/02, § 27, 9 novembre 2006).
66. Il est vrai que l’enquête dans la présente affaire a été transmise le 21 avril 2004 au parquet près le tribunal de première instance de Brașov, lequel l’a renvoyée plusieurs fois pour des questions de compétence et de charge de travail. La Cour relève que le procureur du parquet près la cour d’appel de Brașov s’était borné à entendre uniquement la requérante le 26 octobre 2007, alors que cette dernière avait indiqué le nom de plusieurs témoins, et avait rendu sa décision arrêtant les poursuites trois semaines plus tard. Il ressort en outre du dossier que l’arrêt des poursuites était fondé uniquement sur les preuves administrées cinq années auparavant, lors de la première phase de l’enquête, à savoir la déclaration de la requérante du 4 mars 2002, celle du policier L.I. du 9 avril 2002 et les documents médicaux se rapportant à l’intéressée.
67. De l’avis de la Cour, l’intervention du parquet près la cour d’appel de Brașov ne suffit pas à pallier le manque d’indépendance des procureurs militaires qui avaient recueilli la plupart des éléments de preuve au cours des premières étapes de l’enquête, lesquelles revêtent une importance particulière (mutatis mutandis, Velcea et Mazăre c. Roumanie, no 64301/01, § 112, 1er décembre 2009).
68. La Cour observe également que l’amende administrative infligée initialement au policier L.I. a été annulée par la suite. À cet égard, elle trouve particulièrement surprenant le fait que les actes du policier L.I. aient été considérés comme « manifestement dénués d’importance » et comme ne présentant « pas le degré de danger social requis », malgré la sévérité des lésions causées à la requérante qui ont été constatées dans les documents médicaux.
De plus, la Cour constate que, tant au cours de la procédure menée à son encontre que par la suite, le policier L.I. a continué à exercer ses fonctions sans faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire ; il ressort au contraire du dossier qu’il a bénéficié d’une promotion dans la fonction d’agent en chef principal (paragraphe 22 ci-dessus). À ce titre, la Cour réaffirme que, lorsqu’un agent de l’État est accusé de délits graves impliquant des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, il est difficilement concevable qu’il puisse continuer à exercer ses fonctions pendant l’instruction le concernant ou pendant son procès, encore moins qu’il puisse demeurer dans la fonction publique si sa culpabilité était avérée (mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004, et Türkmen c. Turquie, no 43124/98, § 53, 19 décembre 2006).
69. En conséquence, la Cour considère qu’une condamnation à une amende quasiment symbolique, annulée par la suite de surcroît, ne saurait être tenue pour une réaction adéquate à une violation de l’article 3 de la Convention, même si elle relève de la pratique de l’État défendeur en matière de condamnation. Pareille sanction, manifestement disproportionnée à une violation de l’un des droits essentiels de la Convention, n’a pas l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d’autres transgressions de l’interdiction des mauvais traitements dans des situations difficiles qui pourraient se présenter à l’avenir (Gäfgen, précité, § 124).
70. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené une enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation défendable de la requérante selon laquelle elle avait été soumise à des mauvais traitements.
71. La Cour conclut dès lors qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
Arratibel Garcianda c. Espagne du 5 mai 2015 requête 58488/13
Violation de l'article 3 : L'enquête sur les dénonciations de faits commis durant une garde à vue doit être effective.
35. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, des sévices contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et, le cas échéant, à la punition des responsables (voir, en ce qui concerne l’article 2 de la Convention, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 161, série A no 324, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 101, CEDH 2000-VIII, Beristain Ukar, précité, § 28, Otamendi Egiguren, precité, § 38, Etxebarria Caballero, précité, § 43 et Ataun Rojo c. Espagne, nº 3344/13 § 34, 7 octobre 2014). S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998‑VIII).
36. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été placé en garde à vue au secret pendant cinq jours durant lesquels il n’a pas pu informer de sa détention une personne de son choix ni lui en communiquer le lieu, et n’a pas pu se faire assister par un avocat librement choisi, selon les règles applicables aux gardes à vue au secret.
37. L’intéressé s’est plaint de manière précise et circonstanciée d’avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue au secret le 11 mars 2011 lorsqu’il a porté plainte devant la juge de garde de Pampelune. Il aurait également déclaré avoir fait l’objet de mauvais traitements devant le juge central d’instruction près l’Audiencia Nacional, le 22 janvier 2011. Cette affirmation du requérant n’a toutefois pas pu être vérifiée puisque la copie de ses déclarations n’a pas été jointe au dossier de l’instruction bien qu’il en ait fait expressément la demande dans sa plainte du 11 mars 2011 (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour estime dès lors que le requérant avait un grief défendable sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Elle rappelle que, dans ce cas, la notion de recours effectif implique, de la part de l’État, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et, le cas échéant, à la punition des responsables (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 79, CEDH 1999‑V).
38. S’agissant des investigations menées par les autorités nationales au sujet des allégations de mauvais traitements, la Cour observe que, d’après les informations fournies, le juge d’instruction no 3 de Pampelune s’est borné à examiner les rapports des médecins légistes au sujet du requérant et la déposition de ce dernier par vidéo-conférence, alors qu’il avait aussi sollicité la production de la copie de ses déclarations devant la garde civile et devant le juge central d’instruction pendant sa garde à vue au secret, et les éventuels enregistrements des caméras de sécurité des locaux où il était placé en garde à vue, ainsi que l’identification et l’audition par le juge des agents de la garde civile intervenus pendant la garde à vue et l’audition par le juge des agents ainsi identifiés. Il avait en outre demandé l’audition, en tant que témoins, des médecins légistes l’ayant examiné et de l’avocat commis d’office présent lors de ses dépositions. Il avait également demandé à être soumis à un examen physique et psychologique afin d’établir l’existence d’éventuelles lésions ou séquelles. Or ses demandes n’ont pas été prises en considération par le juge d’instruction no 3 de Pampelune
39. À la lumière des éléments qui précèdent, la Cour estime que l’enquête menée dans la présente affaire n’a pas été suffisamment approfondie et effective pour remplir les exigences précitées de l’article 3 de la Convention. Une investigation effective s’impose pourtant d’autant plus fortement lorsque, comme en l’espèce, le requérant se trouvait, pendant la période de temps où les mauvais traitements allégués se seraient produits, dans une situation d’absence totale de communication avec l’extérieur, pareil contexte exigeant un effort plus important, de la part des autorités internes, pour établir les faits dénoncés. De l’avis de la Cour, l’administration des moyens de preuve supplémentaires suggérés par le requérant, tout particulièrement une audition des agents chargés de sa surveillance lors de sa garde à vue secrète, aurait pu contribuer à l’éclaircissement des faits, dans un sens ou dans l’autre, comme l’exige la jurisprudence de la Cour.
40. La Cour insiste par ailleurs sur l’importance d’adopter les mesures recommandées par le CPT pour améliorer la qualité de l’examen médicolégal des personnes soumises à la détention au secret et suivants (Otamendi Egiguren, précité, § 41). Elle estime que la situation de vulnérabilité particulière des personnes détenues au secret commande que soient imposées par le code de procédure pénale des mesures de surveillance juridictionnelle appropriées et que celles-ci soient rigoureusement appliquées, afin que les abus soient évités et que l’intégrité physique des détenus soit protégée. La Cour souscrit aux recommandations du CPT, reprises par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans son rapport du 9 octobre 2013 (reproduites au paragraphe 32 de l’arrêt Etxebarria Caballero, précité), concernant aussi bien les garanties à assurer en pareil cas que le principe même de la possibilité de placer une personne en détention au secret selon les règles établies par la législation espagnole.
41. En conclusion, eu égard à l’absence d’enquête approfondie et effective au sujet des allégations défendables du requérant (Martinez Sala et autres, précité, §§ 156-160), selon lesquelles il avait subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue au secret, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural.
ANDRIŞCĂ c. ROUMANIE du 3 février 2015 requête 65804/09
Violation de l'article 3 pour violences durant une garde à vue, l'État n'apporte aucune justification sur les éléments apportés par le requérant.
61. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un seuil minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV).
62. La Cour relève qu’en l’espèce les allégations du requérant concernant les violences qui lui auraient été infligées lors de l’incident du 14 août 2007 sont corroborées par les conclusions des rapports médicolégaux établis lors de son hospitalisation qui a suivi son transfert au commissariat. Elle estime que les blessures constatées ont, eu égard à la gravité des traitements qu’elles attestent, incontestablement causé au requérant des souffrances pouvant entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
63. La Cour rappelle à cet égard que les obligations des États contractants prennent une dimension particulière à l’égard des personnes qui sont entièrement sous le contrôle des autorités : ces personnes se trouvant en situation de vulnérabilité, les autorités ont le devoir de les protéger (voir, mutatis mutandis, Alboreo c. France, no 51019/08, § 90, 20 octobre 2011). La Cour en a déduit, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, que, le cas échéant, il incombait à l’État de fournir une explication convaincante quant à l’origine de blessures survenues en garde à vue (voir, par exemple, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 34, série A no 336, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 99, CEDH 2000-VII) ou à l’occasion d’autres formes de privation de liberté (voir, par exemple, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 91, CEDH 2001‑III, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 56, CEDH 2002-II, et Slimani c. France, no 57671/00, § 27, CEDH 2004‑IX).
64. Dès lors, la Cour a estimé, sous l’angle de l’article 3, que l’impossibilité d’établir les circonstances exactes dans lesquelles une personne qui se trouvait sous le contrôle des agents de l’État a été blessée ne l’empêche pas de parvenir à un constat de violation matérielle de cet article, faute pour le gouvernement défendeur d’avoir établi le déroulement des faits de manière satisfaisante et convaincante, éléments de preuve à l’appui (Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 100, 16 décembre 2008, et Alboreo, précité, § 91).
65. En l’espèce, la Cour note que le requérant allègue avoir subi, de la part des policiers, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors des événements qui se sont déroulés dans la soirée du 14 août 2007. Il se plaint notamment d’avoir reçu des coups lors de sa montée dans le véhicule de la police.
66. La Cour note que, s’il n’est pas contesté que le requérant a effectivement été blessé le 14 août 2007, les parties sont en désaccord quant à l’origine des blessures. L’intéressé accuse les policiers d’avoir employé à son égard une force excessive lors de son interpellation tandis que le Gouvernement nie tout recours à la force.
67. La Cour relève qu’il n’est pas contesté que la police est intervenue sur la terrasse du restaurant où se trouvait le requérant en raison du comportement agressif de l’un des amis de celui-ci. Toutefois, tous les témoignages et les juridictions nationales s’accordent sur le fait que le comportement du requérant n’a aucunement été mis en cause et que ce dernier a obtempéré aux ordres des policiers. De même, les juridictions nationales ont retenu que le requérant n’avait pas été blessé sur la terrasse du restaurant et qu’il avait accepté d’accompagner les policiers au commissariat. Dès lors, la Cour estime qu’il ne ressort pas du dossier que l’interpellation du requérant ait nécessité l’usage de la force par les agents de police ni que l’intéressé fût déjà blessé au moment de l’arrivée des agents de police.
68. La Cour note ensuite qu’il ressort également des témoignages et des décisions rendues par les juridictions internes que, à son arrivée au commissariat, le requérant se plaignait de douleurs au niveau du cou, ce qui a nécessité son transfert en urgence à l’hôpital.
69. La Cour note que, entre le moment de son interpellation sur la terrasse du restaurant et celui de son arrivée au commissariat, le requérant était sous le contrôle des forces de police. En effet, il a été emmené vers la voiture par un policier et il est monté dans une voiture de police qui l’a transporté jusqu’au commissariat. S’il est vrai que le requérant a partagé la banquette arrière de la voiture avec S.G., il n’en reste pas moins que le Gouvernement n’a pas soutenu que c’est ce dernier qui a frappé le requérant. En tout état de cause, à supposer que ce fût vrai, le requérant se trouvait entre les mains des autorités de l’État chargées de sa sécurité pendant son transport.
70. Même si aucun élément du dossier ne permet d’affirmer avec certitude à quel moment le requérant a été blessé, la Cour estime que les allégations de l’intéressé sont plausibles au vu de la manière dont l’opération s’est déroulée. Elle prend en compte également les rapports médicolégaux qui ont été établis à la suite de l’hospitalisation du requérant survenue très rapidement après son transfert au commissariat. Ces rapports, dont les constatations n’ont pas été contestées, attestent la présence de plusieurs ecchymoses et d’un traumatisme laryngien avec hématome, lésions qui avaient pu, selon les experts, être causées par un coup porté avec un objet dur, par exemple un poing. La Cour estime que ces blessures atteignent indubitablement le seuil minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention et qu’elles nécessitent des explications quant à leur cause.
71. Prenant en compte le fait que les témoignages et les juridictions internes n’ont aucunement fait état de blessures qui auraient été antérieures à l’interpellation du requérant par les agents de police et le fait que celui-ci a été présenté rapidement après son arrivée au commissariat à un médecin qui a décidé de l’hospitaliser en urgence, la Cour considère qu’il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible quant à l’origine des blessures en cause. Or le Gouvernement se borne à renvoyer aux constatations des juridictions nationales qui ont décidé de ne pas poursuivre les agents de l’État accusés par le requérant. La Cour estime que, selon sa jurisprudence bien établie (Iambor, précité, § 171), le non-lieu rendu au pénal par les juridictions internes ne dégage pas l’État roumain de sa responsabilité au regard de la Convention.
72. Compte tenu de l’état de vulnérabilité dans lequel se trouve toute personne placée sous le contrôle des agents de l’État et de l’importance que revêtent les garanties contre l’arbitraire relativement aux actes des agents investis du pouvoir répressif de l’État, la Cour considère que l’État roumain, n’ayant pas démontré que le requérant ait subi ces sévices avant de se trouver entre les mains de la police, est resté en défaut de fournir une explication satisfaisante quant à l’origine des blessures du requérant (Iambor, précité, § 175).
73. La Cour note enfin que le requérant a été transporté en urgence à l’hôpital, où il a été examiné par un médecin. Elle rappelle à cet égard que des examens médicaux indépendants et approfondis sont des garanties essentielles propres à prémunir les personnes se trouvant sous le contrôle des agents de l’État contre les mauvais traitements. Ces examens doivent être effectués par des médecins dûment qualifiés, en dehors de la présence de la police, et le rapport de l’examen doit faire état non seulement de toutes les lésions corporelles relevées mais aussi des explications fournies par le patient quant à la façon dont elles sont survenues et de l’avis du médecin sur la compatibilité des lésions avec ces explications (Akkoç c. Turquie, nos 22947/93 et 22948/93, § 118, CEDH 2000‑X). Or, en l’espèce, l’examen médical pratiqué par le médecin des urgences en présence d’un policier ne paraît pas satisfaire entièrement à ces exigences.
74. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, dans la présente affaire, l’absence totale d’explication de la part du Gouvernement quant aux blessures du requérant et l’impossibilité d’établir les circonstances exactes dans lesquelles le requérant a été blessé alors qu’il se trouvait sous le contrôle des agents de l’État ne l’empêchent pas de parvenir à un constat de violation matérielle de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Alboreo, précité, § 100, et Iambor, précité, § 175). Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de cette disposition dans son volet matériel.
Arrêt Rivas contre France 01/04/2004 Hudoc 4992 requête 59584/00
"§38: La Cour a souligné que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger.
Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police.
Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait.
Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime ()
Quelle que soit l'issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l'Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention; c'est à lui qu'il appartient de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3 trouve à s'appliquer"
"§39: Il n'est pas objecté que la blessure du requérant soit survenue au cours de la garde à vue alors qu'il se trouvait entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police.
Le Gouvernement ne conteste pas non plus que la lésion subie par le requérant qui a provoqué douleurs et souffrances physiques, à supposer établi qu'elle lui ait été infligée délibérément pendant son interrogatoire, a atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.
§40: Il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée ()
§41: La tentative de fuite alléguée ne saurait dégager l'Etat de la responsabilité qu'il porte en l'espèce ()
En conclusion, elle estime que le Gouvernement n'a pas démontré, dans les circonstances de l'espèce, que l'usage d la force contre le requérant était nécessaire.
§42: La Cour considère dès lors que l'acte dénoncé était de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez le requérant et, compte tenu de son âge, (mineur) à créer également des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale.
Ce sont ces éléments qui amènent la Cour à considérer que les traitements exercés sur la personne du requérant ont revêtu un caractère inhumain et dégradant.
Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention"
Arrêt Selmouni contre France du 28/07/1999 Hudoc 1053 requête 25803/94
Lorsqu'un individu ressort blessé d'une garde à vue, LA CHARGE DE LA PREUVE APPARTIENT A l'ETAT
"La Cour considère que lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible pour l'origine de ses blessures, à défaut de quoi l'article 3 de la Convention se trouve manifestement à s'appliquer"
Arrêt Bocharov contre Ukraine du 17 MARS 2001 requête 21037/05
L'ETAT CONTESTE QUE LES BLESSURES DU REQUERANT SOIT DUES A SA GARDE A VUE
mais ne transmet pas le dossier et de fait pas d'enquêtes effectives
LES FAITS
Le requérant, Yevgeniy Yuryevich Bocharov, est un ressortissant ukrainien né en 1970 et résidant à Kharkiv (Ukraine).
Selon ses déclarations, il fut arrêté le 11 avril 2002 par les services de la police régionale de Kharkiv et passé à tabac dans une forêt où il fut emmené tout d’abord, puis au poste de police. En conséquence, il avoua détenir et vendre des armes.
Libéré le lendemain, il fut hospitalisé presque immédiatement. A son admission à l’hôpital, le personnel médical nota qu’il présentait des blessures à la tête, au torse et aux reins ainsi que des côtes cassées et une commotion cérébrale. Il déclara au personnel médical avoir été battu par la police. Il sortit de l’hôpital le 4 mai 2002.
Alors qu’il était encore hospitalisé, il saisit les autorités de poursuites d’une plainte pour mauvais traitements contre trois agents des services de la police régionale de Kharkiv.
Sur ordre du procureur, M. Bocharov fut examiné par un expert médico-légal le 15 août 2002. Le rapport établi à la suite de cet examen faisait état de blessures légères à moyennes au torse et aux reins ainsi que d’une commotion cérébrale.
Entre juin 2002 et novembre 2007, l’enquête pénale sur les allégations de M. Bocharov fut close et rouverte à plusieurs reprises pour complément d’enquête. Notamment, en décembre 2002, elle fut rouverte afin d’examiner l’allégation de l’intéressé selon laquelle il avait subi des mauvais traitements aux mains des agents de la police régionale de Kharkiv et non de ceux de la police du district Moskovskiy. De plus, les policiers mis en cause furent interrogés en janvier 2003 et une confrontation fut organisée entre eux et M. Bocharov en mai 2003. En définitive, les poursuites furent abandonnées en novembre 2007 pour manque de preuves.
Devant la Cour, le Gouvernement a démenti les allégations de M. Bocharov. Il a indiqué que l’intéressé avait été convoqué par la police pour un interrogatoire et que cet interrogatoire avait permis de saisir des munitions entreposées à son domicile et hors de la ville.
ARTICLE 3
Quelques heures après avoir été remis en liberté, M. Bocharov a été emmené à l’hôpital, dans un état de santé tel qu’il a dû y rester pendant plus de 20 jours. Les lésions alors constatées sont conformes au récit cohérent qu’il a fait des circonstances suspectes de son arrestation et de sa détention et des mauvais traitements qu’il dénonce. Se trouvant détenu, il était sous le contrôle des agents de l’Etat et il incombait donc ensuite aux autorités de rechercher et de poursuivre ceux qui lui avaient infligé de tels traitements. Puisqu’elles ne l’ont pas fait, la Cour considère que les lésions qu’il a subies sont le résultat de traitements inhumains et dégradants dont le gouvernement ukrainien est responsable. Partant, il y a eu violation de l’article 3.
De surcroît, il y a eu dans cette affaire des retards d’une part dans l’obtention de preuves médicales (par exemple, l’ordre d’expertise médico-légale n’a pu être obtenu pendant que la victime se trouvait encore à l’hôpital, alors même que M. Bocharov avait indiqué au personnel médical avoir subi des mauvais traitements et qu’il avait déposé plainte pendant qu’il était encore hospitalisé), et d’autre part dans la conduite de l’enquête (notamment, les policiers mis en cause n’ont été interrogés que neuf mois après les faits et ils ont été confrontés avec la victime plus d’un an après), qui a été dirigée au départ (jusqu’en décembre 2002) contre le mauvais service de police. Compte tenu de ces graves insuffisances, la Cour considère que les autorités internes n’ont pas mené une enquête adéquate sur les allégations de mauvais traitements formulées par M. Bocharov, ce qui constitue une autre violation de l’article 3.
Arrêt SARIGIANNIS contre ITALIE du 5 AVRIL 2011, requête 14569/05
La police italienne s'amuse à taper sur les ressortissants français avec le soutien des juridictions italiennes
Principaux faits
Les requérants, Georges Sarigiannis, et son fils François, sont deux ressortissants français nés respectivement en 1948 et 1983. Lors de l’introduction de la requête, ils résidaient à Franconville (France).
Le 30 juin 2002, Georges Sarigiannis arriva à l’aéroport de Fiumicino (Italie) accompagné de son fils François, de son épouse et de sa fille. Alors qu’il demandait des explications aux agents de la police fiscale qui avaient interpellé son épouse pour un contrôle de passeport, il fut poussé violemment en direction d’un bureau, avec son fils François, qui était venu lui porter secours. Ils furent détenus dans les locaux de la police pendant deux heures et demie et allèguent qu’ils ont été menottés et frappés au visage. Georges Sarigiannis fut transporté dans une pièce contiguë où il fut jeté à terre et frappé à nouveau. Il dit avoir été empêché d’utiliser son téléphone pour appeler l’ambassade de France ou son avocat et n’avoir eu à boire qu’après une heure et demie d’attente. Les policiers remirent ensuite leurs passeports aux requérants et les invitèrent à quitter l’aéroport.
Les rapports établis aux urgences de l’hôpital le même jour faisaient état, chez le père, d’un traumatisme crânien, de multiples zones écorchées au dos, aux poignets, au niveau des oreilles et du cou et une possible lésion osseuse au bras droit et, chez le fils, d’une torsion des deux poignets, d’une contusion du tibia gauche avec écorchures, d’un traumatisme crânien, d’un hématome dans la région frontale, d’ecchymoses sur le visage, les oreilles et la jambe gauche. Les agents auraient également subi de multiples contusions aux bras et aux jambes.
En juillet 2002, les requérants déposèrent plainte contre trois agents de police non identifiés pour les délits de lésions, séquestration de personnes et abus de pouvoir. Ce plaintes furent classées sans suite par le juge des investigations préliminaires de Civitavecchia le 13 octobre 2004, au motif que les différentes versions des faits fournies par les parties ne permettaient pas d’établir si l’intervention des policiers avait été légitime et si leur conduite avait été proportionnée au comportement des requérants.
Article 3
Si l’article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation, ce dernier doit néanmoins être proportionné et nécessaire au vu des circonstances. Le Gouvernement ne conteste ni que la force a été utilisée par les policiers pour maîtriser les requérants ni que leurs blessures sont survenues au cours de leur rétention dans les locaux de la police. Il nie cependant que leurs lésions ont atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. La Cour estime au contraire que les certificats médicaux démontrent que les requérants ont été soumis à des traitements dont les effets dépassent le seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de cette disposition.
Les requérants étaient inconnus des forces de police et Georges Sarigiannis, bien que peu collaboratif, n’a eu un comportement ni violent ni disproportionné lors de son interpellation. La Cour, consciente que des agents de police ont également été blessés lors de l’incident, est prête à admettre la nécessité d’exercer une forme de contrainte pour éviter d’éventuels débordements. Cependant, même à supposer que la contrainte ait été, dans une certaine mesure, « nécessaire » du fait du comportement agressif des requérants, la Cour n’est pas convaincue qu’elle ait été « proportionnelle ».
Elle note que quatre policiers ont entrepris de maîtriser les deux requérants et que les autorités n’ont pas expliqué l’origine des nombreuses blessures au niveau de la tête et du visage du père et de son fils, qui furent par ailleurs placés dans deux pièces séparées pendant la rétention alors qu’étant étrangers, ils avaient des difficultés linguistiques. En outre, Mme Sarigiannis et sa fille mineure, qui avaient été empêchées d’entrer dans le bureau, se trouvaient pendant ce temps dans un état d’inquiétude compréhensible, sans nouvelles de leurs proches. Cette situation était de nature à engendrer chez les requérants des souffrances physiques et mentales et à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement leur résistance physique et mentale. Ainsi, les traitements infligés aux requérants ont revêtu un caractère inhumain et dégradant, contraires à l’article 3.
LA DISPARITION D'UN PROCHE LORS D'UNE GARDE A VUE SANS EXPLICATION
EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT POUR SES PROCHES
Arrêt Matayeva et Dadayeva contre Russie du 19 avril 2011, requête 49076/06
Un Tchétchène convoqué pour un interrogatoire disparaît à l’intérieur d’une enceinte gouvernementale sécurisée.
Après avoir condamner pour l'article 2, sur le droit à la vie et sur le défaut d'enquête effective, la CEDH condamne pour violation de l'article 3 concernant les proches du disparus.
Les requérantes, la femme et la mère de Khamzat Tushayev, ont éprouvé détresse et angoisse à cause de la disparition de celui-ci et de l’impossibilité où elles se sont trouvées – en épit de leurs demandes réitérées – de savoir ce qu’il était advenu de lui.
La manière dont les autorités ont traité les plaintes des requérantes doit passer pour un traitement inhumain interdit par l’article 3.
BOUYID C. BELGIQUE du 21 novembre 2013 requête 23380/09
UNE GIFLE LORS D'UNE GARDE A VUE N'EST PAS UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT LA POLICE PEUT TAPER !
43. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000‑IV, et Creanğa c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 88, 23 février 2012).
44. Sur ce dernier point, la Cour a précisé que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe alors au Gouvernement de fournir une explication satisfaisante et convaincante (voir, par exemple, l’arrêt Salman, précité, § 100), en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (voir l’arrêt Rivas précité, § 38, ainsi que, notamment, Turan Çakır c. Belgique, no 44256/06, § 54, 10 mars 2009 et Mete et autres c. Turquie, no 294/08, § 112, 4 octobre 2012). La Cour estime qu’il en va de même dans le cadre d’une vérification d’identité dans un commissariat ou, comme en l’espèce, d’un simple interrogatoire dans un tel lieu.
45. Un traitement est « dégradant » s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (voir, notamment, M.S.S. c. Belgique [GC], no 30696/09, § 220, CEDH 2011, se référant à Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI, et Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 52, CEDH 2002-III).
46. Lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (voir, notamment, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336, Mete et autres, précité, § 106, et El-Masri c. ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 207, CEDH 2012).
47. Toutefois, pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, en particulier, Irlande c. Royaume-Uni, précité, § 162, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX). Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré (voir par exemple, El-Masri, précité, § 196).
48. Il s’ensuit qu’il existe des violences qui, bien que condamnables selon la morale et très généralement aussi – mais pas toujours (voir Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 février 1982, § 30, série A no 48, et Costello-Roberts c. Royaume-Uni, 25 mars 1993, § 32, série A no 247‑C) –selon le droit interne des États contractants, ne relèvent pas de l’article 3 de la Convention (Irlande c. Royaume-Uni, précité, § 167 ; voir aussi le paragraphe 181 du même arrêt).
49. En l’espèce, les requérants allèguent qu’une gifle a été infligée à chacun d’eux alors qu’ils se trouvaient dans le commissariat de Saint-Josse-ten-Noode. Ils produisent des certificats médicaux à l’appui de leur version des faits. Le Gouvernement, pour sa part, estime qu’il ne ressort pas du dossier que les lésions qu’ils ont subies seraient la conséquence d’une gifle infligée, à l’un ou à l’autre, par un policier. En particulier, les certificats médicaux produits ne démontreraient pas que les lésions qu’ils constatent ont une telle origine. Le Gouvernement souligne par ailleurs que les policiers concernés ont toujours farouchement nié avoir ainsi agi. La Cour juge toutefois inutile de se prononcer sur l’existence ou non des faits allégués par les requérants. Elle estime en effet qu’à les supposer avérés, les actes dénoncés par les requérants ne constitueraient pas, dans les circonstances de la cause, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
50. La Cour souligne d’emblée que des policiers qui frappent des personnes qu’ils interrogent, pour le moins, commettent un manquement déontologique et font preuve d’un déplorable manque de professionnalisme. Elle se rallie à la recommandation faite par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à l’occasion de sa visite en Belgique en 2005 : face aux risques de maltraitance de personnes privées de leur liberté, les autorités compétentes doivent faire preuve de vigilance en ce domaine, particulièrement s’agissant de mineurs (rapport au Gouvernement belge, CPT/Inf (2006) 15, § 11).
51. En l’espèce toutefois, à supposer que gifle il y ait eu, il s’agissait dans les deux cas d’une gifle isolée, infligée inconsidérément par des policiers excédés par le comportement irrespectueux ou provocateur des requérants, et qui ne visait pas à leur extorquer des aveux. Elle serait de plus intervenue dans le contexte d’un climat tendu entre les membres de la famille des requérants et les policiers de leur quartier. Dans de telles circonstances, même si l’un des requérants n’avait alors que 17 ans et s’il est compréhensible que, dans l’hypothèse où les faits se seraient déroulés comme les requérants le disent, ils éprouvent un fort ressentiment, la Cour ne saurait perdre de vue qu’il s’agissait chaque fois d’un acte isolé, posé dans une situation de tension nerveuse et dénué de tout effet grave ou durable. Elle estime que des actes de ce type, bien qu’inacceptables, ne sauraient être considérés comme générant un degré d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour caractériser un manquement à l’article 3 de la Convention. Autrement dit, en tout état de cause, le seuil de gravité mentionné ci-dessus n’est pas atteint en l’espèce, de sorte qu’aucune question de violation de cette disposition ne se pose, que l’on envisage celle-ci sous son angle matériel ou sous son angle procédural.
52. La Cour en déduit que, dans les circonstances de la cause, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
MÊMES DROITS QU'UNE GARDE A VUE
DUBOIS c. FRANCE du 28 avril 2022 requête n° 52833/19
non violation Art 6 § 1 (pénal) + Art 6 § 3 c) • Procès équitable • Audition libre du requérant n’ayant pas reçu notification du droit de garder le silence et bénéficié de l’assistance d’un avocat • Cour d’appel s’étant principalement fondée, pour prononcer sa condamnation, sur des éléments à forte valeur probante n’ayant aucun lien avec l’audition libre. Pas de violation car si la CA n'a pas pris en compte l'irrégularité de l'audition libre, la CA s'est principalement appuyé sur d'autres moyens de preuve. Cet arrêt mérite un appel
FAITS
6. Une enquête est ouverte pour des faits d’exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste. Les trois clients dont les factures ont été produites par le syndicat sont entendus et confirment que le requérant a posé leurs couronnes ou implants.
7. Le 13 novembre 2014 entre 9 h 07 et 10 h 30, le requérant est entendu dans le cadre d’une audition libre par un officier de police judiciaire au commissariat de police. Il est informé des faits qui lui sont reprochés et de son droit de mettre fin à l’audition à tout moment. Il consent à être entendu librement. Il n’est pas explicitement informé de son droit de garder le silence et ne bénéficie pas de l’assistance d’un avocat.
9. Le 30 avril 2015, le requérant est cité devant le tribunal correctionnel de Tours pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste.
10. Assisté d’un avocat, le requérant soulève devant le tribunal une exception de nullité de la procédure d’enquête préliminaire et des actes subséquents au regard de l’article 6 de la Convention, au motif, notamment qu’il a été privé du droit à l’assistance d’un avocat et de la notification du droit de garder le silence lors de son audition libre.
13. Le tribunal correctionnel déclare le requérant coupable et le condamne à deux cents jours-amende à quatre-vingts euros. Le tribunal prononce également à titre de peines complémentaires, notamment, l’interdiction définitive d’exercer la profession de prothésiste dentaire, la confiscation de son matériel et la diffusion de la décision. Des dommages et intérêts sont accordés aux parties civiles.
14. Assisté d’un avocat, le requérant interjette appel du jugement, soulevant à nouveau une exception de nullité de la procédure pour les mêmes motifs qu’en première instance.
17. Au vu de ces éléments, la cour d’appel confirme le jugement de première instance sur la culpabilité et condamne le requérant à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve pendant trois ans avec l’obligation particulière de ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise et de réparer les dommages causés par l’infraction. Elle confirme en outre les peines complémentaires et les dispositions civiles adoptées en première instance.
18. Le requérant se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 mars 2018. Il invoque l’article 6 de la Convention dans son mémoire, faisant grief à l’arrêt d’appel de s’être fondé, pour le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, sur les déclarations incriminantes recueillies au cours de son audition libre qui s’est déroulée sans qu’il puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat ni qu’il ait été informé de son droit de garder le silence.
19. Le 14 mai 2019, la Cour de cassation déclare le pourvoi du requérant non admis au motif qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
RECEVABILITE : AUDITION LIBRE PROTEGEE PAR LA CONV EDH
a) Principes généraux
39. La Cour rappelle que les garanties offertes par l’article 6 s’appliquent à tout « accusé » au sens autonome que revêt ce terme sur le terrain de la Convention et que le stade de l’enquête revêt une importance particulière pour la préparation et le déroulement du procès au fond (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 54, CEDH 2008, et Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, §§ 249 et 253, 13 septembre 2016).
40. Il y a « accusation en matière pénale » dès lors qu’une personne se voit officiellement notifier, par les autorités compétentes, le reproche d’avoir commis une infraction pénale, ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent contre l’intéressé ont des répercussions importantes sur sa situation (Ibrahim et autres, précité, § 249, Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, § 110, 12 mai 2017, et Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 119, 9 novembre 2018).
41. Dans ces affaires, les requérants avaient été arrêtés et placés en garde à vue. Or, la Cour a précisé dans l’arrêt Beuze, précité, § 124, que le point de départ du droit d’accès à un avocat en cas de privation de liberté ne fait pas de doute. Ce droit est applicable dès l’« accusation en matière pénale » et, en particulier, dès l’arrestation d’un suspect, indépendamment du fait que l’intéressé ait ou non été interrogé ou qu’il ait fait l’objet d’une autre mesure d’enquête pendant la période pertinente.
42. Dans Simeonovi, précité, § 111, elle a également précisé qu’une personne soupçonnée, interrogée sur son implication dans des faits constitutifs d’une infraction pénale peut être considérée comme « accusée » et prétendre à la protection de l’article 6 de la Convention (voir également Aleksandr Zaichenko c. Russie, no 39660/02, §§ 41-43, 18 février 2010, Yankov et autres c. Bulgarie, no 4570/05, § 23, 23 septembre 2010, et Ibrahim et autres, précité, § 296).
43. De même, une personne simplement interrogée après avoir été appelée à donner des renseignements peut se prévaloir des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention déjà à ce stade de la procédure, en fonction de la manière dont l’interrogatoire est conduit (Schmid-Laffer c. Suisse, no 41269/08, §§ 28‑31, 16 juin 2015).
44. Par ailleurs, dans l’arrêt Stojkovic c. France et Belgique, no 25303/08, § 55, 27 octobre 2011, qui concernait le cas particulier d’une audition de témoin assisté dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, la Cour a également relevé que le régime juridique de l’audition litigieuse ne dispensait pas les autorités françaises de vérifier par la suite si elle avait été accomplie en conformité avec les principes fondamentaux tirés de l’équité du procès et d’y apporter, le cas échéant, remède.
b) Application au cas d’espèce
45. S’agissant de l’audition libre, telle qu’elle est prévue en droit français, la Cour considère qu’une personne suspectée d’avoir commis une infraction, convoquée et interrogée par un officier de police ou de gendarmerie, doit également être regardée comme « accusée » au sens de l’article 6 de la Convention même si cette audition n’est pas effectuée sous contrainte. En effet, en premier lieu, il n’est procédé à son audition libre que parce que et dans la mesure où, ainsi qu’il lui a été notifié, il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En deuxième lieu, la circonstance que la personne auditionnée soit en principe libre de mettre fin à l’audition à tout moment et de quitter les lieux ne suffit pas à compenser la situation d’asymétrie structurelle dans laquelle, en pratique, elle se trouve placée à l’égard des enquêteurs et des autorités chargées de l’interroger. En troisième et dernier lieu, à l’issue d’une audition libre, comme à l’issue d’une garde à vue, les autorités de police judiciaire sont susceptibles de disposer d’éléments de nature à confirmer ou non leurs soupçons (voir, mutatis mutandis, Brusco c. France, no 1466/07, § 47, 14 octobre 2010).
46. En l’espèce, la Cour note que le requérant a fait l’objet d’une audition libre d’une durée d’une heure et vingt-trois minutes, le 13 novembre 2014, au commissariat de police. À cette occasion, il a été informé du fait qu’il était auditionné parce qu’il était « connu pour exercice illégal de l’art dentaire ». La Cour en déduit, à l’instar des parties (voir paragraphe 38 ci-dessus), que le requérant doit être regardé comme « accusé » au sens de l’article 6 de la Convention (voir paragraphe 63 ci-dessous).
c) Conclusion
47. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
ARTICLE 6
Principes généraux
64. La Cour renvoie aux principes généraux maintes fois réaffirmés par elle (Salduz, précité, §§ 50-55, Ibrahim et autres, précité, §§ 249-274, Simeonovi, précité, §§ 110-120, et rappelés dans Beuze, précité, §§ 119-150, et dans Bloise c. France, no 30828/13, §§ 45-49, 11 juillet 2019).
65. Elle souligne en particulier que, quelle que soit la restriction concernée, même si cette dernière découle directement de la loi applicable, elle procède à un examen en deux étapes : d’une part, en vérifiant tout d’abord l’existence ou non de raisons impérieuses, puis, d’autre part, en examinant l’équité du procès dans son ensemble. Par ailleurs, si l’absence de raisons impérieuses ne suffit pas à entraîner une violation de l’article 6, elle entraîne un contrôle très strict de la Cour, dès lors qu’une telle absence pèse lourdement dans la balance lorsqu’il s’agit d’apprécier globalement l’équité du procès, ce qui peut faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation (Beuze, précité, § 145). Tel est d’autant plus le cas lorsqu’il y a cumul du défaut d’accès à un avocat et du défaut de notification des droits, en particulier du droit de garder le silence : le gouvernement, à qui il incombe d’expliquer de façon convaincante pourquoi, à titre exceptionnel et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la restriction à l’accès à un avocat n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès, pourra alors plus difficilement prouver que le procès a été équitable.
66. Par ailleurs, dans l’arrêt Beuze (précité), la Cour a précisé que la désignation d’un conseil doit impérativement s’accompagner des deux exigences minimales suivantes : d’une part, le suspect doit pouvoir entrer en contact avec son avocat dès sa privation de liberté, ce qui implique qu’il puisse consulter son avocat préalablement à un interrogatoire, voire en l’absence d’un interrogatoire et que l’avocat puisse s’entretenir avec lui en privé et en recevoir des instructions confidentielles (Simeonovi, précité, § 111, et Beuze, précité, § 133) ; d’autre part, le suspect doit également bénéficier de la présence physique de son avocat durant les auditions initiales menées par la police et durant les interrogatoires ultérieurs menés au cours de la procédure antérieure à la phase de jugement, cette présence devant permettre à l’avocat de fournir une assistance effective et concrète, notamment pour éviter les atteintes aux droits de la défense, et non seulement abstraite (ibidem, § 134).
67. Enfin, s’agissant des déclarations du suspect, elle rappelle que le droit de ne pas s’incriminer soi‑même ne se limite pas aux aveux au sens strict ou aux remarques le mettant directement en cause : il suffit, pour qu’il y ait auto‑incrimination, que ses déclarations soient susceptibles d’affecter substantiellement sa position, à l’instar de déclarations circonstanciées qui orientent la conduite des auditions et interrogatoires, qui affectent la position du suspect ou sa crédibilité (Beuze, précité, §§ 178-179).
68. La Cour renvoie aux facteurs non limitatifs qu’elle a retenus lorsqu’elle examine la procédure dans son ensemble de manière à mesurer les conséquences de lacunes procédurales survenues au stade de l’enquête ou durant la phase préalable au procès sur l’équité globale du procès pénal, qu’elle a énoncés dans Ibrahim (précité, § 274) et qu’elle a repris dans Simeonovi et dans Beuze (précités, respectivement § 120 et § 150).
b) Application au cas d’espèce
69. Informé de son droit de mettre fin à l’audition à tout moment, dans le respect du droit en vigueur à l’époque des faits litigieux, le requérant a consenti à être entendu librement. En revanche, il ne s’est pas vu notifier le droit de garder le silence, pourtant reconnu en droit interne à l’époque des faits (voir paragraphe 81 ci-dessous). L’assistance d’un avocat ne lui pas davantage été proposée.
70. À la lumière des considérations figurant aux paragraphes 45 et 46 ci‑dessus, la Cour estime que même si, en principe, le requérant pouvait quitter les lieux à tout moment, dans la pratique, il se trouvait, de manière analogue à un suspect placé en garde à vue, dans une situation asymétrique, seul face aux questions des enquêteurs et sans l’assistance d’un avocat.
71. La Cour relève que les faits se sont déroulés postérieurement à l’intervention de la loi du 27 mai 2014 qui a défini le régime juridique de l’audition libre, comprenant notamment le droit à l’assistance d’un avocat et la notification du droit de garder le silence (voir paragraphes 26 et suivants ci‑dessus).
72. La Cour note cependant que si l’obligation de notifier le droit de garder le silence était applicable dès le 2 juin 2014, date d’entrée en vigueur de la loi, il n’en est pas ainsi du droit à l’assistance d’un avocat, qui ne l’a été qu’à compter du 1er janvier 2015 (voir paragraphe 27 ci-dessus).
73. La Cour prend acte de l’intervention de cette loi, qui a largement renforcé les droits de la personne auditionnée librement et engagé un train de réformes législatives qui a 73.uti à l’instauration d’un régime quasiment identique à celui de la garde à vue. La Cour relève toutefois que ces modifications sont restées sans effet concret sur les modalités de l’audition libre du requérant.
74. La Cour déduit de ce qui précède qu’au moment des faits, s’agissant du droit à l’assistance d’un avocat, la restriction litigieuse était d’origine législative alors que s’agissant du droit de garder le silence, elle résultait de l’absence d’application de la loi alors en vigueur, ce que les juridictions internes n’ont d’ailleurs pas relevé.
75. Or, la Cour a rappelé, s’agissant en particulier des restrictions à l’accès à un avocat pour des raisons impérieuses, qu’elles ne sont permises durant la phase préalable au procès que dans des cas exceptionnels, et qu’elles doivent être de nature temporaire et reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d’espèce (Beuze, précité, § 161). Tel n’a clairement pas été le cas en l’espèce.
76. En outre, le Gouvernement, auquel il appartenait, contrairement à ce qu’il soutient, d’avancer des raisons impérieuses (voir paragraphe 56 ci‑dessus), n’a pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier les restrictions dont a fait l’objet le droit du requérant et il n’appartient pas à la Cour d’en chercher de son propre chef (Simeonovi, précité, § 130, et Beuze, précité, § 163). Aucune raison impérieuse ne justifiait donc en l’espèce les restrictions susmentionnées.
77. Dans ces conditions, la Cour doit évaluer l’équité de la procédure en exerçant un contrôle très strict et ce, à plus forte raison, dans le cas de restrictions d’origine législative ayant une portée générale (Olivieri c. France, no 62313/12, § 33, 11 juillet 2019, et Bloise, précité, § 52). La charge de la preuve pèse ainsi sur le Gouvernement, qui doit démontrer de manière convaincante que le requérant a néanmoins bénéficié globalement d’un procès pénal équitable (Beuze, précité, § 165).
78. Il revient à présent à la Cour de rechercher, au regard des différents facteurs découlant de sa jurisprudence tels qu’ils ressortent des arrêts Ibrahim et autres, Simeonovi et Beuze (précités, respectivement §§ 274, 120 et 150), et dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, si, combinée au défaut de notification du droit de garder le silence, le fait d’avoir été privé de la possibilité d’être assisté d’un avocat a ou non affecté l’équité de la procédure dans son ensemble.
79. La Cour note tout d’abord l’absence tant de vulnérabilité particulière du requérant (voir pour la vulnérabilité inhérente à la qualité de suspect mutatis mutandis, Salduz, précité, § 54, et Beuze, précité, §§ 126-127) que de contrainte exercée sur lui durant l’audition libre. Il n’allègue d’ailleurs pas avoir subi de pression particulière lors de son interrogatoire, qui a été de courte durée.
80. Néanmoins, la Cour considère que le droit de quitter les lieux à tout moment n’est pas de nature à compenser l’absence d’assistance d’un avocat et le défaut de notification expresse du droit de garder le silence durant l’audition libre (voir, mutatis mutandis Olivieri, précité, § 39, et Bloise, précité, § 59).
81. La Cour constate ensuite qu’au cours de l’audition libre, le requérant a décrit la réalisation de différents actes constitutifs de l’infraction qui lui était reprochée (voir paragraphe 8 ci-dessus). Elle en déduit que celui-ci doit dès lors être regardé comme s’étant auto-incriminé au sens de la jurisprudence de la Cour (Beuze, précité, §§ 178-179), ce que le Gouvernement reconnait (voir paragraphe 62 ci-dessus).
82. La Cour doit à présent rechercher si les restrictions litigieuses aux droits garantis ont été compensées de telle manière que la procédure peut être considérée comme ayant été équitable dans son ensemble (Beuze, précité, § 165). Pour ce faire, elle doit vérifier si les juridictions internes ont procédé à l’analyse nécessaire de l’incidence de l’absence d’avocat et du défaut de notification du droit de garder le silence à un moment crucial de la procédure (ibidem, §§ 174 et 176).
83. En premier lieu, la Cour constate que le requérant a pu, dans les phases ultérieures de la procédure, valablement se défendre et faire valoir ses arguments avec le concours d’un avocat, d’abord devant les juridictions du fond, notamment pour discuter des différents éléments de preuve, en première instance comme en appel, dans le cadre du recours qui lui était ouvert et qu’il a pu exercer, puis devant la Cour de cassation, qui était saisie de son pourvoi.
84. En deuxième lieu, la Cour relève que l’exception de nullité soulevée par le requérant, sur le fondement de l’article 6 de la Convention, a d’abord été accueillie par le tribunal correctionnel, qui a procédé à l’annulation du procès-verbal d’audition « au nom des principes d’exercice des droits de la défense garantissant un procès équitable ».
85. Il est vrai que cette solution a été infirmée par la cour d’appel (voir paragraphes 11 et 15 ci-dessus). Pour rejeter l’exception de nullité soulevée par le requérant, les juges d’appel, après avoir relevé que le requérant n’avait pas subi d’état de contrainte et avait accepté de répondre aux questions, ont considéré, contrairement à la Cour (voir paragraphe 81 ci-dessus), que ce dernier n’avait pas été conduit à s’auto-incriminer avant de conclure, en méconnaissance du droit alors applicable, que tous les droits garantis à l’époque des faits avaient été respectés.
86. En troisième lieu, la Cour souligne que le tribunal correctionnel, après avoir écarté le procès-verbal d’audition libre, a conclu dans un jugement longuement motivé à la culpabilité du requérant, sans aucunement se fonder sur les déclarations recueillies au cours de l’audition libre. Le tribunal s’est ainsi appuyé sur ses déclarations à l’audience alors qu’il était assisté d’un avocat, sur le fait qu’il comparaissait pour la neuvième fois depuis 1986 pour des faits similaires, sur le caractère invraisemblable de son allégation selon laquelle il demandait à ses clients de poser eux-mêmes les couronnes, sur l’examen des factures mettant en évidence la réalisation d’actes en bouche, ce que les trois témoins confirmaient, sur l’absence de diplôme de chirurgien‑dentiste, sur le nom de son cabinet (« centre de santé dentaire ») et, enfin, sur le fait qu’il disposait d’un équipement très semblable à celui des chirurgiens-dentistes (voir paragraphe 12 ci-dessus).
87. Quant à elle, la cour d’appel, alors même qu’elle s’est référée, après avoir infirmé la décision d’annulation du procès-verbal de l’audition libre, à une partie des déclarations effectuées lors de celle-ci pour appuyer les témoignages des clients, et ainsi souligner les contradictions du requérant lors des débats, s’est principalement fondée, comme l’avait fait le tribunal correctionnel, sur l’ensemble des autres éléments probants figurant au dossier, se référant en particulier aux déclarations du requérant à l’audience alors qu’il était assisté par un avocat (voir paragraphe 16 ci-dessus).
88. La Cour en conclut que les déclarations recueillies lors de l’audition libre n’ont pas occupé une place déterminante dans la motivation de la cour d’appel.
89. Or, comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Bloise, précité, § 57, il ressort clairement de sa jurisprudence que les restrictions au droit d’accès à un avocat, même systématiques, au droit de ne pas témoigner contre soi‑même et au droit à être informé de la possibilité de garder le silence ne peuvent pas entraîner ab initio la violation de la Convention mais donnent lieu à un examen en deux étapes. La première consiste à vérifier l’existence de raisons impérieuses de restreindre ces droits : même dans l’hypothèse où celles-ci feraient défaut, il ne saurait y avoir de constat de violation automatique de la Convention, la Cour devant, lors d’une seconde étape, effectuer un contrôle de l’équité de la procédure dans son ensemble (Ibrahim et autres, précité, §§ 262, 269 et 273, Beuze, précité, § 141). Parmi les facteurs susceptibles d’établir que la procédure a été équitable dans son ensemble, figure « l’utilisation faite des preuves, et en particulier le point de savoir si elles sont une partie intégrante ou importante des pièces à charge sur lesquelles s’est fondée la condamnation, ainsi que la force des autres éléments du dossier » (Ibrahim et autres, précité, § 274, Simeonovi, précité, § 120, Beuze, précité, § 150, et Bloise, précité, § 57). Dans le cadre de l’examen au cas par cas auquel la Cour se livre, ce qui implique nécessairement une appréciation susceptible de varier en fonction des circonstances particulières de chaque affaire, ce facteur s’avère crucial. À ce titre, elle estime important de souligner, comme elle l’a fait dans d’autres affaires relatives à l’article 6 § 1 de la Convention dans lesquelles un examen de l’équité globale de la procédure était en cause, qu’elle ne doit pas s’ériger en juge de quatrième instance. Lors de l’examen de l’équité globale de la procédure tel que celui exigé par l’article 6 § 1, elle est toutefois appelée à examiner soigneusement le déroulement de la procédure au niveau interne, un contrôle très strict s’imposant lorsque la restriction au droit d’accès à un avocat ne repose sur aucune raison impérieuse (Beuze, précité, §§ 148 et 194, Bloise, précité, et Brus c. Belgique, no 18779/15, § 36, 14 septembre 2021).
90. Dans la présente affaire, la Cour relève que la cour d’appel, aussi regrettable que soit le fait qu’elle n’ait pas, en procédant à l’analyse de l’impact des restrictions litigieuses, tiré toutes les conséquences qui s’évinçaient de l’absence de l’assistance d’un avocat et de notification du droit de garder le silence lors de l’audition libre pour les droits de la défense du requérant, s’est principalement fondée, pour prononcer sa condamnation pénale, sur des éléments à forte valeur probante n’ayant aucun lien avec l’audition libre. Elle en déduit, que, dans les circonstances de l’espèce, les déclarations effectuées pendant cette dernière n’ont, en définitive, joué qu’un rôle accessoire dans la condamnation du requérant (voir, a contrario, Ibrahim et autres, précité, § 309, Rodionov c. Russie, no 9106/09, § 168, 11 décembre 2016, Beuze, précité, § 193, et Bloise, précité, § 58).
91. Compte tenu de ce qui précède et dans le cadre du contrôle auquel elle doit procéder en l’absence de raisons impérieuses, la Cour estime que la procédure pénale menée à l’égard du requérant, considérée dans son ensemble, a permis, dans les circonstances de l’espèce, de remédier aux lacunes procédurales survenues durant l’audition libre (Bloise, précité, § 60).
92. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
WANG c. FRANCE du 28 avril 2022 Requête no 83700/17
Art 6 § 1 (pénal) + Art 6 § 3 • Procès équitable • Droits de la défense • Audition libre de la requérante n’ayant pas expressément reçu notification du droit de garder le silence et bénéficié de l’assistance d’un interprète
RECEVABILITE AUDITION LIBRE SOUS PROTECTION DE LA CONV EDH
a) Principes généraux
36. La Cour rappelle que les garanties offertes par l’article 6 s’appliquent à tout « accusé » au sens autonome que revêt ce terme sur le terrain de la Convention et que le stade de l’enquête revêt une importance particulière pour la préparation et le déroulement du procès au fond (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 54, CEDH 2008, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, §§ 249 et 253, 13 septembre 2016).
37. Il y a « accusation en matière pénale » dès lors qu’une personne se voit officiellement notifier, par les autorités compétentes, le reproche d’avoir commis une infraction pénale, ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent contre l’intéressé ont des répercussions importantes sur sa situation (Ibrahim et autres, précité, § 249, >Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, § 110, 12 mai 2017 et Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 119, 9 novembre 2018).
38. Dans ces affaires, les requérants avaient été arrêtés et placés en garde à vue. Or, la Cour a précisé dans l’arrêt Beuze, précité, § 124, que le point de départ du droit d’accès à un avocat en cas de privation de liberté ne fait pas de doute. Ce droit est applicable dès l’« accusation en matière pénale » et, en particulier, dès l’arrestation d’un suspect, indépendamment du fait que l’intéressé ait ou non été interrogé ou qu’il ait fait l’objet d’une autre mesure d’enquête pendant la période pertinente.
39. Dans Simeonovi, précité, § 111, elle a également précisé qu’une personne soupçonnée, interrogée sur son implication dans des faits constitutifs d’une infraction pénale peut être considérée comme « accusée » et prétendre à la protection de l’article 6 de la Convention (voir également Aleksandr Zaichenko c. Russie, no 39660/02, §§ 41-43, 18 février 2010, Yankov et autres c. Bulgarie, no 4570/05, § 23, 23 septembre 2010, et Ibrahim et autres, précité, § 296).
40. De même, une personne simplement interrogée après avoir été appelée à donner des renseignements peut se prévaloir des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention déjà à ce stade de la procédure, en fonction de la manière dont l’interrogatoire est conduit (Schmid-Laffer c. Suisse, no 41269/08, §§ 28 à 31, 16 juin 2015).
41. Par ailleurs, dans l’arrêt Stojkovic c. France et Belgique, no 25303/08, § 55, 27 octobre 2011, qui concernait le cas particulier d’une audition de témoin assisté dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, la Cour a également relevé que le régime juridique de l’audition litigieuse ne dispensait pas les autorités françaises de vérifier par la suite si elle avait été accomplie en conformité avec les principes fondamentaux tirés de l’équité du procès et d’y apporter, le cas échéant, remède.
b) Application au cas d’espèce
42. S’agissant de l’audition libre, telle qu’elle est prévue en droit français, la Cour considère qu’une personne suspectée d’avoir commis une infraction, convoquée et interrogée par un officier de police ou de gendarmerie, doit également être regardée comme « accusée » au sens de l’article 6 de la Convention même si cette audition n’est pas effectuée sous contrainte. En effet, en premier lieu, il n’est procédé à son audition libre que parce que et dans la mesure où, ainsi qu’il lui a été notifié, il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En deuxième lieu, la circonstance que la personne auditionnée soit en principe libre de mettre fin à l’audition à tout moment et de quitter les lieux ne suffit pas à compenser la situation d’asymétrie structurelle dans laquelle, en pratique, elle se trouve placée à l’égard des enquêteurs et des autorités chargées de l’interroger. En troisième et dernier lieu, à l’issue d’une audition libre, comme à l’issue d’une garde à vue, les autorités de police judiciaire sont susceptibles de disposer d’éléments de nature à confirmer ou non leurs soupçons (voir, mutatis mutandis, Brusco c. France, no 1466/07, § 47, 14 octobre 2010).
43. En l’espèce, la Cour note que la requérante a fait l’objet d’une audition libre d’une durée d’une heure et quinze minutes, le 25 janvier 2013, dans les locaux de la gendarmerie. À cette occasion, elle a été informée du fait qu’il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner գս’elle avait commis ou tenté de commettre le délit d’exercice illégal de la profession de médecin. La Cour en déduit, à l’instar des parties (voir paragraphe 35 ci-dessus), que la requérante doit être regardée comme « accusée » au sens de l’article 6 de la Convention.
c) Conclusion
44. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
ARTICLE 6 §1 ET § 3
Principes généraux
63. S’agissant des droits minimaux garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, la Cour renvoie aux principes généraux maintes fois réaffirmés par elle (Salduz, précité, §§ 50 à 55, Ibrahim et autres, précité, §§ 249 à 274, Simeonovi, précité, §§ 110 à 120 et rappelés dans Beuze, précité, §§ 119 à 150 et dans Bloise c. France, no 30828/13, §§ 45 à 49, 11 juillet 2019).
64. Elle souligne en particulier que, quelle que soit la restriction concernée, même si cette dernière découle directement de la loi applicable, elle procède à un examen en deux étapes : d’une part, en vérifiant tout d’abord l’existence ou non de raisons impérieuses, puis, d’autre part, en examinant l’équité du procès dans son ensemble. Par ailleurs, si l’absence de raisons impérieuses ne suffit pas à entraîner une violation de l’article 6, elle entraîne un contrôle très strict de la Cour, dès lors qu’une telle absence pèse lourdement dans la balance lorsqu’il s’agit d’apprécier globalement l’équité du procès, ce qui peut faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation (Beuze, précité, § 145). Tel est d’autant plus le cas lorsqu’il y a cumul du défaut d’accès à un avocat et du défaut de notification des droits, en particulier du droit de garder le silence : le gouvernement, à qui il incombe d’expliquer de façon convaincante pourquoi, à titre exceptionnel et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la restriction à l’accès à un avocat n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès, pourra alors plus difficilement prouver que le procès a été équitable.
65. Par ailleurs, dans l’arrêt Beuze (précité), la Cour a précisé que la désignation d’un conseil doit impérativement s’accompagner des deux exigences minimales suivantes : d’une part, le suspect doit pouvoir entrer en contact avec son avocat dès sa privation de liberté, ce qui implique qu’il puisse consulter son avocat préalablement à un interrogatoire, voire en l’absence d’un interrogatoire et que l’avocat puisse s’entretenir avec lui en privé et en recevoir des instructions confidentielles (Simeonovi, précité, § 111, et Beuze, précité, § 133) ; d’autre part, le suspect doit également bénéficier de la présence physique de son avocat durant les auditions initiales menées par la police et durant les interrogatoires ultérieurs menés au cours de la procédure antérieure à la phase de jugement, cette présence devant permettre à l’avocat de fournir une assistance effective et concrète, notamment pour éviter les atteintes aux droits de la défense, et non seulement abstraite (ibidem, § 134).
66. Enfin, s’agissant des déclarations du suspect, elle rappelle que le droit de ne pas s’incriminer soi‑même ne se limite pas aux aveux au sens strict ou aux remarques le mettant directement en cause : il suffit, pour qu’il y ait auto‑incrimination, que ses déclarations soient susceptibles d’affecter substantiellement sa position de celui-ci, à l’instar de déclarations circonstanciées qui orientent la conduite des auditions et interrogatoires, qui affectent la position du suspect ou sa crédibilité (Beuze, précité, §§ 178 et 179).
67. La Cour renvoie aux facteurs non limitatifs qu’elle a retenus lorsqu’elle examine la procédure dans son ensemble de manière à mesurer les conséquences de lacunes procédurales survenues au stade de l’enquête ou durant la phase préalable au procès sur l’équité globale du procès pénal, qu’elle a énoncés dans Ibrahim (précité, § 274) et qu’elle a repris dans Simeonovi et dans Beuze (précités, respectivement § 120 et § 150).
68. Ensuite, s’agissant particulièrement du droit à l’assistance d’un interprète, la Cour a rappelé dans l’affaire Baytar c. Turquie, no 45440/04, §§ 48 à 50, 14 octobre 2014, que, selon sa jurisprudence, les exigences du paragraphe 3 e) de l’article 6 de la Convention s’analysant en des éléments particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 de cet article, il convient d’examiner le grief sous l’angle des deux paragraphes combinés.
69. Elle a précisé dans cette affaire que l’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant sa version des événements (Güngör c. Allemagne (déc.), no 31540/96, 17 mai 2001).
70. En outre, la décision d’un accusé de faire usage ou de renoncer aux droits garantis par l’article 6 § 3 c) ne peut être prise que s’il comprend de manière claire les faits qui lui sont reprochés pour pouvoir mesurer les enjeux de la procédure et apprécier l’opportunité d’une éventuelle renonciation. De plus, pour avoir un sens, la notification du droit à un interprète ainsi que des autres droits fondamentaux de la défense doit être faite dans une langue que le requérant comprend (Vizgirda c. Slovénie, no 59868/08, § 87, 28 août 2018).
71. Dans l’arrêt Knox c. Italie (no 76577/13, §§ 182 et 183, 24 janvier 2019), la Cour a ajouté que le droit ainsi garanti doit être concret et effectif. L’obligation des autorités compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète : il leur incombe en outre, une fois alertées dans un cas donné, d’exercer un certain contrôle ultérieur de la valeur de l’interprétation assurée. Elle a également précisé que, tout comme l’assistance d’un avocat, celle d’un interprète doit être garantie dès le stade de l’enquête, sauf à démontrer qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit (voir, en ce sens, Diallo c. Suède (déc.), no 13205/07, § 25, 5 janvier 2010, Baytar, précité, §§ 50 et suivants, 14 octobre 2014, et Şaman c. Turquie, no 35292/05, § 30, 5 avril 2011).
72. La Cour rappelle enfin qu’un défaut d’assistance par un interprète au stade initial de la procédure est susceptible d’aggraver la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve placée une personne interrogée dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle et peut être considéré comme un défaut ayant des répercussions sur d’autres droits qui, tout en étant distincts, y sont étroitement liés, compromettant ainsi l’équité de la procédure dans son ensemble (voir Baytar, précité, § 55, et Knox, précité, § 187).
b) Application au cas d’espèce
73. La Cour note qu’à l’époque des faits, en matière d’audition libre, la législation française en vigueur ne prévoyait pas le droit de garder le silence, le droit à l’assistance d’un avocat ou encore le droit à l’assistance d’un interprète, contrairement à ce qui était prévu pour la garde à vue (voir paragraphes 23 et suivants ci-dessus).
74. Informée de son droit de mettre fin à l’audition à tout moment, dans le respect du droit en vigueur à l’époque, la requérante a consenti à être entendue librement. En revanche, elle ne s’est pas vu explicitement offrir la possibilité de garder le silence. L’assistance d’un avocat et d’un interprète ne lui a pas été davantage proposée.
75. À la lumière des considérations figurant aux paragraphes 42 et 43 ci-dessus, la Cour estime que même si, en principe, la requérante pouvait quitter les lieux à tout moment, dans la pratique, elle se trouvait, de manière analogue à un suspect placé en garde à vue, dans une situation asymétrique, seule face aux questions des enquêteurs, sans l’assistance d’un interprète.
76. La Cour prend acte notamment de l’intervention postérieure, et dès lors sans effet concret sur la situation de la requérante, des réformes législatives, qui ont largement renforcé les droits de la personne auditionnée librement, pour aboutir, à l’heure actuelle, à un régime quasiment identique à celui de la garde à vue (voir paragraphes 27 et suivants ci-dessus).
77. Ainsi, il n’est pas contesté que les restrictions litigieuses aux garanties posées par l’article 6 résultaient de la loi française applicable au moment des faits. Or, la Cour a rappelé, s’agissant en particulier des restrictions à l’accès à un avocat pour des raisons impérieuses, qu’elles ne sont permises durant la phase préalable au procès que dans des cas exceptionnels, et qu’elles doivent être de nature temporaire et reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d’espèce (Beuze, précité, § 161, s’agissant d’une personne placée en garde à vue). Tel n’a clairement pas été le cas en l’espèce.
78. En outre, le Gouvernement, auquel il appartenait, contrairement à ce qu’il soutient, d’avancer des raisons impérieuses (voir paragraphe 56 ci-dessus), n’a pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier les restrictions dont a fait l’objet le droit de la requérante et il n’appartient pas à la Cour d’en chercher de son propre chef (Simeonovi, précité, § 130, et Beuze, précité, § 163). Aucune raison impérieuse ne justifiait donc en l’espèce les restrictions susmentionnées.
79. Dans ces conditions, la Cour doit évaluer l’équité de la procédure en exerçant un contrôle très strict et ce, à plus forte raison dans le cas de restrictions d’origine législative ayant une portée générale (Olivieri c. France, no 62313/12, § 33, 11 juillet 2019 et Bloise, précité, § 52). La charge de la preuve pèse ainsi sur le Gouvernement, qui doit démontrer de manière convaincante que la requérante a néanmoins bénéficié globalement d’un procès pénal équitable (Beuze, précité, § 165).
80. Il revient à présent à la Cour de rechercher, au regard des différents facteurs découlant de sa jurisprudence tels qu’ils ressortent des arrêts Ibrahim et autres, Simeonovi et Beuze (précités, respectivement §§ 274, 120 et 150), et dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, si, combiné à la circonstance que la requérante n’a pas été mise à même de pouvoir garder le silence, le fait d’avoir été privée de la possibilité d’être assistée d’un interprète a ou non affecté l’équité de la procédure dans son ensemble. La Cour estime important de souligner, comme elle l’a fait dans d’autres affaires relatives à l’article 6 § 1 de la Convention dans lesquelles un examen de l’équité globale de la procédure était en cause, qu’elle ne doit pas s’ériger en juge de quatrième instance. Lors de cet examen, elle est toutefois appelée à examiner soigneusement le déroulement de la procédure au niveau interne.
81. Alors même que la requérante, qui se borne à invoquer sans plus de précision l’existence d’une contrainte psychologique, n’allègue pas avoir subi de pression particulière de la part de l’enquêteur lors de son interrogatoire, qui a été mené sans contrainte et qui a été de courte durée, la Cour considère, à la lumière des éléments relevés aux paragraphes précédents, qu’elle se trouvait placée dans une situation de vulnérabilité (voir en ce sens, pour la vulnérabilité inhérente à la qualité de suspect mutatis mutandis, Salduz, précité, § 54 et Beuze, précité, §§ 126 et 127 ; s’agissant de l’assistance d’un interprète Knox c. Italie, no 76577/13, § 160, 24 janvier 2019 et a contrario Doyle c. Irlande, no 51979/17, § 85, 23 mai 2019).
82. En effet, si la cour d’appel a considéré que la lecture du procès-verbal d’audition libre laissait penser que le niveau de français de la requérante était suffisant pour comprendre les enjeux de la procédure (voir paragraphe 7 ci-dessus), la Cour relève, en sens contraire, que tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel ont estimé lors des audiences que la requérante ne maîtrisait pas suffisamment le français pour pouvoir se passer de l’assistance d’un interprète (voir paragraphes 10 et 15 ci-dessus).
83. Elle en déduit, alors même que les faits reprochés n’étaient pas d’une complexité particulière que la requérante, interrogée dans une langue qui n’était pas sa langue maternelle, sans bénéficier de l’assistance d’un avocat, n’était pas, ainsi qu’elle le fait valoir, parfaitement à même de saisir l’objet et la portée de la procédure engagée à son encontre (voir paragraphe 48 ci-dessus). La Cour doute en particulier qu’elle ait pu valablement comprendre, à ce stade de la procédure, dans quelle mesure son audition et ses déclarations pouvaient avoir des répercussions importantes sur la situation (voir, en ce sens, Baytar, précité, § 55, Vizgirda, précité, § 87 et Knox, précité, § 187).
84. Bien plus, la Cour constate qu’au cours de l’audition libre, la requérante, qui n’avait pas été mise à même de bénéficier de la possibilité de garder le silence, a décrit, de manière précise et détaillée, la pratique de son activité, qui était en elle-même constitutive de l’infraction qui lui était reprochée (voir paragraphe 7 ci-dessus). Elle en déduit que celle-ci doit dès lors être regardée comme s’étant auto-incriminée au sens de la jurisprudence de la Cour (Beuze, précité, §§ 178 et 179), alors même que, dans la suite de la procédure, elle a maintenu ses déclarations.
85. La Cour doit à présent rechercher si les restrictions litigieuses aux droits garantis ont été compensées de telle manière que la procédure peut être considérée comme ayant été équitable dans son ensemble (Beuze, précité, § 165). Pour ce faire, elle doit vérifier si les juridictions internes ont procédé à l’analyse nécessaire de l’incidence de l’absence d’un interprète et du défaut de notification du droit de garder le silence à un moment crucial de la procédure.
86. En premier lieu, il est vrai que la requérante a pu, dans les phases ultérieures de la procédure, valablement se défendre et faire valoir ses arguments avec le concours d’un avocat et d’un interprète, d’abord devant les juridictions du fond, notamment pour discuter des différents éléments de preuve, en première instance comme en appel, dans le cadre du recours qui lui était ouvert et qu’elle a pu exercer, puis devant la Cour de cassation, qui était saisie de son pourvoi. Cette dernière a examiné les moyens soulevés par la requérante avant de rejeter le pourvoi.
87. Pour autant, la Cour relève, en deuxième lieu, que les exceptions de nullité de la procédure soulevées par la requérante ont toutes été rejetées par les juges du fond.
88. En troisième lieu, la Cour prend note qu’alors même que la cour d’appel a rappelé que lorsqu’une personne a été entendue sans l’assistance effective d’un avocat ou en l’absence de notification de son droit de se taire, une décision de condamnation ne peut être fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de son interrogatoire, tel n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, en dépit du rappel de principe effectué par la cour d’appel, cette dernière a placé les déclarations de la requérante recueillies au cours de l’audition libre au fondement même de son raisonnement, avant de prononcer sa condamnation. En outre, la Cour relève que les témoignages produits, pour la défense de la requérante, ont été utilisés pour établir sa culpabilité. Il apparaît ainsi que, d’une part, les déclarations recueillies lors de l’audition libre et, d’autre part, les témoignages qu’elle avait cru devoir produire à l’issue de celle-ci ont constitué une partie intégrante et importante des éléments de preuve sur lesquelles a reposé la condamnation de la requérante.
89. La Cour considère qu’en l’espèce, c’est la conjonction des différents facteurs précités et non chacun d’eux pris isolément qui a rendu la procédure inéquitable dans son ensemble (Beuze, précité, § 194, Olivieri, précité, § 40) : la situation dans laquelle l’absence d’assistance d’un interprète lors de l’interrogatoire a placé la requérante, le défaut de notification expresse du droit de garder le silence qui a contribué à ce qu’elle s’auto-incrimine, la part déterminante prise, dans l’issue de la procédure pénale, par les déclarations recueillies lors de l’audition libre et les témoignages produits à sa suite.
90. Compte tenu de tout ce qui précède et du contrôle strict auquel elle doit procéder en l’absence de raisons impérieuses, la Cour conclut que la procédure pénale menée à l’égard de la requérante, considérée dans son ensemble, n’a pas permis de remédier aux graves lacunes procédurales survenues pendant l’audition libre.
91. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
DE LA RÉFORME DE LA GARDE A VUE
Comme nous l'avions annoncé sur ce site dès 2009, toutes les gardes à vue sans assistance d'un avocat alors que le justiciable a demandé, la présence d'un avocat durant la garde à vue, sont annulées. Par conséquent, les procès verbaux signés durant la garde à vue sont aussi annulés.
Nous pensions que la CEDH les aurait toutes annulées. La Cour de Cassation le fait à sa place comme le démontre les arrêts du 31 mai 2011 reproduits ci dessous.
La LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 devait être appliquée le 1er juin 2011 selon la loi, mais la Cour de Cassation a décidé son application immédiate, dès le 15 avril 2011 sans attendre la règle d'un jour franc, puisque la loi est parue dans le JO du 15 avril 2011, pour assurer la sécurité juridique et éviter les sanctions de la CEDH.
Voici le communiqué de la Première Présidence de la Cour de Cassation sur les Décisions de l’assemblée plénière du 15 avril 2011
Par quatre arrêts rendus le 15 avril 2011 (n° P 10- 17.049, F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10-30.242), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à l’assistance effective d’un avocat.
La première chambre civile, saisie de ces affaires, les avait renvoyées devant l’assemblée plénière à la demande du procureur général, ce renvoi étant de droit.
Quatre personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière ont été interpellées puis placées en garde à vue, l’une pour vol, les trois autres pour infraction à la législation sur les étrangers. A l’issue de ces gardes à vue, un arrêté de reconduite à la frontière puis une décision de placement en rétention ont été pris à leur encontre. Le préfet ayant saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention, les personnes retenues ont contesté la régularité de la procédure en soutenant qu’elles n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire. Statuant sur l’appel interjeté contre les décisions du juge qui avaient soit ordonné, soit refusé d’ordonner la prolongation de ces mesures de rétention, le premier président de la cour d’appel de Lyon a considéré la procédure régulière (dossier n° P 10-17.049), tandis que le premier président de la cour d’appel de Rennes l’a jugée irrégulière (dossiers n° F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10-30.242).
Les pourvois qui ont été formés dans le premier dossier par la personne retenue et dans les trois autres par le procureur général près la cour d’appel de Rennes, ont conduit l’assemblée plénière à statuer sur deux questions.
La première porte sur le point de savoir si les dispositions de l’article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont conformes ou non à l’article 6 de la Convention européenne. L’assemblée plénière, reprenant la solution retenue par la chambre criminelle dans ses arrêts du 19 octobre 2010, a constaté que les règles posées par l’article 63-4 du code de procédure pénale ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 6 § 1. Elle a énoncé que “pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires”.
La deuxième question a trait à l’effet immédiat ou différé de la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne. Après avoir rappelé que “les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation”, la plus haute formation de la Cour de cassation, en censurant la décision ayant admis la régularité de la procédure et en rejetant le pourvoi formé contre les trois autres qui avaient retenu son irrégularité, a décidé une application immédiate. Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.
LES QUATRE ARRÊTS DE L'ASSEMBLEE PLENIERE
Donne acte au syndicat des avocats de France de son intervention ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale ;
Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité comorienne en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 1er mars 2010 à compter de 11 heures 30 ; qu’elle a demandé à s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; qu’elle a été entendue par les fonctionnaires de police de 12 heures 30 à 13 heures 15 ; qu’elle s’est entretenue avec un avocat de 14 heures 10 à 14 heures 30 ; que le préfet du Rhône lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention le même jour à 15 heures 30 ; qu’il a saisi un juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée maximale de 15 jours à compter du 3 mars 2010 à 15 heures 30 ; qu’ayant interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait accueilli la demande, Mme X....a soutenu qu’elle n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant son interrogatoire par les fonctionnaires de police ;
Attendu que pour prolonger la rétention, l’ordonnance retient que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ne lient que les Etats directement concernés par les recours sur lesquels elle statue, que ceux invoqués par l’appelante ne concernent pas l’Etat français, que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas que toute personne interpellée ne puisse être entendue qu’en présence de son avocat et que la garde à vue, menée conformément aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, ne saurait être déclarée irrégulière ;
Qu’en statuant ainsi alors que Mme X.... n’avait eu accès à un avocat qu’après son interrogatoire, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger
Donne acte au syndicat des avocats de France de son intervention ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, (Rennes, 18 décembre 2009), rendue par le premier président d’une cour d’appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, qui avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 16 septembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière, a été interpellé, à Nantes, le 14 décembre 2009, à 18 heures 10, sous une fausse identité ; qu’il a été placé en garde à vue à 18 heures 40, pour vol et séjour irrégulier ; qu’il a demandé à s’entretenir avec un avocat commis d’office ; qu’à 20 heures 05, la permanence des avocats a été prévenue par téléphone ; que M. X... a été entendu de 20 heures 10 à 20 heures 30 ; qu’il s’est entretenu avec un avocat de 20 heures 50 à 21 heures 05 ; que la garde à vue a été levée le 15 décembre 2009, à 16 heures 55, et qu’il a été placé en rétention administrative à 17 heures ; que le préfet a saisi un juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention ; que M. X... a interjeté appel de la décision ayant accueilli cette demande, en soutenant qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant son interrogatoire ;
Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Rennes fait grief à l’ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d’ordonner la mise en liberté de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que de l’article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu’en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisqu’aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat, au besoin commis d’office par le bâtonnier ; que s’il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l’avocat qui est informé de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, peut toutefois s’entretenir avec le gardé-à-vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien et qu’à l’issue de cet entretien, d’une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
2°/ qu’aucune disposition de procédure pénale, d’une part, n’impose à l’officier de police judiciaire de différer l’audition d’une personne gardée à vue dans l’attente de l’arrivée de l’avocat assurant l’entretien prévu, d’autre part n’exige de l’avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu’il informe l’officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d’intervenir ou non et de l’éventuel moment de son intervention ;
Mais attendu qu’après avoir retenu qu’aux termes de ses arrêts Salduz c./ Turquie et Dayanan c./Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant ses interrogatoires, le premier président qui a relevé que, alors que M. X... avait demandé à s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l’arrivée de l’avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n’était pas régulière et décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 25 janvier 2010), rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que Mme Y..., de nationalité kenyane, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 22 janvier 2010 à compter de 8 heures 15 ; qu’elle a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; que l’avocat de permanence en a été informé à 8 heures 35 ; que Mme Y... a été entendue par les militaires de la gendarmerie de 9 heures 45 à 10 heures 10, puis de 10 heures 25 à 10 heures 55 ; qu’elle s'est entretenue avec un avocat à une heure non précisée ; que le préfet des Deux-Sèvres lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 22 janvier 2010 ; qu’il a saisi un juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention ; que Mme Y... a soutenu qu’elle n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de sa garde à vue et pendant son interrogatoire ; que le procureur général près la cour d’appel a interjeté appel de la décision ayant déclaré la procédure de garde à vue irrégulière ;
Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Rennes fait grief à l’ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d’ordonner la mise en liberté de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1° que par application de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un Etat n’est tenu que de se conformer aux décisions rendues dans les litiges auxquels il est directement partie ;
2°/ que, de l’article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu’en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisque, aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat, au besoin commis d’office par le bâtonnier ; que s’il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l’avocat qui est informé de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, peut toutefois s’entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien et qu’à l’issue de cet entretien, d’une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
3°/ qu’aucune disposition de procédure pénale, d’une part, n’impose à l’officier de police judiciaire d’indiquer l’heure à laquelle l’entretien avec l’avocat se déroulait, d’autre part, ne l’oblige à différer l’audition d’une personne gardée à vue dans l’attente de l’arrivée de l’avocat assurant l’entretien prévu, et enfin n’exige de l’avocat désigné pour assister le gardé à vue qu’il informe l’officier de police judiciaire et le gardé à vue de sa décision d’intervenir ou non et de l’éventuel moment de son intervention ;
Mais attendu que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ;
Et attendu qu’après avoir retenu qu’aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, le premier président qui a relevé, qu’en l’absence d’indication de l’heure à laquelle Mme Y... avait pu s’entretenir avec un avocat, il était impossible de savoir si elle avait bénéficié des garanties prévues à l’article 6 § 3, a pu en déduire que la procédure n’était pas régulière, et décider qu’il n’y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 25 janvier 2010), rendue par le premier président d’une cour d’appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 19 janvier 2010 à 16 heures ; qu’elle a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; que l’avocat de permanence en a été informé à 16 heures 30 ; que Mme X... a été entendue par les services de police de 16 heures 30 à 17 heures 10 ; qu’elle s'est entretenue avec un avocat de 17 heures 15 à 17 heures 45 ; que le préfet de la Vienne lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 20 janvier 2010 ; que ce dernier a saisi un juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention ; que Mme X... a soutenu qu’elle n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de sa garde à vue et pendant son interrogatoire ; que le procureur général près la cour d’appel a interjeté appel de la décision ayant constaté l’irrégularité de la procédure ;
Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Rennes fait grief à l’ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d’ordonner la mise en liberté de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un Etat n’est tenu que de se conformer aux décisions rendues dans les litiges auxquels il est directement partie ;
2°/ que, de l’article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu’en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisque, aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat, au besoin commis d’office par le bâtonnier ; que s’il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l’avocat, qui est informé de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, peut toutefois s’entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien et qu’à l’issue de cet entretien, d’une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
3°/ qu’aucune disposition de procédure pénale, d’une part, n’impose à l’officier de police judiciaire de différer l’audition d’une personne gardée à vue dans l’attente de l’arrivée de l’avocat assurant l’entretien prévu, d’autre part, n’exige de l’avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu’il informe l’officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d’intervenir ou non et de l’éventuel moment de son intervention ;
Mais attendu que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ;
Et attendu qu’après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, le premier président, qui a relevé que, alors que Mme X... avait demandé à s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l’arrivée de l’avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n’était pas régulière, et décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi
LA COUR DE CASSATION ANNULE LES GARDES A VUE ANTERIEURES AU 14 AVRIL 2011
Toutes les gardes à vue avant le 14 avril 2011 sont annulées si vous avez demandé l'assistance d'un avocat.
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 31 mai 2011 Pourvoi N°10-88809 ANNULATION
La requête date du 15 mars 2010 !
Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme
Attendu qu’il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des agents des douanes exerçant leur droit général de visite ont procédé, lors d’un contrôle routier, à la fouille du véhicule automobile, immatriculé en Lituanie et conduit par M. X..., son propriétaire ; qu’ils ont saisi une quantité importante de résine de cannabis dissimulée dans une cache spécialement aménagée dans le dos de la banquette arrière de ce véhicule ; qu’ils ont également relevé des indices de participation à un trafic de stupéfiants commis en bande organisée, corroborés par l’interpellation, quelques kilomètres plus loin, d’un second automobiliste lituanien ; que, placé en retenue douanière puis en garde à vue, M. X... a été mis en examen des chefs ci-dessus spécifiés
Attendu que, pour écarter l’exception de nullité des procès-verbaux établis dans le cadre de la retenue douanière puis de la garde à vue ainsi que des actes subséquents, présentée par requête du 15 mars 2010 et prise de la violation, par les articles 323 du code des douanes et 63 et suivants du code de procédure pénale, de l’article 6 § 3 de la Convention susvisée, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de rétention douanière puis de garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces actes puis de procéder ainsi qu’il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé
D’où il suit que l’annulation est encourue.
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 31 mai 2011 Pourvoi N°10-80034 ANNULATION PARTIELLE
La garde à vue a eu lieu courant 2010 !
Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme
Attendu qu’il se déduit de ce texte, que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de son interpellation en flagrant délit pour contrebande de stupéfiants, Mme X... a été placée en retenue douanière puis en garde à vue
Attendu que, pour écarter la requête en nullité de ces mesures et des actes qui en ont été la suite, prise par Mme X... de l’absence de notification du droit de se taire et de la privation du droit à l’assistance immédiate et effective d’un avocat, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de rétention douanière puis de garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces actes puis de procéder ainsi qu’il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé
D’où il suit que l’annulation est encourue de ce chef.
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 31 mai 2011 Pourvoi N°10-88293 ANNULATION
La garde à vue a eu lieu le 24 juillet 2009 !
Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme
Attendu qu’il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire, et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., placée en garde à vue le 24 juillet 2009 à 14 h 30, dans une enquête ouverte sur des faits de violation de domicile, menaces de mort et dégradations, a pu s’entretenir avec son avocat, de 15 h 20 à 15 h 50, avant d’être entendue à deux reprises par les enquêteurs, de 16 h 35 à 17 h 20 ; qu’il a été mis fin à la garde à vue le même jour, à 18 heures ; que le tribunal correctionnel, devant lequel Mme X... a comparu suivant la procédure prévue par l’article 394 du code de procédure pénale, a, après avoir écarté l’exception de nullité soulevée par la prévenue, relaxé celle-ci du chef de violation de domicile, l’a déclarée coupable des autres chefs de prévention et a prononcé sur les intérêts civils ; qu’appel a été interjeté de cette décision
Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation des procès-verbaux d’audition de Mme X..., qui faisait valoir qu’elle n’avait pu bénéficier de l’assistance de son avocat au cours de la garde à vue, notamment lorsqu’elle avait été entendue par les enquêteurs, l’arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il
lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de
la garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces auditions et, le cas échéant,
d’étendre les effets de cette annulation aux actes dont les auditions étaient le
support nécessaire, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que l’annulation est encourue de ce chef
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 31 mai 2011 Pourvoi N°10-81412 ANNULATION
La garde à vue a eu lieu le 28 mars 2010 !
Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme
Attendu qu’il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit , dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel le mis en examen soutenait n’avoir pas eu l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces actes puis de procéder ainsi qu’il est prescrit par Ies articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé
D’où il suit que l’annulation est encourue
LA GARDE A VUE D'UN MINEUR EST ANNULEE PARTIELLEMENT
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 31 mai 2011 Pourvoi N°11-81459 REJET
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-4 et 64
du code de procédure pénale et l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans
une enquête suivie du chef de destruction d'un véhicule automobile par incendie,
Kevin X..., âgé de quinze ans, a été placé en garde à vue le 22 juillet 2010 ;
qu'il a pu s'entretenir confidentiellement avec un avocat préalablement à ses
auditions par les services de police ; que, mis en examen du chef de ce délit,
le 5 novembre 2010, il a déposé, le 14 décembre 2010, une requête aux fins
d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents
aux motifs que, lors de cette mesure, il n'avait pas été informé de son droit de
garder le silence et que, durant les actes accomplis au cours de celle-ci, il
n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, et ce contrairement aux
exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Attendu que, pour accueillir partiellement la requête et annuler certains
procès-verbaux de la garde à vue, en particulier ceux des auditions intervenues
pendant celle-ci, l'arrêt retient, notamment, que le droit de ne pas
s'incriminer, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme, exige, pour être effectif, une information préalable et
adéquate du suspect, laquelle implique la notification à celui-ci du droit au
silence, et son assistance effective par un avocat durant ses auditions
Que les juges ajoutent que "cette nécessité devient impérieuse lorsque la
personne privée de sa liberté d'aller et venir est, comme en l'espèce, un mineur
âgé de quinze ans
Attendu qu'en prononçant par ces motifs exempts d'insuffisance comme de
contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision
LA COUR DE CASSATION APPLIQUAIT AUPARAVANT LA THEORIE
DE LA LOI DITE PARAVENT QUI EMPÊCHE LA CEDH DE S'APPLIQUER
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, Audience publique du 4 janvier 2010 Pourvoi n° 10-85520 REJET
Sur le premier moyen de cassation, pris de
la violation des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale et
de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...
a fait l'objet d'une enquête sur les circonstances dans lesquelles il avait, au
cours de la nuit du 16 au 17 novembre 2009, à Voreppe (Isère), attiré des
gendarmes dans une embuscade en leur signalant d'une cabine téléphonique un
incendie de voiture imaginaire, et ainsi permis à l'un de ses co-auteurs de
tirer sur leurs véhicules avec un pistolet à air comprimé ; qu'il a été placé en
garde à vue le 18 novembre 2009 à 6 heures 15, l'avocat qu'il avait désigné
ayant été avisé à 6 heures 25 ; qu'il a reçu notification de ses droits de 7
heures 15 à 7 heures 30, a été entendu le même jour de 8 heures 15 à 10 heures
30 et s'est entretenu avec un avocat de 11 heures 15 à 11 heures 35, après sa
première audition ; qu'à l'issue de sa garde à vue, il a été traduit, le 20
novembre 2009, selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal
correctionnel, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 février 2010, en le
plaçant sous contrôle judiciaire
Attendu qu'à cette date, le tribunal correctionnel, saisi par le prévenu d'une
requête tendant à l'annulation de la procédure, a, par jugement avant-dire
droit, prononcé la nullité de la garde à vue en raison de l'absence d'assistance
effective d'un avocat, ainsi que de l'audition et de la perquisition accomplies
pendant la durée de cette mesure, mais validé le procès-verbal par lequel le
procureur de la République l'avait saisi ; que ce dernier et le requérant ont
interjeté appel de cette décision
Attendu qu'après avoir confirmé l'annulation prononcée, l'arrêt retient, pour
refuser d'en étendre les effets à l'ensemble de la procédure, qu'avant de se
présenter au domicile de M. X... et de l'interpeller, les enquêteurs disposaient
d'un témoignage désignant formellement l'immeuble d'où étaient partis les coups
de feu, avaient identifié sa voix sur l'enregistrement de l'alerte conservé au
centre opérationnel de la gendarmerie, et avaient intercepté sur un service
d'hébergement et de partage de vidéos en ligne, un film le représentant avec une
arme ; que la cour d'appel déduit de ces constatations que la garde à vue et les
procès-verbaux d'audition et de perquisition annulés ne sont pas le support
nécessaire des poursuites
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la nullité de la
garde à vue avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la
décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime
juridique de la garde à vue ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet
2011, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il a eu pour seule
conséquence que les actes annulés n'ont pas constitué des éléments de preuve
fondant la décision de culpabilité du prévenu
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'EST PAS UNE AUTORITE JUDICIAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 5-3 DE LA CONVENTION
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, Audience publique du 15 décembre 2010 Pourvoi n° 10-83674 REJET
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage ; que cette mesure a été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et a pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui a eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile
Attendu que, mis en examen, M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme; que les juges ont rejeté la requête
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. X... a déclaré dès le début de la garde à vue qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat et a renouvelé ce refus lors de la prolongation de la garde à vue
Que, dès lors, le moyen manque en fait
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES sur :
- LES EMPREINTES PALMAIRES
- LA GARDE A VUE SANS AVOCAT EST INCONSTITUTIONNELLE
- LA GARDE A VUE EN MATIÈRE DE TERRORISME
- LA GARDE A VUE EN MATIÈRE DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE
Syndicat de la magistrature et autres [Placement ou maintien en détention provisoire des mineurs et relevés signalétiques sous contrainte]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 novembre 2022 par le Conseil d’État (décision n° 464528 du 29 novembre 2022), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France et l’association Gisti par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1034 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, d’une part, de l’article 397-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, et, d’autre part, du quatrième alinéa de l’article 55-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction issue de cette loi.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de la justice pénale des mineurs ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour les requérants par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, enregistrées le 16 décembre 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers et Informations sur les mineurs isolés étrangers par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour l’association Ligue des droits de l’homme par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les requérants et les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers et Informations sur les mineurs isolés étrangers, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour l’association Ligue des droits de l’homme, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 31 janvier 2023 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par la Première ministre, enregistrée le 3 février 2023 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article
397-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24
janvier 2022 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« S’il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le
tribunal renvoie le dossier au procureur de la République.
« S’il s’agit d’un mineur âgé d’au moins treize ans, le tribunal statue au
préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et
les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien
en détention provisoire jusqu’à sa comparution soit devant le juge d’instruction
spécialisé, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la
détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L. 423-6 ou
L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs. La décision est spécialement
motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à la
disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir
lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis
en liberté d’office.
« Le présent article est également applicable devant le juge des libertés et de
la détention statuant en application de l’article 396 du présent code ».
2. L’article
L. 413-16 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de
la même loi, prévoit :
« L’officier ou l’agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de
faire procéder, en application du deuxième alinéa de l’article 55-1 du code de
procédure pénale, à une opération de prise d’empreintes digitales ou palmaires
ou de photographies d’un mineur entendu en application des articles L. 412-1 et
L. 413-6 du présent code doit s’efforcer d’obtenir le consentement de ce mineur.
« Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues au
troisième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale s’il refuse de se
soumettre à cette opération.
« Lorsque les conditions prévues à l’article L. 413-17 du présent code sont
réunies, il l’informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de
procéder à cette opération sans son consentement, en application du même article
L. 413-17 ».
3. L’article
L. 413-17 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, prévoit :
« L’opération de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies
peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du
procureur de la République saisi par une demande motivée de l’officier de police
judiciaire, lorsque les conditions ci-après sont réunies :
« 1 ° Cette opération constitue l’unique moyen d’identifier le mineur qui refuse
de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité
manifestement inexacts ;
« 2 ° Le mineur apparaît manifestement âgé d’au moins treize ans ;
« 3 ° L’infraction dont il est soupçonné constitue un crime ou un délit puni
d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
« L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police
judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et
proportionnée, compte tenu de la situation particulière du mineur.
« L’avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou,
à défaut, l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-1 sont préalablement
informés de cette opération.
« Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons
pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que
le jour et l’heure auxquels il y est procédé.
« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant
été remise à l’intéressé ainsi qu’aux représentants légaux ou à l’adulte
approprié ».
4. Le
quatrième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale, dans sa
rédaction résultant de la même loi, prévoit :
« Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, lorsque la prise
d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie constitue l’unique
moyen d’identifier une personne qui est entendue en application des articles
61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans
d’emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des
éléments d’identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée
sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de
la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire.
L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police
judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de
manière proportionnée. Il tient compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la
personne. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les
raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne
ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est
transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à
l’intéressé ».
5. En premier lieu, les requérants, rejoints par les parties intervenantes, reprochent aux dispositions de l’article 397-2-1 du code de procédure pénale de permettre à la juridiction qui constate qu’un mineur a été présenté devant elle par erreur de le placer ou de le maintenir en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant une juridiction pour mineurs, quelle que soit la gravité de l’infraction qui lui est reprochée et alors même qu’elle n’est pas une juridiction spécialisée ni tenue de respecter une procédure appropriée. Il en résulterait une méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la présomption d’innocence. Par ailleurs, ces dispositions instaureraient, en méconnaissance du principe d’égalité devant la justice, une différence de traitement entre les mineurs, selon qu’ils sont directement renvoyés devant une juridiction spécialisée ou présentés devant une juridiction incompétente.
6. En second lieu, les requérants, rejoints par les parties intervenantes, reprochent aux dispositions renvoyées de l’article 55-1 du code de procédure pénale et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs d’autoriser le recours à la contrainte pour la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d’une personne entendue sous le régime de la garde à vue ou de l’audition libre, alors que ces opérations ne seraient ni nécessaires à la manifestation de la vérité ni justifiées par la gravité et la complexité des infractions. Il en résulterait une méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, de la liberté individuelle et du droit au respect de la vie privée. Ils font en outre valoir que l’application de ces dispositions aux mineurs « manifestement » âgés d’au moins treize ans serait susceptible de permettre leur mise en œuvre à l’égard de mineurs âgés de moins de treize ans, en méconnaissance de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, faute de prévoir la présence d’un avocat durant ces opérations, les dispositions renvoyées méconnaîtraient les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
7. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le dernier alinéa de l’article L. 413-16 du code de la justice pénale des mineurs, l’article L. 413-17 du même code, le quatrième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale et les deuxième et troisième alinéas de l’article 397-2-1 du même code.
- Sur les dispositions contestées de l’article 397-2-1 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, notamment, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Toutefois, ces exigences n’excluent pas que, en cas de nécessité, soient prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention.
9. L’article L. 12-1 du code de la justice pénale des mineurs donne compétence à des juridictions et chambres spécialisées pour connaître des délits commis par les mineurs. En application du premier alinéa de l’article 397-2-1 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel, saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, ou le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l’article 396 du même code, constate que la personne présentée devant lui est mineure, il se déclare incompétent et renvoie le dossier au procureur de la République.
10. Les dispositions contestées de l’article 397-2-1 du même code prévoient que, s’il s’agit d’un mineur âgé d’au moins treize ans, le tribunal ou le juge des libertés et de la détention doit préalablement statuer sur son placement ou son maintien en détention provisoire pour une durée maximale de vingt-quatre heures jusqu’à sa présentation devant la juridiction compétente.
11. En premier lieu, poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, ces dispositions ont pour objet, dans le cas où il apparaît à la juridiction saisie que le prévenu est mineur, de le maintenir à la disposition de la justice afin de garantir sa comparution à bref délai devant une juridiction spécialisée, seule compétente pour décider des mesures, en particulier éducatives, adaptées à son âge.
12. En deuxième lieu, la juridiction, après avoir entendu ses observations et celles de son avocat, ne peut ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire du mineur que si sa décision est spécialement motivée par la nécessité de garantir son maintien à la disposition de la justice. Afin d’assurer le respect des exigences constitutionnelles précitées, il lui appartient de vérifier que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, son placement ou maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire.
13. En dernier lieu, la comparution du mineur placé ou maintenu en détention devant la juridiction spécialisée, compétente pour prononcer les mesures éducatives ou les peines adaptées à son âge et à sa personnalité, doit intervenir dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut de comparution dans ce délai, le mineur est d’office remis en liberté. En outre, en vertu de l’article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, la détention doit nécessairement être effectuée soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé, soit dans un établissement garantissant la séparation entre détenus mineurs et majeurs.
14. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve mentionnée au paragraphe 12, le grief tiré de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs doit être écarté.
15. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, la présomption d’innocence ou le principe d’égalité devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la même réserve, être déclarées conformes à la Constitution.
- Sur les dispositions contestées de l’article 55-1 du code de procédure pénale et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs :
16. Il résulte des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789 le principe selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire.
17. Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.
18. L’article 55-1 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire de procéder ou faire procéder, dans le cadre d’une enquête de flagrance, aux opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police. Les articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs prévoient les conditions dans lesquelles ces opérations sont effectuées à l’égard des mineurs.
19. En application des dispositions contestées de ces articles, lorsqu’une personne majeure ou une personne mineure manifestement âgée d’au moins treize ans est entendue sous le régime de la garde à vue ou de l’audition libre, ces opérations de prise d’empreintes ou de photographies peuvent, sous certaines conditions, être effectuées sans son consentement.
20. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faciliter l’identification des personnes mises en cause au cours d’une enquête pénale. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions.
21. En deuxième lieu, il ne peut être procédé à la prise d’empreintes ou de photographies sans le consentement de l’intéressé qu’avec l’autorisation écrite du procureur de la République, qui doit être saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire. Cette autorisation ne peut être délivrée par ce magistrat que si ces opérations constituent l’unique moyen d’identifier une personne qui refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et, lorsqu’elle est mineure, d’au moins cinq ans d’emprisonnement. En outre, lorsqu’il s’agit d’une personne mineure, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit préalablement s’efforcer d’obtenir son consentement et l’informer, en présence de son avocat, des peines encourues en cas de refus de se soumettre à ces opérations et de la possibilité d’y procéder sans son consentement.
22. En troisième lieu, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ne peut recourir à la contrainte que dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée, en tenant compte, le cas échéant, de la vulnérabilité de la personne ainsi que de la situation particulière du mineur.
23. En revanche, d’une part, les opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu’elle soit mineure ou majeure, ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées, être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié.
24. D’autre part, les dispositions contestées permettent de recourir à la contrainte dans le cadre du régime de l’audition libre alors que le respect des droits de la défense dans ce cadre exige que la personne intéressée soit entendue sans contrainte et en droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue. Dès lors, les mots « 61-1 ou » figurant au quatrième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées et les dispositions de l’article L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs ne sauraient être interprétées comme s’appliquant aux mineurs entendus sous le régime de l’audition libre.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, à l’exception des mots « 61-1 ou » figurant au quatrième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale qui sont contraires à la Constitution, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée, l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou le droit à un procès équitable, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous les réserves énoncées aux paragraphes 23 et 24, être déclarées conformes à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
26. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
27. En l’espèce, d’une part, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. D’autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « 61-1 ou » figurant au quatrième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution, les dispositions suivantes :
sous la réserve énoncée au paragraphe 12, les deuxième et troisième alinéas de l’article 397-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ;
sous la réserve énoncée au paragraphe 23, le reste du quatrième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la même loi ;
sous les réserves énoncées aux paragraphes 23 et 24, l’article L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de la même loi.
Article 3. - Le dernier alinéa de l’article L. 413-16 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de la même loi, est conforme à la Constitution.
Article 4. - La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 27 de cette décision.
Article 5. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 février 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
ARTICLE 55-1 du CPP
L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
L'officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l'enregistrement, la comparaison et l'identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Sans préjudice de l'application de l'avant-dernier alinéa, lorsque la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne qui est entendue en application des "articles 61-1" (déclaré inconstititionnel)" ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d'une demande motivée par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s'il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé.
DÉPENDANCE DU PARQUET AU MINISTRE DE LA JUSTICE
Décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017
Union syndicale des magistrats [Indépendance des magistrats du parquet
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 septembre 2017
par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant
sur l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature. Selon cet article, « Les
magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs
chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la
justice. À l'audience, leur parole est libre ».
L'Union syndicale des magistrats, rejointe par plusieurs intervenants,
reprochait à ces dispositions de méconnaître le principe d'indépendance de
l'autorité judiciaire qui découle de l'article 64 de la Constitution, au motif
qu'elles placent les magistrats du parquet sous la subordination hiérarchique du
garde des sceaux, alors que ces magistrats appartiennent à l'autorité judiciaire
et devraient bénéficier à ce titre, autant que les magistrats du siège, de la
garantie constitutionnelle de cette indépendance. Pour le même motif, le
syndicat reprochait également à cet article 5 de méconnaître le principe de
séparation des pouvoirs, dans des conditions affectant le principe
d'indépendance de l'autorité judiciaire.
La décision rendue ce jour par le Conseil constitutionnel rappelle le cadre
constitutionnel en vigueur. Elle cite l'article 16 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel « Toute société dans laquelle la
garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de Constitution ». Elle rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la
Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation,
notamment en ce qui concerne les domaines d'action du ministère public. Citant
le premier alinéa de l'article 64 de la Constitution selon lequel « Le Président
de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire », le
Conseil constitutionnel juge qu'il découle de l'indépendance de l'autorité
judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe
selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection
des intérêts de la société, son action devant les juridictions. La décision cite
enfin les dispositions de l'article 64 de la Constitution selon lesquelles « les
magistrats du siège sont inamovibles », ainsi que les quatrième à septième
alinéas de l'article 65 de la Constitution sur les conditions respectives de
nomination des magistrats du siège et du parquet et l'exercice du pouvoir
disciplinaire à leur encontre.
Le Conseil constitutionnel juge qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions
que la Constitution consacre l'indépendance des magistrats du parquet, dont
découle le libre exercice de leur action devant les juridictions, que cette
indépendance doit être conciliée avec les prérogatives du Gouvernement et
qu'elle n'est pas assurée par les mêmes garanties que celles applicables aux
magistrats du siège.
Dans le cadre constitutionnel ainsi précisé conformément à sa jurisprudence
antérieure, la décision du Conseil constitutionnel contrôle la manière dont le
législateur a mis en œuvre, pour la définition des relations entre le garde des
sceaux et les magistrats du parquet, cette exigence de conciliation entre le
principe d'indépendance des magistrats du parquet et les prérogatives du Gouvernement.
D'une part, l'autorité du garde des sceaux sur les magistrats du parquet se
manifeste notamment par l'exercice de son pouvoir de nomination et de sanction.
En application de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les décrets
portant nomination aux fonctions de magistrat du parquet sont pris par le
Président de la République sur proposition du garde des sceaux, après avis de la
formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. En application de
l'article 66 de la même ordonnance, la décision de sanction d'un magistrat du
parquet est prise par le garde des sceaux après avis de la formation compétente
du Conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, en application du
deuxième alinéa de l'article 30 du code de procédure pénale, le ministre de la
justice peut adresser aux magistrats du ministère public des instructions
générales de politique pénale, au regard notamment de la nécessité d'assurer sur
tout le territoire de la République l'égalité des citoyens devant la loi.
Conformément aux dispositions des articles 39-1 et 39-2 du même code, il
appartient au ministère public de mettre en œuvre ces instructions.
D'autre part, en application du même article 30 du code de procédure pénale, le
ministre de la justice ne peut adresser aux magistrats du parquet aucune
instruction dans des affaires individuelles. En vertu de l'article 31 du même
code, le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de
la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu. En
application de l'article 33, il développe librement les observations orales
qu'il croit convenables au bien de la justice. L'article 39-3 confie au
procureur de la République la mission de veiller à ce que les investigations de
police judiciaire tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient
accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du
plaignant et de la personne suspectée. Conformément à l'article 40-1 du code de
procédure pénal, le procureur de la République décide librement de l'opportunité
d'engager des poursuites.
Pour l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que les
dispositions contestées de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958 assurent une conciliation équilibrée entre le principe d'indépendance de
l'autorité judiciaire et les prérogatives que le Gouvernement tient de l'article
20 de la Constitution. Elles ne méconnaissent pas non plus la séparation des pouvoirs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 septembre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 410403 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par l'Union syndicale des magistrats. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-680 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au
statut de la magistrature ;
- le code de procédure pénale ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le syndicat requérant, enregistrées le 18
octobre 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 19
octobre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour M. Patrick N. par Me Olivier
Le Mailloux, avocat au barreau de Marseille, enregistrées les 2 octobre et 6
novembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour le Syndicat de la
magistrature par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation, enregistrées le 19 octobre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour le syndicat Force ouvrière
Magistrats par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour
de cassation, enregistrées les 19 octobre et 6 novembre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me François Saint-Pierre, avocat au barreau de Lyon, pour le
syndicat requérant, Me Le Mailloux, pour M. Patrick N., Me Patrice Spinosi,
avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le syndicat Force
ouvrière Magistrats, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, pour le Syndicat de la magistrature, et M. Philippe Blanc, désigné
par le Premier ministre, à l'audience publique du 28 novembre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 mentionnée ci-dessus prévoit : « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. À l'audience, leur parole est libre ».
2. Le syndicat requérant, rejoint par les intervenants, reproche à ces dispositions de méconnaître le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire qui découle de l'article 64 de la Constitution, au motif qu'elles placent les magistrats du parquet sous la subordination hiérarchique du garde des sceaux, alors que ces magistrats appartiennent à l'autorité judiciaire et devraient bénéficier à ce titre, autant que les magistrats du siège, de la garantie constitutionnelle de cette indépendance. Pour le même motif, il reproche également à cet article 5 de méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, dans des conditions affectant le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire. L'un des intervenants soutient que ces dispositions méconnaissent, toujours pour le même motif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense.
- Sur les normes de référence :
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice » figurant à la première phrase de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
4. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
5. En vertu de l'article 20 de la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation, notamment en ce qui concerne les domaines d'action du ministère public.
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 64 de la Constitution : « Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ». Il découle de l'indépendance de l'autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, son action devant les juridictions.
7. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 64 de la Constitution : « Les magistrats du siège sont inamovibles ».
8. Selon les quatrième à septième alinéas de l'article 65 de
la Constitution : « La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les
nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de
premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de
grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis
conforme.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des
magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les
magistrats du parquet.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des
magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.
Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du
siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des
magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les
concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le
magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des
magistrats du siège ».
9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la Constitution consacre l'indépendance des magistrats du parquet, dont découle le libre exercice de leur action devant les juridictions, que cette indépendance doit être conciliée avec les prérogatives du Gouvernement et qu'elle n'est pas assurée par les mêmes garanties que celles applicables aux magistrats du siège.
- Sur la constitutionnalité des dispositions contestées :
10. Les dispositions contestées placent les magistrats du parquet sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de justice.
11. Cette autorité se manifeste notamment par l'exercice d'un pouvoir de nomination et de sanction du garde des sceaux à l'égard des magistrats du parquet. En application de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les décrets portant nomination aux fonctions de magistrat du parquet sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. En application de l'article 66 de la même ordonnance, la décision de sanction d'un magistrat du parquet est prise par le garde des sceaux après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, en application du deuxième alinéa de l'article 30 du code de procédure pénale, le ministre de la justice peut adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales de politique pénale, au regard notamment de la nécessité d'assurer sur tout le territoire de la République l'égalité des citoyens devant la loi. Conformément aux dispositions des articles 39-1 et 39-2 du même code, il appartient au ministère public de mettre en œuvre ces instructions.
12. En application du troisième alinéa de ce même article 30, le ministre de la justice ne peut adresser aux magistrats du parquet aucune instruction dans des affaires individuelles. En vertu de l'article 31 du même code, le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu. En application de l'article 33, il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. L'article 39-3 confie au procureur de la République la mission de veiller à ce que les investigations de police judiciaire tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. Conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République décide librement de l'opportunité d'engager des poursuites.
13. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que, devant toute juridiction, la parole des magistrats du parquet à l'audience est libre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées assurent une conciliation équilibrée entre le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et les prérogatives que le Gouvernement tient de l'article 20 de la Constitution. Elles ne méconnaissent pas non plus la séparation des pouvoirs.
15. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un procès équitable ni les droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la
justice » figurant à la première phrase de l'article 5 de l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
LA GARDE A VUE SANS AVOCAT EST INCONSTITUTIONNELLE
Mme Murielle Bolt. [Régime de la garde à vue des mineurs]
Dans l'affaire "Gregory", Murielle Bolt a été contrainte de dire, lors de sa garde à vue subie à l'âge de 15 ans, que Bernard Laroche était le prétendu coupable de l'enlèvement et de la mort du jeune Grégory Villemin. Le jeune garçon a été retrouvé mort dans la Vologne, le 16 octobre 1984. Le Conseil Constitutionnel déclare sa garde à vue inconstitutionnel :
Cependant, d'une part, l'état du droit alors en vigueur ne prévoyait aucune autre garantie légale afin d'assurer le respect des droits, notamment ceux de la défense, de la personne gardée à vue, majeure ou non. D'autre part, aucune disposition législative ne prévoyait un âge en dessous duquel un mineur ne peut être placé en garde à vue.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées permettaient que tout mineur soit placé en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures renouvelable avec comme seul droit celui d'obtenir un examen médical en cas de prolongation de la mesure. Dès lors, d'une part, le législateur, qui n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, a alors méconnu les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789. D'autre part, il a alors contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 septembre 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2090 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Murielle B. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-744 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante « dans leur rédaction en vigueur en 1984, à l'époque des faits ».
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de procédure pénale ;
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
la loi n° 51-687 du 24 mai 1951 portant modification de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour la requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 28 septembre et 17 octobre 2018 ;
les observations présentées pour M. Jean-Marie V. et Mme Christine B. épouse V., parties en défense, par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 3 octobre 2018 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 3 octobre 2018 ;
les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les parties en défense, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 23 octobre 2018 ;
Au vu des pièces suivantes :
la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 29 octobre 2018 ;
la note en délibéré présentée pour la requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrée le 31 octobre 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des articles 1er, 5, 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 mentionnée ci-dessus, dans leur rédaction résultant de la loi du 5 juillet 1974 mentionnée ci-dessus, et de l'article 10 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 mai 1951 mentionnée ci-dessus.
L'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, dans
cette rédaction, prévoit :
« Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit
ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront
justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des
mineurs.
« Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe
sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à
l'article 20-1 ».
L'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans cette
même rédaction, prévoit :
« Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les
mineurs sans information préalable.
« En cas de délit, le procureur de la République en saisira soit le juge
d'instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le
président du tribunal pour enfants.
« En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par la procédure de
flagrant délit ou par voie de citation directe ».
L'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans cette
même rédaction, prévoit :
« Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour
enfants est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des
mineurs.
« Toutefois, le procureur de la République, compétent en vertu des articles
43 et 696 du code de procédure pénale, et le juge d'instruction par lui
requis ou agissant d'office conformément aux dispositions de l'article 72 du
même code, procéderont à tous actes urgents de poursuite et d'information, à
charge par eux d'en donner immédiatement avis au procureur de la République
du siège du tribunal pour enfants et de se dessaisir de la poursuite dans le
plus bref délai.
« Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs
majeurs, il sera procédé conformément aux dispositions de l'alinéa qui
précède aux actes urgents de poursuite et d'information. Si le procureur de
la République poursuit des majeurs en flagrant délit ou par voie de citation
directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et le
transmettra au procureur de République près le tribunal du siège du tribunal
pour enfants. Si une information a été ouverte, le juge d'instruction se
dessaisira dans le plus bref délai à l'égard tant du mineur que des inculpés
majeurs au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants ».
L'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans cette
même rédaction, prévoit :
« Le juge des enfants effectuera toutes les diligences et investigations
utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de
la personnalité du mineur ainsi que les moyens appropriés à sa rééducation.
À cet effet il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans
les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de
procédure pénale. Dans ce dernier, cas il ne sera pas tenu d'observer les
dispositions des articles 114, 116 (alinéa 1er) et 118 dudit code.
« Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire
en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions
de l'article 11.
« Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la
situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les
antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à
l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.
« Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un
examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du
mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.
« Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces
mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une
ordonnance motivée.
« Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la
requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.
« Il pourra ensuite :
« 1° Par ordonnance, renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants où,
s'il y a lieu, devant le juge d'instruction ;
« 2° Par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur, s'il
estime que l'infraction n'est pas établie, soit l'admonester, soit le
remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou
à une personne digne de confiance en prescrivant, le cas échéant, qu'il sera
placé jusqu'à un âge qui n'excédera pas celui de sa majorité sous le régime
de la liberté surveillée.
« Il pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté
surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs
périodes d'épreuve dont il fixera la durée ».
L'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans cette
même rédaction, prévoit :
« Le juge d'instruction procédera à l'égard du mineur dans les formes du
chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale et
ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5, 6 de l'article 8 de la
présente ordonnance.
« Lorsque l'instruction sera achevée, le juge d'instruction, sur
réquisitions du procureur de la République, rendra l'une des ordonnances de
règlement suivantes :
« 1° Soit une ordonnance de non-lieu ;
« 2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention, une
ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou, s'il s'agit d'une
contravention de 5° classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal
pour enfants ;
« 3° Soit, s'il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de
renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;
« 4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour
enfants s'il s'agit d'un mineur de seize ans, soit, dans le cas visé à
l'article 20, l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général,
prévue par l'article 181 du code de procédure pénale.
« Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en
cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction
compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera
disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente
ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera
procédé à l'égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de
l'article 181 du code de procédure pénale ; la chambre d'accusation pourra,
soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la cour
d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs
et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs
âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants.
« L'arrêt sera rédigé dans les formes du droit commun.
« Au cas de renvoi devant la cour d'assises des mineurs, la chambre
d'accusation pourra décerner une ordonnance de prise de corps contre les
accusés mineurs ».
L'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans la
rédaction mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le juge des enfants et le juge d'instruction préviendront des poursuites
les parents, tuteur ou gardien connus. À défaut de choix d'un défenseur par
le mineur ou son représentant légal, ils désigneront ou feront désigner par
le bâtonnier un défenseur d'office. Si l'enfant a été adopté comme pupille
de la nation ou s'il a droit à une telle adoption aux termes de la
législation en vigueur, ils en donneront immédiatement avis au président de
la section permanente de l'office départemental des pupilles de la nation.
« Ils pourront charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les
personnes titulaires d'un diplôme de service social, habilités à cet effet.
« Le juge des enfants et le juge d'instruction pourront confier
provisoirement le mineur :
« 1° À ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde,
ainsi qu'à une personne digne de confiance ;
« 2° À un centre d'accueil ;
« 3° À une section d'accueil, d'une institution publique ou privée habilitée
à cet effet ;
« 4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement
hospitalier ;
« 5° À un établissement ou à une institution d'éducation, de formation
professionnelle ou de soins, de l'État ou d'une administration publique,
habilité.
« S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur justifie une
observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans
un centre d'observation institué ou agréé par le ministère de la justice.
« La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de
la liberté surveillée.
« La mesure de garde est toujours révocable ».
La requérante soutient que les dispositions mentionnées ci-dessus méconnaîtraient la présomption d'innocence et les droits de la défense garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, dès lors qu'elles permettraient, dans le cadre d'une instruction, le placement d'un mineur en garde à vue sans que celui-ci bénéficie des garanties nécessaires au respect de ses droits, notamment l'assistance d'un avocat, la notification du droit de garder le silence et l'information de son représentant légal.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 et sur les mots « procédera à l'égard du mineur dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale et » figurant au premier alinéa de l'article 9 de cette même ordonnance.
- Sur le fond :
Aux termes de l'article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance ». Aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre la recherche des auteurs d'infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et les exigences constitutionnelles protégées par l'article 9 de la même déclaration.
L'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle. Ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. Toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives. En particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
Selon les dispositions contestées de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, lorsque le juge des enfants est saisi par le procureur de la République aux fins d'instruire des faits délictuels commis par un mineur, il procède à une enquête dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale. Selon les dispositions contestées de l'article 9 de la même ordonnance, le juge d'instruction procède dans les mêmes formes lorsqu'il est saisi de faits criminels ou délictuels commis par un mineur.
En application de l'article 154 du code de procédure pénale alors applicable, lequel article figure dans le chapitre 1er du titre III du livre 1er de ce code, un officier de police judiciaire peut, dans le cadre d'une procédure d'instruction, retenir une personne à sa disposition vingt-quatre heures, délai à l'issue duquel la personne doit être conduite devant le magistrat instructeur. La garde à vue peut être prolongée, sur décision de ce magistrat, pour une durée de vingt-quatre heures. En application de l'article 64, auquel renvoie l'article 154, la personne gardée à vue bénéficie du droit d'obtenir un examen médical en cas de prolongation de la mesure.
Cependant, d'une part, l'état du droit alors en vigueur ne prévoyait aucune autre garantie légale afin d'assurer le respect des droits, notamment ceux de la défense, de la personne gardée à vue, majeure ou non. D'autre part, aucune disposition législative ne prévoyait un âge en dessous duquel un mineur ne peut être placé en garde à vue.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées permettaient que tout mineur soit placé en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures renouvelable avec comme seul droit celui d'obtenir un examen médical en cas de prolongation de la mesure. Dès lors, d'une part, le législateur, qui n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, a alors méconnu les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789. D'autre part, il a alors contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
Par conséquent, les mots « soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 et les mots « procédera à l'égard du mineur dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale et » figurant au premier alinéa de l'article 9 de cette même ordonnance doivent être déclarés contraires à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.
En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 et les mots « procédera à l'égard du mineur dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale et » figurant au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction résultant de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 19 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 novembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Décision QPC du 30 juillet 2010 n° 2010-14/22
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la
Cour de cassation (arrêt n° 12030 du 31 mai 2010), dans les conditions prévues
à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de
constitutionnalité posée par MM. Daniel W., Laurent D., Eddy et Driss G.,
Hamza F., Antonio M. et Ferat A., Mme Elena L., MM. Alexander Z., Ahmed B.,
Samih Z., Rachid M., Mike S., Claudy I., Grégory B. Ahmed K., Kossi H., Willy
P. et John C., Mme Virginie P., MM. Mehdi T., Abibou S., Mouhssine M., Nouri
G., Mohamed E., Amare K., Ulrich K., Masire N., Abelouahab S., Rami Z., Edgar
A., Valentin F. et Nabil et Sophiane S., relative à la conformité aux droits
et libertés que la Constitution garantit des
articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale
relatifs au régime de la garde à vue. Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Il a également été saisi le 11 juin 2010 par cette même cour (arrêt n°
12041-12042-12043-12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054 du 4 juin 2010),
dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité
posée par MM. Jacques M., Jean C., Didier B., Bruno R., Mohammed A., François
W., Jair Alonso R., Bilel G., Mohamed H. et David L., relative à la conformité
aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
Vu le
code de procédure pénale ;
Vu la
loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale
sur la police judiciaire et le jury d'assises, notamment son article 2 ;
Vu la
loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 modifiant diverses dispositions du
code de procédure pénale et du
code de la route et relative à la police judiciaire, notamment son article
1er ;
Vu la
loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la
loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du
code de procédure pénale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel
n° 93-326 DC du 11 août 1993 ;
Vu la
loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et
relative au nouveau
code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son
article 2 ;
Vu la
loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions
et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 53 ;
Vu la
loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du
terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique
ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions
relatives à la police judiciaire, notamment son article 20 ;
Vu la
loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification
d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la
police nationale ;
Vu la
loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son
article 8 ;
Vu la
loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel
n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;
Vu la
loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles
frontaliers, notamment son article 16 ;
Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, pour MM. D. et W., enregistrées le 17 juin
2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mmes L. et P. et MM.
Z., B., Z., M., S., I., B., K., H., P., C., T., S., M., G., E., K., K., N., S.
et Z., enregistrées le 17 juin 2010 ;
Vu les observations produites par Me Molin, avocat au barreau de Lyon, pour
MM. M., A., S., G., S. et F., enregistrées le 18 juin 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 et
24 juin 2010 ;
Vu les observations produites par Me Barrere, avocat au barreau de Perpignan,
pour M. R., enregistrées le 20 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. M., enregistrées le 23 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. C., enregistrées le 24 juin
2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par Me Barrere, enregistrées le 28
juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par la SCP Piwnica et Molinié,
enregistrées le 30 juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par la SCP Nicolay, de Lanouvelle,
Hannotin, enregistrées le 30 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. G., enregistrées
le 2 juillet 2010 ;
Vu les observations produites par Me Gavignet, avocat au barreau de Dijon,
pour M. A., enregistrées le 2 juillet 2010 ;
Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la
demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction,
enregistrées le 16 juillet 2010;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Me Emmanuel Piwnica, Me René Despieghelaere, Me Gaël Candella, Me Eymeric
Molin, Me Jean-Baptiste Gavignet, Me Marie-Aude Labbe, Me Emmanuel Ravanas, Me
Hélène Farge, Me David Rajjou, Me Denis Garreau, pour les requérants, et M.
François Seners, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de
l'audience publique du 20 juillet 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité portent
sur les mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour
statuer par une seule décision;
2. Considérant qu'aux
termes de l'article 62 du code de procédure pénale : « L'officier de
police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles
de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents
saisis.
« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de
police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les
personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître
par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la
République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à
comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle
convocation.
« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues
procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs
observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire,
lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à
la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite
sur celui-ci.
« Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également
entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes
personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause.
Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des
procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils
secondent.
« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de
soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent
être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de ce même code : « L'officier de
police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à
vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la
République.
« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de
vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la
République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation
préalable de la personne gardée à vue.
« Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre
desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de
poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit
déférées devant ce magistrat.
« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même
ressort » ;
4. Considérant qu'aux termes de son article 63-1 : « Toute personne placée en
garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire,
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la
nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux
articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de
la garde à vue prévues par l'article 63.
« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne
gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à
la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au
moyen de formulaires écrits.
« Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni
écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par
toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de
communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif
technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans
qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur
l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa
connaissance.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les
enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3
doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du
moment où la personne a été placée en garde à vue » ;
5. Considérant qu'aux termes de son article 63-4 : « Dès le début de la garde
à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est
pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté,
elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des
conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé
par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un
agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction
sur laquelle porte l'enquête.
« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes,
l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à
la procédure.
« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la
durée de la garde à vue.
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut
également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la
prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas
précédents.
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°,
7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée
à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article,
l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de
soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la
qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par
ces derniers du placement en garde à vue » ;
6. Considérant qu'aux termes de son article 77 : « L'officier de police
judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition
toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la
République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre
heures.
« Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de
vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de
vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après
présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à
titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans
présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre
ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la
prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu
d'exécution de la mesure.
« Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les
personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à
motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit
remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même
ressort.
« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont
applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre » ;
7. Considérant qu'aux termes de son article 706-73 : « La procédure applicable
à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des
délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des
dispositions du présent titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le
8° de l'article 221-4 du code pénal ;
« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu
par l'article
222-4 du code pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34
à 222-40 du code pénal ;
« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande
organisée prévus par l'article
224-5-2 du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les
articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à
225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article
311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les
articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en
bande organisée prévu par l'article
322-8 du code pénal ;
« 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les
articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les
articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
« 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande
organisée, prévus par les
articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5
du code de la défense ;
« 13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un
étranger en France commis en bande organisée prévus par le
quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
;
« 14° Délits de blanchiment prévus par les
articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles
321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des
infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
« 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article
450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des
infractions mentionnées aux 1° à 14° ;
« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie,
prévu par l'article
321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des
infractions mentionnées aux 1° à 15°.
« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf
précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des
titres XV, XVI et XVII » ;
8. Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que les
conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule
méconnaîtraient la dignité de la personne ;
9. Considérant qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que le pouvoir donné à
l'officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue
méconnaîtrait le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de
la liberté individuelle ; que le procureur de la République ne serait pas une
autorité judiciaire indépendante ; qu'il ne serait informé qu'après la
décision de placement en garde à vue ; qu'il a le pouvoir de la prolonger et
que cette décision peut être prise sans présentation de la personne gardée à
vue ;
10. Considérant qu'ils estiment, en troisième lieu, que le pouvoir donné à
l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue toute personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un
pouvoir arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l'article 9 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prohibe toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer d'une personne mise en
cause ;
11. Considérant que les requérants font valoir, en quatrième lieu, que la
personne gardée à vue n'a droit qu'à un entretien initial de trente minutes
avec un avocat et non à l'assistance de ce dernier ; que l'avocat n'a pas
accès aux pièces de la procédure et n'assiste pas aux interrogatoires ; que la
personne gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le
silence ; que, dès lors, le régime de la garde à vue méconnaîtrait les droits
de la défense, les exigences d'une procédure juste et équitable, la
présomption d'innocence et l'égalité devant la loi et la justice ; qu'en
outre, le fait que, dans les enquêtes visant certaines infractions, le droit
de s'entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième ou à la
soixante-douzième heure de garde à vue méconnaîtrait les mêmes exigences ;
Sur les
articles 63-4, alinéa 7, et 706-73 du code de procédure pénale :
12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du
troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée
et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne
peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à
une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf
changement des circonstances ;
13. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du
deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la
loi du 9 mars 2004 susvisée ; que les requérants contestaient notamment la
conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 1er et 14 ; que,
dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le
Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 1er, qui « insère
dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé : "De la
procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées” » et
comportait l'article
706-73 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les
considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les
dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de
délinquance organisées et, parmi celles-ci, le paragraphe I de l'article 14
dont résulte le
septième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que
l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré les articles 1er et 14
conformes à la Constitution ; que, par suite, le septième alinéa de l'article
63-4 et l'article
706-73 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil
constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la
décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et
la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel,
de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;
Sur les
articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure
pénale :
14. Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 août 1993, le Conseil
constitutionnel n'a pas spécialement examiné les
articles 63, 63-1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ; que,
toutefois, il a déclaré conformes à la Constitution les modifications
apportées à ces articles par les dispositions alors soumises à son examen ;
que ces dispositions étaient relatives aux conditions de placement d'une
personne en garde à vue et à la prolongation de cette mesure, au contrôle de
celle-ci par le procureur de la République et au droit de la personne gardée à
vue d'avoir un entretien de trente minutes avec un avocat ; que,
postérieurement à la
loi susvisée du 24 août 1993, ces articles du
code de procédure pénale ont été modifiés à plusieurs reprises ; que les
dispositions contestées assurent, en comparaison de celles qui ont été
examinées par le Conseil dans sa décision du 11 août 1993, un encadrement
renforcé du recours à la garde à vue et une meilleure protection des droits
des personnes qui en font l'objet ;
15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles
de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa
mise en œuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à
vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le
code de procédure pénale ;
16. Considérant qu'ainsi la proportion des procédures soumises à l'instruction
préparatoire n'a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et
ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle ; que,
postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en
temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique
conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action publique est
prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis
fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en œuvre de
l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus
diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice,
il n'en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits
complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus
souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant
l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu
faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase
principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la
personne mise en cause ;
17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du
28 juillet 1978 et
18 novembre 1985 susvisées, l'article
16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes
ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider
du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par
l'article 2 de la loi du 1er février 1994, l'article 53 de la loi du 8 février
1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998,
l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article
16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont
conduit à une réduction des exigences conditionnant l'attribution de la
qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police
nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et
2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité
d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;
18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la
garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé
l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments
sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de
790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces
modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de
la constitutionnalité des dispositions contestées ;
En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la dignité de la personne :
19. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance,
possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de
la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au
nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;
20. Considérant qu'il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de
police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en
toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la
personne ; qu'il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes,
dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le
code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des
infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les
agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et
d'ordonner la réparation des préjudices subis ; que la méconnaissance
éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives
précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions
d'inconstitutionnalité ; que, par suite, s'il est loisible au législateur de
les modifier, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel
ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;
En ce qui concerne les autres griefs :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul
homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la
loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être
punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à
l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son
article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui
ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
22. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe
les règles concernant la procédure pénale ; qu'aux termes de son article 66 :
« Nul ne peut être arbitrairement détenu. ― L'autorité judiciaire, gardienne
de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les
conditions prévues par la loi » ;
23. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution
l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que,
s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour
éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs
d'infractions ;
24. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la
conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public
et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre
part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre
de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de
l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que
l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité
judiciaire ;
25. Considérant qu'en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne
méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure
une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police
judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des
garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son
déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;
26. Considérant que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du
siège et du parquet ; que l'intervention d'un magistrat du siège est requise
pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ;
qu'avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé
sous le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas
échéant, de sa prolongation de vingt-quatre heures ; qu'il résulte des
articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la
République est informé dès le début de la garde à vue ; qu'il peut ordonner à
tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise
en liberté ; qu'il lui appartient d'apprécier si le maintien de la personne en
garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont
nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la
personne est suspectée d'avoir commis ; que, par suite, le grief tiré de la
méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté ;
27. Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des
articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée
d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier
de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit
la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue
peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette
faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;
28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62
et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ;
que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors
qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective
d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de
façon générale, sans considération des circonstances particulières
susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou
assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à
vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;
29. Considérant que, dans ces conditions, les
articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure
pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est
faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ;
qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à
l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part,
l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être
regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les
articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées
contraires à la Constitution ;
Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
30. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas
d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ;
qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles de
procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à
l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en principe, une
déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté
la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation immédiate des
dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des
atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et
entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu, dès
lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de
permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les
mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées
contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de
cette inconstitutionnalité,
Décide :
Les
articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas
ler à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution.
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er
juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.
Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l'article
706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article
63-4.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article
23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010,
où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, MM. Jacques BARROT, Guy
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de
GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
LA GARDE A VUE EN MATIÈRE DE TERRORISME
Décision QPC n° 2012-223 u 17 février 2012
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2011
par le Conseil d'État (décision n° 354200 du 23 décembre 2011), dans les
conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité posée par l'ordre des avocats au barreau de
Bastia, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution
garantit de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction
issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant, par Me Patrice Spinosi, avocat
à la Cour de cassation et au Conseil d'État, enregistrées les 16 et 31 janvier
2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16
janvier 2012 ;
Vu les observations en intervention produites par la SCP Masse-Dessen et
Thouvenin dans l'intérêt du Syndicat des avocats de France et enregistrées le 13
janvier 2012 ;
Vu les observations en intervention produites par M. Philippe K. enregistrées le
13 janvier 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi, pour le requérant, Me Hélène Masse-Dessen, dans l'intérêt du
Syndicat intervenant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre,
ayant été entendus à l'audience publique du 7 février 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale :
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de
l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le
procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou
le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une
instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné
par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du
Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque
barreau.
« Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en
Conseil d'État » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que le juge des libertés
et de la détention ou le juge d'instruction puisse faire désigner d'office un
avocat afin d'assister une personne placée en garde à vue pour une infraction
mentionnée au 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale et en
s'abstenant de définir les critères objectifs et rationnels en fonction desquels
il peut être dérogé à la liberté de choisir son avocat, ces dispositions portent
atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe d'égalité devant de la
justice ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la
Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une
juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux
droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut
être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de
cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par
le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une
question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un
droit ou une liberté que la Constitution garantit
4. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution
l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que,
s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter
une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions
5. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre,
d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la
sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions,
toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur
constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés
constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figure le respect
des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
6. Considérant que les dispositions contestées permettent que la liberté de
choisir son avocat soit suspendue pendant la durée d'une garde à vue mise en
œuvre pour des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par
les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; que le législateur a ainsi entendu
prendre en compte la complexité et la gravité de cette catégorie de crimes et
délits ainsi que la nécessité d'entourer, en cette matière, le secret de
l'enquête de garanties particulières
7. Considérant que, si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son
avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à
vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en
matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au
législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une
telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise
en œuvre ; que les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une
catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue
sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur
une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des
barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles
n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances
particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant
d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ; qu'en adoptant les
dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la
personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu
l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits
de la défense ; que par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale
doit être déclaré contraire à la Constitution ;
8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la
Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement
de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le
Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les
effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ;
que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à
l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition
déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances
en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel,
les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le
pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses
effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a
produits avant l'intervention de cette déclaration ;
9. Considérant que l'abrogation de l'article 706-88-2 du code de procédure
pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle
est applicable à toutes les gardes à vue mises en œuvre à compter de cette date,
D É C I D E :
Article 1er- L'article 706-88-2 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à
compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 février 2012, où
siégeaient: M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 septembre 2014 par la Cour de
cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Nadav B.
Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit des 6ème à 8ème alinéas de l'article 706-88 du code de
procédure pénale (CPP).
L'article 706-88 du CPP fixe des règles particulières applicables à la garde à
vue d'une personne suspectée d'avoir commis une des infractions relevant de la
délinquance ou la criminalité organisée dont la liste est fixée par l'article
706-73 du même code. Ses sixième à huitième alinéas prévoient que l'intervention
de l'avocat au cours de la garde à vue peut être différée pendant une durée
maximale de quarante-huit heures ou, dans certains cas, de soixante-douze
heures.
Le Conseil constitutionnel a relevé, que ce report de l'intervention de l'avocat
ne peut être décidé qu'en considération de raisons impérieuses tenant aux
circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour
permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une
atteinte aux personnes. La décision initiale de reporter cette intervention
appartient au magistrat chargé de la direction de l'enquête ou de l'instruction.
Au-delà de vingt-quatre heures, ce report ne peut être décidé que par un
magistrat du siège. Le report ne peut en tout état de cause excéder une durée de
quarante-huit heures ou, en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants,
de soixante-douze heures. La décision du magistrat doit être écrite et motivée.
Par ailleurs, la personne placée en garde à vue est notamment informée, dès le
début de la garde à vue, de la qualification, de la date et du lieu présumés de
l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, du droit de consulter les
documents mentionnés afférents ainsi que du droit « de se taire ». Au regard de
l'ensemble de ces éléments, le Conseil constitutionnel a jugé que ces
dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la
défense et sont conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, notamment son
article 16 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014
;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan,
avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 octobre
2014 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'ordre des avocats au
barreau de Marseille par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation, enregistrées le 2 octobre 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 2 et 17
octobre 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Hélène Farge, pour le requérant, Me Spinosi, pour la partie intervenante et
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à
l'audience publique du 12 novembre 2014
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 706-88 du code de
procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi du 14 avril 2011
susvisée : « Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de
l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le
champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne
peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires
de vingt-quatre heures chacune.
« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la
requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la
détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la
prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut
toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de
la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est
examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un
certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au
maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par
l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical.
Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au
procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus
d'émargement, il en est fait mention.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des
investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures
de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge
d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa,
que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de
quarante-huit heures.
« Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la
personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ
d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être
différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances
particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil
ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes,
pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une
infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée
maximale de soixante-douze heures.
« Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième
heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de
l'officier de police judiciaire. Le report de l'intervention de l'avocat au-delà
de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième
alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du
procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une
commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans tous
les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour
laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
« Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent
article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en
garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de
l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3 » ;
2. Considérant que, selon le requérant, les dispositions contestées
méconnaissent le principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte dans
la procédure pénale et les droits de la défense ; qu'il en irait en particulier
ainsi en ce que ces dispositions permettent de reporter l'intervention de
l'avocat au cours de la garde à vue dans le cadre d'une enquête ou d'une
instruction portant sur des faits qualifiés d'escroquerie en bande organisée en
application du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ; que,
selon la partie intervenante, le principe même de la possibilité de reporter
l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue méconnaît ces exigences
constitutionnelles ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les
sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni
détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en
vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance »
; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit
être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
5. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution
l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que,
s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter
une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;
6. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation
entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche
des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et
de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des
libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figure le
respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration
de 1789 ;
7. Considérant que les articles 63-4 à 63-4-2 du code de procédure pénale sont
relatifs aux modalités selon lesquelles une personne placée en garde à vue peut
bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que l'article 63-4 prévoit que la
personne gardée à vue peut avoir un entretien confidentiel d'une durée de trente
minutes avec un avocat ; que l'article 63-4-1 prévoit que l'avocat peut
consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à
vue et des droits qui y sont attachés, les certificats médicaux établis à
l'occasion de la mesure de garde à vue ainsi que les procès-verbaux
d'interrogatoire de la personne en cause ; que l'article 63-4-2 prévoit que
l'avocat peut être présent lors des interrogatoires et confrontations de la
personne gardée à vue ; que les trois derniers alinéas de cet article fixent les
conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut
autoriser le report de la présence de l'avocat lors des auditions ou
confrontations ;
8. Considérant que l'article 706-88 du code de procédure pénale fixe des règles
particulières applicables à la garde à vue d'une personne suspectée d'avoir
commis une des infractions relevant de la délinquance et la criminalité
organisées dont la liste est fixée par l'article 706-73 du même code ; que le a)
de l'article 16 de la loi du 14 avril 2011 susvisée a remplacé le dernier alinéa
de l'article 706-88 du code de procédure pénale par trois nouveaux alinéas ; que
ces sixième à huitième alinéas prévoient que l'intervention de l'avocat au cours
de la garde à vue peut être différée pendant une durée maximale de quarante-huit
heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article
706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures ; que la décision de
différer l'intervention de l'avocat doit être écrite et motivée en considération
de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de
l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves,
soit pour prévenir une atteinte aux personnes ; que ce report est décidé par le
juge d'instruction lorsque la garde à vue est mise en œuvre au cours d'une
information judiciaire ; que, dans les autres cas, il est décidé par le
procureur de la République, jusqu'à la vingt-quatrième heure, et par le juge des
libertés et de la détention, au delà de cette limite ;
9. Considérant que le respect des droits de la défense impose, en principe,
qu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne peut être entendue,
alors qu'elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l'assistance
effective d'un avocat ; que, toutefois, cette exigence constitutionnelle
n'interdit pas qu'en raison de la particulière gravité ou de la complexité de
certaines infractions commises par des personnes agissant en groupe ou en
réseau, l'assistance de l'avocat à la personne gardée à vue puisse être reportée
par une décision du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge
des libertés et de la détention, lorsqu'un tel report apparaît nécessaire pour
permettre le recueil ou la conservation des preuves ou prévenir une atteinte aux
personnes ;
10. Considérant, en premier lieu, que l'appréciation du caractère proportionné,
au regard de la gravité et de la complexité des faits à l'origine de l'enquête
ou de l'instruction, de l'atteinte aux droits de la défense qui résulte de la
faculté de report de l'intervention de l'avocat ne peut s'apprécier qu'au regard
des dispositions qui énoncent les infractions pour lesquelles sont autorisées
ces mesures dérogatoires aux règles de droit commun relatives à la garde à vue ;
que le grief tiré de ce que les dispositions contestées permettent le report de
l'intervention de l'avocat lorsque la personne gardée à vue est suspectée
d'avoir participé à des faits d'escroquerie en bande organisée met en cause non
l'article 706-88 du code de procédure pénale en lui-même, mais la mention du
délit d'escroquerie en bande organisée au 8° bis de l'article 706-73 ; qu'au
surplus, par sa décision du 9 octobre 2014 susvisée, le Conseil constitutionnel
a déclaré ce 8° bis contraire à la Constitution ; qu'il a reporté au 1er
septembre 2015 la date de l'abrogation de cette disposition et a jugé, d'une
part que les dispositions du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure
pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de la
publication de la décision du 9 octobre 2014, pour des faits d'escroquerie en
bande organisée, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 du code
de procédure pénale et, d'autre part, que les mesures de garde à vue prises
avant la publication de la décision du 9 octobre 2014 en application des
dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées
sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que, si le report de l'intervention de
l'avocat dans les conditions prévues par l'article 706-88 du code de procédure
pénale ne peut être décidé que lorsque la personne gardée à vue est suspectée
d'avoir commis l'une des infractions prévues par l'article 706-73, cette
condition n'est pas suffisante pour justifier ce report ; qu'en effet, le report
de l'intervention de l'avocat en application des dispositions contestées doit en
outre être motivé, au cas par cas, en considération de raisons impérieuses
tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit
pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une
atteinte aux personnes ; que la décision initiale de reporter cette intervention
appartient, selon le cas, au procureur de la République ou au juge d'instruction
; qu'il incombe en particulier à ce magistrat d'apprécier, en fonction des
circonstances de l'affaire, si le report doit s'appliquer à l'ensemble des
modalités d'intervention de l'avocat en application de l'article 706-88 ou si
les modalités de report de l'intervention de l'avocat prévues par les trois
derniers alinéas de l'article 63-4-2 sont suffisantes ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au magistrat compétent de
fixer, en considération des raisons impérieuses rappelées ci-dessus, par une
décision écrite et motivée, la durée pendant laquelle l'intervention de l'avocat
est reportée ; qu'au-delà de vingt-quatre heures, ce report ne peut être décidé
que par un magistrat du siège ; que cette durée ne peut en tout état de cause
excéder quarante-huit heures ou, en matière de terrorisme et de trafic de
stupéfiants, soixante-douze heures ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions de
l'article 63-1 du code de procédure pénale, même lorsqu'il est fait application
des dispositions contestées, la personne placée en garde à vue est notamment
informée, dès le début de la garde à vue, « de la qualification, de la date et
du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté
de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2
justifiant son placement en garde à vue », « du droit de consulter, dans les
meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à
vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 », ainsi que du droit « de se
taire » ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en elles-mêmes, les
dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du code de
procédure pénale ne portent pas une atteinte disproportionnée au droits de la
défense ; qu'elles ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la
Constitution garantit et doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Les sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du code de
procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-392 du 14
avril 2011 relative à la garde à vue, sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 novembre 2014, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY
MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2015 par la Cour de
cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Amir F.
relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de
la référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale figurant
aux 14° et 15° de cet article 706-73. Ces dispositions ont notamment pour effet
de permettre le recours à la garde à vue prolongée de 96 heures pour les
infractions de blanchiment ou de recel du produit, des revenus, des choses
provenant du délit d'escroquerie en bande organisée et pour les infractions
d'association de malfaiteurs lorsqu'elles ont pour objet la préparation de ce même délit.
Le Conseil constitutionnel avait, par sa décision n° 2014-420/421 QPC du 9
octobre 2014, jugé que le recours à une garde à vue de quatre-vingt seize heures
pour le délit d'escroquerie en bande organisée portait à la liberté individuelle
et aux droits de la défense une atteinte disproportionnée et avait, par voie de
conséquence, déclaré le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale
contraire à la Constitution. Considérant que le raisonnement suivi alors devait
également s'appliquer pour des faits de blanchiment, recel et association de
malfaiteurs en lien avec une escroquerie en bande organisée, le Conseil
constitutionnel a jugé que la référence au 8° bis contenue dans les 14° et 15°
de l'article 706-73 du code de procédure pénale est également contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé que les mesures prises, avant
l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure
pénale au droit de l'Union européenne, sur le fondement des dispositions
contestées, ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité ;
Vu la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie
et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la
qualité du droit ;
Vu la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale
au droit de l'Union européenne ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Lyon-Caen et Thiriez,
enregistrées le 23 octobre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 1er décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 706-73 du code de procédure pénale fixe la liste des crimes et délits pour lesquels la procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement est soumise aux dispositions particulières du titre XXV « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées » du livre IV du code de procédure pénale ; qu'en vertu du 8° bis de cet article dans sa rédaction rétablie par la loi du 17 mai 2011 susvisée, cette procédure est applicable au délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; qu'aux termes des 14° et 15° de cet article dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 susvisée, cette procédure est applicable aux : « 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ; « 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° » ;
2. Considérant qu'aux termes du 15° du même article dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2011 susvisée, cette procédure est applicable aux : « Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° » ;
3. Considérant que le requérant soutient qu'en permettant le recours à la garde à vue prolongée de quatre-vingt-seize heures pour les infractions de blanchiment ou de recel du produit, des revenus, des choses provenant du délit d'escroquerie en bande organisée et pour les infractions d'association de malfaiteurs lorsqu'elles ont pour objet la préparation de ce même délit, les dispositions contestées méconnaissent la liberté individuelle et les droits de la défense dès lors que ces infractions ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la sûreté, à la dignité ou à la vie des personnes ;
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la référence au 8° bis figurant dans les mots « 1° à 13° » au 14° de l'article 706-73 du code de procédure pénale et dans les mots « 1° à 14° » au 15° du même article ;
5. Considérant que le 8° bis de l'article 706-73 est issu de la loi du 17 mai 2011 ; que la référence au 8° bis aux 14° et 15° de l'article 706-73 résulte de cette même loi ; que cette référence n'a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel ; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc recevable ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
7. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;
8. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et de venir, l'inviolabilité du domicile, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;
9. Considérant que l'article 706-88 du code de procédure pénale, dans ses rédactions successives résultant des lois des 23 janvier 2006 et 14 avril 2011 susvisées, prévoit notamment que, si les nécessités d'une enquête l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune, décidées par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction ; que, dans ce cas, ces prolongations, qui s'ajoutent à la durée de droit commun définie par l'article 63 du même code, portent à quatre-vingt-seize heures la durée maximale de la garde à vue ;
10. Considérant, d'une part, que le 14° de l'article 706-73 du code de procédure pénale permet la mise en œuvre d'une mesure de garde à vue dans les conditions déterminées par l'article 706-88 dudit code pour « les délits de blanchiment, prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal et de recel, prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° » ; que le blanchiment est défini à l'article 324-1 du code pénal comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » ou « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit » ; que le recel est défini par l'article 321-1 du code pénal comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit » ou « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit » ;
11. Considérant, d'autre part, que le 15° de l'article 706-73 permet la mise en œuvre d'une mesure de garde à vue dans les conditions prévues à l'article 706-88 du code de procédure pénale pour les délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et, depuis l'article 5 de la loi du 5 janvier 2011 susvisée, au 17° de l'article 706-73 ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 450-1 du code pénal, « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement » ;
12. Considérant que pour apprécier la constitutionnalité de la référence au 8° bis figurant aux 14° et 15° de l'article 706-73, il convient de vérifier si les délits visés à ces 14° et 15° sont susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes lorsqu'ils se rapportent au délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ;
13. Considérant, en premier lieu, que, dans sa décision du 9 octobre 2014 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en permettant de recourir à la garde à vue, selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale, au cours des enquêtes ou des instructions portant sur le délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi dès lors que ce délit n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'il a déclaré cette disposition du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale contraire à la Constitution et reporté au 1er septembre 2015 la date de son abrogation ; qu'elle a été abrogée par la loi du 17 août 2015 susvisée ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que pour les raisons sus-énoncées, la référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article permettant, jusqu'à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 dudit code, est contraire à la Constitution ; que, toutefois, la loi du 17 août 2015 a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée à compter de son entrée en vigueur ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de se prononcer sur l'abrogation de la référence au 8° bis par les 14° et 15° de l'article 706-73 pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 ;
15. Considérant, en troisième lieu, que la remise en cause
des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions
inconstitutionnelles méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de
recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement
excessives ; que, par suite, les mesures prises avant le 19 août 2015 en
application de la référence au 8° bis par les 14° et 15° de l'article 706-73 du
code de procédure pénale ne peuvent être contestées sur le fondement de cette
inconstitutionnalité,
D É C I D E :
Article 1er.- La référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure
pénale par les 14° et 15° du même article était contraire à la Constitution
avant le 19 août 2015.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à
compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par
ses considérants 14 et 15.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 décembre 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST et Mme Nicole MAESTRACCI.
Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH, lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.