Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au
moyen et par ceux adoptés des premiers juges, pour déclarer les prévenus
coupables de non-représentation d'enfant, la cour d'appel, qui a répondu, sans
insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions déposées
devant elle, a justifié sa décision ;
Attendu que, d'une part, une décision du juge des
affaires familiales fixant une durée à l'exercice du droit de visite ne saurait
être déclarée caduque du seul fait du refus de représenter l'enfant, opposé par
la personne qui en a la charge ;
Attendu que, d'autre part, la résistance d'un mineur à
l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer, pour la personne qui a
l'obligation de le représenter, ni une excuse légale ni un fait justificatif, à
moins de circonstances exceptionnelles, non établies en l'espèce ;
9. Pour écarter le moyen tiré de l'absence d'enquête
relative aux mesures à prendre à l'égard des enfants mineurs de Mme [P] en cas
de placement de celle-ci en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que
celle-ci ne produit pas l'acte de naissance de sa fille [L], mais seulement des
rapports d'enquête sociale et une attestation de la caisse d'allocations
familiales indiquant qu'elle élève seule cet enfant et que ces éléments sont
insuffisants à démontrer l'absence de filiation paternelle pour cet enfant et
l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
10. En l'état de ces
énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la
portée des éléments de preuve débattus devant elle, n'a méconnu aucun des textes
visés au moyen, dès lors, d'une part, que l'application des dispositions de
l'article 145-5 du code de procédure pénale suppose que la personne mise en
examen ait non seulement fait connaître mais encore justifié qu'elle exerce à
titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans ayant sa
résidence habituelle chez elle, d'autre part, que la copie de l'acte de
naissance figurant à la procédure ne suffisait pas, en raison de sa date, à
établir l'absence de lien de filiation paternelle et un exercice exclusif de
l'autorité parentale.
11. Ainsi, le moyen, inopérant en sa deuxième
branche en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt attaqué, doit
être écarté.
Mais sur le troisième moyen
22. Pour rejeter les conclusions du prévenu invoquant le
bénéfice de décisions juridictionnelles prononcées à l'étranger, lui ayant
confié la garde de l'enfant, l'arrêt attaqué énonce, d'abord, que M. [N] a saisi
des juridictions en fraude des droits de son épouse, en la domiciliant
faussement à [Localité 3], puis à Moscou, afin que ces juridictions se déclarent
compétentes, et que son épouse ne puisse être avertie des procédures ainsi
engagées. La cour d'appel ajoute que ces manoeuvres lui ont permis d'obtenir des
décisions convenant à ses voeux. Les juges précisent que le prévenu a faussement
prétendu, devant la juridiction russe, que son épouse, qui vivait avec lui et
son fils, à Moscou, avait abandonné le foyer, le laissant seul avec l'enfant, ce
qui lui a permis d'obtenir une décision lui en ayant confié la garde.
23.
En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement estimé que le
prévenu ne pouvait se prévaloir du contenu de décisions juridictionnelles qu'il
avait obtenues par fraude, en méconnaissance de l'ordre public international
procédural français, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au
moyen.
Mais attendu que l'article 4 du code de procédure
pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à
la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de
l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation
du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la
nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal
est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la
solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ;
Et
attendu qu'après avoir constaté que l'action introduite devant la juridiction
civile par Mme Y... n'était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une
information était ouverte contre la société des chefs de tromperie, homicides et
blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celle-ci au
titre de la défectuosité du Mediator, la cour d'appel en a exactement déduit que
l'action dont elle était saisie était indépendante de l'action publique ; que
c'est sans méconnaître les exigences d'un procès équitable et en l'absence de
démarche de la société aux fins que soient versées à la procédure civile les
pièces du dossier pénal qu'elle considérait comme nécessaires aux besoins de sa
défense, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant
critiqué par la troisième branche, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à
statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal ; que le moyen n'est pas fondé ;
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 12 avril 2022, pourvoi n° 22-80.632 rejet
19. Pour dire la loi française applicable et les juridictions
françaises compétentes, l'arrêt attaqué énonce que la loi pénale française est
applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère
lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs sont commis sur le territoire de la République.
20. Les juges ajoutent qu'il en est de même lorsque l'infraction est commise à
l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette
infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits
étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que
l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres.
21. Ils relèvent que la société [4] a fourni des solutions de chiffrement pour
les téléphones portables grâce à une application et une infrastructure dédiées,
l'analyse technique du logiciel ayant montré qu'il constituait un système de
sécurité particulièrement sophistiqué, comportant quatre couches dotées de clefs de chiffrement et de cryptage.
22. Ils retiennent que, selon les autorités belges, l'utilisation de la solution
Sky ECC ne servait que pour des activités criminelles et que les investigations
néerlandaises ont démontré que les téléphones configurés avec le logiciel Sky 4
ECC ne pouvaient pas être achetés directement sur le site de la société, mais
qu'après un premier contact par courriel, la société renvoyait le client vers un
revendeur local, qu'aucune facture n'était fournie, que le paiement se faisait
en espèces et que seules les coordonnées du revendeur et du service après-vente étaient communiquées.
23. Les juges indiquent que, selon ces investigations, un identifiant est
délivré par la société lors de l'achat, les utilisateurs étant anonymes, aucune
pièce d'identité ou justificatif de domicile n'étant demandé.
24. Ils rappellent que l'un des revendeurs français de téléphones équipés du
logiciel Sky ECC a déclaré avoir pu revendre ces appareils sans structure
officielle, qu'un autre a affirmé ne connaître aucun de ses clients
personnellement, avoir l'interdiction de leur demander pour quelle raison ils
achetaient un téléphone crypté et avoir envoyé, à la demande d'un des
collaborateurs de la société [4], un message à ses contacts leur recommandant de ne pas montrer leurs mains en photo.
25. Ils relèvent que ces téléphones, équipés du logiciel de cryptage, ont été
commercialisés en France par six revendeurs et que l'agence nationale de la
sécurité des systèmes d'information a indiqué qu'aucune demande ou déclaration
concernant ce logiciel, pourtant exigées par la réglementation pour utiliser sur
le territoire national ces moyens de cryptologie, n'ont été déposées auprès d'elle.
26. Ils retiennent que les deux serveurs de la société [4], le serveur principal
et le serveur de sauvegarde, sont hébergés auprès de la société française [2] à
[Localité 3] et que les interceptions ont révélé l'existence de 2 500
utilisateurs du logiciel Sky ECC en France avec des revendeurs identifiés, interpellés et dont plusieurs ont été mis en examen.
27. Ils ajoutent que les échanges interceptés sur la messagerie cryptée font
aussi état de collectes d'argent organisées via l'utilisation, la plupart du
temps, de la photographie du numéro de série d'un billet de banque servant de validation à la récupération de l'argent lors de la collecte.
28. Ils relèvent qu'il résulte des investigations que le téléphone [4] est vendu
et payé avec des liquidités et que l'argent provenant des ventes est transformé en bitcoins.
29. Ils rappellent que M. [M] a occupé un poste stratégique pour le compte de la
société [4] en sa qualité de « distributeur international », c'est-à-dire de
distributeur de haut niveau dans la hiérarchie des ventes de la société, ayant
des contacts avec la structure dirigeante et ayant le pouvoir de bloquer les
accès au système pour les revendeurs placés sous ses ordres en cas de non-paiement des dettes.
30. Ils relèvent également qu'il est identifié comme le distributeur des
appareils de la société [4] à travers le monde, qu'il a vendu au moins
directement cent trente et un téléphones cryptés et qu'il a recruté directement
des revendeurs de téléphones pour le compte de cette dernière.
31. Ils ajoutent que M. [M] est aussi identifié comme le collecteur de
liquidités auprès de clients, sommes ensuite converties en cryptomonnaies, avec
prise d'un pourcentage au titre de commissions, et qu'il a été capable
d'organiser avec des complices ou des intermédiaires des remises d'argent pour
le paiement de leurs dettes, démontrant ainsi l'existence d'une structure installée, cohérente et pérenne.
32. Ils retiennent de plus qu'il s'occupait des circuits financiers de la
société [4] et du blanchiment des fonds pour le compte de cette dernière, grâce à ses connaissances en cryptomonnaie.
33. Ils relèvent encore que, le 18 décembre 2020, Mme [N], compagne de M. [M], a
rencontré une personne dans un hôtel parisien pour échanger la somme de 160 000 euros en bitcoins pour le compte de celui-ci.
34. Ils retiennent que la présence de deux serveurs en France a permis le
transit sur le territoire national de toutes les conversations entre les
protagonistes des différents réseaux criminels, que des revendeurs de téléphones
[4] ont été identifiés en France, que des utilisateurs de ces téléphones ont été
repérés en train de se livrer à des trafics de stupéfiants et que des
transformations de liquidités en bitcoins sont intervenues sur le sol français.
35. Ils en déduisent que les faits commis à l'étranger sont indivisibles de ceux
commis en France en ce qu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que
l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres, dès lors
qu'ils sont tous reliés par l'usage des téléphones [4] répertoriés sur les
serveurs à [Localité 3], que les flux de données illicites utilisées à des fins
criminelles ont été enregistrés sur ces serveurs et que des revendeurs des
produits de la société [4] ont distribué ces téléphones en France, où ils ont servis à des fins criminelles.
36. Ils en concluent, d'une part, qu'il existe des indices graves ou concordants
rendant vraisemblable la participation de M. [M], de nationalité canadienne, aux
faits qui lui sont reprochés, d'autre part, que les faits constitutifs des
infractions, objets de l'information, se sont déroulés en France et sont
indivisibles des infractions identiques commises en divers pays étrangers.
37. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
38. Dès lors, le moyen doit être écarté.
LA FOUILLE DU VEHICULE
La
loi prévoit qu’en enquête préliminaire, en principe non coercitive, les
enquêteurs doivent obtenir l’assentiment de la personne chez laquelle ils
veulent effectuer une perquisition.
Elle ne prévoit rien pour la fouille d’un
véhicule, sauf s’il sert d’habitation ou si les enquêteurs agissent en flagrant
délit.
Pourtant, une telle fouille, même en enquête préliminaire, constitue
une intrusion dans la vie privée. De ce fait, les enquêteurs doivent recueillir
le consentement du propriétaire ou du conducteur du véhicule, comme pour la
perquisition d’un domicile.
Cependant, l’atteinte à la vie privée étant
moindre que lors de la perquisition d’un domicile, la nullité de la fouille d’un
véhicule réalisée sans assentiment ne peut être prononcée que si la personne
concernée établit avoir subi un préjudice
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du
17 janvier 2024, pourvoi n° 22-87.593 rejet
13. Il résulte de l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de
ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts
légitimes prévus audit article.
14. Selon l'article 76 du code de
procédure pénale, durant l'enquête préliminaire, les perquisitions et saisies de
pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la
personne chez qui l'opération a lieu.
15. Un véhicule, sauf s'il est
spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme
résidence, ne constitue pas un domicile
(Crim., 5 janvier 2021, pourvoi n°
20-80.569, publié au Bulletin).
16. Cependant la fouille d'un véhicule,
par l'intrusion dans l'intimité de la vie privée qu'elle permet, est assimilable
à une perquisition.
17. Sauf si un texte l'autorise expressément, elle ne
peut être effectuée qu'avec l'assentiment du propriétaire ou conducteur du
véhicule recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de
procédure pénale.
18. L'ingérence dans la vie privée qui résulte
de la fouille d'un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle
résultant d'une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant
d'établir qu'un tel acte lui a occasionné un grief.
19. En
l'espèce, c'est dès lors, à tort, que l'arrêt attaqué énonce que la fouille du
véhicule pouvait être opérée sans l'assentiment exprès du conducteur.
20.
Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que M. [B] n'établit ni
même n'allègue l'existence d'un grief.
21. Ainsi, le moyen doit être
écarté.
22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
LE REFUS DE SE SOUMETTRE AUX
RELEVES SIGNALETIQUES
La
loi réprime le refus de se soumettre à des opérations de relevés signalétiques
nécessaires à l’alimentation des fichiers de police, par exemple la prise
d’empreintes digitales.
Mais pour que ce refus constitue une infraction, il
faut qu’il soit exprimé par une personne à l’encontre de laquelle il existe une
ou des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre
une infraction.
Les juges doivent constater que ces raisons plausibles
existaient au moment du refus
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du
17 janvier 2024, pourvoi n° 22-86.345 cassation partielle
Vu les articles 55-1 et 485 du code de procédure pénale
:
7. Le premier de ces textes réprime le refus, par une personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se
soumettre aux opérations de relevés signalétiques nécessaires à l'alimentation
et à la constitution des fichiers de police, en particulier à la prise de ses
empreintes digitales.
8. Selon le second, tout jugement de condamnation
doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments
constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.
9.
L'arrêt attaqué relève qu'il n'existe aucun élément démontrant l'appartenance du
prévenu à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de
dégradations.
10. Après requalification de l'infraction de participation
à un tel groupement en port d'arme de catégorie D, les juges relaxent le prévenu
de ce chef, au motif qu'une chaîne avec cadenas de vélo n'entre pas dans la
liste des armes de cette catégorie.
11. Puis, après avoir constaté que le
prévenu a refusé à quatre reprises les opérations de relevés signalétiques, les
juges le déclarent coupable du délit de refus de se soumettre à ces relevés.
12. En se déterminant ainsi, sans caractériser qu'au moment de son refus, il
existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le prévenu avait
commis ou tenté de commettre une infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa
décision.
13. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait
lieu d'examiner l'autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité pour refus de
se soumettre à des relevés signalétiques et à la peine. Les autres dispositions
seront donc maintenues.
LA LOYAUTE DE LA PREUVE
L'affaire Benzema et la sextape de Mathieu Valbuena et de sa femme Fanny.
Une sextape tournée en amoureux et en couple, mais que les principaux intéressés ne veulent pas voir diffuser et que personne ne veut regarder !
Après deux arrêts rendus les 6 mars 2015 et
10 novembre 2017, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient, par la
présente décision, préciser la jurisprudence sur l’étendue de l’obligation
de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale.
La recevabilité des preuves relève des
règles du droit interne et son examen des juridictions nationales, dans le
respect des principes dégagés à cet égard par la Cour européenne au titre du
droit au procès équitable (CEDH, arrêt du 12 juillet 1988, Schenk c. Suisse,
req. n° 10862/84, § 45-46 ; arrêt du 9 juin 1998, Teixeira de Castro c.
Portugal, n°44/1997/828/1034, §34 et 36 ; arrêt du 25 mars 1999, Pelissier
et Sassi c. France, n°25444/94 ; arrêt du 5 février 2008, Ramanauskas c.
Lituanie, req. 74420/01, §54 ; CEDH, GC, arrêt du 15 décembre 2011, Al
Khawaja et Tahery c. Royaume Uni, req. 26766/05 et a., § 118).
 En droit interne, aux termes de l’article
427 du code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par
tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
En droit interne, aux termes de l’article
427 du code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par
tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Toutefois, la liberté de la preuve qui en
résulte n’est pas absolue et se trouve nécessairement limitée par le
principe de légalité, constitutionnellement garanti.
L’autre limite à cette liberté de la preuve,
posée par le principe de loyauté, a été élaborée de manière prétorienne.
De manière constante, la chambre criminelle
de la Cour de cassation considère que le principe de loyauté dans
l’administration de la preuve en matière pénale, qui ne trouve pas à
s’appliquer lorsque des preuves sont produites en justice par des personnes
privées, s’impose aux autorités publiques chargées de l’instruction et des
poursuites.
Il ressort ainsi de sa jurisprudence que le
recours à la ruse ou à un stratagème, par un représentant de l’autorité
publique, est déloyal s’il a pour objet ou effet de pousser à la commission
de l’infraction qui, sans cela, n’aurait pas été commise.
En revanche, la “provocation policière” est
admissible lorsqu’elle n’a pas pour effet de déterminer les agissements
délictueux mais seulement d’en révéler l’existence, afin d’en permettre la
constatation ou d’en arrêter la continuation (Crim., 9 août 2006, pourvoi
n° 06-83.219, Bull. Crim. n°202 ; 4 juin 2008, n° 08-81.045, Bull. n°141 ; 8
juin 2005, n°05-82.012, Bull. n°173 ; 30 avril 2014, n°13-88.162, Bull.
n°119 ; 25 octobre 2000, n°00-80.829, Bull. n° 317 ; 8 juin 2005,
n°05-82.012, Bull. n°173 ; 10 mai 2011, n°10-87.475 ; 17 janvier 2012,
pourvoi n°11-86.471).
La jurisprudence de la chambre criminelle
sanctionne également de manière classique le contournement ou le
détournement de la règle de procédure dont usent les enquêteurs pour
recueillir une preuve (Crim. 16 décembre 1997, pourvoi n°96-85.589, Bull.
Crim. 1997, n°427 ; 15 février 2000, n°99-86.623, Bull. n°68 ; 3 avril 2007,
pourvoi n°07-80.807, Bull. n°102 ; 15 février 2000, pourvoi n°99-86.623,
Bull. n°68).
Cette position a été clairement exprimée par
la formation la plus solennelle de la Cour de cassation à l’occasion d’un
arrêt du 6 mars 2015 (pourvoi n°14-84.339, Bull. Crim. 2015, Ass. plén.
n°2). Dans l’affaire dite des “cellules contiguës”, l’Assemblée plénière a
jugé que le placement, au cours d’une mesure de garde à vue et durant les
périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans
des cellules contiguës, préalablement sonorisées, de manière à susciter des
échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés
comme preuve, constituait un procédé déloyal d’enquête qui avait mis en
échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et,
ainsi, avait porté atteinte au droit à un procès équitable.
À nouveau saisie d’un moyen arguant d’une
implication déloyale de l’autorité publique dans l’administration de la
preuve, l’Assemblée plénière a, par arrêt du 10 novembre 2017 (pourvoi
n°17-82.028, Bull. Crim. 2017, Ass. plén. n°2), statué sur la question de la
participation, directe ou indirecte, de l’autorité publique à l’obtention
d’enregistrements litigieux par un particulier.
Elle a rejeté le pourvoi formé contre un
arrêt qui, pour dire n’y avoir lieu à annulation des procès-verbaux de
retranscription d’enregistrements de conversations privées produites par le
particulier, avait retenu que le seul reproche d’un "laisser faire" des
policiers, dont le rôle n’avait été que passif, ne pouvait suffire à
caractériser un acte constitutif d’une véritable implication.
La nature des actes des enquêteurs apparaît
ainsi déterminante dans la qualification du procédé utilisé, au regard du principe de loyauté des preuves.
Dans la présente affaire, ayant donné lieu à
l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits de tentative de
chantage et association de malfaiteurs, plusieurs des mis en examen
stigmatisaient l’utilisation par les enquêteurs d’un stratagème constitué
d’une combinaison d’actes : intervention d’un policier en qualité de
représentant du plaignant, avec utilisation d’un pseudonyme et participation
à des échanges téléphoniques, dont certains à l’initiative de cet enquêteur.
 Les demandes d’annulation avaient été
rejetées par la chambre de l’instruction de Versailles, dont l’arrêt a été
cassé par la chambre criminelle (11 juillet 2017, pourvoi n°17-80.313) pour
violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et de l’article préliminaire du code
de procédure pénale.
Les demandes d’annulation avaient été
rejetées par la chambre de l’instruction de Versailles, dont l’arrêt a été
cassé par la chambre criminelle (11 juillet 2017, pourvoi n°17-80.313) pour
violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et de l’article préliminaire du code
de procédure pénale.
La chambre de l’instruction de Paris, saisie
sur renvoi, a, quant à elle, dit n’y avoir lieu à annulation d’actes de la
procédure. Elle s’est ainsi inscrite dans le sillage de l’analyse qui avait
été faite par la première chambre de l’instruction saisie de ce dossier.
C’est donc dans le contexte d’une résistance
des juges du fond qu’a été saisie l’assemblée plénière de la Cour de
cassation.
La Cour a été saisie de deux griefs visant
le principe de loyauté dans la recherche de la preuve.
Le premier portait sur la provocation à la
commission de l’infraction, le second, sur l’usage d’un stratagème
prétendument déloyal.
Pour dire que l’intervention de l’enquêteur
n’avait en aucune manière provoqué à la commission de l’infraction, la
chambre de l’instruction avait analysé en détail les actes accomplis par les
personnes mises en cause avant même que le policier n’intervienne comme
intermédiaire et en avait conclu que ces actes, liés de manière indivisibles
aux actes postérieurs, étaient constitutifs d’une tentative de chantage
préexistant à ladite intervention.
L’assemblée plénière juge qu’en l’état de
ces énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu ni le principe de
loyauté des preuves ni les dispositions de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles
préliminaire et 427, 591 et 593 du code de procédure pénale.
La seconde branche du moyen, visant l’emploi
par les enquêteurs d’un stratagème qualifié de déloyal, est celle qui permet
à l’assemblée plénière de préciser une jurisprudence qui donnait lieu à
certaines interprétations ou certains commentaires témoignant, parfois,
d’une confusion entre la preuve apportée par le particulier et celle
recueillie par l’autorité publique, ou quelquefois, d’une confusion entre la
provocation à l’infraction et la “provocation à la preuve”.
Et surtout, elle donne à la Cour de
cassation l’occasion de dire à quelles conditions ou dans quelle mesure un
procédé peut, indépendamment de toute provocation à la commission de
l’infraction, être jugé déloyal et donc de nature à justifier une annulation
de pièces de la procédure.
Pour écarter ce grief, l’assemblée plénière
pose comme principe que :
- le stratagème employé par un agent de
l’autorité publique pour la constatation d’une infraction ou
l’identification de ses auteurs ne constitue pas en soi une atteinte au
principe de loyauté de la preuve,
- seul est proscrit le stratagème qui, par
un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet
ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un
des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne
suspectée ou poursuivie.
Cette précision relative à la nécessité
d’une atteinte à un droit ou une garantie est ainsi essentielle pour
délimiter le champ de la déloyauté.
Or, en l’espèce, les demandeurs au pourvoi,
ainsi que le souligne l’arrêt, ne démontraient ni même n’alléguaient une
quelconque atteinte à l’un de leurs droits.
L'avis du Premier avocat général et son
avis oral à l'audience.
Cour de Cassation, assemblée plénière, arrêt du 9 décembre 2019, pourvoi n° 18-86.767 Rejet
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des
pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. D..., s’estimant victime d’une
tentative de chantage après avoir été approché le 3 juin 2015 par une
personne prétendant détenir un enregistrement audiovisuel à caractère sexuel
dans lequel il apparaissait, a déposé plainte le 8 juin 2015. Un officier de
police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à se faire
passer dans les négociations pour l’homme de confiance du plaignant, a, en
usant d’un pseudonyme, eu du 20 juin au 12 octobre 2015 plusieurs échanges
téléphoniques avec une personne se présentant comme l’intermédiaire des
malfaiteurs.
3. Une information a été ouverte le 31
juillet 2015 et l’enquête a permis d’établir l’existence de cet
enregistrement.
4. Les principaux protagonistes de l’affaire
ont été interpellés le 13 octobre 2015. Ont notamment été mis en examen, le
14 octobre 2015, M. Z... du chef de chantage et association de malfaiteurs,
le 16 octobre 2015, M. H... du chef de tentative de chantage en récidive et
association de malfaiteurs, le 5 novembre 2015, M. X... du chef
d’association de malfaiteurs et complicité de tentative de chantage et, le
même jour, M. Y..., pour association de malfaiteurs et complicité de
tentative de chantage en état de récidive légale.
5. Par arrêt du 16 décembre 2016, la chambre
de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a rejeté les requêtes
déposées par MM. H..., Y... et X... sur le fondement de l’article 173 du
code de procédure pénale et la demande de nullité formée par mémoire par
M. Z..., tendant à l’annulation de la procédure en raison notamment de la
provocation à l’infraction dont ils auraient fait l’objet de la part d’un
fonctionnaire de police. La Cour de cassation (Crim., 11 juillet 2017,
pourvoi n° 17-80.313), statuant sur les pourvois formés par les seuls
MM. X... et Y..., a cassé et annulé cet arrêt.
6. Par arrêt du 8 novembre 2018, la chambre
de l’instruction de la cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi, a dit la
saisine recevable et, au fond, a dit n’y avoir lieu à annulation de pièces
de la procédure. MM. X..., Y... et Z... ont formé des pourvois en cassation,
qui ont été joints par une ordonnance du président de la chambre criminelle
de la Cour de cassation du 14 janvier 2019 prescrivant leur examen immédiat.
Par arrêt du 19 juin 2019, la chambre criminelle a renvoyé l’affaire en
Assemblée plénière.
II. Examen des moyens
Sur les moyens proposés par M. Z...
dans ses mémoires personnels et le moyen, pris en ses trois premières
branches, proposé pour M. Z...
Enoncé des moyens
7. Les deux premiers moyens du premier
mémoire personnel de M. Z... et le premier moyen de son second mémoire
personnel sont pris de la violation des règles de l’opération
d’infiltration, prévues par les articles 706-81 à 706-87 du code de
procédure pénale, et des règles de l’enquête sous pseudonyme, prévues par
les articles 706-81 à 706-87 et 706-87-1 du code de procédure pénale.
8. Ils critiquent l’arrêt attaqué en ce
qu’il n’a pas statué sur le moyen de nullité tiré du non respect des règles
relatives à l’opération d’infiltration, alors :
1°/ que le procédé d’enquête utilisé par
l’enquêteur, par lequel il s’est substitué à la victime en usant d’un
pseudonyme et se faisant passer pour un intermédiaire mandaté par ladite
victime, ne peut être appréhendé que comme une opération d’infiltration ;
2°/ qu’aucune pièce de la procédure ne
permet d’appréhender l’autorisation écrite délivrée par le parquet à
l’enquêteur ;
3°/ que dans son arrêt du 11 juillet
2017 (pourvoi n° 17-80.313), la chambre criminelle de la Cour de cassation a
jugé qu’en application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article préliminaire
du code de procédure pénale, « porte atteinte au droit à un procès équitable
et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la
recherche par un agent de la force publique ».
9. Le troisième moyen du premier mémoire
personnel de M. Z... et le second moyen de son second mémoire personnel, qui
sont identiques, sont pris de la violation du principe de loyauté des
preuves, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 591 et 593 du code
de procédure pénale.
10. Ils critiquent l’arrêt en ce qu’il a
rejeté le moyen de nullité tiré de l’existence d’une provocation à la
commission de l’infraction, alors que, toute provocation à la commission
d’une infraction étant prohibée et l’intervention de l’agent ne pouvant
avoir pour effet que de révéler des infractions déjà commises ou en train de
se commettre et d’en arrêter la continuation, la chambre de l’instruction ne
pouvait écarter l’existence d’une provocation à la commission de
l’infraction sans mieux rechercher le rôle actif joué par ce représentant de
l’autorité publique.
11. En ses trois premières branches, le
moyen du mémoire déposé pour M. Z... est pris de la violation de l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, des articles 450-1, 450-3, 312-10, 312-13 du code pénal, des
articles préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, de la
violation du principe de la loyauté procédurale et des droits de la défense,
de défaut de motifs et de réponse à conclusions.
12. Il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il
a rejeté le moyen de nullité tiré de l’existence d’une provocation à la
commission de l’infraction en raison de l’intervention active et déloyale du
policier alias « Lukas », alors :
« 1°/ que porte atteinte au droit à un
procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en
vicie la recherche par un agent de la force publique ; qu’en l’espèce, il
ressort tant des pièces de la procédure que des énonciations de l’arrêt que
d’une part, le procureur de la République avait donné instruction à un
officier de police judiciaire de se substituer à C... D... dans les
négociations avec les auteurs de l’infraction supposée, que cet enquêteur
avait entretenu plusieurs conversations téléphoniques, tant à son initiative
qu’à celle de ces interlocuteurs, notamment avec l’un d’entre eux des mois
de juin à octobre 2015, qu’enfin cet officier de police judiciaire ne
s’était identifié au cours de ces communications qu’en qualité de
représentant de C... D... et sous le pseudonyme de « Lukas », d’autre part,
ces conversations, dont certaines ont fait l’objet d’interceptions, ont
conduit à l’interpellation des mis en cause ; qu’une telle participation
directe et active de l’autorité publique à l’obtention des preuves vicie la
procédure ; que dès lors, en refusant de constater l’atteinte au droit à un
procès équitable et au principe de loyauté des preuves, la chambre de
l’instruction n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et
a ainsi violé les textes et principes susvisés ;
2°/ que la chambre de l’instruction,
pour écarter l’atteinte au droit à un procès équitable et au principe de
loyauté des preuves, s’est bornée à relever que l’action du commissaire de
police s’inscrivait dans le cours de la réalisation de l’infraction
instantanée et complexe de tentative de chantage de telle sorte qu’elle ne
constituait ni un stratagème ou une machination ayant été de nature à
déterminer les agissements délictueux, portant atteinte à la loyauté de la
preuve, ni une provocation ayant été de nature à inciter les mis en examen à
commettre une infraction qu’autrement ils n’auraient pas commise ; qu’en se
prononçant par un tel motif inopérant, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
3°/ que M. Z... faisait valoir à l’appui
de la demande de nullité de la procédure que l’infraction de chantage ne
rentre pas dans le champ des infractions pour lesquelles le recours au
pseudonyme ou à l’infiltration est possible ; qu’en refusant de prononcer la
nullité du procédé utilisé par l’autorité publique, sans répondre à ce moyen
péremptoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard
des textes et principes susvisés ».
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Il résulte des dispositions combinées
des articles 567 et 609-1 du code de procédure pénale qu’après cassation,
l’affaire est dévolue à la chambre de l’instruction de renvoi dans les
limites de l’acte de pourvoi et dans celles fixées par l’arrêt rendu sur le
pourvoi. En conséquence, seules sont recevables à proposer des moyens de
nullité devant la chambre de l’instruction de renvoi les parties sur le
pourvoi desquelles la cassation a été prononcée (Crim, 19 mars 2019, pourvoi
n° 01-88.240).
15. Par ailleurs, il est de jurisprudence
constante qu’est irrecevable, faute d’intérêt, le moyen qui reproche à la
cour d’appel d’avoir rejeté une exception qu’elle aurait dû en réalité
déclarer irrecevable.
16. En l’espèce, M. Z..., qui ne s’était pas
pourvu contre l’arrêt du 16 décembre 2016 annulé par la Cour de cassation,
était sans qualité pour proposer devant la juridiction de renvoi un moyen
pris de la nullité de la procédure. En conséquence, il ne peut être admis à
critiquer les motifs par lesquels la chambre de l’instruction de Paris a dit
n’y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.
17. Les moyens sont donc irrecevables.
Sur le moyen, pris en sa quatrième
branche, présenté pour M. Z...
Enoncé du moyen
18. Le moyen est pris de la violation de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, des articles préliminaire, 450-1, 450-3, 312-10,
312-13 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, du principe de
la loyauté procédurale et des droits de la défense.
19. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce
qu’il rejette le moyen de nullité tiré de l’existence d’une provocation à la
commission de l’infraction en raison de l’intervention active et déloyale du
policier alias « Lukas », alors que « les juges en charge d’examiner les
moyens de nullité de la procédure ne peuvent pas se prononcer sur la
culpabilité des personnes uniquement mises en examen et non définitivement
jugées ; dès lors, en faisant référence à la culpabilité de M. Z..., par
l’utilisation d’expressions telles que « le malfaiteur » ou « le
maître-chanteur », la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’une
violation de la présomption d’innocence ainsi que des textes et principes
susvisés ».
Réponse de la Cour
20. Ce moyen est recevable comme étant né de
la décision attaquée.
21. Il est mentionné en page 4 de l’arrêt
que : « dès le 20 juin, Lukas prenait contact avec le malfaiteur » et « le
malfaiteur adressait ensuite, le 11 août », puis « le 25 septembre, le
maître-chanteur adressait deux SMS ».
22. Ces mentions figurent dans le descriptif
détaillé des faits et il ressort de la procédure, exposée dans l’arrêt, que
cette personne allait être ultérieurement identifiée comme étant M. Z....
23. Cependant, il n’en résulte pas que la
chambre de l’instruction a tenu pour établie la culpabilité de M. Z... de
sorte qu’elle n’a pas méconnu la présomption d’innocence.
24. Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le moyen, pris en sa seconde
branche, présenté pour MM. X... et Y...
Enoncé du moyen
25. Le moyen est pris de la violation du
principe de loyauté des preuves, de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles
préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale.
26. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce
qu’il rejette le moyen de nullité tiré de la violation du principe de la
loyauté des preuves, alors que, « en vertu du principe de loyauté de la
preuve, toute provocation à la commission d’une infraction est prohibée,
l’intervention de l’agent ne pouvant avoir pour effet que de révéler des
infractions déjà commises ou en train de se commettre et d’en arrêter la
continuation ; que c’est par des motifs erronés que la chambre de
l’instruction a considéré, pour retenir que l’intervention de l’officier de
police judiciaire ne constituait pas une provocation à la commission d’une
infraction, que le délit de tentative de chantage est une infraction
complexe dont les différents actes matériels, qui la constituent, seraient
en l’espèce intervenus entre le 3 juin 2015 et l’interpellation de
l’exposant, au mois d’octobre, lorsque chacun de ces actes matériels
s’analyse comme un commencement d’exécution et donc autant de tentatives de
chantage, autonomes et distinctes les unes des autres ».
Réponse de la Cour
27. Constitue une violation du principe de
loyauté de la preuve toute provocation à la commission de l’infraction de la
part des agents de l’autorité publique.
28. Pour dire n’y avoir lieu à annulation
d’un acte ou d’une pièce de procédure, l’arrêt retient que l’obtention
frauduleuse de l’enregistrement vidéo, les tractations entre les personnes
mises en cause pour trouver le meilleur moyen d’exercer un chantage sur
M. D..., les appels téléphoniques et les messages adressés à cet effet à ce
dernier, les instructions qui lui ont été données pour qu’il trouve un
intermédiaire, les rendez-vous fixés à Alger puis à Paris ou encore la
rencontre organisée avec M. X... à Clairefontaine constituent des
agissements étroitement liés les uns aux autres et accomplis dans le dessein
unique d’obtenir la remise de fonds par M. D....
29. L’arrêt ajoute que les laps de temps
plus ou moins longs qui se sont écoulés entre ces différents épisodes ne
sauraient être assimilés à des désistements de la part des mis en cause, dès
lors qu’il ressort clairement de la procédure que ces derniers avaient un
plan très abouti pour parvenir à la remise des fonds. Il en déduit que le
policier qui a tenu un rôle d’intermédiaire s’est inséré dans un processus
infractionnel indivisible caractérisant une entreprise de chantage et n’a en
aucune manière provoqué à la commission de l’infraction.
30. En l’état de ces énonciations, la
chambre de l’instruction n’a méconnu ni le principe ni les textes invoqués.
31. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa première
branche, présenté pour MM. X... et Y...
Enoncé du moyen
32. Le moyen est pris de la violation du
principe de loyauté des preuves, de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles
préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale.
33. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce
qu’il rejette le moyen de nullité tiré de la violation du principe de la
loyauté des preuves, alors que « porte atteinte au droit à un procès
équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie
la recherche par un agent de la force publique ; qu’en écartant le moyen de
nullité, quand il ressort pourtant des pièces de la procédure et de l’arrêt
attaqué que, sur instruction du procureur de la République, M. K...,
commissaire de police, s’est substitué à M. D... dans les négociations avec
les auteurs des infractions supposées, et qu’en se faisant passer pour « Lukas »,
représentant de la partie civile, il a entretenu des conversations avec ces
derniers, entre le 20 juin 2015 et le mois d’octobre de la même année, à
plusieurs reprises à son initiative, lesquelles ont conduit à
l’interpellation des mis en cause, la chambre de l’instruction a violé le principe susvisé ».
Réponse de la Cour
34. Le stratagème employé par un agent de
l’autorité publique pour la constatation d’une infraction ou
l’identification de ses auteurs ne constitue pas en soi une atteinte au
principe de loyauté de la preuve.
35. Seul est proscrit le stratagème qui, par
un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet
ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un
des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne
suspectée ou poursuivie.
36. En l’espèce, le moyen, qui se borne à
invoquer le fait que le procédé prétendument déloyal a conduit à
l’interpellation de MM. X... et Y..., sans démontrer ni même alléguer une
atteinte à l’un de leurs droits, n’est pas fondé.
37. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois
REPARATION CIVILE AU
PENAL
Si le jugement est frappé d’appel, la cour d’appel doit statuer sur ce qui a été jugé, puis renvoyer aux premiers
juges ce qui n’a pas été tranché, de façon à ne pas priver les parties d’un double degré de juridiction.
Il existe néanmoins une exception à ce principe
: la cour d'appel est tenue de se prononcer sur les demandes d’indemnisation qui n’ont pas été tranchées par les premiers juges lorsque le renvoi exposerait
ceux-ci à contredire leur décision.
Ainsi, dans le cas où la cour d’appel condamne l’un des prévenus alors qu’il avait été relaxé par le tribunal, elle ne
peut renvoyer l’affaire sur les intérêts civils devant le tribunal correctionnel et doit elle-même statuer
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 17 janvier 2024, pourvoi N° 22-86.326 cassation
11. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 509, 520 et 593 du code de procédure pénale :
12. Il résulte des deux premiers textes que la cour d'appel est tenue
d'évoquer les points du litige relatifs à l'action civile qui n'ont pas été
tranchés par les premiers juges lorsque le renvoi devant ces derniers les
exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé.
13. Selon le
troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier
la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties.
L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence
.14.
Après avoir prononcé sur l'action publique et, par infirmation du jugement,
déclaré les deux prévenus coupables, la cour d'appel a renvoyé l'affaire devant
le tribunal correctionnel, afin qu'il statue sur les demandes présentées par M.
[P] [K], partie civile.
15. En se déterminant ainsi, la
cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16. En effet, d'une part,
elle n'a pas répondu aux conclusions déposées par M. [P] [K] qui réclamait, par
infirmation du jugement, la réparation du préjudice causé par l'infraction à la
victime, de son vivant, l'indemnisation du préjudice porté à la succession de
celle-ci par les agissements des prévenus, et la réparation du préjudice
résultant de la réduction de ses droits dans la succession.
17.
D'autre part, elle a exposé la juridiction du premier degré à contredire ses
propres décisions, le tribunal ayant écarté l'existence d'un préjudice matériel,
ainsi que la responsabilité de Mme [N], relaxée en première instance et
condamnée en appel.
18. La cassation est par conséquent encourue
de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
19. Elle portera sur les seules dispositions civiles de l'arrêt concernant
les demandes de M. [P] [K], partie civile. Les dispositions pénales et les
autres dispositions civiles seront maintenues.
Examen des demandes
fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
20. Les
dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit
total ou partiel. Les déclarations de culpabilité de M. [D] et Mme [N] étant
devenues définitives par suite de la non-admission de leurs pourvois, il y a
lieu de faire partiellement droit aux demandes de M. [P] [K].
L'ABANDON DE FAMILLE
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du
31 janvier 2024, pourvoi N° 23-81.704 cassation partielle
QUATRIEME MOYEN
Vu les articles 111-3 et 132-45 du code pénal :
8. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est
pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit.
9. Le
second dresse la liste exhaustive des obligations dont la juridiction de
condamnation peut imposer spécialement le respect à la personne condamnée à une
peine assortie du sursis probatoire. Parmi celles-ci figure l'obligation de
s'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone
spécialement désignée, mais ne figure pas l'interdiction de quitter le
territoire national.
10. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a interdit
au condamné de quitter le territoire national, sur le fondement de l'article
132-45, 9°, du code pénal.
11. En prononçant ainsi, alors que
ladite peine n'est pas prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes
susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est
par conséquent encourue de ce chef.
CINQUIEME MOYEN
Vu les articles 3 et 593 du code de procédure pénale :
14. Il résulte du premier de ces textes que l'action civile, lorsqu'elle
est exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction,
n'est recevable que pour les chefs de dommages qui découlent des faits objet de
la poursuite.
15. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit
contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la
contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Par motifs
adoptés, l'arrêt attaqué, après avoir reconnu le prévenu coupable d'abandon de
famille, pour la période du 30 juin 2014 au 30 juin 2020, l'a condamné à verser
à la partie civile la somme de 42 300 euros au titre de son préjudice financier.
17. Les juges précisent que le prévenu doit à la partie civile, depuis 2008,
cette somme de 42 300 euros, dont 21 600 euros au titre de la prévention.
18. En prononçant ainsi, sans préciser la nature et le montant du
préjudice subi par la partie civile qu'elle a entendu réparer, et alors que la
plainte en abandon de famille n'a pas pour objet le règlement des sommes dues au
titre de la pension alimentaire, mais l'obtention de dommages et intérêts à la
suite du défaut de paiement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
19. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation
sera limitée aux peines, et aux dispositions civiles. Les autres dispositions
seront donc maintenues.
LE CANNABIS AUTORISE EN FORME DE MEDICAMENT
Le Décret
n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 est relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis, pour trois ans.
L'IRRESPONSABILITE PENALE
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 14 avril 2021, pourvoi N° 20-80.135 rejet
Sur le deuxième moyen proposé pour Mme E... Y..., Mme D... Y... et M. F... Y...
9. Pour déclarer irrecevables les appels
formés par les parties civiles contre l’ordonnance de transmission de
pièces, l’arrêt attaqué relève qu’aucune disposition du code de procédure
pénale ne prévoit que cette ordonnance, visée à l’article 706-120 du même
code, puisse faire l’objet d’un appel des parties civiles. 10. Les juges
retiennent que la partie civile ne peut interjeter appel, sur le fondement
de l’article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, que des ordonnances
de non-informer, de non-lieu, et des ordonnances faisant grief à ses
intérêts civils.
11. Ils soulignent que l’ordonnance de
transmission de pièces tend à la saisine de la chambre de l’instruction
devant laquelle la partie civile peut faire valoir ses arguments ; que, si
elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en
examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier
alinéa de l’article 122-1 du code pénal n’est pas applicable, la chambre de
l’instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de
jugement compétente et qu’enfin l’article 706-125 du code de procédure
pénale dispose que dans l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale, la
chambre de l’instruction, si la partie civile le demande, se prononce sur la
responsabilité civile de la personne, conformément à l’article 414-3 du code
civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts.
12. La chambre de l’instruction conclut que
cette ordonnance ne fait pas grief aux intérêts civils des parties.
13. En statuant ainsi, la chambre de
l’instruction a justifié sa décision.
14. En effet, la partie civile, qui est
appelée aux débats, peut exercer devant la chambre de l’instruction les
droits qu’elle tire des articles 706-122 et suivants du code de procédure
pénale.
15. L’ordonnance de transmission de pièces
n’est ni définitive ni attributive de compétence puisque la chambre de
l’instruction peut, soit rendre un arrêt de non-lieu ou de renvoi devant le
tribunal correctionnel ou la cour d’assises, soit rendre un arrêt
d’irresponsabilité pénale.
16. Elle laisse ainsi intacts les droits de
la partie civile et ne fait pas grief à ses intérêts.
17. Le moyen doit, en conséquence, être
rejeté.
Sur les troisième et quatrième
moyens proposés pour Mme E... Y..., Mme D... Y... et M. F... Y... et sur les
six premières branches du moyen unique proposé pour Mme A... X..., M. C...
X... et Mme B... X..., repris par Mme E... Y..., Mme D... Y... et M. F...
Y...
22. Pour dire qu’il existe des charges
suffisantes contre M. Z... d’avoir arrêté, enlevé, détenu ou séquestré la
famille P..., et donné la mort à Mme X..., l’arrêt énumère les éléments
matériels réunis contre l’intéressé, constitués de ses déclarations, des
constatations expertales et des différents témoignages recueillis.
23. Les juges retiennent également que les
déclarations de M. Z..., disant qu’il s’était senti plus oppressé après
avoir vu la torah et le chandelier, et qu’il pensait que le démon était
Mme X..., jointes aux témoignages indiquant l’avoir entendu crier « Allah
Akbar, c’est le sheitan, je vais la tuer », puis « j’ai tué le sheitan » et
« j’ ai tué un démon », et aux constatations des experts selon lesquelles la
connaissance du judaïsme de Mme X... a conduit la personne mise en examen à
associer la victime au diable, et a joué un rôle déclencheur dans le
déchaînement de violence contre celle-ci, constituent des charges
suffisantes de commission des faits à raison de l’appartenance de la victime
à la religion juive.
24. Pour dire que le discernement de la
personne mise en examen était aboli au moment des faits, l’arrêt relève que
le récit de M. Z..., corroboré par celui des membres de sa famille et de la
famille P..., montre que ses troubles psychiques avaient commencé le 2 avril
2017, et ont culminé dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, dans ce que les
experts psychiatres ont décrit de manière unanime comme une bouffée
délirante.
25. Les juges relèvent que seul le premier
expert saisi a estimé qu’en dépit du caractère indiscutable du trouble
mental aliénant, le discernement de M. Z... ne pouvait être considéré comme
ayant été aboli, au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, du
fait de la consommation volontaire et régulière de cannabis ; que le
deuxième collège d’experts a estimé que la bouffée délirante s’est avérée
inaugurale d’une psychose chronique, probablement schizophrénique et que ce
trouble psychotique bref a aboli son discernement, que l’augmentation toute
relative de la prise de cannabis s’est faite pour apaiser son angoisse et
son insomnie, prodromes probables de son délire, ce qui n’a fait qu’aggraver
le processus psychotique déjà amorcé ; que le troisième collège d’experts a
estimé que le sujet a présenté une bouffée délirante caractérisée d’origine
exotoxique orientant plutôt classiquement vers une abolition du discernement
au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, étant précisé qu’au
moment des faits son libre arbitre était nul et qu’il n’avait jamais
présenté de tels troubles antérieurement.
26. Les juges ajoutent que la circonstance
que cette bouffée délirante soit d’origine exotoxique et due à la
consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit
reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli
son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu’aucun élément du
dossier d’information n’indique que la consommation de cannabis par
l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de
stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation.
27. Ils concluent qu’il n’existe donc pas de
doute sur l’existence, chez M. Z..., au moment des faits, d’un trouble
psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de
ses actes.
28. En l’état de ces énonciations, déduites
de son appréciation souveraine des faits et des preuves, la chambre de
l’instruction a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux
chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs
pour lesquels elle a déclaré, d’une part, qu’il existait à l’encontre de
M. Z... des charges d’avoir commis les faits reprochés, d’autre part, qu’il
était irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou
neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au
moment des faits.
29. En effet, les dispositions de l’article
122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du
trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement.
30. Les moyens doivent, en conséquence, être
rejetés.
LA RESPONSABILITÉ PÉNALE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE
OUI, mais pour l'indemnisation il faudra ensuite saisir le juge administratif
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 24 octobre 2017 Pourvoi N° 16-85975 Cassation partielle sans renvoi
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf disposition contraire, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences
dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif ;
Attendu qu'après avoir déclaré le SYMADREM coupable d'homicide involontaire sur la personne de Martin X..., l'arrêt le déclare entièrement et seul
responsable des conséquences de l'accident et le condamne à payer diverses sommes à ses ayants-droit, parties civiles, en réparation de leurs préjudices ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que
le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE ET DES RESPONSABLES POLITIQUES
LA RESPONSABILITÉ POUR NÉGLIGENCE, LE COUPABLE EST L'ÉPOUSE !
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 22 février 2017 Pourvoi N° 15-87328 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., président d'une communauté de communes et d'un
syndicat intercommunal, est poursuivi pour avoir, par sa négligence, permis le détournement de fonds publics, soit d'une somme de 799 756, 17
euros, commis par Mme Y..., secrétaire générale de ladite communauté ; que déclaré coupable de ce délit par le tribunal, il a interjeté appel ; que
M. Y..., cité du chef de recel de détournement de fonds commis par son épouse, a été renvoyé des fins de la poursuite ; que le procureur de la
République a interjeté appel, ainsi que le syndicat en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X..., les juges relèvent qu'il a signé, d'août 2004 à avril 2012, sans procéder à des
vérifications élémentaires qui auraient révélé des anomalies patentes, les ordres de paiement étayés de quarante-sept fausses factures confectionnées à
l'adresse du syndicat par Mme Y..., secrétaire générale de la dite communauté, qu'elle lui a présentés et qui ordonnaient le virement des montants qui y
figuraient au compte bancaire personnel de son époux, M. Hervé Y..., ainsi crédité sans raison par le Trésor public d'une somme totale de 799 756, 17 euros ;
Que les juges ajoutent qu'en s'abstenant de lire les documents présentés à sa signature par la secrétaire générale, en laquelle il
avait une confiance aveugle, et en validant, sans en contrôler le contenu, des factures mensongères censées avoir été établies par une société SARL Y... qui,
à sa connaissance, n'était pas en rapport d'affaires avec le syndicat qu'il présidait, M. X... a manqué aux devoirs de sa charge et commis une faute de
négligence au sens de l'article 432-16 du code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la
cause, et dès lors que l'article 432-16 du code pénal, fondement de la condamnation, n'exige pas, pour que le délit soit caractérisé, la violation
délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
L'AIDE BENEVOLE AUX
ETRANGERS
L'article 1er de la directive 2002/90/CE du Conseil du
28 novembre 2002 permet de réprimer l'aide apportée à l'entrée irrégulière
sur le territoire d'un Etat de l'Union, sans imposer d'immunité, en cas de
poursuite d'un but humanitaire. L'interdiction de poursuivre pénalement un
étranger qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement en cours,
n'interdit pas de poursuivre pénalement une personne qui a aidé cet
étranger à franchir une frontière d'un Etat de l'Union. La personne qui,
dans un but humanitaire, apporte une aide à l'entrée sur le territoire
français, favorise la commission d'une infraction et ne peut bénéficier de
l'immunité prévue en cas d'aide, poursuivant le même but, apportée au
séjour et à la circulation
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 25 janvier 2023 Pourvoi N° 21-86.839 Rejet
14. Pour refuser de saisir la Cour de justice de l'Union
européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de
l'Union de la répression pénale de l'aide au franchissement irrégulier d'une
frontière dans un but humanitaire, la cour d'appel énonce que l'article 1er de
la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à
l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, prévoit que chaque Etat membre
adopte les sanctions appropriées à l'encontre de quiconque aide sciemment une
personne non ressortissante d'un Etat membre à pénétrer sur le territoire d'un
Etat membre ou d'y transiter en violation de sa législation relative à l'entrée
et au séjour des étrangers, un Etat membre pouvant exclure le prononcé de
sanction si ce comportement vise à apporter une aide humanitaire.
15. Elle ajoute que le demandeur ne se trouve pas dans la situation d'un
étranger en séjour irrégulier, qui ne peut faire l'objet de poursuites pénales
tant que la procédure administrative d'éloignement engagée à son égard n'est pas
conduite à son terme.
16. Elle en déduit l'absence de contradiction entre les dispositions de
l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile et la directive susvisée.
17. En prononçant ainsi, et en déclarant le prévenu coupable d'aide à
l'entrée irrégulière d'un étranger, après avoir constaté qu'il avait pris en
charge dans son véhicule pour franchir la frontière, depuis l'Italie, un
étranger démuni de titre lui permettant l'entrée et le séjour en France, la cour
d'appel a fait l'exacte application des dispositions du droit de l'Union et du droit interne.
18. En effet, d'une part, l'article 1er de la directive 2002/90/CE du Conseil du
28 novembre 2002 permet de réprimer l'aide apportée à l'entrée irrégulière sur
le territoire d'un Etat de l'Union, sans imposer d'immunité en cas de poursuite
d'un but humanitaire.
19. D'autre part, l'interdiction de poursuivre pénalement un étranger qui
fait l'objet d'une procédure d'éloignement en cours, n'interdit pas de
poursuivre pénalement une personne qui a aidé cet étranger à franchir une
frontière d'un Etat de l'Union, et qui, elle-même, ne fait pas l'objet d'une
procédure d'éloignement, compte tenu de la différence de leurs situations respectives.
20. Par ailleurs, la personne qui, dans un but humanitaire, apporte une aide à
l'entrée sur le territoire français, favorise la commission d'une infraction, ce
qui explique qu'elle ne puisse bénéficier de l'immunité prévue en cas d'aide,
poursuivant le même but, apportée au séjour et à la circulation.
21. Enfin, l'interprétation des règles communautaires s'impose ainsi avec une
évidence qui ne laisse pas place à un doute raisonnable, ce qui justifie de
rejeter la demande de transmission à la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
22. Le moyen ne peut donc être accueilli.
LA PRISE ILLEGALE D'INTERÊTS
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 5 avril 2023 Pourvoi N° 21-87.217 Rejet
15. Les moyens sont réunis.
16. Pour déclarer les prévenues respectivement coupables des chefs susvisés,
l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'en sa qualité de directrice générale des
services, Mme [S] avait autorité sur l'ensemble des services de la commune et
que son activité consistait, en particulier, à préparer et à exécuter les
décisions du conseil municipal aux séances duquel elle assistait ainsi qu'à
assurer une surveillance générale des affaires de la collectivité.
17. Les juges retiennent que Mme [S] avait en charge le contrôle de l'opération
portant sur la zone artisanale conduite par la commune dans le cadre de ses
fonctions de directrice générale des services et qu'en signant un acte d'achat
d'un lot attribué au cours de cette opération pour le compte de la société dont
elle était la gérante, Mme [S] s'est bien rendue auteur du délit de prise illégale d'intérêts.
18. En l'état de ces énonciations qui caractérisent le délit de prise illégale
d'intérêts au regard du texte alors applicable, l'annulation n'est pas encourue.
19. En effet, les prévisions de l'article 432-12 du code pénal dans sa rédaction
issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 aux termes de laquelle
l'intérêt doit être de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou
l'objectivité de l'auteur du délit sont équivalentes à celles résultant de sa
rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par
une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où
son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge, a
entendu garantir, dans l'intérêt général, l'exercice indépendant, impartial et
objectif des fonctions publiques (Crim., 19 mars 2014, QPC n° 14-90.001 ; Crim., 20 décembre 2017, QPC n° 17-81.975).
20. Dès lors les moyens ne sont pas fondés.
LES ATTAQUES CONTRE L'AVIATION CIVILE
La LOI
n° 2016-1323 du 7 octobre 2016 autorise la ratification de la convention sur la
répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale et du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs.
COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC ET DES DROGUES
Commission nationale consultative des droits de l'homme :
Avis
« usages de drogues et droits de l'homme »
La
LOI
n° 2015-1350 du 26 octobre 2015 autorise la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.
Une drogue n'est une drogue que si elle est reconnue comme telle, par arrêté ministériel
Article 222-41 du Code Pénal
Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de
l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.
ARTICLE L324-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs
exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les
travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.
ARTICLE 222-37 DU CODE PÉNAL
Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au
moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de
l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 14 mars 2017 Pourvoi N° 16-81805 Cassation
Vu les articles L. 3421-1 du code de la santé publique, 222-37 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu les dispositions spéciales du premier de ces textes, incriminant l'usage illicite de produits stupéfiants, excluent l'application du second,
incriminant la détention de tels produits, si les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'interpellé pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui à l'occasion
de la conduite d'un véhicule à moteur, M. X... a été trouvé porteur de trois grammes de cannabis ; qu'il a déclaré consommer quotidiennement environ trois
grammes de ce produit depuis une dizaine d'années ; que, le tribunal correctionnel l'ayant déclaré coupable de mise en danger de la vie d'autrui et
de détention de stupéfiants, il a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du chef de détention de stupéfiants, l'arrêt énonce que le prévenu a été interpellé en possession de
trois grammes de résine de cannabis et a reconnu faire usage de cette substance depuis plusieurs années ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser des faits de détention indépendants de la consommation personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI
Le délit de mise en danger consiste à
exposer une personne à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par
méconnaissance d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité «
imposée par la loi ou le règlement ». L’obligation méconnue doit ainsi avoir
une source légale ou réglementaire que les juges doivent identifier.
L’infraction peut-elle être constituée au préjudice de salariés d’une usine
exploitée à l’étranger par la filiale étrangère d’une société française ?
Non, sauf si leur contrat de travail est régi par la loi française. En effet,
l’obligation méconnue ne peut résulter que de dispositions françaises.
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 16
janvier 2024
pourvoi n° 22-83.681 cassation
Vu les articles 8 du Règlement (CE) n° 593/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, 223-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure
pénale :
29. Selon le premier de ces textes, pris en ses deuxième et
quatrième paragraphes, applicable sous réserve des dispositions de l'article 9
du même règlement, à défaut de choix exercé par les parties, le contrat
individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à
partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit
habituellement son travail. Ce n'est que s'il résulte de l'ensemble des
circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre
pays que la loi de ce dernier s'applique à la relation de travail.
30.
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, le juge qui analyse
l'existence de tels liens doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui
caractérisent la relation de travail et apprécier ceux qui sont les plus
significatifs, parmi lesquels le pays où le salarié s'acquitte des impôts et
des taxes afférents aux revenus de son activité, celui dans lequel il est
affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d'assurance
maladie et d'invalidité, ainsi que les paramètres liés à la fixation du
salaire ou des autres conditions de travail (CJUE, arrêt du 12 septembre 2013,
Schlecker, C-64/12).
31. Il résulte des deux derniers textes qu'une
juridiction d'instruction ne peut procéder à une mise en examen du chef de
mise en danger d'autrui sans avoir préalablement constaté l'existence de
l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le
règlement dont la violation manifestement délibérée est susceptible de
permettre la caractérisation du délit (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°
22-82.535, publié au Bulletin).
32. Le moyen pose notamment la question
de savoir si l'infraction de mise en danger d'autrui peut être constituée
lorsqu'en application des règles de conflit de lois précitées, la loi
française est écartée au profit d'une loi étrangère.
33. En prévoyant
que cette obligation particulière de prudence ou de sécurité est imposée par
la loi ou le règlement, l'article 223-1 susvisé, lu à la lumière des articles
34 et 37 de la Constitution, renvoie nécessairement à des dispositions de
droit français.
34. Dès lors, l'interprétation qui permettrait de
caractériser ce délit en présence de la violation de dispositions de droit
étranger aurait pour conséquence d'étendre la portée de l'incrimination et
contreviendrait au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, énoncé
à l'article 111-4 du code pénal.
35. En outre, une telle
interprétation priverait d'effet utile l'article 111-5 du même code, puisque
les juridictions pénales ne pourraient exercer pleinement leur pouvoir
d'interprétation des actes réglementaires et le contrôle de légalité de
ceux-ci, lorsqu'en dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
36. En l'espèce, pour décider que la loi française était applicable à la
relation de travail entre la société [6] et les salariés de sa filiale de
droit étranger et considérer que cette société est susceptible d'avoir méconnu
les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du
travail français, l'arrêt attaqué énonce que l'immixtion permanente de la
maison-mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale [7] a pour
conséquence l'existence d'un lien étroit entre la France et les contrats de
travail des salariés syriens.
37. Les juges retiennent que ce lien est
caractérisé notamment dans le fait que « [7] est une filiale contrôlée
indirectement à hauteur de 98,7% par [6], laquelle a mené une opération de
financement global de la société, les fonds remis servant à faire face à
toutes les dépenses de la filiale, notamment le paiement de ses fournisseurs.
»
38. Ils ajoutent que les deux « patrons de pays » successifs en
charge de la société [7] ont été recrutés par le directeur adjoint
opérationnel de la société [6], « superviseur » d'une quinzaine de pays, dont
la Syrie.
39. Ils relèvent que la société [6] a organisé des réunions
hebdomadaires entre ses responsables sûreté et le comité sûreté de la société
[7], a élaboré le plan global de sécurité de l'usine syrienne et a pris les
mesures touchant à la sécurité des travailleurs.
40. Ils en déduisent
que la sûreté de l'usine de [Localité 4] a été prise en charge non par la
société [7] mais par la société-mère, qui a décidé de maintenir ce site de
production ouvert en dépit des risques et a ainsi contraint les salariés de sa
filiale à se rendre quotidiennement à l'usine.
41. En statuant ainsi,
la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes
ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
42. En premier lieu,
la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'absence de contrat de
travail et avoir relevé que les salariés accomplissaient habituellement leur
travail sur le territoire syrien, ne pouvait écarter l'application de la loi
syrienne en se déterminant au regard de considérations relatives aux seules
relations entre la maison-mère et sa filiale, éléments insuffisants à
caractériser que les contrats de travail des salariés syriens travaillant à
[Localité 4] présentaient des liens plus étroits avec la France qu'avec la
Syrie.
43. Par ailleurs, aucun des éléments allégués n'est de nature à
caractériser de tels liens au jour de la mise en examen.
44. En
deuxième lieu, les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R.
4141-13 du code du travail français ne peuvent être qualifiées de lois de
police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (Rome I).
45. Enfin, la chambre de l'instruction ne
pouvait énoncer, à titre surabondant, que les articles 33 et 241, alinéa 2, du
code du travail syrien comportent des dispositions permettant de fonder une
mise en examen pour le délit prévu à l'article 223-1 du code pénal, alors que
la violation de ces dispositions de droit étranger ne peut être retenue pour
caractériser cette infraction.
46. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y
ait lieu d'examiner le quatrième grief.
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 13 novembre 2019
pourvoi n° 18-82.718 cassation partielle
Vu l’article 223-1 du code pénal ;
Attendu qu’en application de ce texte, il
incombe au juge de rechercher, au besoin d’office et sans qu’il soit tenu
par les mentions ou l’absence de mention de la citation pour mise en danger
sur ce point, l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de
sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation est
susceptible de permettre la caractérisation du délit ; qu’il lui appartient
ensuite d’apprécier le caractère immédiat du risque créé, puis de rechercher
si le manquement relevé ressort d’une violation manifestement délibérée de
l’obligation de sécurité ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et
des pièces de procédure que la société par actions simplifiée Saft (la
société Saft), qui exerce une activité de conception et de construction de
batteries de haute technologie, disposait à Nersac, en Charente, d’un site
consacré à la fabrication et l’assemblage d’accumulateurs utilisant une
technologie, dite "nickel-cadmium", qui requiert l’utilisation de matériaux
classés dans la catégorie des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction (agents CMR) ;
Que la société Saft, qui avait instauré
depuis 2003 un protocole visant à réduire les risques d’exposition au
cadmium, outre un suivi médical des travailleurs exposés, a cédé l’activité
du site de Nersac à une autre société le 1er juin 2013 ; qu’à la demande du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de cet
établissement, le cabinet G..., expert agréé par le ministère du travail,
missionné avant que cette cession n’intervienne, a établi un rapport (le
rapport G...) après une visite des lieux en janvier 2013 décrivant certaines
insuffisances du dispositif mis en oeuvre sur le site de Nersac ;
Attendu que la société Saft et M. F....,
chef de l’établissement de Nersac, ont été convoqués devant le tribunal
correctionnel d’Angoulême par citation directe délivrée le 23 décembre 2013,
à l’initiative de seize salariés et de l’union départementale des syndicats
CGT de la Charente, parties civiles, pour avoir, à Nersac, depuis le 24
janvier 2013 et jusqu’au 1er juin 2013, exposé directement des salariés de
la société Saft de l’établissement de Nersac à un risque immédiat de mort ou
de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité en :
a) Concevant des procédés de travail ne
limitant pas l’exposition des salariés aux substances chimiques dangereuses
pour leurs santé et notamment en : i. N’organisant pas le temps de travail
de manière à permettre aux salariés travaillant avec des substances
chimiques dangereuses pour la santé de disposer de temps dédié à l’hygiène
individuelle et à l’habillage et au déshabillage avant et après les pauses ;
ii. Entravant l’usage du matériel de protection individuel par l’affectation
d’un seul salarié sur deux postes de travail au sein de l’atelier PME ; iii.
Faisant fonctionner la ligne 14 de l’atelier montage avec les portes
ouvertes, engendrant une exposition directe à des poussières de cadmium des
salariés amenés à intervenir à l’intérieur des confinements ; iv.
N’organisant pas la séparation physique entre les ateliers exposés et non
exposés aux substances chimiques dangereuses de sorte à limiter le risque ;
b) Omettant de mettre en place du matériel
adéquat et efficace d’aspiration collective de nature à éviter la
propagation au sein des espaces de travail des substances chimiques
cancérigènes notamment ;
i. En n’équipant pas de protection
collective les postes de la préparation des pâtes de dispositif dans les
ateliers MH et PME ; ii. En mettant en place des installations collectives
inefficaces conduisant à une dispersion des substances chimiques nocives
pour la santé dans l’environnement de travail des salariés notamment aux
ateliers PBE et DECOUPE ;
c) S’abstenant d’équiper l’ensemble des
salariés affectés aux postes exposés aux agents chimiques dangereux de
masques à ventilation assistée correspondant aux normes en vigueur ;
d) S’abstenant d’organiser des examens
médicaux et des examens complémentaires à tous les salariés exposés au
cadmium à la suite de la reconnaissance par la sécurité sociale d’un cancer
broncho-pulmonaire en janvier 2012 ;
e) S’abstenant d’équiper les salariés de
vêtements de protection ou vêtement appropriés dès leur prise de service ;
f) S’abstenant d’organiser la séparation
physique des espaces au sein desquels les agents chimiques cancérigènes sont
utilisés des autres parties de l’usine ;
g) En ne remettant pas leurs attestations
d’expositions à l’ensemble des salariés transférés le 1er juin 2013 vers une
autre société ; Attendu que par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal
correctionnel a déclaré M. F.... et la société Saft coupables du délit de
mise en danger de la vie d’autrui et a prononcé sur les intérêts civils ;
que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté
appel de cette décision ;
Attendu que pour dire le délit de mise en
danger d’autrui non caractérisé, l’arrêt énonce, après avoir analysé les
motifs retenus par les premiers juges, qu’aucun grief n’est établi au regard
d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi
ou le règlement, ladite obligation devant s’entendre, conformément à la
jurisprudence et à la doctrine, comme une norme suffisamment précise pour
que soit déterminable sans équivoque la conduite à tenir dans telle ou telle
situation et pour que les écarts à ce modèle puissent être aisément
identifiés comme hypothèse de mise en danger ;
Que les juges ajoutent qu’à supposer que
l’on admette que certaines règles de prudence, notamment dans l’organisation
du travail ou des locaux, qui n’auraient pas été respectées, pourraient
ressortir à une acception large notamment des 3° et 6° de l’article R.
4412-70 du code du travail, le caractère manifestement délibéré de la
violation de ces normes ne peut être retenu, l’employeur ayant manifesté
depuis des années un réel souci de progresser dans la sécurité au travail,
comme le démontrent notamment la mise en place des contrôles effectués par
le bureau Veritas, la formalisation du plan cadmium, la généralisation des
contrôles biologiques des salariés, l’abaissement des seuils d’aptitude pour
les salariés exposés au cadmium ou encore le processus de reclassement des
salariés concernés sur des postes non exposés ;
Que la cour d’appel relève enfin que, s’il
ressort du rapport G..., sur lequel les parties civiles assoient leurs
demandes, que le procès industriel peut être amélioré à plusieurs égards
afin de diminuer l’exposition des salariés aux agents CMR, ledit rapport ne
comporte aucune analyse ni mesure des produits que contiennent les dépôts de
poussière dont il constate l’existence en différents ateliers du site de
Nersac, en sorte qu’il ne peut combattre utilement les mesures effectuées
régulièrement et depuis plusieurs années par le bureau Véritas, communiquées
par la défense, qui révèlent que les niveaux d’exposition des salariés au
nickel et au cadmium sont inférieurs aux valeurs limites d’exposition
professionnelles promues par les pouvoirs publics ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors
qu’il lui incombait de rechercher celles des obligations particulières de
prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement régissant
l’emploi d’agents CMR, qui, objectives, immédiatement perceptibles et
clairement applicables sans faculté d’appréciation personnelle du sujet,
étaient susceptibles d’avoir été méconnues, puis, d’apprécier dans cette
hypothèse, si compte tenu des modalités de l’exposition aux agents CMR, les
plaignants avaient été exposés à un risque immédiat, de mort ou de blessures
de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, enfin, de
rechercher si le ou les manquements le cas échéant relevés ressortaient à
une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité, la cour
d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe
ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 7 mai 2019 pourvoi n° 18-80418 cassation
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de
l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, de
l’ordonnance de non-lieu qu’il confirme et des pièces de la procédure, que
l’entreprise familiale et individuelle B... A..., du nom de son dirigeant,
est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Soremir, titulaire
du lot menuiseries extérieures, sur un chantier afférent à la construction
de quarante deux logements sociaux, sis au Tampon ; que le 5 août 2014,
M. G... A..., frère du premier, a été victime d’un accident mortel, ayant
chuté d’une hauteur de près de six mètres, alors qu’en appui sur une
corniche de 80 cm de largeur dépourvue de garde-corps, il procédait à la
pose, avec un autre ouvrier, d’un encadrement d’huisserie ;
Que l’enquête a permis d’établir que, d’une
part, le garde corps avait été déplacé par les ouvriers d’une autre société,
qui intervenaient au même endroit que les ouvriers de l’entreprise A... en
raison de retards pris par les travaux et, d’autre part, M. D...,
coordinateur de sécurité n’avait assisté qu’à treize des soixante-sept
réunions organisées par la personne en charge de la mission
d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), en sorte qu’il n’avait pas
été en situation de pouvoir analyser les phases critiques du chantier, outre
que le jour de l’accident, il n’avait pas procédé à une visite du deuxième
étage de l’immeuble où les ouvriers de la société A... se trouvaient, se
privant ainsi de la possibilité de remédier à l’absence de garde-corps ;
qu’il est également apparu que des harnais étaient disponibles dans le
véhicule de l’entreprise A..., mais que la victime n’en avait pas fait
usage ;
Que le jour de l’accident, l’architecte
représentant la maîtrise d’oeuvre, ainsi que l’OPC précité ont constaté, à
l’issue d’une réunion, le danger immédiat dans lequel la victime, affairée,
se trouvait et lui ont ordonné, ainsi qu’aux autres ouvriers présents avec
elle, dont M. H..., lui-même conducteur de travaux auprès de la société
Soremir, et disposant d’un pouvoir hiérarchique en matière de sécurité sur
les ouvriers de l’entreprise A..., de quitter les lieux ; qu’après avoir
obtempéré, M. G... A... a néanmoins repris le travail ; que M. B... A... ne
se trouvait pas sur les lieux ;
Attendu que le juge d’instruction, après
avoir mis en examen M. D... et M. B... A... du chef d’homicide involontaire
dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de prudence ou de sécurité, a rendu une ordonnance
de non-lieu ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour écarter l’argumentation de l’appelante, qui soutenait que
des poursuites devaient être engagées tant à l’encontre de MM. D... et A...
que de M. H..., l’arrêt retient qu’il n’existe pas de lien de causalité
entre les fautes de M. D... et le décès de la victime, tandis qu’il n’est
pas démontré que M. B... A..., absent le jour des faits, aurait eu
connaissance de la situation dans laquelle son frère s’est trouvé engagé ;
que les juges ajoutent que l’accident a pour causes le non-respect par
M. G... A... des consignes de non-intervention pour raison de sécurité
données le matin même par l’architecte et l’OPC, et des recommandations
verbales aux mêmes fin de M. H..., ainsi que l’absence d’utilisation des
équipements de sécurité à disposition dans le véhicule de l’entreprise ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, d’une
part, par des motifs inopérants relatifs à l’absence de M. B... A...,
d’autre part, sans mieux expliquer en quoi la faute de la victime aurait été
la cause exclusive de l’accident alors qu’elle avait relevé des manquements
à l’encontre notamment du coordonnateur de sécurité et de l’employeur, la
chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 29 mars 2018 Pourvoi n° 17-16873 Rejet
Sur le moyen unique, qui est recevable: Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble
les articles 121-3, alinéa 3, et 222-19 du code pénal
Attendu, selon le premier de ces textes, que les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’une infraction ne
sont applicables entre concurrents d’une compétition sportive qu’en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d’une infraction pénale;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 25 mai 2014, lors d’une épreuve de course pédestre à obstacles, la « Frappadingue
Rhône X’Trem », Mme X... a été heurtée, en sortant d’un toboggan, par une concurrente qui n’a pas été identifiée ; qu’ayant été blessée, elle a saisi
une commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin d’obtenir la désignation d’un expert médical et l’octroi d’une provision ;
Attendu que, pour accueillir ses demandes, l’arrêt énonce que la victime verse deux nouvelles attestations des premiers
témoins suffisamment précises pour établir la réalité de l’accident causé par une autre concurrente ; que l’un des témoins précise qu’il a assisté à
l’accident et insiste sur l’imprudence commise par celle-ci qui suivait de trop près la victime sur le toboggan, que l’autre témoin indique qu’il filmait
la scène avec sa caméra et a vu son amie se faire percuter lors de la sortie du toboggan ; que ces éléments caractérisent une infraction de blessures
involontaires causées à Mme X... par la participante inconnue et établissent son droit à indemnisation ; Qu’en se déterminant ainsi, sans relever une
violation des règles de la course pédestre à obstacles pratiquée présentant le caractère matériel d’une infraction, la cour d’appel a violé les textes susvisés
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 19 avril 2017 Pourvoi N° 16-80695 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure
qu'en 2012, la société Mandevilla, société de construction et de vente, a entrepris la réalisation d'un chantier situé quartier de l'Annonciade à
Bastia ; que les travaux d'excavation du site et de construction étant susceptibles d'exposer les salariés et les riverains à l'inhalation de
poussières d'amiante, une ordonnance du juge des référés du 15 février 2012 a interdit le commencement des travaux jusqu'à l'autorisation de
l'inspection du travail ; que, le 21 mai 2012, la société Mandevilla a passé un marché avec la société Vinci Construction Terrassement, dont M.
Fabien X... était le directeur d'exploitation, pour le terrassement et la construction de trois immeubles ; que le chantier a commencé après la
délivrance de l'autorisation de travaux le 13 juillet 2012 ; que, par procès verbaux des 21, 27, 31 août et 13 et 14 septembre, l'inspectrice du
travail a relevé notamment le recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, la présence d'une clôture de confinement ne permettant pas
de limiter la propagation de fibres d'amiante, l'absence de nettoyage de la pelle de terrassement, la réalisation d'opérations de mesurage de l'air
en fibres d'amiante non conformes, la définition d'un mode opératoire relatif aux mesures de prévention et de protection insuffisant et constaté
un mesurage supérieur à la limite autorisée de fibres d'amiante par litre d'air ; que la société Vinci Construction Terrassement et M. X... ont été
cités devant le tribunal correctionnel pour emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d'exposition à des agents chimiques
cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans respect des règles de prévention et mise en danger de la vie d'autrui ; que le
tribunal les a relaxés du chef de ce délit ; que les prévenus et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il résulte de l'ensemble des
textes applicables à la date des faits, qu'avant même la mise en oeuvre de l'arrêté du 14 août 2012 et l'entrée en vigueur du décret 2012-639 du 4 mai
2012, l'entreprise intervenant sur un chantier où le risque d'inhalation de fibres d'amiantes est identifié et connu, était débitrice d'une obligation
générale de sécurité de résultat, non seulement à l'égard de ses salariés mais aussi à l'égard de toute personne se trouvant à proximité du site, et d'une
obligation générale d'adaptation à l'évolution des connaissances scientifiques, relève que la société Vinci Construction Terrassement et, sur
sa délégation, M. X... ont violé délibérément l'obligation générale de sécurité qui pesait sur eux ainsi que les obligations particulières issues du
décret 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, tant à l'égard des salariés qu'à
l'égard du public avoisinant, par plusieurs manquements tels que l'absence de protection aux abords immédiats du chantier, l'installation de grillages
permettant la dissémination des fibres, la présence de portions importantes de terrains rocheux laissées à découvert ou le non nettoyage des engins ; que,
les juges retiennent ensuite que, alors que le risque de dommage auquel était exposé la victime doit être certain sans qu'il soit nécessaire que ce risque
se soit réalisé de manière effective, en l'état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention, le degré de probabilité de
développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation de poussières d'amiante est certain, sans qu'il n'y ait ni
effet de seuil, en deçà duquel il n'existerait aucun risque ni traitement curatif efficace ; qu'ils en déduisent que le chantier de terrassement
litigieux présentant la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l'acceptation du
marché, la défaillance dans la mise en oeuvre de ! a protection du public et des salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante produites par les
travaux entrepris sur le site entraînait un risque de mort ou de blessures graves lié à l'inhalation de fibres d'amiante ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent l'exposition d'autrui à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité
permanente, en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 12 janvier 2016 Pourvoi N° 14-86503 Cassation
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué retient qu'il a, lors d'un contrôle sur
la voie publique, accéléré brutalement alors que Mme Y..., gardien de la paix, tenait sa portière ouverte afin de procéder au contrôle des pièces de son véhicule ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant à la rébellion et au refus de se
soumettre aux vérifications, ou l'existence de circonstances de fait exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, et sans préciser l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou
le règlement qui aurait été violée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 22 septembre 2015 Pourvoi N° 14-84355 Cassation
Vu l'article 223-1 du code pénal ;
Attendu que le délit de mise en danger n'est caractérisé qu'en cas d'exposition d'autrui à un risque de mort ou de
blessures par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
Attendu que pour déclarer M. Z... coupable de mise en danger d'autrui pour avoir omis de procéder à la neutralisation et à
l'élimination des déchets de munitions et pyrotechniques dont il avait la charge, selon les procédés prévus par la réglementation en vigueur et
conformes à l'autorisation d'exploitation, l'arrêt se borne à retenir que le prévenu n'a pas pris les mesures nécessaires au cours des mois
précédant la cessation d'exploitation pour nettoyer le site, dont il connaissait la situation, afin d'éviter tout danger ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la loi ou le règlement édictant une
obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait été violée de façon manifestement délibérée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 16 décembre 2015 Pourvoi N° 15-80916 Cassation
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 223-1 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué relève que le comportement du prévenu, qui
circulait à la vitesse de 215 km/ h alors que sur cette portion d'autoroute, elle est limitée à 110 km/ h " n'a manifestement pas pris en
compte les autres usagers de la route, nombreux à cette heure de la journée comme en atteste le relevé de la société d'autoroute " ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse
autorisée, ou l'existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature
à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision
RESPONSABILITE CIVILE POUR DOL
Ayant relevé qu’un enfant s’étant rendu au
sous-sol du domicile des personnes auxquelles, accompagné de sa mère, il
rendait visite, s’était blessé accidentellement en manipulant un pistolet
gomme-cogne, qui s’y trouvait entreposé, une cour d’appel a pu déduire de
ses constatations et énonciations, faisant ressortir que l’enfant, âgé de
onze ans, ne pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de
direction et de contrôle sur l’arme dont il avait fait usage, que la
preuve du transfert de garde invoqué par les propriétaires de cette arme
n’était pas rapportée.
Cour de Cassation Chambre civile 2, arrêt du 26 novembre 2020 Pourvoi n° 19-19.676 Rejet
5. Après avoir relevé que A... X... s’était
rendu dans le sous-sol du domicile des époux Y... et s’était blessé
accidentellement en manipulant l’arme s’y trouvant, l’arrêt retient que les
conditions dans lesquelles l’arme était entreposée ont permis son
appréhension matérielle par l’enfant, quand bien même ce dernier n’aurait
pas reçu l’autorisation de se rendre en ce lieu, et alors qu’il n’est pas
soutenu qu’il lui avait été interdit d’y aller. L’arrêt ajoute qu’à supposer
que l’enfant ait procédé lui-même au chargement de l’arme, cela implique
nécessairement la présence d’une munition à proximité.
6. De ses constatations et énonciations,
faisant ressortir que l’enfant, âgé de onze ans, ne pouvait être considéré
comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l’arme dont
il avait fait usage, la cour d’appel a pu déduire que la preuve du transfert
de garde invoqué par M. et Mme Y... n’était pas rapportée.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
CRIME CONTRE L'HUMANITE
COUR DE CASSATION, chambre criminelle, arrêt du 24 novembre 2021 pourvoi n° 21-81.344 cassation
Vu l'article 689-11 du code de procédure pénale :
6. Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle
réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne
soupçonnée d'avoir commis à l'étranger le crime de génocide, prévu par le
code pénal, les autres crimes contre l'humanité définis par ce code, si
les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou
si cet Etat ou l'Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est
partie à la Convention de Rome, portant statut de la Cour pénale
internationale, outre les crimes et délits de guerre, dans les conditions
prévues par le texte susvisé.
7. Pour rejeter l'exception présentée par le demandeur, portant sur
l'incompétence des juridictions françaises, l'arrêt attaqué, après avoir
rappelé les termes de l'article 689-11 du code de procédure pénale et
relevé que la Syrie n'avait pas ratifié la Convention de Rome, portant
statut de la Cour pénale internationale, retient que, si les crimes contre
l'humanité ne sont pas expressément visés comme tels dans le code pénal
syrien, celui-ci incrimine le meurtre, les actes de barbarie, le viol, les
violences et la torture.
8. Les juges énoncent que la Constitution syrienne de 2012 interdit la torture
et qu'en vertu de ce texte, toute violation de la liberté personnelle ou
de la protection de la vie personnelle ou de tous autres droits ou
libertés publiques garantis par la Constitution est considérée comme un
crime qui est puni par la loi.
9. Ils ajoutent que la Syrie est partie à de nombreux autres traités,
parmi lesquels les conventions de Genève dont la IVe prohibe, notamment,
les meurtres de civils, la torture, les exécutions sommaires, et le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques garantissant le
droit à la vie et interdisant la torture.
10. La chambre de l'instruction en déduit que le droit syrien, même s'il
n'incrimine pas, de manière autonome, les crimes contre l'humanité,
réprime les faits qui le constituent et qui sont à l'origine de la
poursuite dans l'affaire dont elle est saisie.
11. En se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé pour
les raisons suivantes.
12. Les crimes contre l'humanité sont définis au chapitre II du sous-titre
Ier du code pénal, et nécessairement commis en exécution d'un plan
concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une
attaque généralisée ou systématique.
13. Dès lors, l'exigence posée par l'article 689-11 du code de procédure
pénale, selon laquelle les faits doivent être punis par la législation de
l'Etat où ils ont été commis, inclut nécessairement l'existence dans cette
législation d'une infraction comportant un élément constitutif relatif à
une attaque lancée contre une population civile en exécution d'un plan concerté.
14. La cassation est, en conséquence, encourue. Elle interviendra avec
renvoi, afin que soient appréciées les conséquences de l'incompétence des juridictions françaises sur la régularité des actes de la procédure.
LÉGITIME DÉFENSE
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 17 janvier 2016 Pourvoi N° 15-86481 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident matériel de la circulation survenu sur le
boulevard périphérique parisien, l'un des conducteurs, M. X..., est sorti de son véhicule et est allé vers l'autre conducteur, M. Z..., pour le
saisir au cou ; que ce dernier ayant pris la fuite au volant de son véhicule pour se réfugier dans un chantier, M. X... a mis le sien en
travers de la voie et en est descendu pour aller l'insulter ; qu'à l'issue de cette altercation, X... a perdu l'équilibre, et chuté au sol, qu'il est
demeuré paraplégique à la suite de cette chute ; que, par ordonnance du juge d'instruction, M. Z... a été renvoyé devant le tribunal
correctionnel, qui, par jugement en date du 6 décembre 2013, l'a déclaré coupable des faits reprochés, et responsable pour moitié de leurs
conséquences dommageables ; que M. Z... ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel ;
Attendu que, pour retenir la légitime défense au bénéfice de M. Z..., le renvoyer des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leur
demande, l'arrêt retient que M. Z..., courbé pour parer les coups de son adversaire, a lancé sa main en avant vers M. X..., qui a chuté au sol après
que sa tête eut heurté le capot de la voiture de M. Z..., puis ensuite le sol, sans qu'il ait pu être établi avec certitude si M. X... a été touché par le
geste de M. Z... ou si, en tentant de l'éviter, il a été déséquilibré ; que les juges ajoutent que le prévenu, ayant été contraint de se défendre et de
riposter pour éviter de recevoir d'autres coups, a réagi de manière proportionnée, un coup de poing contre d'autres coups de poing, face à une
agression injustifiée, réelle, actuelle, les conséquences dramatiques pour M. X... ne pouvant être juridiquement prises en compte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, d'où il résulte, d'une part, que le prévenu avait
répondu par un acte constitutif de violences volontaires aux coups de son agresseur, d'autre part qu'il n'existait pas de disproportion entre
l'agression et les moyens de défense employés, peu important à cet égard le résultat de l'action, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-5 du code pénal
LE DÉLIT D'ENTRAVE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Art. L. 2223-2 du Code de la Santé Publique
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de
s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 par tout moyen, y
compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire
intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse :
1° Soit en perturbant l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements
ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur
une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements mentionnés au même article L.
2212-2, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières.
LE VOL
COUR DE
CASSATION chambre criminelle arrêt du 18 mai 2021 Pourvoi N°21-86685 Rejet
. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce
qui suit.
2. Le 29 juillet 2019, une dizaine de personnes se sont rendues à la mairie de
[Localité 1] (Bas-Rhin) où elles se sont emparé du portrait du Président de la
République pour afficher à sa place un tract.
3. Ces personnes se sont ensuite regroupées devant la mairie, le temps de poser
pour une photographie, avant de repartir en emportant le portrait.
4. Le tract était rédigé au nom de l'organisation Action non-violente COP21 et
expliquait que l'acte consistait à « réquisitionner temporairement » le portrait
de M. [P] [U], Président de la République, jusqu'à ce que soit amorcée par le
Gouvernement une politique en accord avec les engagements pris lors de la
vingt-et-unième conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP21).
5. M. [D] [B] et Mme [X] [K] ont été identifiés comme ayant pris part aux faits
; cette dernière a reconnu qu'elle avait bien le portrait en sa possession, qui
n'a pas été retrouvé à son domicile lors d'une perquisition.
6. Mme [K] et M. [B] ont été condamnés, l'un et l'autre, par ordonnances
pénales, pour vol en réunion, à 300 euros d'amende.
7. Sur leur opposition, le tribunal correctionnel de Strasbourg les a relaxés.
8. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
REPONSE
10. Selon l'article 10 de la Convention européenne des droits
de l'homme, toute personne a droit à la liberté d'expression, et l'exercice de
cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions
ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
11. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l'incrimination d'un comportement
constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances,
constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté
d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause (Crim.,
26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. Crim. 2016, n° 278 ; Crim., 26
février 2020, pourvoi n° 19-81.827, publié au Bulletin ; Crim., 22 septembre
2021, pourvoi n° 20-85.434, publié au Bulletin).
12. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté
d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui
est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté
d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère
proportionné de la condamnation. Ce contrôle de proportionnalité requiert un
examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres
éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble
éventuellement causé.
13. Dans le cas particulier d'une poursuite du chef de vol, doivent être
notamment prises en compte la valeur matérielle du bien, mais également, le cas
échéant, sa valeur symbolique, ainsi que la réversibilité ou l'irréversibilité
du dommage causé à la victime.
14. Pour écarter l'argumentation des prévenus, qui faisaient valoir que
l'incrimination de vol en réunion constituait en l'espèce une ingérence
disproportionnée dans l'exercice de leur liberté d'expression, la cour d'appel
retient qu'ils ont voulu, avec d'autres, dans un dessein politique, appeler
l'attention des pouvoirs publics sur la méconnaissance, par la France, des
engagements qu'elle a souscrits dans le cadre de la COP21.
15. Les juges énoncent que l'objet du vol est le portrait du Président de la
République, exposé dans les locaux d'une mairie, peu important sa valeur
marchande.
16. Ils relèvent que les prévenus ont refusé de restituer le portrait volé tant
que la politique du gouvernement n'aurait pas changé, alors même que le maire de
la commune avait fait en ce sens une démarche amiable. Ils remarquent que la
restitution du portrait aurait évité, si ce n'est les poursuites, du moins une
perquisition du domicile de la prévenue.
17. Ils en déduisent que les poursuites engagées contre les prévenus ne
constituent pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice de leur liberté
d'expression.
18. Ils soulignent, pour motiver la peine prononcée, que les prévenus n'ont pas
des profils de délinquants et que le vol qu'ils ont commis, d'un bien d'une
valeur d'environ 35 euros, s'explique seulement par leur engagement sincère en
faveur de la protection de la planète et de la lutte contre le réchauffement
climatique, ce dont il résulte qu'une amende de 400 euros avec sursis constitue
une sanction adaptée et proportionnée.
19. En l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans
encourir les griefs du moyen.
20. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, bien que
l'action menée par les prévenus se soit inscrite dans le cadre d'une démarche
militante et puisse être considérée comme une expression au sens de l'article 10
précité, la condamnation prononcée n'est pas disproportionnée au regard de la
valeur symbolique du portrait du Président de la République et du refus de le
restituer tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, ainsi que
de la circonstance que le vol a été commis en réunion.
21. Dès lors, le moyen doit être écarté.
BANQUEROUTE
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 1er février 2023 Pourvoi N°
22-82368 Rejet
13. Pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par
augmentation frauduleuse du passif, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que s'il
découle de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation que
la fraude ne peut se limiter à une simple inaction, en l'espèce M. [K] a agi
délibérément, en ce sens que le défaut de paiement de l'intégralité des
cotisations URSSAF n'est pas le résultat d'un oubli mais d'une volonté.
14. Les juges relèvent que M. [K] a d'ailleurs, à de multiples reprises, saisi
le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester les contraintes
délivrées par l'URSSAF, puis la cour d'appel après avoir été débouté. Son
comportement s'analyse ainsi, non comme une inaction, mais comme des agissements
répétés.
15. Les juges précisent qu'il résulte d'un arrêt de la chambre commerciale de la
Cour de cassation qu'une augmentation frauduleuse du passif peut résulter du
fait de soustraire volontairement une société à l'impôt en France ce qui est à
l'origine d'un redressement fiscal ayant entraîné une augmentation des charges
de la société en état de cessation des paiements.
16. Ils ajoutent que le manquement imputable à M. [K] s'analyse en une
infraction pénale constitutive de la contravention de l'article R. 244-4 du code
de la sécurité sociale incriminant le défaut de conformité aux prescriptions de
la législation de sécurité sociale.
17. Les juges concluent que le caractère frauduleux des agissements du prévenu
est corroboré par le fait, d'une part, qu'il a soustrait une partie des sommes
non payées à l'URSSAF des comptes de son entreprise afin de les rendre
insaisissables par les créanciers de celle-ci et, d'autre part, que son
comportement a conduit à la cessation des paiements et a perduré après la date
de celle-ci, augmentant le passif de l'entreprise, non seulement des cotisations
URSSAF impayées depuis plusieurs années, alors que les résultats de l'entreprise
permettaient de s'en acquitter, mais également des dommages et intérêts ainsi
que des frais irrépétibles qui n'auraient pas été dus si M. [K] s'était conformé
aux dispositions du code de la sécurité sociale.
18. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés
au moyen pour les motifs qui suivent.
19. En premier lieu, l'article L. 654-2, 3° du code de commerce n'exclut aucune
modalité d'augmentation du passif.
20. En second lieu, le comportement du prévenu est frauduleux dès lors qu'il
consiste en une omission, manifestement délibérée, de s'acquitter des
cotisations sociales dues.
21. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
L'ABUS DE BIENS SOCIAUX
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 1er février 2017 Pourvoi N° 15-85199 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que
M. X..., dirigeant des sociétés Siminvest et P08. 1, a été poursuivi, du
chef d'abus de biens sociaux, notamment pour avoir transféré à la première
de ces sociétés une partie de la trésorerie de la seconde ; que le
tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite par un jugement dont le ministère public a fait appel;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt
énonce que le transfert de trésorerie a été réalisé dans l'unique intérêt de la société Siminvest et sans contrepartie pour la société P08. 1, dont il excédait les possibilités financières ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le prévenu a nécessairement eu conscience d'accomplir un acte contraire aux intérêts de
la société P08. 1, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour prononcer, à l'encontre de M. X..., la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de gérer, l'arrêt, après avoir
relevé qu'ayant suivi une école de commerce et étant dirigeant de sociétés depuis 1978, il avait repris la gérance de la société Siminvest, placée en
redressement judiciaire en novembre 2013, qu'il ne percevait pas de rémunération au titre de sa gérance et qu'il bénéficiait de revenus fonciers
de l'ordre de 10 000 euros par mois, retient qu'il a privilégié les intérêts de ladite société qui se trouvait en état de cessation des paiements et
faisait l'objet d'une enquête ordonnée par le tribunal de commerce, en réalisant à son profit, en l'absence de convention de trésorerie, des apports
effectués par la société P08. 1, non remboursés, entraînant la déconfiture de cette dernière ; que les juges ajoutent que le prévenu a délibérément sacrifié
la société P08. 1 et placé celle-ci dans l'impossibilité de désintéresser ses
créanciers au seul profit de la société Siminvest dans laquelle il était particulièrement intéressé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon
laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa
situation personnelle, la cour d'appel a justifié son choix de prononcer une
interdiction de gérer, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
LA FRAUDE FISCALE
CUMUL DES POURSUITES FISCALES ET PENALES
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 24 juin 2020 pourvoi n° 19-81.134 rejet
10. Pour écarter le moyen tiré de ce que si
elles aboutissaient, les poursuites engagées contre le prévenu,
entraîneraient un cumul de sanctions fiscales et pénales en méconnaissance
notamment de la réserve posée par le conseil constitutionnel aux termes de
laquelle un tel cumul n’est possible que dans les cas de fraude les plus
graves, l’arrêt attaqué énonce qu’il convient d’observer que les poursuites
pénales dont est saisie la cour concernent M. X... personnellement tandis
que les sanctions fiscales ont été prononcées à l’égard de la société Expart,
ce étant rappelé que la condamnation solidaire de la société et de son
dirigeant au paiement des droits fraudés et de leurs majorations ne revêt
pas le caractère d’une sanction pénale.
11. Les juges ajoutent que la réserve
d’interprétation opérée par le Conseil dans ses décisions du 24 juin 2016,
ne vaut, dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité dont
il était saisi, que pour les cas de dissimulation des sommes imposables.
12. Ils relèvent enfin qu’il est permis de
penser qu’à le supposer établi, le délit de fraude fiscale par omission de
deux déclarations qui est reproché à M. X..., qui fait suite à de précédents
manquements déclaratifs tant en qualité de dirigeant de la société Expart
qu’à titre personnel, constitue un cas grave.
13. C’est à tort que les juges ont considéré
que la réserve posée par le conseil constitutionnel tenant à la gravité des
faits ne s’applique qu’aux cas de fraude fiscale par dissimulation des
sommes sujettes à l’impôt.
14. En effet, dans sa décision n° 2018-745
QPC du 23 novembre 2018, le conseil constitutionnel a jugé, comme il l’avait
fait en matière de fraude par dissimulation (décisions nos 2016-545 QPC et
2016-546 QPC du 24 juin 2016, n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 ), que le
principe de nécessité des délits et des peines impose que les dispositions
de l’article 1741 ne s’appliquent, en complément de sanctions fiscales,
qu’aux cas les plus graves d’omission déclarative frauduleuse.
15. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la
censure.
16. En effet, d’une part la réserve
constitutionnelle selon laquelle seuls les faits présentant une certaine
gravité peuvent faire l’objet, en complément de sanctions fiscales, de
sanctions pénales, ne s’applique que lorsque le prévenu justifie avoir fait
l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits.
17. D’autre part, la solidarité fiscale
prévue à l’article 1745 du code général des impôts, qui constitue une
garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, ne constitue
pas une peine au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789 de sorte que
le principe de nécessité des délits et des peines ne lui est pas applicable.
18. Il s’en déduit que la réserve sus-visée
ne s’applique pas au prononcé de sanctions à l’encontre du prévenu,
dirigeant de société, lorsque celle-ci est la redevable légale de l’impôt.
19. Ainsi, les griefs, inopérants, doivent
être écartés.
20. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la
forme.
MÊME SI LE PREVENU N'A PAS APPREHENDE LES SOMMES - LA FRAUDE FISCALE EST CONSTITUEE
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 8 avril 2021 pourvoi n° 19-87.905 rejet
13. Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou
établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom
de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou
indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou
lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière
prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la
prestation de services.
14. Pour dire établi le délit de fraude
fiscale, l’arrêt attaqué relève que la cession des marques et brevets à la
société Sisig par les prévenus, à un prix très faible, ne se justifiait pas,
ladite société ne disposant pas d’une compétence en la matière, notamment
supérieure à celle que détenaient les époux Y..., ce d’autant plus que ces
derniers ont retrouvé dès le lendemain le bénéfice de leur exploitation via
la société Aroma Thera.
15. Il retient que Mme X..., dont
l’intervention a dépassé le cadre de la simple assistance prévue par le
contrat de cession, qui dictait la conduite à tenir pour le dépôt et la
protection des marques, pour les formalités administratives à accomplir, et
soumettait à son autorisation le paiement des factures que la société Sisig
devait régler, s’est comportée comme la véritable gestionnaire de la société
Sisig à laquelle la société Aroma Thera versait les redevances dues en
contrepartie de l’exploitation des marques et brevets cédés.
16. Les juges indiquent que la société Sisig
présente tous les caractères d’une coquille vide et qu’aucun élément ne
démontre qu’elle exerçait de manière prépondérante, au sens de l’article 155
A précité du code général des impôts, une activité industrielle ou
commerciale autre que la prétendue prestation de services rémunérée par les
redevances litigieuses.
17. La cour d’appel ajoute que les
infractions reprochées ne nécessitent pas d’établir que Mme X... et M. Y...
ont directement appréhendé les fonds litigieux, leur perception pouvant être
dissimulée par des structures écrans.
18.En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a
méconnu aucun des textes visés au moyen.
19. En effet, en premier lieu, la
possibilité prévue par l’article 155 A du code général des impôts d’imposer,
entre les mains d’une personne qui rend des services, la rémunération
correspondant à ces services, lorsqu’elles sont perçues par une personne
domiciliée ou établie hors de France, n’est pas subordonnée, dans
l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie
en France, à la condition que ces services aient été rendus en France.
20. Dès lors, la demanderesse ne saurait se
faire un grief de ce que la cour d’appel n’a pas répondu au moyen
régulièrement soulevé devant elle tiré de ce que les prestations
correspondant à la rémunération versée à la société Sisig auraient été
réalisées à l’étranger.
21. En second lieu, il résulte de l’article
155 A précité, qui tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt
sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une
personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des
services rendus par ces contribuables, que le contribuable domicilié en
France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé
lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la
personne chargée de les percevoir. Il appartient le cas échéant au
contribuable d’apporter la preuve soit que tel n’a pas été le cas, soit que
la rémunération litigieuse, qui lui a été reversée en tout ou partie par
l’entité l’ayant perçue, a été imposée à un autre titre.
22. Dès lors, la caractérisation du délit de
fraude fiscale résultant de l’omission de déclarer les rémunérations
sujettes à l’impôt en application de ce texte n’implique pas qu’il soit
démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes.
23. Ainsi, le moyen doit être écarté.
BLANCHIMENT DE L'ARGENT D'UNE INFRACTION
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 4 décembre 2019 pourvoi n° 19-82.469 Rejet
Sur le premier moyen de cassation,
pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des
droits de l’homme, 121-3, 324-1 et 324-2 du code pénal, préliminaire, 591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et
des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal
correctionnel des chefs de travail dissimulé, blanchiment et recel ; qu’il
lui est notamment reproché le placement et la dissimulation de sommes
provenant d’activités professionnelles non déclarées et de fraude fiscale
pour un montant évalué à 201 000 euros ; que, par jugement du 20 novembre
2017, le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite des chefs de
travail dissimulé et blanchiment, et l’a déclaré coupable de recel ; que le
prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu
coupable de blanchiment, l’arrêt relève que ce dernier, qui n’a jamais
exercé d’activité professionnelle déclarée, bénéficie du revenu de
solidarité active, et n’a effectué aucune déclaration fiscale, a cependant
disposé de la somme de 201 100 euros sur un compte ouvert à la Banque
Nationale d’Algérie, alimenté par des versements d’espèces venant de France,
dont il a ensuite fait bénéficier par virement ou remise de chèques MM. B...
et C... X..., et que la détention de ces fonds ne peut être justifiée par
les revenus de l’intéressé qui n’en déclare aucun ; que les juges ajoutent
que le prévenu manie beaucoup de fonds, puisqu’il a procédé à des échanges
d’espèces en petites coupures dans la succursale de la Banque de France de
Nanterre, pour un montant total de 95 000 euros, et que l’origine de ces
fonds est inconnue, les explications du prévenu relatives au négoce bénévole
de véhicules n’étant corroborées par aucun élément ; qu’ils en déduisent
que, dès lors, l’infraction de blanchiment par dissimulation de sommes
provenant d’activités professionnelles non déclarées et de fraude fiscale
reprochée au prévenu est établie par les constatations précises des
enquêteurs régulièrement rapportées en procédure, le prévenu ne fournissant
pas d’éléments venant contredire ces constatations, se contentant de simples
dénégations qui ne sont pas en mesure de leur faire perdre leur caractère
probant ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations,
d’où il résulte que M. X... a apporté son concours à une opération de
placement et de dissimulation du produit de faits de travail dissimulé et de
fraude fiscale, peu important que les auteurs de ces délits ne soient pas
connus et que les circonstances de leur commission n’aient pas été
entièrement déterminées, la cour d’appel, qui n’a pas renversé la charge de
la preuve, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en
fait en sa troisième branche, dès lors que la cour d’appel n’a pas énoncé
que les fonds objet du délit de blanchiment avaient pour origine le délit de
travail dissimulé reproché au prévenu, doit être écarté ;
LE CUMUL D'INFRACTIONS
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 22 mars 2023 pourvoi n° 19-81.929 Rejet
Vu les articles 50 et 52 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne et 1741 du code général des impôts sous les
réserves résultant des décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin
2016 du Conseil constitutionnel :
8. Aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être poursuivi ou puni
pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné dans l'Union européenne par un jugement pénal définitif conformément
à la loi.
9. Il résulte du second, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union
européenne, qu'une limitation du principe ne bis in idem peut être justifiée à
la condition, notamment et également, que la loi nationale assure que les
charges résultant, pour les personnes concernées, d'un tel cumul soient
limitées au strict nécessaire afin de réaliser l'objectif visé, et ce par une
coordination des procédures et des sanctions.
10. Les dispositions législatives qui luttent contre la fraude à la TVA,
telles celles applicables à la cause, constituent une mise en oeuvre du droit
de l'Union et doivent par conséquent respecter le principe ne bis in idem
garanti par l'article 50 de la Charte qui interdit un cumul de poursuites et
de sanctions présentant une nature pénale pour les mêmes faits et contre une
même personne (CJUE, arrêt du 26 février 2013, [H] [C], C-617/10). Il importe
peu, de ce point de vue, que l'intéressé soit poursuivi et condamné pour une
fraude aux impôts directs dès lors qu'il l'est également pour une fraude à la
TVA.
11. Il résulte de l'article 1741, alinéa 1, du code général des impôts que
quiconque s'est soustrait ou à tenté de se soustraire frauduleusement à
l'établissement ou au paiement total ou partiel de la TVA, notamment en
dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt, à la
condition que la dissimulation excède le dixième de la somme imposable ou le
chiffre de 153 euros, est passible de sanctions pénales, indépendamment des
sanctions fiscales applicables en vertu de l'article 1729 du même code.
12. La Cour de cassation, appliquant une réserve d'interprétation du Conseil
constitutionnel (Cons. const., 24 juin 2016, décisions n° 2016-545 QPC et n°
2016-546 QPC, Cons. const., 22 juillet 2016, décision n° 2016-556 QPC et Cons.
const., 23 novembre 2018, décision n° 2018-745 QPC), a posé pour principe que
lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre
personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge
pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction
au regard de l'article 1741 du code général des impôts, et préalablement au
prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le
degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire. Le
juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant
des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou
des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de
circonstances aggravantes. A défaut d'une telle gravité, le juge ne peut
entrer en voie de condamnation (Crim., 11 septembre 2019, pourvois n°
18-81.067, n° 18-81.040 et n° 18-84.144, publiés au Bulletin).
13. Appliquant une autre réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel
selon laquelle, si l'éventualité que deux procédures, pénale et fiscale, pour
des faits de fraude fiscale soient engagées peut conduire à un cumul de
sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause
le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le
montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues (Cons. const., 24 juin
2016, décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC, Cons. const., 22 juillet
2016, décision n° 2016-556 QPC et Cons. const., 23 novembre 2018, décision n°
2018-745 QPC), la Cour de cassation a par ailleurs énoncé que lorsque le
prévenu justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale
définitivement prononcée pour les mêmes faits, le juge pénal n'est tenu de
veiller au respect de l'exigence de proportionnalité que s'il prononce une
peine de même nature (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.067, publié
au Bulletin).
14. Répondant à une question préjudicielle posée dans la présente affaire par
la Cour de cassation par arrêt en date du 21 octobre 2020, la Cour de justice
de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 5 mai 2022, C-570/20) rappelle que selon
une jurisprudence constante, une limitation du droit fondamental garanti à
l'article 50 de la Charte peut être justifiée sur le fondement de l'article
52, § 1, de celle-ci, à condition d'être prévue par la loi et de respecter le
contenu essentiel de ces droits et libertés.
15. La Cour rappelle que s'agissant du caractère strictement nécessaire d'une
réglementation nationale limitant lesdits droits ou lesdites libertés, elle
doit prévoir des règles claires et précises, lesquelles notamment permettent
au justiciable de prévoir quels actes et omissions sont susceptibles de faire
l'objet d'un tel cumul de poursuites et de sanctions.
16. Elle dit en conséquence pour droit que le droit fondamental garanti à
l'article 50 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 52, § 1, de
celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la
limitation aux cas les plus graves du cumul de poursuites et de sanctions de
nature pénale en cas de dissimulations frauduleuses ou d'omissions
déclaratives en matière de TVA, prévu par une réglementation nationale, ne
résulte que d'une jurisprudence établie interprétant, de manière restrictive,
les dispositions légales définissant les conditions d'application de ce cumul,
à la condition qu'il soit raisonnablement prévisible, au moment où
l'infraction est commise, que celle-ci est susceptible de faire l'objet d'un
cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale.
17. Elle souligne que la prévisibilité de la loi ne s'oppose pas à ce que la
personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour
évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de l'affaire en cause,
les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé et qu'il en va
spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d'une
grande prudence dans l'exercice de leur métier.
18. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que les
dispositions du code général des impôts telles qu'interprétées au paragraphe
12 ne sont pas en elles-mêmes contraires aux exigences de clarté et de
précision imposées par le principe de prévisibilité résultant de l'application
combinée des articles 50 et 52 de la Charte.
19. D'autre part, que le prévenu de fraude fiscale doit avoir été en mesure de
prévoir, au moment où l'infraction a été commise, que ses agissements étaient
susceptibles de faire l'objet d'un cumul de sanctions fiscale et pénale.
20. Répondant à une autre question préjudicielle posée par l'arrêt du 21
octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 5 mai 2022
précité) a par ailleurs dit pour droit que le droit fondamental garanti par
l'article 50 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 52, § 1, de
celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation
nationale de lutte contre la fraude à la TVA qui n'assure pas, dans le cas où
le cumul de poursuites fiscale et pénale conduit au cumul d'une sanction
pécuniaire et d'une peine privative de liberté, par des règles claires et
précises, le cas échéant telles qu'interprétées par les juridictions
nationales, que l'ensemble des sanctions infligées n'excède pas la gravité de
l'infraction constatée.
21. En conséquence, les dispositions du code général des impôts telles
qu'interprétées au paragraphe 13 ne suffisent pas pour assurer que le cumul de
sanctions qu'elles autorisent, prises dans leur ensemble, n'excède pas ce qui
est strictement nécessaire.
22. Les juridictions nationales ayant l'obligation d'interpréter le droit
interne dans un sens conforme au droit de l'Union, il s'en déduit que lorsque
le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel,
d'une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits,
l'article 1741 du code général des impôts doit être appliqué de sorte que la
charge finale résultant de l'ensemble des sanctions prononcées, quelle que
soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de
l'infraction qu'il a commise.
23. Il résulte des considérations qui précèdent, en premier lieu, que, lorsque
le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel,
d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal,
d'une part, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier qu'il était
raisonnablement prévisible, au moment où l'infraction a été commise, que
celle-ci était susceptible de faire l'objet d'un cumul de poursuites et de
sanctions de nature pénale, le cas échéant en tenant compte de la profession
du prévenu et des conseils juridiques auxquels il pouvait recourir.
24. Il lui appartient, d'autre part, après avoir caractérisé les éléments
constitutifs de l'infraction au regard de l'article 1741 du code général des
impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les
faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la
répression pénale complémentaire. Le juge est tenu de motiver sa décision, la
gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des
agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur
intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes.
25. Il résulte de ces mêmes considérations, en second lieu, que lorsque le
prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel,
d'une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, il
appartient au juge pénal, après avoir constaté le montant des pénalités
fiscales appliquées, d'une part, s'il prononce une peine de même nature, de
vérifier que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne
dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
26. Il lui appartient, d'autre part, de s'assurer que la charge finale
résultant de l'ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature,
ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l'infraction qu'il a
commise. Le juge est tenu de motiver sa décision au regard de ces éléments,
sans préjudice des exigences résultant des dispositions des articles 132-1 et
132-20 du code pénal concernant la motivation du choix de la peine.
27. En l'espèce, pour écarter l'application du principe ne bis in idem,
invoqué par le prévenu au soutien de sa relaxe et condamner celui-ci, pour
fraude fiscale et omission d'écritures comptables, à dix-huit mois
d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis
probatoire ainsi qu'à une mesure d'affichage, aux termes de motifs portant sur
la caractérisation des infractions et le choix de la peine, l'arrêt attaqué
énonce que la possibilité d'un cumul des procédures et sanctions pénales et
fiscales est conforme à l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne dès lors que le Conseil constitutionnel en a précisé la
portée et la limite en prévoyant, d'une part, qu'elle ne s'applique qu'aux cas
les plus graves de dissimulation frauduleuse des sommes soumises à l'impôt,
cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des
agissements de la personne poursuivie et des circonstances de leur
intervention, d'autre part, que le montant global des sanctions éventuellement
prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions
encourues, en application du principe de proportionnalité.
28. En prononçant ainsi, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision
pour les motifs qui suivent.
29. En premier lieu, c'est à tort qu'elle s'est abstenue de s'assurer, comme
cela lui était demandé, qu'il était raisonnablement prévisible, pour M. [E],
au moment où les infractions ont été commises, que celles-ci étaient
susceptibles de faire l'objet d'un cumul de poursuites et de sanctions pénale
et fiscale.
30. Cependant l'arrêt n'encourt pas la censure de ce chef. En effet, la Cour
de cassation est en mesure de s'assurer que ce cumul était raisonnablement
prévisible pour l'intéressé, dès lors qu'à la date des faits poursuivis,
antérieure aux décisions du Conseil constitutionnel précitées (paragraphe 12),
les dispositions des articles 1729 et 1741 du code général des impôts
permettaient le cumul de telles sanctions, quels que soient les faits en
cause, la dissimulation excédant le dixième de la somme imposable ou le
chiffre de 153 euros.
31. En deuxième lieu, les juges n'ont pas recherché, préalablement au
prononcé de la peine, si la répression pénale était justifiée au regard de la
gravité des faits retenus, alors que le prévenu faisait valoir qu'il avait
fait l'objet d'une pénalité fiscale sur le fondement de l'article 1729 du code
général des impôts.
32. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
33. En troisième lieu, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la
proportionnalité des sanctions pénales choisies au regard des sanctions
fiscales déjà définitivement prononcées et de la gravité concrète des faits
commis.
34. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
LA DISCRIMINATION
Article 225-1 du Code Pénal
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de
leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation
économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de
leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de
leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du
sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique,
apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des
moeurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
LE CHANTAGE
Article 312-10 du Code Pénal
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération,
soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 13 janvier 2016 Pourvoi N° 14-85905 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Daniel X... a été cité devant le tribunal
correctionnel pour avoir obtenu ou tenté d'obtenir la promesse de poursuivre une relation sentimentale et sexuelle avec M. Nicolas D... en
le menaçant de révéler qu'il entretenait une "relation adultère de nature homosexuelle" ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ;
qu'appel a été interjeté ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce notamment que la menace de révéler l'orientation sexuelle d'un individu doit s'apprécier au
regard du contexte des faits et de la personnalité de la personne menacée ; que les juges relèvent que M. D..., très jeune majeur, entretenait des
relations homosexuelles et hétérosexuelles ; qu'ils en déduisent qu'il a pu légitimement penser que la révélation de sa vie intime allait porter
préjudice à la relation qu'il entretenait avec une jeune fille ainsi qu'à son image au sein de son établissement de formation professionnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, desquelles il résulte que les révélations et imputations objet des menaces formulées par le prévenu
étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la victime appréciés au regard de sa situation concrète, la cour d'appel a justifié sa décision
L'EXTORSION DE FONDS
L'infraction d'extorsion n'exige pas, pour être constituée,
que la signature obtenue par violence, menace ou contrainte soit apposée sur un
document valant engagement
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du
5 février 2025 Pourvoi N° 24-81.579 cassation
Vu l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité
sociale :
9. Selon ce texte, en contrepartie des frais qu'elle engage
pour obtenir le remboursement des prestations servies, la caisse d'assurance
maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre
une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de
l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal
au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites de
montants maximum et minimum fixés par arrêté.
10. L'arrêt attaqué, après
avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles, notamment celle
relative au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme de 1
114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, a condamné le prévenu au paiement
à ladite caisse de la somme de 1 162 euros au même titre.
11. En statuant
ainsi, alors que le tiers responsable ne peut être condamné au paiement que
d'une seule indemnité forfaitaire à la caisse d'assurance maladie, la cour
d'appel a méconnu le texte susvisé.
12. La cassation est par conséquent
encourue de ce chef.
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 3 novembre 2016 Pourvoi N° 15-83892 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 janvier 2013, les époux Z...ont déposé plainte
contre M. X..., professeur d'économie et gestion, enseignant au lycée dans lequel leur fils Mathieu était scolarisé ; qu'ils ont expliqué que
M. X... s'était présenté à leur domicile courant juin 2012, avait accusé leur fils Mathieu de l'avoir agressé en décembre 2011 dans l'enceinte de
l'établissement en projetant dans sa direction, à faible distance, une boulette faite de papier d'aluminium très serré, avait affirmé avoir été
blessé au crâne et continuer à subir des séquelles, et leur avait réclamé une indemnisation en brandissant la menace d'un dépôt de plainte, d'une
exclusion du lycée et d'un séjour de leur fils en prison ; que les époux Z... ont ajouté que, quelques jours après, le 30 juin 2012, ils avaient
signé une " convention d'indemnisation " préparée par M. X..., en présence de la compagne de ce dernier, Mme Y..., qu'ils avaient commencé
à payer la somme convenue de 7 500 euros sur la base de versements mensuels de 300 euros, et qu'ils avaient en définitive décidé de porter
plainte au motif que le comportement de M. X... leur paraissait répréhensible ; qu'à l'issue de l'enquête, M. X... a été renvoyé devant
le tribunal correctionnel des chefs d'extorsions ainsi que de faux et usage ; que Mme Y... a été poursuivie des chefs de complicité
d'extorsions ; que le tribunal correctionnel a relaxé Mme Y... ; qu'après avoir relaxé M. X... pour les délits de faux et usage, il l'a déclaré
coupable d'extorsions ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel du jugement
Sur le moyen, pris en ses 1e, 2e et 4e branches :
Attendu que M. X... a été poursuivi sous la qualification d'extorsions pour avoir, d'une part, le 30 juin 2012, " obtenu ou tenté
d'obtenir par violences, menace de violences ou contrainte, en l'espèce par une convention d'indemnisation, la remise de la somme de 7 500 euros ",
d'autre part, du 30 juin 2012 au 29 janvier 2013, " obtenu ou tenté d'obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte, la remise de la somme de 7 500 euros " ;
Attendu qu'en modifiant, dans un souci de clarification et de précision, le libellé de ces incriminations, et en déclarant le prévenu
coupable d'avoir, d'une part, le 30 juin 2012, obtenu par la contrainte la signature d'une " convention d'indemnisation " en vue de la remise de 7 500
euros, d'autre part, du 30 juin 2012 au 29 janvier 2013, obtenu ou tenté d'obtenir par la contrainte la remise de la somme de 7 500 euros, l'arrêt
n'encourt aucun des griefs invoqués, les modifications opérées étant purement rédactionnelles et n'affectant en rien la nature des poursuites ni l'étendue de la saisine de la cour ;
Qu'au surplus, il résulte des motifs de l'arrêt que M. X... a été invité à s'expliquer à la fois sur les circonstances dans lesquelles la
convention a été signée et sur celles dans lesquelles les paiements ont été effectués par les époux Z... ; qu'enfin, lors de l'audience d'appel, la
défense a formulé des observations sur les deux aspects de la prévention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses 1e, 2e et 4e branches ;
Sur le moyen, pris en ses 3e et 5e branches :
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de s'être fait remettre des fonds en exerçant une contrainte morale, l'arrêt retient,
notamment, que M. X..., au lieu de faire part de ses doléances à son administration, a décidé de se faire justice lui-même, qu'à l'issue d'une
enquête personnelle sur Mathieu Z... et sa famille, il s'est rendu à leur domicile et, refusant de simples excuses, a fait pression sur les parents en
évoquant un dépôt de plainte, une exclusion du lycée et une possible incarcération, qu'après cette mise en condition, il est revenu peu après avec
sa compagne dont la présence avait pour objet d'accroître la pression, ayant préparé une convention d'indemnisation, après avoir réduit ses prétentions de
10 000 euros à 7 500 euros, afin d'obtenir leur signature ; que les juges ajoutent que le comportement de M. X... a fortement impressionné aussi bien M.
Z..., concierge dans un collège de la région, que son épouse, récemment victime d'un accident vasculaire cérébral, l'un et l'autre très préoccupés
tant du sort de leur fils que des possibles répercussions d'un dépôt de plainte sur la situation professionnelle de M. Z... ; que la cour en déduit
que seule la contrainte morale exercée par M. X..., qui avait pleinement conscience de la situation des conjoints Z...et de la vulnérabilité de
l'épouse, lui a permis d'obtenir une indemnisation excessive au regard du préjudice subi ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision,
dès lors que la signature et la remise des fonds ont été déterminées par l'existence d'une contrainte morale exercée en connaissance de cause par le prévenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses 3e et 5e branches
L'EMPOISONNEMENT
Caractérise l’élément matériel du
délit d’administration de substances nuisibles visé à l’article 222-15 du
code pénal, la remise d’une substance à la victime, laquelle en ignorait le
caractère nuisible, afin qu’elle la consomme, peu important que son
ingestion n’intervienne qu’ultérieurement et hors la présence de l’auteur.
Caractérise l’élément intentionnel
du délit d’administration de substances nuisibles visé à l’article 222-15 du
code pénal, la connaissance, par l’auteur, du caractère nuisible de la substance qu’il administre à la victime.
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 23 mars 2021, pourvoi n° 20-81.713 rejet
7. Pour dire établi l’élément matériel du
délit d’administration de substances nuisibles sur mineur de 15 ans, la cour
d’appel retient que le prévenu a reconnu au cours de l’enquête avoir
volontairement préparé une décoction, avec une fleur de Brugmensia dont il
savait qu’elle était une drogue, et l’avoir donnée à B... Y..., lequel a bu
l’infusion en pensant qu’il s’agissait d’un thé « normal ». 8. En statuant
par ces motifs, dépourvus de contradiction et caractérisant l’élément
matériel de l’infraction par la remise à son destinataire de l’infusion
contenant la plante toxique préparée par le prévenu, peu important que
l’ingestion de celle-ci ne soit intervenue qu’ultérieurement et hors sa
présence, la cour d’appel n’a pas méconnu le texte visé au moyen.
9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Pour dire établi l’élément
intentionnel du délit d’administration de substances nuisibles sur mineur
de 15 ans, l’arrêt attaqué retient que le prévenu avait déjà expérimenté
les effets de cette substance dont il savait qu’elle était une drogue et
en avait ressenti les effets durant 5 à 6 heures.
12. En se déterminant ainsi, et dès lors que
l’élément intentionnel du délit prévu à l’article 222-15 du code pénal
résulte de la connaissance, par l’auteur, du caractère nuisible de la
substance qu’il administre, la cour d’appel a justifié sa décision.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
LE PROXENETISME
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 18 mai 2022, pourvoi n° 21-82.283 rejet
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 9 décembre 2010, une information judiciaire a été ouverte des chefs
susvisés sur plainte avec constitution de partie civile de la [1], en raison de
faits constatés sur quatre sites français à caractère pornographique.
3. Cette plainte visait, notamment, des comportements consistant, pour des
jeunes femmes, à se livrer, devant une caméra, à des agissements à caractère
sexuel, retransmis en direct par un moyen de communication audiovisuelle à des
clients qui les sollicitaient et les rémunéraient par un moyen de paiement à distance.
4. Le 8 juillet 2019, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
5. La partie civile a relevé appel de cette ordonnance.
REPONSE
8. Les articles 225-5 et 225-6 du code pénal incriminent le
proxénétisme, qui consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à
aider ou assister la prostitution d'autrui, protéger cette activité, convaincre
une personne de s'y livrer, en tirer profit ou en faciliter l'exercice.
9. Afin de déterminer si un comportement peut être poursuivi au titre du
proxénétisme, il convient, au préalable, de définir ce qui relève de la
prostitution, les dispositions précitées ne la définissant pas.
10. La Cour de cassation juge que la prostitution consiste à se prêter,
moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils
soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim., 27 mars 1996,
pourvoi n° 95-82.016, Bull. crim. 1996 n° 138).
11. Le développement d'internet a favorisé un phénomène connu sous le nom de «
caming », consistant pour des « camgirls » ou « camboys » à proposer, moyennant
rémunération, une diffusion d'images ou de vidéos à contenu sexuel, le client
pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du
comportement ou de l'acte sexuel à accomplir.
12. Ces comportements n'entrent pas dans le cadre de la définition précitée, dès
lors qu'ils n'impliquent aucun contact physique entre la personne qui s'y livre
et celle qui les sollicite, de sorte que l'assimilation de ces comportements à
des actes de prostitution suppose une extension de cette définition.
13. Or, il apparaît que le législateur n'a pas entendu étendre cette définition,
y compris à l'occasion de lois récentes pénalisant certains comportements de nature sexuelle.
14. Ainsi, l'article 611-1 du code pénal, créé par la loi n° 2016-444 du 13
avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à
accompagner les personnes prostituées, incrimine le fait de solliciter une
personne qui se livre à la prostitution, en précisant que ce fait consiste, en
échange d'une rémunération, à solliciter, accepter ou obtenir des relations de
nature sexuelle, ce qui exclut l'incrimination en l'absence de telles relations.
15. Par ailleurs, l'article 227-23-1 du code pénal, créé par la loi n° 2021-478
du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et
de l'inceste, réprime le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d'un mineur
la diffusion ou transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère
pornographique de ce mineur. Même si la condition d'une rémunération n'est pas
exigée pour caractériser cette infraction, il convient de souligner que le
législateur n'a pas employé le terme de prostitution pour qualifier ce
comportement, pourtant comparable à celui visé dans la présente affaire.
16. En l'état de cette évolution législative, dont il résulte que la notion de
prostitution n'excède pas les limites de la définition jurisprudentielle
précitée, qui n'a pas été remise en cause depuis 1996, il n'appartient pas au
juge de modifier son appréciation dans un sens qui aurait pour effet d'élargir
cette définition au-delà de ce que le législateur a expressément prévu.
17. Par l'arrêt attaqué, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de
proxénétisme aggravé, la chambre de l'instruction retient qu'il lui incombe de
garantir le respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et de
ne pas s'écarter de la définition jurisprudentielle de la prostitution qui
implique le contact physique onéreux avec le client pour la satisfaction des besoins sexuels de celui-ci.
18. Les juges ajoutent qu'en l'absence de contact physique avec le client
lui-même, l'activité visée par la plainte se distingue de la prostitution.
19. En l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme
elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a
justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
20. Dès lors, le moyen doit être écarté.
LE VIOL EN FRANCE
Chaque heure, près de 9 personnes sont violées, soit 205 viols par jour. Le nombre de viols seraient
de 75.000 par an en France, dont seulement 10 885 déclarés. Les tentatives de viols seraient de 198 000.
400 enfants sont violés par jour.
LA QUALIFICATION D'AGRESSION SEXUELLE PERMET DE CORRECTIONNALISER UN VIOL
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du
17 mars 2021, pourvoi n° 20-86.318 cassation partielle
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 31 août 2010, Mme C... X... et sa fille, D... X..., née le [...], se sont présentées au commissariat de police
de L’Haÿ-les-Roses (94) pour dénoncer des faits de viol commis par plusieurs
pompiers de la caserne de Bourg-la-Reine en novembre 2009.
3. Au mois de mars 2011, une information
judiciaire a été ouverte contre MM. B... Y..., E... Z... et F... W... des
chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et sur personne
vulnérable, et viols et agressions sexuelles en réunion sur mineure de 15
ans et sur personne vulnérable.
4. Un réquisitoire supplétif a été pris le
24 septembre 2012 afin d’étendre la saisine du juge d’instruction à des
faits d’omission de porter secours à personne en péril, contre MM. G...
V..., H... U..., I... T... et J... S..., et contre personne non dénommée des
chefs de viols en réunion sur mineure de 15 ans et de corruption de mineure
de 15 ans par utilisation d’un réseau de communications électroniques.
5. Par une ordonnance du 19 juillet 2019, le
magistrat instructeur a requalifié les faits de viols et agressions
sexuelles sur mineure de 15 ans en réunion commis en novembre 2009 en
atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur
mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par
plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, et
ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. Y..., Z..., et
W....
6. Il a ordonné un non-lieu pour tous les
autres faits dont il était saisi.
7. Les consorts X... ont relevé appel de
cette décision.
Réponse de la Cour
15. Les moyens sont réunis.
Sur la recevabilité du deuxième moyen
16. Les parties civiles sont recevables à
critiquer, devant la Cour de cassation, l’arrêt de la chambre de
l’instruction en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction,
dans ses dispositions ordonnant le renvoi de MM. Y..., Z... et W..., du chef
d’atteinte sexuelle aggravée, devant le tribunal correctionnel, dès lors que
ce dernier, saisi de la poursuite, n’a pas le pouvoir de modifier les
dispositions de l’arrêt, s’il estime que les faits qui lui sont déférés sous
la qualification de délit sont de nature à entraîner le prononcé de peines
criminelles, l’article 469, dernier alinéa, du code de procédure pénale lui
interdisant de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il
avisera dans le cas où, comme en l’espèce, la victime était constituée
partie civile et assistée d’un avocat lorsque le renvoi devant la
juridiction correctionnelle a été ordonné.
Sur le fond
17. Il résulte des articles 222-22 et 222-23
du code pénal que les infractions d’agression sexuelle et de viol exigent
que les faits aient été commis avec violence, contrainte, menace ou
surprise. La contrainte peut être morale.
18. Aux termes de l’article 222-22-1, alinéa
3, du même code, issu de la loi n° 2018-703, du 3 août 2018, lorsque les
faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la
surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne
disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.
19. Il résulte des travaux préparatoires de
la loi du 3 août 2018 que le législateur a entendu donner une valeur
interprétative à cette disposition. Il ne saurait être déduit de l’emploi
des mots « sont caractérisés » une analyse contraire. En effet, ce texte ne
modifie pas les éléments constitutifs de l’infraction ni n’instaure une
présomption d’absence de consentement du mineur de 15 ans. Il a pour seul
objet de désigner certaines circonstances de fait que le juge doit prendre
en compte pour apprécier si, dans le cas d’espèce, les agissements ont été
commis avec contrainte morale ou surprise. Ayant un caractère interprétatif,
l’article 222-22-1, alinéa 3, du code pénal s’applique aux faits commis
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018.
20. Il appartient à la chambre de
l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction
clôturant une procédure d’information, d’apprécier souverainement si les
charges résultant de la procédure sont suffisantes pour justifier le renvoi
des personnes mises en cause devant la juridiction de jugement. La chambre
de l’instruction peut ordonner un supplément d’information si elle le juge
utile, étendre l’information aux infractions résultant de la procédure qui
n’auraient pas été visées par l’ordonnance du juge d’instruction, et
ordonner que les personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle et qui
n’ont pas fait l’objet d’un non-lieu devenu définitif soient mises en examen
pour les infractions résultant du dossier de la procédure.
21. Il revient à la Cour de cassation,
saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction statuant
sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction réglant une procédure
d’information, de vérifier si la chambre de l’instruction, dans l’exercice
de son appréciation souveraine des faits et des preuves, a statué sur
l’existence et la suffisance des charges par des motifs suffisants, exempts
de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires
déposés devant elle. La Cour de cassation ne peut substituer son
appréciation des faits et des preuves à celle de la cour d’appel.
22. En l’espèce, pour dire qu’il n’existe
pas de charges suffisantes contre quiconque du chef de viol ou d’agression
sexuelle, l’arrêt attaqué relève que D... X..., née le [...], a exposé
souffrir depuis l’âge de 12 ans de crises de tétanie nécessitant de
multiples interventions des sapeurs-pompiers, cent-trente interventions
ayant été recensées, et a indiqué vouer aux pompiers un véritable culte,
confirmé par son entourage tant familial qu’amical.
23. Les juges ajoutent qu’elle a d’ailleurs
effectué un stage chez les jeunes pompiers et souhaité entrer en contact
avec nombre d’entre eux, par le biais des réseaux sociaux, demandant à une
amie proche de lui communiquer leurs coordonnées, et acceptant que ceux qui
l’avaient contactée transmettent à leurs collègues son numéro de téléphone.
24. Ils relèvent également que, lors de sa
plainte initiale, D... X... a dénoncé un seul viol commis en réunion,
qu’elle aurait subi courant novembre 2009 au domicile de M. Y..., de la part
de ce dernier, de M. Z... et de M. W..., ajoutant avoir eu des rapports
sexuels consentis avec de nombreux autres pompiers.
25. Les juges énumèrent les agressions
imaginaires dénoncées par la plaignante, avant et après la plainte du 31
août 2010, et notamment une plainte pour viol et séquestration par deux
auteurs, survenus le 14 mars 2018 sur un parking de L’Haÿ-les-Roses, faits à
propos desquels D... X... a concédé avoir menti.
26. Ils énoncent que, dans sa première
version des faits livrée aux enquêteurs, D... X... a affirmé, qu’exception
faite des actes sexuels de novembre 2009, ses rapports sexuels avec M. Y...
avaient tous été consentis, que c’est seulement en cours d’information que
la plaignante, revenant sur ses déclarations initiales, a soutenu qu’aucun
de ses rapports sexuels avec ce dernier ne l’avait été, que l’expert
psychiatre a attribué ce changement de discours à l’influence de la
psychothérapie alors en cours et au fait qu’il lui était difficile de se
présenter autrement devant ses parents, qu’en outre, après avoir expliqué
qu’elle avait clairement annoncé à ses partenaires sexuels son refus de la
sodomie et du cunnilingus, choix qu’ils avaient tous respecté, elle a écrit
au juge d’instruction pour lui signaler que M. Y... l’avait à plusieurs
reprises sodomisée.
27. Les juges exposent par ailleurs que les
investigations ont mis en évidence que la victime s’était envoyé à elle-même
des messages de menaces et d’insultes par un compte de messagerie anonyme
qu’elle avait payé à l’aide de son compte Paypal.
28. Ils énoncent que l’expertise effectuée,
dans le cadre d’une plainte postérieure, par le professeur Peretti, a conclu
que D... X... révélait des traits anxieux, des troubles du sommeil et des
épisodes dissociatifs de la conscience, des épisodes de déficit intellectuel
et cognitif de nature à réduire sa capacité à représenter le réel ou le vécu
et susceptibles de réduire sa crédibilité.
29. Ils ajoutent enfin, s’agissant de la
vulnérabilité de la plaignante, que la brièveté des contacts avec ses
partenaires ne permettait pas forcément à ces derniers de la constater,
comme l’a mentionné le docteur O... dans son rapport d’expertise, que la
plaignante a concédé, que dans la mesure où elle n’avait pas opposé de refus
lors de ses rapports sexuels avec les pompiers, ces derniers avaient pu la
croire consentante, que le docteur O... a relevé chez D... X... des signes
couramment observés chez les victimes d’agressions sexuelles, lesquels
étaient antérieurs aux agressions alléguées, et a envisagé son comportement
sexuel comme un comportement à risques avec des conduites auto-agressives,
liés à la pathologie dont elle était atteinte, ce que la jeune fille a
d’ailleurs confirmé.
30. La cour d’appel conclut qu’au terme de
l’information, les initiatives prises par D... X... pour lier connaissance
avec des pompiers dont le métier la fascinait et pour avoir avec eux des
rapports sexuels, dans des lieux souvent publics choisis par elle et pour
lesquels elle fournissait fréquemment des préservatifs, son comportement
entreprenant et provocateur, sa participation active lors des ébats,
notamment par la réalisation de fellations, la dissimulation de son âge, sa
morphologie établie par les photographies versées par sa mère à la
procédure, sa capacité à refuser certains actes, comme la pénétration anale
et le cunnilingus, et à repousser certains de ses partenaires, ne permettent
pas de caractériser la violence, la contrainte physique ou morale, la menace
ou la surprise nécessaire à la constitution des infractions de viols et
d’agressions sexuelles visées à la procédure, et ce, nonobstant la
différence d’âge entre la plaignante et les mis en cause.
31. Pour dire qu’il n’existe pas de charges
suffisantes contre MM. Y..., Z... et W... d’avoir commis les faits qui leur
sont reprochés avec violence, contrainte, menace ou surprise, l’arrêt relève
que D... X... a expliqué ne pas avoir exprimé de refus à MM. Y... et Z...,
mais avoir opposé la passivité à ses agresseurs, ce qui n’est pas compatible
avec la réalisation d’une fellation, qu’en outre, il résulte de ses propres
déclarations qu’elle a été en capacité de refuser les attouchements tentés
sur sa personne par M. W..., ce qui démontre que son discernement n’était ni
aboli ni même amoindri par son âge, ou par les médicaments, que le viol
dénoncé est en outre rendu peu vraisemblable par la relation à quatre que la
plaignante a eue au domicile de M. Y..., avec ce dernier, son cousin et une
amie quelques temps plus tard, épisode à propos duquel tous les
protagonistes se sont accordés à dire qu’il s’agissait de rapports librement
consentis en vue desquels D... X... avait apporté préservatifs et sex-toys.
32. Les juges ajoutent que les agressions
imaginaires dénoncées par la plaignante avant et après la plainte du 31 août
2010, et les multiples variations dans ses déclarations leur retirent
beaucoup de crédibilité, et ne permettent pas, en l’absence d’éléments
objectifs, de caractériser le défaut de consentement de la plaignante, et de
retenir à l’encontre de MM. Y... et Z... la qualification de viol et
d’agression sexuelle en réunion sur mineure de 15 ans, et à l’encontre de
M. W..., celle d’agression sexuelle en réunion sur mineure de 15 ans.
33. Les juges concluent cependant que
M. Y... connaissait l’âge de D... X..., ce qu’il a admis, que M. Z... a
exposé l’avoir demandé à M. Y..., qui ne lui a pas répondu, et avoir abrégé
la fellation en raison de son doute sur l’âge de la plaignante, que M. W...
a confié qu’il pensait la jeune fille âgée de 14 à 16 ans, que si ce dernier
a toujours contesté avoir eu le moindre geste de nature sexuelle à l’égard
de la plaignante, il a admis qu’il avait été invité à participer au rapport
sexuel entre M. Y... et D... ; que cette passivité alléguée parait peu
compatible avec l’ambiance du moment, telle que décrite par les autres
protagonistes, et avec la prise, par ses soins d’une photographie de D...
X... en partie dénudée et enveloppée dans une couette, que ces éléments
justifient la requalification des faits reprochés aux susnommés en atteinte
sexuelle sur mineure de 15 ans en réunion.
34. Pour dire n’y avoir lieu à suivre à
l’encontre de MM. V... et U..., mis en cause pour avoir imposé à D... des
pénétrations digitales, vaginales et une fellation sur le capot d’un
véhicule dans un parking près de chez elle, en juin 2010, alors qu’elle
était âgée de plus de 15 ans, l’arrêt relève que la plaignante a d’abord
exposé qu’elle avait consenti à ces actes, avant de se raviser et d’affirmer
qu’elle n’avait pas pu être consentante en raison des médicaments qu’elle
prenait.
35. Les juges exposent que D... X... a
également soutenu n’avoir appris qu’à la dernière minute que ses partenaires
seraient deux, alors que les mis en cause ont assuré qu’une relation à trois
était prévue, ce qu’un ami de D... X..., qui l’a accompagnée au rendez-vous,
a confirmé.
36. Ils retiennent que les accusations de la
plaignante, sujettes à caution, pour les motifs déjà exposés dans l’arrêt,
ne sont corroborées par aucun élément objectif sur l’absence de consentement
de l’intéressée, que son comportement aguicheur, provocateur, entreprenant
envers ses partenaires pompiers ne permet pas de déduire la contrainte
morale de la seule différence d’âge entre D... X... et les deux mis en cause
qu’elle avait accepté de rencontrer.
37. Pour dire n’y avoir lieu à suivre contre
MM. L... Q..., I... P... et M... N... des chefs de viols et agressions
sexuelles qui leur étaient reprochés, l’arrêt relève que les faits ont eu
lieu en 2010, après le quinzième anniversaire de D... X..., et que les trois
mis en cause ont reconnu avoir eu des rapports sexuels consentis avec la
plaignante.
38. Les juges retiennent que le fait d’être
intervenus, même à plusieurs reprises, auprès de D... X... à l’occasion de
crises de spasmophilie ou de tétanie, ne pouvait suffire à la rendre
vulnérable à leurs yeux, ces pathologies étant bénignes, et aucun des faits
dénoncés par la plaignante n’ayant été commis pendant une intervention des
pompiers à son chevet en raison d’une crise, que, dès lors, la circonstance
aggravante de l’autorité conférée par la fonction de pompier ne peut être
retenue, quand bien même ils seraient venus aux rendez-vous fixés avec D...
X... en uniforme et à bord d’un véhicule de service.
39. La cour d’appel conclut qu’en raison des
déclarations fluctuantes de la plaignante, de sa propension à dénoncer des
agressions imaginaires, en l’absence d’éléments objectifs, les agissements
reprochés par D... X... à MM. P..., N... et Q... ne sont pas caractérisés,
et ne sauraient donner lieu à la mise en examen sollicitée.
40. Ces motifs, par lesquels la chambre de
l’instruction a pu estimer notamment, s’agissant des faits dénoncés alors
que D... X... était âgée de 14 ans, que cette dernière disposait du
discernement nécessaire pour les actes dénoncés auxquels elle a consenti,
relèvent de l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments
de fait et de preuve recueillis au cours de l’information. Par ailleurs ils
répondent aux articulations essentielles des mémoires déposés devant la
chambre de l’instruction et sont exempts d’insuffisance comme de
contradiction.
41. Les moyens qui critiquent ces motifs
doivent, en conséquence, être rejetés.
Mais sur le sixième moyen
Vu les articles 227-22 du code pénal et 593
du code de procédure pénale :
43. Selon le premier de ces textes, dans sa
version issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, le fait de favoriser ou
de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept
ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur est âgé de
moins de 15 ans.
44. Selon le second, tout jugement ou arrêt
doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou
la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
45. Pour confirmer l’ordonnance du juge
d’instruction ayant dit n’y avoir lieu à suivre du chef de corruption de
mineure de 15 ans par l’utilisation d’un réseau de communications
électroniques, l’arrêt énonce que la loi du 5 août 2013 a abrogé la
circonstance de la minorité de 15 ans, et réprime désormais la corruption de
mineur, sans distinction d’âge.
46. Les juges relèvent qu’il résulte des
déclarations de D... X..., de ses amis, et des sapeurs-pompiers entendus,
que c’est la jeune fille qui a sollicité les coordonnées de pompiers
célibataires afin de les contacter, notamment via les réseaux sociaux, et
qu’elle a également autorisé ceux avec lesquels elle avait été en relation à
transmettre ses coordonnées à leurs collègues.
47. Les juges énoncent que, selon AB... XY...,
D... X... a très vite retiré la mention de son âge de son compte Facebook,
et qu’après un échange portant sur le métier de pompier, c’est elle qui
donnait à la conversation une connotation sexuelle en termes
particulièrement crus, et parfois s’exhibait par webcam.
48. Ils relèvent encore que les pompiers, à l’exception
de M. Y..., se sont défendus d’avoir connu son âge exact au moment des faits
reprochés, ajoutant que sa morphologie et ses connaissances en matière de
sexualité accréditaient la thèse de sa majorité et que les déclarations
contraires faites sur ce point par la partie civile, lesquelles ne peuvent
être accueillies qu’avec circonspection, en raison de sa propension à
travestir la réalité, notamment du fait de la pathologie dont elle est
atteinte, ne permettent pas d’établir que les pompiers entrés en contact
avec elle par un réseau de communications électroniques savaient qu’elle
était mineure.
49. Ils retiennent qu’en outre, au regard du déroulement
des entretiens avec les pompiers, tels que décrits, non seulement par ces
derniers, mais encore par l’entourage amical de D... X..., et du
comportement adopté par l’intéressée, il n’est pas établi que les mis en
cause cherchaient à pervertir l’adolescente, dans la mesure où elle était à
l’origine des conversations sexualisées et des exhibitions.
50. En l’état de ces énonciations, la chambre de
l’instruction a violé les textes susvisés.
51. L’arrêt énonce à tort que la loi du 5 août 2013 a
abrogé la circonstance de la minorité de 15 ans, et réprime désormais la
corruption de mineur, sans distinction d’âge, alors que, dans sa version
issue de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007, le texte réprimait déjà la
corruption de tout mineur de 18 ans, la minorité spéciale de 15 ans
constituant seulement une circonstance aggravante.
52. Dès lors, iI n’est pas établi que la chambre de
l’instruction a recherché si les personnes incriminées avaient connaissance
de ce que la plaignante était âgée de moins de 18 ans.
53. En conséquence, la chambre de l’instruction n’a pas
justifié sa décision et la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le premier moyen du mémoire
complémentaire, pris en ses deuxième et troisième branches
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
55. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs
propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des
motifs équivaut à leur absence.
56. Il ressort de l’examen des pièces de la procédure,
dont la Cour de cassation a le contrôle, que le magistrat instructeur a été
saisi contre M. Y... de faits de viols et agressions sexuelles commis sur
D... X... entre le 1er février 2009 et le 31 août 2010.
57. La chambre de l’instruction ne pouvait, sans se
contredire, limiter le renvoi de l’intéressé du chef d’atteinte sexuelle aux
seuls faits commis en réunion en novembre 2009 avec MM. Z... et W..., alors
qu’elle constatait que les relations sexuelles entretenues entre M. Y... et
la plaignante avaient débuté au printemps 2009, et qu’elle mentionnait que
l’intéressé, ayant appris que la jeune fille n’était âgée que de 14 ans,
avait poursuivi la relation parce qu’il n’avait pas l’impression de lui
faire du mal et en raison de leur attirance réciproque.
58. La cassation est à nouveau encourue.
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 11 janvier 2016, pourvoi n° 15-86590 rejet
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant M. Grégory X... coupable d'agression sexuelle commise en état d'ivresse, l'arrêt attaqué relève,
notamment, qu'invité à une fête se déroulant au domicile du compagnon de Mme Y..., le prévenu a, par trois fois, fait des avances à celle-ci, qui
les a clairement repoussées ; qu'il s'est ensuite introduit dans la chambre de son hôte, où Mme Y..., elle-même alcoolisée, s'était retirée
pour dormir ; qu'il a pratiqué sur sa personne des baisers et caresses intimes que l'intéressée, dans un état de semi-conscience, a cru être
prodigués par son ami, avant de comprendre son erreur et de s'y opposer ; que les juges ajoutent qu'en agissant ainsi, le prévenu a obtenu des
faveurs sexuelles en abusant des difficultés de compréhension rencontrées par la victime, laquelle a pu croire, à juste titre, à la présence de son
compagnon, venu la rejoindre ; que, dès lors, les faits ont été commis avec surprise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'en l'absence même de toute autre manoeuvre, constitue le délit d'agression sexuelle commise par
surprise, prévu par les articles 222-22 et 222-27 du code pénal, le fait de profiter, en connaissance de cause, de l'erreur d'identification
commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la
cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis
LE COMPLEXE DU SINGE BONOBO DANS UN COUPLE
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 29 mars 2017, pourvoi n° 17-80237 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que Mme X... a dénoncé le 15 janvier 2013 des faits de viols commis le 1er janvier
2012 et au mois de juillet 2012 par M. Y..., avec lequel elle vivait ; qu'elle a exposé que ces faits avaient été précédés d'une violente dispute
au sein du couple et de violences exercées par son compagnon sur elle ; que M. Y... n'a pas contesté les violences exercées mais a soutenu que les
relations sexuelles intervenues postérieurement, exclusives de toutes violences ou contrainte, avaient été librement consenties et résultaient
de la réconciliation du couple ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a mis en accusation M. Y... des chefs de viols et violences
aggravés, appels téléphoniques malveillants et violences contraventionnelles ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision;
Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction et dire n'y avoir lieu de suivre du chef de viols, l'arrêt retient que les
deux relations sexuelles, même si elles ont eu lieu après des disputes, s'inscrivent dans un mode de fonctionnement atypique du couple, traduisent en
réalité la volonté de réconciliation des époux, et qu'il n'est aucunement établi qu'elles aient été imposées par M. Y... à son épouse;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine, la chambre
de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision;
L'AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE SUR MINEUR
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 15 mars 2023, pourvoi n° 21-87.389 Cassation
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme :
7. Il résulte de ce texte que la personne poursuivie doit être informée,
d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre elle et disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
8. En application de l'article 388 du code de procédure pénale, les juges
ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le
prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux
visés à la prévention (Crim., 19 avril 2005, pourvoi n° 04-83.879, Bull. crim. 2005, n° 135).
9. Lorsque la juridiction constate que le fait poursuivi n'a pas été
commis à la date visée par la prévention, mais à une autre date qu'elle détermine, elle en demeure saisie.
10. Le fait n'étant alors pas distinct de celui visé par la prévention, il
n'y a pas lieu de recueillir l'accord de la personne poursuivie pour être jugée sur ce fait commis à une autre date.
11. Cependant, hors le cas d'une erreur matérielle, la restitution au fait
de son exacte date est de nature à emporter des conséquences juridiques au
regard, notamment, de la qualification, de la prescription, de la
détermination de la loi applicable ou de la compétence de la juridiction.
12. Modifiant les termes du débat devant la juridiction de jugement, elle
affecte l'exercice de leurs droits par les parties.
13. En conséquence, les juges ne peuvent retenir, pour entrer en voie de
condamnation, une date autre que celle visée par la prévention, sans que
le prévenu ait été invité à s'expliquer sur cette modification.
14. En l'espèce, pour condamner M. [G] pour agression sexuelle aggravée,
après avoir constaté la réalité du fait dénoncé, l'arrêt attaqué énonce
qu'il n'a pu être commis en 2011, comme l'indique la citation, mais l'a été dans la nuit du 6 au 7 juin 2013.
15. Les juges ajoutent que la question de la date du fait a été longuement
discutée au cours des débats, de manière contradictoire, de sorte qu'il y a lieu de retenir cette dernière date.
16. En l'état de ces motifs, qui n'établissent pas que le prévenu ait été
informé que les juges pouvaient le déclarer coupable du fait poursuivi,
commis à cette autre date, ni qu'il ait été invité à s'expliquer sur cette
modification et ses conséquences, qui n'ont pas été mises dans le débat,
un renvoi pouvant, au besoin, être ordonné à cette fin, la cour d'appel a
méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu les articles 222-22-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
18. Selon le premier de ces textes, les viols et les agressions sexuelles
sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par le partenaire lié par un pacte
civil de solidarité à l'ascendant, le frère, la soeur, l'oncle, la tante,
le grand-oncle, la grand-tante, le neveu ou la nièce de la victime, s'il a sur cette dernière une autorité de droit ou de fait.
19. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres
à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20. Pour qualifier d'incestueuse l'agression sexuelle commise par le prévenu,
l'arrêt attaqué se borne à relever que celle-ci l'a été par lui en qualité
de personne liée par un pacte civil de solidarité à la tante de la victime.
21. En l'état de ce seul motif, qui ne caractérise pas l'existence d'une
autorité, de droit ou de fait, de l'auteur sur la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
22. La cassation est à nouveau encourue.
SI LA PERSONNE EST CONDAMNÉE, LA CIVI PAIE LA VICTIME
Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 21 mai 2015, pourvoi n° 14-18339 Cassation sans renvoi
Vu les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale, ensemble l'article 706-3 de ce code ;
Attendu que les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à
la culpabilité de la personne poursuivie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accusé renvoyé devant une cour d'assises du chef de viol commis sur la personne de Mme X... a été
acquitté ; qu'après cet acquittement, cette dernière a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) d'une demande
en réparation du préjudice causé par cette infraction ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que la cour d'assises n'a pas acquitté l'accusé au motif que les faits de viol
n'étaient pas constitués mais seulement en raison de la réponse négative apportée à la question de savoir si ce dernier était coupable d'avoir à
Martigas-les-Jalles dans la nuit du 20 au 21 novembre 2006 commis sur la personne de Mme X... par violence, contrainte, menace ou surprise un acte
de pénétration sexuelle ; qu'aucune indication ne peut être tirée de cette décision quant à la matérialité de l'infraction elle-même ; qu'on ne peut
considérer que l'arrêt de la cour d'assises impose à la CIVI de constater que les faits ne présentent pas le caractère d'une infraction ; que les
constatations matérielles et objectives sur la personne de Mme X... démontrent que cette dernière a été victime en ce lieu et à cette date de
faits présentant le caractère matériel d'un viol même si la cour d'assises a pu considérer que l'accusé n'aurait pas eu conscience du désaccord de
celle-ci pour la relation sexuelle qu'il a reconnue avoir eu avec elle ; que l'hypothèse non vérifiée selon laquelle cette dernière aurait été
victime, après cette relation sexuelle, de l'intervention d'un autre homme qui l'aurait agressée et violée est sans incidence sur la matérialité des faits ;
Qu'en statuant ainsi, en estimant rapportée la preuve de faits présentant le caractère matériel d'un viol, alors qu'il résultait de ses propres
constatations que la seule personne mise en cause par Mme X... pour l'avoir violée avait été acquittée par une décision définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LES ATTOUCHEMENTS SEXUELS
L’atteinte sexuelle qui caractérise le délit d’agression sexuelle prévu par l’article 222-22 du code pénal suppose un
contact physique entre l’auteur et la victime ; le caractère sexuel d’une
caresse peut être déduit de la manière dont elle est effectuée et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés.
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 3 mars 2021, pourvoi n° 20-82.399 Cassation partielle
8. Pour dire établi
le délit d’agression sexuelle, l’arrêt attaqué retient qu’il résulte des
déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et
corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu’il était assis
à côté de l’enfant, a effectué à plusieurs reprises des caresses à
même la peau sur sa main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en
partant du mollet jusqu’au genou et qu’à l’arrivée des agents de sécurité,
son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette.
9. Les juges ajoutent que ces zones du
corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ont été de nature
à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l’enfant n’avait ni la
maturité ni le pouvoir de s’opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle.
10. En l’état de ces motifs, la cour d’appel
qui a considéré, par une appréciation souveraine, que les caresses avaient
un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et
du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, a justifié sa décision.
11. Le moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 26 février 2020, pourvoi n° 19-82.119 Cassation
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme établissent qu'au prétexte d'un examen clinique, dont les experts ont
démontré qu'il ne correspondait à aucune justification médicale, M. X... avait procédé sur Mme Y..., qu'il avait fait revenir dans son cabinet
après le départ de son dernier patient de la journée, à des massages suivis d'attouchements, notamment, sur le sexe, alors qu'elle était
allongée, pratiquement nue sur la table d'examen ; que les juges ajoutent que la victime était parvenue à repousser le médecin, s'était rhabillée
puis avait quitté le cabinet, avertissant aussitôt ses proches et portant plainte ; que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle,
l'arrêt retient qu'il a surpris Mme Y... en prétextant un examen médical clinique pour la soumettre en réalité à des attouchements sexuels et qu'il
a également exercé une contrainte morale, en se retrouvant seul avec cette jeune patiente, à l'abri des regards, dans un cabinet médical fermé à clé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a examiné tant la crédibilité des accusations de la victime que l'argumentation en défense
présentée par le prévenu, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, lequel ne saurait être accueilli
NON DENONCIATION D'ABUS SEXUEL
2. Le 17 juillet 2014, M. Z... a écrit au
directeur de cabinet de M. Y..., archevêque de Lyon depuis 2002, pour
dénoncer des faits d’agressions sexuelles dont il avait été victime, au
cours de son enfance, avec d’autres jeunes gens, de la part de M. Q...,
prêtre du diocèse de Lyon, curé de paroisse, aumônier d’un établissement
catholique et aumônier d’unité scoute.
3. Plusieurs rencontres ont ensuite eu lieu
entre M. Z..., M. Y..., et plusieurs de ses collaborateurs. M. Y... a
déchargé M. Q... de ses fonctions de curé, puis, le 29 juillet et le 31 août
2015, lui a interdit tout ministère sacerdotal et toute activité comportant
des contacts avec des mineurs.
4. Le 5 juin 2015, M. Z... a déposé plainte
contre M. Q..., pour agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par
personne ayant autorité, devant le procureur de la République à Lyon, lequel
a ouvert une information judiciaire, le 25 janvier 2016. D’autres victimes
ont été identifiées. M. Q..., qui a reconnu avoir procédé à des
attouchements sexuels sur de nombreux enfants, jusqu’en 1991, a été renvoyé
devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 29 octobre 2019.
5. Le 17 février 2016, MM. R... et S...,
tous deux victimes de M. Q..., ont déposé, devant le juge d’instruction
saisi du dossier dans lequel M. Q... était mis en examen, une plainte pour
non-dénonciation d’agressions sexuelles sur des mineurs et omission de
porter secours, afin que la responsabilité de certains des membres du
diocèse de Lyon puisse être recherchée. Le juge d’instruction a communiqué
la plainte au procureur de la République, qui a décidé l’ouverture d’une
enquête préliminaire, le 26 février 2016. A l’issue de celle-ci, il a
procédé à un classement sans suite, le 1er août 2016.
6. Par actes des 23 mai, 1er juin
et 17 juillet 2017, MM. R..., Z..., T..., S..., A... U..., V... U..., AA...,
BB..., X..., indiquant avoir été victimes d’agressions sexuelles commises
par M. Q..., ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Lyon M. Y...
et plusieurs de ses collaborateurs.
7. M. Y... a ainsi été cité pour omission de
porter secours, de 2002 à 2015, pour avoir laissé des enfants et adolescents
être au contact de M. Q... et les avoir ainsi exposés à des agressions
sexuelles, et pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs, au
cours de la même période.
8. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal
correctionnel de Lyon a déclaré irrecevable l’action des parties civiles,
s’agissant de l’infraction d’omission de porter secours. Le tribunal a
relaxé les collaborateurs de M. Y..., ou jugé que l’action publique était
éteinte par prescription à leur égard. Le tribunal correctionnel a retenu,
en ce qui concerne M. Y..., que l’infraction de non-dénonciation
d’agressions sexuelles n’était pas constituée pour la période antérieure à
2010, que l’action publique était éteinte par prescription, depuis 2013,
pour la non-révélation d’une agression dont il avait eu connaissance en
2010, et l’a déclaré coupable des faits de non-dénonciation des agressions
sexuelles qui lui avaient été révélées à partir de juillet 2014 et jusqu’au
5 juin 2015. Le tribunal l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec
sursis. Il a prononcé sur les intérêts civils.
9. Ce jugement a été frappé d’appel par
M. Y... et par les parties civiles, ainsi que par le ministère public, à titre incident.
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 14 avril 2021, pourvoi N° 20-81.196 Rejet
Sur le premier moyen
10. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué en
ce qu’il a déclaré prescrits les faits de non-dénonciation d’agressions
sexuelles sur mineurs commis en mars 2010,
11. Il résulte de l’arrêt attaqué que
M. Y... a été informé, en mars 2010, que M. Q... avait commis des agressions
sexuelles sur M. R..., alors que celui-ci, né en 1979, était âgé de onze
ans.
12. Pour déclarer éteinte par prescription
l’action publique pour le délit de non-dénonciation, par M. Y..., de ces
faits aux autorités judiciaires et administratives, la cour d’appel relève
que cette infraction est un délit instantané pour lequel la prescription
commence à courir au moment où la personne prend connaissance des faits
susceptibles de constituer l’infraction principale et ne les dénonce pas,
soit, en l’espèce, en mars 2010. Elle ajoute que le délai de prescription de
trois ans, alors applicable, n’a pas été interrompu avant l’ouverture, le 26
février 2016, par le procureur de la République, d’une enquête à la suite de
la plainte en non-dénonciation, déposée par M. R.... La cour d’appel retient
encore que cette infraction n’avait aucun caractère clandestin, car la
victime en avait connaissance et pouvait la dénoncer.
13. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a
pas encouru le grief allégué.
14. En effet, le délit de non-dénonciation
de mauvais traitement sur mineur, prévu et puni par l’article 434-3 du code
pénal, dans sa rédaction applicable en la cause, était un délit instantané
dont la prescription courait à compter du jour où le prévenu avait eu
connaissance des faits qu’il devait dénoncer.
15. Le moyen, irrecevable en tant qu’il est
présenté par les autres demandeurs que M. R..., ne peut, dès lors, être
admis.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué en
ce qu’il a relaxé M. Y... du chef de non-dénonciation d’atteintes et
d’agressions sexuelles commis sur mineurs s’agissant des faits postérieurs
au 26 février 2013 et d’avoir débouté les parties civiles de leurs demandes
indemnitaires
Réponse de la Cour
17. L’article 434-3 du code pénal, dans sa
rédaction applicable au moment des faits, issue de l’ordonnance n° 2000-916
du 16 septembre 2000, réprime le fait, pour quiconque ayant eu connaissance
de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un
mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une
déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives.
18. Cet article est inséré dans une section
du code pénal intitulée « Des entraves à la saisine de la justice ». Or,
loin de poser un principe général obligeant les particuliers à dénoncer tous
les faits délictueux dont ils ont connaissance, principe qui n’est énoncé
nulle part ailleurs dans le code pénal, les dispositions contenues dans
cette section ne rendent la dénonciation obligatoire que lorsqu’elle est
particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait.
Comme tout texte d’incrimination, surtout s’il ne découle pas d’un principe
général, cette disposition doit être interprétée de manière stricte.
19. Cet article a pour but de lever
l’obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l’âge ou la fragilité
de la victime l’ont empêchée de dénoncer les faits. Il en résulte que,
lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation ainsi prévue
disparaît.
20. Aussi, la condition, prévue par le texte
en cause, tenant à la vulnérabilité de la victime, doit-elle être remplie
non seulement au moment où les faits ont été commis, mais encore lorsque la
personne poursuivie pour leur non-dénonciation en a pris connaissance.
21. En revanche, tant que l’obstacle ainsi
prévu par la loi demeure, l’obligation de dénoncer persiste, même s’il
apparaît à celui qui prend connaissance des faits que ceux-ci ne pourraient
plus être poursuivis, compte tenu de la prescription de l’action publique.
En effet, d’une part, la condition que la prescription ne soit pas acquise
ne figure pas à l’article 434-3 du code pénal, d’autre part, les règles
relatives à la prescription sont complexes et ne peuvent être laissées à
l’appréciation d’une personne qui peut, en particulier, ignorer l’existence
d’un acte de nature à l’interrompre.
22. Pour prononcer la relaxe de M. Y..., en
ce qui concerne la non-dénonciation, par celui-ci, aux autorités
administratives et judiciaires, d’agressions sexuelles commises par M. Q...,
et qui sont parvenues à sa connaissance en 2014 et en 2015, la cour d’appel
énonce que son obligation de les dénoncer avait disparu, d’une part, parce
que la prescription de l’action publique était acquise quand il avait été
informé de leur existence, d’autre part, parce que leurs victimes, alors
âgées de trente-quatre à trente-six ans, insérées au plan familial, social
et professionnel et ne souffrant pas d’une maladie ou d’une déficience les
empêchant de porter plainte, étaient en mesure de faire connaître
elles-mêmes ces faits aux autorités administratives et judiciaires.
23. C’est à tort que la cour d’appel a
estimé que l’obligation de dénoncer ces agressions sexuelles commises sur
des mineurs avait disparu en raison de la prescription de l’action publique.
24. Cependant, la cassation n’est pas pour
autant encourue, dès lors que, par des motifs relevant de son appréciation
souveraine, la cour d’appel énonce que les victimes étaient, au moment où
les faits ont été portés à la connaissance de M. Y..., en état de les
dénoncer elles-mêmes et que ce seul motif est de nature à justifier la
relaxe prononcée.
LES CONDITIONS DE FORME DES JUGEMENTS
L'exemple de la Cour d'Appel de Montpellier où les décisions de justice sont rendues non pas en application du droit mais
sous couvert d'interprétation des faits, suivant des considérations de réseaux d'influence et de copinage. Le cas d'une condamnation
pénale illégale sur laquelle, les magistrats qui ont rendu le délibéré, refusent de mettre leur nom !
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 30 Mai 2017, pourvoi n° 16-85626 cassation
Vu l'article 486 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition, applicable devant la cour d'appel, que la minute du jugement est datée et mentionne les noms des
magistrats qui l'ont rendu ; que la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée ;
Attendu que, confirmant le jugement de première instance, l'arrêt mentionne le nom de trois magistrats composant la cour lors du délibéré, qui omet de
mentionner la composition lors des débats ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale et que la seule
affirmation que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui
étaient présents lors des débats, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE INFRACTION ET PRÉJUDICE DE LA VICTIME
Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 30 juin 2016, pourvoi n° 14-25070 Cassation
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une tentative de suicide de Robert X..., M. Y... a été déclaré, par arrêt du 25 avril 2002 de la
chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy, devenu irrévocable, coupable de trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques
malveillants réitérés et, sur l'action civile, responsable du préjudice subi par Robert X... ; que celui-ci a demandé l'indemnisation de son
préjudice à un tribunal de grande instance ; que l'instance, interrompue par son décès, a été reprise par ses ayants droit, Mme Brigitte Z..., M.
Romain X..., M. Pierre X..., Mme Marine X..., et M. Ronan X... (les consorts X...) ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'un lien de causalité
directe entre la tentative de suicide de Robert X... et les appels malveillants commis par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, comme s'en prévalait Robert X... dans ses conclusions, dans son arrêt du 25 avril 2002, la cour d'appel avait motivé
sa décision en retenant que les agissements délictueux de M. Y... étaient de façon directe et certaine la cause du préjudice de la partie civile, la
cour d'appel a violé le texte susvisé
LA JUSTICE RESTAURATIVE
C'est un dialogue entre l'agresseur et la victime pour que
celle ci comprenne pourquoi elle est victime et pour que l'agresseur comprenne
la portée de son acte. Un curieux décret prévoit la justice restaurative même
après prescription dans le cadre de violences familiale :
Le Décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021
tend à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille.
Ainsi l'épouse comprendra qu'elle n'est pas sage ou pas sympa
et que par conséquent elle a été violée et battue. L'époux comprendra qu'il faut
qu'il tape moins fort ?
LE FICHIER DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES
CONSEIL D'ETAT, section contentieux, 9e et 10 e sous sections réunies, avis n°395119 du 30 mars 2016
1. Aux
termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale qui autorise sa mise
en œuvre, le traitement des antécédents judiciaires a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de
preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». Il a également pour finalité, en application des
articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de la sécurité intérieure, « dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la
défense des intérêts fondamentaux de la Nation », de contribuer à mettre en œuvre des mesures de protection ou recueillir des renseignements pour la prise
de décisions administratives relatives à des emplois ou activités mentionnés à l'article L. 114-1 du même code, par l'intermédiaire de consultations autorisées, ainsi que,
en application de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, de faciliter l'instruction des demandes en matière de nationalité, de titres de séjour et ordres nationaux.
2. Aux
termes de l'article 230-7 du code de procédure pénale qui détermine les données qui peuvent être collectées par ce traitement, il peut contenir des
informations sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme
auteurs ou complices, à la commission de certaines infractions mentionnées au 1° de l'article 230-6, sur les victimes de ces infractions et sur les personnes
faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort. Aux
termes du premier alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du
procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification
judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner
aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données
personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la
finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles
relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de
non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la
République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait
l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles
L. 114-1,
L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article
17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. ». Le
décret n° 2012-652 du 4 mai 2012, pris sur le fondement de ces dispositions,
encadre la mise en œuvre du traitement des antécédents judiciaires. L'article
R. 40-27 du code de procédure pénale fixe la durée de conservation des données concernant les personnes mises en cause dans le cadre des procédures
établies par les services chargés des opérations de police judiciaire. Cette durée est modulée en fonction de l'âge de la personne mise en cause, de la
gravité des infractions et de l'inscription de nouveaux faits dans le fichier.
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu décrire entièrement les possibilités de radiation, correction ou maintien de données
dans le fichier « traitement des antécédents judiciaires », offertes à l'autorité à laquelle il a confié la responsabilité de contrôler sa mise en œuvre.
4. Il en découle, en premier lieu, que saisis d'une demande d'effacement de
données qui ne sont pas au nombre de celles que l'article
230-7 du code de procédure pénale autorise à collecter dans le traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République ou le magistrat
référent mentionné à l'article 230-9 du même code, désignés par la loi pour contrôler le fichier, sont tenus d'en ordonner l'effacement.
5. En deuxième lieu, les
dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale citées au point 2 ne prévoyant de règles particulières relatives au maintien ou à l'effacement
des données du traitement des antécédents judiciaires qu'en cas de décisions de relaxe, d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite, le législateur
doit être regardé comme n'ayant entendu ouvrir la possibilité d'effacement que dans les cas où les poursuites pénales sont, pour quelque motif que ce soit,
demeurées sans suite. Hors cette hypothèse, les données ne peuvent être effacées qu'à l'issue de la durée de conservation fixée par voie réglementaire et le
procureur de la République ne peut alors que refuser une demande d'effacement avant ce terme.
6. En troisième lieu, si la procédure a abouti à une décision de relaxe ou d'acquittement, le principe est l'effacement des données et l'exception, le
maintien pour des raisons tenant à la finalité du fichier. Lorsque les faits à l'origine de l'enregistrement des données dont l'effacement est demandé ont fait
l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en
application de l'article
177 du code de procédure pénale ou d'un classement sans suite pour insuffisance de charges par le procureur de la République, les données sont
conservées dans le fichier mais sont assorties d'une mention qui fait obstacle à la consultation dans le cadre des enquêtes administratives. Le procureur de la
République a toutefois la possibilité d'ordonner leur effacement. Lorsque les faits à l'origine de l'enregistrement des données dont l'effacement est demandé
ont fait l'objet d'un classement sans suite pour un autre motif que l'insuffisance de charges, les données sont assorties d'une mention et les
dispositions précitées de l'article
230-8 du code de procédure pénale, si elles ne le prévoient pas expressément, ne font pas obstacle à ce que le procureur de la République ou le magistrat
référent décide d'accueillir une demande d'effacement.
7. Dans les hypothèses mentionnées au point 6, les magistrats compétents pour décider de l'effacement des données prennent en considération la nature et la
gravité des faits constatés, les motifs de la relaxe, de l'acquittement, du non-lieu ou du classement sans suite, le temps écoulé depuis les faits et la
durée légale de conservation restant à courir, au regard de la situation personnelle de l'intéressé, protégée par les stipulations de l'article 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils peuvent prendre ainsi en considération l'âge auquel
l'intéressé a commis les faits, son comportement depuis et son attitude vis-à-vis des éventuelles victimes ou son insertion sociale. L'application des
dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose également au juge de l'excès de
pouvoir d'exercer un entier contrôle sur la décision prise par les autorités désignées par la loi sur les demandes d'effacement des données.
8. Enfin, ces règles en matière d'effacement s'exercent sans préjudice de
l'obligation pour l'autorité compétente de faire droit aux demandes fondées de rectification ou de mise à jour.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montreuil, à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 7 juin 2023, pourvoi n° 21-50.036 Cassation partiel
premier moyen
5. La cour d'appel a constaté que la sanction disciplinaire
prononcée le 15 septembre 1994 contre le notaire avait été effacée par les lois
portant amnistie n° 95-884 du 3 août 1995 et n° 2002-1062 du 6 août 2002.
6. Elle a souverainement estimé, hors toute dénaturation, que le jugement
déféré, en retenant que le notaire, sanctionné par la chambre des notaires en
1994 et en 2015, n'en avait pas tiré les conséquences, avait pris en
considération la sanction effacée qui avait influé sur la nouvelle sanction prononcée.
7. Elle en a exactement déduit que le jugement devait être annulé.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
second moyen
Vu les articles 114, alinéa 1er, du code de procédure civile, 133-9 du
code pénal, 14, 17 et 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant
amnistie, 11 et 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie :
10. Aux termes du premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut
être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas
expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une
formalité substantielle ou d'ordre public.
11. Il résulte des suivants que les dispositions des lois d'amnistie qui
interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée ne prévoient pas la
nullité de l'acte contenant la mention prohibée et que seule la décision
prenant en considération la condamnation amnistiée pour l'appréciation de
la nouvelle peine encourt une telle nullité.
12. Pour annuler l'assignation, l'arrêt retient que celle-ci évoque une
sanction disciplinaire effacée par deux lois d'amnistie et que la prise en
considération de la sanction effacée a influé sur la nouvelle sanction prononcée.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
troisième moyen
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
15. La cassation prononcée sur le deuxième moyen emporte, par voie de
conséquence, la cassation du chef de dispositif constatant que l'effet dévolutif
ne s'opère pas en raison de l'annulation de l'assignation, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME
CNCDH
: Avis sur la probité de la vie publique.
CNCDH :
Avis relatif aux violences sexuelles : une urgence sociale et de sante publique, un enjeu de droits fondamentaux.
CNCDH
: Avis sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice tel que présenté en conseil des ministres le 20 avril 2018 - analyse des dispositions relatives à la procédure
pénale et au droit des peines (assemblée plénière du 20 novembre 2018 - adopté à l'unanimité)
.CONTROLEUSE
GENERALE DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE
Le rapport d'activité 2022 :
une inertie pour apporter de la
dignité



Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles
d'être recevables devant le parlement européen, la
CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander
de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour
assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.





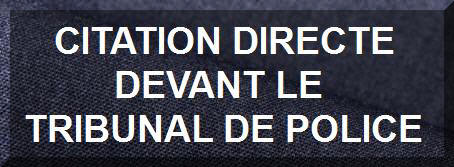



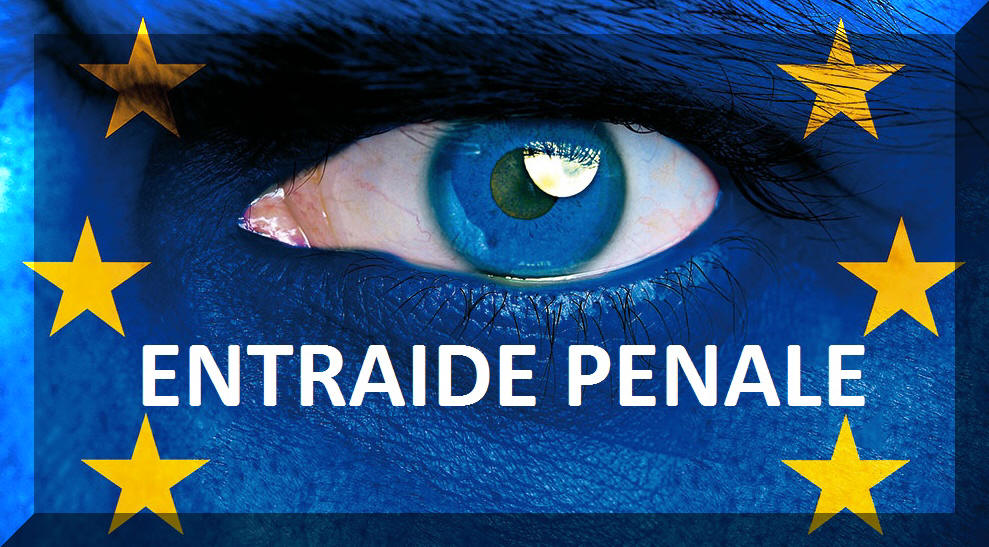




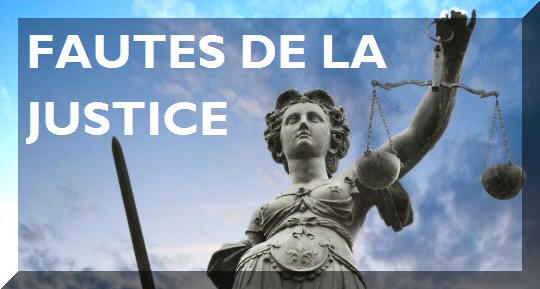

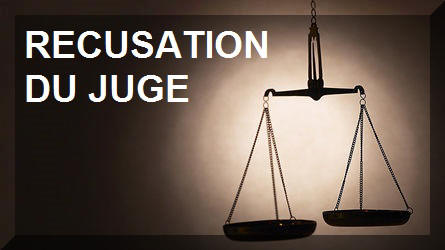










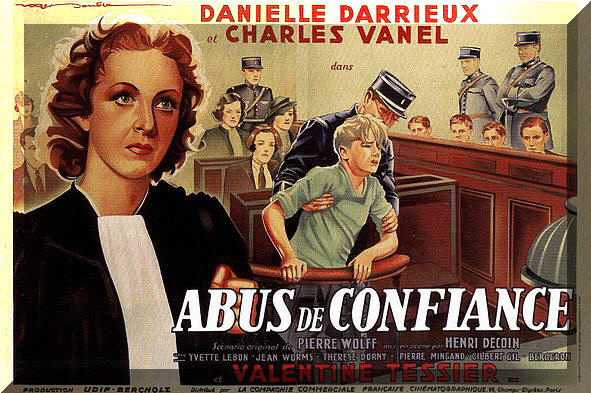
 En droit interne, aux termes de l’article
427 du code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par
tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
En droit interne, aux termes de l’article
427 du code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par
tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Les demandes d’annulation avaient été
rejetées par la chambre de l’instruction de Versailles, dont l’arrêt a été
cassé par la chambre criminelle (11 juillet 2017, pourvoi n°17-80.313) pour
violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et de l’article préliminaire du code
de procédure pénale.
Les demandes d’annulation avaient été
rejetées par la chambre de l’instruction de Versailles, dont l’arrêt a été
cassé par la chambre criminelle (11 juillet 2017, pourvoi n°17-80.313) pour
violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et de l’article préliminaire du code
de procédure pénale.


