REPARATION DES FAUTES DE LA JUSTICE
Pour plus de sécurité, fbls faute de la justice est sur : https://fbls.net/reparationjustice.htm
"Les fautes de la justice ont lieu tous les jours dans chaque tribunal
de France."
Frédéric Fabre docteur en droit.
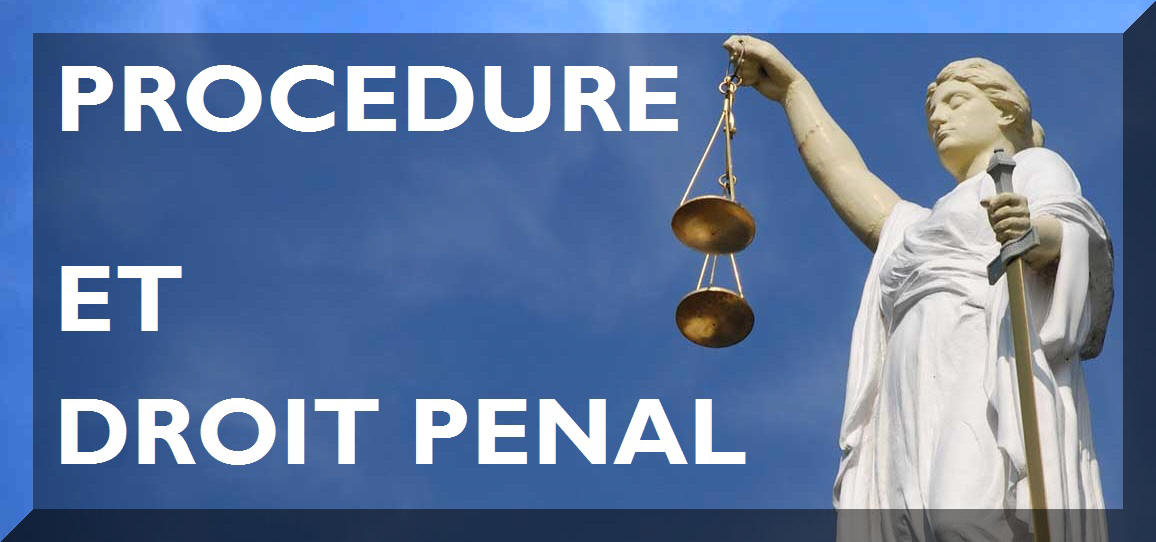 Cliquez sur un lien bleu pour accéder au(x)
Cliquez sur un lien bleu pour accéder au(x)
- LA PRISE Á PARTIE EST UN RECOURS BIDON
- L'ASSIGNATION CONTRE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
- LES MAGISTRATS SONT IRRESPONSABLES ET VEULENT LE RESTER
- LA DÉTENTION INUTILE ET ARBITRAIRE SONT DIFFICILEMENT RÉPARÉES.
- LA COUR DES COMPTES DEMANDE TROIS REFORMES DE LA JUSTICE
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
LA PRISE A PARTIE EST UN RECOURS BIDON
Monsieur Guy Canivet ancien 1er Président de la Cour de Cassation, a fait une étude de droit comparé sur la responsabilité des Magistrats
Un recours complètement bidon puisque les magistrats ne veulent pas reconnaître leurs fautes commises dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, quelque soit le reproche.
Sur le site Vie Publique, il est écrit :
"En matière de responsabilité pénale, les magistrats ne jouissent d’aucun privilège particulier : ils ne bénéficient d’aucune immunité et sont poursuivis dans les conditions du droit commun."
LA PRISE A PARTIE SEMBLE POSSIBLE A LA LECTURE DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
TOUTEFOIS, PERSONNE NE PEUT LES POURSUIVRE DIRECTEMENT LES MAGISTRATS PAR LA PRISE A PARTIE
L'Article 11-1 de l'Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit :
"Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.
La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État.
Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation."
LE CORPORATISME A POUR CONSÉQUENCE LA PROTECTION DES MAGISTRATS ENTRE EUX
Les magistrats évitent que la question du faux durant l'instruction, soit posée.
Article 6-1 du Code de Procédure Pénale
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.
COUR DE CASSATION chambre criminelle, arrêt du 28 octobre 2014, pourvoi n° 14-81127 Rejet.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. Dominique et Marc X..., mis en examen dans une information ouverte des chefs d'association de malfaiteurs et tentative d'assassinat en bande organisée, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles pour faux, usage de faux et subornation de témoin contre les deux juges d'instruction chargés de cette information, en reprochant à ces magistrats de ne pas avoir fidèlement reproduit, dans un procès-verbal d'audition, les propos tenus par Carla Serena Z..., et d'avoir, lors d'une audition ultérieure, exercé des pressions sur ce témoin ; que le procureur de la République, constatant que la plainte avec constitution de partie civile portait sur des faits impliquant, par leur nature, une violation de règles de procédure pénale, a requis qu'en application des dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction n'informe pas tant que le caractère illégal des acte visés dans la plainte ne serait pas constaté par une décision devenue définitive ; que le juge d'instruction ayant dit y avoir lieu à informer, le procureur de la République a interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'a pas été préalablement et définitivement jugé que les actes de procédure contestés, accomplis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, portaient atteinte au principe de loyauté des preuves, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale
LES MAGISTRATS REFUSENT LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DE L'ARTICLE 11-1 DE L'ORDONNANCE DE 1958
LE DROIT
Article 662 du Code de Procédure Pénale
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
LES FAITS
Un Avocat dépose une requête en suspicion légitime et pose par mémoire séparé, une QPC pour le Conseil Constitutionnel ainsi rédigé
"L'article 11-1 de la loi organique portant statut des magistrats est-il conforme à l'article 15 de la Déclaration de 1789 ?"
La requête est signée par l'avocat et non par son client. La Cour de Cassation rejette la requête car l'alinéa 2 de l'article 662 du CPP prévoit
"La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par (-) les parties."
Or l'inobservation d'une disposition même si elle est d'ordre publique, doit porter préjudice pour être sanctionnée. La Cour de Cassation n'a pas défini le préjudice pour déclarer irrecevable la requête.
Voici les deux décisions de la Cour de Cassation pour rejeter la QPC sur l'article 11-1 de l'ordonnance de 1958
COUR DE CASSATION chambre criminelle, arrêt du 14 novembre 2012, pourvoi n° 12-86954 irrecevabilité d'une requête en suspicion légitime
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête n'a pas été présentée par le requérant lui-même ainsi que
l'exige l'article 662 du code de procédure pénale mais par un avocat au barreau
de Seine Saint-Denis ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE
COUR DE CASSATION chambre criminelle, arrêt du 14 novembre 2012, pourvoi n° 12-86954 Qpc incidente - irrecevabilité
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 11-1 de la loi organique portant statut des magistrats est-il conforme à l'article 15 de la Déclaration de 1789 ?" ;
Attendu que le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité
soulevée à l'occasion d'une requête tendant au renvoi d'une affaire devant une
autre juridiction pour cause de suspicion légitime, sans le recours au ministère
d'un avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, doit porter la
signature du requérant en personne, un mémoire présenté par son avocat, s'il n'est pas avocat aux Conseils, n'étant pas recevable ;
Attendu que, par conséquent, le mémoire distinct contenant la question
prioritaire de constitutionnalité déposé au greffe de la Cour de cassation par
le conseil du requérant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui n'est pas signé par le requérant lui-même, n'est pas recevable
L'ASSIGNATION DE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites
- LA FAUTE LOURDE DOIT ÊTRE GRAVE ET L'ÉPUISEMENT DES RECOURS N'A PU LA RÉPARER
- LES FAUTES DU SERVICE DE LA POLICE
- LA PRESCRIPTION CONTRE L'ÉTAT EST DE QUATRE ANS
- UN ARTICLE DE DEUX MAGISTRATS AUX CONSEILS SUR LA RESPONSABILITÉ DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
FAUTE LOURDE DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
LA PERSONNE QUI DOIT ÊTRE ASSIGNÉE EST L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
6 rue louise Weiss
75703 Paris cedex 13
Article 38 modifié de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 :
Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat.
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont habilités, après accord du ministre de l'économie et des finances, à se faire communiquer tous documents de service, de quelque nature que ce soit, détenus par ce fonctionnaire.
Un modèle d'assignation au TGI de Paris dans l'affaire Miller :
https://www.fbls.net/millerassignationTGIparis.pdf
https://www.fbls.net/millerassignationTGIparis2.pdf
GILETS JAUNES : LES FLICS NE DOIVENT PAS SE FAIRE JUSTICE EUX - MÊME C'EST A L'AJE DE LE FAIRE
Cour de Cassation, Chambre criminelle arrêt du 28 octobre 2020, pourvoi n° 19-85.812 Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Mais sur le moyen relevé d’office, mis dans le débat dans le rapport, pris de la violation de l’article 38 modifié de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 ;
Vu ledit article ;
39. Aux termes de ce texte, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
40. Il résulte des pièces de procédure que le commissariat central de police de Bayonne, représenté par le commissaire de police, s’est constitué partie civile et a réclamé à Mme X..., ainsi qu’à d’autres personnes poursuivies, l’indemnisation des dégradations causées au commissariat.
41. Après avoir reconnu la demanderesse coupable de ces dégradations, le tribunal correctionnel a admis la recevabilité de la constitution de partie civile du commissariat de police et condamné Mme X... à lui verser des dommages et intérêts.
42. L’arrêt attaqué, qui a relaxé cette prévenue pour le délit de dégradations, a confirmé les dispositions du jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile précitée, tout en rejetant les demandes indemnitaires présentées contre la demanderesse.
43. En admettant ainsi la recevabilité de la constitution de partie civile du commissariat de police, alors que l’exercice de l’action civile au nom d’un service de l’Etat est réservé, en l’absence de disposition particulière de nature législative, à l’agent judiciaire de l’Etat, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
44. Il en résulte que la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
45. La cassation aura lieu par voie de retranchement de l’arrêt de ses seules dispositions civiles.
Cour de Cassation, Chambre civile 2 arrêt du 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-20463 rejet
Mais attendu qu'ayant, d'abord, retenu par des motifs non critiqués, que le litige opposant les parties était indivisible et que la
déclaration d'appel du 11 septembre 2013, en tant qu'elle avait été formée contre « l'Etablissement Public, Trésor Public » et non contre l'Agent
judiciaire de l'Etat, seul habilité à représenter l'Etat devant les juridictions de l'ordre judiciaire, était affectée d'une irrégularité de fond, puis,
exactement retenu que l'article 552 du code de procédure civile permettait à un appelant, dès lors que son appel était recevable à l'égard d'au moins une partie
et que l'instance était encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel, la cour d'appel en a
exactement déduit que le second appel formé par les consorts X..., le 5 mai 2014, contre l'Agent Judiciaire de l'Etat était recevable ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il découlait que l'ensemble des parties présentes en première instance à ce litige indivisible
l'étaient également en cause d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'article 553 du code de procédure
civile, soulevée par l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Article L141-1 du COJ :
L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
LA FAUTE LOURDE POUR NON APPLICATION DU DROIT EUROPÉEN NE CONCERNE QUE LE DROIT EUROPÉEN BIEN ÉTABLI
Cour de Cassation, Assemblée Plénière arrêt du 18 novembre 2016, pourvoi n° 15-21438 cassation sans renvoi
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la responsabilité des États membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ce texte et de ce principe (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomášová,
C-168/15) que la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une
décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite
juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la coopérative agricole de l'arrondissement de Reims (la CAAR), aux droits de laquelle sont venues la société Cohesis
distribution puis la société Acolyance, dirigée par M. X..., a procédé, en 1987 et 1988, à l'importation de pois protéagineux ; que ces pois ont été déclarés,
lors de leur entrée en France, comme provenant des Pays-Bas et de Grande-Bretagne et n'étant pas destinés à l'ensemencement, ce qui ouvrait droit
à des aides communautaires, que la CAAR a effectivement perçues ; qu'estimant que ces pois provenaient pour partie de Hongrie et avaient été en réalité
utilisés pour l'ensemencement, la direction générale des douanes a poursuivi M. X... pour déclaration d'origine inexacte et fausse déclaration à l'importation ;
que le pourvoi, formé par M. X... contre la décision l'ayant condamné de ces chefs, a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation du 19 septembre 2007, aux motifs que "les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas écarté, comme contraire au principe de
l'application rétroactive de la peine plus légère, l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, selon lequel les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à
la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures, dès lors qu'en l'espèce,
la modification apportée par la loi du 17 juillet 1992 n'a eu d'incidence que sur les modalités de contrôle du respect des conditions de l'octroi de l'aide
aux pois protéagineux et de leur origine et non sur l'existence de l'infraction ou la gravité des sanctions" ; que, saisi par M. X..., le Comité des droits de
l'homme des Nations unies a, le 21 octobre 2010, constaté que l'article 110 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 violait le principe de rétroactivité de la
peine plus légère, énoncé par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que M. X... et la société Cohesis distribution ont
alors assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de la faute lourde résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
Attendu que pour retenir une violation manifeste du droit communautaire et de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'arrêt énonce que la Cour de cassation connaissait
la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 mai 2005 (Berlusconi, C-387/02) relative au principe de la rétroactivité de la peine plus
légère, ainsi que l'article 15 du Pacte international, et n'ignorait pas que ses arrêts antérieurs n'étaient pas dans la ligne de cette jurisprudence et étaient
critiqués par une partie de la doctrine, qu'elle a considéré que la loi du 17 juillet 1992 n'avait ni supprimé l'infraction ni eu d'effet sur les peines, de
telle sorte que le principe de rétroactivité in mitius n'avait pas à s'appliquer et qu'elle a ainsi délibérément fait le choix, sachant que l'incrimination en
cause avait été supprimée par l'article 111 de la loi du 17 juillet 1992, de ne pas appliquer le principe communautaire et le Pacte international, cependant
que, si l'élément matériel de l'infraction pouvait avoir subsisté, l'élément légal avait été supprimé par l'article 111 de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour
de justice de l'Union européenne que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soient poursuivies et sanctionnées
les fausses déclarations en douane ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à des importations intracommunautaires commises
antérieurement à la mise en place du marché unique, de sorte que l'application par la Cour de cassation de l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 ne
contrevenait pas au droit de l'Union, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
LA COUR DE CASSATION A DÉFINI LA FAUTE LOURDE A L'OCCASION DE LA DRAMATIQUE AFFAIRE GREGORY VILLEMAIN
Cour de Cassation, Assemblée Plénière arrêt du 23 février 2001, pourvoi n° 99-16165 cassation
Attendu que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt énonce que la faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'État, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire (ancien article L141-1 du COJ), est celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y aurait pas été entraîné ou encore celle qui révèle l'animosité personnelle, l'intention de nuire ou qui procède d'un comportement anormalement déficient
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
14 ANS EST UN DÉLAI NON RAISONNABLE QUELQUE SOIT LE COMPORTEMENT DU DEMANDEUR
Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 20 février 2008, pourvoi n° 06-20384 cassation
Vu l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire,
devenu l'article L. 141-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 septembre 1984, M. X... a été victime
d'un accident du travail au cours duquel son bras gauche a été sectionné ;
qu'après l'échec d'une tentative de conciliation devant la commission de recours
amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, il a saisi, le 3 juillet
1987, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins
de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir
l'indemnisation de son préjudice corporel et la majoration de sa rente
d'accident du travail ; que l'arrêt confirmatif qui l'a débouté de sa demande a
été cassé ; que par arrêt du 29 mai 2000, complété le 25 juin 2001, la cour de
renvoi a fait droit à la demande et alloué diverses sommes à M. X... ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat
à lui payer des dommages-intérêts pour fonctionnement défectueux du service
public de la justice en raison de la durée excessive de la procédure, l'arrêt
attaqué retient que la procédure judiciaire avait duré 14 ans, que les délais
d'environ trois ans pour l'obtention d'une décision par le tribunal des affaires
de sécurité sociale, puis par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puis par la
Cour de cassation, puis de quatre ans devant la cour d'appel de Montpellier,
désignée comme cour de renvoi, n'étaient pas significatifs d'une carence patente
des juridictions saisies constituée par une inactivité ou une désorganisation,
mais qu'ils résultaient des spécificités de la procédure sans représentation
obligatoire devant la cour d'appel, en sorte que plusieurs renvois avaient été
nécessaires pour permettre la convocation régulière des parties et que M. X...
avait lui-même concouru à la durée de la procédure en raison des mois écoulés
pour l'exercice par lui des différents recours et n'avait jamais tenté
d'accélérer l'issue de la procédure par les démarches adéquates, notamment pour
obtenir une fixation rapide ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir
exercé les voies de recours dont il disposait et qu'un délai de 14 ans pour
obtenir une décision définitive dans un litige relatif à un accident du travail
dénué de complexité caractérisait une série de faits traduisant l'inaptitude du
service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article susvisé ;
LA COUR DE CASSATION EXIGE QUE LES DEMANDEURS APPORTENT LES PREUVES JUSQU'A L'ABSURDE
Cour de Cassation, arrêt du 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-24210 Rejet
Mais attendu que la faute lourde résultant d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du
service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit être regardée
comme constituée lorsqu'il est établi qu'un contrôle d'identité présente un caractère discriminatoire ; que tel est le cas, notamment, d'un contrôle
d'identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable ;
Qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer
l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu, d'abord, qu'ayant souverainement estimé que la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs, en ce que la personne contrôlée
répondait au signalement de l'un des suspects, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, sans inverser la charge de la preuve, en a
exactement déduit que le choix de la personne contrôlée ne présentait pas de caractère discriminatoire ;
Attendu, ensuite, qu'en retenant qu'il ne résultait pas des témoignages que le comportement des fonctionnaires de police à l'égard de la personne contrôlée
procédait de considérations, notamment raciales, autres que celles tirées des éléments dont ils disposaient sur les circonstances de l'infraction qui venait
d'être commise, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées critiquant le déroulement du contrôle ;
Attendu, enfin, que le grief de la septième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Article L141-2 du COJ :
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
- s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature
- s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Cour de cassation chambre criminelle, arrêt du 22 février 2017 pourvoi n° 15-86666 cassation sans renvoi
Attendu que, selon ces textes, la responsabilité des juges non professionnels, en raison de leur faute personnelle, est régie par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie dans les cas de dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements, ou en cas de déni de justice ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 janvier 2008, le gérant de la société Perfextrem, dans laquelle M. X..., président du tribunal de commerce de Vienne était associé, a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, qui a été prononcée le jour même par ce tribunal ; que la Banque Populaire Loire et Lyonnais, créancière de cette société, qui avait opéré une saisie conservatoire sur ses avoirs bancaires, a formé une tierce opposition contre le jugement du tribunal de commerce de Vienne, en déposant simultanément une requête en suspicion légitime ; que, par ordonnance du 31 janvier 2008, M. X..., en sa qualité de président du tribunal de commerce, s'est opposé à cette demande et, par application des dispositions de l'article 359 du code de procédure civile, a transmis la procédure de tierce opposition au premier président de la cour d'appel de Grenoble ; que poursuivi pour ces faits du chef de prise illégale d'intérêts, M. X... a été relaxé par le tribunal correctionnel ; que la Banque populaire Loire et Lyonnais, partie civile, a formé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à la partie civile, seule appelante du jugement de relaxe, la cour d'appel énonce que, dans la mesure où il était à la fois associé de la société Perfextrem et ami de son gérant, ainsi que président du tribunal de commerce de Vienne, M. X... se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts et ne pouvait en aucun cas statuer dans le cadre du litige opposant la Banque populaire et la société Perfextrem ; qu'en conséquence, en statuant sur la requête en suspicion légitime de la Banque populaire, alors qu'il était juge et partie, il a pris, en toute connaissance de cause, un intérêt dans une opération dans laquelle il avait un pouvoir de surveillance ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils après relaxe définitive d'un président de tribunal de commerce pour un acte commis dans l'exercice de son activité juridictionnelle, a méconnu les dispositions susvisées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Article L141-3 du COJ :
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements
2° S'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. L'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
A CES ARTICLES VOUS SERA OPPOSÉE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION SUR L'ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS
Cour de cassation 1ere chambre civile, arrêt du 24 février 2016 pourvoi n° 14-50074 Rejet
Mais attendu que l'Etat ne dispose, en cas de fonctionnement
défectueux du service public de la justice, d'aucune action à l'encontre du justiciable concerné, de sorte qu'en l'absence d'actions réciproques pouvant
avoir le même objet, soumises à des délais de prescription distincts, aucune rupture du juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences
de l'intérêt général ne peut être invoquée ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à
ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts dirigée contre l'Agent judiciaire de l'Etat en raison d'une
faute lourde liée au fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la
mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, l'arrêt relève qu'à l'occasion du pourvoi en cassation
ayant donné lieu à l'arrêt du 19 décembre 2006, les consorts X... n'avaient pas critiqué l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il avait dit que
l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inapplicable en l'espèce ;
que la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que les consorts X..., qui n'avaient pas exercé toutes les voies de recours à leur disposition, ne pouvaient se
prévaloir d'aucune faute au titre d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que le moyen n'est pas fondé
Il est interdit de poursuivre les magistrats mais il vous sera reproché de ne pas les avoir poursuivis !
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 9 mars 1983 N° de pourvoi: 83-90963 Non-lieu à désignation de juridiction
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN VERTU DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL QUI GARANTIT L'INDEPENDANCE DES MAGISTRATS DU SIEGE, LEURS DECISIONS JURIDICTIONNELLES NE PEUVENT ETRE CRITIQUEES, DANS LES MOTIFS OU DANS LE DISPOSITIF QU'ELLES COMPORTENT, QUE PAR LE SEUL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS PREVUES PAR LA LOI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'UNE DECISION DE CLASSEMENT SANS SUITE PRISE PAR UN MAGISTRAT DU PARQUET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUT COMPORTER AUCUNE SANCTION PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LES FAITS DENONCES NE POUVANT RECEVOIR AUCUNE QUALIFICATION PENALE, LES MAGISTRATS VISES DANS LA PLAINTE NE SONT PAS SUSCEPTIBLES, AU SENS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'ETRE INCULPES D'UN CRIME OU D'UN DELIT
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 9 décembre 1981 N° de pourvoi: 81-94848 Non-lieu à désignation de juridiction
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE LEUR PLAINTE QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF AUX MAGISTRATS SUSVISES D'AVOIR, EN STATUANT DANS UNE PROCEDURE LES CONCERNANT EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, COMMIS LES INFRACTIONS PENALES PRECITEES ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN VERTU DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL QUI GARANTIT L'INDEPENDANCE DES MAGISTRATS DU SIEGE, LEURS DECISIONS JURIDICTIONNELLES NE PEUVENT ETRE CRITIQUEES, TANT DANS LES MOTIFS QUE DANS LE DISPOSITIF QU'ELLES COMPORTENT, QUE PAR LE SEUL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS PREVUES PAR LA LOI ;
QUE CE PRINCIPE AINSI D'AILLEURS QUE CELUI DU DELIBERE, METTANT OBSTACLE A CE QU'UNE DECISION DE JUSTICE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUTIVE PAR ELLE-MEME D'UN CRIME OU D'UN DELIT, IL EN RESSORT QUE LES MAGISTRATS DU SIEGE MIS EN CAUSE NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES DES INFRACTIONS QUE LEUR IMPUTENT LES PLAIGNANTS ;
QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LE MAGISTRAT DU PARQUET VISE PAR LA PLAINTE, DES LORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE MINISTERE PUBLIC PREND LES REQUISITIONS ET DEVELOPPE LIBREMENT LES OBSERVATIONS QU'IL CROIT CONVENABLES AU BIEN DE LA JUSTICE
CEDH PALMERO c. FRANCE Requête n° 77362/11 du 30 octobre 2014
Violation article 6 pour délai non raisonnable : Le requérant demande une indemnité pour partialité du juge d'instruction et délai non raisonnable durant une procédure d'accusation pénale. Il subit un rejet devant les juridictions internes. Il présente ses griefs devant la CEDH. Il rajoute le grief de délai non raisonnable de la procédure d'indemnisation, sans auparavant, avoir épuisé les voies de recours internes concernant le délai de cette procédure compensatoire. La CEDH condamne pour délai non raisonnable de la procédure d'indemnisation pourtant échouée en droit interne car la Cour d'Appel a rendu son arrêt avec un délai de 3 ans. La CEDH constate que le délai de la procédure d'accusation pénale est raisonnable puisque le délia entre son premier interrogatoire et sa mort n'est qu'un peu plus de huit mois.
Elle répond ensuite de manière succincte (2 lignes) et générale sur le grief tiré de la partialité évidente du juge d'instruction. Comme la CEDH a examiné la requête contre la France. Du fait de la clause de réserve de la France, le Comité des Droits de l'Homme de Genève est incompétent pour statuer sur les griefs tirés de la procédure pénale, au sens de l'article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.
CEDH
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le père du requérant, André Palmero, exerçait de son vivant des fonctions d’administrateur de biens du prince de Monaco. Le 30 mars 1999, il fut entendu pour la première fois en qualité de témoin dans une information judiciaire ouverte en France en 1994, concernant des faits d’escroquerie liés à la vente de timbres de collection de la Principauté.
7. Le 22 juin 2000, il fut mis en examen du chef de complicité d’escroquerie. Il décéda le 30 décembre 2000 et, le 8 juillet 2002, le juge d’instruction constata l’extinction de l’action publique à son bénéfice en raison de ce décès. En 2005, une ordonnance de non-lieu général concernant l’ensemble des personnes mises en examen fut rendue.
8. Le 28 décembre 2004, le requérant engagea une action en responsabilité de l’État, au nom de son père, sur le fondement de l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire, alors en vigueur, en réparation des fautes qui auraient été commises dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre ce dernier. Le requérant invoqua, notamment, le défaut d’impartialité du juge d’instruction, ainsi que le caractère déraisonnable de la durée de la procédure pénale.
9. Par un jugement du 26 avril 2006, le tribunal de grande instance de Paris déclara la demande du requérant recevable - rappelant notamment que le droit à réparation du dommage moral subi par une personne défunte, entré dans son patrimoine, se transmettait à ses héritiers – mais la rejeta. Le 22 septembre 2009, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement. Les juges du fond estimèrent que les accusations de partialité dirigées contre le juge d’instruction n’étaient pas fondées et considérèrent que le point de départ de la période à envisager sous l’angle de l’exigence d’un délai raisonnable devait être fixé au 22 juin 2000, date de mise en examen du père du requérant, compte tenu de l’absence d’éléments dans le dossier le mettant en cause au moment du dépôt de plainte initial ainsi que lors de sa première audition comme témoin en 1999.
10. Par un arrêt du 1er juin 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en estimant, en outre, que le terme de la période à considérer sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention devait être fixé au décès du père du requérant en décembre 2000.
EN DROIT
11. Le requérant se plaint de la durée déraisonnable tant de la procédure pénale dirigée contre son père, que de la procédure d’indemnisation exercée par lui sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, devenu l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il met par ailleurs en cause l’impartialité du juge d’instruction chargé de l’information dans laquelle son père fut mis en examen. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE PÉNALE
12. Le Gouvernement expose en premier lieu que le requérant ne possède pas la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention, ne démontrant pas en quoi il aurait été personnellement affecté par la durée de la procédure pénale subie par son père. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient, sous l’angle de l’article 35 § 3 b) de la Convention, que le requérant n’a subi aucun préjudice important.
13. Le requérant conteste ces thèses.
14. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner ces exceptions d’irrecevabilité, car elle considère qu’en tout état de cause, le grief est manifestement mal fondé, pour les raisons exposées ci-après.
15. La Cour estime que la période à considérer a débuté le 22 juin 2000, date de la mise en examen de Monsieur André Palmero, compte tenu de l’absence d’éléments dans le dossier le mettant en cause au moment du dépôt de plainte initial ainsi que lors de sa première audition comme témoin en 1999 (voir paragraphe 9 ci-dessus). Elle s’est achevée à son décès le 30 décembre 2000 et a donc duré six mois et huit jours ce qui, aux yeux de la Cour, ne saurait être considéré comme excessif au regard de l’article 6 § 1 de la Convention.
16. Partant, il y a lieu de rejeter ce grief en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE D'INDEMNISATION
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la durée de la procédure d’indemnisation. Il admet que la procédure devant la cour d’appel, d’une durée supérieure à trois ans, ne semble manifestement pas répondre à l’exigence du délai raisonnable.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
20. La période à considérer a débuté le 28 décembre 2004, date de l’assignation en responsabilité de l’Etat pour s’achever le 1er juin 2011, date de l’arrêt de la Cour de cassation. La procédure en indemnisation a dès lors duré six années, cinq mois et quatre jours pour trois degrés de juridictions, dont trois ans et cinq mois au niveau de la seule cour d’appel, puis un an et neuf mois au niveau de la Cour de cassation.
21. Tout en ayant à l’esprit que le requérant a engagé l’action en responsabilité de l’État au nom de son père, la Cour rappelle l’importance pour les juridictions internes de porter une attention particulière à ce type de procédures d’indemnisation, notamment pour ce qui est de la durée raisonnable de leur examen (Gouveia da Siva Torrado c. Portugal, décision, no 65305/01, 22 mai 2003, Cocchiarella c. Italie [GC], précité, § 89, Sartory c. France, précité, § 24). Elle estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’IMPARTIALITÉ DU TRIBUNAL
23. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard du grief allégué. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
FAUTES LOURDES DE LA POLICE : 1 849 649,58 euros prononcés à l'encontre de l'AJE, par une Cour d'Appel, confirmés par la Cour de Cassation
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 16 janvier 2020 pourvoi n° 18-24.594 rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 octobre 2018), qu’à la suite d’un cambriolage, des agents de police ont intercepté un véhicule à bord duquel se trouvait notamment M. X..., qui a été blessé par un coup de feu tiré par l’un de ces agents, M. Y... ; que M. X..., dont il s’est avéré qu’il n’était pas l’un des auteurs du cambriolage, ainsi que sa mère, Mme B... X..., et son frère, M. Z... (les consorts X...), ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’être indemnisés de leurs préjudices ; qu’ayant versé le 22 juillet 2010 aux consorts X... les indemnités qui leur avaient été allouées par décision de la CIVI du 21 juin 2010, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) a exercé le 22 janvier 2016, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, un recours subrogatoire contre l’Agent judiciaire de l’Etat, dont l’agent, M. Y..., avait été déclaré coupable, le 10 mars 2015, de l’infraction de blessures involontaires sur la personne de M. X... ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l’Agent judiciaire de l’Etat fait grief à l’arrêt de dire que l’action du FGTI à son encontre est recevable,
Mais attendu que la constitution de partie civile de la victime d’un dommage contre le seul agent public auteur des faits à l’origine de ce dommage et qui sont de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique, dès lors qu’elle a pour but d’obtenir des dommages-intérêts et porte, au sens des dispositions de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement d’une créance sur cette collectivité publique, interrompt le cours de la prescription quadriennale de cette créance, alors même que la collectivité publique n’a pas été mise en cause dans la procédure pénale ;
Que, dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé qu’il était indifférent que l’Agent judiciaire de l’Etat n’ait pas été partie à l’information judiciaire ni au procès correctionnel, et qu’en l’espèce où le fait générateur de la responsabilité de l’Etat résidait dans le coup de feu tiré par M. Y... dans l’exercice de ses fonctions de gardien de la paix, qui constituait l’élément matériel de l’infraction de violences involontaires objet de la procédure pénale, la constitution de partie civile à l’occasion de cette procédure avait bien interrompu la prescription de l’action en responsabilité contre l’Etat ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l’Agent judiciaire de l’Etat fait grief à l’arrêt de dire que l’Etat est responsable du préjudice subi par les consorts X..., et de le condamner à verser au FGTI la somme de 1 849 649,58 euros, alors, selon le moyen, que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu’il est mal fondé à exercer son recours subrogatoire contre l’Etat dont la responsabilité sans faute est engagée pour rupture de l’égalité devant les charges publiques en conséquence des agissements d’un agent de la police judiciaire dès lors que cette atteinte au principe d’égalité est sans rapport avec la faute pénale ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par le Fonds de garantie ; qu’en accueillant au contraire la demande du Fonds de garantie en son recours subrogatoire contre l’Etat dont elle retient que la responsabilité est engagée sans faute pour atteinte à l’égalité des charges publiques, quand l’indemnisation avait été allouée par la CIVI en réparation de l’infraction de blessures involontaires commises par l’agent de police judiciaire, qui était sans rapport avec la cause juridique fondant la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat, la cour d’appel a violé l’article L. 706-11 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d’appel, après avoir rappelé que le fait générateur de la responsabilité de l’Etat résidait dans le coup de feu tiré par M. Y... dans l’exercice de ses fonctions de gardien de la paix, a exactement retenu qu’en l’espèce la rupture d’égalité devant les charges publiques alléguée résultait précisément des faits constitutifs de l’infraction pénale dont M. Y... était l’auteur et qui ont donné lieu à une indemnisation par le FGTI, de sorte que ce dernier pouvait, en qualité de subrogé dans les droits des victimes de l’infraction, valablement agir sur ce fondement à l’encontre de l’Etat ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
LA PRESCRIPTION DES CRÉANCES CONTRE L'ÉTAT EST DE 4 ANS
L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, prévoit que sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.
Article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
"La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement"
Conseil Constitutionnel Décision n° 2012-256 QPC du 18 juin 2012
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012 par le Conseil d'État (décision n° 356115 du 11 avril 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Boualem M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 3 de la loi du n° 68 1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article premier de la loi du
31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'État, des
départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières
édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes
créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du
premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été
acquis » ; que le second alinéa de ce même texte dispose : « Sont prescrites,
dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements
publics dotés d'un comptable public » ; que l'article 2235 du code civil
prévoit, quant à lui, que la prescription « ne court pas ou est suspendue contre
les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en
paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions
alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées
et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années
ou à des termes périodiques plus courts » ;
5. Considérant qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que les créances
sur les personnes publiques soient soumises aux mêmes règles que les créances
civiles ; qu'en instituant un régime particulier applicable aux créances contre
certaines personnes publiques, le législateur pouvait prévoir des causes de
suspension de la prescription différentes de celles applicables aux relations
entre personnes privées ; qu'ainsi, la différence de traitement instaurée par le
législateur entre les créanciers mineurs non émancipés soumis aux dispositions
du code civil et ceux qui se prévalent d'une créance à l'encontre d'une personne
publique visée par l'article premier de la loi précitée est fondée sur une
différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;
6. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions contestées qu'il
appartient au représentant légal du mineur d'agir pour préserver les droits de
ce dernier; que ces dispositions réservent le cas où le représentant légal est
lui-même dans l'impossibilité d'agir ainsi que les hypothèses dans lesquelles il
ignore légitimement l'existence de la créance ; que, par suite, les dispositions
contestées n'ont pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif qui
résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
7. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre
droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées
conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article 3 de la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à
la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les
établissements publics est conforme à la Constitution.
La Cour de Cassation fixait à trois ans, fin d'année, la forclusion de la déchéance quadriennale.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er JUIN 2011 N° Pourvoi 09-16003 REJET
Mais attendu qu’après avoir énoncé à bon droit, s’agissant d’une créance de dommage, que la déchéance quadriennale des créances sur l’État prévue par la loi du 31 décembre 1968 commence à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, la cour d’appel a exactement décidé que, l’ordonnance de non lieu ayant été prononcée le 18 avril 2002, M. X... aurait dû assigner l’Etat français avant le 31 décembre 2005 ; que le moyen ne peut être accueilli
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Puis la Cour de Cassation corrige. Ainsi une créance de l'État constatée le 18 avril 2002 commence à courir le 1er janvier 2002 à zéro heure pour se terminer le 1er janvier 2006 à zéro heure soit le 31 décembre 2005 à minuit ! Elle est donc en réalité de trois ans fin d'année.
LA COUR DE CASSATION A RALLONGÉ LE DÉLAI A QUATRE ANS FIN D'ANNEE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE SOCIALE, arrêt du 29 octobre 2013 N° Pourvoi 12-21214 Cassation sans renvoi
Qu'en statuant ainsi alors que la salariée ayant été licenciée le 22 novembre 2004, la prescription quadriennale commençait à courir le 1er janvier 2005 de sorte que la créance de la salariée était prescrite lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 3 juin 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 27 février 2013 N° Pourvoi 11-27988 Rejet
Mais attendu qu'après avoir exactement fixé le point de départ du délai de prescription quadriennale au 1er janvier 1997, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué, la cour d'appel a retenu à bon droit que la simple éventualité d'un avis défavorable sur sa demande ne constituait pas un empêchement à agir de sorte que le délai pour agir était expiré depuis le 1er janvier 2001 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé
L'article 2 de la dite loi prévoit que la prescription est interrompue par:
Article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
L'article 3 de la dite loi prévoit que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.
Article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la
survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à
défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.
La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.
Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des
parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.
Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant dans les cas prévus à
l'article L. 771-3 du code de justice administrative.
L'article 6 de la dite loi prévoit que les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription mais doit le faire avant que la juridiction ait répondu sur le fond
Article 6 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi.
Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.
La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.
Article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.
En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.
LA COUR DE CASSATION A INVENTÉ LA RÈGLE DU "FAIT GÉNÉRATEUR" POUR ENCORE RÉDUIRE LE DÉLAI DE PRESCRIPTION
AU POINT QUE LE TEMPS DE FAIRE LA PROCÉDURE POUR LE FAIRE RÉPARER,
LE DÉLAI DE PRESCRIPTION EST PASSÉ SANS QUE LE JUSTICIABLE NE PUISSE AGIR
COUR DE CASSATION, assemblée plénière, 6 juillet 2001 n° Pourvoi 98-17006 cassation partielle sans renvoi
Mais attendu qu'aux termes de son article 9, la loi du 31 décembre 1968 est applicable aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date ; que la déchéance commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; que la cour d'appel, qui a, à bon droit, fixé le point de départ du délai de la déchéance quadriennale à la fin des mesures d'internement, a fait une exacte application de la loi du 29 janvier 1831 modifiée, dès lors applicable, en accueillant le déclinatoire de compétence du préfet ; que le moyen, qui n'est donc pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde
COUR DE CASSATION, chambre civile 3 , arrêt du 7 novembre 2001 n° Pourvoi 98-20659 Rejet
Mais attendu qu'ayant retenu que, selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis et que l'emprise dénoncée est intervenue courant 1979-1980 alors que l'assignation a été délivrée le 23 juin 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action des époux X... était prescrite ;
LA CONSOLIDATION EST LE POINT DE DÉPART ET NON L'ACCIDENT
COUR DE CASSATION, chambre civile 2 , arrêt du 25 octobre 2001 n° Pourvoi 99-10194 cassation sans renvoi
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
Attendu que le point de départ du délai de la prescription quadriennale des créances édictée par ce texte au profit de l'Etat, des départements et des communes est la date de la consolidation pour les préjudices résultant d'atteintes à la personne ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a été renversé, le 23 juin 1967, par un camion de la commune de Luxeuil-les-Bains (la commune) ; qu'il a assigné celle-ci en référé pour obtenir la désignation d'un médecin expert le 25 juin 1991, puis au fond, en réparation de son préjudice, le 15 mai 1992 ; que la commune a opposé la prescription des créances sur une commune non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le tribunal de grande instance saisi a déclaré M. X... forclos ;
Attendu que pour infirmer le jugement déféré et condamner la commune à des dommages intérêts, l'arrêt énonce que la date de consolidation ne confère pas de droits acquis, que s'agissant d'une action en responsabilité le point de départ de la prescription quadriennale est la décision de justice, le droit à indemnisation d'un particulier dépendant nécessairement de l'action qu'il doit engager pour faire consacrer l'existence et le montant de sa créance et n'étant acquis que le jour de la décision constitutive de son droit
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la date de la consolidation des blessures de M. X... a été fixée au 1er janvier 1970 par le médecin expert ; qu'il s'ensuit qu'à la date de son assignation il était forclos pour agir contre la commune.
UNE ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE CONSIDÈRE LA FIN DE LA PROCÉDURE COMME FAIT GÉNÉRATEUR
Cour de Cassation chambre civile 1 arrêt du 18 novembre 2015 pourvoi n° 14-29164, non publié
Attendu qu'ayant relevé que le dernier événement clôturant la procédure pénale était intervenu le 14 juin 2006, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'assignation en responsabilité de l'Etat du fait de cette procédure, délivrée le 29 mars 2011, après l'expiration du délai de prescription quadriennale, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé.
Cour d'Appel de Paris 1ere chambre section A du 13 septembre 2004, n° répertoire général 03/07226, troisième paragraphe de la page 9
«.... il y a lieu à prendre en considération non pas telle ou telle décision prise isolément mai l’ensemble des procédures civiles et pénales invoquées par M B…….. au soutien de ses demandes, lesquelles se sont toutes poursuivies jusqu’à l’année 2000.»
UN ARTICLE DE DEUX MAGISTRATS AUX CONSEILS
SUR LA RESPONSABILITÉ DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
La responsabilité de l’État pour faute du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire et administrative
(par MM. Olivier Renard-Payen, conseiller doyen de la Cour de cassation et Yves Robineau, président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’État, Article de 2002)
INTRODUCTION
La spécificité de la fonction juridictionnelle a toujours imposé un régime particulier de mise en oeuvre de la responsabilité de ceux qui l’exercent, comme de l’État lui-même dont elle constitue un pouvoir régalien.
Les magistrats de l’ordre judiciaire ne pouvaient échapper à un principe général de responsabilité civile. Mais le risque était grand d’une multiplication de leur mise en cause par des plaideurs insatisfaits. Perturbant la sérénité des juges, une telle menace eut porté atteinte à leur indépendance statutaire.
C’est pourquoi un régime de responsabilité très restrictif fut institué par l’article 505 du Code de procédure civile.
Il comportait deux aspects :
- D’une part, la possibilité pour les justiciables de mettre en jeu la responsabilité personnelle des juges dans des conditions particulièrement drastiques. C’était la procédure de la prise à partie, très rarement appliquée, la rigueur de la jurisprudence accentuant encore celle de la loi.
- D’autre part, et corrélativement, l’État était civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts susceptibles d’être prononcées contre les magistrats, sauf recours contre le tiers responsable. Cette règle ne consacrait donc qu’un régime de responsabilité du fait d’autrui.
Certains textes législatifs avaient, cependant, introduit des exceptions au principe d’irresponsabilité de l’État en matière de justice judiciaire dans des domaines particuliers (tutelle : art. 473 al. 2 et 3 du Code civil ; pourvoi en révision en matière pénale : art. 622 à 626 du Code de procédure pénale ; détention provisoire : art. 622 et 623 du même Code).
En outre, la Cour de cassation avait admis la responsabilité de l’État en dehors de toute faute au titre du fonctionnement du service de la justice dans le célèbre arrêt Giry (Civ.2ème, 23 nov. 1956 : J.C.P 1956, éd.G, II, 9681, note Esmein).
Sans doute la portée de cette jurisprudence était-elle doublement limitée. D’abord, en ce que la décision de justice elle-même ne pouvait engager la responsabilité de l’État. Ensuite, en ce que cette responsabilité n’était encourue qu’à l’égard d’un collaborateur occasionnel du service de la justice et non du justiciable lui-même, usager de ce service.
Mais, outre qu’elle portait une atteinte sérieuse au dogme de l’irresponsabilité de l’État en la matière, elle témoignait d’une influence de la jurisprudence administrative sur la jurisprudence judiciaire.
En reconnaissant que la responsabilité de l’État pouvait être fondée sur le risque, en ce qui concernait les actes préparatoires à la décision juridictionnelle, (il s’agissait de l’accident subi par un médecin requis par la police pour établir un rapport sur les causes d’un accident et l’état des victimes), la Cour de cassation jugeait que les tribunaux judiciaires avaient, en la matière, "le pouvoir et le devoir" d’appliquer les principes généraux du droit public. Cette jurisprudence fut reprise par les juridictions du fond (v. C.A. Douai, 31 janv. 1962 : J.C.P 1962, éd. G. II, 12560, note Vedel - C.A Bordeaux, 9 mars 1967, D. 1968, 635, note Demichel).
Toutefois, le juge administratif, auquel était ainsi empruntée une technique de mise en oeuvre de la responsabilité de la puissance publique, persistait à refuser d’en faire application pour ce qui le concernait. Dans ce domaine, le principe de l’irresponsabilité de l’État demeurait intangible (C.E 28 mars 1958, Blondet : Rec. Lebon, p. 600 - 28 juin 1963, Bapst : Rec. Lebon, p. 411 - Ass. 12 juillet 1969, L’Etang : Rec. Lebon, p. 389). De surcroît, aucune procédure comparable à la prise à partie n’existait en ce qui concernait le service de la justice administrative.
Pourtant, la jurisprudence du Tribunal des conflits et des juridictions administratives fut, à nouveau, la source d’inspiration de la loi du 5 juillet 1972 consacrant la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.
Les débats parlementaires révèlent clairement la filiation entre la jurisprudence précitée et la loi du 5 juillet 1972 dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le rapporteur, M. Jean Foyer, a souligné l’infériorité du système existant par rapport aux principes de la responsabilité de la puissance publique. C’est la distinction de la faute de service et de la faute personnelle qui est proposée comme modèle. Seule la seconde engage la responsabilité personnelle du magistrat.
Toutefois, le rapporteur souligne en ces termes la nécessité qui lui paraît s’imposer d’un régime particulier : "à raison des difficultés exceptionnelles que présente l’exercice de la fonction juridictionnelle, la commission vous invite à décider que cette responsabilité sera engagée seulement en cas de faute lourde" (J.O. Deb. A.N, séance du 23 juin 1972, p. 2813 s.).
Le texte adopté reprend effectivement cette exigence d’une faute lourde, à laquelle s’ajoute le déni de justice (art. L. 781-1, al. 1).
Quant à la responsabilité personnelle des juges (qui n’entre pas dans le cadre de cette étude), elle est régie, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, par la loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature modifiée par la loi organique n° 79-43 du 18 janvier 1973 (faute de texte, le régime de la prise à partie subsiste à l’égard des juges non professionnels).
Cette étude n’a pas pour objet de recenser tous les problèmes que suscite la mise en jeu de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice
Parmi les nombreuses études consacrées à cette question, en dehors des notes sous les différents arrêts qui seront cités, voir notamment : L. Cadiet, Droit judiciaire privé : J.C.P éd. G. 1994, Doctr. 3805 - A.M Frison-Roche : J.C.P 1999, éd. G. p. 1869 - S. Guinchard "La responsabilité des gens de justice : Rev. "Justices" n°5, 1997 - G. Pluyette et P. Chauvin : Juris-classeur de procédure civile, Fasc. 74.
Elle se propose de déterminer les points de convergence et de divergence des jurisprudences administrative et judiciaire.
Elle entend également chercher à dégager les tendances, que révèlent les décisions intervenues à ce jour dans les deux ordres de juridiction et s’interroger sur les évolutions souhaitables.
Mais il convient, auparavant, de préciser comment se répartissent, en la matière, les compétences entre les deux ordres de juridiction.
Selon la jurisprudence du Tribunal des conflits issue de la décision du 27 novembre 1952 "Préfet de la Guyane", qui distingue "l’exercice de la fonction juridictionnelle" et "l’organisation même du service public de la justice", l’action en responsabilité de l’État à raison de l’activité juridictionnelle des tribunaux judiciaires est de la compétence de l’ordre de juridiction dont ils relèvent. Les juridictions de l’ordre administratif demeurent compétentes en ce qui les concerne. La notion d’exercice de la fonction juridictionnelle doit s’entendre au-delà des seuls actes, juridictionnels ou non, accomplis par les juges à l’occasion du litige qui leur est soumis. Ainsi, la distinction entre police judiciaire et police administrative trouve à s’appliquer en matière de responsabilité de l’État. Les actes d’exécution des jugements rendus par les juridictions judiciaires ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, à l’exception de certaines décisions administratives qui présentent un caractère détachable, par exemple le refus de concours de la force publique (C.E 30 novembre 1923 Couitéas Rec. Lebon p. 789).
I. L’application de la responsabilité de l’État pour faute du service de la justice par le juge judiciaire
Le dispositif institué par la loi du 5 juillet 1972 comporte deux éléments :
- La mise en jeu de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice pour faute lourde ou déni de justice (art. L. 781-1, al. 1) ;
- La garantie par l’État des victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges, sauf son recours contre ces derniers (art. L. 781-1, al. 3).
Ainsi se trouvent consacrés les principes évoqués lors des débats parlementaires : d’une part, l’exigence d’une faute lourde (à laquelle s’ajoute le déni de justice) témoigne d’une conception restrictive de la responsabilité de l’État en la matière, d’autre part, la distinction de la faute de service et de la faute personnelle confirme que la loi du 5 juillet 1972 s’est inspirée de la jurisprudence administrative.
Quelle a été, à ce jour, l’application de ces principes par le juge judiciaire, tant en ce qui concerne les notions de faute lourde et de déni de justice que celle de faute personnelle ?
A. La faute lourde
L’article L. 781-1, alinéa 1 qualifie la faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il ne la définit pas. Comme en matière de responsabilité administrative, il appartient à la jurisprudence d’en dégager les critères.
A cet égard, une modification importante a été introduite par l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 février 2001 : Consorts Bolle-Laroche (Civ. 1ère, Bull. n° 5 ; AJ.DA 20 sept. 2001, p. 789, note S. Petit).
1. La faute lourde avant l’arrêt du 23 février 2001
C’est, tout naturellement, la définition donnée par la Cour de cassation sous le régime de la prise à partie qui a été retenue : la faute lourde est "celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné" (Civ. 1ère, 13 octobre 1953, Bull. n° 224).
Cette formule se trouve surtout dans les décisions des juges du fond (v. par exemple, C.A Paris, 21 juin 1989 : Gaz. Pal. 1985, 2, p. 344, concl. Lupi - 21 mars 1991 : Gaz. Pal. 1992, I, somm. p. 230).
La Cour de cassation l’utilise également (Civ. 1ère, 10 juin 1999, Vaney c/ AJT, req. n° 97-11.780).
D’autres définitions sont fournies par certaines cours d’appel.
L’animosité personnelle, l’intention de nuire, la mauvaise foi, sont parfois prises en considération (C.A Paris, 13 mars 1985 : B.C c/ Trésor Public : Juris-Data n° 2087 ; C.A Aix, 25 mai 1988, Sté Fils de Ramel - 29 mai 1990, Delalande c/ A.J.T cités par Pluyette et Chauvin, op.cit. n° 113). Ces décisions ne traduisent cependant pas l’exigence d’une faute intentionnelle. Elles se bornent à retenir cet élément comme l’un des critères possibles de la faute lourde.
En revanche, la référence à un "comportement anormalement déficient" parfois utilisée par les juges du fond (v. par exemple, C.A Paris, 21 juin 1989 précité - 25 octobre 2000, Y c/ A.J.T : Légifrance n° 1999/07817) semble révéler un certain assouplissement de la jurisprudence (v. également, T.G.I Paris, 11 juillet 2001 : D. 2001, Inf. rap. 2806, qui se réfère à une "déficience du service public le rendant inapte à remplir la mission dont il est investi").
Il faut, toutefois, souligner que, fréquemment, tant la Cour de cassation que les juges du fond se bornent à déduire des faits constatés que le fonctionnement du service de la justice a été ou non défectueux au sens de l’article L. 781-1, ou simplement que la faute lourde est ou non constituée, sans se référer à une définition (en ce sens, pour la Cour de cassation : Com. 21 fév. 1995 : Bull. n° 52 - Civ. 1ère, 13 oct. 1998, Bull. n° 234 - 9 mars 1999 Bull. n° 84 ; J.C.P 1999, II, 10 069, rapport Sargos).
La jurisprudence, d’abord très restreinte dans les premières années d’application de la loi, est, à ce jour, relativement abondante, surtout en ce qui concerne les juridictions du fond.
Deux observations doivent être faites à cet égard.
On peut constater, tout d’abord, que le fonctionnement des juridictions pénales est la source principale de ce contentieux.
Sans doute faut-il voir là l’effet de la sensibilité particulière du justiciable aux décisions du juge répressif. Mais la raison peut aussi en être trouvée dans la spécificité de la procédure pénale où interviennent fréquemment, à diverses étapes, des décisions individuelles (juge d’instruction, parquet). Ainsi est-il, à la fois, plus aisé d’identifier la faute et de la dissocier de la décision juridictionnelle finale (même si, comme on le verra, l’autorité de chose jugée ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute lourde).
Il faut toutefois, relever que, paradoxalement, c’est à une juridiction civile que l’on demande d’apprécier l’existence d’une faute lourde dans le déroulement d’une procédure pénale.
La seconde remarque porte sur l’étendue de la notion de "service de la justice". Elle englobe non seulement l’activité des magistrats du siège et du parquet, mais également celle des greffiers et, d’une manière générale, de tous les agents participant à des opérations de police judiciaire.
Les exemples d’admission d’une faute lourde par la Cour de cassation sont relativement rares.
Ont notamment été retenus comme tels :
- l’absence de tout acte d’instruction entre deux auditions d’un justiciable justifiée par la seule attente du retour d’une commission rogatoire internationale, alors qu’aucune précision n’est donnée ni sur la date d’envoi de celle-ci ni sur l’impossibilité de poursuivre l’instruction avant son retour (Civ. 1ère, 29 juin1994, Bull. n° 227).
- la divulgation d’information à l’Agence France-Presse par les services de la répression des fraudes à l’occasion d’une enquête de police judiciaire permettant d’identifier les personnes en cause (Civ. 1ère, 9 mars 1999, Bull. n° 84 ; D. 2000, J. p. 398, note Matsopoulos : J.C.P. 1999, II, 10069, rapport Sargos).
- l’exécution d’une opération de police judiciaire en l’absence de l’élément légal de l’infraction supposée (Civ. 1ère, 15 oct. 1996, Bull. n° 352).
- l’adoption par le ministère de la justice d’une circulaire faisant injonction aux procureurs de la République d’engager des poursuites pénales, en application des articles L. 17 et L. 18 du Code des débits de boissons, déclarés contraires au Traité instituant la Communauté européenne par la Cour de justice des communautés européennes (Com. 21 févr. 1995, Bull. n° 52).
Les juridictions du fond ont, pour leur part, admis l’existence d’une faute lourde dans les cas suivants : disparition, dans des circonstances indéterminées, d’un dossier pénal d’instruction, alors que des copies de pièces n’avaient pas été établies, comme le prescrit l’article 81 du Code de procédure pénale (T.G.I Paris, 5 janv. 2000, D. 2000, IR 45) ; mise en détention provisoire non justifiée en ses éléments (C.A Paris, 14 juin 1998 : Gaz. Pal. 8 oct. 1996 : note X) ; injonction de conclure à deux ans et fixation de la date des plaidoiries à trois ans (T.G.I Paris, 6 juill. 1949 ; RTD Civ 1995, 957, obs. Perrot) ; carence d’un greffe correctionnel pour délivrer à la partie civile la grosse d’un jugement (T.G.I Thonon Les Bains, 3 nov. 1994 : Gaz. Pal. 10 juin 1995) ; omission par le parquet de mettre en oeuvre la délocalisation de la procédure requise par l’ancien article 679 du Code de procédure pénale, s’agissant de poursuites dirigées contre un juge consulaire (C.A Paris, 21 mai 1991 : Gaz. Pal. 1992, I, 230).
Plus fréquents sont les arrêts de la Cour de cassation rejetant la qualification de faute lourde.
Ainsi, s’agissant du comportement d’un juge d’instruction, la mise en détention et le renvoi devant le tribunal correctionnel du président du conseil d’administration d’une société anonyme inculpé d’abus de biens sociaux, est excusable, en dépit de l’erreur commise par le magistrat sur sa compétence territoriale, eu égard à la complexité du dossier à portée internationale (Civ. 2ème, 10 juin 1999, arrêt n° 934 D ; v. également Civ. 1ère, 3 mai 2000 : Bienes c/ A.J.T, arrêt n° 795 D : la carence alléguée à l’encontre d’un juge d’instruction dans l’enquête sur les circonstances d’un accident mortel de la circulation ne peut constituer une faute lourde, eu égard à la difficulté insurmontable, caractérisée par la cour d’appel, d’arriver à une certitude).
Ne constitue pas davantage une faute lourde, en raison des circonstances de l’espèce, la lettre, rédigée en termes discourtois, adressée par un juge départiteur à un avocat (avec copie au bâtonnier de l’Ordre et au client), suite à une demande de renvoi formulée lors de l’audience par le conseil adverse, ayant pour effet de vider le rôle de son contenu (Civ. 1ère, 13 oct. 1998 : D. 2000, J. 576 - comparer : T.G.I. Paris, 2 juill. 1999 : D. 1999, I.R p. 214 : l’ordre de perquisitionner au domicile d’un avocat ne relève pas de la faute lourde, dès lors que cette mesure est nécessaire à la manifestation de la vérité et ne porte pas atteinte aux droits de la défense).
Une faute lourde ne peut être retenue à l’encontre du greffe d’un tribunal de grande instance qui a enrôlé inconsidérément une assignation délivrée devant la juridiction commerciale ni du tribunal qui a statué sur cette citation sans vérifier sa saisine (Civ. 1ère, 20 fév. 1996, Bull. n° 94).
Ce dernier arrêt, relatif à une erreur de procédure initiale perpétuée jusqu’à la décision juridictionnelle finale, conduit à s’interroger sur la mise en jeu de la responsabilité de l’État pour des actes juridictionnels revêtus de l’autorité de la chose jugée.
Le danger d’une remise en cause de l’autorité de la chose jugée a été signalé dès l’élaboration de la loi du 5 juillet 1972 (v. observations de MM. Mazeaud et Foyer, Ass. Nat. Rapp. N° 2447). L’arrêt du Conseil d’État Darmont du 29 décembre 1978 (D. 1979, p. 278, note Vasseur) s’est clairement prononcé contre une telle possibilité en ce qui concerne les décisions des juridictions administratives.
Pourtant, dans la célèbre affaire des époux Saint-Aubin contre l’État, la Cour d’appel de Paris a admis que les "actes juridictionnels proprement dits" n’étaient pas exclus du champ d’application de l’article L. 781-1 (C.A Paris, 21 juin 1989 : Gaz. Pal., 1989, 2, 944, concl. Lupi).
La portée de cette décision doit être nuancée, la cour d’appel ayant relevé qu’il s’agissait, en l’occurrence, de décisions rendues par des juridictions d’instruction, provisoires par nature (ordonnance de non-lieu et arrêt confirmatif de la chambre d’accusation, n’ayant pas autorité de chose jugée à l’égard de l’action portée par les époux Saint-Aubin devant la juridiction civile). La qualification de faute lourde n’a, d’ailleurs, pas été retenue en l’espèce.
Plus caractéristique est l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en- Provence le 15 septembre 1986, entre les mêmes parties.
Si cette décision ne retient pas davantage la faute lourde, elle affirme clairement, cette fois, qu’ "un acte juridictionnel, même définitif peut donner lieu à une mise en oeuvre de la responsabilité de l’État". En rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de cassation a, par là-même, validé cette décision dont elle a reproduit les termes précités (Civ. 1ère, 20 mars 1989, Bull. n° 131).
Plus récemment, la cour d’appel de Paris a jugé que la décision d’un juge aux affaires matrimoniales fixant le lieu de résidence habituelle d’une enfant chez la mère, laquelle avait tué sa fille, constituait une faute lourde. La mère avait auparavant été hospitalisée d’office pour meurtre hallucinatoire (C.A Paris, 25 octobre 2000 : D. 2001, J. p. 580, note Lienhard).
La circonstance que l’ordonnance litigieuse soit devenue définitive, faute d’appel du père de l’enfant, n’a pas fait obstacle à la reconnaissance d’une faute lourde. Toutefois, la cour d’appel a pris soin de relever que la signification requise par l’article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, en cas de non réclamation de la lettre recommandée notifiant l’ordonnance, n’avait pas été effectuée.
L’ensemble de la jurisprudence précitée semble révéler une certaine propension à interpréter de façon relativement souple la notion de faute lourde du service de la justice. Certaines omissions, négligences ou erreurs encourant, en effet, cette qualification, plus par l’ampleur de leurs conséquences que par leur gravité intrinsèque.
Le "carcan" de l’exigence d’une faute lourde modère toutefois sensiblement une telle tendance
C’est pourquoi l’arrêt d’assemblée plénière du 23 février 2001 ouvre une perspective beaucoup plus large.
2. L’arrêt d’assemblée plénière du 23 février 2001
Les circonstances dans lesquelles cette décision est intervenue sont bien connues. Bernard Laroche, inculpé et placé sous mandat de dépôt à la suite de l’assassinat du petit Grégory Villemin, en 1984, avait été assassiné par le père de l’enfant peu après sa remise en liberté. Ses ayants-droit ont mis en cause la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La Cour d’appel de Paris avait, par arrêt du 24 mars 1999, rejeté leur demande en reprenant les diverses définitions jusqu’alors retenues pour qualifier la faute lourde. L’assemblée plénière a admis la responsabilité de l’État dans les termes suivants : "constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi".
L’apport de cet arrêt est double :
- D’une part, la Cour de cassation substitue au critère "subjectif" classique auquel se réfèrent les définitions cumulativement énumérées par la cour d’appel un critère "objectif" pris du fonctionnement défectueux du service indépendamment de toute appréciation psychologique du comportement du ou des agents concernés.
- D’autre part, elle admet que la faute lourde peut résulter d’une "série de faits" qui, pris isolément, n’auraient pas ce caractère.
Un signe précurseur de ce changement avait été donné par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 octobre 2000 (précité). Analysant avec rigueur les divers manquements imputables tant au parquet qu’au juge des affaires familiales, la cour d’appel avait déjà admis que " si, pris isolément, aucune des négligences ainsi constatées ne s’analyse en une faute lourde, en revanche, le fonctionnement défectueux du service public de la justice qui découle de leur réunion revêt le caractère d’une faute lourde".
L’avancée est manifeste. Faut-il, pour autant, en retenir que la définition donnée par l’arrêt du 23 février 2001est si large qu’elle s’assimile en pratique à la faute simple (cf. concl. Seban, sur C.E Ass. 30 nov. 2001, Kechichian, Rev. Fr. Dr. Adm. 2002, p. 742).
Cette opinion est discutable. Il ressort de l’arrêt précité que la faute simple, si elle est unique (et même si les faits fautifs ne sont pas assez nombreux pour constituer une "série" au sens de cette décision) n’entraîne pas la responsabilité de l’État.
Le message le plus clair délivré par cette décision est la grande souplesse d’interprétation de la notion de faute lourde par la Cour de cassation. Corrélativement, elle témoigne du souci de dissocier davantage la notion de faute de service de celle de faute personnelle
B. Faute de service et faute personnelle
Cette distinction, qui procède de la jurisprudence administrative :
- inspire ouvertement la loi du 5 juillet 1972, comme l’indiquent les travaux préparatoires.
- est expressément formulée par l’article L. 781-1 qui distingue la responsabilité de l’État pour faute lourde et déni de justice (al. 1) de la responsabilité des juges pour faute personnelle (al. 3).
- emporte la même conséquence de principe qu’en matière de responsabilité de l’administration : l’État répond de la faute personnelle de ses agents (il faut entendre, bien que cela ne soit pas précisé "non dépourvue de tout lien avec le service"), comme de la faute de service.
En dépit de sa source d’inspiration, la solution adoptée est, sur plusieurs points, originale au regard du droit administratif.
- La victime ne peut agir directement contre le magistrat ou la fonctionnaire concerné en invoquant une faute personnelle. Seule l’action récursoire de l’État permet la mise en jeu de cette responsabilité personnelle.
- L’ordre de juridiction compétent est toujours le même, qu’il s’agisse de faute de service ou de faute personnelle. Toutefois, aux termes de l’article 11.1, alinéa 3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, l’action récursoire ne peut être exercée que devant une chambre civile de la Cour de cassation.
L’ordonnance du 22 décembre 1958 n’assortit d’aucune précision cette attribution de compétence à la seule Cour suprême. En l’absence d’action récursoire, les interrogations que suscite ce laconisme ne peuvent être levées, notamment quant à la procédure à suivre (celle en usage à la Cour de cassation ou celle applicable aux juridictions du droit commun de la responsabilité ?).
- La faute personnelle, définie par une jurisprudence administrative abondante et précise, ne l’est ni par la loi du 5 juillet 1972 ni par celle du 18 janvier 1979.
Le premier de ces textes, en précisant que la responsabilité de l’État n’est engagée, en la matière, que par une faute lourde ou un déni de justice, ne facilite pas la définition de la faute personnelle : la marge entre celle-ci et la faute de service est difficile à déterminer.
Cette incertitude ne peut être levée par la jurisprudence. D’une part, en raison de l’absence de toute décision rendue à la suite d’une action récursoire. D’autre part, eu égard à la mission dévolue au juge judiciaire saisi d’une action en responsabilité contre l’État. Il ne s’agit pas, pour lui, lorsqu’une faute personnelle est alléguée, de déterminer si cette qualification est justifiée, mais de rechercher si le comportement mis en cause se rattache au service public de la justice (pour des confirmations de décisions retenant ce rattachement, v. notamment Civ. 1ère, 19 juin 1985, Bull. n° 558 et 559 - v. également T.G.I Paris, 1er juillet 1987, précité).
Est-il possible, en revanche, de définir le déni de justice par rapport à la faute lourde, comme par rapport à la faute personnelle ?
C. Le déni de justice
Selon l’article L. 781-1, le déni de justice est, avec la faute lourde, l’un des deux cas d’ouverture d’une action en responsabilité contre l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice.
Il ne s’agit pas d’une véritable innovation. Le déni de justice était déjà reconnu comme l’un des cas d’ouverture de la prise à partie. En outre, ce terme est utilisé dans plusieurs dispositions législatives : article 506 du Code de procédure civile, article 4 du Code civil, article 185 du Code pénal, abrogé et non repris dans le nouveau Code pénal.
Le dénominateur commun à ces trois textes est l’étroitesse de la définition qu’ils donnent du déni de justice. Celui-ci est constitué par un véritable refus de juger, soit expressément manifesté, soit révélé par une négligence caractérisée.
Une telle conception peut-elle encore être admise dans le cadre de la loi du 5 juillet 1972 ?
Cette question en appelle une autre : le déni de justice n’est-il qu’une espèce particulière de faute ou relève-t-il d’une catégorie spécifique ?
A priori, la première acception semble la plus justifiée. Le déni de justice étant, par définition, la négation de sa mission par le juge, ne constitue-t-il pas l’exemple le plus typique de faute lourde ?
Cette interprétation se heurte à l’argument de texte tiré de ce que le législateur de 1972 a nettement distingué les deux cas d’ouverture. Sans doute la pertinence de cette considération est-elle limitée par son aspect formel. Toutefois l’argument reprend force si l’on prête au législateur l’intention de rompre avec la conception traditionnelle du déni de justice, en conférant à celui-ci une acception sensiblement plus large.
Dans cette perspective, la mention du déni de justice n’apparaît pas comme la reprise rituelle d’un terme consacré. Elle révèle un souci de "contourner" l’obstacle de la faute lourde par le recours à un cas d’ouverture "objectivisé" qui permettrait d’atténuer la rigueur de la loi. Le déni de justice s’apprécierait ainsi, non par référence à l’intention ou à la mauvaise volonté caractérisée de l’agent, mais sous le seul aspect d’un manquement du service à sa mission essentielle (en ce sens, voir notamment S. Guinchard, mégaCode de procédure civile, art. L.781-1, al. 2, et Cadiet, J.C.P. 1994, Doctr. 3805).
C’est bien cette interprétation que la jurisprudence semble retenir. Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
C’est fréquemment la longueur des délais qui est ainsi sanctionnée (en ce sens, T.G.I Paris, 6 juillet 1994, précité : tardiveté de la fixation d’une date de plaidoirie - 5 nov. 1995 : D. 1997, IV, 149 : délai de plus de trois ans entre un arrêt de chambre d’accusation ayant infirmé l’ordonnance d’irrecevabilité du juge d’instruction, la mise en examen d’une personne et le prononcé de l’ordonnance de non lieu). Cette dernière décision souligne que ce délai anormal ne saurait être justifié "quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause" (C.A Paris, 10 nov. 1999, J.C.P, éd. G. 1999, Actualité, p. 2046 ; D 2000. Inf. rap. p.31 : délai de plus de dix mois mis par la formation de départage d’un conseil de prud’hommes à se saisir de l’affaire).
Le jugement du 5 novembre 1995 précité, se réfère, d’ailleurs, expressément au droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable et invoque l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi apparaît le lien entre le déni de justice et le "délai raisonnable" au sens de cette convention.
II. l’application de la responsabilité de l’État pour faute du service de la justice par le juge administratif
"En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité » ; toutefois « l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité, dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive".
Ce considérant de principe de l’arrêt "Darmont" rendu par l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat le 29 décembre 1978 rompt avec le régime d’irresponsabilité de la puissance publique consacré jusque là par la jurisprudence précitée (AJDA 1979 n°ll p.45 note M. Lombard ; D. 1979.279 note Vasseur ; RDP 1979.1742 note J.M. Auby). Aucune raison majeure ne justifiait le maintien de cette jurisprudence alors que la loi de 1972 avait instauré un régime de responsabilité de l’État du fait du service public de la justice judiciaire. La faute lourde s’imposait dès lors logiquement dans les deux cas. Mais, au-delà de cette volonté d’harmoniser les régimes de responsabilité applicables à l’un et l’autre ordre de juridiction, le Conseil d’État avait un motif supplémentaire de retenir la faute lourde. Celle-ci est en effet apparue traditionnellement dans la jurisprudence administrative lorsqu’elle a entendu mettre fin à des régimes d’irresponsabilité anciens qui n’avaient plus de raison d’être (en matière de police) ou interpréter restrictivement un principe d’irresponsabilité posé par la loi en jugeant que devait être réservé le cas de la faute lourde (en matière de postes et télécommunications).
A. la faute de service et la faute personnelle
L’arrêt "Darmont" se réfère, en l’absence de texte, aux "principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique", c’est-à-dire à un droit commun de la responsabilité administrative qui résulte d’une construction jurisprudentielle. Il retient la faute lourde "commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative", sans se prononcer sur l’imputabilité de cette éventuelle faute à tel ou tel membre de cette juridiction. Il est en effet de règle que chaque collectivité publique réponde, à l’égard des victimes, de toutes les fautes de service qui lui sont imputables.
Cette faute de service peut être par nature anonyme, insusceptible d’être imputée à une personne déterminée : c’est le cas de celle qui résulterait d’une décision juridictionnelle collégiale, compte tenu du principe du secret du délibéré. La faute de service est aussi celle commise par une personne déterminée mais qui a agi dans le cadre de ses fonctions, de sorte que son comportement n’engage que la personne publique pour le compte de laquelle elle les exerce (ministre ou maire signant une décision illégale, médecin d’un hôpital public commettant une erreur de diagnostic...). Dans l’immense majorité des cas, les fautes ainsi commises relèvent de la catégorie des fautes de service, et il doit en être de même lorsque sont en cause des actes ou agissements commis par des juges administratifs.
En l’absence de toute jurisprudence relative à la distinction entre faute de service et faute personnelle en matière de responsabilité de la justice administrative, on peut penser que le Conseil d’État s’inspirerait ici aussi des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique. La jurisprudence a retenu une conception extensive de la faute personnelle "non dépourvue de lien avec le service" qui ouvre à la victime, outre l’action directement dirigée contre la personne de l’agent public, l’action, beaucoup plus favorable à la victime, dirigée contre la personne publique au nom de laquelle étaient exercées les fonctions. L’objectif est de protéger les victimes contre le risque d’insolvabilité de l’agent. Cette protection des victimes n’implique pas l’impunité des agents publics en cause. L’Etat condamné à payer une indemnité peut se retourner contre son agent en exerçant une action récursoire, devant le juge administratif, fondée sur la faute personnelle de cet agent (CE 28 juillet 1951 Delville et Laruelle). Cette action à coloration disciplinaire, rarement engagée envers les agents publics, ne l’a jamais été contre un juge administratif.
Quel que soit l’ordre de juridiction concerné, la victime n’a donc pas à établir, ce qui lui serait souvent difficile compte tenu du nombre d’intervenants dans une procédure juridictionnelle, quelle est la personne (ou quelles sont les personnes) à l’origine de la faute (ou des fautes) invoquée(s). Il lui suffit de prouver qu’une faute - individuelle ou collective- a bien été commise et qu’elle peut être qualifiée de "faute lourde". Ainsi se trouvent protégés tout à la fois les intérêts pécuniaires de la victime et la sérénité des participants à l’œuvre de justice, qui ne sont pas contraints à justifier de leur comportement personnel dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle du seul fait qu’un justiciable s’estime fondé à mettre en jeu la responsabilité du service public de la justice.
Cet équilibre ne peut être regardé comme pleinement satisfaisant que dans la mesure où les autorités disciplinaires compétentes à l’égard des membres des juridictions et gardiennes du respect de la déontologie professionnelle demeurent vigilantes quant au respect par ceux-ci de leurs obligations.
B. La faute lourde du service public de la justice administrative
Du fait du très faible nombre de recours, rares sont les décisions juridictionnelles susceptibles d’éclairer la définition de la faute lourde exigée par la décision "Darmont". Jusqu’à la décision du Conseil d’État "Magiera" de 2002, aucune décision définitive n’avait admis l’existence d’une faute.
Ainsi, le fait qu’un tribunal administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, ait annulé ce permis à la demande d’un voisin alors que le juge d’appel a ensuite annulé ce jugement et, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, a rejeté le recours de première instance n’a pas caractérisé une faute lourde du service public de la justice administrative dont puisse se prévaloir le bénéficiaire du permis (CE 2 octobre 1981 "Ministre de l’environnement et du cadre de vie c/ Cloâtre" au recueil Lebon p.351 ; CE 7 décembre 1990 "SCI Les Mouettes" Rec Leb p.852 ). Le motif d’annulation censuré par le juge d’appel était tiré d’une erreur d’interprétation, dans un cas, du règlement sanitaire départemental en ce qui concerne la distance entre les porcheries et les habitations, dans l’autre, de la loi du 27 décembre 1973, dite loi Royer, en ce qui concerne la détermination des surfaces à prendre en compte pour le calcul des seuils au-delà desquels l’autorisation administrative est requise.
L’appréciation de la faute est effectuée "dans les circonstances de l’affaire", ce qui signifie que le juge de l’action en responsabilité n’écarte pas par principe l’idée qu’une annulation contentieuse (ou un sursis à exécution, devenu depuis la loi du 30 juin 2000 une suspension en référé) puisse, eu égard notamment au motif retenu par les juges, révéler une faute lourde. Le Conseil d’Etat rappelle aussi que "la gravité des conséquences qu’auraient entraînées ces décisions pour le titulaire des autorisations dont s’agit est, par elle-même, sans influence sur l’appréciation de la gravité de la faute de nature à engager la responsabilité de l’État". S’agissant en effet d’une responsabilité pour faute, le juge apprécie la gravité de la faute par rapport aux obligations du service et non par rapport à l’ampleur du préjudice invoqué. Il en irait différemment dans le cadre de la responsabilité administrative sans faute qui, dans les cas où elle est admise, fonde l’obligation de réparer sur le seul lien de causalité directe entre l’activité de la puissance publique et un préjudice anormal et spécial.
Par la décision du 1er avril 1992 "société CICOMAP et M. Charbit" (recueil Lebon p.146), le Conseil d’État a jugé que l’illégalité de la délégation donnée par l’assemblée générale au bureau de la chambre de commerce de Paris, pour exercer certaines fonctions juridictionnelles de caractère disciplinaire, ne pouvait pas être qualifiée de faute lourde. Il a ainsi retenu une conception réaliste tenant compte de la relative obscurité des textes applicables, qu’il avait dû lui-même interpréter dans sa formation solennelle de la Section du contentieux en 1983.
Une commission départementale des handicapés ayant insuffisamment motivé sa décision, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait pas faute lourde (14 janvier 1998 "Dagorn" n°169344).
C. La décision du 28 juin 2002 "Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera"
La décision rendue le 28 juin 2002 par l’assemblée du Contentieux du Conseil d’État "Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ M. Magiera" n°239575, confirmant un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, marque une nouvelle étape importante quant à la responsabilité pour faute du service public de la justice administrative.
La décision comporte d’abord un considérant de principe relatif au fondement de la responsabilité, selon lequel il résulte des stipulations des articles 6, paragraphes 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsque le litige entre dans leur champ d’application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
S’agissant des exigences du délai raisonnable de jugement, le Conseil d’État a entendu saisir la première occasion qui lui était effectivement donnée pour reconnaître sans ambiguïté, tout particulièrement aux yeux de la Cour européenne des droits de l’homme qui attendait cette consécration explicite par le juge administratif français, l’existence d’un recours effectif de droit interne permettant la réparation des préjudices subis dans un tel cas par les parties concernées. Il a toutefois donné à sa décision un double fondement en précisant qu’en dehors même du champ d’application de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droits et obligations de caractère civil et accusations en matière pénale) c’est l’ensemble des litiges relevant des juridictions administratives qui sont concernés par le droit au respect d’un délai raisonnable de jugement, en vertu des "principes généraux" qui gouvernent leur fonctionnement.
Le souci de garantir le caractère effectif de ce recours en responsabilité explique la motivation détaillée de la décision de 2002 relative tant au délai raisonnable qu’aux caractères du préjudice indemnisable lorsqu’il n’est pas respecté :
- "le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale - compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement",
- cette action du justiciable "doit permettre la réparation de l’ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation n’est pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; peut ainsi notamment trouver réparation le préjudice causé par la perte d’un avantage ou d’une chance ou encore par la reconnaissance tardive d’un droit ; peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d’une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l’intéressé".
La décision "Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera" innove aussi quant au fondement de la responsabilité. Le fondement retenu n’est certes pas celui d’une responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques : d’une part, parce qu’est relevé un "fonctionnement défectueux" du service public, c’est-à-dire une faute ; d’autre part, parce que le Conseil d’État n’a pas exigé que le préjudice présente le caractère anormal et spécial qu’implique tout régime de responsabilité sans faute de la puissance publique.
Mais eu égard aux termes utilisés, la faute simple suffit dans ce cas, alors que, dans ses conclusions sur l’affaire "Darmont", Michel Rougevin-Baville citait, parmi les exemples envisageables de faute lourde, la lenteur excessive d’une procédure contentieuse. Le Conseil a donc suivi son commissaire du gouvernement, Francis Lamy, qui proposait de s’en tenir à la faute simple pour ce qui est du délai raisonnable. L’avenir dira si cet abandon ponctuel de la faute lourde annonce la distinction esquissée par son commissaire entre "l’administration des procédures juridictionnelles" (l’information des parties, la communication des pièces, le délai raisonnable...) et le "cœur de l’activité juridictionnelle", pour lequel il estimait que "l’argument de la difficulté de la mission joint au souci de ne pas doubler les procédures de droit commun de recours contre les décisions juridictionnelles, justifie mieux le maintien de la faute lourde".
D. Le déni de justice
La question de la responsabilité d’une juridiction administrative à raison d’un déni de justice est susceptible de se poser au même titre que pour la juridiction judiciaire. Elle n’appelle guère de développements spécifiques dès lors que la jurisprudence n’y a pas été directement confrontée. On rappellera que si l’arrêt "Darmont" ne mentionne pas le déni de justice comme cas particulier d’ouverture de la responsabilité de l’État, le Conseil d’État n’a pas entendu introduire une différence de fond - dont on ne saisirait pas le motif - avec la loi de 1972 mais a implicitement jugé qu’il y aurait là une faute lourde.
Le Conseil n’a pas non plus eu recours à cette notion de déni de justice pour qualifier la faute invocable par un justiciable en cas d’inaptitude de la juridiction administrative à trancher un litige dans un délai raisonnable (affaire Magiera).
Les termes "déni de justice" apparaissent dans la jurisprudence administrative dans le cas de contradiction de jugements conduisant à un tel déni, laquelle justifie, selon le cas, soit la procédure de règlement de juges au sein de la juridiction administrative, soit la compétence du tribunal des conflits pour mettre un terme à une telle contradiction entre des décisions de chaque ordre de juridiction (loi du 20 avril 1932).
Il reste que la doctrine a donné à cette notion un contenu parfois très extensif allant bien au-delà des termes de l’article 4 du code civil (Louis Favoreu, "Du déni de justice en droit public français", précité). Ainsi entendue, par référence au concept plus récent de "droit au juge", cette notion est souvent utilisée, notamment par les commissaires du gouvernement, pour appréhender nombre de questions relatives notamment à l’existence d’un recours juridictionnel, à son effectivité ainsi qu’à l’étendue du contrôle du juge. Un revirement jurisprudentiel visant à réduire les cas de décisions administratives insusceptibles de recours pour excès de pouvoir pourra ainsi être souhaité puis justifié au nom du risque de déni de justice (ex : mesures d’ordre intérieur pénitentiaires). Mais on n’imagine pas que le Conseil d’État, après avoir procédé à une extension du champ des décisions susceptibles de recours, sanctionne, pour avoir commis un déni de justice engageant la responsabilité de l’État, une juridiction qui se serait bornée à faire application sur ce point de la jurisprudence antérieure.
E. La limite de la chose jugée
La jurisprudence du Conseil d’État est fixée, depuis l’arrêt "Darmont" de 1978, en ce sens que la responsabilité de l’État ne peut pas être mise en jeu dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive.
M. Darmont, client d’une banque en déconfiture, se plaignait de ce que la Commission de contrôle des banques, organisme juridictionnel dans sa fonction disciplinaire, avait prononcé à l’encontre de cette banque une sanction trop légère, un simple rappel à l’ordre. Et il imputait à cette légèreté le préjudice qu’il avait subi du fait de ses pertes financières. Sans avoir à se prononcer sur le caractère direct ou non du lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’intervention de la juridiction, le Conseil d’État s’est borné, pour rejeter ces conclusions, à constater "qu’en l’espèce, les décisions de sanction incriminées ... et qui ont été prononcées en 1960 et 1964 sont des décisions juridictionnelles définitives".
L’arrêt ne se borne pas à opposer l’achèvement de l’instance juridictionnelle en cause pour écarter le principe de la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat. Ce point est confirmé par la décision "Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera". M. Magiera avait obtenu la condamnation définitive de l’État à lui payer une indemnité pour dommages de travaux publics lorsqu’il a demandé réparation à l’État du préjudice, distinct du précédent, lié à la durée jugée excessive de la procédure. L’autorité de chose jugée qui s’attachait à la décision juridictionnelle ne faisait pas obstacle par elle-même à ce que la responsabilité de l’État soit engagée pour faute lourde commise à l’occasion de l’instance juridictionnelle ainsi définitivement close. En effet M. Magiera n’imputait pas à faute la décision statuant sur sa demande d’indemnité mais le délai nécessaire pour l’obtenir.
Ainsi, la portée exacte de la limite que constitue la chose définitivement jugée doit être appréciée en tenant compte du lien de rattachement plus ou moins étroit exigé par le juge entre la faute lourde du service public de la justice qui est invoquée et le contenu même de la chose jugée. Entre le cas "Darmont" où ce lien est direct et le cas "Magiera" où il est inexistant, des situations intermédiaires sont susceptibles de se présenter.
Après l’innovation jurisprudentielle de 1978, deux arrêts du Conseil d’État rejettent la demande d’indemnité en opposant ainsi la chose jugée, sans qu’il soit donc besoin de qualifier la faute invoquée : CE 12 octobre 1983, consorts Levi, Recueil Lebon p.406, dans une espèce analogue à l’affaire Darmont, et CE 12 novembre 1980, M. Pierrot Luc Francis, n° 22787 non publiée, en matière de sanction disciplinaire à l’encontre d’un chirurgien-dentiste.
Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 27 avril 1988, Krafft, (aux tables du recueil Lebon, p.1011) a jugé que la circonstance qu’une décision du Conseil d’État serait intervenue sans que l’avocat des requérants ait été invité à prendre connaissance des mémoires produits en cours d’instance par l’administration n’est pas de nature à mettre en jeu la responsabilité de l’État, dès lors que ladite décision est devenue définitive et que la faute lourde alléguée résulte d’agissements qui ne sont pas détachables des irrégularités viciant la décision en cause.
La méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure est une irrégularité que le juge d’appel ou de cassation sanctionne par l’annulation de la décision juridictionnelle, et il n’y a guère d’effort à admettre que l’on se trouve alors en présence d’une faute du service public de la justice. Toutefois, les voies de recours permettent d’en pallier l’essentiel des conséquences : le litige sera jugé à nouveau dans le respect du contradictoire. Du temps et de l’argent auront été certes perdus par les parties (préjudice distinct susceptible le cas échéant d’être réparé par ailleurs) mais le jugement définitif sera intervenu conformément aux exigences procédurales. La jurisprudence "Darmont" ne laisse pas au justiciable une option entre l’exercice normal des voies de recours et une action en responsabilité exclusivement fondée sur la "faute" de la juridiction dont il a renoncé à demander la censure en acceptant que la chose jugée devienne définitive.
Au-delà de la question du contradictoire, sont ici en cause toutes les "fautes" éventuelles d’une juridiction, qu’elles concernent la procédure, la prise en compte des faits en litige ou le fond du droit, susceptibles de fonder un recours contre la décision qu’elle a rendue. Même dans le cas où la qualification de faute lourde peut être alors admise, il reste en effet à apprécier si cette faute est directement à l’origine du préjudice invoqué par le plaideur malheureux, c’est-à-dire si elle l’a privé d’une chance de gagner son procès. La renonciation à exercer un recours utile vient alors s’interposer dans la chaîne de causalité.
Est ainsi évité le paradoxe d’un justiciable qui, choisissant l’action indemnitaire plutôt que le recours en annulation de la décision juridictionnelle qu’il conteste (ce n’est donc pas par un souci louable d’économie), devrait établir qu’il a perdu une chance de voir ses prétentions prospérer et ceci devant un juge différent de celui qui aurait dû, s’il l’avait saisi, connaître du litige initial et qui était évidemment le mieux placé pour le trancher.
C’est d’ailleurs un raisonnement de cette nature que le Conseil d’État avait tenu, dès sa décision du 28 novembre 1958, Blondet, précitée. A la suite d’un litige relatif à la pension du requérant devant une cour régionale des pensions qui avait rejeté sa demande, celui-ci mettait en jeu la responsabilité de l’État en soutenant que trois certificats médicaux avaient disparu au cours de la procédure et que la cour avait ainsi statué au vu d’un dossier incomplet. Le Conseil d’État a rejeté ses conclusions au motif que "la faute imputée en l’espèce au commissaire du gouvernement, en admettant qu’elle soit établie, n’est pas détachable de l’irrégularité qui vicierait l’arrêt rendu par la cour et qu’il était, d’ailleurs, loisible au requérant de relever à l’appui du pourvoi en cassation par lui introduit contre ledit arrêt et rejeté par la commission spéciale de cassation des pensions". Sous réserve de l’expression "d’ailleurs" qui caractérise un motif surabondant, cette réponse pourrait demeurer aujourd’hui pertinente.
Il peut arriver que la faute lourde ne soit pas détachable de la décision elle-même mais qu’eu égard à la juridiction dont elle émane, aucune voie de recours utile ne soit susceptible d’en effacer les conséquences. L’hypothèse n’est sans doute pas fréquente mais l’obstacle est ici caractérisé. C’est le cas des juridictions suprêmes, internationales ou nationales, dont l’autorité serait d’ailleurs bien fragile si elle tenait principalement au caractère incontestable de leurs décisions. Plutôt que d’ouvrir des actions indemnitaires fondées sur la faute lourde que révèlerait le contenu d’une décision de justice devenue définitive, ne serait-il pas préférable de faire en sorte que les voies de recours existantes (sans en créer de nouvelles qui ne font qu’allonger les procédures) permettent de rectifier en temps utile tout ce qui doit l’être pour assurer le respect des droits fondamentaux des parties ?
Les influences croisées qui ont été dégagées (celle de la jurisprudence administrative sur la loi du 5 juillet 1972 - celle de la même loi sur la jurisprudence administrative) témoignent de l’identité foncière d’un problème auquel doivent répondre (sauf peut-être quelques nuances nécessaires) des solutions analogues.
En l’état, la convergence entre les deux ordres de juridictions est manifeste sur plusieurs points (même si la jurisprudence judiciaire est, en la matière, beaucoup plus abondante que la jurisprudence administrative).
Dans les deux cas, la faute lourde est, en règle générale, la condition de mise en jeu de la responsabilité de l’État. Mais un souci commun d’atténuer la rigueur d’une telle exigence est discernable.
Lié par un texte législatif, le juge judiciaire a, dans la limite que lui autorisait cette contrainte, assoupli progressivement la notion de faute lourde.
La manifestation la plus évidente de cette tendance est constituée par l’arrêt d’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 février 2001 (précité). Désormais, la faute lourde peut résulter d’un ensemble de fautes simples.
Mais l’aspect spectaculaire de cet arrêt ne doit pas occulter les nombreuses décisions des juges du fond conférant le caractère de faute lourde à des manquements qui, comme on a pu le voir, pourraient relever de la faute simple.
De surcroît, la jurisprudence judiciaire a adopté une notion extensive du déni de justice qui revient pratiquement à fonder la responsabilité, dans certains cas, sur une faute simple.
Parallèlement, le juge administratif, dont la marge de manoeuvre est beaucoup plus grande, a choisi de s’aligner, en principe, sur la condition de la faute lourde tout en s’en écartant, au profit de la faute simple, en matière de délai raisonnable.
Devant l’un et l’autre ordre de juridiction, la responsabilité de l’État est retenue lorsque le service public a connu un dysfonctionnement caractérisé, apprécié objectivement en fonction de ce qu’un justiciable est en droit d’attendre du service public de la justice, sans appréciation du comportement individuel de son agent. La gravité des conséquences du dysfonctionnement est, en revanche, parfois prise en considération.
Demeure, évidemment, une différence majeure entre les deux jurisprudences : la remise en cause de l’autorité de la chose jugée, admise par le juge judiciaire et refusée par le juge administratif.
Néanmoins, la constatation d’une tendance commune à l’assouplissement des conditions de mise en jeu de la responsabilité de l’État en la matière conduit à s’interroger sur les limites d’une telle orientation. En d’autres termes, peut-on envisager une responsabilité fondée sur la faute simple, voire une responsabilité sans faute ?
L’admission de la faute simple, qui a la faveur d’une partie de la doctrine, irait dans le sens de certaines évolutions de la jurisprudence administrative qui a abandonné l’exigence de la faute lourde pour des activités qui présentent pourtant un degré de difficulté certain (services de secours d’urgence ou faute médicale du service public hospitalier). Mais, outre qu’il faudrait, en ce qui concerne les juridictions judiciaires, modifier la loi du 5 juillet 1972, il resterait à faire comprendre que la grande majorité des cas où une décision juridictionnelle est censurée en appel ou en cassation ne révèle pas pour autant de la part de ses auteurs une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. La jurisprudence ne peut effet connaître une "respiration" normale si les juridictions suprêmes sont seules habilitées à prendre l’initiative de son évolution. L’exigence d’une faute lourde permet à cet égard de faire la part des choses ainsi que le montre l’interprétation souple de cette notion qui en a été faite jusqu’à présent par la jurisprudence judiciaire. Cette dernière ne serait-elle pas incitée à se montrer plus sévère si la substitution de la faute simple à la faute lourde lui paraissait de nature à entraver sensiblement l’action des juridictions.
Une autre voie, esquissée par la décision Magiera du Conseil d’État, consisterait à distinguer les fautes du service public de la justice selon qu’elles mettent en cause ou non l’activité juridictionnelle stricto sensu, c’est-à-dire la part d’appréciation qui doit être reconnue à tout juge dans l’exercice des responsabilités qui lui sont propres. Seules ces dernières devraient être qualifiées de fautes lourdes. Mais de telles nuances sont peu compatibles avec les termes de la loi du 5 juillet 1972. Elles seraient difficiles à introduire dans un nouveau texte législatif. Seul le juge administratif, non lié par un texte, pourrait mettre en oeuvre ce critère délicat.
Quant à la responsabilité sans faute, également préconisée par certains auteurs, elle est sans doute concevable en particulier dans des situations où un juge unique est investi en matière judiciaire, de très lourdes responsabilités (juge d’instruction, juge aux affaires familiales, juge des tutelles). C’est d’ailleurs le fondement du régime législatif de réparation de certaines détentions provisoires.
Mais son admission ne présenterait, sans doute, pour le justiciable qu’un avantage apparent, dès lors que, d’une part, la jurisprudence se réfère déjà souvent à une conception objective du dysfonctionnement, détachée de toute appréciation d’un comportement individuel, et que, d’autre part, un régime de responsabilité fondé sur la rupture d’égalité devant les charges publiques ne permet en principe de réparer que la part du préjudice invoqué par la victime qui présente un caractère anormal et spécial.
En revanche, et sauf à ce qu’une responsabilité sans faute coexiste avec une responsabilité pour faute, dans des conditions qui paraissent difficiles à préciser par avance par la loi, l’abandon de l’exigence d’une faute quelconque ne serait pas sans conséquence sur la perception du service public de la justice par ses usagers. Ce serait admettre qu’il n’est plus susceptible d’être regardé comme ayant manqué à sa mission et se trouve déchargé de celle de se prononcer, à la demande des usagers, sur ses propres défaillances. Serait-ce un progrès par rapport à la volonté du législateur de 1972 telle que mise en oeuvre par une jurisprudence constructive ? La mise en relief d’erreurs caractérisées nuisibles au fonctionnement du service doit permettre d’améliorer celui-ci en suscitant une réflexion critique.
En définitive, une réforme législative, inutile pour le juge administratif et très délicate à réaliser pour le juge judiciaire, paraît moins opportune que la poursuite de l’évolution jurisprudentielle amorcée, dans le sens d’une harmonisation aussi large que possible des jurisprudences des deux ordres de juridictions.
LES MAGISTRATS SONT IRRESPONSABLES ET VEULENT LE RESTER
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites
- LES TEXTES CONCERNANT LES MAGISTRATS
- L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
- LA JURISPRUDENCE DÉMONTRE LE CORPORATISME
LES TEXTES CONCERNANT LES MAGISTRATS
L'Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature protège les magistrats dans l'exercice de leur fonction.
La Loi organique n°94-100 du 5 février 1994 concerne le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Décret n°94-199 du 9 mars 1994 est relatif au Conseil supérieur de la magistrature modifié par le Décret n° 2010-1637 du 23 décembre 2010 modifiant le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature.
La loi organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 rallonge dans son article 1er la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire.
Par dérogation à
l'article
76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire nés avant le 1er janvier 1956 est fixée:
1° Pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951, à soixante-cinq ans
2° Pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, à soixante-cinq ans et quatre mois
3° Pour les magistrats nés en 1952, à soixante-cinq ans et huit mois
4° Pour les magistrats nés en 1953, à soixante-six ans
5° Pour les magistrats nés en 1954, à soixante-six ans et quatre mois
6° Pour les magistrats nés en 1955, à soixante-six ans et huit mois.
Le Décret n° 2011-1713 du 1er décembre 2011 modifie le décret n° 2003-1284 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire.
L'Arrêté du 30 novembre 2011 modifie l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'École nationale de la magistrature.
L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
Le Décret n° 2017-713 du 2 mai 2017 est relatif à la déclaration d'intérêts des magistrats de l'ordre judiciaire.
- L'Arrêté du 30 mai 2017 fixe la liste des emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice
L'Arrêté du 5 septembre 2017 porte création de zones protégées au ministère de la justice au service de l'inspection générale de la justice, 31 rue de la Gare Paris (19e).
Le Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 porte création de l'inspection générale de la justice destinée à contrôler la justice.
Le 1er Président de la Cour de Cassation et le Procureur Général refusent l'inspection générale de la justice alors que le pouvoir judiciaire ne respecte pas les obligations internationales que la France a signées !
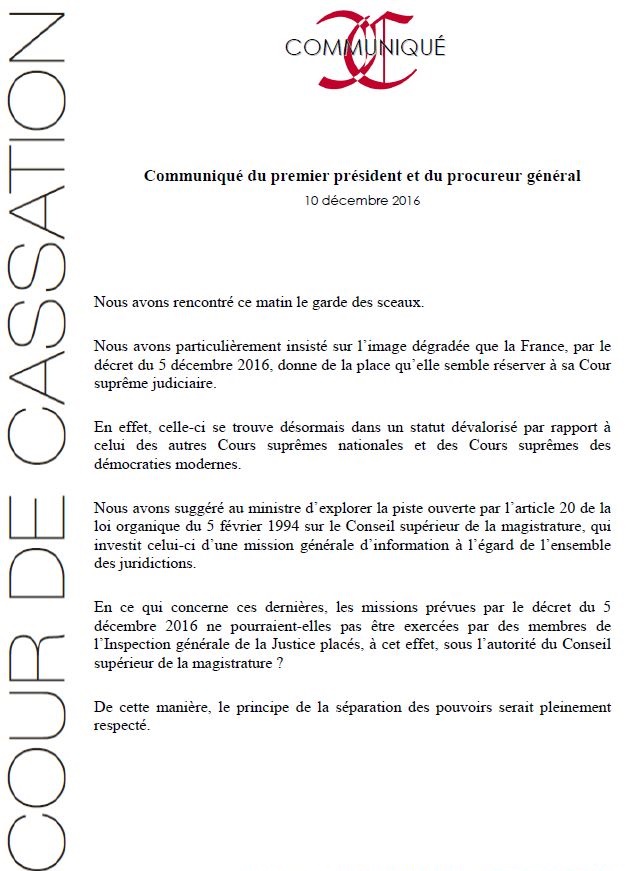
LA JURISPRUDENCE DÉMONTRE LE CORPORATISME
LA JUSTICE A UNE OBLIGATION DE MOYEN ET NON DE RÉSULTAT
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 1er juin 2011 pourvoi n° 10-18237 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2010), que M. X..., motocycliste, a été grièvement blessé au
cours d'un accident de la circulation dont il n'a gardé aucun souvenir ; que des fonctionnaires de police ont établi un procès-verbal mentionnant qu'il
n'existait aucun témoin direct de l'accident ; qu'une personne s'est ultérieurement manifestée pour indiquer que, le jour de l'accident, elle avait
été dépassée par la victime et qu'arrivée sur les lieux elle avait trouvé deux voitures arrêtées dont le conducteur de la première lui avait dit qu'il avait vu
le motard "s'envoler" et celui de la seconde qu'il avait appelé les secours ; qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M.
X... qui relevait les contradictions et les omissions du rapport d'accident établi par les services de police, une ordonnance de non-lieu a été rendue ; que
M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu qu'ayant relevé que les interrogations de M. X... sur la présence et la participation d'un tiers conducteur fautif ou seulement impliqué n'étaient
corroborées par aucun élément matériel ou humain provenant soit des constatations initiales, soit de l'information judiciaire, sans que l'on puisse
imputer le résultat négatif de l'enquête et de l'information à une faute imputable aux services de police et que l'institution judiciaire n'était tenue
qu'à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'existence d'une faute lourde du service
public de la justice n'était pas démontrée et que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée ; que le moyen ne peut être accueilli
LA JUSTICE PEUT LIBÉRER LES VIOLEURS, LES FEMMES VIOLÉES N'ONT RIEN A DIRE DU FAIT CE CETTE LIBÉRATION !
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du 12 octobre 2011 N° de pourvoi 10-19720 Rejet
Attendu que, le 26 avril 2004, M. X..., détenu depuis le 19 mars 2003 pour
des faits de viols aggravés, a fait l'objet d'une mise en accusation devant la
cour d'assises par un juge d'instruction qui n'avait pas ordonné sa prise de
corps ; que le 15 juin 2004, la chambre de l'instruction d'une cour d'appel l'a
mis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir constaté qu'en omettant de
délivrer une prise de corps, le juge d'instruction avait fait une application
erronée, car anticipée, des dispositions de la loi du 9 mars 2004 dont l'entrée
en vigueur ne devait intervenir que le 1er octobre 2004 ; que, le 29 septembre
2004, Mme Y... épouse Z... a été victime d'une agression suivie d'un viol
commise par M. X... ; que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres
infractions (le Fonds de garantie) a versé à Mme Z... une indemnité de 30 300 €
; que, parallèlement, celle-là a recherché la responsabilité de l'Etat pour
faute lourde du service public de la justice ; que le Fonds de garantie est
intervenu à l'instance, sur le fondement du recours subrogatoire qu'il tient de
l'article 706-11 du code de procédure pénale, pour demander le remboursement des
sommes versées à Mme Z... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2010) a déclaré
irrecevables les demandes présentées par Mme Z... et le Fonds de garantie sur le
fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et
recevable celle de Mme Z... fondée sur la rupture d'égalité et a condamné
l'agent judiciaire du Trésor à lui payer une certaine somme à titre de
dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le principe de responsabilité posé par l'article L.
141-1 du code de l'organisation judiciaire ne pouvait être utilement invoqué que
par l'usager qui était, soit directement, soit par ricochet, victime du
fonctionnement du service public de la justice, la cour d'appel qui a constaté
que Mme Z... n'était pas partie à la procédure criminelle suivie contre M. X...
devant le juge d'instruction en a exactement déduit, sans ajouter au texte une
condition qu'il ne contenait pas, qu'elle n'était pas fondée à invoquer les
dispositions de cet article pour demander réparation de son préjudice ; que le
moyen ne peut être accueilli
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions aux
dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille
onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils
pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres
infractions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce
qu'il a déclaré irrecevable la demande du Fonds de garantie au titre de son
recours subrogatoire ;
Aux motifs que « la réparation du préjudice subi par la victime d'une
intervention judiciaire ne la concernant pas est subordonnée à la preuve du
caractère spécial et anormal de ce dommage, ainsi que du caractère anormal de la
charge qu'elle a supportée en contrepartie des avantages résultant de
l'intervention de la justice ; que les mesures prises par les juridictions
d'instruction en matière de mise en liberté sous contrôle judiciaire entrent
dans les prévisions de l'article 137 du Code de procédure pénale, qui arrête que
la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre et qu'elle ne peut
être placée en détention provisoire qu 'à titre exceptionnel, et qu'elles
créent, lorsqu'elles sont utilisées, un risque spécial envers les tiers, propre
à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat ; qu'en
l'espèce, les faits dont Mme Z... a été victime, qui, par leur gravité, lui ont
causé un dommage spécial et anormal, constituent, au regard des avantages
résultant de la poursuite des crimes et délits, une charge anormale résultant du
défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de
l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux qui a décidé de mettre Raoul X...
sous contrôle judiciaire et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le juge
d'instruction au Tribunal de grande instance de Bordeaux a commis une faute ;
qu'il convient, en conséquence, de déclarer l'Etat responsable du dommage subi
par Mme Z... ; que le préjudice dont Mme Z... est fondée à demander réparation
est celui qui découle, non pas du viol et de la séquestration, mais de la
situation dans laquelle elle s'est trouvée à la suite du défaut d'ordonnance de
prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel
de Bordeaux qui ont eu pour conséquences l'élargissement de Raoul X... et la
commission des faits qui lui sont imputés ; qu'il existe un lien direct de cause
à effet entre le fonctionnement des juridictions d'instruction dont il s'agit et
le dommage subi par Mine Z... ; que, compte tenu des circonstances de la cause,
il échet d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner l'Agent
judiciaire du Trésor à payer à Mme Z... la somme de 15 000 euros ; que sur le
recours subrogatoire du Fonds de garantie ; qu'aux termes de l'article 706-11 du
Code de procédure pénale, "le Fonds est subrogé dans les droits de la victime
pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou
tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le
remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite
du montant des réparations à la charge desdites personnes " ; que, si ces
dispositions autorisent le Fonds de garantie à exercer un recours subrogatoire
contre une personne n'ayant pas commis l'infraction, mais tenue d'en assumer la
réparation à un titre quelconque, encore faut-il que l'indemnité ou la provision
sur lesquelles le fonds entend exercer son recours soient destinées à réparer
les conséquences de l'infraction ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence dès
lors que, comme il est dit ci-avant, l'indemnité allouée à Mme Z... répare, non
pas le dommage né des infractions commises par Raoul X..., mais le préjudice
causé par la rupture de l'égalité devant les charges publiques, qui est
imputable à l'Etat ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en
ce que les premiers juges ont débouté le Fonds de garantie de son recours
subrogatoire ;
Alors, d'une part, Que l'action en responsabilité sans faute contre l'Etat est
ouverte à toute personne ayant subi un dommage anormal et spécial du fait d'une
rupture d'égalité devant les charges publiques, c'est ce préjudice anormal et
spécial qu'elle a pour objet de réparer ; qu'en retenant que la séquestration et
le viol dont Mlle Z... avait été victime constituait un préjudice anormal et
spécial justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat mais que
cette action en responsabilité n'aurait pas pour objet de réparer ce préjudice
anormal et spécial né de la séquestration et du viol, la cour d'appel n'a pas
tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et
a ainsi méconnu les principes régissant la responsabilité de la puissance
publique
Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que le Fonds de garantie peut
exercer son recours subrogatoire non seulement contre les personnes responsables
du dommage causé par l'infraction, mais également contre celles qui sont tenues
à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle ; qu'en
déboutant néanmoins le Fonds de garantie de sa demande au motif qu'il est
susceptible d'exercer les seuls droits que la victime tirait de l'infraction
commise par Raoul X... à l'exclusion de ceux qu'elle tirait de la rupture de
l'égalité devant les charges publiques imputable à l'Etat, la cour d'appel a
violé l'article 706-11 du Code de procédure pénale,
Alors, ensuite et plus subsidiairement, que le Fonds de garantie, subrogé dans
les droits de la victime qu'il a indemnisée, est fondé à exercer les droits de
celle-ci quand bien même elle n'en revendiquerait pas l'application ; qu'en
déboutant le Fonds de garantie au motif que l'indemnité allouée à Mme Z...
réparait son seul préjudice résultant de la situation dans laquelle elle s'est
trouvée à la suite du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la
chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui ont eu pour
conséquences la libération de son agresseur et non les conséquences de
l'infraction, sans rechercher si le Fonds, subrogé dans les droits de la
victime, n'était pas par ailleurs fondé à demander la condamnation de l'Agent
judiciaire du Trésor à lui rembourser les sommes qu'il avait réglées en
conséquence de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 706-11 du code de procédure pénale
Alors, enfin et en tout état de cause, que le Fonds de garantie est fondé à
exercer son recours subrogatoire sur les indemnités allouées à la victime en
conséquence de l'infraction ; qu'en affirmant que l'indemnité allouée à Mme Z...
ne réparait pas les conséquences de l'infraction mais la situation dans laquelle
celle-ci s'est trouvée à la suite du défaut d'ordonnance de prise de corps et de
l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant décidé la libération de M X..., de
sorte que le Fonds de garantie n'était pas fondé à en réclamer le paiement,
cependant, d'une part, que comme elle l'a elle-même relevé, seule la libération
de M X... avait rendu possible l'infraction, et d'autre part, que sans la
commission de l'infraction, Mme Z... n'aurait pu se prévaloir d'aucun préjudice,
de sorte que l'indemnité était nécessairement allouée des suites de l'infraction
dont Mme Z... avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du
code de procédure pénale et les principes régissant la responsabilité de la
puissance publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du
Fonds de garantie au titre de son recours subrogatoire sur le fondement de
l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Aux motifs que « en vertu de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation
judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le
fonctionnement défectueux du service de la justice » et que « sauf dispositions
particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un
déni de justice » ; qu'est regardée commune faute lourde toute déficience
caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du
service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que ce principe
de responsabilité ne peut être utilement invoqué que par l'usager qui est soit
directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement défectueux du service
de la justice ; qu'en l'espèce, Mme Z... n'était ni partie à la procédure
criminelle suivie contre Raoul X... devant l'un des juges d'instruction au
Tribunal de grande instance de Bordeaux, ni concernée par cette procédure ;
qu'il suit de là que Mine Z... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de
l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire pour demander réparation
de son préjudice ;
Alors qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire,
l'État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux
du service de la justice ; qu'en écartant l'application de ce texte motif pris
de ce que Mme Z... n'aurait pas la qualité d'usager du service public de la
justice en ce sens qu'elle n'était ni partie ni concernée par la procédure
diligentée contre M. X..., cependant que ce texte ne limite nullement son
application aux seuls usagers du service de la justice entendus comme ceux
parties ou concernés par la procédure ayant occasionné le dysfonctionnement
justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de l'Etat, la cour d'appel y a ajouté une condition et l'a violé
LA JUSTICE PEUT LAISSER UN INDIVIDU SE SUICIDER EN GARDE A VUE SANS EN RENDRE COMPTE
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du 9 mars 2011 N° de pourvoi 10-14697 Rejet
Attendu que le 18 octobre
2003, Michel X... a, à l'issue de sa garde à vue, été présenté au procureur de
la République près le tribunal de grande instance de Pontoise pour y être mis en
examen du chef de viols ; qu'alors qu'il s'entretenait avec son avocat dans une
pièce du tribunal de Pontoise avant d'être déféré devant un juge d'instruction,
il s'est défenestré et est décédé des suites de ses blessures ; que M. et Mme
Pierre X..., ses parents, Mme Evelyne X..., sa veuve, MM. Pierre Antoine et
Valentin X..., ses enfants, et M. Pierre X..., son frère (les consorts X...),
agissant en qualité d'ayants droit du défunt ont recherché la responsabilité de
l'Etat sur le fondement de l'article L.
141-1 du code de l'organisation
judiciaire ; qu'un tribunal les a déboutés de leur demande ; que les consorts
X..., ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement et sont intervenus
volontairement en cause d'appel à titre personnel ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre
2009) d'avoir déclaré irrecevable l'action personnelle engagée par eux en
réparation du préjudice causé par le suicide de leur parent, lui-même décédé à
la suite d'un dysfonctionnement du service public de la justice
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... qui, agissant à titre personnel,
étaient des tiers au regard de la qualité qu'ils avaient en première instance et
qu'ils avaient conservée en cause d'appel, la cour d'appel a pu en déduire que
la demande qu'ils présentaient par voie d'intervention était nouvelle et n'avait
pas été débattue devant les premiers juges de sorte qu'elle était irrecevable
par application de l'article 554 du
code de procédure civile ; que le moyen ne peut
être accueilli
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur
demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat en raison du
mauvais fonctionnement de la justice;
Attendu qu'ayant relevé que, si la pièce où Michel X... s'entretenait avec son
avocat était située au premier étage du bâtiment et que si la fenêtre, pourvue
de crémone mais fermée, n'était pas munie de barreaux, d'abord, cette pièce
était propre à assurer la confidentialité de l'entretien dès lors que les
fonctionnaires de police pouvaient le surveiller à travers la cloison vitrée,
ensuite, la liberté et la dignité de l'entretien étaient assurées par cette
circonstance que Michel X... ne portait pas d'entraves, en outre, la garde à vue
s'était déroulée sans incident, encore, il n'y avait pas lieu de craindre une
volonté d'évasion ou tout acte préjudiciable à autrui ou à lui-même, enfin,
l'intéressé était calme et son avocat ne pouvait imaginer ce que Michel X...
allait faire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans
le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il résultait de l'ensemble
de ces circonstances que rien ne laissait supposer l'intention et la
détermination de Michel X... et que les modalités de l'entretien, qui en
assuraient la confidentialité et la dignité, n'étaient pas constitutives d'une
faute lourde imputable au service de la justice ; que le moyen ne peut être accueilli.
LA JUSTICE PEUT CONDAMNER SANS FAIRE DE CONFRONTATION AVEC LES ACCUSATEURS ET SANS ÉLÉMENTS MATÉRIELS
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 20 janvier 2010 N° de pourvoi 08-20157 Rejet
Attendu que M. X... a présidé
la fondation Y... du 15 mars 1981 au 8 avril 1993 ; qu'à la suite du dépôt par
Victor Z... (dit Y...) et ses deux fils de trois plaintes avec constitution de
partie civile, une information judiciaire a été ouverte ; que M. X... a été mis
en examen puis condamné par un arrêt définitif du 11 mai 2005 pour abus de
confiance, faux et usage de faux ; que M. X... ayant saisi le tribunal de grande
instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat, sur le
fondement des articles L. 781-1 du
code de l'organisation
judiciaire, devenu l'article L.
141-1 du même code,
et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en réparation d'une
faute lourde constituée par le fonctionnement défectueux du service de la
justice, cette juridiction l'en a débouté ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce
jugement ;
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième,
dixième, onzième moyens et la seconde branche du troisième moyen, ci-après
annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'absence de confrontation
entre M. X... et Victor Y... n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense
et à la notion de procès équitable car Victor Y... avait été entendu à deux
reprises par le juge d'instruction et que les accusations de l'artiste n'étaient
pas les seuls éléments d'un dossier comportant de très nombreuses investigations
dont des auditions de témoins, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les
parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'absence de
confrontation n'avait pas porté préjudice à M. X... ; que le grief ne peut être
accueilli.
LES CONSÉQUENCES POUR LES TIERS D'UNE FAUTE DE JUSTICE NE SONT PAS RÉPARABLES
COUR DE CASSATION, chambre civile 1, arrêt du 12 octobre 2011 N° de pourvoi 10-23288 Rejet
Attendu que M. X..., domicilié en Suisse, a fait l'objet de poursuites pénales pour fraude fiscale ; qu'un juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt qui n'a pu être exécuté en France ; que par jugement, rendu par défaut le 29 mars 2000, un tribunal l'a condamné à une peine d'emprisonnement et a confirmé le mandat d'arrêt qui a fait l'objet d'une diffusion internationale ; que M. X... a été interpellé le 17 octobre 2001 à Amsterdam et a été incarcéré pendant 17 jours ; que son extradition a été refusée au motif que la convention d'extradition ne s'appliquait pas en matière d'infractions fiscales ; que, sur opposition, le tribunal correctionnel de Grasse a réduit la peine prononcée et maintenu les effets du mandat d'arrêt ; qu'en cause d'appel, M. X... a contesté la régularité du mandat d'arrêt en soutenant que le juge d'instruction n'avait pas obtenu les réquisitions préalables du parquet et que celles-ci avaient été rajoutées ultérieurement sur l'ordonnance de soit-communiqué (pièce D 18) pour régulariser la procédure ; que par arrêt du 22 mars 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a cancellé la pièce coté D 18 dans sa seconde version, prononcé la nullité de l'ordonnance de renvoi et de tous les actes subséquents et constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription ; que M. X... et la société Constante Suisse avec laquelle celui-ci était en relations commerciales ont recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde du service public de la justice ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2010) d'avoir déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action de la société Constante Suisse à l'encontre de l'Etat français, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice ; que pour déclarer irrecevable la demande présentée par la société Constante Suisse, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'était pas partie à la procédure diligentée contre M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Constante Suisse invoquait un dommage par ricochet causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Constante Suisse était un tiers vis-à-vis de la procédure prétendument défectueuse dans laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a exactement décidé, dès lors que le préjudice invoqué n'était pas la conséquence directe de la faute alléguée, que la société Constante Suisse n'était pas recevable à agir au titre de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la société Constante Suisse de leurs demandes tendant à voir constater la faute lourde commise par le service public de la justice et à voir condamner l'Etat français, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, au paiement de la somme de 4 572 146, 49 euros tous chefs de préjudices confondus ;
Attendu que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, c'est à bon droit qu'ayant relevé que l'exercice des voies de recours, l'opposition, puis l'appel, avaient permis à M. X... de défendre ses droits et de rechercher tous éléments de nature à faire apparaître une faille de la procédure, laquelle avait été sanctionnée, ce qui avait permis à M. X... d'échapper à tout jugement définitif sur le fond au sujet de la fraude fiscale qui lui était reprochée, la cour d'appel a jugé que la demande de M. X..., au titre de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Constante Suisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
SI LE JUSTICIABLE NE FAIT PAS LES RECOURS POUR ÉVITER DE SE FAIRE CONDAMNER
AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC, IL NE PEUT OBTENIR RÉPARATION
Cour de cassation chambre civile 1 arrêt du 18 mai 2011 N° de pourvoi: 10-18050 Rejet
Attendu qu'à la suite d'un
différend portant sur la mise en conformité et la rénovation de locaux dont ils
étaient locataires commerciaux, les époux X... ont fait assigner les consorts
Y..., leur bailleur, devant le juge d'instance de Fougères qui, en référé, a
ordonné une mesure d'expertise ; qu'au vu du rapport, ils ont fait assigner les
consorts Y... devant un tribunal d'instance qui les a déboutés de leur demande
au motif que les travaux dont ils demandaient l'exécution, excessifs par rapport
à la valeur vénale de l'immeuble, revenaient à une véritable reconstruction ;
que par arrêt en date du 6 novembre 1986, la cour d'appel de Rennes a confirmé
ce jugement ; qu'en 1987, les locaux ont été endommagés au cours d'une tempête ;
que, par arrêt du 5 mars 1991, la cour d'appel de Rennes a condamné les
bailleurs à exécuter les travaux préconisés par l'expert et ce, à hauteur de 185
000 francs ; que par arrêt du 23 novembre 1993, la Cour de cassation a cassé
l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes et renvoyé la cause et les parties
devant la cour d'appel d'Angers qui, par arrêt irrévocable du 9 novembre 1995, a
déclaré irrecevable l'action des époux X... en raison de l'autorité de la chose
jugée qui s'attachait à l'arrêt prononcé le 6 novembre 1986 par la cour d'appel
de Rennes ; que les époux X... ont recherché la responsabilité de l'Etat pour
faute lourde du service public de la justice en se fondant sur une lettre du
président de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Rennes qui
reconnaissait le mauvais fonctionnement de cette juridiction en précisant que
les magistrats avaient hâtivement conclu à la ruine de l'immeuble sans en avoir
recherché la valeur réelle et ce, au vu d'une lettre du notaire des bailleurs ;
que, le 11 septembre 2002, la cour d'appel d'Angers a reconnu la faute lourde de
l'Etat en accordant aux époux X..., au titre d'une perte de chance de 50 %, une
somme de 344 400 euros ; que le 29 décembre 2006 les époux X... ont fait
assigner l'agent judiciaire du Trésor et le ministre de la justice pour voir
déclarer l'Etat responsable de la faute lourde commise le 11 septembre 2002 par
la cour d'appel d'Angers et obtenir le paiement de diverse sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
:
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs
demandes indemnitaires ;
Attendu que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission
dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice
des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement
allégué, la cour d'appel, qui a retenu que les époux X... tentaient de remettre
en cause, sans user de la voie de recours prévue à cet effet, ce qui avait été
jugé par la cour d'appel d'Angers, en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas
fondés à réclamer les indemnités qu'ils n'avaient pas obtenues devant cette cour
d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'étant saisie du fonctionnement défectueux du service de la justice
dans la procédure soumise à la cour d'appel d'Angers, la cour d'appel de Paris
ne pouvait se prononcer sur la faute lourde éventuellement commise par la cour
d'appel de Rennes qui constituait le fondement de la saisine de la cour d'appel
d'Angers ; que l'arrêt retient, à bon droit, que les époux X... n'étaient pas
fondés à solliciter la réparation de la perte de revenus après la retraite dès
lors qu'ils n'avaient pas présenté cette demande devant la cour d'appel d'Angers
et que, partant, aucun mauvais fonctionnement de la justice ne saurait être
retenu à ce titre ; que le moyen ne peut être accueilli
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 17 février 2010 N° de pourvoi 09-10319 Rejet
Attendu que les sociétés
Pagegie Chauprade et BAC, qui ont la même gérante, exploitent, chacune, un
commerce de parfumerie, la première à Tulle, la seconde à Ussel ; qu'elles ont
été victimes d'un vol commis selon le même mode opératoire ; que leurs assureurs
respectifs ont refusé de les indemniser en invoquant une clause identique dans
les deux contrats ; que par une décision irrévocable du 14 décembre 2004, la
société Axa a été condamnée à indemniser la société BAC, son assurée ; que par
arrêt du 30 octobre 2002 la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi
formé par la société Pagegie Chauprade contre l'arrêt d'une cour d'appel qui
l'avait déboutée de sa demande contre les Mutuelles du Mans, son assureur ; que
la société Pagegie Chauprade a recherché la responsabilité de l'Etat pour
fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Pagegie Chauprade fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges,
23 octobre 2008) de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, qu'en
refusant de constater que l'État avait engagé sa responsabilité à l'égard de la
SARL Pagegie Chauprade, dévalisée par des individus se faisant passer pour des
clients, et qui, demandant la condamnation de son assureur, les Mutuelles du
Mans dont la police prévoyait la garantie de l'assuré victime d'un vol commis
par des personnes qui se seraient introduites ou maintenues clandestinement dans
les locaux où se trouvent les biens assurés, avait été déboutée par un arrêt de
la cour d'appel de Limoges en date du 19 novembre 1998 et dont le pourvoi visant
à la cassation de cet arrêt refusant manifestement d'appliquer les termes clairs
du contrat d'assurance s'est soldé par une décision de non admission en date du
30 octobre 2002, déni de justice d'autant plus flagrant que, victime des mêmes
faits commis au même moment par les mêmes auteurs, la SARL BAC, obtenait, par
arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 20 janvier 2004, la condamnation
de son assureur, Axa, dont les termes de la police sont exactement identiques à
ceux de la Mutuelles du Mans, la cour d'appel de Limoges a violé, par refus
d'application, les articles L.
141-1 et L. 141-3 du code
de l'organisation judiciaire, ensemble l'article
4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la Cour de cassation n'avait pas eu à connaître
à l'occasion de la première procédure de la difficulté juridique tranchée par la
cour d'appel de Limoges dans l'autre instance opposant la compagnie Mutuelles du
Mans à la société Pagegie Chauprade, la cour d'appel a pu en déduire que la
circonstance que deux affaires identiques puissent être, en définitive, jugées
différemment n'était pas révélatrice d'une faute commise par les juridictions
mais n'était que la conséquence des règles de droit et procédurales applicables
; que le moyen ne peut être accueilli
SI LE JUSTICIABLE OBTIENT GAIN DE CAUSE EN APPEL IL Y A BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE !
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 4 novembre 2010 N° de pourvoi 09-15869 Rejet
Attendu que M. X..., notaire,
qui faisait l'objet de poursuites disciplinaires, a soulevé une exception de
nullité de l'assignation tirée de l'absence de communication de certaines pièces
servant de fondement aux poursuites ; que le tribunal de grande instance de
Brive-la-Gaillarde a, par jugement du 28 janvier 2000, rejeté l'exception de
nullité et prononcé la peine de "défense de récidiver" qu'après avoir ordonné,
en cause d'appel, la communication des pièces litigieuses, la cour d'appel de
Limoges a, par arrêt du 14 septembre 2000, rejeté la demande de nullité du
jugement et prononcé, à l'encontre de M. X..., la peine d'interdiction
temporaire d'exercice de la profession de notaire pendant six mois, peine qui a
été exécutée ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de
cassation du 13 novembre 2002 pour violation du principe du double degré de
juridiction en matière disciplinaire ; que la cour d'appel de Poitiers, désignée
comme cour de renvoi, a, par arrêt du 11 octobre 2005, prononcé la nullité de la
procédure postérieure à l'assignation introductive d'instance et renvoyé le
ministère public à mieux se pourvoir ; que M. X... a saisi le tribunal de grande
instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat, sur le
fondement de l'article L.
141-1 du code de l'organisation
judiciaire, en réparation d'une faute lourde constituée par le fonctionnement
défectueux du service public de la justice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 2009)
de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission
dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice
des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement
allégué, c'est à bon droit, qu'ayant relevé, par motifs propres, que le résultat
de l'exercice des voies de recours, favorable à M. X..., venait démontrer le bon
fonctionnement du service de la justice et, par motifs adoptés, que la cassation
prononcée démontrait le bon fonctionnement du service de la justice par
l'effectivité des voies de recours, la cour d'appel a jugé qu'aucune faute
lourde ne pouvait être imputée à ce service ; que le grief ne peut être accueilli
LES EXPERTS SONT QUANT A EUX MIS EN CAUSE POUR PROTÉGER LES MAGISTRATS
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du 4 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-69233 Cassation
Vu l'article
455 du code de procédure civile ;
Attendu que, par un arrêt confirmatif du 7 décembre 1999, M. X... a été condamné
pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans ; que le pourvoi
contre cet arrêt a été rejeté le 8 novembre 2000 ; que, par assignation du 10
mai 2005, M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement
défectueux du service public de la justice en faisant valoir qu'il avait appris,
tardivement, que les experts qui avaient examiné l'enfant avaient des liens
professionnels avec le père de celui-ci et ne pouvaient donc être impartiaux
Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que M. X... se
contente d'affirmer avoir recueilli les informations nécessaires à la mise en
cause des experts postérieurement au rejet de son pourvoi sans en apporter la
moindre preuve
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cause d'appel, M. X... avait produit des
articles de presse et deux attestations qu'elle
n'a pas analysés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé
LE MIS EN CAUSE PEUT ÊTRE UN NOTAIRE A LA PLACE D'UN MAGISTRAT
Cour de Cassation chambre civile 1, arrêt du 16 juin 2011 N° de pourvoi 09-70772 rejet
Attendu que, par acte du 14
mai 1998, M. X... a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor pour obtenir
réparation du préjudice résultant d'erreurs de jugement et d'un déni de justice
du fait de la procédure de liquidation et partage de la communauté de biens
dissoute par le divorce prononcé entre lui et son épouse par arrêt irrévocable
du 15 décembre 1982 ; que, par arrêt en date du 25 novembre 2003, la Cour
européenne des droits de l'homme a condamné l'État français, pour la période du
27 février 1985 au 8 décembre 1998, à payer à M. X... pour violation de l'article
6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice
moral, rejetant sa demande pour le surplus ; que, par arrêt du 15 mai 2004, la
cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes ; que par décision du 20 septembre
2006 (Civ. 1, pourvoi n° 04-17.498), cet arrêt a été cassé partiellement en ce
qu'il avait rejeté la demande au titre du déni de justice alors que la Cour
européenne des droits de l'homme n'avait indemnisé qu'une période limitée, et en
ce qu'il avait rejeté une demande au titre d'une faute lourde, motif pris d'une
dénaturation de pièces, la cassation ne s'étendant pas aux dispositions décidant
qu'aucune faute lourde ne saurait être reprochée à la cour d'appel pour son
arrêt du 15 décembre 1982, dès lors que c'était dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'appréciation qu'elle avait retenu la maison d'Hericy comme domicile
conjugal ;
Attendu que M X... fait grief à l'arrêt (Paris, 26 mai 2009) d'avoir condamné
l'agent judiciaire du Trésor à ne lui payer que la somme de 6 000 euros à titre
de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'inaptitude du service public
de la justice à remplir la mission dont il est investi doit être appréciée dans
la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais
fonctionnement allégué ; qu'en jugeant, au contraire, que les erreurs de
jugement dénoncées par M. X... n'auraient pas été susceptibles d'engager la
responsabilité de l'Etat au prétexte que l'appréciation des faits relève de la
mission des juges du fond et que le contenu des décisions de justice ne peut
être contesté que dans le cadre de voies de recours ouvertes à leur encontre, et
que M. X... a effectivement exercées, la cour d'appel a violé l'article
L. 781-1, devenu L. 141-1 du
code de l'organisation
judiciaire ;
Mais attendu qu'en énonçant que le partage de la communauté et l'exécution d'un
protocole établi à cet effet par un notaire ont été anormalement longs et
constitutifs d'un déni de justice, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a
fait sans encourir le grief du moyen, relatif un motif surabondant
UN MAGISTRAT JUGE COMMISSAIRE PEUT METTRE EN FAILLITE UN ENTREPRENEUR SANS ÊTRE INQUIÉTÉ
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 23 mars 2011 N° de pourvoi: 10-16831 Rejet
Attendu que M. X...,
exploitant agricole, a fait l'objet d'un redressement judiciaire simplifié ; que
le plan de redressement par voie de continuation dont il a bénéficié a été
résolu le 4 août 1992, M. X... étant autorisé à poursuivre son activité jusqu'au
15 février 1993 ; qu'entre temps, il a transmis son cheptel à M. Y... qui
souhaitait reprendre l'exploitation mais n'a pas obtenu le transfert des quotas
laitiers à son nom ; que M. Z... qui assurait la collecte du lait a cessé de le
faire le 3 juin 1992 ; que, par requête du 19 octobre 1992, M. X... a demandé au
juge-commissaire de l'autoriser à exiger l'exécution du contrat de collecte de
lait par M. Z... ; que par ordonnance du 29 janvier 1993, le juge-commissaire a
sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal se fût prononcé sur la requête en
extension du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de M. X... à M. Y... et
en confusion de leur patrimoine ; qu'après la clôture de la liquidation
judiciaire de MM. X... et Y... pour insuffisance d'actif, M. X... a recherché la
responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la
justice "à raison de la décision abusive et infondée du juge-commissaire en date
du 29 janvier 1993 ordonnant un sursis à statuer ayant conduit à sa première
liquidation judiciaire" ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 16
décembre 2008) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu qu'ayant relevé que la nécessité d'éclaircir, préalablement à l'examen
de la requête qui était soumise au juge-commissaire, la situation des parties en
cause au regard de la réglementation des quotas laitiers, M. X... ayant réalisé
son cheptel vif et s'étant substitué, en qualité de producteur laitier, M. Y...
à qui M. Z... payait le lait collecté, ressortait de la procédure et des pièces
produites, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de sursis à statuer
ne pouvait constituer une erreur manifeste d'appréciation de nature à constituer
une faute lourde ; que le moyen ne peut être accueilli
UN TRIBUNAL DE COMMERCE PEUT ÊTRE RESPONSABLE S'IL N'Y A PAS DE MAGISTRATS PROFESSIONNELS
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du jeudi 4 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-12547 Cassation
Attendu que M. X..., commerçant, a été placé en règlement judiciaire en 1983 et a obtenu un concordat en 1987 ; qu'un jugement du 19 janvier 1993, qualifié contradictoire en dépit de l'absence de convocation de M. X... et assorti de l'exécution provisoire, a prononcé la résolution du concordat et la liquidation des biens du débiteur ; qu'après que des opérations de liquidation ont été entreprises, une ordonnance du 1er avril 1993 a suspendu l'exécution provisoire et un arrêt du 15 décembre 1993 a annulé le jugement ; que, M. X... ayant intenté une action fondée sur les dispositions de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait du prononcé irrégulier de la liquidation judiciaire, un arrêt du 17 janvier 2002, retenant l'existence d'une faute lourde, a condamné l'Etat à lui verser deux sommes au titre du préjudice moral et de la perte de chance ; qu'un arrêt du 11 janvier 2005 (Civ., 1re, Bull. civ. I, n° 20) a cassé et annulé l'arrêt du 17 janvier 2002 ; qu'un arrêt du 3 avril 2006, rendu sur renvoi après cassation, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; que, par arrêt du 13 mars 2007 (Civ., 1re, n° 06-15. 681) la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, dans une lettre du 14 octobre 1992 adressée au ministre du budget, le député qui intervenait en faveur de M. X... écrivait que celui-ci semblait dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes demandées pour l'impôt sur le revenu et qu'il souhaiterait un sursis de paiement et mentionnait la condamnation de M. X... pour fraude fiscale par un jugement du 28 février 1990, confirmé en appel, d'autre part, que le commissaire à l'exécution du concordat avait indiqué que l'admission complémentaire du Trésor était confirmée et portée à 1 287 206 francs à titre privilégié et que cette situation réduisait à néant le concordat initial puisque l'intégralité des fonds disponibles serait absorbée par cette administration et que tout espoir était désormais perdu pour le débiteur de pouvoir honorer ses engagements, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter ses engagements concordataires, inexécution qui, justifiait, à elle seule, la résolution du concordat, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la perte de chance de pouvoir faire état de négociations menées avec l'administration fiscale et de l'éventualité d'une issue favorable, l'arrêt retient que le dégrèvement accordé le 10 octobre 1995 ne résulte pas de la pertinence des arguments de M. X... quant à ses capacités à faire face à ses échéances, mais seulement d'un retournement tout à fait inexplicable, surtout après de longues procédures allant toutes dans le même sens, du Trésor public ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les négociations dont M. X... n'a pas pu faire état devant le tribunal de commerce ont eu une issue favorable, et ce, quelles qu'en soient les raisons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés
LES PRISONS FRANCAISES INSALUBRES SONT SANCTIONNÉES
CAR LA FAUTE EST DUE AUX MOYENS DONNÉS A LA JUSTICE MAIS NON A UN MAGISTRAT
Cour de cassation Commission de réparation des détentions décision du 25 juin 2012 N° de pourvoi: 12CRD001 Accueil du Recours
Attendu que M. X... a été détenu
pour autre cause à compter du 28 mai 2009
Que la période de détention indemnisable court du
11 décembre 2008 au 28 mai 2009
Que les motifs pour lesquels M. X... suppose avoir été maintenu en
détention lors de la procédure d'instruction sont
sans portée sur l'appréciation du préjudice moral subi
Que ne sont pas prises en considération dans l'évaluation de ce préjudice, les
conséquences des poursuites pénales dont l'intéressé a pu faire l'objet en
raison d'une infraction commise dans l'établissement pénitentiaire
Que M. X... n'avait jamais été incarcéré auparavant ; qu'il a été détenu au Camp
Est à Nouméa, un établissement dont l'insalubrité et le taux d'occupation
particulièrement élevé ont été constatés par le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté qui, en publiant le 6 décembre 2011 ses recommandations au
sujet de la prison de Nouméa, a dénoncé une "violation grave des droits
fondamentaux des détenus"
Que ces conditions de détention, que M. X... a
nécessairement subies à titre personnel, doivent être prises en considération
dans l'appréciation du préjudice moral qu'elles ont incontestablement contribué
à aggraver
Qu'il y lieu d'allouer à M. X... la somme de 12 400 euros
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile
Cour de cassation Commission de réparation des détentions, décision du lundi 25 juin 2012 N° de pourvoi: 12CRD002 Accueil du Recours
Attendu que le premier président a pris avec pertinence en considération la durée de la détention, et la circonstance que l'intéressé a été privé d'assister à la naissance de son enfant, intervenue au cours de la détention
Attendu qu'il ne résulte pas du casier judiciaire de M. X... que les courtes peines qui y sont mentionnées aient été exécutées et que dès lors M. X... ait eu une connaissance du milieu carcéral préalable à son placement en détention
Que M. X... a été détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dont la vétusté et le taux d'occupation élevé ont été dénoncés dans le rapport remis au Sénat le 28 juin 2000 par la commission d'enquête sur " Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France ", et le rapport remis le 28 juin 2000 à l'Assemblée Nationale par la commission d'enquête sur " La situation dans les prisons françaises ", concomitants à la période de détention subie par M. X...
Que ces conditions de détention, que M. X... a nécessairement subies à titre personnel, doivent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral qu'elles ont incontestablement contribué à aggraver
Que le préjudice moral subi sera plus justement réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros
LA DÉTENTION ARBITRAIRE EST DIFFICILEMENT RÉPARÉE
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites
- LA DÉTENTION ARBITRAIRE N'EST PAS RÉPARÉE
- LA DÉTENTION INUTILE AVANT RELAXE OU ACQUITTEMENT EST TRÈS DIFFICILEMENT RÉPARÉE
LA DÉTENTION ARBITRAIRE N'EST PAS RÉPARÉE
LE DROIT FRANÇAIS PRÉVOIT LA RÉPARATION D'UNE DÉTENTION ARBITRAIRE
La constitution française prévoit en son article 66 :
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
L'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 faisant partie de la constitution française prévoit :
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
L'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 édicte :
"Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution."
La LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 prévoit un nouvel article 800-2 dans le code de procédure pénale mais sans être assez large pour réparer les détentions abusives ou arbitraires.
Article 800-1 du code de procédure pénale
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'État
Article 800-2 du code de procédure pénale
A la demande de l'intéressé, toute juridiction
prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à
la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci.
Cette indemnité est à la charge de l'État. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par cette dernière.
Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
DANS LES FAITS, LA DÉTENTION ARBITRAIRE N'ETAIT PAS RÉPARÉE
COUR DE CASSATION 10 CRD 047 Arrêt du 20 décembre 2010 QPC Non-lieu à transmission
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale,
composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Leroy-Gissinger, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec
l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par Mme Muriel X...
A l'occasion du recours formé par elle contre la décision du premier président
de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2010
Vu la communication faite à la SCP Ancel-Couturier-Heller, avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation
Vu la communication faite au procureur général
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller référendaire, les observations de Me
Lyon-Caen, avocat assistant Mme X..., celles de Mme X..., comparante, et de Me
Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les
conclusions de M. l'avocat général Charpenel, la demanderesse ayant eu la parole en dernier
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 11 mai 2010, le premier président de la cour d'appel
de Paris a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité et
la demande d'indemnisation présentée par Mme Muriel X... à raison d'une
détention provisoire effectuée du 20 au 21 avril 2008 pour des faits d'outrages
à personnes chargées d'une mission de service public et d'appels téléphoniques
malveillants ayant donné lieu à un jugement de condamnation à une amende
délictuelle de 500 euros ; que celle-ci a formé un recours contre cette décision
et, par des écritures du 19 juillet 2010, a demandé une indemnité de 15 000
euros en réparation du préjudice lié à la détention et sollicité la saisine du
Conseil constitutionnel en invoquant l'inconstitutionnalité des
articles R. 26 et R. 40-3 du
code de procédure pénale
Que son conseil a déposé le 22 novembre 2010 un mémoire distinct posant une
question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que les dispositions de
l'article 149 du code
de procédure pénale contreviennent au droit à la réparation tel qu'il résulte de
l'article 4 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles limitent ce droit aux personnes
ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement et écartent, en
méconnaissance de l'exigence constitutionnelle de proportionnalité des peines
tirée de l'article 9 du même texte, le cas, tel le
sien, des personnes condamnées en définitive à une faible peine révélant le
caractère injustifié de l'emprisonnement préalablement subi
Qu'enfin, par lettre du 2 décembre 2010, elle a mis en cause la
constitutionnalité des articles 706-55 et 706-56
du code de procédure pénale, en visant des griefs
concernant notamment l'inscription au fichier national des empreintes
génétiques, les conditions de la garde à vue et la procédure de flagrance
Attendu que la commission, qui statue en tant que juridiction civile, est une
juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l'article
23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité du 19 juillet 2010,
inscrite dans des conclusions en demande, n'a pas été présentée dans un écrit
distinct, et comme telle, n'est pas recevable ; que par ailleurs la lettre du 2
décembre 2010 invoque l'inconstitutionnalité de dispositions inapplicables au
litige
Attendu qu'en ce qui concerne le mémoire du 22 novembre 2010, la disposition qui
y est contestée est applicable au litige, lequel concerne l'indemnisation de Mme
Muriel X... à la suite d'une détention provisoire
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil
constitutionnel
Mais attendu que la question posée est dépourvue de caractère sérieux en ce que
l'article 149 du code
de procédure pénale instaure un régime spécifique d'indemnisation sans faute,
qui n'est pas exclusif du droit de rechercher la responsabilité de l'Etat du
fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, en application des
dispositions de l'article L.
141-1 du code de l'organisation
judiciaire, et ne méconnaît pas ainsi l'exigence constitutionnelle posée par l'article
4 de la Déclaration des droits de l'homme
Qu'enfin les griefs pris de la méconnaissance de l'article
9 de ladite Déclaration tendent en réalité à contester les dispositions législatives relatives à la détention provisoire, non le droit à indemnisation
consacré par l'article 149 du code de procédure pénale
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION CONTREDIT LES MOTIVATIONS DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE
COUR DE CASSATION 1ere chambre civile, arrêt du 20 juin 2012, pourvoi n° 11-12531 Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait pas exercé, au moment de son arrestation et devant le tribunal correctionnel, toutes les voies de recours que la loi mettait à sa disposition pour établir le caractère prétendument irrégulier de son arrestation et, par motifs adoptés, que les appréciations divergentes du tribunal et de la cour d'appel sur l'opportunité de le maintenir en détention étaient l'expression de l'effectivité du principe du double degré de juridiction, dont la mise en œuvre avait permis de réparer le dysfonctionnement allégué, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des faits invoqués pour établir celui-ci, en a déduit que la faute lourde imputée par M. X... au service public de la justice n'était pas caractérisée qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
Grâce à fbls.net, les choses évoluent peut être enfin, pour que la justice française puisse rejoindre dignement les services publics de justice des sociétés démocratiques.
Une décision du 6 juin 2016 rendue par la première présidence de la Cour d'Appel de Paris sur un recours, introduit au sens de l'article 149 du Code de Procédure pénale, est rejeté mais le magistrat délégué prend soin de prescrire au demandeur de former le recours au sens de l'article L 141-1 du COJ. Il reste au TGI de Paris de suivre, si les magistrats qui forment le tribunal sont assez courageux !
La décision du 6 juin 2016 Binguimandji contre l'agent judiciaire de l'État est au format PDF.
LA COUR DE CASSATION ACCEPTE LA REPARATION D'UN INTERNEMENT PSYCHIATRIQUE ABUSIF
COUR DE CASSATION 1ere chambre civile, arrêt du 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.837 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2018), que M. X... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département, prise sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ; qu’invoquant plusieurs irrégularités affectant notamment les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 ainsi que l’absence de mainlevée de la mesure malgré des décisions judiciaires tardives, M. X... et sa compagne, Mme Y..., ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation de leur préjudice né de l’atteinte portée à la liberté du patient par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’Agent judiciaire de l’Etat fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. X... une indemnité de 50 930 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros au titre du traitement sous contrainte, et à payer à Mme Y... une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral à raison de l’hospitalisation illégale de M. X... du 12 juin au 30 octobre 2012
Mais attendu que l’arrêt énonce exactement qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, et des dispositions transitoires de l’article 18 de cette loi que si le juge administratif est demeuré compétent pour statuer sur les recours à l’encontre de toute décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte dont il aurait déjà été saisi avant le 1er janvier 2013, le juge judiciaire, saisi, à compter de cette date, d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé de telles décisions, peut connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées, dès lors qu’elles n’ont pas été préalablement soumises au contrôle du juge administratif ; qu’il s’en déduit qu’en retenant la compétence du juge judiciaire, lequel ne statue pas alors sur une exception d’illégalité, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche inopérante, n’a pas méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l’Agent judiciaire de l’Etat fait le même grief à l’arrêt,
Mais attendu que l’article L. 3216-1 du code de la santé publique ne subordonne pas la réparation des conséquences dommageables d’une décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte à l’exercice préalable par l’intéressé des voies de recours lui permettant de contester la légalité de cette décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que l’Agent judiciaire de l’Etat fait le même grief à l’arrêt,
Mais attendu que l’arrêt relève, d’une part, que le préfet ne justifie pas de la compétence, par délégation, de l’auteur de l’arrêté du 9 octobre 2012, d’autre part, que cette décision, malgré l’annexion d’un certificat médical, ainsi que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin et 10 juillet 2012 sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de s’assurer que la personne présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; qu’ayant ainsi caractérisé les irrégularités aux conséquences dommageables affectant ces décisions à l’origine des soins contraints, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X... pouvait prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée et Mme Y..., à l’indemnisation de son préjudice moral ; que le moyen, qui critique en ses deux premières branches des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
LA DÉTENTION INUTILE EST TRÈS DIFFICILEMENT RÉPARÉE
Les indemnisations les plus importantes versées pour des détentions inutiles soit une détention provisoire avant jugement de relaxe ou d'acquittement concernent uniquement : Loïc Sécher (environ 800 000 euros pour sept ans passés en prison), Patrick Dils (un million d’euros pour quinze ans en prison) à partager entre lui et sa famille et Marc Machin (663 000 euros pour sept ans de prison). La France peine toujours à indemniser les détentions provisoires.
En 2018, la somme totale de réparation des détentions avant jugement dites inutiles est de 10 000 000 euros partagée entre 500 prévenus, soit une moyenne de 20 000 euros chacun.
La réparation n'est accordée que pour un non lieu, une relaxe ou un acquittement complet et définitif.
Article 149 du Code de Procédure Pénale
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
UNE DÉTENTION DE 4 ANS 1 MOIS ET 26 JOURS, EST INDEMNISÉE 174 000 EUROS, LA RÉPARATION DU HANDICAP SUBI DURANT LA DÉTENTION
COUR DE CASSATION 16 CRD 042 Arrêt du 13 juin 2017 Accueil du recours
Attendu que M. X..., né en 1978, de nationalité somalienne, a été placé en détention provisoire le 18 avril 2008 à la suite de sa mise en examen des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes commis en bande organisée, vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ; qu’il a été renvoyé devant la cour d’assises de Paris le 16 mars 2011 puis acquitté par arrêt du 14 juin 2012, devenu définitif ;
Que le premier président de la cour d’appel de Paris, saisi par requête déposée le 23 juillet 2012, a alloué à M. X..., par décision du 5 novembre 2012, une indemnité de 90 000 euros en réparation du préjudice moral, de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel et a ordonné une expertise médico-psychologique, avant dire droit sur une demande distincte d’indemnisation d’un préjudice corporel ;
SUR CE,
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que, par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’Etat réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées ;
Sur le grief de nullité des rapports d’expertise :
Attendu que ce grief, présenté in limine litis devant la commission nationale, constitue une défense au fond qui peut être soulevée en tout état de cause, le rendant comme tel, recevable ;
Attendu que, selon l’article 149 du code de procédure pénale, le préjudice précité est, à la demande de l’intéressé, évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants du même code ;
Que selon l’article 164 de ce code, les médecins ou psychologues experts peuvent procéder à l’examen du demandeur hors la présence du juge et des avocats ;
Qu’il résulte de ces textes, qui ne renvoient pas à l’article 10 du code de procédure pénale, que l’expert commis aux fins d’examen médico-psychologique du demandeur n’est pas tenu de convoquer les parties aux opérations d’expertise ;
Attendu que la décision du 5 novembre 2012 ordonnant l’expertise ne demandait pas à l’expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif ; que la décision ordonnant l’expertise complémentaire en a en revanche demandé un, lequel a été régulièrement déposé par l’expert ; qu’ainsi les dispositions de l’article 167-2 du code de procédure pénale n’ont pas été méconnues ;
Que la contradiction a pu s’exercer dans les formes de droit, les conclusions expertales ayant été communiquées aux parties qui ont pu présenter leurs observations ;
Qu’en conséquence le grief de nullité des rapports d’expertise n’est pas fondé ;
Sur le préjudice corporel :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise initial que la détention a provoqué chez M. X... une psychose carcérale accompagnée d’un état dépressif réactionnel et que, si la prise en charge psychiatrique a permis une amélioration, des troubles ont persisté après la libération ; que l’expert a conclu le 6 février 2014 à l’existence d’un état séquellaire constitutif d’une atteinte permanente et définitive à l’intégrité psychique du demandeur ;
Que ni l’expertise complémentaire ni aucun autre élément ne contredit les conclusions initiales de l’expert selon lesquelles le déficit fonctionnel permanent était acquis ;
Attendu que l’expert a fixé la date de consolidation au 24 octobre 2013 et évalué à 30 % le taux du déficit fonctionnel permanent, par comparaison de plusieurs barèmes d’évaluation, pour approcher au mieux la situation de M. X... ; qu’au vu de cet avis, l’indemnité de 84 000 euros allouée par le premier président constitue une juste indemnisation du préjudice corporel subi ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... qui, seul, a frappé de recours la décision du 5 novembre 2012 lui allouant une indemnité de 90 000 euros en réparation du préjudice moral, n’en conteste plus le montant qui ne peut dès lors qu’être maintenu ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’allouer au requérant une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la commission nationale ;
Article 149-1 du Code de Procédure Pénale
La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article 149-2 du Code de Procédure Pénale
Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.
Article 149-3 du Code de Procédure Pénale
Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Article 149-4 du Code de Procédure Pénale
La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'État.
Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.
Article 150 du Code de Procédure Pénale
La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'État, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
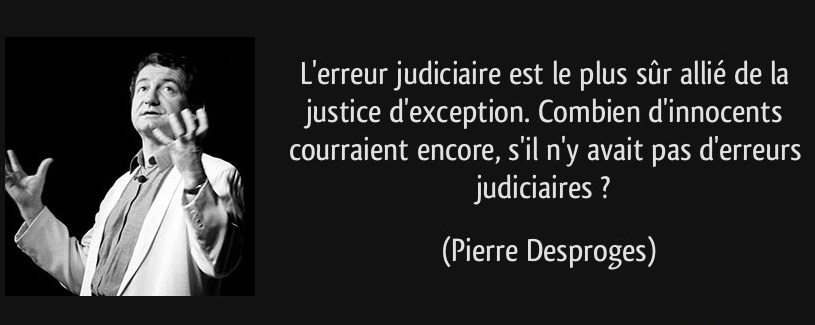
Si un prévenu est relaxé de plusieurs infractions mais condamné pour une seule, il est fait un calcul, si l'infraction pour laquelle il est condamné permet le placement en détention préventive, il n'a pas droit à réparation, si l'infraction retenue ne permet pas la mise en détention provisoire, il n'a droit qu'à une petite réparation.
COUR DE CASSATION 16 CRD 055 Arrêt du 13 juin 2017 Rejet
Attendu que M. Mickaël X... a été placé en détention provisoire le 4 octobre 2013 après avoir été mis en examen des chefs de vol avec arme, vols aggravés et destruction de bien par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive ; qu’il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 février 2015 :
Qu’au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu partiel, abandonnant notamment les poursuites criminelles, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l’a condamné le 16 avril 2015, pour vol en réunion en récidive, à seize mois d’emprisonnement ;
Que par requête déposée le 26 novembre 2015, M. X... a sollicité une indemnité en réparation du préjudice moral résultant de la détention provisoire subie au-delà du maximum légal autorisé pour le délit dont il a été déclaré coupable ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Mais attendu que par le premier de ces textes, le législateur exclut expressément le droit à réparation lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause ;
Et attendu qu’après avoir été placé en détention provisoire, M. X... a exécuté, du 8 novembre 2013 au 3 septembre 2014, deux peines définitives résultant de condamnations pour d’autres faits, peu important que cette circonstance l’ait privé d’un hypothétique aménagement, de sorte que leur durée d’exécution est exclue de la détention provisoire subie, laquelle se cantonne ainsi à six mois et six jours ;
Attendu qu’il résulte du même texte que lorsqu’une personne, placée en détention provisoire du chef de plusieurs infractions, ne bénéficie d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement que pour certaines d’entre elles et se trouve condamnée pour le surplus, la détention provisoire subie n’est indemnisable qu’autant qu’elle excède la durée maximale de détention provisoire que la loi autorise pour l’infraction retenue ;
Qu’ayant subi une détention provisoire effective de six mois et six jours, alors que la détention provisoire maximale autorisée pour le délit de vol aggravé en récidive dont il a été reconnu coupable était d’un an, M. X... n’est pas éligible à une indemnisation ;
Qu’en conséquence, le recours doit être rejeté ;
COUR DE CASSATION 07 CRD 089 Arrêt du 14 avril 2008 Rejet
Attendu que, lorsqu’un demandeur, placé en détention provisoire du chef de plusieurs infractions, ne bénéficie d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement que pour certaines d’entre elles, la compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention provisoire subie s’apprécie en tenant compte de la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l’infraction retenue ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier pénal que M. X... a été mis en examen puis placé et maintenu en détention provisoire des chefs d’agression sexuelle sur mineur, par ascendant, et violences volontaires, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur conjoint ; que, par jugement du tribunal correctionnel du 5 septembre 2006, devenu définitif, il a été relaxé pour le premier de ces délits et condamné, pour le second, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve d’une durée de dix huit mois ;
Attendu que le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et commis sur la personne du conjoint, prévu et réprimé par l’article 222-12 du code pénal, autorisait le placement en détention provisoire de M. X..., pour une durée de quatre mois, en application des articles 143-1 et 145-1 du code de procédure pénale ; que la détention provisoire subie par l’intéressé n’a pas excédé cette durée
Si la qualification des faits est grave et permet une détention mais qu'au cours de la procédure, cette qualification est abandonnée pour une autre qualification qui ne permet pas la détention dite provisoire, le prévenu n'a pas droit à réparation.
COUR DE CASSATION 08 CRD 032 Arrêt du 15 décembre 2008 Rejet
Attendu que Mme N... X... n’a bénéficié ni d’une décision de non-lieu, ni d’un jugement de relaxe pour les faits de violation du secret professionnel, qualifiés initialement de corruption passive aggravée, du chef desquels elle avait été mise en examen ; que, si c’est par des motifs inopérants, tenant à la durée de la peine encourue, que le premier président a déclaré irrecevable la requête présentée par Mme X... aux fins d’obtenir réparation à raison de la détention provisoire qu’elle a subie, le recours de l’intéressée contre cette décision ne peut qu’être rejeté ;
Qu’en effet, la commission n’a pas le pouvoir d’étendre le droit à réparation à des hypothèses non prévues par le législateur, telle celle d’une personne qui a subi une détention provisoire en raison de sa mise en examen sous la qualification d’un délit qui autorisait cette mesure de sûreté et qui, après disqualification des faits, est condamnée pour avoir commis une infraction pour laquelle la loi interdisait son incarcération
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.