ARTICLE 3 DE LA CEDH
Pour plus de sécurité, fbls violence policière est sur : https://www.fbls.net/3violencepolice.htm
"Les violences non proportionnées de la police peuvent être subies par
tous"
Frédéric Fabre docteur en droit.
Article 3 de la Convention
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"
Cliquez
sur un bouton ou un lien bleu pour accéder gratuitement à la JURISPRUDENCE DE LA CEDH :
- LES VIOLENCES POLICIÈRES LORS D'UNE ARRESTATION
- LES VIOLENCES POLICIÈRES CONTRE UNE FAMILLE
- UNE PERQUISITION PEUT ÊTRE UNE VIOLENCE POLICIÈRE CONTRE UNE FAMILLE
- LES VIOLENCES POLICIÈRES DURANT LES MANIFESTATIONS
- LE PORT DES MENOTTES
- LES VIOLENCES POLICIÈRES DURANT UN CONTRÔLE D'IDENTITÉ
- LES AUTORITÉS DOIVENT FAIRE UNE ENQUÊTE EFFECTIVE SUR LES VIOLENCES DE LA POLICE
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH
BAMBAYEV c. RUSSIE du 7 octobre 2017 requête 19816/09
"55. (-) En effet, compte tenu de l’absence en l’espèce de tout élément démontrant la nécessité de recourir à la force à l’égard du requérant, les coups de matraque qui lui ont été assenés à plusieurs occasions et avec acharnement s’analysent purement et simplement en un acte de représailles ou en un châtiment corporel. La violence gratuite à laquelle les agents pénitentiaires ont délibérément eu recours était destinée à susciter chez le requérant des sentiments de peur et d’humiliation propres à briser sa résistance physique et morale. Ces traitements avaient pour but de le rabaisser et de le contraindre à la soumission. De plus, les coups de matraque ont dû lui causer des souffrances physiques et morales intenses.
56. En conclusion, eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les mauvais traitements subis par le requérant dans le cadre des faits du 1er janvier 2009 doivent être qualifiés de torture au sens de l’article 3 de la Convention et qu’il y a donc eu violation de cette disposition."
Cliquez sur l'un des boutons ci-dessous pour accéder aux actes inhumains et dégradants.
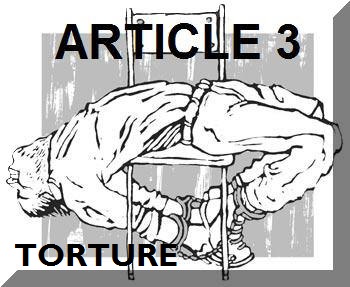


LES VIOLENCES POLICIÈRES LORS D'UNE ARRESTATION
Bouras c. France du 19 mai 2022 requête n o 31754/18
Article 2 : Recours à la force armée par un gendarme sur une personne détenue agressant sa collègue lors de son transfèrement de la maison d’arrêt au tribunal : absence de violation de l’article 2 de la Convention
Art 2 (matériel) • Recours à la force • Usage de l’arme à feu justifiée et absolument nécessaire par un gendarme ayant abouti au décès d’un détenu qui agressait sa collègue dans le véhicule au cours de son transfèrement • Absence de manquement aux règlements
L’affaire concerne, au regard du volet matériel de l’article 2 de la Convention, le recours à la force armée par un gendarme ayant entraîné le décès d’un détenu, au cours du transfèrement de celui-ci et alors qu’il agressait sa collègue dans le véhicule qui le transportait de la maison d’arrêt de Strasbourg au tribunal de grande instance de Colmar. La Cour considère, à l’instar des juridictions nationales, dont elle relève que décisions sont particulièrement motivées, que le gendarme a agi avec la conviction honnête que la vie de sa collègue était menacée et qu’il croyait sincèrement qu’il était nécessaire de recourir à la force armée. La sincérité et l’honnêteté de cette conviction n’a pas été remis en cause lors de l’enquête. Elle note que la décision d’utiliser l’arme a été prise après des sommations et alors que les autres tentatives pour faire cesser l’agression avaient échoué. Le danger encouru par les gendarmes a été confirmé par l’expertise balistique, dont les conclusions ont été reprises par la chambre de l’instruction. Constatant que l’enquête administrative de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale avait conclu à l’absence de manquement aux règlements, de même, la Cour estime, de même, qu’on ne saurait considérer que l’opération n’a pas été préparée et contrôlée de manière à réduire autant que possible tout risque pour la vie du détenu ainsi que pour celle des gendarmes. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour conclut que la décision du gendarme de faire usage de son arme à feu pouvait passer pour être justifiée et absolument nécessaire « pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale », au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention.
FAITS
Les requérants, Mme Fatiha Bouras, née Rabah, et M. Bouamama Bouras sont deux ressortissants respectivement français et algérien, nés en 1960 et résidant à Colmar et à Châtellerault. Ils sont les parents de H.B., décédé le 26 août 2014 des suites d’un coup de feu tiré par un gendarme en réaction à l’agression violente de sa collègue, lors de son transfèrement au tribunal. Le 26 août 2014, lors de son transfèrement de la maison d’arrêt de Strasbourg-Elsau au tribunal de grande instance de Colmar, le fils des requérants, H.B, âgé de vingt-trois ans, décéda des suites d’un coup de feu tiré avec son arme de service par l’un des deux membres de son escorte, le gendarme adjoint volontaire M.G., sa collègue, M.R., cheffe de l’escorte, ayant été soudainement agressée et désarmée par lui alors qu’elle se tenait à ses côtés, à l’arrière du véhicule, lors du trajet sur l’autoroute.
Le jour même, le procureur de la République diligenta une enquête confiée à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). M.G. fut placé en garde à vue et auditionné à quatre reprises. M.R. fut entendue comme témoin à deux reprises. L’examen médico-légal réalisé sur M.R. juste après les faits révéla des contusions, des ecchymoses et des dermabrasions sur le tronc, les membres supérieurs et inférieurs, une tuméfaction de la pommette droite, plusieurs traces linéaires compatibles avec des lésions de griffures. L’un des boutons de son polo, ensanglanté, fut retrouvé au sol. Les investigations se poursuivirent dans le cadre d’une instruction ouverte le 28 août 2014, par le procureur de la République, du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises par un dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions. Outre l’audition de plusieurs témoins, une autopsie et une expertise anatomo-pathologique furent réalisées, ainsi qu’un examen balistique. Une expertise génétique permit de déceler plusieurs traces de l’ADN de H.B. sur l’arme de service de M.R. et son étui. Le juge d’instruction joignit au dossier de l’information judiciaire l’enquête administrative réalisée par l’IGGN sur les conditions du transfèrement. Cette enquête conclut à l’absence de manquement aux règlements applicables et suggéra quatre recommandations pour l’avenir. Dans son réquisitoire définitif du 24 novembre 2015, le procureur de la République requit un nonlieu à poursuivre, au motif que M.G. était en état de légitime défense au bénéfice de M.R. Le 19 janvier 2016, le vice-président chargé de l’instruction rendit une ordonnance de non-lieu au motif que M.G. se trouvait en état de légitime défense lorsqu’il avait tiré sur H.B. Il considéra que face à l’attaque subie par M.R. et au danger de mort imminent qu’elle encourait compte tenu des tentatives répétées de H.B. de s’emparer de son pistolet approvisionné et chargé, la riposte de M.G. était proportionnée et absolument nécessaire. Il releva, notamment, que l’examen médical réalisé sur M.R. et la découverte du bouton ensanglanté de son vêtement au sol confirmaient la violence des coups qu’elle avait subis ; que le nombre et l’emplacement des traces de l’ADN de H.B. sur l’étui et l’arme de M.R. caractérisaient une préhension volontaire de cette arme de sa part ; que les constatations médico-légales confirmaient la version de M.G. selon laquelle il avait tenté par d’autres moyens, en plus de sommations, de faire lâcher prise H.B, par l’usage de sa force physique, puis du bâton de défense. Le requérant interjeta appel de l’ordonnance de non-lieu. La requérante n’exerça pas son droit de recours. Par un arrêt du 8 septembre 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar confirma l’ordonnance de non-lieu. Par un arrêt en date du 9 janvier 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant.
Article 2
La Cour relève qu’il ressort des éléments de l’enquête qu’au cours de son transfèrement de la maison d’arrêt de Strasbourg-Elsau au tribunal de grande instance de Colmar, H.B. a agressé le membre de l’escorte de la gendarmerie, M.R., qui se tenait à ses côtés à l’arrière du véhicule, essayant à plusieurs reprises de saisir son arme de service qui était approvisionnée en munitions et chargée. En conséquence, les juridiction internes ont examiné la question de savoir si l’action du gendarme M.G. avait pour but d’assurer la défense d’une personne, sa collègue M.R., contre la violence illégale de H.B. au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention. La Cour note que les déclarations des deux gendarmes, M.R. cheffe de l’escorte et M.G., gendarme adjoint volontaire, sont corroborées par des examens techniques en matière balistique, génétique et médico-légale. S’agissant de la réalité de l’agression commise par H.B. sur M.R., la Cour relève qu’outre la découverte sur le sol d’un bouton ensanglanté provenant du haut du vêtement de M.R., l’examen médico-légal réalisé juste après les faits a permis de constater des contusions, des ecchymoses, des dermabrasions, ainsi que des traces de coups et de griffures sur le corps de M.R. La crédibilité des déclarations de l’intéressée, décrivant notamment les violences subies par une « pluie de coups », a également été confirmée par l’expert médico-légal qui, lors de reconstitution des faits, a déclaré ses propos compatibles avec les constatations initiales et le rapport du médecin légiste qui l’avait examinée. La Cour constate ensuite qu’une expertise génétique a permis de détecter plusieurs traces de l’ADN de H.B. sur l’étui du pistolet de M.R. et sur de nombreuses parties de l’arme ellemême, ce qui atteste du fait que H.B. ait effectivement tenté de s’en saisir. Un tel constat a légitimement pu conduire le juge d’instruction à en déduire que cela caractérisait la préhension volontaire de l’arme de M.R. par H.B. De plus, la Cour observe que les investigations ont permis d’établir qu’avant d’effectuer le tir qui s’est avéré mortel, M.G. a vainement tenté, à plusieurs reprises, de mettre fin à l’agression de sa collègue par des moyens non létaux, qu’il s’agisse des sommations, du recours à la force physique ou de l’usage d’un bâton de défense. En outre, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar a expressément constaté que l’usage de la bombe lacrymogène par M.G. dans les circonstances de l’espèce lui aurait fait courir le risque d’asperger sa collègue et lui-même en retour, ce qui n’aurait vraisemblablement pu qu’aggraver la situation dans laquelle ils se trouvaient. La Cour souligne le fait que le gendarme M.G. a dû intervenir à la suite d’une agression aussi vive qu’impromptue, l’obligeant à réagir sans préparation, d’autant plus qu’en sa qualité de gendarme adjoint volontaire, il n’avait pas l’expérience d’un gendarme militaire de carrière. Eu égard à la difficulté de la mission des forces de l’ordre dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et à l’inévitabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources, il y a lieu d’interpréter l’étendue de l’obligation positive pesant sur les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau insupportable. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime, avec les juridictions nationales dont les décisions sont particulièrement motivées, que M.G. a agi avec la conviction honnête que la vie de M.R. était menacée et qu’il croyait sincèrement qu’il était nécessaire de recourir à la force. Le caractère sincère et honnête de cette conviction n’a pas été remis en cause lors de l’enquête, ce qui ressort des décisions du juge d’instruction et de la chambre de l’instruction. La décision de M.G. d’utiliser son arme n’a donné lieu qu’à un tir unique, effectué après des sommations et alors que ses autres tentatives pour faire cesser l’agression avaient échoué. La Cour note que le danger encouru par les gendarmes a également été confirmé par l’expertise balistique, dont les conclusions ont été reprises par la chambre de l’instruction, qui démontre qu’une seule pression suffisante sur la queue de détente était nécessaire pour réaliser un tir et que les manœuvres nécessaires pour y parvenir étaient réalisables sans difficulté particulière pour une personne qui aurait eu les poignets entravés. Compte tenu de ce qui précède, en particulier du comportement de H.B., de sa volonté d’agresser la gendarme M.R. et de se saisir de son arme de service qui était chargée, et ce malgré les interventions de M.G. qui a vainement tenté de l’en dissuader et de le maîtriser alors que la situation était particulièrement dangereuse pour sa collègue et lui-même, la décision de M.G. de faire usage de son arme à feu pouvait, dans les circonstances de l’espèce, passer pour être justifiée et absolument nécessaire « pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale », au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention. En ce qui concerne la préparation et le contrôle de l’opération, la Cour constate que l’enquête administrative de l’IGGN a conclu à l’absence de manquement aux règlements. La Cour estime que rien ne permet de déduire des recommandations faites par celle-ci en vue d’améliorer pour l’avenir le déroulement des opérations de transfert une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de faute en l’espèce. En particulier, les constats du juge d’instruction, dans son ordonnance de non-lieu du 19 janvier 2016, concernant tant l’extraction judiciaire que les renseignements fournis par l’administration pénitentiaire, ne sont pas de nature à démontrer qu’il existait un risque d’agression d’un tel niveau de gravité, justifiant des conditions particulièrement renforcées de sécurité pendant le transfèrement de H.B. La Cour ne saurait donc considérer que l’opération n’avait pas été préparée et contrôlée de manière à réduire autant que possible tout risque pour la vie de H.B., comme pour celle des gendarmes. La Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
CEDH
a) Principes généraux
52. La Cour renvoie aux arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni (27 septembre 1995, §§ 146-150 et 200, série A no 324), Giuliani et Gaggio c. Italie ([GC], no 23458/02, §§ 174‑182 et §§ 208‑210, CEDH 2011 (extraits)) et Makaratzis c. Grèce ([GC], no 50385/99, §§ 56‑60, CEDH 2004‑XI), ainsi que, plus récemment, aux arrêts Aydan c. Turquie (no 16281/10, §§ 63‑71, 12 mars 2013), Armani Da Silva c. Royaume‑Uni ([GC], no 5878/08, §§ 244‑248, CEDH 2016), et Chebab c. France (no 542/13, §§ 70 et suivants, 23 mai 2019), qui exposent l’ensemble des principes généraux dégagés par sa jurisprudence sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention et le recours à la force meurtrière.
53. Elle rappelle en particulier qu’eu égard à la nature subsidiaire de sa mission, elle doit se montrer prudente quant à assumer le rôle d’un tribunal de première instance compétent pour apprécier les faits, sauf si cela est rendu inévitable par les circonstances d’une affaire particulière (Camekan c. Turquie, no 54241/08, § 45, 28 janvier 2014, McKerr c. Royaume Uni (déc.), no 28883/95, 4 avril 2000, et Chebab, précité, § 72).
54. En principe, quand des procédures internes ont été menées, il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre version des faits à celle des autorités internes qui doivent établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des matériaux dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (Giuliani et Gaggio, précité, § 180, et Chebab, précité, § 73).
55. De plus, la Cour rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue que la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité de l’État au titre de la Convention. La compétence de la Cour se borne à déterminer la seconde. La responsabilité au regard de la Convention découle des dispositions de celle‑ci, qui doivent être interprétées à la lumière de l’objet et du but de la Convention et eu égard à toute règle ou tout principe de droit international pertinents. Il ne faut pas confondre responsabilité d’un État à raison des actes de ses organes, agents ou employés, et questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle, dont l’appréciation relève des juridictions internes. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence au sens du droit pénal (Giuliani et Gaggio, précité, § 182, Toubache c. France, no 119510/15, § 39, 7 juin 2018, et Chebab, précité, § 74).
56. Enfin, sous le volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour doit examiner la question de savoir si la force utilisée pour atteindre l’objectif susmentionné était « absolument nécessaire » et, en particulier, si elle avait un caractère strictement proportionné, compte tenu de la situation à laquelle était confronté l’agent des forces de l’ordre. À cet égard, pour déterminer si l’emploi de la force potentiellement meurtrière était justifié, la Cour examine si l’agent de l’État croyait honnêtement et sincèrement qu’il était nécessaire d’y recourir. À cette fin, la Cour doit vérifier le caractère subjectivement raisonnable de la conviction en tenant pleinement compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés (Armani Da Silva, précité, §§ 244-248, et Chebab, précité, § 76).
b) Application au cas d’espèce
57. Dans la présente affaire, la Cour relève d’emblée qu’il ressort des éléments de l’enquête, tels que repris par les juridictions internes dans leurs décisions motivées, qu’au cours de son transfèrement de la maison d’arrêt de Strasbourg-Elsau au tribunal de grande instance de Colmar pour y être interrogé par un juge d’instruction, H.B. a agressé le membre de l’escorte de la gendarmerie, M.R., qui se tenait à ses côtés à l’arrière du véhicule, essayant à plusieurs reprises de saisir son arme de service qui était approvisionnée en munitions et chargée. En conséquence, les juridiction internes ont examiné la question de savoir si l’action du gendarme M.G. avait pour but d’assurer la défense d’une personne, sa collègue M.R., contre la violence illégale de H.B. au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention.
58. Elle note ensuite que les déclarations des deux gendarmes (paragraphes 11-12 et 17 ci-dessus) sont corroborées par des examens techniques en matière balistique, génétique et médico-légale (voir, parmi d’autres, Giuliani et Gaggio, précité, § 181).
59. S’agissant tout d’abord de la réalité de l’agression commise par H.B. sur M.R., la Cour relève qu’outre la découverte sur le sol d’un bouton ensanglanté provenant du haut du vêtement de M.R., l’examen médico-légal réalisé juste après les faits a permis de constater des contusions, des ecchymoses, des dermabrasions, ainsi que d’autres traces de coups et de griffures sur le corps de cette dernière (paragraphe 18 ci-dessus). La crédibilité des déclarations de M.R., décrivant notamment les violences subies par une « pluie de coups », a également été confirmée par l’expert médico-légal qui, lors de reconstitution des faits organisée le 2 juin 2015, a déclaré ses propos compatibles avec les constatations initiales et le rapport du médecin légiste qui l’avait examinée (paragraphe 27 ci-dessus).
60. La Cour constate ensuite qu’une expertise génétique a permis de détecter plusieurs traces de l’ADN de H.B. non seulement sur l’étui du pistolet de M.R., mais également sur de nombreuses parties de l’arme elle-même (paragraphe 24 ci-dessus), ce qui atteste du fait que H.B. ait effectivement tenté de s’en saisir. Un tel constat a légitimement pu conduire le juge d’instruction à en déduire que cela caractérisait la préhension volontaire de l’arme de M.R. par H.B. (paragraphe 31 ci-dessus).
61. De plus, la Cour observe que les investigations ont permis d’établir qu’avant d’effectuer le tir qui s’est avéré mortel, M.G. a vainement tenté, à plusieurs reprises, de mettre fin à l’agression de sa collègue par des moyens non létaux, qu’il s’agisse des sommations, du recours à la force physique ou de l’usage d’un bâton de défense (paragraphes 11, 22 et 31). Certes, comme le note le requérant, M.G. n’a pas utilisé la bombe lacrymogène à sa disposition et il n’était pas équipé d’un pistolet à impulsion électrique. Cependant, la Cour ne saurait spéculer dans l’abstrait sur l’opportunité d’employer d’autres moyens, sa tâche ne consistant pas à substituer sa propre appréciation de la situation à celle d’un agent ayant dû réagir dans le feu de l’action, et à imposer ainsi que l’on use de moyens neutralisants avant de se servir d’armes à feu (voir, notamment, Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 139, CEDH 2005-II, et Perk et autres c. Turquie, no 50739/99, § 72, 28 mars 2006). Bien qu’il soit souhaitable que de tels moyens soient répandus si l’on veut limiter progressivement le recours aux méthodes susceptibles d’entraîner la mort, établir une telle obligation de principe sans tenir compte des circonstances d’une affaire donnée imposerait à l’État et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui, eu égard notamment au caractère imprévisible de la nature humaine (ibidem). En tout état de cause, la Cour relève que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar a expressément constaté que l’usage de la bombe lacrymogène par M.G. dans les circonstances de l’espèce lui aurait fait courir le risque d’asperger sa collègue et lui-même en retour (paragraphe 33 ci‑dessus), ce qui n’aurait vraisemblablement pu qu’aggraver la situation dans laquelle ils se trouvaient.
62. La Cour entend également souligner le fait que le gendarme M.G. a dû intervenir à la suite d’une agression aussi vive qu’impromptue, l’obligeant à réagir sans préparation, d’autant plus qu’en sa qualité de gendarme adjoint volontaire, il n’avait pas l’expérience d’un gendarme militaire de carrière (paragraphes 37-39 ci-dessus ; cf., mutatis mutandis, Chebab, précité, § 81).
63. Ainsi, et eu égard à la difficulté de la mission des forces de l’ordre dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et à l’inévitabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources, il y a lieu d’interpréter l’étendue de l’obligation positive pesant sur les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau insupportable (Makaratzis, précité, § 69, et Chebab, précité, § 82).
64. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime donc, avec les juridictions nationales dont les décisions sont particulièrement motivées, que M.G. a agi avec la conviction honnête que la vie de M.R. était menacée (voir, mutatis mutandis, Guiliani et Gaggio, précité, § 189, et Chebab, précité, §§ 76 et 83) et qu’il croyait sincèrement qu’il était nécessaire de recourir à la force (voir, mutatis mutandis, Armani Da Silva, précité, § 248, concernant le volet procédural), ce qui l’autorisait à faire usage de moyens appropriés pour assurer la défense de sa collègue. Le caractère sincère et honnête de cette conviction n’a pas été remis en cause lors de l’enquête, ce qui ressort des décisions du juge d’instruction (paragraphe 31 ci-dessus) et de la chambre de l’instruction (paragraphe 33 ci‑dessus). Elle considère au demeurant que la décision de M.G. d’utiliser son arme n’a donné lieu qu’à un tir unique, effectué après des sommations et alors que ses autres tentatives pour faire cesser l’agression avait échoué. La Cour note au demeurant, outre la violence illégale avérée dont M.R. était victime et du risque qui aurait incontestablement été encouru par elle et M.G. en cas de saisine de son arme par H.B., que le danger encouru par les gendarmes a été confirmé par l’expertise balistique, dont les conclusions ont été reprises par la chambre de l’instruction, qui démontre qu’une seule pression suffisante sur la queue de détente était nécessaire pour réaliser un tir et que les manœuvres nécessaires pour y parvenir étaient réalisables sans difficulté particulière pour une personne qui, à l’instar de H.B., aurait eu les poignets entravés (paragraphes 23 et 33 ci-dessus). De plus, aucun élément factuel ne permet de conclure, au regard du danger immédiat auquel les gendarmes se trouvaient confrontés, qu’il serait réaliste de considérer que M.G. aurait pu viser d’autres parties du corps de H.B. pour mettre fin à l’agression et protéger la vie de sa collègue.
65. Compte tenu de ce qui précède, en particulier du comportement de H.B. (voir, Armani Da Silva, précité, § 251, Lamartine et autres (déc.), no 25382/12, § 36, 8 juillet 2014, et Mendy, précitée, § 34), de sa volonté d’agresser la gendarme M.R. et de se saisir de son arme de service qui était chargée, et ce malgré les interventions de M.G. qui a vainement tenté de l’en dissuader et de le maîtriser alors que la situation était particulièrement dangereuse pour sa collègue et lui-même, la décision de M.G. de faire usage de son arme à feu pouvait, dans les circonstances de l’espèce, passer pour justifiée et absolument nécessaire « pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale », au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention (Giuliani et Gaggio, précité, § 194, et Mendy c. France, (déc.), no 71428/12 § 33, 4 septembre 2018).
66. Par ailleurs, s’agissant du risque d’évasion évoqué à la suite des déclarations initiales des gendarmes et que le requérant entend contester, la Cour note que ni le juge d’instruction ni la chambre de l’instruction ne se sont fondés sur cet élément pour se prononcer sur la légalité du tir mortel et juger que l’emploi de son arme à feu par M.G. était en l’espèce justifié (paragraphes 31 et 33 ci-dessus).
67. Enfin, concernant la préparation et le contrôle de l’opération, la Cour, tout en renvoyant à sa jurisprudence sur la question (voir, notamment, McCann et autres, précité, §§ 147-150, Huohvanainen c. Finlande, no 57389/00, §§ 93‑94, 13 mars 2007, et Aydan, précité, §§ 65-66), constate que l’enquête administrative de l’IGGN a conclu à l’absence de manquement aux règlements (paragraphe 28 ci-dessus). Elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, rien ne permet de déduire des recommandations faites pour l’avenir en vue d’améliorer le déroulement des opérations de transfert (paragraphe 28 ci-dessus) une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de faute en l’espèce. Les décisions motivées des juridictions d’instruction (paragraphes 31 et 33 ci-dessus) ne permettent d’ailleurs pas davantage d’aboutir à une conclusion différente. En particulier, les constats du juge d’instruction, dans son ordonnance de non-lieu du 19 janvier 2016, concernant tant l’extraction judiciaire que les renseignements fournis par l’administration pénitentiaire, ne sont pas de nature à démontrer qu’il existait un risque d’agression d’un tel niveau de gravité, justifiant des conditions particulièrement renforcées de sécurité pendant le transfèrement de H.B. (paragraphe 31 ci-dessus). De même, la Cour relève que le transfèrement de la maison d’arrêt de Colmar à la maison d’arrêt de l’Elsau s’était déroulé sans incident (paragraphes 6 et 31 ci-dessus). Au demeurant, à supposer même que certains manquements soient susceptibles d’être étayés concernant les conditions du transfèrement au cours duquel le proche des requérants a perdu la vie, la Cour ne saurait en conclure, dans les circonstances de l’espèce, que l’opération n’a pas été préparée et contrôlée de manière à réduire autant que possible tout risque pour la vie de H.B., comme pour celle des gendarmes (voir, par exemple, Muhacır Çiçek et autres c. Turquie, no 41465/09, § 64, 2 février 2016). Enfin, et en tout état de cause, la Cour note que le requérant ne s’est pas plaint de la préparation et du contrôle de l’opération dans le cadre de son pourvoi en cassation.
68. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
Tenenbaum c. France du 16 décembre 2021 requête no 68260/17
non violation de l'article 3 : Dans cette affaire, le requérant dénonce les violences dont il aurait été victime lors de son interpellation par les gendarmes ainsi que la partialité et l’insuffisance de l’enquête relative à ces faits.
S’agissant du volet procédural de l’article 3, la Cour relève que les investigations menées à la suite de la plainte du requérant avec constitution de partie civile ont été conduites avec diligence et minutie par des autorités indépendantes qui se sont sérieusement efforcées d’établir, de manière contradictoire, la réalité des faits, avant de statuer par des décisions circonstanciées et dûment motivées. La Cour en déduit que l’obligation de moyens pesant sur les autorités internes de conduire une enquête effective a bien été respectée.
S’agissant du volet matériel de l’article 3, la Cour constate qu’il est établi que le requérant a résisté avec force aux gendarmes lorsqu’ils ont tenté de le menotter. Il souffrait alors de troubles psychiques et neurologiques qui ont d’ailleurs conduit le tribunal correctionnel à le déclarer irresponsable pénalement des délits de vol avec violence et de rébellion. Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, la Cour reconnaît que l’usage de la force par les gendarmes lors de son interpellation était donc strictement nécessaire et proportionné au comportement du requérant qui s’est avéré être difficilement contrôlable.
FAITS
Le soir du 3 juin 2012, vers 22 heures 30, alors que M. Tenenbaum se trouvait dans un établissement de restauration rapide, une altercation éclata entre lui et un employé auquel il avait tenté de voler un sac. Trois employés se mêlèrent à la bagarre. Quatre gendarmes arrivèrent sur place vers 23 heures, à la demande du responsable de l’établissement. La rixe avait cessé et M. Tenenbaum se trouvait alors à l’extérieur de l’établissement. Trois des gendarmes usèrent de la force afin de le maîtriser.
Le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse constata, par un jugement rendu le 17 octobre 2012, que M. Tenenbaum avait commis des faits de vol avec violence et de rébellion. Le tribunal déclara cependant le requérant irresponsable pénalement.
Entretemps, le 16 juillet 2012, M. Tenenbaum avait déposé une plainte pour violences par personnes dépositaires de l’autorité publique contre les quatre gendarmes ayant procédé à son interpellation.
Le 8 octobre 2012, la procureure de la République de Bourg-en-Bresse décida de ne pas y donner suite, « les investigations conduites par le commandant de la compagnie de gendarmerie de Gex, à la suite de la plainte (...) n’a[yant] pas révélé un comportement critiquable de ces gendarmes au moment de l’interpellation ».
Le soir du 3 juin 2012, vers 22 heures 30, alors que M. Tenenbaum se trouvait dans un établissement de restauration rapide, une altercation éclata entre lui et un employé auquel il avait tenté de voler un sac. Trois employés se mêlèrent à la bagarre. Quatre gendarmes arrivèrent sur place vers 23 heures, à la demande du responsable de l’établissement. La rixe avait cessé et M. Tenenbaum se trouvait alors à l’extérieur de l’établissement. Trois des gendarmes usèrent de la force afin de le maîtriser.
Le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse constata, par un jugement rendu le 17 octobre 2012, que M. Tenenbaum avait commis des faits de vol avec violence et de rébellion. Le tribunal déclara cependant le requérant irresponsable pénalement.
Entretemps, le 16 juillet 2012, M. Tenenbaum avait déposé une plainte pour violences par personnes dépositaires de l’autorité publique contre les quatre gendarmes ayant procédé à son interpellation.
Le 8 octobre 2012, la procureure de la République de Bourg-en-Bresse décida de ne pas y donner suite, « les investigations conduites par le commandant de la compagnie de gendarmerie de Gex, à la suite de la plainte (...) n’a[yant] pas révélé un comportement critiquable de ces gendarmes au moment de l’interpellation ».
CEDH
8. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il y a lieu de les examiner sous l’angle de l’article 3 de la Convention uniquement. Elle relève ensuite que le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité de cette disposition en l’espèce.
9. S’agissant du volet procédural du grief, la Cour rappelle que l’article 3 requiert qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsque, comme en l’espèce, un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à cette disposition. Renvoyant à cet égard aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés dans l’arrêt Bouyid c. Belgique [GC] (no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), elle constate tout d’abord que l’information consécutive à la plainte avec constitution de partie civile du requérant a été menée comme il se doit par à un juge d’instruction, lequel est « une autorité judiciaire indépendante, dénuée de lien hiérarchique ou structurel avec la police » (Semache c. France, no 36083/16, § 109, 21 juin 2018) ou la gendarmerie, et que les actes d’investigation sur commission rogatoire ont été confiés à l’inspection générale de la gendarmerie nationale, dont le requérant ne met en cause ni l’indépendance ni l’impartialité. Elle relève ensuite qu’il est vrai que le requérant n’a pas été entendu sur les faits qu’il dénonçait et que le juge d’instruction n’a pas jugé utile de le confronter aux gendarmes mis en cause. Pour autant, elle estime que, prise dans son ensemble, l’information judiciaire répond à l’exigence d’effectivité requise. Il ressort en effet du dossier que diverses mesures d’instructions ont été prises. En particulier, les quatre gendarmes concernés ont été entendus, ainsi que cinq employés de l’établissement de restauration rapide présents sur les lieux au moment des faits et le médecin qui avait examiné le requérant peu de temps après ; les vidéos de surveillance de l’établissement ont été visionnées et ont fait l’objet d’un procès-verbal qui a été joint au dossier ; une expertise médico-légale du requérant a été réalisée à la demande du juge d’instruction. Par ailleurs, la durée de l’information n’apparaît pas déraisonnable, un an, huit mois et deux semaines s’étant écoulés entre la plainte avec constitution de partie civile et l’ordonnance de non-lieu, et huit mois entre cette ordonnance et l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel.
10. Selon la Cour, les investigations menées à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du requérant pour apprécier le bien-fondé de ses allégations ont été conduites avec diligence et minutie, par des autorités présentant les garanties d’indépendance requises et qui se sont sérieusement efforcées d’établir, de manière contradictoire, la réalité des faits avant de statuer par des décisions circonstanciées et dûment motivées. Il s’ensuit que l’obligation de moyens de conduire une enquête effective pesant sur les autorités internes a été respectée (comparer avec P.M. et F.F. c. France, nos 60324/15 et 60335/15, § 72, 18 février 2021).
11. S’agissant du volet matériel du grief, la Cour rappelle qu’en cas d’allégation de traitements contraires à l’article 3 à l’occasion d’une interpellation par les forces de l’ordre, elle doit rechercher si la force utilisée était strictement nécessaire et proportionnée, et si l’État doit être tenu pour responsable des blessures infligées. Elle doit à cette fin prendre en compte les blessures occasionnées et les circonstances dans lesquelles elles l’ont été. Il incombe normalement au Gouvernement d’apporter des preuves pertinentes démontrant que le recours à la force était à la fois nécessaire et proportionné (voir, par exemple, Gheorghiţă et Alexe c. Roumanie, no 32163/13, § 38, 31 mai 2016, ainsi que les références qui y figurent ; pour un exposé des principes généraux applicable voir ce même arrêt, §§ 37-40, et l’arrêt Bouyid précité, §§ 81-90 et 100-101).
12. La Cour constate tout d’abord que lorsqu’ils sont intervenus le 3 juin 2012, les gendarmes entendaient légitimement procéder à l’arrestation d’un individu que l’on pouvait plausiblement soupçonner d’avoir commis une infraction.
13. Il est par ailleurs établi qu’ils sont intervenus après que le requérant a activement participé à une violente altercation au cours de laquelle il a reçu plusieurs coups. Elle juge plus que vraisemblable qu’une partie des blessures constatées sur le requérant a été causée à l’occasion de cette rixe. Elle observe ensuite que, ainsi que l’a relevé la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon et le souligne le Gouvernement, il n’est pas possible de déterminer la proportion des blessures consécutives, d’une part, aux coups reçus lors de cette rixe et, d’autre part, à l’usage de la force physique auquel ont eu recours les gendarmes au cours de l’arrestation.
14. Il est également établi que le requérant a résisté avec force aux gendarmes lorsqu’ils ont tenté de le menotter, et qu’il souffrait alors de troubles psychiques et neurologiques, qui ont d’ailleurs conduit le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à le déclarer irresponsable pénalement des délits de vol avec violence et de rébellion pour lesquels il avait été poursuivi en raison des faits commis le 3 juin 2012 (paragraphe 2 ci-dessus). Sur ce dernier point, la Cour juge convaincant le constat de la chambre de l’instruction selon lequel l’état de démence dans lequel se trouvait le requérant au moment de son arrestation l’avait rendu difficilement contrôlable.
15. Enfin, compte tenu des pièces du dossier et eu égard à la motivation de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon du 4 septembre 2015 (paragraphe 4 ci-dessus), la Cour est convaincue par les explications du Gouvernement selon lesquelles l’usage de la force par les gendarmes lors de l’arrestation du requérant était strictement nécessaire et proportionné à son comportement.
16. Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Zličić c. Serbie du 26 janvier 2021 requête no 73313/17
Article 3 : Un Serbe maltraité par la police
L’affaire concerne les mauvais traitements que le requérant aurait subis de la part de la police, l’enquête sur ses allégations et la procédure qui a suivi. Le requérant obtint également des dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure civile pour mauvais traitements de la part de la police. La Cour juge en particulier que la décision des tribunaux nationaux suffit à elle seule pour conclure à une violation de l’article 3 concernant les mauvais traitements allégués. Toutefois, elle relève de nombreux autres éléments qui permettraient de parvenir à cette conclusion, notamment les preuves médicales et les témoignages. La Cour conclut également à une violation de l’article 3 en raison de l’absence d’enquête adéquate sur les allégations. Concernant le droit à un procès équitable, la Cour précise que les mauvais traitements allégués n’ont pas été déterminants pour la condamnation, et que le requérant a bénéficié d’un procès équitable.
FAITS
Le requérant, Aleksandar Zličić, est un ressortissant serbe, né en 1981 et résidant à Novi Sad (Serbie). Le 10 janvier 2014, le requérant et son ami furent abordés par la police alors qu’ils étaient assis sur un banc à l’extérieur. Un agent de police leur demanda s’ils étaient en possession d’un petit sac en plastique (le Gouvernement affirme que celui-ci contenait du cannabis). Ils furent arrêtés. Le requérant affirme avoir été battu et déshabillé au poste de police, et que des menaces furent proférées à l’encontre de sa famille et de sa petite amie. Craignant d’être maltraité, il signa un certificat de saisie. Le Gouvernement affirme que le requérant fut interrogé conformément à la loi et qu’il ne s’opposa pas à la conduite des agents. Le 12 janvier, le requérant consulta un médecin. Des blessures furent constatées dans le rapport médical. Le requérant porta plainte auprès du procureur. Les témoignages de son ami, des membres de sa famille et de sa petite amie corroboraient certains des éléments attestés par le requérant en termes de blessures et de violences physiques. Le ministère public, à deux niveaux, rejeta sa plainte, constatant un manque de preuves. La Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant, la procédure utilisée n’ayant impliqué aucune violation de la Constitution. Des poursuites pénales furent également engagées contre le requérant. Ce dernier fut déclaré coupable de possession de stupéfiants et condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal de première instance de Novi Sad, peine qui fut confirmée en appel. Le tribunal de première instance admit que le certificat de saisie était recevable comme preuve, souscrivant pour l’essentiel au compte-rendu des agents de police. Un pourvoi dans l’intérêt de la loi et un recours devant la Cour constitutionnelle furent introduits en vain. Le 22 septembre 2019, le requérant entama une procédure civile en lien avec les allégations de mauvais traitements policiers. Le tribunal de première instance de Novi Sad fit droit à ses principaux arguments et lui accorda l’équivalent de 670 euros (EUR) pour la douleur et la souffrance éprouvées, 835 euros au titre de la crainte endurée et 605 euros pour frais et dépens. Ces montants furent par la suite réduits en appel, mais le jugement fut confirmé.
Article 3
La Cour souligne que l’article 3 doit être considéré comme l’une des dispositions les plus fondamentales de la Convention. La Cour précise que l’acceptation par les juridictions civiles internes de la version des faits du requérant est suffisante pour qu’elle constate que celui-ci a subi des mauvais traitements. Elle tient également compte des preuves médicales et de l’affirmation de son ami selon laquelle le requérant a subi des mauvais traitements. La Cour admet en outre que la coercition a joué un rôle dans l’obtention de la signature du certificat de saisie par le requérant. Enfin, la Cour prend note de l’absence d’explication alternative de la part du Gouvernement quant à la manière dont le requérant a été blessé. L’intéressé a donc subi un traitement inhumain et dégradant. La Cour conclut également à une violation de l’article 3 en raison de l’absence d’une enquête adéquate sur les allégations du requérant.
La Cour observe que les tribunaux civils serbes ont établi un lien entre les souffrances ressenties par le requérant et les mauvais traitements qu’il a subis de la part de la police, jugeant l’État responsable. Cependant, le montant alloué n’était pas satisfaisant et aucune enquête policière adéquate n’avait été menée sur les mauvais traitements. Il y a donc eu une violation matérielle de l’article 3 et une violation procédurale dans la manière dont les autorités ont réagi aux allégations.
Autres articles
La Cour ne constate pas de violation de l’article 6 § 1, puisque le certificat de saisie en question n’a eu aucune incidence sur « l’issue de la procédure » à l’encontre du requérant et que, en tout état de cause, le requérant a eu de nombreuses occasions de faire valoir ses arguments devant les tribunaux.
AKIN c. TURQUIE du 17 novembre 2020 Requête n° 58026/12)
Art 3 (volets matériel et procédural) • Absence d’enquête effective menée avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable sur des mauvais traitements infligés par la police lors d’une arrestation • Policier condamné à cinq mois de prison par la cour d’assises • Prescription pénale des faits constatée par la Cour de cassation • Procédure ou condamnation ne pouvant être rendues caduques par le jeu de la prescription
CEDH
48. Le requérant se plaint d’avoir été frappé pendant son arrestation. Il considère également que l’enquête était ineffective car le policier a bénéficié de la prescription pénale.
49. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il indique que l’intervention de la police a résulté des agissements du requérant lui-même et que celui-ci a blessé un policier. Quant à la procédure, il souligne que le requérant et son avocat ont contribué à la prolongation de celle-ci notamment en étant absents à plusieurs audiences.
50. Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], no 39630/09, §§ 182-185 et 195-198, CEDH 2012), Mocanu et autres, (précité, §§ 314-326), et Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 100-101, CEDH 2015). La Cour estime particulièrement important de souligner que lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par cette disposition. La Cour souligne que l’on ne saurait voir dans les mots « en principe » l’indication qu’il y aurait des situations où une telle conclusion de violation ne s’imposerait pas parce que le seuil de gravité ne serait pas atteint. En affectant la dignité humaine, c’est l’essence même de la Convention que l’on touche. Pour cette raison, toute conduite des forces de l’ordre à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à la dignité humaine constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Il en va en particulier ainsi de l’utilisation par elles de la force physique à l’égard d’un individu alors que cela n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé (Bouyid précité, §§ 100-101, Pranjić-M-Lukić c. Bosnie-Herzégovine, no 4938/16, §§ 73 et 82, 2 juin 2020).
51. En l’espèce, la cour d’assises a condamné le policier pour avoir infligé au requérant des coups et blessures en abusant de ses fonctions. Au vu de ce constat opéré au niveau interne, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la nécessité et la proportionnalité du recours à la force.
52. Or, la réclusion criminelle de cinq mois prononcée par la Cour d’assises n’a eu aucun effet en pratique, car la Cour de cassation, par sa décision du 21 mars 2012, a constaté la prescription pénale des faits. En résumé, malgré l’établissement de l’illégalité des agissements du policier concerné par la cour d’assises, ledit jugement n’a été ni confirmé ni infirmé.
53. Tel qu’indiqué ci-dessus, la Cour a dit à maintes reprises que lorsqu’un agent des forces de l’ordre est accusé d’actes contraires à l’article 3, la procédure ou la condamnation ne peuvent être rendues caduques par le jeu de la prescription (paragraphe 37 ci-dessus et les références qui y figurent). En l’espèce, malgré le comportement du requérant et de son avocat, lesquels n’ont pas participé à plusieurs audiences et n’ont pas pu immédiatement présenter leur témoin, la Cour souligne à nouveau que lorsqu’il s’agit d’une enquête relative à des allégations de mauvais traitements commis par les forces de l’ordre, l’obligation positive de mener une enquête effective requiert une promptitude et une diligence de la part de l’État. Cette enquête est à la charge des autorités judiciaires nationales, lesquelles sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires afin de clore la procédure avant que l’action pénale soit éteinte par la prescription. La Cour note en particulier qu’en l’occurrence, il a fallu environ cinq ans aux autorités d’enquête pour trouver des preuves contre l’agent E.S. afin de déclencher la deuxième procédure susmentionnée. Ensuite, tant pour la première que pour la seconde procédure, plus de deux ans se sont écoulés avant que la Cour de cassation ne se prononce sur ces procédures (paragraphes 16-17 et 19-20). Des motifs raisonnables n’ont pas été avancés par le Gouvernement pour expliquer ces délais excessifs.
54. Ainsi, la Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas pris toutes les mesures positives nécessaires pour agir avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable dans cette affaire. Ce manquement dans la conduite de l’enquête a eu pour conséquence d’accorder une impunité au policier concerné et de rendre la plainte pénale ineffective.
55. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure à la violation de l’article 3 de la Convention, sous ses volets matériel et procédural.
Castellani c. France du 30 avril 2020 requête n° 43207/16
Article 3 volet matériel : Opération insuffisamment planifiée et usage excessif de la force par le GIPN lors de l’arrestation d’un suspect : violation de la Convention
L’affaire concerne la plainte du requérant, victime de violences au cours de son interpellation à son domicile en présence de sa femme et de sa fille, par le GIPN, une unité d’élite de la police. La Cour juge que l’opération policière au domicile du requérant n’a pas été planifiée ni exécutée de telle sorte que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’interpellation d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction pénale. Le requérant n’a pas été poursuivi pour des faits de rébellion et les gestes accomplis par plusieurs policiers casqués et protégés par des boucliers ont été particulièrement violents. La Cour conclut que les moyens employés n’étaient donc pas strictement nécessaires pour permettre l’interpellation du requérant et que la force physique dont il a été fait usage à son encontre n’a pas été non plus rendue nécessaire par son comportement.
Art 3 (volet matériel) • Recours à la force • Irruption d’une unité d’élite de la police au domicile d’un suspect au petit matin pour procéder à son arrestation aux fins d’audition dans le cadre d’une enquête pénale • Nécessité de garanties suffisantes face aux risques d’abus d’autorité et de violation de la dignité humaine lors du recours, dans un tel contexte, aux forces spéciales • Doutes sur l’existence de précautions suffisantes • Tribunaux ayant reconnu la légitime défense du requérant, qui avait frappé un policier cagoulé en le prenant pour un cambrioleur • Blessures résultant de l’emploi d’une force physique non rendue strictement nécessaire par le comportement du suspect
LES FAITS
Le requérant, Joseph Castellani, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Contes. En mai 2002, une information judiciaire fut ouverte contre X pour subornation de témoin et menaces de mort à la suite d’une plainte déposée par un avocat qui avait témoigné dans une affaire de violences dirigées contre la force publique, dans laquelle trois membres de la famille E.H. avaient été condamnés. Les principaux suspects étaient membres de la famille E.H., famille amie et voisine du requérant. Le 18 juin 2002, les policiers de Nice demandèrent et obtinrent le soutien du groupe d’intervention de la police nationale (GIPN) pour interpeller des membres de la famille E.H. À la demande de la commandante des forces de police R., le chef de l’unité du GIPN accepta d’intervenir ensuite pour interpeller M. Castellani, mis en cause dans la même affaire. Les circonstances de cette opération policière sont contestées par les parties. Le 13 novembre 2002, une ordonnance de non-lieu fut rendue par le juge d’instruction, sur les faits de subornation de témoins et de menaces de mort réitérées à l’origine de l’interpellation de M. Castellani. Le 13 janvier 2009, le tribunal correctionnel reconnut M. Castellani coupable de détention d’arme sans autorisation et le condamna à une amende délictuelle avec sursis. Par ailleurs, le tribunal relaxa le requérant des chefs de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, retenant la légitime défense, considérant que le requérant avait pu légitimement se croire agressé à son domicile. Le 18 novembre 2002, M. Castellani déposa plainte avec constitution de partie civile pour nonassistance à personne en péril, violences volontaires et actes de barbarie. Une information judiciaire fut ouverte le 7 décembre 2002. Le 2 juillet 2004, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non lieu partiel, ne retenant à l’encontre de certains policiers que l’omission de porter secours et les renvoyant de ce chef devant le tribunal correctionnel de Nice. À la suite de l’appel interjeté par le requérant, la cour d’appel annula l’ordonnance de non-lieu partiel du juge d’instruction et ordonna la poursuite de l’information. Une deuxième ordonnance de non-lieu concernant les faits de violences volontaires par dépositaires de l’autorité publique fut rendue le 27 janvier 2006. Le requérant fit appel. Par un arrêt rendu le 15 juin 2006, la cour d’appel confirma le non-lieu des chefs d’actes de barbarie. Par un arrêt rendu le 25 octobre 2007, la cour d’appel confirma l’ordonnance de non-lieu du chef de violences volontaires par dépositaires de l’autorité publique. Le 26 juin 2009, M. Castellani forma une action en responsabilité de l’État, aux fins d’obtenir une indemnisation du préjudice subi. Le tribunal, par un jugement du 5 avril 2011, considéra qu’en envoyant le GIPN pour procéder à l’interpellation du requérant, l’État avait commis une faute lourde engageant sa responsabilité. Le tribunal condamna l’État à payer la somme de 59 000 euros (EUR) en indemnisation du préjudice subi, ainsi que 3 500 EUR au titre du remboursement des frais. Le 12 avril 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirma la recevabilité de l’action de M. Castellani mais infirma le jugement pour le surplus et débouta le requérant de ses demandes. M. Castellani fut condamné à payer 1 700 EUR en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens. La Cour de cassation cassa l’arrêt et renvoya la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier. Par un arrêt rendu le 27 janvier 2015, la cour d’appel de Montpellier considéra que la faute lourde, engageant la responsabilité de l’État, n’était pas démontrée s’agissant des conditions d’intervention du GIPN. Elle considéra qu’il ne pouvait être conclu à l’inutilité ou au caractère disproportionné de cette intervention en raison des actes accomplis par le requérant pour se défendre, mais aussi de sa persistance à se rebeller. En revanche, la cour d’appel jugea que l’État avait commis une faute lourde à raison du défaut de soins durant la garde à vue dont le requérant avait fait l’objet. L’État fut condamné au paiement de la somme de 5 000 EUR en réparation du préjudice lié à ce défaut de soins et à la somme de 2 000 EUR conformément à l’article 700 du CPC. Le 10 février 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Article 3
La Cour relève d’emblée que l’ensemble des certificats médicaux établis ont constaté que le requérant souffrait de blessures importantes. Outre des souffrances physiques, le requérant a dû supporter des souffrances psychiques. L’arrestation de M. Castellani, très tôt le matin à son domicile, après une ouverture forcée du portail et de la porte d’entrée, par de nombreux agents cagoulés et armés, devant sa compagne et sa fille, a nécessairement provoqué de forts sentiments de peur et d’angoisse chez lui, susceptibles de l’humilier et de l’avilir à ses propres yeux et aux yeux de ses proches. S’agissant de la planification de l’opération, la Cour considère qu’en principe, il ne lui appartient pas de juger du choix d’un service plutôt qu’un autre pour appréhender une personne aux fins d’audition dans le cadre d’une enquête pénale. Néanmoins, elle rappelle que l’intervention d’unités spéciales habituellement engagées dans des situations d’extrême violence ou particulièrement périlleuses exigeant des réactions promptes et fermes peut comporter des risques particuliers d’abus d’autorité et de violation de la dignité humaine. Elle considère que l’intervention de telles unités doit donc être entourée de garanties suffisantes (mutatis mutandis, Kučera c. Slovaquie, n o 48666/99, § 122, 17 juillet 2007). En l’espèce, le but de l’intervention policière avec le concours du GIPN était, dans un premier temps, d’interpeller la famille E.H. Le commandant avait demandé l’intervention du GIPN au juge d’instruction puis obtenu l’accord du directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) afin d’interpeller, non pas le requérant, mais uniquement les membres de la famille E.H. qui avaient déjà été condamnés pour violences et séquestration de fonctionnaire de police. Ce n’est qu’à la suite de l’interpellation de certains membres de cette famille que la commandante de police R. profita de l’opportunité de la présence du GIPN pour demander son assistance dans l’interpellation du requérant, impliqué dans les mêmes faits, sans que le juge d’instruction ait été informé ni que le DDSP ait donné son accord. La Cour relève en conséquence que cette opération n’a pas bénéficié des garanties internes existantes entourant normalement l’intervention de ce type d’unités spéciales. Concernant la personnalité du requérant, la Cour constate que les juges internes ont considéré que le caractère de dangerosité du requérant mis en avant pour justifier l’intervention du GIPN ne résultait que des déclarations des fonctionnaires de police ayant requis l’intervention et n’était étayé par aucun élément probant. Par ailleurs, la Cour relève que certaines juridictions internes ont, elles-mêmes, remis en cause la proportionnalité de l’intervention du GIPN au regard des circonstances de l’espèce. Le tribunal correctionnel a jugé le 13 janvier 2009 que l’intervention d’une unité spéciale telle que le GIPN dans une enquête pour menaces était peu commune et qu’à l’issue de l’interpellation mouvementée du requérant, celui-ci n’avait jamais été mis en examen ni même entendu par le juge d’instruction ayant décerné la commission rogatoire justifiant l’intervention de la police. La Cour observe également que la cour d’appel a néanmoins considéré qu’il était « possible que ce choix ait été disproportionné par rapport au risque que faisait encourir M. Castellani ». Enfin, il ressort du dossier qu’aucune investigation préalable afin de déterminer si le requérant serait seul au moment de son interpellation n’est alléguée. Or la Cour estime que la présence éventuelle de membres de la famille du suspect sur les lieux de l’arrestation est une circonstance qui doit être prise en compte dans la planification et l’exécution de ce type d’opérations policières. Cela n’a pas été fait dans le cas d’espèce et les forces de l’ordre n’ont pas envisagé d’autres modalités de leur opération au domicile de la famille du requérant. Après avoir pris en compte toutes les circonstances particulières de l’espèce, la Cour considère que l’opération policière au domicile du requérant n’a pas été planifiée ni exécutée de manière à s’assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’interpellation d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction pénale. S’agissant de l’usage de la force par les fonctionnaires de police, il n’est pas contesté, d’une part, que les lésions constatées sur le requérant ont été causées par les policiers qui ont procédé à son interpellation et, d’autre part, que M. Castellani a frappé l’un d’entre eux avec une barre de fer. Le requérant et le Gouvernement n’ont cependant pas la même version du déroulement des faits. La Cour note que le tribunal correctionnel a jugé, par une décision devenue définitive, que le requérant avait pu légitimement se croire agressé à son domicile et qu’il avait agi en état de légitime défense. En conséquence, la Cour ne peut retenir la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait sciemment agressé les forces de l’ordre ce qui ne ressort que des affirmations des policiers impliqués dans les faits litigieux et mis en cause, à l’exclusion de tout autre élément de la procédure. La Cour constate néanmoins, d’une part, que le requérant n’a pas été poursuivi pour des faits de rébellion et, d’autre part, que les gestes accomplis par plusieurs policiers casqués et protégés par des boucliers ont été particulièrement violents. La Cour conclut que les moyens employés n’étaient pas strictement nécessaires pour permettre l’interpellation du requérant et que la force physique dont il a été fait usage à son encontre n’a pas été non plus rendue nécessaire par son comportement. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention.
CEDH
a) Principes généraux
52. La Cour renvoie aux arrêts Gutsanovi c. Bulgarie, (no 34529/10, §§ 113, 125-126, CEDH 2013 (extraits)), Douet c. France, (no 16705/10, §§ 28-30, 3 octobre 2013), et Ghedir et autres c. France, (no 20579/12, §§ 108‑113, 16 juillet 2015) ainsi que, plus récemment, Boukrourou et autres c. France, (no 30059/15, §§ 77-81, 16 novembre 2017) qui exposent l’ensemble des principes généraux dégagés par sa jurisprudence sur le recours à la force lors d’une interpellation.
53. La Cour rappelle ainsi que l’article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation. Néanmoins, il doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000‑XII, et Gutsanovi, précité, § 126). À cet égard, il importe notamment de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer des blessures ou des dommages, ou de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil 1997‑VIII). La Cour tient à rappeler, en particulier, que tout recours à la force physique par les agents de l’État à l’encontre d’une personne, qui n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, porte atteinte à sa dignité humaine et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 88, 100 et 101, CEDH 2015).
54. Dans l’affaire Gutsanovi (précité, § 137), après avoir pris en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la Cour a conclu que l’opération policière au domicile des requérants n’avait pas été planifiée et exécutée de manière à assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’arrestation d’une personne suspectée d’avoir commis des infractions pénales et le rassemblement de preuves dans le cadre d’une enquête pénale. Elle a jugé que les quatre requérants avaient été soumis à une épreuve psychologique qui avait généré chez eux de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance et qui, de par ses effets néfastes, s’analysait en un traitement dégradant au regard de l’article 3.
(b) Application de ces principes en l’espèce
55. La Cour relève d’emblée que l’ensemble des certificats médicaux établis ont constaté que le requérant souffrait de blessures importantes : fractures d’une côte, du nez, du maxillaire droit, du cadre orbitaire, ainsi que de multiples ecchymoses sur l’ensemble du corps. Ces lésions ont nécessité une intervention chirurgicale et ont entrainé des douleurs et une incapacité permanente partielle. L’expert désigné par le juge d’instruction a considéré que l’ensemble de ces blessures justifiaient une ITT de dix‑neuf jours.
56. Outre les souffrances physiques que le requérant a dû supporter, la Cour considère que le traitement auquel il a été soumis a engendré des souffrances psychiques, ainsi qu’en atteste l’état de stress post-traumatique relevé par le Dr T. (paragraphe 26 ci-dessus). La manière dont s’est déroulée l’arrestation de M. Castellani, à savoir très tôt le matin à son domicile, après une ouverture forcée du portail et de la porte d’entrée, par de nombreux agents cagoulés et armés, devant sa compagne et sa fille, ont nécessairement provoqués de forts sentiments de peur et d’angoisse chez lui, susceptibles de l’humilier et de l’avilir à ses propres yeux et aux yeux de ses proches.
57. La Cour doit s’assurer, dans un premier temps, qu’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la société et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de l’individu ont été respectés dans les circonstances de l’affaire (Gutsanovi, précité, § 127) et que la planification de l’opération a pris en compte l’ensemble des circonstances pertinentes et a observé des garanties suffisantes. Elle doit également examiner, dans un second temps, si, au vu notamment de l’ensemble des constatations des autorités internes, la force physique dont il a été fait usage à l’encontre du requérant était ou non rendue strictement nécessaire par son comportement.
58. S’agissant de la planification de l’opération, la Cour considère qu’en principe, il ne lui appartient pas de juger du choix d’un service plutôt qu’un autre pour appréhender une personne aux fins d’audition dans le cadre d’une enquête pénale. Néanmoins, elle rappelle que l’intervention d’unités spéciales habituellement engagées dans des situations d’extrême violence ou particulièrement périlleuses exigeant des réactions promptes et fermes (paragraphe 42 ci-dessus) peut comporter des risques particuliers d’abus d’autorité et de violation de la dignité humaine. Elle considère que l’intervention de telles unités doit donc être entourée de garanties suffisantes (mutatis mutandis, Kučera c. Slovaquie, no 48666/99, § 122, 17 juillet 2007).
59. La Cour observe, en l’espèce, que l’opération d’interpellation dans laquelle le GIPN était principalement impliquée le 18 juin 2002 et pour laquelle son intervention avait été autorisée, répondait au but légitime d’effectuer une interpellation et poursuivait l’objectif d’intérêt général de la répression des infractions. Le but de l’intervention policière avec le concours du GIPN était, dans un premier temps, d’interpeller la famille E.H. Il ressort, en effet, des investigations menées par les autorités internes (paragraphe 29 ci-dessus), que le commandant avait demandé l’intervention de cette unité d’élite au juge d’instruction puis obtenu l’accord du DDSP afin d’interpeller, non pas le requérant, mais uniquement les membres de la famille E.H. qui avaient déjà été condamnés pour violences et séquestration de fonctionnaire de police (paragraphe 29 ci-dessus). Ce n’est qu’à la suite de l’interpellation de certains membres de cette famille, le matin du 18 juin 2002, que la commandante de police R., profita de l’opportunité de la présence du GIPN pour leur demander leur assistance dans l’interpellation du requérant, impliqué dans les mêmes faits, sans que le juge d’instruction ait été informé ni que le DDSP ait donné son accord. Partant, la Cour relève que cette opération n’a pas bénéficié des garanties internes existantes entourant normalement l’intervention de ce type d’unités spéciales (paragraphe 43 ci-dessus).
60. Concernant la personnalité du requérant, la Cour constate que les juges internes ayant statué en première instance sur la responsabilité de l’État, ont considéré que le caractère de dangerosité du requérant mis en avant pour justifier l’intervention du GIPN ne résultait que des déclarations des fonctionnaires de police ayant requis son intervention et n’était étayé par aucun élément probant (paragraphe 34 ci-dessus). S’il n’est pas contesté que le requérant détenait des armes à son domicile, la Cour observe néanmoins que le tribunal correctionnel lui a restitué deux d’entre elles dont la possession sans autorisation n’était pas constitutive d’une infraction (paragraphe 20 ci-dessus).
61. Par ailleurs, la Cour relève que certaines juridictions internes ont, elles-mêmes, remis en cause la proportionnalité de l’intervention du GIPN au regard des circonstances de l’espèce. Elle constate que le tribunal correctionnel a jugé le 13 janvier 2009 (paragraphe 20 ci-dessus) que l’intervention d’une unité spéciale telle que le GIPN dans une enquête pour menaces était peu commune et qu’à l’issue de l’interpellation mouvementée du requérant, celui-ci n’avait jamais été mis en examen ni même entendu par le juge d’instruction ayant décerné la commission rogatoire justifiant l’intervention de la police. La Cour observe également que si les juridictions internes n’ont pas retenu la responsabilité de l’État pour le choix de l’intervention du GIPN comme pour les violences qu’il a subi, la cour d’appel a néanmoins considéré qu’il était « possible que ce choix ait été disproportionné par rapport au risque que faisait encourir M. Castellani » (paragraphe 36 ci-dessus).
62. Enfin, il ressort de la lecture des pièces du dossier qu’aucune investigation préalable afin de déterminer si le requérant serait seul au moment de son interpellation n’est alléguée. La présence éventuelle de la fille du requérant et de son épouse n’a donc pas pu être anticipée. Or la Cour estime que la présence éventuelle de membres de la famille du suspect sur les lieux de l’arrestation est une circonstance qui doit être prise en compte dans la planification et l’exécution de ce type d’opérations policières (Gutsanovi, précité, § 132). Cela n’a pas été fait dans le cas d’espèce et les forces de l’ordre n’ont pas envisagé d’autres modalités de leur opération au domicile de la famille du requérant.
63. La Cour considère, après avoir pris en compte toutes les circonstances particulières de l’espèce, que l’opération policière au domicile du requérant n’a pas été planifiée et exécutée de manière à s’assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’interpellation d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction pénale.
64. S’agissant de l’usage de la force par les fonctionnaires de police, il n’est pas contesté, d’une part, que les lésions constatées sur le requérant ont été causées par les policiers qui ont procédé à son interpellation et, d’autre part, que M. Castellani a frappé l’un d’entre eux avec une barre de fer. Le requérant et le Gouvernement n’ont cependant pas la même version du déroulement des faits. Le requérant affirme qu’il ignorait qu’il s’agissait des forces de police au moment où il a frappé l’un d’entre eux. Le Gouvernement soutient que le requérant ne pouvait ignorer qu’il s’agissait des forces de police et qu’il a sciemment frappé l’un des policiers puis, qu’il s’est rebellé et a continué à se montrer violent.
65. La Cour rappelle que lorsque des procédures internes ont été menées, il ne lui appartient pas de substituer sa propre version des faits à celle des autorités internes qui doivent établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des matériaux dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269, et Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 180, CEDH 2011 (extraits)). Or, la Cour note que le tribunal correctionnel a jugé, par une décision devenue définitive, que le requérant avait pu légitimement se croire agressé à son domicile et qu’il avait agi en état de légitime défense (paragraphes 20 et 21 ci-dessus). En conséquence, la Cour ne peut retenir la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait sciemment agressé les forces de l’ordre ce qui ne ressort que des affirmations des policiers impliqués dans les faits litigieux et mis en cause, à l’exclusion de tout autre élément de la procédure. Par ailleurs, les éléments de preuve dont elle dispose ne permettent pas à la Cour de déterminer si, après qu’il eut compris qu’il s’agissait des forces de l’ordre, le requérant a persisté à se rebeller ou non. Elle constate néanmoins, d’une part, qu’il n’a pas été poursuivi pour des faits de rébellion et, d’autre part, que les gestes accomplis par plusieurs policiers casqués et protégés par des boucliers ont été particulièrement violents. La Cour observe, en effet, que les policiers ont décrit ainsi le mode opératoire utilisé pour interpeller le requérant (paragraphes 12 et 30 ci-dessus) : percussion au niveau du visage, utilisation de la force jusqu’à la mise au sol, retournement et plaquage sur le ventre au moyen de pressions des genoux et des coudes exercées au niveau du cou, du dos et des jambes du requérant puis menottage dans le dos. Ces éléments ajoutés aux multiples fractures et hématomes constatés sur l’ensemble du corps du requérant attestent de l’intensité de la force physique dont il a été fait usage à son encontre.
66. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les moyens employés n’étaient pas strictement nécessaires pour permettre l’interpellation du requérant et que la force physique dont il a été fait usage à son encontre n’a pas été rendue telle par son comportement.
67. Partant, et eu égard aux conclusions des paragraphes 63 et 66 ci-dessus, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Kanciał c. Pologne du 23 mai 2019 requête n° 37023/13
violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, dans son volet matériel comme dans son volet procédural.
L’usage excessif de la force par la police et l’absence d’enquête adéquate ont emporté violation des droits d’un requérant polonais
Dans cette affaire, le requérant alléguait qu’il avait été victime de brutalités policières au cours d’une intervention des forces de l’ordre, et en particulier que des policiers avaient fait usage d’une arme à impulsion électrique. La Cour juge que la police a fait un usage excessif de la force contre le requérant, qui avait déjà été immobilisé au moment des faits, et que ses allégations de mauvais traitements n’ont pas fait l’objet d’une enquête
LES FAITS
Le requérant fut arrêté en juin 2011 dans le cadre d’une enquête sur un enlèvement, après que la police l’eut identifié comme un suspect éventuel parmi les amis de la famille de la victime et les employés de l’entreprise familiale. Il fut remis en liberté deux jours plus tard et fut par la suite mis totalement hors de cause. Il se plaignit ensuite auprès des autorités d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et de son arrestation, au cours de laquelle un groupe de policiers armés et masqués de la section antiterroriste avait pris d’assaut l’appartement dans lequel il se trouvait. Il affirma notamment qu’il avait été frappé à la tête, dans le dos et sur la nuque, et qu’il avait reçu des décharges dans le dos, les fesses et les parties génitales au moyen d’une arme à impulsion électrique. En juillet 2011, une procureure enregistra ses allégations d’abus de pouvoir par des agents de police, mais elle classa l’affaire l’année suivante. Elle recueillit les dépositions du requérant et d’autres personnes qui avaient été présentes dans l’appartement, ainsi que celles des policiers et d’un expert médicolégal. Elle examina également les rapports médicaux relatifs aux blessures du requérant. La procureure conclut qu’on ne pouvait certes pas exclure la version des faits du requérant ni nier qu’il avait été blessé au cours de l’intervention de la police, mais qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour confirmer que les policiers avaient commis une infraction. Elle estima notamment que l’arme à impulsion électrique avait été utilisée conformément aux procédures applicables, à un moment où le requérant refusait d’obtempérer aux ordres de la police. Le requérant fit appel de cette décision mais fut débouté en justice en mars 2013.
CEDH
Volet matériel de l’article 3
La Cour estime qu’il ne fait aucun doute que le requérant ait été blessé au cours de son arrestation. Elle relève dans le même temps que les policiers ne sont autorisés à faire usage de la force au cours d’une arrestation que dans la mesure où pareil usage s’avère indispensable et n’est pas excessif. Elle distingue deux phases dans l’arrestation du requérant : la phase précédant le moment où il s’est trouvé menotté et sous le contrôle de la police, et la phase suivant son immobilisation.
Elle ne parvient toutefois pas à déterminer si la police a fait un usage excessif de la force au cours de la première phase, les versions divergeant. D’après les autorités, les policiers ont fait usage d’une arme à impulsion électrique car le requérant refusait d’obtempérer aux ordres de la police et de se laisser menotter. Le requérant, quant à lui, affirme qu’il a obéi aux ordres mais qu’il a tout de même été frappé.
Au cours de la seconde phase de son arrestation, le requérant a souffert de contusions et d’ecchymoses, également constatées dans un rapport médicolégal. La procureure, qui n’a pas expliqué l’origine de ces blessures, a suggéré qu’elles avaient d’une manière ou d’une autre résulté de la rapidité de l’intervention de la police.
Si la Cour n’est pas en mesure de déterminer l’origine des contusions, elle n’est pas convaincue par les observations de la procureure. En fait, ni la procureure ni le Gouvernement n’ont montré que la police avait eu besoin de faire un usage de la force de nature à causer pareilles blessures.
En d’autres termes, le Gouvernement n’a pas apporté la preuve du caractère strictement nécessaire de l’usage de la force qui a été fait à ce stade de l’intervention. L’enquête n’a pas non plus permis de faire la lumière sur l’usage qu’ont fait les forces de l’ordre d’une arme à impulsion électrique.
Le requérant a déclaré avoir reçu plusieurs impulsions sur différentes parties de son corps, et le rapport médicolégal semble corroborer ses allégations. Les marques constatées sur le corps du requérant correspondent aux types de blessures infligées par cette arme lorsqu’elle est utilisée en mode « contact », lequel, d’après le Comité pour la prévention de la torture, cause de violentes douleurs localisées et peut entraîner des brûlures.
En outre, la règlementation interne relative à l’usage de la force par les forces de l’ordre limite notamment l’usage des armes à impulsion électrique aux seuls cas où les autres moyens de coercition se sont avérés inefficaces ou impossibles à mettre en œuvre.
La Cour conclut que les représentants des forces de l’ordre n’ont pas été contraints de faire usage de la force une fois le requérant immobilisé, et que cet usage était donc excessif. Il apparaît également que les actes des forces de l’ordre étaient contraires à la loi, en vertu de laquelle la police peut faire usage de la force dans le seul but de faire respecter les ordres qu’elle donne.
Eu égard à la nature des blessures subies par le requérant et aux souffrances mentales et physiques qui en ont résulté, la Cour conclut que l’intéressé a subi des traitements inhumains et dégradants, en violation du volet matériel de l’article 3.
Volet procédural de l’article 3
Examinant sous le volet procédural de l’article 3 l’enquête menée à propos des allégations de mauvais traitements aux mains de la police, la Cour relève de graves vices de procédure.
Elle observe en particulier que les autorités n’ont pas répondu à des questions importantes, et notamment à la question de savoir de quelle manière les policiers ont fait usage de la force et dans quelles circonstances le requérant a été blessé. Les autorités en charge de l’enquête n’ont pas non plus cherché à répondre à certaines questions essentielles concernant le recours à une arme à impulsion électrique. En particulier, elles ne se sont pas penchées sur l’allégation du requérant selon laquelle cette arme a été utilisée contre lui de façon répétée, alors qu’il avait déjà été immobilisé et était maintenu au sol.
Ni la procureure ni les juridictions internes n’ont procédé à une analyse appropriée de la légalité des mesures prises.
La Cour, en revanche, estime qu’il était nécessaire de mener une enquête rigoureuse sur la nécessité d’un recours à une arme de ce type, d’autant plus que l’on sait que ces armes causent des douleurs intenses et une paralysie temporaire lorsqu’elles sont utilisées comme en l’espèce.
En outre, les autorités ont accepté la version des faits donnée par la police et ont accordé un poids bien moindre à la déposition du requérant, alors que celle-ci était corroborée par des certificats médicaux. La procureure n’a pas tenu compte du fait qu’avant qu’elle ne rende sa décision, le requérant et ses complices supposés avaient été mis hors de cause.
L’enquête n’était donc pas conforme aux normes requises par la Convention. Partant, il y a eu violation du volet procédural de l’article 3.
Portu Juanenea et Sarasola Yarzabal c. Espagne du 13 février 2018 requête n° 1653/13
Article 3 : L'Espagne et ses démons néo franquistes : deux militants basques arrêtés et torturés dont l'un durant cinq jours. Réponse du Gouvernement Rajoy. Ils sont tombés ! Heureusement, ils ont la présence d'esprit de se faire faire des certificats médicaux dont certains de médecins légistes à la sortie de leurs garde à vue !
i. Principes généraux
69. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (voir, notamment, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 315, CEDH (extraits), et Bouyid, précité, § 81) et un droit absolu et inaliénable étroitement lié au respect de la dignité humaine (Gäfgen, précité, § 107, et Bouyid, précité, ibidem). Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et, d’après l’article 15 § 2 de la Convention, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée (voir, notamment, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, et Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 113, CEDH 2014 (extraits)).
70. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à la qualification juridique des mauvais traitements (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006‑IX, et Bouyid, précité, §§ 86-87; pour les facteurs à considérer, voir, parmi beaucoup d’autres, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 64, Recueil 1996‑VI, Egmez, précité, § 78, Krastanov c. Bulgarie, no 50222/99, § 53, 30 septembre 2004, et Al Nashiri c. Pologne, no 28761/11, § 508, 24 juillet 2014 ; pour le contexte, telle une atmosphère de vive tension et à forte charge émotionnelle, voir, entre autres, Selmouni, précité, § 104, et Egmez, précité, § 78). Par ailleurs, lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (voir, notamment, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 207, CEDH 2012, et Bouyid, précité, §§ 88 et 101).
71. Plus précisément, en ce qui concerne la qualification juridique de torture, la Cour renvoie aux principes dégagés dans son arrêt Cestaro c. Italie (no 6884/11, §§ 171-176, 7 avril 2015). En principe, pour déterminer si une forme donnée de mauvais traitement doit être qualifiée de torture, elle doit avoir égard à la distinction que l’article 3 de la Convention opère entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi qu’elle l’a déjà relevé, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (Gäfgen, précité, § 90, avec les arrêts qui y sont cités, et El-Masri, précité, § 197). Le caractère aigu des souffrances est « relatif par essence ; il dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. » (Selmouni, précité, § 100). Outre la gravité des traitements, la « torture » implique une volonté délibérée, ainsi que le reconnaît la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui définit la « torture » comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d’obtenir d’elle des renseignements, de la punir ou de l’intimider (Gäfgen, précité, § 90, El-Masri, précité, § 197, et Cestaro, précité, § 171).
72. Les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Jalloh, précité, § 67, Bouyid, précité, § 82, et Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 122, 2 novembre 2004).
73. Sur ce dernier point, la Cour a précisé que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII, Turan Çakır c. Belgique, no 44256/06, § 54, 10 mars 2009, Gäfgen, précité, § 92, Mete et autres c. Turquie, no 294/08, § 112, 4 octobre 2012, et El-Masri, précité, § 152). En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement (voir, notamment, El-Masri, précité, § 152). Cela est justifié par le fait que les personnes placées en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (voir, notamment, Salman, précité, § 99, et Bouyid, précité, § 83).
74. La Cour a également indiqué que, si elle reconnaît qu’elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie, elle doit se livrer à un « examen particulièrement attentif » lorsque des allégations sont formulées sur le terrain de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ribitsch, précité, § 32, et El-Masri, précité, § 155), quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées au plan interne (Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, § 65, 26 juillet 2007). En d’autres termes, la Cour est disposée, dans un tel contexte, à examiner d’une manière approfondie les conclusions des juridictions nationales. Pour ce faire, elle peut prendre en compte la qualité de la procédure interne et toute déficience propre à vicier le processus décisionnel (Denissenko et Bogdantchikov c. Russie, no 3811/02, § 83, 12 février 2009, et Bouyid, précité, § 85). Même si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins d’habitude des éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles ils sont parvenus (Gäfgen, précité, § 93).
ii. Application de ces principes aux circonstances de l’espèce
75. La Cour observe qu’elle se trouve confrontée à des versions divergentes, notamment en ce qui concerne la conduite des agents de la garde civile lors de l’arrestation et de la détention des requérants ainsi que sur l’origine des lésions subies par ceux-ci pendant cette période. D’une part, les requérants, en s’appuyant sur l’établissement des faits du jugement de première instance de l’Audiencia Provincial, allèguent avoir été battus par les agents de la garde civile responsables de leur arrestation et de leur transfert au poste de la garde civile d’Intxaurrondo le 6 janvier 2008. D’après cette version, après leur arrestation, à 10 h 30, les requérants ont été placés dans deux véhicules différents de la garde civile, où ils ont reçu des coups de la part des trois gardes civils qui les accompagnaient, pendant le transfert jusqu’au poste d’Intxaurrondo, qui a pris fin à 12 h 25, à leur arrivée audit poste et lorsque leur surveillance a été confiée à d’autres agents de la garde civile. Pendant le transfert, les agents ont fait descendre les requérants des véhicules lors du passage par une piste forestière coupée à la circulation, où ils ont continué à les battre séparément. D’autre part, le Gouvernement s’en remet à la version des faits établie par le Tribunal suprême dans son arrêt de cassation, mettant en doute la version des requérants et de l’Audiencia Provincial, notamment quant à l’absence alléguée de résistance des requérants au moment de l’arrestation et au passage et arrêt des véhicules de la garde civile sur la piste forestière mentionnée. Le Gouvernement considère que le Tribunal suprême a fait en dernière instance une appréciation raisonnable des éléments de preuve existants, en concluant que ceux-ci n’étaient pas suffisants pour renverser la présomption d’innocence des gardes civils accusés et condamnés en première instance.
76. La Cour note qu’il ressort des premiers rapports établis par les deux médecins légistes de l’institut médicolégal basque que les requérants présentaient de multiples lésions dans les régions céphalique, thoracique et abdominale, ainsi que dans les extrémités supérieures et inférieures en ce qui concerne le premier requérant (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Ces rapports ont été établis la nuit du 6 au 7 janvier 2008, tout de suite après la sortie des requérants du poste de la garde civile d’Intxaurrondo, où ils avaient été conduits par les gardes civiles qui les avaient arrêtés, et les perquisitions à leurs domiciles respectifs qui ont eu lieu le même jour que les événements litigieux, ce qui conforte leur caractère probant. Le premier requérant a immédiatement été conduit à l’hôpital Arantzazu de Saint-Sébastien, où un autre rapport médical a été dressé par un médecin de cet hôpital. Ce rapport faisait état de contusions et d’érosions multiples, et notamment d’une fracture costale et d’une contusion pulmonaire, confirmant ainsi un pronostic très grave (paragraphe 19 ci-dessus). Le premier requérant a alors été transféré au service des soins intensifs de l’hôpital, où il est resté jusqu’au 9 janvier 2008. Les lésions de l’intéressé ont nécessité 27 jours de traitement, dont cinq jours d’hospitalisation. Quant au second requérant, il a été conduit en voiture à Madrid, où il a été placé dans les locaux de la Direction générale de la garde civile et détenu au secret jusqu’au 11 janvier 2008. Lors de son arrivée à Madrid, il a été examiné par le médecin légiste près l’Audiencia Nacional, qui a constaté plusieurs lésions qui étaient selon lui compatibles avec des manœuvres de détention violente ou de contention (paragraphe 22 ci-dessus). Les lésions du second requérant ont nécessité 14 jours de traitements anti-inflammatoires.
77. Quant à l’origine des lésions, la Cour relève que deux médecins légistes de l’institut médicolégal basque ont établi deux autres rapports qui ont été présentés devant le juge d’instruction no 1 de Saint-Sébastien les 10 et 12 septembre 2008 respectivement, lors de la phase d’instruction (paragraphe 33 ci-dessus). Ces rapports, établis sur la base des rapports médicaux déjà émis, du matériel graphique et des photographies contenues dans ces rapports, des déclarations des requérants et des gardes civils impliqués, ont conclu à l’existence d’éléments laissant penser que les lésions constatées – pour ce qui est du premier requérant – ou certaines des lésions constatées – pour ce qui est du second requérant – avaient pu se produire conformément aux déclarations des requérants selon lesquelles ils avaient été battus par les agents de la garde civils après leur arrestation et pendant leur transfert à Intxaurrondo. Ces deux médecins légistes ont été par la suite entendus en tant qu’experts lors de l’audience publique devant l’Audiencia Provincial, qui s’est appuyée sur leurs expertises pour conclure que les lésions constatées étaient pour la plupart dues à une agression réitérée et directe, et non à l’usage d’une technique d’immobilisation au cours de l’arrestation des requérants, contrairement à ce que soutenaient les gardes civils accusés (paragraphe 44 ci-dessus).
78. Certes, comme l’indique le Gouvernement dans ses observations, la version des requérants n’a pas toujours été concordante. La Cour note par exemple que le second requérant a évoqué, lors de son premier examen par des médecins légistes, le 7 janvier 2008, les circonstances violentes de son arrestation ainsi qu’une une tentative de fuite, ce qui est plus compatible avec la version défendue par les gardes civils selon laquelle les requérants ont fait preuve de résistance au cours de leur arrestation (paragraphe 18 ci‑dessus). Le 9 janvier 2008, lors de son troisième examen médical à Madrid, le second requérant a affirmé ne pas avoir été maltraité (paragraphe 24 ci-dessus). Cependant, la Cour ne saurait dénier, en raison de ce seul fait, toute crédibilité au récit des requérants tel qu’il a été présenté tout au long de la procédure interne. Ainsi, elle note que les requérants ont dénoncé sans délai les mauvais traitements allégués auprès du juge d’instruction de Saint-Sébastien, à savoir deux jours après l’arrestation, le 8 janvier 2008, dans le cas du premier requérant, et six jours après l’arrestation, le 12 janvier 2008, dans le cas du second requérant (comparer avec Beortegui Martinez, précité, §§ 39 et 44). Elle relève que les intéressés ont d’ailleurs précisé lors des audiences publiques devant l’Audiencia Provincial qu’ils n’avaient pas dénoncé tous les mauvais traitements dont ils estimaient avoir été victimes auprès des premiers médecins légistes en raison des menaces qu’auraient proférées à leur égard les gardes civils en cause (paragraphe 36 ci-dessus).
79. La Cour observe ensuite que le Tribunal suprême a mis en doute la version des requérants telle qu’elle avait été partiellement acceptée par le jugement de l’Audiencia Provincial. Pour ce faire, il a procédé à une nouvelle appréciation des preuves et a considéré que les déclarations des requérants répondaient aux ordres donnés par l’organisation terroriste ETA consistant à porter de fausses plaintes pour tortures contre les forces de sécurité de l’État espagnol. Estimant que les déclarations des requérants étaient mensongères, le Tribunal suprême a dénié toute valeur probante aux rapports des médecins légistes de l’institut médicolégal basque sur lesquels s’était appuyée l’Audiencia Provincial, au motif que ceux-ci étaient fondés sur des prémisses fausses. Il a par ailleurs considéré que le manque de sincérité des requérants ne permettait pas d’établir la preuve de l’origine des lésions ni de déterminer si des excès s’étaient produits au moment de l’arrestation des intéressés.
80. Or la Cour constate que les médecins légistes ont également examiné dans leurs rapports la version défendue par les gardes civils selon laquelle les requérants avaient violemment résisté à leur arrestation, et conclu que cette version n’était pas compatible avec la plupart des lésions constatées. En ce qui concerne plus particulièrement les lésions les plus graves présentées par le premier requérant – des fractures des côtes et leurs conséquences –, le Tribunal suprême, sur la base d’une nouvelle lecture des rapports des experts, a conclu dans son considérant no 21 que celles-ci étaient le résultat des facteurs « postérieurs», survenus le lendemain de l’arrestation, et « indéterminés » (paragraphe 49 ci-dessus). Le Tribunal suprême ne s’est livré à aucune appréciation sur la manière ni sur le moment où ces blessures avaient été causées au premier requérant. Or, selon le jugement de l’Audiencia Provincial, tous les experts s’accordaient à dire que les fractures des côtes du premier requérant étaient survenues de façon progressive, tout au long du jour de l’arrestation, et qu’elles avaient probablement été causées par le mouvement du véhicule et par la position assise de l’intéressé lors de son transfert à Intxaurrondo.
81. En tout état de cause, et indépendamment de cette divergence entre l’arrêt du Tribunal suprême et le jugement de l’Audiencia Provincial, la Cour ne peut que constater que le Tribunal suprême s’est limité à écarter la version des requérants sans pour autant déterminer l’origine des lésions subies, établies par les rapports médicaux, au regard de leur arrestation et détention par les membres de la garde civile, ou l’éventuelle part de responsabilité de ces agents. À supposer même que la version du Tribunal suprême sur l’origine des lésions au moment de l’arrestation puisse être acceptée, cette juridiction n’a pas exploré davantage la question de savoir si le recours à la force physique par les agents de la garde civile pendant cette opération était strictement nécessaire et proportionné (voir, mutatis mutandis, Iribarren Pinillos c. Espagne, no 36777/03, § 56, 8 janvier 2009) ou si les lésions les plus graves subies par le premier requérant, après son arrestation selon le Tribunal suprême, étaient imputables aux agents responsables de son maintien en détention et de sa surveillance, alors que celui-ci se trouvait toujours placé en garde à vue et donc sous le contrôle de la garde civile.
82. La Cour note que le Gouvernement ne fait que renvoyer à l’issue de la procédure pénale interne et à l’appréciation faite par le Tribunal suprême. Or elle rappelle que, quelle que soit l’issue de la procédure engagée au plan interne, l’acquittement des agents des forces de sécurité ne saurait dégager l’État défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention ; c’est à lui qu’il appartient de fournir une explication plausible sur l’origine des lésions (Selmouni, précité, § 87, Rivas c. France, no 59584/00, § 38, 1er avril 2004, et Ghedir et autres c. France, no 20579/12, § 112, 16 juillet 2015). En l’espèce, même si l’on accepte l’hypothèse du Tribunal suprême sur l’origine des lésions au moment de l’arrestation, le Gouvernement n’a pas démontré les circonstances exactes de l’arrestation des requérants ni établi que la force utilisée par les agents impliqués lors de cette opération avait été proportionnée.
Quant aux lésions qui auraient pu survenir ultérieurement à l’arrestation et au transfert des requérants à Intxaurrondo, le Gouvernement se limite à soutenir que la plainte pour tortures des requérants ne se rapportait à aucun fait qui aurait eu lieu après l’arrivée des requérants à la caserne de la garde civile. Or la Cour note que la plainte des requérants devant les juridictions internes portait aussi sur des mauvais traitements qui leur auraient été infligés après leur arrestation, et que l’Audiencia Provincial a examiné aussi cette période (paragraphe 41 ci-dessus).
83. Eu égard à ce qui précède, la Cour juge qu’il est suffisamment établi que les lésions décrites dans les certificats produits par les requérants, dont l’existence n’a été niée ni par le Tribunal suprême ni par le Gouvernement, sont survenues alors qu’ils se trouvaient entre les mains de la garde civile. Elle considère que ni les autorités nationales ni le Gouvernement n’ont fourni d’arguments convaincants ou crédibles pouvant servir à expliquer ou justifier dans les circonstances de l’espèce les lésions subies par les requérants. Partant, la Cour estime la responsabilité des lésions décrites doit être imputée à l’État défendeur.
84. Dans la mesure où les requérants n’ont pas allégué que les lésions en question ont eu des conséquences à long terme sur eux (comparer avec Cestaro, précité, §§ 155 et 178) et en l’absence de preuve concluante relative au but des traitements infligés (Krastanov, précité, § 53, et comparer avec Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, §§ 67-70, 24 juillet 2008), la Cour estime que les mauvais traitements infligés aux requérants ne sauraient être qualifiés de tortures. Cela étant, ils étaient suffisamment graves pour être considérés comme des traitements inhumains et dégradants.
85. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
b) Sur le volet procédural de l’article 3 de la Convention
i. Principes généraux
86. La Cour renvoie aux principes généraux énoncés, notamment, dans les arrêts El-Masri (précité, §§ 182-185), Mocanu et autres (précité, §§ 316-326), et Bouyid (précité, §§ 115-123).
87. Il en ressort que, pour que l’interdiction générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s’adressant notamment aux agents publics s’avère efficace en pratique, il faut qu’existe une procédure permettant d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements infligés à une personne se trouvant entre leurs mains. Ainsi, notamment, compte tenu du devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », les dispositions de l’article 3 requièrent par implication qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3 (Bouyid, précité, §§ 115-116). Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et, le cas échéant, à la punition des responsables (voir Martinez Sala et autres, précité, § 156, San Argimiro Isasa c. Espagne, no 2507/07, § 34, 28 septembre 2010, Beristain Ukar c. Espagne, no 40351/05, § 28, 8 mars 2011, B.S. c. Espagne, no 47159/08, § 40, 24 juillet 2012, Otamendi Egiguren, précité, § 38, Etxebarria Caballero, précité, § 43, Ataun Rojo, précité, § 34, Arratibel Garciandia, précité, § 35, et, pour un arrêt récent, Beortegui Martinez, précité, § 37).
88. L’enquête doit être suffisamment vaste pour permettre aux autorités qui en sont chargées de prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui ont eu directement et illégalement recours à la force, mais aussi l’ensemble des circonstances les ayant entourés. Bien qu’il s’agisse d’une obligation non pas de résultat mais de moyens, toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (Mocanu et autres, précité, §§ 321-322, Bouyid, précité, §§ 119-120). L’enquête doit en outre être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête (Bouyid, précité, § 123).
89. Lorsque l’investigation préliminaire a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales, c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’interdiction posée par l’article 3 de la Convention. Ainsi, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’État de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (Okkali c. Turquie, no 52067/99, § 65, 17 octobre 2006, et Cestaro, précité, § 206).
90. La tâche de la Cour consiste donc à vérifier si et dans quelle mesure les juridictions, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, peuvent passer pour avoir soumis le cas porté devant elles à l’examen scrupuleux que demande l’article 3 de la Convention, de manière à préserver la force de dissuasion du système judiciaire mis en place et l’importance du rôle qui revient à ce dernier dans le respect de l’interdiction de la torture (Okkali, précité, § 66, Ali et Ayşe Duran c. Turquie, no 42942/02, § 62, 8 avril 2008, et Cestaro, précité, § 206).
ii. Application de ces principes aux circonstances de l’espèce
91. La Cour relève que, en l’espèce, une instruction pour délits présumés de tortures a été rapidement ouverte devant le juge d’instruction no 1 de Saint-Sébastien. Celle-ci a permis l’audition de plusieurs gardes civils responsables de l’arrestation, des transferts et de la garde à vue au secret des requérants. Des expertises sur l’origine des lésions ont été aussi présentées au cours de cette instruction.
92. En tout état de cause, les requérants dénoncent principalement les défaillances dans la phase de jugement de la procédure pénale engagée contre les agents de la garde civile mis en cause, notamment la manière dont le Tribunal suprême a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de preuve du dossier et les carences dans son raisonnement au regard de l’obligation procédurale imposée par l’article 3 de la Convention d’établir l’ensemble des faits et des circonstances.
93. Quant à la nouvelle appréciation des preuves faite par le Tribunal suprême, qui l’a conduit à rejeter la version des requérants et à modifier substantiellement l’établissement des faits estimés prouvés par l’Audiencia Provincial, la Cour relève que le Tribunal suprême a réexaminé certaines preuves documentaires sur la base du dossier, telles que les différentes expertises médicales et le document saisi auprès du chef de l’organisation ETA, lequel prouverait selon cette juridiction que les plaintes des requérants étaient fausses. Mais le Tribunal suprême ne s’est pas limité à effectuer une interprétation différente des preuves documentaires, il a également réévalué la crédibilité des témoignages des deux requérants, plaignants dans la procédure interne, ainsi que celle des autres témoins – P.E., I.R. et A.A. –qui, selon la haute juridiction, auraient des liens plus ou moins étroits avec les requérants ou avec l’ETA. Cette nouvelle appréciation des preuves de nature personnelle, sans une appréciation directe par le Tribunal suprême et en contradiction avec les conclusions du tribunal d’instance, lequel avait eu l’opportunité d’entendre les requérants, les accusés et tous les témoins lors d’une audience publique, a été déterminante pour parvenir à l’acquittement des gardes civils accusés.
À cet égard, la Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence relative à l’article 6 § 1 de la Convention, lorsque les juridictions d’appel ou de recours réexaminent des preuves de nature personnelle telles que les témoignages des témoins ou des accusés et parviennent à des conclusions opposées à celles établies par la juridiction a quo, les exigences d’un procès équitable peuvent rendre indispensable la tenue d’une audience publique devant la juridiction d’appel ou de recours, afin que celle-ci puisse avoir une connaissance directe et immédiate de ces éléments de preuve (voir Helmers c. Suède, 29 octobre 1991, § 38, série A no 212‑A, et, mutatis mutandis, Igual Coll, précité, §§ 36-37, et Lacadena Calero c. Espagne, no 23002/07, §§ 46-51, 22 novembre 2011). S’il est vrai que les garanties offertes par l’article 6 de la Convention ne s’apprécient pas nécessairement de la même manière que les exigences procédurales des articles 2 ou 3, la Cour a admis que les exigences du procès équitable peuvent inspirer l’examen des questions procédurales sur le terrain de ces dispositions (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 220, 14 avril 2015).
94. En tout état de cause, comme la Cour l’a relevé plus haut (paragraphe 81 ci-dessus), le Tribunal suprême s’est limité dans son arrêt de cassation à écarter la version des requérants sans pour autant chercher à établir si le recours à la force physique par les agents de la garde civile lors de l’arrestation des requérants avait été strictement nécessaire et proportionné ou si les lésions les plus graves subies ultérieurement par le premier requérant – d’après l’établissement des faits du Tribunal suprême – étaient imputables aux agents responsables de la détention et de la surveillance de celui-ci. Ces omissions ont empêché la juridiction nationale d’établir les faits et l’ensemble des circonstances aussi complètement qu’elle aurait pu le faire, conformément à l’obligation de soumettre le cas porté devant elle à l’examen scrupuleux que demande l’article 3 de la Convention.
95. En conclusion, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 sous son volet procédural.
BOUKROUROU et autres c. FRANCE requête n° 30059/15 du 16 novembre 2017
Décès d’une personne atteinte de troubles psychiatriques et ayant subi des mauvais traitements lors d’une intervention policière
Article 2 : Encore la violence de la police en France, la mort n'est pas liée à l'action des policiers qui ont appelé le SAMU et les pompiers très vite. Les policiers ignoraient les problèmes cardiaques de la personne arrêtée. Leurs coups n'ont pas été fatals, même s'il y a un lien de causalité.
En revanche, au sens de l'article 3, les coups de poings dans le plexus, le port inutile des menottes, le fait d'avoir mis la personne arrêtée qui est une personne vulnérable sur le ventre, avec un policier qui le maintient au niveau du dos, l'autre au niveau des fesses et le troisième au niveau des pieds sont disproportionnés au comportement de la personne décédée qui appelait la police au secours, et sont par conséquent, des actes inhumains et dégradants.
ARTICLE 2
54. La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention. Combiné à l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. L’objet et le but de la Convention, en tant qu’instrument de protection des êtres humains, requièrent que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, entre autres, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 146-147, série A no 324, Taïs c. France, no 39922/03, § 82, 1er juin 2006, et Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 174 et 177, CEDH 2011 (extraits)).
55. Eu égard à l’importance de la protection offerte par l’article 2, la Cour doit examiner avec la plus grande vigilance les griefs relatifs à des cas où la mort est infligée, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (cf., par exemple, McCann et autres, précité, § 150, et Scavuzzo-Hager et autres c. Suisse, no 41773/98, § 89, 7 février 2006).
56. La Cour rappelle que les exceptions définies au paragraphe 2 montrent que l’article 2 vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n’est pas son unique objet. Le texte de l’article 2, pris dans son ensemble, démontre que son paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d’avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) (McCann et autres, précité, § 148, et Saoud c. France, no 9375/02, 9 octobre 2007).
57. Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 131, CEDH 2014).
b) L’application de ces principes au cas d’espèce
58. La Cour juge opportun d’aborder le point de savoir si l’action des fonctionnaires de police répond aux exigences de l’article 2 sous l’angle de deux volets distincts : i) la causalité alléguée entre la force utilisée par les policiers et la mort de M.B., ii) la question de savoir si les fonctionnaires de police ont violé l’obligation positive de protéger la vie de M.B., qui était en situation de vulnérabilité et sous leur contrôle (Saoud, précité, § 96).
i) Sur la causalité alléguée entre la force utilisée par les policiers et la mort de M.B. et la prévisibilité des conséquences qui pourraient en résulter
59. S’agissant tout d’abord du lien de causalité entre la force utilisée par les policiers et la mort de M.B., compte tenu des éléments dont dispose la Cour, notammment du rapport d’autopsie du médecin légiste, de la contre expertise médico légale effectuée par deux experts, de l’expertise anatomo-pathologique et du rapport du médecin psychiatre (respectivement paragraphes 27, 34, 35 et 38, ci-dessus), il apparaît que les fonctionnaires de police n’ont pas eu recours à une force en soi fatale pour M.B. La Cour constate en effet, avec les juridictions internes, que l’ensemble de ces expertises médico-légales ont permis d’exclure une mort par compression thoracique, tout en révélant que M.B. souffrait, sans le savoir, d’une sténose athéroscléreuse coronarienne d’environ 70 %. Selon les experts, l’intéressé est décédé subitement de troubles du rythme cardiaque par un spasme coronaire déclenché dans le contexte d’un stress émotionnel et physique intense et prolongé sur un sujet souffrant d’une atteinte athéromateuse sur une artère du coeur. La Cour observe que si l’intervention des fonctionnaires de police a également généré une tension supplémentaire, M.B. présentait un état de nervosité dès son arrivée dans la pharmacie, bien avant leur intervention. La Cour relève que, selon l’expert psychiatre, la victime présentait une affection psychiatrique grave, à savoir une psychose délirante, ce qui expliquait tant l’altercation initiale avec le pharmacien que son état d’agitation extême lorsque les policiers ont tenté de le faire sortir de la pharmacie, leur intervention pouvant avoir été interprétée de « manière délirante », selon les termes utilisés par l’expert psychiatre.
60. Une question distincte est celle de savoir si la force employée par les fonctionnaires de police, même si elle n’était pas fatale en tant que telle, était néanmoins susceptible, face à l’état de faiblesse de M.B., de provoquer sa mort, ou pour le moins de l’accélérer. La Cour est d’avis que dans la mesure où le décès de M.B. est intervenu précisément pendant que les agents essayaient de l’immobiliser, il n’est a priori pas exclu que la force infligée à cette fin ait néanmoins provoqué l’issue fatale (cf. Scavuzzo-Hager et autres, précité, §§ 58 et 60).
61. Concernant ensuite la prévisibilité des conséquences du recours à la force en l’espèce, à supposer même que la lutte entre M.B. et les policiers ait aggravé ses conditions de santé, la Cour rappelle que pour engager la responsabilité internationale de l’Etat défendeur, il faut en plus que les agents aient raisonnablement pu se rendre compte que la victime se trouvait dans un état de vulnérabilité exigeant un degré de précaution élevé dans le choix des techniques d’arrestation « usuelles » ( cf cf. Scavuzzo-Hager et autres, précité, §§ 58 et 60 et dans un autre contexte, mutatis mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 93, CEDH 2001‑III). Or, les policiers avaient certes connaissance de l’existence d’un suivi psychiatrique de M.B., mais ils ignoraient la pathologie cardiaque dont il souffrait. Partant, ils ne pouvaient envisager l’existence d’un danger encouru en raison de l’accumulation de ces deux facteurs, le stress et cette pathologie cardiaque, susceptibles de présenter un risque pour la victime.
62. Compte tenu de ce qui précède, considérant qu’il n’existe aucun motif de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des experts, retenues par les autorités nationales, la Cour estime que s’il existe un certain lien de causalité entre la force utilisée par les policiers et la mort de M.B., cette conséquence n’était quant à elle pas prévisible dans les circonstances de l’espèce.
ii) Sur l’obligation positive pour les autorités de protéger la vie de M.B.
63. La Cour rappelle que, face à des personnes détenues, placées en garde à vue ou venant, comme M.B., d’être interpellées et se trouvant donc dans un rapport de dépendance par rapport aux autorités de l’État, ces dernières ont une obligation de protection de la santé. Celle-ci implique de dispenser avec diligence des soins médicaux lorsque l’état de santé de la personne le nécessite afin de prévenir une issue fatale (voir, Saoud, précité, § 98, et Ketreb c. France, no 38447/09, §§ 73-74 et 93, 19 juillet 2012).
64. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d’autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d’une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 116, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, Scavuzzo‑Hager et autres, précité, § 66, et Saoud c. France, précité, § 99).
65. La Cour estime qu’il convient, au vu des circonstances de l’espèce, de s’interroger sur la prise en compte par les forces de l’ordre de la pathologie psychiatrique de M.B. Elle observe que les forces de l’ordre ne pouvaient ignorer la vulnérabilité résultant de cette pathologie pour ce dernier, ayant été requis par, Mme R., préparatrice en pharmacie, puis leur centre opérationnel afin d’intervenir au sein d’une pharmacie dans laquelle une personne bénéficiant d’un suivi psychiatrique menaçait de « tout casser » et refusait de quitter les lieux. Or, du fait de sa maladie psychiatrique, ce dernier était en situation de vulnérabilité et les policiers se devaient de s’assurer de son état de santé, M.B. étant placé par la contrainte sous leur responsabilité.
66. La Cour note à ce titre que la retranscription des communications permet de connaître précisément la chronologie des faits : les policiers sont arrivés sur site à 16 h 53 et ont demandé l’assistance des pompiers et du SAMU dès 16 h 58, soit 5 minutes seulement après leur arrivée ; les pompiers sont quant à eux arrivés à 17 h 07 ; à 17 h 20, le commandement a été informé que M.B. était en arrêt cardio-ventilatoire ; enfin, la présence du SMUR a été confirmée à 17 h 40. À la lumière de ces éléments, constatés par les juridictions internes et non contestés par les parties, la Cour considère que la demande rapide d’assistance de la part des fonctionnaires de police et l’intervention rapide de ces services de secours sur les lieux (paragraphes 16‑19 ci-dessus) permettent d’exclure tout manquement des autorités quant à leur obligation de protéger la vie de M.B.
67. Compte tenu de ce qui précède, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
ARTICLE 3
a) Principes généraux
77. La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V, Ghedir et autres c. France, no 20579/12, § 108, 16 juillet 2015).
78. La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Ketreb, précité, § 108, et Ghedir, précité, § 109).
79. Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré, étant entendu que la circonstance qu’un traitement n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser la victime n’exclut pas de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (voir, entre autres, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999‑IX, et Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 114, CEDH 2014 (extraits)). Doit également être pris en compte le contexte dans lequel le traitement a été infligé, telle une atmosphère de vive tension et à forte charge émotionnelle (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 86, CEDH 2015).
80. À l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de cette personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Bouyid, précité, § 88). De même, le traitement infligé à un malade mental peut se trouver incompatible avec les normes imposées par l’article 3 s’agissant de la protection de la dignité humaine, même si cette personne n’est pas en mesure, ou pas capable, d’indiquer des effets néfastes précis (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111-113, CEDH 2001‑III).
81. Par ailleurs, l’article 3 de la Convention met à la charge des États parties l’obligation positive de former les agents de maintien de l’ordre de manière à garantir un degré élevé de compétence quant à leur comportement professionnel afin que personne ne soit soumis à un traitement contraire à cette disposition (voir Bouyid, précité, § 108).
b) Application au cas d’espèce
i) Sur l’établissement des faits
82. La Cour relève que l’instruction diligentée en interne a permis d’établir les faits de manière assez claire, le Gouvernement admettant que les lésions sur le corps de M.B., constatées par les experts médicaux, ont été causées par les fonctionnaires de police qui ont procédé à son interpellation le 12 novembre 2009.
83. La Cour estime ensuite, à l’instar des juridictions internes, que le témoignage de Mme S. et de son fils mineur, qui ont déclaré avoir été témoins de coups de pied et de poing violents ainsi que de coups de matraque, volontairement portés à M.B. alors que celui-ci était maintenu allongé, dans le fourgon et sur le perron de la pharmacie, sont sujets à caution. En effet, elle constate que les magistrats instructeurs et le procureur de la République ont relevé que la reconstitution a permis d’établir qu’au vu du temps maussade, de l’absence de luminosité au moment des faits, de l’absence d’éclairage et de la distance, Mme S. et son fils ne pouvaient avoir vu les gestes décrits. Par ailleurs, il ressort de l’information judicaire que le témoignage du mineur relatif à l’épisode s’étant déroulé sur le perron de la pharmacie et à l’usage d’une matraque est en discordance totale avec les autres témoignages. Enfin, les violences décrites par ces témoins ne correspondent pas davantage aux constatations des experts médicaux.
84. En revanche, la Cour observe que des lésions établies par les expertises judiciaires (paragraphe 27 ci-dessus) correspondent aux gestes décrits par les policiers : celles visibles dans la partie basse du thorax et dans le creux épigastrique pouvant correspondre aux deux coups de poing portés au plexus ; celles présentent sur le visage évoquant un contact appuyé sur la surface rugueuse du fourgon ; une plaie à l’arcade sourcilière pouvant s’expliquer par la chute de M.B. sur la tablette du fourgon, des lésions aux poignets caractéristiques du menottage. Au-delà des constatations médicales, la Cour constate que les fonctionnaires de police reconnaissent des gestes à l’encontre de M.B. dont la compatibilité avec l’article 3 se pose.
ii) Sur la qualification du traitement infligé au requérant
85. La Cour relève tout d’abord que, si M.B. avait eu un accès d’énervement à propos des médicaments qu’il voulait échanger, il s’était ensuite assis sur une chaise et qu’aucun témoignage ne le décrit comme particulièrement agité lors de l’arrivée des forces de l’ordre. Elle constate également que si les policiers ont bien demandé à l’intéressé de sortir à plusieurs reprises, devant son refus, ils ont ensuite décidé de passer directement à un mode coercitif en tentant de le faire sortir par la force alors qu’il ne s’agissait pas d’une intervention nécessaire pour maîtriser une personne qui constituait une menace pour la vie ou l’intégrité physique d’autres personnes ou de lui-même (cf. Tekın et Arslan c. Belgique, no 37795/13, § 101, 5 septembre 2017). Les difficultés rencontrées pour parvenir à faire sortir et menotter M.B. ont conduit les forces de l’ordre à lui porter deux coups de poing au plexus. S’agissant de cette action, la Cour n’est pas convaincue par l’explication du Gouvernement selon laquelle ces coups de poing, correspondant à un geste technique enseigné aux fonctionnaires dans le but de créer une diversion et de faciliter le menottage, étaient nécessaires dans les circonstances de l’affaire. En effet, elle note que la violence de ce geste, attestée par le rapport d’autopsie, n’a en réalité eu pour effet que d’amplifier l’agitation et la résistance de M.B., renforçant son sentiment d’exaspération et, à tout le moins, d’incompréhension dans le déroulement des faits. La Cour constate d’ailleurs qu’il ressort des témoignages non contestés que M.B. appelait au secours en réclamant l’intervention de la police, ce qui a conduit l’un des policiers à lui montrer son insigne. Elle relève que l’expert psychiatre a en effet expliqué que M.B., atteint d’une affection psychiatrique grave, avait pu vivre ces gestes sur un mode très persécutif. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que ces coups de poing constituent un traitement ni justifié ni strictement nécessaire, infligé à une personne vulnérable qui ne comprenait manifestement pas l’action des policiers.
86. La Cour se doit également d’examiner le traitement infligé à M.B. à l’intérieur du fourgon de police. L’intéressé a été maintenu sur le ventre, menotté à un point fixe et avec trois policiers debout et pesant de tout leur poids sur différentes parties de son corps, le premier le chevauchant accroupi au niveau des épaules, le deuxième debout sur ses fesses et le troisième debout sur ses mollets. De plus, elle observe que les déclarations des pompiers et des fonctionnaires de police eux-mêmes attestent de la violence de la situation. Les juridictions internes ont quant à elles souligné le caractère inhabituel, voire critiquable, de ces gestes. La Cour relève ainsi que M.B., bien que placé dans une situation de vulnérabilité tant en raison de sa maladie psychiatrique que de sa qualité de personne privée de sa liberté, a littéralement été foulé aux pieds par les forces de police. Ces dernières sont clairement apparues dans l’incapacité de faire face à la situation, qui a semblé leur échapper.
87. La Cour souligne que rien ne laisse supposer que ces violences infligées au requérant auraient été inspirées par une quelconque intention des fonctionnaires de police d’humilier l’intéressé ou de lui infliger des souffrances, mais qu’elles pourraient s’expliquer, comme semble le suggérer le Défenseur des droits lorsqu’il préconise le renforcement de la formation des fonctionnaires de police quant à la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux (paragraphe 39 ci-dessus), par un manque de préparation, d’expérience, de formation adéquate ou d’équipement. Il ne semble pas y avoir eu une réflexion des policiers sur la manière dont ils allaient aborder M.B. et éventuellement réagir face à une réaction négative ou agressive de celui-ci, alors qu’il ressort du dossier qu’ils connaissaient sa problématique psychiatrique (cf. Tekin et Arslan, précité, § 104). Il n’en demeure pas moins que la Cour considère que ces gestes, violents, répétés et inefficaces, pratiqués sur une personne vulnérable, sont constitutifs d’une atteinte à la dignité humaine et atteignent un seuil de gravité les rendant incompatibles avec l’article 3.
88. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
NASRETTİN ASLAN et ZEKİ ASLAN c. TURQUIE du 30 août 2016 requête 17850/11
violation de l'article 3 sur le défaut d'enquête et non violation de l'article 3 sur les faits puisque les policiers ont dû arrêter une cinquantaine de personnes armées de gourdin et de pierres.
1. Sur le volet matériel de l’article 3 de la Convention
a. Thèses des parties
36. Les requérants réitèrent leurs allégations (paragraphe 32 ci-dessus).
37. Le Gouvernement, au sujet des allégations des requérants relatives aux mauvais traitements qu’ils auraient subis lors de leur arrestation, indique que, selon le procès-verbal daté du 4 juin 2010, les agents de police s’étaient rendus sur les lieux de l’incident, car un groupe d’individus était en train de jeter des pierres sur un immeuble où résidaient des policiers. Puis, ce groupe se serait dispersé dans les bâtiments se trouvant aux alentours. Les policiers auraient essayé d’obtenir des informations en interrogeant les habitants du quartier. À ce moment-là, un groupe d’une cinquantaine d’individus aurait commencé à les attaquer avec des pierres et des bâtons. Ce groupe se serait dispersé lors de l’arrivée des renforts de police. Les requérants, qui auraient fait partie du groupe en question, auraient alors été arrêtés. Lors de leur arrestation, les requérants auraient résisté aux policiers et les auraient attaqués. Le Gouvernement indique que c’est la raison pour laquelle les policiers avaient dû recourir à la force pour arrêter les requérants. Il fait valoir que la force utilisée contre les requérants était proportionnée au comportement de ces derniers. De plus, il déclare que les forces de l’ordre ont également été blessées au cours de cette attaque et de l’altercation qui s’en est suivie avec les requérants. Enfin, il explique que les blessures mentionnées dans les rapports médicaux des requérants résultent de l’usage de la force utilisé par la police pour les maîtriser alors qu’ils leur résistaient.
38. En ce qui concerne les allégations des requérants selon lesquelles ils avaient subi des mauvais traitements à l’intérieur du véhicule qui les avait conduits à la direction de la sûreté, le Gouvernement observe qu’il ressort de la déposition de Nasrettin Aslan devant le tribunal qu’il n’a pas réitéré cette allégation. Il estime donc qu’elle ne doit pas être prise en considération. À cet égard, le Gouvernement fait valoir qu’une partie des blessures constatées sur le corps des requérants résultent de leur propre fait puisqu’ils se les seraient infligées eux-mêmes à l’intérieur du véhicule. Par ailleurs, le Gouvernement conteste l’argument des requérants selon lequel les policiers les auraient tenus pour responsables des voies de fait dont se seraient rendus coupables d’autres individus. Il insiste sur la présence des requérants parmi le groupe d’individus qui s’en était pris aux policiers avec des pierres et des bâtons.
b. Appréciation de la Cour
39. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et, en dernier lieu, Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 82, CEDH 2015).
40. La Cour rappelle également que l’article 3 de la Convention ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation. Néanmoins, le recours à la force doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce. À cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer des blessures ou dommages, ou de supprimer des preuves (Alexey Petrov c. Bulgarie, no 30336/10, § 51, 31 mars 2016).
41. La Cour a déjà admis que, en présence d’une résistance physique ou d’un risque de comportements violents de la part de personnes contrôlées, une forme de contrainte de la part des forces de l’ordre était justifiée (voir, parmi d’autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269, et Sarigiannis c. Italie, no 14569/05, § 61, 5 avril 2011). Elle est parvenue aux mêmes conclusions dans des cas de « résistance passive » à une interpellation (Milan c. France, no 7549/03, § 59, 24 janvier 2008), de tentative de fuite face à la force publique (Caloc c. France, no 33951/96, §§ 100-101, CEDH 2000‑IX) ou de refus de fouille de la part d’un détenu (Borodin c. Russie, no 41867/04, §§ 119-121, 6 novembre 2012). Dans ce type de situations, il appartient alors à la Cour de rechercher si la force utilisée était proportionnée au but poursuivi. À cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées aux personnes visées par l’intervention et aux circonstances précises dans lesquelles elles l’ont été (voir, parmi d’autres, Klaas, précité, §§ 26-30, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 72, CEDH 2000‑XII, R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004, et Perrillat-Bottonet c. Suisse, no 66773/13, § 41, 20 novembre 2014).
42. En l’espèce, la Cour relève que les versions respectives des parties diffèrent sur la manière dont les lésions constatées sur les corps des requérants sont survenues. Le Gouvernement, se fondant sur l’enquête pénale menée par le procureur de la République ainsi que sur le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Hakkâri, en attribue la cause à la présence des requérants dans le groupe d’une cinquantaine d’individus qui avait attaqué les policiers au moyen de bâtons et de pierres. Quant aux requérants, ils soutiennent que les blessures constatées sur leur corps avaient pour origine les coups portés par les policiers.
43. Toutefois, la Cour note d’emblée qu’il existe certains éléments matériels incontestés de nature à lui permettre de déterminer si la force utilisée était, en l’occurrence, proportionnée. À cet égard, elle relève que, le jour de faits, une manifestation s’est déroulée dans le centre-ville de Hakkâri. Les policiers impliqués n’ont pas nié avoir porté des coups aux requérants. Ces derniers soutiennent avoir utilisé une force proportionnée par rapport aux comportements des requérants. Enfin, les requérants ne soutiennent pas que les policiers impliqués ou tout autre agent de police les auraient frappés dans les locaux du commissariat de police.
44. Cela étant, la Cour note que, en l’espèce, les requérants se plaignent uniquement des mauvais traitements qu’ils auraient subis de la part des policiers lors de leur arrestation et dans le véhicule de police pendant leur trajet jusqu’à la direction de la sûreté. Elle relève que, selon les constatations du procureur de la République, les requérants ont été arrêtés par les policiers après une course-poursuite et qu’ils faisaient partie du groupe d’une cinquantaine d’individus qui avait attaqué les policiers avec des bâtons et des pierres. En outre, elle note qu’il ressort des éléments du dossier ainsi que des conclusions du procureur de la République que le véhicule des policiers ayant procédé à l’arrestation des requérants ainsi que d’autres biens publics ont été endommagés (paragraphes 17 et 18 ci-dessous). Elle considère que, dans ce contexte, les policiers ont eux aussi été contraints d’utiliser une certaine force pour arrêter les auteurs de ces actes et assurer l’ordre public.
45. La Cour constate en outre qu’une altercation a éclaté entre les policiers en cause et les requérants. En tout état de cause, à la lumière des documents versés au dossier et de l’enquête menée par le procureur de la République, elle note que les requérants, mais aussi les trois policiers impliqués dans l’incident litigieux, présentaient des blessures. À cet égard, la Cour relève d’abord que les requérants ont été jugés coupables par le tribunal correctionnel de Hakkâri respectivement de voie de fait à l’encontre de fonctionnaires en service et de destruction de biens publics. Même si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins d’habitude des éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des observations auxquelles ils sont parvenus. C’est pourquoi, même si la Cour n’est pas en mesure de procéder à sa propre appréciation quant à la survenance exacte des faits à l’origine de l’arrestation des requérants, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et en particulier de la procédure interne menée par le tribunal correctionnel de Hakkâri (paragraphe 25 et 26 ci-dessus), il ne fait pas de doute que les requérants s’en sont pris physiquement aux policiers ou ont fait preuve d’un comportement violent vis-à-vis de ceux-ci.
46. Par ailleurs, la Cour rappelle que le tribunal correctionnel de Hakkâri a établi que les requérants faisaient partie d’un groupe d’une cinquantaine d’individus qui avaient attaqué les policiers avec des bâtons et des pierres et qu’ils avaient aussi endommagé des biens publics et en particulier un véhicule de police. Elle réitère que lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre toutefois pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des choses à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 93, CEDH 2010). En l’occurrence, la Cour ne dispose pas d’éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles le tribunal correctionnel de Hakkâri est parvenu.
47. Partant, à la lumière des faits de l’espèce, des documents versés au dossier et des actes de violence commis de la part des manifestants, y compris les requérants, la Cour n’aperçoit pas d’éléments susceptibles de l’amener à douter de l’origine des lésions relevées sur les corps des requérants et survenues lors de leur arrestation opérée à la suite de l’incident litigieux. La Cour note que le rapport médical établi suite à l’examen des requérants lors de leur placement en garde à vue, c’est-à-dire après l’incident litigieux, fait état de lésions qui peuvent être considérées comme consécutives à la force employée par les policiers pour les arrêter dans un contexte où une cinquantaine de manifestants, armés de bâtons et de pierres, s’en étaient pris à aux forces de l’ordre.
48. Au regard des circonstances qui viennent d’être rappelées et prenant en considération le contexte dans lequel la manifestation s’était déroulée, la Cour conclut qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que les lésions relevées sur le corps des requérants ont résulté de l’utilisation d’une force excessive de la part des policiers par rapport aux actions menées par les requérants à l’encontre des policiers.
49. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
SUR LE VOLET PROCÉDURAL
b. Appréciation de la Cour
52. La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans les arrêts El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 182-185, CEDH 2012, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 316-326, CEDH 2014 (extraits)).
53. Ainsi, notamment, compte tenu du devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », les dispositions de l’article 3 requièrent par implication qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3 (Bouyid, précité, § 116).
54. Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois qui interdisent la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants dans les affaires où des agents ou organes de l’État sont impliqués, et de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des mauvais traitements survenus sous leur responsabilité (Bouyid, précité, § 117).
55. L’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête (Bouyid, précité, § 123).
56. En l’espèce, la Cour rappelle que les requérants se plaignent de l’insuffisance de l’enquête menée par le procureur de la République de Hakkâri. Elle note qu’il ressort des éléments versés au dossier et des observations des parties que le procureur de la République a examiné la plainte pour mauvais traitements que les requérants ont formulée dans leurs dépositions recueillies à la direction de la sûreté juste après l’incident litigieux. Elle relève néanmoins un certain nombre de manquements notables. Il ressort de la décision de non-lieu du procureur de la République qu’il a pris en considération les éléments de preuve matériels à la décharge des policiers. Or, le rôle du procureur de la République était de mener une véritable enquête pénale comprenant toute la palette des mesures d’investigations pour déterminer la responsabilité des acteurs en présence et éclaircir les conditions dans lesquelles les faits s’étaient déroulés.
57. Ainsi, la Cour constate que le procureur de la République a entendu en personne uniquement Zeki Aslan, et pas le second requérant ni les policiers impliqués dans l’incident litigieux. De plus, elle observe que le président de la cour d’assises de Van – qui a confirmé la décision de non-lieu rendue par le procureur de la République – n’a pas jugé nécessaire ni utile d’ordonner les investigations supplémentaires demandées par les requérants dans leur recours présenté le 25 juin 2010. Dans leur recours, ils ont demandé l’audition des témoins de l’incident, des voisins ou des commerçants des alentours ; une reconstitution des faits ; et le visionnage des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du centre-ville (paragraphe 20 ci-dessus). Par conséquent, la Cour considère que les requérants ont démontré que les investigations menées par les autorités internes compétentes n’étaient pas conformes aux exigences procédurales de l’article 3 de la Convention.
58. Partant, il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
POPOVI c. BULGARIE du 9 juin 2016 requête 39651/11
Violation de l'article 3 pour violence inutile de la police lors de l'arrestation du requérant et pour défaut d'enquête.
60. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou psychologiques ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. La Cour a considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à créer chez ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV).
61. La Cour rappelle également que l’article 3 de la Convention ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation. Néanmoins, le recours à la force doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000‑XII, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001). À cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer des blessures ou dommages, ou de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII).
62. La Cour constate que les faits relatifs à l’opération policière en cause n’ont pas été examinés par les juridictions internes : l’enquête pénale menée sur ces événements a été clôturée par le parquet en raison de l’écoulement du délai de prescription (paragraphe 46 ci-dessus). Elle rappelle que, lorsqu’elle a été confrontée à des situations similaires, elle a procédé à sa propre appréciation des faits en respectant les règles fixées par sa jurisprudence (voir, par exemple, Sashov et autres c. Bulgarie, no 14383/03, § 48, 7 janvier 2010).
63. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que les parties ne contestent pas que l’opération policière a été planifiée plusieurs jours à l’avance, qu’elle a été effectuée par une équipe d’agents spéciaux cagoulés et armés, que l’assistante E.S. a essayé d’empêcher ceux-ci d’entrer en refermant la porte d’entrée de l’étude notariale, que les policiers ont poussé la porte, que l’un d’eux a eu recours à une technique d’immobilisation pour maîtriser le requérant qui courait vers lui et que le requérant s’est cogné la tête contre une porte alors que le policier le plaquait au sol, ce qui lui a causé un hématome et une égratignure au front. Elle note que ces faits se trouvent corroborés par les autres pièces du dossier, en particulier par l’enregistrement de l’opération policière par la caméra de vidéosurveillance de l’étude notariale de la requérante (paragraphes 12-16 ci-dessus) et par le registre médical du centre de détention provisoire à Sofia (paragraphe 22 ci‑dessus).
64. Les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour d’établir au-delà de tout doute raisonnable si les policiers ont annoncé à haute voix qu’il s’agissait d’une opération policière, si l’agent qui a maîtrisé le requérant l’a intentionnellement blessé au front et si le requérant a été giflé par le caméraman. La Cour estime cependant que, dans la présente affaire, ces circonstances ne revêtent pas une importance décisive pour ce qui est de l’engagement de la responsabilité de l’État sous l’angle de l’article 3 de la Convention pour plusieurs motifs.
65. La Cour considère que les moyens employés par les forces de l’ordre et le mode opératoire de leur intervention n’apparaissaient pas comme nécessaires dans les circonstances spécifiques de l’espèce. Elle note que le but de l’intervention policière était d’arrêter le requérant, suspecté dans une affaire pénale de corruption active d’un enquêteur, et d’effectuer une perquisition dans les locaux de l’étude notariale de la requérante afin de rechercher des preuves dans le cadre de l’enquête pénale. Elle relève que les soupçons pesant sur le requérant ne concernaient donc pas des actes criminels violents et que, de surcroît, aucun élément du dossier ne permet de conclure que le requérant avait des antécédents de violence et qu’il aurait pu représenter un danger pour les agents de police amenés à intervenir ce jour‑là.
66. Il est vrai que le requérant s’est précipité vers la porte d’entrée de l’étude notariale au moment où les policiers ont pénétré dans les locaux. Ce comportement du requérant est cependant la conséquence directe de l’intervention d’une équipe de policiers cagoulés, armés et vêtus de noir. L’intervention des agents a créé une confusion puisqu’ils ont été perçus comme des malfaiteurs par l’assistante E.S. ; celle-ci a donné l’alerte et le requérant est venu précipitamment à son aide (paragraphes 18-20 ci-dessus).
67. La Cour estime enfin que la technique d’immobilisation à laquelle l’agent de police a eu recours pour maîtriser le requérant n’était guère adaptée à la situation. Eu égard au savoir-faire et l’entraînement spécialisés de l’agent, au fait qu’il pouvait compter sur le soutien de ses quatre collègues et à l’espace confiné où s’est déroulée l’arrestation, à savoir l’entrée de l’étude notariale, la Cour considère que la force employée par l’agent apparaît comme étant disproportionnée au danger que le comportement du requérant risquait de représenter. Elle rappelle que le recours à la technique en question a causé au requérant des lésions sur le front (paragraphe 22 ci-dessus).
68. À la lumière des circonstances susmentionnées, la Cour estime que le requérant a été soumis à un traitement dégradant par la police lors de son arrestation. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
ABSENCE ENQUÊTE EFFECTIVE
71. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998‑VIII).
72. Une telle enquête doit être « effective » dans le sens où elle doit permettre aux autorités de déterminer si le recours à la force était ou non justifié dans les circonstances particulières de l’espèce (Zelilof c. Grèce, no 17060/03, § 55, 24 mai 2007). Un des aspects essentiels d’une enquête effective est sa promptitude – les autorités de l’État sont tenues d’ouvrir une telle enquête dès qu’il existe à leur connaissance des indications suffisamment précises donnant à penser que l’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitement, et ce même en l’absence d’une plainte proprement dite de la part des personnes concernées (voir, par exemple, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 133, CEDH 2004‑IV (extraits)). De même, les organes d’investigation doivent faire preuve de célérité dans l’accomplissement des mesures d’instruction (voir, par exemple, Labita, précité, §§ 133 et 134).
73. L’article 3 de la Convention impose encore que l’enquête en cause soit suffisamment « approfondie » ; les autorités chargées de l’enquête doivent chercher à établir de bonne foi les circonstances de l’espèce, sans négliger les preuves pertinentes ni s’empresser de mettre fin à l’enquête en s’appuyant sur des constats mal fondés ou hâtifs (voir, entre autres, l’arrêt Assenov et autres, précité, §§ 103-105). Les autorités sont tenues par ailleurs de préserver et recueillir les preuves nécessaires à l’établissement des faits, qu’il s’agisse – par exemple – des dépositions de témoins ou des preuves matérielles (Zelilof, précité, § 56). Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les causes des préjudices subis ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (Boicenco c. Moldova, no 41088/05, § 123, 11 juillet 2006).
74. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note qu’une enquête officielle sur les événements ayant entouré l’arrestation du requérant a été ouverte par le parquet de district de Sofia. Le parquet et les organes de l’instruction pénale ont enquêté sur les événements en cause entre le 9 mai 2011 et le 21 mars 2014. Compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce, cette période apparaît comme excessivement longue. La Cour estime à cet égard que l’affaire n’était pas particulièrement complexe : il s’agissait notamment d’identifier l’agent qui avait immobilisé le requérant, de rassembler des preuves médicales sur les lésions causées à celui-ci, d’interroger les témoins oculaires de l’arrestation et d’exploiter les images de l’enregistrement vidéo de l’opération policière.
75. Force est de constater que, à la suite des multiples rebondissements procéduraux de l’enquête (ordonnance de non-lieu, ouverture d’une procédure pénale contre X, suspension et puis reprise des investigations sur décision du tribunal de district), il a été mis fin à l’enquête pour écoulement du délai de prescription (paragraphes 31-46 ci-dessus). Ainsi, l’enquête n’a permis ni d’établir les faits ayant entouré l’arrestation du requérant ni de déterminer, le cas échéant, la responsabilité des policiers que celui-ci avait mis en cause.
76. À la lumière de ces éléments, la Cour considère que l’enquête en cause n’a pas été suffisamment rapide et qu’elle n’a pas été menée avec la diligence requise. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
LES VIOLENCES POLICIÈRES CONTRE UNE FAMILLE
Baysultanov c. Russie du 4 février 2020 requête n° 56120/13
Article 2 : L’intervention armée de la police russe ayant blessé le requérant et tué son épouse a emporté violation du droit à la vie.
L’affaire concerne une opération de police qui visait à arrêter le chef d’un groupe armé illégal et qui a causé le décès de l’épouse du requérant et des blessures au requérant. La Cour dit en particulier que le Gouvernement n’a pas démontré que le recours de la police à la force meurtrière était absolument nécessaire. L’enquête s’est avérée ineffective dès lors que, notamment, elle n’a pas permis de résoudre les contradictions entre les versions des deux parties, la police ayant déclaré que le requérant ou son épouse avait ouvert le feu en premier, ce que le requérant a démenti.
LES FAITS
Le requérant, Gasan Mamatovich Baysultanov, est un ressortissant russe né en 1981 et résidant à Khasavyurt. En novembre 2006, les forces de l’ordre de la République russe du Daguestan programmèrent une opération qui devait permettre d’appréhender un chef militaire d’un groupe armé illégal, qui était présumé être un ancien collègue du requérant et se cacher chez celui-ci à Khasavyurt. L’intervention fut menée par des policiers. Alors que l’opération débutait, la police ouvrit le feu sur le requérant et son épouse, Saniyat Magomedova, et une grenade explosa. Mme Magomedova fut tuée et le requérant blessé. En mars 2017, le requérant fut acquitté des chefs d’appartenance à un groupe armé illégal et d’attaque contre des policiers, mais il fut condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire pour possession illégale d’armes à feu, au motif qu’une kalachnikov avait été découverte sur les lieux de l’intervention et qu’il en aurait été le propriétaire. Le tribunal jugea en particulier que quatre policiers avaient fait de fausses déclarations en affirmant que le requérant et son épouse avaient ouvert le feu en premier. Le requérant nia avoir possédé une kalachnikov. De son côté, le requérant dénonça les faits auprès des autorités, déclarant que la police avait eu recours à la force meurtrière alors que cela n’était pas nécessaire. En juin 2009, un dossier pénal fut ouvert mais l’enquête fut close et reprise plusieurs fois. Elle fut finalement close en septembre 2013, les enquêteurs ayant conclu que le requérant ou son épouse avait tiré en premier sur la police avec la kalachnikov et que la police avait ensuite riposté.
Article 2
Obligation d’enquêter La Cour déplore l’écoulement d’un si long laps de temps avant l’ouverture d’une enquête pénale, qui a débuté en juin 2009, c’est-à-dire plus de deux ans et demi après les faits. Elle relève ensuite diverses carences de l’enquête, qui n’a pas été menée de manière prompte et approfondie. Ainsi, les enquêteurs n’ont pas été capables d’expliquer les contradictions entre les différentes versions des faits qui avaient été présentées – la police ayant déclaré que le requérant et son épouse avaient tiré en premier, ce que le requérant a contesté –, ou d’établir avec certitude que l’un d’eux était armé. Aucune douille de kalachnikov n’a été retrouvée et les prélèvements effectués sur le requérant et son épouse n’ont révélé aucune trace résiduelle de tir. La Cour considère que les autorités internes n’ont pas répondu de manière adéquate à de graves allégations concernant un recours inapproprié à la force meurtrière. Elle fait observer que le manquement d’un État à son obligation de mener une enquête effective favorise un sentiment d’impunité parmi ses agents. De fait, une enquête conforme aux obligations de la Convention sur un tel usage de la force est essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 sous son volet procédural. Responsabilité de l’État quant au décès de Mme Magomedova et aux blessures du requérant Compte tenu des lacunes présentées par l’enquête, notamment quant à une preuve de l’utilisation de la kalachnikov, la Cour ne saurait accepter les conclusions de la police selon lesquelles Mme Magomedova ou le requérant aurait ouvert le feu. Eu égard à son rôle subsidiaire et aux éléments contradictoires et peu nombreux dont elle dispose, la Cour décide de ne pas trancher la question de savoir si le couple était armé. En revanche, elle juge que l’opération de police n’offrait pas de garanties suffisantes. Alors que les policiers auraient dû être préparés à la tournure qu’ont pris les faits, ils ont ouvert le feu, sans sommation, dès que le requérant et son épouse sont sortis de leur maison. Quelque 60 balles ont été tirées, dans la confusion et en l’absence d’un quelconque ordre d’ouvrir le feu. Ni le requérant ni son épouse n’ont eu la possibilité de se rendre. Les policiers ont tiré sur eux plusieurs fois en l’absence de menace immédiate et en étant à couvert. Rien ne pouvait justifier pareille conduite. La Cour conclut que le Gouvernement n’a pas démontré que le recours à la force meurtrière était absolument nécessaire ou se fondait sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des faits. Partant, il y a eu violation de l’article 2 sous son volet matériel.
A c. Russie du 12 novembre 2019 requête n° 37735/09
Violation de l'article 3 : violation des droits d’une enfant de neuf ans ayant assisté à l’arrestation violente de son père par la police
deux violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants/enquête) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concernait l’allégation de la requérante selon laquelle elle avait été traumatisée par l’arrestation violente de son père, à laquelle elle avait assisté à l’âge de neuf ans. La Cour juge crédibles les allégations de l’intéressée et observe que la seule réponse des autorités a consisté en des vérifications préliminaires superficielles et ineffectives. Par ailleurs, les agents des forces de l’ordre, qui savaient que la requérante était ou risquait d’être présente sur les lieux, n’ont en aucune manière pris en compte ses intérêts lorsqu’ils ont planifié et mené leur opération contre le père de l’intéressée et l’ont ainsi exposée à une scène de violence qui l’a gravement affectée, puisqu’elle a en particulier souffert d’un trouble neurologique et de troubles psychiques post-traumatiques pendant plusieurs années après l’arrestation. Selon la Cour, le fait pour la requérante d’avoir assisté à un épisode d’une telle violence s’analyse en un mauvais traitement que les autorités n’ont pas prévenu, au mépris de leurs obligations découlant de l’article 3.
FAITS
En mai 2008, le père de Mme A, qui était alors policier, fut arrêté au cours d’une opération d’infiltration organisée par le Service fédéral de lutte antidrogue (« le FSKN »). Ladite opération se déroula à l’extérieur de l’école de Mme A, après que cette dernière eut été accompagnée à une fête de fin d’année par son père et qu’elle eut pris place dans le véhicule de celui-ci pour rentrer à leur domicile. Selon Mme A, les policiers jetèrent son père à terre, le frappèrent et lui donnèrent des coups de pied dans le torse à plusieurs reprises, tout en refusant de la laisser sortir de la voiture. Mme A aurait finalement réussi à ouvrir la portière de la voiture et à s’enfuir, avant d’être retrouvée dans la rue en état de choc par son oncle, qui l’aurait ramenée chez elle. Peu après, on diagnostiqua chez elle un trouble neurologique, une énurésie et des troubles psychiques post-traumatiques, dont elle affirme qu’ils ne disparurent que plusieurs années plus tard. En juillet 2008, la mère de la requérante saisit le parquet d’une plainte dans laquelle elle affirmait que sa fille souffrait de problèmes de santé qui lui avaient été provoqués par le fait d’avoir assisté au passage à tabac de son père. Des vérifications préliminaires furent effectuées.
Estimant toutefois qu’aucune force physique n’avait été employée contre le père de Mme A et que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient donc pas réunis, les autorités de poursuite refusèrent d’engager des poursuites pénales. Elles s’appuyèrent sur les déclarations de personnes présentes lors de l’incident, essentiellement des agents du FSKN et des témoins instrumentaires de l’opération d’infiltration, ainsi que sur les registres de la prison où le père de Mme A avait été détenu juste après son arrestation, lesquels n’indiquaient la présence d’aucune blessure. La mère de la requérante saisit les juridictions internes qui, en octobre 2008, approuvèrent la décision de ne pas ouvrir d’enquête. Les poursuites engagées contre le père de Mme A pour vente de cannabis furent finalement abandonnées en décembre 2009 au motif que les éléments à charge avaient été obtenus illégalement et qu’ils étaient donc irrecevables.
ARTICLE 3
La Cour juge crédible l’allégation de la requérante selon laquelle elle était présente lorsque son père fut arrêté et frappé. La Cour ne peut exclure que le recours allégué à la force contre le père de la requérante – qui aurait notamment été jeté à terre et frappé à plusieurs reprises – n’ait laissé sur l’intéressé aucune trace physique, comme il l’a lui-même affirmé. Il ressort notamment de ses déclarations, et de celles d’un autre témoin, que les agents du FSKN portaient des survêtements au moment des faits, ce qui laisserait penser qu’ils portaient également des chaussures de sport, et non pas des bottes de l’armée, et pourrait expliquer l’absence de contusions et d’écorchures. Par ailleurs, les déclarations des agents du FSKN, sur lesquelles se sont appuyés les autorités de poursuite et le Gouvernement pour conclure qu’aucune force physique n’avait été employée contre le père de la requérante, s’accordent mal avec les déclarations d’autres témoins, notamment celles d’un agent du Service fédéral de sécurité, présent lors de l’arrestation, qui a reconnu que les agents avaient eu recours à la force.
La violence de l’arrestation a également été corroborée par un électricien qui effectuait des travaux de maintenance sur des feux de signalisation à proximité de l’école de la requérante. La Cour n’est pas convaincue par les motifs invoqués par l’enquête interne – à savoir que ledit électricien aurait été consommateur de stupéfiants – pour qualifier de peu fiable sa déposition. Aucun élément n’a été produit concernant une quelconque procédure administrative qui aurait été engagée contre lui pour consommation de drogue. Malgré l’importance de son témoignage pour établir les faits, ledit électricien n’a en outre jamais été entendu par la commission d’enquête qui a effectué les vérifications préliminaires. La personne qui a mené l’enquête interne était elle-même un agent du FSKN, ce qui soulève par ailleurs des doutes quant à son indépendance. Enfin, la Cour juge dénuées de toute valeur les déclarations des deux témoins instrumentaires de l’opération d’infiltration, selon lesquelles aucune force physique n’aurait été employée contre le père de la requérante. L’un de ces témoins a par la suite admis, au cours de la procédure pénale dirigée contre le père de la requérante, qu’il avait fait un faux témoignage à la demande des agents du FSKN. Il ressort également des déclarations de ces deux témoins qu’ils ne pouvaient pas voir l’intéressé au moment de son interpellation. Tant leurs dépositions que les constats contenus dans la décision d’abandon des poursuites contre le père de la requérante jettent ainsi le discrédit sur les explications des agents du FSKN. Les autorités n’ont toutefois répondu aux allégations crédibles de la requérante que par des vérifications préliminaires, refusant d’engager des poursuites pénales et de mener une véritable enquête. La Cour juge que lesdites vérifications préliminaires n’ont pas fourni au Gouvernement d’éléments de nature à mettre en doute les allégations crédibles de la requérante quant à son exposition à l’arrestation violente de son père, que la Cour considère donc comme établie. Par ailleurs, les autorités n’ont à aucun moment pris en compte les intérêts de la requérante, qui n’avait que neuf ans à l’époque des faits, lorsqu’elles ont planifié et mené leur opération contre le père de l’intéressée. Les agents des forces de l’ordre, qui savaient que la requérante se trouverait sur le lieu de l’opération, ont agi sans tenir compte de sa présence, l’exposant ainsi à une scène de violence envers son père alors même que ce dernier n’avait opposé aucune résistance. La requérante en a été gravement affectée et cela s’analyse, pour la Cour, en un manquement des autorités à leur obligation positive découlant de l’article 3 de prévenir tout mauvais traitement. La Cour voit également dans l’absence d’enquête effective menée sur l’incident du 31 mai 2008 une autre violation de l’article 3. Les simples vérifications préliminaires, qui n’ont pas été suivies d’une enquête préliminaire, ne suffisaient pas à satisfaire aux exigences de l’article 3 de la Convention qui imposent à l’État de mener une enquête effective sur les allégations crédibles de violences commises par des policiers. Compte tenu des conclusions ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs soulevés par la requérante sous l’angle de l’article 13 de la Convention concernant l’absence d’une enquête effective, et sous l’angle de l’article 8, en ce qu’ils s’appuient sur les mêmes faits que les plaintes formulées sur le terrain de l’article 3.
Shevtsova c. Russie du 3 octobre 2017 requête 36620/07
Article 3 : pas d'enquête effective sur les violences de deux policiers qui entrent dans une famille pour tabasser la maîtresse de maison puis son mari venu à son secours.
7. La requérante expose sa version des faits de la manière suivante.
Deux hommes étant entrés dans le jardin, R. sortit pour aller à leur rencontre à l’entrée de la maison. Peu après, elle appela la requérante et lui indiqua que les deux hommes étaient des policiers et qu’ils cherchaient O. Sa sœur étant en état d’ébriété, la requérante lui dit de rentrer à l’intérieur de la maison. Ensuite, la requérante demanda aux policiers de présenter leurs cartes professionnelles, ce qu’ils firent. Ayant été informés par la requérante que O. était absent, les policiers rédigèrent sur place une convocation à comparaître au commissariat de police adressée à O. et demandèrent à la requérante de la lui remettre. La requérante prit la convocation et demanda aux policiers de quitter les lieux. À ce moment, P. insulta la requérante et la saisit par la main pour la tirer en bas de l’escalier d’entrée. T. s’empara également de la main de la requérante. Les deux policiers firent tomber la requérante par terre tout en lui portant des coups. Au moment de sa chute, celle-ci se cogna la tête contre un mur de la maison.
8. Ayant été appelé par R., sa compagne, F., qui se trouvait jusque-là à l’intérieur de la maison, accourut à l’extérieur. Interrogés par celui-ci sur les raisons de leur présence, P. et T. répondirent que cela ne le concernait pas. F. poussa alors T., à la suite de quoi les deux policiers le jetèrent par terre en lui portant des coups, puis le menottèrent. Pendant ce temps, la requérante se rendit dans la maison d’une voisine pour téléphoner à la police.
9. Après avoir menotté F., P. et T. quittèrent les lieux pour conduire ce dernier au commissariat de police, sans procéder à l’arrestation de la requérante.
2. La version du Gouvernement
10. Le Gouvernement confirme que le 6 novembre 2001 les policiers P. et T. se sont rendus au domicile de la sœur de la requérante dans le cadre des recherches menées pour retrouver O. Il expose comme suit sa version des faits.
11. Après que P. et T. eurent remis la convocation adressée à O. à la requérante, celle-ci se comporta d’une manière agressive : elle déchira la convocation et la jeta au visage de T., et elle insulta les deux policiers et se mit à les chasser hors de la maison.
12. La requérante, se trouvant en état d’ébriété, ne cessa pas ses actions même après avoir été prévenue par les policiers du caractère illégal de son comportement. Puisque les actes de la requérante présentaient des éléments d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique – infraction réprimée par l’article 319 du code pénal (CP) –, P. et T. demandèrent à l’intéressée de les suivre au commissariat de police afin de dresser un procès-verbal. Face au refus de la requérante d’obtempérer, ils prirent celle‑ci par les mains afin de la conduire dans la voiture de police. La requérante résista et essaya de tomber sur ses genoux. À ce moment, F. sortit en courant de la maison et donna un coup de pied dans le ventre d’un des policiers. P. et T. furent alors contraints de mettre un terme aux agissements de F. en utilisant la force physique et en le menottant. Ils conduisirent ensuite F. au commissariat de police.
2. Sur le fond
40. La Cour examinera la présente affaire à la lumière des principes généraux exposés dans les arrêts Bouyid c. Belgique [GC] (no 23380/09, §§ 81‑90, CEDH 2015) et El Masri c. « l’ex‑République yougoslave de Macédoine » [GC] (no 39630/09, §§ 182‑185, CEDH 2012).
a) Sur l’effectivité de l’enquête
41. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour constate tout d’abord que les allégations de mauvais traitements que la requérante déclare avoir subis le 6 novembre 2001 ont été examinées par les autorités internes dans le cadre d’une enquête préliminaire sur la base de l’article 144 du CPP (paragraphe 17 ci-dessus). Elle relève ensuite que l’enquête susmentionnée n’a jamais abouti à l’ouverture d’une instruction pénale proprement dite (paragraphes 24‑25 ci-dessus).
42. La Cour souligne avoir déjà jugé que le refus des autorités internes d’ouvrir une instruction pénale au sujet d’un grief défendable de mauvais traitements subis entre les mains de la police est révélateur d’un manquement de l’État à son obligation de conduire une enquête effective prévue par l’article 3 de la Convention (Lyapin, précité, §§ 133-140). Elle ne voit aucune raison d’aboutir à un constat différent en l’espèce. En effet, elle note en l’occurrence que les autorités chargées de l’instruction se sont bornées à recueillir les explications de différentes personnes et se sont appuyées principalement sur ces explications pour rejeter les allégations de la requérante, après les avoir considérées comme non étayées (paragraphe 23 ci‑dessus). Elle note aussi que les autorités chargées de l’instruction, qui ont estimé que les déclarations de la requérante et de ses proches étaient contradictoires, n’ont toutefois pas procédé à des confrontations avec les policiers ou le présumé témoin B. La Cour rappelle à cet égard que des explications recueillies dans le cadre d’une vérification préliminaire ne sont pas assorties des garanties inhérentes à une enquête pénale effective comme, par exemple, l’engagement de la responsabilité pénale pour faux témoignage ou refus de témoigner (Lyapin, précité, § 134).
43. La Cour estime que les défauts constatés sont la conséquence de l’absence d’ouverture d’une instruction pénale, laquelle aurait constitué une réponse adéquate aux allégations de mauvais traitements de la requérante puisqu’elle aurait permis de déployer toutes les mesures d’instruction prévues par le CPP, telles que – entre autres – les interrogatoires, les confrontations, les identifications, les reconstitutions et les expertises (Aleksey Borisov c. Russie, no 12008/06, § 60, 16 juillet 2015).
44. La Cour note ensuite que, bien que les autorités internes aient promptement ordonné une expertise médicolégale pour consigner les lésions corporelles de la requérante, elles ne se sont pas fondées sur les conclusions du médecin légiste. La Cour ne peut que constater que les autorités se sont hâtivement ralliées aux explications des auteurs présumés des mauvais traitements dénoncés par la requérante en refusant d’ouvrir une enquête pénale le 18 novembre 2001, soit un jour avant même que le médecin légiste ne rende son rapport du 19 novembre 2001 (paragraphe 20 ci‑dessus).
45. En ce qui concerne les décisions de refus d’ouverture d’une enquête pénale ultérieures, la Cour note que les autorités internes ont passé sous silence les conclusions de l’expert qui avait expressément indiqué que les lésions sur le visage et le thorax de la requérante avaient été causées à celle‑ci « très probablement » trois à quatre jours avant son examen médical en date du 9 novembre 2001. Puisque l’incident du 6 novembre 2001 était couvert par la période définie par l’expert, la thèse de la requérante quant à l’apparition des lésions était pour le moins défendable. Cependant, les autorités chargées de l’instruction n’ont pas effectué une analyse objective de ces constatations médicales. Notamment, elles n’ont pas essayé d’expliquer l’origine des contusions de l’arcade droite et du thorax présentées par la requérante. Elles n’ont pas non plus cherché à établir si cette dernière présentait ces contusions avant l’intervention des policiers, ce qui leur aurait permis de réfuter la thèse de l’intéressée relative à l’origine de ces lésions.
46. La Cour note enfin que l’enquête n’a pas été menée avec la célérité requise puisque plusieurs mesures d’instruction ont été prises plusieurs années après l’incident litigieux (paragraphe 23 ci-dessus), ce qui a contribué à compromettre son effectivité.
47. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’enquête sur les mauvais traitements dont la requérante avance avoir été victime n’a pas rempli la condition d’effectivité requise. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
b) Sur les allégations de mauvais traitements
48. La Cour rappelle avoir précisé que, lorsque les allégations de mauvais traitements concernaient des évènements qui, dans leur totalité ou pour une large part, étaient connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, tout dommage corporel ou décès survenu pendant cette période de détention donnait lieu à de fortes présomptions de fait (Bouyid, précité, § 83).
49. En l’espèce, la Cour constate que les évènements du 6 novembre 2001 n’étaient pas connus exclusivement des autorités puisque l’incident litigieux ne s’était pas produit dans une zone placée sous le contrôle exclusif des autorités de l’État (voir, a contrario, Zolotarev c. Russie, no 43083/06, §§ 8 et 48, 15 novembre 2016, et Ablyazov c. Russie, no 22867/05, §§ 6 et 49, 30 octobre 2012). Il n’en reste pas moins que, lors des évènements litigieux, les policiers P. et T. agissaient en leur qualité officielle de personnes dépositaires de l’autorité publique et qu’en vertu de la loi la requérante était tenue d’obéir à tout ordre légal émanant de leur part (Shamardakov c. Russie, no 13810/04, § 95, 30 avril 2015), ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement (paragraphe 10 ci‑dessus). La Cour estime donc que le 6 novembre 2001, au cours de la visite des policiers P. et T. au domicile de R., la requérante se trouvait sous le « contrôle » des autorités de l’État.
50. Compte tenu de la thèse du Gouvernement selon laquelle les policiers P. et T. avaient pris la décision d’emmener la requérante au commissariat au motif qu’elle avait commis l’infraction d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, la Cour estime que la requérante s’est retrouvée dans une situation d’arrestation de facto. Par conséquent, conformément à sa jurisprudence bien établie en la matière, la Cour doit rechercher, en tenant compte des blessures occasionnées à la requérante et des circonstances dans lesquelles elles l’ont été, si la force utilisée était strictement nécessaire et proportionnée et si l’État doit être tenu pour responsable des blessures causées à l’intéressée (voir, parmi beaucoup d’autres, Douet c. France, no 16705/10, § 30, 3 octobre 2013). Si, dans le contexte de la présente affaire, les allégations de mauvais traitements dénoncés par la requérante ne donnent pas lieu à de fortes présomptions de fait, la Cour estime que ce constat ne dispense pas le Gouvernement de son obligation d’établir le déroulement des faits de manière satisfaisante et convaincante, éléments de preuve à l’appui (Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 100, 16 décembre 2008).
51. La Cour note ensuite que les parties sont en désaccord quant au déroulement des évènements du 6 novembre 2001. La position du Gouvernement consiste à dire que les policiers P. et T. n’ont ni frappé ni poussé la requérante et que, confrontés à un comportement outrageux de celle-ci, ils ont pris la décision d’emmener l’intéressée au commissariat. Selon le Gouvernement, ce n’est que lorsque la requérante a refusé d’obtempérer à leurs ordres que les policiers ont fait usage de la force à son encontre, et ce uniquement en la saisissant par les bras.
52. Cependant, la Cour trouve peu convaincante la version des faits présentée par le Gouvernement.
53. Tout d’abord, elle note que le Gouvernement s’appuie dans une large mesure sur les conclusions de l’enquête préliminaire menée par les autorités chargées de l’instruction, notamment en se fondant sur les témoignages de B., qui avait confirmé les explications de P. et T. La Cour rappelle à cet égard qu’elle ne saurait tirer aucune conclusion probante d’une enquête qu’elle a jugée ineffective (voir, mutatis mutandis, dans le cadre de l’article 2 de la Convention, Lykova c. Russie, no 68736/11, § 132, 22 décembre 2015).
54. En l’espèce, la Cour a conclu que l’enquête préliminaire menée sur les allégations de mauvais traitements n’avait pas été effective au sens de l’article 3 de la Convention (paragraphe 47 ci-dessus). Eu égard aux défauts constatés, elle estime que les conclusions de ladite enquête ne sont pas suffisantes pour établir le déroulement des faits de manière satisfaisante et convaincante.
55. À ce sujet, la Cour relève que, alors que les autorités chargées de l’instruction, tout comme le Gouvernement devant elle, se réfèrent à un comportement illicite de la requérante lors des évènements du 6 novembre 2001, elles ne se fondent à cet égard sur aucun élément formel. En effet, si les policiers P. et T. avaient agi dans le but de mettre fin au comportement prétendument illicite de la requérante, cette dernière aurait dû faire l’objet de poursuites pénales sur la base soit de l’article 318 (violence sur personne dépositaire de l’autorité publique) soit de l’article 319 (outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique) du CP. Or la décision du 11 novembre 2009 précise expressément qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la requérante pour l’infraction réprimée par l’article 319 du CP (paragraphe 25 ci‑dessus). De surcroît, aucun élément du dossier dont la Cour dispose ne démontre que la requérante a été poursuivie et reconnue coupable de l’infraction réprimée par l’article 318 du CP.
56. Si, comme le suggère le Gouvernement, la requérante avait refusé d’obtempérer aux ordres des policiers P. et T., elle aurait dû être sanctionnée en conformité avec le code des infractions administratives (voir, pour plus de détails sur l’infraction administrative pour le refus d’obéir à un ordre donné par un policier, Frumkin c. Russie, no 74568/12, § 79, CEDH 2016 (extraits)). En tout état de cause, tout usage de la force par les policiers P. et T. aurait dû être suivi par la remise de rapports aux supérieurs hiérarchiques de ces agents, et ce aux fins d’appréciation de la proportionnalité de la force employée en conformité avec la loi sur la police (Davitidze, précité, §§ 91‑93, Ryabtsev, précité, § 43). Or il ne ressort pas des décisions des autorités chargées de l’instruction que celles-ci aient cherché à établir l’existence de tels rapports et, le cas échéant, leur contenu.
57. À la lumière de ces éléments, les conclusions des autorités chargées de l’instruction, tout comme celles du Gouvernement, sur la légalité et la nécessité du recours à la force physique en l’occurrence apparaissent comme dépourvues de fondement suffisant.
58. La Cour note ensuite que, en contestant la présence des hématomes sur le thorax de la requérante lors de l’examen médical du 6 novembre 2001, le Gouvernement, à l’instar des autorités chargées de l’instruction, fait valoir que les faits à l’origine de ces lésions ont pu survenir après l’incident litigieux. La Cour relève que le médecin légiste, en se basant sur les résultats de l’examen médical de la requérante du 9 novembre 2001, a établi que ces hématomes étaient apparus trois à quatre jours avant ledit examen (paragraphe 15 ci‑dessus), ce qui exclut la possibilité d’une apparition des lésions en question après le 6 novembre 2001. Par ailleurs, l’enquête préliminaire a laissé sans réponse la question de savoir quelle était l’origine de la contusion de l’arcade droite constatée sur la requérante tant lors de l’examen médical au service de traumatologie du 6 novembre 2001 que lors de l’examen par le médecin légiste du 9 novembre 2001. Le Gouvernement n’a pas non plus fourni d’explication plausible quant à l’origine de cette blessure.
59. En l’absence d’explications satisfaisantes et convaincantes quant à l’origine des blessures présentées par la requérante, la Cour considère que celles-ci ont été causées à l’intéressée le 6 novembre 2001 lors de l’usage de la force par les policiers P. et T. (comparer avec Ryabtsev, précité, § 75).
60. Se pose donc la question de savoir si la force physique dont il a été fait usage à l’encontre de la requérante était ou non rendue strictement nécessaire par le comportement de cette dernière. Eu égard à ses conclusions aux paragraphes 53‑57 ci‑dessus, la Cour estime qu’aucun élément du dossier ne démontre que la requérante ait fait preuve d’une résistance physique ou d’un risque de comportements violents. Les lésions constatées sur la requérante par le médecin légiste (paragraphe 15 ci‑dessus) attestent de l’intensité de la force physique dont il a été fait usage à l’encontre de l’intéressée. Dans ces circonstances, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré que le recours à la force était à la fois proportionné et strictement nécessaire.
61. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
SLAVOV ET AUTRES c. BULGARIE du 10 novembre 2015 requête 58500/10
Violation de l'article 3 : l'arrestation des requérants durant l'opération Meduse devant leurs enfants et leur famille est un acte inhumain et dégradant.
67. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence : elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou psychologiques ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. La Cour a jugé un traitement « inhumain » notamment parce qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques et morales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV). Elle rappelle en outre que la souffrance psychologique peut résulter d’une situation où des agents de l’État créent délibérément chez les victimes un sentiment de peur en les menaçant de mort ou de maltraitances (Hristovi c. Bulgarie, no 42697/05, § 80, 11 octobre 2011).
68. L’article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation. Néanmoins, le recours à la force doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000‑XII, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001). À cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil 1997‑VIII). La Cour tient à rappeler en particulier que tout recours à la force physique par les agents de l’État à l’encontre d’une personne qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de celle-ci rabaisse sa dignité humaine et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis par l’article 3 (Rachwalski et Ferenc c. Pologne, no 47709/99, § 59, 28 juillet 2009). Ce critère de stricte proportionnalité a également été appliqué par la Cour dans des situations où les personnes concernées se trouvaient déjà sous le contrôle des forces de l’ordre (voir, entre autres Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269, Rehbock, précité, §§ 68-78, et Milan c. France, no 7549/03, §§ 52‑65, 24 janvier 2008).
69. La Cour rappelle enfin que les allégations de mauvais traitements, contraires à l’article 3 de la Convention, doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII).
70. La Cour constate que, dans la présente affaire, les faits relatifs à l’opération policière conduite au domicile des requérants n’ont fait l’objet d’aucun examen de la part des juridictions internes. Elle rappelle que, lorsqu’elle a été confrontée à des situations similaires, elle a procédé à sa propre appréciation des faits tout en respectant les règles fixées par sa jurisprudence à cet effet (voir, à titre d’exemple, Sashov et autres c. Bulgarie, no 14383/03, § 48, 7 janvier 2010).
71. En l’espèce, la Cour constate qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’intervention policière au domicile des requérants a été effectuée très tôt le matin, le 31 mars 2010, par des agents spéciaux du ministère de l’Intérieur qui étaient masqués et armés. Ceux-ci ont immobilisé de force et menotté M. Daniel Slavov. Peu après, ce requérant a été emmené à l’extérieur de la maison, allongé face contre le sol et filmé par un caméraman. L’enregistrement a été transmis aux médias, qui l’ont utilisé à plusieurs reprises, en partie ou dans sa totalité, dans leurs publications et reportages sur l’opération « Méduses » (paragraphes 12, 14, 15 et 37 ci‑dessus).
72. En revanche, les parties sont en désaccord en ce qui concerne la présence des trois autres requérants au domicile familial lors de l’opération policière du 31 mars 2010. Le Gouvernement allègue que Mme Nenkova et ses deux fils mineurs étaient à l’étranger, tandis que la partie requérante soutient que l’épouse de M. Slavov et leurs deux enfants mineurs se trouvaient dans la maison ce jour-là (paragraphes 60 in fine et 63 ci-dessus).
73. La Cour observe que le Gouvernement a présenté une lettre émanant du ministère de l’Intérieur et attestant, entre autres, que les enfants Daniel et Plamen étaient sortis du pays les 10 janvier, 31 octobre et 21 décembre 2010, et que leur mère, Mme Nenkova, était entrée en Bulgarie le 10 janvier 2010 et en était sortie les 14 janvier et 21 décembre 2010. Le Gouvernement en déduit que les enfants et l’épouse de M. Slavov ne se trouvaient pas dans la maison familiale à Varna le matin du 31 mars 2010, lorsque les policiers ont arrêté leur époux et père. La Cour ne partage pas cette position du Gouvernement.
74. En effet, force est de constater que ladite lettre ne contient aucune information sur les dates auxquelles Mme Nenkova et ses enfants sont rentrés en Bulgarie après leurs premières sorties du pays, respectivement le 10 janvier et le 14 janvier 2010. De surcroît, la lettre fait apparaître que l’information contenue dans la base de données du ministère de l’Intérieur sur les déplacements des citoyens bulgares en dehors du territoire national est incomplète en raison notamment de la méthode sélective de contrôle utilisée par les agents de la police bulgare des frontières depuis l’adhésion du pays à l’Union européenne (paragraphe 63 in fine ci-dessus). À la lumière de ces circonstances, la Cour estime que la lettre en question ne démontre pas que ces trois requérants étaient absents de leur domicile à Varna le 31 mars 2010.
75. En revanche, la version des faits des requérants est corroborée par les autres pièces du dossier, notamment les documents délivrés par le médecin de famille et par le pédopsychiatre ayant examiné les enfants peu de jours après l’opération policière (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). La Cour estime donc suffisamment établie l’allégation de la partie requérante selon laquelle Mme Nenkova et ses deux fils étaient présents à leur domicile lors de l’opération policière du 31 mars 2010.
76. La Cour observe que l’opération litigieuse poursuivait le but légitime d’effectuer une arrestation, une perquisition et une saisie et qu’elle avait pour objectif d’intérêt général la répression d’infractions. Elle doit s’assurer que, dans les circonstances de l’affaire, un juste équilibre a été respecté entre les exigences de l’intérêt général de la société et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de l’individu. Elle relève que, même si les quatre requérants n’ont pas été physiquement blessés au cours de l’intervention policière contestée, celle-ci a nécessairement impliqué un certain recours à la force physique : M. Slavov a été immobilisé par des agents cagoulés et armés puis menotté et emmené de force à l’extérieur de la maison. La Cour se doit donc d’établir si ce recours à la force physique était proportionné et absolument nécessaire en l’espèce.
77. Le but de l’intervention policière au domicile des requérants ce jour-là était d’appréhender M. Slavov, suspect dans une affaire pénale de détournement de fonds publics, et d’effectuer une perquisition afin de rechercher des preuves matérielles et documentaires dans le cadre de cette même enquête pénale. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête en cause avait été ouverte cinq mois auparavant, qu’il y avait plusieurs suspects dans cette affaire et que les autorités soupçonnaient l’existence d’une organisation de malfaiteurs (paragraphes 9 et 28 ci‑dessus). Toutefois, la Cour note qu’il ne s’agissait pas expressément d’un groupe d’individus soupçonnés d’avoir commis des actes criminels violents.
78. Pour ce qui est de la personnalité de M. Slavov, la Cour observe qu’il était un homme d’affaires connu à Varna. De surcroît, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il avait des antécédents violents et qu’il aurait pu représenter une menace pour les agents de police amenés à intervenir à son domicile.
79. Il est vrai que M. Slavov détenait légalement une arme à feu et des munitions à son domicile. Ce fait était connu des services de police (paragraphe 64 in fine ci-dessus). C’est sans doute un élément pertinent qui a dû être pris en compte par les agents lors de leur intervention. La Cour considère cependant que la présence de l’arme au domicile des requérants ne saurait suffire à elle seule à justifier le recours à une équipe d’intervention spéciale ni le recours à une force aussi imposante que celle employée en l’espèce.
80. Il est vrai que M. Slavov n’a pas subi de lésions physiques importantes lors de l’intervention en cause. Cependant, la Cour estime particulièrement frappant le fait que les forces de l’ordre ont procédé, à deux reprises, à la reconstitution de l’arrestation de ce requérant, devant ses proches et dans le but d’obtenir un reportage vidéo qui a été livré par la suite aux médias (paragraphes 15 et 37 ci-dessus). La Cour considère que rien en l’espèce ne justifiait de procéder à cette remise en scène de l’arrestation. Elle estime que M. Slavov a éprouvé des sentiments d’humiliation et de rabaissement à ses propres yeux suffisamment intenses pour que le traitement qui lui a été réservé par les forces de l’ordre soit qualifié de « dégradant » au regard de l’article 3 de la Convention.
81. La Cour note par ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier que la présence éventuelle des enfants mineurs et de l’épouse de M. Slavov n’a jamais été prise en compte dans la planification et l’exécution de l’opération policière, et qu’elle n’a, en particulier, pas été mentionnée dans le plan d’intervention prévoyant le déploiement des agents de police (paragraphe 64 ci-dessus).
82. Certes, la Cour ne saurait aller jusqu’à interdire aux forces de l’ordre d’arrêter les suspects d’infractions pénales à leur domicile chaque fois que leurs enfants ou conjoints s’y trouvent. Elle estime cependant que la présence éventuelle de membres de la famille du suspect sur les lieux de l’arrestation est une circonstance qui doit être prise en compte dans la planification et l’exécution de ce type d’opération policière. Cela n’a pas été le cas dans la présente affaire et les forces de l’ordre n’ont pas envisagé d’autres modalités d’exécution de leur opération au domicile des requérants, par exemple retarder l’heure de l’intervention, voire procéder au redéploiement des différents types d’agents impliqués dans l’opération. La prise en compte des intérêts légitimes des trois requérants en l’espèce était d’autant plus nécessaire que Mme Nenkova n’était pas suspectée d’être impliquée dans les infractions pénales reprochées à son mari et que ses deux fils étaient psychologiquement vulnérables en raison de leur jeune âge – quatre et sept ans.
83. La Cour observe également que l’absence d’un contrôle judiciaire préalable sur la nécessité et la légalité de la perquisition en cause a laissé entièrement à la discrétion des autorités policières et des organes de l’enquête pénale la planification de l’opération et n’a pas permis la prise en compte des droits et intérêts légitimes de Mme Nenkova et de ses deux fils mineurs. Elle est d’avis que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, un tel contrôle judiciaire préalable aurait pu permettre la mise en balance de leurs intérêts légitimes avec l’objectif d’intérêt général d’appréhender les personnes suspectées d’avoir commis une infraction pénale.
84. Pour ce qui est de l’effet psychologique de l’intervention policière sur ces trois requérants, la Cour rappelle que les opérations policières impliquant une intervention au domicile et une arrestation des suspects engendrent inévitablement des émotions négatives chez les personnes visées par ces mesures. En l’espèce, elle relève qu’il existe des éléments de preuve concrets et non contestés démontrant que Mme Nenkova et ses deux fils mineurs ont été très fortement affectés par les événements en cause. Durant toute la journée du 31 mars 2010, Mme Nenkova était extrêmement stressée, tremblait de peur, avait des nausées. Elle a également pris des tranquillisants (paragraphe 20 ci-dessus). Pendant plusieurs jours, ses deux fils ont eu un sommeil perturbé et ils ont eu peur de retourner dans leur maison par crainte d’un retour des policiers cagoulés (paragraphe 17 ci-dessus).
Le médecin de famille et le pédopsychiatre qui ont examiné les enfants ont également relevé les traces d’un traumatisme psychologique. Ces spécialistes ont constaté que les enfants étaient émotionnellement très affectés par ce qui s’était passé le 31 mars 2010 (paragraphe 18 ci-dessus) et que le fils aîné, Daniel, présentait un tic nerveux des yeux (paragraphe 19 ci-dessus). La Cour considère également que l’heure matinale de l’intervention policière et la participation d’agents spéciaux cagoulés ont contribué à amplifier les sentiments de peur et d’angoisse éprouvés par ces trois requérants. Elle estime dès lors que le traitement infligé a dépassé le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 de la Convention et que ces trois requérants ont été soumis à un traitement dégradant.
85. En conclusion, après avoir pris en compte toutes les circonstances pertinentes en l’espèce, la Cour considère que l’opération policière au domicile des requérants n’a pas été planifiée et exécutée de manière à assurer que les moyens employés se limitent à ceux strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’arrestation d’une personne suspectée d’avoir commis des infractions pénales et le rassemblement de preuves dans le cadre d’une enquête pénale. Les quatre requérants ont été soumis à une épreuve psychologique qui a généré chez eux de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance, et qui, de par ses effets néfastes, s’analyse en un traitement dégradant au regard de l’article 3. Il y a donc eu en l’espèce violation de cette disposition de la Convention.
Grande Chambre Bouyid C. Belgique du 28 septembre 2015 requête 23380/09
Violation de l'article 3 pour cause matérielle et défaut d'enquête : La famille habitait à côté du commissariat, elle n'était pas aimée et recevait des claques non justifiées de la part des forces de l'ordre.
1. Sur le volet matériel du grief
a) Principes généraux
81. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (voir, notamment, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 87, CEDH 2010, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 195, CEDH 2012, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 315, CEDH (extraits)). En effet, l’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine.
Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d’après l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (ibidem). Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée (voir, notamment, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V et, précités, Labita, Gäfgen et El-Masri, mêmes références, ainsi que Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, § 192, CEDH 2014 (extraits), et Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 113, CEDH 2014 (extraits)).
82. Les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, Labita, précité, § 121, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006‑IX, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 117, CEDH 2006‑IX, et Gäfgen, précité, § 92).
83. Sur ce dernier point, la Cour a précisé que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (voir Salman, précité, § 100, Rivas c. France, no 59584/00, § 38, 1er avril 2004, ainsi que, notamment, Turan Çakır c. Belgique, no 44256/06, § 54, 10 mars 2009, Mete et autres c. Turquie, no 294/08, § 112, 4 octobre 2012, Gäfgen, précité, § 92 et El-Masri, précité, § 152). En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement (voir, notamment, El-Masri, précité, § 152). Cela est justifié par le fait que les personnes placées en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (voir, notamment, Salman, précité, § 99).
84. La chambre a jugé en l’espèce qu’il en allait de même dans le cadre d’une vérification d’identité dans un commissariat (comme dans le cas du premier requérant) ou d’un simple interrogatoire dans un tel lieu (comme dans le cas du second requérant). La Grande Chambre marque son accord. Elle souligne que le principe énoncé au paragraphe 83 ci-dessus vaut dans tous les cas où une personne se trouve entre les mains de la police ou d’une autorité comparable.
85. La Cour a également indiqué dans l’arrêt El-Masri précité (§ 155) que, si elle reconnaît qu’elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (McKerr c. Royaume‑Uni (déc.), no 28883/95, 4 avril 2000), elle doit se livrer à un « examen particulièrement attentif » lorsque des allégations sont formulées sur le terrain de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 32, série A no 336, et Georgiy Bykov c. Russie, no 24271/03, § 51, 14 octobre 2010), quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées au plan interne (Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, § 65, 26 juillet 2007). En d’autres termes, la Cour est disposée, dans un tel contexte, à examiner d’une manière approfondie les conclusions des juridictions nationales. Pour ce faire, elle peut prendre en compte la qualité de la procédure interne et toute déficience propre à vicier le processus décisionnel (Denissenko et Bogdantchikov c. Russie, no 3811/02, § 83, 12 février 2009).
86. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni, précité, § 162, Jalloh, précité, § 67, Gäfgen, précité, § 88, El-Masri, précité, § 196, et Svinarenko et Slyadnev, précité, § 114). Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré (comparer, entre autres, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 64, Recueil 1996‑VI, Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 78, CEDH 2000‑XII, et Krastanov c. Bulgarie, no 50222/99, § 53, 30 septembre 2004 ; voir aussi, notamment, Gäfgen, précité, § 88, et El-Masri, précité, § 196), étant entendu que la circonstance qu’un traitement n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser la victime n’exclut pas de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (voir, entre autres, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999‑IX, et Svinarenko et Slyadnev, précité, § 114). Doit également être pris en compte le contexte dans lequel le traitement a été infligé, telle une atmosphère de vive tension et à forte charge émotionnelle (comparer, par exemple, Selmouni, précité, § 104, et Egmez, précité, § 78 ; voir aussi, notamment, Gäfgen, précité, § 88).
87. Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de sévices de ce type, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 (voir, parmi d’autres, Vasyukov Russie, no 2974/05, § 59, 5 avril 2011, Gäfgen, précité, § 89, Svinarenko et Slyadnev, précité, § 114, et Géorgie c. Russie (I), précité, § 192). Il faut en outre préciser qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui (voir, parmi d’autres, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 32, série A no 26, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 220, CEDH 2011).
88. Par ailleurs, au regard des faits de la cause, la Cour estime particulièrement important de souligner que lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (voir, notamment, Ribitsch, précité, § 38, Mete et autres, précité, § 106, et El-Masri, précité, § 207).
89. Le terme « dignité » figure dans de nombreux textes et instruments internationaux et régionaux (paragraphe 45-47 ci-dessus). Si la Convention ne mentionne pas cette notion – qui apparaît néanmoins dans le préambule du Protocole no 13 à la Convention relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances –, la Cour a souligné que le respect de la dignité humaine se trouve au cœur même de la Convention (Svinarenko et Slyadnev précité, § 118) et qu’avec la liberté de l’homme, elle en est l’essence même (C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 42, série A no 335‑C, et S.W. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 44, série A no 335‑B ; voir aussi, notamment, Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 65, CEDH 2002‑III).
90. Par ailleurs, il existe un lien particulièrement fort entre les notions de peines ou traitements « dégradants », au sens de l’article 3 de la Convention, et de respect de la « dignité ». Dès 1973, la Commission européenne des droits de l’homme a souligné que, dans le contexte de l’article 3 de la Convention, l’expression « traitements dégradants » montrait que cette disposition visait en général à empêcher les atteintes particulièrement graves à la dignité humaine (Commission européenne des droits de l’homme, Asiatiques d’Afrique orientale c. Royaume-Uni, nos 4403/70, 4404/70, 4405/70, 4406/70, 4407/70, 4408/70, 4409/70, 4410/70, 4411/70, 4412/70, 4413/70, 4414/70, 4415/70, 4416/70, 4417/70, 4418/70, 4419/70, 4422/70, 4423/70, 4434/70, 4443/70, 4476/70, 4477/70, 4478/70, 4486/70, 4501/70, 4526/70, 4527/70, 4528/70, 4529/70 et 4530/70, rapport du 14 décembre 1973, Décisions et Rapports 78-B, § 192). Quant à la Cour, c’est dans l’arrêt Tyrer précité, relative non à un « traitement » dégradant mais à une peine « dégradante », qu’elle s’est pour la première fois expressément référée à cette notion. Pour conclure que la peine dont il était question était dégradante au sens de l’article 3 de la Convention, la Cour a notamment tenu compte du fait que, « quoique le requérant n’[av]ait pas subi de lésions physiques graves ou durables, son châtiment, consistant à le traiter en objet aux mains de la puissance publique, a[vait] porté atteinte à ce dont la protection figure précisément parmi les buts principaux de l’article 3 : la dignité et l’intégrité physique de la personne » (§ 33). De nombreux arrêts postérieurs mettent en exergue le lien étroit entre les notions de « traitements dégradants » et de respect de la « dignité » (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 102, CEDH 2001‑VIII, Yankov c. Bulgarie, no 39084/97, § 114, CEDH 2003‑XII (extraits), et Svinarenko et Slyadnev, précitée, § 138).
b) Application au cas d’espèce
i. Sur l’établissement des faits
91. Le Gouvernement ne conteste pas le principe énoncé précédemment selon lequel, si un individu présente des traces de coups après avoir été entre les mains de la police et soutient qu’elles résultent de mauvais traitements, il est présumé – de manière réfragable – que tel a été le cas (paragraphes 83-84 ci-dessus). Il admet en outre que ce principe s’applique en l’espèce. Il soutient cependant que les certificats médicaux produits par les requérants n’établissent ni que les lésions dont ils font état seraient la conséquence d’une gifle, ni qu’elle aurait été infligée par des policiers, d’autant moins, ajoute-t-il, que les agents de police concernés ont toujours nié les faits. Il ajoute qu’aucun des éléments recueillis lors de l’instruction ne contredit ce démenti.
92. La Cour fait observer que, pour bénéficier de la présomption dont il s’agit, les personnes qui se disent victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention doivent démontrer qu’elles présentent des traces de mauvais traitements alors qu’elles se trouvaient précédemment entre les mains de la police ou d’une autorité comparable. Comme l’illustrent nombre d’affaires soumises à son examen, elles produisent habituellement à cette fin des certificats médicaux décrivant des blessures ou des traces de coups, auxquels la Cour reconnaît une importante valeur probante.
93. Elle constate ensuite que les certificats médicaux produits en l’espèce – dont l’authenticité n’est pas en cause –, font état, pour le premier requérant, de son « état de choc », d’un « érythème au niveau de la joue gauche (en voie de disparition) » et d’un « érythème au niveau [du] conduit auditif gauche » (paragraphe 12 ci-dessus) et, pour le second, d’une « contusion à la joue gauche » (paragraphe 16 ci-dessus). Il s’agit là de conséquences susceptibles de résulter d’une gifle.
94. Elle relève par ailleurs que ces certificats ont été établis le jour des faits, rapidement après la sortie des requérants du commissariat de Saint‑Josse-ten-Noode, ce qui conforte leur caractère probant. Celui relatif au premier requérant a en effet été établi le 8 décembre 2003 à 19 heures 20, alors que l’intéressé se trouvait au commissariat entre 16 heures et 17 heures 30 (paragraphes 12 et 14 ci-dessus). Daté du 23 février 2004, celui relatif au second requérant est antérieur à 11 heures 20 – heure à laquelle il a été produit devant le Comité P (paragraphe 25 ci-dessus) –, alors que l’intéressé se trouvait dans le commissariat entre 9 heures 44 et 10 heures 20 (paragraphes 15 et 16 ci-dessus).
95. Elle note ensuite qu’il n’est pas contesté que les requérants ne présentaient pas de telles marques lorsqu’ils sont entrés dans le commissariat de Saint-Josse-ten-Noode.
96. Enfin, certes, les policiers mis en cause ont tout au long de la procédure interne constamment nié avoir giflé les requérants. Cependant, ces derniers ont affirmé le contraire avec une constance comparable. Par ailleurs, dès lors que l’instruction présente des déficiences significatives (paragraphes 124-134 ci-dessous), on ne saurait déduire la véracité des déclarations desdits policiers du seul fait que l’enquête n’a pas apporté d’élément les contredisant.
97. Quant à l’hypothèse émise par le Gouvernement lors de l’audience, selon laquelle les requérants se seraient eux-mêmes giflés dans le but de constituer un dossier contre la police (paragraphe 68 ci-dessus), la Cour constate qu’aucun élément ne vient la corroborer. Il apparaît d’ailleurs, au vu des pièces produites par les parties, qu’elle n’a pas été évoquée devant les juridictions internes.
98. Au vu de ce qui précède, la Cour juge suffisamment établi que les ecchymoses décrites par les certificats produits par les requérants sont survenues alors qu’ils se trouvaient entre les mains de la police, au commissariat de Saint-Josse-ten-Noode. Elle constate ensuite que le Gouvernement ne produit aucun élément susceptible de faire douter du récit des intéressés, selon lequel ces ecchymoses résultaient d’une gifle donnée par un agent de police. La Cour estime donc que ce fait est avéré.
99. Il reste à rechercher si les requérants sont fondés à soutenir que le traitement dont ils se plaignent était contraire à l’article 3 de la Convention.
ii. Sur la qualification du traitement infligé aux requérants
100. Comme la Cour l’a rappelé précédemment (paragraphe 88 ci‑dessus), lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par cette disposition.
101. La Cour souligne que l’on ne saurait voir dans les mots « en principe » l’indication qu’il y aurait des situations où une telle conclusion de violation ne s’imposerait pas parce que le seuil de gravité précité (paragraphes 86-87 ci-dessus) ne serait pas atteint. En affectant la dignité humaine, c’est l’essence même de la Convention que l’on touche (paragraphe 89 ci-dessus). Pour cette raison, toute conduite des forces de l’ordre à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à la dignité humaine constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Il en va en particulier ainsi de l’utilisation par elles de la force physique à l’égard d’un individu alors que cela n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé.
102. En l’espèce, le Gouvernement ne prétend pas que la gifle dont se plaint chacun des requérants correspondait à une utilisation de la force physique rendue strictement nécessaire par leur comportement ; il se contente de nier que gifle il y ait eu. Il ressort du reste du dossier qu’il s’agissait d’un acte impulsif, qui répondait à une attitude perçue comme étant irrespectueuse, ce qui, assurément, ne suffit pas à caractériser une telle nécessité. La Cour retient en conséquence qu’il y a eu atteinte à la dignité des requérants et, donc, violation de l’article 3 de la Convention.
103. Cela étant, la Cour tient à souligner que l’infliction d’une gifle par un agent des forces de l’ordre à un individu qui se trouve entièrement sous son contrôle constitue une atteinte grave à la dignité de ce dernier.
104. L’impact d’une gifle sur la personne qui la reçoit est en effet considérable. En atteignant son visage, elle touche à la partie du corps qui à la fois exprime son individualité, marque son identité sociale et constitue le support des sens – le regard, la voix et l’ouïe – qui servent à communiquer avec autrui. La Cour a d’ailleurs déjà eu l’occasion de relever le rôle que joue le visage dans l’interaction sociale (voir l’arrêt S.A.S. c. France [GC], relatif à l’interdiction de porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage ; no 43835/11, §§ 122 et 141 CEDH 2014 (extraits)). Elle a également pris en compte la spécificité de cette partie du corps dans le contexte de l’article 3 de la Convention, jugeant qu’« en particulier à cause de sa localisation », un coup de poing asséné sur la tête d’un individu à l’occasion de son interpellation, qui avait causé une enflure et une ecchymose de deux centimètres sur le front, était suffisamment grave pour qu’une question se pose sur le terrain de cette disposition (Samüt Karabulut c. Turquie, no 16999/04, §§ 41 et 58, 27 janvier 2009).
105. La Cour rappelle à cet égard qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux pour qu’il y ait traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (paragraphe 87 ci-dessus). Or, elle ne doute pas que même isolée, non préméditée et dénuée d’effet grave ou durable sur la personne qui la reçoit, une gifle peut être perçue comme une humiliation par celle-ci.
106. Il en va à plus forte raison ainsi lorsqu’elle est infligée par des agents des forces de l’ordre à des personnes qui se trouvent sous leur contrôle, puisqu’elle surligne alors le rapport de supériorité-infériorité qui, par essence, caractérise dans de telles circonstances la relation entre les premiers et les seconds. Le fait pour les victimes de savoir qu’un tel acte est illégal, constitue un manquement déontologique et professionnel de la part de ces agents et – comme l’a pertinemment souligné la chambre dans son arrêt – est inacceptable, peut en outre susciter en elles un sentiment d’arbitraire, d’injustice et d’impuissance (sur la prise en compte de ce type de ressenti dans le contexte de l’article 3 de la Convention, voir, par exemple, Petyo Petkov c. Bulgarie, no 32130/03, §§ 42 et 47, 7 janvier 2010).
107. Par ailleurs, les personnes placées en garde à vue ou même simplement conduites ou convoquées dans un commissariat pour un contrôle d’identité ou pour un interrogatoire – tels les requérants –, et plus largement les personnes qui se trouvent entre les mains de la police ou d’une autorité comparable, sont en situation de vulnérabilité. Les autorités ont en conséquence le devoir de les protéger (paragraphes 83-84 ci-dessus). En leur infligeant l’humiliation d’une gifle par la main d’un de leurs agents, elles méconnaissent ce devoir.
108. Le cas échéant, le fait que la gifle ait pu être infligée inconsidérément par un agent excédé par le comportement irrespectueux ou provocateur de la victime est à cet égard dénué de pertinence. La Grande Chambre ne partage donc pas l’approche de la chambre sur ce point. Comme la Cour l’a rappelé précédemment, même dans les circonstances les plus difficiles, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée (paragraphe 81 ci-dessus). Dans une société démocratique, les mauvais traitements ne constituent jamais une réponse adéquate aux problèmes auxquelles les autorités sont confrontées. Spécialement en ce qui concerne la police, celle-ci « ne doit infliger, encourager ou tolérer aucun acte de torture, aucun traitement ou peine inhumain ou dégradant, dans quelque circonstance que ce soit » (code européen d’éthique de la police, § 36 ; paragraphe 51 ci-dessus). Par ailleurs, l’article 3 de la Convention met à la charge des États parties l’obligation positive de former les agents de maintien de l’ordre de manière à garantir un degré élevé de compétence quant à leur comportement professionnel afin que personne ne soit soumis à un traitement contraire à cette disposition (voir Davydov et autres, précité, § 268).
109. Enfin, la Cour relève surabondamment que, né le 22 août 1986, le premier requérant avait 17 ans le 8 décembre 2003. Il était donc mineur au moment des faits. Or un mauvais traitement est susceptible d’avoir un impact – psychologique en particulier – plus important sur un mineur (voir, par exemple, Rivas, précité, § 42, et Darraj c. France, no 34588/07, § 44, 4 novembre 2010) que sur un adulte. Plus largement, la Cour a de nombreuses fois souligné la vulnérabilité des mineurs dans le contexte de l’article 3 de la Convention. Tel fut le cas par exemple dans les affaires Okkalı c. Turquie (no 52067/99, CEDH 2006‑XII (extraits)), Yazgül Yılmaz c. Turquie (no 36369/06, 1er février 2011) et Iurcu c. République de Moldova (no 33759/10, 9 avril 2013). La nécessité de prendre en compte la vulnérabilité des mineurs est du reste clairement affirmée au plan international (paragraphes 52-53 ci-dessus).
110. La Cour souligne qu’il est essentiel que, lorsque, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les agents des forces de l’ordre sont en contact avec des mineurs, ils prennent dûment compte de la vulnérabilité inhérente au jeune âge de ces derniers (code européen d’éthique de la police, § 44 ; paragraphe 51 ci-dessus). Un comportement de leur part à l’égard de mineurs peut, du seul fait qu’il s’agit de mineurs, être incompatible avec les exigences de l’article 3 de la Convention alors même qu’il pourrait passer pour acceptable s’il visait des adultes. Ainsi, lorsqu’ils ont affaire à des mineurs, les agents des forces de l’ordre doivent faire preuve d’une vigilance et d’une maîtrise de soi renforcées.
111. En conclusion, la gifle assénée aux requérants par des agents de police alors qu’ils se trouvaient sous leur contrôle dans le commissariat de Saint-Josse-ten-Noode, laquelle ne correspondait pas à une utilisation de la force physique rendue strictement nécessaire par leur comportement, a porté atteinte à leur dignité.
112. Les requérants ne faisant état que de lésions corporelles légères et ne démontrant pas avoir enduré de vives souffrances physiques ou mentales, ce traitement ne peut être qualifié ni d’inhumain ni, a fortiori, de torture. La Cour retient en conséquence qu’il y a eu traitement dégradant en l’espèce.
113. Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 dans le chef de chacun des requérants.
2. Sur le volet procédural du grief
a) Principes généraux
114. La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans les arrêts El-Masri (précité, §§ 182-185) et Mocanu et autres (précité, §§ 316-326).
115. Il en ressort que, pour que l’interdiction générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s’adressant notamment aux agents publics s’avère efficace en pratique, il faut qu’existe une procédure permettant d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements infligés à une personne se trouvant entre leurs mains.
116. Ainsi, notamment, compte tenu du devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », les dispositions de l’article 3 requièrent par implication qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3.
117. Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois qui interdisent la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants dans les affaires où des agents ou organes de l’État sont impliqués, et de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des mauvais traitements survenus sous leur responsabilité.
118. D’une manière générale, pour qu’une enquête puisse passer pour effective, il faut que les institutions et les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes qu’elle vise. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète.
119. Quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office. De plus, pour être effective, l’enquête doit permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Elle doit également être suffisamment vaste pour permettre aux autorités qui en sont chargées de prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui ont eu directement et illégalement recours à la force, mais aussi l’ensemble des circonstances les ayant entourés.
120. Bien qu’il s’agisse d’une obligation non pas de résultat mais de moyens, toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise.
121. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable en découle implicitement. S’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux.
122. La victime doit être en mesure de participer effectivement à l’enquête.
123. Enfin, l’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête.
b) Application au cas d’espèce
124. Selon la Cour, telles qu’exposées dans les plaintes déposées devant les autorités internes, les allégations des requérants d’après lesquels des membres du commissariat de Saint-Josse-ten-Noode leur avaient infligé un traitement contraire à l’article 3 de la Convention étaient défendables. Cette disposition obligeait donc lesdites autorités à mener une enquête effective.
125. Le Gouvernement soutient que la manière dont s’est déroulée l’enquête est satisfaisante au regard des critères jurisprudentiels rappelés ci‑dessus.
126. La Cour ne partage pas cette analyse.
127. Elle constate que, suite à la constitution de partie civile des requérants, une instruction a été ouverte et les deux policiers mis en cause par ces derniers ont été inculpés d’avoir, à l’occasion de leurs fonctions, usé de violences envers des personnes et, notamment, volontairement fait des blessures ou porté des coups, et d’avoir exécuté un acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution. L’instruction s’est déroulée en conformité avec les prescriptions légales, sous l’autorité d’un juge d’instruction. Elle était donc entre les mains d’une autorité indépendante. Par ailleurs, rien n’indique que les requérants n’ont pas été en mesure d’y participer.
128. Cependant, le juge d’instruction, qui semble n’avoir pris lui-même aucune mesure spécifique d’investigation, s’est limité à demander au service d’enquêtes du Comité P de prendre connaissance de la constitution de partie civile des requérants, d’entendre ceux-ci pour leur faire préciser les éléments de leur plainte, de réaliser un rapport sur le comportement de la famille Bouyid, de dresser la liste des dossiers ouverts à la charge de celle-ci et des plaintes déposées par elle et de préciser les suites données à ceux-ci. Il n’a ni procédé ni fait procéder à une confrontation entre les policiers en cause et les requérants, et n’a entendu ou fait entendre ni les médecins qui ont établi les certificats médicaux produits par les intéressés, ni la personne qui se trouvait avec le premier requérant lorsque l’agent A.Z. l’a interpellé dans la rue le 8 décembre 2003 (paragraphe 11 ci-dessus), ni le commissaire K., qui avait rencontré le second requérant chez lui le 23 février 2004, peu de temps après qu’il ait quitté le commissariat de Saint-Josse-ten-Noode (paragraphe 26 ci‑dessus). De telles mesures auraient pourtant pu contribuer à éclaircir les faits.
129. L’enquête s’est ainsi pour l’essentiel limitée à l’audition des policiers impliqués dans les faits par les policiers affectés au service d’enquête du Comité P, et à la rédaction par ces derniers d’un rapport synthétisant des éléments recueillis également par des policiers (le service de contrôle interne de la zone de police incluant le quartier des requérants) et décrivant principalement « le comportement général » de la famille Bouyid.
130. Par ailleurs, le réquisitoire du procureur du Roi et l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles qui a prononcé le non-lieu ne sont pas motivés en fait. Quant à la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, elle s’est presqu’exclusivement fondée pour confirmer ce non-lieu sur le rapport susmentionné relatif au comportement de la famille Bouyid et sur les dénégations des inculpés, sans évaluer la crédibilité et la gravité de l’allégation des requérants selon laquelle ils avaient été giflés par les inculpés. Il faut d’ailleurs relever que son arrêt du 9 avril 2008, qui ne contient qu’une très brève référence au certificat médical produit par le second requérant, n’évoque même pas celui produit par le premier requérant.
131. Ces éléments tendent à indiquer que les juridictions d’instruction n’ont pas accordé toute l’attention requise aux allégations des requérants, pourtant étayés par les certificats médicaux qu’ils avaient versés au dossier, et à la nature de l’acte qui consiste pour un membre des forces de l’ordre à gifler une personne qui est entièrement livrée à lui.
132. Enfin, la Cour relève la durée singulière de l’instruction, pour laquelle le Gouvernement ne fournit aucune explication. Les faits se sont en effet produits le 8 décembre 2003 dans le cas du premier requérant et le 23 février 2004 dans celui du second requérant, et les intéressés ont déposé plainte devant le Comité P dès les 9 décembre 2003 et 23 février 2004 respectivement, puis se sont constitués partie civile le 17 juin 2004. Or l’ordonnance de non-lieu n’a été prise que le 27 novembre 2007. Quant aux arrêts de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles et de la Cour de cassation, ils ont été rendus les 8 avril 2008 et 29 octobre 2008 respectivement. Presque cinq ans se sont ainsi écoulés entre la plainte du premier requérant et l’arrêt de cassation marquant la fin de l’instruction, et plus de quatre ans et huit mois dans le cas du second requérant.
133. Or, comme la Cour l’a souligné à d’autres occasions, s’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, notamment, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001‑III, et Mocanu et autres, précité, § 323).
134. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants n’ont pas bénéficié d’une enquête effective. Elle conclut en conséquence à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
GUTSANOVI c. BULGARIE du 15 Octobre 2013 requête 34529/10
L'arrestation du chef de famille devant l'épouse et les enfants est une violation de l'article 3.
a) Sur l’établissement des faits
113. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements, contraires à l’article 3 de la Convention, doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits, celle-ci se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Salman c. Turquie, précité, § 100).
114. La Cour constate que les faits relatifs à l’opération policière au domicile des quatre requérants n’ont fait objet d’aucun examen de la part des juridictions internes. Lorsqu’elle a été confrontée à des situations similaires, la Cour a procédé à sa propre appréciation des faits tout en respectant les règles fixées par sa jurisprudence à cet effet (voir, à titre d’exemple, Sashov et autres c. Bulgarie, no 14383/03, § 48, 7 janvier 2010).
115. Sur la base de ces principes, la Cour estime opportun de prendre comme point de départ de son analyse les circonstances qui ne prêtent pas à controverse entre les parties et les éléments de preuve apportés par les parties. Elle prendra également en compte les allégations des parties qui sont suffisamment corroborées par les éléments factuels non contestés et par les preuves apportées.
116. Il n’est pas contesté par les parties que l’intervention des policiers au domicile des requérants a commencé peu après 6 h 30, le matin du 31 mars 2010. Les séquences des caméras de vidéosurveillance de la propriété dont la Cour dispose, ainsi que le bulletin du service météorologique de Varna, corroborent l’allégation des requérants que l’opération s’est déroulée avant le lever du soleil, notamment au crépuscule (voir paragraphes 20 et 21 ci-dessus).
117. Les parties s’accordent également sur le fait que l’équipe d’intervention de la police était composée d’agent en uniformes, d’agents en tenue civile et d’agents spéciaux cagoulés et armés. Les enregistrements vidéos soumis par les requérants (voir paragraphe 21 ci-dessus) et les rapports présentés par le Gouvernement (voir paragraphes 22, 24 et 27 ci‑dessus) corroborent ces allégations.
118. La présence d’une arme à feu et des munitions au domicile des requérant est également un fait non disputé et prouvé par le procès-verbal de perquisition. Il ressort des observations du Gouvernement et des rapports présentés par celui-ci que les agents de police étaient avertis par leurs supérieurs de la présence de cette arme (voir paragraphes 23 et 27 ci‑dessus).
119. Les parties s’accordent ensuite sur le fait que le portail d’entrée de la propriété des requérants a été ouvert volontairement par le gardien à la demande des agents de police (voir paragraphes 13 et 24 ci-dessus). La scène en cause a par ailleurs été filmée et enregistrée par le système de vidéosurveillance de la maison (voir paragraphe 21 ci-dessus). Les parties conviennent également que le gardien a informé les policiers de l’identité des personnes présentes à la maison et du fait qu’il n’avait pas les clés de la porte d’entrée de celle-ci, et que cette même porte a été forcée par des agents spéciaux qui ont pénétré dans la maison et arrêté M. Gutsanov (voir paragraphes 13, 14, 24 et 25 ci-dessus).
120. Aucune des parties ne conteste le fait que les requérants n’ont pas été blessés physiquement au cours de l’opération policière et les certificats d’examen psychiatrique de Mme Gutsanova et de ses deux filles (voir paragraphes 30 et 31 ci-dessus) n’ont pas été contestés par le Gouvernement.
121. Une première divergence entre les versions des parties réside dans la description du comportement de M. Gutsanov. D’après le Gouvernement, il s’est montré à deux reprises par l’une des fenêtres de sa maison, a aperçu les policiers et a entendu leurs appels mais n’a pas ouvert la porte d’entrée (paragraphe 25 ci-dessus). Le requérant, quant à lui, affirme qu’il n’a compris qu’il s’agissait d’une opération de police qu’au moment où les agents spéciaux sont entrés à sa maison et ont commencé à monter l’escalier (voir paragraphe 16 ci-dessus).
122. Les éléments de preuve dont elle dispose ne permettent pas à la Cour de déterminer si le requérant s’est en effet montré par la fenêtre de sa maison et s’il a délibérément refusé d’ouvrir la porte d’entrée aux policiers. Elle observe cependant que nul ne conteste que les policiers aient frappé au portail d’entrée de la propriété et qu’ils ont annoncé à haute voix leur présence au gardien. Ils ont ensuite affirmé avoir frappé à la porte d’entrée de la maison et avoir crié « Police. Ouvrez ! ». Cette affirmation est corroborée par les déclarations de M. et Mme Gutsanovi, selon lesquelles ils avaient été réveillés par des cris et des coups à la porte de leur maison (voir paragraphe 15 ci-dessus). M. Gutsanov affirme qu’il est allé au premier étage de sa maison pour récupérer ses deux enfants et qu’il est remonté ensuite dans la chambre à coucher au deuxième étage. Cette affirmation est corroborée par la version des policiers qui ont aperçu la silhouette d’un homme par les vitres de la maison (voir paragraphe 25 ci-dessus).
123. Pour ce qui est du lieu exact où M. Gutsanov a été arrêté, la Cour observe que lui-même a admis dans sa déclaration qu’au moment où les policiers ont forcé la porte et lui ont donné des sommations verbales, il s’est précipité vers la chambre à coucher au deuxième étage où se trouvaient son épouse et ses enfants (voir paragraphe 16 ci-dessus). La Cour n’est pas en mesure de déterminer si M. Gutsanov a été arrêté à l’intérieur même de la chambre à coucher au deuxième étage de sa maison, comme il l’affirme, ou bien sur le palier du deuxième étage après qu’il soit sorti de la chambre de son plein gré, comme le soutient le Gouvernement. Il n’est pas établi au‑delà de tout doute raisonnable, non plus, que les policiers ont adressé la parole à Mme Gutsanova et qu’ils lui ont demandé de couvrir les enfants avec la couette. Quoi qu’il en soit, la Cour observe que d’après la déposition des agents spéciaux (voir paragraphes 25 et 27 ci-dessus), ils ont vu les enfants et l’épouse de M. Gutsanov à l’intérieur de la chambre à coucher lorsqu’ils ont monté au deuxième étage de la maison à la poursuite de M. Gutsanov. La Cour accepte que Mme Gutsanova et ses deux filles ont également vu les hommes armés et cagoulés, ne serait-ce que devant la porte de leur chambre.
124. La Cour n’estime pas prouvée au-delà de tout doute raisonnable l’allégation de M. Gutsanov qu’il a été contraint à s’agenouiller afin que les policiers puissent lui passer les menottes. Quant au port des menottes, il n’est pas contesté que les agents spéciaux ont menotté M. Gutsanov à l’étage inférieur de sa maison (voir paragraphe 16 ci-dessus). La Cour observe cependant qu’aucune des parties ne précise combien de temps le requérant aurait-il resté menotté. Quoi qu’il en soit, force est de constater qu’aucune pièce du dossier ne démontre que le requérant a été exposé menotté devant les objectifs des journalistes qui se sont rassemblés devant l’entrée de sa propriété ce jour-là. De surcroît, la photographie prise au moment de sa sortie de la maison, vers 13 heures, ne fait apparaître aucunement que l’intéressé était menotté (voir paragraphe 53 ci-dessus). La Cour estime dès lors qu’il convient de distinguer sur ce point la présente espèce de l’affaire Mirosław Garlicki, précité, § 75, où le requérant était arrêté à son lieu de travail, devant ses collègues et patients, menotté et filmé.
b) Sur l’observation de l’article 3 dans le cas d’espèce
125. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou psychologiques ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. La Cour a jugé un traitement « inhumain » notamment pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques et morales. Elle a considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à créer chez ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV). La souffrance psychologique peut résulter d’une situation où des agents de l’État créent délibérément chez les victimes un sentiment de peur en les menaçant de mort ou de maltraitances (voir Hristovi, précité, § 80).
126. L’article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation. Néanmoins, le recours à la force doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000‑XII; Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001). A cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII). La Cour tient à rappeler en particulier que tout recours à la force physique par les agents de l’Etat à l’encontre d’une personne qui n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement rabaisse sa dignité humaine et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention (voir Rachwalski et Ferenc c. Pologne, no 47709/99, § 59, 28 juillet 2009). Cette approche de stricte proportionnalité a également été appliquée par la Cour dans des situations où les personnes concernées se trouvaient déjà sous le contrôle des forces de l’ordre (voir entre autres Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269 ; Rehbock, précité, §§ 68-78 ; Milan c. France, no 7549/03, §§ 52-65, 24 janvier 2008).
127. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que l’opération poursuivait le but légitime d’effectuer une arrestation, perquisition et saisie et visait l’intérêt général de la poursuite des infractions. Elle doit s’assurer qu’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de l’individu aient été respectés dans les circonstances de l’affaire. La Cour relève que même si les quatre requérants n’ont pas été physiquement blessés au cours de l’intervention policière contestée, celle-ci a nécessairement impliqué un certain recours à la force physique : la porte d’entrée de la maison a été forcée par une équipe d’intervention spéciale, M. Gutsanov a été immobilisé par des agents cagoulés et armés, amené de force à l’étage inférieur de sa maison et menotté. La Cour se doit donc d’établir si ce recours à la force physique était proportionné et absolument nécessaire dans le cas d’espèce.
128. Le but de l’intervention policière au domicile des requérants ce jour-là était d’appréhender M. Gutsanov, qui était suspect dans une affaire pénale de détournement de fonds publics, et d’effectuer une perquisition dans les locaux afin de rechercher des preuves matérielles et documentaires dans le cadre de cette même enquête pénale. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête en cause avait été ouverte cinq mois auparavant, qu’il y avait plusieurs suspects dans cette affaire et que les autorités soupçonnaient l’existence d’une organisation de malfaiteurs (voir paragraphes 9 et 42 ci‑dessus). Or, il ne s’agissait clairement pas d’un groupe d’individus soupçonnés de la commission d’actes criminels violents.
129. Pour ce qui est de la personnalité de M. Gutsanov, la Cour observe qu’il était un homme politique connu à Varna : à l’époque des faits, il occupait le poste de président du Conseil municipal de cette ville. De surcroît, il n’existe aucun élément du dossier permettant à conclure qu’il avait des antécédents violents et qu’il aurait pu poser un danger pour les agents de police amenés à intervenir à son domicile.
130. Il est vrai que M. Gutsanov détenait légalement une arme à feu et des munitions à son domicile. Ce fait était connu des services de police et il a été spécialement mentionné lors du débriefing de l’équipe de police qui avait eu lieu avant le début de l’opération (voir paragraphe 23 ci-dessus). C’était sans doute un élément pertinent qui devait être pris en compte par les agents lors de leur intervention au domicile des requérants. La Cour considère cependant que la présence de l’arme au domicile des requérants ne saurait suffire à elle seule ni pour justifier l’utilisation d’une équipe d’intervention spéciale ni le recours à la force d’une telle intensité que celle employée en l’occurrence.
131. Il ressort des pièces du dossier que la présence éventuelle des enfants mineurs et de l’épouse de M. Gutsanov n’a jamais été prise en compte dans la planification et l’exécution de l’opération policière. Ce fait n’a pas été mentionné lors du débriefing précédant le déploiement des agents de police (voir paragraphe 23 ci-dessus) et la mise en garde de la part du gardien de la propriété sur la présence des enfants mineurs à la maison a apparemment été négligée par les policiers (voir paragraphe 24 ci-dessus).
132. Certes, la Cour ne saurait aller jusqu’à imposer aux forces de l’ordre de ne pas arrêter les suspects d’infractions pénales dans leur domicile chaque fois que leurs enfants ou conjoints s’y trouvent. Elle estime cependant que la présence éventuelle des membres de la famille du suspect sur les lieux de l’arrestation est une circonstance qui doit être prise en compte dans la planification et l’exécution de ce type d’opérations policières. Cela n’a pas été fait dans le cas d’espèce et les forces de l’ordre n’ont pas envisagé d’autres modalités de leur opération au domicile des requérants comme, par exemple, de retarder l’heure d’intervention, voire de procéder au redéploiement des différents types d’agents impliqués dans l’opération. La prise en compte des intérêts légitimes des trois requérantes dans le cas d’espèce était d’autant plus nécessaire que Mme Gutsanova n’était pas suspectée d’être impliquée dans les infractions pénales reprochées à son mari et que ses deux filles étaient psychologiquement vulnérables en raison de leur jeune âge - cinq et sept ans respectivement.
133. La Cour observe également que l’absence d’un contrôle judiciaire préalable sur la nécessité et la légalité de la perquisition en cause a laissé entièrement à la discrétion des autorités policières et des organes de l’enquête pénale la planification de l’opération et n’a pas permis la prise en compte des droits et intérêts légitimes de Mme Gutsanova et de ses deux filles mineures. La Cour est de l’avis que dans les circonstances spécifiques de l’espèce un tel contrôle judiciaire préalable aurait pu permettre la mise en balance de leurs intérêts légitimes avec l’intérêt général d’appréhender les personnes suspectées d’avoir commis une infraction pénale.
134. Pour ce qui est de l’effet psychologique que l’intervention policière a provoqué chez les requérants, la Cour rappelle que les opérations policières impliquant l’intervention au domicile et l’arrestation des suspects engendrent inévitablement des émotions négatives chez les personnes visées par ces mesures. Cependant, il existe dans le cas d’espèce des éléments de preuve concrets et non contestés qui démontrent que Mme Gutsanova et ses deux filles mineures ont été très fortement affectées par les événements en cause. Mme Gutsanova a consulté à deux reprises un psychiatre en se plaignant d’insomnie et d’angoisse accrue et elle s’est vu prescrire des anxiolytiques (voir paragraphe 31 ci-dessus). Les deux filles ont elles aussi été examinées par un psychiatre qui a constaté qu’au rappel des événements, elles réagissaient par des pleurs ou par une angoisse accrue (voir paragraphe 30 ci-dessus). Mme Gutsanova affirme que B., sa fille cadette, s’est remise à bégayer (voir paragraphe 28 ci-dessus). Quant à S., la fille aînée du couple, les déclarations de sa tante et de sa professeure d’école indiquent que l’enfant a été profondément marqué par l’intervention policière à son domicile et par l’arrestation de son père (voir paragraphe 29 ci-dessus). La Cour considère également que l’heure matinale de l’intervention policière et la participation d’agents spéciaux cagoulés, qui ont été vus par Mme Gutsanova et ses deux filles, ont contribué à amplifier les sentiments de peur et d’angoisse éprouvées par ces trois requérantes à tel point que le traitement infligé a dépassé le seuil de gravité exigé pour l’application de l’article 3 de la Convention. La Cour estime donc que ces trois requérantes ont été soumises à un traitement dégradant.
135. En ce qui concerne l’effet psychologique néfaste de l’opération policière sur M. Gutsanov, force est de constater que ce requérant n’a pas soumis des preuves médicales à cet effet. Il affirme néanmoins que l’humiliation et l’angoisse qu’il a éprouvées lors de son arrestation musclée devant les membres de sa famille étaient suffisamment intenses pour rendre applicable l’article 3 à son égard (voir paragraphe 107 ci-dessus).
136. La Cour réitère ses conclusions que l’opération policière en cause a été planifiée et exécutée sans prendre en compte plusieurs circonstances pertinentes telles que la nature des infractions pénales reprochées à M. Gutsanov, l’absence d’antécédents violents de sa part, la présence éventuelle de ses filles et de son épouse à la maison familiale. Ce sont autant d’éléments qui indiquaient clairement le caractère excessif de l’emploi d’agents et de procédés spéciaux pour l’appréhension du requérant et pour assurer l’entrée de la police à son domicile. La Cour estime que, à la lumière de ces circonstances, la manière dont s’est déroulée l’arrestation de M. Gutsanov, à savoir très tôt le matin, après une ouverture forcée de la porte d’entrée, par plusieurs agents cagoulés et armés et devant le regard de son épouse et de ses deux filles mineures effrayées, a provoqué de forts sentiments de peur, angoisse et impuissance chez ce requérant, susceptibles de l’humilier et de l’avilir à ses propres yeux et dans ceux de ses proches. La Cour estime que l’intensité de ces sentiments a dépassé le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 et que de ce fait M. Gutsanov a également été soumis à un traitement dégradant.
137. En conclusion, après avoir pris en compte toutes les circonstances pertinentes en l’espèce, la Cour considère que l’opération policière au domicile des requérants n’a pas été planifiée et exécutée de manière à assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’appréhension d’une personne suspectée d’avoir commis des infractions pénales et le rassemblement de preuves dans le cadre d’une enquête pénale. Les quatre requérants ont été soumis à une épreuve psychologique qui a généré de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance chez eux et qui, de par ces effets néfastes, s’analyse en un traitement dégradant au regard de l’article 3. Il y a donc eu en l’espèce violation de cette disposition de la Convention.
IlJINA ET SARULIENE c. LITHUANE DU 15 MARS 2011 REQUÊTE 32293/05
Une famille lituanienne victime d’un traitement dégradant lors d’une perquisition policière ayant dégénéré dans son immeuble
L’affaire concernait les brutalités policières dont une mère et sa fille disaient avoir été victimes avec leur famille dans la cage d’escalier de leur immeuble d’habitation ainsi que l’absence d’enquête adéquate à ce sujet.
LES FAITS
Les requérantes, Danuta Iljina et sa fille Evelina Sarulienė, sont deux ressortissantes lituaniennes, nées respectivement en 1958 et en 1978 et résidant à Vilnius (Lituanie).
Le 3 août 2003, un policier se rendit dans leur immeuble pour perquisitionner l’appartement de leur voisin et y rechercher des biens volés. Une altercation éclata lorsque le voisin refusa d’ouvrir sa porte et que Mme Sarulienė, qui fumait dans la cage d’escalier avec son oncle (O.B.) et son frère (V.I.), intervint avec eux.
Selon Mme Sarulienė, un policier attrapa son frère, chargea son arme et la pointa vers celui-ci. D’autres policiers venus en renfort frappèrent ensuite son oncle et son frère à l’aide de matraques en caoutchouc et à coup de pied et de poing. Son père (A.I.), qui revenait du travail, prit alors part à l’altercation et fut lui aussi matraqué à la tête, aux épaules et aux mains. Mme Sarulienė fut elle-même blessée lorsqu’elle mit son pied dans la porte de l’appartement pour empêcher sa fille âgée d’un an et demi – qui voulait voir ce qui se passait – de se faire mal car un policier se ruait vers la porte pour la claquer. Mme Iljina arriva sur les lieux et vit son mari, son fils et son frère à bord de voitures de police. Pour tenter d’arrêter les agents, elle s’allongea sur le capot de l’un des véhicules. Elle affirme que les policiers démarrèrent avant de s’arrêter et de la dégager de force du capot, la jetant sur le gazon et déchirant son chemisier.
A.I., O.B. et V.I. passèrent la nuit en garde à vue et, interrogés le lendemain matin, ils furent ensuite immédiatement remis en liberté. Les chefs d’inculpation d’insultes et de résistance à une arrestation retenus contre eux furent abandonnés en décembre 2004 faute de preuve.
D’après des expertises médicales pratiquées aussitôt après l’incident, les requérantes et les trois hommes avaient subi des blessures légères, notamment des égratignures et des hématomes, infligées en particulier à l’aide d’objets solides et contondants.
Le Gouvernement soutient que la force employée par les policiers n’était pas excessive et était nécessaire, A.I., O.B. et V.I. ayant résisté à leur arrestation et les requérantes ayant elles-mêmes entravé l’action des policiers. Aucun de ces derniers n’a utilisé ou montré son arme, ni menacé d’en faire usage. Mme Iljina a bien été dégagée de force d’une voiture de police mais le véhicule était à l’arrêt, son moteur ayant été coupé.
La plainte déposée par les requérantes concernant l’incident fut examinée à trois niveaux : par le service des affaires internes de la police, par le parquet et par le tribunal du premier district de Vilnius. Toutes ces instances se prononcèrent en défaveur des requérantes, relevant que ni celles-ci ni A.I., O.B. et V.I. n’auraient été blessés s’ils n’avaient pas résisté à l’arrestation. L’inspecteur des affaires internes interrogea notamment, entre août et novembre 2004, les trois hommes, les requérantes, leurs voisins ainsi que les policiers impliqués dans l’incident. L’interrogatoire eut lieu dans les locaux de la police. Fondant leur décision sur les dépositions ainsi recueillies, les autorités du parquet décidèrent de mettre fin à l’instruction préliminaire faute de preuve. En définitive, en mars 2005, le tribunal du district rejeta lui aussi la plainte au motif que l’instruction était complète et que les décisions du parquet étaient motivées. Ni lui ni le parquet n’avaient jugé nécessaire d’entendre à nouveau les policiers ou les témoins.
Article 3
Il n’est pas contesté entre les parties que les blessures relevées sur les deux femmes par des rapports médicaux ont été infligées au cours de leur altercation avec la police. La Cour constate que ces blessures concordent avec leurs récits des événements, notamment le fait que Mme Iljina a été dégagée à bout de bras d’une voiture de police et que Mme Sarulienė avait mis le pied dans la porte. Elle considère en outre que ces blessures, ainsi que le fait que les deux femmes ont été témoins de violences policières, montrent qu’elles ont été victimes d’un traitement dégradant.
La Cour estime toutefois que l’emploi de la force ne pouvait se justifier par le fait que les deux femmes s’étaient opposées aux policiers ou que des membres de leur famille avaient résisté à leur arrestation. L’abandon en décembre 2004 des charges retenues contre les proches des requérantes fait d’ailleurs douter de la nécessité d’un recours à la force.
La Cour est particulièrement préoccupée par le fait que, malgré l’abandon de ces charges, ni le parquet ni les tribunaux lituaniens n’ont jugé important ou raisonnable de rouvrir l’instruction préliminaire pour conduire des interrogatoires plus transparents, sans la pression psychologique que les témoins et les victimes avaient forcément dû subir au poste de police.
Enfin, à aucun stade la contribution de chacun des policiers impliqués aux blessures subies par les deux femmes ou par les membres de leur famille n’a été clairement établie.
La Cour en conclut que les violences physiques et psychologiques subies par les deux femmes ainsi que le caractère inadéquat de l’enquête consécutivement menée sur l’incident sont contraires à l’article 3 et engagent la responsabilité de Lituanie.
DOUET C. FRANCE du 3 octobre 2013 requête 16705/10
L'UTILISATION DE LA FORCE CONTRE UNE FAMILLE PAR LA GENDARMERIE N'EST PAS PROPORTIONNEE MÊME S'ILS ONT TENTE DE FUIR
28. La Cour rappelle, d’une part, que lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (voir, notamment, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336, Mete et autres c. Turquie, no 294/08, § 106, 4 octobre 2011 et El-Masri c. ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 207, CEDH 2012). D’autre part, les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000‑IV, et Creanğa c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 88, 23 février 2012 ; pour un exemple d’arrêt s’inscrivant dans le contexte d’une interpellation, voir Matko c. Slovénie, no 43393/98, §§ 98-99, 2 novembre 2006).
29. A cela il faut ajouter qu’il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données qu’ils recueillent. En règle générale, seules des données convaincantes sont susceptibles de la conduire à s’écarter des constatations de fait des juridictions internes (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, §§ 29-30, série A no 269). Elle n’est cependant pas liée par leurs conclusions et elle se doit de faire preuve d’une vigilance particulière en cas d’allégations de violation de l’article 3 de la Convention (voir Ribitsch, précité, § 32, et El-Masri, précité, § 155 ; voir aussi, notamment, Matko, précité, § 100).
30. S’agissant en particulier de l’usage de la force au cours d’une arrestation, la Cour doit rechercher si la force utilisée était strictement nécessaire et proportionnée et si l’Etat doit être tenu pour responsable des blessures infligées. Pour répondre à cette question, elle doit prendre en compte les blessures occasionnées et les circonstances dans lesquelles elles l’ont été. De plus, il incombe normalement au Gouvernement d’apporter des preuves pertinentes démontrant que le recours à la force était à la fois proportionné et nécessaire (voir, notamment, Petyo Popov c. Bulgarie, no 75022/01, § 54, 22 janvier 2009).
31. La Cour relève que le Gouvernement admet que les lésions dont le requérant fait état ont été causées par les gendarmes qui ont procédé à son arrestation le 25 août 2005. Observant en outre que ces lésions sont établies par les certificats médicaux produits par l’intéressé (paragraphes 8-12 ci-dessus), la Cour juge avéré que les gendarmes ont usé de la force physique à son encontre.
32. Se pose donc la question de savoir si, au vu notamment des constatations des juridictions internes, la force physique dont il a été fait usage à l’encontre du requérant était ou non rendue strictement nécessaire par son comportement.
33. La Cour n’est pas convaincue par les explications fournies par le Gouvernement.
34. Elle comprend, certes, que des agents des forces de l’ordre puissent juger suspect un automobiliste qui fait demi-tour à leur vue. Elle constate toutefois que le Gouvernement ne fournit aucun élément susceptible d’indiquer que, lorsque le requérant s’est comporté de la sorte, le contexte était de nature à conduire les gendarmes qui se sont lancés à sa poursuite à craindre qu’ils se trouvaient confrontés à un individu dangereux. Elle relève en particulier que le Gouvernement ne prétend pas que les gendarmes en cause étaient en train de participer à une opération risquée, mais confirme dans ses observations qu’ils étaient simplement en poste de surveillance devant une parcelle de maïs transgénique susceptible d’être endommagée par des militants anti-OGM.
35. Elle note par ailleurs que, si l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 1er avril 2009 confirme le jugement prononçant la relaxe des gendarmes en cause, il met en exergue plusieurs éléments susceptibles, selon ses propres termes, de caractériser un « usage disproportionné de la force ». La cour d’appel a en effet relevé que les gendarmes avaient pratiqué sur le requérant une clé à bras et utilisé un bâton télescopique alors qu’il était déjà interpellé et menotté à la main droite et que les occupants du véhicule ne constituaient pas une menace. Elle a en outre constaté que, bien qu’un seul gendarme à genou sur le dos du requérant suffisait à le maintenir sur le sol, plusieurs coups avaient été portés sur lui. Selon elle, la fracture dont le requérant avait souffert à la suite de son arrestation montrait qu’au moins un coup suffisant pour provoquer une fracture du coude lui avait été asséné à l’aide d’un bâton télescopique, et les hématomes sur le haut de son bras gauche, l’important œdème sur son coude gauche et les ecchymoses linéaires sur son dos indiquaient qu’il en avait reçu d’autres. La cour d’appel a de plus constaté que le requérant n’avait adopté qu’une « attitude de résistance passive ».
36. La Cour accorde une importance particulière à ce dernier élément. Elle note en outre à cet égard que cette même cour d’appel avait déjà constaté le 10 janvier 2007 que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer qu’il y avait eu résistance active de la part du requérant, et avait retenu qu’à le supposer établi, le fait que le requérant s’était débattu lorsqu’il était au sol pouvait « s’expliquer par une attitude de protection d’un homme à terre ». Elle l’avait en conséquence relaxé du chef de rébellion, retenant ainsi qu’il n’avait pas « oppos[é] une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice » (article 433-6 du code pénal).
37. La Cour constate ensuite que les certificats médicaux produits par le requérant font état de nombreuses lésions, que le médecin qui a ausculté l’intéressé après son arrestation a déclaré son état incompatible avec une mesure de garde à vue sans examen complémentaire et soins adaptés, qu’une incapacité totale de travail de cinq jours a été retenue, et qu’une fracture du coude gauche et un arrachement osseux de l’épicondyle médial de l’humérus ont par la suite été diagnostiqués (paragraphes 8-10 et 12 ci-dessus). Par ailleurs, un certificat médical du 10 avril 2006 établit que, plus de sept mois après les faits, l’état du requérant n’était toujours pas consolidé. Ces éléments attestent de l’intensité de la force physique dont il a été fait usage contre le requérant alors qu’il n’opposait pas de résistance active à son interpellation.
38. Dans ces circonstances, au vu tout particulièrement des faits relevés par le juge interne, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré que le recours à la force était à la fois proportionné et nécessaire.
39. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
DEMBELE C. SUISSE du 24 septembre 2013 Requête 74010/11
LES VIOLENCES DES GENDARMES LORS D'UNE INTERPELLATION ONT CAUSE DES LÉSIONS.
i. Principes généraux
38. La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no
25803/94, § 95, CEDH 1999-V).39. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime.
Pour apprécier les éléments qui lui permettent de dire s’il y a eu violation de l’article 3, la Cour se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Jalloh c. Allemagne [GC], no
54810/00, § 67, CEDH 2006‑IX ; Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 117, CEDH 2006‑IX).40. En cas d’allégations sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour doit se livrer à un examen particulièrement approfondi (Vladimir Romanov c. Russie, no
41461/02, § 59, 24 juillet 2008). Lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre toutefois pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des choses à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Jasar c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 69908/01, § 49, 15 février 2007). Même si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins des éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles ils sont parvenus.Quelle que soit l’issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l’Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention ; c’est à lui qu’il appartient de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 trouve à s’appliquer (Selmouni, précité, § 87 ; Rivas c. France, no
59584/00, § 38, 1er avril 2004).41. En ce qui concerne la question particulière des violences survenues lors de contrôles d’identités ou d’interpellations opérés par des agents de police, la Cour rappelle que le recours à la force doit être proportionné et nécessaire au vu des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Rehbock c. Slovénie, no
29462/95, § 76, CEDH 2000-XII ; Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001). Par ailleurs, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, § 38, et Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, §§ 52-53).42. La Cour a déjà admis qu’en présence d’une résistance physique ou d’un risque de comportements violents de la part des personnes contrôlées, une forme de contrainte de la part des agents de police était justifiée (voir, parmi d’autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269 ; Sarigiannis c. Italie, no
14569/05, § 61, 5 avril 2011). La Cour est arrivée aux mêmes conclusions dans des cas de « résistance passive » à une interpellation (Milan c. France, no 7549/03, § 59, 24 janvier 2008), de tentative de fuite face à la force publique (Caloc c. France, no 33951/96, §§ 100-101, CEDH 2000‑IX) ou d’un refus de fouille de la part d’un détenu (Borodin c. Russie, no 41867/04, §§ 119-121, 6 novembre 2012). Il appartient dès lors à la Cour de rechercher si la force utilisée dans ce type de situations est proportionnée au but recherché. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées aux personnes objet de l’intervention et aux circonstances précises dans lesquelles elles l’ont été (voir, parmi d’autres, R.L. et M.-J.D., R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004 ; Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 72, CEDH 2000‑XII ; Klaas c. Allemagne, précité, §§ 26-30).ii. Application de ces principes au cas d’espèce
43. La Cour relève qu’en l’espèce, si les versions des parties divergent sur le fait de savoir si le requérant s’était soumis au contrôle d’identité, en présentant ses papiers, ou s’il avait refusé de le faire (voir paragraphes 5 et 8 ci-dessus), il n’est pas contesté que le requérant refusa à plusieurs reprises d’éteindre sa cigarette ; qu’il réagit avec vigueur lorsque l’un des gendarmes se saisit de la cigarette ; qu’il refusa de se coucher au sol lorsque la situation devint plus tendue ; et que, lorsque l’un des gendarmes tenta de lui prendre le bras pour l’emmener au véhicule de police, il se débattit et parvint à s’éloigner. Les constats médicaux établis à la clinique de Carouge (voir paragraphe 9 ci-dessus) font d’ailleurs état de lésions à un bras et au cou pour l’un des gendarmes et d’une plaie superficielle avec réaction inflammatoire à l’avant-bras pour l’autre gendarme.
44. Ces éléments suffisent à la Cour pour admettre que le requérant avait opposé une résistance physique à l’action des gendarmes et que le recours à des moyens de coercition de la part de ces derniers était en principe justifié (voir Sarigiannis, précité § 61; Milan, précité § 59 ; Caloc, précité §§ 100-101). Reste à savoir si les moyens de coercition employés étaient proportionnés à la résistance opposée par le requérant.
45. A cet égard, la Cour relève que la fracture de la clavicule dont a été victime le requérant dépasse sans aucun doute le seuil de gravité exigé pour que le traitement qui lui a été infligé par les gendarmes qui l’avaient interpellé tombe sous les coups de l’article 3 de la Convention (voir paragraphe 39 ci-dessus). Les blessures occasionnées par l’intervention des gendarmes étaient à l’origine de l’arrêt de travail du requérant qui était initialement fixé à 21 jours (voir paragraphe 9 ci‑dessus).
46. Selon le médecin qui avait examiné le requérant, ce type de fracture résulte généralement d’un coup reçu perpendiculairement et serait fréquent chez les adeptes des deux-roues lors de chutes en avant. Dans le cas d’espèce, la fracture est donc compatible soit avec un ou plusieurs coups de matraque, ou autres coups, portés directement sur la clavicule, soit avec une chute en avant du requérant. En l’absence d’autre lésions corporelles compatibles avec la thèse du requérant, selon laquelle il aurait subi plusieurs coups, notamment à la tête, les juridictions nationales ont estimé que l’hypothèse la plus plausible était celle de la chute en avant et, sur ce constat, ont conclu que la force utilisée par les gendarmes était proportionnée.
47. La Cour ne partage pas ce raisonnement. Indépendamment de la cause précise et immédiate de la fracture de la clavicule du requérant, elle considère que les modalités d’intervention des gendarmes, dans leur ensemble, révèlent un usage disproportionné de la force.
En effet, il n’est pas contesté que le requérant n’était pas armé d’objets dangereux, mis à part la cigarette qu’il tenait dans la main, et que, au moins dans les premières phases de l’incident, il n’avait pas blessé les gendarmes ou tenté de les blesser en leur portant des coups de poings, de pied ou d’autre nature. La résistance qu’il avait opposée, avant d’être plaqué au sol et de mordre l’avant-bras de l’un des gendarmes, avait été par conséquent une résistance, certes opiniâtre, mais somme toute passive. L’usage des matraques de la part des gendarmes, qu’il ait été ou pas à l’origine directe de la blessure du requérant, était donc en lui-même injustifié (voir, mutatis mutandis, Borodin, précité, § 108).
48. En ce qui concerne les allégations d’injures à caractère raciste et les menaces de mort, la Cour prend note avec préoccupation du rapport de l’ECRI du 2 avril 2009 selon lequel il subsisterait des cas de comportements abusifs de la police à l’encontre de « non-ressortissants, de demandeurs d’asile, de Noirs et autres groupes minoritaires » ainsi que des inquiétudes de même nature exprimées par le CPT dans son rapport relatif à sa visite effectuée en Suisse du 10 au 20 octobre 2011 (voir paragraphes 30 et 31 ci-dessus). Cela étant, dans le cas d’espèce, force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet d’étayer les allégations du requérant sur ce point.
49. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la force employée pour maîtriser le requérant a été disproportionnée. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention sur ce point.
ÖZALP ULUSOY c. TURQUIE du 4 juin 2013 requête n° 9049/06
LA FORCE PUBLIQUE DOIT ÊTRE PROPORTIONNEE A L'ATTITUDE DE L'INDIVIDU
39. La Cour rappelle d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Mouisel c. France, no
67263/01, § 37, 14 novembre 2002, CEDH 2002‑IX, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000‑XI, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001‑III, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, 11 juillet 2006, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV). La Cour réaffirme en outre que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, par exemple lors d’une arrestation, l’utilisation à son égard d’une force physique excessive et injustifiée par rapport à son comportement constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (voir, parmi d’autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, §§ 23 et 24, série A no 269, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 68-78, CEDH 2000‑XII, Günaydın c. Turquie, no 27526/95, § 29, 13 octobre 2005).40. Dans les cas où il était absolument nécessaire de recourir à la force pour procéder à une arrestation, il convient de rechercher s’il en a été fait un usage proportionné (Altay c. Turquie, no
22279/93, § 54, 22 mai 2001, Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 70, CEDH 2003‑VII). A cet égard, la Cour rappelle attacher une importance particulière aux lésions ou séquelles qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été (Çelik c. Turquie (no 3), no 36487/07, § 65, 15 novembre 2012).41. La Cour relève d’emblée que, dans sa plainte auprès du procureur de la République, la requérante a aussi allégué qu’elle avait fait une fausse couche en raison des coups qui lui avaient été infligés par les forces de l’ordre. Cela étant, la Cour estime utile de souligner qu’elle est appelée en l’espèce à se prononcer sur la question de savoir si la requérante a subi des mauvais traitements de la part des forces de l’ordre lors de la dispersion de la manifestation litigieuse et si l’enquête menée par les autorités nationales sur ce point a été ou non suffisante.
42. Dans ces conditions, la Cour n’a pas à se prononcer d’office sur le point de savoir si la requérante a fait une fausse couche en raison des mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre.
43. En l’espèce, la Cour constate qu’il ressort en particulier du rapport médical établi par l’institut médicolégal d’Istanbul le 19 mars 2004 que la requérante présentait sur la cuisse droite une ecchymose de 5 x 6 cm ainsi que diverses contusions sur d’autres parties du corps (paragraphe 9 ci-dessus). A la lumière des constats opérés dans le rapport en question, la Cour considère que les traitements dont la requérante a été victime tombent sous le coup de l’article 3 de la Convention.
44. La Cour note aussi que, dans sa plainte, la requérante a exposé sa version du déroulement de la manifestation et des brutalités subies par elle et les autres manifestants. La décision de classement sans suite rendue par le procureur de la République indique qu’aucun élément de preuve ne corroborait les allégations de la requérante selon lesquelles les forces de l’ordre avaient dépassé le cadre légal de leurs fonctions, notamment envers la requérante elle-même. Toutefois, au regard des faits de l’espèce, la Cour constate qu’il n’est pas établi que la requérante avait fait preuve d’une agressivité telle qu’elle n’avait pu être maîtrisée que par le recours à la force. Elle estime en outre que la dispersion d’une manifestation ne saurait suffire en soi à justifier la violence des coups portés à la requérante.
45. Au vu de ce qui précède et des rapports médicaux produits par la requérante, la Cour estime que les explications du Gouvernement sur le recours à la force par ses agents ne comportent aucun argument convaincant de nature à la conduire à conclure que la force employée n’était pas excessive ou qu’elle était absolument nécessaire au regard du comportement adopté par la requérante lors de la dispersion de la manifestation. En conséquence, la Cour conclut que la force utilisée dans la présente affaire était excessive et injustifiée.
46. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
UNE PERQUISITION POLICIÈRE AU DOMICILE
PETROV ET IVANOVA c. BULGARIE du 31 mars 2016 requête 45773/10
Violation de l'article 3 : Commando de la police qui perquisitionne et entre de force dans son domicile, il y a une violation de l'article 3 de la Convention car la requérante a subi une sentiment de peur, d'angoisse et d'impuissance.
33. La requérante allègue que l’entrée de policiers cagoulés et lourdement armés à son domicile, tôt le matin du 10 février 2010, lui a causé de forts sentiments de peur et d’angoisse qui ont dépassé le seuil de gravité nécessaire pour conclure à une violation de l’article 3 en l’occurrence. Elle estime qu’elle a été soumise à un traitement inhumain et dégradant.
34. Le Gouvernement n’a pas formulé des observations sur le fond de ce grief.
35. La Cour observe que les circonstances de la présente espèce, concernant l’intervention de la police au domicile de la requérante, sont similaires à celles dans l’affaire Gutsanovi, précitée, où la Cour a trouvé violation de l’article 3 de la Convention en prenant en compte les éléments suivants : i) plusieurs policiers cagoulés et lourdement armés avaient fait irruption dans le logement des requérants tôt le matin ; ii) la présence éventuelle des proches de la personne recherchée par la police n’avait pas été prise en compte aux stades de préparation et d’exécution de l’opération policière ; iii) l’intervention policière avait été effectuées sans l’autorisation préalable d’un juge ; iv) la conjointe de la personne recherchée n’avait pas été impliquée dans les faits reprochés à son époux (voir §§ 116, 117 et 131‑134 de l’arrêt précité). Force est de constater que tous ces éléments sont également présents dans le cas d’espèce (voir paragraphes 16 et 18 in fine ci-dessus). La Cour observe par ailleurs qu’à l’époque des faits, la requérante était enceinte (voir paragraphe 7 ci-dessus).
36. La Cour ne voit donc aucune raison d’arriver à une conclusion différente de celle qu’elle a adoptée dans l’affaire Gutsanovi, précitée, pour ce qui est du grief tiré de l’article 3 de la Convention. A la lumière des éléments susmentionnés, la Cour estime que la requérante a été soumise à une épreuve psychologique qui a généré chez elle de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance (voir paragraphe 16 in fine), et qui, de par ses effets néfastes, s’analyse en un traitement dégradant au regard de l’article 3 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Gutsanovi, précité, § 134). Il y a donc eu en l’espèce violation de cette disposition de la Convention.
STOYANOV ET AUTRES c. BULGARIE du 31 mars 2016 requête du 31 mars 2016
Violation de l'article 3 : Commando de la police qui perquisitionne et entre de force dans son domicile, il y a une violation de l'article 3 de la Convention car la requérante a subi une sentiment de peur, d'angoisse et d'impuissance.
63. Pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou psychologiques ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. La Cour a considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à créer chez ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV). La souffrance psychologique peut résulter d’une situation dans laquelle des agents de l’État créent délibérément chez les victimes un sentiment de peur en les menaçant de mort ou de maltraitances (Hristovi c. Bulgarie, no 42697/05, § 80, 11 octobre 2011).
64. La Cour rappelle également que l’article 3 de la Convention ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation. Néanmoins, le recours à la force doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000‑XII, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001). À cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer des blessures ou dommages, ou de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII).
65. La Cour observe en l’espèce que les circonstances ayant entouré l’opération policière en cause ne prêtent pas à controverse entre les parties. En particulier, il est établi que l’intervention policière a été effectuée très tôt le matin, le 10 février 2010, par des agents spéciaux du ministère de l’Intérieur qui étaient masqués et armés. Les agents du ministère ont eu recours à la force physique pour immobiliser et menotter Plamen, Yordan et Veselin Stoyanovi. Les agents spéciaux ont également pénétré dans les autres pièces des deux logements où ils ont été aperçus par les conjointes et les enfants mineurs de Plamen et Yordan Stoyanovi (paragraphes 6-10 ci‑dessus).
66. La Cour note aussi que l’opération policière a été filmée et que certaines images prises lors de celle-ci – en particulier la photographie de Plamen Stoyanov, en tee-shirt et en caleçon, menotté et assis sur le sol – ont été par la suite publiées par les médias (paragraphes 5 in fine, 10 in fine et 32 ci-dessus).
67. Concernant les requérants Plamen et Yordan Stoyanovi, la Cour note d’emblée qu’ils étaient soupçonnés de participer à une organisation de type mafieux mêlée, entre autres, à différentes affaires d’extorsion et de racket (paragraphe 5 ci-dessus). Elle constate également qu’ils étaient titulaires de permis de ports d’armes et que la police a retrouvé dans leurs domiciles respectifs des armes à feu et des munitions (paragraphes 18 et 20 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait reprocher aux autorités le choix tactique d’impliquer dans l’opération en cause les forces spéciales d’intervention du ministère de l’Intérieur, ni le fait que celles-ci ont immobilisé et menotté ces deux requérants.
68. La Cour estime, en revanche que rien dans la présente espèce ne justifiait le fait de laisser Yordan Stoyanov menotté, tout nu, pendant presque une heure, un fait qui n’a pas été contesté par le Gouvernement. Ce requérant a même été amené à se cacher derrière une porte pour éviter les regards de ses enfants (voir paragraphe 9 ci-dessus). Plamen Stoyanov, quant à lui, a été contraint de rester assis sur le sol à l’extérieur de son immeuble, menotté et en sous-vêtements (paragraphe 32 ci-dessus). À la lumière de ces faits, la Cour estime que ces deux requérants ont été assujettis à une humiliation suffisamment intense pour rendre le traitement qui leur a été réservé incompatible avec l’article 3 de la Convention. Ils ont donc été soumis à un traitement dégradant par les forces de l’ordre.
69. En ce qui concerne l’intervention policière vis-à-vis de M. Veselin Stoyanov, le fils aîné de Yordan Stoyanov, la Cour observe qu’aucun soupçon de commission d’infractions pénales ne pesait à son encontre et que ce requérant a été immobilisé de force et menotté par les policiers dans sa chambre (paragraphe 8 in fine ci-dessus). Or, aucun document du dossier ne permet de conclure que l’intéressé a opposé une quelconque résistance aux forces de l’ordre lors de l’arrestation de son père ou que les policiers avaient des raisons sérieuses de craindre un comportement agressif de sa part. La Cour note aussi que, à la suite de ces événements, le jeune homme a souffert d’anxiété et de troubles du sommeil et qu’il a consulté une psychothérapeute à deux reprises (paragraphe 16 ci-dessus).
70. À la lumière de ces faits, la Cour estime que Veselin Stoyanov a, lui aussi, subi un traitement dégradant aux mains des forces de l’ordre.
71. En ce qui concerne les cinq autres requérants, à savoir Mme Petranka Stoyanova et M. Plamen Plamenov Stoyanov – épouse et fils mineur de M. Plamen Stoyanov –, et Mme Antonia Ivanova et Mlles Emilia et Monika Stoyanovi – compagne et filles mineures de M. Yordan Stoyanov–, la Cour constate que leur situation est similaire à celle de certains requérants dans l’affaire Gutsanovi, précitée. Dans cet arrêt la Cour a trouvé violation de l’article 3 de la Convention en prenant en compte les éléments suivants : i) l’intervention de la police avait impliqué une équipe d’agents cagoulés et lourdement armés et elle avait été effectuée tôt le matin ; ii) la présence éventuelle des proches de la personne recherchée par la police n’avait pas été prise en compte aux stades de préparation et d’exécution de l’opération policière ; iii) l’intervention policière avait été effectuées sans l’autorisation préalable d’un juge ; iv) la conjointe du suspect recherché n’avait pas été impliquée dans les faits reprochés à son époux ; v) la conjointe et les enfants mineurs du suspect recherché par la police avaient été fortement affectés par les événements (voir §§ 116, 117 et 131-134 de l’arrêt précité). Force est de constater que tous ces éléments sont également présents dans le cas d’espèce (voir paragraphes 5-16 ci-dessus).
72. La Cour ne voit donc aucune raison d’arriver à une conclusion différente de celle qu’elle a adoptée dans l’affaire Gutsanovi, précitée, pour ce qui est du grief tiré de l’article 3 de la Convention par ces cinq requérants À la lumière des éléments susmentionnés, la Cour estime que ces requérants ont été soumis à une épreuve psychologique qui a généré chez eux de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance et qui, de par ses effets néfastes, s’analyse en un traitement dégradant au regard de l’article 3 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Gutsanovi, précité, § 134).
73. En conclusion, après avoir pris en compte toutes les circonstances pertinentes en l’espèce, la Cour considère que les huit requérants susmentionnés ont été soumis à une épreuve psychologique qui a généré chez eux de forts sentiments de peur, d’angoisse, d’impuissance et d’avilissement et qui, de par ses effets néfastes, s’analyse en un traitement dégradant au regard de l’article 3 de la Convention. Pour ces motifs, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de victime des requérants. Il y a donc eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention.
GOVEDARSKI c. BULGARIE du 16 février 2016 requête 34957/12
Violation de l'article 3 : une perquisition policière sans contrôle du juge dans un domicile en présence de quatre enfants mineurs est une violation de l'article 3 alors que le chef de famille était déjà sous le contrôle de la police.
50. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou psychologiques ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. La Cour a jugé un traitement « inhumain » notamment en raison de son application avec préméditation pendant des heures et des lésions corporelles ou vives souffrances physiques et morales causées. Elle a considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à créer chez ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV). La souffrance psychologique peut résulter d’une situation dans laquelle des agents de l’État créent délibérément chez les victimes un sentiment de peur en les menaçant de mort ou de maltraitances (Hristovi c. Bulgarie, no 42697/05, § 80, 11 octobre 2011).
51. La Cour rappelle également que l’article 3 de la Convention ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation. Néanmoins, le recours à la force doit être proportionné et absolument nécessaire eu égard aux circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000‑XII, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001). À cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou bien tentera de fuir, ou de provoquer des blessures ou dommages, ou de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil 1997‑VIII). La Cour tient à rappeler en particulier que tout recours à la force physique par les agents de l’État qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de la personne qui y est soumise rabaisse la dignité humaine de celle-ci et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention (Rachwalski et Ferenc c. Pologne, no 47709/99, § 59, 28 juillet 2009). Ce critère de stricte proportionnalité a également été appliqué par la Cour dans des situations dans lesquelles les personnes concernées se trouvaient déjà sous le contrôle des forces de l’ordre (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269, Rehbock, précité, §§ 68-78, et Milan c. France, no 7549/03, §§ 52-65, 24 janvier 2008).
52. La Cour rappelle enfin que les allégations de mauvais traitements, contraires à l’article 3 de la Convention, doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII).
53. Dans la présente affaire, la Cour constate que les faits relatifs à l’opération policière menée au domicile des requérants n’ont fait l’objet d’aucun examen de la part des juridictions internes. Elle souligne que, confrontée à des situations similaires, elle procède à propre appréciation des faits tout en suivant les règles fixées par sa jurisprudence à cet effet (voir, à titre d’exemple, Sashov et autres c. Bulgarie, no 14383/03, § 48, 7 janvier 2010).
54. La Cour note en l’espèce qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’intervention policière au domicile des requérants a été effectuée le 21 novembre 2011, au matin, par des agents spéciaux du ministère de l’Intérieur qui étaient masqués et armés. Ceux-ci ont forcé la porte de la maison et ont arrêté M. Govedarski. Ce dernier a été retenu dans sa chambre un certain temps par les policiers. Vers midi, il a été menotté et emmené hors de sa maison. Il a été aperçu par plusieurs personnes qui s’étaient entre‑temps rassemblées devant sa maison.
55. La Cour note en revanche que les parties sont en désaccord en ce qui concerne l’heure exacte du début de l’opération policière. Le Gouvernement allègue que l’opération a débuté à 8 h 45 et les requérants exposent que les agents de police sont entrés à leur domicile à 6 h 40.
56. La Cour n’est pas en mesure de déterminer l’heure exacte du début de l’opération policière. Elle constate cependant que l’heure à laquelle se réfère le Gouvernement, à savoir 8 h 45, est celle du début de la perquisition de la maison. À cette heure-ci, les policiers étaient déjà présents dans la maison des requérants et M. Govedarski était déjà sous leur contrôle puisque, d’après le procès-verbal, il a assisté à la fouille des pièces du logement. Qui plus est, l’ordre de placement en détention du requérant dressé le jour de son arrestation mentionnait qu’il était détenu à compter de 8 heures (paragraphe 19 ci‑dessus). Il en ressort que l’opération policière a débuté quelque temps avant cette heure-ci. Quoi qu’il en soit, la Cour observe que les parties s’accordent pour dire que les requérants ont été réveillés par l’entrée de la police à leur domicile.
57. La Cour observe que l’opération en cause poursuivait le but légitime d’effectuer une arrestation, une perquisition et une saisie, ainsi que l’objectif d’intérêt général de la répression des infractions. Aussi doit-elle s’assurer qu’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la société et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de l’individu ont été respectés dans les circonstances de l’affaire. Sur ce point, elle relève que, même si les requérants n’ont pas été physiquement blessés au cours de l’intervention policière contestée, celle-ci a nécessairement impliqué un certain recours à la force physique : les policiers ont forcé la porte de la maison, ont pénétré à l’intérieur de celle-ci et ont arrêté M. Govedarski.
58. À cet égard, la Cour note que le but de l’intervention policière menée au domicile des requérants ce jour‑là était d’appréhender M. Govedarski, qui était suspecté dans une affaire pénale d’exercice illégal d’une activité financière, et d’effectuer une perquisition des locaux afin de rechercher des preuves matérielles et documentaires dans le cadre de cette même enquête pénale. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête en cause avait débuté quelques mois auparavant (paragraphe 6 ci‑dessus) et que des actes criminels violents n’étaient clairement pas en cause.
59. Pour ce qui est de la personnalité de M. Govedarski, la Cour observe qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’intéressé avait des antécédents de violence et qu’il aurait pu représenter un danger pour les agents de police amenés à intervenir à son domicile.
60. La Cour observe ensuite que ce requérant a été menotté et emmené hors de sa maison sous les regards de plusieurs habitants de sa ville qui s’étaient rassemblés devant le domicile familial (paragraphe 12 ci-dessus).
61. En outre, aucune pièce du dossier ne permet à la Cour de conclure que la présence éventuelle des enfants mineurs et de l’épouse de M. Govedarski a été prise en compte dans la planification et l’exécution de l’opération policière.
62. Certes, la Cour ne saurait aller jusqu’à imposer aux forces de l’ordre de ne pas arrêter les suspects d’infractions pénales à leur domicile chaque fois que leurs enfants ou conjoints s’y trouvent. Elle estime cependant que la présence éventuelle de membres de la famille du suspect sur les lieux de l’arrestation est une circonstance qui doit être prise en compte dans la planification et l’exécution de ce type d’opérations policières, ce qui n’a pas été fait dans la présente affaire. Qui plus est, en l’espèce, les forces de l’ordre n’ont pas envisagé d’autres modalités d’exécution de leur opération au domicile des requérants, consistant par exemple à retarder l’heure de l’intervention, voire à procéder au redéploiement des différents types d’agents impliqués dans l’opération. La prise en compte des intérêts légitimes de l’épouse et des enfants du premier requérant était d’autant plus nécessaire que Mme Taneva‑Govedarska n’était pas suspectée d’être impliquée dans les infractions pénales reprochées à son mari et que les deux fils du couple étaient psychologiquement vulnérables en raison de leur jeune âge – quatre et huit ans respectivement.
63. La Cour observe également que l’absence d’un contrôle judiciaire préalable sur la nécessité et la légalité de la perquisition en cause a laissé entièrement à la discrétion des autorités policières et des organes chargés de l’enquête pénale la planification de l’opération et n’a pas permis la prise en compte des droits et intérêts légitimes de Mme Taneva-Govedarska et des deux enfants mineurs. La Cour est d’avis que dans les circonstances spécifiques de l’espèce un tel contrôle judiciaire préalable aurait pu permettre la mise en balance des intérêts légitimes de ces trois requérants avec l’objectif d’intérêt général d’appréhender les personnes suspectées d’avoir commis une infraction pénale.
64. Pour ce qui est de l’effet psychologique de l’intervention policière sur les quatre requérants, la Cour rappelle que les opérations policières impliquant une intervention au domicile et l’arrestation de suspects engendrent inévitablement des émotions négatives chez les personnes visées par ces mesures. Cependant, il existe dans la présente espèce des éléments concrets, non contestés par le Gouvernement, qui démontrent que les requérants ont été très fortement affectés par les événements en cause : M. Govedarski a souffert d’une crise d’angoisse, d’insomnie et de dépression et a pris des anxiolytiques (paragraphe 13 ci-dessus) ; Mme Taneva‑Govedarska a fait une crise d’hypertension artérielle et un malaise (paragraphe 14 ci-dessus) ; les enfants du couple Govedarski ont été fortement marqués par les événements – M., demandait souvent si les policiers allaient revenir et S. avait entre autres des problèmes d’incontinence (paragraphe 15 ci-dessus).
65. La Cour considère également que l’heure matinale de l’intervention policière et la participation d’agents spéciaux cagoulés ont contribué à amplifier les sentiments de peur et d’angoisse éprouvées par les requérants, à tel point que le traitement infligé a dépassé le seuil de gravité exigé pour l’application de l’article 3 de la Convention. La Cour estime donc que les requérants ont été soumis à un traitement dégradant.
66. En conclusion, après avoir pris en compte toutes les circonstances pertinentes en l’espèce, la Cour considère que l’opération policière au domicile des requérants n’a pas été planifiée et exécutée de manière à assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’arrestation d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction pénale et le rassemblement de preuves dans le cadre d’une enquête pénale. Les requérants ont été soumis à une épreuve psychologique qui a généré chez eux de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance et qui, de par ses effets néfastes, s’analyse en un traitement dégradant au regard de l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu en l’espèce violation de cette disposition.
BLAIR ET AUTRES c. ITALIE du 26 octobre 2017 requête 1442/14
VIOLENCES POLICIÈRES DURANT LES MANIFESTATIONS
Les violences policières contre les manifestants en France a contraint la CGT à publier un abécédaire pour apprendre aux citoyens à réagir.
Kilici c. Turquie du 27 novembre 2018 requête n° 32738/11
Violation de l'article 3 : le requérant se plaint d’avoir été blessé par une balle en caoutchouc et d’avoir inhalé du gaz lacrymogène, lors d'une manifestation. Il allègue enfin que la police a frappé les manifestants à coups de matraque.
"35. Compte tenu de l’absence de cadre réglementaire adéquat sur l’usage des balles en caoutchouc pendant les manifestations ainsi que de l’absence de mention quant à l’utilisation de ce type de munitions dans les procès-verbaux établis par la police le jour des faits dénoncés, la Cour conclut que les forces de l’ordre ont agi sans instruction précise, avec une grande autonomie. (-) Pour la Cour, une telle situation ne permet pas d’offrir le niveau de protection de l’intégrité physique des personnes qui est requis dans les sociétés démocratiques contemporaines en Europe.
37. Enfin, et plus spécifiquement, le procureur n’a pas non plus cherché à savoir si l’utilisation de la force contre le requérant correspondait à un usage, par les policiers, de la force qui était rendue strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Zülcihan Şahin et autres c. Turquie, no 53147/99, § 54, 3 février 2005). À cet égard, il convient de noter que, même si un certain nombre de manifestants semblent avoir été arrêtés pour violences ou résistance aux policiers, le requérant n’a été ni arrêté ni poursuivi au titre d’une quelconque infraction qu’il aurait commise lors de la manifestation litigieuse."
LES FAITS
20. Le requérant dénonce un usage disproportionné et injustifié de la force par les policiers ainsi que l’absence d’une enquête effective à l’égard de ces derniers. Il se plaint d’avoir été blessé par une balle en caoutchouc et d’avoir inhalé du gaz lacrymogène. Il allègue enfin que la police a frappé les manifestants à coups de matraque. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention.
CEDH
25. Le Gouvernement indique que les manifestants avaient lancé des pierres sur les policiers et bloqué les voies principales, et que les policiers ont répliqué en ayant recours à la force, et ce sur le fondement de la loi no 2559 et de la loi no 2911. Par ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a été blessé par une balle en caoutchouc lors d’un tir effectué par les forces de l’ordre.
26. Il soutient également que les moyens utilisés par la police étaient conformes à la loi et aux instructions – sans préciser lesquelles –, et que, en dépit des allégations du requérant, il n’a pas été fait usage de gaz lacrymogènes ce jour-là, aucun registre officiel n’en faisant mention.
27. Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], no 39630/09, §§ 182-185 et 195-198, CEDH 2012), Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], nos 10865/09 et 2 autres, §§ 314-326, CEDH 2014 (extraits)), et Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH 2015).
28. En l’espèce, même si la version du requérant (paragraphe 8 ci-dessus) diverge de celle du Gouvernement sur certains aspects du déroulement des événements du 16 mars 2009, la Cour observe que, comme cela ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier, la manifestation litigieuse avait débuté de manière pacifique dans le quartier de Beyoğlu, où les membres de différents syndicats s’étaient réunis pour protester à l’occasion de la tenue du forum. Alors que le groupe prenait la direction du quartier voisin où se tenait le forum, la police a pris des dispositions pour l’empêcher d’avancer et a demandé aux manifestants de faire leur déclaration à la presse dans un endroit qu’elle leur a désigné, et ce sans s’approcher des lieux du forum et sans perturber le trafic automobile et la circulation des piétons. Une partie du groupe a accepté de suivre ces instructions, a donné lecture au public de sa déclaration et a quitté les lieux. Le restant du groupe, dont le requérant, s’est rapproché davantage des lieux non autorisés, il a fait une déclaration à la presse et, au moment où le groupe se dispersait, certains manifestants, qui souhaitaient continuer à progresser vers le quartier de Haliç, ont scandé des slogans et lancé des pierres en direction de la police, laquelle est alors intervenue pour faire obstacle à leur progression. Il n’est pas établi ni allégué que le requérant a activement pris part aux actes de violence commis lors des événements en question.
29. La Cour note que, au cours de ces événements, le requérant a été légèrement blessé par une balle en caoutchouc, qui a provoqué une rougeur et une ecchymose au niveau du dos (paragraphe 13 ci-dessus). En outre, l’intéressé a dénoncé l’utilisation de gaz lacrymogènes et de matraques lors de la dispersion des manifestants.
30. La Cour observe cependant que, même si le procureur confirme (paragraphe 14 ci-dessus) – et si le Gouvernement ne conteste pas – que la blessure du requérant a été occasionnée par une balle en caoutchouc tirée par les policiers, le dossier de l’affaire (paragraphes 10 et 11 ci-dessus) est muet sur la manière dont les policiers sont intervenus lors de la manifestation. En effet, les procès-verbaux d’incident dressés à la suite des événements n’indiquent nullement que la police a eu recours à des balles en caoutchouc ou à des gaz lacrymogènes et ils ne contiennent aucune indication sur la manière dont la police a utilisé ces munitions afin de disperser les manifestants. Ils indiquent sans autre précision que la police est intervenue graduellement, d’abord en se protégeant avec les boucliers puis en utilisant un canon à eau pour repousser les manifestants.
31. Autrement dit, la Cour est appelée à examiner la question de savoir si une action policière qui n’a pas été intégralement rapportée dans les documents officiels était ou non conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention.
32. Bien qu’en l’espèce, par chance, la blessure occasionnée par la balle en caoutchouc ait été relativement légère, il n’en reste pas moins que, dans la mesure où la dangerosité de pareilles munitions ne fait pas de doute, le requérant a quand même été exposé à un risque de blessure plus importante. En effet, à l’instar du tir d’une grenade lacrymogène au moyen d’un lanceur (Abdullah Yaşa et autres, précité, § 43), le tir d’une balle en caoutchouc risque de causer de graves blessures lorsque ce type de munitions est utilisé de manière inadéquate. Pour ces raisons, elle considère que la lésion que présentait le requérant (paragraphe 13 ci-dessus) suffit pour faire entrer en jeu l’article 3 de la Convention (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 88, CEDH 2010).
33. Par conséquent, selon la jurisprudence pertinente de la Cour (ibidem, § 43), pour qu’une telle action policière soit compatible avec les exigences de l’article 3 de la Convention, les opérations de police – y compris l’utilisation de balles en caoutchouc – doivent non seulement être autorisées par le droit national mais aussi être suffisamment délimitées par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire, l’abus de la force et les accidents évitables.
34. Or le Gouvernement ne fait référence ni à une quelconque disposition réglementant spécifiquement l’usage des balles en caoutchouc pendant les manifestations ni à une directive concernant leur mode d’utilisation.
35. Compte tenu de l’absence de cadre réglementaire adéquat sur l’usage des balles en caoutchouc pendant les manifestations ainsi que de l’absence de mention quant à l’utilisation de ce type de munitions dans les procès-verbaux établis par la police le jour des faits dénoncés, la Cour conclut que les forces de l’ordre ont agi sans instruction précise, avec une grande autonomie. Elle estime que les seules dispositions législatives qui décrivent les lignes directrices des compétences attribuées à la police dans l’usage de la force (paragraphe 18 ci-dessus) ne suffisent pas en elles-mêmes à faire du tir de balles en caoutchouc une action policière régulière et adéquate en l’absence d’une réglementation spécifique régissant l’usage de ce type de munitions. Pour la Cour, une telle situation ne permet pas d’offrir le niveau de protection de l’intégrité physique des personnes qui est requis dans les sociétés démocratiques contemporaines en Europe.
36. Par ailleurs, la Cour note que, à la suite du dépôt de sa plainte par le requérant, le procureur de la République saisi de l’affaire a rendu une décision de non-lieu sans avoir répondu à la doléance principale du requérant concernant sa blessure par balle en caoutchouc et sans avoir procédé à un quelconque acte d’investigation. Le procureur s’est borné à estimer que, au regard de la tournure des événements, la réaction des forces d’intervention rapide était restée dans les limites du recours à la force légitime prévu par la loi. La Cour observe que la décision du procureur n’indique nullement le type de balle en caoutchouc utilisé par les forces de l’ordre au moment des faits dénoncés ni à partir de quel type d’arme les balles en question ont été lancées. Le Gouvernement n’a pas non plus fourni d’explication sur le type et les modalités d’usage des balles en caoutchouc mises à la disposition des policiers antiémeutes. Partant, la Cour estime que l’enquête menée par les autorités internes a été manifestement défaillante.
37. Enfin, et plus spécifiquement, le procureur n’a pas non plus cherché à savoir si l’utilisation de la force contre le requérant correspondait à un usage, par les policiers, de la force qui était rendue strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Zülcihan Şahin et autres c. Turquie, no 53147/99, § 54, 3 février 2005). À cet égard, il convient de noter que, même si un certain nombre de manifestants semblent avoir été arrêtés pour violences ou résistance aux policiers, le requérant n’a été ni arrêté ni poursuivi au titre d’une quelconque infraction qu’il aurait commise lors de la manifestation litigieuse.
38. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il n’est pas établi que l’usage de la force dont le requérant a été victime dans les conditions décrites ci-dessus était une réponse adéquate à la situation, au regard des exigences de l’article 3 de la Convention, et proportionnée au but recherché, à savoir réguler la dispersion d’un rassemblement. De même, elle considère que, en méconnaissance de la même disposition, les actes d’enquête entrepris n’ont pas revêtu un caractère approfondi et effectif.
39. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Hentschel et Stark c. Allemagne du 9 novembre 2017 requête no 47274/15
Violation article 3 : Allégations de mauvais traitements infligés lors d'une manifestation sportive, à des supporters de football, par des policiers casqués mal identifiables. L'enquête est qualifiée d'inadéquate, alors que les faits de violence policière sont considérés comme non avérés devant la CEDH !
Les Faits
Les requérants, Ingo Hentschel et Matthias Stark, sont des ressortissants allemands nés en 1969 et 1989 et habitant à Illertissen et Harburg (Allemagne), respectivement. Les requérants assistèrent tous deux à un match de football à Munich le 9 décembre 2007. Plus de 200 policiers furent déployés pendant le match, notamment plusieurs agents antiémeutes, en raison d’un risque supposé d’altercations entre supporters de football rivaux. À la fin du match, la police forma un cordon pendant une quinzaine de minutes pour entourer les supporters de l’une des équipes, au sein desquels se trouvaient les requérants, afin de les empêcher de se heurter aux supporters de l’autre équipe. Devant la Cour, M. Hentschel soutenait qu’alors qu’il se rendait vers la sortie une fois le cordon levé, des policiers s’étaient approchés d’un groupe de spectateurs et certains d’entre eux avaient commencé à frapper ces derniers à l’aide de leurs matraques sans sommation préalable. Il affirmait avoir été blessé à la tête par des coups de matraque qui avaient causé un saignement et nécessité son hospitalisation ultérieure. Selon M. Stark, avant de sortir du stade, un policier l’avait attrapé à l’épaule et aspergé de gaz lacrymogène à bout portant. Il alléguait que, une fois allongé au sol, il avait été frappé au bras à coups de matraque. Le Gouvernement soutenait qu’aucun élément ne prouvait de manière crédible que les requérants avaient été délibérément frappés ou blessés par des policiers. À la suite de la diffusion par les médias de témoignages de supporters de football qui affirmaient avoir été arbitrairement agressés par des policiers juste après le match, le parquet de Munich ouvrit une enquête préliminaire en janvier 2008. Les requérants, qui disaient avoir été victimes de policiers mais sans pouvoir les identifier précisément parce que ceux-ci portaient des uniformes identiques sans signes distinctifs et sans mention de leurs noms, portèrent chacun plainte au pénal contre des policiers non identifiés. En septembre 2008, le parquet classa l’instruction sans suite. Il estima que certains éléments prouvaient que des policiers avaient fait usage de leur matraque de manière disproportionnée mais conclut qu’il était impossible d’identifier les suspects. À la suite d’un recours formé par les requérants, il rouvrit l’instruction en octobre 2008, ordonnant de nouvelles mesures d’enquête. En août 2009, il classa de nouveau sans suite l’instruction, au motif en particulier que plusieurs supporters s’étaient agressivement approchés des policiers déployés et les avait insultés et provoqués, ce qui justifiait l’usage par ces derniers de leurs matraques. Le classement sans suite fut confirmé par le parquet général de Munich en 2011. En septembre 2011, la cour d’appel de Munich jugea irrecevable l’action formée par les requérants aux fins de l’adoption de nouvelles mesures d’instruction. En mars 2015, la Cour constitutionnelle fédérale rendit une décision motivée (dossier no 2 BvR 1304/12) par laquelle elle refusait de se saisir du recours constitutionnel formé par les requérants.
Article 3 (traitement)
La Cour constate que les parties sont en désaccord sur le point de savoir comment les événements se sont réellement déroulés après le match de football du 9 décembre 2007. Elle souligne que son rôle est subsidiaire et qu’elle doit se garder de jouer le rôle d’un juge du fond compétent pour apprécier les faits, sauf si cela est rendu inévitable par les circonstances de la cause.La Cour relève que le cordon formé par la police à la fin du match n’a servi qu’à bloquer les sorties du stade pendant une quinzaine de minutes, sans entraver la libre circulation des supporters dans les tribunes, et que, selon les requérants, les violences policières se sont produites une fois le cordon levé, alors qu’ils avaient déjà quitté les tribunes. Elle en conclut que les requérants ne se trouvaient pas, à ce moment-là, aux mains de la police, que la charge de la preuve n’est donc pas passée sur le Gouvernement, et que, par conséquent, il incombait aux requérants d’étayer leurs arguments factuels en produisant devant elle les éléments de preuve nécessaires. La Cour constate que les certificats médicaux soumis par les requérants attestent que ceux-ci présentaient des lésions pouvant avoir été causées par des mauvais traitements, à savoir des coups de matraque à la tête et la projection de gaz lacrymogène à bout portant sur le visage, mais qu’ils n’indiquent pas la cause précise des lésions. Elle observe qu’en outre, le certificat médical de M. Stark n’a été délivré que six semaines après les mauvais traitements allégués et que le médecin qui l’a établi n’a donc pas pu s’appuyer sur l’examen des lésions elles-mêmes. Si certains des témoignages produits par les requérants et rapportés par la presse ont décrit l’opération policière en des termes analogues aux récits des requérants, ces derniers n’ont présenté aucun témoignage ni aucune autre preuve confirmant directement leurs dires, et aucune des personnes interrogées au cours de l’enquête interne n’a été témoin des actes allégués. De plus, M. Hentschel n’a dénoncé les violences policières alléguées que six semaines après les faits, et les deux requérants n’ont déposé une plainte pénale que plusieurs mois plus tard. En bref, la Cour conclut qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que les événements se soient effectivement déroulés selon la description qu’en ont faite les requérants. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 3 en ce qui concerne le traitement des intéressés par la police (volet matériel).
Article 3 (enquête)
La Cour considère que les requérants ont formulé un grief défendable de mauvais traitements infligés par la police, allégation sur laquelle il était nécessaire qu’une autorité nationale indépendante enquête de manière effective. Examinant l’indépendance de l’enquête, la Cour ne décèle, entre le service de police qui a mené l’enquête sur les violences policières alléguées et le service antiémeutes qui a fait l’objet de ladite enquête, aucun lien hiérarchique, institutionnel ou pratique qui aurait en soi privé l’enquête de son caractère fiable ou effectif. Les investigations n’ont pas été conduites par un service de police distinct, ce qui aurait été souhaitable, mais par une division des services de police de Munich spécialisée dans les infractions commises par des agents publics. Toutefois, l’enquêteur n’était pas un collègue direct des agents antiémeutes et le seul point commun entre ces deux divisions était qu’elles faisaient l’une et l’autre partie des services de police de Munich, et relevaient donc du même chef de la police. La Cour souligne néanmoins qu’il est important que la manière dont ce type d’enquête est mené garantisse également une apparence d’indépendance afin de préserver la confiance du public. La Cour estime que l’enquête a été menée de manière suffisamment rapide et diligente. La police de Munich a ouvert une enquête préliminaire après avoir été alertée par la presse sur des allégations selon lesquelles des violences policières avaient été commises en marge du match de football du 9 décembre 2007. Au vu des pièces du dossier, la Cour ne décèle pas de longues périodes d’inactivité pendant l’enquête, qui a duré 19 mois avant d’être abandonnée. Elle observe que les requérants n’ont déposé plainte qu’en mars et en avril 2008, respectivement. Les autorités n’ont donc été en mesure d’enquêter sur les allégations des requérants qu’à partir de ce moment-là, et elles n’ont pas pu ordonner un examen médico-légal des lésions des intéressés immédiatement après les faits, compte tenu du retard avec lequel les plaintes ont été déposées.
En ce qui concerne les mesures d’enquête effectivement mises en œuvre, la Cour observe que les policiers antiémeutes casqués qui ont été déployés ne portaient aucune mention de leur nom ni aucun autre signe distinctif, mais seulement un numéro d’identification à l’arrière de leur casque, et qu’il était donc particulièrement important d’appliquer d’autres mesures qui auraient permis d’établir l’identité des personnes responsables des mauvais traitements allégués. Quant aux enregistrements vidéo réalisés par les agents antiémeutes, la Cour relève que l’autorité d’enquête n’en a reçu que des extraits. Le Gouvernement n’a pas clairement indiqué si un service indépendant avait pu analyser l’ensemble des enregistrements, pourquoi le service d’enquête n’en avait reçu que des extraits, ni quand les enregistrements avaient été détruits et par qui. Examinant les autres mesures d’enquête afin de déterminer si elles auraient pu contrebalancer le manquement à réunir la totalité des enregistrements vidéo et à les faire analyser par des services d’enquête indépendants, la Cour note qu’une quarantaine de témoins ont été interrogés, y compris les chefs d’équipe des unités antiémeutes. Elle observe toutefois que tous les policiers déployés dans la zone où les requérants affirment avoir été maltraités n’ont pas été interrogés et que, de surcroît, les agents chargés des enregistrements vidéo n’ont été entendus qu’après la réouverture de l’enquête en octobre 2008 et aucune démarche n’a été entreprise pour retrouver et interroger l’infirmier qui, selon M. Hentschel, l’avait soigné pendant qu’il était encore au stade. Étant donné que ces pistes pourtant évidentes n’ont pas été suivies, la Cour estime que le fait que les policiers casqués qui ont été déployés n’aient pas porté d’insignes qui auraient permis de les identifier, avec toutes les difficultés qui en ont résulté, n’a pas été suffisamment contrebalancé pendant l’enquête. Elle conclut donc qu’il n’y a pas eu d’enquête effective, ce qui emporte violation de l’article 3 (volet procédural).
AZZOLINA et autres c. Italie du 26 octobre 2017 requêtes nos 28923/09 et 67599/10
Article 3 : Défaillances de l’enquête officielle menée à la suite des violences exercées par la police sur des manifestants détenus à la caserne de Bolzaneto après le sommet du G8 de Gênes du 20 septembre 2001. Deux arrêts avec l'arrêt Blair ci-dessous de celui -ci rendus 16 ans après les faits. Ces arrêts si longtemps après les faits ont-ils encore un sens ? Une évolution jurisprudentielle sur la recevabilité, il est possible quand les procédures internes traînent de saisir la Cour de Cassation, puis la CEDH sans attendre la réponse de la Cour de cassation.
Recevabilité car les requérants ont saisi la CEDH avant la décision de la Cour de Cassation : requête recevable
103. Aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
104. La Cour a déjà jugé, dans certaines affaires introduites avant la fin de la procédure pénale concernant des mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention, que l’exception du gouvernement défendeur tirée du caractère prématuré de la requête avait perdu sa raison d’être une fois la procédure pénale en question achevée (Kopylov, précité, § 119, renvoyant à Samoïlov c. Russie, no 64398/01, § 39, 2 octobre 2008, et Cestaro, précité, § 145).
105. En outre, si, en principe, le requérant a l’obligation de tenter loyalement divers recours internes avant de saisir la Cour et si le respect de cette obligation s’apprécie à la date d’introduction de la requête (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits)), la Cour tolère que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité de celle‑ci (Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, §§ 57 et 87-92, CEDH 2011 (extraits), Rafaa c. France, no 25393/10, § 33, 30 mai 2013, et Cestaro, précité, §§ 146 et 205-208 et les références qui y sont mentionnées).
106. En l’espèce, la Cour rappelle que les requérants allèguent avoir été victimes d’actes de torture qui auraient été commis entre le 20 et le 23 juillet 2001 (paragraphes 18-50 ci-dessus).
107. Elle relève ensuite que la procédure pénale engagée contre les forces de l’ordre relativement aux événements survenus au sein de la caserne de Bolzaneto, procédure dans laquelle les requérants se sont constitués parties civiles en janvier 2005 (à l’exception de Mme Kutschkau, qui s’est constituée partie civile en février 2005, et de M. Galloway et Mme Ender, qui l’ont fait en octobre 2005), a abouti, en novembre 2008, au dépôt du jugement de première instance (paragraphe 52 ci-dessus) et, en avril 2011, au dépôt de l’arrêt d’appel (paragraphe 57 ci-dessus). Elle estime que l’application de la prescription et de la remise de peine sont deux aspects qui pèsent sur l’appréciation de l’épuisement des voies de recours internes.
108. Dans ces circonstances, en tenant compte en particulier des faits allégués, la Cour ne saurait reprocher aux requérants de lui avoir adressé leurs griefs portant sur la violation de l’article 3 de la Convention en mai 2009 et en septembre 2010, soit respectivement près de huit ans et plus de neuf ans après les événements survenus au sein de la caserne de Bolzaneto, sans avoir attendu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 juin 2013 et déposé le 10 septembre 2013 (paragraphe 69 ci-dessus). En conséquence, cette partie de l’exception du Gouvernement tirée du non‑épuisement des voies de recours internes en matière pénale ne peut être retenue.
Épuisement des voix de recours, et qualité de victime :
113. La Cour rappelle que, selon ses principes généraux relatifs à la règle de l’épuisement des voies de recours internes (Vučković et autres c. Serbie ([GC], nos 17153/11 et autres, §§ 69-77, 25 mars 2014), l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et qu’il présente des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil 1996‑IV, et Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 70, CEDH 2010).
114. La Cour rappelle également qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte, en faisant preuve d’une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment qu’elle doit tenir compte de manière réaliste du contexte juridique et politique dans lequel les recours s’inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres, précité, § 69, Selmouni, précité, § 77, Kozacıoğlu c. Turquie [GC], no 2334/03, § 40, 19 février 2009, et Reshetnyak c. Russie, no 56027/10, § 58, 8 janvier 2013).
115. Dans son appréciation de l’effectivité de la voie de recours indiquée par le gouvernement défendeur, la Cour doit donc prendre en compte la nature des griefs et les circonstances de l’affaire pour établir si cette voie de recours fournissait au requérant un moyen adéquat de redressement de la violation dénoncée (Reshetnyak, précité, § 71, concernant le caractère inadéquat d’un recours indemnitaire en cas de violation continue de l’article 3 de la Convention à raison des conditions de détention et, en particulier, de l’aggravation de l’état de santé du détenu, et De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, §§ 82-83, CEDH 2012, où la Cour a rappelé que l’exigence d’un recours de plein droit suspensif contre l’expulsion de l’intéressé dépendait de la nature de la violation de la Convention ou de ses Protocoles qu’aurait entraînée l’expulsion).
116. En l’espèce, la Cour observe que, comme sur le terrain de la perte de la qualité de victime (paragraphes 93-98 ci-dessus), les thèses des parties divergent profondément quant à l’étendue des obligations découlant de l’article 3 de la Convention et quant aux moyens nécessaires et suffisants pour redresser les violations en cause.
117. Eu égard à sa décision de joindre au fond la question de la perte de la qualité de victime, elle estime qu’il doit en aller de même pour l’exception de non-épuisement de la voie de recours en matière civile.
VOLET MATÉRIEL
α) Principes généraux
126. Les principes généraux applicables en la matière ont été récemment rappelés dans les arrêts Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 88-90, CEDH 2015) et Bartesaghi Gallo et autres c. Italie (nos 12131/13 et 43390/13, §§ 111-113, 22 juin 2017).
β) Application de ces principes aux circonstances des présentes espèces
127. La Cour note d’emblée que les tribunaux internes ont établi de manière détaillée et approfondie, avec exactitude et au-delà de tout doute raisonnable les mauvais traitements dont les personnes placées à la caserne de Bolzaneto ont été l’objet (paragraphes 18-50 ci-dessus) et elle ne relève pas d’éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des conclusions auxquelles ils sont parvenus (Gäfgen, précité, § 93). Les témoignages des victimes ont été confirmés par les dépositions de membres des forces de l’ordre et de l’administration publique, par les admissions partielles des accusés ainsi que par les documents à disposition des magistrats, notamment les comptes rendus médicaux et les expertises judiciaires.
128. Dès lors, la Cour juge établies tant les agressions physiques et verbales dont les requérants se plaignent que les séquelles découlant de celles-ci. Elle constate en particulier ce qui suit :
– dès leur arrivée à la caserne de Bolzaneto, il a été interdit aux requérants de lever la tête et de regarder les agents qui les entouraient ; ceux qui avaient été arrêtés à l’école Diaz-Pertini ont été marqués d’une croix tracée au feutre sur la joue ; tous les requérants ont été obligés de se tenir immobiles, bras et jambes écartés, face aux grilles à l’extérieur de la caserne ; la même position vexatoire a été imposée à chacun à l’intérieur des cellules ;
– à l’intérieur de la caserne, les requérants étaient contraints de se déplacer penchés en avant et la tête baissée ; dans cette position, ils devaient traverser « le tunnel des agents », à savoir le couloir de la caserne dans lequel des agents se tenaient de chaque côté pour les menacer, les frapper et leur lancer des insultes à caractère politique ou sexuel (paragraphe 64 ci‑dessus) ;
– lors des visites médicales, les requérants ont été l’objet de commentaires, d’humiliations et parfois de menaces de la part du personnel médical ou des agents de police présents ;
– les effets personnels des requérants ont été confisqués, voire détruits de façon aléatoire ;
– compte tenu de l’exiguïté de la caserne de Bolzaneto ainsi que du nombre et de la répétition des épisodes de brutalité, tous les agents et fonctionnaires de police présents étaient conscients des violences commises par leurs collègues ou leurs subordonnés ;
– les faits en cause ne peuvent se résumer à une période donnée au cours de laquelle, sans que cela ne puisse aucunement le justifier, la tension et les passions exacerbées auraient conduit à de tels excès : ces faits se sont déroulés pendant un laps de temps considérable, à savoir entre la nuit du 20 au 21 juillet et le 23 juillet, ce qui signifie que plusieurs équipes d’agents se sont succédées au sein de la caserne sans aucune diminution significative en fréquence ou en intensité des épisodes de violence.
129. En ce qui concerne les récits individuels des requérants, la Cour ne peut que constater la gravité des faits décrits par les intéressés. Ce qui ressort du matériel probatoire démontre nettement que les requérants, qui n’ont opposé aucune forme de résistance physique aux agents, ont été victimes d’une succession continue et systématique d’actes de violence provoquant de vives souffrances physiques et psychologiques (Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 126, CEDH 2013 (extraits)). Ces violences ont été infligées à chaque individu dans un contexte général d’emploi excessif, indiscriminé et manifestement disproportionné de la force (Bouyid, précité, § 101).
130. Ces épisodes ont eu lieu dans un contexte délibérément tendu, confus et bruyant, les agents criant à l’encontre des individus arrêtés et entonnant de temps en temps des chants fascistes. Dans son arrêt no 678/10 du 15 avril 2011, la cour d’appel de Gênes a établi que la violence physique et morale, loin d’être épisodique, a, au contraire, été indiscriminée, constante et en quelque sorte organisée, ce qui a eu pour résultat de conduire à « une sorte de processus de déshumanisation réduisant l’individu à une chose sur laquelle exercer la violence » (paragraphe 67 ci-dessus).
131. La gravité des faits de la présente espèce réside également dans un autre aspect qui, aux yeux de la Cour, est tout aussi important. En effet, elle a rappelé à maintes reprises que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les personnes placées en garde à vue impose aux autorités le devoir de les protéger (idem, § 107). Or l’ensemble des faits litigieux démontre que les membres de la police présents à l’intérieur de la caserne de Bolzaneto, les simples agents et, par extension, la chaîne de commandement, ont gravement contrevenu à leur devoir déontologique primaire de protection des personnes placées sous leur surveillance.
132. Cela est d’ailleurs souligné par le tribunal de première instance de Gênes (paragraphe 53 ci-dessus), qui a estimé que les agents poursuivis avaient trahi le serment de fidélité et d’adhésion à la Constitution et aux lois républicaines en portant atteinte, par leur comportement, à la dignité et à la probité de la police italienne en tant que corps de métier et, par suite, en affaiblissant la confiance de la population italienne dans les forces de l’ordre.
133. La Cour ne saurait dès lors négliger la dimension symbolique de ces actes, ni le fait que les requérants ont été non seulement les victimes directes de sévices mais aussi les témoins impuissants de l’usage incontrôlé de la violence à l’égard des autres personnes arrêtées. Aux atteintes portées à l’intégrité physique et psychologique individuelle s’est donc ajouté l’état d’angoisse et de stress causé par les épisodes de violences auxquels ils ont assisté (Iljina et Sarulienė c. Lituanie, no 32293/05, § 47, 15 mars 2011).
134. En s’appuyant notamment sur les conclusions de la cour d’appel de Gênes (paragraphe 67 ci-dessus) et de la Cour de cassation (paragraphe 72 ci-dessus), la Cour estime que les requérants, traités comme des objets aux mains de la puissance publique, ont vécu pendant toute la durée de leur détention dans un lieu de « non-droit » où les garanties les plus élémentaires avaient été suspendues.
135. En effet, outre les épisodes de violence susmentionnés, la Cour ne saurait ignorer les autres atteintes aux droits des requérants s’étant produites à la caserne de Bolzaneto. Aucun requérant n’a pu prendre contact avec un proche, un avocat de son choix ou, le cas échéant, un représentant consulaire. Les effets personnels ont été détruits sous les yeux de leurs propriétaires. L’accès aux toilettes était refusé et, en tous cas, les requérants ont été fortement dissuadés de s’y rendre en raison des insultes, des violences et des humiliations subies par les personnes ayant demandé à y accéder. En outre, il y a lieu de remarquer que l’absence de nourriture et de draps en quantité suffisante, ce qui, d’après les juges nationaux, ne découlait pas tant d’une volonté délibérée d’en priver les requérants que d’une mauvaise planification du fonctionnement du site, ne peut qu’avoir amplifié la situation de détresse et le niveau de souffrance éprouvés par les requérants.
136. En conclusion, la Cour ne saurait ignorer que, en l’espèce, tel qu’il ressort des jugements internes (paragraphe 67 ci-dessus), les actes qui ont été commis dans la caserne de Bolzaneto sont l’expression d’une volonté punitive et de représailles à l’égard des requérants, privés de leurs droits et du niveau de protection reconnu à tout individu par l’ordre juridique italien (voir, mutatis mutandis, Cestaro, précité, § 177).
137. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les actes de violence répétés subis par les requérants à l’intérieur de la caserne de Bolzaneto doivent être regardés comme des actes de torture. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
VOLET PROCÉDURAL
α) Principes généraux
147. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et, le cas échéant, à la punition des responsables et à l’établissement de la vérité. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de piétiner, en jouissant d’une impunité virtuelle, les droits des personnes soumises à leur contrôle (voir, parmi beaucoup d’autres, Nasr et Ghali c. Italie, no 44883/09, § 262, 23 février 2016).
148. Les principes pertinents concernant les éléments d’« une enquête officielle effective » ont été rappelés récemment par la Cour dans l’arrêt Cestaro (précité, §§ 205-212, et les références qui y sont citées) et résumés dans son arrêt Nasr et Ghali (précité, § 263), auxquels la Cour renvoie.
β) Application de ces principes aux circonstances des présentes espèces
149. La Cour observe d’emblée que la plupart des auteurs matériels des actes de « torture » (paragraphe 54 ci-dessus) n’ont pas pu être identifiés par les autorités judiciaires ni inquiétés par une enquête, et qu’ils sont donc restés impunis.
150. Tout en rappelant que l’obligation de mener une enquête n’est pas, selon sa jurisprudence, une obligation de résultat mais de moyens (voir, parmi beaucoup d’autres, Gheorghe Dima c. Roumanie, no 2770/09, § 100, 19 avril 2016), il y a lieu de noter que les remarquables efforts des juges nationaux pour identifier les agents de police ayant participé aux faits dénoncés se sont soldés par un échec pour deux raisons principales.
151. D’une part, l’interdiction faite aux requérants de regarder les agents et l’obligation qui leur était imposée de se tenir face aux grilles à l’extérieur de la caserne ou au mur des cellules, combinée à l’absence de signes distinctifs sur l’uniforme des agents, tel qu’un numéro de matricule, ont contribué à rendre impossible l’identification par les victimes des policiers présents à l’intérieur de la caserne de Bolzaneto.
152. D’autre part, la Cour constate que le regrettable manque de coopération de la police avec les autorités judiciaires chargées de l’enquête a été déterminant en l’occurrence.
153. En ce qui concerne la procédure pénale, elle note que la vaste majorité des délits de lésions corporelles, simples ou aggravées, ainsi que ceux de calomnie et d’abus d’autorité publique ont été déclarés prescrits. En effet, sur quarante-cinq personne renvoyées en justice, la Cour de cassation (paragraphe 69 ci-dessus) n’a confirmé la condamnation que de huit agents ou cadres des forces de l’ordre à des peines d’emprisonnement allant d’un an pour abus d’autorité publique (les trois agents condamnés ayant renoncé à la prescription) à trois ans et deux mois pour le délit de lésions corporelles (puis réduite de trois ans en application de la loi no 241/06). La Cour constate que tous les condamnés ont bénéficié soit de la remise de peine, soit du sursis à l’exécution et de la non-inscription de la condamnation au casier judiciaire. Elle remarque que, en pratique, personne n’a passé un seul jour en prison pour les traitements infligés aux requérants.
154. En vertu de l’article 19 de la Convention et conformément au principe voulant que la Convention garantisse des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour doit s’assurer que l’État s’acquitte comme il se doit de l’obligation qui lui est faite de protéger les droits des personnes relevant de sa juridiction, en particulier dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée. Sinon, le devoir qu’ont les États de mener une enquête effective perdrait beaucoup de son sens.
155. Partant, elle ne peut que relever que, malgré l’établissement des faits les plus graves par les juridictions internes, la prescription a empêché le constat de la responsabilité pénale de leurs auteurs. Elle remarque aussi que, en application de la loi no 241 du 29 juillet 2006 relative aux conditions d’octroi de la remise générale de peine (indulto), les peines prononcées pour les autres délits ont été réduites de trois ans (paragraphe 58 ci-dessus).
156. Elle rappelle que, parmi les éléments qui caractérisent une enquête effective sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le fait que les poursuites judiciaires ne souffrent d’aucun délai de prescription est primordial. Elle indique également avoir déjà jugé que l’octroi d’une amnistie ou d’un pardon ne devrait pas être toléré en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents de l’État (Abdülsamet Yaman, précité, § 55, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 326, CEDH 2014 (extraits)).
157. Comme elle l’a fait dans son arrêt Cestaro (précité, §§ 223 et 224), la Cour reconnaît que les juges nationaux ont dû diligenter pour les faits relatifs à la caserne de Bolzaneto une procédure pénale complexe liée à un épisode de violence policière unique dans l’histoire de la République italienne. Elle ne saurait ignorer qu’aux difficultés de la procédure à l’égard de nombre de coaccusés et de parties civiles se sont ajoutés des obstacles liés au manque de coopération de la part de l’administration de la police (paragraphe 54 ci-dessus).
158. Contrairement à sa conclusion dans d’autres affaires, la Cour considère que, en l’espèce, la durée de la procédure interne et le non-lieu prononcé pour cause de prescription de la plupart des délits ne sont pas imputables aux atermoiements ou à la négligence du parquet ou des juges internes mais aux défaillances structurelles de l’ordre juridique italien (voir, parmi d’autres, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 142‑147, CEDH 2004‑IV (extraits), et Hüseyin Şimşek c. Turquie, no 68881/01, §§ 68-70, 20 mai 2008).
159. En effet, aux yeux de la Cour, l’origine du problème réside dans le fait qu’aucune des infractions pénales existantes n’apparaît à même d’englober toute la gamme de questions soulevées par un acte de torture dont un individu risque d’être victime (Myumyun c. Bulgarie, no 67258/13, § 77, 3 novembre 2015).
160. La Cour a déjà jugé dans son arrêt Cestaro (précité, § 225) que la législation pénale nationale appliquée dans les affaires en cause s’était révélée à la fois inadéquate par rapport à l’exigence de sanction des actes de torture en question et dépourvue de l’effet dissuasif nécessaire à la prévention de violations similaires de l’article 3 de la Convention.
161. Dans ce cadre, elle a invité l’Italie à se munir des outils juridiques aptes à sanctionner de manière adéquate les responsables d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements au regard de l’article 3 et à empêcher que ceux-ci puissent bénéficier de l’application de mesures en contradiction avec la jurisprudence de la Cour, notamment la prescription et la remise de peine (idem, §§ 242-246).
162. Le législateur italien a présenté une proposition de loi introduisant le délit de torture. Après des modifications successives, le 18 juillet 2017 la loi est entrée en vigueur. La Cour prend note de l’introduction des nouvelles dispositions qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
163. Concernant, enfin, les mesures disciplinaires, la Cour observe que le Gouvernement indique que les policiers concernés n’ont pas été suspendus de leurs fonctions pendant le procès. Elle note que le Gouvernement ne précise pas si ces mêmes policiers ont fait l’objet de mesures disciplinaires et n’indique pas, le cas échéant, quelles ont été les mesures adoptées à cet égard.
164. La Cour rappelle en tout état de cause, à ce propos, avoir répété que, lorsque des agents de l’État sont inculpés d’infractions impliquant des mauvais traitements, il importe qu’ils soient suspendus de leurs fonctions pendant l’instruction ou le procès et en soient démis en cas de condamnation (voir, parmi beaucoup d’autres, Abdülsamet Yaman, précité, § 55, Ali et Ayşe Duran, précité, § 64, Çamdereli, précité, § 38, Gäfgen, précité, § 125, Cestaro, précité, § 205, Erdal Aslan c. Turquie, nos 25060/02 et 1705/03, §§ 74 et 76, 2 décembre 2008, et Saba c. Italie, no 36629/10, § 78, 1er juillet 2014).
165. En conclusion, la Cour considère que les requérants n’ont pas bénéficié d’une enquête officielle effective aux fins de l’article 3 de la Convention. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de cette disposition sous son volet procédural. Dès lors, elle rejette tant l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la perte de la qualité de victime (paragraphes 93‑98 ci-dessus) que l’exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes en matière civile (paragraphes 109-117 ci-dessus ; Cestaro, précité, §§ 229-236).
DOMMAGE
167. Les requérants de la requête no 28923/09 réclament 150 000 EUR chacun au titre du préjudice matériel et moral qu’ils estiment avoir subi, tandis que les requérants de la requête no 67599/10 (notamment les requérants figurant sous les numéros 1-4, 6-8, 12, 13, 15, 16 et 19 dans la liste en annexe) s’en remettent à l’appréciation de la Cour.
168. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à déclarer qu’un constat de violation fournirait une satisfaction équitable suffisante. À titre subsidiaire, il critique le montant réclamé par les requérants, qu’il estime disproportionné, et demande à la Cour de tenir compte des sommes provisionnelles qui ont été versées aux requérants en leur qualité de parties civiles à la procédure pénale.
169. La Cour relève que les requérants n’ont pas étayé suffisamment leurs prétentions pour que le lien de causalité nécessaire entre la violation constatée et le dommage matériel allégué pût être établi. Elle rejette par conséquent cette partie de la demande (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası et autres c. Turquie, no 20347/07, § 116, 5 juillet 2016).
170. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour relève que, selon les dernières informations fournies par les requérants et non contestées par le Gouvernement, les indemnités provisionnelles accordées à titre de dommages-intérêts aux requérants par les tribunaux internes n’ont pas été versées ou ne l’ont été que partiellement et à un nombre limité de requérants (quatre requérants de la requête no 28923/09 et deux requérants de la requête no 67599/10). Elle rappelle également la gravité des actes de violence établis dans les présentes affaires qui ont conduit à sa conclusion de violation de l’article 3 de la Convention, tant sous son volet matériel que sous son volet procédural.
171. Partant, elle décide d’accorder en équité à chaque requérant la somme de 80 000 EUR (quatre-vingt mille euros) à titre de dommage moral, à l’exception de M. G. Azzolina. À ce dernier, en raison de la gravité et cruauté des violences dont il fut victime au sein de la caserne de Bolzaneto, la Cour décide d’accorder en équité la somme de 85 000 EUR (quatre‑vingt‑cinq mille euros) à titre de dommage moral.
172. La Cour précise néanmoins que les sommes qu’elle a accordées au titre du dommage moral ne sont dues qu’en fonction de l’état de versement des indemnités reconnues à titre de provision au plan interne. Ainsi, dans l’hypothèse où ces sommes seraient effectivement payées par les autorités italiennes aux requérants, elles viendraient en déduction des satisfactions équitables que le Gouvernement devra verser aux parties requérantes en vertu du présent arrêt (Kavaklıoğlu et autres c. Turquie, no 15397/02, § 302, 6 octobre 2015).
BLAIR ET AUTRES c. ITALIE du 26 octobre 2017 requêtes n° 1442/14 et 2 autres
VOLET MATERIEL
α) Principes généraux
95. Les principes généraux applicables en la matière ont été récemment rappelés dans les arrêts Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 88-90, CEDH 2015) et Bartesaghi Gallo et autres c. Italie (nos 12131/13 et 43390/13, §§ 111-113, 22 juin 2017).
β) Application de ces principes aux circonstances en l’espèce
96. La Cour note d’emblée que les tribunaux internes ont établi de manière détaillée et approfondie, avec exactitude et au-delà de tout doute raisonnable les mauvais traitements dont les personnes placées à la caserne de Bolzaneto ont été l’objet (paragraphes 18-45 ci-dessus) et elle ne relève pas d’éléments convaincants qui l’inciteraient à s’écarter des conclusions auxquelles les juridictions internes sont parvenues (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 93, CEDH 2010). Les témoignages des victimes ont été confirmés par les dépositions de membres des forces de l’ordre et de l’administration publique, par les admissions partielles des accusés ainsi que par les documents à disposition des magistrats, notamment les comptes rendus médicaux et les expertises judiciaires.
97. Dès lors, la Cour juge établies tant les agressions physiques et verbales dont les requérants se plaignent que les séquelles découlant de celles-ci. Elle constate en particulier ce qui suit :
– dès leur arrivée à la caserne de Bolzaneto, il a été interdit aux requérants de lever la tête et de regarder les agents qui les entouraient ; ceux qui avaient été arrêtés à l’école Diaz-Pertini ont été marqués d’une croix tracée au feutre sur la joue ; tous les requérants ont été obligés de se tenir immobiles, bras et jambes écartés, face aux grilles à l’extérieur de la caserne ; la même position vexatoire a été imposée à chacun à l’intérieur des cellules ;
– à l’intérieur de la caserne, les requérants étaient contraints de se déplacer penchés en avant et la tête baissée ; dans cette position, ils devaient traverser « le tunnel des agents », à savoir le couloir de la caserne dans lequel des agents se tenaient de chaque côté pour les menacer, les frapper et leur lancer des insultes à caractère politique ou sexuel (paragraphe 59 ci‑dessus) ;
– lors des visites médicales, les requérants ont été l’objet de commentaires, d’humiliations et parfois de menaces de la part du personnel médical ou des agents de police présents ;
– les effets personnels des requérants ont été confisqués, voire détruits de façon aléatoire ;
– compte tenu de l’exiguïté de la caserne de Bolzaneto ainsi que du nombre et de la répétition des épisodes de brutalité, tous les agents et fonctionnaires de police présents étaient conscients des violences commises par leurs collègues ou leurs subordonnés ;
– les faits en cause ne peuvent se résumer à une période donnée au cours de laquelle, sans que cela ne puisse aucunement le justifier, la tension et les passions exacerbées auraient conduit à de tels excès : ces faits se sont déroulés pendant un laps de temps considérable, à savoir entre la nuit du 20 au 21 juillet et le 23 juillet, ce qui signifie que plusieurs équipes d’agents se sont succédé au sein de la caserne sans aucune diminution significative en fréquence ou en intensité des épisodes de violence.
98. En ce qui concerne les récits individuels des requérants, la Cour ne peut que constater la gravité des faits décrits par les intéressés. Ce qui ressort du matériel probatoire démontre nettement que les requérants, qui n’ont opposé aucune forme de résistance physique aux agents, ont été victimes d’une succession continue et systématique d’actes de violence provoquant de vives souffrances physiques et psychologiques (Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 126, CEDH 2013 (extraits)). Ces violences ont été infligées à chaque individu dans un contexte général d’emploi excessif, indiscriminé et manifestement disproportionné de la force (Bouyid, précité, § 101).
99. Ces épisodes ont eu lieu dans un contexte délibérément tendu, confus et bruyant, les agents criant à l’encontre des individus arrêtés et entonnant de temps en temps des chants fascistes. Dans son arrêt no 678/10 du 15 avril 2011, la cour d’appel de Gênes a établi que la violence physique et morale, loin d’être épisodique, a, au contraire, été indiscriminée, constante et en quelque sorte organisée, ce qui a eu pour résultat de conduire à « une sorte de processus de déshumanisation réduisant l’individu à une chose sur laquelle exercer la violence » (paragraphe 62 ci-dessus).
100. La gravité des faits de la présente espèce réside également dans un autre aspect qui, aux yeux de la Cour, est tout aussi important. En effet, elle a rappelé à maintes reprises que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les personnes placées en garde à vue impose aux autorités le devoir de les protéger (ibidem, § 107). Or l’ensemble des faits litigieux démontre que les membres de la police présents à l’intérieur de la caserne de Bolzaneto, les simples agents et, par extension, la chaîne de commandement, ont gravement contrevenu à leur devoir déontologique primaire de protection des personnes placées sous leur surveillance.
101. Cela est d’ailleurs souligné par le tribunal de première instance de Gênes (paragraphe 48 ci-dessus), qui a estimé que les agents poursuivis avaient trahi le serment de fidélité et d’adhésion à la Constitution et aux lois républicaines en portant atteinte, par leur comportement, à la dignité et à la probité de la police italienne en tant que corps de métier et, par suite, en affaiblissant la confiance de la population italienne dans les forces de l’ordre.
102. La Cour ne saurait dès lors négliger la dimension symbolique de ces actes ni le fait que les requérants ont été non seulement les victimes directes de sévices, mais aussi les témoins impuissants de l’usage incontrôlé de la violence à l’encontre des autres personnes arrêtées. Aux atteintes portées à l’intégrité physique et psychologique individuelle s’est donc ajouté l’état d’angoisse et de stress causé par les épisodes de violence auxquels ils ont assisté (Iljina et Sarulienė c. Lituanie, no 32293/05, § 47, 15 mars 2011).
103. En s’appuyant notamment sur les conclusions de la cour d’appel de Gênes (paragraphe 63 ci-dessus) et de la Cour de cassation (paragraphe 67 ci-dessus), la Cour estime que les requérants, traités comme des objets aux mains de la puissance publique, ont vécu pendant toute la durée de leur détention dans un lieu de « non-droit » où les garanties les plus élémentaires avaient été suspendues.
104. En effet, outre les épisodes de violence susmentionnés, la Cour ne saurait ignorer les autres atteintes aux droits des requérants s’étant produites à la caserne de Bolzaneto. Aucun requérant n’a pu prendre contact avec un proche, un avocat de son choix ou, le cas échéant, un représentant consulaire. Les effets personnels ont été détruits sous les yeux de leurs propriétaires. L’accès aux toilettes était refusé et, en tous cas, les requérants ont été fortement dissuadés de s’y rendre en raison des insultes, des violences et des humiliations subies par les personnes ayant demandé à y accéder. En outre, il y a lieu de remarquer que l’absence de nourriture et de draps en quantité suffisante, ce qui, d’après les juges nationaux, ne découlait pas tant d’une volonté délibérée d’en priver les requérants que d’une mauvaise planification du fonctionnement du site, ne peut qu’avoir amplifié la situation de détresse et le niveau de souffrance éprouvés par les requérants.
105. En conclusion, la Cour ne saurait ignorer que, en l’espèce, tel qu’il ressort des jugements internes (paragraphe 62 ci-dessus), les actes qui ont été commis dans la caserne de Bolzaneto sont l’expression d’une volonté punitive et de représailles à l’égard des requérants, privés de leurs droits et du niveau de protection reconnu à tout individu par l’ordre juridique italien (voir, mutatis mutandis, Cestaro, précité, § 177).
106. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les actes de violence répétés subis par les requérants à l’intérieur de la caserne de Bolzaneto doivent être regardés comme des actes de torture. Partant, il y a eu violation à leur égard de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
VOLET PROCÉDURAL
α) Principes généraux
116. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et, le cas échéant, à la punition des responsables et à l’établissement de la vérité. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de piétiner, en jouissant d’une impunité virtuelle, les droits des personnes soumises à leur contrôle (voir, parmi beaucoup d’autres, Nasr et Ghali c. Italie, no 44883/09, § 262, 23 février 2016).
117. Les principes pertinents concernant les éléments d’« une enquête officielle effective » ont été rappelés récemment par la Cour dans son arrêt Cestaro (précité, §§ 205-212, et les références qui y sont citées) et résumés dans son arrêt Nasr et Ghali (précité, § 263), auxquels la Cour renvoie.
β) Application de ces principes aux circonstances en l’espèce
118. La Cour observe d’emblée que la plupart des auteurs matériels des actes de « torture » (paragraphe 49 ci-dessus) n’ont pu être ni identifiés par les autorités judiciaires ni inquiétés par une enquête, et qu’ils sont donc restés impunis.
119. Tout en rappelant que l’obligation de mener une enquête n’est pas, selon sa jurisprudence, une obligation de résultat mais de moyens (voir, parmi beaucoup d’autres, Gheorghe Dima c. Roumanie, no 2770/09, § 100, 19 avril 2016), il y a lieu de noter que les remarquables efforts des juges nationaux pour identifier les agents de police ayant participé aux faits dénoncés se sont soldés par un échec pour deux raisons principales.
120. D’une part, l’interdiction faite aux requérants de regarder les agents et l’obligation qui leur était imposée de se tenir face aux grilles à l’extérieur de la caserne ou au mur des cellules, combinées à l’absence de signes distinctifs sur l’uniforme des agents, tel qu’un numéro de matricule, ont contribué à rendre impossible l’identification par les victimes des policiers présents dans la caserne de Bolzaneto.
121. D’autre part, la Cour constate que le regrettable manque de coopération de la police avec les autorités judiciaires chargées de l’enquête a été déterminant en l’occurrence.
122. En ce qui concerne la procédure pénale, elle note que la vaste majorité des délits de lésions corporelles, simples ou aggravés, ainsi que ceux de calomnie et d’abus d’autorité publique ont été déclarés prescrits. En effet, sur quarante-cinq personnes renvoyées en justice, la Cour de cassation (paragraphe 65 ci-dessus) n’a confirmé la condamnation que de huit agents ou cadres des forces de l’ordre à des peines d’emprisonnement allant d’un an pour abus d’autorité publique (les trois agents condamnés ayant renoncé à la prescription) à trois ans et deux mois pour le délit de lésions corporelles (puis réduite de trois ans en application de la loi no 241/06). La Cour constate que tous les condamnés ont bénéficié soit de la remise de peine, soit du sursis à l’exécution et de la non-inscription de la condamnation au casier judiciaire. Elle remarque que, en pratique, personne n’a passé un seul jour en prison pour les traitements infligés aux requérants.
123. En vertu de l’article 19 de la Convention et conformément au principe voulant que la Convention garantisse des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour doit s’assurer que l’État s’acquitte comme il se doit de l’obligation qui lui est faite de protéger les droits des personnes relevant de sa juridiction, en particulier dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée. Sinon, le devoir qu’ont les États de mener une enquête effective perdrait beaucoup de son sens.
124. Partant, elle ne peut que relever que, malgré l’établissement des faits les plus graves par les juridictions internes, la prescription a empêché le constat de la responsabilité pénale de leurs auteurs. Elle remarque aussi que, en application de la loi no 241 du 29 juillet 2006 relative aux conditions d’octroi de la remise générale de peine (indulto), les peines prononcées pour les autres délits ont été réduites de trois ans (paragraphe 53 ci-dessus).
125. Elle rappelle que, parmi les éléments qui caractérisent une enquête effective sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le fait que les poursuites judiciaires ne souffrent d’aucun délai de prescription est primordial. Elle indique également avoir déjà jugé que l’octroi d’une amnistie ou d’un pardon ne devrait pas être toléré en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents de l’État (Abdülsamet Yaman, précité, § 55, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 326, CEDH 2014 (extraits)).
126. Comme elle l’a fait dans son arrêt Cestaro (précité, §§ 223 et 224), la Cour reconnaît que les juges nationaux ont dû diligenter pour les faits relatifs à la caserne de Bolzaneto une procédure pénale complexe liée à un épisode de violence policière unique dans l’histoire de la République italienne. Elle ne saurait ignorer qu’aux difficultés de la procédure à l’égard de nombre de coaccusés et de parties civiles se sont ajoutés des obstacles liés au manque de coopération de la part de l’administration de la police (paragraphe 49 ci-dessus).
127. Contrairement à sa conclusion dans d’autres affaires, la Cour considère que, en l’espèce, la durée de la procédure interne et le non-lieu prononcé pour cause de prescription de la plupart des délits ne sont pas imputables aux atermoiements ou à la négligence du parquet ou des juges internes, mais aux défaillances structurelles de l’ordre juridique italien (voir, parmi d’autres, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 142‑147, CEDH 2004‑IV (extraits), et Hüseyin Şimşek c. Turquie, no 68881/01, §§ 68-70, 20 mai 2008).
128. En effet, aux yeux de la Cour, l’origine du problème réside dans le fait qu’aucune des infractions pénales existantes n’apparaît à même d’englober toute la gamme de questions soulevées par un acte de torture dont un individu risque d’être victime (Myumyun c. Bulgarie, no 67258/13, § 77, 3 novembre 2015).
129. La Cour a déjà jugé dans son arrêt Cestaro (précité, § 225) que la législation pénale nationale appliquée dans les affaires en cause s’était révélée à la fois inadéquate par rapport à l’exigence de sanction des actes de torture en question et dépourvue de l’effet dissuasif nécessaire à la prévention des violations similaires de l’article 3 de la Convention.
130. Dans ce cadre, elle a invité l’Italie à se munir des outils juridiques aptes à sanctionner de manière adéquate les responsables d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements au regard de l’article 3 et à empêcher que ceux-ci puissent bénéficier de l’application de mesures en contradiction avec la jurisprudence de la Cour, notamment la prescription et la remise de peine (ibidem, §§ 242-246).
131. Le législateur italien a présenté une proposition de loi introduisant le délit de torture. Après des modifications successives, le 18 juillet 2017 la loi est entrée en vigueur. La Cour prend note de l’introduction des nouvelles dispositions qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
132. Concernant, enfin, les mesures disciplinaires, la Cour observe que le Gouvernement indique que les policiers concernés n’ont pas été suspendus de leurs fonctions pendant le procès. Elle note que le Gouvernement ne précise pas si ces mêmes policiers ont fait l’objet de mesures disciplinaires et n’indique pas, le cas échéant, quelles ont été les mesures adoptées à cet égard.
133. La Cour rappelle en tout état de cause, à ce propos, avoir répété que, lorsque des agents de l’État sont inculpés d’infractions impliquant des mauvais traitements, il importe qu’ils soient suspendus de leurs fonctions pendant l’instruction ou le procès et en soient démis en cas de condamnation (voir, parmi beaucoup d’autres, Abdülsamet Yaman, précité, § 55, Ali et Ayşe Duran, précité, § 64, Çamdereli, précité, § 38, Gäfgen, précité, § 125, Cestaro, précité, § 205, Erdal Aslan c. Turquie, nos 25060/02 et 1705/03, §§ 74 et 76, 2 décembre 2008, et Saba c. Italie, no 36629/10, § 78, 1er juillet 2014).
134. En conclusion, la Cour considère que les requérants n’ont pas bénéficié d’une enquête officielle effective aux fins de l’article 3 de la Convention. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de cette disposition sous son volet procédural.
DOMMAGE
136. Les requérants des requêtes nos 1442/14 et 21319/14 réclament 150 000 EUR chacun au titre du préjudice matériel et moral qu’ils estiment avoir subi tandis que les requérants de la requête no 21911/14 (notamment les requérants figurant à l’annexe I sous les numéros 2-7, 10-13 et 15-17 de la liste correspondante) s’en remettent à l’appréciation de la Cour.
137. Le Gouvernement conteste ces prétentions et critique le montant réclamé par les requérants comme étant disproportionné notamment en raison des versements déjà effectués de sommes à titre de provision sur les dommages-intérêts. Il précise à cet égard que les requérants ont obtenu des indemnités au niveau national, d’un montant compris entre 10 000 EUR et 15 000 EUR, et, dans deux cas, d’un montant de 70 000 EUR.
138. La Cour relève que les requérants n’ont pas étayé suffisamment leurs prétentions pour que le lien de causalité nécessaire entre la violation constatée et le dommage matériel allégué pût être établi. Elle rejette par conséquent cette partie de la demande (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası et autres c. Turquie, no 20347/07, § 116, 5 juillet 2016).
139. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour considère que les requérants ont subi un préjudice moral certain du fait des violations constatées. Compte tenu des circonstances de l’affaire et, notamment, du dédommagement déjà obtenu au niveau national par les requérants (Cestaro, précité, § 251), la Cour, statuant en équité, estime qu’il y a lieu d’octroyer à ce titre à Mme Menegon et M. Spingi la somme de 10 000 EUR (dix mille euros) chacun, aux requérants des requêtes nos 1442/14 et 21319/14 et aux requérants figurant à l’annexe I sous les numéros 2-7, 10, 12, 13, 16 et 17 de la liste correspondant à la requête no 21911/14 la somme de 70 000 EUR (soixante-dix mille euros) chacun.
B. Frais et dépens
140. Les requérants de la requête no 1442/14 ont sollicité le remboursement des frais et dépens engagés dans la procédure devant la Cour sans les quantifier. Dès lors, la Cour estime qu’il y lieu de rejeter ces demandes. Quant aux requérants de la requête no 21319/14, ils n’ont formulé aucune demande de remboursement concernant des frais et dépens qu’ils auraient engagés dans la procédure devant la Cour. La Cour estime dès lors qu’il n’y a pas lieu de leur accorder de somme à ce titre.
141. Les requérants de la requête no 21911/14 sollicitent 66 357,28 EUR en remboursement des frais et dépens engagés dans la procédure devant la Cour et ils produisent à cet égard des notes d’honoraires émanant des différents avocats les ayant représentés. En particulier, ils distinguent les frais et dépens exposés pour l’assistance de Mes V. Onida et B. Randazzo, se rapportant au travail d’étude, de rédaction et de suivi de la requête introduite par tous les requérants, de ceux relatifs au travail de collecte d’informations effectué par les autres avocats ayant assisté un ou plusieurs requérants.
142. En ce qui concerne ces derniers, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime en principe raisonnable la somme demandée pour la procédure devant elle.
143. Pour ce qui est des avocats Mes Onida et Randazzo, les requérants demandent 17 001,92 EUR pour frais et dépens. Ils réclament en premier lieu 4 313,92 EUR pour les frais qui auraient été exposés à titre de débours par le cabinet. En outre, ils sollicitent le remboursement des honoraires qu’ils souhaitent verser aux avocats pour leur assistance juridique pro bono relative à la rédaction de la requête et au suivi de la procédure. À ce titre, « dans le cas où la Cour octroie à titre de satisfaction équitable une somme à chaque requérant, qui comprend aussi le remboursement des honoraires d’avocat », les requérants estiment raisonnable la somme globale de 12 688 EUR. Ils fournissent à cet égard une note d’honoraires du cabinet d’avocats.
144. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
145. Selon les critères dégagés par sa jurisprudence lorsqu’elle se prononce sur la satisfaction équitable (article 41 de la Convention), la Cour examine une demande de remboursement de frais et dépens en estimant qu’un requérant ne peut obtenir leur remboursement que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Dudgeon c. Royaume-Uni (article 50), 24 février 1983, § 20, série A no 59, et Koudechkina c. Russie, no 29492/05, § 109, 26 février 2009).
146. En l’occurrence, la Cour observe que les requérants ont accompagné leur demande de pièces justificatives nécessaires (Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 27996/06 et 34836/06, §§ 64-66, CEDH 2009, Troubnikov c. Russie, no 49790/99, §§100-104, 5 juillet 2005, Akoulinine et Babitch c. Russie, no 5742/02, §§ 71-73, 2 octobre 2008, Omojudi c. Royaume-Uni, no 1820/08, §§ 58-60, 24 novembre 2009, Artyomov c. Russie, no 14146/02, §§ 219-222, 27 mai 2010, Shulenkov c. Russie, no 38031/04, § 69-71, 17 juin 2010 et Gheorghe Dima, précité, § 117-119 ).
147. Pour ce qui est de la complexité de l’affaire, la Cour observe que les requérants sont de nationalités différentes et que, pour la plupart d’entre eux, ils ne résident pas en Italie, ce qui a demandé à la fois un long travail de collecte des informations et de la documentation nécessaires pour étayer la requête et un effort de coordination conséquent. En outre, il ressort de la qualité et de l’ampleur des observations présentées qu’un travail considérable a été réalisé au nom des requérants.
148. Enfin, quant au caractère raisonnable du montant des frais et dépens, la Cour note que les dix-sept requérants demandent au total 12 688 EUR pour les frais et dépens, ce qui correspond à environ 750 EUR chacun.
149. En conclusion, sous réserve des paragraphes suivants, la Cour estime en principe raisonnable la demande de frais et dépens présentée par les requérants pour l’activité pro bono de leurs avocats.
150. Elle constate cependant que certains parmi les requérants ont accepté la proposition de règlement amiable présentée par le gouvernement défendeur (paragraphes 85-87 ci-dessus). Le texte de la déclaration, formulée de manière identique pour chaque requérant concerné, est ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :
« Le Gouvernement a proposé au requérant la somme de 45 000 EUR (quarante-cinq mille euros) au titre des préjudices matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par l’intéressé, lequel a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie concernant les faits à l’origine de sa requête. »
151. Dès lors, en acceptant la proposition de règlement amiable, ces requérants ont renoncé à toute prétention relative aux frais et dépens. Par conséquent, la Cour décide qu’il y a lieu de déduire du montant global demandé la somme correspondant aux requérants ayant accepté la proposition de règlement amiable (Bartesaghi Gallo et autres, précité, §§ 131-133).
152. En conclusion, la Cour accorde aux requérants de la requête no 21911/14 figurant à l’annexe I sous les numéros 2-7, 10-13 et 15-17 de la liste correspondante la somme globale de 40 320 EUR en remboursement des frais et dépens engagés dans la procédure devant elle (voir l’annexe II pour le détail des sommes accordées aux requérants).
C. Intérêts moratoires
153. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
BARTESAGHI GALLO ET AUTRES c. ITALIE du 22 juin 2017 Requêtes nos 12131/13 et 43390/13
violation de l'article 3 : La CEDH condamne en 2017, les violences policières italiennes du temps du camarade Berlusconi qui se sont déroulées dans l'école Diaz-Pertini, au moment de la réunion du G8 à Gênes. L'arrêt décrit les violences avec une grande précision.
LE TRISTE SOMMET DU G8 DE GÊNES DE 2001
5. Les 19, 20 et 21 juillet 2001, la ville de Gênes accueillit le vingt-septième sommet des huit pays les plus industrialisés (G8), sous la présidence du gouvernement italien. De nombreuses organisations non gouvernementales, rassemblées sous la bannière du groupe de coordination « Genoa Social Forum – GSF » (« le GSF »), organisèrent un sommet « altermondialiste » qui se déroula à la même période. Il a été estimé que 200 000 personnes (selon le ministère de l’Intérieur) à 300 000 personnes (selon le GSF) participèrent à l’événement.
6. Un vaste dispositif de sécurité fut mis en place par les autorités italiennes (arrêts Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 12, CEDH 2011, et Cestaro c. Italie, no 6884/11, §§ 11-12, 23-24, 7 avril 2015). Celles-ci divisèrent la ville en trois zones concentriques : la « zone rouge », de surveillance maximale, où le sommet devait se dérouler et où les délégations devaient loger ; la « zone jaune », une zone tampon où les manifestations étaient en principe interdites, sauf autorisation du chef du bureau de la police (questore) ; et la « zone blanche », où les principales manifestations étaient programmées.
7. Les autorités attribuèrent une couleur à chaque groupe organisé, à chaque association, à chaque syndicat et à chaque ONG, en fonction de sa dangerosité potentielle : le « bloc rose », non dangereux ; le « bloc jaune » et le « bloc bleu », considérés comme comprenant des auteurs potentiels d’actes de vandalisme, de blocage de rues et de rails, et également d’affrontements avec la police ; et enfin, le « bloc noir », dont faisaient partie plusieurs groupes, anarchistes ou plus généralement violents, ayant pour but de commettre des saccages systématiques.
8. La journée du 19 juillet se déroula dans une ambiance relativement calme, sans épisodes particulièrement significatifs. Par contre, les journées des 20 et 21 juillet furent marquées par des accrochages de plus en plus violents entre les forces de police et certains manifestants appartenant essentiellement au « bloc noir ». Au cours de ces incidents, plusieurs centaines de manifestants et de membres des forces de l’ordre furent blessés ou intoxiqués par du gaz lacrymogènes. Des quartiers entiers de la ville de Gênes furent dévastés (pour une analyse plus détaillée, voir Giuliani et Gaggio, précité, §§ 12-30, et Cestaro, précité, §§ 9-17).
L’irruption de la police dans l’école Diaz-Pertini est d'une violence inouïe :
13. Vers minuit, une fois arrivés à proximité des deux écoles, les membres du VII Nucleo antisommossa, munis de casques, de boucliers et de matraques de type tonfa, suivis par d’autres agents équipés à l’identique, commencèrent à avancer au pas de course. Un journaliste britannique et un conseiller municipal, qui se trouvaient à l’extérieur des deux écoles, furent frappés par des agents de police (jugement du tribunal de Gênes, pp. 253-261).
14. Au même moment, certains des occupants de l’école Diaz-Pertini qui se trouvaient à l’extérieur regagnèrent alors le bâtiment et en fermèrent la grille et les portes d’entrée, essayant de les bloquer avec des bancs et des planches en bois. La grille fut rapidement forcée à l’aide d’un engin blindé, puis les agents de police enfoncèrent les portes d’entrée (ibidem).
15. Les agents se répartirent dans les étages du bâtiment, partiellement plongés dans le noir. La plupart d’entre eux avaient le visage masqué par un foulard. Ils commencèrent à frapper les occupants à coups de poing, de pied et de matraque, en criant et en menaçant les victimes. Des groupes d’agents s’acharnèrent même sur certaines personnes qui étaient assises ou allongées par terre. Certains des occupants, réveillés par le bruit de l’assaut, furent frappés alors qu’ils se trouvaient encore dans leur sac de couchage ; d’autres le furent alors qu’ils se tenaient les bras levés en signe de capitulation ou qu’ils montraient leurs papiers d’identité. Certains essayèrent de s’enfuir et de se cacher dans les toilettes ou dans des débarras du bâtiment, mais ils furent rattrapés, battus, parfois tirés hors de leurs cachettes par les cheveux (jugement de première instance, pp. 263-280, et arrêt d’appel, pp. 205-212).
16. Les tribunaux internes ont établi avec exactitude, au-delà de tout doute raisonnable, les mauvais traitements dont avaient fait l’objet les personnes présentes à l’intérieur de l’école Diaz-Pertini. Les témoignages des victimes ont été confirmés par les dépositions des membres des forces de l’ordre et de l’administration publique, les reconnaissances partielles des faits par les accusés, les enregistrements audiovisuels ainsi que par les documents à disposition des magistrats, notamment les rapports médicaux et les expertises judiciaires.
LE DROIT
Principes généraux
111. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (voir, notamment, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 87, CEDH 2010, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 195, CEDH 2012, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 315, CEDH (extraits)) et un droit absolu et inaliénable étroitement lié au respect de la dignité humaine (Aleksandr Novoselov c. Russie, no 33954/05, § 54, 28 novembre 2013, Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 81, CEDH 2015), qui ne prévoit pas de restrictions et, d’après l’article 15 § 2, ne souffre nulle dérogation (Gäfgen, précité, § 87).
112. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à la qualification juridique de mauvais traitement (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25 et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006‑IX ; pour les facteurs à considérer, voir, parmi beaucoup d’autres, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 64, Recueil 1996‑VI, Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 78, CEDH 2000‑XII, Krastanov c. Bulgarie, no 50222/99, § 53, 30 septembre 2004, El Masri, précité, § 196, et Al Nashiri c. Pologne, no 28761/11, § 508, 24 juillet 2014 ; pour le contexte, telle une atmosphère de vive tension et à forte charge émotionnelle, voir, entre autres, Selmouni, précité, § 104, et Egmez, précité, § 78 ; pour l’usage de la force physique de la part des forces de l’ordre, voir, parmi beaucoup d’autres, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336, Mete et autres c. Turquie, no 294/08, § 106, 4 octobre 2011, El-Masri, précité, § 207, et Bouyid, § 101, précité). Plus précisément, en ce qui concerne la qualification juridique de torture, la Cour renvoie aux principes dégagés dans son arrêt Cestaro (précité, §§ 171-176).
113. Quant à l’appréciation des preuves, si la Cour a toujours souligné son devoir de se livrer à un examen particulièrement approfondi en cas d’allégations sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention (Matko c. Slovénie, no 43393/98, § 100, 2 novembre 2006, et Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 59, 24 juillet 2008), elle a également affirmé que, soucieuse de respecter la nature subsidiaire de son rôle, elle n’a pas pour tâche de substituer sa propre vision des choses à celle des cours et tribunaux nationaux, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269, Jasar c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine, no 69908/01, § 49, 15 février 2007, et Eski c. Turquie, no 8354/04, § 28, 5 juin 2012). Même si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins d’habitude des éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles ils sont parvenus (Gäfgen, précité, § 93).
β) Application de ces principes aux circonstances des présentes espèces
114. La Cour note d’emblée que les tribunaux internes ont établi les faits de manière détaillée et approfondie (paragraphes 69-77 ci-dessus), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le Gouvernement. En particulier, les juges nationaux ont constaté ce qui suit :
– la décision de procéder à l’irruption à l’intérieur des écoles Diaz-Pertini et Pascoli a été prise par les hauts fonctionnaires de police présents à Gênes (paragraphe 12 ci-dessus). Cette opération de perquisition (perquisizione ad iniziativa autonoma) visant à la recherche d’armes, bien que pleinement légitime (paragraphe 70 ci-dessus), devait en même temps permettre des arrestations « médiatisées » afin d’effacer l’image d’une police inerte face aux très graves épisodes de dévastation et de pillage survenus les 20 et 21 juillet (paragraphe 73 ci-dessus) ;
– au cours de l’irruption dans l’école Diaz-Pertini, les agents ont frappé la quasi-totalité des occupants à coups de poing, à coups de pied et à coups de matraque, en proférant des insultes et des menaces ;
– à l’issue de l’opération, les 93 occupants ont été arrêtés, 78 d’entre eux ont été hospitalisés en raison des blessures subies (paragraphe 61 ci-dessus) ;
– les violences commises, multiples et répétées, ont atteint un niveau de gravité absolue car commises dans tous les locaux de l’école et à l’égard de personnes à l’évidence désarmées, endormies ou assises les mains en l’air (paragraphe 76 ci-dessus) ;
– lesdites violences étaient injustifiées et ont été exercées dans un but punitif et de représailles, visant à provoquer l’humiliation et la souffrance physique et morale des victimes. D’après la Cour de cassation, ces actes pouvaient relever de la « torture » aux termes de la Convention contre la torture des Nations unies et aux termes de l’article 3 de la Convention (paragraphe 77 ci-dessus).
115. En tenant compte de ces éléments comme toile de fond, la Cour observe que la planification de l’opération de police s’est bornée à prévoir de manière générale la séquence des phases opérationnelles (« sécurisation » et perquisition proprement dite) sans pour autant préciser en détail les modalités d’engagement et d’utilisation éventuelle de la force (paragraphe 12 ci-dessus). Elle rappelle également que la tâche d’intervenir en premier, afin de contrer toute hypothétique forme de résistance et de violence de la part des occupants de l’école, a été attribuée au VII Nucleo antisommossa. En particulier, elle note que les agents de cette unité sont arrivés sur les lieux au pas de course et en tenue antiémeute, munis de casques, de boucliers et de matraques de type tonfa. La police a fait irruption dans l’enceinte de l’école en enfonçant la grille d’entrée à l’aide d’un engin blindé. Les portes d’entrée ont été rapidement forcées et, une fois à l’intérieur, les agents ont fait un usage indiscriminé, systématique et disproportionné de la force (paragraphe 15 ci-dessus).
116. La Cour estime que ces éléments montrent les défaillances de la planification de l’opération de police. Les forces de l’ordre ne se trouvaient pas face à une situation d’urgence, à une menace immédiate empêchant de prévoir une intervention adéquate, adaptée au contexte et proportionnée aux menaces potentielles. La Cour considère que les hauts responsables avaient la possibilité de planifier l’intervention de la police, d’analyser l’ensemble des informations disponibles et de tenir compte de la situation de tension et de stress à laquelle les agents de police avaient été soumis depuis quarante-huit heures (voir, mutatis mutandis, Egmez, § 78, précité). La Cour souligne en particulier le fait que, malgré la présence à Gênes de fonctionnaires expérimentés faisant partie de la haute hiérarchie policière, aucune directive spécifique sur l’utilisation de la force n’a été émise et qu’aucune consigne n’a été donnée aux agents sur cet aspect décisif (voir, pour le même constat, Cestaro, § 182, précité).
117. En ce qui concerne les actes de violence subis par les requérants, la Cour tient à souligner que les agressions infligées à chaque individu l’ont été dans un contexte général d’emploi excessif, indiscriminé et manifestement disproportionnée de la force. En effet, les requérants ont été à la fois victimes et témoins d’une utilisation incontrôlée de la violence par la police, les agents passant à tabac de manière systématique chacun des occupants, y compris ceux allongés par terre ou assis mains en l’air (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard que les occupants de l’école n’ont commis aucun acte de violence ni de résistance à l’encontre des forces de l’ordre.
118. S’agissant des récits individuels, la Cour ne peut que constater la gravité des faits décrits par les requérants et confirmés par les tribunaux nationaux. Chaque requérant a été frappé de manière violente, la plupart a reçu des coups de matraque, des coups de pied et des coups de poing et, dans certains cas, du mobilier a été jeté sur eux. Les coups reçus ont provoqué des hématomes, des blessures et, dans certains cas, des fractures sérieuses laissant des séquelles physiques permanentes (paragraphes 17 à 58 ci-dessus).
119. Eu égard à l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, la Cour est convaincue que les actes de violence commis à l’encontre des requérants ont provoqué des souffrances physiques et psychologiques « aiguës », et qu’ils revêtaient un caractère particulièrement grave et cruel (Cestaro, précité, §§ 177‑190).
120. Dès lors, la Cour conclut que les traitements subis par les requérants à l’intérieur de l’école Diaz-Pertini doivent être regardés comme des actes de torture. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
ii. Sur le volet procédural de l’article 3 de la Convention
121. La Cour observe que la même procédure interne est à l’origine du constat de violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention dans l’affaire Cestaro (précité §§ 204-236). Dès lors, elle ne voit pas de motif de s’écarter des conclusions auxquelles elle est parvenue dans ladite affaire, y compris pour ce qui est de l’insuffisance de l’ordre juridique italien concernant la répression de la torture, et conclut à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
MIZRAK ET ATAY c. TURQUIE du 18 octobre 2015 requête 65146/12
Violation de l'article 3 de la Conv EDH : l'utilisation des grenades lacrymogènes n'étaient pas nécessaires pour le maintien de l'ordre. Il y a un défaut d'enquête.
a) Volet matériel
54. En l’espèce, la Cour observe notamment que, sur le plan interne, le tribunal administratif de Diyarbakır a considéré qu’il pouvait passer pour établi que l’administration avait commis une faute dans le décès de Mahsum Mızrak, les forces de l’ordre ayant fait un usage disproportionné du matériel à leur disposition. Elle relève également que le Gouvernement ne prétend pas que la grenade lacrymogène qui a tué Mahsum Mızrak a été tirée par une personne autre qu’un membre des forces de l’ordre. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il peut passer pour établi « au-delà de tout doute raisonnable » qu’un agent des forces de l’ordre a tiré avec un lanceur de grenades lacrymogènes sur Mahsum Mızrak, le blessant à la tête et provoquant sa mort. Par conséquent, il convient d’examiner l’affaire sur le terrain des obligations négatives de l’État. Il s’ensuit que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent démontrer que l’usage de la force meurtrière en cause était rendu absolument nécessaire par la situation et qu’il n’était pas excessif ou injustifié, au sens de l’article 2 § 2 de la Convention (Bektaş et Özalp c. Turquie, no 10036/03, § 57, 20 avril 2010).
55. La Cour relève d’emblée que, dans deux affaires relatives aux incidents survenus entre le 28 et le 31 mars 2006 (Abdullah Yaşa et autres c. Turquie, no 44827/08, 16 juillet 2013 et Ataykaya c. Turquie, no 50275/08, 22 juillet 2014), elle a examiné le cadre normatif relatif à l’utilisation des armes non létales, telles que les grenades lacrymogènes, et a considéré ce qui suit (Ataykaya, précité, § 57) :
« (...) la Cour rappelle que, dans l’affaire Abdullah Yaşa et autres (précitée), qui portait sur une blessure occasionnée par le tir d’une grenade lacrymogène lors des mêmes incidents que ceux qui font l’objet de la présente affaire, elle a examiné la réglementation en matière d’usage des grenades lacrymogènes. Elle a conclu qu’à l’époque des faits, le droit turc ne contenait aucune disposition spécifique réglementant l’utilisation de ces matériels pendant les manifestations et qu’il n’énonçait aucune directive concernant leur mode d’emploi. En effet, compte tenu du fait qu’au cours des événements ayant eu lieu à Diyarbakır entre le 28 et le 31 mars 2006, deux personnes dont Tarık Ataykaya ont été tuées par des tirs de grenades lacrymogènes, on peut en déduire que les policiers ont pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’ils avaient bénéficié d’une formation et d’instructions adéquates. Pour la Cour, une telle situation ne permet pas d’offrir le niveau de protection du droit à la vie « par la loi » qui est requis dans les sociétés démocratiques contemporaines en Europe (...). ».
56. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter dans la présente affaire de sa jurisprudence en la matière. Bien que, en l’espèce, contrairement à l’affaire Ataykaya précitée, une procédure pénale ait été engagée du chef d’homicide contre trois policiers, elle ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de faire une différence entre le cas de Mahsum Mızrak et celui de M. Ataykaya, tué lors des mêmes évènements par un tir de grenade lacrymogène. En effet, ni l’enquête ni la procédure pénale n’ont pu apporter un éclairage susceptible de justifier la manière inappropriée dont il a été fait usage des grenades lacrymogènes en l’espèce. Il ressort notamment du dossier que de nombreux agents des forces de l’ordre ont utilisé des grenades lacrymogènes de manière chaotique lors des manifestations en question. Le nombre d’agents des forces de l’ordre ayant été habilités à utiliser ce type d’arme lors de l’incident n’est même pas établi avec certitude (Ataykaya, précité, § 50). Bien que des poursuites aient été engagées contre trois policiers, il s’est avéré, lors de la procédure pénale, que le projectile extrait de la tête du défunt ne correspondait pas au calibre des lance-grenades utilisés par les trois policiers en question et qu’il ne pouvait donc avoir été tiré au moyen de ces derniers (paragraphe 31 ci-dessus).
57. La Cour observe qu’il incombait au premier chef aux autorités nationales d’effectuer les recherches nécessaires afin d’établir la manière dont le tir avait été effectué. Or les expertises réalisées au plan interne sont loin d’être concluantes et elles ne sont pas susceptibles d’infirmer la thèse des requérants selon laquelle il s’agissait d’un tir direct et tendu. Même s’il est impossible de déterminer précisément comment la grenade lacrymogène a été tirée, la Cour observe, comme dans l’affaire Abdullah Yaşa et autres (arrêt précité, § 48), qu’il semble, au vu des blessures occasionnées, qu’il s’agissait d’un tir direct et tendu et non d’un tir en cloche. Pour la Cour, le tir direct et tendu d’une grenade lacrymogène au moyen d’un lanceur ne saurait être considéré comme une action policière adéquate, puisque ce tir peut causer des blessures graves, voire mortelles, alors que le tir en cloche évite que les personnes soient blessées ou tuées en cas d’impact (ibidem).
58. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater qu’il n’est pas établi que la force meurtrière utilisée contre le proche des requérants était « absolument nécessaire ». La Cour considère notamment que, au vu de la manière dont les agents des forces de l’ordre ont utilisé les grenades lacrymogènes, les autorités n’ont pas manifesté la vigilance voulue pour que toute mise en danger de Mahsum Mızrak fût réduite au minimum. La Cour estime que les autorités ont ainsi fait preuve de négligence dans le choix des mesures prises, et ce dans un contexte d’absence de réglementation adéquate sur l’usage des grenades lacrymogènes par les forces de maintien de l’ordre.
b) Volet procédural
59. Sur le terrain du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour remarque d’emblée la durée excessive de l’enquête pénale et de la procédure pénale qui a suivi : selon les dernières informations fournies par les parties, plus de huit ans après les faits, l’affaire était toujours pendante devant le tribunal de première instance sans qu’aucun jugement sur le fond n’ait été rendu.
60. À cet égard, la Cour constate qu’une enquête pénale a été ouverte d’office par le parquet compétent, lequel a entendu les plaignants ainsi que certains policiers ayant participé aux opérations des 28, 29, 30 et 31 mars 2006, et ordonné des expertises. Il ressort du dossier devant elle que, le 30 mai 2008, le parquet de Diyarbakır a transmis le dossier d’enquête à la préfecture de Diyarbakır et lui a demandé l’autorisation d’entamer une action pénale contre les fonctionnaires de police ayant fait usage de grenades lacrymogènes. Toutefois, à la suite d’une enquête administrative, la préfecture a décidé le 19 février 2009 de ne pas autoriser le déclenchement de poursuites pénales contre les policiers en question au motif que ceux-ci, agissant dans le cadre de leur compétence, n’avaient pas tiré des grenades lacrymogènes directement vers les manifestants. Sur opposition du requérant, le tribunal administratif régional de Diyarbakır a levé cette décision de refus le 8 avril 2009 et c’est ainsi qu’après plus de trois ans après l’incident, une action pénale a pu être déclenchée.
61. La Cour considère notamment que l’enquête dans son ensemble a manqué de la méticulosité nécessaire, ce qui a compromis de façon décisive sa capacité à établir l’origine du tir ayant causé le décès de Mahsum Mızrak et l’identité des personnes responsables. À cet égard, la Cour rappelle avoir observé plus haut que l’enquête et la procédure pénale subséquente n’ont pu établir avec certitude le nombre d’agents des forces de l’ordre ayant été habilités à utiliser le type de lance-grenades litigieux lors de l’incident. En outre, il s’est avéré lors de la procédure pénale que le projectile qui a atteint le proche des requérants ne pouvait avoir été tiré par l’intermédiaire des lance‑grenades appartenant aux trois policiers, car ceux-ci n’avaient pas le calibre correspondant (paragraphe 31 ci-dessus). Il est également étonnant de constater que le projectile extrait de la tête du défunt a par la suite été égaré.
62. Par ailleurs, le parquet n’a procédé que tardivement à l’audition des quelques policiers dont l’identité avait été communiquée. Par exemple, ce n’est que le 6 juillet 2007, c’est-à-dire environ un an et cinq mois après l’incident, que le parquet a commencé à procéder à l’audition des policiers, et ce en qualité de plaignants (paragraphe 20 ci-dessus). L’audition des trois policiers contre lesquels l’action pénale a été engagée n’a été effectuée qu’en janvier 2009, environ deux ans et dix mois après les faits (paragraphe 24 ci-dessus). Il ne fait pas de doute que, comme la Cour l’a souligné à maintes reprises, de tels retards créent non seulement une apparence de collusion entre les autorités chargées de l’enquête et la police, mais qu’ils peuvent également conduire les proches des victimes – ainsi que le public en général – à croire que les membres des forces de l’ordre n’ont pas à répondre de leurs actes devant les autorités judiciaires. En l’espèce, bien que rien ne suggère que les policiers en cause se soient entendus entre eux ou avec leurs collègues de la police de Mardin, le simple fait que les démarches appropriées n’aient pas été entamées pour prévenir le risque d’une telle collusion s’analyse en une lacune importante affectant l’adéquation de l’enquête (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 330, CEDH 2007‑II). En outre, tout retard injustifié dans le recueil des témoignages risque d’entraîner la disparition des preuves et de rendre difficile l’obtention d’une déclaration complète sur l’incident puisque des témoins oublient les détails de leurs souvenirs à mesure que le temps passe.
63. Les éléments énumérés ci-dessus suffisent à la Cour pour conclure que les autorités n’ont pas conduit une enquête effective au sujet du décès de Mahsum Mızrak.
CESTARO c. ITALIE du 7 avril 2015 requête 6884/ 11
Violation de l'article 3, cet arrêt définit la torture par rapport à un acte inhumain et dégradant : une arrestation médiatisée, avec violences policières, pendant le sommet de Gênes de 2001, dans les écoles Diaz‑Pertini et Diaz-Pascoli, transformées en dortoir et où tout le monde dormait. Personne ne résistait et il n'y avait aucune raison objective pour justifier le passage à tabac commis par des policiers. C'est un acte de torture. L'Italie n'a pas de procédure judiciaire effective pour réparer les actes de torture, commis par la police.
LES ACTES REPROCHÉS SONT DES ACTES DE TORTURE
i. Sur la preuve des mauvais traitements allégués
164. La Cour rappelle que, comme il ressort de sa jurisprudence bien établie (voir, parmi beaucoup d’autres, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII, et Gäfgen, précité, § 92), en cas d’allégations de violation de l’article 3 de la Convention, elle doit, pour apprécier les preuves, se livrer à un examen particulièrement approfondi. Lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles.
En effet, même si dans ce type d’affaires elle est disposée à examiner d'un œil plus critique les conclusions des juridictions nationales (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 155, CEDH 2012), il lui faut néanmoins d’habitude disposer d’éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles celles-ci sont parvenues (voir, parmi beaucoup d’autres, Vladimir Romanov, précité, § 59, 24 juillet 2008, Georgiy Bykov c. Russie, no 24271/03, § 51, 14 octobre 2010, Gäfgen, précité, § 93, Darraj, précité, § 37, Alberti c. Italie, no 15397/11, § 41, 24 juin 2014, Saba c. Italie, no 36629/10, § 69, 1er juillet 2014, et Ataykaya c. Turquie, no 50275/08, § 47, 22 juillet 2014).
165. En l’espèce, la Cour note que le jugement de première instance et l’arrêt d’appel (paragraphes 33 et 73 ci-dessus), auxquels se réfère l’arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 77 ci-dessus), exposent que, une fois entrés dans l’école Diaz-Pertini, les agents ont frappé presque tous les occupants, même ceux qui étaient assis ou allongés par terre, à coups de poing, de pied et de matraque, en criant et en menaçant les occupants.
Le jugement de première instance relate qu’à l’arrivée de la police le requérant était assis dos contre le mur, à côté d’un groupe d’occupants, et avait les bras en l’air ; qu’il a reçu des coups surtout sur la tête, les bras et les jambes, qui lui ont causé de multiples fractures du cubitus droit, de la fibule droite et de plusieurs côtes ; que ces blessures ont entraîné une hospitalisation de quatre jours, une incapacité temporaire supérieure à quarante jours et une faiblesse permanente du bras droit et de la jambe droite (paragraphes 34-35 ci-dessus).
166. Les allégations du requérant concernant l’agression dont il a été victime et les séquelles que celle-ci a entraînées ont ainsi été confirmées dans les décisions judiciaires internes.
167. Au demeurant, le Gouvernement a déclaré souscrire, en général, « au jugement des juridictions nationales, qui ont très durement stigmatisé le comportement des agents de police » lors de leur irruption dans l’école Diaz-Pertini.
168. Dès lors, et compte tenu également du caractère systématique et généralisé de l’agression physique et verbale dont les occupants de l’école Diaz-Pertini ont fait l’objet (Dedovski et autres c. Russie (no 7178/03, §§ 77-79, CEDH 2008), la Cour juge établies tant l’agression physique et verbale dont le requérant se plaint que les séquelles que celle-ci a entraînées.
169. Dans ces conditions, elle estime que le grief tiré de la violation de l’article 3 est suffisamment caractérisé et qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur la question de la preuve des autres allégations du requérant (positions humiliantes, impossibilité de prendre contact avec un avocat et/ou une personne de confiance, absence de soins adéquats en temps utile, présence d’agents des forces de l’ordre pendant l’examen médical).
ii. Sur la qualification juridique des traitements avérés
170. Eu égard aux critères découlant de sa jurisprudence bien établie (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni, précité, § 104, Labita, précité, § 120, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 84, CEDH 2000‑VII, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 118-119, CEDH 2004-IV, Gäfgen, précité, § 88, El-Masri, précité, § 196, Alberti, précité, § 40, et Saba, précité, §§ 71-72), la Cour estime qu’on ne saurait sérieusement douter que les mauvais traitements en cause tombent sous l’empire de l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement, du reste, ne le conteste pas. Reste à savoir s’ils doivent être qualifiés de torture, comme le prétend le requérant.
α) Aperçu de la jurisprudence en matière de « torture »
171. En principe, pour déterminer si une forme donnée de mauvais traitement doit être qualifiée de torture, la Cour doit avoir égard à la distinction que l’article 3 opère entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (Batı et autres, précité, § 116, Gäfgen, précité, § 90, avec les arrêts qui y sont cités, et El-Masri, précité, § 197). Le caractère aigu des souffrances est « relatif par essence ; il dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. » (Selmouni, précité, § 100, et Batı et autres, précité, § 120).
Outre la gravité des traitements, la « torture » implique une volonté délibérée, ainsi que le reconnaît la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 26 juin 1987 à l’égard de l’Italie (paragraphe 109 ci-dessus), qui définit la « torture » comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d’obtenir d’elle des renseignements, de la punir ou de l’intimider (İlhan, précité, § 85, Gäfgen, § 90, et El-Masri, précité, § 197).
172. Dans certaines affaires, les faits de la cause ont amené la Cour à estimer que les mauvais traitements en question devaient bien être qualifiés de « torture » après avoir appliqué conjointement les deux critères susmentionnés, à savoir la gravité des souffrances et la volonté délibérée (voir, par exemple, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, §§ 63-64, Recueil 1996‑VI : le requérant avait été soumis à la « pendaison palestinienne » pour qu’il avoue et qu’il livre des informations ; Batı et autres, précité, §§ 110, 122-124 : les requérants avaient été privés de sommeil et soumis à la « pendaison palestinienne », à des jets d’eau, à des coups répétés et au supplice de la falaka pendant plusieurs jours, pour qu’ils avouent leur appartenance à un parti politique ; Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, §§ 19-20, 2 novembre 2004 : le requérant avait été soumis à la « pendaison palestinienne », à des jets d’eau et à des électrochocs pendant plusieurs jours pour qu’il passe aux aveux ; Polonskiy c. Russie, no 30033/05, § 124, 19 mars 2009 : le requérant avait été frappé plusieurs fois et à divers endroits du corps, et soumis à des électrochocs pour qu’il avoue un délit – il convient de remarquer que la Cour a conclu à la « torture » même en l’absence de séquelles physiques de longue durée ; Kopylov, précité, §§ 125-126 : pour qu’il avouât un délit, le requérant avait été suspendu au moyen d’une corde avec les mains liées dans le dos, matraqué, tabassé et soumis, pendant quatre mois environ, à plusieurs autres sévices, ce qui a entraîné des séquelles graves et irréversibles ; El-Masri, précité, §§ 205-211 : le requérant avait été roué de coups, déshabillé de force et soumis à l’administration de force d’un suppositoire, puis enchaîné et encapuchonné avant d’être traîné de force jusqu’à un avion, où il avait été jeté à terre, attaché et mis de force sous sédatifs ; selon la Cour, l’ensemble de ces traitements, perpétrés dans le cadre d’une « remise extraordinaire », visait à obtenir des renseignements de l’intéressé, à le punir ou à l’intimider).
173. Dans certaines affaires, la Cour, dans son raisonnement, a fondé le constat de « torture » moins sur le caractère intentionnel des mauvais traitements que sur le fait qu’ils avaient « provoqué des douleurs et des souffrances aiguës » et qu’ils revêtaient « un caractère particulièrement grave et cruel » (voir, par exemple, Selmouni, précité, §§ 101-105, et Erdal Aslan c. Turquie, nos 25060/02 et 1705/03, § 73, 2 décembre 2008).
174. Dans d’autres arrêts, elle a attribué un poids particulier au caractère gratuit des violences commises à l’égard du requérant, détenu, pour parvenir à un constat de « torture ». Par exemple, dans l’affaire Vladimir Romanov (précitée, §§ 66-70), elle a souligné que le requérant avait été frappé à coups de matraque après qu’il eut obtempéré à l’ordre de quitter sa cellule et alors même qu’il était tombé à terre : les violences en question avaient donc valeur de « représailles ». De même, dans l’affaire Dedovski et autres (précitée), la Cour a pris en compte le potentiel de violence existant dans un établissement pénitentiaire et le fait qu’une désobéissance des détenus pouvait dégénérer rapidement en une mutinerie nécessitant ainsi l’intervention des forces de l’ordre (Dedovski et autres, § 81), la Cour n’a discerné « aucune nécessité qui [eût] justifié l’usage de matraques en caoutchouc contre les requérants. Au contraire, les actions des agents (...) étaient manifestement disproportionnées aux transgressions imputées aux requérants », qui dans le cadre d’une fouille avaient refusé de quitter la cellule ou d’écarter les bras et les jambes, et elles les a, de surcroît, jugées « inutiles à la réalisation des objectifs des agents », car « ce n’était pas en frappant un détenu avec une matraque que les agents [seraient parvenus] au résultat désiré, à savoir faciliter la fouille » (idem, § 83). La Cour a considéré que les mauvais traitements avaient ainsi clairement le caractère de « représailles » ou de « châtiment corporel » (idem, §§ 83 et 85) et que, dans le contexte, l’utilisation de la force était dépourvue de base légale (idem, § 82).
175. Dans certaines affaires concernant des violences commises par des agents de police lors d’arrestations, la Cour s’est penchée également sur la question de savoir si les mauvais traitements litigieux étaient constitutifs de « torture » au sens de l’article 3 de la Convention. Toutefois, elle n’a pas conclu dans ce sens, eu égard au fait que le but des policiers n’avait pas été d’arracher des aveux au requérant et eu égard à la courte durée des violences commises dans un contexte particulièrement tendu (Krastanov c. Bulgarie, no 50222/99, § 53, 30 septembre 2004 : coups donnés au requérant en raison d’une erreur sur la personne commise lors d’une opération de police visant à l’arrestation d’un délinquant dangereux), ainsi que compte tenu des doutes sur la gravité des souffrances entraînées par les mauvais traitements en question et de l’absence de séquelles de longue durée (Egmez c. Chypre, no 30873/96, §§ 76 et 78-79, CEDH 2000‑XII ).
176. Enfin, dans l’affaire Gäfgen (précitée), la Cour a pris en compte : a) la durée du mauvais traitement infligé au requérant, à savoir environ dix minutes (Gäfgen, précité,§ 102) ; b) les effets physiques ou mentaux que ce traitement avait eus sur le requérant ; la Cour a estimé que les menaces de mauvais traitements avaient provoqué chez celui-ci une peur, une angoisse et des souffrances mentales considérables, mais pas de séquelles à long terme (idem, § 103) ; c) la question de savoir si ce mauvais traitement était intentionnel ou non ; la Cour a jugé que les menaces n’avaient pas été un acte spontané, mais qu’elles avaient été préméditées et conçues de manière délibérée et intentionnelle (idem, § 104) ; d) le but que le mauvais traitement poursuivait et le contexte dans lequel il avait été infligé ; la Cour a souligné que les policiers avaient menacé le requérant de mauvais traitements dans le but de lui extorquer des informations sur le lieu où se trouvait un enfant kidnappé et qu’ils croyaient encore en vie, mais en grave danger (idem, §§ 105-106). Ainsi, la Cour, tout en prenant en compte « la motivation qui inspirait le comportement des policiers et l’idée qu’ils [avaient] agi dans le souci de sauver la vie d’un enfant » (idem, § 107), a jugé que la méthode d’interrogatoire à laquelle le requérant avait été soumis dans les circonstances de la présente affaire avait été suffisamment grave pour être qualifiée de traitement inhumain prohibé par l’article 3, mais qu’elle n’avait pas eu le niveau de cruauté requis pour atteindre le seuil de la torture (idem, § 108).
ß) Application en l'espèce
177. Dans la présente affaire, la Cour ne saurait ignorer que, d’après la Cour de cassation, les violences de l’école Diaz-Pertini, dont le requérant a été victime, avaient été perpétrées dans « un but punitif, un but de représailles, visant à provoquer l’humiliation et la souffrance physique et morale des victimes », et qu’elles pouvaient relever de la « torture » aux termes de l’article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (paragraphe 77 ci-dessus).
178. Ensuite, il ressort du dossier que le requérant a été agressé par des agents à coups de pied et de matraque du type tonfa, considérée comme potentiellement meurtrière par l’arrêt d’appel (paragraphe 68 ci-dessus), et qu’il a été frappé à maintes reprises à plusieurs endroits du corps.
Les coups donnés au requérant lui ont causé de multiples fractures (du cubitus droit, du styloïde droit, de la fibule droite et de plusieurs côtes) qui ont entraîné une hospitalisation de quatre jours, une incapacité temporaire supérieure à quarante jours, une opération chirurgicale lors de ladite hospitalisation ainsi qu’une opération chirurgicale quelques années plus tard ; le requérant en a gardé une faiblesse permanente du bras droit et de la jambe droite (paragraphes 34-35 et 155 ci-dessus). Les séquelles physiques des mauvais traitements subis par le requérant sont donc importantes.
Les sentiments de peur et d’angoisse suscités chez le requérant ne sauraient, eux non plus, être sous-estimés. S’étant abrité dans un asile de nuit, le requérant a été réveillé par le bruit causé par l’irruption de la police. En plus des coups subis, il a vu plusieurs agents des forces de l’ordre frapper d’autres occupants sans aucune raison apparente.
Dans ce contexte, il convient également de rappeler les conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions internes dans le cadre de la procédure pénale et auxquelles le Gouvernement a déclaré souscrire en général : selon le jugement de première instance, la conduite de la police à l’intérieur de l’école Diaz-Pertini a constitué une violation claire à la fois de la loi, « de la dignité humaine et du respect de la personne » (paragraphe 51 ci-dessus) ; d’après l’arrêt d’appel, les agents ont frappé systématiquement les occupants d’une façon cruelle et sadique, agissant comme des « matraqueurs violents » (paragraphes 67 et 73 ci-dessus) ; la Cour de cassation parle de violences « d’une gravité inhabituelle » et « absolue » (paragraphe 77 ci-dessus).
Dans ses observations devant la Cour, le Gouvernement lui-même a qualifié les agissements de la police dans l’école Diaz-Pertini d’actes « très graves et déplorables ».
179. En somme, on ne saurait nier que les mauvais traitements commis à l’égard du requérant ont « provoqué des douleurs et des souffrances aiguës » et qu’ils revêtaient « un caractère particulièrement grave et cruel » (Selmouni, précité, § 105, et Erdal Aslan, précité, § 73).
180. La Cour note également l’absence de tout lien de causalité entre la conduite du requérant et l’utilisation de la force par les agents de police.
En effet, le jugement de première instance, tout en admettant que quelques actes de résistance isolés avaient vraisemblablement été commis par des occupants de l’école Diaz-Pertini, évoque le cas du requérant – qui avait déjà un certain âge en juillet 2001 – pour souligner le caractère absolument disproportionné entre la violence de la police et les actes de résistance des occupants (paragraphe 51 ci-dessus). D’ailleurs, ainsi qu’il ressort de ce même jugement, la posture du requérant, assis dos contre le mur et les bras en l’air (paragraphe 34 ci-dessus) lors de l’arrivée de la police, exclut toute résistance de sa part à l’égard de la police.
De manière encore plus nette, l’arrêt d’appel expose qu’aucune preuve n’a été fournie quant aux prétendus actes de résistance de la part de certains des occupants, avant ou après l’irruption de la police (paragraphe 71 ci-dessus). En outre, selon cet arrêt, les agents de police étaient restés indifférents à toute condition de vulnérabilité physique liée au sexe et à l’âge, et à tout signe de capitulation, même de la part de personnes que le bruit de l’irruption venait de réveiller (paragraphe 67 et 73 ci-dessus).
L’arrêt de la Cour de cassation confirme l’absence de résistance de la part des occupants (paragraphe 80 ci-dessus).
181. Dès lors, la présente affaire se distingue des affaires où l’utilisation (disproportionnée) de la force par des agents de police était à mettre en relation avec des actes de résistance physique ou des tentatives de fuite (parmi les cas d’arrestation d’un suspect, voir, par exemple, Egmez, précité, §§ 13, 76 et 78, et Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 71-78, CEDH 2000‑XII ; parmi les cas de contrôles d’identité, voir, par exemple, Sarigiannis c. Italie, no 14569/05, §§ 59-62, 5 avril 2011, et Dembele, précité, §§ 43-47 ; pour des cas de violences perpétrées en garde à vue, voir Rivas c. France, no 59584/00, §§ 40-41, 1er avril 2004, et Darraj, précité, §§ 38-44).
182. Les mauvais traitements en cause en l’espèce ont donc été infligés au requérant de manière totalement gratuite et, à l’instar de ceux relatés dans les affaires Vladimir Romanov (précitée, § 68) et Dedovski et autres (précitée, §§ 83-85), ils ne sauraient passer pour être un moyen utilisé de manière proportionnée par les autorités pour atteindre le but visé.
À ce propos, il y a lieu de rappeler que l’irruption dans l’école Diaz-Pertini était censée être une perquisition : la police aurait dû entrer dans l’école, où le requérant et les autres occupants s’étaient abrités légitimement, pour rechercher des éléments de preuve pouvant conduire à l’identification des membres des black blocks, auteurs des saccages dans la ville, et, le cas échéant, à leur arrestation (paragraphe 29 ci-dessus).
Or, au-delà de toute considération sur les indices concernant la présence de black blocks dans l’école Diaz-Pertini le soir du 21 juillet (paragraphes 51 et 63 ci-dessus), les modalités opérationnelles suivies in concreto ne sont pas cohérentes avec le but déclaré par les autorités : la police a fait irruption en enfonçant la grille et les portes d’entrée de l’école, a passé à tabac presque tous les occupants et a ramassé leurs effets personnels, sans même chercher à en identifier les propriétaires respectifs. Ces circonstances, du reste, comptent parmi les raisons pour lesquelles, dans sa décision, confirmée par la Cour de cassation, la cour d’appel a estimé illégale, et donc constitutive du délit d’abus de fonction publique, l’arrestation des occupants de l’école Diaz-Pertini (paragraphes 33-34, 38-39, 72 ci-dessus).
183. L’opération litigieuse devait être conduite par une formation constituée majoritairement d’agents appartenant à une division spécialisée dans les opérations « anti-émeute » (paragraphe 29 ci-dessus). Cette formation, selon les explications des autorités, devait « sécuriser » le bâtiment, c’est-à-dire accomplir une tâche qui s’apparente, selon la cour d’appel de Gênes, moins à une obligation de moyens qu’à une obligation de résultat (paragraphes 29, 65 et 79 ci-dessus). Il ne ressort pas des décisions internes que des directives concernant l’utilisation de la force avaient été fournies aux agents (paragraphes 65, 68 et 79 ci-dessus). La police a attaqué immédiatement des personnes clairement inoffensives à l’extérieur de l’école (paragraphes 31 et 66 ci-dessus). À aucun moment, elle n’a essayé de parlementer avec les personnes qui s’étaient abritées légitimement dans ce bâtiment ni de se faire ouvrir les portes que ces personnes avaient légitimement fermées, préférant d’emblée les enfoncer (paragraphes 32 et 67 ci-dessus). Enfin, elle a systématiquement passé à tabac l’ensemble des occupants dans tous les locaux du bâtiment (paragraphes 33 et 67 ci-dessus).
Dès lors, on ne saurait méconnaître le caractère intentionnel et prémédité des mauvais traitements dont le requérant, notamment, a été victime.
184. Pour apprécier le contexte dans lequel s’est produite l’agression du requérant et, notamment, l’élément intentionnel, la Cour ne peut pas non plus négliger les tentatives de la police de cacher ces événements ou de les justifier sur le fondement de circonstances fallacieuses.
D’une part, comme l’ont souligné la cour d’appel et la Cour de cassation, en faisant irruption dans l’école Pascoli, la police voulait effacer toute preuve filmée de l’irruption qui se déroulait dans l’école Diaz-Pertini (paragraphe 83-84 ci-dessus). En outre, il y a lieu de rappeler les déclarations du chef de l’unité de presse de la police dans la nuit du 21 au 22 juillet, selon lesquelles les nombreuses taches de sang, au sol, sur les murs et sur les radiateurs du bâtiment, s’expliquaient par les blessures que la plupart des occupants se seraient faites au cours des accrochages de la journée (paragraphe 41 ci-dessus, et paragraphe 67 ci-dessus pour l’appréciation de la cour d’appel à ce propos).
D’autre part, l’arrêt d’appel indique que la résistance des occupants, l’agression au couteau subie par un agent et la découverte dans l’école Diaz-Pertini de deux cocktails Molotov étaient autant de mensonges, constitutifs des délits de calomnie et faux, qui visaient à justifier, a posteriori, l’irruption et les violences commises (paragraphes 70-73 ci-dessus). Il s’agissait, selon la Cour de cassation, d’une « opération scélérate de mystification » (paragraphe 80 ci-dessus).
185. Dans ces conditions, la Cour ne peut souscrire à la thèse implicitement avancée par le Gouvernement, à savoir que la gravité des mauvais traitements perpétrés lors de l’irruption de la police dans l’école Diaz-Pertini devrait être relativisée eu égard au contexte très tendu découlant des nombreux accrochages s’étant produits pendant les manifestations et des exigences tout à fait particulières de protection de l’ordre public.
186. Certes, lorsqu’elle se prononce sur les mauvais traitements commis par des agents de police s’acquittant de certaines tâches objectivement difficiles et qui présentent des risques pour la sécurité des agents eux-mêmes ou pour celle d’autrui, la Cour tient compte du contexte tendu et de la forte tension émotionnelle (voir, par exemple, respectivement, Egmez, précité, §§ 11-13 et 78 : arrestation en flagrant délit d’un trafiquant de drogue, qui avait opposé une résistance et essayé de prendre la fuite, dans la zone tampon qui sépare la partie du territoire sous le contrôle de la République turque de Chypre du Nord de la partie du territoire placé sous l’autorité du gouvernement de Chypre ; et Gäfgen, précité, §§ 107-108 : menaces de torture dans le but d’extorquer au requérant des informations sur le lieu où se trouvait un enfant kidnappé que les investigateurs croyaient encore vie, mais en grave danger).
187. En l’espèce, si la juridiction de première instance a reconnu que les accusés avaient agi « en condition de stress et fatigue » lors de l’irruption dans l’école Diaz-Pertini (paragraphe 50 ci-dessus), la cour d’appel comme la Cour de cassation n’ont pas retenu cette circonstance atténuante (paragraphe 73 ci-dessus).
188. Or il incombe à la Cour de statuer non pas sur la culpabilité en vertu du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des États contractants au regard de la Convention (El-Masri, précité, § 151). En ce qui concerne, en particulier, l’article 3 de la Convention, la Cour a dit maintes fois que cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. L’article 3 ne prévoit pas d’exceptions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni, précité, § 95, Labita, précité, § 119, Gäfgen, précité, § 87, et El-Masri, précité, § 195). La Cour a confirmé que même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime (Labita, Gäfgen et El-Masri, précités, idem).
189. Dès lors, et sans vouloir ainsi mésestimer la difficulté de la mission de la police dans les sociétés contemporaines et l’imprévisibilité du comportement humain (voir, mutatis mutandis, Tzekov c. Bulgarie, no 45500/99, § 61, 23 février 2006), elle souligne, en l’espèce, les éléments suivants :
– l’irruption de la police dans l’école Diaz-Pertini a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 juillet, alors que les accrochages et les saccages qui s’étaient produits au cours du sommet du G8 avaient pris fin et que rien de similaire ne se passait dans cette école ou ses alentours ;
– même à supposer que des casseurs avaient trouvé refuge dans l’école, il ne ressort guère du dossier que ses occupants avaient eu, lors de l’arrivée de la police, un comportement susceptible de mettre quiconque en danger et, notamment, les policiers qui, en grand nombre et bien armés (paragraphe 30 ci-dessus), participaient à cette opération : certains des occupants, il faut le rappeler, s’étaient bornés à fermer la grille et les portes d’entrée de l’école, comme ils en avaient le droit, et il n’y avait pas eu de véritables actes de résistance (paragraphes 71 et 80 ci-dessus) ;
– il ressort du dossier que les autorités ont eu suffisamment de temps pour bien organiser l’opération de « perquisition » (paragraphes 27-30 ci-dessus) ; en revanche, il ne ressort pas du dossier que les policiers ont dû réagir dans l’urgence à des développements imprévus qui seraient survenus au cours de cette opération (voir, a contrario, Tzekov, précité, §§ 61-62) ;
– la perquisition d’une autre école et l’arrestation d’une vingtaine de ses occupants, même si dépourvues de toute utilité sur le plan judiciaire, avaient eu lieu dans l’après-midi du 21 juillet apparemment sans aucune violence de la part de la police (paragraphe 22 ci-dessus).
Compte tenu de ce qui précède, les tensions qui, comme le prétend le Gouvernement, auraient présidé à l’irruption de la police dans l’école Diaz-Pertini peuvent s’expliquer moins par des raisons objectives que par la décision de procéder à des arrestations médiatisées et par l’adoption de modalités opérationnelles non conformes aux exigences de la protection des valeurs qui découlent de l’article 3 de la Convention ainsi que du droit international pertinent (paragraphes 107-111 ci-dessus).
190. En conclusion, eu égard à l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, la Cour estime que les mauvais traitements subis par le requérant lors de l’irruption de la police dans l’école Diaz-Pertini doivent être qualifiés de « torture » au sens de l’article 3 de la Convention.
ŞÜKRÜ YILDIZ c. TURQUIE du 17 mars 2015 requête n° 4100/10
Violation article 3 (volet matériel) : tir à bout portant sur des individus qui écrivaient des slogans interdits sur un mur
54. Le Gouvernement soutient qu’il n’est pas certain que le requérant ait été blessé dans la fusillade avec la police. Il souligne que le rapport médical du 10 décembre 2000 établi par l’hôpital de Taksim ne précise pas si les blessures en question étaient dues à une blessure par balle ou à des actes de violence d’un autre type. Le Gouvernement soutient par conséquent qu’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que les blessures du requérant au niveau de la tête sont imputables aux policiers. On ne saurait donc, selon le Gouvernement, conclure à la violation de l’article 3 de la Convention.
55. Le requérant conteste cette thèse.
56. La Cour rappelle que, pour l’appréciation des éléments de preuve, elle retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (El‑Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 151, CEDH 2012). Selon sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. La Cour est également attentive à la gravité que revêt un constat selon lequel un État contractant a violé des droits fondamentaux (Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, § 94, 3 juillet 2014).
57. La Cour relève à titre liminaire que l’importance des blessures constatées dans le rapport médical établi le 10 décembre 2000 autorise à considérer que celles-ci, si elles lui ont été infligées par la police comme il le prétend, étaient suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 (Tomaszewscy c. Pologne, no 8933/05, § 98, 15 avril 2014). Il reste à examiner si l’État défendeur peut être jugé responsable de ces blessures au regard de l’article 3.
58. Pour ce qui est des causes des blessures du requérant, la Cour ne partage pas la thèse du Gouvernement selon laquelle il n’est pas possible de conclure avec certitude que les blessures du requérant à la tête sont imputables aux policiers. Cette thèse s’appuie sur le fait que le rapport médical du 10 décembre 2000 établi par l’hôpital de Taksim reste imprécis sur les causes des blessures. Or, il ressort du procès-verbal d’arrestation (paragraphe 7 ci-dessus) que les policiers avaient usé de la force contre le requérant, au motif que celui-ci résistait à son arrestation. Ensuite, dans son arrêt du 24 mai 2012, la cour d’assises a admis que les blessures du requérant résultaient de l’usage légitime de la force contre le requérant, qui avait résisté aux policiers lors de son arrestation (paragraphe 27 ci-dessus). Cela signifie qu’en dépit du fait que les instruments de ces blessures demeurent incertains, il peut passer pour établi au plan interne que ce sont bien les agissements des policiers lors de l’arrestation du requérant qui en sont la cause. Par ailleurs, aucune autre explication n’a été présentée par le Gouvernement lors de la procédure devant la Cour.
59. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention n’interdit pas l’usage de la force dans certaines circonstances, par exemple à l’égard d’une personne qui oppose une résistance à son arrestation, ou tente de fuir ou de provoquer des blessures ou des dommages. Elle rappelle également que lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, par exemple lors d’une arrestation, l’utilisation à son égard d’une force physique excessive et injustifiée par rapport à son comportement constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Birgean c. Roumanie, no 3626/10, § 76, 14 janvier 2014). Par conséquent, dans les circonstances de la présente affaire, il appartient au Gouvernement d’apporter des preuves pertinentes démontrant que le recours à la force était à la fois nécessaire et proportionné (Grămadă c. Roumanie, no 14974/09, § 65, 11 février 2014). L’obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement infligé à un individu s’impose d’autant plus lorsque le pronostic vital est engagé, comme tel est le cas en l’espèce.
60. Les blessures en question étaient deux coupures suturées de 2 et 3 centimètres dans la zone pariétale droite, trois coupures suturées de 2 centimètres dans la zone occipitale et une fracture du crâne avec enfoncement dans la région temporo-pariétale droite.
61. S’agissant de la gravité des blessures du requérant, la Cour observe que la présente espèce se distingue de l’affaire Camekan (précitée, § 50), dans laquelle la Cour a conclu à l’absence de violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention. En effet, M. Camekan avait certes été blessé par balle à l’oreille, mais le pronostic vital n’avait pas été engagé.
Dans la présente affaire, au contraire, la Cour relève que la fracture crânienne du requérant était très importante, au point que son pronostic vital était engagé et qu’une incapacité de travail – quarante-cinq jours – était retenue. Comme l’a précisé la Cour au paragraphe 58 ci-dessus, le Gouvernement n’a fourni d’autre explication pour les origines des blessures du requérant que l’usage de la force par la police. En effet, la Cour rappelle que le Gouvernement n’a ni soutenu, ni démontré en aucune manière que la fracture du crâne pourrait résulter d’un coup de feu tiré par la police (paragraphe 53 ci-dessus). Une telle conclusion ne peut d’ailleurs ressortir de l’arrêt de la cour d’assise (paragraphe 27 ci-dessus), qui a considéré que les blessures du requérant trouvaient son origine dans un usage légitime de la force par les policiers. En outre, le Gouvernement n’a pas apporté la preuve permettant de conclure que la fracture du crâne était une conséquence de l’usage justifié de la force et que cette force était proportionnée à l’attitude du requérant. À cet égard, la Cour rappelle que les policiers en question n’ont jamais été interrogés sur les mauvais traitements que le requérant alléguait avoir subis après son arrestation (paragraphe 17 ci-dessus). En somme, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas pu démontrer de façon convaincante que l’utilisation de la force par la police en l’espèce était strictement nécessaire et donc justifiée au sens de l’article 3 de la Convention, ce en dépit de la gravité de la blessure subie par le requérant.
Eu égard aux constats figurant au paragraphe antérieur, la Cour estime ne pas devoir vérifier au surplus l’origine des autres blessures constatées sur la tête du requérant, compte tenu du caractère lacunaire de la documentation médicale présentée par les parties.
62. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel.
Arrêt Ali Günes C. Turquie du 10 avril 2012 requête n°9829/07
Caractère inapproprié de l’utilisation par la police de gaz lacrymogène contre un manifestant pacifique
Article 3
Pour commencer, la Cour relève que le gaz lacrymogène peut provoquer entre autres des problèmes respiratoires, des nausées, des vomissements, des irritations, des spasmes et des douleurs à la poitrine. A forte dose, il peut aussi abîmer les poumons ou provoquer des nécroses des voies respiratoires ou digestives ainsi que des hémorragies internes.
La Cour observe en outre que, bien que le gaz lacrymogène ne soit pas considéré comme une arme chimique par la Convention de 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, le Comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture (le CPT) s’est déclaré préoccupé par l’utilisation de ce gaz par les forces de l’ordre. Le CPT a notamment recommandé que soient élaborées des règles claires et précises pour son usage et a déconseillé de l’employer dans des espaces confinés, le considérant comme potentiellement dangereux.
La Cour souscrit à l’avis du CPT et souligne que rien ne justifie d’utiliser ce gaz contre des individus déjà placés en garde à vue. Elle ajoute que le Gouvernement n’a donné aucune raison pour expliquer que ce gaz ait été employé contre M. Güneş après son arrestation par la police.
Elle conclut que l’aspersion injustifiée de gaz sur le visage de M. Güneş a dû causer à celui-ci de grandes souffrances physiques et mentales, et que celui-ci a donc subi des traitements inhumains et dégradants. Eu égard à cette conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner séparément l’allégation relative aux coups portés par les policiers.
Par ailleurs, le procureur a mis fin à l’enquête 48 heures après l’avoir ouverte. En dehors de la décision du procureur relative à la clôture de l’enquête, le Gouvernement n’a présenté à la Cour aucun document indiquant quelles mesures d’enquête avaient été prises.
Dans ces conditions, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 3 au motif que M. Güneş a été aspergé de gaz lacrymogène et que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur ses griefs à ce sujet.
DIMITAR DIMITROV c. BULGARIE requête 18059/05 du 3 avril 2012
Les violences policières durant une arrestation et une garde à vue.
36. La Cour relève d’emblée que les versions du requérant et du Gouvernement divergent sur la question de savoir si le requérant avait été menotté à un seul poignet ou aux deux, s’il avait eu un comportement agressif envers les policiers, et si de l’eau froide avait été versée sur lui. Les parties ne s’accordent pas non plus sur le niveau de gravité des blessures, le Gouvernement affirmant que celles-ci ne sont pas de nature à entraîner l’applicabilité de l’article 3.
37. La Cour note que selon le certificat médical établi le 2 juillet 2002, l’intéressé présentait une ecchymose au niveau des lombaires de trois à quatre centimètres et une écorchure des lèvres. De plus, il devait demeurer sous surveillance médicale pendant une semaine après les évènements avant d’être transféré de nouveau à la prison de Burgas. Le Gouvernement ne conteste pas que les blessures en question avaient été causées par les agents de police. Même s’il ne soumet pas d’observations quant à l’allégation que de l’eau froide avait été versée sur le requérant et s’il est difficile d’établir ce fait, la Cour estime que les blessures du requérant telles qu’établies en l’espèce revêtent une gravité suffisante pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
38. La Cour rappelle ensuite qu’en ce qui concerne l’usage de la force au cours d’une arrestation, elle doit rechercher si la force utilisée était strictement nécessaire et proportionnée et si l’Etat doit être tenu pour responsable des blessures infligées (Berliński c. Pologne, nos 27715/95 et 30209/96, § 64, 20 juin 2002). Pour répondre à cette question, elle doit prendre en compte les blessures occasionnées et les circonstances dans lesquelles elles l’ont été (R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004). De plus, il incombe normalement au Gouvernement d’apporter des preuves pertinentes démontrant que le recours à la force était à la fois proportionné et nécessaire (Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 72-76, CEDH 2000-XII, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 34, série A no 336, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001, Ivan Vassilev c. Bulgarie, no 48130/99, § 79, 12 avril 2007, et Petyo Popov c. Bulgarie, no 75022/01, § 54, 22 janvier 2009).
39. En l’espèce, le Gouvernement soutient que les agents de police ont recouru à la force afin de maîtriser le requérant qui refusait d’obtempérer, alors que celui-ci combat cette thèse. Eu égard aux éléments de preuve contradictoires produits devant elle, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir dans quelles circonstances les lésions ont été occasionnées. En revanche, il lui reste à déterminer si les blessures constatées par le médecin étaient sérieuses au point de ne pouvoir correspondre, dans aucun des deux cas, à un usage par les policiers de la force rendue strictement nécessaire par le comportement du requérant.
40. La Cour observe, au vu du certificat médical établi le jour de l’incident, que le requérant présentait une ecchymose au niveau lombaire et une écorchure des lèvres. Elle note aussi que, selon les constats des procureurs, le comportement de l’intéressé avait été agressif, ce que ce dernier conteste. Elle tient en revanche pour établi que lorsque les policiers ont fait usage de la force, le requérant se trouvait déjà attaché au moins d’un poignet à un autre prisonnier et que pendant une partie de l’incident il était assis ou couché par terre, ce qui le mettait dans une situation de faiblesse. Dans une telle situation, deux policiers se sont employés à mettre les menottes au deuxième poignet du requérant, lui affligeant les blessures litigieuses et le mettant dans la nécessité d’être placé sous surveillance médicale pendant sept jours. Au vu des ces éléments, il semble à la Cour que les coups reçus par le requérant ont résulté de l’usage de la force disproportionnée par rapport à la situation affaiblie de celui-ci, même s’il manifestait une agression physique.
41. Pour ce qui est des allégations selon lesquelles de l’eau froide aurait été versée sur l’intéressé et qu’il a été ensuite soulevé et relâché par terre à plusieurs reprises par un policier, de sorte qu’il était ensuite épuisé et que les policiers l’auraient traîné jusqu’à la gare, le dossier ne révèle pas clairement si le requérant a exposé ces dernières affirmations auprès des procureurs. Le Gouvernement ne les a pas commentées et le parquet ne les a pas examinées dans ses ordonnances. Cependant, la Cour remarque que le dossier contient des témoignages d’un prisonnier, témoin de l’incident, mais que ces dépositions n’ont jamais été examinées par les autorités. Elle note à cet égard que les faits auraient pu être établis de manière plus approfondie étant donné que d’autres prisonniers ont été témoins à l’incident et auraient pu être retrouvés. Dans la mesure où le requérant soutient que les lacunes dans l’établissement des faits sont dues aux autorités nationales, la Cour estime que ce point relève du respect de l’obligation positive de l’Etat de conduire une enquête effective (paragraphes 43-49 ci-dessous).
42. En conclusion, compte tenu de l’usage de la force jugé disproportionné en l’espèce, la Cour estime que le requérant a été soumis à des traitements entraînant une violation de l’article 3, sous son volet substantiel.
IORDAN PETROV C. BULGARIE requête 22926/04 du 24 janvier 2011
Détenu brutalisé par la police et des agents pénitentiaires puis condamné sur la base de preuves obtenues par la violence
Article 3
Incidents des 18 et 19 janvier 2001 et enquête
Les examens médicaux pratiqués sur le requérant les 18 et 22 janvier indiquent que les blessures sur ses jambes sont survenues le 16 janvier 2001, soit deux jours avant son arrestation, lors d’un affrontement avec une patrouille de police. La Cour estime que l’emploi de munitions sub-létales par les policiers à cette occasion ne soulève pas de problème sous l’angle de l’article 3.
Les éléments de preuve dont elle dispose ne permettent pas à la Cour de déterminer au delà de tout doute raisonnable si le requérant a effectivement été forcé par les policiers après son arrestation à rester en position de grand écart, le front contre le mur, jusqu’à ce qu’il s’effondre à terre. Les lésions corporelles constatées dans les rapports médicaux (coups violents à la tête et sur les membres supérieurs) démontrent néanmoins qu’il a été soumis à des traitements dont les effets dépassent le seuil de gravité exigé par l’article 3. Le gouvernement bulgare n’a fourni aucune explication quant à l’origine de ces blessures et le dossier ne mentionne aucun comportement agressif ou tentative d’évasion ou d’automutilation de la part du requérant lors des premiers jours de sa détention. Le gouvernement bulgare doit donc être tenu pour responsable des traitements inhumains et dégradants infligés au requérant lors de ses deux premiers jours de détention, en violation de l’article 3.
Concernant l’enquête menée sur ces incidents, étant donné les conclusions du rapport médical du 22 janvier 2001, les autorités étaient tenues de mener une enquête approfondie. Les deux enquêtes conduites respectivement par le parquet militaire de Varna et le parquet militaire de Pleven ont abouti à des non-lieux. Si lors de ces enquêtes les témoignages des policiers, des surveillants pénitentiaires, du requérant et de témoins ont été entendus ainsi que des preuves médicales examinées, aucune ne s’est attachée à établir si de mauvais traitements étaient intervenus lors du transfert du requérant à Varna dans l’après-midi ou le soir du 18 janvier 2001. La Cour estime peu convaincante l’hypothèse émise par le procureur militaire de Pleven, également évoquée par les parquets de degré supérieur, selon laquelle les lésions seraient survenues au cours de l’arrestation mais seraient devenues visibles quelques jours plus tard. Ainsi, l’effectivité des enquêtes ayant été sapée par leur étendue limitée, la Cour conclut à la violation de l’article 3.
Soins médicaux
L’infection des blessures aux jambes alléguée le requérant ne figure pas dans le rapport médical du 22 janvier 2001, ni dans la déposition du médecin pénitentiaire entendu dans le cadre de l’enquête sur les allégations de mauvais traitements. Les déclarations de la famille du requérant selon lesquelles ses sous-vêtements souillés attestaient de cette infection, ne permettent pas à la Cour de prouver « au-delà de tout doute raisonnable »
que l’absence de soins médicaux est avérée. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 3 à cet égard.
Allégations de mauvais traitements le 12 décembre 2003 et enquête
Il n’est pas contesté que les ecchymoses et contusions constatées sur le requérant dans le rapport médical du 12 décembre 2003 ont été causées par les surveillants pénitentiaires. Il s’agit de savoir si leurs agissements étaient proportionnés au comportement du requérant. Si la question de savoir si le requérant a été violent ne peut être tranchée, la Cour observe cependant qu’il était seul et non armé face à un groupe de plusieurs surveillants professionnels munis de matraques, au sein de la zone de haute sécurité de la prison de Varna. Dans ces circonstances, les moyens employés par les agents pénitentiaires pour maîtriser le requérant semblent disproportionnés au danger que présentait son comportement. Le Gouvernement n’a pas fait mention de blessures que les agents pénitentiaires auraient subies lors de leur affrontement avec lui.
La Cour estime que le comportement du requérant ne nécessitait pas l’emploi d’une force physique d’une telle intensité et conclut à la violation de l’article 3.
L’enquête, menée sur l’incident du 12 décembre 2003 afin de déterminer si la responsabilité pénale des surveillants était engagée, aboutit à un non-lieu, les agissements des surveillants ayant été considérés comme conformes à la législation.
Alors même que cette dernière pose comme question essentielle la proportionnalité du recours à la force, le manquement du parquet à procéder à une pondération de la force employée et du degré de menace du requérant a limité l’enquête au point de la rendre ineffective, en violation de l’article 3.
Conditions de détention du requérant à la prison de Varna
La Cour est partie des allégations du requérant et a pris en compte tous les autres éléments de preuve soumis par les deux parties, ainsi que les données qu’elle s’est procurées elle-même, en accord avec les règles de sa jurisprudence à ce égard.
Le requérant fait état de locaux insalubres, d’accès non-libre aux équipements sanitaires, et de repas maigres et médiocres. L’absence d’eau courante et de toilettes séparées dans les cellules a été confirmée par le directeur général des établissements pénitentiaires. En l’absence de circonstances exceptionnelles, la Cour estime inacceptable l’absence d’un espace toilettes spécialement aménagé en cellule. Les mesures prises par l’administration pénitentiaire pour améliorer les conditions des détenus ne suffisent pas à pallier les conditions décrites par le requérant. Il est incarcéré depuis dix ans, dont les cinq premières en isolement quasi complet sans qu’un tel régime n’ait été justifié par des raisons particulières.
La Cour a déjà constaté, dans d’autres affaires bulgares portées devant elle, qu’un régime pénitentiaire restrictif, combiné avec les effets néfastes de conditions matérielles inadéquates en prison, avait pour résultat de soumettre les détenus à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, en violation de l’article 3.
Article 6 § 1
Dans sa déposition du 19 janvier 2001, le requérant s’est lui-même reconnu coupable de plusieurs vols à main armée et d’implication dans un triple meurtre. Alors que le tribunal de première instance a exclu cette déposition de la masse des preuves, les juridictions d’appel et de cassation l’ont prise en compte et ont condamné le requérant à la plus lourde des peines pénales en Bulgarie, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation. Elles ont rejeté la déclaration de rétractation ultérieure du requérant qui
faisait état d’aveux extorqués par les policiers. La cour d’appel de Varna et la Cour suprême de cassation ont en effet estimé qu’il aurait été impossible en pratique aux agents de police de se livrer à des traitements violents, au vu de l’organisation de la journée du 19 janvier 2001. La Cour observe à cet égard qu’un certain laps de temps peut séparer la violence tendant à l’obtention d’aveux et le moment où le suspect parle.
Par ailleurs, la seule pression psychologique ressentie par le requérant devant l’éventualité d’être de nouveau violenté a pu suffire à un passage aux aveux. En tout état de cause, les juridictions d’appel et de cassation, ne prenant en compte que les faits survenus le jour de l’arrestation, ont omis la question de savoir si M. Petrov avait subi des violences policières destinées à le faire passer aux aveux le jour d’avant alors même qu’ils disposaient du rapport médical du 22 janvier 2001. Ainsi l’utilisation de la déposition du requérant comme preuve de culpabilité a anéanti l’équité du procès pénal à son encontre, en violation de l’article 6 § 1.
Article 8
Les allégations du requérant selon lesquelles deux des lettres de sa représentante ont été ouvertes et photocopiées sont corroborées par le fait que la loi en vigueur à l’époque autorisait le contrôle de la correspondance des détenus. La Cour observe à nouveau qu’une telle ingérence n’avait pas de base légale puisque ladite loi a été déclarée contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle bulgare. La Cour conclut donc à la violation de l’article 8.
Arrêt Taraburca C. MOLDOVA requête 18919/10 du 6 décembre 2011
Un manifestant de 21 ans et de nombreuses autres personnes ont subi des brutalités policières pendant des manifestations dénonçant des fraudes électorales
Article 3
Brutalités policières
La Cour souligne que cette affaire s’inscrit dans un contexte général de mauvais traitements infligés de manière systématique et sur une grande échelle par la police sur une période relativement brève. En particulier, à la suite de visites au Moldova immédiatement après ces événements, tant le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (le « CPT ») que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ont confirmé qu’ils avaient recueilli de nombreuses allégations crédibles et cohérentes indiquant une situation globale de mauvais traitements infligés à des détenus par la police à la suite des élections générales d’avril 2009.
En ce qui concerne M. Taraburca lui-même, la Cour observe qu’à son arrestation il était en bonne santé, et qu’aucun signe de mauvais traitements n’a été relevé par le médecin pénitentiaire. Ce n’est qu’une semaine plus tard (le 14 avril 2009) qu’un autre médecin pénitentiaire a constaté la présence de blessures sur son visage. Le fait que le requérant ne s’est pas plaint de brutalités policières avant cette date ne prouve pas, contrairement à ce que suggère le Gouvernement, qu’il n’a pas été maltraité. Au contraire, vu l’insécurité qui prévalait à cette époque (de nombreuses personnes étaient ouvertement maltraitées et humiliées, des juges examinaient les affaires de manière sommaire dans les commissariats et des avocats commis d’office ne prêtaient aucune attention aux
blessures pourtant visibles de leurs clients, comme M. Taraburca en a fait l’expérience), il est parfaitement compréhensible que l’intéressé ait déposé plainte uniquement après avoir vu un avocat à qui il a estimé pouvoir se fier. Les sentiments de peur et d’impuissance qu’il a ressentis étaient en réalité partagés par une majorité des victimes alléguées, comme le confirme le rapport du CPT qui indique que la plupart des plaintes ont été déposées après la libération des personnes concernées ou leur transfert dans un établissement dépendant du ministère de la Justice. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3 concernant les mauvais traitements infligés à M. Taraburca par des policiers.
Enquête
La Cour estime que l’enquête initiale sur la plainte de M. Taraburca, menée par l’autorité dont dépendait la plupart des accusés, était dès le départ compromise. En outre, l’enquête été émaillée de retards inexpliqués : la plainte a mis une semaine pour parvenir au procureur militaire, qui l’a mise ensuite de côté pendant 38 jours en attendant les résultats de l’enquête initiale du ministère de l’Intérieur. Une fois que le procureur a finalement pris sa décision, il a fallu un mois pour que le requérant en soit informé. En outre, aucun des fonctionnaires qui ont vu le requérant avant le 14 avril 2009 (ni les policiers travaillant dans les établissements où il a été détenu, ni l’avocat commis d’office, ni le juge) n’a réagi aux blessures pourtant clairement visibles de M. Taraburca, ni fait part aux autorités de poursuite d’une éventualité de mauvais traitements. De même, personne n’a tenté de recueillir des preuves en tentant de retrouver les codétenus du requérant ou d’organiser une séance d’identification. Partant, la Cour estime que l’enquête sur les allégations de mauvais traitements présentées par M. Taraburca a été totalement inadéquate, en violation de l’article 3.
Article 41 (satisfaction équitable)
La Cour dit que le Moldova doit verser à M. Taraburca 15 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens.
Izgi C.Turquie requête 44861/04 du 15 novembre 2011
La police turque responsable des mauvais traitements subis par le manifestant
LES FAITS
Le requérant, M. Abdullah Izgi est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Adana (Turquie). En tant que membre de la section locale d’Adana du DEHAP (Parti démocratique du peuple), le 14 septembre 2003, M. Izgi a participé à une déclaration de presse au terme d’une manifestation organisée par le DEHAP au parc Inönü. Selon M. Izgi, les policiers de la direction de la sûreté et de la lutte contre le terrorisme seraient intervenus pour disperser les participants en les frappant à coup de matraques et d’objets similaires, sans sommation et alors même que les participants n’avaient pas résisté. En outre, la police aurait porté des coups à M. Izgi en lui cassant une côte.
Selon le Gouvernement turc, environ cinq cents manifestants scandaient des slogans faisant l’apologie d’Abdullah Öcalan2 durant la déclaration de presse et il est devenu nécessaire de les mettre en garde afin qu’ils cessent. Au vu de l’enregistrement de la manifestation, la déclaration de presse se serait terminée sans intervention de la police, mais finalement certains manifestants auraient continué à exalter l’organisation terroriste et son chef et ils auraient jeté des pierres sur les policiers. Ces derniers sont intervenus donc pour rétablir l’ordre.
Le rapport médical établi le même jour par l’hôpital d’Adana a indiqué que M. Izgi avait sur le temporal droit une ecchymose superficielle et des zones d’oedèmes ainsi que des hyperémies sur les côtes 8 à 10.
Le lendemain Mr. Izgi a déposé une plainte pénale contre les policiers pour mauvais traitements, coups et blessures, et injures. Il alléguait qu’à la suite de l’intervention de la police pour disperser les manifestants, les policiers après l’avoir immobilisé, l’avaient frappé à coups de poing et de matraque. Il précisait qu’il avait des ecchymoses sur différentes parties du corps, en particulier sur les côtes et le côté droit de la tête.
Deux rapports médicaux établis par l’institut médicolégal d’Adana avaient indiqué que M. Izgi avait des douleurs aigües et une sensibilité sur le coté droit de la poitrine, des égratignures, ecchymoses et oedèmes sur la région du temporal droit et une zone d’hyperémies sur l’axial droit et sur les côtes 8 à 10. L’examen médical de son nez a attesté une déviation et une hypertrophie nasale. M. Izgi s’est vu reconnaître une incapacité de travail de cinq jours.
En décembre 2003, le préfet a refusé d’autoriser l’ouverture de poursuites pénales contre les policiers en question. Par la suite, le procureur de la République et M. Izgi ont contesté cette décision devant le tribunal administratif régional d’Adana, qui en février 2004, a rejeté leur opposition. Le tribunal a pris cette décision sur le fondement de la loi 4483 concernant la procédure relative aux poursuites contre des fonctionnaires qui ne prévoit pas de voie de recours contre une décision du préfet de refuser l’autorisation des poursuites contre des fonctionnaires soupçonnés de mauvais traitements. Par la suite, en mars 2004, le procureur a rendu une décision de non-lieu à poursuite, qui, en dépit de la contestation de M. Izgi, a été confirmée par la cour d’assises de Tarsus.
Par ailleurs, en décembre 2003, le procureur a accusé dix personnes, dont M. Izgi d’avoir participé à une manifestation en méconnaissance de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestation publiques et il a précisé que la manifestation s’était déroulée sans autorisation. Il soutenait également que les manifestants avaient attaqué les policiers par des jets de pierres et des bâtons et blessé l’un d’entre eux à la jambe.
En novembre 2005, le tribunal correctionnel d’Adana a acquitté les personnes poursuivies, dont M. Izgi, au motif que ses agissements ne pouvaient être considérés comme une infraction. En examinant notamment l’affaire, le tribunal a observé qu’à la fin de la manifestation, les dirigeants du DEHAP avaient demandé par mégaphone aux manifestants de se disperser calmement. Cependant, certains individus non identifiables avaient scandé des slogans, ils ne s’étaient pas dispersés immédiatement et ils avaient jeté des pierres sur les policiers, causant la blessure d’un policier. Le tribunal a conclu ainsi que les dirigeants du DEHAP n’avaient pas commis de faute et n’avaient pas l’intention de commettre une infraction dans la mesure où il fallait laisser un temps raisonnable aux manifestants pour se disperser. Selon les informations, ce jugement n’a pas fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.
LA CEDH
La Cour constate que, selon les rapports médicaux, suite à l’incident au cours de la manifestation, M. Izgi avait des ecchymoses, des hyperémies, des douleurs ainsi qu’une hypertrophie nasale.
La Cour constate que ni la préfecture, ni le procureur n’expliquent si M. Izgi aurait jeté des pierres sur les policiers et que, selon le jugement du tribunal correctionnel d’Adana, un policier fut blessé à cause de pierres jetées par d’autres individus non identifiés. De plus, il n’est pas non plus établi que M. Izgi s’en soit pris physiquement ou violemment aux policiers. En effet, rien n’indique dans les faits que M. Izgi se soit montré agressif au point que la police n’ait pu le maîtriser que par la force.
A cet égard, quand bien même le comportement de M. Izgi aurait pu justifier un recours à la force par la police pour rétablir l’ordre, la Cour considère que la gravité de coups portés au corps, au visage ou à la tête d’un participant à un rassemblement ne peut être expliquée uniquement par la tentative de la police de disperser le rassemblement. La Cour constate que les autorités nationales n’ont pas indiqué les circonstances exactes dans lesquelles M. Izgi a reçu des coups et qu’elles n’ont présenté aucun fait précis permettant de vérifier si le degré de force utilisée par les policiers contre M. Izgi était acceptable.
Par ailleurs, la Cour note que, curieusement, la demande d’autorisation d’ouverture de poursuites pénales contre les policiers a été adressée au préfet en appliquant la loi 4483, sans tenir compte du fait que, depuis la modification de cette loi (la loi d’amendement 4778) en janvier 2003, la décision d’engager une procédure pénale contre les agents de l’Etat incriminés pour des délits relevant des mauvais traitements et des recours excessifs à la force relève du procureur.
En rappelant que les faits de l’affaire se sont déroulés en septembre 2003, lorsque la nouvelle disposition était déjà en vigueur, la Cour considère qu’en l’espèce le procureur aurait été seul compétent pour décider d’une procédure pénale, et que la méconnaissance de cette disposition a empêché d’établir les circonstances exactes dans lesquelles M. Izgi subit des mauvais traitements.
La Cour précise qu’elle n’est pas convaincue par les explications des autorités nationales quant au recours à la force employé par la police envers M. Izgi, et elle constate qu’aucune enquête n’a été menée par les juridictions nationales. Elle estime que la force employée qui a causé à M. Izgi des lésions et une souffrance était excessive, injustifiée et comparable à un traitement inhumain. La Cour a conclu donc à la violation de l’article 3.
GÜLET et ONGEL c Turquie
requêtes n°29612/05 et 30668/05 du 4 octobre 2011
Article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants)
La Cour observe qu’il n’est pas contesté que les lésions des requérants, attestées par des rapports médicaux, ont été infligées par la police pendant la dispersion de la manifestation. De plus, les juridictions nationales ont conclu que les requérants n’avaient pas fait partie des manifestants qui avaient attaqué la police et opposé une résistance.
En effet, d’après un enregistrement vidéo de l’incident, les manifestants avaient commencé à se disperser d’eux-mêmes et les policiers, dotés d’un équipement complet et déployés avant même la manifestation, étaient préparés à faire face à une telle situation. En outre, le Gouvernement n’a fourni aucune information montrant que l’intervention était adéquatement encadrée par des règles et organisée de manière à réduire autant que possible le risque de causer des blessures aux manifestants. Dès lors, la Cour conclut que, bien qu’un petit groupe de manifestants ait attaqué la police, la force ensuite employée contre les requérants, qui n’étaient même pas dans les rangs de ceux qui avaient résisté, n’était pas justifiée. En conséquence, les blessures des requérants sont le résultat d’un traitement inhumain et dégradant dont l’Etat porte la responsabilité, et il y a eu violation de l’article 3.
CÜNEYT POLAT c. TURQUIE du 13 novembre 2014 requête 32211/07
Le requérant a subi des coups de matraque et des lésions graves durant une manifestation. L'usage de la force par la police pour disperser une manifestation, n'est pas proportionnée.
28. Le Gouvernement fait observer tout d’abord que les blessures du requérant nécessitaient une intervention médicale simple. Il considère que, si le requérant avait été l’objet des mauvais traitements allégués, il aurait dû présenter des blessures plus graves.
29. Le Gouvernement indique ensuite ne pas contester l’existence des lésions indiquées dans les rapports médicaux des 4 et 5 septembre 2005. Il plaide cependant qu’il n’est pas certain que les blessures observées sur le corps de l’intéressé fussent consécutives à l’usage de la force lors de son arrestation. Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas fourni d’éléments ou d’indices de nature à établir « au-delà de tout doute raisonnable » qu’il a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des policiers lors de son arrestation.
30. Le requérant réitère ses allégations.
31. La Cour rappelle d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000‑XI, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001‑III, Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002‑IX, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006‑IX). La Cour réaffirme en outre que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, par exemple lors d’une arrestation, l’utilisation à son égard de la force physique excessive et injustifiée par rapport à son comportement constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (Çelik c. Turquie (no 3), no 36487/07, § 64, 15 novembre 2012).
32. La Cour rappelle de plus que, dans les circonstances où il est question de recours à la force rendu strictement nécessaire pour procéder à une arrestation, il convient de rechercher si cet usage de la force a été proportionné (Çelik, précité, § 65). À cet égard, elle rappelle attacher une importance particulière aux lésions ou séquelles qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été (R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004, et Gülizar Tuncer c. Turquie, no 23708/05, § 31, 21 septembre 2010).
33. En l’espèce, la Cour constate qu’il ressort des rapports médicaux établis les 4 et 5 septembre 2005, et qui ne sont pas contestés par le Gouvernement, que le requérant présentait des blessures (paragraphes 9 et 11 ci-dessus). À la lumière de ces constats, elle considère que les traitements dont le requérant a été victime tombent sous le coup de l’article 3 de la Convention.
34. La Cour relève que le requérant et le Gouvernement ont donné des versions divergentes sur la manière dont les blessures ont été occasionnées : le requérant se plaint de coups de matraque donnés par des policiers lors de son arrestation, et le Gouvernement soutient que les policiers n’ont pas eu recours à la force contre le requérant.
35. Aussi, la Cour rappelle que le critère à employer aux fins de la Convention est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume‑Uni, 18 janvier 1978, § 161, série A no 25).
36. En l’occurrence, la Cour note que le 4 septembre 2005, le requérant a participé à une manifestation à la fin de laquelle il a été arrêté par les forces de l’ordre. Elle observe de surcroît qu’il n’est pas contesté par les parties que la police est intervenue de manière musclée afin de disperser le groupe des manifestants. À la suite de son arrestation, les 4 et 5 septembre 2005, le requérant a été examiné par des spécialistes dont les rapports médicaux décrivent les blessures du requérant. Devant les spécialistes, le requérant a affirmé qu’il avait été blessé par des coups de matraque des policiers lors de son arrestation. À cet égard, la Cour relève que les propos du requérant sont cohérents avec ses blessures. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le requérant a produit des éléments suffisamment solides pour étayer sa version de l’incident. Il appartenait donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures constatées et de produire les preuves faisant selon lui peser un doute sur les allégations de la victime, ce qu’il a manqué de faire. Dès lors, les blessures constatées peuvent donc être considérées comme résultant de la force employée par les policiers au cours de la manifestation.
37. La Cour constate que rien n’indique dans les faits de l’espèce que le requérant ait fait preuve d’une agressivité telle qu’il n’eût pu être maîtrisé que par le recours à la force. Elle estime en outre que la dispersion d’un rassemblement ne saurait suffire en soi à expliquer la gravité de coups portés au visage ou à la tête de manifestants.
38. Eu égard aux constats qui précèdent ainsi qu’aux rapports médicaux présentés, la Cour estime que le recours à la force en cause a été excessif et qu’il n’a pas été rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant. Partant, la Cour conclut que la force utilisée dans la présente affaire était excessive et injustifiée.
39. Il s’ensuit qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
SI LE REQUÉRANT APPORTE SUFFISAMMENT D'ÉLÉMENTS
L'ÉTAT DOIT PORTER LE DOSSIER A LA CEDH
Razzakov c. Russie du 5 février 2015 requête no 57519/09
Violation article 3, la Cour confirme que l’indemnisation d’une victime de torture ne suffit pas s’il n’y a pas d’enquête effective. Un homme soupçonné d’avoir commis une infraction pénale affirmait que des policiers l’avaient torturé en garde à vue afin de lui faire avouer un meurtre.
Article 3
La Cour conclut à des violations de l’article 3 en raison tant des mauvais traitements subis par M. Razzakov en garde à vue que du défaut d’enquête effective.
Prenant acte de la reconnaissance par le gouvernement russe des mauvais traitements subis par M. Razzakov aux mains de la police en violation de l’article 3, la Cour juge établies les allégations formulées par ce dernier sur ce qui lui est arrivé du 26 au 28 avril 2009. Elle conclut que ce traitement s’analyse en actes de torture. Elle constate, en particulier, que M. Razzakov a été déshabillé, pendu dans des positions douloureuses et électrocuté, ce qui nécessitait une certaine préparation et le recours à des appareils spéciaux. M. Razzakov a subi ces sévices – visant à lui faire avouer un meurtre – pendant une longue durée, alors qu’il était illégalement privé de sa liberté et ne pouvait joindre un avocat. Son état de vulnérabilité complète était aggravé par le fait que, étranger, il connaissait mal la langue russe.
La Cour estime que le long délai de cinq mois pour ouvrir une procédure pénale ainsi que la manière dont l’enquête a été conduite montrent que les autorités n’ont pas pris de mesure raisonnable pour recueillir des preuves et n’ont pas sérieusement cherché à savoir ce qui s’était passé ni à poursuivre et punir les responsables. Les autorités ont donc manqué à leur obligation de conduire une enquête effective.
Pour ce qui est de la recevabilité des griefs soulevés par M. Razzakov, la Cour confirme qu’il peut toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 3 alors même que le Gouvernement a reconnu une violation et qu’il a été indemnisé pour ces mauvais traitements. Elle a déjà jugé qu’un mauvais traitement délibérément infligé par des agents de l’État, en violation de l’article 3, ne peut être réparé par la seule indemnisation. Les autorités devaient également mener une enquête complète et effective susceptible de conduire à l’identification et à la punition des responsables, ce qu’elles n’ont pas fait dans le cas de M. Razzakov.
AYRAPETYAN c. RUSSIE DU 16 SEPTEMBRE 2010 REQUÊTE N° 75472/01
Le requérant, Tigran Ayrapetyan, est un ressortissant russe né en 1983 et résidant à Moscou.
Il alléguait qu’à l’âge de 18 ans il avait subi de mauvais traitements en garde à vue et que ses plaintes à ce sujet n’avaient pas donné lieu à une enquête adéquate.
Soupçonné d’extorsion de fonds parce que la police l’avait vu recevant de l’argent d’un autre étudiant dans une cour d’école, il fut arrêté le 10 février 2001. Il affirme qu’on l’a conduit dans une cellule du poste de police, où on l’a battu à plusieurs reprises pour le faire passer aux aveux. Frappé à coups de pied au niveau de la poitrine et du visage, et sur le point de perdre connaissance, il signa tous les documents qu’on lui demandait de signer. Le même soir, il fut conduit aux urgences d’une polyclinique, où un médecin constata qu’il avait une fracture de la mâchoire et recommanda qu’il fût d’urgence examiné par un chirurgien en régime hospitalier. M. Ayrapetyan fut ensuite ramené en cellule de police, où l’on prit ses empreintes digitales. Il fut remis en liberté le 11 février vers 2 heures du matin.
Le même jour, il fut conduit dans un hôpital de la ville, où sa mâchoire, disloquée et brisée, fut opérée.
A une date non précisée, une procédure pénale fut engagée contre lui pour extorsion de fonds ; en décembre 2001, elle fut suspendue en application d’une loi d’amnistie adoptée en novembre par la Douma.
La mère du requérant se plaignit auprès de diverses autorités, notamment la police et le parquet, au sujet des mauvais traitements subis par son fils. En conséquence, une procédure pénale fut ouverte en mai 2001 et un examen médicolégal fut effectué. En juin 2001, il s’avéra que le dossier médical établi après la consultation du requérant à la polyclinique avait été perdu. En dépit de ses demandes spécifiques, le requérant ne reçut que des informations limitées sur les progrès de l’enquête et ne fut pas autorisé à voir le dossier. La procédure pénale fut close en octobre 2001, faute de preuves qu’une infraction avait été commise. Elle fut rouverte en juin 2002, à la suite de quoi un policier fut inculpé d’abus d’autorité. Elle s’acheva en fin de compte par la relaxe du policier, les tribunaux ayant jugé que les éléments de preuve étaient trop confus et contradictoires pour leur permettre de conclure avec certitude à la culpabilité de cette personne.
Article 3
Mauvais traitements
La Cour relève qu’il n’est pas contesté qu’un médecin a conclu dans la soirée du 10 février 2001 que M. Ayrapetyan avait une fracture de la mâchoire et avait besoin de soins en régime hospitalier. Elle observe par ailleurs que le gouvernement russe n’a pas fourni d’explications satisfaisantes et convaincantes quant à l’origine des blessures du requérant, et admet dès lors la version des faits soumise par ce dernier.
Étant donné que l’intéressé n’avait que 18 ans lorsqu’il a été sévèrement battu en détention, ce qui lui a causé d’importantes souffrances physiques et morales, la Cour conclut qu’il a été torturé par la police, en violation de l’article 3.
Enquête
La Cour observe que l’enquête n’a débuté que trois mois après la plainte de la mère du requérant. Les autorités n’ont donc pas réagi assez rapidement, ce qui a eu un effet négatif sérieux sur la qualité et l’effectivité de l’enquête. De plus, la Cour déplore la perte, par les autorités chargées de l’instruction, du dossier médical original établi par la polyclinique. Eu égard au démarrage tardif de l’enquête, le dossier médical constituait un élément de preuve crucial, dont la perte a gravement compromis la possibilité de procéder à une enquête adéquate sur la cause des blessures en question. Enfin, M. Ayrapetyan n’a eu qu’un accès limité aux informations sur les progrès de l’enquête et n’a pas pu participer à la procédure. La Cour conclut que les autorités chargées de l’instruction ont fait preuve de négligence et n’ont pas procédé à une enquête adéquate, au mépris de l’article 3.
Article 38
La Cour conclut également que le gouvernement russe n’a pas satisfait à son obligation de coopérer avec la Cour, car il n’a pas fourni copie des documents requis au sujet des faits survenus le 10 février 2001.
Satisfaction équitable (article 41)
La Cour dit que la Russie doit verser au requérant 35 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
ARRÊT SHISHKIN C. RUSSIE DU 7 JUILLET 2011 REQUÊTE 18280/04
LES FAITS
Le requérant est un ressortissant russe, né en 1963 et résidant à Lipetsk (Russie).
Deux procédures pénales distinctes furent ouvertes contre lui en novembre 2000 et janvier 2001 respectivement, l’une pour trois chefs de vol qualifié et un chef de vol, l’autre pour un chef d’homicide et un chef de vol. Arrêté le 23 janvier 2001, il fut informé qu’il était soupçonné d’homicide et de vol qualifié.
L’intéressé ayant nié toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés, il fut sévèrement battu pendant sa garde à vue. Des agents de police lui frappèrent la plante des pieds avec des matraques en caoutchouc, le suspendirent par les bras après lui avoir attaché les mains dans le dos, lui placèrent sur le visage un masque à gaz rempli de fumée dont ils avaient bouché l’arrivée d’air et lui infligèrent des décharges électriques sur diverses parties du corps. Ces mauvais traitements conduisirent le requérant à avouer les délits qui lui étaient reprochés et à renoncer à son droit d’obtenir l’assistance d’un avocat. Fin janvier 2001, ses proches engagèrent un avocat pour sa défense. Celui-ci essaya en vain de s’entretenir avec l’intéressé les 30 et 31 janvier, n’y parvenant que le 2 février 2001.
En février 2001, M. Shishkin se plaignit auprès du parquet que la police l’avait maltraité pour obtenir des aveux qu’il avait passés sous la contrainte. Au mois de mai de la même année, les poursuites dont il faisait l’objet pour homicide et vol qualifié furent abandonnées après que d’autres suspects eurent été condamnés pour les faits en question.
En mars 2001, l’intéressé adressa au parquet une plainte pour mauvais traitements de la part de la police. Les autorités refusèrent d’abord d’ouvrir des poursuites, mais par la suite, dix policiers furent mis en accusation et condamnés à des peines d’emprisonnement plus ou moins longues. Quatre d’entre eux bénéficièrent d’un sursis et furent immédiatement remis en liberté. Les six autres furent condamnés à des peines d’emprisonnement allant de deux ans et demi à trois ans et trois mois.
M. Shishkin obtint une indemnisation de 2 300 euros (EUR) en réparation des mauvais traitements à l’issue de la procédure civile qu’il avait engagée contre les agents mis en cause ainsi que les ministères de l’Intérieur et des Finances.
En juin 2002, l’intéressé fut conduit de force devant un tribunal pour y répondre des autres charges de vol qualifié et de vol retenues contre lui. Le procureur à qui il avait demandé de diligenter des poursuites sur ces agissements rejeta sa requête.
En avril 2003, le requérant fut reconnu coupable de vol qualifié ainsi que de vol et condamné à six ans d’emprisonnement. Pour se prononcer ainsi, les juridictions internes s’appuyèrent notamment sur les déclarations formulées par l’intéressé pendant l’enquête préliminaire bien que celui-ci ait affirmé qu’elles lui avaient été extorquées.
L’intéressé se plaignit en outre des conditions dans lesquelles il avait été détenu avant sa condamnation, en vain. Selon lui, sa cellule, infestée de souris et de rats, était équipée de toilettes que rien ne séparait du reste de l’espace, était mal ventilée et l’éclairage y était insuffisant.
Torture par la police (article 3)
La Cour relève que les juridictions russes ont reconnu que l’intéressé avait été maltraité à plusieurs reprises. Compte tenu du fait que ces mauvais traitements ont été infligés au requérant dans le but de lui faire avouer un délit qu’il n’avait pas commis et de la violence et de la cruauté auxquelles l’intéressé a été exposé, la Cour conclut que celui-ci a été torturé.
La Cour rappelle que les juridictions ont condamné plusieurs agents de police pour torture et accordé au requérant une réparation à cet égard. Toutefois, elle estime que, faute de constituer une réparation suffisante pour les souffrances causées au requérant, l’enquête sur les tortures subies par l’intéressé et l’indemnisation dont il a bénéficié ne l’ont pas privé de la qualité de victime.
A cet égard, la Cour relève que l’enquête n’a été ouverte que plusieurs mois après les événements, qu’elle a été lente et émaillée de mesures hasardeuses. Les policiers reconnus coupables de mauvais traitements sur la personne de l’intéressé n’ont été condamnés que sept ans après les faits et se sont vu infliger des peines relativement clémentes, inférieures au minimum prévu par la loi. Certaines d’entre elles ont même été assorties d’un sursis.
En ce qui concerne la réparation accordée à l’intéressé, la Cour rappelle qu’il n’existe pas de règle permettant d’évaluer en termes financiers la souffrance et le désarroi.
Toutefois, elle relève que l’indemnité de 2 300 € allouée au requérant en réparation des souffrances prolongées dues à la torture est sensiblement inférieure aux sommes allouées par elle dans des affaires comparables dirigées contre la Russie.
En conséquence, il y a eu violation de l’article 3 en raison des mauvais traitements infligés au requérant par la police et à l’absence d’enquête effective sur ces faits.
Mauvais traitements infligés par les agents d’escorte (article 3)
L’emploi de la force physique en juin 2002 contre le requérant lors de son escorte vers le tribunal ne prête pas à controverse entre les parties. La Cour relève qu’une enquête a rapidement été ouverte sur ces faits et qu’elle s’est achevée dans des délais assez courts. Toutefois, cette enquête a connu de graves lacunes. Les enquêteurs n’ont pas pu reconstituer le déroulement exact des faits et n’ont pas signalé les contradictions émaillant les dépositions des différents témoins. Le parquet n’a pas suffisamment motivé sa décision de classement sans suite et ne s’est pas posé la question de savoir si les circonstances justifiaient l’emploi de la force et si celle-ci était proportionnée à la résistance prétendument opposée par le requérant. En conséquence, il y a eu violation de l’article 3 en raison de l’absence d’enquête effective sur les allégations de l’intéressé.
Cela étant, la version des faits donnée par le requérant n’a été que partiellement corroborée par les témoins ayant déposé. En l’absence de dossier médical et d’autres preuves, la Cour ne saurait dire que l’intéressé a subi des mauvais traitements contraires à l’article 3.
Conditions de détention (article 3)
Le Gouvernement et M. Shishkin s’opposent sur les conditions dans lesquelles il a été détenu. Le requérant n’ayant fourni aucune preuve à l’appui de ses allégations, son grief doit être rejeté.
Absence d’un avocat (article 6 § 3 c))
Le Gouvernement ne conteste pas que M. Shishkin avait demandé l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue et qu’il n’a pu en rencontrer un que dix jours après son arrestation. Eu égard à l’importance que revêt pour un suspect la présence d’un avocat dès son arrestation, la Cour estime inacceptable que l’intéressé se soit vu refuser une assistance juridique au cours de la garde à vue où il a été interrogé et torturé. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 3 c).
Aveux extorqués (article 6 § 1)
La Cour rappelle que l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par des moyens jugés contraires à la Convention dans le cadre d’une procédure pénale suscite toujours de graves questions quant à l’équité de celle-ci.
Même s’il n’est pas certain que M. Shishkin ait formulé des déclarations qui l’incriminaient lui-même en ce qui concerne les chefs de vol qualifié pour lesquels il a été condamné, le simple fait qu’il n’ait pu bénéficier de l’assistance d’un avocat et qu’il ait été torturé au cours d’un interrogatoire mené dans le cadre d’une seconde procédure où il était accusé d’homicide et de vol qualifié a entaché la première. En conséquence, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
LA GARDE A VUE D'UN MINEUR SANS ADULTE
EST UN ACTE INHUMAIN ET DÉGRADANT
LA CEDH CONDAMNE D'ABORD LES VIOLENCES SUBIES PAR LES MINEURS POUR REMETTRE EN CAUSE LA GARDE A VUE D'UN MINEUR SANS ASSISTANCE.
DARRAJ C. FRANCE DU 4 novembre 2010 REQUÊTE 34588/07
La force déployée à l’encontre d’un mineur lors d’une vérification d’identité au commissariat était disproportionnée
Les blessures du requérant, occasionnées par les violences qui l’ont opposé aux policiers, sont survenues au commissariat, lors d’un contrôle d’identité, alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police et qu’il était menotté et donc vulnérable. Les coups portés ont provoqué, en plus de contusions et d’hématomes, une fracture testiculaire, entraînant une hospitalisation, une intervention en urgence et une ITT de 21 jours. De telles lésions, à l’origine de douleurs et de souffrances physiques chez le requérant, ont atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
Les raisons justifiant les menottes imposées à Yassine Darraj, calme jusqu’à l’arrivée au commissariat et qui n’était pas placé en garde à vue, restent obscures. Cinq policiers ont dû intervenir pour le maîtriser, en le faisant tomber ventre à terre et en mettant un genou dans son dos pour lui passer les menottes. La Cour prend en considération l’avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité selon lequel le port des menottes pouvait difficilement se justifier à l’arrivée au commissariat. La Cour note que les expertises se contredisent et ne peut que constater que le requérant a été atteint d’une blessure grave, restée sans explication claire, dans l’enceinte d’un local de police alors que des fonctionnaires en avaient la responsabilité et devait assurer sa protection.
La Cour relève que le requérant, de corpulence moyenne, était menotté dans le dos et se trouvait seul face à au moins deux policiers de plus forte corpulence, que le tribunal a considéré que les violences allaient au-delà de l’usage raisonné de la force dans de telles circonstance, et que la cour d’appel a reconnu que la fracture testiculaire ne résultait pas de la seule force majeure. D’autres méthodes auraient pu être employées pour calmer le requérant.
Ainsi ces actes étaient de nature à engendrer chez le requérant des douleurs ou des souffrances physiques et mentales et, eu égard à son âge et à son stress post-traumatique, à créer également des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale. Ils ont ainsi revêtu un caractère inhumain et dégradant.
Le gouvernement français allègue, qu’au terme des procédures nationales, Yassine Darraj a perdu la qualité de victime. La Cour note qu’aucune lacune quant à l’enquête menée par les juridictions internes n’est à relever. En revanche, on ne peut dire que la cour d’appel ait reconnu que le traitement subi par le requérant était contraire à l’article 3, puisqu’elle a révisé à la baisse la peine des policiers, dont elle a évoqué la « maladresse et l’imprudence ». Enfin, la Cour observe que les policiers n’ont pas fait l’objet de sanctions disciplinaires et ont été condamnés à des amendes contraventionnelles modiques, ayant un faible pouvoir dissuasif, et étant inférieures aux sommes qu’elle octroie généralement dans des affaires où elle constate une violation de l’article 3. A cet égard, si la Cour reconnaît qu’il revient aux juridictions nationales de choisir les sanctions à infliger à des agents de l’Etat, elle doit intervenir s’il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée, à défaut de quoi le devoir des Etats de mener une enquête effective perdrait beaucoup de son sens.
Ainsi le requérant peut toujours se prétendre victime et la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3.
ARRÊT DE LA CEDH
a) Quant aux mauvais traitements allégués
i. Principes pertinents
34. La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni, précité, § 95).
35. La Cour rappelle également qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336, et Tekin c. Turquie, 9 juin 1998, §§ 52-53, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV).
36. La Cour a souligné que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (Tomasi c. France, 27 août 1992, §§ 108-111, série A no 241-A ; Ribitsch, précité, § 31, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001). Quelle que soit l’issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l’Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention ; c’est à lui qu’il appartient de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 trouve à s’appliquer (Selmouni, précité, § 87 ; Büyükdag c. Turquie, no 28340/95, § 51, 21 décembre 2000, et Berktay, précité, § 168).
37. En cas d’allégations sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour doit se livrer à un examen particulièrement approfondi (Vladimir Romanov, précité, § 59). Lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre toutefois pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des choses à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Jasar c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 69908/01, § 49, 15 février 2007). Même si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins des éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles ils sont parvenus.
ii. Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
38. Il est admis que les blessures du requérant sont survenues au commissariat, lors d’un contrôle d’identité, alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police, qu’il était menotté et donc vulnérable. Il est également établi que les blessures ont été occasionnées par les violences qui l’ont opposé aux policiers. La Cour relève que les coups portés ont provoqué une fracture testiculaire, entraînant une hospitalisation et une intervention en urgence, et occasionnant une ITT fixée à vingt et un jours. Outre la fracture testiculaire, le médecin qui examina le requérant à sa sortie du commissariat constata des contusions du globe oculaire droit, du poignet et du dos, de multiples érosions cutanées du visage et du cou, et de multiples hématomes du cuir chevelu.
Il ne peut être contesté que les lésions subies par le requérant qui ont provoqué douleurs et souffrances physiques ont atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (Rivas, précité, § 39).
39. Dès lors, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l’espèce, proportionnée. La Cour tient pour révélateur que le Gouvernement admette lui-même que la force utilisée par les policiers était disproportionnée. Elle s’interroge néanmoins sur la pertinence de son argument selon lequel la force utilisée était « disproportionnée mais nécessaire ».
40. La Cour relève que le requérant était mineur au moment des faits et n’était pas connu des services de police. Elle constate que la conduite du requérant au commissariat, fondée sur une vérification d’identité, s’est effectuée sans heurt. Elle observe que c’est à partir du moment où les policiers ont tenté de menotter le requérant que celui-ci s’est montré agressif.
41. La Cour s’interroge sur l’opportunité de faire usage des menottes dans un tel cas. La Cour a estimé que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’espèce. A cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil 1997-VIII).
En l’espèce, la Cour relève que les raisons justifiant le menottage du requérant restent obscures, celui-ci n’ayant pas été placé en garde à vue. Cinq policiers ont dû intervenir pour maîtriser le requérant qui refusait de se laisser menotter, en le faisant tomber à terre, sur le ventre, et en mettant un genou dans le dos pour lui passer les menottes. Elle prend en considération l’avis rendu par la Commission nationale de déontologie de la sécurité le 23 mai 2002, laquelle a estimé que le port des menottes, qui n’avait pas été jugé nécessaire pendant le transfert au commissariat, pouvait difficilement se justifier à l’arrivée au commissariat (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour émet ainsi de sérieux doutes quant à la nécessité de menotter le requérant, celui-ci ne s’étant montré ni agressif, ni dangereux, ni même agité avant le menottage (voir, mutatis mutandis, Nita c. Roumanie, no 24202/07, §§ 34 et 38, 26 janvier 2010).
42. Par la suite, bien que menotté dans le dos, le requérant a été conduit par les policiers dans un couloir en direction de la cellule de dégrisement, ce qui aurait déclenché les violences. La Cour note que les versions des parties divergent quant à l’élément provocateur de la fracture (coup de genou porté par les policiers, choc avec le genou d’un policier lors de coups de pied donnés en arrière par le requérant, chute du requérant contre le robinet de la fontaine, etc.). De même, elle observe que les expertises sont contradictoires quant à l’origine de la fracture testiculaire. En tout état de cause, et à l’instar des juridictions internes, la Cour ne peut que constater que le requérant a été atteint d’une blessure grave dans l’enceinte d’un local de police alors que des fonctionnaires en avaient la responsabilité et devait assurer sa protection. Cette blessure grave est restée sans explication claire quant à son origine.
43. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel l’emploi de la force à l’encontre du requérant a été rendu nécessaire par son comportement. Elle relève que le requérant, de corpulence moyenne, était menotté dans le dos et se trouvait seul face à au moins deux policiers de plus forte corpulence. Elle relève également que le tribunal a considéré que les violences allaient au-delà de l’usage raisonné de la force que requérait l’état d’un mineur conduit dans un poste de police pour vérifications et ayant refusé de se laisser menotter (paragraphe 19 ci-dessus). Enfin, la cour d’appel a reconnu que la fracture testiculaire ne résultait pas de la seule force majeure.
Si l’agitation du requérant pouvait conduire les fonctionnaires à exercer une forme de contrainte pour éviter d’éventuels débordements, la Cour estime qu’il n’existait aucun risque sérieux et imminent pouvant justifier l’emploi d’une telle force par les policiers. A tout le moins, dans de telles circonstances, les fonctionnaires de police auraient pu employer d’autres méthodes pour calmer le requérant (voir, dans le même sens, Rivas, précité, § 41). En conclusion, elle estime que le Gouvernement n’a pas démontré, dans les circonstances de l’espèce, que l’usage de la force contre le requérant était proportionnée et nécessaire (voir, a contrario, Caloc c. France, no 33951/96, §§ 100-101, CEDH 2000-IX).
44. La Cour considère dès lors que les actes dénoncés étaient de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez le requérant et, compte tenu de son âge et du stress post-traumatique constaté, à créer également des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale. Ce sont ces éléments qui amènent la Cour à considérer que les traitements exercés sur la personne du requérant ont revêtu un caractère inhumain et dégradant.
b) Quant à la question de la perte de qualité de victime
45. Afin de déterminer si le requérant a perdu la qualité de victime, la Cour se réfère aux principes énoncés par l’arrêt Gäfgen c. Allemagne, précité, (§§ 115 à 119).
46. En premier lieu, la Cour se doit de rechercher si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Elle observe que les fonctionnaires de police ont été condamnés à quatre et huit mois d’emprisonnement avec sursis en première instance, peine révisée en appel à une amende contraventionnelle de 800 EUR chacun. Le tribunal de grande instance a estimé que les fonctionnaires avaient exercé des violences volontaires sur le requérant, celles-ci ayant excédé l’emploi légitime de la force nécessairement inhérente à l’exercice des fonctions de police. La cour d’appel a quant à elle considéré que les blessures occasionnées au requérant par les deux fonctionnaires de police, au cours de leur confrontation physique avec celui-ci, ont été causées, par « maladresse et imprudence » (paragraphe 20 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour n’est pas convaincue que la cour d’appel a reconnu que le traitement subi par le requérant était contraire à l’article 3 de la Convention, même si l’octroi d’indemnités au requérant et la condamnation pénale des policiers pourrait s’apparenter à une reconnaissance de violation de l’article 3 (voir, mutatis mutandis, Vladimir Romanov, précité, § 75).
47. En second lieu, pour dire si les autorités nationales ont de surcroît accordé au requérant une réparation adéquate et suffisante pour la violation de l’article 3, la Cour doit déterminer si elles ont mené contre les responsables une enquête approfondie et effective conformément aux exigences qu’elle pose dans sa jurisprudence (Gäfgen, précité, § 121).
A cet égard, la Cour constate que l’inspection générale des services de la préfecture de police fut saisie par le parquet de Nanterre le 11 juillet 2001, c’est-à-dire le lendemain des mauvais traitements subis par le requérant. Le 20 juillet 2001, une information fut ouverte du chef de violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Deux expertises furent menées, avec reconstitution des faits, et les témoins furent entendus. La Cour ne constate aucune lacune quant aux diligences menées dans le cadre de l’enquête par les juridictions internes.
48. En outre, l’issue de l’enquête et des poursuites pénales qu’elle déclenche, y compris la sanction prononcée ainsi que les mesures disciplinaires prises, passent pour déterminantes. Elles sont essentielles si l’on veut préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est tenu d’exercer dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais traitements (Ali et Ayşe Duran c. Turquie, no 42942/02, § 62, 8 avril 2008 ; Çamdereli c. Turquie, no 28433/02, § 38, 17 juillet 2008, et Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03, §§ 60 et suiv., 20 décembre 2007).
La Cour observe que les fonctionnaires de police ont été condamnés à des amendes contraventionnelles modiques. Elle rappelle à ce propos qu’il ne lui incombe pas de se prononcer sur le degré de culpabilité de la personne en cause (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII), ou de déterminer la peine à infliger, ces matières relevant de la compétence exclusive des tribunaux répressifs internes. Toutefois, en vertu de l’article 19 de la Convention et conformément au principe voulant que la Convention garantisse des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour doit s’assurer que l’Etat s’acquitte comme il se doit de l’obligation qui lui est faite de protéger les droits des personnes relevant de sa juridiction (Nikolova et Velitchkova, précité, § 61, avec d’autres références). Dès lors, si la Cour reconnaît le rôle des cours et tribunaux nationaux dans le choix des sanctions à infliger à des agents de l’Etat en cas de mauvais traitements infligés par eux, elle doit conserver sa fonction de contrôle et intervenir dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée. Sinon, le devoir qu’ont les Etats de mener une enquête effective perdrait beaucoup de son sens (Nikolova et Velitchkova, précité, § 62 ; Ali et Ayşe Duran, précité, § 66).
49. La Cour ne perd pas de vue que, lorsqu’elle a fixé les peines de G. et de D., la cour d’appel de Versailles a pris en compte l’agressivité du requérant. Elle admet que la présente requête n’est pas comparable à d’autres affaires concernant des actes de brutalité graves et arbitraires commis par des agents de l’Etat qui ont par la suite tenté de les dissimuler, et dans lesquelles elle a estimé que des peines d’emprisonnement fermes auraient été plus appropriées (comparer, par exemple, Nikolova et Velitchkova, précité, § 63, et Ali et Ayşe Duran, précité, §§ 67-72). Néanmoins, une condamnation à des amendes contraventionnelles de 800 EUR ne saurait être tenue pour une réaction adéquate à une violation de l’article 3, même si on la situe dans la pratique de l’Etat défendeur en matière de condamnation. Pareille sanction, manifestement disproportionnée à une violation de l’un des droits essentiels de la Convention, n’a pas l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d’autres transgressions de l’interdiction des mauvais traitements dans des situations difficiles qui pourraient se présenter à l’avenir (voir, Gäfgen, précité, § 124). Elle constate par ailleurs qu’aucune sanction disciplinaire n’a été infligée aux fonctionnaires de police.
50. Quant à la condition supplémentaire d’une réparation pour que la violation de l’article 3 soit redressée au niveau national, la Cour relève que si le préjudice du requérant a été évalué à 10 000 EUR, son droit à indemnisation a été réduit à 5 000 EUR pour avoir participé pour moitié à la réalisation de son préjudice. Elle rappelle que dans des circonstances similaires, la Cour avait alloué à un requérant la somme de 15 000 EUR (Rivas, précité, § 46). Dès lors, elle considère que la somme allouée au requérant en réparation du préjudice subi est inférieure au montant généralement octroyé par la Cour dans des affaires où elle a conclu à une violation de l’article 3 de la Convention. L’Etat défendeur n’a donc pas suffisamment redressé le traitement contraire à l’article 3 que le requérant avait subi.
51. Il s’ensuit que le requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 3 au sens de l’article 34 de la Convention. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement liée à la perte de qualité de victime.
c) Conclusion
52. La Cour renvoie au constat auquel elle a abouti plus haut (paragraphes 38 à 44), à savoir qu’après avoir conduit le requérant au commissariat pour une vérification d’identité, les fonctionnaires de police ont fait usage d’une force disproportionnée sur sa personne, laquelle n’avait pas été rendue nécessaire par le comportement de celui-ci.
53. Dès lors, il y eu violation de l’article 3 de la Convention.
CİĞERHUN ÖNER C. TURQUIE DU 23 novembre 2010 REQUÊTE 2858/07
Un enfant de 12 ans frappé par la police est une violation de l'article 3 mais la Turquie est aussi condamnée pour manque d'enquête effective.
96. Le Gouvernement expose que le parquet a ouvert une enquête à la suite de la plainte pénale déposée par le requérant, qu'une action pénale a été déclenchée contre les policiers concernés, que ceux-ci ont été condamnés en première instance et que l'action est pendante devant la Cour de cassation. Il indique que le policier I.Y. a été chargé par la direction de la sûreté de mener une enquête au sujet de la plainte du requérant, et que, dans le cadre de cette enquête administrative, les policiers G.Ö. et M.Z. ainsi que différents témoins ont été entendus. Il ajoute que, selon la conclusion du rapport du policier I.Y., il n'y avait pas lieu de prononcer de sanction disciplinaire à l'encontre des deux policiers et que, à la lumière de ce rapport, la préfecture d'İzmir a décidé, le 4 octobre 2002, de ne pas prendre de sanction administrative à leur encontre.
97. Le requérant précise que plus de huit années se sont écoulées depuis les faits, survenus le 7 octobre 2001. Il indique que le tribunal correctionnel qui a condamné le policier M.Z. a prononcé un sursis à l'exécution de la peine en accordant à celui-ci les circonstances atténuantes. Aux yeux du requérant, cela équivaut à une absence de condamnation. Se référant à l'affaire Okkalı (précité), l'intéressé ajoute que le délai de prescription de sept ans et six mois prévue à l'article 102 § 4 de l'ancien code pénal se trouve atteint. Au vu des peines prononcées contre les policiers, il dénonce un manque d'impartialité des juges. A cet égard, il se plaint en outre de l'absence d'une voie de recours interne effective.
98. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil, 1998-VIII, et Ay c. Turquie, no 30951/96, § 59-60, 22 mars 2005). En ce qui concerne l'obligation pour les autorités nationales d'ouvrir et de mener une enquête effective, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence dans les arrêts Khachiev et Akaïeva c. Russie (nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005), Menecheva, précité, § 67, CEDH 2006-...), Batı et autres, précité, §§ 134-137, et Abdülsamet Yaman c. Turquie (no 32446/96, § 54, 2 novembre 2004).
99. La Cour relève d'emblée que, à la suite de la plainte déposée par le requérant, une procédure pénale a été ouverte contre les policiers et qu'elle est pendante devant les juridictions nationales depuis plus de huit ans. Il est vrai que la lenteur de l'action pénale engagée contre les policiers ne fera pas, à ce stade de la procédure, bénéficier ces derniers de la prescription. Néanmoins, la Cour rappelle avoir déjà jugé, dans des circonstances similaires à celles de l'espèce, que les autorités nationales devaient prendre toutes les mesures positives nécessaires pour agir avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs de traitements contraires à l'article 3 ne jouissent pas d'une quasi-impunité, nonobstant l'existence de preuves irréfutables à leur encontre (Batı et autres, précité, § 146, et, mutatis mutandis, Selmouni, précité, §§ 78-79).
100. Ensuite, la Cour note que cette action s'est conclue par un jugement de condamnation assorti d'un sursis à l'exécution de la peine. Elle n'est pas convaincue que la gravité des faits reprochés aux accusés, en leur qualité de policiers, a été appréciée à sa juste mesure. Il est vrai que l'un des policiers a été acquitté alors que l'autre a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et quinze jours et à son exclusion de la fonction publique pour une durée de deux mois et quinze jours. Cela étant, la Cour observe que le policier condamné a bénéficié de circonstances atténuantes compte tenu de son comportement exemplaire au procès, alors même qu'il n'a pas assisté à toutes les audiences et qu'il y a été emmené par la contrainte, puis qu'il a bénéficié d'un sursis à l'exécution de sa peine. Aux yeux de la Cour, les dispositions législatives et répressives du droit national ont été utilisées en fait pour éviter toute condamnation effective du policier ainsi poursuivi au pénal. Or l'objet de telles dispositions est de permettre une protection véritable des personnes, en particulier lors de la garde à vue – période au cours de laquelle, en l'espèce, le requérant, âgé alors de douze ans, avait été placé sous le seul contrôle des policiers – et d'inclure des mesures efficaces pour sanctionner et empêcher des mauvais traitements par les agents de l'Etat (Zeynep Özcan c. Turquie, no 45906/99, § 43, 20 février 2007, et Abdülsamet Yaman, précité, § 55).
101. Enfin, la Cour relève qu'une enquête disciplinaire a été ouverte contre les policiers. Selon le rapport rendu par les supérieurs hiérarchiques des policiers, il n'y avait pas lieu de prononcer de sanction disciplinaire à l'encontre des policiers en cause. Le rapport constatait, d'une part, qu'il n'existait pas de trace de la garde à vue du requérant dans le registre des gardes à vue du commissariat concerné et, d'autre part, que les allégations du requérant n'était pas fondées sur des éléments de preuve convaincants. Dans ce contexte, la Cour rappelle que le manque de rigueur dans l'application du système pénal et disciplinaire – comme en l'espèce – n'est pas de nature à dissuader les forces de l'ordre de commettre des actes illégaux tels que ceux dénoncés par le requérant. En effet, lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est accusé d'actes contraires à l'article 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par exemple par une prescription ; et l'application de mesures telles que l'amnistie, la grâce ou le sursis à l'exécution de la peine ne saurait être autorisée (voir, en ce sens, Zeynep Özcan, précité, § 45, Okkalı, précité, §§ 76 et 78, et, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman, précité, § 55).
102. Dans ces conditions, les manquements qui viennent d'être soulignés quant à l'absence de promptitude et de diligence ainsi que le sursis à l'exécution qui a été prononcé contre le policier inculpé et qui a eu pour conséquence d'accorder une quasi-impunité à l'auteur présumé de tels faits ont rendu le recours pénal ineffectif. En conséquence, dans les circonstances particulières de l'espèce, la Cour estime que le recours introduit devant le tribunal correctionnel d'Izmir n'était pas normalement disponible et suffisant pour permettre au requérant d'obtenir réparation des violations qu'il allègue (voir, mutatis mutandis, Selmouni c. France, précité, § 81). Il s'ensuit qu'il convient donc de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard.
103. Partant, la Cour estime qu'il y a eu violation des exigences procédurales de l'article 3 de la Convention.
Yazgül Yilmaz c. TURQUIE DU 1er février 2011 REQUÊTE 36369/06
L’examen gynécologique pratiqué sur une mineure seule en garde à vue était un traitement dégradant
Les examens
La requérante a été détenue pendant deux jours dans les locaux de la direction de la sûreté, sans que ses parents ou son représentant légal aient été prévenus. Rien n’indique non plus que les autorités aient cherché à obtenir le consentement de la requérante ou de son représentant légal concernant l’examen gynécologique. Mlle Yılmaz a déclaré devant le parquet ne l’avoir jamais donné.
Selon la Cour, l’obtention du consentement d’une mineure aurait dû être entourée d’un minimum de garanties correspondant à l’importance d’un examen gynécologique. A l’époque, un vide juridique caractérisait l’examen gynécologique des femmes détenues, qui était pratiqué sans aucune garantie contre l’arbitraire. Or, contrairement aux autres examens médicaux, un examen gynécologique peut constituer être traumatisant, d’autant plus pour une personne mineure, qui doit bénéficier de garanties et précautions supplémentaires (par exemple recueillir le consentement à toutes les étapes, offrir le
choix d’un accompagnant, d’être examinée par un médecin homme ou femme, informer du motif de l’examen, de son déroulement et des résultats ainsi que respecter la pudeur).
La Cour ne peut être d’accord avec une pratique généralisée consistant à soumettre automatiquement des femmes détenues à un examen gynécologique, dans le but d’éviter de fausses accusations de violences sexuelles contre les membres des forces de l’ordre. Cette pratique ne tient aucunement compte des intérêts des femmes détenues et ne se réfère à aucune nécessité médicale. A cet égard d’ailleurs, Mlle Yılmaz ne s’était jamais plainte d’un viol lors de sa garde à vue – elle a allégué des faits de harcèlement sexuel, qui ne pouvaient en aucun cas être réfutés par un examen d’hymen. La Cour constate avec intérêt que le nouveau code de procédure pénale règlemente pour la première fois les examens internes du corps, y compris gynécologiques, même s’il n’existe aucune mesure spécifique pour les mineures.
En outre, le rapport du 13 octobre 2004 indiquait que les certificats médicaux n’étaient pas conformes aux critères d’évaluation médicale prévus dans les circulaires adoptées par le ministère de la Santé et dans le Protocole d’Istanbul et que les allégations de violences subies par la requérante en garde à vue étaient largement corroborées par les examens médicaux, ce qui va dans le sens des affirmations de la requérante sur la superficialité de ces examens médicaux pratiqués en garde à vue.
Ainsi, le manque de garanties fondamentales lors de sa garde à vue – aucune mesure n’a été prise pour la protéger lors de cette privation de liberté – a placé Mlle Yılmaz dans un état de profond désarroi. L’extrême angoisse que lui a nécessairement causé cet examen, ce que les autorités ne pouvaient ignorer étant donné son âge et le fait qu’elle était non-accompagnée, permet de qualifier cet examen en l’espèce de traitement dégradant.
L’enquête
Suite à la plainte de la requérante, c’est le directeur adjoint de la santé qui a été chargé de l’affaire, alors que celui ci dépendait de la même hiérarchie que les médecins sur lesquels il menait son enquête. La Cour rappelle avoir déjà émis de sérieux doutes quant à la capacité des organes administratifs concernés de mener une enquête indépendante. Une décision de non-lieu ayant été prononcée, suite à la conclusion du directeur adjoint de la santé, selon laquelle les médecins devaient bénéficier de la prescription, aucune enquête pénale n’a pu être conduite. Par ailleurs, le rapport concluant à la responsabilité des médecins n’a pas été communiqué à la requérante et les médecins ont donc bénéficié de la prescription sans aucun constat de leur éventuelle responsabilité.
Ainsi, les carences de l’enquête ont eu pour conséquence d’accorder une quasi-impunité aux auteurs présumés des actes incriminés et ont rendu la voie pénale inefficace – ainsi que les recours civils en vue d’une indemnisation.
ARRÊT DUSHKA c. UKRAINE DU 3 février 2011 REQUÊTE 29175/04
La détention illégale et l’interrogatoire d’un mineur de 17 ans en l’absence d’un avocat et de ses parents constituait un traitement inhumain et dégradant (l'affaire Patrick Dils n'est plus possible en Europe sans violation de l'article 3)
Mauvais traitements
La Cour estime que les déclarations de M. Dushka sur la cause de ses blessures, c’est-à-dire des mauvais traitements infligés par la police pendant son interrogatoire, étaient suffisamment détaillées et sont corroborées par les rapports médicaux de novembre 2002 et janvier 2005. Par ailleurs, le Gouvernement n’a donné aucune autre version des faits cohérente et étayée, malgré plusieurs années d’enquête. Partant, la Cour conclut que l’Etat doit répondre des blessures subies par M. Dushka en conséquence des mauvais traitements infligés à celui-ci.
En réalité, que la police ait eu recours à la violence physique ou non, l’arrestation de M. Dushka dans des circonstances ambiguës, ainsi que sa détention administrative déclarée par la suite illégale par les autorités judiciaires internes, donnent fortement à croire que la police avait arrêté M. Dushka et l’avait mis en détention dans le but de briser sa résistance morale et de lui extorquer des aveux. L’obtention de ces aveux dans un cadre dépourvu de garanties procédurales telles que la présence d’un avocat et leur rétractation dès la libération de l’intéressé amènent à conclure qu’ils n’ont pas été formulés librement.
Eu égard en particulier à la vulnérabilité de M. Dushka du fait de son âge, la Cour estime que cette pratique s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3.
Enquête
La Cour relève que, bien que M. Dushka ait informé rapidement les autorités des mauvais traitements qu’il prétendait avoir subis, l’enquête a duré plus de trois ans et n’a pas permis d’établir ce qui lui était arrivé lors de son arrestation et de sa garde à vue, ou d’identifier les responsables de ses blessures.
Il y a eu de nombreuses décisions administratives ou judiciaires de renvoi pour complément d’enquête, qui énonçaient que l’enquête était lacunaire et partiale. Toutefois, les autorités de poursuite se sont contentées de répondre à chaque fois par la même conclusion (manque de preuves) pour justifier leur refus de poursuivre la procédure. Malgré des instructions particulières émises par les tribunaux et les autorités de poursuite supérieures, l’enquête n’a donc pas répondu aux allégations de M. Dushka en permettant par exemple de dégager une explication plausible à l’origine de ses blessures ou une réponse étayée concernant la légalité de son arrestation et de sa détention, ainsi que de son interrogatoire mené au mépris des garanties procédurales requises (absence d’un avocat ou des parents de l’intéressé).
La Cour rappelle qu’elle a récemment été saisie de plusieurs affaires dirigées contre l’Ukraine, dans lesquelles elle a constaté une violation de l’article 3 du fait de l’absence d’enquête effective sur des allégations de mauvais traitements. Relevant que l’affaire de M. Dushka est similaire à ces affaires, elle conclut à une autre violation de l’article 3 à raison du défaut d’enquête effective sur les mauvais traitements qui, selon M. Dushka, lui avaient été infligés par des policiers.
Eu égard à cette conclusion, la Cour juge inutile d’examiner le grief de M. Dushka relatif à l’effectivité de l’enquête sous l’angle de l’article 13.
La Cour dit que l’Ukraine doit verser à la succession de M. Dushka une somme de 18 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 150 EUR à la mère de l’intéressé pour frais et dépens.
L'ABSENCE DE SOINS MEDICAUX DURANT LA GARDE A VUE
Arrêt MS contre Royaume Uni du 3 mai 2012 requête 24527/08
Le maintien en garde à vue d’un aliéné en l’absence de soins médicaux adéquats est contraire à la Convention
La justification de l'arrestation initiale de M.S. ne fait aucun doute car, vu son état d’agitation extrême, il constituait un danger pour le public et pour lui-même. Son placement initial en garde à vue était autorisé par le droit britannique. Ni l'une ni l'autre des parties ne conteste que la police et les services de santé n'avaient pas eu l'intention de traiter M.S. d'une manière incompatible avec l'article 3, et les registres de détention produits devant la Cour montrent bien qu'on cherchait réellement à l’hospitaliser.
La Cour ne peut accepter les griefs tirés par M.S. de la réaction du personnel médical de la clinique. Les pièces produites par le gouvernement britannique montrent que, au lieu de rester inactif, le consultant en médecine légale de cet établissement était disposé à examiner puis à accueillir M.S. une fois les dispositions prises en matière de personnel.
La Cour rejette en outre le grief tiré par M.S. de ce qu'il n'aurait pas été convenablement alimenté en nourriture et en eau, aucune négligence ne ressortant des documents de la police.
Il reste cependant que, tout au long de sa garde à vue au commissariat, M.S. se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité. Comme l'ont indiqué tous les professionnels de la santé qui l'avaient examiné, il fallait absolument lui prodiguer des soins psychiatriques. Cette situation, qui a persisté jusqu'à son transfert à la clinique le quatrième jour de sa garde à vue, a excessivement nui à sa dignité fondamentale en tant qu'être humain. Pendant cette période, il s'est entièrement retrouvé entre les mains de l'État et les autorités répondaient donc du traitement subi par lui. À ce sujet, la Cour cite un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants de 2008, dans lequel cet organe s’est dit préoccupé par le fait que certaines personnes en garde à vue au Royaume-Uni ne recevaient pas toujours les soins psychiatriques nécessaires. De plus, dans le cas de M.S., le délai maximal de garde à vue n'a pas été respecté.
La Cour reconnaît que la situation était essentiellement née de problèmes de coordination entre les autorités compétentes soudain confrontées à un cas d'urgence psychiatrique et elle prend note que, selon le Gouvernement, cette affaire est à l'origine de réformes améliorant les dispositions entre la police et les services de santé.
Cependant, quand bien même il n’y aurait eu aucune intention d’humilier M.S., elle conclut que les conditions qu'il a dû subir ont atteint le seuil de traitement dégradant au sens de l'article 3. Il y a donc eu violation de cette disposition.
L'ENQUÊTE SUR LES VIOLENCES POLICIÈRES
DURANT LES GARDES A VUE DOIT ÊTRE EFFECTIVE ET RÉELLE
ANDERSEN c. GRÈCE du 26 avril 2018 Requête n° 42660/11
Article 3 : Le requérant a été torturé par la police pour le faire avouer. Les juridictions n'ont pas enquêté sur les plaintes de l'auteur, concernant les griefs de la police.
VOLET PROCÉDURAL
L’appréciation de la Cour
i. Principes généraux
47. La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans les arrêts Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), El-Masri (précité, §§ 182-185) et Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 316-326, CEDH (extraits)).
48. Il en ressort que, pour que l’interdiction générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s’adressant notamment aux agents publics s’avère efficace en pratique, il faut qu’existe une procédure permettant d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements infligés à une personne se trouvant entre leurs mains.
49. Ainsi, notamment, compte tenu du devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », les dispositions de l’article 3 de la Convention requièrent par implication qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3.
50. Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois qui interdisent la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants dans les affaires où des agents ou organes de l’État sont impliqués, et de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des mauvais traitements survenus sous leur responsabilité.
51. D’une manière générale, pour qu’une enquête puisse passer pour effective, il faut que les institutions et les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes qu’elle vise. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète.
52. Quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office. De plus, pour être effective, l’enquête doit permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Elle doit également être suffisamment vaste pour permettre aux autorités qui en sont chargées de prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui ont eu directement et illégalement recours à la force, mais aussi l’ensemble des circonstances les ayant entourés.
53. Bien qu’il s’agisse d’une obligation non pas de résultat mais de moyens, toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise.
54. En outre, la victime doit être en mesure de participer effectivement à l’enquête.
55. L’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête. Qui plus est, l’enquête doit être propre à déterminer si le recours à la force était ou non justifié dans les circonstances particulières d’une affaire (Corsacov c. Moldova, no 18944/02, § 69, 4 avril 2006, et Grimailovs c. Lettonie, no 6087/03, § 106, 25 juin 2013).
56. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable en découle implicitement. S’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (Bouyid, précité, § 121).
ii. Application de ces principes en l’espèce
57. En l’espèce, la Cour note tout d’abord que, telles qu’exposées devant les autorités internes, les allégations du requérant d’après lesquelles des policiers lui ont infligé des traitements contraires à l’article 3 de la Convention étaient défendables. Cette disposition obligeait donc lesdites autorités à mener une enquête effective.
58. La Cour constate que les circonstances ayant entouré les évènements du 18 septembre 2008 ont fait l’objet d’une enquête administrative et qu’une procédure pénale a été menée à l’encontre des policiers K.K. et Al.M.
59. Reste à savoir si les procédures en cause ont satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention.
60. La Cour observe à cet égard qu’il existe des éléments de nature à entacher le caractère indépendant et approfondi des enquêtes en cause. En premier lieu, elle relève que les personnes chargées de l’enquête administrative étaient des collègues des policiers soupçonnés d’être impliqués et qu’ils n’étaient pas supervisés par une autorité indépendante. Les autorités chargées de l’enquête se sont fondées principalement sur les dépositions de neuf policiers, y compris celles des acteurs présumés, K.K. et Al.M (paragraphe 31 ci-dessus). Dans leurs dépositions, ces témoins ont notamment soutenu que le comportement de tous les policiers se trouvant dans le commissariat en même temps que le requérant était « impeccable et approprié », et que le requérant avait résisté à son arrestation. Quant aux allégations du requérant, les autorités chargées de l’enquête lui ont reproché de ne pas avoir dénoncé plus tôt les mauvais traitements allégués. Elles ont estimé que, en introduisant sa plainte, le requérant avait pour but de se venger des policiers et de tirer profit d’une éventuelle demande en dommages-intérêts. En considérant comme subjective la version du requérant et non pas celle des policiers, les autorités chargées de l’enquête ont ainsi appliqué en pratique des critères différents lors de l’évaluation des dépositions. Or la Cour estime que la crédibilité des dépositions des policiers aurait dû elle aussi être mise en question, d’autant plus que l’enquête en cause visait également à établir si les policiers étaient passibles de sanctions disciplinaires (Zelilof c. Grèce, no 17060/03, § 60, 24 mai 2007, et Ognyanova et Choban c. Bulgarie, no 46317/99, § 99, 23 février 2006).
61. La Cour relève en outre que les autorités chargées de l’enquête ont exprimé des doutes quant au certificat établi à la suite de la visite du requérant à l’hôpital G. Gennimatas, au motif que l’heure à laquelle les évènements allégués s’étaient déroulés, les circonstances exactes des faits dénoncés et le moyen employé pour infliger les lésions n’y étaient pas précisés et que ces éléments ne pouvaient être établis que par un médecin légiste. La Cour note qu’il ressort de manière claire de ce document que le requérant s’est rendu à l’hôpital G. Gennimatas le 19 septembre 2008, soit immédiatement après sa mise en liberté, dès qu’il a pu agir pour rassembler des preuves. Dans ces circonstances, la Cour considère que le certificat médical aurait dû au moins être attentivement évalué par les autorités chargées de l’enquête.
62. La Cour observe encore que, par la suite, les autorités se sont bornées à constater que, en tout état de cause, les lésions corporelles mentionnées dans le certificat médical, à savoir l’ecchymose au triceps gauche, l’ecchymose au triceps droit et l’ecchymose à l’intérieur de la malléole droit, ne correspondaient pas aux allégations du requérant au motif que, si les mauvais traitements allégués avaient effectivement été infligés quarante-cinq minutes durant, ses blessures auraient été multiples et plus graves. Or les autorités n’ont pas vérifié si les lésions corporelles qui existaient lors de la mise en liberté du requérant pouvaient correspondre aux allégations de l’intéressé selon lesquelles il avait été frappé de coups de pied, de poing et de matraque aux jambes et aux bras. Lesdites lésions ont été attribuées sans équivoque aux évènements antérieurs au placement du requérant en garde à vue.
63. La Cour observe à cet égard que, lors de son placement en garde à vue, le requérant n’a fait l’objet d’aucun examen médical. Or elle a maintes fois souligné l’importance d’un examen médical qui soit effectué avant le placement d’une personne en garde à vue. Un tel examen peut permettre non seulement de savoir si la personne en cause est à même de faire l’objet d’un interrogatoire, mais également, en cas d’allégation ultérieure de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, de « décharger » les autorités de la preuve en ce qui concerne l’origine des blessures constatées (Ion Bălăşoiu c. Roumanie, no 70555/10, § 115, 17 février 2015, et Turkan c. Turquie, no 33086/04, § 42, 18 septembre 2008).
64. La Cour note ensuite que, en examinant la possibilité que les blessures du requérant se fussent produites pendant son arrestation, les autorités n’ont aucunement examiné l’argument du requérant selon lequel son état de santé ne lui permettait ni de courir ni de résister à son arrestation. Qui plus est, les circonstances exactes de l’affrontement présumé entre le requérant et les policiers, et, notamment, le comportement du requérant qui aurait nécessité l’utilisation de force, ainsi que l’origine exacte de ses blessures n’ont pas été précisés lors de l’enquête.
65. En ce qui concerne la procédure pénale contre K.K. et Al.M., la Cour relève que le procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique s’est borné à entendre les policiers soupçonnés d’avoir été impliqués ainsi qu’un certain T.S. Ce procureur n’a pas procédé à une confrontation entre les policiers en cause et le requérant, et il n’a entendu ni M.A., témoin proposé par le requérant, ni les médecins qui ont établi les certificats médicaux produits par l’intéressé. De telles mesures auraient pourtant pu contribuer à éclaircir les faits. La Cour note en outre que, en classant l’affaire le 10 octobre 2010, le procureur près le tribunal correctionnel a pris en considération la procédure pénale menée contre le requérant, et qu’il a constaté que l’intéressé avait repoussé les policiers et qu’il avait essayé de les frapper. À cet égard, la Cour ne perd pas de vue le fait que les policiers n’ont nullement soutenu devant les juridictions internes que le requérant leur aurait infligé de quelconques lésions corporelles. De plus, la Cour observe que, dans son ordonnance no 1/11, le procureur près la cour d’appel a reproduit la plupart des constats de l’enquête administrative et de la procédure pénale engagée contre le requérant.
66. En conséquence, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’une enquête effective. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
VOLET MATÉRIEL
71. La Cour rappelle que la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements reprochés à la victime (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
72. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au‑delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).
73. En l’espèce, la Cour note que les rapports médicaux ne sont pas concluants quant à l’origine possible des blessures que présentait le requérant et que les éléments du dossier ne permettent pas d’avoir une certitude suffisante, au-delà de tout doute raisonnable, sur la cause des lésions constatées. À cet égard, elle tient toutefois à souligner que cette impossibilité découle en grande partie de l’absence d’une enquête approfondie et effective par les autorités nationales (B.S. c. Espagne, no 47159/08, § 55, 24 juillet 2012, Lopata c. Russie, no 72250/01, § 125, 13 juillet 2010, et Gharibashvili c. Géorgie, no 11830/03, § 57, 29 juillet 2008).
74. Eu égard à ses conclusions sous le volet procédural de l’article 3 de la Convention, la Cour considère qu’il n’existe pas en l’espèce d’éléments suffisants permettant de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a fait l’objet des traitements allégués.
75. À la lumière de ce qui précède, la Cour ne peut conclure à une violation matérielle de l’article 3 s’agissant des mauvais traitements allégués par le requérant.
76. Dès lors, il n’y a pas eu de violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
Sidiropoulos et Papakostas c. Grèce du 25 janvier 2018 requête n° 33349/10
Article 2 : Le manque de rigueur pour sanctionner les actes de torture d'un policier qui profitera d'un changement de service par une promotion, n'est pas proportionné à la gravité des fait.
L’affaire concerne une procédure ayant abouti à la condamnation pénale d’un policier pour avoir infligé des tortures à MM. Sidiropoulos et Papakostas et, en particulier, les sanctions infligées à l’auteur des faits : une peine de cinq ans d’emprisonnement convertie en une sanction pécuniaire de 5 euros (EUR) par jour de détention payable en 36 versements pendant trois ans. Une enquête administrative fut également classée.
La Cour juge en particulier que le système pénal et disciplinaire s’est avéré loin d’être rigoureux et ne pouvait engendrer de force dissuasive susceptible d’assurer la prévention efficace d’actes illégaux tels que la torture. En effet, l’issue des procédures litigieuses contre le policier n’a pas offert un redressement approprié de l’atteinte portée à la valeur consacrée dans l’article 3 de la Convention, l’auteur des faits n’ayant jamais eu à subir les conséquences de ses actes en tant que policier et la clémence de la sanction pénale imposée étant manifestement disproportionnée eu égard à la gravité du traitement infligé aux requérants.
La Cour juge également que la durée de la procédure pénale (huit ans pour une instance) n’était pas raisonnable et que MM. Sidiropoulos et Papakostas n’ont pas bénéficié d’un recours interne pour en obtenir la sanction.
CEDH
a) Principes généraux
83. La Cour estime que le grief des requérants concerne principalement l’obligation positive de protéger l’intégrité physique et morale de la personne par la loi. Par conséquent, elle recherchera en l’espèce si l’obligation positive de l’État découlant de l’article 3 de la Convention, consistant à prendre des mesures propres à empêcher que les personnes placées sous son contrôle ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, a été respectée (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 54, CEDH 2006‑XII (extraits)).
84. La Cour rappelle que les États contractants ont une obligation positive de mettre en place une protection dissuasive suffisante contre les violations du droit énoncé à l’article 3 de la Convention. Dans le système de la Convention, il est reconnu depuis longtemps que le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. C’est un droit absolu qui ne souffre aucune dérogation en aucune circonstance (Derman, précité, § 27).
85. La Cour rappelle que, en cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État au mépris de l’article 3 de la Convention, deux mesures s’imposent pour que la réparation soit suffisante. Premièrement, les autorités de l’État doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification et – le cas échéant – à la punition des responsables (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 116, CEDH 2010 ; voir aussi Armani da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 233, CEDH 2016). Deuxièmement, le requérant doit le cas échéant percevoir une compensation (Vladimir Romanov, précité, § 79) ou, du moins, avoir la possibilité de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice que lui a causé le mauvais traitement (comparer, mutatis mutandis, Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03, § 56, 20 décembre 2007, (concernant une violation de l’article 2), Çamdereli, précité, § 29, Yeter c. Turquie, no 33750/03, § 58, 13 janvier 2009, et Gäfgen, précité, § 116). Pour qu’une enquête soit effective en pratique, la condition préalable est que l’État ait promulgué des dispositions de droit pénal réprimant les pratiques contraires à l’article 3 de la Convention (comparer, mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 150, 153 et 166, CEDH 2003‑XII, Nikolova et Velitchkova, précité, § 57, Çamdereli, précité, § 38, et Gäfgen précité, § 117).
86. Encore faut-il préciser que, en la matière, les exigences procédurales de l’article 3 de la Convention s’étendent au-delà du stade de l’instruction préliminaire lorsque, comme en l’espèce, celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’interdiction posée par cette disposition. Ainsi, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’État de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (Okkalı, précité, § 65, et Derman, précité, § 27).
87. Pour déterminer si les autorités nationales avaient mené contre les responsables une enquête approfondie et effective conformément aux exigences qu’elle pose dans sa jurisprudence, la Cour a pris en compte, dans de précédentes affaires, plusieurs critères. D’abord, d’importants facteurs pour que l’enquête soit effective, et qui permettent de vérifier si les autorités avaient la volonté d’identifier et de poursuivre les responsables, sont la célérité avec laquelle elle est ouverte et la célérité avec laquelle elle est conduite. En outre, l’issue de l’enquête et des poursuites pénales qu’elle déclenche, y compris la sanction prononcée ainsi que les mesures disciplinaires prises, passent pour déterminantes. Elles sont essentielles si l’on veut préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est tenu d’exercer dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais traitements (Gäfgen, précité, § 121, et Zontul, précité, § 98).
88. Certes, les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation, soumise au contrôle de la Cour, pour déterminer les peines applicables aux infractions pénales. De même, le caractère dissuasif d’une peine relève du pouvoir discrétionnaire de l’État. Cela étant, dans le cas où les juridictions nationales ont établi qu’un requérant a été torturé, comme en l’espèce, la Cour, dans son examen des décisions ou des mesures disciplinaires adoptées par les juridictions nationales contre les auteurs concernés, devra prendre en considération si de telles mesures constituent un redressement approprié et si elles peuvent être considérées comme ayant un effet dissuasif pour l’avenir (Zeynep Özcan c. Turquie, no 45906/99, § 42, 20 février 2007, et, mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, précité, § 166). Dans ce contexte, la Cour rappelle que lorsque des agents de l’État sont inculpés d’infractions impliquant des mauvais traitements, il importe qu’ils soient suspendus de leurs fonctions pendant l’instruction ou le procès et en soient démis en cas de condamnation (Gäfgen, précité, § 125).
b) Application de ces principes en l’espèce
89. La Cour relève d’emblée qu’une procédure pénale et une enquête administrative ont été ouvertes contre le policier C.E. Elle note que les deux procédures auraient pu avoir des conséquences sur la situation pénale ou personnelle de l’auteur des faits en raison des actes incriminés. Dès lors, elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble des procédures litigieuses afin de pouvoir se prononcer sur la question de savoir si, en l’espèce, des mesures de protection dissuasives et suffisantes contre la torture conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention ont été prises.
90. En ce qui concerne la procédure pénale, la Cour constate que la culpabilité du policier C.E. quant aux actes qui lui étaient reprochés a été reconnue par les juridictions nationales. Cette procédure s’est conclue par un jugement de condamnation pour torture infligée par chocs électriques (paragraphes 43-45 ci-dessus).
91. S’agissant de la peine infligée au policier C.E., la Cour note d’emblée que le fait que le premier requérant était mineur à l’époque des faits n’a pas été pris en compte dans le cadre de l’imposition de la peine et que la cour d’appel, reconnaissant à C.E. des circonstances atténuantes, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans. Elle observe en outre que la peine imposée a été commuée en une sanction pécuniaire de 5 EUR par jour d’emprisonnement et que le montant était payable en trente-six versements sur une période de trois ans.
92. La Cour note à cet égard que l’article 137 B du CP, qui réprime les actes en cause, prévoit une peine de réclusion d’au moins dix ans. Or elle observe que la cour d’appel, en appliquant les articles 79, 84 et 94 du CP, a considéré que la peine de cinq ans au total était appropriée au vu de la torture infligée aux requérants. La Cour relève en outre qu’en vertu de l’article 83 du CP, lorsque le droit interne prévoit une peine réduite, une peine de réclusion initialement prévue d’au moins dix ans peut être convertie en une peine de réclusion allant jusqu’à douze ans ou à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. Toutefois, l’arrêt no 80, 81, 82/2014 de la cour d’appel ne comprenant aucune justification spécifique qui permettrait d’éclairer la divergence entre la peine applicable en principe et la peine finalement imposée, la Cour peut uniquement constater cette disparité et n’est pas en mesure de se prononcer sur les raisons de celle-ci.
93. La Cour observe en outre qu’en vertu de l’article 82 du CP, la peine privative de liberté qui est supérieure à deux ans et qui ne dépasse pas les cinq ans est commuée en sanction pécuniaire, sauf si le tribunal, par un arrêt contenant une justification spéciale, considère que le fait de ne pas commuer la peine est nécessaire afin de dissuader l’auteur de commettre pareilles infractions à l’avenir (paragraphe 48 ci-dessus). Elle souscrit à l’argument du Gouvernement selon lequel la commutation des peines restrictives de liberté en sanctions pécuniaires peut se révéler bénéfique pour le système pénitentiaire et, en particulier, peut permettre d’éviter ou de combattre la surpopulation carcérale. Elle considère cependant que cela n’exempte pas les autorités internes de respecter leur obligation de garantir le caractère adéquat et dissuasif de la sanction prononcée dans tous les cas de mauvais traitements infligés par des agents de l’État au mépris de l’article 3 de la Convention.
94. La Cour observe par ailleurs que, si la cour d’appel a considéré que l’infraction commise par le policier C.E. était d’une indignité morale particulière pour « la civilisation légale et la personnalité » des requérants, elle a pour autant commué la peine prononcée en une amende de 5 EUR par jour d’emprisonnement quand le maximum prévu par les dispositions du droit interne était de 100 EUR par jour d’emprisonnement. Certes, la Cour n’est pas compétente pour déterminer quelle peine aurait constitué un redressement approprié. Toutefois, elle observe que, en imposant la sanction pécuniaire précitée et en permettant son paiement en trente-six versements, la cour d’appel a uniquement pris en compte la situation financière du policier C.E. et la question de savoir si cette peine était capable d’empêcher ce dernier de commettre pareilles infractions à l’avenir.
95. De l’avis de la Cour, une telle sanction ne saurait ni être considérée comme propre à dissuader l’auteur des faits ou d’autres agents de l’État de commettre des infractions similaires ni être perçue comme juste par les victimes. Ceci d’autant plus que les actes incriminés ont en l’occurrence été qualifiés de torture. Or l’objet des dispositions du droit interne sanctionnant la torture infligée par des agents de l’État est de permettre une protection véritable des personnes, en particulier lorsque les intéressés sont placés, comme les requérants, sous le seul contrôle de la police – et d’inclure des mesures efficaces pour sanctionner et empêcher des mauvais traitements par les agents de l’État (voir, mutatis mutandis, Ciğerhun Öner c. Turquie (no 2), no 2858/07, § 100, 23 novembre 2010, Zeynep Özcan, précité, § 43, 20 février 2007, et Abdülsamet Yaman, précité, § 55).
96. En résumé, la Cour estime que la clémence de la sanction imposée au policier C.E. est manifestement disproportionnée eu égard à la gravité du traitement infligé aux requérants (voir Zontul, précité, § 108, Ali et Ayşe Duran, précité, § 54, Atalay, précité, § 44 et, mutatis mutandis, Derman, précité, § 28).
97. Elle relève ensuite qu’une enquête administrative a été ouverte contre le policier en cause. Par une décision du 8 juillet 2003, l’affaire a été classée en ce qui concernait l’utilisation d’un appareil à décharge électrique et C.E. a été condamné à une amende de 100 EUR pour avoir porté et utilisé un émetteur-récepteur portatif sans permission préalable. Cette procédure s’est conclue avant l’achèvement de la procédure pénale, lors de laquelle il a été constaté que C.E. avait torturé les requérants. Entre-temps, le policier avait quitté le service à sa propre demande. Toutefois, la Cour observe que les deux procédures sont parvenues à des conclusions substantiellement différentes et que C.E. n’a jamais eu à subir les conséquences de ses actes en tant que policier, ayant quitté le service de son propre chef. En effet, C.E. a servi au sein de la police pendant huit ans après les faits en cause, sans avoir à subir les conséquences de ses actes. Qui plus est, en raison de la durée de la procédure pénale, l’article 49 § 2 du décret présidentiel no 22/1996 qui prévoit la répétition de la procédure disciplinaire ne pouvait être appliqué, C.E. ayant entre-temps quitté le service (paragraphe 51 ci-dessus). De surcroît, en quittant le service, C.E. a bénéficié d’une promotion, avec toutes les implications morales et pécuniaires que cela comporte (paragraphe 18 ci‑dessus). Dans ce contexte, elle rappelle que le manque de rigueur dans l’application du système pénal et disciplinaire, comme en l’espèce, n’est pas de nature à dissuader les forces de l’ordre de commettre des actes illégaux tels que ceux dénoncés par les requérants (voir, en ce sens, Zeynep Özcan, précité, § 45, Okkalı, précité, §§ 76 et 78, et, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman, précité, § 55).
98. S’agissant de la célérité de l’enquête (voir paragraphe 87 ci-dessus), la Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, qu’il est plus approprié d’examiner la question sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui garantit le droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable (paragraphes 101-118 ci-dessous).
c) Conclusion
99. La Cour estime en conséquence que le système pénal et disciplinaire, tel qu’il a été appliqué en l’espèce, s’est avéré loin d’être rigoureux et ne pouvait engendrer de force dissuasive susceptible d’assurer la prévention efficace d’actes illégaux tels que ceux dénoncés par les requérants. Dans les circonstances particulières de l’affaire, elle parvient ainsi à la conclusion que l’issue des procédures litigieuses contre le policier n’a pas offert un redressement approprié de l’atteinte portée à la valeur consacrée dans l’article 3 de la Convention (Zeynep Özcan, précité, § 45). Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions du Gouvernement tirées du défaut de la qualité de victime et du non-respect du délai des six mois.
100. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
Adam C. Slovaquie du 28 juillet 2016 requête 68066/12
Violation de l'article 3 : Les gifles qu'un jeune Rom de 16 ans disait avoir reçues ne sont pas établies, mais l'enquête menée sur ces faits a été inadéquate.
La Cour ne peut que relever certaines incohérences entre les déclarations faites par le requérant au médecin qui l'a examiné le 19 décembre 2010, aux autorités nationales et à la Cour en ce qui concerne les gifles qu'il disait avoir reçues de la part des agents de police qui l'avaient interrogé.
Ainsi, le rapport médical indique que M. Adam affirmait avoir été giflé sur la joue droite, alors que le médecin a noté que c'était la joue gauche qui était enflée. En outre, l'allégation selon laquelle il aurait reçu des gifles et des coups de poing au visage et à la tête pendant trois heures a été contredite par le rapport du médecin qui mentionne que le patient se plaignait d’avoir été giflé mais qui ne constate la présence d’aucun hématome. Enfin, M. Adam n’a déposé plainte officiellement que le 5 janvier 2011, soit 17 jours après les mauvais traitements allégués et n’a produit à l’appui de ses assertions aucun élément documentaire, telle une déclaration des coaccusés, par exemple.
Au vu des circonstances, la Cour juge plausible que, comme le soutenait le Gouvernement, les blessures de M. Adam aient été causées par la résistance qu’il a opposée lors de son arrestation. Le Gouvernement a étayé cette version à l’aide d’une documentation fournie et détaillée, contrairement au requérant, qui affirmait, d’une manière générale et sans produire aucun élément à l’appui de ses déclarations, que le Gouvernement avait produit de faux rapports pour établir la légalité des mesures de contrainte utilisées à son endroit. La Cour juge qu’il n’est pas établi que M. Adam ait été giflé au cours de son interrogatoire préliminaire par la police et que le requérant n’a pas apporté la preuve de ses allégations relatives à des pressions de nature psychologique, à une privation d’eau ou à des traitements discriminatoires dont il aurait été l’objet. En ce qui concerne l’allégation de privation de nourriture, la Cour juge que le niveau de gravité requis pour caractériser un traitement inhumain ou dégradant sous l’angle de l’article 3 de la Convention n’a pas été atteint.
Par conséquent, la Cour juge que M. Adam n’a pas été victime de traitements inhumains ou dégradants et conclut à une non-violation de l’article 3 de la Convention relativement aux gifles que le requérant disait avoir reçues lors de sa garde à vue.
Néanmoins, la Cour juge que les assertions de M. Adam étaient suffisamment crédibles pour faire peser sur les autorités une obligation d’ouvrir une enquête sur le sujet, dans le respect des critères découlant de l’article 3 de la Convention. À cet égard, la Cour fait observer que, plutôt que d’engager une enquête sur les allégations de M. Adam de leur propre initiative, les autorités semblent avoir transféré à M. Adam lui-même la charge d’en établir la véracité. Elle fait observer en particulier que l’une des raisons pour lesquelles les accusations du requérant relatives à des brutalités policières ont été rejetées est qu’il ne les avait pas mentionnées lors de son entretien avec l’enquêteur. En outre, la Cour peine à suivre la logique qui a justifié le rejet des griefs par les autorités nationales, qui ont renvoyé le requérant au dossier de la procédure pénale menée contre lui, qui concluait à l’absence de brutalités commises contre lui au cours de l’enquête le visant.
De plus, aucune mesure ne semble avoir été prise pour résoudre les incohérences entre les différentes théories proposées pour identifier la cause de sa joue enflée. Les autorités n’ont pas non plus pris de disposition pour interroger l’autre personne qui, selon les dires de M. Adam, était présente au poste de police lors de son interrogatoire ; pour contre-interroger les agents de police impliqués ; pour organiser une confrontation entre M. Adam et ces agents ou pour interroger le médecin qui l’avait traité.
Enfin, les autres griefs de M. Adam relatifs à l’absence alléguée de notification de son arrestation et de sa détention à ses représentants légaux, au fait qu’il aurait été privé d’eau et de nourriture pendant sa détention et qu’il n’aurait pas été entendu immédiatement après son arrestation ont également été rejetés sans autre explication, et la Cour constitutionnelle semble avoir complètement ignoré ses récriminations à cet égard.
Au vu de la nature sensible de la situation des Roms en Slovaquie à l’époque des faits, la Cour juge que les autorités n’ont pas entrepris toutes les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour enquêter sur les allégations de mauvais traitements formulées par M. Adam. Il y a donc eu violation de l’article 3 en ce qui concerne l’enquête menée sur les allégations de M. Adam relatives aux mauvais traitements dont il disait avoir été l'objet.
Eu égard à cette conclusion, la Cour juge qu’il n’est pas nécessaire d’examiner au fond les griefs que M. Adam tirait de l’article 13 de la Convention.
TA-Lyon-tir-de-LBD-gilet-jaune.pdf
H.M. et autres c. Hongrie du 2 juin 2022 requête no 38967/17
Art 3 : Le fait d’avoir menotté et entravé un demandeur d’asile constitue un traitement inhumain et dégradant
Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des conditions dans lesquelles la mère de famille et ses enfants ont dû vivre pendant les quatre mois qu’ils ont passés dans la zone de transit. La Cour considère par ailleurs que le fait d’avoir menotté et entravé le père de famille pour le conduire à l’hôpital où il devait accompagner son épouse à un rendez-vous n’était pas justifié.
En outre, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 5 §§ 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 (droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité d’une détention) de la Convention au motif que la détention des membres de la famille requérante était dépourvue de base légale et qu’ils ont été privés de toute possibilité de faire examiner leur situation à bref délai par un juge
FAITS
Les requérants sont un couple d’Irakiens nés en 1978 et 1980 respectivement, et quatre de leurs enfants, nés entre 2001 et 2013. Ils résident à Aachen (Allemagne). Après avoir fui l’Irak, où le père de la famille requérante aurait été torturé par les services nationaux de sécurité, et après avoir traversé plusieurs pays, les membres de la famille requérante arrivèrent le 3 avril 2017 dans la zone de transit de Trompa, située à la frontière serbo-hongroise, où ils demandèrent l’asile. Dans la zone de transit, ils furent hébergés dans un container situé dans le secteur réservé aux familles, d’où ils n’étaient autorisés à sortir que pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou autres, et toujours sous escorte policière. La mère de la famille requérante étant enceinte et souffrant de complications, sa grossesse était jugée à haut risque. Elle dut être conduite à l’hôpital à plusieurs reprises. Dix jours après leur arrivée dans la zone de transit, son mari l’accompagna à l’hôpital, après avoir été menotté et entravé sous les yeux de ses enfants. Il demeura menotté pendant toute la durée de la consultation à l’hôpital, où il servit d’interprète à son épouse.
Le 3 juillet 2017, l’Office de l’immigration et de l’asile (« l’OIA ») reçut l’ordre d’examiner les demandes d’asile présentées par les requérants. Ceux-ci demandèrent à plusieurs reprises à l’OIA d’accélérer la procédure, invoquant les besoins des enfants et la grossesse difficile de la mère. Il semble que cette dernière ait fait une grève de la faim de plusieurs jours, en signe de protestation.
Le 24 août 2017, la mère donna naissance à son cinquième enfant, et la famille fut transférée de la zone de transit de Tompa vers un centre d’accueil ouvert.
Article 3
La Cour considère que si la mère de famille semble avoir bénéficié du suivi médical requis, les contraintes qui lui ont été imposées pendant tout le temps où elle se trouvait à un stade avancé de sa grossesse n’ont pu manquer de susciter chez elle de l’angoisse et des souffrances psychiques qui, compte tenu de sa vulnérabilité, étaient suffisamment graves pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. La Cour estime par ailleurs, conformément à sa jurisprudence, que les conditions de vie subies par les enfants requérants au cours de la période de plus de quatre mois pendant laquelle ils ont été confinés dans la zone de transit emportent violation de l’article 3 de la Convention. La Cour considère que, contrairement à la mère de la famille requérante, le père n’était pas plus vulnérable que les autres adultes demandeurs d’asile confinés dans la zone de transit. Bien qu’il ait allégué souffrir de troubles psychiques du fait des sévices qu’il dit avoir subis en Irak, il n’a pas demandé l’aide du personnel présent dans la zone de transit. La Cour considère que les conditions générales de rétention dans la zone en question n’étaient pas particulièrement inadaptées à la situation de l’intéressé. Toutefois, le fait que celui-ci ait été menotté et entravé en une occasion était humiliant. La principale question qui se pose consiste à savoir si l’utilisation de moyens de contrainte était nécessaire, car lorsqu’il est inutile, le recours à la force physique porte atteinte à la dignité humaine, et constitue, en principe, une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention. La Cour constate que les requérants ont été internés d’office dans la zone de transit, et non en vertu d’une décision de justice qui les aurait privés de leur liberté. Elle en conclut que l’utilisation de menottes et d’une entrave n’a pas été « imposée à l’occasion d’une arrestation ou d’une détention légales ». En outre, le père de la famille requérante était un demandeur d’asile, et il avait été conduit à l’hôpital pour assister sa femme enceinte. Rien ne prouve qu’il était dangereux pour lui-même ou pour autrui. Même si les menottes et l’entrave n’ont été utilisées qu’en une seule occasion, rien ne permet de conclure que cette mesure était justifiée. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut également à la violation de l’article 3 en ce qui concerne l’intéressé.
Article 5
Conformément à sa jurisprudence antérieure, la Cour juge que la rétention de la famille requérante dans la zone de transit pendant plus de quatre mois s’analyse en une privation de liberté. Elle conclut que la détention des intéressés ne pouvait passer pour « régulière » et constate qu’ils n’ont pas pu faire examiner en temps utile leur situation par un tribunal. Partant, il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention.
COMORAŞU c. ROUMANIE du 31 mai 2016 requête 16270/12
Non violation de l'article 3 sur le fait matériel car le port des menottes, était nécessaire. Violation de l'article 3 sur le défaut d'enquête puisque le requérant n'y a pas été associé.
a) Principe généraux
40 . La Cour rappelle tout d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (notamment Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 86-90, CEDH 2015, mais aussi R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004). En particulier, elle a établi ce qui suit (Bouyid, précité, §§ 88 et 101) :
« 88. [...] lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3.
101. [...] toute conduite des forces de l’ordre à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à la dignité humaine constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Il en va en particulier ainsi de l’utilisation par elles de la force physique à l’égard d’un individu alors que cela n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé. »
41. Qui plus est, si l’article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation, ce recours à la force doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce (notamment Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 126, CEDH 2013 (extraits) et, mutatis mutandis, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 72 et 76, CEDH 2000-XII).
42. La Cour rappelle s’être exprimé ainsi, sur le port des menottes (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII) :
« 56. ... le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’espèce. À cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves. »
43 . Ensuite, la Cour réitère qu’il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur particulière vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne, pour apprécier si le traitement concerné était incompatible avec les exigences de l’article 3 (Renolde c. France, no 5608/05, §§ 84 et 109, CEDH 2008 (extraits) ; Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 111, CEDH 2001-III ; Bureš c. République tchèque, no 37679/08, § 85, 18 octobre 2012).
44. La Cour rappelle par ailleurs que lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3, ces allégations doivent faire l’objet d’une enquête officielle et effective qui répond aux critères ci-dessous énoncés plus récemment dans l’arrêt Bouyid, précité (§§ 114-123, et notamment les paragraphes ci-dessus reproduits, références à la jurisprudence omises) :
« 119. Quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office. De plus, pour être effective, l’enquête doit permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Elle doit également être suffisamment vaste pour permettre aux autorités qui en sont chargées de prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui ont eu directement et illégalement recours à la force, mais aussi l’ensemble des circonstances les ayant entourés.
120. Bien qu’il s’agisse d’une obligation non pas de résultat mais de moyens, toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise.
122. La victime doit être en mesure de participer effectivement à l’enquête (...)
123. Enfin, l’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête. »
45. La Cour rappelle enfin avoir exigé que les requérants qui entendent se plaindre devant elle d’un manque d’effectivité de l’enquête ne tardent pas indûment à saisir les autorités internes compétentes et la Cour de leur grief. Au fil du temps, la mémoire des témoins décline, ceux-ci risquent de décéder ou d’être introuvables, certains éléments de preuve se détériorent ou disparaissent et les chances de mener une enquête effective s’amenuisent progressivement, de sorte que l’examen et le prononcé d’un arrêt par la Cour risquent de se trouver privés de sens et d’effectivité. Par conséquent, les requérants doivent faire preuve de diligence et d’initiative et introduire leurs griefs sans délai excessif (mutatis mutandis Baklanov c. Ukraine, no 44425/08, § 74, 24 octobre 2013).
b) Application de ces principes aux faits de la présente affaire
i) Sur le volet matériel de l’article 3 de la Convention
46. La Cour rappelle que le requérant a été interpellé devant sa maison par cinq policiers qui lui ont passé des menottes aux mains et aux pieds et l’ont amené de force au service de psychiatrie de l’hôpital. La nuit précédente la police et le service d’ambulance avaient tenté en vain de calmer le requérant, dont la belle-mère les avait alerté sur le fait qu’il était agité et montrait un comportement agressif envers sa famille (paragraphe 26 ci-dessus). Dans ce contexte, compte tenu de l’imprévisibilité du comportement du requérant, la Cour n’estime pas déraisonnable que cinq policiers soient intervenus pour l’interpeller.
47. À ce propos, il faut rappeler qu’eu égard à la difficulté de la mission de la police dans les sociétés contemporaines et à l’imprévisibilité du comportement humain, il y a lieu d’interpréter l’étendue de la responsabilité pesant sur les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau insupportable (voir, mutatis mutandis, Günaydın c. Turquie, no 27526/95, § 31, 13 octobre 2005).
48. En outre, pour rechercher si la force utilisée était, en l’espèce, proportionnée, la Cour attache une importance particulière à l’existence de blessures occasionnées par l’intervention et, le cas échéant, aux circonstances dans lesquelles elles ont été subies (Timtik c. Turquie, no 12503/06, § 49, 9 novembre 2010, et Rehbock, précité, § 72). Or, aucune violence physique ou psychique ne semble avoir été infligée au requérant lors de son interpellation (voir, a contrario, respectivement Rehbock, § 68 et Gutsanovi, §§ 134-135, arrêts précités).
49. Des lors, la Cour estime qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention en raison des modalités de l’interpellation du requérant par les forces de l’ordre.
ii) Sur le volet procédural de l’article 3 de la Convention
50. Le gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir été diligent dans ses agissements auprès des autorités internes. Se penchant sur la qualité de l’enquête menée en l’espèce, la Cour note tout d’abord que les incidents en question ont eu lieu le 29 décembre 2007, que le requérant est sorti de l’hôpital le 3 mars 2008, qu’il a saisi la police le 20 janvier 2009, que la dernière décision définitive lui a été communiquée le 25 novembre 2010, que le dernier acte procédural dont il a été informé a eu lieu le 22 mars 2011 et qu’il a saisi la Cour le 5 mars 2012. En outre, les parties sont d’accord sur le fait que la plainte pénale avec constitution de partie civile constituait un recours effectif en l’espèce (mutatis mutandis, Stoica c. Roumanie, no 42722/02, §§ 105-109, 4 mars 2008).
51. La Cour estime que le fait pour le requérant d’avoir attendu environ dix mois avant de saisir les autorités internes compétentes de sa plainte n’est pas déraisonnable, compte tenu du fait que le droit interne lui accordait un délai encore plus long pour déposer sa plainte. Ainsi, selon les normes de droit interne en vigueur à l’époque, le délai le plus court de prescription de la responsabilité pénale était d’au moins trois ans. Qui plus est, en l’espèce ce retard de dix mois n’a pas porté préjudice à l’enquête : les souvenirs des témoins n’ont pas été affectés, leurs déclarations étant détaillées et exhaustives. En outre, tous les documents médicaux pertinents ont été préservés et mis à la disposition des enquêteurs (paragraphe 45 ci-dessus).
52. Toujours s’agissant du comportement du requérant pendant l’enquête, la Cour note le désaccord entre les parties sur le fait de savoir si celui-ci a fait preuve de diligence pour se renseigner sur le déroulement de la procédure pénale. La Cour rappelle toutefois qu’il était normal, à l’époque des faits, que les enquêteurs n’aient pas de contacts avec les parties avant la fin de la procédure car ils menaient de leur propre initiative tout acte d’investigation qu’ils considéraient pertinent sans pour autant en informer les victimes (Mocanu et autres, précité, § 321; Georgescu c. Roumanie (déc.), no 4867/03, § 25, 22 octobre 2013; Bucureşteanu c. Roumanie, no 20558/04, § 42, 16 avril 2013; et, mutatis mutandis, Poede c. Roumanie, no 40549/11, §§ 56-57, 15 septembre 2015). La Cour rappelle aussi que les autorités ont manqué à leur obligation de communiquer au requérant la décision prise par le procureur le 11 mai 2011, lui ôtant ainsi toute possibilité de la contester en temps utile devant un tribunal.
53. La Cour constate ensuite qu’une fois saisies, les autorités internes ont agi avec une célérité et une diligence raisonnables : dans une période d’environ huit mois elles ont pu faire examiner l’état de santé du requérant et recueillir les témoignages pertinents. Les recours introduits par le requérant ont eux aussi été examinés de manière approfondie et avec rapidité.
54. Toutefois, des déficiences majeures ont été signalées dans le déroulement de l’enquête par la cour d’appel qui, le 25 novembre 2010, a renvoyé le dossier au procureur en lui prescrivant d’ouvrir des poursuites pénales contre les responsables. La cour d’appel a estimé que l’enquête n’avait pas été effective et que toutes les circonstances de l’incident n’avaient pas été élucidées. Malgré ces indications précises de la part de la cour d’appel, la nouvelle décision du procureur ne fait que reproduire le raisonnement de la décision critiquée. Mis à part une nouvelle expertise psychiatrique, aucun acte procédural ne semble avoir eu lieu après le renvoi du dossier chez le procureur. Qui plus est, faute d’avoir été communiquée au requérant, cette nouvelle décision de non-lieu n’a pu être soumise par lui au contrôle juridictionnel. Par ailleurs, le requérant n’a pas été en mesure de participer activement à l’enquête.
55. Ces éléments suffissent pour permettre à la Cour de conclure que l’enquête effectuée en l’espèce n’a pas été « effective » (mutatis mutandis, Baklanov, § 89). Dès lors, il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
ARCHIP c. ROUMANIE requête n° 49608/08 du 27 septembre 2011
Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Mauvais traitements
Le menottage à un arbre d’un homme souffrant d’arthrose de la hanche devant un poste de police était une mesure excessive
La Cour considère que le menottage de M. Archip à un arbre dans la cour du poste de police aux yeux de tous, en plein centre du village, n’a pu manquer de provoquer chez lui des sentiments d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et l’avilir au-delà du raisonnable, et que ces sentiments n’ont pu qu’être aggravés par la présence de journalistes de la presse et de la télévision. Sur le plan physique, menotter une personne en parfaite santé – sans même parler de quelqu’un souffrant comme le requérant de coxarthrose – en plein air par une journée froide et humide de novembre peut être extrêmement douloureux. De plus, selon l’article 36 de la loi roumaine de 2002 sur la police, les menottes ne doivent pas être utilisées sur des personnes qui, comme M. Archip, souffrent d’un handicap visible. Même si l’intéressé avait refusé d’obéir aux policiers qui lui ordonnaient de se calmer, la Cour ne voit pas comment les autorités nationales ont pu conclure que la force utilisée contre lui n’avait pas été excessive. C’est pourquoi elle dit que M. Archip a été soumis à des traitements inhumains et dégradants dont l’Etat est responsable, en violation du volet matériel de l’article 3.
CARPEN C. ROUMANIE requête 61258/10 du 14 janvier 2014
LE PORT DES MENOTTES EN PUBLIC PEUT ÊTRE ADMIS EN CAS DE NÉCESSITÉ ET DE BRIÈVETÉ.
30. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX). Lorsqu’il s’agit pour elle de déterminer si une peine ou un traitement a revêtu un caractère « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examine si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001‑III). À cet égard, le caractère public de la sanction ou du traitement peut constituer un élément pertinent et aggravant. En outre, il peut fort bien suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui (Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, § 32).
31. La Cour peut accepter que des mesures de sécurité telles que le port des menottes ou l’escorte soient nécessaires pour assurer la sûreté du transport des personnes détenues (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII). Cela n’exclut pas que, dans certaines circonstances, des éléments liés à la personne du détenu soient pris en compte pour décider de la nécessité de l’application d’une telle mesure.
32. Quant au contexte de l’utilisation de cette mesure, la Cour rappelle que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’espèce. À cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves (Raninen, précité, § 55 et Šaban Hadžiu c. République tchèque (déc.), no 52110/99, 4 novembre 2003).
33. La Cour note à titre liminaire qu’en l’occurrence la base légale régissant l’application des menottes aux personnes détenues lors des transports résidait dans la loi no 275/2006 et dans différents ordres du ministère de l’Intérieur ou de la Justice. À cet égard, il convient de noter que, si la loi no 275/2006 limite l’utilisation des menottes à des situations exceptionnelles, il ressort des ordres adoptés par les différents ministères que l’utilisation des menottes s’applique dès que les détenus sont transportés sur la voie publique.
34. En l’espèce, la mesure contestée a été appliquée au requérant lors de son transfert de la voiture aux locaux de détention et de ces derniers à la salle d’audience. Il est incontestable que le requérant se trouvait à ce moment dans un espace public que le juge délégué a jugé, en raison de son architecture et spécificité, comme nécessitant le port des menottes par les détenus (paragraphe 17 ci-dessus).
35. Certes, en l’occurrence, le requérant était procureur et n’était pas soupçonné d’une infraction violente. Il n’y avait pas de preuve de son agressivité, ni qu’il ait tenté de fuir pendant la procédure.
36. Néanmoins, il ressort des images vidéos soumises par le requérant à la Cour qu’il a été exposé menotté au public uniquement pendant une courte période, à savoir de sa sortie de la voiture garée devant l’entrée du tribunal et jusqu’à son entrée effective dans le bâtiment. Dès lors, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait été exposé au public au-delà de ce qui était nécessaire. De plus, il n’a pas été gardé menotté pendant les audiences devant le tribunal (Pop Blaga c. Roumanie (déc.), no 37379/02, § 101, 10 avril 2012) mais uniquement pendant le trajet de la voiture au tribunal.
37. Quant à l’impact de cette mesure sur la personnalité du requérant, la Cour note qu’à part ses allégations, l’intéressé n’a présenté à la Cour aucun rapport médical ou tout autre document qui puisse établir qu’il a souffert de troubles psychiques allant au-delà du stress et de la tension psychique inhérents à toute mesure de sécurité, même sans violence et abus de pouvoir (voir, mutatis mutandis, Colesnicov c. Roumanie, no 36479/03, § 95, 21 décembre 2010 et a contrario, Erdoğan Yağız c. Turquie, no 27473/02, § 43, CEDH 2007‑III (extraits)). Enfin, il n’a pas soutenu que le port des menottes pendant le transport à l’audience l’ait affecté physiquement.
38. Par conséquent, la Cour n’estime pas établi que le traitement dénoncé a atteint le degré minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
PERRILLAT-BOTTONET c. SUISSE du 20 novembre 2014, requête 66773/13
Non violation de l'article 3 : Le requérant français sort d'un bar suisse, voit deux gendarmes lui mettre un PV sur sa voiture mal stationnée. Il y a une discussion peu aimable. Il refuse d'aller au poste. Il subit une clef de bras pour lui mettre des menottes et l'emmener en cellule de dégrisement. L'action de la police est proportionnée.
7. La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V).
38. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime.
Pour apprécier les éléments qui lui permettent de dire s’il y a eu violation de l’article 3, la Cour se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006‑IX ; Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 117, CEDH 2006‑IX).
39. En cas d’allégations sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour doit se livrer à un examen particulièrement approfondi (Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 59, 24 juillet 2008). Lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre toutefois pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des choses à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Jasar c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 69908/01, § 49, 15 février 2007). Même si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins des éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles ils sont parvenus.
Quelle que soit l’issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l’État défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention ; c’est à lui qu’il appartient de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 trouve à s’appliquer (Selmouni, précité, § 87 ; Rivas c. France, no 59584/00, § 38, 1er avril 2004).
40. En ce qui concerne la question particulière des violences survenues lors de contrôles d’identités ou d’interpellations opérés par des agents de police, la Cour rappelle que le recours à la force doit être proportionné et nécessaire au vu des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000-XII ; Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001). Par ailleurs, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, série A no 336, § 38, et Tekin c. Turquie, 9 juin 1998, §§ 52-53, Recueil 1998-IV).
41. La Cour a déjà admis qu’en présence d’une résistance physique ou d’un risque de comportements violents de la part des personnes contrôlées, une forme de contrainte de la part des agents de police était justifiée (voir, parmi d’autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269 ; Sarigiannis c. Italie, no 14569/05, § 61, 5 avril 2011). La Cour est arrivée aux mêmes conclusions dans des cas de « résistance passive » à une interpellation (Milan c. France, no 7549/03, § 59, 24 janvier 2008), de tentative de fuite face à la force publique (Caloc c. France, no 33951/96, §§ 100-101, CEDH 2000‑IX) ou d’un refus de fouille de la part d’un détenu (Borodin c. Russie, no 41867/04, §§ 119-121, 6 novembre 2012). Il appartient dès lors à la Cour de rechercher si la force utilisée dans ce type de situations est proportionnée au but recherché. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées aux personnes objet de l’intervention et aux circonstances précises dans lesquelles elles l’ont été (voir, parmi d’autres, Klaas c. Allemagne, précité, §§ 26-30 ; Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 72, CEDH 2000‑XII ; R.L. et M.-J.D., R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004).
β) Application de ces principes au cas d’espèce
42. La Cour relève que le requérant admet avoir mal garé sa voiture le soir de l’incident et tardé à présenter ses papiers d’assurance aux gendarmes, auxquels il a répondu avec agacement. Il admet également avoir consommé de l’alcool peu avant l’incident mais soutient qu’en raison de sa forte corpulence, la coupe de champagne et les deux bières qu’il avait bues, ne lui avaient pas causé d’état d’ébriété. Il reconnaît par ailleurs avoir répandu des objets sur la voie publique, infraction pour laquelle il a été acquitté le 13 septembre 2010, le tribunal ayant considéré que l’intérêt public à poursuivre le requérant était de peu d’importance.
43. Le requérant conteste, en revanche, le constat de la Chambre d’accusation, établi dans son ordonnance du 9 juin 2010, selon lequel il avait résisté aux gendarmes lorsque ces derniers avaient tenté de le conduire au poste de police, mais ne fournit aucune explication alternative de la raison pour laquelle les gendarmes lui avaient pratiqué une clé de bras, l’avaient emmené au poste de police et l’avaient placé en cellule de dégrisement. Il considère, toutefois, que son comportement pourrait être considéré, tout au plus, comme de la résistance passive.
44. La Cour note que les déclarations de tous les gendarmes entendus par le Ministère public dans le cadre de l’enquête concordent sur le fait que le requérant était ivre au moment des faits et qu’il avait résisté à l’arrestation.
De son côté, V.A., présent sur les lieux, a reconnu que le requérant et les gendarmes avaient « échangé des piques » et qu’il avait lui-même « tenté de calmer les esprits de part et d’autre » (paragraphe 16 ci-dessus). L’ami du requérant a également admis avoir consommé de l’alcool toute la soirée en compagnie du requérant et avoir d’ailleurs été contrôlé positif au test de l’éthylomètre.
45. Ces éléments suffisent à la Cour pour considérer que les gendarmes se trouvaient face à un risque de débordements (Sarigiannis, précité, § 61) de la part du requérant ou, du moins, que le requérant opposait une forme de résistance passive à leur action (Milan, précité § 59). Le recours à des moyens de coercition, tels qu’une clé de bras, était donc, en principe, justifié.
46. Reste à savoir si les moyens de coercition employés étaient proportionnés à la résistance opposée par le requérant.
47. A cet égard, la Cour relève que le seul moyen de coercition auquel ont eu recours les gendarmes a été la ou les clés de bras pratiquées sur le requérant. En effet, le requérant ne soutient pas que les gendarmes aient employé d’autres moyens de coercition ou lui aient porté des coups de quelque nature que ce soit, ni au moment de l’interpellation, ni pendant son transfert au poste de police et son placement en cellule de dégrisement. En particulier, il n’allègue pas que les gendarmes aient fait usage de matraques ou d’autres armes non-létales généralement employées par les services de police afin d’immobiliser des personnes récalcitrantes.
Or, comme le Gouvernement, la Cour considère qu’une clé de bras, dans le but de passer les menottes, peut s’analyser, dans un contexte de ce type, comme un geste relativement courant qui ne révèle pas, en lui-même, un comportement contraire à l’article 3 de la Convention.
Certes, la rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, dont a été victime le requérant et qui a nécessité un arrêt de travail de 15 jours (paragraphe 10, ci-dessus), dépasse sans aucun doute le seuil de gravité exigé pour que le traitement qui lui a été infligé par les gendarmes tombe sous les coups de l’article 3 de la Convention (mutatis mutandis, Dembele, précité, § 45) mais, à supposer même que le lien de causalité entre cette blessure et la clé de bras eût été scientifiquement établi, il est constant que, compte tenu des antécédents médicaux du requérant, une force de faible importance aurait pu suffire à la provoquer (paragraphe 19 ci-dessus).
Ces éléments conduisent la Cour à conclure que les modalités d’intervention des deux gendarmes, dans leur ensemble, ne révèlent pas un usage disproportionné de la force (a contrario, Dembele, précité, § 47).
48. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, dans son volet matériel.
LE CONTRÔLE D'ALCOOLEMIE A L'HÔPITAL
R.S c. Hongrie du 2 juillet 2019 requête n° 65290/14
Article 3 : Forcer un chauffeur ivre à faire un test urinaire au moyen d’un cathéter est inhumain et dégradant
Dans cette affaire, le requérant avait été contraint de faire un test urinaire au moyen d’un cathéter parce qu’il était soupçonné de conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. La Cour a jugé que les autorités avaient gravement porté atteinte à l’intégrité physique et mentale du requérant, contre son gré, sans que cette mesure eût été nécessaire puisqu’un test sanguin avait également été pratiqué pour déterminer s’il était en état d’ébriété.
 LES FAITS :
LES FAITS :
En mars 2010, il fut mêlé à une bagarre à l’extérieur d’un night-club. Lorsqu’il fut interpellé plus tard cette nuit-là par la police dans sa voiture, il refusa de se soumettre à un éthylotest et il fut arrêté pour être interrogé. Il fut conduit dans un hôpital de manière à ce qu’il puisse être déterminé au moyen de tests sanguins et urinaires s’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. À l’hôpital, le requérant dit au médecin de garde qu’il n’arrivait pas à uriner. Les policiers demandèrent donc au médecin une mise sous cathéter. Cette procédure fut exécutée, et un test sanguin fut pratiqué. Le requérant se plaignit ultérieurement aux autorités de son traitement par la police. Les autorités d’enquête interrogèrent le requérant, les policiers, un conducteur de garde à l’hôpital et le personnel médical. Si tous les témoins s’accordaient à dire que le requérant se trouvait en état d’ébriété, deux versions des faits divergentes apparaissaient. D’un côté, la police alléguait que le requérant avait consenti à l’insertion d’un cathéter, qu’il avait ôté ses vêtements volontairement et qu’il n’avait pas protesté avant l’ouverture de la procédure. Il aurait fait preuve d’agressivité, et il aurait donc fallu l’immobiliser et lui passer les menottes de manière à ce que la procédure soit achevée. D’un autre côté, le requérant affirmait qu’il n’avait jamais consenti au cathéter. De plus, il ajoutait que la police lui avait entravé les jambes pendant l’incident. Les autorités rejetèrent la plainte, retenant la version des faits des policiers selon laquelle le requérant avait consenti au cathéter et n’avait été attaché que pour éviter qu’il ne se blesse. Le requérant forma un recours en justice, avant d’être finalement débouté en juillet 2014.
VIOLATION ARTICLE 3
Tout d’abord, la Cour relève que le droit et la pratique internes sur le recours au cathéter en vue d’obtenir des preuves d’une implication dans une infraction ne sont ni clairs ni cohérents. Elle juge ensuite que le requérant n’a pas donné son consentement libre et éclairé à la mise sous cathéter. Si les autorités ont examiné ses allégations, elles ont décidé de retenir la version des faits livrée par les policiers sans tenir compte de ce que le consentement allégué avait été donné sous l’emprise de l’alcool. D’ailleurs, la Cour doute que le requérant ait eu concrètement d’autre choix que d’accepter l’intervention puisqu’il se trouvait entièrement entre les mains des policiers. En tout état de cause, le droit interne permettait au requérant de retirer son consentement initial à tout moment. Or, il l’avait clairement retiré, comme le montre le fait qu’il avait résisté et avait dû être immobilisé par la police afin que la procédure aboutisse. De plus, aucune raison médicale ne justifiait la procédure, qui visait à l’obtention de preuves, et elle était également inutile puisque les policiers disposaient aussi d’un échantillon sanguin. Rien ne montre non plus que les policiers aient tenu le moindre compte du risque que cette procédure entraînerait pour le requérant. Les autorités ont donc porté une atteinte grave à l’intégrité physique et morale du requérant, contre son gré. La manière dont la procédure a été conduite a pu faire naître chez lui un sentiment d’insécurité, d’angoisse et de stress, et revêtir un caractère humiliant et avilissant. Le requérant a donc subi des douleurs physiques et psychologiques qui s’analysent en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3. Au vu de cette conclusion, la Cour juge inutile d’examiner séparément la recevabilité ou le fond du grief de violation de l’article 8 de la Convention.
VIOLENCES POLICIÈRES DURANT UN CONTRÔLE D'IDENTITÉ
Bădoiu c. Roumanie du 25 juin 2019 requête n° 5365/16
Article 3 : Les défaillances de l’enquête sur un contrôle de police emportent violation de la Convention
La Cour juge en particulier que les autorités d’enquête n’ont pas établi de manière suffisamment précise les faits qui se sont déroulés lors du contrôle de police ainsi qu’au poste de police afin d’établir clairement l’origine et les responsables des blessures du requérant. Ces défaillances leur sont exclusivement imputables.
LES FAITS
Le 8 novembre 2010, vers 23 heures, une voiture de police s’arrêta à proximité d’un groupe d’amis dont faisait partie M. Bădoiu et une équipe de trois policiers procéda à un contrôle d’identité. Les versions du Gouvernement et du requérant divergent quant aux circonstances. M. Bădoiu porta plainte contre les trois policiers qui l’auraient violenté. Le 6 décembre 2010, les policiers en cause déclarèrent que le requérant avait refusé de présenter sa carte d’identité, qu’il aurait accepté de monter dans leur voiture pour se rendre au poste de police, mais serait devenu violent pendant le trajet et une fois arrivé, aurait agressé un policier. Les policiers auraient dû employer la force pour maîtriser et menotter M. Bădoiu. Après vérification de son identité, ils lui auraient infligé une contravention, puis l’auraient relâché. De leur côté, M. Bădoiu ainsi que ses amis nièrent toute violence à l’égard des policiers. M. Bădoiu contesta aussi la présence d’un témoin cité par la police sur les lieux du contrôle et accusa celui-ci d’avoir porté de faux témoignage à l’instigation des policiers. Deux expertises réalisées par l’institut de médecine légale d’Arad et de Timisoara confirmèrent les conclusions d’un premier examen médicolégal réalisé le 12 novembre 2010, à savoir que les blessures de M. Bădoiu avaient nécessité huit ou neuf jours de soins et qu’elles avaient été provoquées par des coups portés au moyen d’objets durs. Le 5 septembre 2012, le parquet interrogea les policiers. Ceux-ci présentèrent une autre version des faits que la première : ils affirmèrent que le requérant était devenu violent lors du contrôle, ce qui les avaient obligés à le menotter. Au poste de police, le requérant se serait jeté au sol et cogné plusieurs fois la tête volontairement contre un grillage métallique. Le 22 janvier 2014, le parquet classa la plainte au motif que les blessures résultaient d’un emploi justifié et proportionné de la force ainsi que d’actes d’auto-agression. Sur contestation de M. Bădoiu, le tribunal d’Arad et la cour d’appel de Timisoara ordonnèrent la réouverture de l’enquête estimant que celle-ci n’avait pas satisfait aux conditions de l’article 3 de la Convention. Le dossier fut transféré au parquet militaire, un des trois policiers ayant un statut de militaire. Le parquet militaire interrogea de nouveau les intéressés. Le 30 avril 2015, le parquet militaire classa la plainte, considérant que les policiers avaient utilisé une force proportionnée et que certaines blessures avaient été volontaires. M. Bădoiu déposa plainte contre les trois policiers, les accusant de subornation de témoin et de présentation de faits controuvés dans le procès-verbal de l’intervention. Le tribunal d’Arad rejeta sa plainte. Le 8 novembre 2010, les policiers infligèrent au requérant une amende pour refus de se soumettre à un contrôle d’identité. Le tribunal d’Arad accueillit la contestation du requérant et annula l’amende, estimant que ce dernier avait été victime de mauvais traitements de la part des policiers. Enfin, le parquet infligea à M. Bădoiu une amende pénale pour outrage aux forces de l’ordre. Par un jugement devenu définitif le 28 mars 2012, le tribunal rejeta la contestation de M. Bădoiu, estimant que ce dernier avait injurié les policiers.
CEDH
ARTICLE 3 : VOLET MATERIEL
39. La Cour renvoie aux principes généraux applicables quant au volet matériel de l’article 3 de la Convention, qu’elle a réitérés dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 81-90, CEDH 2015). Elle rappelle plus particulièrement que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime. En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement. Cela est justifié par le fait que les personnes placées en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Bouyid, précité, § 83).
40. En l’espèce, la Cour constate d’abord qu’il ressort des documents médicaux versés au dossier que, le 8 novembre 2010, le requérant a subi des blessures qui ont nécessité huit ou neuf jours de soins médicaux (paragraphes 15 et 23 ci-dessus). Il ne fait pas de doute que ces blessures étaient d’une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
41. La Cour note ensuite que les parties sont en désaccord quant à l’origine de ces blessures. Le requérant accuse les policiers d’avoir employé la force à son égard, sans aucune justification. Le Gouvernement soutient quant à lui qu’une partie des lésions ont été occasionnées par les policiers à la suite d’un usage de la force qui, selon lui, était nécessaire et proportionné eu égard au comportement violent du requérant. De surcroît, d’après le Gouvernement, le requérant s’est ensuite infligé lui-même d’autres blessures (paragraphes 7-8 et 10 ci-dessus).
42. En ce qui concerne l’argument selon lequel le requérant a eu un comportement violent, la Cour note que, dans leurs premières déclarations, en date du 6 décembre 2010 (paragraphe 19 ci-dessus), qui ont ensuite été réitérées les 14 et 26 janvier 2011 (paragraphe 22 ci-dessus), les policiers indiquèrent que l’intéressé s’était montré « coopératif » et qu’ils n’avaient employé ni la force ni les menottes pour le faire monter dans leur voiture.
43. La Cour observe que le rapport d’incident donne des faits une description différente dont il ressort que le requérant était devenu violent pendant le contrôle (paragraphe 11 ci-dessus). Elle note que les policiers eux-mêmes modifièrent leurs déclarations le 5 septembre 2012 et qu’ils déclarèrent qu’ils avaient menotté le requérant pour le faire monter dans leur voiture (paragraphe 24 ci‑dessus). Néanmoins, à supposer même qu’il fût nécessaire d’utiliser la force pour maîtriser le requérant et le conduire au poste de police, la Cour estime que les multiples traumatismes et lésions présents sur tout le corps du requérant n’étaient pas compatibles avec des simples mesures d’immobilisation. À cet égard, elle note que, selon le certificat médicolégal versé au dossier, ces blessures ont été infligées par des coups répétés portés avec ou contre des corps durs (paragraphes 14, 15 et 16 ci‑dessus).
44. La Cour note ensuite que les policiers ont affirmé que le requérant s’était livré à des actes d’automutilation au poste de police. Il se serait jeté de façon répétée à terre et contre le grillage métallique de la porte d’entrée du poste de police, et il se serait ainsi infligé lui-même certaines blessures (paragraphe 24 ci-dessus).
45. La Cour émet de sérieux doutes quant à la fiabilité de ces déclarations. Elle constate que dans leurs déclarations initiales du 6 décembre 2010, réitérées les 14 et 26 janvier 2011, les policiers n’ont nullement fait état d’actes d’auto-agression (paragraphes 19 et 22 ci-dessus).
46. La Cour note de surcroît que le procès-verbal d’incident ne comportait aucune indication sur les circonstances dans lesquelles le requérant, qui se trouvait menotté et sous le contrôle des policiers dans les locaux de la police, se serait infligé lui-même ces blessures, ni aucune description, fût-elle sommaire, des blessures occasionnées (paragraphe 11 ci-dessus).
47. À cet égard, elle réitère l’importance de consigner par écrit toutes les informations permettant d’éclairer ultérieurement, en cas de besoin, les circonstances relatives à la présence de personnes au poste de police, telles que les blessures visibles sur la personne appréhendée, et de fournir une explication plausible de ce qui s’est passé dans les locaux de la police. La non-consignation de ces informations s’analyse en une défaillance grave, de nature à permettre aux forces de police d’échapper à leur responsabilité en ce qui concerne le sort de la personne se trouvant sous leur contrôle (voir, mutatis mutandis, Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536/01, § 168, 24 juin 2008, et Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 105, CEDH 2000‑VI). En l’occurrence, cette défaillance était d’autant plus grave que les policiers auraient constaté que le requérant était blessé et qu’il saignait (paragraphe 25 ci-dessus).
48. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le requérant a été blessé alors qu’il se trouvait totalement sous le contrôle des policiers, et que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible à ce sujet. Ce constat suffit pour permettre à la Cour de conclure que la responsabilité de l’État se trouve engagée.
49. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
ARTICLE 3 : VOLET PROCEDURAL
52. S’agissant de l’obligation pour les autorités nationales d’ouvrir une enquête et de mener des investigations effectives, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence (El-Masri c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 182-185, CEDH 2012 ; Bouyid, précité, §§ 115-123 ; et Alpar c. Turquie, no 22643/07, §§ 44‑47, 26 janvier 2016).
53. En l’espèce, il n’est pas contesté que les allégations de mauvais traitements étaient « défendables » au sens de la jurisprudence précitée. Une enquête ayant bien eu lieu dans la présente affaire, il reste à apprécier son caractère effectif.
54. La Cour constate que le 22 janvier 2014 le parquet a mis fin à l’enquête en décidant de classer la plainte du requérant sans suite (paragraphe 26 ci-dessus). Elle note que, ce faisant, le parquet a pris en compte la thèse avancée par les policiers selon laquelle les blessures du requérant résultaient d’un emploi justifié et proportionné de la force ainsi que d’actes d’auto-agression.
55. La Cour note d’emblée que le parquet ne s’est pas penché sur le fait que les policiers avaient modifié leurs déclarations, alors même qu’aucune explication n’avait été fournie pour justifier ces modifications. Elle relève qu’au cours des premiers interrogatoires les policiers affirmèrent que le requérant avait été « coopératif » (paragraphe 19 ci-dessus), qu’ils modifièrent leurs déclarations un an et dix mois après les faits et, surtout, qu’ils invoquèrent pour la première fois l’argument de l’auto-agression, laquelle, selon eux, était à l’origine des nombreuses blessures constatées (paragraphe 24 ci-dessus).
56. La Cour note également que les experts désignés dans le cadre des deux expertises ordonnées par le parquet n’ont pas procédé à un examen médical approfondi des blessures, mais qu’ils ont simplement confirmé les conclusions du certificat médicolégal produit par le requérant (paragraphe 23 ci-dessus). Or un examen de chaque lésion, plaie, hématome, ecchymose et contusion constatés sur le corps du requérant aurait pu être déterminant pour accréditer les dires des policiers concernant le lien de causalité entre, d’une part, ces blessures et, d’autre part, les manœuvres d’immobilisation et les actes d’auto-agression allégués, ce qui aurait donné davantage de poids au classement de la plainte.
57. Enfin, la Cour observe que le tribunal d’Arad et la cour d’appel de Timisoara ont estimé que l’enquête du parquet qui avait abouti à l’ordonnance de classement du 22 janvier 2014 ne répondait pas aux exigences de l’article 3 de la Convention (paragraphe 26 ci-dessus). De surcroît, le tribunal d’Arad jugea que le requérant avait été victime de mauvais traitements de la part des policiers (paragraphe 32 ci-dessus).
58. Cependant, malgré ces décisions judiciaires et les contradictions évidentes entre les deux versions des faits présentées par les policiers, le parquet militaire se borna à interroger à nouveau les trois policiers, qui réitérèrent simplement leurs déclarations du 5 septembre 2012 (paragraphe 27 ci-dessus), sans essayer d’obtenir de nouvelles preuves relatives aux faits en question, le cas échéant, au moyen d’une reconstitution des faits ou d’une confrontation de tous les protagonistes de l’affaire. Sur la base de ces seules déclarations, le parquet militaire décida de ne pas rouvrir l’enquête et classa la plainte une seconde fois (paragraphe 27 ci-dessus).
59. Au vu de ces défaillances, qui étaient exclusivement imputables aux autorités d’enquête, la Cour estime que celles-ci n’ont pas établi de manière suffisamment précise les faits qui se sont déroulés lors du contrôle de police et au poste de police afin d’identifier l’origine et les responsables des blessures litigieuses.
60. Par conséquent, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
CAZAN c. ROUMANIE du 5 avril 2016 requête 30050/12
Violation de l'article 3 : Le requérant avocat qui ose poser des questions pour défendre son client, s'est fait tordre les doigts dans un commissariat de police pour un contrôle d'identité. Il n'y a été que 5 minutes pour subir une violence. Le Gouvernement ne précise pas pourquoi il a été blessé. C'est lui qui doit justifier des causes de sa blessure et non le requérant.
38. La Cour renvoie aux principes généraux applicables quant au volet matériel de l’article 3 de la Convention, qu’elle a récemment réitérés dans l’arrêt Bouyid(précité, §§ 81-90).
39. La Cour note qu’en l’espèce les versions des parties sont contradictoires au sujet de l’incident du 12 juillet 2010 ; s’il n’est pas contesté que le requérant a subi une entorse de l’annulaire gauche nécessitant entre cinq et sept jours de soins médicaux, les parties divergent sur les causes de cette entorse. Le Gouvernement s’est particulièrement référé à l’absence d’éléments de preuve à l’appui des allégations du requérant (paragraphe 35 ci-dessus).
40. Toutefois, la Cour rappelle avoir réitéré le principe selon lequel la charge de la preuve des faits survenus lorsqu’une personne se trouve entre les mains de la police ou d’une autorité comparable revient aux autorités ; elle a également précisé que ce principe s’applique même si la personne s’y trouve dans un autre contexte que celui de la privation de liberté proprement dite, comme c’est le cas d’une vérification d’identité ou d’un simple interrogatoire (Bouyid, précité, § 84). Elle a également souligné que l’interdiction de l’utilisation de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par le comportement de la personne l’intéressée s’applique lorsque cette dernière est privée de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confrontée à des agents des forces de l’ordre (Bouyid, précité, § 88). Alors que, à la différence de l’affaire Bouyid précitée, le requérant en l’espèce s’est présenté de son propre gré au poste de police, la Cour note qu’il s’est confronté à un agent des forces de l’ordre en sa qualité d’avocat d’un client qui cherchait des renseignements sur un dossier pénal ouvert contre lui.
41. À cet égard, la Cour attache une importance particulière au fait que le requérant intervenait en sa qualité d’avocat. Elle rappelle avoir déjà reconnu le statut spécifique des avocats qui, en leur qualité d’intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, occupent une position centrale dans l’administration de la justice (Morice c. France [GC], no 29369/10, §§ 132‑133, 23 avril 2015). Elle a également rappelé que les avocats bénéficient de droits et de privilèges exclusifs, qui peuvent varier d’une juridiction à l’autre ; la Cour a ainsi reconnu aux avocats une certaine latitude concernant les propos qu’ils tiennent devant les tribunaux (Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 46, série A no 285‑A, et Steur c. Pays‑Bas, no 39657/98, § 38, CEDH 2003‑XI). Ces principes doivent s’appliquer à plus forte raison lorsqu’il s’agit de reconnaître aux avocats le droit d’exercer leur profession à l’abri de tout mauvais traitement.
42. La Cour estime qu’il revient ainsi à la police de respecter le rôle des avocats, de ne pas s’immiscer indûment dans leur travail, ni de les soumettre à aucune forme d’intimidation ou de tracasserie (voir aux paragraphes 29 et 30 ci-dessus le paragraphe 10 du code européen d’éthique de la police et son exposé des motifs) et par conséquent, à aucun mauvais traitement. Cette obligation doit d’autant plus s’appliquer pour assurer la protection des avocats, agissant en leur qualité officielle, contre les mauvais traitements.
43. Elle estime donc que le principe réitéré dans l’affaire Bouyid précitée quant à la charge de la preuve survenus au poste de police trouve à s’appliquer en l’espèce et que la charge de la preuve incombait aux autorités.
44. Le requérant a produit, tant devant les autorités nationales que devant la Cour, un certificat médical du 12 juillet 2010 et un certificat médico-légal du 16 juillet 2010 qui attestent qu’il a subi une entorse à l’annulaire gauche nécessitant entre cinq et sept jours de soins médicaux (paragraphes 15 et 16 ci-dessus ; voir, a contrario, Çelik c. Turquie (no 1), no 39324/02, § 33, 20 janvier 2009). Or, le Gouvernement n’a présenté aucun élément susceptible de faire douter du récit que le requérant a constamment présenté, à savoir que le policier lui a tordu l’annulaire de la main gauche dans laquelle il tenait son téléphone portable. En effet, alors que le policier a constamment nié dans le cadre de la procédure interne avoir agressé le requérant, ce dernier a affirmé le contraire avec une constance comparable (paragraphes 18 et 20 ci-dessus). Par ailleurs, dès lors que l’instruction présente des déficiences significatives (paragraphes 58-62 ci-dessous), on ne saurait déduire la véracité de la déclaration du policier du seul fait que l’enquête n’a pas apporté d’élément la contredisant (Bouyid, précité, § 96).
45. Par conséquent, la Cour juge suffisamment établi que le requérant a subi une entorse à l’annulaire de la main gauche alors qu’il se trouvait au poste de police.
46. Elle note ensuite que le Gouvernement soutient que la lésion subie par le requérant n’a pas atteint le seuil minimal de gravité requis pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Toutefois, la Cour note que la lésion en cause n’était pas superficielle dans la mesure où il lui a été recommandé de poursuivre les soins médicaux pendant cinq à sept jours (paragraphe 16 ci-dessus).
47. Elle tient en outre à relever que le traitement infligé au requérant n’a aucunement été rendu nécessaire par son comportement. À supposer même que le requérant ait fait preuve d’une attitude irrespectueuse envers le policier (paragraphe 14 ci-dessus), rien dans le dossier n’indique, et le Gouvernement ne le suggère d’ailleurs pas, qu’il ait eu un comportement violent rendant nécessaire l’utilisation de la force physique à son encontre.
48. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu traitement dégradant en l’espèce (mutatis mutandis, Bouyid, précité, § 112).
49. Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
PAS D'ENQUÊTE EFFECTIVE
55. La Cour renvoie aux principes généraux applicables quant au volet procédural de l’article 3 de la Convention, qu’elle a récemment réitérés (Bouyid, précité, §§ 114-123).
56. En l’espèce, au vu des éléments présentés devant elle et notamment du certificat médico-légal du requérant, la Cour considère que les allégations de mauvais traitements étaient « défendables » au sens de sa jurisprudence en la matière.
57. La Cour note ensuite qu’une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire. Il reste à apprécier la diligence avec laquelle elle a été menée et son caractère « effectif ».
58. La Cour relève que, bien que le requérant et son client aient été entendus en août 2010 (paragraphes 18 et 19 ci-dessus), le policier en cause n’a été entendu qu’en août 2011, c’est-à-dire un an après l’incident (paragraphe 21 ci-dessus). Le Gouvernement n’a pas expliqué ce retard de l’enquête. Elle note ensuite qu’en dehors de ces auditions, aucun autre acte d’enquête n’a été effectué en l’espèce ; à cet égard, elle observe que s’il n’y avait pas de témoins oculaires directs, il y avait quand-même d’autres personnes présentes en même temps que le requérant et S.G. au poste de police, tant parmi les policiers que parmi les justiciables (paragraphes 9 et 21 ci‑dessus). En outre, il n’a pas été procédé à une confrontation entre le requérant et le policier en cause, ni à une audition des médecins ayant consulté ou soigné le requérant. De telles mesures auraient pu contribuer à éclaircir les faits.
59. Qui plus est, il ne ressort pas des décisions rendues en l’espèce que le parquet ou la cour d’appel aient examiné les documents médicaux versés au dossier par le requérant, et en particulier le certificat médico-légal (paragraphe 16 ci-dessus). Par ailleurs, dans sa brève décision du 22 novembre 2011, la cour d’appel n’a pas contesté le fait que l’incident du 12 juillet 2010 s’était déroulé de la manière décrite par le requérant dans sa plainte pénale, mais s’est simplement bornée à constater l’absence d’éléments certains prouvant la thèse de la responsabilité pénale, sans pour autant examiner si cette absence d’éléments de preuve était le résultat des carences de l’enquête.
60. À cet égard et sans mettre en cause le raisonnement du Gouvernement quant à la qualification juridique des faits en l’espèce, et en particulier à l’intention requise pour l’établissement concret d’une infraction en droit pénal roumain (paragraphe 53 ci-dessus), la Cour note qu’il intervient après les faits et que les autorités nationales, à qui revenait la tâche de mener une enquête effective en l’espèce, n’ont aucunement procédé à un tel raisonnement.
61. Quant à l’argument du Gouvernement tiré de la possibilité pour le requérant de former une action civile en dommages et intérêts (paragraphe 53 ci-dessus), la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté que si les autorités pouvaient se borner à réagir en cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État en accordant une simple indemnité, sans s’employer à poursuivre et punir les responsables, les agents de l’État pourraient dans certains cas enfreindre les droits des personnes soumises à leur contrôle pratiquement en toute impunité, et l’interdiction légale absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants serait dépourvue d’effet utile en dépit de son importance fondamentale (voir, en ce sens, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 119, CEDH 2010, avec les références citées).
62. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’une enquête
LES AUTORITES DOIVENT FAIRE UNE ENQUÊTE EFFECTIVE SUR LES VIOLENCES DE LA POLICE P.M. et F.F. c. France du 18 février 2021 requête n o 60324/15
Article 3 : Interpellation et garde à vue de deux personnes en état d’ébriété pour faits de dégradation de biens privés : non-violation de la Convention
La CEDH est compétente malgré l'application de l'article L 141-1 du COJ qui permet d'assigner l'Agent Judiciaire de l'Etat, contre les violences de la police.
L’affaire concerne les blessures subies par les deux requérants au cours de leur interpellation à Paris le 1er janvier 2007, en état d’ébriété, pour des faits de dégradation de biens privés et de leur garde à vue par la police. Considérées sous l’angle procédural de l’article 3 de la Convention qui prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants, la Cour estime que les investigations ont été conduites avec diligence et minutie par les autorités nationales qui présentaient les garanties d’indépendance requises. Les autorités se sont sérieusement efforcées d’établir la réalité des faits avant de présenter leurs conclusions par des décisions circonstanciées et dûment motivées. Il s’ensuit que l’obligation de moyens de conduire une enquête effective a bien été respectée par les autorités. Sous l’angle matériel de l’article 3, la Cour note les incohérences qui frappent le récit des requérants. Elle retient, s’agissant des blessures des requérants, que les explications fournies par le Gouvernement sont satisfaisantes, et que les autorités nationales sont arrivées à des conclusions unanimes au terme d’investigations effectives. La Cour estime par conséquent qu’elle n’est pas en position de se départir des appréciations factuelles des juridictions nationales selon lesquelles les requérants n’ont pas été victimes d’un usage de la force non strictement nécessaire.
Art 3 (volet procédural) • Enquête effective sur des allégations défendables de violences infligées par des policiers lors de l’interpellation et la garde à vue des requérants • Diligence, minutie, indépendance et caractère contradictoire et approfondie des différentes investigations • Décisions circonstanciées et dûment motivées
Art 3 (volet matériel) • Traitement inhumain ou dégradant • Aucune raison de s’écarter des appréciations factuelles des juridictions nationales selon lesquelles les requérants n’ont pas été victimes d’un usage de la force non strictement nécessaire
FAITS
Les requérants, MM. P.M. et F.F., deux frères, sont des ressortissants français nés en 1982 et 1978. Le 1 er janvier 2007 à 6 heures du matin, P.M. et F.F. furent interpellés en état d’ébriété dans le 11e arrondissement de Paris pour des faits de dégradation de biens privés. Après leur arrestation et une fouille, ils furent transférés au commissariat de cet arrondissement, puis à l’hôpital Saint-Antoine. Le médecin les ayant examinés et constaté leur état d’ébriété, refusa leur admission à l’hôpital. Ils furent placés à 7 h 45 en chambre de sûreté. Leur garde à vue leur fut notifiée respectivement à 14 h 20 et 15 heures. À 14 h 40 et 15 h 20, l’officier de police judiciaire requit un examen médical et les requérants furent emmenés à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu et examinés par un médecin qui établit pour chacun un certificat médical et constata des lésions. P.M. et F.F. se virent attribuer des interruptions temporaires de travail (ITT) de six jours à la suite du constat de ces lésions. Le 2 janvier à 16 h 50, les gardes à vue des requérants prirent fin. Le 11 janvier 2007, P.M. et F.F. déposèrent plainte auprès du procureur de la République pour violences par personnes dépositaires de l’autorité publique, coups et blessures et traitements cruels inhumains et dégradants. Le 24 janvier 2007, l’Inspection générale des services (IGS) fut saisie pour mener une enquête sur instruction de l’autorité judiciaire. L’IGS auditionna les requérants, les policiers présents au commissariat ainsi que le médecin et l’infirmière ayant examiné les requérants à l’hôpital le jour des faits. Le 25 mai 2007, le parquet classa l’affaire sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Le 4 mars 2008, les requérants furent auditionnés par la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), saisie le 23 mars 2007 par un député de Seine-Saint-Denis à la suite d’une réclamation des requérants concernant les conditions de leur interpellation. Dans son avis du 18 novembre 2008, la CNDS conclut que les fonctionnaires de police avaient utilisé la force pour maîtriser les requérants et ajouta qu’elle n’était pas en mesure d’accréditer les allégations de violences. Elle conclut à l’absence de manquement à la déontologie de la sécurité, mais souligna que le maintien prolongé d’une personne interpellée en position de « décubitus ventral » était de nature à provoquer en certaines circonstances un arrêt cardio-respiratoire et que l’utilisation d’une telle technique devrait être strictement encadrée. Le 17 mars 2008, P.M. et F.F. déposèrent une plainte avec constitution de partie civile du chef de violences volontaires ayant entraîné une « incapacité totale de travail » inférieure ou égale à huit jours, commises en réunion par personnes dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. Le 15 mai 2012, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Les requérants interjetèrent appel. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance. Le 1 er octobre 2013, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 27 mai 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Le 13 avril 2018, le tribunal correctionnel de Paris condamna P.M. et F.F. à trois mois de prison avec sursis pour dégradation, outrage et rébellion commis en réunion. Ils furent également condamnés civilement à indemniser plusieurs agents de police impliqués dans leur interpellation du fait des coups portés et des injures proférées à leur encontre. Les requérants et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Article 3 - volet procédural et volet matériel
Volet procédural
La Cour relève que les requérants ont engagé une procédure pénale, après avoir tout d’abord porté plainte auprès du procureur de la République. Après le classement sans suite de cette plainte, ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction. Les faits litigieux ont fait l’objet d’une saisine de la CNDS. En premier lieu, la Cour note que l’IGS a été saisie très rapidement par le procureur de la République. L’IGS a conduit une enquête approfondie et contradictoire en procédant à l’audition des requérants, de l’ensemble des policiers ayant été en contact avec ces derniers lors des faits litigieux, ainsi que du médecin et de l’infirmière ayant évalué leur état à l’hôpital Saint-Antoine. Elle a conclu qu’aucun élément de l’enquête ne permettait d’accréditer les dires des requérants, ce qui a conduit le parquet à classer l’affaire sans suite. La Cour relève la diligence avec laquelle ces premières investigations ont été menées. En deuxième lieu, le juge d’instruction chargé de l’affaire a procédé à l’audition des requérants, donné commission rogatoire à l’IGS pour auditionner de nouveau les policiers, entendu une nouvelle fois les requérants puis organisé plusieurs confrontations entre les différents protagonistes au cours de l’année 2011. Au terme de cette procédure, il a rendu une ordonnance de non-lieu, dûment motivée. La chambre de l’instruction, saisie en appel, a confirmé la solution adoptée par le juge d’instruction. Enfin, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dont elle a été saisie après avoir relevé que l’information était complète et qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché. En troisième lieu, la CNDS a été saisie. Cette autorité administrative indépendante, dont les missions sont exercées depuis 2011 par le Défenseur des droits, présentait toutes les garanties d’indépendance requises pour conduire une enquête effective. La Cour estime que les investigations ont été conduites avec diligence et minutie par des autorités nationales présentant les garanties d’indépendance requises. Celles-ci se sont sérieusement efforcées d’établir la réalité des faits avant de présenter leurs conclusions par des décisions circonstanciées et dûment motivées. Il s’ensuit que l’obligation de moyens de conduire une enquête effective a bien été respectée par les autorités. La Cour conclut à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
Volet matériel
En premier lieu, la Cour relève que l’affirmation selon laquelle certaines des allégations des requérants ne sont pas compatibles avec la nature de leurs blessures n’est pas contestée par les requérants eux-mêmes. En deuxième lieu, il apparaît que les témoignages font état du calme des policiers contrastant avec l’agressivité des requérants en état d’ébriété particulièrement marqué lors des faits. En troisième lieu, s’agissant de la blessure à la cheville du second requérant, la version présentée par le Gouvernement, selon laquelle l’intéressé se serait blessé en frappant à de nombreuses reprises la porte de sa cellule avec son pied nu, apparaît cohérente et n’est pas sérieusement contredite. S’agissant de la blessure à l’œil du premier requérant, le récit de la victime a varié lors des différentes étapes de la procédure interne et il est entaché de nombreuses imprécisions, incohérences et contradictions. La Cour estime, à l’instar de toutes les autorités nationales qui se sont penchées sur la question, qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette blessure proviendrait d’un usage de la force policière ou qu’elle aurait été provoquée par un usage non strictement nécessaire de la force. En dernier lieu, la Cour relève que l’ensemble des autorités nationales a conclu, au terme d’investigations complètes et par des décisions dûment motivées, à l’absence de manquements établis de la part des policiers mis en cause. Compte tenu des incohérences qui frappent le récit des requérants et du caractère satisfaisant des explications fournies par le Gouvernement s’agissant des blessures, eu égard aux conclusions unanimes des autorités nationales au terme d’investigations effectives menées au plan interne, la Cour estime qu’elle n’est pas en position de se départir des appréciations factuelles des juridictions nationales selon lesquelles les requérants n’ont pas été victimes d’un usage de la force non strictement nécessaire. Il n’y a donc pas eu, en l’espèce, violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
CEDH
a) Sur le volet procédural du grief tiré de l’article 3 de la Convention
Principes généraux
56. Les principes généraux applicables au volet procédural de l’article 3, lorsque sont allégués des mauvais traitements infligés à une personne se trouvant entre les mains d’agents publics, ont été résumés par la Cour dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 115 et suivants, CEDH 2015).
57. Il en ressort que, pour que l’interdiction générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s’adressant notamment aux agents publics s’avère efficace en pratique, il faut qu’existe une procédure permettant d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements infligés à une personne se trouvant entre leurs mains (Bouyid, précité, § 115).
58. Ainsi, notamment, compte tenu du devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », les dispositions de l’article 3 requièrent qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3 (Bouyid, précité, § 116).
59. Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois qui interdisent la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants dans les affaires où des agents ou organes de l’État sont impliqués et de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des mauvais traitements survenus sous leur responsabilité (Bouyid, précité, § 117).
60. D’une manière générale, pour qu’une enquête puisse passer pour effective, il faut que les institutions et les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes qu’elle vise. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (Bouyid, précité, § 118).
61. Quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office. De plus, pour être effective, l’enquête doit permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Elle doit également être suffisamment vaste pour permettre aux autorités qui en sont chargées de prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui ont eu directement et illégalement recours à la force, mais aussi l’ensemble des circonstances les ayant entourés (Bouyid, précité, § 119).
62. Bien qu’il s’agisse d’une obligation non pas de résultat mais de moyens, toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (Bouyid, précité, § 120).
63. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable en découle implicitement. S’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (Bouyid, précité, § 121).
64. La victime doit être en mesure de participer effectivement à l’enquête (Bouyid, précité, § 122).
65. Enfin, l’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête (Bouyid, précité, § 123).
Application de ces principes au cas d’espèce
66. En l’espèce, la Cour considère que, telles qu’exposées dans les plaintes déposées devant les autorités internes, les allégations des requérants d’après lesquelles des policiers leur ont infligé des traitements contraires à l’article 3 de la Convention étaient défendables. Les exigences attachées au respect du volet procédural de cet article obligeaient donc les autorités nationales à mener une enquête effective.
67. La Cour relève en premier lieu qu’une procédure pénale a été engagée par les requérants, ceux-ci ayant tout d’abord porté plainte auprès du procureur de la République puis, postérieurement au classement sans suite de cette plainte, déposé plainte avec constitution de partie civile dans les mains d’un juge d’instruction. Elle observe en second lieu que les faits litigieux ont fait l’objet d’une saisine de la CNDS.
68. Il lui revient de déterminer si ces procédures ont satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention telles que rappelées aux paragraphes 58 à 63 ci-dessus.
69. En premier lieu, la Cour note que l’IGS a été saisie très rapidement par le procureur de la République, à la suite du dépôt de plainte par les requérants. Il ressort des pièces versées au dossier que l’IGS a conduit, sur instruction de l’autorité judiciaire, une enquête approfondie et contradictoire en procédant à l’audition des requérants, de l’ensemble des policiers ayant été en contact avec ces derniers lors des faits litigieux, ainsi que du médecin et de l’infirmière ayant évalué leur état à l’hôpital Saint-Antoine (paragraphe 20 ci-dessus). Elle a conclu qu’aucun élément de l’enquête menée ne permettait d’accréditer les dires des requérants, ce qui a conduit le parquet à classer l’affaire sans suite moins de cinq mois après les événements ayant donné lieu à la plainte. La Cour relève la diligence avec laquelle ces premières investigations ont été menées.
70. En deuxième lieu, la Cour relève qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des requérants, formée près d’un an après le classement sans suite de leur première plainte par le parquet, le juge d’instruction chargé de l’affaire a procédé à leur audition, a donné commission rogatoire à l’IGS pour auditionner de nouveau les policiers présents lors des faits litigieux, a entendu une nouvelle fois les requérants puis a organisé plusieurs confrontations entre les différents protagonistes au cours de l’année 2011. Au terme de cette procédure et en l’absence de charges suffisantes contre quiconque, il a rendu une ordonnance de non-lieu, dûment motivée. La chambre de l’instruction, saisie en appel par les requérants, a confirmé la solution adoptée par le juge d’instruction. Enfin, la Cour de cassation a rejeté, au visa de l’article 3 de la Convention, le pourvoi dont elle était saisie après avoir relevé que l’information avait été complète et qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché.
71. En troisième et dernier lieu, la Cour relève qu’indépendamment des investigations menées dans le cadre des procédures pénales, la CNDS a été saisie. La Cour note que cette autorité administrative indépendante, dont les missions sont exercées depuis 2011 par le Défenseur des droits, présentait toutes les garanties d’indépendance requises pour conduire une enquête effective. Dans le cadre de l’examen contradictoire qu’elle a effectué de la situation litigieuse, elle a procédé, en 2008, à l’audition des requérants et des fonctionnaires de police mis en cause. Sur le fondement non seulement des pièces de la procédure pénale mais aussi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de ses propres investigations, elle a conclu à l’absence de manquement à la déontologie de la sécurité après avoir constaté qu’il avait été fait usage de la force mais qu’il n’était pas établi que les blessures des requérants étaient imputables à des violences policières illégitimes (paragraphe 22 ci-dessus).
72. S’agissant de ces différentes enquêtes et procédures, la Cour relève que les requérants ne dénoncent aucunement un manque de célérité ou une carence de la part des autorités nationales. Leurs critiques portent essentiellement sur le sens des décisions adoptées par celles-ci. Pour sa part, eu égard à l’ensemble des éléments présentés ci-dessus, la Cour estime que les investigations menées à la suite de la plainte des requérants pour apprécier le bien-fondé de leurs allégations ont été conduites avec diligence et minutie, par des autorités nationales présentant au cas d’espèce les garanties d’indépendance requises, au demeurant non contestées par les requérants, et qui se sont sérieusement efforcées d’établir, de manière contradictoire, la réalité des faits avant de présenter leurs conclusions par des décisions circonstanciées et dûment motivées. Il s’ensuit que l’obligation de moyens de conduire une enquête effective pesant sur les autorités internes a été respectée en l’espèce.
73. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
b) Sur le volet matériel du grief tiré de l’article 3 de la Convention
Principes généraux
74. La Cour souligne que sa jurisprudence relative aux mauvais traitements subis par des personnes placées sous le contrôle des forces de police, en particulier en garde en vue, est bien établie et se trouve notamment rappelée dans son arrêt Bouyid (précité, §§ 81 et suivants).
75. Il ressort de cette jurisprudence que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. En effet, l’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et, d’après l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée (Bouyid, précité, § 81).
76. En premier lieu, la Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré, étant entendu que la circonstance qu’un traitement n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser la victime n’exclut pas de façon définitive un constat de violation de l’article 3. Doit également être pris en compte le contexte dans lequel le traitement a été infligé, telle une atmosphère de vive tension et à forte charge émotionnelle (Bouyid, précité, § 86). Lorsqu’un individu est confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Bouyid, précité, § 88).
77. En deuxième lieu, la Cour rappelle qu’en principe, les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Bouyid, précité, § 82).
78. S’agissant de l’administration de la preuve, la Cour rappelle toutefois que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime. En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement. Cela est justifié par le fait que les personnes placées en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Bouyid, précité, § 83).
79. En troisième et dernier lieu, si la Cour reconnaît qu’elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie, elle rappelle qu’elle doit se livrer à un examen particulièrement attentif lorsque des allégations sont formulées sur le terrain de l’article 3 de la Convention, quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées au plan interne. En d’autres termes, la Cour est disposée, dans un tel contexte, à examiner d’une manière approfondie les conclusions des juridictions nationales. Pour ce faire, elle peut prendre en compte la qualité de la procédure interne et toute déficience propre à vicier le processus décisionnel (Bouyid, précité, § 85).
Application de ces principes au cas d’espèce
80. En premier lieu, la Cour relève que l’ensemble des certificats médicaux établis à l’époque des faits ont constaté que les deux requérants souffraient de plusieurs blessures et lésions corporelles (voir pour leur description les paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Ces dernières, même si elles n’ont pas laissé de séquelles, ont justifié une interruption temporaire de travail de six jours pour chacun des requérants. Elles apparaissent d’une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Il n’est par ailleurs pas contesté que ces blessures sont survenues au cours de la période comprise entre l’interpellation des requérants et la fin de leur garde à vue (paragraphe 53 ci-dessus). Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 79 ci-dessus qu’alors même qu’elle ne remplit pas le rôle d’un juge du fait, la Cour doit se livrer, au cas d’espèce, à un examen particulièrement attentif des circonstances de l’affaire compte tenu tant des allégations des requérants que des explications fournies par le Gouvernement. Toutefois, elle rappelle que lorsque des procédures internes ont été menées, il ne lui appartient pas de substituer sa propre version à celle des autorités internes qui doivent établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (Castellani c. France, no43207/16, § 65, 30 juillet 2020).
81. En deuxième lieu, la Cour constate que les parties sont en désaccord quant au fait générateur de ces blessures. Les événements litigieux s’étant produits alors que les requérants se trouvaient sous le contrôle des forces de l’ordre, il résulte des principes rappelés ci-dessus (paragraphes 76 à 78 ci‑dessus) qu’il existe, au profit des allégations des requérants, une « forte présomption de fait » et qu’il revient au Gouvernement de fournir des explications suffisamment convaincantes pour la renverser en démontrant l’absence de crédibilité du récit des requérants et en justifiant devant la Cour soit que leurs blessures ne sont pas imputables aux forces de l’ordre soit qu’elles résultent d’un usage de la force rendu strictement nécessaire par le comportement des personnes en cause.
82. Alors que les requérants affirment avoir été victimes de violences policières illégitimes ainsi qu’en attestent leurs blessures, le Gouvernement soutient au contraire que certaines de leurs allégations sont démenties par les pièces du dossier, qu’une partie des lésions corporelles ont été occasionnées par les policiers à la suite d’un usage de la force qui, selon lui, était nécessaire et proportionné au comportement des requérants et enfin que le second requérant s’est infligé lui‑même une partie de ses blessures. Pour leur part, les requérants réfutent cette présentation des faits litigieux, l’estimant non démontrée, sans toutefois faire état devant la Cour de leur propre version des faits.
83. En ce qui concerne l’établissement des faits, la Cour souligne l’absence, dans les écritures des requérants devant elle, de récit circonstancié et documenté des événements qui auraient selon eux conduit à ce qu’ils soient blessés. Elle dispose de leurs seuls témoignages auprès des autorités internes (paragraphe 16 ci-dessus) qui, ainsi que le souligne le Gouvernement, manquent notablement de constance et sont pour partie entachés de contradiction comme le relève en particulier l’ordonnance de non-lieu du 15 mai 2012 (paragraphe 32 ci-dessus). Au contraire, la présentation des faits litigieux par le Gouvernement, qui repose notamment sur des témoignages qui n’ont jamais varié dans le temps, est cohérente et n’est pas sérieusement contestée par les requérants.
84. En premier lieu, la Cour relève que l’affirmation selon laquelle certaines des allégations des requérants, en particulier le fait qu’ils auraient été piétinés et étranglés à plusieurs reprises, ne sont pas compatibles avec la nature de leurs blessures (paragraphe 33 ci-dessus) n’est pas contestée par les requérants. En outre, la Cour note que les témoignages du médecin et de l’infirmière qui ont évalué l’état des requérants à l’hôpital Saint-Antoine contredisent formellement certaines autres de leurs allégations, notamment que l’un d’entre eux aurait été amené sans connaissance à l’hôpital, tandis que l’autre aurait présenté lors de son examen une hémorragie au niveau du nez (paragraphes 20 et 32 ci-dessus).
85. En deuxième lieu, il apparaît que ces mêmes témoignages font état du calme des policiers contrastant avec l’agressivité des requérants qui étaient dans un état d’ébriété particulièrement marqué lors des faits, ainsi qu’en attestent l’éthylotest auquel ils ont été soumis, les fiches A et les constats opérés par le médecin de garde à l’hôpital Saint‑Antoine (paragraphes 5 et 20 ci-dessus). S’agissant de leur comportement, les requérants se sont d’ailleurs pour partie retranchés derrière une amnésie qu’aurait provoquée leur imprégnation alcoolique tout au long de la procédure pénale (paragraphes 20, 27 et 32 ci-dessus) et dans le cadre des poursuites pénales engagées contre eux pour coups et injures à l’encontre de plusieurs policiers (paragraphe 35 ci-dessus), et pour lesquels ils ont été condamnés en première instance. En outre, la plupart des blessures constatées peuvent s’expliquer par le recours aux techniques de contention et de maintien au sol utilisées par les policiers dans la présente affaire et dont la défense du Gouvernement fait état. Compte tenu de l’agressivité des requérants, unanimement constatée par les témoins des faits de l’espèce, et de leur comportement vis-à-vis des policiers tel qu’il résulte de l’instruction, le recours à ces techniques ne traduit pas, au cas d’espèce, un usage de la force autre que celui qui était strictement nécessaire pour éviter que les requérants ne blessent des tiers ou ne se blessent eux‑mêmes. Il s’ensuit que les éléments fournis par le Gouvernement sont suffisants pour convaincre la Cour que la plupart des blessures des requérants résultent de l’utilisation de la force rendue strictement nécessaire par leur comportement.
86. En troisième lieu, il reste à s’interroger sur deux blessures des requérants, une entorse à la cheville et un hématome au niveau de l’œil, qui revêtent un caractère de gravité plus important que les autres et posent la question de l’usage strictement nécessaire de la force par les policiers ainsi d’ailleurs que l’a relevé la chambre de l’instruction au stade de l’appel. S’agissant de la blessure à la cheville du second requérant, la version présentée par le Gouvernement, selon laquelle l’intéressé se serait blessé en frappant à de nombreuses reprises la porte de sa cellule avec son pied nu, apparaît cohérente et n’est pas sérieusement contredite. S’agissant de la blessure à l’œil, la Cour ne peut que constater que le récit du premier requérant a varié sur le sujet lors des différentes étapes de la procédure interne et qu’il est entaché de nombreuses imprécisions, incohérences et contradictions. Elle note que les allégations du requérant sur ce point ne sont assorties d’aucune précision dans les écritures devant elle qui se limitent, tout particulièrement sur ce point, à des généralités et à des affirmations non étayées. Dans ces conditions, la Cour estime, à l’instar de toutes les autorités nationales qui se sont penchées sur la question, qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette blessure proviendrait d’un usage de la force policière à l’encontre du premier requérant ni, a fortiori, qu’elle aurait été provoquée par un usage non strictement nécessaire de la force.
87. En dernier lieu, la Cour relève que l’ensemble des autorités nationales qui ont été amenées à se prononcer sur le bien-fondé des allégations des requérants ont conclu, au terme d’investigations complètes et effectives (paragraphes 66 à 72 ci-dessus) et par des décisions dûment motivées, à l’absence de manquements établis de la part des policiers mis en cause.
88. Compte tenu, d’une part, des incohérences qui frappent le récit des circonstances litigieuses par les requérants et, d’autre part, du caractère satisfaisant des explications fournies par le Gouvernement s’agissant de leurs blessures et eu égard aux conclusions auxquelles sont unanimement parvenues les autorités nationales au terme des investigations effectives menées au plan interne, la Cour estime qu’elle n’est pas en position, au vu des éléments dont elle dispose, de se départir des appréciations factuelles des juridictions nationales selon lesquelles les requérants n’ont pas été victimes, lors de leur interpellation et de leur garde à vue, d’un usage de la force non strictement nécessaire.
89. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
JURASZ c. POLOGNE du 22 novembre 2018 Requête 48327/09
Violation de l'article 3 : L'enquête contre les violences de la police subies par le requérant, n'a pas respecté les obligations tirées de l'article 3 pour cause de lenteur de l'enquête et de la procédure
46. Le requérant soutient que la procédure menée par les autorités nationales sur ses allégations de mauvais traitements n’a été ni rapide ni diligente. L’enquête du parquet aurait été hâtivement clôturée sur la base des seules déclarations des agents impliqués ; puis, sans aucune raison valable, les juridictions de deux degrés auraient omis de prendre en considération l’expertise favorable à sa version et, de son côté, le parquet n’aurait rien fait pour rectifier cette erreur. Enfin, plus de sept ans se seraient écoulés entre le dépôt de sa plainte et la date de clôture de la procédure y relative.
47. Le Gouvernement soutient que la procédure diligentée sur les allégations de mauvais traitements du requérant a été adéquate, approfondie et effective et que sa durée s’explique par un grand nombre d’instances dédiées à son instruction. Les juridictions nationales de première et de seconde instance auraient tenu leurs audiences à des intervalles réguliers et leurs erreurs auraient été rectifiées en application de l’arrêt de la Cour suprême. Enfin, la procédure aurait abouti à la fois à la condamnation des agents impliqués et à l’indemnisation du requérant.
48. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose aux autorités nationales, lorsqu’une personne allègue de manière défendable avoir été victime d’actes contraires à cette disposition, le devoir de mener une enquête officielle effective propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et, le cas échéant, la punition des responsables. Lorsque, comme en l’espèce, les investigations préliminaires effectuées ont entraîné l’ouverture de poursuites pénales devant les juridictions nationales, les exigences procédurales de l’article 3 précité s’étendent à l’ensemble de la procédure, y compris à la phase de jugement (N.A. c. République de Moldova, no 13424/06, § 65, 24 septembre 2013).
49. La Cour rappelle en outre que la célérité avec laquelle l’enquête est ouverte et celle avec laquelle elle est conduite sont des facteurs importants permettant de conclure à l’effectivité de ladite enquête et de vérifier si les autorités avaient la volonté d’identifier et de poursuivre les responsables (Mikheïev c. Russie, no 77617/01, § 109, 26 janvier 2006, et Dedovski et autres c. Russie, no 7178/03, § 89, 15 mai 2008).
50. En l’espèce, la Cour observe que l’enquête du parquet, ouverte trois mois après le dépôt de la plainte du requérant, a été abandonnée à peine un mois plus tard, au motif d’une absence d’éléments montrant que les infractions reprochées aux policiers mis en cause avaient été commises. Pour ce faire, le parquet s’est essentiellement fondé sur deux éléments, à savoir les déclarations des agents impliqués et le rapport d’expertise ayant conclu à l’impossibilité de déterminer précisément l’origine des contusions présentées par le requérant (paragraphe 13 ci‑dessus). Eu égard à ces éléments et à la rapidité avec laquelle l’instruction a été abandonnée, la Cour doute qu’à ce stade les autorités nationales aient été animées d’une volonté déterminée d’identifier et de poursuivre les responsables des traitements infligés à l’intéressé.
51. La Cour note que l’enquête en question a été reprise environ un an et quatre mois plus tard sur la base d’un rapport d’expertise remis dans le cadre d’une autre procédure et que, dans un délai assez bref, elle a donné lieu à l’inculpation des agents impliqués devant un tribunal. Par deux jugements consécutifs prononcés en l’espace de trois ans, ces derniers ont été innocentés ; puis les jugements rendus en leur faveur ont été invalidés par la Cour suprême au motif qu’ils avaient été rendus en violation manifeste des règles procédurales. Bien qu’il ne lui appartienne pas de se prononcer sur les éventuelles erreurs commises par les juridictions nationales, en l’espèce, la Cour ne peut que constater que les irrégularités identifiées par la Cour suprême dans son arrêt du 21 novembre 2014 ont contribué à allonger considérablement la procédure. Au total, plus de sept années se sont écoulées entre le dépôt de la plainte du requérant et l’identification et la punition par la justice des responsables des mauvais traitements subis par ce dernier.
52. Ce délai, combiné à l’absence de diligence requise des autorités lors de la phase initiale de l’instruction et aux erreurs commises par les juridictions de première et de seconde instance, amène la Cour à constater que la procédure menée en l’espèce n’a pas pleinement satisfait aux exigences procédurales de l’article 3 de la Convention (Zayev c. Russie, no 36552/05, § 115, 16 avril 2015).
53. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural.
VATANDAŞ c. TURQUIE du 15 mai 2018 requête 37869/08
article 3 et violences de la police : une enquête effective n’est pas une obligation de résultat mais de moyens. En l’espèce, la Cour observe qu’il n’y a pas de désaccord entre les parties pour dire que la blessure du requérant, à savoir une fracture intra‑articulaire du coude, atteint le « seuil de gravité nécessaire » pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention et qu’elle est survenue durant l’intervention de la police anti-émeute. Or les policiers anti-émeute auteurs de l’intervention en cause n’ont jamais été identifiés, faute de recherches en ce sens, et ce malgré les allégations répétées du requérant, concordantes avec les dépositions des policiers chargés de son transfert et de son placement en garde à vue. La Cour observe aussi que la procédure s’est soldée par la constatation de la prescription pénale des faits, situation qu’elle a qualifiée à maintes reprises d’incompatible avec les exigences procédurales de l’article 3 de la Convention
CEDH
23. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation, lesquels lui auraient causé une fracture du coude. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il se plaint aussi que l’enquête menée à l’encontre des policiers, qui a abouti à l’extinction de la procédure pénale pour prescription, a été ineffective.
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement déplore l’inactivité du requérant pendant une période de plus de quatre ans entre l’acquittement des policiers en première instance et l’appel introduit à cet égard. Se référant aux décisions Bayram et Yıldırım c. Turquie ((déc.), no 38587/97, ECHR 2002‑III), et Bulut et Yavuz c. Turquie ((déc.) no 73065/01, 28 mai 2002), il invite ainsi la Cour à déclarer la requête irrecevable aux motifs que le requérant n’a pas respecté le délai de six mois et qu’il n’a pas fait preuve de diligence quant à la poursuite de ses griefs.
25. Le requérant argue avoir été dûment qualifié de partie intervenante par le tribunal correctionnel et déclare que tout acte juridique relatif à cette procédure aurait dû lui être notifié conformément à la législation en la matière.
26. La Cour rappelle que les intéressés sont effectivement censés prendre des mesures pour se tenir informés de l’état d’avancement de l’enquête, ou de sa stagnation, au risque de se voir reprocher de la négligence (Bayram et Yıldırım, décision précitée, Bulut et Yavuz, décision précitée, et Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 autres, § 158, CEDH 2009). Les requérants potentiels doivent en effet s’enquérir de manière diligente de l’état d’avancement de l’enquête pénale. Un requérant doit agir dès qu’il apparaît clairement qu’aucune enquête effective ne sera menée, c’est-à-dire dès qu’il devient manifeste que l’État défendeur ne s’acquittera pas de son obligation au regard de la Convention (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, §§ 262-263, CEDH 2014 (extraits)). La Cour a estimé qu’il était indispensable que les personnes qui entendaient se plaindre devant elle du manque d’effectivité d’une enquête ou de l’absence d’enquête ne tardent pas indûment à la saisir de leur grief. Après un laps de temps considérable, lorsque l’activité d’investigation est marquée par d’importantes lenteurs et interruptions, vient un moment où les intéressés doivent se rendre compte qu’il n’est et ne sera pas mené une enquête effective. La Cour a cependant jugé que, tant qu’il existe un contact véritable entre ces derniers et les autorités au sujet des plaintes et des demandes d’information, ou un indice ou une possibilité réaliste que les mesures d’enquête progressent, la question d’un éventuel retard excessif de la part des requérants ne se posait généralement pas (même référence, §§ 266-269). Or, en l’espèce, le requérant pouvait légitimement croire que les autorités nationales s’orientaient vers l’identification et la poursuite des véritables auteurs des violences d’autant plus que ses allégations concordaient avec les dépositions des policiers chargés de son transfert.
27. En outre, la Cour constate que le pourvoi du requérant a bel et bien été déclaré recevable malgré le laps de temps important qui s’était écoulé entre le jugement du tribunal correctionnel du 22 avril 2004 et le pourvoi introduit le 11 juillet 2008. Ceci était vraisemblablement dû au fait que la législation nationale prévoyait la notification du jugement à la partie intervenante, laquelle n’a eu lieu que le 25 juillet 2008. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas indiqué que le requérant avait été informée du jugement en question avant le 11 juillet 2008, date de connaissance du jugement déclarée par l’intéressé (voir mutatis mutandis, El-Masri c. l’ex‑République Yougoslave de Macédoine ([GC], no 39630/09, § 147). Eu égard à ce qui précède, la Cour ne peut attribuer au requérant une négligence quelconque dans la poursuite de sa plainte, étant considéré de surcroît que la procédure était en phase de jugement (voir, a contrario, Bayram et Yıldırım, ainsi que Bulut et Yavuz, décisions précitées). Par conséquent, elle rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
28. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
29. Le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements et considère que l’enquête menée à cet égard était ineffective. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention.
30. Le Gouvernement conteste ces allégations et considère que la force utilisée à l’égard du requérant était nécessaire et proportionnelle pour disperser une manifestation illégale.
31. La Cour considère que ces griefs doivent être examinés uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
32. Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri (précité, §§ 182-185 et 195-198), Mocanu et autres (précité, §§ 314-326, CEDH 2014 (extraits)), et Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH 2015).
33. La Cour a déjà dit que l’obligation d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements n’est pas une obligation de résultat mais de moyens. L’enquête doit être en principe de nature à conduire à l’établissement des faits et, si les allégations se révèlent vraies, à l’identification et à la sanction des responsables (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 98, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, Mikheïev c. Russie, no 77617/01, § 107, 26 janvier 2006, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 65, CEDH 2006‑XII (extraits), et Mehmet Fidan c. Turquie, no 64969/10, §§ 46-49, 16 décembre 2014).
34. La Cour rappelle aussi que, lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (Salin et Karşin c. Turquie, no 44188/09, § 60, 23 juin 2015, Bouyid, précité, §§ 56 et 88).
35. En l’espèce, la Cour observe qu’il n’y a pas de désaccord entre les parties pour dire que la blessure du requérant, à savoir une fracture intra‑articulaire du coude, atteint le « seuil de gravité nécessaire » pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention et qu’elle est survenue durant l’intervention de la police anti-émeute. Or les policiers anti-émeute auteurs de l’intervention en cause n’ont jamais été identifiés, faute de recherches en ce sens, et ce malgré les allégations répétées du requérant, concordantes avec les dépositions des policiers chargés de son transfert et de son placement en garde à vue. La Cour observe aussi que la procédure s’est soldée par la constatation de la prescription pénale des faits, situation qu’elle a qualifiée à maintes reprises d’incompatible avec les exigences procédurales de l’article 3 de la Convention (Mehmet Yaman c. Turquie, no 36812/07, § 67-72, 24 février 2015, et Ali Aba Talipoğlu c. Turquie, no 16408/10, §§ 33-35, 18 octobre 2016).
36. Au vu de ce qui précède, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Chatzistavrou c. Grèce du 1er mars 2018 requête n° 49582/14
Non violation de l'article 3 sur les faits et l'enquête ; les allégations de la requérante sur une agression d'un policier sont contredites par trois témoignages.
1. Sur l’absence d’une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements
51. L’obligation de mener une enquête effective sur des allégations de traitements contraires à l’article 3 subis par une personne aux mains d’agents de l’État est bien établie dans la jurisprudence de la Cour. À cet égard, la Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et, le cas échéant, à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (voir, par exemple, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 317, CEDH 2014 (extraits), Cestaro c. Italie, no 6884/11, §§ 204-212, 7 avril 2015, Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114‑123, CEDH 2015, et Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 103, CEDH 2016).
52. La Cour rappelle ensuite que l’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête (Assenov et autres, précité, § 103, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV, et Bouyid, précité, § 123). Les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables à leur disposition pour obtenir les preuves relatives à l’incident en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et les expertises criminalistiques (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 104, CEDH 1999‑IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les causes du dommage ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (Boicenco c. Moldova, no 41088/05, § 123, 11 juillet 2006).
53. En l’espèce, eu égard aux éléments du dossier, et notamment au témoignage écrit de Mme M.S. et aux certificats médicaux présentés par la requérante, la Cour considère que les allégations de mauvais traitement subi par celle-ci étaient « défendables » au sens de la jurisprudence précitée. Elle note d’ailleurs que le policier mis en cause était en service dans le tribunal et chargé du maintien de l’ordre. Il incombe donc à la Cour d’apprécier la diligence avec laquelle les autorités ont enquêté sur ces allégations et le caractère effectif des démarches entreprises.
54. S’agissant de la procédure devant le tribunal correctionnel, la Cour note que l’audience a eu lieu le 13 janvier 2014 et que, avant cette date, elle avait déjà été reportée à six reprises, dont deux pour cause d’empêchement de l’avocat de la requérante et trois pour cause de non-comparution des témoins, dont la requérante elle-même et Mme M.S. Dans ces conditions, la Cour ne saurait reprocher au tribunal correctionnel d’avoir décidé la tenue de l’audience, en dépit de l’absence de la requérante, auteur de la plainte, et de Mme M.S., principal témoin à charge. À cet égard, elle note que la requérante n’a pas fait valoir, pour expliquer son absence à l’audience du 13 janvier 2014, d’autre motif que des problèmes de santé et que l’absence de Mme M.S. n’a aucunement été justifiée. Elle relève aussi qu’il convenait de tenir compte de la circonstance que les faits remontaient à 2008, ce qui faisait courir un risque de prescription des infractions reprochées au policier M.M. Ainsi, le tribunal a donné lecture des vingt et un documents constituant le dossier (dont huit certificats médicaux) et a entendu les trois témoins à décharge, qui étaient présents à l’audience. Enfin, la Cour souligne que la requérante était représentée par un avocat tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience devant le tribunal correctionnel et – comme l’indique le Gouvernement – qu’elle avait tous les droits reconnus par le droit interne à la partie civile.
55. Certes, le tribunal correctionnel a choisi de fonder sa décision sur les dépositions des témoins à décharge. Pour autant, la Cour considère, compte tenu de l’absence des deux témoins à charge principaux combinée avec l’historique des ajournements de l’audience, que, en choisissant de donner la primauté à la version des témoins à décharge, le tribunal n’a pas failli à son obligation d’examiner de manière approfondie l’affaire devant lui. La Cour réitère, à cet égard, sa jurisprudence selon laquelle elle ne peut apprécier elle‑même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, à moins de s’ériger en juge de « quatrième instance » et de méconnaître les limites de sa fonction (voir, parmi beaucoup d’autres, Viorica Marean c. Roumanie (déc.), no 61553/08, § 30, 30 juin 2015).
56. Quant à la procédure devant les instances disciplinaires, la Cour note que, le 6 décembre 2010, le directeur de la police de l’île d’Eubée a décidé de révoquer la décision portant classement de l’affaire et d’ordonner une « enquête administrative sous serment » et que, le 18 avril 2011, l’officier chargé de l’enquête a proposé de suspendre la procédure disciplinaire en attendant l’issue de la procédure pénale. En dépit de cette décision, le 2 mai 2011, le directeur de la police de la région de Sterea Ellada a renvoyé le policier M.M. devant le conseil de discipline des fonctionnaires de police de première instance, et, par une décision du 16 juillet 2012, ledit conseil a estimé avérés les faits reprochés à cet agent et a suspendu ce dernier de ses fonctions pour une durée de deux mois. Le 21 octobre 2013, statuant sur un recours de M.M. contre cette décision, le conseil de discipline des fonctionnaires de police de deuxième instance a conclu qu’il n’avait pas été établi que l’intéressé avait commis les actes qui lui étaient reprochés.
57. Plus particulièrement, en ce qui concerne la procédure devant le conseil de discipline des fonctionnaires de police de deuxième instance, la Cour relève l’argument de la requérante selon lequel la minorité des membres de ce conseil avait indiqué, dans son opinion dissidente, que les dépositions des témoins à décharge avaient été le résultat de pressions exercées sur eux par la police dans le but de les faire témoigner dans un sens favorable à M.M. Or, comme l’affirme le Gouvernement, il ressort de la lecture de cette opinion que cette allégation est sans fondement factuel et que c’était la requérante qui, dans le cadre de l’ « enquête administrative sous serment », avait prétendu que des pressions avaient été exercées sur ces témoins.
58. En conclusion, la Cour estime que les autorités nationales ont mené une enquête propre à permettre de répondre à la question de savoir si la requérante avait ou non subi un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
59. Il n’y a donc pas eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
2. Sur l’allégation de mauvais traitement infligé par le policier M.M.
60. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour et notamment de l’arrêt Bouyid ([GC], précité), la requérante soutient que ses blessures ont été causées par le policier M.M, qui l’aurait agressée et lui aurait asséné des coups. Elle allègue que, le jour de l’incident, ce policier, alors en service au moment des faits, l’a insultée, l’a frappée à la tête, l’a jetée par terre et lui a donné un coup de pied au bras. Elle indique que la gravité de ses blessures est attestée par les huit certificats médicaux produits en justice, qui auraient été établis immédiatement après l’agression alléguée, et surtout par le rapport du médecin légiste, ayant conclu à l’existence d’« une lésion corporelle grave » causée par « un instrument obtus et contondant ». Elle estime que le seul responsable de ses blessures était le policier M.M., ce qui ressortirait non seulement de l’attestation sous serment de Mme M.S., présentée par elle comme témoin oculaire, mais aussi de la décision du conseil de discipline des fonctionnaires de police de première instance et de l’avis exprimé par la minorité des membres du conseil de discipline des fonctionnaires de police de deuxième instance dans la décision rendue par ce dernier.
61. Le Gouvernement réplique que les conditions pour l’application de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel ne se trouvent pas réunies en l’espèce. Il marque son désaccord avec la manière dont la requérante relate les circonstances de l’espèce. Il déclare ne pas remettre en cause le fait que la requérante a été blessée – tel qu’attesté par l’hôpital de Chalkida –, mais conteste la gravité des blessures et surtout l’origine de celles-ci telles que décrites par l’intéressée. Il indique que les rapports médicaux joints par la requérante à sa requête devant la Cour ne prouvent pas que celle-ci a été blessée par le policier M.M. : d’après lui, si lesdits rapports attestent de certaines blessures, ils n’établissent pas si celles-ci avaient pour cause des violences exercées par le policier ou la chute de la requérante dans la rue.
62. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au‑delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).
63. La Cour relève que, à la suite de la plainte de la requérante, le procureur près la cour d’appel d’Athènes a décidé, le 9 août 2010, d’engager des poursuites contre le policier M.M. Le 28 juillet 2013, ce dernier a été renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel de Chalkida pour répondre des accusations de lésion corporelle grave, dégradation de biens, insulte et menace. Entre-temps, le 2 mai 2011, le directeur de la police de la région de Sterea Ellada avait renvoyé cet agent devant le conseil de discipline des fonctionnaires de police de première instance, et, par une décision du 16 juillet 2012, celui-ci avait estimé avérés les faits reprochés à M.M. et avait suspendu ce dernier de ses fonctions pour une durée de deux mois.
64. Il ressort de ce qui précède que pour certaines autorités nationales, les allégations de la requérante concernant les circonstances de l’incident ne manquaient pas de crédibilité et méritaient un plus ample examen.
65. Toutefois, eu égard à ses conclusions sous le volet procédural de l’article 3 de la Convention, la Cour considère qu’il n’existe pas en l’espèce d’éléments suffisants permettant de conclure au-delà de tout doute raisonnable que la requérante a fait l’objet des traitements allégués.
66. Il n’y a donc pas eu non plus violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
Zolotev c. Russie du 19 septembre 2017 requête n° 13408/07
Article 3 : pas d'enquête effective contre les violences d'un enquêteur de la police judiciaire, subies par un prévenu mis en détention avant jugement, pour lui faire avouer un meurtre qu'il n'aurait pas commis.
a) Sur l’effectivité des enquêtes
47. La Cour considère que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 116, CEDH 2015).
48. Pour qu’une enquête relative à une allégation de mauvais traitements puisse passer pour effective, elle doit être approfondie. Cela signifie que les autorités doivent entreprendre des démarches appropriées pour établir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas se fier à des conclusions hâtives et mal fondées pour motiver leurs décisions à l’issue de l’enquête et notamment pour clôturer celle-ci (Markaryan c. Russie, no 12102/05, § 55, 4 avril 2013). Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, la déclaration détaillée de la victime présumée au sujet de ces allégations, les dépositions des témoins oculaires, les expertises et, le cas échéant, les certificats médicaux complémentaires propres à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations médicales, notamment de la cause des blessures. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause des blessures ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme (Davitidze c. Russie, no 8810/05, § 100, 30 mai 2013).
49. En outre, une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (Bouyid, précité, § 121).
50. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour constate, tout d’abord, que les mauvais traitements que le requérant déclare avoir subis les 7 juillet et 20 septembre 2003 et le 23 juin 2005, alors qu’il était privé de sa liberté, ont été examinés par les autorités internes dans le cadre d’enquêtes préliminaires sur la base de l’article 144 du CPP (paragraphe 28 ci-dessus). Elle relève ensuite que les enquêtes menées sur chacun des incidents susmentionnés n’ont jamais abouti à l’ouverture d’une véritable instruction pénale (paragraphes 31, 35 et 40 ci-dessus).
51. La Cour souligne avoir déjà jugé que le refus des autorités internes d’ouvrir une instruction pénale au sujet d’un grief défendable de mauvais traitements subis entre les mains de la police est révélateur d’un manquement de l’État à son obligation de conduire une enquête effective sur la base de l’article 3 de la Convention (Lyapin, précité, §§ 133-140). Elle ne voit aucune raison d’aboutir à un constat différent en l’espèce. En effet, elle note que les autorités chargées de l’instruction se sont bornées à recueillir les explications de différentes personnes et se sont appuyées principalement sur ces explications pour rejeter les allégations du requérant en les considérant comme non étayées (paragraphes 30, 34 et 39 ci-dessus). Elle rappelle que des explications recueillies dans le cadre d’une vérification préliminaire ne sont pas assorties, en droit interne, des garanties inhérentes à une enquête pénale effective comme, par exemple, l’engagement de la responsabilité pénale pour faux témoignage ou refus de témoigner (Lyapin, précité, § 134).
52. La Cour note ensuite que les autorités internes n’ont à aucun moment ordonné une expertise médicolégale pour consigner les lésions corporelles du requérant et qu’elles n’ont pas non plus essayé d’analyser et d’expliquer leur origine afin de savoir si les lésions subies par le requérant étaient compatibles avec son récit des faits (voir, dans un contexte similaire, Zolotarev c. Russie, no 43083/06, § 50, 15 novembre 2016). Elle constate en outre que les autorités internes ont même explicitement refusé d’ordonner une expertise médicolégale relative aux lésions constatées sur le requérant le 21 septembre 2003 malgré une demande expresse en ce sens soumise par l’avocat de l’intéressé le 26 septembre 2003 (paragraphes 25 et 26 ci‑dessus). Quant aux avis médicaux recueillis dans le cadre des enquêtes préliminaires sur les incidents du 20 septembre 2003 et du 23 juin 2005 (paragraphes 34 et 39 ci-dessus), la Cour observe qu’ils ne sont pas assimilables à une expertise médicolégale rendue dans le cadre d’une instruction pénale et qu’ils ne peuvent donc pas présenter les garanties nécessaires évoquées au paragraphe 51 ci‑dessus. Par ailleurs, elle relève que les experts en cause n’ont jamais examiné le requérant personnellement et qu’ils ont fondé leurs avis uniquement sur des documents médicaux datant, de surcroît, de cinq et six ans respectivement après les mauvais traitements allégués du 20 septembre 2003 et du 23 juin 2005 (voir, dans un contexte similaire, Igoshin c. Russie, no 21062/07, § 68, 21 juin 2016).
53. La Cour estime que les défauts constatés sont la conséquence de l’absence d’ouverture d’une instruction pénale, laquelle aurait constitué une réponse adéquate aux allégations de mauvais traitements du requérant puisqu’elle aurait permis de déployer toutes les mesures d’instruction prévues par le CPP, telles que – entre autres – les interrogatoires, les confrontations, les identifications, les reconstitutions et les expertises (Aleksey Borisov c. Russie, no 12008/06, § 60, 16 juillet 2015).
54. Enfin, la Cour constate que les autorités chargées de l’instruction ont perdu, au stade initial de chacune des enquêtes préliminaires sur les trois épisodes de mauvais traitements allégués, les dossiers y relatifs ainsi que les fiches médicales du requérant (paragraphes 32, 36 et 41 ci-dessus). Elle estime que ces circonstances ont contribué à compromettre l’effectivité et la célérité des enquêtes (Tigran Ayrapetyan c. Russie, no 75472/01, § 72, 16 septembre 2010).
55. Ces éléments lui suffisent pour conclure que les enquêtes sur l’ensemble des mauvais traitements dont le requérant avance avoir été victime en détention n’ont pas rempli la condition d’effectivité requise. Partant, elle juge qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
b) Sur les allégations de mauvais traitements
56. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Sur ce dernier point, elle a précisé que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime. En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement (Bouyid, précité, §§ 82‑83).
i. Sur les mauvais traitements allégués du 7 juillet 2003
57. La Cour note que le requérant, en alléguant avoir reçu deux coups de matraque dans le ventre le 7 juillet 2003, s’appuie dans une large mesure sur la présence d’un fil de fer dans sa paroi abdominale. Selon lui, il s’est mutilé en s’introduisant, par peur, une « épingle » dans le ventre à la suite des mauvais traitements dont il aurait été victime (paragraphe 7 ci-dessus).
58. Si la Cour est prête à accepter que la présence d’un fil de fer dans l’abdomen du requérant (paragraphe 11 ci-dessus) peut constituer un élément de preuve indirect à prendre en considération, les données susmentionnées sont toutefois insuffisantes, à elles seules, pour constituer une preuve au‑delà de tout doute raisonnable des mauvais traitements allégués.
59. La Cour relève que, selon la note du 21 juillet 2003 établie par un médecin de la maison d’arrêt no IZ-47/1, la présence d’un fil de fer dans l’abdomen du requérant résulterait d’un accident subi par l’intéressé lors de travaux de construction avant son incarcération (paragraphe 12 ci-dessus). Elle souligne à cet égard que la version retenue par le médecin n’a pas été étayée par une expertise médicolégale. Toutefois, la Cour constate que la version des faits du requérant est sujette à caution.
60. Elle a toujours tenu compte du fait que les allégations de torture ou de mauvais traitements subis pendant une garde à vue sont extrêmement difficiles à étayer pour la victime si elle a été isolée du monde extérieur et privée de la possibilité de voir médecins, avocats, parents ou amis, susceptibles de lui fournir un soutien et d’établir les preuves nécessaires (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 97, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI). Cependant, il lui est impossible de constater, dans le cas d’espèce, que le requérant a été privé de contacts avec le monde extérieur lors de sa garde à vue. En effet, elle note que l’intéressé a eu l’occasion de voir ses avocats, P. et S., lors de l’interrogatoire du 9 juillet 2003, soit deux jours après la survenance hypothétique des mauvais traitements allégués (paragraphe 9 ci-dessus). Elle constate cependant que le requérant n’explique pas pourquoi il n’a pas saisi cette occasion pour se plaindre auprès de ses avocats P. et S. des mauvais traitements qu’il aurait subis. Eu égard au récit des événements fourni par l’intéressé, les séquelles éventuelles des deux coups de matraque n’auraient pas perduré dans le temps, d’où l’intérêt, selon la Cour, d’en fixer l’existence au moins par le biais de témoignages de tierces personnes.
61. La Cour relève également que, lors de l’interrogatoire du 19 septembre 2003, le requérant a été en mesure de formuler des plaintes quant à la qualité de l’assistance médicale dans la maison d’arrêt sans toutefois soulever la question des mauvais traitements qu’il aurait subis le 7 juillet 2003 (paragraphe 14 ci-dessus).
62. Il est vrai que la Cour est consciente des difficultés – voire de l’impossibilité – qu’un détenu peut rencontrer pour produire des preuves des mauvais traitements qu’il dit avoir subis alors qu’il était entre les mains de la police. À cet égard, elle tient à souligner que, en l’espèce, l’impossibilité de produire des preuves découle en grande partie de l’absence d’une enquête approfondie et effective par les autorités nationales à la suite de la plainte présentée par le requérant pour mauvais traitements (voir, pour des situations similaires, Aleksey Borisov, précité, § 73, et les arrêts auxquels il renvoie), pour laquelle la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural (paragraphe 55 ci-dessus). Elle constate notamment que la fiche médicale de la maison d’arrêt no IZ-47/1 a été perdue lors des enquêtes préliminaires menées à la suite de la plainte du requérant (paragraphes 32 et 36 ci-dessus), ce qui l’empêche de vérifier si le requérant s’était effectivement plaint de mauvais traitements au moment du placement à la maison d’arrêt no IZ-47/1 le 9 juillet 2003 ou si des lésions avaient été constatées sur son corps le même jour (voir, a contrario, Shamardakov c. Russie, no 13810/04, §§ 29 et 117, 30 avril 2015). La Cour considère néanmoins que, lorsque le requérant lui a soumis sa thèse, il n’a pas fourni d’explication satisfaisante quant aux incohérences constatées ci‑dessus (voir, dans le même sens, Samartsev c. Russie, no 44283/06, §§ 79‑85, 2 mai 2013).
63. En conclusion, en raison de l’absence d’éléments probatoires suffisants due, notamment, à l’insuffisance de l’enquête menée en l’espèce, la Cour considère ne pas être en mesure d’affirmer avec un degré de certitude suffisant, en accord avec sa propre jurisprudence, que le requérant a été soumis, le 7 juillet 2003, aux mauvais traitements allégués.
64. Partant, la Cour ne peut conclure raisonnablement à une violation substantielle de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne l’incident susmentionné.
ii. Sur les mauvais traitements allégués du 20 septembre 2003 et du 23 juin 2005
65. La Cour observe que les parties ne contestent pas le fait que le requérant a subi des lésions corporelles le 20 septembre 2003 et le 23 juin 2005 alors qu’il se trouvait en détention.
66. Elle considère que le récit du requérant quant aux circonstances dans lesquelles les lésions lui avaient été infligées (paragraphes 15 et 22 ci‑dessus) concorde avec la nature et la localisation des lésions identifiées (paragraphes 19, 20 et 23 ci-dessus). Ces éléments suffisent pour faire naître une forte présomption en faveur de la thèse du requérant.
67. Le Gouvernement se trouve, par conséquent, dans l’obligation de donner une explication plausible de la manière dont les lésions constatées ont été infligées pour réfuter la thèse du requérant.
68. À cet égard, la Cour note que le Gouvernement se rallie aux conclusions des autorités internes selon lesquelles, en ce qui concerne l’incident du 20 septembre 2003, les lésions ont été causées par la chute du requérant de son lit, et, en ce qui concerne l’incident du 23 juin 2005, par le requérant lui‑même, qui se serait infligé des blessures dans des circonstances inconnues (paragraphes 35 et 40 ci-dessus).
69. La Cour rappelle qu’elle ne saurait tirer aucune conclusion probante d’une enquête qu’elle a jugée ineffective (voir, mutatis mutandis, dans le cadre de l’article 2 de la Convention, Lykova c. Russie, no 68736/11, § 130, 22 décembre 2015). En l’espèce, elle a jugé que les enquêtes préliminaires menées sur les allégations de mauvais traitements n’avaient pas constitué une enquête effective au sens de l’article 3 de la Convention (paragraphe 55 ci‑dessus). Elle relève notamment que, bien que les autorités internes aient été informées des lésions dont souffrait le requérant, elles n’ont pas ordonné d’expertise médicolégale afin d’élucider les questions relatives au caractère desdites lésions et au mécanisme éventuel de leur apparition. Les autorités ont à chaque fois admis de manière hâtive les versions des policiers mis en cause par le requérant sans s’efforcer de reconstituer les événements pour vérifier la véracité de ces versions, en organisant, par exemple, des confrontations entre le requérant et les auteurs présumés des mauvais traitements. Eu égard aux défauts constatés, les conclusions desdites enquêtes ne sont pas suffisantes pour réfuter la thèse du requérant selon laquelle les lésions lui ont été infligés par des agents de l’État. En l’absence d’autres explications plausibles, la Cour estime, par conséquent, que l’État défendeur ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve lui incombant sur le terrain de l’article 3 de la Convention et qu’il n’a pas renversé la présomption en faveur de la thèse du requérant (voir, dans le même sens, Samartsev, précité, §§ 94‑99).
70. La Cour accueille donc la thèse du requérant selon laquelle les lésions qu’il a subies le 20 septembre 2003 et le 23 juin 2005 lui ont été infligées par des agents de l’État.
71. En ce qui concerne, d’une part, la gravité des mauvais traitements subis par le requérant le 20 septembre 2003, la Cour prend en considération l’intensité des actes en question, le fait que les mauvais traitements subis par le requérant lui ont été infligés de manière intentionnelle par un agent de l’État agissant dans l’exercice de ses fonctions ainsi que par des personnes agissant sous le contrôle de ce dernier dans le but d’extorquer un aveu de crime, et la particulière gravité des séquelles physiques et psychologiques (paragraphes 19 et 20 ci-dessus). Eu égard à ces éléments, elle estime dès lors que les actes dénoncés relèvent de la torture (Tigran Ayrapetyan, précité, § 77).
72. En ce qui concerne, d’autre part, la gravité des traitements subis par le requérant le 23 juin 2005, eu égard aux critères indiqués ci-dessus, la Cour estime que les actes dénoncés s’analysent, dans le cas d’espèce, en un traitement inhumain et dégradant (Kopylov c. Russie, no 3933/04, § 165, 29 juillet 2010).
73. Les éléments susmentionnés permettent à la Cour de conclure que les mauvais traitements subis par le requérant le 20 septembre 2003 et le 23 juin 2005 ont emporté violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
Grande Chambre JERONOVIČS c. LETTONIE du 5 juillet 2016 requête 44898/10
Violation de l'article 3 sur le volet procédural, les juridictions n'ont pas fait d'enquête effective sur les violences subies durant la garde à vue et n'ont pas rouvert l'enquête comme le souhaitait le requérant. Devant la CEDH, le gouvernement a versé une indemnité pour dire que le requérant n'était pas victime. C'est insuffisant aux yeux de la CEDH
a) Principes établis dans la jurisprudence de la Cour
103. L’obligation de mener une enquête effective sur des allégations de traitements contraires à l’article 3 subis par une personne aux mains d’agents de l’État est bien établie dans la jurisprudence de la Cour (voir, pour l’arrêt le plus récent, Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114‑123, CEDH 2015, et pour un exposé complet des principes développés par la Grande Chambre, El-Masri c. ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 182-185, CEDH 2012, et Mocanu et autres, précité, §§ 316-326). Pour être qualifiée d’« effective », pareille enquête, comme au titre de l’article 2, doit d’abord être adéquate (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007‑II, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 172, 14 avril 2015). Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits, permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances ainsi que d’identifier et – le cas échéant – de sanctionner les responsables (voir, notamment, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998‑VIII, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 301, CEDH 2011 (extraits), et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 172).
104. Pour redresser une violation de l’article 3, l’État, en plus de mener une enquête approfondie et effective, doit accorder au requérant une indemnité, le cas échéant, ou à tout le moins la possibilité de solliciter et d’obtenir une réparation pour le préjudice que le mauvais traitement lui a causé (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 118, CEDH 2010).
105. En cas de mauvais traitement délibéré, l’octroi d’une indemnité à la victime ne suffit pas à réparer la violation de l’article 3. En effet, si les autorités pouvaient se borner à réagir en cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État en accordant une simple indemnité, sans s’employer à poursuivre et punir les responsables, les agents de l’État pourraient dans certains cas enfreindre les droits des personnes soumises à leur contrôle pratiquement en toute impunité, et l’interdiction légale absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants serait dépourvue d’effet utile en dépit de son importance fondamentale (Gäfgen, précité, §§ 116 et 119).
106. En outre, l’issue de l’enquête et des poursuites pénales qu’elle déclenche, y compris la sanction prononcée ainsi que les mesures disciplinaires prises, passent pour déterminantes. Elles sont essentielles si l’on veut préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est tenu d’exercer dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais traitements (ibidem, § 121).
107. La Cour a également dit, dans le contexte de l’obligation d’enquêter sur des morts violentes ou suspectes qu’impose l’article 2, que cette obligation procédurale peut renaître si des éléments censés jeter une nouvelle lumière sur les circonstances de tels décès sont révélés au public (Hackett c. Royaume-Uni (déc.), no 34698/04, 10 mai 2005, Brecknell c. Royaume-Uni, no 32457/04, §§ 66-67, 27 novembre 2007, et Williams, précité). La nature et la portée de toute enquête ultérieure requise par l’obligation procédurale dépendent inévitablement des circonstances de chaque affaire particulière et peuvent tout à fait être différentes de celles que l’on attend immédiatement après la survenue du décès (Stanimirović c. Serbie, no 26088/06, § 29, 18 octobre 2011, et Harrison et autres c. Royaume-Uni (déc.), nos 44301/13, 44379/13 et 44384/13, § 51, 25 mars 2014).
Les principes relatifs à l’obligation procédurale d’enquêter que recèle l’article 2, esquissés ci-dessus, s’appliquent de même à l’obligation procédurale d’enquêter découlant de l’article 3 (Tuna c. Turquie, no 22339/03, §§ 58-63, 19 janvier 2010). L’obligation qui incombe aux autorités internes en vertu de la Convention de mener une enquête approfondie et effective sur des griefs défendables fondés sur l’article 3 ne signifie pas nécessairement sanctionner à tout prix les fonctionnaires impliqués dans les mauvais traitements allégués. La Convention requiert seulement des « investigations propres à conduire à la punition des responsables » (Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 70, CEDH 2000‑XII).
108. En ce qui concerne l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de dénoncer une violation des droits et libertés consacrés par la Convention. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention, mais le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur (Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, § 64, 21 décembre 2000, et les arrêts qui y sont cités, en particulier Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 95, Recueil 1996‑VI).
109. En outre, la Cour rappelle que ses arrêts servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les États, des engagements qu’ils ont pris en leur qualité de Parties contractantes. Si le système mis en place par la Convention a pour objet fondamental d’offrir un recours aux particuliers, il a également pour but de trancher, dans l’intérêt général, des questions qui relèvent de l’ordre public, en élevant les normes de protection des droits de l’homme et en étendant la jurisprudence dans ce domaine à l’ensemble de la communauté des États parties à la Convention (Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, § 197, CEDH 2010 (extraits), avec d’autres références).
b) Application en l’espèce des principes exposés ci-dessus
i. Article 3 de la Convention
110. En vertu de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant pour les États contractants de la Convention.
111. Le requérant allègue que l’État défendeur était tenu d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements, eu égard à sa reconnaissance d’une violation de l’article 3 et à l’engagement pris par lui dans sa déclaration unilatérale « d’offrir un recours effectif », que la Cour a acceptée dans sa décision.
Le Gouvernement soutient au contraire que l’on ne peut interpréter les termes de sa déclaration unilatérale ou le libellé de la décision de la Cour acceptant ladite déclaration comme générant une obligation de rouvrir la procédure clôturée concernant les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant.
112. La Cour doit en premier lieu déterminer si l’État défendeur avait l’obligation de rouvrir la procédure clôturée et si son refus d’accéder à la demande de réouverture soulève une question au regard de la Convention.
Elle observe à cet égard que dans sa décision de radiation du 10 février 2009 elle n’a pas expressément indiqué au Gouvernement si celui-ci était toujours tenu par l’obligation de mener une enquête effective ou si la reconnaissance d’une violation et le versement d’une indemnité avaient éteint cette obligation.
La Cour examinera donc si pareille obligation peut naître de l’engagement pris par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale et de la décision de la Cour du 10 février 2009, en ce que celle-ci a rayé du rôle le grief soulevé par le requérant sous l’angle du volet procédural de l’article 3 dans la requête no 547/02 (paragraphe 20 ci-dessus), ou si le refus en question a donné lieu à la violation d’une obligation procédurale qui aurait continué d’exister après cette décision de radiation.
113. La Cour rappelle que, ainsi qu’il ressort clairement de la structure de l’article 37 de la Convention et de sa jurisprudence relative aux déclarations unilatérales (paragraphes 64 à 69 ci-dessus), les raisons qui l’amènent à accepter une déclaration unilatérale et à rayer tout ou partie d’une requête de son rôle sont étroitement liées à la nature du grief du requérant et, en conséquence, aux obligations qui incombent au gouvernement défendeur au titre de la Convention en ce qui concerne les droits violés.
114. C’est à la lumière de ces considérations que la Cour, dans sa décision du 10 février 2009, s’est livrée à une appréciation des engagements pris par le gouvernement letton dans sa déclaration unilatérale du 30 avril 2008 concernant la requête no 547/02. Le résultat de cette appréciation se reflète dans les arguments et les observations formulés à l’appui de la décision – dont ils font partie intégrante – par laquelle la Cour a rayé du rôle, le 10 février 2009, les griefs en question tirés de l’article 3 de la Convention.
115. Dans la présente affaire, les parties ne soutiennent pas que la Cour a commis une erreur procédurale ou matérielle manifeste en prenant la déclaration unilatérale du Gouvernement pour base de sa décision de rayer du rôle les griefs en cause. En revanche, elles sont en désaccord quant aux conséquences qu’il convient de tirer du libellé :
a) de l’engagement du Gouvernement « de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des violations similaires ne se reproduisent à l’avenir et pour offrir un recours effectif », et
b) de la phrase figurant au paragraphe 54 de la décision de la Cour, qui évoque la possibilité que d’autres recours soient exercés : « Cette décision ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d’exercer, le cas échéant, d’autres recours afin d’obtenir réparation » (« That decision is without prejudice to the possibility for the applicant to exercise any other available remedies in order to obtain redress »).
116. La Cour ne voit en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle (paragraphe 69 ci-dessus) de nature à justifier la réinscription au rôle de la partie de la requête no 547/02 qu’elle a rayée du rôle le 10 février 2009.
L’engagement du Gouvernement figurant au point a) ci-dessus d’« offrir un recours effectif » devrait être interprété comme une mesure générale et non comme une mesure individuelle spécifique qui impliquerait que le refus de la demande de réouverture a porté atteinte à cet engagement.
Néanmoins, la Cour juge particulièrement pertinente la référence, au point b) ci-dessus, au fait que sa décision de rayer du rôle la partie en cause de la requête reposait sur la condition préalable que le requérant conservât la possibilité d’exercer, « le cas échéant, d’autres recours afin d’obtenir réparation ».
Pareille possibilité doit être considérée dans le contexte de la jurisprudence de la Cour sur les mauvais traitements infligés par des agents de l’État. Le droit du requérant de se prévaloir des recours existants pour obtenir réparation doit s’accompagner de l’obligation correspondante, de la part du gouvernement défendeur, de lui offrir un recours sous la forme d’une procédure permettant d’enquêter sur les mauvais traitements qui lui auraient été infligés alors qu’il se trouvait aux mains d’agents de l’État (paragraphe 105 ci-dessus).
Le paiement d’une indemnité, qu’il résulte d’une déclaration unilatérale ou d’une procédure interne en dommages-intérêts, ne saurait suffire, eu égard à l’obligation qui incombe à l’État en vertu de l’article 3 de mener une enquête effective dans les affaires de mauvais traitements délibérés par des agents de l’État (Gäfgen, précité, §§ 116 et 119).
117. Dès lors, l’interprétation du Gouvernement, telle qu’elle apparaît dans sa déclaration unilatérale et selon laquelle le versement d’une indemnité vaut règlement définitif de l’affaire, ne saurait être admise. Pareille interprétation amputerait d’une partie essentielle tant le droit du requérant que l’obligation de l’État découlant du volet procédural de l’article 3 de la Convention (paragraphes 104 et 105 ci-dessus).
S’il est vrai que sa décision du 10 février 2009 a apporté une réponse définitive, aux fins de la Convention, au grief soulevé par le requérant sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention dans le cadre de la requête no 547/02, la Cour souligne à cet égard que la procédure de déclaration unilatérale revêt un caractère exceptionnel. Partant, lorsqu’il s’agit de violations des droits les plus fondamentaux garantis par la Convention, cette procédure n’a pas vocation d’éluder l’opposition du requérant à un règlement amiable ou de permettre au Gouvernement d’échapper à sa responsabilité pour de telles violations.
118. La Cour estime donc que, en l’absence d’enquête effective sur les mauvais traitements infligés au requérant par les policiers, la décision de radiation du 10 février 2009 n’a pas éteint, et n’avait pas vocation à éteindre, l’obligation continue du gouvernement letton de mener une enquête conforme aux exigences de la Convention (voir également Žarković et autres, précité). En conséquence, on ne saurait dire qu’en versant l’indemnité indiquée dans sa déclaration unilatérale et en reconnaissant une violation des diverses dispositions de la Convention l’État défendeur s’est acquitté de l’obligation procédurale continue qui lui incombe au titre de l’article 3 de la Convention.
119. En vertu des dispositions pertinentes du droit letton, le requérant avait la possibilité, dont il s’est prévalu, de saisir le procureur d’une demande de réouverture de l’enquête. Sous réserve que les conditions prévues par les articles 393 et 655 à 657 de la loi sur la procédure pénale fussent remplies (paragraphes 27 à 31 ci-dessus), le procureur avait le pouvoir de rouvrir la procédure sur la base d’éléments nouveaux (voir, a contrario, Rezgui, précité). La Cour observe qu’aux termes de l’article 655 § 2, alinéa 5, un constat d’une autorité judiciaire internationale selon lequel une décision rendue par une juridiction lettone et passée en force de chose jugée n’est pas conforme à des dispositions internationales contraignantes pour la Lettonie est admis comme un élément nouveau. Or, la demande du requérant a été rejetée par les autorités de poursuite à deux niveaux, au motif que la déclaration unilatérale du Gouvernement ne constituait pas un élément nouveau aux fins de l’article 655 § 2.
120. La Cour rappelle en outre que, selon sa jurisprudence constante, une demande de réouverture d’une procédure ou l’utilisation de recours extraordinaires similaires ne peut, en règle générale, être prise en compte aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Withey c. Royaume-Uni (déc.), no 59493/00, CEDH 2003-X, et H. c. Islande, précité, avec d’autres références). Pareille approche aurait en l’espèce pour conséquence d’empêcher la Cour, pour des raisons formelles, d’examiner au fond le grief du requérant concernant le défaut d’enquête effective.
Cependant, la Cour voit dans les circonstances spécifiques de l’espèce des raisons de s’écarter de cette règle, eu égard aux éléments suivants : l’admission sans réserve et sans équivoque par le Gouvernement que le requérant a subi des mauvais traitements et que l’enquête ne répondait pas aux exigences d’effectivité requises par l’article 3 de la Convention ; la propre appréciation de la Cour de cette déclaration et, à la lumière de ses conclusions à cet égard, sa décision de rayer cette partie de la requête du rôle par une décision définitive du 10 février 2009, par laquelle elle mettait fin à son examen de la question (paragraphe 54 de cette décision) – tout en notant qu’il était loisible au requérant d’exercer tout recours national à sa disposition ; et le fait que, en l’absence d’enquête effective, l’obligation procédurale découlant pour l’État défendeur de l’article 3 perdure.
121. Quant au fond dudit grief, la Cour observe d’emblée qu’elle ne se prononcera pas sur le point de savoir si les procureurs lettons étaient ou non fondés à refuser la demande de réouverture de l’enquête présentée par le requérant. Selon sa jurisprudence ancienne et constante, la Convention ne garantit pas en principe un droit à la réouverture d’une procédure clôturée (voir, mutatis mutandis, Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 44, CEDH 2015). La Cour peut néanmoins examiner si la manière dont les autorités lettones ont traité la demande du requérant a produit des effets qui étaient incompatibles avec l’obligation continue qui leur incombait au titre de l’article 3 de mener une enquête effective.
122. Quoi qu’il en soit, à supposer même que les autorités d’enquête n’aient pas été en mesure, dans le cadre juridique national existant, de reprendre l’enquête qui avait été abandonnée le 19 mars 2001, la Cour estime qu’aucun des obstacles juridiques nationaux évoqués par le procureur de rang supérieur dans sa décision du 20 décembre 2010 n’est de nature à exonérer l’État défendeur de son obligation continue découlant de l’article 3 de la Convention de mener une enquête effective (voir également le paragraphe 34 ci-dessus). S’il en était autrement, les autorités pourraient, en cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État, se borner à réagir en accordant une simple indemnité, sans s’employer à poursuivre et punir les responsables, permettant ainsi aux agents de l’État, dans certains cas, d’enfreindre les droits des personnes soumises à leur contrôle pratiquement en toute impunité, ce qui priverait l’interdiction légale absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants de tout effet utile en dépit de son importance fondamentale (Gäfgen, précité, § 119).
123. Eu égard au refus des autorités de rouvrir la procédure pénale clôturée concernant les mauvais traitements infligés au requérant et dont le Gouvernement a reconnu l’existence dans sa déclaration unilatérale soumise dans le cadre de la requête no 547/02, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant n’a pas bénéficié d’une enquête effective aux fins de l’article 3 de la Convention.
124. Partant, elle rejette les exceptions préliminaires d’incompatibilité ratione materiae de la requête avec la Convention, de défaut de qualité de victime, de non-épuisement des voies de recours internes et de non-respect du délai de six mois soulevées par le Gouvernement. Statuant au fond, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
ii. Article 13 de la Convention
125. Eu égard à ses conclusions exposées aux paragraphes 119 et 122 et à celle figurant au paragraphe 124 ci-dessus, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 (voir, parmi d’autres, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 123, CEDH 2005‑VII, Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 252, CEDH 2012, et Chiragov et autres c. Arménie [GC], no 13216/05, § 220, CEDH 2015).
BEORTEGUI MARTINEZ c. ESPAGNE du 31 mars 2016 Requête no 36286/14
Violation de l'article 3 pour défaut d'enquête : Le requérant accusé d'être un terroriste basque a été arrêté. Il se plaint d'avoir été torturé pour qu'il signe des aveux. Le défaut d'enquête entraîne la violation de l'article 3 de la Convention
a) Sur l’insuffisance alléguée des investigations menées par les autorités nationales
37. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, des sévices contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et, le cas échéant, à la punition des responsables (voir, en ce qui concerne l’article 2 de la Convention, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 161, série A no 324, et, pour des affaires similaires portant sur l’article 3, Beristain Ukar, précité, § 28, Otamendi Egiguren, précité, § 38, Etxebarria Caballero, précité, § 43, Ataun Rojo, précité, § 34 ou, en dernier lieu, Arratibel Garciandia, précité, § 35). S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de bafouer, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII).
38. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été placé en garde à vue au secret pendant trois jours durant lesquels il n’a pas pu informer de sa détention une personne de son choix ni lui en communiquer le lieu, et n’a pas non plus pu se faire assister par un avocat librement choisi, en vertu des règles applicables aux gardes à vue au secret. Il n’aurait pas non plus pu s’entretenir en privé avec son avocat commis d’office avant sa déclaration en garde à vue (paragraphe 14 ci-dessus).
39. L’intéressé a décrit de manière précise et circonstanciée, lorsqu’il a porté plainte à leur sujet le 16 mai 2011 devant le juge de garde de Pampelune, les mauvais traitements dont il affirmait avoir fait l’objet durant sa garde à vue au secret.
Il a également déclaré avoir fait l’objet de mauvais traitements devant le juge central d’instruction près l’Audiencia Nacional, le 21 janvier 2011. Cette affirmation du requérant n’a toutefois pas pu être vérifiée puisque la copie de ses déclarations n’a pas été jointe au dossier de l’instruction, bien qu’il en eût fait expressément la demande dans sa plainte du 16 mai 2011 (paragraphe 16 ci-dessus).
La gravité des délits objet de la plainte du requérant méritaient par conséquent une investigation approfondie de la part de l’État, comme le relève l’Audiencia Provincial de Navarre dans sa décision du 31 octobre 2012, propre à conduire à l’établissement des faits, à l’identification et, le cas échéant, s’il est jugé approprié, à la punition des responsables (Armani da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 286, 30 mars 2016).
40. S’agissant des investigations menées par les autorités nationales au sujet des allégations de mauvais traitements, la Cour observe que, d’après les informations fournies, le juge d’instruction no 3 de Pampelune s’est borné à examiner les rapports des médecins légistes et les rapports établis respectivement le 17 janvier 2012 par le médecin généraliste du requérant, qui l’avait examiné le 24 février 2011, et le 13 février 2012 par une psychologue qui l’avait examiné le 15 février 2011.
Or, le requérant avait aussi sollicité plusieurs autres mesures d’administration de la preuve, à savoir : le recueil d’une copie de ses déclarations devant la garde civile et devant le juge central d’instruction pendant sa garde à vue au secret ; le recueil des éventuels enregistrements des caméras de sécurité des locaux où s’était déroulée sa garde à vue ; l’identification et l’audition par le juge des agents de la garde civile intervenus pendant sa détention et la garde à vue, et l’audition par le juge des agents ainsi identifiés ; l’audition des médecins légistes l’ayant examiné, et de l’avocat commis d’office présent lors de ses dépositions ; et un examen physique et psychologique, afin d’établir l’existence d’éventuelles lésions ou séquelles. Ces demandes n’ont pas été prises en considération par le juge d’instruction no 3 de Pampelune.
41. Concernant le laps de temps écoulé entre la remise en liberté du requérant et le dépôt de sa plainte, signalé par le Gouvernement, la Cour rappelle que le premier aspect du devoir de diligence – c’est-à-dire l’obligation de saisir promptement les autorités internes – s’apprécie au regard des circonstances de la cause. Elle a déjà jugé que le retard mis par des requérants à porter plainte n’est pas décisif dès lors que les autorités auraient dû être averties qu’une personne pouvait avoir subi des mauvais traitements, le devoir d’enquête mis à la charge des autorités leur incombant même en l’absence de plainte formelle (Velev c. Bulgarie, no 43531/08, §§ 59-60, 16 avril 2013, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 265, CEDH 2014 (extraits)).
42. En l’espèce, la Cour note que le 21 janvier 2011, le requérant fut traduit devant le juge central d’instruction no 3 près l’Audiencia Nacional, auquel il aurait fait part des mauvais traitements prétendument subis pendant et après son transfert à Madrid. Ceci aurait d’ailleurs été corroborée, d’après le requérant, par l’avocat d’office, qui indiquait avoir la certitude que le requérant avait fait sa déclaration sous la contrainte. Le juge central d’instruction n’ordonna toutefois aucune mesure d’investigation, et ne transmit pas non plus le dossier à un quelconque autre juge compétent.
43. La Cour reconnaît, à l’instar du Comité contre la torture des Nations unies (Mocanu et autres, précité, §§ 251-255), que les conséquences psychologiques des mauvais traitements infligés par des agents de l’État peuvent aussi nuire à la capacité des victimes à se plaindre des traitements subis et, ainsi, constituer un obstacle majeur à l’exercice du droit à réparation des victimes de torture et autres mauvais traitements. Ce type de facteurs peut avoir pour effet de rendre la victime incapable d’entreprendre les démarches nécessaires pour intenter sans délai des poursuites à l’encontre de l’auteur des faits.
44. Compte tenu de ce qui précède, de la vulnérabilité du requérant à l’issue d’une détention comme celle de l’espèce, de l’absence d’enquête entamée d’office par la juridiction responsable tant de la garde à vue subie par le requérant que de la procédure sur le bien-fondé des accusations formulées à son encontre, ainsi que du délai de trois mois et vingt-cinq jours entre sa remise en liberté et le dépôt de la plainte, qui ne semble pas excessif de prime abord, on ne saurait conclure que le retard mis par le requérant pour dénoncer à nouveau les mauvais traitements qu’il aurait subis était de nature à compromettre l’effectivité de l’enquête ni à faire douter du sérieux de son grief.
45. La Cour observe à cet égard que, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, il incombe aux autorités compétentes de l’État de procéder d’office et sans retard à une enquête impartiale (Arratibel Garciandia, précité, § 26). Or, à la lumière des éléments qui figurent au dossier, la Cour estime que l’enquête menée dans la présente affaire n’a pas été suffisamment approfondie et effective pour remplir les exigences précitées de l’article 3 de la Convention. Une investigation effective s’impose pourtant d’autant plus fortement lorsque, comme en l’espèce, le requérant se trouvait, pendant le laps de temps durant lequel les mauvais traitements allégués se seraient produits, dans une situation d’absence totale de communication avec l’extérieur, pareil contexte exigeant un effort plus important de la part des autorités internes pour établir les faits dénoncés. De l’avis de la Cour, l’administration des moyens de preuve supplémentaires suggérés par le requérant, et tout particulièrement une audition des agents chargés de sa surveillance lors de sa garde à vue au secret, aurait pu contribuer à l’éclaircissement des faits, dans un sens ou dans l’autre, comme l’exige la jurisprudence de la Cour.
46. La Cour répète par ailleurs l’importance d’adopter les mesures recommandées par le CPT pour améliorer la qualité de l’examen médicolégal des personnes en garde à vue au secret (Otamendi Egiguren, précité, § 41).
La Cour prend acte également des rapports du CPT des 25 mars 2011 et 30 avril 2013 concernant ses visites en Espagne en 2007 et 2011 respectivement, ainsi que du rapport du 9 octobre 2013 du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (Etxebarria Caballero, précité §§ 26-32, Arratibel Garciandia, précité, §§ 24-27, et paragraphe 24 ci-dessus), et indique que les autorités espagnoles doivent établir un code de conduite clair sur la procédure à suivre pour mener les interrogatoires par les personnes chargées de la surveillance des détenus au secret et garantir leur intégrité physique.
La Cour souligne en particulier la situation de spéciale vulnérabilité des personnes détenues au secret, qui commande que soient adoptées des mesures de surveillance juridictionnelle appropriées, et que celles-ci soient rigoureusement appliquées, afin que les abus soient évités et que l’intégrité physique des détenus soit protégée.
Pour la Cour, il incombe aux juges compétents en matière de gardes à vue au secret d’adopter une approche plus proactive concernant les pouvoirs de surveillance dont ils disposent. Elle souscrit aux recommandations des organes du Conseil de l’Europe, s’agissant aussi bien des garanties à assurer en pareil cas que du principe même de la possibilité de placer une personne en détention au secret (Ataun Rojo, précité, § 38, et Etxebarria Caballero, précité, § 48), selon les règles établies par la législation espagnole (Arratibel Garciandia, précité, § 40).
47. En conclusion, eu égard à l’absence d’enquête approfondie et effective au sujet des allégations défendables du requérant (Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, §§ 156-160, 2 novembre 2004) selon lesquelles il avait subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue au secret, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural.
b) Sur les allégations relatives aux mauvais traitements en détention
48. La Cour renvoie à sa jurisprudence constante sur la prohibition absolue de la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (Selmouni, précité, § 95, et Assenov et autres, précité, § 93, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil 1996-V).
49. La Cour considère que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant a été soumis à des traitements ayant atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction posée par l’article 3 de la Convention. À cet égard, elle tient à souligner que cette impossibilité découle en grande partie de l’absence d’une enquête approfondie et effective par les autorités nationales à la suite de la plainte présentée par le requérant pour mauvais traitements (Lopata c. Russie, no 72250/01, § 125, 13 juillet 2010, et Etxebarria Caballero, précité, § 58), défaillance pour laquelle la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural (paragraphe 47 ci-dessus).
50. En conséquence, la Cour ne peut conclure à une violation matérielle de l’article 3 de la Convention s’agissant des mauvais traitements allégués par le requérant lors de son arrestation et durant sa garde à vue.
Grande Chambre ARMANI DA SILVA c. ROYAUME-UNI du 30 mars 2016 requête n° 5878/08
Non violation de l'article 3 : Le système de justice et de poursuites pénales du Royaume-Uni n’a pas porté atteinte à l’enquête menée sur la mort d’un homme tué par balles dans le métro de Londres. Deux semaines plus tôt une bombe avait explosé dans le métro de Londres. Le jeune homme habitait le même immeuble que les kamikazes visés par l'enquête.
Les policiers n'ont fait aucune faute individuelle, en revanche la préfecture de police a mal organisé l'opération. Le CPS décida de n’engager de poursuites pénales contre aucun des policiers à titre individuel, au motif que de telles poursuites n’auraient présenté aucune perspective réaliste de condamnation.
Concernant la préfecture de police, la Cour ne dispose d’aucune indication permettant de dire que la sanction qui lui a été infligée (une amende de 175 000 GBP et le paiement des dépens, soit 385 000 GBP) ait été excessivement clémente pour une infraction de cette nature. Lorsque la famille a engagé une action civile en réparation, la police métropolitaine a accepté de conclure avec elle un accord prévoyant le versement d’une indemnité, dont le montant n’a pas été divulgué.
a) Les principes relatifs à l’obligation procédurale qui incombe à l’État lorsque ses agents ont fait usage de la force meurtrière
229. Eu égard à son caractère fondamental, l’article 2 de la Convention impose l’obligation procédurale – décrite ci-dessous – de mener une enquête effective sur les allégations de violation du volet matériel de cette disposition (Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, § 82, Recueil 1998‑IV, Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 89, CEDH 2002‑VIII, Giuliani et Gaggio, précité, § 298, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 69, 14 avril 2015).
230. Pour que l’interdiction générale des homicides arbitraires s’adressant aux agents publics s’avère efficace en pratique, il faut qu’existe une procédure permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière par les autorités de l’État. Combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose cette disposition requiert par implication qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’État, a entraîné mort d’homme (McCann et autres, précité, § 161). L’État a donc le devoir d’assurer, par tous les moyens dont il dispose, une réaction adéquate – judiciaire ou autre – pour que le cadre législatif et administratif mis en place pour protéger le droit à la vie soit effectivement mis en œuvre et pour que, le cas échéant, les violations du droit en jeu soient réprimées et sanctionnées (Zavoloka c. Lettonie, no 58447/00, § 34, 7 juillet 2009, et Giuliani et Gaggio, précité, § 298).
231. L’obligation pour l’État de mener une enquête effective est considérée dans la jurisprudence de la Cour comme une obligation inhérente à l’article 2, lequel exige notamment que le droit à la vie soit « protégé par la loi ». Bien qu’un manquement à cette obligation puisse avoir des conséquences sur le droit protégé par l’article 13, l’obligation procédurale de l’article 2 est une obligation distincte (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 91-92, CEDH 2000-VII, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 148, CEDH 2004-XII, et Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, §§ 153-154, 9 avril 2009). Elle peut donner lieu à un constat d’« ingérence » distincte et indépendante. Cette conclusion découle du fait que la Cour a constamment examiné la question des obligations procédurales séparément de la question du respect de l’obligation matérielle (et conclu, le cas échéant, à une violation distincte de l’article 2 en son volet procédural), et qu’en diverses occasions la violation de l’obligation procédurale a été alléguée en l’absence de grief relatif à l’aspect matériel de cette disposition (Šilih, précité, §§ 158-159).
232. D’une manière générale, on peut considérer que pour qu’une enquête sur une allégation d’homicide illicite commis par des agents de l’État soit effective, il faut que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes impliquées (voir, par exemple, Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999‑III, Giuliani et Gaggio, précité, § 300, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 177). Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel mais aussi une indépendance concrète (voir, par exemple, Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, §§ 81-82, Recueil 1998‑IV, Giuliani et Gaggio, précité, § 300, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 177). Il en va de l’adhésion de l’opinion publique au monopole de l’État en matière de recours à la force (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 106, 4 mai 2001, Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 325, et Giuliani et Gaggio, ibidem).
233. Pour pouvoir être qualifiée d’« effective » au sens où cette expression doit être comprise dans le contexte de l’article 2 de la Convention, l’enquête doit d’abord être adéquate (Ramsahai et autres, précité, § 324, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 172). Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances ainsi que d’identifier et – le cas échéant – de sanctionner les responsables (Giuliani et Gaggio, précité, § 301, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 172). Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 160, CEDH 2005‑VII), Jaloud c. Pays‑Bas [GC], no 47708/08, § 186, CEDH 2014, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 173). Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès (en ce qui concerne les autopsies voir, par exemple, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII ; sur la question des témoins voir, par exemple, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV ; pour ce qui est des expertises criminalistiques voir, par exemple, Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). De plus, lorsque des agents de l’État ont eu recours à la force, l’enquête doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances (voir, par exemple, Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 87, Recueil 1998-I). Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme (Avşar c. Turquie, no 25657/94, §§ 393-395, CEDH 2001‑VII (extraits), Giuliani et Gaggio, précité, § 301, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 174).
234. En particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et l’identité des personnes responsables (Kolevi c. Bulgarie, no 1108/02, § 201, 5 novembre 2009, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 175). Il n’en demeure pas moins que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête (Velcea et Mazăre c. Roumanie, no 64301/01, § 105, 1er décembre 2009, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 175). Quand un individu a perdu la vie aux mains d’un agent de l’État dans des circonstances suspectes, les autorités internes compétentes doivent soumettre l’enquête menée sur les faits à un contrôle particulièrement strict (Enoukidze et Guirgvliani, précité, § 277).
235. En outre, l’enquête doit être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes. Le public doit également pouvoir exercer un droit de regard suffisant sur l’enquête, à un degré variable selon les cas (Hugh Jordan, précité, § 109, Giuliani et Gaggio, précité, § 303, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 179 ; voir aussi Güleç (précité, § 82), où le père de la victime n’avait pas été informé de la décision de ne pas engager de poursuites, et Oğur (précité, § 92), où la famille de la victime n’avait pas eu accès à l’enquête ni aux documents judiciaires).
236. Cependant, la divulgation ou la publication de rapports de police et d’éléments d’enquête peut aboutir à rendre publiques des données sensibles, avec des effets préjudiciables sur des particuliers ou sur d’autres enquêtes, et ne saurait donc être considérée comme une exigence découlant automatiquement de l’article 2. L’accès dont doivent bénéficier le public ou les proches de la victime peut donc être accordé à d’autres stades de la procédure (voir, entre autres, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 129, CEDH 2001‑III, et Giuliani et Gaggio, précité, § 304). Par ailleurs, l’article 2 de la Convention n’impose pas aux autorités l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête (Velcea et Mazăre, précité, § 113, et Ramsahai et autres, précité, § 348).
237. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, §§ 102-104, Recueil 1998-VI, et Kaya, précité, §§ 106-107). Force est d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr, précité, §§ 111 et 114, et Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 150, CEDH 2009).
238. Pour autant, il ne découle pas de ce qui précède que l’article 2 impliquerait le droit d’obtenir que des tiers soient poursuivis ou condamnés au pénal (Mastromatteo, précité, § 90, Šilih, précité, § 194, et Giuliani et Gaggio, précité, § 306) ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doive se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (Zavoloka, précité, § 34 c)). En effet, si la Cour reconnaît le rôle des cours et tribunaux nationaux dans le choix des sanctions à infliger à des agents de l’État pour homicide, elle doit conserver sa fonction de contrôle et intervenir dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée (Kasap et autres c. Turquie, no 8656/10, § 59, 14 janvier 2014, A. c. Croatie, no 55164/08, § 66, 14 octobre 2010, et Ali et Ayşe Duran c. Turquie, no 42942/02, § 66, 8 avril 2008).
239. Lorsque l’enquête officielle mène à l’ouverture d’une procédure devant les juridictions nationales, cette procédure dans son ensemble, y compris au stade du procès, doit respecter l’obligation positive de protéger juridiquement le droit à la vie. Ainsi, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie (voir, par exemple, Öneryıldız, précité, § 95, et Giuliani et Gaggio, précité, § 306). La tâche de la Cour consiste donc à vérifier si et dans quelle mesure ces juridictions, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, peuvent passer pour avoir soumis l’affaire à l’examen scrupuleux qu’exige l’article 2 de la Convention, de manière que la force de dissuasion du système judiciaire mis en place et l’importance du rôle que celui-ci doit jouer dans la prévention des violations du droit à la vie ne soient pas amoindries (Mileusnić et Mileusnić-Espenheim c. Croatie, no 66953/09, § 66, 19 février 2015, et Öneryıldız, précité, § 96).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
240. Ainsi qu’il ressort des principes généraux énoncés ci-dessus, la Cour a posé dans sa jurisprudence un certain nombre de conditions devant être respectées pour qu’une enquête sur le recours par des agents de l’État à la force meurtrière soit « effective ». En résumé, pareille enquête doit être menée par des personnes indépendantes de celles impliquées dans les faits ; elle doit être « adéquate » ; elle doit aboutir à des conclusions reposant sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents ; elle doit être suffisamment accessible à la famille de la victime et ouverte à l’examen du public ; et elle doit être menée promptement et avec une diligence raisonnable.
241. En l’espèce, la requérante ne se plaint pas de l’enquête de manière générale. Celle-ci a été menée par un organe indépendant (l’IPCC), qui a recueilli les éléments de preuve matériels et criminalistiques pertinents (plus de 800 pièces à conviction ont été retenues), recherché les témoins (près de 890 dépositions ont été recueillies), suivi toutes les pistes évidentes et analysé objectivement toutes les preuves pertinentes (paragraphe 49 ci‑dessus). De plus, la famille de la victime a été régulièrement informée oralement de la progression des investigations et, avec ses représentants, des conclusions de l’IPCC (paragraphe 49 ci-dessus). Elle a pu prendre connaissance de toutes les conclusions du CPS (notamment dans un premier rapport de cinquante pages puis dans un rapport définitif (paragraphes 77 et 133 ci-dessus), elle a obtenu un contrôle juridictionnel de la décision de ne pas engager de poursuites, et elle a été représentée aux frais de l’État lors de l’enquête judiciaire, au cours de laquelle elle a pu contre-interroger les soixante et onze témoins cités et présenter des observations.
242. Certes, l’IPCC n’a pas pu accéder immédiatement à la scène des tirs – ce qu’elle a d’ailleurs critiqué (paragraphe 56 ci-dessus). Toutefois, la requérante ne s’est pas plainte de ce délai, et rien n’indique que celui-ci ait compromis en quoi que ce soit l’intégrité de l’enquête, laquelle a dans l’ensemble été menée promptement et avec une diligence raisonnable. La direction des normes professionnelles, un service de la police métropolitaine à caractère indépendant, a été avertie des tirs dans l’heure qui a suivi les faits, et ses agents ont pu veiller à l’intégrité de la scène dès le début de l’enquête (paragraphe 40 ci-dessus). De plus, même si l’IPCC a relevé des points qui auraient pu être examinés plus tôt si elle avait été avertie immédiatement (par exemple, la question des enregistrements des caméras de sécurité à la station de métro de Stockwell, les disques durs du métro et l’éventuelle modification du registre de l’équipe de surveillance – paragraphe 56 ci-dessus), aucun de ces points ne s’est révélé crucial pour l’enquête qui a suivi.
243. De l’avis de la Cour, il importe de garder ces considérations à l’esprit pour examiner la procédure dans son ensemble, sachant que la requérante exprime des griefs spécifiques, qui ne concernent que certains aspects du caractère adéquat de l’enquête. Comme énoncé dans les principes généraux exposés ci-dessus, pour être « adéquate », une enquête doit permettre de déterminer si le recours à la force se justifiait ou non dans les circonstances, ainsi que d’identifier les responsables et, le cas échéant, de les sanctionner. Eu égard aux faits de la cause, la requérante soutient en l’espèce : a) que les autorités d’enquête n’étaient pas en mesure d’évaluer si l’usage de la force était justifié car elles ne pouvaient pas examiner si la conviction apparemment honnête de Charlie 2 et Charlie 12 selon laquelle l’emploi de la force était nécessaire revêtait aussi un caractère raisonnable ; et b) que le système de justice pénale en Angleterre et au pays de Galles présente des défaillances qui ont empêché l’enquête d’aboutir à la sanction des responsables.
i. Caractère adéquat de l’enquête : les autorités ont-elles pu examiner dûment le caractère justifié ou non du recours à la force ?
α. Le critère appliqué par la Cour
244. Le critère constamment appliqué par la Cour pour déterminer si l’emploi de la force meurtrière était justifié est énoncé dans l’arrêt McCann et autres (précité, § 200) en ces termes :
« [La Cour] estime que le recours à la force par des agents de l’État pour atteindre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention peut se justifier au regard de cette disposition lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée. Affirmer le contraire imposerait à l’État et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui. »
245. Le Gouvernement argue que le caractère raisonnable d’une conviction selon laquelle il est nécessaire de recourir à la force meurtrière doit être déterminé de manière subjective. La requérante admet cette thèse, tandis que le tiers intervenant estime que l’honnêteté de la conviction doit s’apprécier suivant qu’elle est raisonnable ou non d’un point de vue objectif. Il ressort toutefois tant de l’application du critère précité aux circonstances particulières de l’affaire McCann et autres que de la jurisprudence de la Cour postérieure à cette affaire que l’existence de « bonnes raisons » doit s’apprécier de manière subjective. Dans plusieurs affaires, la Cour a dit expressément qu’elle ne saurait, en réfléchissant dans la sérénité des délibérations, substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’agent qui a dû réagir, dans le feu de l’action, à ce qu’il percevait honnêtement comme un danger, afin de sauver sa vie ou celle d’autrui, mais qu’elle doit plutôt envisager les faits du point de vue de la personne estimant sur le moment se trouver en état de légitime défense (voir, par exemple, Bubbins, précité, § 139, et Giuliani et Gaggio, précité, §§ 179 et 188). En conséquence, dans les affaires concernant l’article 2 où la Cour a expressément abordé la question de savoir si une conviction était considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements, elle n’a pas adopté le point de vue d’un observateur détaché, mais elle s’est efforcée de se mettre à la place de la personne qui avait eu recours à la force meurtrière, aussi bien pour déterminer si la conviction présentait les caractéristiques voulues que pour apprécier la nécessité de recourir à la force avec l’intensité utilisée (voir, par exemple, Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 65-66, CEDH 2004‑XI, Oláh c. Hongrie (déc.), no 56558/00, 14 septembre 2004, et Giuliani et Gaggio, précité, § 189).
246. De plus, lorsqu’elle a appliqué ce critère, la Cour n’a pas traité le caractère raisonnable ou non de la conviction comme une exigence distincte mais plutôt comme un facteur pertinent à prendre en compte pour déterminer l’honnêteté et la sincérité de la conviction. Dans l’affaire McCann et autres, elle a relevé le risque qu’il y aurait à imposer une charge irréaliste aux forces de l’ordre dans l’accomplissement de leur mission. Elle a donc conclu à la non-violation de l’article 2 au motif que les militaires « pensaient de bonne foi, compte tenu des informations qu’ils avaient reçues, comme indiqué plus haut, qu’il était nécessaire de tirer sur les suspects pour les empêcher de déclencher la bombe et de causer ainsi d’importantes pertes en vies humaines » (McCann et autres, précité, § 200). On retrouve une approche similaire, principalement centrée sur la sincérité de la conviction, dans bien d’autres arrêts, notamment Andronicou et Constantinou (précité, § 192), Bubbins (précité, § 140), Golubeva c. Russie (no 1062/03, § 102, 17 décembre 2009), Wasilewska et Kałucka c. Pologne (nos 28975/04 et 33406/04, § 52, 23 février 2010), et Giuliani et Gaggio (précité, § 189).
247. À cet égard, il est particulièrement important de noter qu’il n’est jamais arrivé que la Cour constate qu’un individu estimant avoir agi en état de légitime défense croyait sincèrement que l’usage de la force était nécessaire, et qu’elle conclue ensuite à la violation de l’article 2 au motif que la conviction n’était pas considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque. Au contraire, dans les affaires où la légitime défense était invoquée, elle n’a conclu à la violation de l’article 2 que lorsqu’elle a estimé que la conviction alléguée n’était pas honnête (voir, par exemple, Akhmadov et autres c. Russie, no 21586/02, § 101, 14 novembre 2008, et Suleymanova c. Russie, no 9191/06, § 85, 12 mai 2010) ou que l’intensité de la force employée était totalement disproportionnée (voir, par exemple, Gül, précité, §§ 82-83).
248. Il ressort donc de la jurisprudence de la Cour que, pour appliquer le critère McCann et autres, la principale question à se poser est celle de savoir si la personne croyait honnêtement et sincèrement qu’il était nécessaire de recourir à la force. Pour répondre à cette question, la Cour doit vérifier le caractère subjectivement raisonnable de la conviction en tenant pleinement compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés. Si elle conclut que la conviction n’était pas subjectivement raisonnable (c’est‑à‑dire que celle-ci ne reposait pas sur des raisons subjectivement valables), il est probable qu’elle aura du mal à admettre le caractère honnête et sincère de pareille conviction.
β. Compatibilité avec la Convention du critère appliqué en Angleterre et au pays de Galles
249. En l’espèce, le coroner a énoncé en ces termes le critère à appliquer (paragraphe 106 ci-dessus) :
« L’agent croyait-il honnêtement et sincèrement qu’il était nécessaire qu’il fasse usage de la force pour sa propre défense et/ou pour celle d’autrui ? Il s’agit de savoir ce qu’il croyait subjectivement. Même si sa conviction était erronée, et même s’il était déraisonnable qu’il se trompe, le moyen de défense peut toujours tenir. Le caractère raisonnable ou non de la conviction n’est pertinent que pour aider le jury à déterminer si elle était sincère. »
250. La Cour a déjà examiné la compatibilité de ce critère avec l’article 2 de la Convention dans des affaires antérieures, mais celles-ci ne sont d’aucune aide pour l’examen de la présente cause. Il est vrai que, dans la décision Bennett (précitée), elle a expressément conclu qu’il n’y avait « pas de différence significative entre la définition anglaise de la légitime défense et le critère d’« absolue nécessité » prévu par l’article 2 ». Toutefois, la question en cause dans l’affaire Bennett était celle de savoir si le critère appliqué par le coroner – le recours à la force meurtrière devait être « raisonnablement justifié » – était compatible avec l’exigence d’« absolue nécessité » posée à l’article 2 de la Convention. La Cour n’était donc pas appelée à examiner la compatibilité du droit interne avec l’exigence qu’une conviction honnête soit considérée, pour de bonnes raisons, comme valable au moment des faits. Cette question s’est en revanche posée dans l’affaire Caraher c. Royaume-Uni (déc., no 24520/94, CEDH 2000‑I) dans laquelle la Cour a conclu que l’approche adoptée par le juge national était compatible avec les principes énoncés dans l’arrêt McCann et autres. Cependant, cette approche était quelque peu différente de celle suivie en l’espèce, et le Gouvernement a admis que cette dernière reflétait fidèlement le droit interne.
251. Il ressort clairement tant des observations des parties que des décisions internes rendues en l’espèce que l’admission de l’excuse de légitime défense dépend avant tout en Angleterre et au pays de Galles du point de savoir si l’auteur de l’atteinte à la vie croyait honnêtement et sincèrement qu’il était nécessaire de recourir à la force. Le caractère subjectivement raisonnable de cette conviction (ou l’existence de raisons subjectivement valables la sous-tendant) sert principalement à répondre à la question de savoir si cette conviction était effectivement honnête et sincère. Une fois cette question examinée, les autorités nationales doivent se demander si la force employée était « absolument nécessaire ». Il s’agit là essentiellement d’une question de proportionnalité, qui commande aux autorités d’examiner à nouveau la question du caractère raisonnable : elles doivent vérifier si la force a été employée avec une intensité raisonnable eu égard à ce que la personne croyait honnêtement et sincèrement (paragraphes 148-155 ci-dessus).
252. On ne saurait dire que, formulé ainsi, le critère appliqué en Angleterre et au pays de Galles diffère de manière significative de la norme appliquée par la Cour dans l’arrêt McCann et autres et dans sa jurisprudence ultérieure (paragraphes 244-248 ci-dessus). Sachant que la Cour a déjà refusé de juger un cadre juridique interne défaillant au seul motif d’une différence de formulation pouvant être surmontée par l’interprétation des juridictions nationales (Perk c. Turquie, no 50739/99, § 60, 28 mars 2006, et Giuliani et Gaggio, précité, §§ 214 et 215), on ne saurait dire que la définition de la légitime défense en Angleterre et au pays de Galles ne satisfait pas à la norme découlant de l’article 2 de la Convention.
253. Il est clair aussi qu’en l’espèce toutes les autorités indépendantes qui ont examiné les actes de Charlie 2 et Charlie 12 ont vérifié soigneusement le caractère subjectivement raisonnable de leur conviction selon laquelle Jean Charles de Menezes était un kamikaze qui risquait de faire exploser une bombe d’une seconde à l’autre. Dans le rapport Stockwell I, l’IPCC a noté que les agissements des deux policiers devaient être considérés à la lumière des événements qui s’étaient déroulés ce jour-là et les deux semaines précédentes. En particulier, l’IPCC a tenu compte des instructions reçues par les agents d’élite lors de la réunion préparatoire, du fait que M. de Menezes avait été formellement identifié comme le suspect par les équipes de surveillance, de la décision d’appliquer le code rouge lorsque les agents d’élite étaient arrivés à Stockwell, et de l’ordre donné par l’officier supérieur ad hoc d’empêcher (stop) M. de Menezes d’agir (paragraphe 60 ci-dessus).
254. Le CPS a lui aussi tenu compte du fait que les événements de Stockwell s’étaient déroulés « en l’espace de quelques secondes » et que « certains témoignages indépendants corrobor[ai]ent la version des agents consistant à dire qu’ils craignaient que Jean Charles [de Menezes] ne fasse sauter une bombe » (paragraphe 78 ci-dessus). Le CPS a ajouté que si Charlie 2 et Charlie 12 croyaient sincèrement qu’ils se trouvaient en situation de légitime défense, alors ils avaient agi de manière raisonnable et non pas illégale en abattant M. de Menezes (paragraphe 83 ci‑dessus).
255. De même, le coroner a dit sans ambiguïté que, pour déterminer si Charlie 2 et Charlie 12 croyaient honnêtement et sincèrement que le recours à la force était nécessaire, il devait se demander si cette conviction était raisonnable (paragraphe 106 ci-dessus).
256. On ne peut donc pas dire que les autorités nationales n’ont pas vérifié, d’une manière compatible avec les exigences de l’article 2 de la Convention, si le recours de Charlie 2 et Charlie 12 à la force était justifié compte tenu des circonstances.
ii. Caractère adéquat de l’enquête : a-t-elle été apte à identifier les responsables et, le cas échéant, à les sanctionner ?
257. La Cour rappelle que les autorités ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie, mais aussi que, comme elle l’a déjà dit à maintes reprises, l’obligation d’enquête découlant de l’article 2 de la Convention est une obligation de moyens et non de résultat (paragraphe 233 ci-dessus). Elle a d’abord posé dans les anciennes affaires que « [l’]enquête doit pouvoir conduire à l’identification et [à] la punition des responsables » (Oğur, précité, § 88) puis, au fil de sa jurisprudence, elle a précisé cette exigence et expliqué que l’enquête « doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances (...) ainsi que d’identifier et – le cas échéant – [de] sanctionner les responsables » (Giuliani et Gaggio, précité, § 301 ; voir aussi Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 172). Il s’ensuit donc que l’article 2 ne garantit pas un droit d’obtenir qu’un tiers soit poursuivi – ou condamné – pour une infraction pénale (Mastromatteo, précité, § 90, et Šilih, précité, § 194). La tâche de la Cour consiste plutôt à vérifier, eu égard à la procédure dans son ensemble, si et dans quelle mesure les autorités internes ont soumis l’affaire à l’examen scrupuleux que requiert l’article 2 de la Convention (Öneryıldız, précité, § 95).
258. Comme indiqué au paragraphe 241 ci-dessus, la Cour ne dispose en l’espèce d’aucune indication portant à croire que les autorités nationales n’aient pas recueilli des preuves matérielles ou criminalistiques pertinentes ou n’aient pas recherché les témoins ou les renseignements pertinents. De plus, les éléments de preuve obtenus ont été soigneusement analysés et examinés par l’IPCC, un organe d’enquête indépendant qui a rassemblé les dépositions de près de 890 personnes et réuni plus de 800 pièces à conviction, par le CPS, par un juge et un jury au cours du procès pénal de la préfecture, où 47 témoins ont été appelés à faire des dépositions, et par un coroner et un jury au cours de l’enquête judiciaire, dans le cadre de laquelle 71 témoins ont été cités (paragraphes 45-71, 77-99, 100-101 et 103-127). La requérante ne dit au demeurant pas le contraire. La seule question à laquelle la Cour doit répondre est donc celle de savoir si la décision de ne poursuivre aucun policier à titre individuel mais de poursuivre seulement la préfecture en sa qualité d’employeur des policiers est en elle-même susceptible de constituer une violation procédurale de l’article 2 de la Convention.
259. À ce jour, la Cour n’a jamais jugé fautive une décision relative à l’ouverture de poursuites qui faisait suite à une enquête à tous autres égards conforme à l’article 2. Elle s’est en réalité montrée respectueuse à l’égard des États contractants s’agissant tant de l’organisation de leur système de poursuites que de la prise concrète des décisions en matière de poursuites. Dans l’arrêt Kolevi (précité, § 208), elle s’est exprimée en termes clairs :
« [La Cour] n’ignore pas que divers systèmes nationaux de poursuites et différentes règles procédurales en matière d’enquête pénale peuvent être compatibles avec la Convention, laquelle ne prévoit pas de modèle particulier dans ce domaine (...) L’indépendance et l’impartialité dans les affaires impliquant des procureurs de haut rang ou d’autres agents de l’État peuvent être assurées de différentes manières, par exemple grâce à un organe extérieur au système de poursuites pour mener les enquêtes ou les poursuites, par des garanties spéciales d’indépendance du processus décisionnel malgré une dépendance hiérarchique, par le contrôle du public, par un contrôle juridictionnel ou par d’autres mesures. La Cour n’a pas pour tâche de dire quel système répond le mieux aux exigences de la Convention. Le système choisi par l’État membre concerné doit toutefois garantir, en droit comme en pratique, l’indépendance de l’enquête et son objectivité en toutes circonstances, même si elle concerne des personnages publics. »
260. De même, dans l’arrêt Brecknell c. Royaume-Uni (no 32457/04, § 81, 27 novembre 2007), tout en jugeant qu’au début de la procédure l’enquête n’avait pas été suffisamment indépendante (et concluant pour ce motif à la violation du volet procédural de l’article 2), elle a dit qu’il n’y avait pas lieu de critiquer une décision de ne pas engager de poursuites dès lors qu’il n’« apparaissait pas que des poursuites auraient présenté la moindre perspective de succès » et que l’on ne pouvait « reprocher aux autorités aucune négligence coupable ni aucune mauvaise foi ou mauvaise volonté perceptibles ». Dans cette affaire, la requête avait été introduite près de trente ans après le décès en cause. Néanmoins, le raisonnement de la Cour démontre clairement qu’elle n’est guère disposée à remettre en question une décision relative à l’ouverture de poursuites prise de bonne foi à l’issue d’une enquête par ailleurs effective.
261. Cela étant dit, il est arrivé que la Cour admette que des « défaillances institutionnelles » dans le système de justice pénale ou dans le système de poursuites pénales emportent violation de l’article 2 de la Convention. Dans l’arrêt Kolevi (précité, § 209), elle a constaté que des défaillances dans le système de poursuites avaient nui à l’indépendance de l’enquête menée sur des infractions potentiellement commises par le procureur général. Elle a jugé en particulier que la structure centralisée du système de poursuites rendait « pratiquement impossible de mener une enquête indépendante sur les circonstances impliquant [le procureur général] ». Dans la présente affaire, il n’y a pas eu de tels freins à l’effectivité de l’enquête, mais la requérante plaide que d’autres éléments ont fait obstacle à l’ouverture de véritables poursuites. S’il existait de tels obstacles, ils risqueraient d’avoir pour effet que des atteintes à la vie demeurent impunies, ce qui donnerait à penser que l’État tolère des actes illégaux ou s’en fait le complice. La Cour devra donc examiner tour à tour chacune des allégations de la requérante afin de déterminer si des défaillances institutionnelles ont pu emporter violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention.
α. Le CPS
262. En Angleterre et au pays de Galles, la décision d’engager ou non des poursuites est prise par un procureur du CPS. Le Gouvernement affirme – et la requérante ne le conteste pas – que le CPS est indépendant aux fins de l’article 2 de la Convention. Dans les affaires aussi sérieuses que la présente espèce, la décision est prise par un procureur de haut rang qui recueille auparavant un avis juridique indépendant. La Cour n’a jamais dit que la décision relative aux poursuites doive être prise par un tribunal (voir, par exemple, Hugh Jordan, précité, §§ 122-124, où elle n’a pas critiqué le fait que la décision relative aux poursuites a été adoptée par un agent de l’État). D’ailleurs, dans vingt-cinq États contractants au moins, la décision de poursuivre est prise par un procureur (paragraphe 175 ci‑dessus). La circonstance que la décision a été prise par un agent de l’État n’est donc pas problématique en elle-même, pour autant qu’il existe des garanties suffisantes quant à son indépendance et à son objectivité.
263. Par ailleurs, la Cour ne considère pas que l’on puisse s’appuyer sur l’arrêt Maksimov (précité) pour dire que les procureurs doivent entendre les témoins avant de prendre une décision. Dans l’affaire Maksimov, la décision relative aux poursuites avait été prise sans qu’aucun organe d’enquête indépendant n’entende les témoins importants. La situation en l’espèce est tout à fait différente : l’IPCC, un organe d’enquête indépendant, a mené des investigations approfondies dans le cadre desquelles il a interrogé tous les témoins pertinents, et le CPS a eu accès à ses conclusions lorsqu’il a dû décider d’engager ou non des poursuites (paragraphe 80 ci-dessus). De plus, il a été procédé à un interrogatoire et à un contre-interrogatoire des témoins devant le coroner au cours de l’enquête judiciaire, et ce dernier a conclu qu’il n’y avait à présenter au jury aucun élément de preuve permettant d’établir que l’un quelconque des policiers avait commis à titre individuel un homicide illicite (paragraphes 103-127 ci-dessus). À l’issue de l’enquête judiciaire, le CPS a réexaminé sa décision initiale mais il a conclu qu’il n’y avait toujours pas suffisamment d’éléments de preuve pour engager des poursuites contre qui que ce fût à titre individuel (paragraphe 133 ci‑dessus). En pareil cas, rien dans la jurisprudence de la Cour n’indique qu’un procureur indépendant doive aussi entendre les témoins avant de décider d’engager ou non des poursuites.
264. En conséquence, la Cour considère que les griefs de la requérante quant au rôle et à l’organisation du CPS ne font pas apparaître de « défaillances institutionnelles » qui auraient empêché les autorités de garantir comme elles le devaient que les responsables de la mort de M. de Menezes répondent de leurs actes.
β. Le critère de la présence d’éléments suffisants
265. Comme le Gouvernement l’a expliqué, pour décider d’engager ou non des poursuites pour une infraction donnée, les procureurs d’Angleterre et du pays de Galles doivent appliquer un double critère : premièrement, ils doivent se demander s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour considérer qu’il y a une « perspective réaliste de condamnation » de chacun des accusés potentiels pour chacun des chefs d’accusation (critère de la présence d’éléments suffisants) ; deuxièmement, ils doivent rechercher si l’intérêt public commande d’engager des poursuites (paragraphe 163 ci‑dessus). Pour évaluer s’il existe une perspective réaliste de condamnation, ils ne doivent pas appliquer une « règle des 51 % », mais ils doivent se demander si un verdict de culpabilité est « plus probable que le verdict contraire » (paragraphe 164 ci-dessus).
266. Nul ne conteste que les États doivent pouvoir appliquer un critère relatif à la présence d’éléments suffisants afin d’éviter d’imposer aux personnes concernées le coût financier et émotionnel d’un procès qui n’a guère de chance d’aboutir à une condamnation. Dans la décision Gürtekin et autres c. Chypre ((déc.) nos 60441/13, 68206/13 et 68667/13, 11 mars 2014), la Cour l’a implicitement reconnu (au paragraphe 27) :
« Il ne faudrait jamais engager des poursuites à la légère, particulièrement pour une accusation aussi grave que la participation à des homicides illicites massifs, car l’impact est considérable pour l’accusé, lequel se trouve soumis au poids de la machine judiciaire et à l’opprobre, avec toutes les répercussions qui s’ensuivent pour sa réputation et sa vie privée, familiale et professionnelle. Eu égard à la présomption d’innocence consacrée par l’article 6 § 2 de la Convention, on ne peut jamais présumer qu’un individu est à ce point suspect que les normes applicables en matière de preuve seraient sans pertinence dans son cas. Il est dangereux de fonder sur des rumeurs et des ragots des mesures pouvant ruiner une vie. »
267. La Cour considère en outre, pour les raisons exposées ci-dessous, que les États contractants doivent bénéficier d’une certaine marge d’appréciation pour fixer ce critère.
268. Premièrement, lorsqu’elles définissent le critère à appliquer quant à la présence d’éléments suffisants, les autorités internes doivent mettre en balance un certain nombre d’intérêts divergents, notamment ceux des victimes, ceux des accusés potentiels et ceux du public, et elles sont évidemment mieux placées que la Cour pour procéder à une telle appréciation. À cet égard, il est clair que le critère appliqué par les procureurs en Angleterre et au pays de Galles n’a rien d’arbitraire. Au contraire, il a fait l’objet à maintes reprises de réexamens, de consultations publiques et de débats politiques. En particulier, le code a été réexaminé en détail en 2003, en 2010 et en 2012. Par ailleurs, le seuil d’ouverture des poursuites s’applique de manière générale, c’est-à-dire pour toutes les infractions et quelle que soit la personne susceptible de les avoir commises.
269. Deuxièmement, il n’y a pas d’approche uniforme au sein des États contractants en ce qui concerne le critère employé dans leurs ordres juridiques respectifs pour juger de la présence d’éléments suffisants aux fins d’engager des poursuites. Un critère écrit existe à cet égard dans au moins vingt-quatre États contractants (paragraphe 176 ci-dessus). En théorie, l’ouverture des poursuites dépend essentiellement dans vingt de ces États du caractère suffisant des éléments à charge, mais en pratique il est impossible de dire avec certitude que ceux qui prennent la décision relative aux poursuites dans ces États ne tiennent aucun compte des chances d’obtenir une condamnation. Les quatre pays où le critère est expressément axé sur la perspective de condamnation n’apprécient pas cette perspective selon les mêmes paramètres. En Autriche, on évalue « la probabilité d’une condamnation » ; en Islande, il s’agit de déterminer si les éléments sont « suffisants ou probablement suffisants pour parvenir à une condamnation » ; dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine », on vérifie s’il y a « suffisamment d’éléments pour permettre au procureur d’escompter une condamnation » ; au Portugal, enfin, on recherche s’il y a « une possibilité raisonnable qu’une peine soit infligée à l’issue du procès » (paragraphe 178 ci-dessus).
270. En tout état de cause, le critère de la présence d’éléments suffisants doit être envisagé dans le contexte du système de justice pénale dans son ensemble. Le seuil adopté en Angleterre et au pays de Galles est peut-être plus élevé que celui retenu dans certains autre pays, mais cela reflète l’importance du rôle du jury dans le système qui y est en vigueur : une fois que des poursuites ont été engagées, le juge doit laisser le jury examiner l’affaire dès lors qu’il y a « des éléments de preuve » à partir desquels, convenablement instruit, le jury peut conclure à la culpabilité, et ce même si ces éléments sont « ténus » (critère Galbraith – voir le paragraphe 166 ci‑dessus). Étant donné que les affaires où il n’y a pas matière à poursuivre ou celles reposant sur un dossier fragile ne peuvent pas être écartées par le juge, on peut comprendre que le critère de la présence d’éléments suffisants pour l’ouverture de poursuites doive être plus strict. À cet égard, il est à noter que d’autres pays de common law semblent avoir adopté un critère semblable à celui appliqué par les procureurs d’Angleterre et du pays de Galles (paragraphes 182-185 ci‑dessus).
271. Dans ces conditions, on ne saurait dire que le critère relatif à la présence d’éléments suffisants appliqué en Angleterre et au pays de Galles fixe un seuil à ce point élevé qu’il excède la marge d’appréciation de l’État. Dans l’arrêt Brecknell, qui concernait l’Irlande du Nord, la Cour a dit que l’article 2 n’exigeait pas des États qu’ils engagent des poursuites lorsqu’il n’apparaissait pas qu’elles auraient présenté la moindre perspective de succès (paragraphe 260 ci-dessus). Cette approche est tout à fait similaire à la « perspective réaliste de condamnation » appliquée en Angleterre et au pays de Galles, et le fait que ce dernier critère ait ensuite été interprété par les juridictions et les autorités internes comme signifiant qu’un verdict de culpabilité devait être « plus probable que le verdict contraire » ne suffit pas, de l’avis de la Cour, à le faire sortir du champ de la marge d’appréciation de l’État. En tout état de cause, il est impossible de dire avec certitude que le critère employé en Angleterre et au pays de Galles est plus strict que ceux appliqués dans les quatre autres États membres qui disposent d’un seuil de poursuites basé sur la perspective d’obtenir une condamnation (paragraphe 178 ci-dessus).
272. La requérante estime que ce seuil devrait être abaissé dans les affaires dans lesquelles des agents de l’État ont eu recours à la force meurtrière. Toutefois, la Cour constate que rien dans sa jurisprudence ne va dans le sens de cette proposition. Dans l’affaire Gürtekin, qui ne concernait pas un homicide illicite commis par des agents de l’État mais portait sur des tueries de masse, la Cour a dit clairement que le fait qu’un crime relevant de l’article 2 de la Convention soit particulièrement « grave » n’était pas une raison suffisante pour engager des poursuites individuelles sans tenir compte de la solidité du dossier. Elle a au contraire estimé que, les conséquences d’accusations aussi graves étant particulièrement importantes pour la personne visée, il ne fallait pas en pareil cas engager de poursuites à la légère (paragraphe 266 ci-dessus).
273. Les mêmes considérations valent pour les affaires concernant le recours à la force meurtrière par des agents de l’État. Il est vrai que si le public avait l’impression que les agents de l’État n’ont pas à répondre de leurs actes lorsqu’ils ont fait un usage injustifiable de la force meurtrière, cela serait de nature à saper sa confiance dans les forces de l’ordre et dans les services de poursuites. Cependant, compte tenu du coût financier et émotionnel que représente un procès, la confiance du public pâtirait tout autant d’une obligation pour les États d’engager des poursuites en l’absence de perspective réaliste de condamnation. Les autorités de l’État défendeur sont donc fondées à estimer que le meilleur moyen de préserver la confiance du public dans le système de poursuites consiste à ouvrir des poursuites lorsque les éléments du dossier le justifient, et de ne pas en engager lorsqu’ils ne le justifient pas (paragraphe 217 ci-dessus).
274. Quoi qu’il en soit, il apparaît clairement que les autorités nationales ont sérieusement envisagé la possibilité d’abaisser le seuil de poursuites dans les affaires engageant la responsabilité de l’État mais qu’elles ont finalement estimé qu’il serait à la fois injuste et incohérent de faire reposer une charge accrue sur les accusés potentiels en pareil cas. Elles ont toutefois bien veillé à la mise en place d’un certain nombre de garanties dans les affaires de décès causés par la police ou survenus en détention : le DPP revoit personnellement toutes les décisions relatives aux poursuites ; dans toutes les affaires autres que les plus simples, la décision de ne pas poursuivre doit être contrôlée par un juriste indépendant ; le procureur doit écrire à la famille de la victime pour lui expliquer sa décision ; et il faut proposer à la famille de rencontrer le procureur pour qu’il lui explique la décision (paragraphe 220 ci-dessus). S’il est vrai qu’il n’est pas fréquent que des poursuites soient engagées en cas d’homicide par des policiers au Royaume-Uni (comme le tiers intervenant l’indique au paragraphe 228 ci‑dessus), cela peut s’expliquer par la politique extrêmement restrictive appliquée en matière d’usage des armes à feu par des agents de l’État (paragraphe 221 ci-dessus). Comme l’a souligné le Gouvernement, de 2003‑2004 à 2012-2013, le nombre d’opérations de police au cours desquelles il a été fait feu est toujours resté inférieur à une dizaine par an, alors même que l’usage des armes a été autorisé dans dix mille à vingt mille opérations par an (paragraphe 221 ci-dessus).
275. De plus, en l’espèce, il n’est nullement certain, ni même probable, qu’il eût été possible de poursuivre des policiers à titre individuel si le critère appliqué pour déterminer la présence d’éléments suffisants pour poursuivre avait été le critère Galbraith (c’est-à-dire s’il avait suffi qu’il y eût quelques éléments de preuve, même ténus). En réalité, vu les circonstances de la cause, c’est le contraire qui est vrai étant donné que c’est précisément ce critère qui a été appliqué par le coroner lorsqu’il a tranché la question de savoir s’il y avait lieu de laisser au jury la possibilité de prononcer un verdict d’homicide illicite ; or, après avoir entendu soixante et onze témoins, cet officier ministériel indépendant a conclu qu’aucun des policiers ne pouvait être poursuivi à titre individuel en vertu de ce critère (paragraphes 103-127 ci-dessus). Cela étant, même en admettant qu’il eût été possible d’ouvrir des poursuites individuelles si le critère Galbraith avait été employé, cela ne voudrait pas dire que le seuil de poursuites appliqué en Angleterre et au pays de Galles soit élevé au point de heurter l’article 2.
276. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le critère relatif à la présence d’éléments suffisants appliqué en Angleterre et au pays de Galles ne constitue pas une « défaillance institutionnelle » ou un défaut du système de poursuites ayant fait obstacle à ce que les responsables de la mort de M. de Menezes répondent de leurs actes.
γ. Le contrôle des décisions relatives aux poursuites
277. Comme indiqué précédemment, les décisions de ne pas engager de poursuites sont susceptibles de contrôle juridictionnel en Angleterre et au pays de Galles mais le pouvoir de contrôle est à exercer avec circonspection : le juge ne peut modifier la décision que si elle est erronée en droit (paragraphe 165 ci-dessus).
278. Cela étant, la Cour n’est pas convaincue par l’argument de la requérante selon lequel la portée de ce contrôle est trop étroite. Dans la décision Gürtekin (précitée, § 28), elle a dit que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 n’imposait pas forcément d’instaurer un contrôle juridictionnel des décisions d’enquête, même si pareil contrôle constitue indubitablement une garantie rassurante de responsabilité et de transparence. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas pour tâche de contrôler jusque dans les moindres détails le fonctionnement du système d’enquête pénale et du système de justice pénale dans les États contractants ainsi que les procédures y afférentes, ces systèmes pouvant tout à fait suivre des approches et des politiques différentes. De même, dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç (précité, § 233), elle a dit que l’intervention d’un tribunal ou d’un juge disposant de garanties statutaires d’indépendance adéquates était un élément supplémentaire permettant d’assurer l’indépendance de l’enquête dans son ensemble mais qu’elle ne constituait pas en soi une exigence absolue.
279. Selon les informations dont dispose la Cour, la décision de ne pas engager de poursuites est susceptible d’une forme ou d’une autre de contrôle juridictionnel ou de recours devant un tribunal dans au moins vingt-cinq États contractants, et le niveau de contrôle varie considérablement de l’un de ces États à l’autre. Dans sept d’entre eux, la décision doit d’abord être contestée devant un supérieur hiérarchique du service de poursuites. Dans douze États, la décision du procureur ne peut être contestée que devant un supérieur hiérarchique (paragraphe 181 ci‑dessus). On ne peut donc pas dire qu’il y ait au sein des États membres une approche uniforme quant à la possibilité d’obtenir un contrôle des décisions relatives à l’ouverture de poursuites ou quant à la portée de ce contrôle s’il y en a un.
280. En Angleterre et au pays de Galles, il existait au moment des faits un droit de faire contrôler par un tribunal indépendant les décisions relatives aux poursuites. Étant donné que, en l’espèce, la décision a été prise par un procureur indépendant de haut rang qui avait auparavant recueilli un avis juridique indépendant et que les motifs de cette décision ont été pleinement expliqués à la famille du défunt, la Cour ne voit rien dans sa jurisprudence qui corrobore la thèse de la requérante selon laquelle l’article 2 commanderait que la Cour administrative ait un pouvoir de contrôle plus étendu. En tout état de cause, la Cour note que la Cour administrative a en l’espèce tenu compte de sa jurisprudence, et en particulier de « l’examen scrupuleux » que requiert l’arrêt Öneryıldız. De plus, la Cour administrative ne s’est pas contentée de constater que la décision du procureur n’était pas irrationnelle mais, alors qu’elle n’était pas tenue d’aller aussi loin, elle a expressément indiqué qu’elle souscrivait aux conclusions du procureur (paragraphe 98 ci-dessus).
281. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’on ne peut pas qualifier la portée du contrôle juridictionnel des décisions relatives aux poursuites prises en Angleterre et au pays de Galles de « défaillance institutionnelle » ayant porté atteinte à la capacité des autorités internes de veiller à ce que les responsables de la mort de M. de Menezes aient à en répondre.
δ. Conclusion partielle
282. Partant, prenant en compte la procédure pénale dans son ensemble, la Cour conclut que la requérante n’a pas démontré qu’il existât dans le système de justice pénale ou dans le système de poursuites pénales des « défaillances institutionnelles » qui auraient donné lieu ou auraient été de nature à donner lieu à une violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention dans les circonstances de la présente espèce.
iii. Conclusion globale quant au grief que la requérante tire de l’article 2
283. Les faits de la présente espèce sont assurément dramatiques, et la frustration ressentie par la famille de M. de Menezes face à l’absence de poursuites individuelles est compréhensible. Néanmoins, on ne peut pas dire que « toute question se rapportant à une éventuelle responsabilité des autorités dans la mort » ait été « laissé[e] en suspens » (comparer, par exemple, avec l’affaire Öneryıldız (arrêt précité, § 116), où la responsabilité des agents de l’État dans la mort des proches du requérant n’avait pas été reconnue). En l’espèce, dès qu’il a été confirmé que M. de Menezes n’avait pas participé aux attentats manqués du 21 juillet 2005, la police métropolitaine a admis publiquement qu’il avait été tué par erreur par des agents d’élite. Un représentant de la police métropolitaine s’est rendu au Brésil pour présenter en personne aux membres de sa famille les excuses des autorités et leur remettre à titre gracieux une somme d’argent destinée à couvrir leurs besoins financiers. Il a également été conseillé à la famille de M. de Menezes de recueillir l’avis d’un avocat indépendant et il lui a été assuré que la police métropolitaine couvrirait toutes ses dépenses à cet égard. L’IPCC, le CPS, le tribunal pénal et, dans le cadre de l’enquête judiciaire, le coroner et le jury ont ensuite examiné de manière approfondie la responsabilité de chacun des policiers impliqués dans l’affaire ainsi que la responsabilité institutionnelle de la préfecture. Par la suite, lorsque la famille a lancé une action civile en réparation, la police métropolitaine a accepté de conclure avec elle un accord prévoyant le versement d’une indemnité, dont le montant n’a pas été divulgué.
284. Comme le Gouvernement l’a souligné, il arrive que des décès soient causés par des défaillances du système dans son ensemble plutôt que par des erreurs individuelles engageant la responsabilité pénale ou disciplinaire de la personne. La Cour a d’ailleurs implicitement reconnu dans l’affaire McCann et autres que, dans les opérations de police complexes, les manquements pouvaient être institutionnels ou individuels ou à la fois institutionnels et individuels. En l’espèce, tant la responsabilité institutionnelle de la police que la responsabilité individuelle de chacun des policiers concernés ont été examinées de manière approfondie par l’IPCC, le CPS, le tribunal pénal, le coroner et le jury de l’enquête judiciaire. La décision de poursuivre la préfecture en sa qualité d’employeur des policiers n’avait pour conséquence d’exclure l’ouverture de poursuites contre les policiers à titre individuel ni en droit ni en pratique. La décision de n’engager des poursuites contre aucun des agents à titre individuel n’est pas non plus due à des déficiences de l’enquête ou à une complicité ou une tolérance de l’État relativement à des actes illégaux ; elle est la conséquence de ce que, à l’issue d’une enquête approfondie, un procureur a examiné tous les faits de la cause et a conclu au regard du critère pertinent qu’il n’y avait contre aucun des agents pris individuellement suffisamment d’éléments de preuve pour engager à leur égard des poursuites pénales à raison d’une quelconque infraction pénale. Néanmoins, des défaillances institutionnelles et opérationnelles ont été constatées et des recommandations détaillées ont été formulées pour faire en sorte que les erreurs ayant abouti à la mort de M. de Menezes ne se reproduisent pas. Dans son rapport, le CPS a clairement dit que la gestion de l’opération Theseus 2 avait été défaillante depuis le moment où elle avait été transmise du commandant McDowall au commandant Dick, que la mort de Jean Charles de Menezes était imputable à un défaut de préparation, et que les défaillances institutionnelles et opérationnelles qui s’étaient produites étaient « graves et évitables » et avaient « conduit à la mort d’un innocent ».
285. Ces défaillances institutionnelles ont valu à la préfecture d’être condamnée pour une infraction à la loi de 1974 que la requérante estime ne pas être suffisamment grave pour satisfaire aux exigences procédurales découlant de l’article 2 de la Convention. Pour autant, il n’y a pas en l’espèce de « disproportion manifeste » entre l’infraction commise et la sanction infligée (voir, par exemple, Kasap et autres, précité, § 59, A. c. Croatie, précité, § 66, et Ali et Ayşe Duran, précité, § 66). La Cour a conclu à une telle « disproportion manifeste » à propos d’affaires dans lesquelles des individus avaient été reconnus coupables d’infractions graves mais s’étaient vu infliger des peines excessivement clémentes. Dans la présente cause, en revanche, un procureur indépendant a soupesé tous les éléments du dossier et constaté qu’il n’y avait suffisamment d’éléments à charge que pour poursuivre la préfecture pour infraction à la loi de 1974. De plus, la préfecture a été déclarée coupable des accusations retenues contre elle, et la Cour ne dispose d’aucune indication permettant de dire que la sanction qui lui a été infligée (une amende de 175 000 GBP et le paiement des dépens, soit 385 000 GBP) ait été excessivement clémente pour une infraction de cette nature.
286. En conséquence, au vu de la procédure prise dans son ensemble, on ne saurait dire que les autorités internes ont failli à l’obligation procédurale que leur faisait l’article 2 de la Convention de mener sur la mort par balles de M. de Menezes une enquête effective propre à conduire à l’établissement des faits, à déterminer si le recours à la force était justifié dans les circonstances de l’espèce et à identifier les responsables ainsi que, le cas échéant, à les sanctionner.
287. Eu égard à cette conclusion, il n’est pas nécessaire que la Cour détermine si l’ouverture d’une procédure privée ou celle d’une procédure disciplinaire auraient été aptes à permettre à l’État de respecter les obligations procédurales découlant pour lui de l’article 2 de la Convention.
288. Partant, la Cour conclut qu’aucune violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention n’a été établie en l’espèce.
RĂZVAN LAURENŢIU CONSTANTINESCU c. ROUMANIE du 15 mars 2016 Requête no 59254/13
Violation de l'article 3 : Défaut d'enquête, l'enquête débute trois ans après les faits de violence de la police sur les requérants.
b) Appréciation de la Cour
66. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d’autres services comparables de l’État, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle requise par l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 315-319, 17 septembre 2014).
67. L’enquête menée ne doit pas être entravée de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur. Elle doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. Certes, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent démontrer avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, la déclaration détaillée de la victime présumée au sujet de ces allégations, les dépositions des témoins oculaires, les expertises et, le cas échéant, les certificats médicaux complémentaires propres à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations médicales, notamment de la cause des blessures. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause des blessures ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004‑IV).
68. Enfin, pour qu’une enquête menée au sujet des faits d’homicide ou de mauvais traitements commis par des agents de l’État puisse passer pour effective, d’une manière générale, il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements. Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (Bursuc, précité, § 103).
69. Dans la présente affaire, la Cour note qu’une enquête a bien eu lieu. Il reste à apprécier son caractère effectif.
70. En l’espèce, la Cour constate que l’enquête a été confiée au parquet près le tribunal départemental d’Argeş, soit à des procureurs qui travaillaient quotidiennement avec les services de police au sein desquels les agents poursuivis exerçaient leurs fonctions. Or cette pratique a récemment fait l’objet de préoccupations exprimées par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Celui-ci a estimé qu’il était crucial que la Roumanie établisse un mécanisme indépendant et efficace d’examen des plaintes contre la police. Il a aussi indiqué qu’un système indépendant et efficace de plaintes contre la police était primordial pour obtenir et préserver la confiance du public dans la police et qu’un tel système constituait une protection essentielle contre les mauvais traitements et comportements répréhensibles. Pour le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, pareil système requiert qu’il n’y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre l’enquêteur et le fonctionnaire visé par la plainte, et l’indépendance concrète doit prévaloir dans la pratique (Anton, précité, § 56).
Par ailleurs, la Cour note les préoccupations exprimées à cet égard par le tribunal départemental d’Argeş, dans sa décision du 11 mars 2011 (paragraphe 26, ci-dessus, in fine).
71. S’agissant de la diligence avec laquelle l’enquête aurait dû être conduite, la Cour observe que le Gouvernement n’a apporté aucun élément pour expliquer la période d’inactivité au début de l’enquête, dénoncée par le requérant. Qui plus est, la Cour constate que le délai de finalisation de l’enquête, fixé pour le 10 août 2012, à la suite d’un recours hiérarchique exercé par le requérant, n’a pas été respecté (paragraphe 37 ci-dessus). Le Gouvernement n’a aucunement expliqué cette absence manifeste de diligence des enquêteurs par rapport à leurs propres injonctions. Il en va de même pour ce qui est de l’injonction faite, par deux fois, par le tribunal départemental, dans ses décisions définitives des 11 mars 2011 et 20 mars 2012, que des poursuites pénales soient entamées contre les policiers accusés (paragraphes 27 et 35 ci-dessus).
72. À cet égard,
la Cour n’est pas convaincue qu’il ait été dûment remédié à toutes les lacunes
de l’enquête signalées par les décisions des 11 mars 2011 et 20 mars 2012 du
tribunal départemental d’Argeş. En particulier, il ne ressort pas des pièces du
dossier qui lui ont été soumises que le parquet se soit conformé à l’injonction
du tribunal départemental, contenue dans sa décision du 20 mars 2012, de
demander un complément d’expertise médico-légale, visant à rechercher de quelle
manière exactement les lésions traumatiques du requérant avaient été causées
(paragraphe 34
ci-dessus).
73. La Cour note ensuite que les enquêteurs n’ont recherché que près de trois ans après le début de l’enquête, et après deux renvois successifs de l’affaire par le tribunal, des informations essentielles pour l’affaire – à savoir l’identité des policiers présents lors de l’incident – informations qui étaient contenues dans l’enregistrement audio-vidéo déposé au dossier par un des policiers accusés dès le 29 juin 2010.
74. Par
ailleurs, elle estime particulièrement frappant que les enquêteurs ne se soient
pas préoccupés du fait que l’enregistrement en question avait été extrait d’un
fichier électronique créé le 4 mai 2010 (paragraphe 30,
ci-dessus) et n’aient pas recherché à retrouver le
support sur lequel l’enregistrement initial réalisé à la date de l’incident,
soit le 2 septembre 2009, avait été stocké, afin de vérifier si son contenu
avait été entièrement mis à la disposition des enquêteurs.
75. La Cour relève également que le tribunal départemental d’Argeş ne s’est nullement penché, dans sa décision du 25 mars 2013, sur les constats contenus dans le rapport du médecin légiste A.F., établi le 12 décembre 2012, quant à l’origine des blessures relativement graves constatées sur le corps du requérant, dont faisait état le rapport médico-légal (Cucu, précité, § 97).
76. Enfin, la
déclaration détaillée de la victime et les dépositions des témoins oculaires
proposés par elle, n’ont pas été recueillies dès le début de l’enquête, mais
seulement à la suite de la décision de justice rendue le 11 mars 2011, qui a
accueilli le recours du requérant contre le premier
non-lieu rendu dans cette affaire.
77. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené d’enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation défendable du requérant selon laquelle des policiers lui avaient infligé des mauvais traitements.
78. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
RUSTAM KHODZHAYEV c. RUSSIE du 12 novembre 2015 requête 21049/06
Violation de l'article 3 pas d'enquête effective sur les violences policières. Le défaut d'enquête empêche la CEDH de constater s'il y a eu des actes inhumains et dégradants.
a) Principes généraux
i. Interdiction de mauvais traitements et usage de la force
52. La Cour a déclaré à maintes reprises que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Cet article ne prévoit pas d’exceptions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d’après l’article 15 § 2 de la Convention il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
53. Lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (voir, notamment, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336 ; Mete et autres c. Turquie, no 294/08, § 106, 4 octobre 2011 ; et El Masri c. « l’ex‑République yougoslave de Macédoine » [GC], no 39630/09, § 207, CEDH 2012).
54. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, Labita, précité, § 121, et Matko c. Slovénie, no 43393/98, §§ 98-99, 2 novembre 2006).
55. La Cour rappelle en outre sa jurisprudence constante selon laquelle, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, lorsque les événements en cause sont connus exclusivement des autorités, la survenue de toute blessure ou décès pendant la période où l’individu se trouvait entre les mains des agents de l’État donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse dans ce cas sur les autorités qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 89, 23 février 2012, et les références qui y sont citées).
56. S’agissant en particulier de l’usage de la force au cours d’une arrestation, la Cour doit rechercher si la force utilisée était strictement nécessaire et proportionnée et si l’État doit être tenu pour responsable des blessures infligées. Pour répondre à cette question, elle doit prendre en compte les blessures occasionnées et les circonstances dans lesquelles elles l’ont été. À partir du moment où l’allégation de mauvais traitements a été suffisamment étayée, il incombe normalement au Gouvernement d’apporter des preuves pertinentes démontrant que le recours à la force était à la fois proportionné et nécessaire (voir, notamment, Petyo Popov c. Bulgarie, no 75022/01, § 54, 22 janvier 2009, et les références qui y sont citées).
57. À cela il faut ajouter que, si la Cour est consciente du caractère subsidiaire de son rôle et doit se montrer prudente avant d’assumer celui de tribunal de première instance appelé à connaître des faits, elle n’est pas liée par les constatations factuelles des tribunaux nationaux et peut s’en écarter lorsque les circonstances d’une affaire particulière rendent cela inévitable (voir, par exemple, Maslova et Nalbandov c. Russie, no 839/02, § 100, 24 janvier 2008, et Buntov c. Russie, no 27026/10, § 118, 5 juin 2012). La Cour se doit de faire preuve d’une vigilance particulière en cas d’allégations de violation de l’article 3 de la Convention (Ribitsch, précité, § 32, et El‑Masri, précité, § 155; voir aussi, notamment, Georgiy Bykov c. Russie, no24271/03, § 51, 14 octobre 2010).
ii. Obligation de mener une enquête effective
58. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective.
59. L’obligation de mener une enquête effective est une obligation de moyens : toute enquête ne doit pas nécessairement aboutir à la conclusion qui correspond à la version des faits du plaignant. Toutefois, elle doit en principe pouvoir mener à l’établissement des faits et, si les allégations s’avèrent confirmées, à l’identification et à la punition des responsables (voir, entre autres, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 124, CEDH 2000‑III, et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 71, CEDH 2002‑II; voir aussi Georgiy Bykov, précité, § 60).
60. L’enquête doit également être prompte. La Cour va ainsi notamment examiner si les autorités ont réagi rapidement aux allégations de mauvais traitements (Labita, précité, §§ 133 et suiv.) et prendre en compte la durée de l’enquête initiale (Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 37, 18 octobre 2001). La Cour rappelle également que l’enquête rendue nécessaire par des allégations de mauvais traitements doit être à la fois rapide et approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête ou fonder leurs décisions (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 103, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004‑IV). Les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables à leur disposition pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et les expertises criminalistiques (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 104, CEDH 1999‑IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les causes des préjudices subis ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (voir, par exemple, Mikheïev c. Russie, no 77617/01, § 108, 26 janvier 2006).
61. De plus, la victime doit être en mesure de participer effectivement, d’une manière ou d’une autre, à l’enquête (El‑Masri, précité, § 185).
62. Enfin, l’enquête doit être indépendante. En particulier, elle ne peut l’être si elle est menée par des agents du même département que ceux impliqués dans les mauvais traitements allégués (Buntov, précité, § 124).
b) Application des principes à la présente espèce
63. La Cour estime nécessaire d’examiner les griefs soulevés d’abord sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention puis sous celui du volet matériel de cette disposition.
i. Sur les carences alléguées de l’enquête
64. La Cour estime avant tout que, pris ensemble, les certificats médicaux soumis par le requérant, ainsi que le témoignage de ce dernier, constituent des motifs raisonnables de penser que les blessures de l’intéressé ont pu être causées par la police. Elle va donc rechercher si les autorités nationales ont mené une enquête prompte et approfondie sur les allégations de mauvais traitements.
65. À cet égard, la Cour constate tout d’abord que des blessures ont été constatées sur le visage et le corps du requérant peu après son arrestation. Elle note aussi que, dès le lendemain de son arrestation, le requérant a déposé une plainte auprès du procureur du district Léninski de Tumen – autorité compétente et suffisamment indépendante pour enquêter sur les mauvais traitements prétendument commis par des agents de police (paragraphe 14 ci-dessus). Ainsi, la Cour estime que le requérant a agi avec la diligence nécessaire et que les autorités chargées de l’enquête ont pris connaissance de la situation suffisamment tôt au regard de la nécessité de procéder à l’établissement des faits.
66. La Cour relève que les autorités chargées de l’enquête ne semblent pas avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de confirmer ou de réfuter les allégations de mauvais traitements et d’établir l’origine des lésions corporelles. Les enquêteurs se sont bornés à interroger les policiers impliqués, ainsi que les témoins arrivés sur les lieux alors que le requérant était déjà au sol et menotté. Malgré la demande du requérant tendant à l’interrogation des témoins oculaires présents au moment même de l’arrestation, les enquêteurs ne semblent avoir pris aucune mesure visant à la vérification de l’existence desdits témoins et, le cas échéant, à l’identification et l’interrogatoire de ceux-ci. Enfin, aucune mesure n’a été prise aux fins de confrontation des dépositions des policiers à celle du requérant, notamment au moyen d’une reconstitution des faits. La Cour observe par ailleurs que les agents de police O. et Ku. ont donné des dépositions contradictoires quant au déroulement de l’interpellation (paragraphes 16, 20, 28 et 29 ci-dessus), ce qui n’a jamais fait l’objet d’une analyse de la part des enquêteurs.
67. La Cour note aussi que les enquêteurs chargés d’examiner la plainte ont manifestement omis de communiquer sans délai au requérant les résultats de l’enquête (paragraphes 18 et 21 ci-dessus), rendant ainsi illusoire le contrôle effectif des résultats de l’enquête par le public et plus particulièrement par l’intéressé.
68. La Cour souligne avoir jugé que le refus des autorités internes d’ouvrir une instruction pénale au sujet d’un grief défendable de mauvais traitements subis entre les mains de la police est révélateur d’un manquement de l’État à son obligation de conduire une enquête effective prévue par l’article 3 de la Convention (Lyapin c. Russie, no 46956/09, §§ 128-140, 24 juillet 2014). En l’occurrence, la Cour ne voit aucune raison d’aboutir à un constat différent : en l’espèce, les autorités se sont en effet limitées à une brève enquête préliminaire qui s’est soldée par un refus d’ouvrir une véritable instruction pénale.
69. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’enquête sur les allégations de mauvais traitements n’était pas conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural. Il y a donc eu, en l’espèce, violation de cette disposition sous cet aspect.
ii. Sur l’usage de la force contre le requérant et les allégations de mauvais traitements
70. La Cour note que les certificats médicaux soumis par le requérant, non contestés par le Gouvernement (paragraphes 11 à 13 ci-dessus), font état d’une contusion pariétale, d’une contusion du thorax et de plusieurs éraflures sur le visage et le cou. Elle estime que les blessures constatées atteignent le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Elle va donc examiner si, eu égard aux éléments dont elle dispose, l’État peut être tenu pour responsable de ces blessures.
71. La Cour prend note de la version des faits présentée par le requérant, lequel soutient avoir été immobilisé au sol et menotté, puis avoir reçu plusieurs coups à la tête et au corps lors de son arrestation et enfin avoir été frappé à l’abdomen dans le bureau de police (paragraphe 8 ci‑dessus).
72. De même, la Cour prend note de la version des faits retenue par les autorités nationales, selon laquelle le requérant tentait de s’échapper et de s’opposer à son arrestation, à la suite de quoi des agents l’ont projeté au sol et menotté (paragraphe 9 ci-dessus).
73. La Cour note que toutes les circonstances de l’arrestation font l’objet d’une controverse entre les parties. Elle observe toutefois que les blessures constatées ne correspondent qu’en partie aux mauvais traitements dénoncés par le requérant et qu’elles pourraient avoir été causées par une chute au sol, telle que décrite par les autorités nationales. De même, si l’un des certificats soumis par le requérant fait état de la fracture d’une côte, la Cour note que ce diagnostic n’a pas été confirmé ultérieurement. La thèse du requérant concernant les coups de poing à l’abdomen reçus au bureau de police (paragraphe 8 ci-dessus) n’a jamais été confirmée par les certificats médicaux, aucune blessure au niveau d’abdomen n’étant constatée (paragraphes 10 à 13 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de constater que le requérant a subi des mauvais traitements physiques après son arrestation.
74. Ainsi, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisamment probants pour conclure « au-delà de tout doute raisonnable » que le requérant a été soumis à des traitements inhumains et dégradants lors de son arrestation ou dans le bureau de police.
75. La Cour souligne, néanmoins, que son incapacité de parvenir à un constat de l’existence d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention dérive, largement, du défaut des autorités nationales de conduire une enquête effective à l’époque des faits (Igbal Hasanov c. Azerbaïdjan, no 46505/08, § 49, 15 janvier 2015, et Uzeyir Jafarov c. Azerbaïdjan, no 54204/08, § 61, 29 janvier 2015).
76. Compte tenu des considérations développées ci-dessus, la Cour ne peut donc relever aucune infraction à l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
Poede C. Roumanie arrêt du 15 septembre 2015 requête 40549/11
Violation de l'article 3 de la Convention : pas d'enquête automatique et effective sur une plainte de violence policière.
52. La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la part de la police ou d’autres autorités comparables, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV) et elle doit être diligentée d’office par les autorités.
53. L’enquête qu’exigent des allégations graves de mauvais traitements doit être à la fois rapide et approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête ou fonder leur décision (Assenov et autres, précité, § 103, et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004–IV). Les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables à leur disposition pour obtenir les preuves relatives à l’incident en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et les expertises criminalistiques (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 104, CEDH 1999‑IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les causes du dommage ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (Boicenco c. Moldova, no 41088/05, § 123, 11 juillet 2006).
54. En l’espèce, au vu des éléments présentés devant elle et notamment du certificat médical du requérant, la Cour considère que les allégations de mauvais traitements étaient « défendables » au sens de la jurisprudence précitée, au moins à partir du moment où les autorités compétentes ont eu connaissance du document médical en question.
55. La Cour note ensuite que deux enquêtes préliminaires ont bien eu lieu dans la présente affaire. Il reste à apprécier la diligence avec laquelle elles ont été menées et leur caractère « effectif ».
56. La Cour observe ensuite que, dans le cadre de la première procédure engagée par le requérant, le parquet s’est borné à entendre celui-ci, les quatre policiers et gendarmes impliqués dans les événements, ainsi qu’un seul des témoins proposés par le requérant. Il n’a pas fait de démarches sérieuses pour entendre le deuxième témoin proposé par le requérant. Par ailleurs, le tribunal n’a pas estimé utile d’ordonner au parquet d’entendre les autres témoins oculaires qui avaient fait des déclarations confirmant la version des faits du requérant dans une procédure parallèle (voir, a contrario, Stanchev c. Bulgarie, no 8682/02, § 70, 1er octobre 2009).
57. La Cour observe ensuite que, dans la deuxième procédure, le parquet militaire a entendu dans un premier temps lesdits témoins ainsi que le chef des policiers qui avaient assisté aux événements.
En revanche, il apparaît que les autres parquets auxquels la procédure a ensuite été renvoyée n’ont pas effectué un véritable examen de leurs dépositions – quitte à les écarter le cas échéant.
En effet, il s’avère que le parquet près le tribunal départemental de Vaslui a rendu sa décision de non-lieu du 11 avril 2011 à la lumière des décisions adoptées dans la première procédure engagée par le requérant, en estimant qu’aucun nouveau fait ou circonstance présentant un caractère nouveau n’était intervenu depuis lors (paragraphe 31 ci-dessus).
Or, précisément, lesdites déclarations constituaient en elles-mêmes, comme le tribunal départemental de Vaslui l’a lui-même admis, sinon des faits et circonstances nouveaux, du moins des éléments nouveaux par rapport à la première procédure.
Il apparaît que le tribunal a également omis de faire une analyse approfondie de ces témoignages.
58. Force est donc de constater que les autorités ont choisi de fonder leurs décisions uniquement sur les déclarations des agents de l’État et du témoin confirmant leur version des faits. En l’absence d’une explication plausible à cet égard, la Cour ne voit aucune raison de donner la primauté à la version des agents de l’État sur celle du requérant, étayée par les témoignages susmentionnés (voir, mutatis mutandis, Archip c. Roumanie, no 49608/08, § 70, 27 septembre 2011, et Andreşan c. Roumanie, no 25783/03, § 45, 30 octobre 2012).
59. De surcroît, la Cour constate que les autorités nationales n’ont ordonné d’expertise médicale dans aucune des deux procédures, alors qu’une telle mesure d’instruction eût été de nature à permettre d’élucider les causes possibles des lésions subies par le requérant, et de donner plus de poids à leurs conclusions (voir, mutatis mutandis, Petru Roşca c. Moldova, no 2638/05, § 47, 6 octobre 2009).
60. En tout état de cause, il convient de noter qu’il n’a à aucun moment été ouvert de poursuites pénales en l’espèce. Or, la Cour a déjà souligné que le défaut d’ouvrir des poursuites pénales dans des affaires concernant des allégations de mauvais traitements sur des personnes se trouvant « entre les mains de la police » est susceptible de compromettre la validité de tout élément de preuve retenu au terme de l’instruction (voir, mutatis mutandis, Maslova et Nalbandov c. Russie, no 839/02, §§ 94-96, 24 janvier 2008 ; Buntov c. Russie, no 27026/10, § 132, 5 juin 2012, et Beresnev c. Russie, no 37975/02, § 98, 18 avril 2013). En l’occurrence, la décision de non-lieu a été fondée sur de simples déclarations qui n’avaient pas le statut de preuves au sens des règles roumaines de procédure pénale (paragraphe 37 ci-dessus). Cela est d’autant plus grave dans un cas comme celui de l’espèce, où les blessures étaient attestées par un certificat médical. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’étudier plus avant l’argument du requérant concernant la question de la qualité en laquelle les agents de l’État ont été entendus par le parquet.
61. En conclusion, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas mené une enquête propre à permettre de répondre à la question de savoir si l’usage de la force par les agents de l’État contre le requérant avait été proportionné.
62. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural.
ANTON C. ROUMANIE du 19 mai 2015 requête 57365/12
Violation de l'article 3 pour défaut d'enquête : Le requérant se plaint de violences subies durant son interpellation. Il porte plainte mais l'enquête n'est pas effective.
40. La Cour relève que la requête porte, d’une part, sur les traitements que le requérant aurait subis le 26 août 2010 et, d’autre part, sur l’enquête menée par les autorités au sujet de ces traitements, qualifiée d’inappropriée par le requérant. Elle analysera séparément ces deux griefs sous l’angle des deux volets – substantiel et procédural – de l’article 3 de la Convention.
1. Sur l’allégation de mauvais traitements
41. Le requérant affirme qu’il a été victime de mauvais traitements de la part de plusieurs policiers lors de son interpellation, le 26 août 2010.
42. Le Gouvernement combat les accusations de mauvais traitements. Se référant aux éléments de preuve recueillis lors des investigations menées par les autorités internes – qu’il estime mieux placées pour établir les faits –, il soutient que le requérant n’a été soumis à aucune forme de violence de la part des policiers mis en cause.
43. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne se trouve entièrement sous le contrôle de la police, toute blessure qui lui est occasionnée pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur l’origine de pareille blessure et de produire des preuves de nature à faire peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, et Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, § 80, 12 octobre 2004).
Eu égard à l’obligation pour les autorités de rendre des comptes au sujet des individus placés sous leur contrôle, la Cour rappelle également que l’acquittement des policiers au pénal ne dégage pas l’État défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 168, 1er mars 2001).
44. En l’espèce, la Cour note que le requérant a subi des violences le 26 août 2010, constatées dans la nuit par le personnel médical autorisé à examiner les personnes placées en détention provisoire. Un rapport médicolégal a confirmé par la suite que l’intéressé présentait des blessures ‑ notamment de multiples contusions, un traumatisme crânien cérébral mineur, une contusion thoracique et abdominale mineure, une contusion au poignet droit et une contusion à la jambe droite avec plaie ouverte – et que ces lésions avaient nécessité sept à huit jours de soins médicaux.
45. Or la Cour observe que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible concernant l’origine des lésions constatées chez le requérant juste après son interpellation, avant son placement en détention.
46. Par conséquent, en l’absence d’une telle explication, la Cour estime établi en l’espèce que les lésions dont les traces ont été constatées sur la personne du requérant ont été causées par un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité (Cucu c. Roumanie, no 22362/06, § 97, 13 novembre 2012).
47. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
2. Sur l’allégation d’insuffisance de l’enquête
48. Le requérant soutient que l’enquête menée au sujet de sa plainte n’a pas été effective et que le procureur a étouffé l’affaire.
49. Le Gouvernement considère qu’il y a eu en l’espèce une enquête effective et sérieuse et que le non-lieu rendu par le procureur était fondé sur de nombreuses preuves.
50. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d’autres services comparables de l’État, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle requise par l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale des traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 315-319, 17 septembre 2014).
51. D’une manière générale, pour qu’une enquête puisse passer pour effective, il faut que les institutions et les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes qu’elle vise. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 110, CEDH 2005‑VII, Halat c. Turquie, no 23607/08, § 51, 8 novembre 2011, et Mocanu et autres, précité, § 320).
52. L’enquête menée doit ainsi être effective, ce qui signifie qu’elle ne doit pas être entravée de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur. Elle doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. À cet égard, la Cour réaffirme que, lorsque les circonstances sont telles que les autorités doivent déployer des agents cagoulés pour procéder à une arrestation, il faut que ces agents soient tenus d’arborer un signe distinctif – par exemple un numéro de matricule – qui, tout en préservant leur anonymat, permette par la suite de les identifier en cas de contestation de la part des personnes appréhendées (Hristovi c. Bulgarie, no 42697/05, § 92, 11 octobre 2011, et Antayev et autres c Russie, no 37966/07, § 109, 3 juillet 2014). Certes, la conduite de pareille enquête est une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Par ailleurs, la Cour souligne une nouvelle fois que les allégations de mauvais traitements infligés pendant une garde à vue sont extrêmement difficiles à étayer pour la victime si elle a été isolée du monde extérieur et privée de la possibilité de voir médecins, avocats, parents ou amis, susceptibles de lui fournir un soutien et d’établir les preuves nécessaires (Eldar Imanov et Azhdar Imanov c. Russie, no 6887/02, §§ 88‑89, 16 décembre 2010).
53. Par ailleurs, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause des blessures ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette exigence (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004‑IV, et Mocanu et autres, précité, § 322).
54. Dans la présente affaire, la Cour note qu’une enquête a été ouverte d’office, à la suite des observations faites par quatre délégués du CPT qui, au cours de leur visite dans plusieurs centres de détention de Roumanie, dont celui où se trouvait le requérant, avaient rencontré ce dernier.
Il reste à apprécier si cette enquête a été menée avec diligence et de manière effective.
55. À cet égard, la Cour relève que, dans sa décision de non-lieu rendue le 25 octobre 2011, le parquet près la cour d’appel de Bucarest a conclu à l’absence de responsabilité pénale de deux des policiers mis en cause par le requérant (paragraphe 19). De même, par un non-lieu rendu ultérieurement, dans une procédure pénale subséquente, il a été conclu à l’absence de responsabilité pénale des trois autres policiers mis en cause par le requérant.
56. S’agissant de l’impartialité de l’enquête, la Cour constate qu’elle a été confiée tout d’abord au parquet près la cour d’appel de Bucarest, puis au parquet près le tribunal départemental de Bucarest, soit à des procureurs qui, selon la procédure pénale ordinaire, travaillaient quotidiennement avec les services administratifs de police dans lesquels les agents poursuivis exerçaient leurs fonctions. Or cette pratique a récemment fait l’objet de préoccupations exprimées par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Celui-ci a estimé qu’il était crucial que la Roumanie établisse un mécanisme indépendant et efficace d’examen des plaintes contre la police. Il a aussi indiqué qu’un système indépendant et efficace de plaintes contre la police était primordial pour obtenir et préserver la confiance du public dans la police et qu’un tel système constituait une protection essentielle contre les mauvais traitements et comportements répréhensibles. Pour le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, pareil système requiert qu’il n’y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre l’enquêteur et le fonctionnaire visé par la plainte, et l’indépendance concrète doit prévaloir dans la pratique.
57. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà conclu à la violation du volet procédural des articles 2 et 3 de la Convention dans un certain nombre d’affaires similaires dirigées contre la Roumanie (Cucu, précité, §§ 93-99, Petruş Iacob c. Roumanie, no 13524/05, §§ 28-52, 4 décembre 2012, et Austrianu c. Roumanie, no 16117/02, §§ 56-75, 12 février 2013).
58. Qui plus est, dans la présente espèce, la Cour relève qu’il est particulièrement frappant que ni le parquet près la cour d’appel de Bucarest ni cette dernière juridiction ne se soient enquis, respectivement dans l’ordonnance de non‑lieu et dans la décision de justice subséquente rendues par eux, de l’origine des blessures relativement graves constatées sur le corps du requérant dans le rapport médicolégal établi en l’affaire (Cucu, précité, § 97).
59. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené d’enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation défendable du requérant selon laquelle un policier lui avait infligé des mauvais traitements.
Partant, elle rejet l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement et conclut à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
ZAYEV c. RUSSIE du 16 avril 2015 requête 36552/05
Violation de l'article 3 pour défaut d'enquête : Le requérant se plaint de violences subies durant la garde à vue. Il porte plainte mais l'enquête n'est pas effective.
b) Sur l’effectivité de l’enquête
i. Les principes généraux
99. La Cour considère que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII)
100. Certes, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens : l’enquête ne doit pas nécessairement arriver à la conclusion qui coïncide avec la version des faits présentée par le plaignant. Toutefois, elle doit également être effective en ce sens qu’elle doit tant pouvoir conduire à l’identification et au châtiment des responsables (voir, parmi beaucoup d’autres, Kopylov c. Russie, no 3933/04, § 132, 29 juillet 2010) que déterminer si la force utilisée pouvait ou non être justifiée dans les circonstances.
101. Pour qu’une enquête relative à une allégation de mauvais traitements puisse passer pour effective, elle doit être approfondie. Cela signifie que les autorités doivent entreprendre des démarches appropriées pour établir ce qui s’est passé et ne doivent pas se fier à des conclusions hâtives et mal fondées pour motiver leurs décisions à l’issue de l’enquête et notamment pour clôturer celle-ci (Assenov et autres, précité, § 103 et suiv., et Markaryan, précité, § 55). Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, la déclaration détaillée de la victime présumée au sujet de ces allégations, les dépositions des témoins oculaires, les expertises et, le cas échéant, les certificats médicaux complémentaires propres à fournir un compte-rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations médicales, notamment de la cause des blessures. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause des blessures ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme (Davitidze, précité, § 100).
102. En outre, il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999‑III). De surcroît, une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte (Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 37, 18 octobre 2001). Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (mutandis mutandis Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 167, CEDH 2011). Enfin, il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l’enquête ou de ses résultats. Le degré de contrôle public requis peut varier d’une affaire à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête est indispensable (El‑Masri, précité, § 185).
103. De surcroît, les autorités ont l’obligation de mener une enquête officielle dès qu’une plainte officielle est déposée. Même lorsqu’une plainte proprement dite n’est pas formulée, il y a lieu d’ouvrir une enquête s’il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitements (Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie, no 71156/01, § 97, 3 mai 2007, Velev c. Bulgarie, no 43531/08, § 60, 16 avril 2013, ainsi que El-Masri, précité, § 186 in fine).
104. Enfin, dans le cadre de l’examen des griefs tirés de l’article 5, la Cour a, à maintes reprises, souligné l’importance du contrôle juridictionnel indépendant à l’égard des actes de privation de liberté en vue du renforcement de la protection de l’individu contre les actes de torture et de mauvais traitements. La Cour réitère à ce propos qu’une prompte intervention judiciaire peut conduire à la détection et à la prévention de mesures propres à mettre en péril la vie de la personne concernée ou de sévices graves enfreignant les garanties fondamentales énoncées aux articles 2 et 3 de la Convention (El-Masri, précité, § 231, et Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 76, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI).
ii. L’application de ces principes au cas d’espèce
α) sur le caractère approfondi de l’instruction
105. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que les autorités russes ont mené une enquête préliminaire, mais que celle-ci n’a abouti à l’ouverture d’une instruction pénale, selon l’article 146 du code de procédure pénale (voir, a contrario, Lyapin, précité, §§ 128-136), que dans un délai de trois mois, ce qui excédait le terme imparti à cet effet par l’article 145 § 3 du code de procédure pénale (paragraphe 57 ci-dessus). La Cour note que les informations jugées suffisantes par le procureur de la région de Sakhaline pour ouvrir une instruction pénale le 4 avril 2002 (paragraphe 18 ci-dessus) étaient disponibles immédiatement après les mauvais traitements, à savoir, le 28 janvier 2002 (paragraphe 12 ci‑dessus). Or, en l’espèce, rien ne peut expliquer ce retard de trois mois dans l’ouverture de l’instruction. La Cour considère qu’un tel retard est de nature à avoir un effet négatif irréversible compromettant la capacité de l’instruction à faire la lumière sur les faits (Indelicato, précité, § 37, Kopylov, précité, § 137, et Shishkin c. Russie, no 18280/04, § 100, 7 juillet 2011).
106. La Cour relève que, dans le cadre de l’instruction, les autorités ont entrepris plusieurs opérations de vérification de la plausibilité des allégations formulées, dont une expertise médicolégale et l’interrogatoire des policiers impliqués dans l’incident, ainsi que des témoins oculaires (paragraphes 19, 22 – 26 ci-dessus). Cependant, la Cour n’est pas convaincue que l’instruction, prise dans son ensemble, ait été suffisamment approfondie pour satisfaire les critères élaborés par sa jurisprudence.
107. En premier lieu, la Cour trouve surprenant que les enquêteurs, après avoir entendu les versions des policiers – auteurs présumés des mauvais traitements selon les allégations portées à la connaissance des autorités –, s’y soient ralliés si hâtivement (paragraphe 92 ci-dessus). Les efforts des enquêteurs ont été principalement orientés vers une instruction à décharge, visant à disculper les policiers, plutôt que vers l’établissement minutieux et impartial les circonstances de l’incident (Ablyazov, précité, § 59).
108. En second lieu, la Cour observe que le motif pour lequel les autorités chargées de l’instruction ont mis en doute la version du requérant était celui lié à son casier judiciaire. Les enquêteurs ont fait valoir que l’allégation du requérant n’était qu’un moyen de défense, inspiré par le souci d’échapper à sa responsabilité pénale pour ses propres agissements (paragraphes 27, 41 et 48 ci-dessus). Dans ses observations, le requérant dénonce cette attitude qui est, à son avis, un corollaire du manque d’indépendance de ces enquêteurs par rapport aux policiers et contribue à renforcer l’impunité de ces derniers (paragraphe 75 ci-dessus). La Cour a déjà observé à cet égard que ce motif avancé par les autorités à l’égard du requérant pourrait l’être de façon tout aussi valable à l’égard des policiers impliqués, dans la mesure où ces derniers pouvaient, eux aussi, risquer d’être tenus pénalement responsables des mauvais traitements en cause (Markaryan, précité, § 66).
109. La Cour observe, en troisième lieu, que la version présentée par les policiers et retenue par les enquêteurs – usage légitime de la force lors de l’arrestation – est mise à mal par l’absence de lésions corporelles sur le visage du requérant au moment de son arrivée au commissariat de police, absence confirmée tant par les témoins (paragraphes 22, 26 et 27 ci‑dessus) que par l’absence de toute inscription pertinente dans le registre des personnes amenées dans des commissariats de police (paragraphe 11 ci‑dessus). Or, les autorités n’ont pas cherché à élucider cette contradiction, par exemple au moyen d’une reconstitution des faits sur les lieux – à savoir sur la route où l’arrestation avait eu lieu et au commissariat de police – ou bien au moyen de confrontations (Kopylov, précité, § 170) entre les personnes entendues.
De même, l’autre version retenue par les enquêteurs tenant à l’auto‑infliction des lésions par le requérant n’a pas été suffisamment étayée. En effet, des incertitudes demeurent : notamment, le requérant ne s’était-il cogné qu’une seule fois, comme indiqué par l’enquêtrice A. (paragraphe 16 ci-dessus) – sans, d’ailleurs, que l’intéressé ne le conteste (paragraphe 19 ci‑dessus) – ou plusieurs fois, comme indiqué par le policier D. (paragraphe 16 ci-dessus). Cette contradiction entre les déclarations de ces trois personnes qui se trouvaient pourtant dans la même salle au moment des faits n’a pas éveillé l’attention des enquêteurs, qui n’ont pas tenté de l’élucider. Force est de constater que les autorités n’ont pas pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident. Cette carence de l’instruction a affaibli sa capacité à conduire à l’identification de la ou des personnes responsables.
110. De surcroît, la Cour observe que l’instruction pénale n’a pas rempli le rôle qui lui incombait d’expliquer de manière convaincante l’origine de toutes les lésions corporelles du requérant (voir, mutadis mutandis Ribitsch précité, § 34). Cette faille a également été mise en exergue tant par le procureur de la région de Sakhaline (paragraphes 16 et ci-dessus) que par le tribunal d’Aniva (paragraphe 41 ci-dessus). Certes, des compléments d’information ont été ordonnés afin de remédier à cette faille. Toutefois, loin de se conformer aux consignes données, leurs destinataires se sont bornés à reproduire mot pour mot leurs précédentes décisions. Vu cette circonstance, la Cour n’est pas convaincue par la thèse du Gouvernement selon laquelle les consignes des procureurs et des juges sont contraignantes pour les autorités chargées de l’enquête (paragraphe 71 ci‑dessus). Manifestement, les paragraphes 6 et 7 de l’article 148 du code de procédure pénale, auxquels se réfère le gouvernement russe, se sont avérés inopérants dans le cas d’espèce.
β) sur le contrôle « public » de l’instruction
111. En outre, s’agissant de l’accès du plaignant à la procédure de l’instruction, la Cour prend note de la reconnaissance par le Gouvernement du fait que ce droit n’a pas été respecté par les autorités compétentes (paragraphe 70 ci-dessus). En effet, à deux reprises, le requérant s’est vu refuser le droit de prendre connaissance du dossier au motif qu’il n’était pas « victime » des mauvais traitements dénoncés pour la simple raison que ceux-ci n’avaient pas eu lieu (paragraphes 50 et 51 ci-dessus). Cette qualité ne lui a été reconnue qu’en 2005, c’est-à-dire trois ans après l’incident (paragraphes 52 et 53 ci-dessus). Ainsi, la Cour constate que, malgré les dispositions légales relatives à la qualité de victime et aux droits s’y attachant, telles qu’interprétées par la Cour constitutionnelle de Russie (paragraphe 59 ci-dessus), les autorités nationales ont échoué à assurer le contrôle « public » de l’instruction et de ses résultats par le principal intéressé.
γ) sur le rôle du juge de la détention provisoire
112. La Cour note que le 29 janvier 2002, c’est-à-dire trois jours après les mauvais traitements, le requérant a été traduit devant un juge du tribunal du district d’Aniva pour l’examen de la demande tendant à sa mise en détention provisoire. La Cour constate que lors de l’audience, le requérant présentait déjà des lésions sur des parties visibles du corps, notamment des hématomes sur le front (paragraphes 11 – 15 ci-dessus). Toutefois, ces lésions n’ont pas suscité la vigilance du juge, celui-ci n’ayant donné aucune suite à cette singularité patente. En effet, il n’a ni interrogé le requérant sur l’origine de ces lésions, ni signalé leur existence aux autorités compétentes.
113. Tout en reconnaissant que l’initiative de déposer plainte incombe à la victime, la Cour estime que le juge a un rôle essentiel dans la prévention des mauvais traitements, notamment dans le cadre de la procédure de placement en détention provisoire. En effet, il peut y avoir des situations – telles que décrites dans les rapports du CPT – où « des personnes allèguent avoir eu peur de se plaindre des mauvais traitements subis à cause de la présence lors de l’audition par le procureur ou le juge des mêmes membres des forces de l’ordre qui les avaient interrogées ou [avoir été] expressément dissuadées de déposer plainte (...) » (paragraphe 64 ci-dessus). Selon le CPT, « le fait que des personnes détenues par les forces de l’ordre soient présentées aux autorités de poursuite et de jugement leur offre une excellente opportunité de faire savoir si elles ont été maltraitées ou non. En outre, même en l’absence d’une plainte formelle, ces autorités pourront prendre les mesures nécessaires, en temps voulu, s’il y a d’autres indices (par exemple, des blessures visibles [ou bien] l’apparence ou le comportement général d’une personne) que des mauvais traitements ont pu avoir lieu. »
114. La Cour observe qu’en l’occurrence, lors de l’audience du 29 janvier 2002, l’autorité judiciaire indépendante s’est montrée passive face à des indices suffisamment précis – hématome de taille importante sur les paupières de l’œil gauche – d’un cas de mauvais traitements.
δ) conclusion
115. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’instruction pénale menée à la suite de l’allégation du requérant n’a pas rempli la condition d’ « effectivité » requise. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural.
CESTARO c. ITALIE du 7 avril 2015 requête 6884/ 11
Violation de l'article 3, cet arrêt définit la torture par rapport à un acte inhumain et dégradant : une arrestation médiatisée, avec violences policières, pendant le sommet de Gênes de 2001, dans les écoles Diaz‑Pertini et Diaz-Pascoli, transformées en dortoir et où tout le monde dormait. Personne ne résistait et il n'y avait aucune raison objective pour justifier le passage à tabac commis par des policiers. C'est un acte de torture. L'Italie n'a pas de procédure judiciaire effective pour réparer les actes de torture, commis par la police.
SUR LE VOLET PROCÉDURAL PAS DE RECOURS INTERNE EFFECTIF
i. Principes généraux
204. La Cour rappelle que lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la ] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (voir, parmi maints autres arrêts, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998‑VIII, Labita, précité, § 131, Krastanov, précité, § 57, Vladimir Romanov, précité, § 81, Ali et Ayşe Duran c. Turquie, no 42942/02, § 60, 8 avril 2008, Georgiy Bykov, précité, § 60, El-Masri, précité, §§ 182 et 185 ainsi que les autres références qui y figurent, Dembele, précité, § 62, Alberti, précité, § 62, Saba, précité, § 76, et Dimitrov et autres c. Bulgarie, no 77938/11, § 135, 1er juillet 2014).
205. D’abord, pour qu’une enquête soit effective et permette d’identifier et de poursuivre les responsables, elle doit être entamée et menée avec célérité (Gäfgen, précité, § 121, ainsi que les autres références qui y figurent).
En outre, l’issue de l’enquête et des poursuites pénales qu’elle déclenche de même que la sanction prononcée et les mesures disciplinaires prises passent pour déterminantes. Elles sont essentielles si l’on veut préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est tenu d’exercer dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais traitements (Çamdereli c. Turquie, no 28433/02, § 38, 17 juillet 2008, Gäfgen, § 121, Saba, précité, § 76 ; sur le terrain de l’article 2, voir aussi Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03, §§ 60 et suivants, 20 décembre 2007).
206. Lorsque l’investigation préliminaire a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales, c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’interdiction posée par cette disposition. Ainsi, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’État de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (voir, sur le terrain de l’article 2, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 96, CEDH 2004‑XII).
La tâche de la Cour consiste donc à vérifier si et dans quelle mesure les juridictions, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, peuvent passer pour avoir soumis le cas porté devant elles à l’examen scrupuleux que demande l’article 3, de manière à préserver la force de dissuasion du système judiciaire mis en place et l’importance du rôle qui revient à ce dernier dans le respect de l’interdiction de la torture (Okkali c. Turquie, no 52067/99, §§ 65-66, 17 octobre 2006, Ali et Ayşe Duran, précité, §§ 61-62, Zeynep Özcan c. Turquie, no 45906/99, § 42, 20 février 2007, et Dimitrov et autres, précité, §§ 142-143).
207. Quant à la sanction pénale pour les responsables de mauvais traitements, la Cour rappelle qu’il ne lui incombe pas de se prononcer sur le degré de culpabilité de la personne en cause (voir, sous l’angle de l’article 2, Öneryıldız, précité, § 116, et Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005‑VII) ou de déterminer la peine à infliger, ces matières relevant de la compétence exclusive des tribunaux répressifs internes. Toutefois, en vertu de l’article 19 de la Convention et conformément au principe voulant que la Convention garantisse des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour doit s’assurer que l’État s’acquitte comme il se doit de l’obligation qui lui est faite de protéger les droits des personnes relevant de sa juridiction. Par conséquent, la Cour « doit conserver sa fonction de contrôle et intervenir dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée. Sinon, le devoir qu’ont les États de mener une enquête effective perdrait beaucoup de son sens » (voir, dans ces termes exacts, Gäfgen, précité, § 123 ; voir également Ali et Ayşe Duran, précité, § 66, et Saba, précité, § 77 ; voir, enfin, sur le terrain de l’article 2, Nikolova et Velitchkova, précité, § 62).
208. L’appréciation du caractère adéquat de la sanction dépend donc des circonstances particulières de l’affaire donnée (İlhan, précité, § 92).
La Cour a également jugé que, en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat, l’action pénale ne devrait pas s’éteindre par l’effet de la prescription, de même que l’amnistie et la grâce ne devraient pas être tolérées dans ce domaine. Au demeurant, l’application de la prescription devrait être compatible avec les exigences de la Convention. Il est dès lors difficile d’accepter des délais de prescriptions inflexibles ne souffrant aucune exception (Mocanu et autres c. Roumanie [GC] nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 326 CEDH 2014 (extraits)) et les affaires qui y sont citées.
Il en va de même du sursis à l’exécution de la peine (Okkali, précité, §§ 74-78, Gäfgen, précité, § 124, Zeynep Özcan, précité, § 43 ; voir aussi, mutatis mutandis, Nikolova et Velitchkova, précité, § 62) et d’une remise de peine (Abdülsamet Yaman, précité, § 55, et Müdet Kömürcü, §§ 29-30).
209. Pour qu’une enquête soit effective en pratique, la condition préalable est que l’État ait promulgué des dispositions de droit pénal réprimant les pratiques contraires à l’article 3 (Gäfgen, précité, § 117). En effet, l’absence d’une législation pénale suffisante pour prévenir et réprimer effectivement les auteurs d’actes contraires à l’article 3 peut empêcher les autorités de poursuivre les atteintes à cette valeur fondamentale des sociétés démocratiques, d’en évaluer la gravité, de prononcer des peines adéquates et d’exclure l’application de toute mesure susceptible d’affaiblir excessivement la sanction, au détriment de son effet préventif et dissuasif (M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 149, 153 et 166, CEDH 2003‑XII, Tzekov, précité, 71, Çamdereli, précité, § 38 ; sur le terrain de l’article 4, voir, mutatis mutandis, Siliadin c. France, no 73316/01, §§ 89, 112 et 148, CEDH 2005‑VII).
210. En ce qui concerne les mesures disciplinaires, la Cour a dit à maintes reprises que, lorsque des agents de l’État sont inculpés d’infractions impliquant des mauvais traitements, il importe qu’ils soient suspendus de leurs fonctions pendant l’instruction ou le procès et en soient démis en cas de condamnation (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts précités Abdülsamet Yaman, § 55, Nikolova et Velitchkova, § 63, Ali et Ayşe Duran, § 64, Erdal Aslan, §§ 74 et 76, Çamdereli, § 38, Gäfgen, § 125, et Saba, § 78).
211. En outre, la victime doit être en mesure de participer effectivement, d’une manière ou d’une autre, à l’enquête (Dedovski et autres, précité, § 92, et El-Masri, précité, § 185, avec les autres références qui y figurent).
212. Enfin, outre mener une enquête approfondie et effective, l’État doit accorder au requérant une indemnité, le cas échéant, ou à tout le moins la possibilité de solliciter et d’obtenir réparation du préjudice que les mauvais traitements en question lui ont causé (Gäfgen, précité, § 118, avec les autres références qui y figurent).
ii. Application en l’espèce
213. Eu égard aux principes résumés ci-dessus et, notamment, à l’obligation qui incombe à l’État d’identifier et, le cas échéant, de sanctionner de manière adéquate les auteurs d’actes contraires à l’article 3 de la Convention, la Cour estime que la présente affaire soulève trois types de problème.
α) Absence d’identification des auteurs matériels des mauvais traitements en cause
214. Les policiers qui ont agressé le requérant dans l’école Diaz-Pertini et l’ont matériellement soumis à des actes de torture n’ont jamais été identifiés (paragraphe 52 ci-dessus). Ils n’ont donc même pas été l’objet d’une enquête et sont demeurés, tout simplement, impunis.
215. Certes, l’obligation d’enquête découlant de l’article 3 est plutôt une obligation de moyens que de résultat (Kopylov, précité, § 132, Samoylov, précité, § 31, et Batı et autres, précité, § 134), dans la mesure où l’enquête peut se solder par un échec malgré tous les moyens et les efforts dûment déployés par les autorités.
216. Il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, selon le jugement de première instance, l’absence d’identification des auteurs matériels des mauvais traitements litigieux découle de la difficulté objective du parquet de procéder à des identifications certaines et du défaut de coopération de la police au cours des investigations préliminaires (paragraphe 52 ci-dessus).
La Cour regrette que la police italienne ait pu refuser impunément d’apporter aux autorités compétentes la coopération nécessaire à l’identification des agents susceptibles d’être impliqués dans des actes de torture.
217. En outre, il ressort des décisions internes que le nombre exact des agents ayant participé à l’opération est resté inconnu (paragraphe 30 ci-dessus) et que les policiers, dont au moins ceux qui étaient en tête du groupe portaient des casques de protection, ont fait irruption dans l’école en ayant, pour la plupart d’entre eux, le visage masqué par un foulard (paragraphe 29 et 33 ci-dessus).
Aux yeux de la Cour, ces deux circonstances, qui procèdent des phases de planification et de réalisation de l’irruption policière dans l’école Diaz-Pertini, constituent déjà des obstacles non négligeables à toute tentative d’enquête efficace sur les événements en question.
La Cour rappelle, notamment, avoir déjà jugé, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, que l’impossibilité d’identifier les membres des forces de l’ordre, auteurs présumés d’actes contraires à la Convention, était contraire à celle-ci. De même, elle a déjà souligné que, lorsque les autorités nationales compétentes déploient des policiers au visage masqué pour maintenir l’ordre public ou effectuer une arrestation, ces agents sont tenus d’arborer un signe distinctif – par exemple un numéro de matricule – qui, tout en préservant leur anonymat, permette de les identifier en vue de leur audition au cas où la conduite de l’opération serait contestée ultérieurement (Ataykaya, précité, § 53, ainsi que les références qui y figurent).
ß) Prescription des délits et remise partielle des peines
218. Pour l’irruption dans l’école Diaz-Pertini, pour les violences qui y ont été commises et pour les tentatives de cacher ou justifier celles-ci, des hauts dirigeants, des cadres et un certain nombre d’agents de police ont été poursuivis et renvoyés en jugement pour plusieurs délits. Il en a été de même pour les faits qui se sont produits à l’école Pascoli (paragraphes 45 et 47 ci-dessus).
219. Néanmoins, pour ce qui est des événements ayant eu lieu à l’école Diaz-Pertini, les délits de calomnie, d’abus d’autorité publique (notamment en raison de l’arrestation illégale des occupants), de lésions simples ainsi que, à l’égard d’un accusé, de lésions aggravées ont été prescrits avant la décision d’appel (paragraphe 61 ci-dessus). Le délit de lésions aggravées, pour lequel dix et neuf accusés avaient été condamnés respectivement en première et en deuxième instance (paragraphes 49 et 60 ci-dessus), a été déclaré prescrit par la Cour de cassation (paragraphes 76 et 79 ci-dessus).
Pour ce qui est des événements ayant eu lieu à l’école Pascoli, les délits qui y ont été commis dans le but d’effacer les preuves de l’irruption et des violences perpétrées dans l’école Diaz-Pertini ont également été prescrits avant la décision d’appel (paragraphe 83 ci-dessus).
220. Seules des condamnations à des peines comprises entre trois ans et trois mois et quatre ans d’emprisonnement, en plus de l’interdiction d’exercer pour une durée de cinq ans des fonctions publiques, ont donc été prononcées pour faux intellectuel (dix-sept accusés) et port abusif d’armes de guerre (un accusé) (paragraphe 60 ci-dessus).
221. En somme, à l’issue de la procédure pénale, personne n’a été condamné en raison des mauvais traitements perpétrés dans l’école Diaz-Pertini à l’encontre, notamment, du requérant, les délits de lésions simples et aggravées ayant été frappés de prescription. En effet, les condamnations confirmées par la Cour de cassation concernent plutôt les tentatives de justification de ces mauvais traitements et l’absence de base factuelle et juridique pour l’arrestation des occupants de l’école Diaz-Pertini (paragraphes 76, 79 et 80 ci-dessus).
De surcroît, en application de la loi no 241 du 29 juillet 2006, établissant les conditions à remplir pour l’octroi d’une remise générale de peine (indulto), les peines ont été réduites de trois ans (paragraphes 50 et 60 ci-dessus). Il s’ensuit que les condamnés devront purger, au pire, des peines comprises entre trois mois et un an d’emprisonnement.
222. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la réaction des autorités n’a pas été adéquate compte tenu de la gravité des faits. Ce qui, par conséquent, la rend incompatible avec les obligations procédurales découlant de l’article 3 de la Convention.
223. À l’inverse de ce qu’elle a jugé dans d’autres affaires (voir, par exemple, Batı et autres, précité, §§ 142-147, Erdal Aslan, précité, §§ 76-77, Abdülsamet Yaman, précité, §§ 57-59, et Hüseyin Şimşek, précité, §§ 68-70), la Cour considère que ce résultat n’est pas imputable aux atermoiements ou à la négligence du parquet ou des juridictions nationales.
En effet, si, à première vue, le requérant semble attribuer la prescription des délits à la durée excessive de la procédure, il n’a aucunement étayé cette allégation par une description, fût-elle sommaire, du déroulement de la procédure et de retards qui auraient été injustifiés au cours de l’enquête ou des débats. Aucun retard ne ressort non plus du dossier.
Bien qu’il ait fallu plus de dix ans après les événements de l’école Diaz-Pertini pour qu’une décision définitive soit rendue, la Cour ne saurait ignorer que le parquet a dû faire face à des obstacles non négligeables au cours de l’enquête (paragraphes 44, 45 et 52 ci-dessus) et que les juridictions de jugement ont dû diligenter une procédure pénale très complexe, à l’égard de dizaines d’accusés et d’une centaine de parties civiles italiennes et étrangères (paragraphes 46-47 ci-dessus), afin d’établir, dans le respect des garanties du procès équitable, les responsabilités individuelles d’un épisode de violence policière que le Gouvernement défendeur a lui-même qualifié d’exceptionnel.
224. La Cour ne saurait reprocher non plus aux juridictions internes de ne pas avoir mesuré la gravité des faits reprochés aux accusés (Saba, précité, §§ 79-80 ; voir aussi, mutatis mutandis, Gäfgen, précité, § 124) ou, pire, d’avoir utilisé de facto les dispositions législatives et répressives du droit national pour éviter toute condamnation effective des policiers poursuivis (Zeynep Özcan, précité, § 43).
Les arrêts d’appel et de cassation, en particulier, font preuve d’une fermeté exemplaire et ne trouvent aucune justification aux graves événements de l’école Diaz-Pertini.
Dans ce contexte, les raisons qui ont amené la cour d’appel à déterminer les peines sur la base du minimum prévu par la loi pour chacun des délits en question (à savoir le fait que toute l’opération avait pour origine la directive du chef de la police de procéder à des arrestations et que les accusés avaient dès lors agi sous cette pression psychologique – paragraphe 74 ci-dessus) ne semblent pas comparables à celles que la Cour a dénoncées dans d’autres affaires (voir, par exemple, Ali et Ayşe Duran, précité, § 68, où les auteurs d’actes contraires à l’article 3 de la Convention avaient bénéficié d’une réduction de peine en raison de leur prétendue collaboration au cours de l’enquête et des débats, alors qu’en réalité ils s’étaient toujours bornés à réfuter toute accusation ; voir aussi Zeynep Özcan, précité, § 43, où les juridictions de jugement avaient reconnu aux accusés des circonstances atténuantes compte tenu de leur comportement au procès alors qu’en réalité les intéressés n’avaient jamais assisté aux audiences).
225. La Cour considère dès lors que c’est la législation pénale italienne appliquée en l’espèce (paragraphes 88-102 ci-dessus) qui s’est révélée à la fois inadéquate par rapport à l’exigence de sanction des actes de torture en question et dépourvue de l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d’autres violations similaires de l’article 3 à l’avenir (Çamdereli, précité, § 38).
Du reste, dans l’arrêt Alikaj et autres c. Italie (no 47357/08, § 108, 29 mars 2011), la Cour, après avoir affirmé que « les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête préliminaire (...) puis par les juges du fond pendant le procès ne [prêtaient] pas à controverse », a également estimé que « l’application de la prescription relève sans conteste de la catégorie de « mesures » inadmissibles selon la jurisprudence de la Cour concernant l’article 2 de la Convention dans son volet procédural, puisqu’elle a eu pour effet d’empêcher une condamnation ».
226. La Cour devra revenir ultérieurement (paragraphes 244 et suivants ci-dessous) sur ces conclusions, qui sont confortées, notamment, par les observations du premier président de la Cour de cassation italienne (paragraphe 105 ci-dessus) et par celles des tiers intervenants (paragraphes 200-203 ci-dessus).
γ) Doutes sur les mesures disciplinaires adoptées à l’égard des responsables des mauvais traitements en cause.
227. Il ne ressort pas du dossier que les responsables des actes de torture subis par le requérant et des autres délits liés à ceux-ci ont été suspendus de leurs fonctions pendant la procédure pénale. La Cour ne dispose pas non plus d’informations sur l’évolution de leur carrière au cours de la procédure pénale et sur les démarches entreprises sur le plan disciplinaire après leur condamnation définitive, informations qui sont également nécessaires aux fins de l’examen du respect de l’article 3 de la Convention (paragraphe 210 ci-dessus).
228. Par ailleurs, elle prend acte du silence du Gouvernement à cet égard en dépit de la demande de renseignements expressément formulée lors de la communication de l’affaire.
iii. Qualité de victime et épuisement des voies de recours internes (en particulier : action en dommages-intérêts)
229. Eu égard aux constats qui précèdent, la Cour estime que les différentes mesures prises par les autorités internes n’ont pas pleinement satisfait à la condition d’une enquête approfondie et effective, telle qu’établie par sa jurisprudence. Cette circonstance est déterminante aux fins de l’exception que le Gouvernement tire de la perte de la qualité de victime du requérant au motif, en particulier, que les juridictions ont déjà reconnu la violation en cause dans le cadre de la procédure pénale et qu’elles ont accordé une réparation à l’intéressé (paragraphe 131 ci-dessus).
230. En effet, comme la Grande Chambre l’a rappelé dans l’arrêt Gäfgen (précité, § 116), « en cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État au mépris de l’article 3, la Cour estime de manière constante que », en sus de la reconnaissance de la violation, « deux mesures s’imposent pour que la réparation soit suffisante » pour priver le requérant de sa qualité de victime. « Premièrement, les autorités de l’État doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables (voir, entre autres, Krastanov, précité, § 48, Çamdereli, [précité] §§ 28-29 (...), et Vladimir Romanov, précité, §§ 79 et 81). Deuxièmement, le requérant doit, le cas échéant, percevoir une compensation (Vladimir Romanov, précité, § 79, et, mutatis mutandis, Aksoy, précité, § 98, et Abdülsamet Yaman, [précité], § 53 (...) (ces deux arrêts dans le contexte de l’article 13)) ou, du moins, avoir la possibilité de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice que lui a causé le mauvais traitement ».
231. La Cour a dit à maintes reprises que l’octroi d’une indemnité à la victime ne suffit pas à réparer la violation de l’article 3. En effet, si les autorités pouvaient se borner à réagir en cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État en accordant une simple indemnité, sans s’employer à poursuivre et punir les responsables, les agents de l’État pourraient dans certains cas enfreindre les droits des personnes soumises à leur contrôle pratiquement en toute impunité, et l’interdiction légale absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants serait dépourvue d’effet utile en dépit de son importance fondamentale (voir, parmi beaucoup d’autres, Camdereli, précité, § 29, Vladimir Romanov, précité, § 78, Gäfgen, précité, § 119 ; voir aussi, mutatis mutandis, Krastanov, précité, § 60 ; sur le terrain de l’article 2, voir Nikolova et Velichkova, précité, § 55, et les références qui y figurent ; voir, en dernier ressort, Petrović c. Serbie, no 40485/08, § 80, 15 juillet 2014).
C’est pourquoi la possibilité pour le requérant de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice que lui a causé le mauvais traitement ou bien le versement, comme dans la présente affaire, par les autorités d’une certaine somme à titre de provision constituent seulement une partie des mesures nécessaires (Camdereli, précité, § 30, Vladimir Romanov, précité, § 79, et Nikolova et Velichkova, précité, § 56).
232. En ce qui concerne le deuxième volet de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, tiré du fait que le requérant n’a pas introduit une procédure civile ultérieure en dommages-intérêts (paragraphe 139 ci-dessus), la Cour rappelle qu’elle a rejeté à maintes reprises des exceptions similaires, après avoir observé que la procédure en dommages-intérêts ne visait pas la punition des responsables des actes contraires aux articles 2 ou 3 de la Convention et en réaffirmant que, pour des violations de ce type, la réaction des autorités ne peut se limiter au dédommagement de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, §§ 70-74, Recueil 1998‑VI, Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 66-67, CEDH 1999‑III, Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, §§ 146-149, 24 février 2005, Estamirov et autres c. Russie, no 60272/00, §§ 76-77, 12 octobre 2006, Beganović c. Croatie, no 46423/06, §§ 54-57, 25 juin 2009, et Fadime et Turan Karabulut c. Turquie, no 23872/04, §§ 13-15, 27 mai 2010).
En d’autres termes, dès lors que, en cas de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, l’obligation d’octroyer une réparation au niveau interne s’ajoute à l’obligation de mener une enquête approfondie et effective visant à l’identification et à la sanction des responsables et ne se substitue pas à elle, les voies de recours exclusivement indemnitaires ne peuvent pas être considérées comme effectives sur le terrain de cette disposition (Sapožkovs c. Lettonie, no 8550/03, §§ 54-55, 11 février 2014).
233. La Cour rappelle que, lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Kozacıoğlu, précité, §§ 40-43, Karakó c. Hongrie, no 39311/05, § 14, 28 avril 2009, et Jasinskis c. Lettonie, no 45744/08, §§ 50-55, 21 décembre 2010).
234. Elle observe qu’en l’espèce, le requérant s’est bien prévalu de la voie de recours civile en se constituant partie civile dans la procédure pénale en juillet 2004 dans le but d’obtenir la réparation du préjudice souffert (paragraphes 46 ci-dessus ; voir également Calvelli et Ciglio, no 32967/96, § 62, CEDH 2002-I). Il a ainsi participé à la procédure pénale à tous les degrés de juridiction (paragraphes 59 et 75 ci-dessus) et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation déposé au greffe le 2 octobre 2012.
Dans ces circonstances, prétendre qu’aux fins du respect de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, le requérant aurait dû entamer une procédure civile ultérieure constituerait un fardeau excessif pour la victime d’une violation de l’article 3 (voir, mutatis mutandis, Saba, précité, § 47).
235. Se fondant sur sa jurisprudence et sur les constats formulés en l’espèce relativement aux défaillances de l’enquête concernant les mauvais traitements dont le requérant a été victime, la Cour ne peut que rejeter les deux exceptions préliminaires du Gouvernement défendeur qu’elle a jointes au fond.
iv. Conclusion
236. La Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention – à cause de mauvais traitements subis par le requérant qui doivent être qualifiés de « torture » au sens de cette disposition - dans ses volets tant matériel que procédural. Dans ces circonstances, elle estime qu’il échet de rejeter tant l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la perte de la qualité de victime (paragraphes 131 et suivants ci-dessus) que l’exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes (paragraphes 139-140 ci-dessus).
Grămadă c. Roumanie du 11 février 2014 requête 14974/09
Les autorités roumaines sont condamnées pour avoir exonéré un policier de toute responsabilité pénale en l’absence d’enquête effective. Lors d'une arrestation musclée, un policier tire sans être menacé directement.
60. La Cour rappelle tout d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV).
61. En l’espèce, la Cour note que les allégations du requérant concernant les violences subies lors de l’incident qui a eu lieu dans la nuit du 22 mai 2005 sont corroborées par les conclusions du rapport médicolégal du 8 juin 2005. Les lésions constatées sur le requérant lui ont incontestablement causé des souffrances pouvant entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
62. La Cour observe ensuite qu’elle se trouve confrontée à des versions divergentes des événements du 22 mai 2005. Toutefois, en dépit de ces versions différentes, elle note que les parties s’accordent à dire que l’auteur du coup qui a touché le requérant était le policier et que le recours à la force avait été excessif. Toujours est-il que les tribunaux internes ont estimé que le dépassement de la légitime défense avait été justifié par la peur et la confusion que le policier A.C. avait ressenties lors des événements et, en conséquence, ont jugé qu’il ne convenait pas de lui infliger une peine pénale.
63. La Cour rappelle que, en règle générale, elle n’est pas liée par les constatations des juridictions internes et qu’elle demeure libre de se livrer à sa propre appréciation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose (Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536/01, § 166, 24 juin 2008). À cet effet, pour apprécier les preuves, la Cour adopte en général le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutés, suffisamment graves, précis et concordants.
64. En ce qui concerne l’usage de la force au cours d’une arrestation, il convient de rappeler qu’il incombe à la Cour de rechercher si la force utilisée était strictement nécessaire et proportionnée et si l’État doit être tenu pour responsable des blessures infligées (Berliński c. Pologne, nos 27715/95 et 30209/96, § 64, 20 juin 2002). Pour répondre à cette question, la Cour tient compte des blessures occasionnées et des circonstances dans lesquelles elles l’ont été (R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004).
65. Par ailleurs, il incombe au Gouvernement d’apporter des preuves pertinentes démontrant que le recours à la force était à la fois proportionné et nécessaire (Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 72-76, CEDH 2000‑XII; Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 34, série A no 336, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001). Cela est également valable en l’espèce, même si le recours à la force est intervenu dans le cadre de l’arrestation d’une autre personne que le requérant.
66. Dans ces conditions, la Cour doit examiner les circonstances dans lesquelles le coup de feu a été tiré et les mesures prises par les autorités judiciaires roumaines pour les éclaircir.
67. En l’occurrence, il s’agissait d’une opération de contrôle routier, visant à l’interpellation d’I.C., qui était suspecté d’avoir commis une infraction au code de la route, et qui a donné lieu à des développements inattendus auxquels la police a été appelée à réagir sans y être préparée. Il ressort en effet du dossier que la police n’avait pas programmé l’opération d’interpellation et qu’elle n’a pas eu suffisamment de temps pour évaluer les risques éventuels et prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à cette interpellation à laquelle se seraient opposés dans un premier temps les amis d’I.C. et ultérieurement le requérant et son père.
68. Le requérant critique fermement l’approche des tribunaux internes qui ont considéré que le policier A.C. avait tiré un coup de feu en état de légitime défense car il était menacé par le requérant et son père qui étaient armés d’armes blanches. À cet égard, il souligne, en premier lieu, la qualité de policier de la personne qui lui a tiré dessus, chez qui on ne saurait excuser un usage excessif de la force. En deuxième lieu, le requérant nie avoir été armé d’une quelconque arme blanche et réfute en conséquence la thèse contraire retenue par les tribunaux sur la base des seules déclarations du policier et du gardien de la paix.
69. La Cour rappelle que la notion de dépassement de la légitime défense, à laquelle correspond la notion « d’excès justifié » du droit roumain, n’est pas inconnue du droit pénal européen en tant que telle (Aydan c. Turquie, no 16281/10, §§ 48-51 et 96, 12 mars 2013). De plus, il apparaît que les membres des forces de l’ordre ne sont pas de jure exclus du bénéfice du dépassement de la légitime défense, mais que leur qualité ou leur fonction constituent des éléments qui peuvent être pris en compte lors de l’examen de l’affaire (Aydan précité, §§ 51 et 97).
70. En l’espèce, la Cour estime que la critique du requérant quant à l’application de la notion d’« excès justifié » est légitime. En effet, les déclarations des parties sur les événements montrent que le policier n’a pas hésité à faire usage des moyens de défense dont il était muni à la moindre opposition de la part d’autrui. Bien que ces actes particuliers ne fassent pas l’objet de l’examen de la Cour dans la présente affaire, elle ne saurait pas les ignorer dans le contexte qui a conduit à l’usage d’une arme à feu. La Cour note à cet égard que le policier a fait usage, dans un premier temps, de son spray à gaz lacrymogène envers I.C. qui s’était opposé à l’immobilisation. Même à supposer qu’elle accepte la version du policier selon laquelle I.C. l’aurait repoussé, il n’apparaît pas que le comportement de ce dernier représentait un risque grave et sérieux pour l’ordre public ou pour l’intégrité physique des agents publics, qui aurait pu justifier l’usage qui a été fait du spray irritant à son encontre (Petruş Iacob c. Roumanie, no 13524/05, § 37, 4 décembre 2012). Le policier a ensuite fait usage de son spray à l’encontre du père du requérant qui l’aurait également repoussé dans un premier temps de sa cour afin d’empêcher l’interpellation d’I.C. Le comportement du père du requérant ne semblait pas non plus constituer un danger important contre l’intégrité physique des agents publics.
71. Dans la même ligne, le policier a fait très facilement usage de son arme contre le requérant. À cet égard, si la Cour pourrait accepter que le père du requérant était muni d’une arme blanche (une fourche selon le policier, l’agent et la voisine M.M. ; un grand balai selon le père du requérant), la possibilité que le requérant ait été armé ne lui apparaît pas vraisemblable. En effet, cette thèse repose sur les seules déclarations du policier et du gardien, que les autorités ont acceptées sans réserve. D’ailleurs, cela a été sanctionné par la cour d’appel de Cluj qui, dans sa décision du 19 avril 2006, a reproché au tribunal inférieur d’avoir retenu la thèse de la légitime défense sur la base des seules déclarations de l’agent de police et du gardien, déclarations qui étaient pourtant contredites par les autres pièces du dossier (voir, paragraphe 34 ci-dessus et, pour une situation similaire, Cobzaru précité, § 61). Le policier a ainsi agi de façon totalement autonome en prenant des initiatives inconsidérées, ce qui n’aurait probablement pas été le cas s’il avait bénéficié d’instructions adéquates (voir, mutatis mutandis, Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 70, CEDH 2004‑XI, et Soare et autres précité, § 135).
72. La Cour estime ensuite qu’il y
a des omissions frappantes dans la réalisation de l’enquête menée dans la
présente affaire. Ainsi, il est surprenant que les autorités n’aient pas saisi
les armes blanches dont le requérant et son père auraient été armés, et cela,
bien que, selon le
procès-verbal dressé par les officiers de police le jour
des événements, les lieux aient été surveillés par un agent de police
(paragraphe 11 ci-dessus). En outre, elle note que les autorités ont refusé de
procéder à une reconstitution des faits, bien qu’il s’agisse d’une mesure
d’instruction essentielle pour ce type d’affaire (voir, dans ce sens,
Karagiannopoulos c. Grèce,
no
27850/03, § 68, 21 juin 2007 ; Hamiyet Kaplan
et autres c. Turquie, no
36749/97, § 62, 13 septembre 2005 ; Perk et
autres c. Turquie, no
50739/99, § 80, 28 mars 2006).
73. De plus, la Cour souligne que
les autorités n’ont pas cherché à établir, par le biais d’une expertise
balistique et afin de statuer sur le respect de la législation concernant
l’usage des armes à feu, combien de coups avaient été tirés par l’agent de
police, la distance ou la direction des tirs (Tzekov
c. Bulgarie, no
45500/99, § 72, 23 février 2006). À cet égard, elle observe que le refus des
tribunaux internes était justifié, entre autres, par le fait que l’arme avait
été entre-temps utilisée par l’agent de police, dans l’exercice de ses
fonctions. Or, la Cour considère qu’il incombait aux autorités de prendre toutes
les mesures nécessaires afin de garantir la collecte et la disponibilité des
preuves surtout dans une affaire comme
celle-ci. Cela d’autant plus que la plupart des témoins
avaient entendus au moins quatre coups de feu (paragraphes 13-14, 16 et 25
ci-dessus), soit plus que les deux tirs d’avertissement et celui vers les jambes
du requérant, admis par le policier. Une telle expertise était d’autant plus
importante qu’une seule douille avait été trouvée sur les lieux de l’incident
(paragraphes 10-11 ci-dessus).
74. Dans ces conditions, les autorités ne sauraient passer pour avoir vraiment cherché à savoir si le recours à la force a été réellement excessif. L’insuffisance des éléments factuels et des preuves recueillis empêche la Cour de porter une appréciation sur les faits de la cause en s’appuyant sur les constatations opérées par les autorités nationales. En conséquence, les omissions imputables aux autorités judiciaires décrites ci-dessus conduisent la Cour à rejeter la thèse du Gouvernement selon laquelle la blessure du requérant a été provoquée par la riposte d’un policier qui se trouvait dès lors en état de dépassement justifié de la légitime défense. Dans ces conditions, la Cour considère que la décision des juges d’exempter le policier de toute responsabilité pénale, en invoquant la notion d’« excès justifié » consacrée par le droit pénal roumain, dénote un pouvoir discrétionnaire exercé plus dans le souci de réduire l’effet d’un acte illégal d’une extrême gravité que dans celui de prohiber toute tolérance de tels actes par une condamnation adéquate.
75. Dans les circonstances particulières de l’affaire, et compte tenu de ce qui précède, la Cour parvient ainsi à la conclusion que l’enquête pénale litigieuse n’a pas offert un redressement approprié de l’atteinte portée à la valeur consacrée dans l’article 3 de la Convention. En outre, compte tenu du défaut des autorités de faire des recherches approfondies permettant d’établir les circonstances de l’emploi de la force, elle convient qu’un simple redressement civil ne saurait pas non plus remédier à la situation décrite ci-dessus (voir, a contrario, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 119, CEDH 2010). La Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement et conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH, lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédigervotre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.