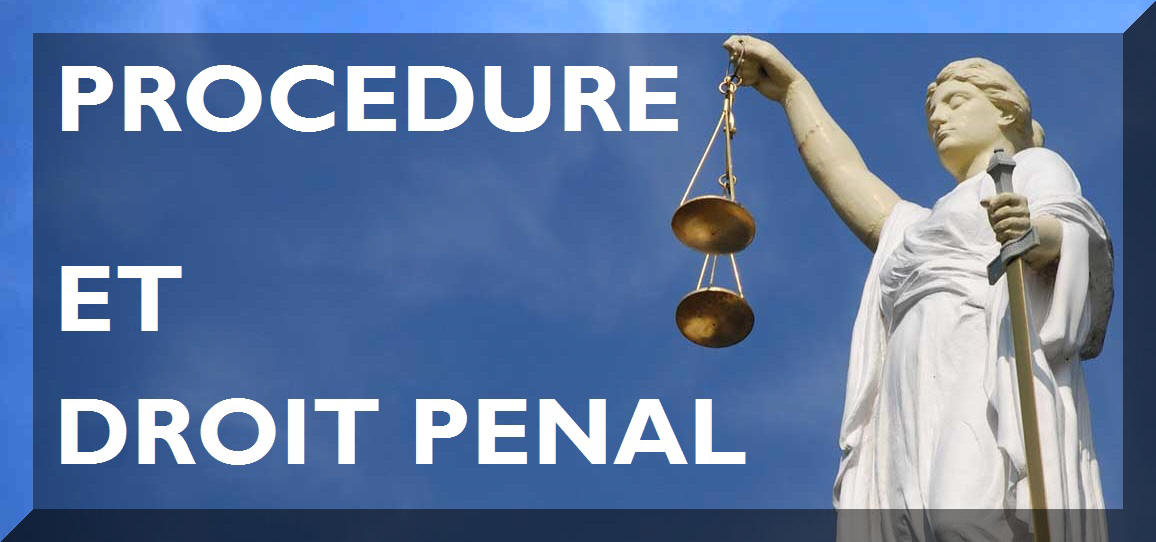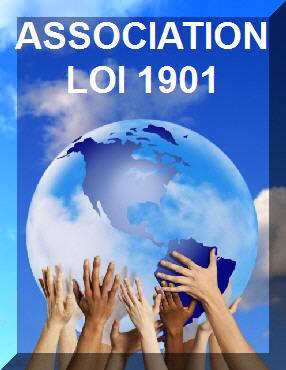LIBERTÉ DE LA PRESSE
LIBERTÉ DE LA PRESSE
Pour plus de sécurité, fbls liberté de la presse est sur :
https://www.fbls.net/presse.htm
Aucun cookie garanti = liberté préservé pour chacun !
"La liberté de la presse trouve ses limites dans la calomnies"
Frédéric Fabre docteur en droit.
 Cliquez
sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites sur :
Cliquez
sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites sur :
- Les textes qui régissent la presse en France
- La Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- L'Injure et la diffamation sur Internet
- La répression de la diffamation et de l'injure non publique
- L'Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse
- La réforme sur la protection des sources journalistiques.
- L'obtention de la carte de presse
- Analyses juridiques importantes sur la diffamation
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles
d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances,
vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour
assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.



TEXTES GÉNÉRAUX SUR LA PRESSE
OBLIGATIONS
La
Loi
n°86-897 du 1 août 1986 porte réforme du régime juridique de la presse.
L'Arrêté
du 3 juillet 2012 est relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation.
Le
Décret n° 2012-1431 du 19 décembre 2012 abroge les dispositions réglementaires relatives au dépôt légal au ministère de l'intérieur des périodiques.
L'Arrêté
du 22 novembre 2012 est pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 29 juillet 1881 portant sur l'obligation de dépôt des journaux
et écrits périodiques à diffusion nationale.
DISTRIBUTION
La LOI
n° 2011-852 du 20 juillet 2011 est relative à la régulation du système de distribution de la presse en France.
L'Arrêté
du 29 août 2011 pris pour application du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié, est relatif au fonds d'aide au portage de la presse.
La Loi n° 47-585
du 2 avril 1947 est relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.
SUBVENTIONS
L'Arrêté
du 19 avril 2012 est relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention ou d'avance au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse.
L'Arrêté du 22 avril 2013
est pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse
ANNONCES LEGALES
La
Loi
n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales applique les publications sur internet.
La Loi n° 57-32
du 10 janvier 1957 porte statut de l'agence France-Presse.
LA LOI DU 29 JUILLET 1881 A LA LUMIÈRE DU CODE CIVIL
La loi sur la presse et la "lex specialis derogat legi
generali" qui s'impose à l'article 1240 du code civil
Tels qu'éclairés par la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme, les articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, au regard des
impératifs de libre exercice des droits de la défense et de droit à un procès
équitable, à ce qu'une partie appelante d'un jugement soit condamnée, sur le
fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
à des dommages-intérêts à raison d'un passage ou d'un extrait des écritures
remises à la cour d'appel. En effet, seules les dispositions spéciales
prévues à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 peuvent fonder une
condamnation à indemnisation à raison d'écrits produits devant les tribunaux et
de leur caractère prétendument diffamatoire, à condition que les passages litigieux soient étrangers à l'instance judiciaire.
La Cour d'Appel d'Orléans est arbitraire sur cette affaire
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 8 juin 2028 Pourvoi n° 19-25.101 cassation
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales :
5. Selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
6. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'impartialité se définit
d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris. La Cour distingue entre
une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son
for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une
démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes
pour exclure à cet égard tout doute légitime ([B] c. Belgique, arrêt du 1er
octobre 1982, n° 8692/79, § 30, et [O] c. Royaume-Uni [GC], arrêt du 16 décembre
2003, n° 57067/00, § 69). Dans le cadre de la démarche subjective, la Cour a
toujours considéré que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume
jusqu'à la preuve du contraire ([W] c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, 10486/83,
§ 47). La Cour reconnaît la difficulté d'établir l'existence d'une violation de
l'article 6 pour partialité subjective. C'est la raison pour laquelle, dans la
très grande majorité des affaires soulevant des questions de partialité, elle a
eu recours à la démarche objective. La frontière entre les deux notions n'est
cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d'un juge peut, du
point de vue d'un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement
justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également
toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective). (CEDH,
Kyprianou c/ Chypre [GC], arrêt du 15 décembre 2005, n° 73797/01, n° 119)
7. L'arrêt énonce que les débiteurs se sont soigneusement abstenus d'engager une
procédure d'inscription de faux à l'encontre du procès-verbal de dénonciation
qui leur a été délivré, et par ailleurs qu'une procédure engagée par leur
adversaire n'aurait fait que tourner à leur confusion et aurait pu entraîner de
nouveaux frais à leur charge de sorte qu'ils devraient se féliciter de ne pas avoir fait l'objet d'une assignation en la matière.
8. En statuant ainsi, en analysant, dans les motifs de l'arrêt, les thèses des
parties selon des modalités différentes, celle de la banque étant présentée avec
neutralité, celle des débiteurs étant ponctuée d'expressions révélant une
appréciation subjective de leur cause et traduisant des jugements de valeur, une
telle présentation étant de nature à faire peser un doute légitime sur
l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen relevé d'office
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1240 du code civil, 559 du code de procédure civile, 6, § 1, et
10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
10. Selon l'article 6, § 1, de la Convention précitée, toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
11. Selon l'article 10, § 1, de la Convention précitée, toute personne a droit à
la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
12. L'article 10, § 2, stipule que l'exercice de ces libertés comportant des
devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
13. Par ailleurs, il résulte de l'article 559 du code de procédure civile qu'en
cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
14. La question se pose de savoir si une partie appelante peut être condamnée à
des dommages-intérêts sur les fondements de l'article 559 précité et 1240 du
code civil à raison du contenu de ses écritures produites devant la cour d'appel.
15. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, de manière générale, la
condamnation à des dommages-intérêts constitue une ingérence dans l'exercice par
l'intéressé de sa liberté d'expression et pareille immixtion enfreint l'article
10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts
légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société
démocratique pour les atteindre (Paturel c. France, arrêt du 22 mars 2006, n° 54968/00, § 24).
16. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'«
égalité des armes » et d'autres considérations d'équité militent en faveur d'un
échange de vues libre, voire énergique, entre les parties, et de critiques très
larges de la part de l'avocat de la défense en vue de garantir le libre exercice
de sa profession et le droit de son client à un procès équitable. ([E] c. Finlande, arrêt du 21 mars 2002, n° 31611/96, § 49).
17. Il en résulte qu'éclairés par la jurisprudence de la Cour européenne, les
articles 6 et 10 de la CEDH s'opposent, au regard des impératifs de libre
exercice des droits de la défense et de droit à un procès équitable, à ce qu'une
partie appelante d'un jugement soit condamnée, sur le fondement des articles 559
du code de procédure civile et 1240 du code civil, à des dommages-intérêts à
raison d'un passage ou d'un extrait de ses écritures remises à la cour d'appel.
18. En effet, seules les dispositions spéciales prévues à l'article 41 de la loi
du 29 juillet 1881 peuvent fonder une condamnation à indemnisation à raison
d'écrits produits devant les tribunaux et de leur caractère prétendument
diffamatoire. Encore faut-il que les passages litigieux soient étrangers à
l'instance judiciaire. (1re Civ., 28 septembre 2022, n° 20-16.139, publié ; Crim., 11 octobre 2005, n° 05-80.545, publié)
19. Une telle interprétation, si elle n'a pas été affirmée antérieurement par la
deuxième chambre civile, est conforme aux articles 6 et 10 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Pour condamner M. et Mme [A] à payer à la banque une certaine somme à titre
de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de
l'intimée sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881
précitée, retient essentiellement que la mauvaise foi des appelants est patente,
qu'ils n'ont pas craint dans leurs écritures de reprocher des malversations à la
banque qu'ils accusent pratiquement d'escroquerie, qu'un tel comportement
constitue à l'évidence un abus fautif, de nature à causer un préjudice à la
partie intimée, l'abus déjà constaté par le juge de l'exécution ayant été
aggravé par la procédure d'appel et le contenu de l'argumentation malveillante de M. et Mme [A].
21. En statuant ainsi, alors que les appelants ne pouvaient être condamnés à des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code
civil et 559 du code de procédure civile, à raison d'un passage ou d'un extrait
de leurs conclusions devant la cour d'appel, fussent-ils de nature à heurter et choquer, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés.
Article 16 du Code Civil
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Cour de Cassation Chambre civile 1 arrêt du 29 mars 2017 Pourvoi n° 15-28813 cassation partielle
Vu les articles 9 et 16 du code civil et 10 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la liberté de la presse et le droit à l'information du public autorisent la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement
d'actualité ou illustrant avec pertinence un débat d'intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ;
Attendu que, pour décider que l'atteinte au droit à l'image de M. X... est injustifiée et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la
séquence litigieuse est précédée et suivie d'un commentaire en voix off de nature à dévaloriser la personne ainsi montrée au public et que, s'il est
constant que le sujet est effectivement un sujet de société en ce qu'il a pour but de prévenir le public des dérives découlant de l'utilisation du réseau
internet, cette présentation de l'image de M. X... comme étant le médecin qui s'est laissé berner par sa patiente n'était pas, dans la forme qui a été
adoptée, utile à l'information des téléspectateurs ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés des propos tenus par les journalistes, relevant, comme tels, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse, mais impropres à caractériser une atteinte à la dignité de la personne représentée, au sens de l'article 16 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
La loi du 29 juillet 1881 loi spéciale écarte la loi générale de l'article 1382 devenu l'article 1240 du Code Civil.
Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 7 février 2017 Pourvoi n° 15-86970 cassation
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi
du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu l'article 1240, du Code civil ;
Qu'il s'en déduit que l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée ne peut être fondée que sur la loi susvisée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jacques X..., sénateur et président du conseil général de la Guadeloupe, a fait
citer directement M. Claude Y..., représentant du syndicat CFTC au conseil général de la Guadeloupe, du chef de diffamation publique envers un citoyen
chargé d'un mandat public, en raison de propos tenus lors d'une émission télévisée diffusée le 12 janvier 2014 sur la chaîne de télévision Guadeloupe Première ainsi retranscrits :
" Oui, euh, je n'ai rien contre Monsieur Jacques X..., je n'ai rien contre lui. Mais il se trouve qu'il a commis un certain nombre de malversations. Alors
moi je prends mes responsabilités, hein, il peut me conduire au pénal, euh, je dis qu'il a commis des malversations. Quand vous vous permettez d'embaucher un
médecin à 5. 200 euros par mois, ce monsieur a un temps plein, mais il travaille à temps plein en France, ou bien il a le don d'ubiquité ",
Question de M. Z..." Vous nous dites que c'est une affaire parmi tant d'autres "
Réponse de Monsieur Y... : " Parmi tant d'autres "
" Ecoutez., Monsieur Jacques X... est sénateur de la GUADELOUPE, c'est un législateur, un peu comme A..., les lois c'est pour les autres et pas pour lui.
Il est de droit divin " ;
Attendu que les premiers juges, après avoir accueilli l'exception de vérité, ont prononcé la relaxe du prévenu ; que M. X... a, seul, interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour débouter M. X... de toutes ses demandes sur l'action civile, l'arrêt, après avoir relevé que la relaxe survenue sur l'action publique est
définitive faute d'appel du ministère public et que la décision à intervenir sur l'action civile ne saurait permettre la remise en cause de l'innocence du
prévenu relaxé, en a déduit que l'action civile ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1382, devenu l'article 1240, du Code civil selon
lesquelles tout fait quelconque de l'homme l'oblige à réparation, et non sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, sauf pour les seconds juges à statuer
de nouveau sur le bien-fondé de l'action publique, en sorte que les incidents et prétentions des parties sur la réunion des conditions fixées par la loi du 29
juillet 1881 sur l'exception de vérité et sur la bonne foi du prévenu sont sans objet ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en écartant la loi du 29 juillet 1881 au profit de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, alors qu'il lui
incombait d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur la seule base de ladite loi,
la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue
Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 29 octobre 2014 Pourvoi n° 13-15850 Cassation partielle sans renvoi
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt accueille la demande de dommages-intérêts formée par la société au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte
causée à sa réputation et à celle de son gérant par la publication tronquée du jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits, tels que dénoncés par la société, ne pouvaient relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la cour
d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'a pas été interrompue au regard des dispositions de cette loi, se trouve acquise ;
Une Maison d'Éditions n'est pas un organe de presse
COUR DE CASSATION, 1ere CHAMBRE CIVILE, arrêt du 3 février 2016 N° Pourvoi 15-10374 rejet
Mais attendu que, s'il résulte des articles 7 à 13 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août
1986 portant réforme du régime juridique de la presse, que le directeur d'une publication périodique peut, par dérogation aux articles 654 à 659 du code de
procédure civile, être cité au siège de l'entreprise éditrice, cette dérogation ne concerne pas l'éditeur d'un livre ; qu'ayant constaté que M. A... avait été
assigné au siège de la société Éditions du Seuil, éditrice de livres, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette assignation, délivrée en dehors des
conditions fixées par les textes précités du code de procédure civile, était irrégulière ;
Et attendu que les juges du fond ne se sont pas bornés à énoncer qu'une telle irrégularité portait nécessairement atteinte aux droits de la défense, en
entravant l'exercice des droits reconnus à la personne poursuivie par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, mais ont encore relevé que la preuve de la
vérité des propos en cause était, en l'espèce, susceptible d'être rapportée
LE PRINCIPE DU SECRET DE L'INSTRUCTION
Article 11 du Code de Procédure pénale
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits
de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est
secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines des
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou
inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la
République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des
parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne
comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les
personnes mises en cause.
Article 56 du Code de Procédure Pénale
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la
saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la
possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir
des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier
de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers
pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de
police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels
sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à
l'article
131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de
saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de
rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les
cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement
autorisée par le procureur de la République.
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et
celles auxquelles il a éventuellement recours en application de
l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou
données informatiques avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, sans préjudice de l'application des articles 56-1 à 56-5, il a
l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit
assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés
sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des
difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de
leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des
personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à
l'article 57.
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la
manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support
physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui
assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du
procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique
qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la
détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes
ou des biens.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police
judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données
informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont
la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur
des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est
pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits
des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un
établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
saisis et confisqués.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie
libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit
transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque
type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité
à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des
scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute
ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées,
le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la
juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il
n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés
faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets,
documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la
perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police
judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
Décision n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018
Association de la presse judiciaire [Présence des journalistes au cours d'une perquisition]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 décembre 2017
par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant
sur l'article 11 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes, et de l'article 56 du même code, dans sa
rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Le premier alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale pose le principe
du secret de l'enquête et de l'instruction. Selon une jurisprudence constante de
la Cour de cassation qui a servi de base à la circulaire contestée devant le
Conseil d'État, il résulte de cet article que « constitue une violation du
secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une
perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne
qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un
officier de police judiciaire en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une
autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image ».
Selon l'association de la presse judiciaire, ces dispositions méconnaîtraient la
liberté d'expression et de communication protégée par l'article 11 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Dans sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel juge, en premier lieu,
que, en instaurant le secret de l'enquête et de l'instruction, le législateur a
entendu, d'une part, garantir le bon déroulement de l'enquête et de
l'instruction, poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de
prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs
d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes
de valeur constitutionnelle. Le législateur a entendu, d'autre part, protéger
les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le
droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui
résultent des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789.
Le Conseil constitutionnel relève, en second lieu, les tempéraments que le
législateur a lui-même apportés à l'interdiction résultant des dispositions contestées.
Le premier est que la portée du secret est limitée aux actes d'enquête et
d'instruction et à la durée des investigations correspondantes. Ces dispositions
ne privent pas les tiers, en particulier les journalistes, de la possibilité de
rendre compte d'une procédure pénale et de relater les différentes étapes d'une
enquête et d'une instruction. L'atteinte portée à l'exercice de la liberté
d'expression et de communication est ainsi limitée.
Un second tempérament se trouve dans des possibilités de déroger au secret de
l'enquête et de l'instruction, notamment dans le cadre des « fenêtres de
publicité » prévues au troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure
pénale, qui permettent au procureur de la République de rendre publics certains
éléments objectifs à la condition qu'ils ne comportent aucune appréciation sur
le bien-fondé des charges retenues. Enfin, au titre des droits de la défense,
les parties et leurs avocats peuvent communiquer des informations sur le
déroulement de l'enquête ou de l'instruction.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge que l'atteinte à l'exercice de
la liberté d'expression et de communication qui résulte des dispositions
contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi et
conclut à la conformité à la Constitution de ces dispositions. Il relève par
ailleurs qu'il n'est pas interdit au législateur d'autoriser la captation par un
tiers du son et de l'image à certaines phases de l'enquête et de l'instruction
dans des conditions garantissant le respect des exigences constitutionnelles.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 décembre 2017
par le Conseil d'État (décision n° 411915 du 27 décembre 2017), dans les
conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association
de la presse judiciaire par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État
et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel sous le n° 2017-693 QPC. Elle est relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 11
du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516
du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les
droits des victimes, et de l'article 56 du même code, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le
crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
- la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
- l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2017 (chambre criminelle, n° 16-84.740) ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour l'association requérante par la SCP Spinosi
et Sureau, enregistrées les 19 janvier et 5 février 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 19 janvier 2018 ;
- les observations en intervention présentées pour Mme Huguette P. par Me
Laurent Pasquet-Marinacce, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 janvier 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, pour l'association requérante, Me Pasquet-Marinacce, pour la partie
intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 13 février 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 11 du code de procédure pénale, dans sa
rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits
de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
« Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et
226-14 du code pénal.
« Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou
inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la
République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des
parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne
comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause».
2. L'article 56 du code de procédure pénale, dans sa
rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la
saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la
possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des
pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de
police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour
y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police
judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont
susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article
131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de
ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de
saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième
alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.
« Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et
celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le
droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
« Toutefois, sans préjudice de l'application des articles 56-1 à 56-5, il a
l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit
assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
« Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous
scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils
font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et
de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont
assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la
manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support
physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur
de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas
été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou
l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
« Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire
ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles
à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est
prévue à l'article 131-21 du code pénal.
« Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des
espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas
nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des
personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un
établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie
libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit
transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque
type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à
cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés.
Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou
réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et
les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction
compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il
n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux,
tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
« Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets,
documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la
perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire
le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations ».
3. L'association requérante reproche à ces dispositions,
telles qu'interprétées par la Cour de cassation, d'interdire toute présence d'un
journaliste ou d'un tiers lors d'une perquisition, pour en capter le son ou
l'image, même lorsque cette présence a été autorisée par l'autorité publique et
par la personne concernée par la perquisition. Il en résulterait une
méconnaissance de la liberté d'expression et de communication protégée par
l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
ainsi que du « droit du public à recevoir des informations d'intérêt général »,
qui en constituerait le corollaire.
4. Le premier alinéa de l'article 11 du code de procédure
pénale pose le principe du secret de l'enquête et de l'instruction. Selon la
jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu'elle ressort de
l'arrêt mentionné ci-dessus auquel se réfère la circulaire attaquée devant le
Conseil d'État, il résulte de cet article que « constitue une violation du
secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une
perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne
qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un
officier de police judiciaire en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une
autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le
son ou l'image ».
5. Par conséquent, la question prioritaire de
constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale.
6. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son
exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect
des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette
liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
7. En vertu du premier alinéa de l'article 11 du code de
procédure pénale, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est
secrète, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des
droits de la défense. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de
cassation, interdisent notamment qu'un tiers à la procédure capte par le son et
l'image le déroulement d'une perquisition.
8. En premier lieu, en instaurant le secret de l'enquête
et de l'instruction, le législateur a entendu, d'une part, garantir le bon
déroulement de l'enquête et de l'instruction, poursuivant ainsi les objectifs de
valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de
recherche des auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de
droits et de principes de valeur constitutionnelle. Il a entendu, d'autre part,
protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de
garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence,
qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789.
9. En second lieu, d'une part, la portée du secret
instauré par les dispositions contestées est limitée aux actes d'enquête et
d'instruction et à la durée des investigations correspondantes. Ces dispositions
ne privent pas les tiers, en particulier les journalistes, de la possibilité de
rendre compte d'une procédure pénale et de relater les différentes étapes d'une
enquête et d'une instruction. Dès lors, l'atteinte portée à l'exercice de la
liberté d'expression et de communication est limitée.
10. D'autre part, le législateur a prévu plusieurs
dérogations au secret de l'enquête et de l'instruction. En particulier, le
troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale permet au procureur
de la République, soit d'office, soit à la demande de la juridiction ou des
parties, de rendre publics des « éléments objectifs tirés de la procédure », à
la condition qu'ils ne comportent aucune appréciation sur le bien-fondé des
charges retenues contre les personnes mises en cause.
11. Enfin, il ressort des dispositions contestées que le
secret de l'enquête et de l'instruction s'entend « sans préjudice des droits de
la défense ». Les parties et leurs avocats peuvent en conséquence communiquer
des informations sur le déroulement de l'enquête ou de l'instruction.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans que cela
interdise au législateur d'autoriser la captation par un tiers du son et de
l'image à certaines phases de l'enquête et de l'instruction dans des conditions
garantissant le respect des exigences constitutionnelles mentionnées ci-dessus,
l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui
résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée à
l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 11 de la
Déclaration de 1789 doit donc être écarté.
13. Le premier alinéa de l'article 11 du code de procédure
pénale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution
garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le premier alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale,
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la
protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, est
conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er
mars 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

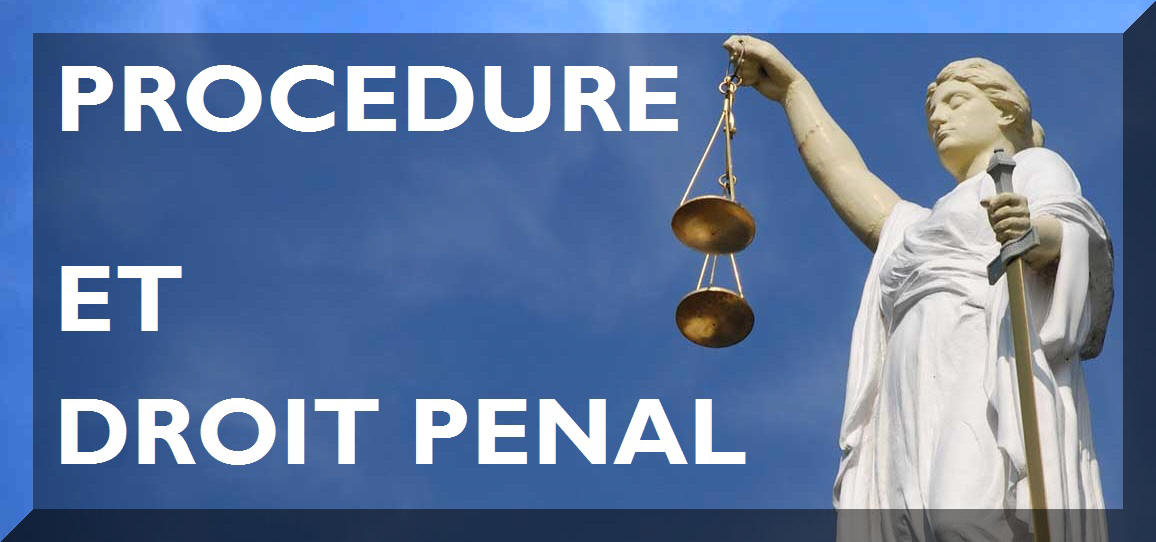

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE
ARTICLE 1
L'imprimerie et la librairie sont libres
ARTICLE 2
Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public.
Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne,
de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public.
Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont
strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.
Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir les sources d'un journaliste au
moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources.
Au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l'atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée
pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité.
JURISPRUDENCE
LES ECOUTES TELEPHONIQUES DU JOURNAL LE MONDE
Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 6 décembre 2011 Pourvoi n° 11-83970 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure qu'à la suite de la publication, le 1er septembre 2010, dans le journal Le Monde, sous les signatures de M. Gérard A... et de M. Jacques Z...,
d'un article rendant compte d'investigations réalisées la veille et le jour même dans une enquête la concernant, Mme Y... a porté plainte du chef de violation du
secret professionnel auprès du procureur de la République ; que ce dernier a, le 2 septembre 2010, ordonné une enquête préliminaire, en autorisant notamment les
officiers de police judiciaire à obtenir, par voie de réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie, l'identification des numéros de téléphone des
correspondants des journalistes auteurs de l'article ; que, procédant par voie
de recoupements, les enquêteurs ont ainsi dressé une liste des personnes pouvant avoir un lien avec la procédure en cours ;
Attendu qu'après ouverture d'une information contre personne non dénommée, les juges d'instruction désignés ont saisi la chambre de
l'instruction aux fins de voir statuer sur la régularité de la procédure ; que pour prononcer l'annulation des réquisitions visant à des investigations sur les
lignes téléphoniques des journalistes en cause, et celle des pièces dont elles étaient le support nécessaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'atteinte portée au secret des sources des journalistes n'était pas justifiée
par l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public et que la mesure n'était pas strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi, la chambre de l'instruction
a légalement justifié sa décision, tant au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'au regard de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881
LE SECRET DE L'INSTRUCTION S'IMPOSE SUR LA PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES
Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 14 mai 2013 Pourvoi n° 11-86626 Cassation
Attendu que cette juridiction, après avoir prononcé l'annulation d'actes de
la procédure effectués en exécution du supplément d'information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, pour annuler les réquisitions tendant à l'exécution
d'investigations destinées à déterminer les lignes téléphoniques attribuées à
des journalistes et les facturations détaillées correspondant à ces lignes,
ainsi que les actes en étant le support nécessaire, l'arrêt retient que ces
réquisitions ont été prises, sans l'accord des journalistes, en violation de
l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 2
de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier
2010 ; que les juges ajoutent que lesdites réquisitions, qui avaient pour objet
de porter atteinte au droit des journalistes concernés de ne pas révéler leurs
sources, ont eu pour origine la dénonciation, par un particulier, de la simple
probabilité de la commission d'un délit de violation du secret de l'instruction
déduite de la succession à délai très rapproché d'un placement en garde à vue et
d'informations parues dans la presse ; qu'ils en concluent qu'en l'espèce,
l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public n'était pas avérée et
que l'atteinte portée au secret des sources, à partir de simples suppositions
des parties civiles, était disproportionnée ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, d'une part, sans
mieux s'expliquer sur l'absence d'un impératif prépondérant d'intérêt public
alors que la violation du secret de l'instruction reprochée imposait de
rechercher les auteurs de cette infraction ayant porté atteinte à la présomption
d'innocence, d'autre part, sans caractériser plus précisément le défaut de
nécessité et de proportionnalité des mesures portant atteinte au secret des
sources des journalistes au regard du but légitime poursuivi, et enfin, en
faisant à tort référence à l'obligation d'obtenir l'accord des journalistes pour
procéder aux réquisitions litigieuses alors qu'un tel accord n'est nécessaire
que si ces professionnels sont directement requis de fournir des informations,
la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue
ARTICLE 2 bis
Tout journaliste, au sens du 1° du I de l'article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de
refuser de signer un article, une émission, une partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou
contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de
son entreprise ou de sa société éditrice.
Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de
communication audiovisuelle entraîne l'adhésion à la charte déontologique de l'entreprise ou de la société éditrice.
Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la
loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée
conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de
celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à
l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du
présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017.
ARTICLE 3
Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets,
portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d'amende.
La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au
paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.
Une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les
douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature.
Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite
le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante.
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE
Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet.
Article 5
Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni
autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement.
Article 6
Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.
Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une
entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme
du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des
droits de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les autres
cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise
éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L.
225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le
président du directoire ou le directeur général unique.
Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les
conditions prévues à l'article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du
Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés
européennes, l'entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication
choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et,
lorsque l'entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du
conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de
ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doir être nommé dans le délai d'un mois à
compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie
de l'immunité visée à l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent
être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de
leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont
applicables au codirecteur de la publication.
ARTICLE 7 abrogé par l'article 99 de la loi du 22 mars 2012
ARTICLE 8 abrogé par l'article 99 de la loi du 22 mars 2012
ARTICLE 9
En cas de contravention à l'article 6, le propriétaire, le directeur de la
publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa du même article 6, le
codirecteur de la publication sont punis de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe. La peine sera applicable à l'imprimeur à
défaut du propriétaire ou du directeur ou, dans le cas prévu au troisième alinéa
de l'article 6, du codirecteur de la publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après
avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication
irrégulière continue, de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe
prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à
partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement
est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été
rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution
provisoire est ordonnée.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la
cour dans le délai de trois jours.
ARTICLE 10
Sont soumis à l'obligation de dépôt auprès du ministre chargé de la
communication à la parution de chaque numéro les journaux et écrits périodiques
à diffusion nationale. Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe les
modalités de mise en œuvre de l'obligation de dépôt ainsi que le nombre
d'exemplaires à déposer. Ce nombre ne peut être supérieur à dix et tient compte
notamment du fait que la publication est ou non consacrée à l'information
politique et générale.
Ce dépôt sera effectué sous peine de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4° classe contre le directeur de la publication.
ARTICLE 11
Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les
exemplaires, à peine contre l'imprimeur de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4° classe par chaque numéro publié en contravention de la
présente disposition.
Paragraphe 2 : Des rectifications.
ARTICLE 12
Le directeur de la publication sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du
prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui
lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des
actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article
auquel elles répondront.
En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni de 3 750
euros d'amende.
ARTICLE 13
Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de
leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le
journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans
préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait
donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le
directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la
réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que
l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la
signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à
la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre
cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et
elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait
d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux
répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux
commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra
excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le
surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru
l'article.
Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice
de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie
par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait
retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de
reproduire.
Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en
refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais
en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant
opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la
déclaration, faite au greffe.
Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour
l'insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux
quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six
heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès
ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal
sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er,
l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son
journal. Le délai de citation sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre
heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être
délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du
tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui
concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai qui est fixé par
le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le
directeur de la publication sera passible de trois mois d'emprisonnement et de 3
750 euros d'amende.
L'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter
du jour où la publication aura eu lieu.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, toute personne nommée
ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de
poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le
délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait
l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant
expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
ARTICLE 13-1
Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les
associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une
personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique,
fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à
leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées
individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
Aucune association ne pourra requérir l'insertion d'une réponse en
application du présent article dès lors qu'aura été publiée une réponse à la
demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1.
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE
Paragraphe 1er : De l'affichage.
ARTICLE 15
Dans chaque commune, le maire, désignera, par arrêté, les lieux exclusivement
destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur
papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression
d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou
d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit
dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2.
ARTICLE 16 : abrogé par la
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
ARTICLE 17
Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé
quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches
apposées par ordre de l'Administration dans les emplacements à ce réservés,
seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité
publique, la peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe ceux
qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de
manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales
émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de
ceux qui auront commis cette lacération ou altération.
La peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, si
le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à
moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés par l'article 15.
ARTICLE 18 à 22 : abrogé
CHAPITRE IV :
DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.
ARTICLE 23
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui,
soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes,
images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par
des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué
l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été
suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.
JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 8 avril 2014 N° de pourvoi 12-87497 rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que M. X...a été cité devant le tribunal correctionnel pour injure publique à caractère racial pour avoir tenu à M. Dogan Y...les propos suivants "
sale bougnoule, vous êtes juste tolérés ici ", et ce dans la cour commune de l'immeuble où résident les deux intéressés en qualité de copropriétaires ; que
le tribunal a déclaré M. X...coupable de ce délit par un jugement dont le prévenu et le ministère public ont interjeté appel
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient, notamment, que les propos incriminés, également entendus par l'épouse de M.
Y..., ont été proférés dans une cour d'immeuble comportant seize appartements et à laquelle le public a accès
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il se déduit que les propos litigieux ont été tenus dans des circonstances traduisant
une volonté de leur auteur de les rendre publics, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen
DES PROPOS NON PUBLICS NE SONT PAS CONCERNÉS PAR LES ARTICLES 23 ET 24
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 15 décembre 2015 Pourvoi n° 14-86132 cassation sans renvoi
Vu les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le délit d'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité n'est constitué que si les propos incriminés ont
été "proférés" au sens de l'article 23 de la loi sur la presse, c'est-à-dire tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, l'arrêt, après annulation du jugement et évocation, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant par des motifs dont il se déduit que les propos ont été tenus par leur auteur dans des circonstances exclusives de toute volonté de
les rendre publics, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet
l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
INCITATION A LA HAINE
ARTICLE 24
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux
qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement
provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à
commettre l'une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à
l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes,
définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes
et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes
visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité,
des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, y compris
si ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs.
Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes
moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics
seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la
discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou
à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de
leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les
articles 225-2 et
432-7 du code pénal.
Lorsque les faits mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article
sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les
septième et huitième alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente
loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits
énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l'article 131-5-1 du code pénal.
JURISPRUDENCE
CRITIQUER L'IMMIGRATION MUSULMANE DANS SON ENSEMBLE EST UN APPEL A LA HAINE
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 21 juin 2023 pourvoi n° 21-86.068 cassation
LES PROPOS INCRIMINES
Il a été également cité pour avoir, dans les mêmes circonstances, provoqué publiquement à la discrimination, à la haine ou à la
violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, en tenant les propos suivants :
« Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c'est que l'avenir n'est pas régi par des courbes économiques mais par des
courbes démographiques. Celles-ci sont implacables. L'Afrique, qui était une terre vide de 100 millions d'habitants en 1900, sera une terre pleine à ras bord
de 2 milliards et plus en 2050. L'Europe, qui était alors une terre pleine de 400 millions d'habitants, quatre fois plus, n'est montée qu'à 500 millions. Un
pour quatre, le rapport s'est exactement inversé. A l'époque, le dynamisme démographique de notre continent, a permis aux blancs de coloniser le monde. Ils
ont exterminé les indiens et les aborigènes, asservi les africains. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants
migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs indiens et leurs esclaves. C'est vous » ;
« La question qui se pose donc à nous est la suivante : les jeunes français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres ?
Si oui, ils méritent leur colonisation. Si non, ils devront se battre pour leur libération. Mais comment se battre ? Où se battre ? Sur quoi se battre ? » ;
« L'immigration c'était la guerre, venir d'un pays étranger pour donner à ses enfants un destin français. Aujourd'hui les immigrés
viennent en France pour continuer à vivre comme au pays. Ils gardent leur histoire, leurs héros, leurs moeurs, leurs prénoms, leurs femmes qu'ils font
venir de là-bas, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux Français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre c'est à dire vivre sous la
domination des moeurs islamiques et du hallal ou fuir.» ;
« Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou les Anglais en Inde. Ils se
comportent en colonisateurs. Les caïds et leurs bandes s'allient à l'Imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille
alliance du sabre et du goupillon, en l'occurrence, la kalach et la djellaba.» ;
« Il y a une continuité entre les viols, vols, trafics jusqu'aux attentats de 2015 en passant par les innombrables attaques au couteau
dans les rues de France, ce sont les mêmes qui commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les « kouffars » les infidèles. C'est
le djihad partout et pour tous et par tous. » ;
« Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue et les uniformes
d'une armée d'occupation rappellent aux vaincus leur soumission. Au triptyque d'antan « Immigration, Intégration, Assimilation » s'est substitué « Invasion,
colonisation, Occupation. » »
LA REPONSE DE LA COUR DE CASSATION
13. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
14. Il résulte de ces textes que les délits de provocation et d'injure qu'ils
répriment sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens
que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne
ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou
de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
15. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que
le tribunal et le ministère public ont retenu que les propos litigieux
visaient la communauté musulmane dans son ensemble à raison de sa religion mais qu'en revanche, les parties civiles étaient plus nuancées.
16. Les juges ajoutent qu'il leur appartient donc de rechercher si les propos
litigieux visent des personnes ou groupes protégés par lesdits articles.
17. Ils relèvent, à cet égard, que le premier passage poursuivi vise des
immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique ; que le deuxième
évoque les immigrés de confession musulmane ; que les troisième, quatrième et
cinquième passages visent les immigrés de confession musulmane auxquels il est
imputé de vouloir venir en France pour continuer à vivre comme au pays et placer
les autochtones sous la domination des moeurs islamiques ; que le sixième ne
concerne pas les musulmans dans leur ensemble mais seulement une partie d'entre
eux qui affiche une appartenance communautaire par le port d'un voile pour les femmes ou d'une djellaba pour les hommes.
18. Ils en concluent qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des
Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes.
19. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés et le
principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, peu important que le ministère public et les parties
civiles lui aient soumis des analyses différentes des propos poursuivis, il lui
appartenait de déterminer si ceux-ci visaient un groupe protégé au sens des dispositions susvisées.
21. En deuxième lieu, elle devait, pour ce faire, procéder à une analyse globale
des propos poursuivis, éclairés par tous les éléments extrinsèques qu'il lui appartenait de relever.
22. Enfin, les propos litigieux désignent les immigrés de confession musulmane venant d'Afrique, soit un groupe de personnes déterminé tant par leur
origine que par leur religion, entrant dans les prévisions de la loi.
23. La cassation est par conséquent encourue.
CRITIQUER LA POLITIQUE DE NATURALISATION DU GOUVERNEMENT N'EST PAS UN APPEL A LA HAINE
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 7 juin 2017 N° de pourvoi 16-80322 cassation sans renvoi
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 24, alinéa 8, devenu l'alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des
mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du même texte ;
Attendu que, selon le second, le délit de provocation qu'il prévoit n'est caractérisé que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur
portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, par voie de citation directe délivrée le 17 octobre
2013, l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) a fait citer M. Yves X..., directeur de publication de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, pour y répondre du
délit de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse ; que la citation visait le texte figurant sur la
couverture du numéro daté du 26 septembre au 2 octobre 2013 : " Naturalisés L'invasion qu'on cache Deux français sur trois contre les naturalisations
massives de Valls Islam, immigration : comment la gauche veut changer le peuple Michèle Y...: « Le poids des musulmans n'a cessé d'augmenter » ", les propos
étant associés à la reproduction d'un buste de Marianne revêtue d'un voile intégral noir ; que le tribunal a déclaré la prévention établie, reçu la
constitution de partie civile de l'UEJF ainsi que les constitutions de partie civile formées par voie d'intervention des associations Maison des potes-Maison
de l'égalité et SOS Racisme-Touche pas à mon pote et de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), et leur a alloué à chacune des
dommages-intérêts ; que le prévenu et l'association Maison des potes ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X..., en sa qualité de directeur de publication, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos litigieux, portant sur une question d'intérêt public relative à la politique
gouvernementale de naturalisation, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression et que, même si leur formulation peut légitimement
heurter les personnes de confession musulmane, ils ne contiennent néanmoins pas d'appel ou d'exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence à leur
égard, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
CRITIQUER LE CHRIST N'EST PAS UN APPEL A LA HAINE (note de Frédéric Fabre : en revanche Mahomet, oui vu
les états contre Charlie Hedbo ?)
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 14 novembre 2017 N° de pourvoi 16-84945 rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement
qu'il confirme sur l'action civile et des pièces de la procédure que l'Alliance
générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et
chrétienne (AGRIF) a porté plainte et s'est constituée partie civile, sur le
fondement de l'article 24, alinéa 8, devenu alinéa 7, de la loi du 29 juillet
1881, en raison de propos tenus dans la pièce de théâtre de l'auteur
hispano-argentin Rodrigo Garcia, intitulée "Golgota picnic", que la société Les
Solitaires intempestifs avait éditée le 2 novembre 2011 et dont le théâtre du
Rond-Point avait donné neuf représentations, du 8 au 17 décembre suivants, dans le cadre du Festival d'automne à Paris ;
Attendu que les propos incriminés sont les suivants :
Page 17 lignes 13 à 22 : "Il [Jésus Christ] n'est d'accord avec personne, il
n'aime aucune des illustrations qu'on a réalisées de lui, il est vaniteux. Il
approuve, ça oui, la tonalité globale des tableaux et des fresques : une
iconographie de la terreur qui part, ironiquement, du mot "amour". Il a
orchestré une parfaite iconographie de la terreur qui durant des siècles a
produit des estampes diaboliques où il tient le haut de l'affiche" ;
Page 18 lignes 10 à 25 : "En tant qu'héritiers d'un tel legs graphique, il ne
faut pas s'étonner de voir des gens en pousser d'autres par la fenêtre ou des
gens baiser des gosses ou des gens qui ne se contentent pas de flanquer
cinquante coups de couteau dans un même corps ou des gens qui aiment tourner des
snuffmovies et des gens qui envoient des armées aux quatre coins de la planète
et des gens qui engloutissent d'un coup six douzaines de BigMac et des litres de
soda noir pour faire passer le tout. Le musée du Prado, le Louvre, le musée des
Beaux-Arts de Bruxelles ou d'Anvers, la Galerie des Offices, la pinacothèque
Albertina, l'Academia, la Alte Pinakothek, le Historisches Museum de Vienne,
tous ces beaux édifices doivent être livrés aux flammes" ;
Page 18 lignes 26 à 29 et page 19 ligne 2 : "Personne ne devrait jamais avoir
accès à ces épouvantables tableaux représentant des calvaires, des croix et des
larmes, des plaies béantes et des doigts qui fouillent l'intérieur, de la
propagande pour la perversion, le tourment et la cruauté, résultat de techniques raffinées" ;
Page 19 lignes 12 et 13 : "il y a des visites réservées aux enfants pour que les
enfants apprennent à faire le mal" ;
Page 19 lignes 16 à 18 : "Il y a des souvenirs - j'allais les oublier - pour que
tu puisses coller sur la porte du frigo tes morceaux de violence et de dépravation préférés" ;
Page 19 lignes 26 à 29 et page 20 lignes 1 à 6 : "Revenons-en à nos moutons :
quand il vivait parmi les hommes, il a su mieux que personne prédire et diriger.
Il a su dissuader. Il était capable d'embrouiller son monde Il était doué pour
organiser et planifier l'avenir des autres. Mais il ne parvenait pas à vivre en
paix avec lui-même. Il ne parvenait pas à vivre une simple expérience, parce
qu'il s'était imposé de ne partager sa vie quotidienne avec personne" ;
Page 20 lignes 7 à 31 : "Il disait qu'il était le fils de Dieu, ce qui le
plaçait sur un autre plan, et il terminait ses nuits en maudissant le monde tout
seul dans son coin, sans avoir caressé, sans avoir écouté, avec l'écho de ses
propres mots adressés comme des sermons depuis tout là-haut. Il n'a même pas su
déguster une glace au chocolat. Il était inapte au quotidien. Le meilleur comme
le pire. Il ne l'a jamais avoué, mais il rêvait de perdre son temps comme tout
un chacun, sauf qu'il avait le plus grand mal à s'amuser. Il était nul dès qu'il
s'agissait de parler de foot. Incapable d'aller boire des bières, de se lancer
dans une discussion sur les filles avec un pote et de rater le dernier bus. Il
ne supportait pas qu'autour de lui des gens éclatent de joie ou aient le coeur
brisé au moindre déboire ou pour des bricoles. Il était stupéfait de constater
qu'en l'espace d'une journée une personne lambda pouvait passer de l'euphorie à
la tentative de suicide. Il s'émerveillait de ces changements d'humeur, de ces
miracles routiniers. Ce qui l'emmerdait, c'était de reconnaître qu'il était le
seul à ne jamais fondre en larmes, le seul à ne jamais lâcher le moindre éclat de rire" ;
Page 21 lignes 1 à 10 : "Il enviait les autres - ceux qui perdaient leur temps
pour des bricoles, des fadaises qui pourtant faisaient d'eux des êtres
passionnels, charnels - alors, rongé par la jalousie et par la haine, il tenta
d'allumer des feux de-ci de-là. Il devint pyromane, il avait toujours des
allumettes dans ses poches et il savait comment mettre le feu à une forêt par
une journée de chaleur et de grand vent, quand pas un nuage dans le ciel n'était annonciateur d'orage" ;
Page 21 lignes 11 à 18 : "Il voulut être le meneur d'une poignée de fous - et il
les désigna comme le peuple élu pour l'inauguration du chauvinisme - et il
voulut mener ce peuple de fous à la guerre contre tous. Il étudia toutes les
nomenclatures des guérillas à venir : Sentier Lumineux. Armée révolutionnaire du
peuple. Front de libération nationale. ETA. Et pour sa guérilla il choisit le mot AMOUR" ;
Page 21 lignes19 à 30 : "Il en vint à dire : "Ne croyez pas que je sois venu
apporter la paix sur terre, je ne suis pas venu apporter la paix mais la
discorde. Car je suis venu séparer le fils de sa mère. Celui qui aime sa mère
plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra et
celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera". Voilà le genre de
gentillesse qu'il proférait, ce fou, même une fois plaqué comme un autocollant
sur la croix. Et pour couronner le tout, il lançait son célèbre "qui n'est pas avec moi est contre moi" ;
Page 22 lignes 1 à 15 : "Il voulut la destruction pour les hommes qui ne
pensaient pas comme lui et il dessécha le figuier parce que le figuier ne
donnait pas de fruit au moment où il avait faim. Il possédait la faculté quasi
divine de souffrir, de faire le mal. Et il aimait faire peur à l'assistance avec
des miracles pervers, du genre recoller une oreille tranchée d'un coup d'épée à
un pauvre type qui s'était mêlé à une bagarre, soigner les lépreux ou marcher
sur l'océan. Il fut aussi le premier démagogue : il multiplia la nourriture pour
le peuple au lieu de travailler coude à coude avec lui. Autant qu'on sache, il n'a jamais travaillé" ;
Page 22 lignes 16 à 24 : "Et il enseigna au peuple à être doux comme un agneau.
Et il commanda à Francisco de Zurbaràn le tableau d'un agneau attaché et mort,
posé sur un amas de peinture. On n'avait jamais rien vu de tel : un agneau blanc
posé sur les ténèbres. Il déclara à propos de lui-même qu'il était un agneau. Mais c'était un foutu démon" ;
Page 22 lignes 25 à 29 et page 23 lignes 1 à 19 : "Si un bâtiment, ses habitants
et l'usage que la société en faisait n'était pas à son goût, il n'en laissait
pas une seule pierre debout. Puis il brandit la menace de la peste et de
maladies en tout genre, il fut le messie du SIDA. Il détruisit des temples car
il était jaloux des richesses d'autrui, il savait qu'un gars comme lui, sans le
sou et sans une goutte de sang bleu dans les veines, était un moins que rien,
qu'il n'irait pas bien loin, alors il entreprit de s'emparer de la fortune de
ceux qui, confiants, le suivraient. Ils furent peu à le suivre : douze hommes
seulement parmi les millions qui l'avaient écouté. Douze paumés parmi des
millions : le genre de statistiques qui t'oblige à te retirer de la politique,
cet art douteux ; mais lui non, il est resté sur le pied de guerre jusqu'à la
fin. Il a fini sur la croix qu'il méritait, car tout tyran mérite un châtiment
ou, comme on dit dans mon quartier : si tu foires, tu payes. Le calvaire qu'il a
vécu n'a pas été plus douloureux que celui de n'importe quel employé de la
poste, le calvaire d'une vie dépourvue de sens, comme n'importe quelle vie, pareille que la tienne" ;
Page 26 lignes 16 à 26 et page 21 lignes 1 à 6 : "C'est dans ce lieu nommé
Golgotha, terre des crânes, qu'on a finalement découvert tous ses mensonges : il
a échoué comme stratège militaire et comme leader politique. Il était tellement
inutile qu'au lieu de négocier un armistice ou de brandir un drapeau blanc, une
fois que tout était accompli, il s'est contenté de dire aux étoiles, une nuit,
en plein Gethsémani : "éloigne de moi ce calice". Il lançait tout cela dans les
airs, il espérait être sauvé par les airs, il avait perdu la tête. C'est ainsi
que les lâches parlent à des dieux qui ne veulent pas les entendre et que les
bouchers parlent à l'acier et que les maçons parlent aux bières et que les
marins parlent aux pattes des araignées de mer et que moi je bouffe une chatte bien juteuse, tendre et rasée" ;
Page 34 lignes 18, 19 et 20 : "Sur le tableau de Rubens, parmi les grands
gaillards, les grosses, les chevaux, les gamins et le Christ, le chien est le seul qui n'a jamais trahi personne" ;
Page 71 lignes 4 à 12 : "Cloué sur la croix en haut de Golgotha, je suis à
l'abri des tâches quotidiennes ; je n 'ai pas à prendre le métro pour aller
travailler. Je n'ai pas à réparer la gouttière sur le toit de ma maison, je
m'évite d'avoir à raconter des mensonges à mes enfants, je me contrefiche des
factures de téléphone et d'électricité, les autres n'ont qu'à les payer. Ici,
sur la croix, on peut se laisser aller à la paresse" ;
Page 72 lignes 1 à 10 : "Sur le dégoût que l'on inspire, d'autres écriront après
ma mort. On appellera ça les évangiles, et les évangiles ourdiront des milliers
de mensonges, infantiles pour la plupart, destinés à ne pas accepter l'homme
dans son imperfection. On appellera péché les actes les plus courants, les plus
mondains, on nommera péché des attitudes sociales répétées au long des siècles.
Bref, on appellera péché la vérité" ;
Page 76 lignes 1 à 4 : "Et pour le faire taire une bonne fois pour toutes, ils
lui clouèrent les mains et les pieds. Et le gars continua à parler comme si de rien n'était".
Attendu qu'à l'issue de l'information ouverte sur les faits, Mme Pascale
Y..., gérante de la société d'édition, et M. Jean-Michel X..., directeur du
théâtre, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de
provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne
ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion
chrétienne ; que les juges du premier degré les ont renvoyés des fins de la
poursuite et ont débouté l'AGRIF de ses demandes ; que cette dernière a relevé seule appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles,
l'arrêt énonce, par les motifs propres repris au moyen et ceux réputés adoptés
des premiers juges, que les propos incriminés sont tirés d'une oeuvre de fiction
à vocation artistique ne prétendant, en tant que telle, à l'affirmation d'aucune
vérité mais participant de l'échange des idées et opinions indispensable à toute
société démocratique sous réserve des seules limites fixées par la loi ; qu'en
l'occurrence, les juges retiennent que ces propos, quelque provocateurs, voire
choquants pour certains chrétiens, qu'ils soient, se rapportent à une image de
Jésus Christ totalement inventée et désacralisée, de sorte qu'ils ne peuvent
être pris au pied de la lettre, ni induire une quelconque animosité ou sentiment
de rejet à l'égard de l'ensemble des personnes qui se réclament de celui-ci ;
qu'ils ajoutent que ceux relatifs à l'iconographie religieuse, présentée comme
cruelle et perverse, ne peuvent être interprétés comme visant précisément et
spécifiquement les chrétiens, dès lors que le legs graphique ainsi dénoncé participe de l'héritage culturel commun au monde occidental ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de
contradiction, et dès lors que, par leur sens et leur portée, les propos
litigieux ne tendent pas à exhorter autrui à la discrimination, à la haine ou à
la violence à l'égard d'un groupe déterminé de personnes en raison de leur
appartenance religieuse, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'ils ne
constituent pas une faute civile entrant dans les prévisions de l'article 24,
alinéa 8, devenu alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, fondement de la poursuite ;
UN APPEL AU BOYCOTT DES PRODUITS ISRAELIENS EST UN DÉLIT D'OPINION
PUNI PAR LES JURIDICTIONS
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 20 octobre 2015 N° de pourvoi 14-80020 rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., Mme Y..., MM. Y..., Z..., A..., Mme B..., M. C..., Mmes
D..., et E..., ont été interpellés, le 22 mai 2010, à Illzach (68) dans les locaux du magasin " Carrefour ", alors qu'ils participaient à une manifestation
appelant au boycott des produits en provenance d'Israël, en portant des vêtements comportant la mention " Palestine vivra, boycott Israël ", en
distribuant des tracts sur lesquels on lisait : " Boycott des produits importés d'Israël, acheter les produits importés d'Israël, c'est légitimer les crimes à
Gaza, c'est approuver la politique menée par le gouvernement israélien ", mention suivie de l'énumération de plusieurs marques de produits commercialisées
dans les grandes surfaces de la région, et en proférant les slogans : " Israël assassin, Carrefour complice " ; qu'à la suite de ces faits, ils ont fait
l'objet de citations à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, pour
provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une
race, une religion, une nation ; que le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté les associations parties civiles de leurs demandes ;
que toutes les parties et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, et déclarer les prévenus coupables, l'arrêt retient que ceux-ci, par leur action, provoquaient à
discriminer les produits venant d'Israël, incitant les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l'origine des producteurs et fournisseurs,
lesquels, constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation déterminée, en l'espèce Israël, qui constitue une nation au sens de l'article
d'incrimination et du droit international ; que les juges ajoutent que la provocation à la discrimination ne saurait entrer dans le droit à la liberté
d'opinion et d'expression dès lors qu'elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant par l'incitation à opérer une différence de traitement à l'égard
d'une catégorie de personnes, en l'espèce les producteurs de biens installés en Israël ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qui répondaient aux chefs péremptoires des conclusions dont elle
était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a relevé, à bon droit, que les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 24,
alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 étaient réunis, et que l'exercice de la liberté d'expression, proclamée par l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme, peut être, en application du second alinéa de ce texte, soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l'espèce, des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la protection des droits d'autrui ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté
ARTICLE 24 BIS
Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux
qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6
du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée
criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré
ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23,
l'existence d'un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa
du présent article, d'un autre crime contre l'humanité, d'un crime de réduction
en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou d'un crime
de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale
internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3,
224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :
1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction
française ou internationale ;
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis
par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou
de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000
euros d'amende.
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique.
ARTICLE 26
L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans
l'article 23 est punie d'une amende de 45 000 euros.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la
personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.
ARTICLE 27
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce
soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement
attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix
publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros.
Les mêmes faits seront punis 135 000 euros d'amende, lorsque la publication,
la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler
la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes.
DIFFAMATION
ARTICLE 29
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est
imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous
forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des
discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
JURISPRUDENCE SUR LA BONNE FOI ET LE BUT D'INTERÊT GENERAL
LE TON ET LA GRAVITE DES ACCUSATIONS DEFINISSENT L'ANIMOSITE OU NON DE LA PERSONNE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 7 janvier 2020 Pourvoi N° 18-85.620 Cassation partielle
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à
justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des
parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. L’arrêt attaqué, après avoir rejeté l’exception de nullité
de la citation, retient que les propos poursuivis imputent aux parties civiles
d’avoir recruté des mercenaires, préparé un coup d’État, organisé une
insurrection violente, corrompu le pouvoir en place et déstabilisé le régime
guinéen par des moyens illégaux, pour favoriser un parti fictif et protéger
leurs intérêts miniers.
8. L’arrêt reproduit, en les résumant, les déclarations des
témoins entendus au titre de l’offre de preuve. Mme Z... dit avoir reçu, peu
avant les élections en Guinée, d’une source de confiance et dont elle ne révèle
pas le nom, deux notes dites blanches, sur l’authenticité desquelles elle n’a
pas eu de doute et qu’elles a transmises à M. B.... Ce dernier déclare notamment
que lui étaient parvenues, d’une source fiable et crédible, ainsi que le lui
avaient confirmé les appels téléphoniques passés pour s’assurer que ces notes
avaient été établies par les services, des informations, dont il avait vérifié
le contenu, sur un probable coup d’État contre le régime du président guinéen,
M. Alpha Conde, et ajoute qu’il y avait eu deux morts quelques mois avant les
élections. M. C..., politologue, qui se trouvait à Conakry au moment des
élections de 2013, et M. D..., professeur émérite de droit public, qui a connu
M. Conde sur les bancs de l’université, mentionnent le caractère plausible des
rumeurs et des informations publiées par l’hebdomadaire.
9. Sur l’offre de preuve, l’arrêt retient que ni les
documents produits, soit plusieurs textes, certains en langue anglaise, non
traduits, et deux notes dites blanches, qui ne peuvent être rattachées à un
quelconque service secret, français ou américain, ni les déclarations des
témoins, compte tenu de leur teneur, ne démontrent d’aucune façon l’organisation
ni même la participation des parties civiles au coup d’État visant le régime
guinéen, et en déduit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est
pas rapportée.
10. Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, les
juges énoncent que le sujet de l’article, à savoir la situation à Conakry, était
d’actualité, compte tenu de la proximité des élections dans ce pays, de sorte
que l’information pouvait paraître légitime, mais que font défaut la prudence
nécessaire dans l’expression comme l’absence d’animosité envers les parties
civiles, le journaliste s’étant borné à reprendre à son compte, sans aucun
recul, la teneur comme les conclusions des deux notes confidentielles précitées,
dont l’origine reste ignorée, et qu’il a jeté un doute sur leur réalité, en
taisant les investigations qu’il a affirmé avoir entreprises pour les
accréditer, de sorte que la base factuelle nécessaire est insuffisante.
11. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié
sa décision pour les trois motifs qui suivent.
12. Il lui appartenait, en premier lieu, d’analyser
précisément les pièces de l’offre de preuve et les déclarations des témoins
entendus à ce titre, également invoquées par le prévenu au soutien de
l’exception de bonne foi, afin d’énoncer les faits et circonstances lui
permettant de juger si les propos reposaient ou non sur une base factuelle, sans
écarter les documents présentés comme des notes blanches au seul motif que le
prévenu ne révélait pas par quelles sources il les avait obtenus.
13. Elle ne pouvait, en deuxième lieu, refuser au prévenu le
bénéfice de la bonne foi aux motifs d’un défaut de prudence dans l’expression et
d’une animosité personnelle de l’auteur de l’article, alors qu’elle devait
apprécier ces critères d’autant moins strictement que, d’une part, elle
constatait, en application de l’article 10 de la Convention européenne des
droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne, que les propos
s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, d’autre part, il résulte de ce
qui précède que son appréciation sur la suffisance de leur base factuelle
n’était pas complète.
14. En troisième lieu, elle ne pouvait déduire l’animosité
personnelle du journaliste de sa seule analyse selon laquelle les propos
seraient privés de base factuelle et exprimés sans prudence, alors qu’une telle
animosité envers la partie civile ne peut se déduire seulement de la gravité des
accusations et du ton sur lequel elles sont formulées, mais n’est susceptible de
faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est
préexistante à ceux-ci et qu’elle résulte de circonstances qui ne sont pas
connues des lecteurs.
15. La cassation est en conséquence encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. Quoique les motifs ci-dessus ne concernent que la bonne
foi, l’arrêt cassé prononçant, dans son dispositif, une décision globale sur la
culpabilité, celle-ci est intégralement remise en cause, ainsi que les décisions
qui en sont la conséquence, sur la peine et les intérêts civils.
17. Seule la décision distincte sur le rejet de l’exception
de nullité n’est pas atteinte par la cassation.
18. Il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen de cassation.
L'ARTICLE 10 DE LA CEDH EXIGE UN EXAMEN DE LA BASE FACTUELLE POUR SAVOIR SI ELLE EST SUFFISANTE
: LA BONNE FOI
L'AFFAIRE DU MINISTRE JOXE FACE A LA FILLE DU
MINISTRE BESSON
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 11 mai 2022 Pourvoi N° 21-16.156
rejet
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2021),
les propos suivants ont été mis en ligne :
- le 18 octobre 2017, dans un article de Mme [L] intitulé « #Moiaussi : pour que
la honte change de camps », sur le site www.itinera-magica.com à l'adresse URL
http://www.itinera-magica.com/moi-aussi/ :
« la troisième agression, ou comment j'ai été agressée par un ancien ministre
[?]
J'avais vingt ans. À cette époque, mon père était ministre. Il était très exposé
médiatiquement, et je souffrais beaucoup de cette attention extrême, de ce
climat polémique qui rôdait tout le temps autour de lui, de ma famille, et
j'aurais mille fois préféré l'anonymat. Mais le seul privilège de ministre qui
me consolait, le seul dont lequel j'étais heureuse de bénéficier, c'était
l'opéra. Le merveilleux opéra de [Localité 5] invitait régulièrement les
ministres à assister aux représentations, et mon père, qui connaît mon amour
pour l'art lyrique, me faisait souvent bénéficier de la deuxième invitation. L'y
accompagner était une joie immense. Ce soir-là, nous allions voir un Wagner à
l'opéra [Localité 3], était-ce Parsifal ? Était-ce le Ring ?, et j'étais aux
anges. Mais mon père a eu une urgence à gérer, et n'a pu me rejoindre qu'à
l'entracte. Du coup, les sièges étaient rebattus, et quelqu'un s'est assis à ma
droite, là où mon père aurait dû être.
Je ne sais pas si vous connaissez l'opéra [Localité 3]. Dans cette immense et
magnifique salle, une rangée est considérée comme la « rangée VIP ». C'est la
catégorie Optima, la première rangée du premier balcon, en plein milieu de la
salle (et non pas devant la scène), avec personne devant vous sur plusieurs
mètres. C'est la rangée la plus exposée, où on voit aussi bien qu'on est vu. Les
ministres, les hautes personnalités, les stars, sont toujours placés là, et
c'était un immense bonheur pour moi de pouvoir en bénéficier. J'insiste
là-dessus pour expliquer que ce ne sont pas des places discrètes, où on serait
caché dans l'ombre. Ce sont des places où tout le monde sait qui vous êtes et
voit ce que vous faites.
Un vieux monsieur à l'air éminemment respectable s'assoit donc à ma droite. Son
épouse est à sa droite à lui. J'insiste. Son épouse est là. La représentation
commence. Et au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse.
Je me dis qu'il doit être très âgé, perturbé. Je le repousse gentiment. Il
recommence. Rebelote. Une troisième fois. Il commence à remonter ma jupe. Il
glisse sa main à l'intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe. J'enlève
sa main plus fermement et je pousse un cri d'indignation étouffé, bouche fermée.
Tout le monde me regarde. Il arrête. Dix minutes plus tard, il recommence.
Je lui plante mes ongles dans la main. C'est un combat silencieux, grotesque, en
plein opéra [Localité 3]. Wagner sur scène, le vieux pervers contre la gamine en
pantomime dans la salle.
[?]
C'est un ancien ministre de [O], membre de plusieurs gouvernements, qui a occupé
des fonctions régaliennes, qui est une grande figure de gauche, décoré de
l'Ordre national du mérite et de plusieurs autres Ordres européens. Une statue
vivante. La représentation recommence, je suis tranquille, mais je n'arrive pas
à me concentrer sur la mort des Dieux
et les vocalises de la cantatrice. »
- le 19 octobre 2017, dans un article intitulé « [D] [T], fille d'[W] [L],
accuse l'ex-ministre [S] [M] d'agression sexuelle », sur le site www.lexpress.fr,
à l'adresse https://www.lexpress.[04].html :
« Au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse. Je me dis
qu'il doit être très âgé, perturbé. Je le repousse gentiment. Il recommence.
Rebelote. Une troisième fois. Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main
à l'intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe. J'enlève sa main plus
fermement et je pousse un cri d'indignation, étouffé, bouche fermée. Tout le
monde me regarde. Il arrête. Dix minutes plus tard, il recommence. Je lui plante
mes ongles dans la main. C'est un combat silencieux, grotesque, en plein opéra
[Localité 3]. »
[?]
« Je ne voulais pas qu'on commence à soupçonner tous les anciens ministres de
[P] [O], alors j'ai donné des indices précis, mais j'ai eu peur de donner son
nom, peur de mettre en cause un homme très respecté, qui a occupé les plus
hautes fonctions de l'État... En même temps, j'ai vu toutes mes amies qui ont
subi des agressions témoigner, et je ne veux pas être la seule qui se taise par
lâcheté. D'autant que c'est l'agression qui m'a le plus sidérée, parce que je
savais que je n'y étais absolument pour rien. »
2. Le 10 janvier 2018, M. [M] a assigné Mme [L] en diffamation sur le fondement
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
R
EPONSE
COUR
6. Il résulte des articles 10 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 29, alinéa
1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que la liberté
d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles
constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.
7. En matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était
de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci
s'est exprimé dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est
appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans
l'expression, de rechercher, en application du paragraphe 2 du premier de ces
textes, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si
lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une
base factuelle suffisante.
8. La cour d'appel a énoncé que, si les propos litigieux portaient atteinte à
l'honneur ou à la considération de M. [M], ils s'inscrivaient dans un débat
d'intérêt général consécutif à la libération de la parole des femmes à la suite
de l'affaire [H].
9. Elle a relevé, au vu des pièces produites par Mme [L], que les parties
avaient assisté le 25 mars 2010 à une représentation de l'Or du Rhin à l'Opéra
[Localité 3] et étaient assises à côté l'une de l'autre, qu'après la soirée, Mme
[L] avait confié avoir subi une agression à plusieurs personnes de son
entourage, à savoir ses parents, son compagnon et un ami, que son compagnon et
sa mère avaient contribué à la dissuader de déposer plainte et qu'une expertise
psychiatrique amiable, effectuée huit ans après les faits dénoncés, ne faisait
état d'aucune pathologie mentale qui aurait pu affecter la crédibilité des propos.
10. Elle a retenu souverainement que, si Mme [L] avait commis des erreurs de
fait dans son récit quant à l'opéra représenté et à l'existence d'un entracte,
ces erreurs, qu'elle avaient reconnues, n'étaient pas de nature à discréditer
l'ensemble de ses propos dès lors qu'elle les exprimait plus de sept ans et demi
après les faits et que cette durée faisait également obstacle à la recherche de
témoins directs.
11. Sans méconnaître son office, elle en a déduit, à bon droit, abstraction
faite de motifs justement critiqués par les première et quatrième branches mais
surabondants, que les propos incriminés reposaient sur une base factuelle
suffisante et que, compte tenu du contexte dans lequel ils avaient été tenus, le
bénéfice de la bonne foi devait être reconnu à Mme [L].
12. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 15 octobre 2019 Pourvoi N° 18-83.255 cassation
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme, 29 et 31 de loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
‟en ce que la cour d’appel a confirmé le
jugement ayant déclaré M. X... coupable de diffamation à l’encontre de M. Y...,
maire de Joeuf, citoyen chargé d’un mandat public et condamné M. X... à une amende de 2 000 euros avec sursis ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce
qu’il a retenu le caractère diffamatoire des propos, l’arrêt énonce notamment
que ceux-ci contiennent les imputations, visant la partie civile en sa qualité
de maire de la commune, d’un acte d’appropriation indue, susceptible de recevoir
la qualification pénale de vol commis, de surcroît, au détriment de personnes
âgées pouvant être vulnérables, et d’abus de pouvoir par un détenteur de
l’autorité publique ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la
cour d’appel, qui ne devait, pour déterminer le caractère diffamatoire des
propos poursuivis, prendre en considération ni le sujet d’intérêt général dont
ils pouvaient traiter, ni leur éventuelle base factuelle, a exactement apprécié
leur sens et leur portée et en a déduit à bon droit qu’ils contenaient
l’imputation de faits précis, susceptibles d’un débat sur la preuve de leur
vérité, et contraires à l’honneur ou à la considération de la personne visée ;
D’où il suit que le grief n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde
branche :
Vu les articles 10 de la Convention européenne
des droits de l’homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la liberté d’expression ne peut être
soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures
nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes ;
Attendu qu’il se déduit du deuxième de ces
textes que, si c’est au seul auteur d’imputations diffamatoires qui entend se
prévaloir de sa bonne foi d’établir les circonstances particulières qui
démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou
rejetée par les juges qu’autant qu’ils analysent les pièces produites par le
prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision ;
Attendu enfin que tout jugement ou arrêt doit
comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la
contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce
qu’il a refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt énonce que, si le
débat local entre les élus et les animateurs du site internet “laviede.fr” est
particulièrement virulent et marqué par la mise en cause récurrente de l’action
des élus locaux, aucune recherche sérieuse tenant à la nature de la convention
d’occupation liant les pensionnaires de la résidence pour personnes âgées et le
CCAS, à l’évolution législative et réglementaire affectant cette matière, aux
obligations incombant aux personnes morales de droit public et aux collectivités
territoriales n’a manifestement été menée, et que les propos de M. X... ne
reposent sur aucune base factuelle suffisante ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors
que, d’une part, le texte litigieux participait d’un débat d’intérêt général
relatif à l’exercice par le maire de ses responsabilités dans la gestion d’une
résidence pour personnes âgées, d’autre part, le prévenu, qui n’est pas un
professionnel de l’information, n’était pas tenu aux mêmes exigences
déontologiques qu’un journaliste, la cour d’appel, qui devait analyser
précisément les pièces produites par le prévenu au soutien de l’exception de
bonne foi, pièces qui avaient seulement été énumérées par les premiers juges en
tant qu’elles avaient été jointes à l’offre de preuve, afin d’apprécier, au vu
de ces pièces et de celles produites par la partie civile pour combattre cette
exception, et en considération de ce qui précède, la suffisance de la base factuelle, n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
LA BASE FACTUELLE DOIT ÊTRE ANTERIEURE ET NON PAS POSTERIEURE A LA DECLARATION POUR JUSTIFIER LA BONNE FOI
Un journaliste publié dans un
journal doit savoir faire la différence entre peine correctionnelle et peine criminelle, ne pas le faire = ABSENCE DE BONNE FOI
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 13 novembre 2024 Pourvoi n° 23-81.810 Cassation
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt
doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur
absence.
7. Pour rejeter l'existence d'une faute civile commise par les
prévenus, en raison de leur bonne foi, s'agissant des propos poursuivis selon
lesquels la partie civile avait été condamnée du chef de complicité de tentative
de meurtre, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés,
après avoir retenu que lesdits propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt
général, qu'aux termes du jugement rendu le 2 mars 2011 par le tribunal
correctionnel de Bobigny, M. [I] [G] a été déclaré coupable du chef
d'arrestation, enlèvement ou détention arbitraire suivi d'une libération avant
le septième jour et condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, décision
que la cour d'appel a confirmée sur la culpabilité, réduisant toutefois
l'emprisonnement ferme à deux années, le surplus étant assorti d'un sursis.
8. Les juges ajoutent que M. [I] [G] a pu se rendre compte de l'état
d'énervement des frères [G] vis-à-vis de la victime qui a été contrainte de
monter avec eux en voiture et qui, après avoir été frappée violemment dans les
bois, ne pouvait qu'être à nouveau contrainte de remonter dans la voiture pour
être emmenée dans celle de M. [N] [G], considérant ainsi qu'il était établi que
M. [I] [G] avait volontairement empêché la victime d'aller et venir.
9.
Ils observent, dès lors, que si M. [I] [G] n'a pas été déclaré coupable
de complicité de meurtre, comme l'a retenu l'article, il a été condamné pour des
faits d'une extrême gravité au cours desquels un homme, qui a légitimement pu
craindre pour sa vie, ayant été menacé d'être brûlé vif, a subi des violences
graves et n'a dû son salut qu'à la fuite.
10. Ils en concluent
que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'erreur dans la
qualification des faits, commise par un non-juriste, ne pouvait suffire à ôter
sa pertinence à la base factuelle, l'auteur de l'article, dénué d'animosité
personnelle, ayant, par ailleurs, fait preuve de mesure dans l'expression en
reprenant essentiellement des éléments de fait sur lesquels s'appuient les
motifs de deux décisions de justice.
11. En se
déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. En effet, aux termes du jugement et de l'arrêt, produits au soutien de
l'exception de bonne foi, les prévenus, qui devaient procéder à une
enquête sérieuse en leur qualité de professionnels de l'information, ne
disposaient d'aucune base factuelle pour affirmer à trois reprises, dans
l'article litigieux, que la partie civile avait été condamnée pour complicité de
tentative de meurtre, faits criminels relevant de la cour d'assises, faute pour
les décisions susvisées de l'évoquer de quelque manière que ce soit.
13. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres griefs.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 3 novembre 2020 Pourvoi n° 19-84.700 Cassation partielle
Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
20. Il résulte du premier de ces textes que la
bonne foi du prévenu ne peut être déduite ni de faits postérieurs à la diffusion
des propos litigieux, ni de pièces établies postérieurement à celle-ci, sauf le
cas d’attestations rapportant des faits antérieurs et établissant que le prévenu
en avait connaissance au moment de cette diffusion.
21. Tout jugement ou arrêt doit comporter les
motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des
conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
22. Pour accorder au prévenu le bénéfice de la
bonne foi, l’arrêt, après avoir exactement énoncé que les éditoriaux litigieux
traitaient d’un sujet d’intérêt général, relatif à la gestion des fonds publics
dans le domaine de la santé et spécialement dans celui particulièrement sensible
de la dialyse à la Réunion, retient que les propos reposent sur une base
factuelle suffisante constituée, notamment, d’une lettre de l’association
nationale des patients du 8 novembre 2017 et d’un rapport d’observations
provisoires de la chambre régionale des comptes dont il ne précise pas la date
mais qui fait état de faits dont certains se seraient déroulés au cours de l’année 2018.
23. En se déterminant ainsi, alors que certains
des faits retenus au titre de la base factuelle étaient postérieurs à la
diffusion des propos, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
UN JOURNAL DOIT UTILISER SES MOYENS POUR CONTRÔLER LES PROPOS INJURIEUX SUR UN JOURNAL
: LA BONNE FOI
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 3 novembre 2015, pourvoi n° 13-82645 Cassation partielle sans renvoi
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui faisait valoir qu'il n'avait pas eu personnellement connaissance de l'existence du commentaire
litigieux, de sorte qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, sa responsabilité pénale ne pouvait
être engagée, l'arrêt retient notamment que, en sa qualité de directeur de la publication d'un service de communication en ligne mettant à la disposition du
public un espace de contributions personnelles, mais également la possibilité d'alerter en temps réel un service de modération sur le contenu des messages
déposés dans cet espace, M. X... avait été mis en mesure, dès les alertes postées par M. E..., d'exercer son devoir de surveillance sur ledit commentaire,
qui n'avait pour autant pas été retiré promptement ; que les juges ajoutent que le prévenu ne peut utilement se prévaloir, ni de ce que ladite fonction de
modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions régissant la responsabilité pénale des hébergeurs de site ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle
était saisie, la cour d'appel a fait l'exacte application du dernier alinéa de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 111-3 et 131-10 du code pénal, 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. X... et la peine d'amende, l'arrêt prononce, à titre de peine complémentaire,
la diffusion pendant quinze jours, par le service de communication au public par voie électronique du site " lefigaro. fr ", de cette décision par extraits ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 réprimant
l'infraction reprochée, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
L'AFFAIRE CLEARSTREAM COMMENTEE SUR CANAL +
LA BONNE FOI
Cour de Cassation Chambre civile 1 arrêt du 3 février 2011 Pourvoi n° 09-10301 CASSATION SANS RENVOI
Vu l'article10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881
Attendu que la chaîne de télévision Canal + a diffusé dans l'émission " 90 minutes ", le 1er mars 2001, un film documentaire intitulé
" Les dissimulateurs " réalisé par MM. X... et Z... ; que la société luxembourgeoise Clearstream banking visée par les investigations, estimant que certains passages
de l'émission portaient atteinte à son honneur et à sa considération, a fait assigner M. Y..., directeur de la publication de la chaîne de télévision, M.
X..., écrivain, et la société Canal + au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881
Attendu que pour relever le caractère diffamatoire des passages poursuivis du reportage « Les dissimulateurs »
et refuser le bénéfice
de la bonne foi à leur auteur, l'arrêt, après avoir admis que celui-ci avait poursuivi un but légitime en recherchant si la société Clearstream banking,
chambre de compensation internationale, offrait les garanties de transparence nécessaire et ne favorisait pas des transferts financiers frauduleux ou des
opérations de blanchiment, et qu'aucune animosité personnelle à l'égard de cette société n'était démontrée, retient que l'enquête réalisée ne conforte pas les
imputations litigieuses et que l'auteur s'est livré à des interprétations hasardeuses en assimilant les comptes non publiés à des comptes occultes servant
à enregistrer des transactions frauduleuses et en présentant la société Clearstream comme abritant une structure de dissimulation, tirant ses bénéfices
de sa complicité avec des entreprises criminelles et mafieuses
Qu'en statuant ainsi, quand l'intérêt général du sujet traité et le sérieux constaté de l'enquête, conduite par un journaliste
d'investigation, autorisaient les propos et les imputations litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES PEUVENT EXONERER LA TELEVISION
: LA BONNE FOI
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 28 février 2012 pourvoi n° 08-83926 08-83978 Cassation
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 septembre 2000, la chaîne de télévision France
2 a diffusé un reportage, commenté par M. X..., correspondant permanent de la
chaîne au Proche-Orient, et consacré aux affrontements entre Palestiniens et
Israéliens dans la bande de Gaza, reportage au cours duquel on pouvait voir un
Palestinien tentant de protéger son enfant de tirs qui, selon le commentateur,
provenaient de positions israéliennes et blessèrent mortellement cet enfant ;
que, les 22 et 26 novembre 2004, M. Y..., directeur d'une agence de notation des
médias, a diffusé sur son site internet et par voie électronique respectivement
un article et un communiqué de presse intitulés " France 2 : Mme Arlette Z...et
M. Charles X...doivent être démis de leurs fonctions immédiatement ", accusant
ces derniers d'avoir diffusé, le 30 septembre 2000, un " faux reportage, une
pure fiction comportant, en première partie, une série de scènes jouées "
Attendu qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la
société France 2 et de M. X...pour diffamation publique envers des particuliers,
M. Y...a été renvoyé de ce chef devant la tribunal correctionnel et déclaré
coupable ; que, sur appel de l'intéressé, la cour d'appel a, par arrêt avant
dire droit du 3 octobre 2007, ordonné un supplément d'information, et, par arrêt
du 21 mai 2008, débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe du prévenu
En cet état
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 3 octobre 2007 :
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, 35 et 55 de la loi du
29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2007) a ordonné, avant-dire droit,
un supplément d'information afin que la société France 2 transmette à la cour
d'appel les " rushes " pris le 30 septembre 2000 par son cameraman M. A... ;
" aux motifs que les débats ont fait apparaître la nécessité pour la cour de
visionner les images prises le 30 septembre 2000 à Gaza par M. A..., le cameraman de la société France 2 ;
" alors que, tant la preuve de la bonne foi que celle de la vérité du fait
diffamatoire incombant au seul prévenu selon les modalités prévues par la loi du
29 juillet 1881, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, au seul
vu des conclusions d'incident en désignation d'expert déposées par le prévenu
(se fondant sur une interview de MM. C...et D...postérieure à la parution des
écrits incriminés et soutenant que le journaliste M. X...avait menti en
prétendant que les rushes de la cassette présenteraient l'agonie du jeune
Mohamed E...et que la quasi-totalité de la cassette était constituée de scènes
de jeunes Palestiniens " jouant la guerre ", comme prétendu dans les écrits
incriminés), conclusions auxquelles s'opposaient, également par conclusions, les
parties civiles, ordonner d'office un supplément d'information afin que France 2
communique les " rushes " de la journée du 30 septembre 2000 pris dans la bande de Gaza par son cameraman
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881
Attendu qu'en matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe
cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l'établissement de celle-ci
Attendu que, pour ordonner, avant dire droit au fond, la communication, par la société France 2, des " rushes " du film de la journée du 30 septembre 2000,
pris par son cameraman, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé
Que, dès lors, la censure est encourue et entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 21 mai 2008.
LA COUR DE CASSATION APPLIQUE LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH EN MATIERE DE SUJET D'INTERÊT GENERAL
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 10 septembre 2013 Pourvoi n° 12-81990 cassation partielle
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que
dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ;
Attendu qu'après avoir relevé, à juste titre, le caractère diffamatoire des
propos dénoncés par la partie civile, l'arrêt, pour refuser le bénéfice de la
bonne foi au prévenu, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le passage incriminé relatif
au conflit israélo-palestinien dans la bande de Gaza, ne dépassait pas les
limites admissibles de la liberté d'expression sur le sujet d'intérêt général
constitué par le débat relatif à la couverture par la chaîne France 2, d'un
évènement ayant eu un retentissement mondial ainsi qu'à l'origine des blessures
présentées par M. Z..., la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à
nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet
l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
LA DIFFAMATION ORALE
L'affaire Michel Vauzelle
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 19 juin 2012 N° de pourvoi 11-84235 rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Michel X..., alors préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été cité directement devant le tribunal correctionnel par M. Michel Y..., président de cette région, du chef de
diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé pour certains propos mais l'a reconnu coupable
d'avoir diffamé la partie civile en tenant les propos suivants : " Je décerne un prix citron à tous les parangons et autres ayatollahs du statu quo qui se
sentent attaqués et déposent plainte. L'Etat a le droit de parler et que je sache aucun préfet ou sous-préfet n'a été accusé de détournement de fonds. Sur
le plan moral, nous sommes aussi valables que d'autres " ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il juge diffamatoires les propos susvisés, l'arrêt, pour
confirmer le refus d'accorder le bénéfice de la bonne foi au prévenu, retient que M. X..., en sa qualité de préfet de Région, représentant au niveau régional
du pouvoir exécutif, n'est pas un membre élu de ce pouvoir mais un agent de haut rang de l'Etat et ne saurait, dans le respect de la neutralité devant s'attacher
à l'exercice de sa mission républicaine, se prévaloir de l'outrance permise dans le débat politique ; que les juges ajoutent qu'au contraire, son éminente
qualité, lors de l'intervention au cours de laquelle il a tenu les propos incriminés, lui imposait mesure, retenue et prudence dans l'expression libre de
ses propos publics de manière à ne pas porter atteinte à la dignité et à l'honneur de quiconque ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées
dès lors que les propos en cause, même s'ils faisaient suite à un débat public, constituaient, par leur caractère outrancier, une attaque personnelle excédant les limites de la liberté
d'expression accordée à un membre du corps préfectoral tenu à une obligation de réserve, a justifié sa décision
LA DIFFAMATION DOIT CONCERNER UNE PERSONNE PHYSIQUE
OU MORALE
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 10 septembre 2013, pourvoi n° 11-86311 cassation sans renvoi
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler si les écrits ou discours poursuivis présentent les éléments légaux des délits de diffamation ou
injures publiques tels qu'ils sont définis par la loi qui les réprime ;
Attendu que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est constituée par un fait précis et déterminé portant atteinte à l'honneur et à la
considération d'une personne visée et que, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale, les appréciations, même excessives, touchant les
produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de diffamation publique envers des particuliers, l'arrêt retient que les passages litigieux visent directement
la société Le Trio et son cuisinier gérant M. Y..., parfaitement identifiés, et qu'à partir d'une référence historique à la vie du roi Louis VIII, mort d'une
dysenterie, ils leur imputent la mauvaise qualité des denrées consommées dans l'établissement, et ses conséquences sur la santé des clients, ce qui
caractérise des allégations portant atteinte à leur honneur et à leur considération ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les appréciations litigieuses ne mettaient en cause aucune personne physique ou morale déterminée, mais
seulement la qualité des prestations d'une entreprise commerciale désignée sous l'enseigne Carte blanche, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans
renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
COUR DE CASSATION Chambre Criminelle Arrêt du 10 septembre 2013 pourvoi n° 12-83672 Rejet
Attendu que, pour renvoyer M. Y... des fins de la poursuite,
l'arrêt retient que le tract incriminé met en cause M. Z..., senior
vice-président et directeur juridique de Manpower Inc., auteur de l'enquête
interne, et dénonce le traitement par la société mère des relations
contractuelles existant entre sa filiale française et la société Netfective,
mais ne vise pas directement Mme X... et la société Manpower France ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement
apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et a, à bon droit, retenu
qu'ils ne comportaient pas, de la part de M. Y..., d'imputations diffamatoires à l'égard des parties civiles, a justifié sa décision
ARTICLE 30
La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les
cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps
constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 25 février 2014 pourvoi n° 12-88.172 Rejet
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que la commune d’X... a fait citer, du chef de diffamation envers un corps constitué prévue par l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881, M. Y...,
en raison d’un article intitulé : “[…]” dénonçant de prétendues pratiques de surveillance de la population imputées au maire et au service municipal “[…]” ;
que le prévenu a soulevé la nullité de la citation en soutenant que l’article 30 de la loi précitée ne visait pas les communes, municipalités ou services
municipaux ; que le tribunal a rejeté cette exception, a déclaré le prévenu coupable du délit reproché et a statué sur la peine ainsi que sur les intérêts
civils ; que le prévenu puis le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement;
Attendu que les juges du second degré, après avoir approuvé le tribunal en ce qu’il avait considéré que la commune était un corps constitué
au sens de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881, relèvent, pour annuler la citation, que seuls le maire et des personnes physiques identifiables étaient
visés par les propos incriminés ;
Attendu que, si c’est à tort que la cour d’appel a prononcé la nullité de la citation, alors qu’en matière d’infraction à la loi sur la
liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l’acte initial des poursuites, et que
toute erreur sur ce point, qu’il appartient aux juges de relever d’office, est dénuée d’effet sur la validité dudit acte, mais fait obstacle à la condamnation,
l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les faits objet de la citation ont été exactement qualifiés,
au terme d’un débat contradictoire, de diffamation envers des citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public.
ARTICLE 31
Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à
raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du
ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des
cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après.
JURISPRUDENCE
LES ETATS FRANÇAIS OU ETRANGERS NE PEUVENT PAS POURSUIVRE POUR DIFFAMATION
Cour de Cassation chambre plénière, arrêt du 17 décembre 2018, pourvoi n° 18-82737 QPC non lieu à renvoi
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 29, alinéa 1er, 30, 31, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 48, 1°, 3° et 6° de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, desquelles il résulte qu’à la différence de l’Etat français qui, notamment par l’intermédiaire de ses
ministres, peut engager des poursuites en diffamation sur le fondement des articles 30 et 31 susvisés en cas d’atteinte portée à sa réputation résultant de
propos attentatoires à l’honneur ou à la considération de ses institutions, corps constitués, administrations publiques ou représentants en raison de leurs
fonctions, un Etat étranger n’est pas admis à engager une telle action en cas d’atteinte portée à sa réputation par les mêmes moyens, faute de pouvoir agir
sur le fondement des articles 30 et 31 de la loi susvisée et faute de pouvoir être assimilé à un particulier au sens de son article 32, alinéa 1er,
instituent-elles une différence de traitement injustifiée entre l’Etat français et les Etats étrangers dans l’exercice du droit à un recours juridictionnel et
méconnaissent-elles par conséquent le principe d’égalité devant la justice, tel qu’il est garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen ?»
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige et qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil
constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu qu’il ne résulte pas des textes invoqués une différence de traitement entre l’État français et les États
étrangers, qui ne peuvent agir ni l’un ni les autres sur leur fondement ;
D’où il suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
RENVOIE à l’audience du 12 avril 2019 l’examen du pourvoi au fond ;
UN MAIRE QUI AGIT EN SON NOM N'A PAS BESOIN D'UNE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 1er décembre 2015, pourvoi n° 14-86516 cassation
Vu les articles 31 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon le dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, en cas de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, la
poursuite peut être exercée à la requête de la partie lésée, sans qu'il soit besoin d'une délibération ou d'un mandat du corps auquel elle appartient pour agir ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., agissant, selon l'acte, en sa qualité de maire de la commune de
Saint-Quay-Portrieux, a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Michel Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat
public, au visa des articles 29 alinéa 1, 31 alinéa 1, 30 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la publication sur le blog
"sant-ke-portrieux.blogpost.com" d'un texte intitulé "Plus dure sera la chute...", lui imputant des comportements frauduleux et des pratiques occultes
dans la gestion de la commune ; que le tribunal l'ayant déclaré coupable à raison de l'une des allégations litigieuses, M. Y... a relevé appel de cette
décision, ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la partie civile, et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt retient que, la citation
mentionnant que M. X... agit en sa qualité de maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux, domicilié à la mairie, il s'en déduit que c'est en qualité
de représentant de la commune qu'il a saisi le tribunal, et qu'en l'absence de délégation de pouvoir du conseil municipal pour agir en justice, son action n'est pas recevable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'acte initial de la poursuite qualifiait les faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un
mandat public, visait l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, renvoyait à l'article 30 pour les pénalités applicables, et mentionnait la qualité de maire
du plaignant à seule fin de justifier la qualification retenue dans la poursuite, qui n'était pas intentée au nom de la commune, et qui n'était pas
subordonnée à une délibération ou un mandat du conseil municipal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, et le principe ci-dessus rappelé
LE REPROCHE PERSONNEL A UN MAIRE QUI N'AGIT PAS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS N'EST PAS PUNISSABLE
PAR L'ARTICLE 31
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 15 décembre 2015 Pourvoi n° 14-85118 cassation sans renvoi
Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés, et de vérifier si dans les
propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des
qualités qu'il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les ont inspirées ou le but recherché par leur auteur,
mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la
fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Michel D..., maire de la commune de Lège-Cap Ferret, a fait citer directement
devant le tribunal correctionnel M. X..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir publiquement tenu à son
encontre les propos suivants : « fils de crapule, le maire est une crapule, il est où le maire que je l'étrangle, D... assassin, incendiaire, voleur, vous
n'êtes que des merdes, des sous-merdes, retournez en Corse, il faut leur tirer dessus et ne pas être lâche comme en 40, il faut les dénoncer, il faut les
étrangler » ; que, faisant droit à une exception présentée par le prévenu, le tribunal a prononcé l'annulation de la citation ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour annuler le jugement, évoquer, et retenir le prévenu dans les liens de la prévention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en retenant notamment que les propos litigieux, qui s'inscrivaient dans un contentieux lourd et ancien entre M. X...
et M. D..., faisaient référence précisément à un incendie, survenu quelques jours auparavant, d'un hangar appartenant au premier nommé, qui en imputait la
responsabilité au second, alors que le fait imputé ne constituait ni un acte, ni un abus de la fonction du maire, et se trouvait dépourvu de tout lien avec
ladite fonction, la diffamation ne concernant que le particulier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que
le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
ARTICLE 32
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12000 euros.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur
sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l'article 131-5-1 du code pénal.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 6 mars 2018, Pourvoi n° 17-80526 rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que la société Biotope Une Libellule a
fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Paris, par acte du 19 septembre 2013, M. Hervé X... et Mme E... B... des chefs de
diffamation publique envers un particulier et complicité, ainsi que la société Médiapart, en qualité de civilement responsable, en raison de la mise en ligne,
le 27 juin 2013, sur le site http://www.mediapart.fr/, d'un article intitulé "Notre-Dame-des-Landes : et s'il fallait tout recommencer ?"
écrit par Mme B... et dont la partie civile considérait quatorze passages comme attentatoires à son honneur et à sa considération ;
Que les passages en cause étaient décrits comme suit :
1° "le bureau d'études Biotope est soupçonné de détournement d'emplois jeunes"
2° "Un jeune sous-traitant employé par une agence de voyages de façade"
3° "Ces révélations mettent en doute la rigueur des études préalables au projet"
4° "Mardi 18 juin, la société a été entendue par le tribunal des prud'hommes de
Nantes à la demande d'un ancien collaborateur Bertrand C..."
5° "Or c'est Bertrand C... qui était responsable pour Biotope du rapport sur l'état initial du site"
6° "Pour Bertrand C..., qui est aujourd'hui à la tête d'un bureau d'études : "On
a confié un dossier aussi complexe et aussi sensible à un emploi jeune dans une agence de voyages !"
7° "L'objet officiel de l'association VIAS était en effet l'organisation de voyages d'études de la nature et la réalisation d'études."
8° "Pour Bertrand C..., le montage des emplois jeunes "ne signifie pas que le travail a été mal fait, mais crée une suspicion certaine sur la rigueur et
l'honnêteté du travail mené dans le cadre de la réalisation des dossiers réglementaires liés au projet d'aéroport". Pour autant, il ne pense pas avoir
bâclé sa tâche, ne se souvient pas avoir manqué de temps. Pour l'état initial, quatre autres personnes de Biotope ont collaboré au rapport sur d'autres sujets
(habitat, flore, amphibiens...)"
9° "Mais c'est logique, l'objet de VIAS est de faire des voyages : vous imaginez dire à l'acheteur public que pour ce qui a été fait dans le cadre de ce marché
public l'est par une association qui fait des voyages ?" a affirmé Franck-Olivier D..., l'avocat de Bertrand C... devant les juges. Pour lui: "Notre-Dame-des-Landes
a été étudié avec un sous-traitant non homologué par la commande publique ", De son côté, Frédéric A... assure que "tout est extrêmement carré du point de vue
contractuel sur ces sujets" et que cette affaire est "très simple juridiquement mais très chargée d'affect".
10° "Ces révélations mettent en doute la rigueur des études préalables au transfert de l'aéroport. L'état initial du site a-t-il été réalisé en infraction
avec la loi? Si oui, peut-il encore être considéré comme valide, et comment vont réagir les pouvoirs publics ? La question est de nature juridique mais pas
seulement : c'est aussi un enjeu de confiance entre les parties dans un dossier aussi conflictuel et aussi contesté. Difficile d'accepter qu'un contrat de
concession d'environ 500 millions d'euros, signé pour 55 ans, se fonde sur une expertise élaborée dans des conditions douteuses."
11° "Les petits arrangements de Biotope avec les emplois jeunes sont d'autant
plus piquants que son patron, Frédéric A..., a participé au mouvement des "pigeons" ".
12° "Il l'a pensé si fort qu'il s'est retrouvé interviewé par le 20 heures de France 2 le 4 octobre, dans un reportage consacré à "ces créateurs d'entreprises
qui ont réussi à se faire entendre", comme le présente David Z.... "Des patrons en colère qui se sentent maltraités, mal aimés aujourd'hui en France, c'est le
cas de Frédéric A...", explique le reporter de France Télévision. On découvre alors à l'image le directeur général de Biotope, debout à côté d'une plante verte"
13° "Un ancien dirigeant de la société se souvient que l'expression maison pour parler de gestion du personnel était "GML ", pour "grand méchant loup ". Et
qu'un leitmotiv récurrent de fin de réunions était "TBE", pour "ton blé enculé !"
14° "Personne ne peul exclure qu'éclate un jour un scandale Enron de l'environnement." ;
Attendu que, par jugement du 5 février 2016, le tribunal correctionnel a donné acte à la partie civile de son désistement à l'égard des passages numérotés 7 et
12 dans la citation introductive d'instance et constaté par conséquent l'extinction des actions publique et civile à l'égard des prévenus en
application des dispositions de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que la partie civile a, seule, interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la partie civile et confirmer le
jugement dans la limite de l'appel dont elle était saisie, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'elle a à bon droit constaté que le désistement, non équivoque, de la partie civile dont il avait été donné acte
par jugement n'était plus susceptible de rétractation, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'en effet, dans le cas d'une poursuite introduite par un acte unique du plaignant incriminant, sous la même qualification, plusieurs propos tenus dans
le même article de presse, le désistement de la partie civile, même limité à certains des passages incriminés, emporte désistement de l'action en son entier,
l'acte initial de poursuite en matière de diffamation fixant de manière irrévocable la nature et l'étendue de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
LA PRESCRIPTION COMMENCE A COURIR DES LA MISE A DISPOSITION
DU PERIODIQUE
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 22 octobre 2013 N° de pourvoi 12-84272 REJET
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et
des pièces de la procédure que, par acte du 25 février 2011, M. X... et la
société Le Wafou brasserie ont fait citer M. Y... et la société Editions I et P,
sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir
publié, dans le numéro 42 du journal "Le Petit Impertinent", un article intitulé
"Le platane assassiné par le Wafou" qui comportait, selon eux, des propos
diffamatoires à leur égard ; que le tribunal ayant écarté l'exception de
prescription présentée par la défense et déclaré les prévenus coupables du délit
poursuivi, ceux-ci ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et dire l'action publique éteinte par la
prescription, l'arrêt retient que, si le numéro 42 du périodique visé par la
citation porte la mention "décembre 2010/janvier 2011", il a, en fait, été mis à
la disposition du public dès le 17 novembre 2010, ainsi que le démontrent les
bordereaux de livraison du journal à des points de vente différents et
l'attestation de l'imprimeur produits aux débats, et que cette date constitue le
point de départ du délai de trois mois fixé par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et
résultant de son appréciation souveraine des éléments de conviction soumis au
débat contradictoire, dont elle a déduit que les prévenus avaient rapporté la
preuve d'une date de publication effective du journal antérieure au premier jour
de la période considérée, la cour d'appel a justifié sa décision
IL FAUT QUE LA PERSONNE SOIT VISEE PRECISEMENT POUR QU'IL Y AIT DIFFAMATION
Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 16 janvier 2013 N° de pourvoi 12-15-547 REJET
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry 10 janvier 2012), que le 19 août 2010 le journal Le
Dauphiné libéré a publié un article intitulé "travail illégal dans une résidence de luxe" illustré
d’une photographie de M. X... ; que ce dernier a assigné la société éditrice du journal en réparation du préjudice subi du fait de la publication de son image
faite sans son autorisation et de l’atteinte à la réputation de son entreprise qui s’en est suivie
Attendu que la société Le Dauphiné libéré fait grief à l’arrêt d’écarter la mise en œuvre de la loi du 29 juillet 1881, partant
la nullité de l’assignation et en conséquence, de la condamner à indemniser M. X...
Mais attendu qu’analysant la teneur de l’article qu’illustrait la photographie litigieuse, la cour d’appel a constaté
que celui-ci ne mentionnait pas l’entreprise exploitée par M. X... ni ne lui imputait aucun des faits litigieux qu’il relatait ; qu’elle en a exactement
déduit que cet article ne revêtait pas un caractère diffamatoire à l’égard de l’intéressé ; que le moyen n’est pas fondé
Mais attendu que la cour d’appel, ayant relevé que M. X... avait été photographié sans son autorisation, en dehors de tout
événement d’actualité le concernant, en a exactement déduit que la diffusion de cette photographie, sur laquelle M. X... était reconnaissable, portait en raison de la teneur
de l’article qu’elle illustrait, une atteinte à sa personne que ne pouvait légitimer la liberté de communication des informations ; que le moyen n’est pas fondé
L'EXCUSE DE BONNE FOI EST INOPÉRANTE FACE UN NON LIEU OU UNE RELAXE
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 14 mars 2017 N° de pourvoi 16-80209 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à
la suite de la publication, le 13 juillet 2011, sur le site internet " www. telobs. nouvelobs. com ", d'un article intitulé " Z...et B...sur France 3 :
copinage et obstination " et contenant le passage suivant : " Quant à Cyril Z..., écarté il y a quinze ans de la cinquième (aujourd'hui France 5) pour une
affaire d'escroquerie, il signe son retour à la télé publique ", M. Z... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers
un particulier ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a renvoyé M. X..., directeur de publication, et Mme Y..., auteur de cet article, des chefs
susvisés devant le tribunal correctionnel, qui les a relaxés et a débouté M. Z... de ses demandes ; que la partie civile a, seule, relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour retenir le caractère diffamatoire du passage poursuivi, refuser aux intimés le bénéfice de la bonne foi et infirmer le jugement en ses
dispositions civiles, l'arrêt énonce que le texte visé par la prévention, qui relie sans nuance à une affaire d'escroquerie le fait que l'appelant a été
écarté de la télévision publique, suppose qu'une procédure judiciaire le mettant en cause a été à l'origine de la fin de sa collaboration avec le service public,
ce qui constitue un fait précis, susceptible d'un débat contradictoire, attentatoire à son honneur et à sa considération ; que les juges relèvent qu'en
omettant de rappeler la décision de non-lieu dont a bénéficié M. Z..., les intimés, diffusant une information tronquée, ont manqué de prudence dans l'expression ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, le passage incriminé laisse entendre que la partie civile a participé à des faits
pénalement répréhensibles, en omettant de préciser qu'elle a bénéficié d'une décision de non-lieu, d'autre part, la restriction apportée à la liberté
d'expression des prévenus est nécessaire pour faire respecter le principe de la présomption d'innocence affirmé tant par l'article 9 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui, à juste titre, a retenu le caractère
diffamatoire du passage incriminé et écarté le bénéfice de la bonne foi en raison du manque de prudence dans l'expression, a justifié sa décision sans
méconnaître les dispositions légales et stipulations conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
UNE PEINE AMNISTIEE EST AMNISTIEE POUR TOUS ET NE PEUT ÊTRE ÉVOQUÉE POUR JUSTIFIER DE LA BONNE FOI
Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 16 mai 2013 N° de pourvoi 11-28-252 Cassation
Vu l’article 10, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles 29 et 32 de
la loi du 29 juillet 1881
Attendu qu’en décembre 2009 ont été mis en ligne sur plusieurs sites internet différents articles diffusant une ancienne coupure
de presse du journal « Le Petit Varois » du 11 novembre 1965 relatant et précisant que les deux jeunes gens ayant « tenu la vedette »
étaient « les nommés X... Patrick et A... Alain à qui le soleil a un peu tourné la tête » ; que dans le numéro de Var Matin daté
du 5 décembre 2009 a été publié un article faisant état de ces informations circulant sur le Web, intitulé « Buzz autour de l’été varois agité de
X... et A... en 1965, sous titré « Web les aventures de deux jeunes parisiens en goguette avaient défrayé la chronique » dans lequel il est expliqué que « les deux
compères s’étaient fait remarquer durant ce fameux été 1965 pour une affaire de siphonnage et
plusieurs vols » et qu’ils avaient été condamnés par le tribunal correctionnel à un an de prison avec sursis et trois ans de mise à l’épreuve
Attendu, cependant, que si la circonstance que les écrits incriminés ont eu pour objet de porter à la connaissance du public
les agissements dans leur jeunesse de deux hommes politiques peut justifier, en cas de bonne foi de leur auteur, la diffamation, il ne saurait en être ainsi,
sauf à violer les textes précités, lorsqu’elle consiste dans le rappel de condamnations amnistiées, lequel est interdit sous peine de sanction pénale
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés
UN ETAT NE PEUT PAS INVOQUER L'ARTICLE 32 - IL N'EST PAS UNE PERSONNE PRIVEE
TROIS ARRÊTS DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION CONTRE LE MAROC :
L’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être
assimilé à un particulier au sens de ce texte, d’engager une poursuite en diffamation.
En droit interne, la liberté d’expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à son
exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (pourvoi n° 18-82.737).
A la supposer invocable, il ne résulte pas de l’article 8 de ladite Convention qu’un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter
l’exercice de cette liberté (pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les organes
de la Convention peuvent créer, par voie d’interprétation de son article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n’a aucune base légale dans l’Etat
concerné (pourvois n°s 17-84.509 et 17-84.511).
Ainsi, il n’existe aucun droit substantiel, dont le droit processuel devrait permettre l’exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer
l’effectivité.
En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d’une diffamation, ne peut agir en réparation du préjudice qui en résulterait.
Cour de cassation Assemblée Plénière arrêt du 10 mai 2019 N° de pourvoi 18-82737 Rejet
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, le
26 février 2015, le Royaume du Maroc, représenté par son ministre de
l’intérieur, a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel de Paris du
chef de diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des
articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse et de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982 sur la communication audiovisuelle, en raison de propos tenus en direct, le
11 janvier 2015, sur les chaînes de télévision I-Télé et BFM ; que le tribunal
de grande instance de Paris l’ayant déclaré irrecevable en son action au motif
qu’il ne saurait être assimilé à un particulier au sens de l’article 32, alinéa
1er, précité, le Royaume du Maroc a formé appel de cette décision ;
Attendu que le Royaume du Maroc fait grief à
l’arrêt de le déclarer irrecevable en son action du chef de diffamation publique
envers un particulier, en violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 8, 13 et 14 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 31,
32 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale,
alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions combinées des
articles 29, alinéa 1er, 30, 31, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 48, 1°, 3° et 6°
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, desquelles il résulte
qu’à la différence de l’Etat français qui, notamment par l’intermédiaire de ses
ministres, peut engager des poursuites en diffamation sur le fondement des
articles 30 et 31 susvisés en cas d’atteinte portée à sa réputation résultant de
propos attentatoires à l’honneur ou à la considération de ses institutions,
corps constitués, administrations publiques ou représentants en raison de leurs
fonctions, un Etat étranger n’est pas admis à engager une telle action en cas
d’atteinte portée à sa réputation par les mêmes moyens, faute de pouvoir agir
sur le fondement des articles 30 et 31 de la loi susvisée et faute de pouvoir
être assimilé à un particulier au sens de son article 32, alinéa 1er, instituent
une différence de traitement injustifiée entre l’Etat français et les Etats
étrangers dans l’exercice du droit à un recours juridictionnel et méconnaissent
par conséquent le principe d’égalité devant la justice, tel qu’il est garanti
par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
que consécutivement à la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra,
l’arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
2°/ que, selon les dispositions combinées
des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme,
toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause
soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu’il résulte en outre
de l’article 8 de cette Convention que les personnes morales ont droit à la
protection de leur réputation, droit par ailleurs reconnu aux Etats par le droit
international public ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l’action en
diffamation engagée sur le fondement de l’article 32, alinéa 2, de la loi du 29
juillet 1881 par le Royaume du Maroc à raison des propos estimés diffamatoires
que M. X... a tenus sur deux chaînes de télévision françaises envers la police
marocaine, lorsqu’à la différence de l’Etat français qui, dans la même
situation, aurait pu agir, par l’intermédiaire de son ministre de l’intérieur,
sur le fondement de l’article 30 de cette loi, le Royaume du Maroc ne dispose
d’aucune autre voie de recours lui permettant d’accéder à un juge pour qu’il
soit statué sur l’atteinte portée à sa réputation et, le cas échéant, sur la
réparation du préjudice en résultant, la cour d’appel a porté atteinte à la
substance même de son droit d’accès à un tribunal et l’a placé dans une
situation discriminatoire dans la jouissance de ce droit par rapport à l’Etat
français et aux autres personnes, physiques et morales, en violation des
dispositions conventionnelles visées au moyen ;
Mais attendu que le moyen, pris en sa première
branche, est devenu sans portée à la suite de l’arrêt de l’assemblée plénière de
cette Cour en date du 17 décembre 2018 disant n’y avoir lieu de renvoyer au
Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée
par le demandeur ;
Et attendu, d’abord, que l’article 32, alinéa
1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un
Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte,
d’engager une poursuite en diffamation sur le fondement de cette loi ;
Attendu ensuite, qu’en droit interne, la libre
communication des pensées et opinions est une liberté fondamentale qui garantit
le respect des autres droits et libertés, et que les atteintes portées à son
exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif
poursuivi (Cons. constit., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC) ; qu’il en est de même
au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de
l’homme, laquelle considère que la liberté d’expression constitue l’un des
fondements essentiels d’une société démocratique (CEDH, 7 décembre 1976,
Handyside c. Royaume-Uni, n° 5493/72 ; 14 février 2008, July et SARL Libération
c. France, n° 20893/03), de sorte qu’un Etat ne peut se prévaloir d’un droit à
la protection de sa réputation, résultant de l’article 8 de ladite Convention,
pour en limiter l’exercice (CEDH, 25 août 1998, Hertel c. Suisse, n° 25181/94 ;
25 juin 2002, Colombani et autres c. France, n° 51279/99 ; 22 octobre 2007,
Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, n°s 21279/02 et 36448/02) ; qu’en
conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d’une diffamation, ne peut
agir en réparation de son préjudice et que, dès lors, il n’existe aucun droit
substantiel dont le droit processuel devrait permettre l’exercice en organisant,
conformément à l’article 6, § 1, de la Convention précitée, un accès au juge de
nature à en assurer l’effectivité ;
D’où il suit qu’à supposer que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales puisse être invoquée, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Cour de cassation Assemblée Plénière arrêt du 10 mai 2019 N° de pourvoi 17-84509 Rejet
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que,
le 29 décembre 2015, le Royaume du Maroc, représenté par son ambassadeur en
France, a porté plainte et s’est constitué partie civile devant le doyen des
juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de
diffamation publique envers un particulier sur le fondement des articles 23, 29,
alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, contre Mme X..., directrice de publication du magazine [...], en qualité
d’auteur principal, M. Z... et Mme Y..., journalistes, en qualité de complices,
à la suite de la publication, dans l’édition du 1er octobre 2015 dudit magazine,
d’un article écrit par ces journalistes sous le titre “Une nouvelle affaire
marocaine ; Tu peux demander 2 millions d’euros”, dont plusieurs passages
étaient jugés diffamatoires par cet Etat ; qu’une information judiciaire a été
ouverte, le 12 mai 2016, de ce chef ; qu’un juge d’instruction ayant déclaré
irrecevable sa constitution de partie civile au motif qu’il ne saurait être
assimilé à un particulier au sens de l’article 32, alinéa 1er, de la loi
précitée, le Royaume du Maroc a formé appel de cette décision ;
Attendu que le Royaume du Maroc fait grief à
l’arrêt de déclarer irrecevable sa constitution de partie civile du chef de
diffamation publique envers un particulier, en violation des articles 2, 6, et
16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 13
et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 111-4 du code
pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors, selon le moyen :
1°/ qu’un Etat étranger, personne morale
étrangère de droit public, est un particulier au sens de l’article 32, alinéa
1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer le
Royaume du Maroc irrecevable en sa constitution de partie civile, qu’il ne
pouvait bénéficier des dispositions de ce texte, la chambre de l’instruction en
a méconnu le sens et la portée ;
2°/ que, selon les dispositions combinées
des articles 6, § 1, et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme,
toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause
soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu’en jugeant que le
Royaume du Maroc était irrecevable à agir au titre de l’article 32, alinéa 1er,
de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu’il n’existe aucun autre fondement
permettant à un Etat étranger qui se prétend victime de diffamation publique
d’accéder à un juge pour obtenir réparation de son préjudice, la chambre de
l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
3°/ que, si les dispositions des articles
29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 doivent être
interprétées comme excluant qu’un Etat étranger, personne morale étrangère de
droit public, puisse se prétendre victime de diffamation commise envers les
particuliers, elles méconnaissent le droit au recours juridictionnel effectif,
le principe d’égalité devant la justice et le droit constitutionnel à la
protection de la réputation qui découle de la liberté personnelle, tels qu’ils
sont respectivement garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen ; que consécutivement à la déclaration
d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouvera privé de
base légale ;
Mais attendu, d’abord, que l’article 32, alinéa
1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un
Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte,
d’engager une poursuite en diffamation sur le fondement de cette loi ;
Attendu, ensuite, que, selon la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 21 février 1986, James et autres
c. Royaume-Uni, n° 8793/79, § 81 ; CEDH, 14 septembre 2017, Károly Nagy c.
Hongrie [GC], n° 56665/09), les organes de la Convention ne peuvent pas créer,
par voie d’interprétation de son article 6, § 1, un droit matériel de caractère
civil qui n’a aucune base légale dans l’Etat concerné ; qu’en conséquence, aucun
Etat, qui soutient être victime d’une diffamation, ne peut agir en réparation de
son préjudice et que, dès lors, il n’existe aucun droit substantiel dont le
droit processuel devrait permettre l’exercice en organisant, conformément à
l’article 6, § 1, précité, un accès au juge de nature à en assurer
l’effectivité ;
Attendu, enfin, que le moyen, pris en sa
troisième branche, est devenu sans portée à la suite de l’arrêt de cette Cour en
date du 27 mars 2018, disant n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le
demandeur ;
D’où il suit qu’à supposer que la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisse être
invoquée, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Cour de cassation Assemblée Plénière arrêt du 10 mai 2019 N° de pourvoi 17-84511 Rejet
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, le
29 décembre 2015, le Royaume du Maroc, représenté par son ambassadeur en France,
a porté plainte et s’est constitué partie civile devant le doyen des juges
d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de diffamation
publique envers un particulier, sur le fondement des articles 23, 29, alinéa
1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, contre Mme Z..., directrice générale de la société Calmann-Lévy, en
qualité d’auteur principal, M. Y... et Mme X..., épouse Y..., en qualité de
complices, à la suite de la publication par cette maison d’édition, au mois
d’octobre 2015, d’un ouvrage écrit par M. et Mme Y... sous le titre “L’Homme qui
voulait parler au roi”, dont plusieurs passages étaient jugés diffamatoires par
cet Etat ; qu’une information judiciaire a été ouverte, le 13 mai 2016, de ce
chef ; qu’un juge d’instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de
partie civile au motif qu’il ne saurait être assimilé à un particulier au sens
de l’article 32, alinéa 1er, de la loi précitée, le Royaume du Maroc a formé
appel de cette décision ;
Attendu que le Royaume du Maroc fait grief à
l’arrêt de déclarer irrecevable sa constitution de partie civile du chef de
diffamation publique envers un particulier, en violation des articles 2, 6, et
16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 13
et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 111-4 du code
pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors, selon le moyen :
1°/ qu’un Etat étranger, personne morale
étrangère de droit public, est un particulier au sens de l’article 32, alinéa
1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer le
Royaume du Maroc irrecevable en sa constitution de partie civile, qu’il ne
pouvait bénéficier des dispositions de ce texte, la chambre de l’instruction en
a méconnu le sens et la portée ;
2°/ que, selon les dispositions combinées
des articles 6, § 1, et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme,
toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause
soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu’en jugeant que le
Royaume du Maroc était irrecevable à agir au titre de l’article 32, alinéa 1er,
de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu’il n’existe aucun autre fondement
permettant à un Etat étranger qui se prétend victime de diffamation publique
d’accéder à un juge pour obtenir réparation de son préjudice, la chambre de
l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
3°/ que si les dispositions des articles 29,
alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 doivent être
interprétées comme excluant qu’un Etat étranger, personne morale étrangère de
droit public, puisse se prétendre victime de diffamation commise envers les
particuliers, elles méconnaissent le droit au recours juridictionnel effectif,
le principe d’égalité devant la justice et le droit constitutionnel à la
protection de la réputation qui découle de la liberté personnelle, tels qu’ils
sont respectivement garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen ; que consécutivement à la déclaration
d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
Mais attendu, d’abord, que l’article 32,
alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet
pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce
texte, d’engager une poursuite en diffamation sur le fondement de cette loi ;
Attendu, ensuite, que, selon la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 21 février 1986, James et
autres c. Royaume-Uni, n° 8793/79, § 81 ; CEDH, 14 septembre 2017, Károly Nagy
c. Hongrie [GC], n° 56665/09), les organes de la Convention ne peuvent pas
créer, par voie d’interprétation de son article 6, § 1, un droit matériel de
caractère civil qui n’a aucune base légale dans l’Etat concerné ; qu’en
conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d’une diffamation, ne peut
agir en réparation de son préjudice et que, dès lors, il n’existe aucun droit
substantiel dont le droit processuel devrait permettre l’exercice en organisant,
conformément à l’article 6, § 1, précité, un accès au juge de nature à en assurer l’effectivité ;
Attendu, enfin, que le moyen, pris en sa
troisième branche, est devenu sans portée à la suite de l’arrêt de cette Cour en
date du 27 mars 2018, disant n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le demandeur ;
D’où il suit qu’à supposer que la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisse être
invoquée, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
ARTICLE 33
L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros.
Sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'injure commise, par les mêmes moyens, envers une personne
ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise commise dans les mêmes conditions, envers une personne ou un groupe de personnes à raison
de leur sexe, de leur orientation sexuelle identité de genre ou de leur handicap.
Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième
alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont
portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les
troisième et quatrième alinéas, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l'article 131-5-1 du code pénal.
JURISPRUDENCE
Cour de cassation chambre criminelle, arrêt du 29 mars 2017, pourvoi n° 17-80149 cassation sans renvoi
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, et 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés
à l'article 23 de la loi susvisée sur la liberté de la presse, contre une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité
publique à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, n'entrent pas dans les prévisions de
l'article 433-5 du code pénal incriminant l'outrage, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage à personne
dépositaire de l'autorité publique pour avoir tenu des propos visant M. Z..., brigadier de police, à l'occasion d'une conférence de presse qu'il avait
organisée afin de critiquer publiquement, en sa qualité d'avocat, une opération de police intervenue la veille, à laquelle ce brigadier avait participé ; que
ces paroles, prononcées en présence de policiers, ont été rapportées à l'intéressé par son supérieur et un de ses collègues ; que le ministère public a
relevé appel du jugement ayant renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt retient qu'en affirmant " le Z...,
on aura sa tête ", le prévenu n'a pas simplement entendu contester la régularité des actes de procédure établis par le brigadier de police, mais a voulu porter
publiquement, devant des personnes assemblées et des journalistes, une atteinte personnelle à son autorité morale et diminuer le respect dû à sa fonction ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les propos incriminés n'avaient pas été adressés à la personne
dépositaire de l'autorité publique visée, mais prononcés lors d'une conférence de presse publique, hors la présence de celle-ci, et sans qu'il soit établi que
le prévenu ait voulu qu'ils lui soient rapportés par une personne présente, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet
l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
ARTICLE 34
Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces
diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou
légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l'article 13.
ARTICLE 35
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires,
dans le cas d'imputations
contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle,
commerciale ou financière, dont les titres financiers sont admis aux négociations
sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée,
sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne.
Le troisième alinéa du présent article ne s'applique pas
lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et
227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La
preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est
rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites
commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite
et au jugement du délit de diffamation.
JURISPRUDENCE
RAPPELER UNE CONDAMNATION AMNISTIÉE EST POURSUIVIE
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 3 novembre 2015 Pourvoi N° 14-83419 irrecevabilité
Vu les articles 15, alinéa 3, de la loi du 6 août 2002 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée est punie d'une peine d'amende de 5 000 euros ;
Attendu que, si, en application du second de ces textes, et après abrogation par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-319 QPC du 7 juin 2013, du
paragraphe c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité des faits diffamatoires peut à présent être prouvée lorsque l'imputation se réfère à un
fait constituant une infraction amnistiée, cette preuve ne peut être rapportée lorsque l'imputation consiste dans le rappel de la condamnation amnistiée elle-même ;
Attendu que, pour admettre la preuve de la vérité du fait diffamatoire, et débouter la partie civile, l'arrêt retient que le prévenu produit le jugement de
la condamnation, dont le propos litigieux faisait état, prononcée le 15 septembre 2006 contre le Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes, à la
peine de 1 500 euros d'amende avec sursis pour recel de violation du secret professionnel, et qu'il résulte de ce jugement que ledit conseil a été reconnu
coupable d'avoir adressé au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris une lettre qui ne pouvait être acheminée sans méconnaître le secret professionnel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et en admettant, à titre de fait justificatif, la preuve de la vérité de l'imputation d'une condamnation
amnistiée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
AFFAIRE BETTENCOURT UNE CONVERSATION PRIVEE NE PEUT ETRE PUBLIEE DANS LA PRESSE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 6 octobre 2011 Pourvoi N° 10-21.822 Cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le magazine
Le Point a publié dans son édition du 17 juin 2010 un article de M.Z..., intitulé “Les enregistrements secrets du Maître d’hôtel”, qui avait comme sous
titre “Affaire Y.... Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence “et dont il ressortait
que le maître d’hôtel de Mme Y... avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, capté les conversations tenues dans la salle de l’hôtel particulier de Neuilly sur
Seine où Mme Y... tenait “ses réunions d’affaires” avec certains de ses proches, dont M.B... chargé de la gestion de sa fortune ; que cet article fut suivi le
1er juillet, d’autres articles publiés tant dans l’hebdomadaire que sur le site internet du magazine
Le Point ; que M.B... a assigné en référé la société d’exploitation du magazine Le Point, MM. A...,
directeur de la publication, et Z..., journaliste, pour voir ordonner le retrait du site de tout ou partie de la
transcription des enregistrements réalisés au domicile de Mme Y..., l’interdiction de toute nouvelle publication de ces retranscriptions et la
publication d’un communiqué judiciaire
Sur le premier moyen :
Vu l’article 566 du code de procédure civile
Attendu que pour déclarer irrecevables certaines des prétentions de Mme Y..., la cour d’appel a énoncé que celles ci, relatives à
la publication les 24 juin et 1er juillet 2010 d’autres extraits des enregistrements formant des actes de publication distincts ayant trait à des contenus différents de ceux analysés,
constituaient des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile
Qu’en statuant ainsi, quand ces demandes issues des mêmes enregistrements tendaient aux mêmes fins et constituaient le
complément de celles dont avait été saisi le premier juge, compte tenu de l’évolution des circonstances de fait, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé
Et sur le second moyen
Vu les articles 226 1 et 226 2 du code pénal, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., tirées de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué
par la publication d’enregistrements réalisés à son insu à son domicile de conversations privées et du dommage imminent susceptible de lui être causé,
l’arrêt énonce que l’article 226 2 du code pénal prend place au chapitre VI intitulé “Des atteintes à la personnalité” et à la première section de ce chapitre qui traite
exclusivement, “De l’atteinte à la vie privée”, que sauf à se méprendre sur la portée de ces dispositions qui, définissant une infraction pénale, ne peuvent
qu’être strictement interprétées, l’article 226 2 n’englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectués sans le consentement de
l’auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent “atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui” ; que l’arrêt ajoute que les entretiens
litigieux portent sur les rapports entre Mme Y..., MM. C...et B..., sur les libéralités consenties par cette dernière et sur la gestion patrimoniale et financière dont
M.B... rendait compte à Mme Y..., que les propos litigieux sont, dans leur ensemble, de nature professionnelle et patrimoniale et rendent compte des relations que Mme Y...
pouvait entretenir avec celui qui gérait sa fortune et que les informations ainsi révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l’un des premiers
groupes industriels français, dont l’activité et les libéralités font l’objet de très nombreux commentaires publics, relèvent de la légitime information du public
Attendu cependant que constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du
public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; d’où il suit qu’en statuant
comme elle l’a fait, quand il ressort de ses propres constatations que les entretiens litigieux présentaient un tel caractère, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 6 octobre 2011 Pourvoi N° 10-21.823 Cassation
Attendu que le journal en ligne Médiapart dont M. B... est le directeur de la publication, a diffusé les 14, 16, 17 et 21 juin 2010, sur son site, un article intitulé “C..., D..., fraude fiscale : les secrets
volés de l’affaire Y...”, sous la signature de MM. Z... et A..., dans lequel il était relaté que le maître d’hôtel de Mme Y... avait,
une année durant, à partir du mois de mai 2009, décidé de “piéger la milliardaire et son entourage” en captant les propos échangés dans la salle de
son hôtel particulier de Neuilly sur Seine où elle tenait “ses réunions d’affaires” avec certains de ses proches, parmi lesquels M. E..., chargé de la gestion de sa fortune ;
que l’article diffusé par Médiapart a repris certains des propos échangés en les regroupant en quatre “actes” intitulés “les interférences de l’Elysée”, “les relations avec E... et
F... D...”, “les comptes suisses secrets” et “la succession de L... Y...” ; que d’autres extraits ou verbatims furent mis en ligne les 16, 17 et 21 juin suivants sous les
titres “Madame D...”, “On lui donnera de l’argent parce que c’est trop dangereux”, “Affaire Y...” “J’ai peur que le fisc tire un fil” et “Trois chèques, trois questions” ; que
Mme Y... a assigné en référé la société Médiapart, MM. B..., Z... et A... pour voir ordonner le retrait du site de la société
Médiapart de tout ou partie de la transcription des enregistrements réalisés à son domicile et désigner un séquestre chargé de se faire remettre la totalité des supports
d’enregistrements clandestins
Sur le premier moyen :
Vu l’article 566 du code de procédure civile
Attendu que pour déclarer irrecevables certaines des prétentions de Mme Y..., la cour d’appel a énoncé que celles ci, relatives à
la publication les 24 et 28 juin 2010 d’autres extraits des enregistrements, formant des actes de publication distincts ayant trait à des contenus différents
de ceux analysés, constituaient des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Qu’en statuant ainsi, quand ces demandes issues des mêmes enregistrements tendaient aux mêmes fins et constituaient le complément de
celles dont avait été saisi le premier juge, compte tenu de l’évolution des circonstances de fait, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé
Et sur le second moyen :
Vu les articles 226 1 et 226 2 du code pénal, ensemble l’article 809 du code de procédure civile
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., tirées de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué
par la publication d’enregistrements réalisés à son insu à son domicile de conversations privées et du dommage imminent susceptible de lui être causé,
l’arrêt énonce que l’article 226 2 du code pénal prend place au chapitre VI intitulé “Des atteintes à la personnalité” et à la première section de ce chapitre qui traite
exclusivement, “De l’atteinte à la vie privée”, que sauf à se méprendre sur la portée des ces dispositions qui, définissant une infraction pénale, ne peuvent
qu’être strictement interprétées, l’article 226 2 n’englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectué sans le consentement de
l’auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ; que l’arrêt ajoute que les entretiens litigieux
concernent principalement la gestion du patrimoine de Mme Y... que les liens qu’elle entretient sont de nature professionnelle pour M. E... et exclusivement
patrimoniale pour Mme Y... et que les informations ainsi révélées mettant en cause la principale actionnaire de l’un des premiers groupes industriels
français, dont l’activité et les libéralités font l’objet de très nombreux commentaires publics, relèvent de la légitime information du public
Attendu cependant que constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du public, la
captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; d’où il suit qu’en
statuant comme elle l’a fait, quand il ressort de ses propres constatations que les entretiens litigieux présentaient un tel caractère, la cour d’appel a violé les textes susvisés
b) (Abrogé par le Conseil Constitutionnel Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011)
Un journaliste doit pouvoir remonter à plus de dix ans pour démontrer des faits quand il est attaqué pour diffamation.
Conseil Constitutionnel Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011
(MME TÉRÉSA C. ET AUTRE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mars 2011 par la
Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1707 du 15 mars 2011), dans les
conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Térésa C. et M. Maurice D.,
relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du
cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée notamment par
l'ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Normand et
associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 15 avril 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 avril 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Christophe Bigot, avocat au barreau de Paris, pour Mme C., Me Renaud Le
Gunehec pour M. D. et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant
été entendus à l'audience publique du 10 mai 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 29
juillet 1881 susvisée, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être
prouvée, sauf « lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans » ;
2. Considérant que, selon le requérant, l'impossibilité pour la personne
prévenue de diffamation de rapporter la preuve de la vérité des faits
diffamatoires de plus de dix ans porte atteinte à la liberté d'expression et aux droits de la défense ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi » ; que la liberté d'expression et de
communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de
la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ;
que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être
nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
4. Considérant que l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée définit
les cas dans lesquels une personne poursuivie pour diffamation peut s'exonérer
de toute responsabilité en établissant la preuve du fait diffamatoire ; que les
alinéas 3 à 6 de cet article disposent en particulier que la vérité des faits
diffamatoires peut toujours être prouvée sauf lorsque l'imputation concerne la
vie privée de la personne et lorsqu'elle se réfère à des faits qui remontent à
plus de dix années ou à un fait constituant une infraction amnistiée ou
prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;
5. Considérant qu'en interdisant de rapporter la preuve des faits diffamatoires
lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans, le
cinquième alinéa de l'article 35 a pour objet d'éviter que la liberté
d'expression ne conduise à rappeler des faits anciens portant atteinte à
l'honneur et à la considération des personnes qu'elles visent ; que la
restriction à la liberté d'expression qui en résulte poursuit un objectif
d'intérêt général de recherche de la paix sociale ;
6. Considérant, toutefois, que cette interdiction vise sans distinction, dès
lors qu'ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les
propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les
imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire
s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général ; que, par son caractère
général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une
atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi ; qu'ainsi, elle méconnaît
l'article 11 de la Déclaration de 1789 ;
7. Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief,
le cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée doit
être déclaré contraire à la Constitution ; que cette déclaration
d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non
jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision,
Décide :
ARTICLE 1
Le cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse est déclaré contraire à la Constitution.
ARTICLE 2
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend
effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 7.
ARTICLE 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française
et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mai 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction
amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la
réhabilitation ou la révision ; (déclaré inconstitutionnel par le Conseil Constitutionnel Décision n°2013-319 QPC du 07 juin 2013
Conseil Constitutionnel Décision n° 2013-319 QPC du 07 juin 2013
M. Philippe B. [Exception de vérité des faits
diffamatoires constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou ayant donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la
Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe B. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés
que la Constitution garantit du c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881.
L'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 définit les cas dans lesquels une
personne poursuivie pour diffamation peut s'exonérer de toute responsabilité en
établissant la preuve du fait diffamatoire. Le c) de cet article interdit de
rapporter la preuve des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à un
fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à
une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Le requérant
soutenait que cette interdiction portait atteinte à la liberté d'expression et aux droits de la défense.
Le Conseil a jugé que les dispositions concernant l'amnistie, la prescription de
l'action publique, la réhabilitation et la révision n'ont pas, par elles-mêmes,
pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits qui ont motivé une
condamnation amnistiée, prescrite ou qui a été suivie d'une réhabilitation ou
d'une révision ou qu'il soit fait référence à des faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite.
La restriction à la liberté d'expression qui résulte du c) de l'article 35 vise
sans distinction, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou
scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le
rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général.
Dès lors le Conseil constitutionnel a jugé que, par son caractère général et
absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui
n'est pas proportionnée au but poursuivi. Elle méconnaît donc l'article 11 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette déclaration
d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non
jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée notamment par
l'ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le Conseil national de l'Ordre des
chirurgiens-dentistes par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État
et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 avril 2013 et le 25 avril 2013 ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Christophe Bigot, avocat
au barreau de Paris, enregistrées le 23 avril 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 avril 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Bigot, pour le requérant, Me Frédéric Thiriez, pour le Conseil national de
l'Ordre des chirurgiens dentistes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier
ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 mai 2013 ;
Vu la note en délibéré produite pour le Conseil national de l'Ordre des
chirurgiens-dentistes, enregistrée le 27 mai 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu du c) de l'article 35 de la loi du
29 juillet 1881 susvisée, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être
prouvée, sauf «lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une
infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation
effacée par la réhabilitation ou la révision»;
2. Considérant que, selon le requérant, l'impossibilité pour la personne
prévenue de diffamation, de rapporter la preuve de la vérité d'un fait
diffamatoire constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné
lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, porte
atteinte à la liberté d'expression et aux droits de la défense ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi » ; que la liberté d'expression et de
communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de
la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ;
que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être
nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif d'intérêt général poursuivi ;
4. Considérant que l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée définit
les cas dans lesquels une personne poursuivie pour diffamation peut être
renvoyée des fins de la plainte en établissant la preuve du fait diffamatoire ;
que les alinéas a) et c) de cet article disposent en particulier que la vérité
des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf lorsque l'imputation
concerne la vie privée de la personne et lorsqu'elle se réfère à un fait
constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une
condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 34 de la
Constitution, il appartient au législateur de fixer les règles concernant la
détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale et l'amnistie ; qu'en vertu de la compétence
que lui confère ce texte, il lui appartient en particulier, d'une part, de fixer
le délai d'extinction de l'action publique et, d'autre part, en matière
d'amnistie, d'enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits
pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en
effaçant les condamnations qui les ont frappés ; qu'il lui est loisible, à cette
fin, d'apprécier quelles sont ces infractions et le cas échéant les personnes
auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de ces dispositions ; qu'il peut, en
outre, définir le champ d'application de l'amnistie, en référence avec des
événements déterminés en fixant les dates et lieux de ces événements ; que
l'amnistie et la prescription visent au rétablissement de la paix politique et sociale ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les articles 133-12 à 133-17 du code pénal
fixent les conditions de la réhabilitation de plein droit et de la
réhabilitation judiciaire ; que la réhabilitation vise au reclassement du condamné ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les articles 622 et suivants du code de
procédure pénale fixent les conditions dans lesquelles une condamnation pénale
définitive pour un crime ou un délit peut donner lieu à révision ; que la
révision vise au respect des principes du procès équitable et à la poursuite de
l'objectif de bonne administration de la justice par la remise en cause, à
certaines conditions, d'une condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
8. Considérant, d'une part, que les dispositions concernant l'amnistie, la
prescription de l'action publique, la réhabilitation et la révision n'ont pas,
par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits
qui ont motivé une condamnation amnistiée, prescrite ou qui a été suivie d'une
réhabilitation ou d'une révision ou à des faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite ;
9. Considérant, d'autre part, que l'interdiction prescrite par la disposition en
cause vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à un fait constituant
une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation
effacée par la réhabilitation ou la révision, tous les propos ou écrits
résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se
référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un
débat public d'intérêt général ; que, par son caractère général et absolu, cette
interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas
proportionnée au but poursuivi ; qu'ainsi, elle méconnaît l'article 11 de la Déclaration de 1789 ;
10. Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief,
le c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée doit être déclaré
contraire à la Constitution ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité est
applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au
jour de la publication de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- Le c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse est déclaré contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à
compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 10.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 juin 2013, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY
MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits
sont prévus et réprimés par les
articles 222-23 à 222-32 et
227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est
réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée,
lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant
l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette
production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout
autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires.
ARTICLE 35 bis
Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée
faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
ARTICLE 35 ter
I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par
quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une
personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure
pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant
apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle
est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d'amende.
II. - Est puni de la même peine le fait :
- soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute
autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à
l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou
consultations visés à l'alinéa précédent.
ARTICLE 35 quater
La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de
la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est
réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 15 000 euros d'amende.
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers.
ARTICLE 36 : abrogé
ARTICLE 37
L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques
accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d'une amende de 45 000 euros.
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
ARTICLE 38
Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de
procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de 3 750 euros.
Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du code pénal, il est
interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature, à l'exception des
informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats. Pourront toutefois
être publiées les informations communiquées par le président d'une formation du Conseil supérieur.
JURISPRUDENCE
UN RAPPORT TECHNIQUE NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIE AVANT LE JUGEMENT SANS VIOLER LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-88430 Cassation Partielle
Vu les articles 38, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, est punie par le premier de ces textes la publication, même partielle, des actes d'accusation et de tous autres actes de procédure
criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des
conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 mars 2010, l'édition nationale du journal "Le parisien libéré" et le site
Internet de ce journal ont publié le point de vue technique d'un expert relatif à la commission de deux infractions imputées au docteur X..., alors médecin-chef
du ministère de la Santé, qui faisait l'objet d'une information, ouverte des chefs d'homicide involontaire et omission de porter secours et non encore
clôturée ; qu'à la suite de la dénonciation de cette publication par Mme X..., le procureur de la République a fait citer à comparaître Mme B..., directrice de
publication, M. Z..., rédacteur de l'article, en qualité de prévenus, et le journal "Le parisien libéré" en qualité de civilement responsable ; que le
tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté Mme X..., partie civile, de ses demandes; que Mme X... et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, après avoir relevé que les deux extraits d'un rapport d'expertise publiés concernaient un point de vue
technique soumis à la contestation des parties à la procédure d'instruction et ne valant pas appréciation de la culpabilité de Mme X..., l'arrêt retient que
cette publication n'a porté atteinte ni à l'autorité et à l'impartialité de la justice, ni au droit de Mme X..., qui a exercé son droit de réponse, de
bénéficier d'un procès équitable ; que les juges du second degré ajoutent que l'application de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 constituerait en
l'espèce une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression et ne répondrait pas à un besoin impérieux de protection de la
réputation et des droits d'autrui ou de garantie de l'autorité et de l'impartialité de la justice ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans apprécier l'incidence de la publication, dans son contexte, sur les droits de la personne
mise en cause, et, notamment, sur son droit à la présomption d'innocence, au sens de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la
cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés
es de
procédure extraits de l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de Nanterre dans l'affaire dite “Z...”, à savoir quatre dépositions publiées en
pages ... sous le titre “Exclusif : les femmes qui accusent”, constitue une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 et d'avoir, en
conséquence, condamné in solidum MM. Y... et X... et la société Sebdo à payer à Mme Z... une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
Mais attendu que l'arrêt constate qu'ont été publiés de larges extraits des témoignages recueillis dans les procès verbaux dressés lors
de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée pour abus de faiblesse commis à l'égard de Mme Z..., lesquels la présentaient comme une femme
manipulée et affaiblie ; que faisant une exacte application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a, sans se
contredire, pu en déduire, dès lors que des actes dressés par les services de police au cours d'une enquête sont des actes de procédure au sens de l'article 38 de la loi du
29 juillet 1881, que Mme Z... était fondée à invoquer, du seul fait de cette publication, un préjudice personnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
LA PARTIE CIVILE PEUT CHOISIR DE SAISIR LES JURIDICTIONS CIVILES
Cour de Cassation Chambre civile 1 arrêt du 29 mai 2013 Pourvoi n° 12-19101 REJET
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer recevable
l’action de M.Z... engagée sur le seul fondement de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881
Mais attendu qu’ayant constaté que M.Z... demandait réparation du préjudice qu’il prétendait avoir subi du fait de la
publication, en violation de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, d’extraits de procès-verbaux d’audition dressés par la police judiciaire à
l’occasion d’une enquête préliminaire, la cour d’appel en a déduit par une exacte application de l’article 4 du code de procédure pénale qu’il était
recevable à saisir le juge civil d’une telle demande ; que le moyen n’est pas fondé
.....attendu qu’ayant constaté, d’une part, que l’article du [...] s’appuyait sur une analyse des extraits de divers procès-verbaux de police
judiciaire pour présenter M. Z... comme ayant abusé de la faiblesse de Mme A..., à la veille de sa comparution devant le tribunal correctionnel appelé à se prononcer
sur la pertinence et le bien-fondé des accusations portées contre lui par la fille de celle-ci, d’autre part, que l’article du [...], fondé sur la reproduction partielle de dépositions
recueillies par la police judiciaire, tendait à présenter M. Z... comme accusé par des tiers en des termes probants à l’effet d’amener le lecteur
à estimer avérés les faits reprochés à celui-ci, deux mois avant une audience constituant, selon l’article, « l’épilogue de l’affaire », la cour d’appel, qui
n’avait pas à répondre aux conclusions invoquées par le troisième grief, lesquelles étaient inopérantes, faute de lecture des actes de procédure litigieux en audience publique avant
leur publication, en a déduit que celle-ci portait atteinte au droit de M. Z... à un procès équitable dans le respect de son droit à la présomption d’innocence
et des droits de sa défense ; qu’ayant ainsi justifié au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’ingérence, dans la liberté
d’expression, prévue par l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, elle a sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision de
condamner les auteurs de cette atteinte à en réparer les conséquences dommageables.
ARTICLE 38 ter
Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de
transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en
violation de cette interdiction.
Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la
condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.
Toute infraction aux dispositions du
présent article sera punie de de deux mois d'emprisonnement et
4 500 euros d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la
confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de
la parole ou de l'image utilisé.
Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou
document obtenu en violation des dispositions du présent article.
JURISPRUDENCE
Cour de
Cassation chambre criminelle arrêt du 24 Mars 2020 pourvoi n° 19-81.769 rejet
Sur le moyen pris en ses deux premières branches
7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce en substance que, si le public a
un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures en
matière pénale, particulièrement, comme en l'espèce, s'agissant d'une affaire de
terrorisme ayant eu des conséquences dramatiques et un important retentissement
médiatique, la liberté d'information doit être mise en balance avec les autres
intérêts en présence, au nombre desquels la sérénité des débats et,
spécialement, la spontanéité et la sincérité des dépositions et attitudes des
accusés et des témoins, qui dépend notamment, dans un procès aussi médiatisé, de
la certitude qu'aucune publication de prises de vue n'interviendra, ainsi que le
droit à l'image des parties concernées qui doit être préservé dans l'enceinte judiciaire.
8. Les juges ajoutent que l'accès au public de la salle d'audience était libre
et que l'information du public était garantie par la publication de comptes
rendus des débats et de dessins d'audience, et qu'au moment des publications
litigieuses, l'affaire en cause n'était pas jugée définitivement, un appel étant en cours.
9. Ils concluent que la prohibition de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet
1881 ne saurait constituer une ingérence disproportionnée dans les droits
garantis par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées au moyen.
11. Si, en effet, toute personne a droit à la liberté d'expression et si le
public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives, notamment,
aux procédures en matière pénale ainsi qu'au fonctionnement de la justice,
l'interdiction de tout enregistrement, fixation ou transmission de la parole ou
de l'image après l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou
judiciaires, et de leur cession ou de leur publication, constitue une mesure
nécessaire, dans une société démocratique, à garantir la sérénité et la
sincérité des débats judiciaires, qui conditionnent la manifestation de la
vérité et contribuent ainsi à l'autorité et à l'impartialité du pouvoir judiciaire.
12. En conséquence, les griefs, dont le premier est devenu sans objet à la suite
de la décision n° 2019-817 QPC du 6 décembre 2019 par laquelle le Conseil
constitutionnel a déclaré la première phrase des premier et troisième alinéas et
le quatrième alinéa de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse conformes à la Constitution, doivent être écartés.
Sur le moyen pris en sa troisième branche
13. Pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité spécialement du
chef de la photographie prise le 2 novembre 2017, l'arrêt retient que l'accusé
qui y figure, pas davantage que ses avocats, ne pouvait s'attendre à faire
l'objet de clichés photographiques alors qu'il se trouvait encore dans la salle
d'audience et qu'il se savait protégé par l'interdiction édictée par l'article
38 ter de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que doit être sanctionnée
l'atteinte faite à l'image de l'accusé pendant l'attente du verdict alors qu'il
importe de garder à l'enceinte judiciaire son caractère préservé.
14. En statuant ainsi, l'arrêt a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
15. En effet, l'interdiction instituée par l'article 38 ter précité, qui
commence dès l'ouverture de l'audience et se prolonge jusqu'à ce que celle-ci
soit levée, s'applique pendant les périodes de suspension de l'audience.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Article 38 quater
I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 38 ter,
l'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience peut être autorisé, pour
un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou
scientifique, en vue de sa diffusion. La demande d'autorisation
d'enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la justice.
L'autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le
président du Tribunal des conflits, le vice-président du Conseil d'Etat, le
premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des
comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, après
avis du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant
les juridictions administratives et les juridictions comprenant un magistrat du
siège membre de la Cour de cassation, et par le premier président de la cour
d'appel concernant les cours d'appel et les juridictions de l'ordre judiciaire
de leur ressort.
Lorsque l'audience n'est pas publique, l'enregistrement est subordonné à
l'accord préalable et écrit des parties au litige. Lorsqu'un majeur bénéficiant
d'une mesure de protection juridique est partie à l'audience, qu'elle soit
publique ou non, l'enregistrement est subordonné à l'accord préalable du majeur
apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de
protection juridique. Lorsqu'un mineur est partie à l'audience, qu'elle soit
publique ou non, l'enregistrement est subordonné à l'accord préalable du mineur
capable de discernement ainsi qu'à celui de ses représentants légaux ou, le cas
échéant, de l'administrateur ad hoc désigné.
Les modalités de l'enregistrement ne portent atteinte ni au bon déroulement de
la procédure et des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties
et les personnes enregistrées, dont la confidentialité des échanges entre
l'avocat et son client. Le magistrat chargé de la police de l'audience peut, à
tout moment, suspendre ou arrêter l'enregistrement. Cette décision constitue une
mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
La diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement n'est possible
qu'après que l'affaire a été définitivement jugée. En cas de révision d'un
procès en application de l'article 622 du code de procédure pénale, la diffusion
de l'enregistrement peut être suspendue.
La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la
sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au
respect de la présomption d'innocence. Cette diffusion est accompagnée
d'éléments de description de l'audience et d'explications pédagogiques et
accessibles sur le fonctionnement de la justice.
Sans préjudice de l'article 39 sexies de la présente loi, l'image et les autres
éléments d'identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés
qu'avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l'audience. Les
personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze
jours à compter de la fin de l'audience.
L'image et les autres éléments d'identification des mineurs ou des majeurs
bénéficiant d'une mesure de protection juridique ne peuvent, en aucun cas, être
diffusés.
Aucun élément d'identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé
cinq ans après la première diffusion de l'enregistrement ou dix ans après
l'autorisation d'enregistrement.
L'accord écrit des parties au litige ou des personnes enregistrées ne peut faire
l'objet d'aucune contrepartie.
II. - Après recueil de l'avis des parties, les audiences
publiques devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation peuvent également
être diffusées le jour même, sur décision de l'autorité compétente au sein de la
juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Le présent article est également applicable, par
dérogation à l'article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant
au cours d'une enquête ou d'une instruction ainsi qu'aux auditions,
interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d'instruction. Lors des
auditions, interrogatoires et confrontations, l'enregistrement est subordonné à
l'accord préalable et écrit des personnes entendues et le juge d'instruction
peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l'enregistrement.
IV. - Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en
application du I sans respecter les conditions de diffusion prévues au même I
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
V. - La cession des droits sur les images enregistrées
emporte de droit transfert au cessionnaire des obligations et interdictions
prévues au présent article.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
ARTICLE 39
Il est interdit de rendre compte des
procès en diffamation dans le cas prévu au troisième alinéa
de l'article 35 de la présente loi. Il est pareillement interdit de rendre
compte des débats et de publier des pièces de procédures concernant les
questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce,
séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d'avortement.
Cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des décisions, qui peut
toujours être publié.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux publications
techniques à condition que soit respecté l'anonymat des parties.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures,
soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
Les interdictions prévues au premier alinéa du présent
article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord.
Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 18 000 euros.
ARTICLE 39 bis
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que
ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :
- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;
- d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;
- d'un mineur qui s'est suicidé ;
- d'un mineur victime d'une infraction.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la
publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires.
ARTICLE 39 quater
Il est interdit, moins de trente ans après la mort de l'adopté, de publier par le livre, la presse, la radiodiffusion, le cinématographe
ou de quelque manière que ce soit, une information relative à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière.
Les infractions à la disposition qui précède sont punies de 6 000 euros
d'amende ; en cas de récidive un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.
ARTICLE 39 quinquies
Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime
d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 15 000 euros d'amende.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit.
JURISPRUDENCE
L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, qui incrimine la diffusion d'image ou de renseignement sur
l'identité d'une victime d'agression ou d'atteinte sexuelles sans son accord
écrit, n'exige pas que celle-ci ait été reconnue comme telle par décision définitive de condamnation de l'auteur des faits.
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 7 février 2023 pourvoi n° 22-81.057 rejet
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
7. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 10 août 2022, dit n'y avoir lieu de
renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de
constitutionnalité, les griefs sont devenus sans objet.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
8. Pour écarter le moyen selon lequel Mme [O] ne pouvait être considérée comme
victime d'agression sexuelle en l'absence de déclaration de culpabilité de M.
[V] pour de tels faits, l'arrêt attaqué énonce que le terme de « victime »
employé à l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 s'applique
nécessairement à toute personne se présentant comme telle.
9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen.
10. En effet, le texte susvisé n'a pas entendu réserver sa protection aux seules
victimes reconnues comme telles par décision définitive ayant prononcé la condamnation de l'auteur des faits.
11. Dès lors, le grief n'est pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
12. L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine la diffusion, sans l'accord écrit de celle-ci, de
renseignements concernant l'identité d'une victime d'infraction sexuelle ou son image lorsqu'elle est identifiable.
13. Cette disposition affecte l'exercice de la liberté d'expression qui
constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et ne peut
être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des
mesures nécessaires au regard de l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme.
14. Une telle ingérence, prévue par la loi, est définie de manière suffisamment
claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire.
15. La restriction qu'apporte à la liberté d'expression l'article 39 quinquies
de la loi précitée poursuit l'un des buts énumérés à l'article 10, § 2, susvisé,
en ce qu'elle a pour objet la protection de la dignité et de la vie privée de la
victime d'infraction sexuelle, protection qui est également de nature à éviter des pressions sur celle-ci.
16. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
que la réputation d'une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours
d'un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité
morale et, dès lors, relève de la vie privée de celle-ci au sens de l'article 8
de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 15 novembre
2007, Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03). L'identité d'une victime de violences
sexuelles relève également de sa vie privée et bénéficie de la protection
offerte par l'article 8 précité (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche, n° 3401/07).
17. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression
ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en
cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits.
18. Pour ce faire, le juge doit examiner si la diffusion de l'identité de la
victime d'infraction sexuelle contribue à un débat d'intérêt général, tenant
compte de l'éventuelle notoriété de la personne visée et de son comportement
avant la diffusion, de l'objet de cette dernière, son contenu, sa forme et ses répercussions.
19. Enfin, s'il retient que l'infraction prévue à l'article 39 quinquies précité
est caractérisée, le juge doit prononcer une sanction proportionnée à
l'ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression du prévenu, au regard des
circonstances particulières de l'affaire (CEDH [GC], arrêt du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, n°39954/08).
20. En l'espèce, pour déclarer M. [V] coupable, infirmer le jugement sur la
peine et le condamner à 1 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce en
substance, par motifs propres et adoptés, qu'il importe peu que l'identité de la
victime ait déjà été révélée ou que celle-ci ait contribué à son identification,
l'article 39 quinquies de la loi précitée visant la seule diffusion d'informations concernant l'identité d'une victime.
21. Les juges relèvent qu'au surplus, Mme [O], si elle a pu diffuser des
photographies sur lesquelles elle pouvait être identifiée, a constamment
dissimulé son état civil, communiquant uniquement sous le pseudonyme de « [R] ».
22. Ils retiennent que M. [V] a, dans ces circonstances, agi en connaissance de
cause et ne démontre pas que la diffusion du nom de Mme [O] était nécessaire à l'exercice des droits de la défense.
23. Les juges ajoutent qu'une peine d'amende est adaptée à la nature, à la durée
et à la gravité des faits, ainsi qu'à la personnalité, la situation sociale et
professionnelle et aux revenus de M. [V], qui a sciemment diffusé l'identité de
Mme [O] dans un ouvrage ainsi que dans deux autres médias, sans avoir recueilli son accord écrit.
24. Ils concluent qu'il doit toutefois être tenu compte du fait que Mme [O] a
elle-même contribué à son identification, notamment en diffusant sa photographie
en juin 2019 et en faisant figurer son nom en qualité d'organisatrice d'une
cagnotte en ligne au soutien de « [R] », pour dénoncer les agissements imputés à M. [V].
25. En statuant ainsi, et dès lors que la publication litigieuse ne contribuait
pas à un débat d'intérêt général, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
ARTICLE 39 sexies
Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité
des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou
unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros.
ARTICLE 40
Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des
souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et
dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, , des amendes
forfaitaires, des amendes de composition pénale ou des sommes dues au titre des
transactions prévues par le code de procédure pénale ou par l'article 28 de la
loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, sous
peine de six mois d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Le fait d'annoncer publiquement la prise en charge
financière des amendes, frais, dommages-intérêts et autres sommes mentionnés au
premier alinéa du présent article est sanctionné des mêmes peines.
ARTICLE 41
Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de
l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce
imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des
assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les
propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée, en
leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y
déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu
fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le
compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours
prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond,
prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner
ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque
ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
JURISPRUDENCE
Les débats judiciaires sont exempts de poursuites pénales
pour diffamation au sens de l'article 41
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 20 avril 2020 Pourvoi N° 21-22.206 Cassation partielle
Vu les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
7. Selon les quatrième et cinquième alinéas du second de ces textes, ne
donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte
rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés
ou les écrits produits devant les tribunaux, mais les juges saisis de la cause
et statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression des discours
injurieux, outrageants, ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
8. Il résulte du premier que toute expression qui contient l'imputation d'un
fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la
considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est
présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation.
9. Pour prononcer la suppression de la phrase « et procédant d'une mauvaise
foi qui confine à l'escroquerie » et condamner l'avocat au paiement de
dommages-intérêts, l'ordonnance retient que si le fait d'imputer à son
adversaire de la mauvaise foi ne peut être considéré comme diffamatoire, le fait
d'assimiler les demandes et moyens d'une partie à une escroquerie constitue bien
l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de celui qui est visé.
10. En statuant ainsi, alors que les propos litigieux ne contenaient pas
l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à
l'honneur ou à la considération de M. et Mme [F], le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du
code de l'organisation judiciaire et de l'article 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Les termes « et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie »
ne constituant pas un propos diffamatoire, il y a lieu de rejeter la demande de
suppression de ce passage dans les conclusions de l'avocat devant le premier
président de la cour d'appel et de rejeter la demande de M. et Mme [F] en paiement de dommages-intérêts.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 9 juin 2017 pourvoi n°16-17970 Cassation partielle
Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article 41, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Attendu que, si, par application du premier de ces textes, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens
précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, les faits diffamatoires
étrangers à la cause contenus dans des conclusions qui ne sont pas les dernières peuvent, conformément au second texte, donner lieu soit à l'action publique,
soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de l'instance aux fins de fixation d'une contribution aux charges du mariage introduite par son épouse, M.
X... a invoqué le caractère diffamatoire et étranger à la cause de propos contenus dans les conclusions de cette dernière, notifiées le 14 janvier 2015,
et demandé que lui soit réservée l'action prévue à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt se borne à retenir que les dernières écritures de Mme Y..., signifiées le 27 janvier 2015, ne reprennent
pas les propos en cause et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 16 novembre 2016 pourvoi n°11-24248 Cassation partielle sans renvoi
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre officielle du 14 mars 2012 avait été adressée, par le
conseil de la SCI, tant à l'avocat de la partie adverse qu'au juge de la mise en état, afin qu'il soit informé des échanges entre les parties, et que celui-ci,
chargé du contrôle de l'expertise judiciaire en cours, était compétent pour statuer sur l'incident soulevé par la société, la cour d'appel a retenu, à bon
droit, que cette lettre devait être considérée comme ayant été produite devant les tribunaux, au sens de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt constate que le litige a pour objet de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction éventuellement due par la
bailleresse, qu'un expert a été désigné en raison des difficultés liées à cette indemnisation et qu'au cours des opérations d'expertise, la SCI a émis des
réserves sur la fiabilité de la comptabilité produite par la société pour justifier de la valeur de son fonds de commerce ; que la cour d'appel en a
exactement déduit que les propos litigieux, dont la société avait elle-même soutenu qu'ils auraient conduit l'expert à s'adjoindre un sapiteur, n'étaient pas étrangers à la cause
Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 3 mai 2012 pourvoi n°11-14964 Cassation partielle
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Attendu que ne donneront lieu à aucune action
en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi
des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant
les tribunaux ; que pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant
sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou
diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; que
pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner
ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque
ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas,
à l'action civile des tiers
Attendu que pour condamner Mme X... à verser à
Mme Y... des sommes au titre du préjudice moral occasionné par ses conclusions
en défense signifiées le 2 septembre 2008, la cour d'appel retient, par motifs
propres et adoptés, que la référence dans ces écrits au suicide de M. Y... est
étrangère au débat concernant les travaux à réaliser dans l'immeuble et présente
un caractère infamant pour Mme Y... et en déduit que celle-ci est fondée à
demander réparation de son préjudice moral en application des dispositions de l'article 1382 du code civil
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 41 susvisé était seul applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé
ARTICLE 41-1
Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent
chapitre, la communication audiovisuelle est regardée comme un mode de publication.
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.
ARTICLE 42
Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la
répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :
1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs
professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de la publication ;
2° A leur défaut, les auteurs ;
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, la responsabilité
subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication, lorsque,
contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné.
JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION Chambre criminelle arrêt du 18 juin 2019 POURVOI N° 18-85.298 rejet
10. L’arrêt énonce notamment, par motifs propres
et adoptés, qu’il est établi que l’association de droit français Riposte laïque,
que M. Z... avait présidée, ayant d’ailleurs été condamné à ce titre en qualité
de directeur de la publication du site litigieux, a postérieurement transféré,
le 20 octobre 2012, la publication dudit site à l’association Riposte laïque
suisse. Le président de cette dernière association a confirmé la date des
publications et le nom de l’auteur, mais a refusé de fournir plus
d’informations. Un précédent président de cette même association suisse,
M. B..., avait confirmé à deux reprises lors d’enquêtes antérieures être, à ce
titre, le directeur de publication du site concerné et a été condamné en cette
qualité pour des propos qui y avaient été publiés.
11. Les juges ajoutent que l’adresse
électronique de contact du site était une adresse secondaire de celle de
M. Z..., et que les prélèvements correspondants étant effectués sur un compte au
nom de celui-ci, qui était également titulaire du compte Paypal utilisé par le
site. Si une perquisition a permis de trouver chez M. Z... les mots de passe et
codes d’accès au site, plusieurs autres personnes ont attesté en disposer
également pour publier leurs textes, les mettre à jour, les illustrer ou les
corriger.
12. Ils en déduisent qu’au moment des faits dont
ils sont saisis, il n’est nullement établi, avec la certitude nécessaire au
prononcé d’une condamnation pénale, que le prévenu serait encore le directeur de
publication ou le responsable, en droit ou en fait, de ce site, ni qu’il serait
le dirigeant de droit ou de fait de l’association suisse, qui édite le site
depuis l’étranger, pas davantage que n’est démontrée sa participation
personnelle à la gestion du site ni une quelconque participation à la mise en
ligne ou à la rédaction des propos incriminés.
13. L’arrêt confirme en conséquence le jugement
en ce qu’il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté les parties
civiles de leurs demandes.
14. C’est à tort que les juges ont cru devoir
examiner si le prévenu était le directeur de la publication du site internet.
15. En effet, de même que la responsabilité en
cascade prévue par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse ne s’applique que lorsque le journal est imprimé et publié en France (Crim.,
25 octobre 2005, pourvoi n° 04-82.400, Bull. crim. 2005, n° 266, rejet), la
responsabilité en cascade prévue par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle ne s’applique que lorsque le service de
communication au public par voie électronique est fourni depuis la France.
16. Abstraction faite de ce motif, erroné mais
surabondant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il résulte de ses
constatations qu’il n’est pas démontré que le prévenu a personnellement
participé à la diffusion en France, sur un site internet édité à l’étranger, des
propos litigieux, dont il n’est plus contesté qu’ils étaient destinés au public
français.
17. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.
18. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
COUR DE CASSATION Chambre criminelle arrêt du 3 mars 2015 POURVOI N° 13-87597 cassation
Vu les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, d'une part, qu'aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne
la mise en cause de l'auteur de l'écrit à la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication, ou à celle, à quelque titre que ce
soit, d'autres personnes pénalement responsables en application de ces textes ;
Attendu, d'autre part, que , dans une poursuite exercée en vertu de la loi du 29 juillet 1881, la juridiction correctionnelle a le pouvoir d'apprécier le mode de
participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans l'acte de poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de
cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification du fait incriminé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, par le journal "le Haut Anjou", d'un texte émanant de
M. Claude X..., candidat aux élections législatives sous l'étiquette "Europe Ecologie les Verts", mettant en cause le fonctionnement de la société Approchim,
et lui imputant de "meurtrir tout un territoire", de "mettre en danger la santé des riverains et de ses salariés", et de "détruire l'économie vivrière locale",
celle-ci a fait citer directement devant le tribunal correctionnel l'auteur du propos, du chef de complicité de diffamation publique envers particulier, au
visa notamment des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du code pénal ; que les premiers juges,
reconnaissant au prévenu le bénéfice de la bonne foi , l'ont renvoyé des fins de la poursuite; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, par substitution de motifs, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 43 de
la loi sur la presse, l'auteur du propos diffamatoire ne peut être poursuivi comme complice que dans la seule hypothèse où le directeur de la publication est
lui-même poursuivi comme auteur principal, et qu'en l'espèce M. X..., rédacteur du texte incriminé, n'est recherché qu'en qualité de complice, sans que le
directeur de la publication ait été appelé en la cause; que la cour d'appel en déduit qu'en l'absence de fait principal punissable, l'auteur de l'écrit publié
n'est pas susceptible d'être mis en cause comme complice du directeur de publication ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la poursuite de l'auteur du texte litigieux, comme complice, n'était pas subordonnée à la mise en cause, à titre
d'auteur principal, du directeur de la publication, et qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'apprécier le mode de participation de M. X... aux faits visés par
la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, et les principes ci-dessus rappelés
COUR DE CASSATION
1ere Chambre civile arrêt du 17 juin 2015 POURVOI N° 14-17910 Rejet
Mais attendu que doivent recevoir application devant la juridiction civile les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, qui
énumèrent les personnes susceptibles d'engager leur responsabilité pénale en cas d'infractions commises par la voie de la presse, ainsi que l'article 44 de la
même loi, aux termes duquel les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers
contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil ; que, dès lors, la
cour d'appel a retenu à bon droit qu'à défaut de mise en cause de l'une des personnes visées par les articles 42 et 43 précités, l'action dirigée contre la
seule société Groupe La Dépêche du Midi, en sa qualité de civilement responsable, était irrecevable
ARTICLE 43
Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article
121-7 du code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et
les conditions prévus par l'article
431-6 du code pénal sur les attroupements ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6.
Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur
de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les
trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.
ARTICLE 43-1
Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux
infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables.
JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION Chambre Criminelle Arrêt du 10 septembre 2013 pourvoi n° 12-83672 Rejet
Attendu que, pour mettre hors de cause le Syndicat national
du travail temporaire, poursuivi en qualité de prévenu, l'arrêt énonce qu'aucune
disposition de la loi du 29 juillet 1881, ni aucun texte ultérieur, n'autorisent
la poursuite d'une personne morale du chef de diffamation, et que le régime
juridique de la contravention de diffamation non publique étant celui des
infractions de presse, le premier juge ne pouvait pas entrer en voie de
condamnation à l'encontre de ce syndicat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors
qu'il se déduit de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qu'en dehors des
cas expressément prévus par les textes, les personnes morales ne sauraient
encourir de responsabilité pénale à raison des contraventions de presse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli
ARTICLE 44
Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des
condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des
articles 1382, 1383, 1384 du code civil.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, le recouvrement des
amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
ARTICLE 45
Les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux
correctionnels sauf :
a) Dans les cas prévus par l'article 23 en cas de crime ;
b) Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
ARTICLE 46
L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les
articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait
incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
UN MANDATAIRE OU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE N'A PAS DE
PREROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE
COUR DE CASSATION Chambre Mixte arrêt du 4 novembre 2002 pourvoi n° 00-13610 cassation
Vu les articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que l'interdiction d'exercer l'action civile séparément de l'action publique, édictée par l'article 46 de la loi visée, ne concerne que la
diffamation commise envers les personnes protégées par l'article 31 de la même loi et notamment les citoyens chargés d'un service public ; qu'une telle qualité
est reconnue à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des éditions Albin Michel a publié, le 26 mars 1998, un livre de M. X... intitulé "La mafia des tribunaux de
commerce" mettant en cause, aux chapitres neuf et dix, M. Y..., administrateur judiciaire au tribunal de commerce de Nanterre, accusé de corruption dans deux
affaires dont il a eu à connaître ; que s'estimant diffamé, M. Y... a fait assigner, par acte d'huissier de justice du 2 juin 1998, M. X... et la société
éditrice, en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les défendeurs ont invoqué la nullité de
l'assignation, en application de l'article 53 de ladite loi et l'irrecevabilité de la demande en application de l'article 46 de cette loi ;
Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable devant la juridiction civile,
l'arrêt retient qu'en application de la loi du 25 janvier 1985 sur le
redressement et la liquidation judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises assument une
mission de service public dans le cadre d'une activité libérale ; qu'à cette fin, de par leur statut et leur réglementation, il leur est imposé des
obligations particulières et donné des pouvoirs et prérogatives propres découlant du mandat de justice qui leur est confié par l'autorité judiciaire et
qui font d'eux, non pas de simples mandataires des personnes qu'ils représentent, chargés de la protection d'intérêts privés mais des organes
nécessaires de la procédure collective, devant agir pour rechercher les mesures propres à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité
et de l'emploi et l'apurement du passif, et, à défaut d'y parvenir, à la liquidation judiciaire de l'entreprise au mieux des intérêts de toutes les
personnes intéressées et de l'intérêt public ; qu'il est le délégué nécessaire de l'autorité judiciaire dans une procédure instituée pour répondre à un besoin
d'intérêt général lorsque notamment il engage des poursuites à l'encontre des dirigeants des entreprises placées sous son administration sur le fondement des
articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'administrateur judiciaire est un citoyen protégé par les dispositions de l'article 31 de la loi
du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les administrateurs judiciaires ne disposent d'aucune prérogative de puissance publique, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
Paragraphe 2 : De la procédure.
ARTICLE 47
La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu
d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après.
ARTICLE 48
1° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et
autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites,
ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;
1° bis Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du
Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ;
2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de
l'une ou de l'autre Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics,
les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite
aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;
4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par
l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;
5° Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage envers les
agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée
au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice ;
6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32
et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois,
la poursuite, pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la
diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public
lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de
personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de
leur identité de genre ou de leur handicap ; il en sera de
même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des
personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné
leur accord ;
7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée
prévue par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;
8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35
quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime.
En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus,
ainsi que dans les cas prévus aux articles 13, 38 quater et 39 quinquies de la présent loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 15 décembre 2020 pourvoi n° 20-85.461 rejet
Lorsque les poursuites pour diffamation envers un
corps constitué n’ont pas été précédées de la délibération de l’assemble
générale prévue par l’article 48, 1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse, les juges doivent relever d’office l’irrecevabilité de la
constitution de partie civile et constater que la juridiction n’est pas valablement saisie.
FAITS
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le département des Côtes-d’Armor a fait citer Mme X... devant le tribunal correctionnel du chef précité.
3. Les juges du premier degré ont condamné
Mme X... et prononcé sur les intérêts civils. L’intéressée a relevé appel de cette décision, de même que le ministère public à titre incident.
REPONSE DE LA COUR DE CASSATION
7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 48, 1° de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse et 423 du code de procédure pénale :
8. Lorsque les poursuites pour diffamation
envers un corps constitué n’ont pas été précédées de la délibération de
l’assemble générale prévue par l’article 48,1° précité, les juges doivent
relever d’office l’irrecevabilité de la constitution de partie civile et
constater que la juridiction n’est pas valablement saisie.
9. En l’espèce, il n’est pas contesté que la
poursuite n’a pas été précédée d’une délibération du conseil départemental la requérant.
10. Il appartenait à la cour d’appel de relever
d’office l’irrecevabilité en résultant et de constater que le tribunal correctionnel n’avait pu être valablement saisi.
11. La cassation est donc encourue de ce chef.
Conseil constitutionnel Décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013
Commune du Pré-Saint-Gervais [Mise en oeuvre de l'action publique en cas
d'injure ou de diffamation publique envers un corps constitué]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 août 2013 par la Cour de cassation
d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune du
Pré-Saint-Gervais. Cette question était relative à la conformité aux droits et
libertés que la Constitution garantit de l'article 47 et des premier et dernier
alinéas de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit qu'en matière d'infractions de
presse, seul le ministère public peut mettre en mouvement et exercer l'action
publique. Le dernier alinéa de l'article 48 prévoit les cas dans lesquels, par
dérogation à ce principe, la victime peut mettre en mouvement l'action publique
elle-même. Ne figurent pas parmi ces exceptions les corps constitués, notamment
les autorités publiques dotées de la personnalité morale et, en particulier, les
collectivités territoriales. Ainsi, lorsqu'elles sont victimes d'un délit ou
d'une contravention commis par voie de presse, ces collectivités territoriales
ne peuvent pas mettre en mouvement l'action publique.
La commune requérante soutenait que ces dispositions méconnaissent le principe
du droit à un recours effectif, le principe d'égalité et le principe de la libre
administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a
fait droit à leur argumentation.
Le Conseil constitutionnel a relevé que, lorsqu'elles sont victimes d'une
diffamation, les autorités publiques dotées de la personnalité morale autres que
l'État ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l'action
publique a été engagée par le ministère public, en se constituant partie civile
à titre incident devant la juridiction pénale. Elles ne peuvent ni engager
l'action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer
partie civile ni agir devant les juridictions civiles pour demander la
réparation de leur préjudice. Le Conseil constitutionnel a jugé que la
restriction ainsi apportée à leur droit d'exercer un recours devant une
juridiction méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Il l'a déclarée contraire à la Constitution. Cette déclaration
d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la décision du Conseil et est
applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour M. Franz-Olivier GIESBERT et la SA SEBDO Le
Point « Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point », parties en défense,
par la SCP Normand et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 13 septembre 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 17 septembre 2013 ;
Vu les observations produites pour la commune requérante par Me Patrick Tosoni, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 1er octobre 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Tosoni pour la commune requérante, Me Renaud Le Gunehec, avocat au barreau de
Paris, pour les parties en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 octobre 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29
juillet 1881 susvisée : « La poursuite des délits et contraventions de police
commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu
d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 : « 1°
Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres
corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une
délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites,
ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou
du ministre duquel ce corps relève ;
« 2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers le Président de la
République, un membre du Gouvernement ou un membre du Parlement, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
« 3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics,
les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres et
envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite
aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont
ils relèvent ;
« 4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par
l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin
qui se prétendra diffamé ;
« 5° Dans le cas d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la
poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires
étrangères et par celui-ci au ministre de la justice ;
« 6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32
et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois,
la poursuite, pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la
diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public
lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de
personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur
handicap ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été
commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que
celles-ci aient donné leur accord ;
« 7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée
prévue par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la
personne intéressée ;
« 8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35
quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime.
« En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus,
ainsi que dans les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présente
loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée » ;
3. Considérant que, selon la commune requérante, en privant les collectivités
territoriales victimes d'injure ou de diffamation du droit de mettre en
mouvement l'action publique, les dispositions de l'article 47 et des premier et
dernier alinéas de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 méconnaissent le
principe du droit à un recours effectif, le principe d'égalité et le principe de
la libre administration des collectivités territoriales ;
4. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la
garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit
pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées
d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;
5. Considérant, d'une part, que l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881
prévoit qu'en matière d'infractions de presse, seul le ministère public peut
mettre en mouvement et exercer l'action publique ; que le dernier alinéa de
l'article 48 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à ce principe, la
victime peut mettre en mouvement l'action publique elle-même ; que ce dernier
alinéa vise les alinéas précédents de ce même article 48 à l'exception de son 1°
; que ce 1° est relatif à la poursuite en cas « d'injure ou de diffamation
envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30 » ; que cet
article 30 désigne « les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de
l'air, les corps constitués et les administrations publiques » ; que, parmi les
corps constitués, figurent notamment des autorités publiques dotées de la
personnalité morale et, en particulier, les collectivités territoriales ; que,
par suite, lorsqu'elles sont victimes d'un délit ou d'une contravention commis
par voie de presse, ces personnes ne peuvent pas mettre en mouvement l'action publique ;
6. Considérant, d'autre part, que l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881
susvisée dispose que : « L'action civile résultant des délits de diffamation
prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès
de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique » ;
7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que,
lorsqu'elles sont victimes d'une diffamation, les autorités publiques dotées de
la personnalité morale autres que l'État ne peuvent obtenir la réparation de
leur préjudice que lorsque l'action publique a été engagée par le ministère
public, en se constituant partie civile à titre incident devant la juridiction
pénale ; qu'elles ne peuvent ni engager l'action publique devant les
juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile ni agir devant les
juridictions civiles pour demander la réparation de leur préjudice ; que la
restriction ainsi apportée à leur droit d'exercer un recours devant une
juridiction méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et
doit être déclarée contraire à la Constitution ; que, par suite, les mots « par
les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° » figurant au dernier alinéa de l'article 48 de
la loi du 29 juillet 1881, qui ont pour effet d'exclure les personnes visées au
1° de cet article du droit de mettre en mouvement l'action publique, doivent
être déclarés contraires à la Constitution ;
8. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 47 et du
surplus du dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, relatifs
aux pouvoirs respectifs du ministère public et de la victime en matière de mise
en oeuvre de l'action publique, ainsi que les dispositions du 1° de ce même
article 48, qui subordonnent la mise en oeuvre de l'action publique par le
ministère public à une délibération prise en assemblée générale ou, pour les
corps n'ayant pas d'assemblée générale, à une plainte « du chef du corps ou du
ministre duquel ce corps relève », ne méconnaissent ni le principe d'égalité, ni
le principe de la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun
autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être
déclarées conformes à la Constitution ;
9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la
Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement
de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le
Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les
effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ;
que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à
l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition
déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances
en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel,
les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le
pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses
effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a
produits avant l'intervention de cette déclaration ;
10. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « par les 2°,
3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° » figurant au dernier alinéa de l'article 48 de la loi
du 29 juillet 1881 prend effet à compter de la publication de la présente
décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées
définitivement à cette date,
D É C I D E :
Article 1er.- Les mots « par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° » figurant au
dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont contraires à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend
effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 10.
Article 3.- L'article 47, le premier alinéa et le surplus du dernier alinéa de
l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont conformes à la Constitution.
Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 24 octobre 2013, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY
MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.
ARTICLE 48-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et
l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les
victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale
ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions prévues par les articles 24 (alinéa 8), 32 (alinéa 2)
et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus
par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par
l'article 132-76 du code pénal ou si elle justifie que ces personnes ne s'opposent pas aux poursuites.
Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes
considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
ARTICLE. 48-1-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins
cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre l'esclavage ou de
défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
d'apologie, de négation, de minoration ou de banalisation des crimes de
réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage
prévues aux articles 24 et 24 bis.
Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées
individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle
justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou si elle justifie que ces
personnes ne s'opposent pas aux poursuites.
ARTICLE 48-2
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq
ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les
intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, d'assister les
victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, de défendre leur
mémoire ou de lutter contre les discriminations peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne :
1° L'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes
ou délits de collaboration avec l'ennemi mentionnée au cinquième alinéa de
l'article 24, lorsque ces crimes ou délits ont donné lieu à une ou plusieurs
condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;
2° L'infraction prévue à l'article 24 bis.
JURISPRUDENCE
Le massacre d'Asq : commentaire du journal Rivarol sur la Gestapo qui aurait arrêté le massacre organisé par l'armée allemande.
Cour de Cassation chambre criminelle, 27 avril 2011 pourvoi n° 09-80774 CASSATION
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte sur réquisitions
du ministère public, M. Jean-Marie Z..., Mme Marie-Luce X..., directrice de
publication du journal Rivarol, et M. Fabrice Y..., journaliste, ont été
renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour apologie de crime de guerre
et complicité, en raison de la publication dans ledit journal, à l'occasion de
la réponse apportée par M. Jean-Marie Z... à la question posée par M. Fabrice
Y...: " Que pensez-vous des commémorations de la fin de la seconde guerre
mondiale avec la propagande qui va se déchaîner dès ce mois-ci et tout au long
de l'année 2005 ? ", des propos suivants : " Je me souviens que dans le Nord, un
lieutenant allemand, fou de douleur que son train de permissionnaires ait
déraillé dans un attentat, causant ainsi la mort de ses jeunes soldats, voulait
fusiller tout le village ; il avait d'ailleurs déjà tué plusieurs civils. Et
c'est la Gestapo de Lille, avertie par la SNCF, qui arriva aussitôt à deux
voitures pour arrêter le massacre. "
Attendu que, par ailleurs, à l'issue d'une autre information ouverte sur la
plainte avec constitution de partie civile de l'association Fils et filles des
déportés juifs de France (FFDJF), M. Jean-Marie Z..., Mme Marie-Luce X...et M.
Fabrice Y...ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour
contestation de crimes contre l'humanité et complicité, à l'occasion de la
publication dans ledit journal, des propos suivants tenus au cours de la même
interview de M. Jean-Marie Z... par M. Fabrice Y...: " En France, du moins,
l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine même s'il y eut
des bavures, inévitables dans un pays de 550 000 kilomètres carrés (...). Il y a
donc une insupportable chape de plomb qui pèse depuis des décennies sur tous ces
sujets et qui, comme vous le dites, va en effet être réactivée cette année
(...). Mais le plus insupportable à mes yeux, c'est l'injustice de la justice
(...). Ce n'est pas seulement de l'Union européenne et du mondialisme que nous
devons délivrer notre pays, c'est aussi des mensonges sur son histoire,
mensonges protégés par des mesures d'exception. D'où notre volonté constante
d'abroger toutes les lois liberticides, Pleven, Gayssot, Lellouche, Perben II.
Car un pays et un peuple ne peuvent rester ou devenir libres s'ils n'ont pas le
droit à la vérité dans tous les domaines. Et cela quoi qu'il en coûte. "
Attendu que les premiers juges, qui ont joint les poursuites, ont dit la
prévention établie et déclaré recevables, au regard des dispositions de
l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, les constitutions de partie civile
du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), de la
Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP)
et de la Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH) ; que
les prévenus, la société civilement responsable, ainsi que le procureur de la
République et les parties civiles ont relevé appel du jugement
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la
contradiction des motifs équivaut à leur absence
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que Mme
Marie-Luce X..., M. Fabrice Y...et la société Les Editions des Tuileries ont
soutenu que la constitution de partie civile de l'association FFDJF était
irrecevable, dès lors que le président de cette association ne disposait pas, au
moment du dépôt de la plainte, d'un mandat spécial du conseil d'administration
de l'association l'autorisant à agir
Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire recevable la constitution
de partie civile critiquée, l'arrêt retient que les statuts de l'association,
versés aux débats, n'exigent pas que le président de ce groupement soit autorisé
à ester en justice par le conseil d'administration
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, et alors qu'il lui
appartenait, avant de se prononcer, de rechercher si les statuts de
l'association investissaient, ou non, son président d'un pouvoir de
représentation en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision
Vu l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute association régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts,
de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou
délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction de
contestation d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévue par l'article 24
bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, pour infirmer le jugement entrepris et
dire irrecevables les constitutions de partie civile du MRAP, de la LDH, et de
la FNDIRP, les juges d'appel constatent tout d'abord que le MRAP est intervenu
dans l'information ouverte sur réquisitoire introductif du ministère public
tandis que la FNDIRP et la LDH se sont toutes deux constituées à l'audience du
tribunal correctionnel ; que les juges ajoutent qu'en matière de presse, l'acte
initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de
celle-ci ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre et
qu'il s'ensuit qu'aucune personne ne saurait être admise à intervenir comme
partie civile dans la procédure déjà engagée à l'initiative d'une autre partie
civile ou du ministère public ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition ne fait
obstacle à l'intervention d'une association habilitée par l'article 48-2 de la
loi du 29 juillet 1881 et qui entend se constituer partie civile dans une
procédure engagée par une autre partie ou le ministère public du chef des
infractions visées par ce texte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé
Qu'il s'ensuit que la cassation est encore encourue de ce chef
ARTICLE 48-3
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et
victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui
se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des
anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de
diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
En cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par l'article 30
et le premier alinéa de l'article 33, les dispositions du 1° de l'article 48 ne sont pas applicables.
En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées
individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.
ARTICLE 48-4
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses
statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou identité de genre, ou d'assister les victimes de ces
discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième
alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation
concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par
l'article 132-77 du code pénal.
Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action
que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
ARTICLE 48-5
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les
discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33, ainsi que les
délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d'agressions sexuelles ou commis avec la
circonstance aggravante prévue par l'article 132-80 du code pénal.
Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes
considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
ARTICLE 48-6
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap ou d'assister les victimes de ces
discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième
alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation
concerne des crimes ou délits aggravés en raison du handicap de la victime.
Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes
considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
ARTICLE 49
Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le
désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.
ARTICLE 50
Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son
réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec
indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.
JURISPRUDENCE SUR L'OBLIGATION D'ARTICULATION DE L'ACCUSATION
COUR DE CASSATION, chambre criminelle, arrêt du 19 juin 2019 pourvoi n° 19-80.088 cassation sans renvoi
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des
pièces de la procédure qu’à la suite de la diffusion à de nombreux destinataires
d’une lettre ouverte de M. X..., expert-comptable, secrétaire national du
syndicat formation et développement CFE-CGC, le conseil supérieur de l’ordre des
experts-comptables, représenté par le conseil régional de l’ordre des experts-comptables des Pays de Loire, a porté plainte et s’est constitué partie
civile, en raison de plusieurs passages de ce texte qui, selon la plainte,
imputaient au conseil régional une discrimination raciale par refus de
l’inscription d’un candidat d’origine ivoirienne, du chef de diffamation
publique envers ledit conseil régional, au visa des articles 29 et 31, alinéa
1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que le juge d’instruction a renvoyé, du chef de diffamation publique envers un corps
constitué, le conseil régional de l’ordre des experts-comptables des Pays de
Loire, M. X... devant le tribunal correctionnel, qui l’a relaxé ; que la partie civile a relevé appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris
de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 2 et 497 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse ; Attendu qu’en matière de délits de presse, l’acte
initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature, l’étendue
et l’objet de la poursuite, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à
se défendre ; qu’il s’ensuit que les propos poursuivis comme diffamatoires à
l’égard d’une personne ne peuvent emporter condamnation en tant qu’ils comportent également des imputations en visant une autre ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur les
intérêts civils, l’arrêt retient une faute civile caractérisée par l’allégation de faits contraires à l’honneur ou à la considération non seulement du conseil
régional de l’ordre des experts-comptables des Pays de Loire mais aussi du
conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors
qu’elle n’était saisie par la plainte avec constitution de partie civile que de
diffamation publique envers le conseil régional de l’ordre des
experts-comptables des Pays de Loire, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé
et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce
chef ;
Et sur le moyen relevé d’office pris de
la violation de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, la possibilité de soulever ce moyen ayant été évoquée dans le rapport ;
Attendu que ne peuvent agir en diffamation sur
le fondement de ce texte que les corps constitués ayant une existence légale
permanente auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de
l’autorité ou de l’administration publique ;
Attendu que l’arrêt a retenu l’existence d’une
faute civile définie à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite
engagée sur le fondement de ce texte du chef de diffamation publique envers le
conseil régional de l’ordre des experts-comptables des Pays de Loire ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors
que ledit conseil régional n’a pas reçu de la loi une portion de l’autorité ou
de l’administration publique, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le
principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est également
encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle
aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
COUR DE
CASSATION, chambre criminelle, arrêt du 25 juin 2013 pourvoi n° 12-84696 rejet
Attendu que,
pour prononcer la nullité de la plainte avec constitution de partie civile
déposée par M. Guy Y..., M. Yves Y... et Mme Evelyne Y..., l'arrêt retient que
cette plainte, par ailleurs concomitante à une autre plainte incriminant les
mêmes faits sous des qualifications à la fois de diffamation publique envers un
particulier et de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat
public, qui vise à la fois les dispositions de l'article 29 et de l'article 30
de la loi du 29 juillet 1881, s'agissant en l'espèce de particuliers ou de
sociétés gérées par eux, crée une incertitude et une confusion qui ne permettent
pas aux personnes mises en cause de connaître avec précision la qualification
des faits qui leur sont imputés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction
a fait une exacte application de la loi, dès lors qu'en matière de diffamation,
une plainte avec constitution de partie civile qui omet d'énoncer la
qualification exacte des faits dénoncés, et vise de manière approximative un
ensemble de textes applicables à des infractions de nature et de gravité
différentes, laisse incertaine la base de la poursuite et ne satisfait pas aux
exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881
ARTICLE 50-1
Lorsque les faits visés par les articles 24 et 24 bis par les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et par les
troisième et quatrième alinéas de l'article 33, résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication au
public en ligne et qu'ils constituent un trouble manifestement illicite, l'arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du
ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
ARTICLE 51
Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.
Toutefois, dans les cas prévus aux premier à troisième et cinquième alinéas de l'article 24 et à l'article 37, la saisie des écrits ou imprimés, des
placards ou affiches, a lieu conformément aux règles édictées par le
code de procédure pénale.. Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans les cas prévus aux septième et
huitième alinéas de l'article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33.
ARTICLE 51-1
Par dérogation aux articles
80-1 et
116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui envisage de
mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d'injure procède
conformément aux dispositions du présent article.
Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception en précisant chacun des faits qui
lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l'avisant de son
droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d'un mois. Sous
réserve des dispositions du troisième alinéa, il peut aussi, par le même avis,
interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa
réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée
qu'elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à
être entendue par le juge d'instruction.
Le juge d'instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité
des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de
diffamation, ni non plus instruire sur l'éventuelle excuse de provocation en
matière d'injure.
Lors de l'envoi de l'avis prévu au deuxième alinéa du présent article, la
personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la
procédure est mise à la disposition de l'avocat désigné durant les jours
ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet
d'instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou
partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l'article
114 du code de procédure pénale.
A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis mentionné au
deuxième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut procéder à la
mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception selon les modalités prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 113-8 du code de procédure pénale.
Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par
le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
Les III à VIII de l'article 175 du même code ne sont pas applicables. S'il n'a
pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux
mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge
d'instruction rend l'ordonnance de règlement.
ARTICLE 52
Si la personne mise en examen est
domiciliée en France, elle ne pourra être placée en détention provisoire que dans les cas prévus à l'article 23 et aux deuxième à quatrième et sixième alinéas de l'article 24.
ARTICLE 53
La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et
sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 3 novembre 2020, pourvoi n° 19-87.463 cassation
partielle
Sur le moyen pris en sa troisième branche
7. Pour confirmer le jugement sur la nullité de
la citation, l’arrêt attaqué énonce notamment que cet acte ne distingue pas
particulièrement les imputations ou allégations qui porteraient atteinte à
l’honneur et à la considération de l’AURAR de celles qui concerneraient
Mme X..., ce qui ne permet pas au prévenu de connaître le périmètre exact des
faits qui lui sont reprochés.
8. En l’état de ces énonciations et dès lors
qu’ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer, les passages
poursuivis aux points 18, 19 et 20 du dispositif sous la qualification de
diffamation publique envers Mme X... et l’AURAR sont présentés, dans les motifs
de l’acte, en page 47, comme diffamatoires « à l’endroit seulement de Mme X...
et non pas de l’AURAR », ce qui créait une incertitude dans l’esprit du prévenu
quant à l’étendue de la poursuite du chef de ces trois passages, la cour d’appel
n’a pas méconnu le texte visé au moyen.
9. Ainsi, le grief doit être écarté.
Mais sur le moyen pris en ses autres
branches
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse :
10. Ce texte n’exige, à peine de nullité de
l’acte initial de poursuite, que la précision et la qualification du fait
incriminé, ainsi que la mention du texte de loi énonçant la peine encourue. La
nullité ne peut être prononcée que si l’acte a pour effet de créer une
incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue des faits dont il a à
répondre.
11. Pour confirmer le jugement sur la nullité de
la citation, l’arrêt attaqué énonce encore que les imputations mentionnées en
pages 54 et 55 de l’acte, relatives à des consultations fantôme de néphrologie
qui se feraient sans l’accord des praticiens concernés, à l’établissement de
vraies consultations qui n’ont pas eu lieu, et au fait qu’un médecin aurait payé
de son emploi au sein de l’AURAR le fait d’avoir protesté, ne sont pas
exactement reprises dans le dispositif, qui poursuit, au point 27, « peut-on
s’étonner que de telles pratiques de consultation fantôme de néphrologie se
fassent sans l’accord des praticiens concernés », au point 28 « quelques
praticiens ont refusé cette signature électronique ... Ils se sont attiré les
foudres de Mme X... un médecin l’a payé de son emploi » et au point 31 « sur un
note de service qui orchestrerait de vraies facturations de consultations qui
n’ont pas eu lieu ».
12. Les juges ajoutent que des imputations ne
sont pas exemptes de la qualification d’injure qui a pu être mentionnée mais qui
n’est pas reprise dans le dispositif.
13. Ils concluent que ces incertitudes et ces
imprécisions ne permettent pas au prévenu de connaître le périmètre exact des
faits qui lui sont reprochés à l’encontre de Mme X... et de l’AURAR et de
formuler une offre de preuve dans les conditions de l’article 55 de la loi du 29
juillet 1881, ce qui emporte l’annulation de l’acte en son entier.
14. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a
méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les trois motifs qui suivent.
15. En premier lieu, il ne résulte aucune
incertitude préjudiciable aux droits de la défense du fait que trois passages
poursuivis, extraits de l’article situé page 11 de l’édition du 31 octobre 2017
et exactement reproduits aux points 27, 28 et 31 du dispositif de la citation,
ont été, dans les motifs de cet acte, seulement résumés ou cités au style indirect, sans que le sens en ait été dénaturé.
16. En deuxième lieu, outre que ce moyen de
nullité a été relevé d’office par les juges, la citation, ainsi que la Cour de
cassation est également en mesure de s’en assurer, expose clairement, en pages
34 et 35, dans des conditions qui ne sont de nature à créer aucune incertitude
dans l’esprit du prévenu sur la qualification retenue, pourquoi une expression
qui, prise seule, serait injurieuse, est indivisible de l’imputation
diffamatoire dans laquelle elle est incluse et est donc poursuivie sous la qualification de diffamation.
17. Enfin, la cour d’appel ne pouvait déduire
des nullités partielles qu’elle constatait que l’acte devait être annulé en son entier.
18. En effet, lorsque plusieurs propos sont
incriminés dans une même citation délivrée du chef d’une ou plusieurs
infractions de presse, l’irrégularité affectant la poursuite s’agissant d’un de
ces propos ne s’étend à l’ensemble de l’acte que si, en raison de
l’indivisibilité existant entre les différents faits poursuivis, c’est sur la
nature et l’étendue de l’intégralité de ceux-ci qu’il en résulte une incertitude dans l’esprit du prévenu.
19. Tel n’était pas le cas en l’espèce, les
passages concernés par la seule nullité exactement retenue par l’arrêt attaqué
étant divisibles des autres propos poursuivis, dont ils n’affectaient pas le sens et la portée.
20. La cassation est par conséquent encourue.
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 14 mars 2017, pourvoi n° 15-86929 cassation
Vu l'article 53 de la loi
du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon ce texte, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la
poursuite ; qu'il n'appartient pas aux juges de subordonner la régularité de cet acte à d'autres conditions, dès lors qu'il ne peut exister d'incertitude sur l'objet de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Beny Y...et la société Beny Y...
Group Ressources LTD ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, la société Les Editions Marechal-Le
Canard Enchainé et son directeur de publication, M. Z..., à la suite de la publication, dans le numéro daté du 25 septembre 2013 de cet hebdomadaire, d'un
article intitulé " Des notes de la CIA et de la DGSE annoncent un coup d'Etat à Conakry " ; que les juges du premier degré ont fait droit à l'exception de
nullité de la citation qui était soulevée par les prévenus ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la citation reproduit intégralement l'article
litigieux, en précisant que son ensemble est diffamatoire à l'égard des deux parties civiles, mais que les développements figurant ensuite visent à
commenter, en contestant leur véracité, des passages de cet article en distinguant les imputations qui seraient diffamatoires à l'égard de chacune des
parties civiles ; que ces développements ne permettent pas de rattacher précisément ces passages à des imputations et donc de déterminer les faits
diffamatoires précisément poursuivis ; que les juges relèvent que l'exigence d'articulation entre les propos visés et les imputations diffamatoires n'est pas
satisfaite, la citation se contentant soit de reproduire l'intégralité de l'article, qui foisonne d'informations diverses, soit de dresser une liste, au
demeurant variable, des imputations jugées diffamatoires, mais sans jamais mettre en corrélation chacune des imputations avec le ou les propos de l'article
correspondants ; qu'ils ajoutent que ces incertitudes sont préjudiciables aux droits de la défense ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la citation en cause précisait et qualifiait le fait incriminé consistant en
l'intégralité de l'article litigieux et que ses auteurs n'étaient pas tenus de mettre en corrélation les imputations qu'ils présentaient comme diffamatoires
avec des passages de ce texte, de sorte qu'il ne pouvait en résulter, en l'espèce, aucune incertitude dans l'esprit des prévenus sur les faits, objet de
la poursuite, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Cour de Cassation chambre civile 1, arrêt du 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-29923 cassation
Attendu que pour déclarer nulles les assignations délivrées à
M. Z... et à la société MG international à la requête de la société Futura Play
et déclarer prescrite l'action en diffamation engagée à leur encontre, la cour
d'appel énonce qu'il est constant que les assignations délivrées les 21 et 22
octobre 2010 font référence à la SCP d'avocats Ledoux Ferri
Yahiaoui-Riou-Jacques Touchon, sans indiquer le nom de l'avocat en particulier,
personne physique, représentant la société Futura Play, qu'à bon droit M. Z...
et la société MG international font valoir qu'il n'a pas été satisfait aux
prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qu'en particulier,
en l'absence de désignation de l'avocat intervenant au nom de la société
demanderesse, il n'y a pas eu élection de domicile mais seulement indication de
ce que la SCP d'avocats avait son siège social à Charleville-Mézières, que cette
omission est nécessairement préjudiciable puisque seule une postulation
régulière permet l'offre de preuve de la vérité du fait dénoncé comme
diffamatoire, qu'il convient dès lors, infirmant sur ce point l'ordonnance
entreprise, de déclarer nulles les assignations délivrées le 22 octobre 2010 à
M. Z... et à la société MG international à la requête de la société Futura Play;
Qu'en statuant ainsi quand la régularité de la constitution comme avocat d'une
SCP d'avocats n'est pas subordonnée à l'identification de l'avocat appartenant à
cette SCP appelé à représenter la partie au nom de laquelle la constitution est
effectuée, en sorte que la constitution de cette SCP dont il n'est pas contesté
qu'elle fût domiciliée dans la ville où siège la juridiction saisie, vaut
élection de domicile au sens du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé.
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 10 septembre 2013, pourvoi n° 11-86311 cassation sans renvoi
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que les mêmes faits ne
sauraient recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans
l'esprit du prévenu, et que, si des instances relatives aux mêmes imputations
qualifiées différemment et visant des textes de loi distincts ont été engagées
successivement, la seconde se trouve frappée de nullité ;
Attendu que, pour confirmer les dispositions du jugement ayant rejeté
l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, prise de ce que
la société Le Trio, ayant d'abord saisi le juge des référés au titre de
l'article 1382 du code civil, ne pouvait agir ensuite devant le juge répressif
sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi sur la
presse incriminant la diffamation, l'arrêt énonce qu'il s'évince des articles 5
et 5-1 du code de procédure pénale que l'assignation devant le juge des référés,
dont l'objet est de voir ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser
un trouble manifestement illicite, ne saurait s'analyser en une action en
justice au sens de cet article, et ne saurait faire obstacle au droit de la
victime d'une infraction de saisir le juge pénal ; que les juges ajoutent que,
bien que le délai d'une action en diffamation se prescrive par trois mois, il
n'en demeure pas moins qu'une victime doit être en capacité de saisir le juge
des référés, avant ou dans le temps d'une poursuite en matière de délit de presse ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, pour les mêmes faits, deux
instances ont été engagées sur des fondements différents, la première sur celui
de l'article 1382 du code civil, la seconde sur celui des articles 29 et 32 de
la loi de 1881, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 3 juillet 2013, pourvoi n° 11-28907 Rejet
Mais attendu qu’il résulte de l’article 53 de
la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction
civile, que l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir
élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; qu’en
retenant que ces dispositions l’emportent sur celles des articles 751 et 752 du
code de procédure civile, l’arrêt, qui n’a pas méconnu les exigences de
l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales est légalement justifié
Cour de Cassation assemblée plénière, arrêt du 15 février 2013, pourvoi n° 11-14637 Rejet
Mais attendu que selon l’article
53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la
juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et
qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle
une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation
Et attendu qu’ayant constaté que
des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant pour certains dans
des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvaient poursuivis sous
deux qualifications différentes, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans
encourir les griefs du moyen, que ce cumul de qualifications étant de nature à
créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l’assignation était nulle en son entier
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
Cour de Cassation chambre civile 1 arrêt du 4 février 2015, pourvoi n° 13-16263 cassation sans renvoi
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon ce texte, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi
applicable ; qu'est nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l'article 9 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait créé sans le consentement de M. Y... un site internet ouvert au nom de celui-ci
et faisant apparaître sa photographie assortie de commentaires désobligeants, a été assigné en référé sur le fondement des articles 35 à 55 de la loi du 29
juillet 1881 ainsi que de l'article 9 du code civil, en indemnisation de son préjudice ;
Qu'en statuant sur les mérites de l'assignation, alors que celle-ci, fondée sur une double qualification, était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
COMMUNIQUE DE LA COUR DE CASSATION
Par un arrêt du 15 février 2013,
l’assemblée plénière de la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon
lequel les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
s’appliquent aux actions engagées devant la juridiction civile.
Suivant l’évolution
jurisprudentielle
initiée par la deuxième chambre civile en 1992, cette même assemblée avait
consacré la prééminence de cette loi sur le régime de droit commun de la
responsabilité civile en énonçant, par deux arrêts du 12 juillet 2000, que “les
abus de la liberté d’expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet
1881, ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil”.
Cette évolution avait conduit à
l’unification des règles
procédurales et à l’instauration d’un régime unique du procès de presse,
quelle que soit la voie, pénale ou civile, choisie par la victime qui était
tenue notamment de se conformer aux formalités prévues par l’article 53 de la
loi sous peine de nullité de la citation ou de l’assignation. Par un arrêt du 8
avril 2010, la 1ère
chambre civile a, dans une instance civile, assoupli les exigences de l’article
53 en écartant la nullité d’un acte introductif d’instance qui ne précisait pas
ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations.
Dans son arrêt du 15 février
2013, l’assemblée plénière a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour
d’appel de Paris, qui, statuant sur renvoi, a, de nouveau, annulé l’assignation en son entier.
En affirmant que l’article 53 de
la loi du 29 juillet 1881 devait recevoir application devant la juridiction
civile et que des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant dans
des commentaires publiés à des dates différentes, ne pouvaient être poursuivis
sous deux qualifications différentes, ce cumul de qualifications étant de nature
à créer, pour les défenderesses, une incertitude préjudiciable à leur défense et
en approuvant la cour d’appel d’avoir annulé, en son entier, l’assignation
comportant une telle irrégularité, la formation la plus solennelle de la Cour de
cassation a ainsi entendu poursuivre dans la voie de l’uniformisation du régime du procès de presse.
Cet arrêt a été rendu sur avis conforme du procureur général.
Conseil Constitutionnel Décision n° 2013-311 QPC du 17 mai 2013
Société Écocert France [Formalités de l'acte introductif d'instance en matière de presse]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2013 par
la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société ÉCOCERT France. Cette question était relative à la conformité aux
droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, relatif à la saisine du tribunal en
droit de la presse, fixe les formalités substantielles de la citation en justice
pour les infractions prévues par cette loi. La Cour de cassation juge que ces
dispositions s'appliquent devant la juridiction civile.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en imposant que la citation précise et
qualifie le fait incriminé et que l'auteur de la citation élise domicile dans la
ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur
soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la
citation. Il a jugé que la conciliation ainsi opérée entre, d'une part, le droit
à un recours juridictionnel du demandeur et, d'autre part, la protection
constitutionnelle de la liberté d'expression et le respect des droits de la
défense ne revêt pas, y compris dans les procédures d'urgence, un caractère déséquilibré.
Le Conseil constitutionnel a conclu que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 est conforme à la Constitution
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Assemblée plénière, du 15 février 2013, n° 11-14637 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société Écocert par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
enregistrées le 13 mars, le 25 mars et le 28 mars 2013 ;
Vu les observations produites pour la Société France Télévisions par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
enregistrées le 13 mars et le 27 mars 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 mars 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Emmanuel Piwnica et Me Éric Andrieu, avocat au barreau de Paris, pour la
société France Télévisions et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 avril 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle
indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
« Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
« Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite » ;
2. Considérant que, selon la société requérante, en imposant que la citation
pour des infractions de presse désigne précisément les propos ou écrits
incriminés et en donne la qualification pénale, ces dispositions conditionnent
l'accès au juge à des règles de recevabilité d'un formalisme excessif qui ne
trouvent aucune justification devant les juridictions civiles ; qu'il en irait
de même de l'obligation d'élire domicile dans la ville où siège la juridiction
saisie et de notifier la citation au ministère public ; que la sanction de
nullité en cas de non-respect de ces exigences présenterait un caractère
disproportionné ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaîtraient le
droit au recours effectif ; qu'il conviendrait à tout le moins d'exclure
l'application de ces dispositions devant les juridictions civiles, en
particulier lorsqu'elles sont saisies selon la procédure de référé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des
droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté
d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi »
; que la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse
que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ;
5. Considérant que les dispositions contestées fixent les formalités
substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, par son arrêt susvisé du
15 février 2013, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que
l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la
juridiction civile » ; qu'en imposant que la citation précise et qualifie le
fait incriminé et que l'auteur de la citation élise domicile dans la ville où
siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis
à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et,
notamment, puisse, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui
lui est reconnu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en
défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation
; que la conciliation ainsi opérée entre, d'une part, le droit à un recours
juridictionnel du demandeur et, d'autre part, la protection constitutionnelle de
la liberté d'expression et le respect des droits de la défense ne revêt pas, y
compris dans les procédures d'urgence, un caractère déséquilibré ; que
l'obligation de dénoncer la citation au ministère public ne constitue pas
davantage une atteinte substantielle au droit d'agir devant les juridictions ;
qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte au droit à un
recours juridictionnel effectif doivent être écartés ;
6. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre
droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2013, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY
MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
ARTICLE 54
Par dérogation au premier alinéa de l'article 552 du code de
procédure pénale, le délai entre la citation et la
comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance.
Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale
contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance, et les dispositions des
articles 55 et 56 de la présente loi ne seront pas applicables.
JURISPRUDENCE
Décision n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019
Association Sea Shepherd [Délai entre la citation et la comparution devant un tribunal correctionnel en matière d'infractions de presse]
1.La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion
duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 54 de la loi du 29
juillet 1881 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 septembre 1945 mentionnée ci-dessus.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots «
outre un jour par cinq myriamètres de distance » figurant au premier alinéa de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881.
8. La prise en compte, par l'instauration d'un délai spécifique, de la distance séparant le
lieu de résidence de la personne poursuivie du lieu où elle est citée à comparaître n'est, par elle-même, pas contraire au principe d'égalité devant la
justice. Toutefois, en raison de l'étendue du territoire de la République, les modalités de détermination de ce délai définies par les dispositions contestées
sont susceptibles de conduire à des délais de distance très différents. Compte tenu des moyens actuels de transport, ces différences dépassent manifestement ce
qui serait nécessaire pour prendre en compte les contraintes de déplacement, et ce quelle que soit la distance séparant le lieu de résidence du prévenu de celui
de sa comparution. Dès lors, les dispositions contestées procèdent à une distinction injustifiée entre les justiciables.
9. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, les mots «
outre un jour par cinq myriamètres de distance » figurant au premier alinéa de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, qui méconnaissant le principe
d'égalité devant la justice, doivent être déclarés contraires à la Constitution.
11. L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer tout délai de distance pour les citations directes
délivrées en application de la loi du 29 juillet 1881. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au
législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 31 mars 2020 la date de l'abrogation des dispositions contestées.
12. Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la
présente décision, il y a lieu de juger que les citations délivrées en application de la loi du 29 juillet 1881 après cette date sont soumises aux
délais de distance déterminés aux deux derniers alinéas de l'article 552 du code de procédure pénale.
13. La déclaration d'inconstitutionnalité ne peut être invoquée dans les instances engagées par une citation délivrée avant la publication de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « outre un jour par cinq myriamètres de distance » figurant au premier alinéa de l'article 54 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 11 à 13 de cette décision.
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 15 décembre 2015 pourvoi n° 14-85570 cassation sans renvoi
Vu les articles 54 de la
loi du 29 juillet 1881 et 553-1° du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en matière de délits de presse, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour
par cinq myriamètres de distance ;
Attendu que, selon le second, si le délai légal entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal
correctionnel n'a pas été observé, la citation doit être déclarée nulle dans le cas où la partie citée ne se présente pas ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure, présentée par les prévenus, motif pris de l'inobservation du délai de comparution lors de
la convocation en justice initiale, en l'état d'un délai inférieur à vingt jours, l'arrêt retient que, si ce délai n'a, de fait, pas été respecté, et si,
par voie de conséquence, le jugement doit être annulé, la cour doit évoquer l'affaire, constater qu'elle a été régulièrement saisie par l'appel du ministère
public, et que, les prévenus ayant été effectivement informés de l'accusation portée contre eux par la notification qui leur a été faite du jugement de
première instance, les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont satisfaites ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que moins de vingt jours s'étaient écoulés entre la notification des convocations en justice et la date à laquelle
les prévenus devaient comparaître devant le tribunal, que les prévenus ne s'étaient pas présentés à l'audience, et que les convocations en justice
devaient, en conséquence, être annulées, sans que les juges d'appel puissent évoquer, l'action publique n'étant pas régulièrement mise en mouvement, la cour
d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés
ARTICLE. 54-1
En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au septième alinéa de
l'article 24, soit au deuxième alinéa de l'article 32, soit au troisième alinéa de l'article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du
contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions.
En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l'article 24, soit au troisième
alinéa de l'article 32, soit au quatrième alinéa de l'article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier
l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions.
ARTICLE 55
Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi,
il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu,
suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal
correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues
aux septième ou huitième alinéas de l'article 24 ou aux troisième ou quatrième
alinéas de l'article 33, le présent article est également applicable devant la
juridiction de jugement si celle-ci requalifie l'infraction sous la
qualification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 22 octobre 2013 pourvoi n° 12-86197 Cassation
Vu les articles R 621-1 du code pénal et 55 de la loi du 29 juillet 1881
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, pour être admis au titre de l'offre de preuve, les écrits et témoignages qu'il vise
doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Caille, qui avait développé son activité dans la grande
distribution en partenariat avec le groupe Carrefour, notamment en signant avec la société Prodim, appartenant à ce groupe, un contrat aux fins d'exploitation
exclusive de l'enseigne commerciale Shopi, a déclaré résilier ce contrat le 24 avril 2009; que postérieurement à cette rupture, la société Prodim a fait citer
devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique, Me Y... et Me X..., avocats de la société Caille, à raison de courriers, adressées à des
magistrats, qui lui imputaient une stratégie de harcèlement poursuivie au travers de manoeuvres procédurales dans le litige commercial opposant ces
personnes morales ; que le premier juge ayant admis l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires et relaxé les prévenus, la société Carrefour,
venant aux droits de la société Prodim, a relevé appel de la décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte
que la preuve de la vérité des faits diffamatoires a été admise, en particulier,
sur le fondement de pièces établissant l'existence de procédures judiciaires
postérieures aux correspondances diffamatoires qui ne pouvaient avoir été
connues des prévenus et avoir servi de fondement à leurs allégations, la cour
d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encouru
ARTICLE 56
Dans les cinq jours suivants, en tous cas moins de trois jours francs avant
l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera tenu de
faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et
les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la
preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.
ARTICLE 57
Le tribunal correctionnel et le tribunal de police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date
de la première audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 54, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin.
ARTICLE 58
Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu
et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Le
prévenu sera dispensé de se mettre en état.
La partie civile pourra user du
bénéfice de l'article 585 du Code de procédure pénale sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
ARTICLE 59
Le pourvoi devra être formé, dans les
trois jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans
les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour de
cassation, qui jugera d'urgence dans les dix jours à partir de leur réception.
L'appel contre les jugements ou le
pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué sur les incidents
et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, à peine de
nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond : faute de ce,
elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même jugement.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 17 décembre 2013, pourvoi n° 12-87133 nullité du pourvoi
Attendu que, selon l’article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le
pourvoi contre les arrêts des cours d’appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence, ne
peut être formé qu’après l’arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité;
Attendu qu’en conséquence, le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant dit n’y avoir lieu à constater
l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Y..., doit être déclaré nul
ARTICLE 60
Sous réserve des dispositions des articles 50, 51, et 52 ci-dessus, la poursuite des crimes [*commis par la voie
de la presse*] aura lieu conformément au droit commun.
Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
ARTICLE 61
S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36 et 37, prononcer la confiscation des
écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui
seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des
exemplaires saisis.
ARTICLE 62
En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27, la
suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette
suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
ARTICLE 63
L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues par les articles 24 (alinéas 5, 6, 8 et
9), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) de la présente loi.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
ARTICLE 64
Lorsque ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit la diffusion de l'information, le premier
président de la cour d'appel statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives.
PRESCRIPTION DE TROIS MOIS DE L'ARTICLE 65
Le Principe : Lorsque la prescription est interrompue, un nouveau délai
de 3 mois recommence à courir à compter de l’acte interruptif. Il faut donc suivre la procédure de trois mois à trois mois.
Certains actes de procédure interrompent la prescription comme
l'obligation de consignation ou la transmission de la plainte avec constitution
de partie civile du juge d'instruction au Procureur de la république aux fins de
réquisitions. Tout obstacle prévue par la loi ou insurmontable, ou tout rappel à
la loi (voir arrêt du 29 novembre 2022 sous l'article 65) suspend la
prescription.
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 8 mars 2022 pourvoi n° 21-83.037 cassation
Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, le délai de prescription de l'action
publique pour les délits de presse est de trois mois et court à compter du jour
où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
9. Aux termes du deuxième, le dépôt d'une plainte avec constitution de
partie civile, à la suite duquel est versée, dans le délai imparti, la
consignation prévue par ce texte interrompt la prescription de l'action
publique. Il en est de même lorsque le juge d'instruction communique la plainte
au procureur de la République en application de l'article 86 du code précité.
10. Il résulte du troisième que tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou
tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend
impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.
11. Tel est le cas lorsque la personne qui, lésée par un crime ou un délit, a
mis en mouvement l'action publique par sa plainte avec constitution de partie
civile, ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à
accomplir un acte interruptif de prescription.
12. Il s'en déduit que le délai de prescription est suspendu entre la date
de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et la délivrance du
réquisitoire par le procureur de la République.
13. Pour déclarer éteinte par la prescription l'action engagée par M. [C],
l'arrêt attaqué énonce que le délai de prescription a été interrompu par
l'ordonnance de fixation de la consignation du 25 février 2019 puis par
l'enregistrement du versement de son montant, par la DRFIP, à la date du 26 mars 2019.
14. Les juges relèvent que le doyen des juges d'instruction n'a été avisé du
versement de la consignation ni par la partie civile ni par la DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes.
15. Ils énoncent que de ce fait, le juge d'instruction n'a pu accomplir aucun
acte interruptif de prescription, notamment en transmettant la procédure au
ministère public pour solliciter ses réquisitions en vue d'une ouverture d'information.
16. Les juges en déduisent que la prescription de l'action publique était
acquise, ce délai n'étant pas suspendu par l'attente du versement de la
consignation de la partie civile.
17. En se déterminant ainsi, alors que la partie civile n'est recevable à
présenter une demande d'acte qu'après l'ouverture de l'information, la chambre
de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
18. La cassation est par conséquent encourue.
ARTICLE 65
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois
mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de
prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore,
suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.
LA PRESCRIPTION S'INTERROMPT QUE PAR LES REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 16 septembre 2014 pourvoi n° 13-85457 cassation
Vu l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon ce texte, en matière d'infractions à la loi
sur la liberté de la presse, avant l'engagement des poursuites, seules les
réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant les provocations,
outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de
l'action publique soulevée par la prévenue, l'arrêt énonce qu'il résulte des
pièces de la procédure que plusieurs actes d'enquête ont été effectués entre le
10 mars 2012, date de mise en ligne des propos incriminés, et le 11 juin 2012,
date d'expiration du délai de trois mois prévu par la loi du 29 juillet 1881,
soit l'audition de Mme Y..., le 13 mars 2012, les investigations effectuées le
16 avril 2012 sur le site "conscience-vraie.info", et l'audition de Mme X..., le
7 juin 2012 ; que les juges retiennent que ces éléments d'enquête ont chacun
interrompu la prescription durant la période alléguée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun acte de poursuite ou
d'instruction, ni aucune réquisition d'enquête articulant et qualifiant la
diffamation, n'ont été réalisés entre la date des faits et la mise en mouvement
de l'action publique par la délivrance, le 10 janvier 2013, d'une convocation en
justice à la prévenue, et qu'un délai de plus de trois mois s'étant ainsi
écoulé, l'action publique du chef de diffamation était éteinte par l'effet de la
prescription, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que la Cour de cassation
appliquera directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L.411-3
du code de l'organisation judiciaire, concernant la poursuite du chef de diffamation publique;
UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INTERROMPT LA PRESCRIPTION MAIS PAS LA PLAINTE SIMPLE
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 29 novembre 2022 pourvoi n° 22-81.814 rejet
"justify">8. Pour constater la prescription de l'action de M. [E] à la
date de sa plainte avec constitution de partie civile du 6 avril 2021, l'arrêt
attaqué énonce que le délai de prescription, qui a couru à compter de la tenue
des propos le 4 décembre 2020, n'a été interrompu ni par la plainte simple du
20 décembre 2020, ni par le soit-transmis du procureur de la République
aux fins d'enquête du 30 décembre 2020, ni par les actes d'enquête des 12 et 22 janvier 2021.
9. Les juges ajoutent que le rappel à la loi ordonné par le
procureur de la République le 26 janvier 2021 n'a entraîné la suspension de la
prescription que jusqu'à la notification à l'intéressé, le 11 février 2021, de
ce rappel à la loi, soit pendant un délai de seize jours. Ils en déduisent que
la prescription s'est trouvée acquise le 20 mars 2021.
10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
11. D'une part, le soit-transmis du ministère public aux
fins d'enquête et les actes d'exécution qui ont suivi n'ont pu interrompre la
prescription, dès lors que les réquisitions aux fins d'enquête ont
seulement fait état d'une diffamation publique, sans autre précision sur le type
de diffamation visé, et n'ont donc pas qualifié les faits, comme l'exige
l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
12. D'autre part, le rappel à la loi prévu par
l'article 41-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il s'effectue en deux
temps, a entraîné la suspension du délai de prescription du 26 janvier 2021,
date de la décision du ministère public, au 11 février suivant, date de la notification à l'intéressé dudit rappel.
13. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 14 mars 2017 pourvoi n°15-86199 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y..., a porté plainte et s'est constituée partie civile, le 6 juin 2014, du
chef de diffamation publique envers particulier, en raison de propos tenus lors d'une réunion publique le 21 février 2014, la mettant en cause ; que le juge
d'instruction a rendu, le 13 mai 2015, une ordonnance constatant l'extinction de l'action publique par la prescription ; que Mme Y... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a relevé que plus de trois mois s'étaient écoulés entre la date à laquelle les faits
dénoncés auraient été commis et celle à laquelle Mme Y... avait porté plainte et s'était constituée partie civile, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 65
de la loi du 29 juillet 1881 les infractions prévues par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises
ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait et, qu'avant l'engagement des poursuites, seules des réquisitions aux fins d'enquête
formulées selon les modalités prévues au même article sont interruptives de prescription ;
que les juges ajoutent que la plainte déposée par Mme Y..., le
7 mars 2014, devant les services de gendarmerie n'a pu avoir pour effet de mettre en mouvement l'action publique, dès lors que l'engagement des poursuites ne
résulte que de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 juin 2014 ; que la chambre de l'instruction en conclut qu'à cette date l'extinction
de l'action publique par la prescription avait été acquise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, dès lors que l'article 85 du code de procédure pénale exclut expressément les infractions en matière de presse de la condition de
recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile consistant en la justification du dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République ou
d'un service de police judiciaire, il s'en déduit que la suspension de la prescription de l'action publique, qui est le corollaire nécessaire de la
condition de recevabilité précitée, n'est pas applicable lorsqu'est poursuivie l'une de ces infractions ;
LE DELAI DE TROIS MOIS POUR EXIGER UN DROIT DE REPONSE OU
POURSUIVRE A POUR BUT DE PROTEGER LA LIBERTE D'EXPRESSION
Cour de cassation chambre civile 1 arrêt du 29 mars 2023 pourvoi n° 22-10.875 Rejet
4. En premier lieu, c'est à bon droit que la cour d'appel a
énoncé que l'action en justice afin de faire sanctionner le refus d'insertion
d'un droit de réponse est soumise au délai de prescription de trois mois prévu à
l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
7. L'existence d'un court délai de prescription édicté par
l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de garantir la liberté
d'expression et ne prive pas le demandeur à l'action en insertion forcée de tout
recours effectif, dès lors qu'il a la faculté d'interrompre la prescription par
tout acte régulier de procédure manifestant son intention de continuer l'action.
Ces règles sont suffisamment claires et accessibles pour permettre aux parties d'agir en
conséquence (CEDH, ordonnance du 29 avril 2008, n° 24562/03 ; CEDH, ordonnance du 17 juin 2008, n° 39141/04).
8. Dès lors que l'existence d'un calendrier de procédure ne dispense pas le
demandeur à l'action en insertion forcée d'un droit de réponse de s'assurer de
l'accomplissement dans les délais requis des actes nécessaires à l'interruption de la prescription trimestrielle, le moyen est inopérant.
ATTEINTE A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
ARTICLE 65-1
Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23
se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 8 novembre 2017 pourvoi n° 16-23779 cassation sans renvoi
Vu l'article 9-1 du code civil, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la présomption d'innocence peuvent être réparés sur le seul fondement de l'article
9-1 du code civil ; que les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquent pas à l'assignation visant une telle atteinte ;
Attendu que, pour requalifier les demandes au titre de l'atteinte à la présomption d'innocence en demandes visant à réparer les conséquences
d'allégations et d'imputations diffamatoires et, en conséquence, prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 13 avril 2015, l'arrêt énonce que les
propos dénoncés dans l'assignation, au titre de l'atteinte à la présomption d'innocence, sont susceptibles de recevoir la qualification de diffamation et ne
peuvent, dès lors, être sanctionnés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, dont l'article 53 impose, à peine de nullité, que la citation précise et
qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaure, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence, un délai de
prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile ; que ces dispositions, d'ordre public, imposent au demandeur
d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés ; que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription doit être relevée d'office ;
Attendu qu'il résulte des constatations et appréciations souveraines des juges du fond que l'assignation du 13 avril 2015 n'a pas été délivrée dans le délai de
trois mois édicté par ce texte ; que la prescription se trouve donc acquise ;
ARTICLE 65-2
En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article
65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.
ARTICLE 65-3
Pour les délits prévus par l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième
et troisième alinéa de l'article 32 et les troisième et quatrième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an.
Pour ces délits, le deuxième alinéa de l'article 65 n'est pas applicable.
ARTICLE. 65-4
Les articles 54-1 et 65-3 et le dernier alinéa de l'article
55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les
faits prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24, aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de
l'article 33 lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement.
JURISPRUDENCE
Décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013
La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le
22 janvier 2013 deux questions prioritaires de constitutionnalité posées dans les mêmes termes par M. Laurent A. et cinq autres requérants. Ces questions étaient relatives à
l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 adaptant la justice aux évolutions de la criminalité.
L'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse instaure, pour certains délits prévus par cette loi, un délai de prescription
d'un an, par dérogation au délai de droit commun de trois mois prévu par
l'article 65 de cette même loi. Les requérants soutenaient que cette durée
particulière de prescription portait atteinte aux principes d'égalité devant la
loi et devant la justice. Le Conseil a écarté ces griefs et jugé l'article 65-3
de la loi du 29 juillet 1881 conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 65-3 prévoit un allongement du
délai de la prescription pour le délit de provocation à la discrimination ou à
la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à
raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévu et réprimé par le
huitième alinéa de l'article 24 de la loi de 1881, les délits de diffamation et
d'injure publiques commis aux mêmes fins, prévus et réprimés par le deuxième
alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33 et le délit de
contestation des crimes contre l'humanité, prévu et réprimé par l'article 24 bis de la même loi de 1881.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en portant de trois mois à un an le délai
de la prescription pour les délits qu'il définit précisément, l'article 65-3 de
la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de faciliter la poursuite et la
condamnation des auteurs de propos ou d'écrits incitant à la discrimination, à
la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à caractère ethnique,
national, racial, ou religieux ou contestant l'existence d'un crime contre
l'humanité. La différence de traitement qui résulte de ce délai de prescription
particulier pour les infractions poursuivies ne revêt pas un caractère
disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Il a donc été déclaré conforme à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 adaptant la justice aux évolutions de la criminalité ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par Me Antoine Comte, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 14 et 28 février 2013 ;
Vu les observations produites pour l'association « Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVA) » par la SCP Bensimhon-Associés, avocat au barreau
de Paris, enregistrées le 14 février 2013 ;
Vu les observations en interventions produites pour l'association « SOS soutien ô sans papiers » par Mes Henri Braun et Nawel Gafsia, avocats au barreau de
Paris, enregistrées le 31 janvier 2013 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association « La ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) » par la SCP Mendi-Cahn,
avocat au barreau de Mulhouse, enregistrées le 6 février 2013 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association « Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) » par Me Patrice
Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 12 février 2013 et 1er mars 2013 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association « SOS Racisme - Touche pas à mon pote » par Me Michaël Ghnassia, avocat au barreau de Paris,
enregistrées le 12 février 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 février 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Comte pour les requérants, Me Marc Bensimhon pour le BNVA, Me Braun, pour « SOS soutien ô sans papiers », Me Rodolphe Cahn pour la LICRA, Me Ghnassia pour
SOS Racisme, Me Spinosi pour le MRAP et Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 avril 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le premier alinéa de l'article 65 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que l'action publique
et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par
cette loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont
été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a
été fait ; que, toutefois, aux termes de l'article 65-3 de cette même loi, dans
sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 susvisée : « Pour les délits
prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième
alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an » ;
2. Considérant que, selon les requérants, en allongeant la durée de la
prescription pour certains délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, les
dispositions de l'article 65-3 portent atteinte aux principes d'égalité devant
la loi et la justice ; qu'ils font valoir en particulier que la courte
prescription prévue par l'article 65 de cette même loi constitue l'une des
garanties essentielles de la liberté de la presse ;
3. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse » ; qu'il est loisible au législateur, compétent
pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la
Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits,
les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition
que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que
soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au
respect du principe des droits de la défense ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi »
; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être
nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
5. Considérant que, par dérogation à la règle prévue par l'article 65 de la loi
du 29 juillet 1881 susvisée, qui fixe le délai de prescription de l'action
publique et de l'action civile à trois mois pour les infractions prévues par
cette loi, les dispositions contestées prévoient que ce délai est porté à un an
pour certains délits qu'elles désignent ; que cet allongement du délai de la
prescription vise le délit de provocation à la discrimination ou à la haine ou à
la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée, prévu et réprimé par le
huitième alinéa de l'article 24 de cette loi, les délits de diffamation et
d'injure publiques commis aux mêmes fins, prévus et réprimés par le deuxième
alinéa de son article 32 et le troisième alinéa de son article 33 et le délit de
contestation des crimes contre l'humanité, prévu et réprimé par son article 24 bis ; que les
règles de la prescription applicables à ces délits ne se distinguent des règles
applicables aux autres infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet
1881 que par la durée de ce délai de prescription ; qu'en particulier, ce délai
d'un an court à compter du jour où les délits ont été commis ou du jour du
dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait ;
6. Considérant qu'en portant de trois mois à un an le délai de la prescription
pour les délits qu'il désigne, l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 a
pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation, dans les conditions
prévues par cette loi, des auteurs de propos ou d'écrits provoquant à la
discrimination, à la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à
caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l'existence
d'un crime contre l'humanité ; que le législateur a précisément défini les
infractions auxquelles cet allongement du délai de la prescription est
applicable ; que la différence de traitement qui en résulte, selon la nature des
infractions poursuivies, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de
l'objectif poursuivi ; qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense ;
que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ;
7. Considérant que ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
adaptant la justice aux évolutions de la criminalité, est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
ARTICLE 66 : abrogé
ARTICLE 67 : abrogé
ARTICLE 68
Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés,
règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs à l'imprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à
l'affichage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent
revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures.
Est également abrogé le second paragraphe de l'article 31 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux,
relatif à l'appréciation de leurs discussions par les journaux.
ARTICLE 69
La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant
de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
ARTICLE 70
Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits
commis antérieurement au 16 février 1881, par la voie de la presse ou autres
moyens de publication, sauf l'outrage aux bonnes moeurs puni par l'article 28
de la présente loi et sans préjudice du droit des tiers.
Les amendes non perçues ne seront pas exigées. Les
amendes déjà perçues ne seront pas restituées, à l'exception de celles qui ont
été payées depuis le 16 février 1881.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et
par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.



INJURE ET DIFFAMATION SUR INTERNET
SUR INTERNET C'EST LA LOI SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE QUI S'APPLIQUE
LA DIFFERENCE ENTRE INJURE PUBLIQUE ET LE FAIT DIFFAMATOIRE
Dans les circonstances de a cause, "votre mauvaise éducation, votre indignité à exercer des mandats publics",
et : "c'est un comportement de voyou", ne renferment pas des imputations précises de nature à faire l'objet d'un débat
contradictoire et d'une preuve. il ne s'agit pas de diffamation mais d'injures publiques.
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-85.401 rejet
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10,
§ 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31 et 33 de la loi
du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu en considérant que
les propos litigieux ne constituaient pas une injure mais une diffamation ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet
1881 toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme
l'imputation d'aucun fait est une injure ; attendu, par ailleurs que selon
l'article 29, alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881 est diffamatoire
toute allégation ou imputation de faits précis de nature à porter atteinte à
l'honneur ou à la considération de la personne visée ; que peu importe que
l'allégation ou l'imputation soit faite sous une forme dubitative ou
interrogative ou même par insinuations dès lors qu'elle est suffisamment
significative à l'encontre de cette personne ; que, par suite, les expressions "
votre mauvaise éducation ", et " votre indignité à exercer des mandats publics "
ne peuvent être considérées comme étant une injure mais doivent être qualifiées
de diffamation publique dans la mesure où elles sont susceptible de faire
l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité ; que s'agissant du
mot " voyou ", il ne peut être pris dans sa seule acception mais doit
s'apprécier comme étant le qualificatif du terme " comportement " dans
l'expression " comportement de voyou ", que par suite, l'expression " c'est un
comportement de voyou ", placée dans le contexte dans lequel elle a été tenue,
renferme, elle aussi, des imputations précises de nature à faire l'objet de la
preuve contraire ;
que, dès lors, elle constitue une diffamation publique ; qu'en matière
d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être
appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l'acte initial
des poursuites ; que la juridiction de jugement ne peut substituer un délit de
presse à un autre délit de presse ; que, par suite, il convient de relaxer le
prévenu des faits d'injure publique ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans violer, par fausse
application, les dispositions visées au moyen et le principe précité, que les
propos suivants : « votre mauvaise éducation », « votre indignité à exercer des
mandats publics » et « comportement de voyou » constituaient une diffamation et
non une injure aux motifs, totalement erronés, que ces expressions sont
susceptibles de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de leur
vérité et que le mot « voyou » ne peut « être pris dans sa seule acception mais
doit s'apprécier dans l'expression ¿ comportement de voyou'qui, placée dans le
contexte dans lequel elle a été tenue, renferme, elle aussi, des imputations
précises de nature à faire l'objet de la preuve contraire », de tels propos, qui
s'analysent comme l'expression d'une opinion injurieuse, ne renfermant aucun
fait précis " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au
cours d'une séance du conseil municipal de Nice, un incident est survenu entre
M. Robert Y..., conseiller municipal d'opposition, et le maire, M. Christian
X..., qui lui reprochait de vouloir interrompre l'exposé du premier adjoint,
lors d'un débat d'orientation budgétaire ; que M. X...s'est adressé à ce
conseiller en ces termes :
« S'il vous plaît, cela suffit ! Votre mauvaise éducation,
votre indignité à exercer des mandats publics », et : « Vous quittez cet
hémicycle si vous n'êtes pas digne d'y tenir la place qui est la vôtre ; je suis
là pour faire respecter la police de séance, quand quelqu'un s'exprime, on
l'écoute et on le respecte ; on vous a écouté beaucoup trop longtemps, mais on
vous a écouté, ayez la correction d'écouter notre adjoint aux finances apporter
des réponses, sinon ce n'est pas la peine d'intervenir et de poser de fausses
questions », avant d'ajouter « c'est un comportement de voyou » ;
Que M. Y..., considérant que les expressions : " votre mauvaise éducation,
votre indignité à exercer des mandats publics ", et : " c'est un comportement de
voyou ", étaient injurieuses à son égard, a fait citer M. X...devant le tribunal
correctionnel ; que celui-ci ayant déclaré le prévenu coupable, les parties,
ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, et dire le délit d'injure non
constitué à la charge de M. X..., l'arrêt retient que les expressions
litigieuses, placées dans le contexte dans lequel elles ont été prononcées,
renferment des imputations précises, de nature à faire l'objet d'un débat
contradictoire et d'une preuve, et ne peuvent être qualifiées d'injures, mais constituent des diffamations ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que les propos
litigieux caractérisaient une diffamation, en l'absence d'imputation ou
d'allégation de faits suffisamment précis, l'arrêt n'encourt pas pour autant la
censure, dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en
assurer, les paroles injurieuses incriminées, prononcées, dans le contexte d'un
débat politique, par le maire, chargé de la police de l'assemblée municipale,
s'analysaient en une critique du comportement de l'un de ses membres dans
l'exercice de son mandat public, et ne dépassaient pas les limites admissibles
de la liberté d'expression, qui ne peut connaître d'ingérence ou de restriction,
en une telle circonstance, que pour des motifs impérieux, dont l'existence n'est pas établie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
L'outrage doit être prononcé directement au magistrat et non pas en public
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 1er mars 2016, pourvoi n° 15-82824 Cassation partielle sans renvoi
Vu les articles 434-24 du code pénal, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés
à l'article 23 de la loi susvisée sur la liberté de la presse, contre un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire à raison de ses fonctions ou à
l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal incriminant
l'outrage à magistrat, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le
tribunal correctionnel, des chefs de dénonciation calomnieuse et outrage à magistrat, en raison de la diffusion, sur un site internet et par voie
d'affichage sur la voie publique, d'un texte accusant un magistrat de viol d'enfant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et traitant l'intéressé de
" pédo-criminelle " et de " juge sorcière " ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits ; que le prévenu
et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur les poursuites du chef d'outrage, après relaxe du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt énonce que
les propos incriminés constituent un outrage de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction du magistrat concerné ; que les juges
ajoutent que toute expression injurieuse ou diffamatoire, lorsqu'elle s'adresse à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire dans l'exercice de ses
fonctions ou à l'occasion de cet exercice, est qualifiée d'outrage par l'article 434-24 du code pénal, même lorsqu'elle a été proférée publiquement ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les propos incriminés n'avaient pas été adressés au magistrat
visé, mais diffusés auprès du public selon l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d'appel a
méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet
l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
LA DIFFAMATION PAR EMAIL OU COURRIEL
Lorsqu'un courriel susceptible de contenir des propos diffamatoires à l'égard d'une personne a été adressé à des tiers, il
convient d'apprécier, avant toute autre chose, si ledit courriel a été envoyé à
ses destinataires dans des conditions exclusives de toute confidentialité. Ce n'est que si ce courriel a été adressé de manière non confidentielle qu'il
convient alors de déterminer, pour apprécier si la diffamation présente ou non
un caractère public, s'il a été envoyé à des destinataires liés ou non entre eux par une communauté d'intérêts
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 14 juin 2022 pourvoi N° 21-84.537 rejet
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La société [2] et M. [T] [I], biologiste co-gérant de cette société et
président de la société française d'informatique de laboratoire, ont porté
plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique
envers des particuliers, à la suite d'un courriel les mettant en cause, adressé
par M. [Y] [G] à neuf personnes concernées par les logiciels informatiques de
laboratoire de biologie médicale, à savoir le directeur général d'une entreprise
spécialisée dans l'informatique et la commercialisation de logiciels de gestion
de laboratoire de biologie médicale et vice-président de la société française
d'informatique de laboratoire, deux médecins biologistes, cinq pharmaciens biologistes et un médecin anatomopathologiste.
3. Les juges du premier degré ont relaxé M. [G] et débouté les parties civiles de leur demande.
4. Ces dernières ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6. Pour écarter toute faute civile à la charge de M. [G], l'arrêt attaqué énonce
que les destinataires du courriel en cause sont liés par une communauté
d'intérêts dès lors qu'ils sont tous concernés par l'objet de la société
française d'informatique de laboratoire, s'agissant de propos relatifs à la
probité et à la légitimité de M. [I] en qualité de président de ladite association.
7. Les juges ajoutent que le courriel revêt le caractère d'une correspondance
personnelle et privée et n'a perdu son caractère confidentiel que par le fait de l'un de ses destinataires.
8. Ils en déduisent qu'aucune faute civile ne peut être retenue à l'encontre de M. [G].
9. En se déterminant ainsi, et abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relatif à l'existence d'une communauté d'intérêts entre
l'expéditeur et les destinataires du courriel, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, lorsque le courriel a été adressé à des tiers par rapport à la
personne visée, il convient d'apprécier, avant toute autre chose, si ledit
courriel a été envoyé aux destinataires dans des conditions exclusives de toute
confidentialité et ce n'est que si ce courriel a été adressé de manière non
confidentielle qu'il convient alors de déterminer s'il a été envoyé à des destinataires liés par une communauté d'intérêts.
11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
LES BLOGS INTERNET SONT SOUMIS AUX LOIS DE LA PRESSE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 6 octobre 2011 Pourvoi N° 10-18.142 Cassation sans renvoi
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881
Attendu que reprochant à M. X...
d’être l’auteur d’un blog
le dénigrant, M. Y..., agissant tant en son nom propre qu’en ses qualités de
maire d’O... et de député du L..., l’a assigné en référé, sur le fondement de
l’article 1382 du code civil, en paiement de dommages intérêts, fermeture du
blog litigieux et
publication de la décision ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette demande
Attendu que pour rejeter le moyen
de défense de M. X... tendant à l’application aux faits litigieux des
dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l’arrêt attaqué énonce que le contenu
du blog de M. X..., qui a agi de façon anonyme et sous une présentation
trompeuse, cherche effectivement à discréditer M. Y... auprès des électeurs,
mais que cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le
tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d’une vision orientée et
partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement
au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération
Qu’en statuant ainsi alors que
dans son assignation M. Y... reprochait à M. X... de l’avoir dénigré dans des
termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté
d’expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 la cour d’appel a violé le texte susvisé
Et attendu que conformément à
l’article 411 3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, la Cour de
cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit
appropriée.
SUR INTERNET LA LIBERTÉ D'EXPRESSION EST PROTEGÉE PAR L'ARTICLE 10 DE LA CONV
EDH
LE DIESE SOIT LE # DE #BALANCE TON PORC DEMONTRE UNE
MODERATION DES PROPOS QUI E SONT PAS OUTRANCIERS
UNE BASE FACTUELLE SUFFISANTE
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2021), soutenant que
le message suivant : « « Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais
te faire jouir toute la nuit ». [E] [L] ex patron de Equidia #balancetonporc »,
publié le 13 octobre 2017 sur le compte Twitter de la société Audiovisuel
Business System Media (la société ABSM), administré par Mme [J], journaliste
indépendante, présentait un caractère diffamatoire à son égard, M. [L] a assigné Mme [J] et la société ABSM en réparation de son préjudice.
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 11 mai 2022, pourvoi n° 21-16.497 rejet
3. Il résulte des articles 10 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 29, alinéa 1er, de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que la liberté d'expression ne
peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des
mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.
4. En matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était
de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci
s'est exprimé dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est
appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans
l'expression, de rechercher en application du paragraphe 2 du premier de ces
textes, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si
lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une
base factuelle suffisante, afin, s'ils constatent que ces deux conditions sont
réunies, d'apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment l'absence
d'animosité personnelle et la prudence dans l'expression.
5. La cour d'appel a retenu que les propos litigieux contribuaient à un débat
d'intérêt général sur la dénonciation de comportements à connotation sexuelle
non consentis de certains hommes vis-à-vis des femmes et de nature à porter
atteinte à leur dignité.
6. Elle a relevé que les propos imputés à M. [L] avaient déjà été dénoncés par
Mme [J] dans un message publié sur Facebook, que M. [L] avait admis dans divers
médias les avoir tenus, que le message, reproduisant ces propos, visait
uniquement à dénoncer un tel comportement sans contenir l'imputation d'un délit
et que les termes « balance » et « porc » ne conduisaient pas à lui attribuer
d'autres faits qui auraient pu être commis à l'égard de Mme [J] ou d'autres femmes.
7. Elle a estimé que, si ces deux termes étaient outranciers, ils étaient
suffisamment prudents dès lors que les propos attribués à M. [L] étaient
accompagnés du mot-dièse « #balancetonporc », ce qui permettait aux internautes
de se faire leur idée personnelle sur le comportement de celui-ci et de débattre
du sujet en toute connaissance de cause.
8. Ayant ainsi analysé le sens et la portée de l'ensemble du message incriminé
et mis en balance les intérêts en présence, sans être tenue de se prononcer sur
des pièces que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel en a
déduit, à bon droit, que les propos incriminés reposaient sur une base factuelle
suffisante et demeuraient mesurés, de sorte que le bénéfice de la bonne foi devait être reconnu à Mme [J].
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 10 avril 2013, pourvoi n° 11-19530 Cassation Partielle
Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme
Attendu que pour interdire à Mme X... de reproduire sur son site internet les propos litigieux et de se prévaloir d’un lien quelconque
direct ou indirect avec le Comité du débarquement et/ou le musée Mémorial Pegasus de Ranville et pour la condamner in solidum avec l’ASPEG à payer
des dommages intérêts, l’arrêt énonce que lesdits propos revêtent un caractère mensonger et que ceux ci comme la confusion entretenue par Mme X... et
l’ASPEG sur leur site internet lui ont causé un préjudice
Qu’en statuant ainsi, alors que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans
les cas spécialement déterminés par la loi, et que les propos reproduits, fûssent ils mensongers, n’entrent dans aucun de ces cas, la cour d’appel a violé par fausse
application, le texte susvisé
L'HEBERGEUR MÊME CREATEUR DU SITE N'EST PAS RESPONSABLE DES INFORMATIONS QU'IL NE CONTRÔLE PAS
Cour de Cassation Chambre Civile 1 arrêt du 17 février 2011 pourvoiN° 09-13202 REJET
Attendu que la société Bloobox-net a créé sur internet un
site accessible à l'adresse http://www.fuzz.fr sur lequel sont diffusées des informations ; que le 31 janvier 2008 a été
publiée sur ce site, une brève rédigée en ces termes : "Kylie X... et Olivier
Y... réunis et peut-être bientôt de nouveau amants", accompagnée d'un titre
"Kylie X... et Olivier Y... toujours amoureux, ensemble à Paris", lui-même
assorti d'un lien renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site
www.célébrités-stars.blogspot.com ; qu'invoquant une atteinte à sa vie privée,
M. Y... a saisi le juge des référés pour voir obtenir réparation et retrait immédiat de l'article sous astreinte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 21 novembre 2008)
statuant en matière de référé, d'avoir débouté M. Y... de sa demande,
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que
l'activité de la société Bloobox-net, créatrice du site www.fuzz.fr, se bornait
à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public
pour faciliter l'usage de son service mais que cette société n'était pas
l'auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les
contenus du site, en a exactement déduit que relevait du seul régime applicable
aux hébergeurs, la responsabilité de ce prestataire, fût-il créateur de son
site, qui ne jouait pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données
stockées ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une
recherche qui ne lui était pas demandée a légalement justifié sa décision.
LE MOTEUR DE RECHERCHE GOOGLE N'EST PAS RESPONSABLE DES RESULTATS DE RECHERCHE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 19 février 2013 Pourvoi N° 12-12798 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2011), que M. X... a assigné la société Google Inc., M. Y... pris en
qualité de directeur de la publication du site internet www. google.fr ainsi que la société Google France du chef de diffamation à la suite de l’apparition, lors de la
saisie des termes sur le service “Google suggest” : “pierre X...[nom tronqué] ” ou “pierre X...” des mots ou propositions de requêtes, dans
la rubrique “recherches associées” : Pierre X... viol, Pierre X... condamné, Pierre X... sataniste Pierre X... prison, Pierre X... violeur
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué de mettre hors de cause M. Y...
Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que les critères de prudence dans l’expression et de
sérieux de l’enquête se trouvaient réunis au regard d’un procédé de recherche
dont la fonctionnalité se bornait à renvoyer à des commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu;
D’où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause la société Google France
Mais attendu que, par motifs tant propres qu’adoptés, la cour d’appel a relevé que la société
Google France sollicitait à bon droit sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’avait pas de responsabilité directe dans le fonctionnement du moteur de recherche ni dans le
site google.fr et qu’elle n’était pas concernée par l’élaboration des items incriminés ;
qu’elle a ainsi nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 19 juin 2013 Pourvoi N° 12-17591 Cassation
Vu les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Lyonnaise de garantie a assigné la société Google Inc., M. X... pris en qualité
de directeur de la publication du site internet www.google.fr ainsi que la société Google France du chef d’injure publique à la suite de l’apparition, lors de la saisie
des termes «Lyonnaise de g>" sur les moteurs de recherche accessibles aux adresses google.fr, google.be, google.uk, google.es, google.it et google.ca des mots ou
propositions de requêtes: «lyonnaise de garantie escroc» au troisième rang des suggestions proposées
Attendu que pour ordonner sous astreinte à M. X... en sa qualité de directeur de publication et à la société
Google Inc. en sa qualité de civilement responsable des sites internet précités de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service
«Prévisions de recherche» ou «service de saisie semi-automatique», à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres «lyonnaise de g» ou
«lyonnaise de garantie», l’expression «lyonnaise de garantie escroc» et les condamner à payer des dommages-intérêts à la société Lyonnaise de garantie, la cour d’appel énonce
que le fait de diffuser auprès de l’internaute l’expression «lyonnaise de garantie, escroc » correspond à l’énonciation d’une pensée rendue possible
uniquement par la mise en œuvre de la fonctionnalité en cause, qu’il est acquis aux débats que les suggestions proposées aux
internautes procèdent des sociétés Google à partir d’une base de données qu’elles ont précisément constituée pour ce
faire, lui appliquant des algorithmes de leur fabrication, que le recours à ce procédé n’est que le moyen d’organiser et de présenter les pensées que la
société Google met en circulation sur le réseau internet
Qu’en statuant ainsi, quand la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d’un processus purement
automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l’affichage des «mots clés» qui en résulte est exclusif de toute volonté
de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de
leur seule fonction d’aide à la recherche, la cour d’appel a violé les textes susvisés
L'HEBERGEUR MÊME CREATEUR DU SITE N'A QU'UNE OBLIGATION DE PROMPTITUDE
POUR RETIRER LES ELEMENTS LITIGIEUX APRES NOTIFICATION
Cour de Cassation Chambre Civile 1. N° de pourvoi: 09-15857 arrêt du 17 février 2011. REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que, le 7
février 2008, le conseil de M. X... a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Agence des médias numériques (la société AMEN),
dénonçant la diffusion par M. Y..., sur un site internet hébergé par cette
dernière, de documents portant atteinte à la vie privée de son client ; que M.
X... a par la suite agi en référé afin d'obtenir !a condamnation solidaire de M.
Y..., en raison de l'activité de ce site, et de la société AMEN, pour son retard
à en suspendre l'accès, au paiement d'une provision sur son préjudice
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si,
comme il le lui était demandé, la notification délivrée en application de la loi
susvisée comportait l'ensemble des mentions prescrites par ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 30 octobre 2012, pourvoi n° 10-88825 Annulation
Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis
donné aux parties, pris de la violation de l'article 93-3 de la loi du 29
juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, interprété selon la
réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2011-64 en date du 16 septembre 2011
Attendu qu'il se déduit de ce texte que la
responsabilité pénale du producteur d'un site de communication au public en
ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des
internautes n'est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s'il est
établi qu'il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas
contraire, il s'est abstenu d'agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance ;
Attendu que, pour dire établis à l'encontre de M. X..., président de
l'association de défense des intérêts des habitants des Bas-Heurts-La Varenne,
les faits de diffamation publique envers M. Y..., député-maire de
Noisy-le-Grand, pour avoir publié, sur l'espace de contributions personnelles du
site de cette association, les propos d'un internaute ainsi libellés : " Par
ailleurs, M. Y... cumule plusieurs mandats (député, maire) : sont-ils
compatibles avec d'autres fonctions (dans l'immobilier par exemple) ? Ne
confond-il pas intérêts personnels et spoliation des " petites gens " ? ",
l'arrêt attaqué retient notamment que M. X...doit être considéré comme l'auteur
du message litigieux dès lors qu'il assume aux yeux des internautes et des tiers
la qualité de producteur du blog de l'association susvisée sans qu'il puisse
opposer un défaut de surveillance dudit message ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans
rechercher si, en sa qualité de producteur, M. X...avait eu connaissance,
préalablement à sa mise en ligne, du contenu du message litigieux ou que, dans
le cas contraire, il s'était abstenu d'agir avec promptitude pour le retirer dès
qu'il en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas fait l'exacte
application de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la
communication audiovisuelle, au regard de la réserve du Conseil constitutionnel susvisée
LE DÉLAI DE PRESCRIPTION POUR INJURE EST DE TROIS MOIS A PARTIR
DE LA DATE DE LA PREMIÈRE PUBLICATION SUR UN SITE INTERNET
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 1er septembre 2020 pourvoi n° 19-84.505 Cassation
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le groupe Alternative libertaire a mis en
ligne, le 20 février 2017, sur son site internet, un communiqué contenant les
propos suivants : « La coordination fédérale d’Alternative libertaire a voté le
28 janvier 2017 l’exclusion de A..., membre du groupe local de Moselle, à la
suite d’une accusation de viol. Cette décision résulte d’une procédure fédérale
déclenchée au sein de l’organisation au mois de novembre 2016, suspendant
provisoirement le militant concerné. À l’issue de cette procédure,
l’organisation a estimé que les faits recueillis étaient extrêmement graves et
que la présence de ce militant à nos côtés était devenue impossible. Nous
souhaitons informer largement le milieu militant de notre décision afin de
s’assurer que de tels agissements de sa part ne trouvent plus leur place nulle
part, et nous invitons les autres cadres dans lesquels il peut agir à prendre
leurs dispositions pour assurer la sécurité de leurs militant.es et
sympathisant.es. Il nous semble primordial de briser le silence qui permet à de tels actes de continuer à exister ».
3. Le syndicat CNT Santé, social, collectivités
territoriales (SSCL) de Lorraine, dont le prénommé A... était adhérent, a
ultérieurement, le 5 mars 2017, publié un texte se référant à ce communiqué,
critiquant les procédures internes au groupe Alternative libertaire, faisant
savoir que les éléments en sa possession ne le conduisaient pas à la même
conclusion, s’agissant des faits de viol reprochés à l’intéressé, et rappelant
que le groupe Alternative libertaire avait précédemment agi différemment avec
deux autres de ses membres, également accusés de viol, mais qu’il n’avait pas exclus.
4. Le 9 mars suivant, ces deux textes ont été
reproduits intégralement sur un site internet tiers, accessible à l’adresse
[...], introduits par le titre « Accusé de viol, A... X... provoque une crise chez les antifas (MàJ) ».
5. Le même jour, Mme Y..., élue locale, a mis en
ligne, sur son compte au sein du réseau Facebook, un lien hypertexte renvoyant à
ladite publication, précédé notamment des mots « Où un groupuscule **antifa**
qui fait régner sa loi à Metz se justifie de couvrir son chef accusé de viol...
en accusant le groupuscule antifa qui le dénonce de couvrir... deux violeurs
dans leurs rangs. On en rirait, si le fond n’était pas aussi grave ».
6. Le 27 mai 2017, M. A... X... a porté plainte
et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique à raison du
seul texte émanant du groupe Alternative libertaire, mais en ce qu’il avait été
reproduit ultérieurement sur divers sites, dont celui de Mme Y....
7. Celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel qui l’a déclarée coupable.
8. Elle a relevé appel de ce jugement.
L’éventuelle prescription de l’action publique évoquée dans le rapport
9. Les poursuites ayant été engagées le 27 mai
2017, soit plus de trois mois après la première mise en ligne de l’écrit
litigieux, le 20 février 2017, il convient d’abord de s’interroger sur le point
de savoir si le lien hypertexte incriminé, qui y renvoie, inséré le 9 mars 2017,
a pu faire courir un nouveau délai de prescription.
10. La Cour de cassation juge que, lorsque des
poursuites pour diffamation et injures publiques sont engagées à raison de la
diffusion d’un message sur le réseau internet, le point de départ du délai de
prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de
publication, et que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la
première fois à la disposition des utilisateurs du réseau (Crim., 16 octobre
2001, pourvoi n° 00-85.728, Bull. crim. 2001, n° 210, rejet).
11. À l’égard de publications réalisées sur
papier, elle juge que le fait de publication étant l’élément par lequel les
infractions sont consommées, toute reproduction dans un écrit rendu public d’un
texte déjà publié est elle-même constitutive d’infraction, et que le point de
départ de la prescription, lorsqu’il s’agit d’une publication nouvelle, est fixé
au jour de cette publication (Crim., 8 janvier 1991, pourvoi n° 90-80.593, Bull.
crim. 1991, n° 13, cassation ; Crim., 2 octobre 2012, pourvoi n° 12-80.419,
Bull. crim. 2012, n° 204, rejet). Elle juge de même pour les rediffusions à la
radio ou à la télévision (Crim., 8 juin 1999, pourvoi n° 98-84.175, Bull. crim. 1999, n° 128, rejet).
12. Sur le réseau internet, elle rappelle ce
même principe et, l’appliquant au cas d’une nouvelle mise à disposition du
public d’un contenu litigieux précédemment mis en ligne sur un site internet
dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet,
après l’avoir désactivé, juge qu’il s’agit d’une reproduction faisant courir un
nouveau délai de prescription (Crim., 7 février 2017, pourvoi n° 15-83.439,
Bull. crim. 2017, n° 38, cassation).
13. Elle a, en revanche, précisé que la simple
adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait
caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l’identique
sur ce site (Crim., 6 janvier 2009, pourvoi n° 05-83.491, Bull. crim. 2009,
n° 4, rejet), étant observé qu’une telle adjonction avait été le fait de l’éditeur du site.
14. S’agissant enfin spécifiquement du recours à
un lien hypertexte, elle juge que l’insertion, sur internet, par l’auteur d’un
écrit, d’un tel lien renvoyant directement audit écrit, précédemment publié,
caractérise une telle reproduction (Crim., 2 novembre 2016, pourvoi
n° 15-87.163, Bull. crim. 2016, n° 283, cassation).
15. Il en résulte qu’un lien hypertexte qui,
comme au cas présent, renvoie directement à un écrit qui a été mis en ligne par
un tiers sur un site distinct, constitue une reproduction de ce texte, qui fait
courir un nouveau délai de prescription, de sorte que l’action publique n’était pas prescrite.
SI LES ÉCRITS SONT A NOUVEAU PUBLIÉS, UN NOUVEAU DÉLAI DE PRESCRIPTION COURT
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 7 février 2017 pourvoi n°15-83439 Cassation
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que toute reproduction, dans un écrit rendu public, d'un texte déjà publié, est constitutive d'une publication
nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu'une nouvelle mise à disposition du public, d'un contenu précédemment mis en ligne
sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l'avoir désactivé, constitue une telle reproduction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, que, le 29 mai 2013, la société Atrium Gestion a porté plainte avec constitution
de partie civile du chef de diffamation, en raison d'un article publié sur le site internet www. stopauxarnaquesdessyndics. com ; qu'elle a exposé avoir déjà
déposé une plainte après la publication, les 1er, 7 et 9 décembre 2010, de ce même article sur ce site et avoir fait établir, par acte d'huissier de justice
du 15 juin 2012, qu'il n'était plus en ligne ; que, le 24 avril 2013, elle a fait constater, par acte d'huissier, qu'avec le même contenu, le site était de
nouveau en ligne, ce qui constitue une réédition des propos ; qu'une information ayant été ouverte, M. X..., identifié comme directeur de publication du site en
cause et mis en examen, a fait valoir qu'il l'avait désactivé en juin 2012 avant de le réactiver, avec le même contenu, en septembre ou octobre 2012 ; que le
juge d'instruction, considérant que les faits étaient prescrits, a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'opération de réactivation du site
stopauxarnaquesdessyndics.com n'a pas constitué un nouvel acte de publication ; que les juges concluent que la première mise à disposition du public étant les
1er, 7 et 9 décembre 2010, l'action publique était prescrite au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 2 novembre 2016 pourvoi n°15-87163 Cassation
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte dudit article qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, le point de départ de la prescription est le jour de la
publication de l'écrit incriminé, par laquelle se consomment les délits que celui-ci peut contenir ; qu'il suit de là que toute reproduction, dans un écrit
rendu public, d'un texte déjà publié, est constitutive d'une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; que
l'insertion, sur internet, par l'auteur d'un écrit, d'un lien hypertexte renvoyant directement audit écrit, précédemment publié, caractérise une telle reproduction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., inspecteur des impôts, a porté plainte et s'est constitué partie civile du
chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public en raison de la mise en ligne sur un site internet édité par M. Y..., le 29 juin 2011, du texte d'une
citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris que celui-ci lui avait fait délivrer, texte directement accessible par un lien hypertexte
inséré dans un article intitulé " La preuve par trois " ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel, M. Y... a excipé de la prescription de l'action
publique, au motif qu'il avait, le 26 mai 2010, rendu accessible la même citation à comparaître depuis un précédent article intitulé " L'enfer-Ici tout
de suite " également mis en ligne sur un site internet qu'il éditait ; que les juges du premier degré ont écarté ce moyen et ont déclaré le prévenu coupable ;
que celui-ci a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et dire la prescription acquise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte incriminé avait été rendu à nouveau accessible par son auteur au moyen d'un lien hypertexte, y
renvoyant directement, inséré dans un contexte éditorial nouveau, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé
La simple adjonction d'une seconde adresse
pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l'identique sur ce site.
Cour de Cassation Chambre Criminelle. N° de pourvoi: 05-83491 arrêt du 6 janvier 2009. CASSATION
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881
Attendu que, lorsque des
poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi précitée sont engagées
en raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un
site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par
l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier
acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis
pour la première fois à la disposition des utilisateurs
Attendu qu'il résulte de l'arrêt
attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Louis X... a été renvoyé devant
le tribunal correctionnel des chefs susvisés, en raison de la diffusion, le 10
juillet 1997, sur le réseau internet, à l'adresse Http : //..., de trois textes
intitulés " Apprenez le caniveau aux bicots ", " Les races puent " et "
Blanchette, tapette à bicots " ; que, par jugement du 28 janvier 1999, le
tribunal, constatant que ces textes étaient en tous points identiques à ceux
diffusés également à l'adresse Http : // altern...., dès avant le 8 avril 1997,
a déclaré l'action publique prescrite, dès lors que leur publication avait eu
lieu plus de trois mois avant le premier acte de poursuite, constitué par les
réquisitions du procureur de la République aux fins d'enquête, en date du 29
septembre 1997 ; que, par arrêt du 15 décembre 1999, la cour d'appel, infirmant
le jugement déféré, a déclaré les faits non prescrits et renvoyé l'affaire à une
audience ultérieure ; que, par arrêt du 20 décembre 2000, Jean-Louis X... a été
déclaré coupable ; que, par arrêt du 27 novembre 2001, la Cour de cassation a
cassé les deux arrêts susvisés et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée
Attendu que, pour infirmer le jugement
entrepris, la cour d'appel, après avoir constaté que les textes incriminés
pouvaient être consultés, le 10 juillet 1997, soit à l'adresse Http : // altern....
soit à l'adresse Http : //..., retient qu'en créant un nouveau mode d'accès au
site existant, plus accessible par une adresse plus courte et donc plus simple
que la dénomination initiale, Jean-Louis X... a renouvelé la mise à disposition
desdits textes dans des conditions assimilables à une réédition ; qu'ils
ajoutent que ce nouvel acte de publication est intervenu moins de trois mois
avant le premier acte interruptif de prescription et que l'action publique n'est donc pas prescrite
Mais attendu qu'en statuant ainsi,
alors que la simple adjonction d'une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes
figurant déjà à l'identique sur ce site, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé
LA RESPONSABILITÉ DE LA PRESCRIPTION APPARTIENT A LA PARTIE CIVILE
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 20 octobre 2015 pourvoi n°14-87122 REJET
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de
l'homme, 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles préliminaire, 7, 8, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte assortie de constitution de partie civile déposée par M.
X..., du chef de diffamation publique envers particulier, en raison de la publication dans le journal Le Monde du 23 avril 2003 d'un article intitulé "Un
témoignage éclaire les dessous des ventes d'armes à l'Angola", M. Y..., directeur de publication, et M. Z..., journaliste, ont été renvoyés devant le
tribunal correctionnel ; que les prévenus ayant fait une offre de preuve des faits réputés diffamatoires, et quatre des témoins dénoncés à ce titre étant mis
en examen dans l'affaire dite "de l'Angolagate", le tribunal correctionnel, par jugement du 13 décembre 2005, a ordonné un sursis à statuer jusqu'au prononcé
d'une décision définitive sur les poursuites engagées à leur encontre ; que l'instance en diffamation ayant, dans cette attente, fait l'objet de renvois
successifs, les prévenus ont, à l'audience du 19 septembre 2013, excipé de la prescription de l'action publique ; que le tribunal ayant, par jugement du 17
octobre 2013, fait droit à cette exception, la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, et dire l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt relève que la procédure dite "de l'Angolagate" a pris
fin par l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mai 2011, constatant le désistement du pourvoi qu'avait formé M. A... contre l'arrêt
de la cour d'appel de Paris du 29 avril 2011, et que, le cours de la prescription trimestrielle n'étant plus suspendu depuis cette date, et l'affaire
ayant continué de faire l'objet de renvois successifs, il s'est écoulé un délai supérieur à trois mois entre l'audience du 10 janvier 2012 et celle du 19 juin
2012, sans qu'aucun acte interruptif ne soit intervenu, alors qu'il revenait à la partie poursuivante de s'assurer que la cause du sursis n'avait pas disparu,
et de prendre toutes précautions utiles à ce titre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartient à la partie civile de surveiller le déroulement de la
procédure et d'accomplir les diligences utiles pour poursuivre l'action qu'elle a engagée, en faisant citer elle-même le prévenu à l'une des audiences de la
juridiction, avant l'expiration du délai de prescription, et que cette obligation n'est pas incompatible avec les articles 6 et 13 de la Convention
européenne des droits de l'homme quand, comme en l'espèce, il n'existe pour elle aucun obstacle de droit ou de fait la mettant dans l'impossibilité d'agir
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 17 février 2015 pourvoi n°13-88129 cassation
Vu les articles 8 du code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si l'action publique résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après trois mois
révolus à compter du jour où l'infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait, la prescription est
interrompue par l'audience à laquelle ont lieu les débats, et suspendue pendant la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l'impossibilité
d'accomplir un tel acte de procédure avant le prononcé du jugement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... et l'association Sollies environnement et urbanisme, dont il est le
président, ont fait citer M. Y..., maire de la commune de Sollies Pont, devant le tribunal correctionnel des chefs d'injures et diffamation publiques envers un
particulier en raison de propos tenus par celui-ci lors d'un conseil municipal ; que l'audience des débats a eu lieu le 1er mars 2013 ; que par jugement du 8
avril 2013, le tribunal correctionnel, après avoir procédé d'office à la requalification des faits poursuivis, a déclaré M. Y... coupable d'injures et
diffamation publiques commises envers un fonctionnaire ou un dépositaire de l'autorité publique; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire l'action publique prescrite, après avoir annulé le jugement prononcé le 8 avril 2013, l'arrêt retient qu'en l'état de cette
annulation, la prescription a couru du précédent jugement, en date du 7 janvier 2013, par lequel le tribunal avait fixé la consignation à verser par les parties
civiles, que le mandement de citation du procureur général, seul acte interruptif de prescription, est intervenu le 11 juin 2013 et qu'un délai de
plus de trois mois s'est donc écoulé entre ces deux actes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action publique a été interrompue par l'audience des débats du 1er mars 2013, dont le
déroulement est attesté par les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président, conformément à l'article 453 du code de procédure
pénale, puis suspendue pendant la durée du délibéré du tribunal correctionnel, peu important que le jugement prononcé ait été ultérieurement annulé, la cour
d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 28 octobre 2014 pourvoi n°13-86303 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que, par courrier du 14 septembre 2012, M. Bernard X..., candidat aux élections législatives de juin 2012, a porté plainte et s'est constitué partie
civile du chef de diffamation publique, à la suite de la distribution, par M. Jean-Christophe Y..., de deux tracts qu'il estimait porter atteinte à son
honneur et à sa considération ; que, par ordonnance du 22 avril 2013, le juge d'instruction, après avoir relevé que les documents litigieux avaient été
distribués à compter du 13 juin 2012, a constaté la prescription de l'action publique au jour du dépôt de la plainte ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, le point de départ du délai de prescription de trois mois fixé par l'article 65 de la loi du 29
juillet 1881 pour les infractions de presse, qui sont des infractions instantanées, court du jour de la première diffusion de l'écrit incriminé, et
que, d'autre part, la rediffusion d'un même écrit, sans reproduction ni réimpression, ne constitue pas une nouvelle publication, la chambre de
l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté
Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 12 avril 2012 N° de pourvoi: 11-20664 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), que la société Nouvelle
du Journal de l'Humanité (la société) a mis en ligne, au courant du mois d'août 1996, sur son site Internet des articles concernant l'état de santé de M. X... ;
que, considérant que ces informations étaient constitutives d'une atteinte à sa vie privée au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X... a fait assigner, par acte du 7 septembre 2009, la société devant un tribunal de grande
instance en réparation du préjudice résultant de cette faute civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action alors, selon le moyen, que le délai de prescription de l'action en responsabilité
extracontractuelle court à compter du jour de la manifestation du dommage causé à la victime ou de la date à laquelle il a été révélé à cette dernière, si
celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en ayant décidé que le délai de prescription de l'action en responsabilité pour atteinte à la vie
privée engagée par M. X... avait couru à compter de la mise en ligne sur l'Internet du texte litigieux au mois d'août 1996 et non à compter de la
révélation du dommage à la victime au mois d'avril 2009, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil ;
Mais attendu que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau Internet d'un
message, court à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué ;
Et attendu que l'arrêt retient que le texte incriminé déjà publié sur le support
papier le 14 janvier 1991 a été mis en ligne courant août 1996 ; qu'étant exclusif de toute confidentialité depuis cette époque, ce texte ne pouvait être
considéré comme "étant clandestin" ; que c'est à partir de cette mise en ligne, équivalente à la mise à disposition du public, que le délai de prescription de
dix ans devait être calculé et non à partir des seules constatations de M. X..., datant du 6 mai 2009, soit treize ans après la révélation au public du texte ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'‘appel a exactement décidé que l' action engagée par M. X... était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 16 septembre 2014 N° de pourvoi 13-85457 Cassation partielle
Vu l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon ce texte, en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins
d'enquête articulant et qualifiant les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces de la
procédure que plusieurs actes d'enquête ont été effectués entre le 10 mars 2012, date de mise en ligne des propos incriminés, et le 11 juin 2012, date
d'expiration du délai de trois mois prévu par la loi du 29 juillet 1881, soit l'audition de Mme Y..., le 13 mars 2012, les investigations effectuées le 16
avril 2012 sur le site "conscience-vraie.info", et l'audition de Mme X..., le 7 juin 2012 ; que les juges retiennent que ces éléments d'enquête ont chacun
interrompu la prescription durant la période alléguée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction, ni aucune réquisition d'enquête articulant et qualifiant la
diffamation, n'ont été réalisés entre la date des faits et la mise en mouvement de l'action publique par la délivrance, le 10 janvier 2013, d'une convocation en
justice à la prévenue, et qu'un délai de plus de trois mois s'étant ainsi écoulé, l'action publique du chef de diffamation était éteinte par l'effet de la
prescription, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que la Cour de cassation appliquera directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L.411-3
du code de l'organisation judiciaire, concernant la poursuite du chef de diffamation publique
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 12 novembre 2014 pourvoi n° 13-88109 cassation
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de ce texte que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de
la presse se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ; que
ce délai se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte du 23 novembre 2011, M. X... a fait citer, sur le fondement des
articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, M. Y..., maire de la commune de Bayonne, pour avoir tenu, à l'occasion de la séance du conseil municipal en date
du 26 mai 2011, des propos qu'il a estimé diffamatoires et injurieux à son égard ; que le procès-verbal du conseil municipal du 26 mai 2011 reproduisant ces
propos a été mis en ligne à la disposition du public sur le site de la mairie ; que le tribunal ayant souverainement retenu le 23 août 2011 au plus tard comme
date de publication en ligne desdits propos, a constaté l'extinction de l'action publique et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. X... ;
que ce dernier et le ministère public ont relevé appel de la décision;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et dire l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que c'est le 23 novembre 2011 à minuit qu'était venu à expiration le délai de prescription de l'action publique,
la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé;
D'où il suit que la cassation est encourue
IL FAUT DONC POURSUIVRE L'AUTEUR DU CONTENU. UNE AFFIRMATION DOIT ÊTRE PRECISE POUR ÊTRE DIFFAMATOIRE
Cour de Cassation Chambre Civile 1. N° de pourvoi: 10-15447 arrêt du 22 septembre 2011. CASSATION
Mais attendu qu’ayant retenu que l’expression "l’avocat
maritimiste Me X... et Total ont tout intérêt à ce que l’indien ne déterre pas la hache de guerre"
était trop elliptique, imprécise et insuffisamment alarmante pour constituer un
acte d’intimidation vis-à-vis d’un avocat et que les propos tenus dans la lettre
ouverte relevaient tout au plus de l’allusion douteuse, de l’ironie déplacée
voire de l’humour de mauvais goût et qu’il n’était pas démontré qu’ils
tendissent à
influencer la manière dont M. X... devait défendre son client devant la
juridiction correctionnelle, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’existait
pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent justifiant la mise
en œuvre d’injonctions ;
D’où il suit que le moyen
n’est pas fondé ;
Mais sur le premier
moyen :
Vu l’article 53 de la loi
du 29 juillet 1881, ensemble l’article 5 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre
1971 modifiée et l’article 165 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991
modifié ;
Attendu que pour annuler
la partie des assignations fondée sur la loi du 29 juillet 1881 faute d’élection
de domicile dans la ville de
Lorient et débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce que
s’il est désormais admis par référence à l’article 751 du code de procédure
civile que la mention dans l’assignation de l’intervention d’un avocat inscrit
au barreau du tribunal de la ville où siège la juridiction saisie emporte
élection de domicile du demandeur au sens de l’article 53 de la loi du 29
juillet 1881, encore faut il que cet avocat ait son domicile professionnel en
cette ville et qu’en l’espèce les assignations mentionnent, d’une part, que
M. X... demandeur à l’instance est domicilié à
Nantes, d’autre part,
qu’il a pour avocat Me A.., certes inscrit au barreau de
Lorient, mais dont le
domicile professionnel est situé à
Larmor Plage, commune
distincte de celle où siège la juridiction
lorientaise
Qu’en statuant ainsi,
quand la constitution d’un avocat postulant devant le tribunal de grande instance saisi de l’action en diffamation vaut élection de domicile au sens de
l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a violé les textes susvisés
POSTER SUR FACEBOOK N'EST PAS UNE INJURE PUBLIQUE PUISQU'IL S'AGIT D'UNE COMMUNAUTÉ
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 10 avril 2013, pourvoi n° 11-19530 Cassation Partielle
Mais attendu qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y...
tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint,
la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles ci formaient une communauté d’intérêts; qu’elle en a exactement déduit que
ces propos ne constituaient pas des injures publiques; que le moyen n’est pas touché en ses quatres premières branches;
Mais sur la cinquième branche du moyen
Vu l’article R. 621 2 du code pénal
Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., la cour d’appel s’est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques;
Qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non
publiques, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé
COUR APPEL DIJON
CA Dijon, 27 fév. 2018,
n°17/00035 : jurisdata n°2018-002532
Si le caractère public de propos qui seraient diffusés dans
la presse nationale, à la télévision ou sur Internet ne semble pas poser de
difficultés, qu’en est-il pour des propos qui seraient tenus sur un réseau
social comme Facebook ? Un arrêt de la Cour d’appel de Dijon vient illustrer
cette question, même s’il s’agit d’une affaire qui ne concernait pas un réseau
de distribution.
Une personne avait engagé une action en responsabilité
délictuelle contre une autre personne à qui elle reprochait d’avoir proférer des
injures publiques sur Facebook à son encontre. Elle réclamait l’indemnisation du
préjudice subi.
La Cour d’appel relève tout d’abord que les textes incriminés
mis en ligne n’étaient accessibles qu’à un nombre restreint de membres choisis,
qui, « compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales,
forment une communauté d’intérêts ». Cela excluait donc le caractère d’injure
publique.
Elle précise ensuite que si la personne était identifiable,
elle n’était pas destinataire des propos puisque ne faisant pas partie des
contacts de l’intimé et que ces propos devaient être appréciés « dans le cadre
dans lequel ils ont été tenus, c’est-à-dire auprès d’un petit groupe de
contacts, dans un but manifeste d’exutoire et dans le but de nuire à Mme A ».
Elle conclut qu’en l’espèce les propos n’ont pas de caractère
fautif et ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité de leur
auteur.
LE JUGE FRANÇAIS N'A PAS COMPÉTENCE UNIVERSELLE, IL N'EXAMINE QUE LES PUBLICATIONS DESTINÉES AUX FRANÇAIS
N'importe quel tribunal de France peut poursuivre, à condition que le site Internet soit destiné aux français
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 12 juillet 2016 Pourvoi N° 15-86645 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme X..., de nationalités américaine
et japonaise, et sa soeur, Mme A..., de nationalité japonaise, toutes deux domiciliées au Japon, ont fait citer M. Y..., de nationalité sud-africaine,
devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers des particuliers, en raison de deux textes en langue anglaise mis en ligne sur le
site internet accessible à l'adresse kickstarter. com et évoquant les relations professionnelles entretenues au Japon par les intéressés ; que les juges du
premier degré se sont déclarés incompétents ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt énonce que, si les infractions de presse sont réputées commises en tout lieu où
les propos incriminés ont été reçus, lorsque ces derniers ont été diffusés sur le réseau internet, la compétence territoriale du tribunal français saisi, qui
ne saurait être universelle, ne peut être retenue que si les pages du site les contenant sont à destination du public français ; que les juges ajoutent que, ni
les propos, en langue anglaise, qui visent des personnes de nationalité japonaise et/ ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des événements
qui se sont déroulés dans ce pays, ni le site internet américain sur lequel ils ont été mis en ligne par une personne qui n'était pas de nationalité française,
ne sont orientés vers le public français, peu important que ce site soit accessible depuis le territoire national ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'en l'absence de tout
critère rattachant au territoire de la République les propos incriminés, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet,
aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérisait pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis
LE DISCOURS DE HAINE SUR INTERNET
Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme :
Avis
sur la lutte contre les discours de haine sur Internet.
Conseil Constitutionnel, décision n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017 - M. David P.
[Délit de consultation habituelle des sites internet terroristes II]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 octobre 2017 par le Conseil
d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article
421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
Ces dispositions ont rétabli, sous une nouvelle rédaction, le délit de
consultation habituelle de sites internet terroristes dont le Conseil
constitutionnel avait censuré une première rédaction par sa décision n° 2016-611
QPC du 10 février 2017. L'article 421-2-5-2 du code pénal, dans cette nouvelle
rédaction, sanctionne d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
euros d'amende le fait de consulter de manière habituelle, sans motif légitime,
un service de communication au public en ligne faisant l'apologie ou provoquant
à la commission d'actes de terrorisme et comportant des images ou
représentations d'atteintes volontaires à la vie. Ce délit a pour objet de
prévenir l'endoctrinement d'individus susceptibles de commettre ensuite de tels actes.
Il était notamment soutenu que la liberté de communication était méconnue par
ces dispositions dès lors que l'atteinte portée par la disposition contestée
n'était ni nécessaire, compte tenu des dispositifs juridiques déjà en vigueur, ni adaptée et proportionnée.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle sa jurisprudence
constante déduisant de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard
au développement généralisé des services de communication au public en ligne
ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie
démocratique et l'expression des idées et des opinions, la liberté de
communication implique la liberté d'accéder à de tels services. Sur le fondement
de l'article 34 de la Constitution, il est loisible au législateur d'édicter des
règles de nature à concilier avec l'exercice du droit de libre communication et
de la liberté de parler, écrire et imprimer la poursuite de l'objectif de lutte
contre l'incitation et la provocation au terrorisme sur les services de
communication au public en ligne, qui participe de l'objectif de valeur
constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des
infractions. Toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant
plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des
garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à
l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
S'agissant de la conformité des dispositions contestées au regard du principe de
nécessité des peines, le Conseil constitutionnel relève, comme il l'avait fait
par sa décision du 10 février 2017 précitée, que, d'une part, la législation
comprend un ensemble d'infractions pénales autres que celle contestée et de
dispositions de procédure pénale spécifiques ayant pour objet de prévenir la
commission d'actes de terrorisme et que, d'autre part, le législateur a
également conféré à l'autorité administrative de nombreux pouvoirs afin de
prévenir la commission d'actes de terrorisme. Au recensement des dispositions
législatives en vigueur précédemment opéré dans sa décision de février et repris
aux paragraphes 7 à 11 de la décision de ce jour, le Conseil constitutionnel
ajoute que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions contestées, le
législateur a complété les pouvoirs de l'administration en adoptant, par la loi
n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme, de nouvelles mesures individuelles de contrôle
administratif et de surveillance aux fins de prévenir la commission d'actes de
terrorisme. Il en déduit qu'au regard de l'exigence de nécessité de l'atteinte
portée à la liberté de communication, les autorités administrative et judiciaire
disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses prérogatives, non
seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne
provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et pour réprimer leurs
auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour
l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un
comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution.
S'agissant des exigences d'adaptation et de proportionnalité requises en matière
d'atteinte à la liberté de communication, le Conseil constitutionnel relève que,
si les dispositions contestées prévoient que, pour tomber sous le coup du délit
qu'elles instaurent, la consultation doit s'accompagner de la manifestation de
l'adhésion à l'idéologie exprimée sur les sites consultés, cette consultation et
cette manifestation ne sont pas susceptibles d'établir à elles seules
l'existence d'une volonté de commettre des actes terroristes. Ces dispositions
répriment donc d'une peine de deux ans d'emprisonnement le seul fait de
consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne,
sans que soit retenue comme élément constitutif de l'infraction l'intention
terroriste de l'auteur de la consultation. En outre, si le législateur a exclu
la pénalisation de la consultation lorsqu'elle répond à un « motif légitime »,
la portée de cette exemption ne peut être déterminée en l'espèce, faute
notamment qu'une personne adhérant à l'idéologie véhiculée par ces sites
paraisse susceptible de relever de l'un des exemples de motifs légitimes énoncés
par le législateur. Il en résulte une incertitude sur la licéité de la
consultation de certains services de communication au public en ligne et, en
conséquence, de l'usage d'internet pour rechercher des informations.
Le Conseil constitutionnel déduit de tout ce qui précède que les dispositions
contestées portent une atteinte à l'exercice de la liberté de communication qui
n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Il les déclare dès lors inconstitutionnelles en donnant effet immédiat à cette déclaration.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 octobre
2017 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2518 du 4 octobre
2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une
question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M.
David P. par Me Sami Khankan, avocat au barreau de Nantes. Elle a été
enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n°
2017-682 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit de l'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
- la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique ;
- la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la
lutte contre le terrorisme ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-611 QPC du 10 février 2017 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par Me Claire Waquet, avocat au
Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Khankan le 31 octobre 2017 et le
15 novembre 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 31
octobre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la Ligue des droits de
l'Homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, enregistrées le 31 octobre 2017 et le 15 novembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association La Quadrature
du Net par Me Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, avocat au barreau de Paris,
enregistrées le 31 octobre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Mes Waquet et Khankan, pour le requérant, Me Fitzjean Ó
Cobhthaigh, pour l'association La Quadrature du Net, et Me François Sureau,
avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la Ligue des droits de
l'Homme, parties intervenantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier
ministre, à l'audience publique du 4 décembre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction
issue de la loi du 28 février 2017 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Le fait de
consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au
public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations
soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant
l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou
représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes
volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende lorsque cette consultation s'accompagne d'une manifestation de
l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service.
« Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la
consultation résultant de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet
d'informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou
réalisée afin de servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation
s'accompagne d'un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques
compétentes ».
2. Le requérant soutient qu'en adoptant à nouveau un délit
de consultation habituelle de sites internet terroristes, alors que le Conseil
constitutionnel en a censuré une précédente rédaction dans sa décision du 10
février 2017 mentionnée ci-dessus, le législateur aurait méconnu l'autorité de
chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel. Il reproche ensuite aux
dispositions contestées de méconnaître le principe de légalité des délits et des
peines et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et
d'intelligibilité de la loi en raison de l'imprécision des termes employés. Il
soutient également que la liberté de communication serait méconnue dès lors que
l'atteinte portée par la disposition contestée ne serait ni nécessaire, compte
tenu des dispositifs juridiques déjà en vigueur, ni adaptée et proportionnée. Le
requérant dénonce par ailleurs la violation du principe d'égalité devant la loi
qui résulterait du fait, d'une part, qu'est seule réprimée la consultation d'un
site internet publiant le contenu illicite mais pas celle d'un contenu identique
publié par un autre moyen et, d'autre part, que seules certaines personnes
pourraient avoir légalement accès à ces contenus, à raison de leur profession ou
d'un motif légitime. Selon le requérant, les dispositions contestées
méconnaîtraient également le principe de nécessité des délits et des peines,
dans la mesure où elles incriminent la seule consultation de sites internet et
non la commission d'actes laissant présumer que la personne aurait cédé aux
incitations publiées sur ces sites. Enfin, l'article 421-2-5-2 du code pénal
instaurerait une présomption de culpabilité contraire à l'article 9 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où il
serait impossible à l'intéressé de démontrer que son intention, en consultant
ces sites, n'était pas de se radicaliser. Les associations intervenantes
développent pour partie les mêmes griefs.
- Sur le fond :
3. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement
généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à
l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique
et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté
d'accéder à ces services.
4. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La
loi fixe les règles concernant ... les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».
Sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature
à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre l'incitation et la
provocation au terrorisme sur les services de communication au public en ligne,
qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre
public et de prévention des infractions, avec l'exercice du droit de libre
communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer. Toutefois, la
liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son
exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect
des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette
liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif
poursuivi.
5. Les dispositions contestées sanctionnent d'une peine de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de consulter de
manière habituelle, sans motif légitime, un service de communication au public
en ligne faisant l'apologie ou provoquant à la commission d'actes de terrorisme
et comportant des images ou représentations d'atteintes volontaires à la vie.
Elles ont pour objet de prévenir l'endoctrinement d'individus susceptibles de
commettre ensuite de tels actes.
6. En premier lieu, comme le Conseil constitutionnel l'a
relevé dans sa décision du 10 février 2017, la législation comprend un ensemble
d'infractions pénales autres que celle prévue par l'article 421-2-5-2 du code
pénal et de dispositions procédurales pénales spécifiques ayant pour objet de
prévenir la commission d'actes de terrorisme.
7. Ainsi, l'article 421-2-1 du code pénal réprime le fait
de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de
terrorisme. L'article 421-2-4 du même code sanctionne le fait d'adresser à une
personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou
avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin
qu'elle participe à un groupement ou une entente prévus à l'article 421-2-1 ou
qu'elle commette un acte de terrorisme. L'article 421-2-5 sanctionne le fait de
provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement
l'apologie de ces actes. Enfin, l'article 421-2-6 réprime le fait de préparer la
commission d'un acte de terrorisme dès lors que cette préparation est
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but
de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle
est caractérisée par le fait de détenir, de se procurer ou de fabriquer des
objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ainsi que par
d'autres agissements tels que la consultation habituelle d'un ou de plusieurs
services de communication au public en ligne provoquant directement à la
commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.
8. Dans le cadre des procédures d'enquête relatives à ces
infractions, les magistrats et enquêteurs disposent de pouvoirs étendus pour
procéder à des mesures d'interception de correspondances émises par voie de
communication électronique, de recueil des données techniques de connexion, de
sonorisation, de fixation d'images et de captation de données informatiques. Par
ailleurs, sauf pour les faits réprimés par l'article 421-2-5 du code pénal, des
dispositions procédurales spécifiques en matière de garde à vue et de
perquisitions sont applicables.
9. Par ailleurs, le législateur a conféré à l'autorité
administrative de nombreux pouvoirs afin de prévenir la commission d'actes de
terrorisme.
10. Ainsi, en application du 4° de l'article L. 811-3 du
code de la sécurité intérieure, les services spécialisés de renseignement
peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII de ce même
code pour le recueil des renseignements relatifs à la prévention du terrorisme.
Ces services peuvent accéder à des données de connexion, procéder à des
interceptions de sécurité, sonoriser des lieux et véhicules et capter des images
et données informatiques.
11. En application de l'article 6-1 de la loi du 21 juin
2004 mentionnée ci-dessus, lorsque les nécessités de la lutte contre la
provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de
l'article 421-2-5 du code pénal le justifient, l'autorité administrative peut
demander à tout éditeur ou hébergeur d'un service de communication au public en
ligne de retirer les contenus qui contreviennent à cet article. Selon l'article
706-23 du code de procédure pénale, l'arrêt d'un service de communication au
public en ligne peut également être prononcé par le juge des référés pour les
faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble
manifestement illicite. L'article 421-2-5-1 du même code réprime le fait
d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données
faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à
ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures
précitées.
12. Enfin, depuis l'entrée en vigueur des dispositions
contestées, le législateur a complété les pouvoirs de l'administration en
adoptant, par la loi du 30 octobre 2017 mentionnée ci-dessus, de nouvelles
mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance aux fins de
prévenir la commission d'actes de terrorisme.
13. Dès lors, au regard de l'exigence de nécessité de
l'atteinte portée à la liberté de communication, les autorités administrative et
judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses
prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au
public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer
leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services
et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne
d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet
soit entré dans sa phase d'exécution.
14. En second lieu, s'agissant des exigences d'adaptation
et de proportionnalité requises en matière d'atteinte à la liberté de
communication, les dispositions contestées n'imposent pas que l'auteur de la
consultation habituelle des services de communication au public en ligne
concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes. Si le législateur a
ajouté à la consultation, comme élément constitutif de l'infraction, la
manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services, cette
consultation et cette manifestation ne sont pas susceptibles d'établir à elles
seules l'existence d'une volonté de commettre des actes terroristes. Les
dispositions contestées répriment donc d'une peine de deux ans d'emprisonnement
le seul fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au
public en ligne, sans que soit retenue l'intention terroriste de l'auteur de la
consultation comme élément constitutif de l'infraction.
15. En outre, si le législateur a exclu la pénalisation de
la consultation lorsqu'elle répond à un « motif légitime » alors qu'il n'a pas
retenu l'intention terroriste comme élément constitutif de l'infraction, la
portée de cette exemption ne peut être déterminée en l'espèce, faute notamment
qu'une personne adhérant à l'idéologie véhiculée par les sites en cause paraisse
susceptible de relever d'un des exemples de motifs légitimes énoncés par le
législateur. Dès lors, les dispositions contestées font peser une incertitude
sur la licéité de la consultation de certains services de communication au
public en ligne et, en conséquence, de l'usage d'internet pour rechercher des
informations.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions
contestées portent une atteinte à l'exercice de la liberté de communication qui
n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. L'article 421-2-5-2 du code
pénal doit donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, être
déclaré contraire à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
17. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la
Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement
de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le
Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les
effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ».
En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de
la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée
contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à
la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant,
les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le
pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses
effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a
produits avant l'intervention de cette déclaration.
18. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les
effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à
compter de la date de publication de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - L'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet
dans les conditions fixées au paragraphe 18 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM.
Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.



LA REPRESSION DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE NON PUBLIQUE
Art. R. 625-8 du code pénal
La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation
sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.
Art. R. 625-8-1 du code pénal
L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou
identité de genre, ou de leur handicap.
Art. R. 625-8-2 du code pénal
Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
5° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par la présente section
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15

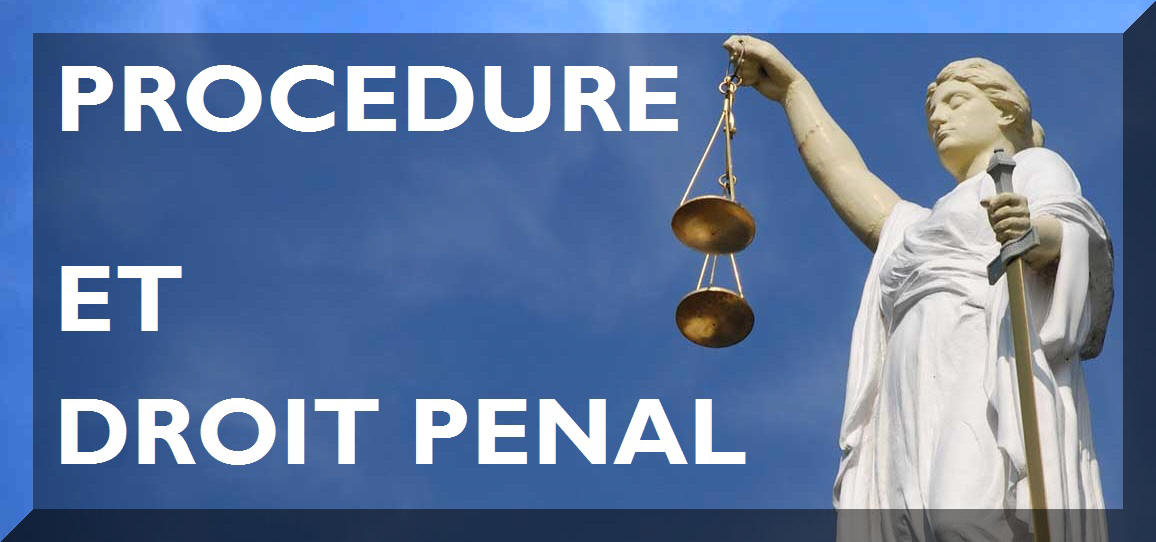

ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945
portant réglementation provisoire des agences de presse
Article 1er
Sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente
ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en
forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d'information ayant
fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique et
dont la moitié au moins du chiffre d'affaires provient de la fourniture de ces
éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la
loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la
presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie
électronique et à des agences de presse.
« Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de
l'appellation "agence de presse” et des avantages qui s'y attachent que les
organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres
chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d'une commission
présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant en nombre égal, d'une
part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants
des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en
situation de conflit d'intérêts sur une demande d'inscription, il ne prend pas
part aux débats ni au vote sur cette demande.
L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions
prévues par la présente ordonnance.
Article 2
Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute agence privée de
presse doit se conformer aux
articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.
Article 3
Les agences de presse ne peuvent se livrer
à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir
gratuitement des éléments d'information, au sens de l'article 1er, à des
entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de
communication au public par voie électronique et à des agences de presse
Article 4 abrogé par l'article 100 de la loi du 22 mars 2012
Article 5
Sont applicables aux propriétaires, directeurs et collaborateurs des agences
de presse, les articles 8 et 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.
Article 6
Sont applicables aux agences de presse les dispositions de l'article 6 de la loi 86-897 du 1er août 1986 précitée.
Article 7 abrogé par l'article 100 de la loi du 22 mars 2012
Article 8 abrogé par l'article 100 de la loi du 22 mars 2012
Article 8 bis
La liste des organismes constituant des agences de presse au sens de la
présente ordonnance est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'information,
du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et
télécommunications, pris sur la proposition d'une commission présidée par un
haut magistrat et comportant en nombre égal, d'une part, des représentants de
l'Administration et, d'autre part, des représentants des entreprises et agences
de presse. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
Article 8 ter
Les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article précédent,
tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par la
présente ordonnance, sont exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires pour les
fournitures qu'elles font à des entreprises de presse bénéficiant des
dispositions de l'article 261-8 du Code général des impôts.
Ces mêmes agences sont exonérées de la contribution des patentes à raison de
l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er ci-dessus.
Les bulletins périodiques qu'elles éditent sont, du point de vue postal,
assimilés aux journaux et écrits périodiques destinés à l'information du public
et bénéficient, à ce titre, du tarif préférentiel prévu par l'article 90 de la
loi de finances du 16 avril 1930, et sous les mêmes conditions.
Les agences de presse sont assimilées aux journaux pour l'application des
tarifs réduits du service des télécommunications.
Article 9
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies de
6000 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

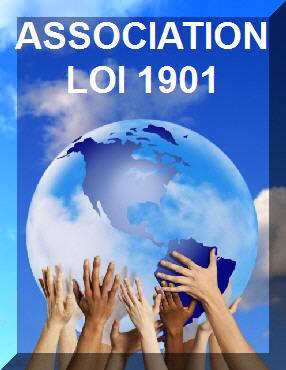

Avis sur la réforme de la protection du secret des sources
COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 25 AVRIL 2013
1. Par une lettre en date du 21 novembre 2012, Mme la garde
des sceaux a saisi la CNCDH d'une demande d'avis sur la protection du secret des
sources des journalistes. Cette demande énumère un certain nombre d'options
envisagées pour améliorer le dispositif existant : définir plus précisément le
principe de la protection du secret des sources des journalistes, ainsi que les
cas dans lesquels il est possible d'y porter atteinte, mettre en place des
sanctions en cas de violation du secret des sources, mieux protéger le
journaliste en cas de recel de violation du secret de l'instruction, définir les
bénéficiaires de la protection des sources, ainsi que les sources qu'il convient
de protéger. A l'occasion d'une réunion à la chancellerie le 31 janvier 2013, un
avant-projet de loi qui traduit ces orientations a été communiqué officiellement à la CNCDH.
2. A l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, la CNCDH rappelle que
la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne
des droits de l'homme, constitue l'un des fondements essentiels d'une société
démocratique (1). La presse a un « rôle indispensable de "chien de garde” en
démocratie » (2) ; or sans protection du secret des sources par l'Etat, « son
aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s'en trouver
amoindrie » (3). Ainsi, la protection du secret des sources est « l'une des
pierres angulaires de la liberté de la presse (...) » (4) car elle garantit le
droit à l'information du public sur des questions d'intérêt général.
3. En France, la nécessité de protéger le secret des sources est d'autant plus
forte que la vie publique souffre d'un déficit de transparence. La publication
des documents administratifs n'est que trop peu systématique, et certains
dénoncent l'existence d'une culture du secret dans le fonctionnement de
l'administration. Face à cette culture, la protection des sources, corollaire
indispensable de ce que certains appellent « journalisme de combat », est une
garantie nécessaire pour protéger le droit à l'information, essentiel à toute
société démocratique.
Bilan du cadre normatif existant :
4. La matière a été profondément réformée par la
loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes. Un nouvel article a été inséré dans la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour que le principe soit
expressément reconnu par la loi. Cet article définit en même temps les cas dans
lesquels il est possible de porter atteinte à ce principe. La CNCDH souligne que
cette loi a indéniablement marqué un progrès dans la protection du secret des
sources. Cependant des précisions et des compléments méritent d'être apportés.
5. La CNCDH relève qu'il est difficile de faire un bilan de l'impact de cette
loi, après seulement trois années d'application. Médiatiquement, la perception
de la loi par l'opinion a souffert de l'affaire dite des « fadettes », qui a vu
le procureur de la République de Nanterre requérir un opérateur téléphonique de
lui communiquer les factures téléphoniques détaillées de trois journalistes pour
découvrir quelle était leur source. Cette affaire a été vécue par l'opinion
publique, et surtout par les médias, comme la démonstration de l'insuffisance de
la loi pour protéger les sources des journalistes. Cependant, la CNCDH souligne
que l'application de la loi du 4 janvier 2010 a conduit à l'annulation a
posteriori des réquisitions du procureur de la République et de toute la
procédure subséquente. En effet, la chambre de l'instruction de la cour d'appel
de Bordeaux, qui a eu à se prononcer sur ces faits, a par arrêt du 5 mai 2011
annulé les réquisitions visant à des investigations sur les téléphones des trois
journalistes, qui tendaient à découvrir leurs sources. Cet arrêt de la cour
d'appel de Bordeaux a été approuvé par la Cour de cassation qui a rendu un arrêt
de rejet du pourvoi formé à son encontre le 6 décembre 2011 (5).
6. La CNCDH n'a pas eu connaissance d'autres cas dans lesquels les juridictions
n'auraient pas pu protéger efficacement le secret des sources des journalistes
depuis l'adoption de la loi du 4 janvier 2010. Si les personnes entendues ont pu
souligner que les journalistes pouvaient faire l'objet de certaines pressions,
notamment de la part des fonctionnaires de police, pour qu'ils révèlent leurs
sources, ces pressions se font en dehors de tout cadre légal ; une meilleure
protection et une meilleure prévention de ces atteintes au secret des sources
pourraient éventuellement ne pas passer par une modification du cadre
législatif. Par ailleurs, les condamnations de la France par la Cour européenne
des droits de l'homme, en raison d'une atteinte au secret des sources,
intervenues depuis l'adoption de la loi sont relatives à des faits antérieurs à
cette loi (6). Néanmoins, la CNCDH propose des modifications de la loi de 2010
pour assurer une meilleure protection du secret des sources et de la liberté
d'expression.
Définir précisément le principe de la protection des sources et les
bénéficiaires de celle-ci.
7. Sur les bénéficiaires du droit au secret des sources. Ainsi qu'il a été
souligné ci-dessus, protéger le secret de sources des journalistes ne tient pas
à la nécessité de défendre un intérêt corporatiste des journalistes : c'est une
garantie essentielle pour le fonctionnement de notre démocratie. Ce principe se
rattache tant à la liberté d'expression qu'au droit à l'information du public. A
cet égard, la CNCDH met en garde contre toute définition du secret des sources
qui ne serait qu'un attribut de la profession de journaliste. Elle considère, à
l'inverse, que dans la mesure où il contribue à l'information du public, le
droit à la protection du secret des sources doit être reconnu à tous : aussi
bien aux journalistes qu'à toute personne publiant des informations à titre
simplement occasionnel. La limitation dans son principe même du droit au secret
des sources aux journalistes professionnels apparaît inadaptée et injustifiée.
8. A cet égard, la loi belge du 7 avril 2005 est particulièrement intéressante.
Suite à plusieurs condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, le
législateur belge a souhaité reconnaître le secret des sources des journalistes.
Il a ainsi adopté la loi « relative à la protection du secret des sources » ;
cette loi est aujourd'hui considérée, en France, comme un modèle, car
particulièrement protectrice du secret des sources. Dans sa rédaction d'origine,
elle restreignait cependant le bénéfice de la protection des sources aux seuls
journalistes. Or, par une décision du 7 juin 2006, la Cour d'arbitrage belge,
devenue la Cour constitutionnelle, a censuré cette limitation en considérant que
cette loi, qui excluait les personnes exerçant les activités journalistiques en
dehors de la définition du journalisme, ne respectait pas l'article 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme et l'article 19.2 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (7), qui reconnaissent à
tout citoyen le droit à la liberté d'expression.
9. La CNCDH partage cette approche et considère comme essentiel de ne pas
limiter la protection des sources aux seuls journalistes professionnels. Par
ailleurs, reconnaître la protection du secret des sources comme un attribut de
la profession de journaliste nécessiterait de définir avec précision la
profession de journaliste. Or, l'exercice est particulièrement délicat. D'une
part, il existe d'ores et déjà une définition de la profession de journaliste
dans le
code du travail. Aux
termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, « est
journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale,
régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs
entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de
presse et qui en tire le principal de ses ressources ». Cette définition est
distincte de celle de la loi du 4 janvier 2010, qui définit le journaliste comme
« toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises
de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle
ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué,
le recueil d'informations et leur diffusion au public ». La multiplication de
définitions distinctes n'est pas satisfaisante du point de vue de la sécurité
juridique, et notamment des objectifs de clarté et de précision de la loi.
Tenter de redéfinir cette profession, trois ans après la loi du 4 janvier 2010,
apporterait une nouvelle confusion, et serait une nouvelle manifestation
d'instabilité législative. D'autre part, une définition particulièrement large
de la profession de journaliste, qui inclurait les travailleurs indépendants et
occasionnels, risquerait d'avoir des effets collatéraux sur l'exercice de la
profession de journaliste, qui est actuellement une activité salariée (8).
10. La CNCDH tient à souligner que les conséquences d'une extension du secret
des sources à toutes les personnes qui contribuent directement à la collecte, la
rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un
média, au profit du public et non aux seuls journalistes, n'aurait pas pour
conséquence de permettre à tous de publier des informations erronées ou portant
notamment atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, à sa
dignité ou à sa vie privée. D'une part, cette extension est limitée aux
personnes qui contribuent réellement à la collecte, la rédaction, la production
ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public.
D'autre part, toute personne qui publie des informations est tenue de s'assurer
de leur véracité, en tout cas de leur sérieux, et de le prouver, le cas échéant,
devant un tribunal. Si cette personne considère que le secret des sources lui
permet de ne pas révéler la source de son information, et qu'elle souhaite ne
pas la révéler pour protéger l'anonymat de celle-ci et pour respecter le pacte
de confidentialité qu'elle a conclu avec elle, cela ne l'exonère pas de sa
responsabilité civile et/ou pénale et l'expose, par conséquent, à un risque de
condamnation civile et/ou pénale pour diffamation par exemple.
11. La CNCDH considère également qu'une protection doit être reconnue à ceux qui
par l'exercice de leur fonction sont amenés à prendre connaissance
d'informations permettant d'identifier une source. Cette protection doit
s'étendre au travail des collaborateurs de la rédaction, sans se limiter à eux seuls.
La CNCDH recommande que le Gouvernement s'inspire de la loi belge sur la
protection du secret des sources, pour que bénéficient de la protection des sources :
― toute personne qui contribue directement à la collecte, la rédaction, la
production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public ;
― toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre
connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers
la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
12. Si la CNCDH considère que la protection du secret des sources ne doit pas se
limiter aux seuls journalistes, elle souligne néanmoins que les journalistes
professionnels devraient pouvoir se voir reconnaître des droits renforcés pour
garantir leur droit à la protection du secret de leurs sources. En effet, en
tant que professionnels, les journalistes sont particulièrement exposés au
risque de violation du secret de leurs sources, et doivent être spécialement
protégés. Elle considère notamment que les journalistes professionnels peuvent
se voir reconnaître une immunité concernant le délit de recel de violation du secret professionnel.
13. Sur la définition du secret des sources. Si la loi du 4 janvier 2010 a
reconnu le principe de protection du secret des sources, elle a fait le choix de
ne pas définir ce secret. La CNCDH approuve ce choix, et considère que l'absence
de définition du secret des sources est une garantie pour les personnes qui s'en
prévaudront. Toute définition des sources à protéger risquerait d'être trop restrictive, et se montrerait inadéquate.
Pour répondre à la question posée par la saisine, la CNCDH considère qu'il n'est
pas nécessaire de définir la protection du secret des sources, ni les sources à protéger.
14. La CNCDH souligne que la protection du secret des sources n'est pas une
immunité qui pourrait permettre de violer les différents secrets : secrets
professionnels, secret de l'enquête ou secret de l'instruction auxquels sont
tenues les personnes qui ne concourent pas à la procédure. Le secret des sources
ne protège que la personne qui publie ces informations. En revanche, la personne
qui communique des éléments au journaliste en violation de son secret
professionnel peut se voir sanctionnée. Ce qui est prohibé, c'est d'identifier
la source à partir de la publication de l'information, non de rechercher la
personne qui a fourni cette information à travers une enquête interne, par
exemple. Il reste que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, il
convient, dans certains cas spécifiques, de protéger les personnes qui ont
délibérément violé le secret auquel elles étaient astreintes ; c'est le cas des
lanceurs d'alerte, qui doivent se voir reconnaître une protection lorsqu'ils
divulguent, de bonne foi, des informations authentiques d'intérêt public qui ne
pourraient être divulguées par d'autre moyen faute d'autres vecteurs de divulgation de l'information (9).
Définir les exceptions au principe :
15. La loi du 4 janvier 2010 avait fait le choix de transposer directement les
solutions dégagées par la Cour européenne des droits de l'homme : « Il ne peut
être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un
impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées
sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ». Si
la volonté du législateur de transposer la formule de la jurisprudence de la
Cour de Strasbourg était louable, elle a été mal perçue par les journalistes,
qui ont critiqué les contours incertains de cette notion. La notion d'impératif
prépondérant d'intérêt public peut laisser une trop grande marge d'appréciation
à tous les stades de la procédure. Certains ont ainsi soutenu que la prévention
et la répression de toute infraction constituaient des impératifs prépondérants
d'intérêt public, ce qui aurait vidé la protection de tout contenu. La notion a
toutefois été interprétée restrictivement par la chambre de l'instruction de la
cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 5 mai 2011, approuvé par l'arrêt de
la Cour de la cassation du 6 décembre 2011, arrêts précités.
16. La tentative de définition de l'avant-projet de loi, préconisée par
certains, qui évoque « la prévention de la commission d'infractions constituant
une atteinte grave à l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes »
semble néanmoins trop restrictive, sans pour autant être une garantie absolue.
En effet, le renvoi à la seule prévention ne permet pas de rechercher des
auteurs d'infractions, même si elles sont particulièrement graves.
Pour permettre d'améliorer la précision de cette définition, la CNCDH recommande
de modifier la loi pour qu'il ne soit possible de porter « atteinte directement
ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant
d'intérêt public tenant à la prévention ou à la répression d'infractions de
nature criminelle le justifie et si les mesures envisagées sont strictement
nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ».
Prévenir les violations du secret des sources :
17. A l'occasion de l'arrêt Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, la grande chambre
de la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que, pour prévenir toute
violation du secret des sources, « le juge ou autre organe indépendant et
impartial doit donc être en mesure d'effectuer avant toute divulgation cette
mise en balance des risques potentiels et des intérêts respectifs relativement
aux éléments dont la divulgation est demandée, de sorte que les arguments des
autorités désireuses d'obtenir la divulgation puissent être correctement
appréciés » (10). En l'état actuel, le droit national ne permet pas de prévenir
ces violations ; la phase d'enquête, qui se déroule sous la direction du
procureur de la République, pose particulièrement problème, eu égard notamment à
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant
l'indépendance du ministère public français (11).
18. La CNCDH recommande, comme l'article 2 de l'avant-projet de loi qui lui a
été communiqué le prévoit, que les actes d'enquête ou d'instruction qui auraient
pour objet direct ou indirect, dans le cadre de l'exception ci-dessus définie,
la découverte de la source d'information d'un journaliste ne soient possibles
qu'après l'autorisation d'un juge indépendant et impartial. Eu égard à ses
autres attributions, elle recommande que le juge des libertés et de la détention
soit doté de cette compétence. Elle préconise, à cette occasion, que le juge des
libertés et de la détention se voie reconnaître, à l'instar du juge
d'instruction, un véritable statut, et qu'il soit doté de moyens humains et
financiers suffisants afin de prendre une décision éclairée tenant compte de
l'ensemble des éléments du dossier pour contrôler efficacement la requête du
parquet ou du juge d'instruction.
La CNCDH recommande que tous les actes d'enquête ou d'instruction qui auraient
pour objet direct ou indirect la découverte de la source d'une information
soient autorisés préalablement par le JLD, à peine de nullité.
Mettre en place des sanctions en cas de violation du secret :
19. Parmi les nombreuses critiques adressées à la loi du 4 janvier 2010, l'une
d'entre elle portait sur l'absence de sanctions pénales en cas de violation du
secret. Actuellement, en effet, la seule conséquence de la violation du secret
des sources est la nullité des actes accomplis en violation des prescriptions
légales, et donc des éléments obtenus grâce à celle-ci. Cette nullité est, sans
aucun doute, la mesure la plus efficace : elle est dissuasive pour les autorités
judiciaires, et a des conséquences particulièrement importantes pour la suite du procès.
20. Concernant la mise en place de sanctions pénales, revendiquée par les
journalistes, plusieurs options existent : soit une absence de pénalisation,
soit une pénalisation par la voie de circonstances aggravantes de délits
existants, soit la création d'un délit autonome de violation du secret des
sources qui seul permettrait de réprimer tous les actes de violation du secret
des sources. La CNCDH a, à l'occasion de plusieurs de ses avis (12), demandé une
désescalade dans l'échelle des peines, et l'absence de nouvelle incrimination
s'inscrirait dans cette tendance. Elle serait également légitime dans la mesure
où certaines incriminations non spécifiques au secret des sources permettent
d'ores et déjà de sanctionner les actes commis en méconnaissance de ce principe
: la violation du domicile, ou la violation des correspondances, quelle qu'en
soit leur nature, les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
(13) « sont incriminées par le
code pénal. La création d'une circonstance aggravante pour
ces délits lorsque l'infraction a pour objet de porter atteinte à la protection
du secret des sources pourrait avoir l'avantage de sanctuariser ce principe, de
faire œuvre de pédagogie, et d'éviter de multiplier les infractions autonomes
tout en conservant la valeur symbolique de la sanction pénale.
La CNCDH recommande, comme dans l'avant-projet de loi, de créer une circonstance
aggravante concernant certains délits, et notamment les délits d'atteinte aux
systèmes de traitement automatisé de données, d'atteinte à l'inviolabilité du
domicile et à l'inviolabilité des correspondances, qu'ils soient commis ou non
par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, lorsque le délit a pour objet de porter atteinte à la protection
des sources d'information d'un bénéficiaire de cette protection.
Protéger les journalistes en cas de recel de violation du secret de l'instruction :
21. Le délit de recel de violation du secret de l'instruction n'aboutit que très
rarement à une condamnation d'un journaliste, mais présente un intérêt certain
pour contraindre un journaliste à révéler ses sources. La CNCDH a conscience de
ce que la question du secret de l'instruction pose aujourd'hui de façon cruciale
celle de l'information du public sur les enquêtes judiciaires en cours, et
qu'elle devra être résolue de façon autonome dans le cadre d'une réflexion sur la réforme du
code de procédure pénale. La création d'une immunité pour
les journalistes pourrait sans aucun doute être intéressante. Une telle immunité
nécessite cependant de définir la profession de journaliste, ce qui est un
exercice difficile, comme il a été dit. La solution alternative qui consiste à
exclure du délit de recel de violation de l'instruction les cas où le recel est
justifié par la volonté d'informer le public n'est pas totalement satisfaisante
non plus, puisqu'il repose sur une simple intention, qui ne sera pas aisée à
prouver. Il semble, ici aussi, qu'il soit nécessaire de créer une immunité dont
ne pourraient bénéficier que les seuls journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.
La CNCDH recommande que la loi du 29 juillet 1881 soit modifiée pour indiquer
que « le journaliste peut détenir, dans l'exercice de sa mission d'information
du public des documents provenant du délit de violation du secret de l'enquête,
de l'instruction ou de tout autre secret professionnel, sans que cette détention
puisse donner lieu à des poursuites pour recel ».
Accès des journalistes aux lieux de privation de liberté :
22. L'article 5 de l'avant-projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes permet aux journalistes, titulaires de la carte de
presse et habilités dans des conditions fixées par décret, d'accompagner les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus
en France lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires. Cette disposition va dans le bon sens. Néanmoins, la CNCDH s'interroge sur le fait que
ce droit de visite soit limité aux seuls établissements pénitentiaires, et uniquement pour les journalistes qui accompagnent un parlementaire. La CNCDH
fait siennes les revendications de nombreux acteurs de la société civile tendant à l'ouverture aux journalistes des établissements pénitentiaires, centres de
rétention administrative, zones d'attente et locaux de garde à vue dans des conditions fixées par décret, même en dehors de la présence de parlementaires.
(Résultat du vote : 46 voix pour, aucune voix contre, aucune abstention.)



L'OBTENTION DE LA CARTE DE PRESSE
Article L 7111-3 du Code de Travail
Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans
une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des
rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 1er décembre 2016 Pourvois N°15-19177 cassation
Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession
dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ;
que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la
personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 25 septembre 2013, n° 12-17.516) que Mme X... a été engagée le 2 mai 1996 par la
société Événements services promotion en qualité de journaliste rédactrice en chef de la revue Ateliers d'art, publication d'information destinée tant aux
professionnels artisans de métier qu'aux amateurs ; qu'elle effectuait également des piges ; que son contrat de travail a été transféré le 3 octobre 2007 à la
Chambre syndicale des céramistes et ateliers d'art de France ; que la salariée, licenciée le 3 octobre 2008 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale
de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour reconnaître à Mme X... le statut de journaliste, l'arrêt
retient que certes la chambre syndicale des ateliers d'art de France n'est pas une entreprise de presse, mais que ce syndicat professionnel édite une
publication, la revue Ateliers d'art de manière périodique, diffusée à la fois à ses adhérents et au public, amateur et des professionnels d'art, que sa
principale activité, son objet, tendent à défendre les intérêts des artisans exerçant les métiers d'art, mais qu'au delà de la défense de cet intérêt et du
sien propre, la revue en cause, par sa qualité intrinsèquement esthétique et la diversité des thèmes, toujours traités dans une perspective artistique, revêt le
caractère d'un ouvrage d'information et de culture générale, qu'en effet, son contenu est une succession de reportages avec photographies, intégrant des
entretiens avec des artisans, des informations sur les techniques utilisées et des commentaires sur les aspects artistiques et culturels, outre des
informations sur les expositions et les manifestations en lien avec la céramique, que sur la quarantaine de pages environ que compte la revue, la
chambre syndicale n'apparaît que dans la demi-page de l'éditorial, que ce contenu de la revue n'a guère changé entre 2007 et 2014, mais que sa forme a été
un peu modifiée (plus de photos et moins de textes), de sorte qu'elle ne se présente toujours pas comme le vecteur médiatique de la chambre et du mouvement
syndical que cette dernière incarne, mais comme une publication à destination de tous les publics, que la diffusion de la revue Ateliers d'art s'est en effet
élargie au public spécialisé devenu progressivement plus important, démontrant ainsi que la revue se donne à voir avant tout comme une publication de qualité,
spécialisée dans l'art de la céramique, que cette volonté d'atteindre aussi un public de spécialistes et d'institutionnels est d'ailleurs un des objectifs du
comité de rédaction depuis 2008, qu'ainsi, dès lors que Mme X... a perçu une rémunération régulière pour l'activité de rédactrice en chef salariée et de
journaliste pigiste dans une publication de presse, la revue Ateliers d'art, présentant une indépendance éditoriale, il convient de lui reconnaître le statut
de journaliste, et de lui appliquer les dispositions de la convention collective des journalistes ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une indépendance éditoriale de la publication en cause, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;



ANALYSES JURIDIQUES SUR LA DIFFAMATION
DIÉMERT c.FRANCE du 30 mars 2023 Requête no 71244/17
6 § 1 (pénal) • Accès à un tribunal en matière de diffamation • Constat de la prescription de l’action indemnitaire
du requérant en cours d’instance d’appel l’ayant privé d’un examen au fond sans lui faire supporter une charge procédurale excessive (en dépit de la négligence
de la cour d’appel en matière d’audiencement)
FAITS : poursuites pour diffamation
- La prescription de l’action civile en matière d’infractions à la loi sur la liberté de la presse en France
18. L’article 65
alinéa 1er
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse se lit comme il suit :
« L’action publique
et l’action civile résultant des infractions à la loi sur la presse se
prescrivent à l’échéance d’un délai de trois mois, à compter du jour où ils
auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il
en a été fait. »
19. La
prescription est acquise à l’expiration du délai précité, à moins que son cours
ait été suspendu ou interrompu.
20. La Cour de
cassation juge que la prescription est suspendue au profit de la partie
poursuivante lorsqu’un obstacle de droit ou de fait la met dans l’impossibilité
d’agir (Cass. crim., 17 décembre 2013, no 12‑86.393).
21. Or, elle
considère que le seul fait d’introduire l’instance ne suffit pas à suspendre la
prescription, mais ne fait que l’interrompre. Elle juge en effet que le droit de
poursuivre l’audience pour faire juger l’affaire appartient à toutes les parties
et que la partie civile, comme le ministère public, peuvent assigner le prévenu
à une des audiences de la juridiction de jugement (Cass. crim., 26 janvier 1884,
Bull. crim. t. 89,
no
22, pp. 35-37, et 30 mai 2007, no 06‑86.256,
Bull. crim. no
142), une telle citation interrompant la prescription.
22. Selon une
jurisprudence constante et bien établie, il incombe à la partie civile de
surveiller le déroulement de la procédure et d’accomplir les diligences utiles
pour poursuivre l’action qu’elle a engagée, en faisant citer elle-même le
prévenu à l’une des audiences de la juridiction avant l’expiration du délai de
prescription au besoin (voir, parmi beaucoup d’autres, Cass. crim., 2 décembre
1986, no 86-91.698,
Bull. crim., no 364,
27 juin 1990, no 89‑85.008,
Bull. crim. no 267,
21 mars 1995, no 93‑81.642,
Bull. crim. no 115,
et 11 avril 2012, no 11-83.916).
Si ces décisions concernaient pour la plupart des cas dans lesquels des appels
avaient été tardivement audiencés, la Cour de cassation a également appliqué
cette jurisprudence dans une hypothèse où la juridiction correctionnelle avait
ordonné un renvoi à plus de trois mois en cours d’instance (Cass. crim.,
20 octobre 2015, no 14‑87.122,
Bull. crim. 2015,
no 225).
23. Elle juge que
cette obligation procédurale n’est pas incompatible avec les articles 6 et 13 de
la Convention (Cass. crim., 21 mars 1995 et 20 octobre 2015, précités).
24. Par ailleurs,
la décision de renvoi de l’examen d’une l’affaire à une audience ultérieure
prononcée par un jugement ou un arrêt, en présence du ministère public,
constitue un acte interruptif de prescription (Cass. crim., 21 mars 1995, no
93-81.531, Bull. crim.
no 116,
et 9 octobre 2007, pourvoi no 07-81.786,
Bull. crim. no 239).
La Cour de cassation reconnaît également le caractère interruptif d’un renvoi
ordonné à l’audience, mais non formalisé par une décision, à la double condition
qu’il ait été prononcé contradictoirement et qu’il ait été constaté sur les
notes d’audience (Cass. crim., 28 novembre 2006, nos 01‑87.169
et 05‑85.085, Bull. crim. no 298).
CEDH
a) Principes
généraux
33. La Cour
rappelle que le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la
Convention, doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire »
(Bellet c. France,
4 décembre 1995, § 36, série A no 333-B).
Ce droit n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises,
notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours ; les États
contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Cela
étant, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable
de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint
dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1
que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable
de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi
beaucoup d’autres, Naït-Liman c. Suisse
[GC], no 51357/07,
§§ 114‑115, 15 mars 2018, et Grzęda c. Pologne
[GC], no 43572/18,
§ 343, 15 mars 2022).
34. Les principes
applicables à l’examen des restrictions d’accès à un degré supérieur de
juridiction ont été résumés par la Cour dans l’affaire
Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12,
§§ 80-86, 5 avril 2018). Lorsqu’elle statue sur la proportionnalité de telles
restrictions, la Cour se montre particulièrement attentive à trois critères, à
savoir i) la prévisibilité de la restriction, ii) le point de savoir qui doit
supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la
procédure (Zubac,
précité, §§ 90-95, et Willems et Gorjon
c. Belgique, nos 74209/16
et 3 autres, §§ 80 et 87-88, 21 septembre 2021 ; voir, également,
Barbier c. France, no 76093/01,
§§ 27-32, 17 janvier 2006) et iii) la question de savoir si les restrictions en
question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif » (Zubac,
précité, §§ 96-99, et Walchli c. France,
no 35787/03,
§§ 29-36, 26 juillet 2007). Par ailleurs, pour apprécier si les exigences de
l’article 6 § 1 ont été respectées à hauteur d’appel ou de cassation, la Cour
tient compte de la mesure dans laquelle l’affaire a été examinée par les
juridictions inférieures, du point de savoir si la procédure devant ces
juridictions soulève des questions concernant l’équité, et du rôle de la
juridiction concernée (Levages Prestations
Services c. France, 23 octobre 1996, §§ 45-49,
Recueil des arrêts et décisions
1996‑V, et Zubac,
précité, § 84).
35. Enfin, la Cour
rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment
aux cours et tribunaux, d’interpréter la législation interne, le rôle de la Cour
se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de
pareille interprétation (Nejdet Şahin et Perihan
Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05,
§ 49, 20 octobre 2011).
b) Application
en l’espèce
36. En l’espèce,
la Cour relève que l’acquisition de la prescription de l’action indemnitaire du
requérant a restreint son droit d’accès à un tribunal, en le privant d’un examen
au fond de son appel. Si le requérant a pu présenter ses observations sur la
prescription devant la cour d’appel et la Cour de cassation, la Cour rappelle
qu’un tel accès aux juridictions de degré supérieur ne satisfait pas toujours
aux impératifs de l’article 6 § 1 (Ashingdane
c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, §§ 56-57, série A no 93,
et Bellet,
précité, § 36).
37. S’agissant du
but poursuivi par cette restriction, la Cour rappelle que la réglementation
relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à
assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de
la sécurité juridique (Walchli,
précité, § 27, et Clinique Sainte Marie c. France
(déc.), no 24562/03,
29 avril 2008). En outre, elle admet que les exigences procédurales prévues par
la loi du 29 juillet 1881 ont également pour but de protéger la liberté
d’expression (Vally et autre c. France
(déc.), no 39141/04,
17 juin 2008) et reconnaît la légitimité d’une telle finalité. Dès lors, il
reste à la Cour à déterminer s’il existait un rapport raisonnable de
proportionnalité entre la restriction en cause et les buts qu’elle visait.
38. À cet égard,
la Cour constate d’emblée que les prétentions du requérant ont fait l’objet d’un
examen sérieux en première instance. Le tribunal de première instance de Papeete
les a rejetées par un jugement motivé, au terme d’une procédure dont l’équité
n’est pas discutée.
39. Elle relève
ensuite que le régime du délai de prescription litigieux est précisément défini
par la loi, dont l’application fait l’objet d’une jurisprudence constante
(paragraphes 18‑21 ci‑dessus). Elle précise que le devoir de surveillance de la
procédure incombant à la partie civile, s’il fait certes peser sur le requérant
une responsabilité lourde de conséquences, n’en est pas moins établi par une
jurisprudence claire, accessible et bien établie (paragraphe 22 ci‑dessus
et Clinique Sainte
Marie, décision précitée). La restriction en
cause était donc prévisible.
40. La Cour note
que le requérant ne conteste ni le principe ni la brièveté du délai de
prescription litigieux. Il se plaint d’une application excessivement
formaliste de son devoir de surveillance de la procédure, et fait valoir, plus
largement, que la déclaration d’appel devrait avoir pour effet de suspendre la
prescription (paragraphe 31 ci-dessus). À cet égard, la Cour rappelle que
les délais de péremption ou de prescription figurent parmi les restrictions
légitimes au droit à un tribunal (Sanofi
Pasteur c. France, no
25137/16, § 50, 13 février 2020). Elle réaffirme ensuite que les États
contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation dans l’élaboration de
la réglementation relative à l’accès aux tribunaux. La Cour n’a pas qualité pour
substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de
ce qui pourrait être la meilleure politique en la matière. En revanche, il lui
appartient de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la
Convention (Zubac,
précité, § 78).
41. Dans les
circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’il lui revient de déterminer si la
combinaison des règles procédurales en cause a fait peser sur le requérant une
charge excessive. À cette fin, il convient d’abord d’identifier les raisons qui,
en définitive, ont restreint le droit d’accès à un tribunal du requérant (Zubac,
précité, § 90).
42. S’agissant
d’une part du rôle joué par la cour d’appel de Papeete, la Cour relève que le
droit interne confère aux décisions de renvoi prises par la juridiction de
jugement un effet interruptif de prescription (paragraphe 24 ci-dessus) et qu’il
impose à celle-ci de fixer la date de renvoi en déterminant l’audience à
laquelle l’affaire pourra utilement être examinée (paragraphe 17 ci-dessus). Or,
à l’audience du 9 octobre 2014, la cour d’appel a reporté l’examen de
l’affaire à plus de trois mois, c’est-à-dire au-delà de l’échéance du délai de
prescription (paragraphe 18 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, la cour d’appel ne
pouvait ignorer qu’une telle décision entraînerait la prescription. Elle estime
donc que la date fixée n’était pas une « date utile » au sens du droit interne,
et que l’audiencement de l’affaire procède d’un dysfonctionnement du service
public de la justice.
43. S’agissant
d’autre part du rôle joué par le requérant, la Cour rappelle que le droit
interne lui imposait de surveiller le déroulement de la procédure et de veiller
à ce que son action en justice, toujours pendante, échappe à la prescription
(paragraphe 22 ci-dessus). Or, la décision de renvoi du 9 octobre 2014 a été
prononcée contradictoirement, de sorte que le requérant pouvait effectivement
faire citer son contradicteur à l’une des audiences de la cour d’appel pour
interrompre la prescription. Les juridictions internes ont donc pu considérer
que celui-ci avait manqué à son devoir de surveillance sans que cette conclusion
puisse passer pour arbitraire ou déraisonnable.
44. La Cour en
conclut que la cour d’appel de Papeete et le requérant ont tous deux contribué à
l’acquisition de la prescription. En pareilles circonstances, pour
déterminer si le requérant a dû supporter une charge procédurale excessive, la
Cour doit tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, considérée dans
son ensemble, en recherchant en particulier i) si le requérant était assisté
d’un avocat et s’il a agi avec la diligence requise, ii) si les erreurs commises
auraient pu être évitées dès le début, iii) et si les erreurs sont
principalement ou objectivement imputables au requérant ou aux autorités
compétentes (Zubac,
précité, §§ 91-95).
45. À cet égard,
la Cour constate en premier lieu que le requérant a été assisté par un avocat
spécialisé en droit pénal devant la cour d’appel et qu’il est lui‑même un
professionnel du droit. Elle estime donc qu’il ne pouvait ignorer l’étendue de
ses obligations procédurales. La Cour remarque que le requérant est à l’origine
des poursuites pénales engagées à l’encontre de M. Tuheiava, et elle admet que
cette circonstance peut lui conférer une responsabilité particulière dans la
conduite de l’instance.
46. En deuxième
lieu, elle observe que l’avocat du requérant aurait pu présenter des
observations sur la demande de renvoi présentée par le prévenu à l’audience du
9 octobre 2014 ou interpeller la juridiction sur le problème lié à la fixation
par les juges d’une date d’audience entraînant prescription. Or, il ne résulte
pas des documents produits devant la Cour qu’il ait fait usage de cette faculté.
Au contraire, le requérant reconnaît dans ses observations que son avocat s’est
« [laissé] surprendre par la prescription ».
47. En troisième
lieu, la Cour souligne que le requérant a eu connaissance de la date de
renvoi dès le 9 octobre 2014 et qu’il a disposé d’un délai de trois mois pour
faire délivrer aux parties une citation à comparaître à une autre audience.
Elle considère que cette formalité procédurale, bien qu’étant nécessairement
de nature à générer un coût supplémentaire pour le requérant, était simple et
accessible. À cet égard, la Cour rappelle que droits procéduraux et
obligations procédurales vont normalement de pair et que les parties sont tenues
d’accomplir avec diligence les actes de procédure relatifs à leur affaire (Zubac,
précité, § 93, et, par exemple, Clinique Sainte
Marie, décision précitée).
48. Dans ces
conditions, et en dépit de la négligence dont la cour d’appel de Papeete a fait
preuve en matière d’audiencement, la Cour juge que le requérant n’a pas eu à
supporter une charge procédurale excessive.
49. Compte tenu
de l’ensemble de ces éléments, la Cour juge qu’en constatant la prescription de
l’action du requérant en cours d’instance d’appel, les juridictions internes
n’ont ni porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal du
requérant, ni porté atteinte à la substance même de ce droit. Par conséquent, il
n’y a pas violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
La preuve de la vérité du fait diffamatoire
par Mme Sylvie Menotti, conseiller
référendaire à la Cour de cassation
La diffamation est définie, par l’article 29 al.1 de la loi
du 29 juillet 1881, comme "toute allégation ou imputation d’un fait qui
porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé".
Face à une poursuite pour diffamation, le prévenu peut se
défendre de différentes façons :
- en amont, il peut soutenir que l’imputation litigieuse ne
vise pas le plaignant, n’est pas suffisamment précise, ou ne porte pas
atteinte à son honneur ou à sa considération ;
- en aval, il peut invoquer sa bonne foi ;
- mais il peut aussi obtenir sa relaxe en prouvant que son propos est exact,
c’est-à-dire en rapportant la preuve de la vérité du fait diffamatoire.
Or, nous allons voir qu’il s’agit d’un parcours semé
d’embûches expliquant sans doute que ce moyen de défense n’est couronné de
succès que dans un nombre extrêmement réduit de cas.
En effet, outre que l’offre de preuve n’est pas toujours
juridiquement possible (I) et qu’elle peut n’être pas souhaitable au regard de
son incidence sur les débats (II), le prévenu devra faire face aux difficultés
résultant de ses conditions de recevabilité, d’une part (III) et des
conditions de son admission, d’autre part (IV).
I. Les difficultés tenant au fait que l’offre de preuve
n’est pas toujours juridiquement possible
Il convient en effet de s’interroger : l’offre de preuve
est-elle possible quel que soit le mode de diffusion du propos (A), quelle que
soit la nature de l’imputation (B), quel que soit le type de diffamation (C) ?
A. Le mode de diffusion
Il y a fort longtemps que la jurisprudence a précisé que
l’offre de preuve "s’applique à toute diffamation, qu’elle ait été
réalisée par la voie de la presse ou par tout autre des moyens définis en
l’article 23 de ladite loi" (Crim. 03/03/1949, Bull n° 82).
B. La nature de l’imputation
L’article 35 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 exclut
toute possibilité de rapporter la preuve du fait diffamatoire :
- lorsque l’imputation concerne la vie privée de la
personne ;
- lorsqu’elle se réfère à des faits qui remontent à plus de 10 ans ;
- lorsqu’elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou
prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la
réhabilitation ou la révision.
S’agissant de la vie privée, deux points méritent d’être
soulignés :
- l’imputation d’avoir commis des actes financièrement
indélicats à l’égard de tiers relève de la vie privée à condition que l’acte
en cause ait été commis en dehors de toute activité professionnelle (Crim.
18/11/1975, Bull n° 250 : offre de preuve admise au sujet d’un notaire ayant
commis une escroquerie au préjudice d’un client ; Crim. 19/03/1956, Bull
n° 275 : offre de preuve refusée à propos d’un individu accusé de s’être
conduit en escroc ; Crim. 23/04/1958, Bull n° 333 : offre de preuve refusée au
sujet d’une personne à laquelle il était fait reproche de ne pas avoir
respecté ses engagements pécuniaires) ;
- l’imputation relative au patrimoine relève, en principe, de la vie privée, à
moins qu’elle ne concerne une personnalité publique (CEDH, 21/01/1999, Fressoz/France).
En revanche, lorsque le propos diffamatoire comporte des
imputations indivisibles, relevant, pour certaines d’entre elles seulement, de
la vie privée, la preuve est alors admissible pour le tout (Crim. 17/12/1979,
Bull n° 360).
Notons enfin :
- que le moyen tiré de l’impossibilité de rapporter la
preuve en application des interdictions de l’article 35 de la loi sur la
presse doit être soulevé devant les juges du fond et ne peut être invoqué,
pour la première fois, devant la Cour de cassation (Crim. 12/12/2003, pourvoi
n°02-85.657) ;
- que l’impossibilité posée par l’article 35 de rapporter la preuve de faits
remontant à plus de 10 ans n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme (Crim. 10/02/1987, Bull. n° 68).
C. Le type de diffamation
L’article 35 al.1 comporte une rédaction ambigue :
"La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand
il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires,
dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de
mer ou de l’air, les administrations publiques et contre toutes les personnes
énumérées dans l’article 31".
Si certains ont autrefois soutenu que l’offre de preuve
n’était possible que pour les diffamations des articles 30 (diffamation contre
les corps constitués) et 31 (diffamation contre les personnes protégées), la
jurisprudence, tirant les conséquences de l’apparition, en 1944, de l’alinéa 3
ci-dessus énoncé, a clairement affirmé que les dispositions de l’article 35
"ont une portée générale" et "autorisent la preuve de la vérité
des faits diffamatoires dans toutes circonstances et à l’égard de toute
personne, n’exceptant seulement que les cas limitativement énumérés"
ci-dessus (Crim. 12/10/1954, D.1954, p.765).
En revanche et malgré le silence du texte sur ce point, il
résulte de la jurisprudence de la Chambre criminelle que l’offre de preuve est
impossible en matière de diffamation raciale (Crim. 11/07/1972, Bull. n° 236 ;
Crim. 16/03/2004, pourvoi n° 03-82.828). Il s’agit là d’une restriction de bon
sens, tant on n’imagine mal un débat portant précisément sur ce que la loi a
entendu interdire.
Il convient enfin de préciser que les prescriptions de
l’article 35 sont d’ordre public et que l’irrecevabilité de l’offre de preuve
doit être relevée d’office par le juge (Crim. 19/11/1985, Bull n° 363).
Si l’offre de preuve est possible, encore faut-il avoir
conscience, avant de la proposer, de l’incidence qu’elle peut avoir sur les
débats.
II. Les difficultés tenant à l’incidence de l’offre de
preuve sur les débats
On sait que l’offre de preuve est susceptible de susciter
une offre de preuve contraire de la part du plaignant (B). Mais, il faut,
aussi et surtout, savoir qu’elle peut remettre en cause certains moyens de
défense du prévenu (A). Enfin, l’offre de preuve peut, dans certains cas,
contraindre la juridiction de jugement à surseoir à statuer (C).
A. L’offre de preuve et son incidence sur les moyens de
défense du prévenu
Si l’offre de preuve ne remet pas en cause le droit du
prévenu d’arguer, à titre subsidiaire, de sa bonne foi (2), elle est, en
revanche, de nature à remettre en cause certains moyens de défense
susceptibles d’être invoqués en amont (1).
1. L’incidence de l’offre de preuve sur la contestation du
caractère diffamatoire de l’imputation litigieuse
Partant de l’idée que l’offre de preuve n’est possible que
lorsque les faits sont suffisamment précis et qu’il est donc paradoxal de
prétendre, à la fois, faire la preuve d’un fait précis et contester la
précision dudit fait, la Cour de cassation a posé en règle que "le prévenu
qui a spontanément offert, dans les conditions précisées à l’article 55 de la
loi du 29 juillet 1881, de faire la preuve de la vérité des faits
diffamatoires, ne saurait ensuite soutenir que les termes ou expressions
incriminées ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l’imputation d’un
fait précis susceptible de preuve" (Crim. 29/11/1994, Bull n° 381 ; Crim.
14/04/1992, Bull n° 162 ; Crim. 22/05/1990, Bull n° 211).
Cette solution ne s’imposait pas d’évidence dans la mesure
où :
- l’offre de preuve est toujours faite sous réserve de tous
autres moyens de défense, et ne devrait pas "entamer" les droits de la
défense, au nombre desquels figure celui de faire feu de tout bois ...
- déduire, de l’existence même de l’offre de preuve, la précision du fait,
peut avoir, sur la suite des débats, des conséquences qui méritent d’être
prises en considération :
. si l’offre de preuve vaut reconnaissance de la
précision des faits par celui qui l’a faite, ne doit-on pas en déduire que cet
"aveu de précision" s’impose aux juges ?
. et, si l’offre de preuve lie le juge, imaginons un instant les difficultés
auxquelles se heurteront les magistrats qui estimeront, en conscience et
nonobstant l’existence de l’offre de preuve, les faits insuffisamment précis :
il leur faudra mener des débats et motiver un jugement sur la vérité de faits
que, pour leur part, ils ne parviennent pas à articuler ; de même et si la
vérité n’est pas admise, ils seront contraints d’apprécier la bonne foi d’un
prévenu au regard d’une imputation qui, selon eux, ne constituait pas une
diffamation au sens de la loi !
Cette question, qui peut paraître très théorique, est donc
lourde de conséquences pratiques.
Notons, à cet égard que, si l’offre de preuve fait obstacle
à toute contestation du prévenu sur la précision du fait argué de diffamation,
elle ne l’empêche pas, en revanche, d’établir que ledit fait n’est pas
attentatoire à l’honneur et à la considération du plaignant. La Chambre
criminelle a, en effet, clairement indiqué que "le prévenu, qui a
spontanément demandé dans les conditions déterminées par l’article 55 de la
loi du 29 juillet 1881 à faire la preuve de la vérité des faits allégués,
conserve la faculté de soutenir que les propos ou écrits incriminés ne portent
pas atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile" (Crim.
02/09/2003, Bull n° 150).
2. L’incidence de l’offre de preuve sur l’exception de
bonne foi
L’offre de preuve n’a aucune incidence sur la bonne foi qui
peut toujours être admise :
- "alors même que serait irrecevable la preuve de la
vérité des faits diffamatoires" (Crim. 29/06/1988, Bull n° 160) ;
- lorsque l’offre de preuve n’a pas été admise, car en matière de diffamation,
la preuve de la vérité du fait diffamatoire et la bonne foi constituent deux
questions distinctes (selon la notice de Crim. 27/06/1967, Bull n° 193).
B. L’offre de preuve et l’offre de preuve contraire
L’offre de preuve ouvre la possibilité, pour le plaignant,
de faire une offre de preuve contraire, dans les 5 jours de la signification
de l’offre de preuve et selon les mêmes modalités.
C. L’offre de preuve et le sursis à statuer obligatoire
L’article 35 dernier alinéa de la loi sur la presse prévoit
que "lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la
requête du ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera,
durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au
jugement du délit de diffamation". Ceci concerne l’hypothèse dans
laquelle la preuve est impossible (Crim. 22/05/1990, Bull. n°212), car alors,
la seule façon pour le prévenu de se défendre réside dans l’attente du
résultat des poursuites : on lui laisse donc cette possibilité en rendant le
sursis à statuer obligatoire.
Partant d’une considération identique, la chambre
criminelle a jugé (Crim. 18/12/1978, Bull. n° 358), qu’outre l’hypothèse
ci-dessus, il est également obligatoirement sursis à statuer "lorsqu’un
témoin, inculpé dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la
foi du serment en application de l’article 55 de ladite loi et que les faits
diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux qui ont motivé son inculpation",
au motif que "le prévenu de diffamation ne peut être privé d’un moyen de
preuve prévu par la loi et intéressant sa défense ... par un obstacle
invincible et indépendant de sa volonté". En effet, si l’on se trouve,
ici, dans l’hypothèse inverse d’une offre de preuve possible et offerte, il
n’en reste pas moins que le prévenu se trouve, en pratique, privé de la
possibilité de rapporter la preuve du fait diffamatoire par l’audition du
témoin cité à ce titre, du fait que ce dernier ne peut être entendu sous
serment dans l’affaire en diffamation, sur des faits en rapport étroit avec
ceux objet de sa mise en examen : la Chambre criminelle "restaure" donc la
possibilité pour le prévenu de faire cette preuve, en rendant le sursis
obligatoire jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la culpabilité du
témoin et que ce dernier puisse être entendu sous serment.
Toutefois, afin de remédier aux procédés dilatoires
consistant à faire citer, au titre de l’offre de preuve, un témoin que l’on
sait mis en examen, dans le seul but de différer le jugement de l’affaire de
presse, il appartient aux juridictions du fond d’apprécier la réalité du
rapport étroit invoqué entre les faits diffamatoires litigieux et ceux pour
lesquels le témoin est mis en examen.
Si, en considération de tous ces éléments, l’offre de
preuve apparaît souhaitable, encore faut-il qu’elle obéisse aux formes prévues
par les textes.
III. Les difficultés tenant aux modalités de l’offre de
preuve
Les modalités de l’offre de preuve sont prescrites par
l’article 55 de la loi sur la presse, qui les édicte à peine de déchéance du
droit de faire la preuve.
L’offre de preuve doit être faite, par acte d’huissier, au
domicile élu par le plaignant (c’est là toute l’importance qui s’attache à
l’exigence de cette élection de domicile).
Elle doit satisfaire à des conditions de délai (A) et de
forme (B).
A. Conditions de délai
L’offre de preuve doit être signifiée dans les 10 jours :
- ce délai court à compter de la première citation délivrée
au prévenu (Crim. 06/11/1962, Bull. n° 303) et de nouvelles citations ne
peuvent relever le prévenu de la déchéance encourue (Crim. 28/05/1957, Bull.
n° 451) ;
- il s’agit d’un délai non franc (Crim. 11/05/1960, Bull. n° 253), qui n’est
susceptible d’aucune augmentation, ni du fait des distances (Crim. 24/06/1986,
Bull. n° 223), ni du fait qu’il expire un jour férié (Crim. 12/09/1912,
D.1914, p.148) car le prévenu est censé s’être préconstitué la preuve de la
vérité des faits diffamatoires.
B. Conditions de forme
L’offre de preuve doit par ailleurs :
- préciser "les faits articulés et qualifiés dans la
citation, desquels il entend prouver la vérité" et il ne suffit donc pas
de reproduire in extenso les passages incriminés, "alors même que le
prévenu déclare vouloir faire la preuve de tous les faits visés dans la
citation" (Crim. 22/02/1966, Bull. n° 62 ; Crim. 23/10/1975, Bull.
n° 224 ; Crim. 29/11/1994, Bull. n° 383) ; il n’est fait exception à cette
règle que lorsque la citation n’incrimine qu’un seul fait, "aucun doute ne
pouvant exister dans l’esprit des plaignants sur la preuve contraire à
administrer" (Crim. 27/10/1998, Bull. n° 279) ;
- comporter les pièces apportées en preuve et l’identité
des témoins dont l’audition est demandée à ce titre. On observera, à cet
égard :
. "qu’il n’importe que, lors de son audition par
le tribunal, un des témoins, régulièrement dénoncés en application de
l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ait produit divers documents non
signifiés et que ceux-ci aient été versés au dossier, dès lors que ... les
juges n’ont pas fait état de ces pièces dans leur appréciation de la preuve de
la vérité des faits diffamatoires" (Crim. 28/11/1995, Bull. n° 360) ;
. "qu’aucune disposition légale n’autorise une
personne citée comme témoin (au titre de l’offre de preuve) à
substituer à sa déposition orale une déclaration écrite" (Crim. 26/07/1976,
Bull. n° 270).
Notons enfin que, là encore, les prescriptions de l’article
55 sont d’ordre public et que l’irrégularité de l’offre de preuve doit être
relevée d’office par le juge et peut être invoquée en tout état de cause (Crim. 17/11/1953,
Bull. n° 296 ; Crim. 24/09/2002, Bull. n° 173).
IV. Les difficultés tenant aux conditions d’admission de
l’offre de preuve
Rappelons que la preuve de la vérité des faits
diffamatoires doit être invoquée par le prévenu et n’a pas à être examinée
d’office par les juges (Crim. 05/12/1962, Bull. n° 358 ; Crim. 05/11/1963,
Bull. n° 306). Le régime de l’offre de preuve est, sur ce point, identique à
celui de l’exception de bonne foi (Crim. 14/10/1997, Bull. n° 333).
Il reste à déterminer :
- ce qui doit être prouvé (A) ;
- les éléments qui peuvent être apportés en preuve (B).
A. Eléments qui doivent être prouvés
Selon la formule consacrée par la jurisprudence, "pour
produire l’effet absolutoire, la preuve de la vérité des faits diffamatoires
doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans
toute leur portée" (Crim. 14/06/2000, Bull. n° 225).
Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement
la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus (Crim.
12/04/1976, Bull. n° 114 ; Crim. 22/05/1997, Bull. n° 200).
En revanche, "il appartient à la Cour de cassation de
contrôler si ces mêmes juges ont apprécié la corrélation des faits ainsi
déterminés avec les imputations diffamatoires et se sont par suite prononcés à
bon droit sur l’administration de la preuve ; qu’il en résulte que les juges
du fond ne sauraient se borner à affirmer les résultats de leur appréciation
et qu’ils doivent préciser les éléments sur lesquels ils l’ont fondée" (Crim.
21/11/1989, Bull. n° 431).
B. Eléments qui peuvent être pris en compte
Des difficultés sont apparues quant aux documents ou
témoignages susceptibles d’être pris en compte au titre de la preuve de la
vérité.
1. Date des documents et témoignages
La chambre criminelle a approuvé une cour d’appel qui avait
estimé ne pouvoir trouver la preuve de la vérité des faits diffamatoires dans
des coupures de presse faisant état de déclarations postérieures à la date des
imputations, "dès lors qu’il appert des témoignages ou copies de pièces
produites que (le prévenu) n’était pas en mesure de produire les éléments de
cette preuve au moment où les faits diffamatoires ont été rendus publics"
(Crim. 10/12/1991, Bull. n° 468).
Cette position rapprochait l’appréciation de l’offre de
preuve de celle de la bonne foi au titre de laquelle le prévenu ne peut, très
logiquement d’ailleurs, invoquer que des documents ou témoignages dont il
disposait lors même de la formulation des imputations diffamatoires. Mais la
vérité a, quant à elle, un caractère "intemporel" dont il convient de tenir
compte.
C’est sans doute ce qui explique qu’un arrêt plus récent
indique que "les écrits et témoignages ... doivent, quelle que soit leur
date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation"
(Crim. 22/05/1997, Bull. n° 200).
On en déduit donc qu’en matière de preuve, la date du
document ou témoignage importe peu, seule comptant la date des faits évoqués
dans ceux-ci.
2. Origine des pièces produites
Face aux contestations des parties civiles, qui soutiennent
que la preuve de la vérité repose sur la production de documents ayant été
obtenue par des moyens déloyaux, la chambre criminelle a estimé que les juges
ne pouvaient, de ce seul fait, les écarter et devaient, au contraire, en
apprécier souverainement la valeur (Crim. 18/11/1986, Bull. n° 345 : il
s’agissait en l’espèce de propos recueillis, à l’insu d’un médecin, consulté
par une "fausse patiente" dans le cadre d’une enquête intitulée "Maigrir sur
ordonnance").
Statuant plus récemment sur la production, dans un procès
en diffamation, de pièces couvertes par le secret de l’instruction, la chambre
criminelle a censuré une cour d’appel qui avait écarté ces pièces des débats,
alors que l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence ne pouvait faire
obstacle à ce que la journaliste prévenue produise, pour les nécessités de sa
défense, les pièces d’où étaient tirées les informations rapportées par
l’article incriminé (Crim. 11/02/2003, Bull. n° 29).
A noter que ce fait justificatif a également été admis pour
censurer une cour d’appel qui avait prononcé une condamnation du chef de recel
de violation du secret de l’instruction, alors qu’elle n’avait pas recherché
si la production en justice des pièces litigieuses n’était pas rendue
nécessaire par l’exercice des droits de la défense (Crim. 11/06/2002, Bull.
n° 132).
3. Eléments apportés par d’autres personnes que le prévenu
Cet aspect doit nous conduire à examiner deux questions.
a) La recherche de la vérité par le juge
Rappelons :
- que "seule la juridiction de jugement peut prononcer
sur la vérité du fait diffamatoire" (Crim. 04/11/1986, Bull. n° 323) ;
- "qu’il n’appartient pas aux juridictions d’instruction de rechercher si
les faits relevés comme diffamatoires sont vrais ou faux" (Crim.
04/11/1986, Bull. n° 323), ni même "de la recevoir, à peine d’excès de
pouvoir" (Crim. 26/05/1992, Bull. n° 212) ;
- que la juridiction de jugement ne peut d’ailleurs tenir compte d’éléments
ayant pu être recherchés dans ce but au cours de l’instruction préalable (Crim.
24/10/1989, Bull. n° 379).
Par ailleurs et s’agissant des juridictions de jugement,
les juges n’ont pas le pouvoir de "provoquer, de compléter ou de parfaire
l’établissement d’une preuve que la loi a laissée à la seule initiative de la
partie poursuivie" (Crim. 21/10/1964, Bull. n° 273 ; Crim. 21/11/1989,
Bull. n° 431 ; Civ.2 19/01/1994, Bull. n° 30), de sorte que les juridictions
du fond n’ont pas à ordonner, à cette fin, un supplément d’information ou la
communication d’un dossier d’information.
b) Les éléments provenant du plaignant lui-même
Dans le même esprit, il a été jugé :
- que la reconnaissance, par le plaignant, de la vérité du
fait diffamatoire, "ne peut dispenser le prévenu de suivre la procédure
prescrite pour l’établir, ni autoriser les juges à en déduire le fait
justificatif prévu par l’article 35 de la loi sur la presse" (Crim.
23/12/1968, Bull. n° 357) ;
- que "la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être fondée
sur des éléments de preuve apportés par le plaignant" (Crim. 07/11/1995,
Bull. n° 339).
4. Mise en cause d’une personne à raison de faits n’ayant
donné lieu à aucune condamnation
Rien n’interdit aux juges de la diffamation d’admettre la
vérité des faits diffamatoires, même si les faits dont s’agit n’ont donné lieu
à aucune condamnation contre la personne mise en cause : la Chambre criminelle
l’a indiqué dans une espèce où la preuve avait été admise d’un vol de récolte
par un agriculteur au préjudice d’un autre, alors que les faits avaient donné
lieu à un classement sans suite (Crim. 08/01/1975, Bull. n° 7).
De même, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel
qui a estimé rapportée la preuve de la mise en cause de Paul BARRIL dans
l’affaire des Irlandais de VINCENNES, bien que celui-ci n’ait fait l’objet
d’aucune poursuite dans cette affaire, en soulignant d’ailleurs qu’il n’y
avait aucune atteinte à sa présomption d’innocence puisque, précisément, il
n’avait pas la qualité d’accusé au sens de l’article 6 paragraphe 2 de la
Convention européenne (Crim. 28/11/1995, Bull. n° 360).
Conclusion
La vérité, c’est, dit-on, l’accord de la pensée avec le
réel et il convient de ne pas se laisser emporter par le mythe de la caverne
en confondant l’ombre projetée sur la paroi avec le sujet en pleine lumière.
En droit de la presse, comme en d’autres domaines, la
vérité est exigeante et ne souffre aucune approximation. On peut ainsi
affirmer que "si toute vérité n’est pas bonne à dire", sa preuve est encore
moins facile à faire.
Pour autant, gardons-nous du conseil de Mark TWAIN qui
déclarait volontiers : "la vérité est la chose la plus précieuse que nous
ayons ... Economisons-là !"
La
loi
n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet est retoquée pour l'essentiel par la
Décision
n° 2020-801 DC du Conseil Constitutionnel, du 18 juin 2020.



Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles
d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH,
le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander
de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour
assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.