Pour plus de sécurité, fbls QPC 2022 est sur : https://www.fbls.net/QPC2022.htm
 Publié par Frédéric Fabre docteur en droit.
Publié par Frédéric Fabre docteur en droit.
La jurisprudence du Conseil Constitutionnel en matière de Question Prioritaire de Constitutionnalité, dans l'ordre chronologique.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
M. Manuel R. [Droit de recours dans le cadre de la procédure d'exécution sur le territoire français d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 octobre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1254 du 6 octobre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Manuel R. par Mes Camille Friedrich et Jean-Baptiste de Gubernatis, avocats au barreau d'Aix-en-Provence. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-959 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 728-48 du code de procédure pénale et du deuxième alinéa de l'article 728-52 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France.
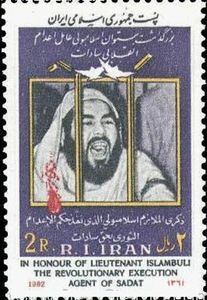 Au vu des textes suivants :
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le requérant par Mes Friedrich et de Gubernatis, enregistrées le 4 novembre 2021 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Mes Friedrich et de Gubernatis pour le requérant, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 14 décembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 728-48 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2013 mentionnée ci-dessus, détermine notamment les conditions dans lesquelles peut être contestée une décision du procureur de la République prise sur une demande de reconnaissance et d'exécution sur le territoire français d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un autre État membre de l'Union européenne. Son second alinéa prévoit : « Toutefois, la personne condamnée n'est pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels en cas de refus d'exécution opposé dans le cas prévu au 3 ° de l'article 728-11 ».
2. Le deuxième alinéa de l'article 728-52 du même code, dans la même rédaction, prévoit : « Si la demande de reconnaissance et d'exécution présentée par l'autorité compétente de l'État de condamnation entre dans les prévisions du 3 ° de l'article 728-11 et si le procureur général déclare ne pas consentir à l'exécution, la chambre des appels correctionnels lui en donne acte et constate que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté ne peut être mise à exécution en France ».
3. Le requérant reproche à ces dispositions de priver une personne condamnée par une juridiction d'un autre État membre de toute possibilité de contester le refus du procureur de la République de consentir à l'exécution sur le territoire français de sa peine. Ces dispositions méconnaîtraient, d'une part, le droit à un recours juridictionnel effectif et, d'autre part, au regard des conséquences qu'emporte un tel refus sur la situation personnelle de la personne condamnée, le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.
4. Il soutient également que ces dispositions priveraient les seules personnes de nationalité étrangère de la possibilité de saisir le juge de ce refus, en méconnaissance du principe d'égalité.
- Sur le fond :
5. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
6. Le procureur de la République est compétent pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance et d'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation à une peine privative de liberté prononcées par les juridictions des autres États membres. En application du 3 ° de l'article 728-11 du code de procédure pénale, une telle reconnaissance est subordonnée au consentement du procureur de la République lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère.
7. Selon l'article 728-43 du même code, le procureur de la République peut refuser de donner son consentement notamment s'il estime que l'exécution en France de la condamnation n'est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne concernée. Dans ce cas, les dispositions contestées de l'article 728-48 prévoient que cette personne n'est pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels pour contester ce refus.
8. Les dispositions contestées de l'article 728-52 prévoient, quant à elles, que, lorsque la chambre des appels correctionnels est saisie d'un recours formé contre une décision de refus fondée sur un autre motif que celui prévu au 3 ° de l'article 728-11, le procureur général peut invoquer cette disposition pour refuser de consentir à l'exécution de la peine en France. La chambre des appels correctionnels doit alors lui en donner acte et constater que la peine privative de liberté ne peut être mise à exécution en France.
9. Il résulte ainsi des dispositions contestées que les personnes qui se voient opposer une décision de refus sur le fondement du 3 ° de l'article 728-11 ne peuvent pas la contester devant une juridiction.
10. Au regard des conséquences qu'est susceptible d'entraîner pour ces personnes une telle décision, l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de cette décision méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
11. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.
 - Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
12. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
13. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le second alinéa de l'article 728-48 du code de procédure pénale et le deuxième alinéa de l'article 728-52 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 13 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Association française des producteurs de cannabinoïdes [Définition de la notion de stupéfiant dans le régime des substances vénéneuses]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 octobre 2021 par le Conseil d'État (décision n° 455024 du 8 octobre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association française des producteurs de cannabinoïdes par Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-960 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 5132-1, L. 5132-7 et L. 5132-8 du code de la santé publique.
 Au vu des textes suivants :
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de la santé publique ;
l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique ;
l'ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques ;
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations en intervention présentées pour le syndicat professionnel du chanvre par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 novembre 2021 ;
les observations en intervention présentées pour l'association Auto-support et réduction des risques parmi les usagers et ex-usagers de drogues et autres par Me Nicolas Hachet, avocat au barreau de Bordeaux, enregistrées le 3 novembre 2021 ;
les observations en intervention présentées pour l'union des professionnels du CBD et autres par Me Xavier Pizarro, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le même jour ;
les observations présentées pour l'association française des producteurs de cannabinoïdes par Me Scanvic, enregistrées le 4 novembre 2021 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations en intervention présentées pour l'union des professionnels du CBD et autres par Me Pizarro, enregistrées le 17 novembre 2021 ;
les secondes observations en intervention présentées pour le syndicat professionnel du chanvre, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 18 novembre 2021 ;
les secondes observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 19 novembre 2021 ;
les secondes observations en intervention présentées pour l'association Auto-support et réduction des risques parmi les usagers et ex-usagers de drogues et autres par Me Hachet, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Scanvic, pour l'association française des producteurs de cannabinoïdes, Me Cédric Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le syndicat professionnel du chanvre, Me Hachet, pour l'association Auto-support et réduction des risques parmi les usagers et ex-usagers de drogues et autres, Me Pizarro, pour l'union des professionnels du CBD et autres, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 14 décembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 22 décembre 2011 mentionnée ci-dessus, de l'article L. 5132-7 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 7 décembre 2020 mentionnée ci-dessus et de l'article L. 5132-8 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 juin 2000 mentionnée ci-dessus.
2. L'article L.
5132-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
du 22 décembre 2011, prévoit : « Sont comprises comme substances vénéneuses :
« 1 ° (Supprimé) ;
« 2 ° Les substances stupéfiantes ;
« 3 ° Les substances psychotropes ;
« 4 ° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à
l'article L. 5132-6.
« Au sens de cette présente partie :
« On entend par »substances" les éléments chimiques et leurs composés comme ils
se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie,
contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.
« On entend par »préparations« les mélanges ou solutions composés de deux
substances ou plus ».
3. L'article L. 5132-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 décembre 2020, prévoit : « Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4 ° de l'article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain ».
4. L. 5132-8 du
code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 juin
2000, prévoit : « La production, la fabrication, le transport, l'importation,
l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de
plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont
soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'État.
« Ces décrets peuvent prohiber toute opération relative à ces plantes et
substances ; ils peuvent notamment, après avis des Académies nationales de
médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des
préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en
contiennent.
« Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont
fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre
des pharmaciens ».
5. L'association requérante, rejointe par une partie intervenante, reproche à ces dispositions de ne pas définir la notion de « substance stupéfiante » et de renvoyer ainsi au pouvoir règlementaire la détermination du champ d'application de la police spéciale qui réglemente ces substances. Ce faisant, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre.
6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 2 ° de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique ainsi que sur le mot « stupéfiants » figurant à l'article L. 5132-7 du même code.
7. Certaines parties intervenantes soutiennent en outre que, dans la mesure où les dispositions pénales qui répriment le trafic et l'usage illicite de stupéfiants renvoient à l'article L. 5132-7 pour définir la notion de stupéfiants, il résulterait des dispositions contestées de cet article une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, du principe de nécessité et de proportionnalité des peines et du principe d'égalité devant la loi pénale.
- Sur l'admission des interventions :
8. Selon le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 mentionné ci-dessus, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention.
9. Le Premier ministre conclut à l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat professionnel du chanvre au motif que son mémoire ne développerait aucun grief à l'encontre des dispositions contestées.
10. Le syndicat professionnel du chanvre, qui rejoint l'association requérante au soutien du grief qu'elle soulève et conclut à ce qu'il y soit fait droit, justifie d'un intérêt spécial. Les conclusions aux fins d'irrecevabilité de son intervention doivent donc être rejetées.
11. L'association Auto-support et réduction des risques parmi les usagers et ex-usagers de drogues et autres, l'union des professionnels du CBD et autres et l'association française des producteurs de cannabinoïdes justifient également d'un intérêt spécial. Leurs interventions sont admises par le Conseil constitutionnel.
- Sur le fond :
12. En premier lieu, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
13. En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » et détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.
14. La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
15. Les articles L. 5132-1 à L. 5132-10 du code de la santé publique soumettent les substances vénéneuses à une police administrative spéciale visant notamment à réglementer leur production, leur commerce et leur emploi.
16. Les dispositions contestées de l'article L. 5132-1 prévoient que les substances vénéneuses comprennent notamment les substances stupéfiantes. Les dispositions contestées de l'article L. 5132-7 prévoient, quant à elles, que les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
17. La notion de stupéfiants désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. En incluant ces substances parmi les substances nocives pour la santé humaine, le législateur n'a pas adopté des dispositions imprécises.
18. En renvoyant à l'autorité administrative le pouvoir de classer certaines substances dans cette catégorie, il n'a pas non plus conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de procéder à ce classement en fonction de l'évolution de l'état des connaissances scientifiques et médicales.
19. Le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre doit donc être écarté.
20. En second lieu, les dispositions contestées n'instituent pas une sanction pénale. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que de l'égalité devant la loi pénale ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
21. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sont conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le 2 ° de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques, ainsi que le mot « stupéfiants » figurant à l'article L. 5132-7 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 janvier 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 octobre 2021 par le Conseil
d'État (décision nos 454719, 454775, 455105 et 455150 du 12 octobre 2021) dans
les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par l'union
syndicale des magistrats administratifs, pour le syndicat de la juridiction
administrative par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat au Conseil d'État et à
la Cour de cassation, pour l'association des anciens élèves de l'École nationale
d'administration et autres par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'État
et à la Cour de cassation, et pour l'association des magistrats de la Cour des
comptes par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel sous le n° 2021-961 QPC. Elle est relative à la conformité aux
droits et libertés que la Constitution garantit :
- de l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de
l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État ;
- des articles L. 133-12-3 et L. 133-12-4 du code de justice administrative,
dans leur rédaction issue de la même ordonnance ;
- des articles L. 122-9 et L. 122-10 du code des juridictions financières, dans
la même rédaction.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code des juridictions financières ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État, prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 59 de la loi du 6 août 2019 mentionnée ci-dessus, dont le délai, prolongé par l'article 14 de la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus, est expiré ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour l'association des anciens élèves de l'École nationale d'administration et autres par la SCP Foussard-Froger, enregistrées le 8 novembre 2021 ;
les observations présentées pour l'association des magistrats de la Cour des comptes par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le même jour ;
les observations présentées par l'union syndicale des magistrats administratifs, enregistrées le même jour ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 9 novembre 2021 ;
les observations en intervention présentées par M. Renaud F., enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées par l'union syndicale des magistrats administratifs, enregistrées le 23 novembre 2021 ;
les secondes observations présentées pour l'association des anciens élèves de l'École nationale d'administration et autres par la SCP Foussard-Froger, enregistrées le 24 novembre 2021 ;
les secondes observations présentées pour l'association des magistrats de la Cour des comptes par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations en intervention présentées par M. Renaud F., enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Anthony Baudiffier, avocat au barreau de Paris, pour l'union syndicale des magistrats administratifs, Me Manuel Delamarre, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le syndicat de la juridiction administrative, Me Régis Froger, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association des anciens élèves de l'École nationale d'administration et autres, Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association des magistrats de la Cour des comptes, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 6 janvier 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 6 de
l'ordonnance du 2 juin 2021 mentionnée ci-dessus prévoit :
« Les nominations, parcours de carrière et mobilités au sein des services
d'inspection générale dont les missions le justifient et dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'État sont régis par les dispositions qui suivent.
« Les chefs de ces services sont nommés par décret en conseil des ministres pour
une durée renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme
de cette durée qu'à leur demande ou en cas d'empêchement ou de manquement à
leurs obligations déontologiques, après avis d'une commission dont la
composition est fixée par décret en Conseil d'État. Le sens de cet avis est
rendu public avec la décision mettant fin aux fonctions.
« Les agents exerçant des fonctions d'inspection générale au sein des mêmes
services sont recrutés, nommés et affectés dans des conditions garantissant leur
capacité à exercer leurs missions avec indépendance et impartialité.
« Lorsqu'ils ne sont pas régis par les statuts particuliers des corps
d'inspection et de contrôle, ces agents sont nommés pour une durée renouvelable.
Pendant cette durée, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande
ou, sur proposition du chef du service de l'inspection générale concernée, en
cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article ».
2. L'article L.
133-12-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la même
ordonnance, prévoit :
« La commission d'intégration comprend :
« 1 ° Le vice-président du Conseil d'État, ou son représentant ;
« 2 ° Un membre du Conseil d'État en exercice ayant au moins le grade de
conseiller d'État et un membre du Conseil d'État en exercice ayant le grade de
maître des requêtes, nommés par le vice-président du Conseil d'État ;
« 3 ° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans
le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République ;
« 4 ° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans
le domaine de l'action publique, nommée par le président de l'Assemblée
nationale ;
« 5 ° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans
le domaine du droit, nommée par le président du Sénat ;
« Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du
vice-président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
« Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2 ° à 5 ° comprennent au
moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'État précise les
modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
« Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et
d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives
ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit
d'intérêts ».
3. L'article L.
133-12-4 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« La commission d'intégration propose la nomination au grade de maître des
requêtes des auditeurs et des maîtres des requêtes en service extraordinaire
après audition des candidats. Elle procède de manière distincte pour les
auditeurs, pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire mentionnés
aux articles L. 133-9 et L. 133-12 et pour les maîtres des requêtes en service
extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin
2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de
l'État et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions
administratives et financières.
« Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période
d'activité au sein du Conseil d'État, l'aptitude des candidats à exercer les
fonctions consultatives et contentieuses et à participer à des délibérations
collégiales, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces
fonctions ainsi que leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les
lignes directrices guidant son évaluation des candidats.
« À l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats retenus
par ordre de mérite dans la limite du nombre fixé par le vice-président.
« Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a
refusé de proposer son intégration.
« Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission ».
4. L'article L.
122-9 du code des juridictions financières, dans la même rédaction, prévoit :
« La commission d'intégration comprend :
« 1 ° Le premier président de la Cour des comptes, ou son représentant ;
« 2 ° Un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant au moins le grade de
conseiller maître et un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant le
grade de conseiller référendaire, nommés par le premier président de la Cour des
comptes ;
« 3 ° Deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences
dans le domaine des finances publiques et de l'évaluation des politiques
publiques, nommées par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
« 4 ° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans
le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République.
« Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du premier
président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
« Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2 ° à 4 ° comprennent au
moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'État précise les
modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
« Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et
d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives
ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit
d'intérêts ».
5. L'article L.
122-10 du code des juridictions financières, dans la même rédaction, prévoit :
« La commission d'intégration décide de la nomination au grade de conseiller
référendaire des auditeurs et des conseillers référendaires en service
extraordinaire. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les
conseillers référendaires en service extraordinaire mentionnés à l'article L.
112-7 et pour les conseillers référendaires en service extraordinaire relevant
de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de
l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État et des règles de
recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et
financières.
« Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période
d'activité au sein de la Cour des comptes, l'aptitude des candidats à exercer
les fonctions de magistrat et à participer à des délibérations collégiales, leur
compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que
leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les lignes directrices
guidant son évaluation des candidats.
« À l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats par ordre
de mérite dans la limite du nombre fixé par le Premier président.
« Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a
refusé de proposer son intégration.
« Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en
Conseil d'État ».
6. Certains requérants reprochent aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2021 de ne pas viser les services d'inspection générale relevant de leur champ d'application et de ne pas entourer de garanties suffisantes les conditions d'exercice des fonctions de leurs agents et de leurs chefs de service. Ces dispositions seraient dès lors entachées d'incompétence négative dans une mesure affectant le principe constitutionnel d'indépendance des membres des services d'inspection générale de l'État, qu'ils demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître sur le fondement de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que, le cas échéant, de son article 16. Ils dénoncent également, pour les mêmes motifs, la méconnaissance directe, par ces dispositions, de ce même principe.
7. Les parties requérantes critiquent les autres dispositions renvoyées en ce qu'elles prévoient que les commissions chargées de proposer la nomination aux grades de maître des requêtes au Conseil d'État et de conseiller référendaire à la Cour des comptes sont composées pour moitié de personnalités nommées par le Président de la République et les présidents des assemblées parlementaires, sans prévoir de règle de départage des voix. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité des fonctions juridictionnelles ainsi que de la séparation des pouvoirs, protégés par l'article 16 de la Déclaration de 1789, en raison du risque d'immixtion des pouvoirs législatif et exécutif dans l'exercice des missions juridictionnelles et de blocage de l'activité des commissions. Pour les mêmes motifs, ils reprochent à ces dispositions d'être entachées d'incompétence négative dans une mesure affectant ces mêmes principes.
8. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2021, sur l'article L. 133-12-3 du code de justice administrative et sur l'article L. 122-9 du code des juridictions financières.
- Sur l'intervention :
9. Selon le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 mentionné ci-dessus, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention.
10. La seule qualité d'inspecteur général de l'administration n'est pas de nature à conférer à M. Renaud F. un intérêt spécial à intervenir dans la procédure. Par conséquent, son intervention n'est pas admise.
- Sur l'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2021 :
11. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par cet article que de dispositions de nature législative.
12. Si les dispositions d'une ordonnance adoptée selon la procédure prévue à l'article 38 de la Constitution acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu'elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l'expiration du délai de l'habilitation, comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution dans les matières qui sont du domaine législatif.
13. D'une part, aucune exigence constitutionnelle n'impose que soit garantie l'indépendance des services d'inspection générale de l'État.
14. D'autre part, en vertu de l'article 34 de la Constitution, « La loi fixe les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ».
15. L'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2021, qui se borne à définir les conditions d'affectation à des emplois au sein de services d'inspection générale de l'État, ne met pas en cause des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'État. Par conséquent, ces dispositions ne peuvent être regardées comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution.
16. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution.
- Sur les autres dispositions contestées :
17. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.
18. L'article L. 133-12-3 du code de justice administrative fixe la composition de la commission d'intégration chargée de proposer la nomination au grade de maître des requêtes au Conseil d'État des auditeurs et des maîtres des requêtes en service extraordinaire. Cette commission est composée de trois membres du Conseil d'État et de trois personnalités qualifiées nommées respectivement par le Président de la République et les présidents des assemblées parlementaires.
19. L'article L. 122-9 du code des juridictions financières fixe quant à lui la composition de la commission d'intégration chargée de décider de la nomination au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes des auditeurs et des conseillers référendaires en service extraordinaire. Cette commission est composée de trois magistrats de la Cour des comptes et de trois personnalités qualifiées nommées respectivement par le Président de la République et les présidents des assemblées parlementaires.
20. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que les personnalités qualifiées membres de ces commissions sont désignées en raison de leurs compétences dans un domaine précis et doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.
21. En deuxième lieu, les articles L. 133-12-4 du code de justice administrative et L. 122-10 du code des juridictions financières précisent que la commission prend en compte l'aptitude des candidats à exercer les fonctions auxquelles ils se destinent et, en particulier, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique.
22. En dernier lieu, l'absence de règle de départage des voix au sein des commissions d'intégration, qui conduit à ce que ne peuvent être proposés à la nomination que des candidats pour lesquels une majorité s'est dégagée, est sans incidence sur l'indépendance et l'impartialité des juridictions.
23. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.
24. Les articles L. 133-12-3 du code de justice administrative et L. 122-9 du code des juridictions financières, qui ne sont pas entachés d'incompétence négative et qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarés conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État.
Article 2. - L'article L. 133-12-3 du code de justice administrative et l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de la même ordonnance, sont conformes à la Constitution.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Époux B. [Imposition des plus-values résultant de la cession à titre onéreux de titres financiers au moyen d'un crédit-vendeur]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 octobre 2021 par le Conseil d'État (décision n° 452773 du 13 octobre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les époux B. par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-962 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article 150-0 A du code général des impôts.
Au vu des textes suivants :
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 9 novembre 2021 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 6 janvier 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2013 mentionnée ci-dessus.
2. Le paragraphe
I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans cette rédaction,
prévoit :
« 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que
des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre
onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire
d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au
1 ° de l'article 118 et aux 6 ° et 7 ° de l'article 120, de droits portant sur
ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs,
droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.
« 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du
contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le
cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement
déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la
société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de
l'année au cours de laquelle il est reçu.
« Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son
origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier
alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou
de l'apport.
« 3. (abrogé)
« 4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels
l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année
au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou
reportée ».
3. Les requérants reprochent à ces dispositions de ne pas prévoir la possibilité pour le contribuable d'obtenir la réduction de l'imposition acquittée sur une plus-value de cession de valeurs mobilières lorsqu'une partie du prix de cette cession n'a pas été effectivement versée par le cessionnaire, notamment dans le cadre d'un crédit-vendeur. Or, selon eux, les capacités contributives du contribuable ne peuvent s'apprécier qu'au regard des sommes qu'il a effectivement encaissées. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « les gains nets retirés des cessions à titre onéreux » figurant au 1 du paragraphe I de l'article 150-0 A du code général des impôts.
5. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
6. L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs.
7. L'article 12 du code général des impôts prévoit que l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.
8. Les dispositions contestées prévoient que sont soumises à l'impôt sur le revenu les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés. Il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'État que la date à laquelle la cession doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur.
9. En premier lieu, en application de l'article 1583 du code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Ainsi, à la date de la vente, le contribuable a acquis une créance certaine dont il peut disposer librement.
10. En second lieu, d'une part, le fait qu'une partie du prix de cession doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d'un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu'ils ont librement choisie. D'autre part, la circonstance que des événements postérieurs affectent le montant du prix effectivement versé au contribuable est sans incidence sur l'appréciation de ses capacités contributives au titre de l'année d'imposition.
11. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques.
12. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « les gains nets retirés des cessions à titre onéreux » figurant au 1 du paragraphe I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 janvier 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 octobre 2021 par le Conseil d'État (décision n° 454722 du 15 octobre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la fédération nationale des chasseurs par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-963 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement, ainsi que de l'article L. 426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du même code.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de l'environnement ;
la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;
la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations en intervention présentées pour la fédération départementale des chasseurs du Gard par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 novembre 2021 ;
les observations en intervention présentées pour la fédération départementale des chasseurs du Gers par Me Antoine Tugas, avocat au barreau de Bayonne, enregistrées le 8 novembre 2021 ;
les observations en intervention présentées pour la fédération départementale des chasseurs des Landes par Me Tugas, enregistrées le même jour ;
les observations présentées pour la fédération requérante par la SCP Spinosi, enregistrées le 10 novembre 2021 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations en intervention présentées pour la fédération départementale des chasseurs du Gard par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 25 novembre 2021 ;
les secondes observations présentées pour la fédération requérante par la SCP Spinosi, enregistrées le 26 novembre 2021 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la fédération requérante, Me Cédric Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la fédération départementale des chasseurs du Gard, Me Tugas, pour les fédérations départementales des chasseurs du Gers et des Landes, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 11 janvier 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du troisième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus, ainsi que de l'article L. 426-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 13 octobre 2014 mentionnée ci-dessus.
2. L'article L.
421-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 24
juillet 2019, est relatif aux fédérations départementales des chasseurs. Son
troisième alinéa prévoit :
« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent
l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les
articles L. 426-1 et L. 426-5 ».
3. L'article L.
426-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 octobre 2014,
prévoit :
« L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale
n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. Un seuil
spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle
culturale de prairie. S'il est établi que les dégâts constatés n'atteignent pas
ces seuils, les frais d'estimation des dommages sont à la charge financière du
réclamant.
« En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel.
« En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime
des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La
Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, visée à l'article L.
426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.
« Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l'exploitant sont
excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais
d'estimation sont à la charge financière du réclamant.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'État ».
4. Les troisième
et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du même code, dans sa rédaction
résultant de la loi du 24 juillet 2019, prévoient :
« Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est
institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et
sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à
tirer destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand
gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition
du conseil d'administration.
« La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa
charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de
grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines
catégories d'adhérents. Elle exige une participation des territoires de chasse ;
elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des
chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque
dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de
participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces
de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de
gestion ».
5. La fédération requérante, rejointe par les parties intervenantes, reproche à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, au motif qu'elles font peser sur les seules fédérations départementales des chasseurs la charge de l'indemnisation des dégâts de grand gibier, alors que son montant a augmenté en raison de la prolifération de certaines espèces et que les chasseurs ne sont pas responsables de ces dégâts. Pour les mêmes motifs, il en résulterait également une méconnaissance du droit de propriété.
6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 » figurant au troisième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement et sur les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du même code.
7. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Si cet article n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
8. Les dispositions contestées de l'article L. 421-5 du code de l'environnement prévoient que les fédérations départementales des chasseurs assurent l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier dont, en application des dispositions contestées de l'article L. 426-5 du même code, le financement est réparti entre leurs adhérents.
9. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer le financement de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 421-5 du code de l'environnement que les fédérations départementales des chasseurs sont chargées de participer à la gestion de la faune sauvage, de coordonner l'action des associations communales et intercommunales de chasse agréées, de conduire des actions de prévention des dégâts de gibier et d'élaborer un schéma départemental de gestion cynégétique, dans lequel figurent notamment les plans de chasse et les plans de gestion. Ainsi, la prise en charge par ces fédérations de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier est directement liée aux missions de service public qui leur sont confiées.
11. En dernier lieu, d'une part, seuls les dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles peuvent donner lieu à indemnisation. En outre, l'indemnisation, dont le montant est déterminé sur la base de barèmes fixés par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal et fait l'objet d'un abattement proportionnel. D'autre part, l'indemnité peut être réduite s'il est établi que l'exploitant a une part de responsabilité dans la survenance des dégâts et aucune indemnité n'est due si les dommages ont été causés par des gibiers provenant de son propre fonds. Par ailleurs, la fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a accordée à l'exploitant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la charge financière que représente en l'état l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier, les dispositions contestées n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit dès lors être écarté.
13. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 » figurant au troisième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Société civile immobilière et agricole du Mesnil [Responsabilité financière du détenteur du droit de chasse en cas de non régulation des espèces causant des dégâts]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 octobre 2021 par le Conseil d'État (décision n° 455017 du 27 octobre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société civile immobilière et agricole du Mesnil par Mes Hélène Thouy et Olivier Vidal, avocats au barreau de Bordeaux. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-964 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 425-5-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de l'environnement ;
la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 18 novembre 2021 ;
les observations en intervention présentées pour la fédération nationale des chasseurs par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour la société requérante par Mes Thouy et Vidal, enregistrées le 3 décembre 2021 ;
les secondes observations en intervention présentées pour la fédération nationale des chasseurs par la SCP Spinosi, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Thouy, pour la société requérante, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie intervenante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 11 janvier 2022 ;
 Et après avoir entendu le rapporteur ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L.
425-5-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars
2012 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne
fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui
causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée
pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation
mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée
à l'article L. 421-5.
« Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce
territoire, le représentant de l'État dans le département, sur proposition de la
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre
départementale ou interdépartementale d'agriculture, après avis de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation
spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux
récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre
d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre
de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa ».
2. La société requérante reproche à ces dispositions de permettre au préfet d'imposer à une personne que soient abattus des animaux sur sa propriété, à l'encontre de ses convictions personnelles. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté de conscience. Elle dénonce également la violation de l'article 2 de la Charte de l'environnement qui résulterait de cette obligation.
3. Elle soutient en outre que, lorsque la personne ne procède pas à ce prélèvement et que des dommages sont causés par le grand gibier provenant de son fonds, le juge judiciaire serait tenu de retenir sa responsabilité financière en considération de l'arrêté préfectoral. Il en résulterait une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif, protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa » figurant au second alinéa de l'article L. 425-5-1 du code de l'environnement.
5. Aux termes de l'article 10 de la Déclaration de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Il en résulte la liberté de conscience.
6. Les dispositions contestées prévoient que le préfet peut notifier au détenteur du droit de chasse d'un territoire un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné, servant le cas échéant de référence à la mise en œuvre de sa responsabilité financière en cas de dommages causés par le grand gibier provenant de son fonds.
7. En premier lieu, le détenteur du droit de chasse ne peut se voir notifier un nombre d'animaux à prélever que lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de son territoire. En autorisant le préfet à prendre une telle mesure, ces dispositions tendent à sauvegarder l'équilibre entre la présence durable d'une faune sauvage et les activités agricoles et sylvicoles en prévenant les dégâts de gibier.
8. En second lieu, les dispositions contestées ne remettent pas en cause le droit du détenteur du droit de chasse d'interdire, au nom de ses convictions personnelles, la pratique de la chasse sur son territoire. Au demeurant, sa responsabilité financière ne peut être engagée qu'en cas de dégâts causés par le grand gibier provenant de son fonds.
9. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de conscience.
10. Par ailleurs, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir d'appréciation reconnu à la juridiction judiciaire pour la mise en œuvre de la responsabilité financière du détenteur du droit de chasse en cas de dommages causés par le gibier provenant de son fonds. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté.
11. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus l'article 2 de la Charte de l'environnement, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa » figurant au second alinéa de l'article L. 425-5-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Société Novaxia développement et autres [Sanction des entraves aux contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 novembre 2021 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 869 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Novaxia développement et autres par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-965 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du f du paragraphe II et du c du paragraphe III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code monétaire et financier ;
le code pénal ;
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour les sociétés requérantes par Me Jean-Philippe Pons-Henry, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 26 novembre 2021 ;
les observations présentées pour l'Autorité des marchés financiers, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Ohl et Vexliard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour les sociétés requérantes par Me Pons-Henry, enregistrées le 13 décembre 2021 ;
les secondes observations présentées pour l'Autorité des marchés financiers par la SCP Ohl et Vexliard, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Pons-Henry, pour les sociétés requérantes, Me Claude Ohl, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'Autorité des marchés financiers, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 18 janvier 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le f du
paragraphe II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa
rédaction résultant de la loi du 9 décembre 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit
que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer une sanction à l'encontre
de :
« Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en
application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des
contrôleurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et
opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un
document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de
communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de
donner accès à des locaux professionnels ».
2. Le c du
paragraphe III du même article, dans la même rédaction, prévoit :
« Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de
l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent
article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100
millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si
celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public ».
3. Les sociétés requérantes soutiennent que ces dispositions ne définiraient pas précisément le manquement qu'elles répriment et institueraient une sanction manifestement excessive. Il en résulterait une méconnaissance des principes de légalité des délits et des peines et de proportionnalité des peines.
4. Elles dénoncent également, comme contraire au principe de nécessité des délits et des peines, le cumul possible entre la sanction administrative prévue par ces dispositions et les sanctions pénales prévues à l'article L. 642-2 du code monétaire et financier en cas d'obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers.
5. Elles soutiennent en outre que, en permettant à l'Autorité des marchés financiers de sanctionner des personnes qui ne sont pas soumises à des obligations qu'elle a pour mission de contrôler, ces dispositions lui octroieraient un pouvoir qui empiéterait sur celui de l'autorité judiciaire, en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs.
6. Elles critiquent enfin l'absence de possibilité de s'opposer aux demandes de l'autorité alors même qu'elles conduiraient la personne sollicitée à révéler des éléments relevant de la vie privée ou qu'elles tendraient à l'obtention d'aveux. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du droit de ne pas s'auto-incriminer.
- Sur le fond :
. En ce qui concerne les griefs autres que celui tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines :
7. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. En vertu du principe de légalité des délits et des peines, le législateur ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir réglementaire, doivent fixer les sanctions ayant le caractère d'une punition en des termes suffisamment clairs et précis.
8. L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
9. Les dispositions contestées punissent d'une sanction pécuniaire toute personne dont le comportement entrave le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle diligenté par l'Autorité des marchés financiers.
10. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, sauf dans le cas d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des marchés financiers, peut être sanctionné le refus opposé par toute personne, après une demande en ce sens des enquêteurs ou contrôleurs, de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou de donner accès à des locaux professionnels. Ainsi, le législateur a précisément défini les éléments constitutifs du manquement ainsi que les personnes auxquelles il peut être reproché.
11. En second lieu, d'une part, en instituant une sanction pécuniaire destinée à assurer l'efficacité des enquêtes et contrôles de l'Autorité des marchés financiers, le législateur a poursuivi l'objectif de préservation de l'ordre public économique. Un tel objectif implique que le montant des sanctions fixées par la loi soit suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention des manquements assignée à la punition.
12. D'autre part, si l'amende peut atteindre cent millions d'euros ou le décuple de l'avantage retiré du manquement, ce montant ne constitue qu'un plafond et doit, en application du paragraphe III ter du même article L. 621-15, être modulé, sous le contrôle du juge, en fonction notamment de la gravité du manquement, de sa situation financière, des manquements commis précédemment et de toute circonstance propre à la personne en cause. Dès lors, ces dispositions n'instituent pas une peine manifestement disproportionnée au regard de la gravité des manquements réprimés.
13. Il résulte de ce qui précède que doivent être écartés les griefs tirés de la méconnaissance des principes de légalité des délits et des peines et de proportionnalité des peines. Il en va de même des griefs tirés de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, du droit au respect de la vie privée et du principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser.
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines :
14. Il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu'une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
15. En premier lieu, l'article L. 642-2 du code monétaire et financier punit de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de faire obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
16. Les refus opposés aux demandes des enquêteurs et contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers étant susceptibles de constituer également des obstacles à une mission de contrôle ou d'enquête, les dispositions contestées du f du paragraphe II de l'article L. 621-15 tendent ainsi à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique que ceux visés par l'article L. 642-2.
17. En deuxième lieu, la sanction administrative instaurée par les dispositions contestées vise, comme la sanction pénale prévue à l'article L. 642-2, à assurer l'efficacité des investigations conduites par l'Autorité des marchés financiers. Ces deux répressions protègent ainsi les mêmes intérêts sociaux.
18. En dernier lieu, le délit prévu à l'article L. 642-2 du code monétaire et financier est puni, lorsque sont en cause des personnes physiques, de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende et, lorsque sont en cause des personnes morales, conformément aux règles énoncées par l'article 131-38 du code pénal, d'une amende de 1 500 000 euros. Ces sanctions ne sont pas d'une nature différente de celle de l'amende prévue par les dispositions contestées du c du paragraphe III de l'article L. 621-15, dont le montant maximal est fixé à cent millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement.
19. Dès lors, la répression administrative du manquement d'entrave aux enquêtes et contrôles de l'Autorité des marchés financiers prévue par les dispositions contestées du f du paragraphe II de l'article L. 621-15 et la répression pénale organisée par l'article L. 642-2 du code monétaire et financier tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux.
20. Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, les dispositions du f du paragraphe II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, qui permettent de poursuivre les refus opposés aux demandes des enquêteurs et contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers, méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
21. En revanche, le c du paragraphe III du même article, qui ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
22. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
23. D'une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur.
24. D'autre part, la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans les procédures en cours par la personne poursuivie en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution lorsqu'elle a préalablement fait l'objet de poursuites sur le fondement de l'article L. 642-2 du code monétaire et financier.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le f du paragraphe II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 23 et 24 de cette décision.
Article 3. - Le c du paragraphe III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans la même rédaction, est conforme à la Constitution.
Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 janvier 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et François PILLET.
M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 novembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1539 du 17 novembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Cédric L. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et pour la société Sogeres, par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-966 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ;
la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
le code de la commande publique ;
l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le requérant par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 7 décembre 2021 ;
les observations présentées pour la société requérante par Me Claire Waquet, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 décembre 2021 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 22 décembre 2021 ;
les secondes observations présentées pour la société requérante par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 23 décembre 2021 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Marie Molinié, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Waquet, pour la société requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 18 janvier 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L.
2141-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance
du 26 novembre 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont
fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues
aux articles 222-34 à 222-40, 225-4-1, 225-4-7, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1,
324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1,
433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1
à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code
général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les
infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre État membre de
l'Union européenne.
« La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une
de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de
direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir
de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne
l'exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale,
tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
« Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée
différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure
de passation des marchés au titre du présent article s'applique pour une durée
de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation ».
2. L'article L.
3123-1 du même code, dans la même rédaction, prévoit : « Sont exclues de la
procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait
l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux
articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à
421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1,
435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du
code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts,
et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de
défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour
recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues
par la législation d'un autre État membre de l'Union européenne.
« La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une
de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de
direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir
de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne
l'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession de cette
personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
« L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession au titre
du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé
de la condamnation ».
3. Selon les requérants, en prévoyant l'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession de toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour certaines infractions, ces dispositions institueraient une peine. Or, elles ne prévoiraient ni que cette peine doit être prononcée par la juridiction de jugement, ni la possibilité pour cette juridiction de la moduler ou celle, pour la personne condamnée, d'en obtenir le relèvement. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et d'individualisation des peines ainsi que du droit à un recours juridictionnel effectif.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive » figurant au premier alinéa de l'article L. 2141-1 du code de la commande publique et sur les mots « Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive » figurant au premier alinéa de l'article L. 3123-1 du même code.
5. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». La transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne. Dans cette hypothèse, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive ou ce règlement des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
6. En application de l'article 38 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 et de l'article 57 de la directive 2014/24/UE du même jour, les autorités adjudicatrices doivent exclure un opérateur économique des procédures de passation des concessions et des marchés lorsque cet opérateur a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions que ces articles énumèrent.
7. Les dispositions contestées des articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique visent à assurer la transposition de ces directives en prévoyant que sont exclues respectivement de la procédure de passation des marchés et de la procédure de passation des contrats de concession les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions que ces articles visent.
8. Ces dispositions se bornent ainsi à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de ces directives.
9. Par conséquent, le Conseil constitutionnel n'est compétent pour contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit que dans la mesure où elles mettent en cause une règle ou un principe qui, ne trouvant pas de protection équivalente dans le droit de l'Union européenne, est inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.
10. Or, en premier lieu, d'une part, les dispositions contestées, qui n'ont pas pour objet de punir les opérateurs économiques mais d'assurer l'efficacité de la commande publique et le bon usage des deniers publics, n'instituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition. D'autre part, les principes de nécessité et d'individualisation des peines, qui sont protégés par le droit de l'Union européenne, ne constituent pas des règles ou principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France.
11. En second lieu, le droit à un recours juridictionnel effectif, qui est également protégé par le droit de l'Union européenne, ne constitue pas non plus une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.
12. Par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les mots « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive » figurant au premier alinéa de l'article L. 2141-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, et sur les mots « Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive » figurant au premier alinéa de l'article L. 3123-1 du même code, dans la même rédaction.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 janvier 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
M. Nicolas F. et autre [Définition des substances constituant des stupéfiants pour les infractions de trafic de stupéfiants]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 novembre 2021 par la Cour de
cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1570 du 24 novembre 2021), dans les
conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Nicolas F.
par la SCP Krivine et Viaud, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le
n° 2021-967 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit de l'article 222-41 du code pénal et de l'article L.
5132-7 du code de la santé publique.
Il a également été saisi le 9 décembre 2021 par le Conseil d'État (décision n°
456556 du 8 décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la
Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a
été posée pour M. Anthony D. par Me Nicolas Hachet, avocat au barreau de
Bordeaux. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel sous le n° 2021-973 QPC. Elle est relative à la conformité aux
droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 5132-7 du code
de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7
décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code pénal ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes ;
la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ;
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour M. Nicolas F. par Me Hachet, enregistrées le 15 décembre 2021 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour le syndicat professionnel du chanvre par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour l'union des professionnels du CBD et autres par Me Xavier Pizarro, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour le syndicat professionnel du chanvre par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 24 décembre 2021 ;
les observations présentées pour M. Anthony D., partie requérante, et pour l'association Groupe de recherche et d'études cliniques sur les cannabinoïdes, partie à l'instance à l'occasion de laquelle la seconde question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Hachet, enregistrées le 29 décembre 2021 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour l'association Auto-support et réduction des risques parmi les usagers et ex-usagers de drogues et autres par Me Hachet, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour l'union des professionnels du CBD et autres par Me Pizarro, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour M. Nicolas F. par Me Hachet, enregistrées le 30 décembre 2021 ;
les secondes observations en intervention présentées pour l'union des professionnels du CBD et autres par Me Pizarro, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour M. Anthony D. et pour l'association Groupe de recherche et d'études cliniques sur les cannabinoïdes par Me Hachet, enregistrées le 13 janvier 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Hachet, pour les requérants, pour l'association Groupe de recherche et d'étude cliniques sur les cannabinoïdes et pour l'association Auto-support et réduction des risques parmi les usagers et ex-usagers de drogues et autres, Me Pizarro, pour l'union des professionnels du CBD et autres, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 1er février 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi, pour celles des dispositions dont la rédaction n'a pas été précisée, de l'article 222-41 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1992 mentionnée ci-dessus et de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2011 mentionnée ci-dessus.
3. L'article
222-41 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1992,
prévoit :
« Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section
les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article
L. 5132-7 du code de la santé publique ».
4. L'article L.
5132-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 29
décembre 2011, prévoit :
« Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme
stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par
arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général
de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».
5. L'article L.
5132-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 7
décembre 2020 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme
stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par
décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé, sans préjudice des dispositions réglementaires
applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les
listes I et II mentionnées au 4 ° de l'article L. 5132-1 contenues dans des
produits autres que les médicaments à usage humain ».
6. Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, reprochent à ces dispositions de ne pas définir la notion de « stupéfiants » et ainsi de renvoyer au pouvoir réglementaire la détermination du champ d'application des infractions relevant du trafic de stupéfiants. Ce faisant, le législateur aurait méconnu le principe de légalité des délits et des peines. Pour les mêmes motifs, et au regard des peines prévues pour de telles infractions, ils reprochent également à ces dispositions de méconnaître les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines ainsi que le principe d'égalité devant la loi pénale.
7. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 222-41 du code pénal ainsi que sur les mots « par arrêté du ministre chargé de la santé » figurant à l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2011, et sur les mots « par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » figurant au même article, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 décembre 2020.
8. En premier lieu, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.
9. Les articles 222-34 à 222-40 du code pénal répriment les crimes et délits relevant du trafic de stupéfiants.
10. L'article 222-41 du même code prévoit que constituent des stupéfiants, au sens de ces dispositions, les substances ou plantes classées comme telles en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.
11. Les dispositions contestées de l'article L. 5132-7, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2011, prévoient que les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants par décision du ministre de la santé. Les dispositions contestées de cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 décembre 2020, prévoient que ce classement est effectué par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
12. La notion de stupéfiants, qui désigne des substances psychotropes se caractérisant par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé, est suffisamment claire et précise pour garantir contre le risque d'arbitraire.
13. Ainsi, en renvoyant à l'autorité administrative le pouvoir de classer certaines substances comme stupéfiants, le législateur n'a pas conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour déterminer les éléments constitutifs des infractions qui s'y réfèrent. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de procéder à ce classement en fonction de l'évolution de l'état des connaissances scientifiques et médicales.
14. Dès lors, en faisant de la notion de stupéfiants un élément dont dépend le champ d'application de certaines infractions pénales, le législateur n'a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines.
15. En second lieu, les dispositions contestées n'instituent, par elles-mêmes, aucune incrimination. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que du principe d'égalité devant la loi pénale, ne peuvent qu'être écartés.
16. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Sont conformes à la Constitution :
l'article 222-41 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes ;
les mots « par arrêté du ministre chargé de la santé » figurant à l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ;
les mots « par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » figurant à l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 février 2022, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Fédération nationale des activités de dépollution [Obligation de stockage des déchets ultimes issus d'activités de tri ou de recyclage pour les exploitants d'installations de stockage des déchets non dangereux]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 novembre 2021 par le Conseil d'État (décision n° 456187 du 26 novembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la fédération nationale des activités de dépollution par Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-968 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de l'environnement ;
la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour la fédération requérante par Me Scanvic, enregistrées le 21 décembre 2021 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Scanvic, pour la fédération requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 1er février 2022 ;
Au vu des pièces suivantes :
la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 4 février 2022 ;
la note en délibéré présentée pour la fédération requérante par Me Scanvic, enregistrée le 9 février 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L.
541-30-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 10
février 2020 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non
inertes est tenu d'y réceptionner les déchets produits par les activités
mentionnées aux a, b et c du 2 ° du II de l'article L. 541-1 ainsi que les
résidus de tri qui en sont issus, lorsqu'elles traitent des déchets issus d'une
collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté
du ministre chargé des installations classées.
« L'obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux
conditions suivantes :
« 1 ° Le producteur ou le détenteur des déchets a informé l'exploitant de
l'installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à
réceptionner avant le 31 décembre de l'année précédente et au moins six mois
avant leur réception effective ;
« 2 ° La réception des déchets dans l'installation de stockage est, au regard de
leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l'autorisation prévue
au 2 ° de l'article L. 181-1 ;
« 3 ° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères prévus au
premier alinéa du présent article, est justifiée par le producteur ou le
détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en
compte la capacité autorisée et la performance de son installation.
« Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des
déchets pour les quantités réservées.
« L'exploitant de l'installation de stockage ne peut facturer au producteur des
déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des
déchets de même nature, selon des modalités définies par décret.
« La mise en œuvre de l'obligation définie au premier alinéa n'ouvre droit à
aucune indemnisation ni de l'exploitant de l'installation de stockage soumis aux
dispositions du présent article, ni des producteurs ou détenteurs dont le
contrat avec cet exploitant n'aurait pu être exécuté en tout ou partie pour
permettre l'admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés,
respectivement, au même premier alinéa ainsi qu'aux 1 ° et 2 °, quelle que soit
la date de conclusion du contrat ».
2. La fédération requérante reproche à ces dispositions d'obliger les exploitants d'installations de stockage de déchets à réceptionner certains déchets à un prix déterminé. Il en résulterait une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre.
3. Elle fait également valoir que, en ne précisant pas suffisamment les conditions dans lesquelles les exploitants sont tenus de réceptionner ces déchets, ni les modalités de détermination du prix de leur traitement, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant les exigences constitutionnelles précitées.
4. En outre, elle soutient que, dans un contexte de saturation des capacités de stockage des installations existantes, l'obligation de réception mise à la charge des exploitants pourrait les conduire à refuser le traitement d'autres déchets, en méconnaissance des contrats préalablement conclus avec leurs apporteurs. Les dispositions renvoyées seraient ainsi contraires au droit au maintien des conventions légalement conclues.
5. La fédération requérante dénonce enfin la rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques qui résulterait, en application des dispositions renvoyées, de l'exclusion de toute indemnisation des préjudices subis par les exploitants et les apporteurs de déchets.
- Sur le fond :
6. Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
7. Les dispositions contestées imposent aux exploitants des installations de stockage de déchets non dangereux et non inertes de réceptionner les déchets ultimes produits par les filières industrielles de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets dès lors qu'elles satisfont à certains critères de performance. Les producteurs ou détenteurs de déchets de ces filières sont redevables du prix de traitement des déchets qu'ils apportent, qui ne peut être facturé par l'exploitant de l'installation de stockage à un montant supérieur à celui habituellement facturé pour des déchets de même nature.
8. En obligeant les exploitants à réceptionner, par priorité, certains déchets ultimes, les dispositions contestées sont susceptibles de faire obstacle à l'exécution des contrats qu'ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d'autres déchets. Elles portent donc atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues.
9. Il ressort des travaux préparatoires que, dans un contexte de raréfaction des capacités de stockage, le législateur a entendu garantir un exutoire aux déchets ultimes de certaines installations de valorisation et favoriser ainsi une gestion plus vertueuse des déchets. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement.
10. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées obligent l'exploitant à réceptionner tous les déchets ultimes qui lui sont apportés par certaines filières industrielles, quand bien même elles ne rencontreraient pas de difficultés pour procéder à leur traitement.
11. En deuxième lieu, les dispositions contestées prévoient que l'exploitant doit être informé de la nature et de la quantité des déchets ultimes qu'il est tenu de prendre en charge au plus tard le 31 décembre de l'année précédant leur réception et au moins six mois avant celle-ci. Néanmoins, ce délai n'est pas de nature à garantir qu'il sera en mesure, à la date de réception de ces déchets, d'exécuter les contrats préalablement conclus avec les apporteurs d'autres déchets, dès lors que les dispositions contestées ne prévoient aucune exception à son obligation de réception.
12. En dernier lieu, les apporteurs de déchets dont le contrat avec un exploitant n'aura pu être exécuté, en tout ou partie, du fait des dispositions contestées, sont privés, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat, de la possibilité de demander réparation des conséquences de cette inexécution.
13. Dès lors, si pour mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, il est loisible au législateur d'instituer une obligation pour les installations de stockage de réceptionner certains déchets ultimes, les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.
14. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
15. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
16. En l'espèce, d'une part, aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.
17. D'autre part, la déclaration d'inconstitutionnalité ne peut pas être invoquée lorsque le producteur ou le détenteur de déchets a régulièrement informé, avant cette même date, l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - L'article L. 541-30-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 16 et 17 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel 11de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 février 2022, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Mme B. et autres [Procédure d'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 décembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1582 du 1er décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme B. et les sociétés Beralto, Crystal, Pralong et Jaze irrevocable trust par Me Hervé Temime, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-969 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 713-36, 713-38, 713-39 et 713-41 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, et des articles 713-37 et 713-40 du même code.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale ;
la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines ;
la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour les requérantes par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 décembre 2021 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour les requérantes par la SCP Spinosi, enregistrées le 11 janvier 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les requérantes, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 1er février 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi, pour celles des dispositions dont la rédaction n'a pas été précisée, de l'article 713-37 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2017 mentionnée ci-dessus et de l'article 713-40 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mars 2012 mentionnée ci-dessus.
2. L'article
713-36 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9
juillet 2010 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« En l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles
713-37 à 713-40 sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation
prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation
des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui
étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent en être le produit
direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit
de cette infraction ».
3. L'article
713-37 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2017,
prévoit :
« Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la
confiscation est refusée :
« 1 ° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une
infraction selon la loi française ;
« 2 ° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire
l'objet d'une confiscation selon la loi française ;
« 3 ° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas
de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles
et des droits de la défense ;
« 4 ° S'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de
poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa
religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses
opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre ;
« 5 ° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de
poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par
la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par
les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un État autre que l'État
demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée,
soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les
lois de l'État de condamnation ;
« 6 ° Si elle porte sur une infraction politique ».
4. L'article
713-38 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010,
prévoit :
« L'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère
en application de l'article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel,
sur requête du procureur de la République.
« L'exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit
définitive et exécutoire selon la loi de l'État requérant.
« L'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux
droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi
française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision
étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux
droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les
tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la
juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi
française.
« Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par
la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie. Il en
est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin ou n'ont
pas conduit à la confiscation des biens saisis ».
5. L'article
713-39 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par
commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi
que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la
décision étrangère de confiscation.
« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent se faire représenter
par un avocat.
« Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision
étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par
commission rogatoire à l'autorité étrangère ayant rendu la décision, la
fourniture, dans un délai qu'il fixe, des informations complémentaires
nécessaires ».
6. L'article
713-40 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mars 2012,
prévoit :
« L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation
émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'État français de la
propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'État
requérant.
« Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code
du domaine de l'État.
« Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total
des montants recouvrés.
« Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués,
déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'État français lorsque ce
montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'État français et
pour moitié à l'État requérant dans les autres cas.
« Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision
autorisant son exécution rend l'État français créancier de l'obligation de payer
la somme d'argent correspondante. À défaut de paiement, l'État fait recouvrer sa
créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré, déduction
faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent
article ».
7. L'article
713-41 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010,
prévoit :
« Pour l'application de la présente section, le tribunal correctionnel compétent
est celui du lieu de l'un des biens objet de la demande ou, à défaut, le
tribunal correctionnel de Paris ».
8. Les requérantes soutiennent, tout d'abord, que ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit de propriété. À l'appui de ces griefs, elles font valoir que les dispositions renvoyées n'imposeraient ni la tenue d'un débat contradictoire devant le tribunal correctionnel, ni la notification de la décision prise par cette juridiction, ni la possibilité de la contester. Elles reprochent en outre à ces dispositions de ne pas déterminer les pièces produites par le procureur de la République et celles communiquées aux personnes concernées.
9. Elles font valoir, ensuite, qu'en ne prévoyant pas les cas dans lesquels les personnes sont entendues par le tribunal correctionnel et les conditions dans lesquelles les pièces leur sont communiquées, ces dispositions seraient contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant la justice.
10. Enfin, pour les mêmes motifs, les dispositions renvoyées seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant les droits précités et méconnaîtraient le principe de clarté de la loi.
11. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa des articles 713-38 et 713-39 du code de procédure pénale.
12. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense.
13. Les dispositions des articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale prévoient les conditions dans lesquelles les juridictions françaises compétentes peuvent autoriser ou refuser l'exécution sur le territoire national d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère.
14. En application des dispositions contestées, le tribunal correctionnel peut, sur requête du procureur de la République, autoriser l'exécution d'une telle décision sans être tenu d'entendre préalablement les personnes intéressées.
15. En premier lieu, d'une part, le tribunal correctionnel ne se prononce que sur l'exécution en France de la décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère, ayant un caractère définitif et exécutoire selon la loi de l'État requérant. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de confiscation. D'autre part, les dispositions contestées permettent au tribunal correctionnel d'entendre, s'il estime utile, l'ensemble des personnes intéressées.
16. En second lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu'elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que les personnes intéressées bénéficient, selon les conditions de droit commun, d'un droit d'appel contre la décision du tribunal correctionnel autorisant l'exécution de la décision étrangère de confiscation. Le droit d'exercer un tel recours implique nécessairement que cette décision soit portée à leur connaissance.
17. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.
18. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et qui ne méconnaissent pas non plus les principes d'égalité devant la loi et devant la justice ou le droit de propriété, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le premier alinéa de l'article 713-38 du code de procédure pénale et le premier alinéa de l'article 713-39 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 février 2022, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
M. Patrick S. [Information sur les voies et délais de recours contre les refus de restitution d'objets placés sous main de justice]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 décembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1583 du 1er décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Patrick S. par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-970 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le requérant par Me François Mazon, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 27 décembre 2021 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Mazon, pour le requérant, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 8 février 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus.
2. Le deuxième
alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, est
relatif à la restitution des objets placés sous main de justice. Il prévoit :
« Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un
danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument
ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition
particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la
décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre
motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général
peut être déférée par l'intéressé au président de la chambre de l'instruction ou
à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification,
par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif ».
3. Le requérant fait valoir que, faute de prévoir que la notification de la décision de refus de restitution d'un bien placé sous main de justice doive comporter l'indication des voies et délais de recours, ces dispositions priveraient la personne intéressée de la possibilité de contester en temps utile cette décision. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que du droit de propriété.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « dans le délai d'un mois suivant sa notification » figurant au deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
5. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
6. L'article 41-4 du code de procédure pénale donne compétence au procureur de la République ou au procureur général pour statuer, d'office ou sur requête de toute personne intéressée, sur la restitution des objets placés sous main de justice au cours de l'enquête, lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans statuer sur le sort de ces objets.
7. La décision de refus de restitution peut faire l'objet d'un recours suspensif de la personne intéressée devant le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction.
8. D'une part, en application des dispositions contestées, la personne intéressée dispose d'un délai d'un mois pour former un tel recours par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec avis de réception.
9. D'autre part, ces dispositions prévoient que ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision de refus de restitution a été effectivement portée à sa connaissance.
10. Dans ces conditions, la personne est mise à même d'exercer un recours contre la décision de refus de restitution d'un objet placé sous main de justice. Par conséquent, en ne prévoyant pas que la notification de cette décision doit faire mention des voies et délais de recours, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.
11. Il résulte de ce qui précède que ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « dans le délai d'un mois suivant sa notification » figurant au deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 février 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et François PILLET.
France nature environnement [Prolongation de plein droit de certaines concessions minières]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 décembre 2021 par le Conseil d'État (décision nos 456524, 456525, 456528 et 456529 du 3 décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par l'association France nature environnement. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-971 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du code minier et de la seconde phrase de l'article L. 144-4 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code minier ;
l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ;
la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par l'association requérante, enregistrées le 17 décembre 2021 ;
les observations en intervention présentées pour la société Compagnie minière Montagne d'or par Me Malik Memlouk, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 23 décembre 2021 ;
les observations en intervention présentées par l'association Guyane nature environnement, enregistrées le 27 décembre 2021 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 28 décembre 2021 ;
les observations en intervention présentées pour l'association Fédération des opérateurs miniers de Guyane par Mes Frédéric Scanvic et Corentin Chevallier, avocats au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées par l'association requérante, enregistrées le 6 janvier 2022 ;
les secondes observations en intervention présentées pour la société Compagnie minière Montagne d'or par Me Memlouk, enregistrées le 12 janvier 2022 ;
les secondes observations en intervention présentées pour l'association Fédération des opérateurs miniers de Guyane par Mes Scanvic et Chevallier, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Jeanne Bonacina Lhommet, avocate au barreau de Paris, pour l'association requérante, Me Memlouk, pour la société Compagnie minière Montagne d'or, Me Alexandre Faro, avocat au barreau de Paris, pour l'association Guyane nature environnement, Me Scanvic, pour l'association Fédération des opérateurs miniers de Guyane, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 8 février 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L.
142-7 du code minier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 janvier 2011
mentionnée ci-dessus, prévoit :
« La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations
successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans ».
2. L'article L.
142-8 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'État ».
3. L'article L.
142-9 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a
pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession
reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité
administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres
sur lesquels porte la demande de prolongation ».
4. L'article L.
144-4 du code minier, dans la même rédaction, prévoit que les anciennes
concessions minières perpétuelles expirent le 31 décembre 2018. Sa seconde
phrase prévoit :
« La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à
cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2
de la section 1 du chapitre 2 du présent titre ».
5. L'association requérante, rejointe par l'une des parties intervenantes, soutient que ces dispositions permettraient la prolongation de certaines concessions minières sans que l'autorité administrative n'ait à prendre en compte les effets sur l'environnement d'une telle décision. Il en résulterait une méconnaissance des exigences découlant des articles 1er, 2 et 3 de la Charte de l'environnement.
6. Elle estime, en outre, qu'un tel régime de prolongation priverait d'effet utile la participation du public à l'élaboration de cette décision, en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement.
7. L'association requérante reproche enfin à ces dispositions d'instituer une différence de traitement injustifiée entre les exploitants de concessions minières puisque seuls ceux qui exploitent une ancienne concession perpétuelle bénéficient de ce régime de prolongation.
8. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase de l'article L. 144-4 du code minier.
- Sur le fond :
9. Selon l'article 1er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.
10. En application de l'article L. 144-4 du code minier, les concessions minières initialement instituées pour une durée illimitée devaient expirer le 31 décembre 2018. Les dispositions contestées prévoient que ces concessions sont prolongées de droit lorsque les gisements sur lesquels elles portent sont encore exploités à cette date.
11. En premier lieu, la décision de prolongation d'une concession minière détermine notamment le cadre général et le périmètre des travaux miniers. Au regard de son objet et de ses effets, elle est ainsi susceptible de porter atteinte à l'environnement.
12. En second lieu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021 mentionnée ci-dessus, les dispositions contestées ne soumettaient la prolongation de la concession à aucune autre condition que celle de l'exploitation du gisement au 31 décembre 2018. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoyaient que l'administration prenne en compte les conséquences environnementales d'une telle prolongation avant de se prononcer. À cet égard, est indifférente la circonstance que certaines de ces conséquences pouvaient être, le cas échéant, prises en considération ultérieurement à l'occasion des autorisations de recherches et de travaux devant se dérouler sur le périmètre de la concession.
13. Par conséquent, le législateur a méconnu, pendant cette période, les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement.
14. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021, l'article L. 114-3 nouveau du code minier prévoit à son paragraphe II notamment que la demande de prolongation d'une concession est refusée si l'administration émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder à l'exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux mentionnés à l'article L. 161-1 du même code. Le paragraphe III de l'article L. 114-3 précise, en outre, que l'administration peut imposer à l'exploitant de respecter un cahier des charges, annexé à l'acte octroyant le titre minier, pouvant notamment prévoir l'interdiction de certaines techniques de recherche ou d'exploitation. En application de l'article 67 de la même loi, ces dispositions s'appliquent à toutes les demandes en cours d'instruction à cette date.
15. Dès lors, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le fait que les dispositions contestées prévoient que la prolongation des anciennes concessions perpétuelles est de droit ne saurait être interprété comme faisant obstacle à la prise en compte des conséquences sur l'environnement de la décision de prolongation de ces concessions.
16. Par conséquent, depuis cette date et sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent plus les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement. Elles ne méconnaissent pas non plus les articles 2 ou 7 de la Charte de l'environnement, ni le principe d'égalité, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
17. Il résulte de tout ce qui précède que ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021 et, sous la réserve énoncée au paragraphe 15, conformes à celle-ci à compter de cette date.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
18. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
19. D'une part, l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021 a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
20. D'autre part, aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable aux instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La seconde phrase de l'article L. 144-4 du code minier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, est contraire à la Constitution avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Article 2. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 15, la seconde phrase de l'article L. 144-4 du code minier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, est conforme à la Constitution à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Article 3. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 20 de cette décision.
Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 février 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et François PILLET.
Association Avocats pour la défense des droits des étrangers et autres [Légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 décembre 2021 par le Conseil d'État (décision nos 448305, 454144 et 455519 du 3 décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers et Informations sur les mineurs isolés étrangers par la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et pour l'association Gisti, le syndicat des avocats de France et le Conseil national des barreaux par Me Vincent Lassalle-Byhet, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-972 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour l'association Gisti, le syndicat des avocats de France et le Conseil national des barreaux par Me Lassalle-Byhet, enregistrées le 24 décembre 2021 ;
les observations présentées pour les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers et Informations sur les mineurs isolés étrangers par la SCP Zribi et Texier, enregistrées le 27 décembre 2021 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 28 décembre 2021 ;
les secondes observations présentées pour l'association Gisti, le syndicat des avocats de France et le Conseil national des barreaux par Me Lassalle-Byhet, enregistrées le 12 janvier 2022 ;
les secondes observations présentées pour les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers et Informations sur les mineurs isolés étrangers par la SCP Zribi et Texier, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Isabelle Zribi, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers et Informations sur les mineurs isolés étrangers, Me Lassalle-Byhet, pour l'association Gisti, le syndicat des avocats de France et le Conseil national des barreaux, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 8 février 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le paragraphe
II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus prévoit :
« Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une
autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y
produire effet.
« La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la
signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas
échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
« Un décret en Conseil d'État précise les actes publics concernés par le présent
II et fixe les modalités de la légalisation ».
2. Les parties requérantes reprochent d'abord à ces dispositions d'imposer à une personne la légalisation d'un acte public étranger dont elle entend se prévaloir en France, sans garantir que l'examen de sa demande intervienne dans un délai utile, ni prévoir de recours en cas de refus de légalisation par l'autorité compétente. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense et d'un « droit à la preuve » qui découlerait également de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elles font enfin valoir qu'en déléguant au pouvoir réglementaire la détermination des modalités de la légalisation de tels actes, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant les droits précités.
3. Certaines parties requérantes soutiennent également que, au regard des conséquences de l'absence de légalisation sur une demande de titre de séjour, ces dispositions seraient contraires au droit de mener une vie familiale normale, au droit d'asile ainsi qu'à un droit à l'identité. Selon elles, ces dispositions méconnaîtraient en outre l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors qu'elles priveraient les mineurs étrangers de la possibilité de prouver leur minorité.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019.
- Sur le fond :
5. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
6. En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « la nationalité, l'état et la capacité des personnes ». Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.
7. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
8. Aux termes du paragraphe II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
9. En application des dispositions contestées de ce même paragraphe, sauf engagement international contraire, toute personne qui entend faire produire des effets en France à un acte public établi par une autorité étrangère doit en obtenir la légalisation.
10. Toutefois, d'une part, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État, telle qu'elle ressort notamment de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que le juge administratif ne se reconnaît pas compétent pour apprécier la légalité d'une décision de refus de légalisation d'un acte de l'état civil. D'autre part, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent aux personnes intéressées de contester une telle décision devant le juge judiciaire.
11. Au regard des conséquences qu'est susceptible d'entraîner cette décision, il appartenait au législateur d'instaurer une voie de recours.
12. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont entachées d'incompétence négative dans des conditions qui portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
13. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 doivent être déclarés contraires à la Constitution.
14. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
15. En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont contraires à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 15 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 février 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et François PILLET.
M. Youcef Z. [Réquisition de données informatiques par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire II]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 décembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1559 du 7 décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Youcef Z. par Me Karim Morand-Lahouazi, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-974 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée ;
la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021 ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 30 décembre 2021 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 15 février 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article
77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24
décembre 2020 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou
l'agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne,
de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration
publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant
l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement
de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme
numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans
que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret
professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux
articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur
accord.
« En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions
du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
« Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
« Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales
prises en application de l'article 39-3, autoriser les officiers ou agents de
police judiciaire, pour des catégories d'infractions qu'il détermine, à requérir
de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de
toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant
l'enquête qui sont issues d'un système de vidéoprotection. Le procureur est
avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée
qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées ».
2. Le requérant reproche à ces dispositions de permettre au procureur de la République, sans contrôle préalable d'une juridiction indépendante, de requérir des données de connexion. Ce faisant, ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée, ainsi que les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « , y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale.
4. Aux termes du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
5. L'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. Elle fait obstacle à ce que le Conseil soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la même version d'une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf changement des circonstances.
6. Dans sa décision du 3 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « , y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020, contraires à la Constitution et décidé de reporter leur abrogation au 31 décembre 2022.
7. Dès lors, en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les mots « , y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 février 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
M. Roger C. [Information de la personne mise en cause du droit qu'elle a de se taire lors d'un examen réalisé par une personne requise par le procureur de la République - Information du tuteur ou du curateur de la possibilité de désigner un avocat pour assister un majeur protégé entendu librement]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 décembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1560 du 7 décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Roger C. par Me Marie-Emmanuelle Beloncle, avocate au barreau de Nantes. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-975 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, d'une part, de l'article 77-1 du code de procédure pénale et, d'autre part, de l'article 706-112-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le requérant par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 30 décembre 2021 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Manuela Grévy, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 15 février 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi, pour celle des dispositions dont la rédaction n'a pas été précisée, de l'article 77-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 77-1
du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou
scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci,
l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes
qualifiées.
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60
sont applicables ».
3. L'article
706-112-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019,
prévoit :
« Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime
ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement font apparaître qu'une personne
devant être entendue librement en application de l'article 61-1 fait l'objet
d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire
en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou
demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne
lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n'a pu être avisé et si la
personne entendue n'a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette
personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation ».
4. Le requérant reproche aux dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale de ne pas prévoir que la personne mise en cause soit informée de son droit de garder le silence lorsqu'elle est entendue sur les faits qui lui sont reprochés par une personne qualifiée requise par le procureur de la République. Il en résulterait une méconnaissance du droit de se taire.
5. Il fait par ailleurs valoir que les dispositions de l'article 706-112-2 du même code ne prévoiraient pas que le tuteur ou le curateur, lorsqu'il est avisé de l'audition libre du majeur protégé, soit informé de la possibilité qu'il a de désigner ou de faire désigner un avocat pour l'assister. Elles seraient ainsi contraires aux droits de la défense et, pour les mêmes motifs, entachées d'incompétence négative.
6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur les mots « a recours à toutes personnes qualifiées » figurant au premier alinéa de l'article 77-1 du code de procédure pénale et, d'autre part, sur la première phrase de l'article 706-112-2 du même code.
- Sur les dispositions contestées de l'article 77-1 du code de procédure pénale :
7. Selon l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire.
8. Les dispositions contestées permettent au procureur de la République d'avoir recours, dans le cadre d'une enquête préliminaire, à toutes personnes qualifiées pour procéder à des constatations ou examens techniques ou scientifiques.
9. En application de ces dispositions, il peut, en particulier, requérir une telle personne pour procéder à l'examen psychologique ou psychiatrique de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction afin, notamment, de s'assurer des conditions préalables à l'exercice des poursuites.
10. Au cours de cet examen, la personne requise a la faculté d'interroger la personne mise en cause sur les faits qui lui sont reprochés. Cette dernière peut ainsi être amenée, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître sa culpabilité.
11. Or, le rapport établi à l'issue de cet examen, dans lequel sont consignées les déclarations de la personne mise en cause, est susceptible d'être porté à la connaissance de la juridiction de jugement.
12. Dès lors, en ne prévoyant pas que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit être informée de son droit de se taire lors d'un examen au cours duquel elle peut être interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, les dispositions contestées de l'article 77-1 du code de procédure pénale méconnaissent les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
- Sur les dispositions contestées de l'article 706-112-2 du code de procédure pénale :
13. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.
14. En vertu de l'article 61-1 du code de procédure pénale, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée de ses droits, notamment de celui d'être assistée par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
15. Les dispositions contestées prévoient que, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne devant être entendue librement fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit aviser par tout moyen son tuteur ou son curateur. Elles prévoient également que, dans ce cas, ce dernier peut désigner un avocat ou demander la désignation d'un avocat commis d'office afin d'assister le majeur protégé lors de son audition.
16. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que le majeur protégé soit, au cours de son audition libre, assisté dans l'exercice de ses droits et, en particulier, dans l'exercice de son droit à l'assistance d'un avocat.
17. Ainsi, les dispositions contestées impliquent nécessairement que, lorsqu'il est avisé de l'audition libre du majeur protégé, le tuteur ou le curateur est informé par les enquêteurs de la possibilité qu'il a de désigner ou faire désigner un avocat pour assister ce dernier.
18. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté.
19. Par conséquent, les dispositions contestées de l'article 706-112-2 du code de procédure pénale, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
20. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
21. En l'espèce, d'une part, les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur.
22. D'autre part, la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « a recours à toutes personnes qualifiées » figurant au premier alinéa de l'article 77-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - La première phrase de l'article 706-112-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est conforme à la Constitution.
Article 3. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 21 et 22 de cette décision.
Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 décembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts nos 1590 et 1591 du 7 décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour M. Habib A. et M. Samy B. par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2021-976 QPC et 2021-977 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes II et III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code des postes et des communications électroniques ;
la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour les deux requérants par Me Bertrand Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Raphaël Chiche, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 3 janvier 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour M. Lazreg B. et autres par Mes Périer et Chiche, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour M. Pierre R. par Me Périer et Me Joanna Grauzam, avocate au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour l'association Ligue des droits de l'homme et l'association des avocats pénalistes par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour les associations La quadrature du net et Franciliens.net par Me Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, avocat au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour les associations La quadrature du net et Franciliens.net par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, enregistrées le 18 janvier 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Chiche, pour les requérants et pour M. Lazreg B. et autres, Me Grauzam, pour M. Pierre R., Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association Ligue des droits de l'homme et l'association des avocats pénalistes, Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, pour les associations La quadrature du net et Franciliens.net, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 15 février 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. Le paragraphe
II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques,
dans sa rédaction résultant de la loi du 18 décembre 2013, prévoit :
« Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes
dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public
en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous
réserve des dispositions des III, IV, V et VI.
« Les personnes qui fournissent au public des services de communications
électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l'alinéa
précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des
autorités compétentes.
« Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou
accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en
ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont
soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de
communications électroniques en vertu du présent article ».
3. Le paragraphe
III de ce même article, dans la même rédaction, prévoit :
« Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des
infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation définie à l'article L.
336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les besoins de la
prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal, et dans le
seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de
l'autorité judiciaire ou de la haute autorité mentionnée à l'article L. 331-12
du code de la propriété intellectuelle ou de l'autorité nationale de sécurité
des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la
défense, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations
tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données
techniques. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées
par le VI, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon
l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les
modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et
spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'État, par les
opérateurs ».
4. Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, reprochent à ces dispositions d'imposer aux opérateurs de communications électroniques la conservation générale et indifférenciée des données de connexion, sans la réserver à la recherche des infractions les plus graves ni la subordonner à l'autorisation ou au contrôle d'une juridiction ou d'une autorité indépendante. L'une des parties intervenantes ajoute qu'une telle conservation ne serait pas nécessaire en raison de l'existence d'autres moyens d'investigation. Il en résulterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, ainsi qu'une méconnaissance du droit de l'Union européenne.
5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales » et « de l'autorité judiciaire ou » figurant à la première phrase du paragraphe III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
- Sur le fond :
6. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée.
7. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il lui incombe d'assurer la conciliation entre, d'une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée.
8. L'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques. Son paragraphe II prévoit que les opérateurs de communications électroniques effacent ou rendent anonymes les données relatives au trafic enregistrées à l'occasion des communications électroniques dont ils assurent la transmission.
9. Par dérogation, les dispositions contestées du paragraphe III prévoient que ces opérateurs peuvent être tenus de conserver pendant un an certaines catégories de données de connexion, dont les données de trafic, pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, en vue de la mise à disposition de telles données à l'autorité judiciaire.
10. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions.
11. Toutefois, en premier lieu, les données de connexion conservées en application des dispositions contestées portent non seulement sur l'identification des utilisateurs des services de communications électroniques, mais aussi sur la localisation de leurs équipements terminaux de communication, les caractéristiques techniques, la date, l'horaire et la durée des communications ainsi que les données d'identification de leurs destinataires. Compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, ces données fournissent sur ces utilisateurs ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée.
12. En second lieu, d'une part, une telle conservation s'applique de façon générale à tous les utilisateurs des services de communications électroniques. D'autre part, l'obligation de conservation porte indifféremment sur toutes les données de connexion relatives à ces personnes, quelle qu'en soit la sensibilité et sans considération de la nature et de la gravité des infractions susceptibles d'être recherchées.
13. Il résulte de ce qui précède qu'en autorisant la conservation générale et indifférenciée des données de connexion, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
14. Par conséquent, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
15. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
16. D'une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur.
17. D'autre part, la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales » et « de l'autorité judiciaire ou » figurant à la première phrase du paragraphe III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 16 et 17 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 février 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Mme Pascale G. [Notification d'un nouveau congé pour reprise en cas de prorogation d'un bail à ferme jusqu'à l'âge de la retraite]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 décembre 2021 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 892 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Pascale G. par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-978 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code rural et de la pêche maritime ;
la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 6 janvier 2022 ;
les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 18 janvier 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Frédéric Rocheteau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 22 février 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du troisième alinéa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la loi du 13 octobre 2014 mentionnée ci-dessus.
2. Le troisième
alinéa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, dans cette
rédaction, prévoit :
« Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de
prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à
l'article L. 411-47 ».
3. La requérante reproche à ces dispositions de prévoir que le bailleur ayant valablement délivré un congé pour reprise, auquel le preneur s'est opposé en raison de son âge pour obtenir la prorogation du bail, doit délivrer un nouveau congé pour pouvoir reprendre son bien à l'issue de cette prorogation. Elle fait également valoir que, dans certains cas, le bailleur serait placé dans l'impossibilité de délivrer ce nouveau congé. Il en résulterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre.
- Sur le fond :
4. Il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
5. L'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur qui entend refuser le renouvellement d'un bail rural aux fins de reprise de l'exploitation doit délivrer au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, un congé présentant les motifs et les conditions de cette reprise. En application du deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du même code, le preneur peut toutefois s'y opposer s'il se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu pour les exploitants agricoles ou de l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. Le bail est alors prorogé de plein droit pour une durée égale à celle lui permettant d'atteindre l'âge correspondant.
6. Les dispositions contestées imposent au bailleur qui souhaite reprendre son bien au terme de la période de prorogation de délivrer, au moins dix-huit mois avant son expiration, un nouveau congé au preneur.
7. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir la continuité des exploitations agricoles en s'assurant qu'à l'issue de la période de prorogation, le bailleur souhaite toujours reprendre son bien en vue de l'exploiter et remplit les conditions pour ce faire.
8. Toutefois, il résulte des dispositions contestées que, dans le cas où le preneur s'oppose à la reprise moins de dix-huit mois avant l'expiration de la période de prorogation, le bailleur est placé dans l'impossibilité de notifier un nouveau congé, dans le délai imparti.
9. Dès lors, ces dispositions portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
10. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
11. En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2022 la date de l'abrogation de ces dispositions.
12. En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, en cas d'opposition du preneur à la reprise du bail dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur n'est pas tenu de délivrer un nouveau congé en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles si la durée de la prorogation du bail résultant de cette opposition est inférieure à dix-huit mois.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le troisième alinéa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 11 et 12 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Société Prologue [Recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers contre les décisions de la commission des sanctions]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 décembre 2021 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 910 du 15 décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Prologue par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-979 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code monétaire et financier ;
la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour la société requérante par la SCP Melka-Prigent-Drusch, enregistrées le 5 janvier 2022 ;
les observations présentées pour l'Autorité des marchés financiers, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Ohl et Vexliard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 janvier 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour la société requérante par la SCP Melka-Prigent-Drusch, enregistrées le 20 janvier 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Marie-Paule Melka, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Frank Martin-Laprade, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, Me Claude Ohl, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'Autorité des marchés financiers, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 22 février 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le troisième
alinéa de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, dans sa rédaction
résultant de la loi du 30 décembre 2014 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet
d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité
des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une
personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes
conditions, former un recours ».
2. La société requérante reproche à ces dispositions de prévoir que, dans le cas où la personne sanctionnée forme un recours contre la décision de sanction, le président de l'Autorité des marchés financiers peut former un recours incident, sans ouvrir la même possibilité pour la personne sanctionnée lorsque ce dernier forme un recours contre la décision de sanction. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la justice, du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense. Ces dispositions seraient également entachées, pour les mêmes motifs, d'incompétence négative dans des conditions affectant ces exigences constitutionnelles.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier.
4. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.
5. En application de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, les décisions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers à l'encontre de personnes autres que celles soumises à sa régulation peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. Ce recours principal peut être formé par la personne sanctionnée et par le président de l'Autorité des marchés financiers.
6. Les dispositions contestées prévoient que, lorsque la personne sanctionnée a formé un recours contre la décision de sanction, le président de l'Autorité des marchés financiers peut former un recours incident.
7. D'une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, par dérogation au principe général du droit selon lequel la situation de la personne sanctionnée ne peut être aggravée sur son seul recours, permettre à l'autorité de poursuite de solliciter l'aggravation de la sanction dans le cas où la personne sanctionnée forme un recours contre cette sanction. Dans ces conditions, ces dispositions ne procèdent pas à une distinction procédurale injustifiée.
8. D'autre part, les dispositions contestées n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de priver une personne sanctionnée, en cas de recours principal du président de l'Autorité des marchés financiers contre une décision de la commission des sanctions, de la possibilité de présenter des demandes reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la sanction prononcée.
9. Au demeurant, il appartient aux juridictions d'apprécier la recevabilité de telles demandes en garantissant le caractère juste et équitable de la procédure ainsi que l'équilibre des droits des parties.
10. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et qui ne méconnaissent ni les droits de la défense, ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et François PILLET.
Société H. et autres [Droit de visite et de saisie en matière fiscale]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 décembre 2021 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 911 du 15 décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société H. et autres par Me Romain Laffly, avocat au barreau de Lyon. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-980 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code général des impôts ;
le livre des procédures fiscales ;
la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016 (chambre commerciale, n° 15-14.554) ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour les requérants par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 janvier 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour les requérants par la SCP Spinosi, enregistrées le 24 janvier 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Aurélie Carrara, avocate au barreau de Lyon, pour les requérants, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 22 février 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L.
16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du
29 décembre 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale,
estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à
l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou
des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes
sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se
rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des
écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est
imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues
au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le
grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des
finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des
visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant
sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et
procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
« II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les lieux à visiter.
« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et
qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance
unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention
territorialement compétents.
« Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui
lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
« L'ordonnance comporte :
« a) L'adresse des lieux à visiter ;
« b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu
l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
« c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite
de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des
renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son
représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que
l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur
identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.
« d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil
de son choix.
« L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de
visite et de saisie.
« Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit
qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements
frauduleux dont la preuve est recherchée.
« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence
d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont
la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et
documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se
trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a
pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de
cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments
révélant l'existence en d'autres lieux de pièces et documents se rapportant aux
agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation
délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder
immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et
documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
« La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le
contrôle du juge qui les a autorisées. À cette fin, il donne toutes instructions
aux agents qui participent à ces opérations.
« Il désigne le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé
d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
« Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance,
il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au
treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le
ressort duquel s'effectue la visite.
« Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant
l'intervention.
« À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant
des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite,
par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis.
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par
acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les
parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit
être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé
ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe
de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la
remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet
appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« III. - La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt
et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert
deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de
celle de l'administration des impôts.
« Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être
assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les
inspecteurs.
« Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et
l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et
documents avant leur saisie.
« L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et
des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est
applicable.
« III bis. - Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent
recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les
agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de
son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir
informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et
justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal
mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces
agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été
recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent.
« Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son
représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur
identité et de leur adresse.
« Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas
échéant, du refus de signer.
« IV. - Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération
et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les
agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents
saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont
signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police
judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en
cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents
saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est
avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de
l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
« IV bis. - Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à
l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur
lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de
ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de
quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou
documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur
lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa
copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés
et de la détention.
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le
support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des
impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au
clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à
l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents
présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de
police judiciaire.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces
et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents
de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui
est annexé, s'il y a lieu.
« Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par
l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de
sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les
restituer.
« V. - Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont
été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes
documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est
également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de
l'article L. 103.
« Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les
six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées,
leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
« Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
« Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a
autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de
visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit
être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé
ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe
de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise
ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au
premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VI. - L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les
informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements
mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents
saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle
visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
« Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la
notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est
annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la
restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci
n'ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies
sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle
mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les
conditions prévues à l'article L. 76 C.
« En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie
dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au
contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification
prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à
l'article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la
nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie
qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le
début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est
informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le
contrôle desquels, les opérations sont réalisées ».
2. Les requérants reprochent à ces dispositions de permettre à l'administration fiscale de saisir toutes les données accessibles ou disponibles depuis les supports informatiques présents dans les lieux visités, y compris lorsque ces données sont stockées dans des lieux distincts de ceux dont la visite a été autorisée par le juge et appartiennent à des tiers à la procédure. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du principe de l'inviolabilité du domicile.
3. Ils reprochent également à ces dispositions de ne pas prévoir l'information des tiers à la procédure en cas de saisie d'un document informatique leur appartenant lors d'une visite domiciliaire, ce qui les priverait ainsi de la possibilité de contester utilement une telle opération. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense.
4. Pour les mêmes motifs, les requérants soutiennent que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant les exigences constitutionnelles précitées.
5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ou d'être accessibles ou disponibles » figurant au paragraphe I de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée :
6. Selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée.
7. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et le droit au respect de la vie privée.
8. L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet aux agents habilités de l'administration fiscale d'effectuer des visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d'être détenus des pièces et documents se rapportant à des agissements frauduleux en matière d'impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d'affaires.
9. En application des dispositions contestées, ces agents peuvent procéder à la saisie des documents accessibles ou disponibles depuis les locaux visités, notamment ceux présents sur un support informatique, quand bien même ces documents sont stockés sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts.
10. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu adapter les prérogatives de l'administration fiscale à l'informatisation des données des contribuables et à leur stockage à distance sur des serveurs informatiques. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
11. En deuxième lieu, d'une part, le droit de saisie reconnu aux agents habilités de l'administration des impôts ne peut être mis en œuvre qu'au titre d'une visite ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements de fraude fiscale, dans le cas où il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
12. D'autre part, si peuvent être saisis à cette occasion des documents n'appartenant pas aux personnes visées par ces présomptions, ce n'est qu'à la condition qu'ils se rapportent à de tels agissements.
13. En dernier lieu, d'une part, la saisie ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une visite autorisée par le juge des libertés et de la détention, qui doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Sa décision doit être motivée par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
14. D'autre part, les opérations de visite et de saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui est tenu informé du déroulement de ces opérations et peut donner des instructions aux agents, se rendre dans les locaux durant l'intervention et décider à tout moment la suspension ou l'arrêt de la visite.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées procèdent à une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et le droit au respect de la vie privée.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif :
16. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
17. L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite des agents de l'administration des impôts peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de quinze jours. Ce dernier connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ces recours peuvent être formés non seulement par la personne visée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et l'occupant des lieux visités, mais aussi par toute personne ayant qualité et intérêt à contester la régularité de la saisie d'un document.
18. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit donc être écarté.
19. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent ni le principe d'inviolabilité du domicile ni les droits de la défense, non plus qu'aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « ou d'être accessibles ou disponibles » figurant au paragraphe I de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
M. Jean-Mathieu F. [Destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables saisis dans le cadre d'infractions au code de l'environnement]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 décembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1599 du 14 décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Jean-Mathieu F. par Me Jean-Sébastien de Casalta, avocat au barreau de Bastia. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-981 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 172-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de l'environnement ;
la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le requérant par Me de Casalta, enregistrées le 10 janvier 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour le requérant par Me de Casalta, enregistrées le 19 janvier 2022 ;
les observations présentées pour M. Lucien P., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Cynthia Costa Sigrist, avocate au barreau de Bastia, enregistrées le 3 février 2022 ;
les observations présentées pour l'Office de l'environnement de la Corse, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Sébastien Mabile, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 4 février 2022 ;
les observations présentées pour M. Sylvain M., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Anne-Marie Antonetti, avocate au Barreau de Bastia, enregistrées le 10 février 2022 ;
les nouvelles observations présentées pour le requérant par Me de Casalta, enregistrées 14 février 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Lia Simoni, avocate au barreau de Bastia, pour le requérant, Me Mabile, pour l'Office de l'environnement de la Corse, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 8 mars 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le premier
alinéa de l'article L. 172-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction
résultant de la loi du 8 août 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article
L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et des
animaux morts ou non viables ».
2. Le requérant, rejoint par certaines parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, reproche à ces dispositions de permettre la destruction des animaux morts ou non viables saisis à la suite de la constatation d'une infraction au code de l'environnement sans prévoir que la personne mise en cause ou des témoins n'assistent à leur décompte. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire.
3. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire.
4. Selon l'article L. 172-12 du code de l'environnement, les agents publics spécialement habilités et les inspecteurs de l'environnement, commissionnés et assermentés à cette fin, peuvent, dans le cadre de leur mission de recherche et de constatation des infractions au code de l'environnement, saisir notamment les animaux et végétaux qui sont l'objet d'une telle infraction.
5. Les dispositions contestées de l'article L. 172-13 du même code prévoient que, lorsque ces végétaux et animaux sont morts ou non viables, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder ou faire procéder à leur destruction.
6. D'une part, tant la saisie des végétaux et animaux objet d'une infraction que la destruction de ceux qui seraient morts ou non viables sont constatées par procès-verbal versé au dossier de la procédure, en application respectivement du quatrième alinéa de l'article L. 172-12 et du dernier alinéa de l'article L. 172-13.
7. D'autre part, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que la personne mise en cause puisse contester les procès-verbaux sur le fondement desquels elle est poursuivie, ceux-ci faisant foi jusqu'à preuve contraire qui peut être apportée par écrit ou par témoins.
8. Dès lors, la personne intéressée est mise en mesure de contester devant le juge les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause.
9. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le premier alinéa de l'article L. 172-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Alain JUPPÉ, Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 décembre 2021 par le Conseil d'État (décision n° 456741 du 14 décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la commune de la Trinité par Mes Simon Daboussy et Aude de Prémare, avocats au barreau de Nice. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-982 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Au vu des textes suivants :
Au vu des pièces suivantes :
Après avoir entendu Me de Prémare, pour la commune requérante, Me Tissier, pour la commune d'Aspremont et autres, Me Pozzo di Borgo, pour la commune de Beaulieu-sur-Mer et autres, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 8 mars 2022 ;
Au vu des pièces suivantes :
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe IV de l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2020 mentionnée ci-dessus.
2. Le paragraphe
IV de l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019, dans cette rédaction,
prévoit :
« A.- Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes
suivants :
« 1 ° La somme :
« a) Du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux
meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de
2020 par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le
territoire de la commune ;
« b) Des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la
commune ;
« c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur
les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020
au profit de la commune ;
« 2 ° La somme :
« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la
commune ;
« b) Des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;
« c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les
propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le
territoire de la commune.
« B.- Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport
entre les termes suivants :
« 1 ° La somme :
« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;
« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la
commune ;
« c) De la différence définie au A du présent IV ;
« 2 ° La somme :
« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;
« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la
commune.
« C.- À compter de l'année 2021 :
« 1 ° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2 ° du A excède
de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1 ° du même A, le produit de taxe
foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :
« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié
par :
« - le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la
commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
« - et le coefficient correcteur défini au B ;
« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par
le rapport entre :
« - la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la
commune appliqué au titre de l'année et la somme des taux de taxe foncière sur
les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de
la commune en 2020 ;
« - et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué
au titre de l'année.
« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties
prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre
2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B
du présent IV diminué de 1.
« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c du présent 1 ° est négative,
elle s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code
général des collectivités territoriales ;
« 2 ° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1 ° du A excède
celle mentionnée au 2 ° du même A, le produit de taxe foncière sur les
propriétés bâties versé à la commune est majoré d'un complément. Ce complément
est égal à la somme :
« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié
par :
« - le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la
commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
« - et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties
prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre
2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B
du présent IV diminué de 1.
« 3 ° La différence, au titre d'une année, entre le produit net issu des rôles
généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d'une
commune et le produit versé à cette commune en application du 1 ° du présent C
est affectée au financement du complément prévu au 2 ° au titre de la même
année.
« D.- Pour l'application du 2 ° du A et des B et C aux communes situées sur le
territoire de la métropole de Lyon :
« 1 ° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière
sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le
territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des
rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au
profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le
rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le
territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de
taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune
en 2020 au profit de la métropole ;
« 2 ° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles
supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les
références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles
supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre
le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en
2020 au profit de la métropole de Lyon.
« E.- Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les
coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l'année au
cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les
modalités prévues au B.
« F.- Les dispositions des A à E du présent IV ne s'appliquent pas à la Ville de
Paris.
« G.- Un abondement de l'État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F
est institué. Il est constitué :
« 1 ° D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application
aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de
l'article 1641 du code général des impôts ;
« 2 ° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41
de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des
prélèvements résultant de l'application à la cotisation foncière des entreprises
du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
« 3 ° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41
de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant
de l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de
l'article 1647 du code général des impôts.
« Pour constituer l'abondement, il est recouru à titre principal au produit
mentionné au 1 ° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés
au 2 ° puis au 3 °.
« L'abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments
prévus au 2 ° du C et le montant total des différences calculées en application
du 3 ° du même C.
« H.- Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est
réalisée au cours du premier semestre de la troisième année suivant celle de son
entrée en vigueur.
« En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er
mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de
compensation prévu au présent IV, notamment :
« 1 ° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en
distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs
capacités d'investissement ;
« 2 ° Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les
communes à la construction de logements sociaux ;
« 3 ° L'impact sur l'évolution de la fiscalité directe locale et, le cas
échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux
d'habitation ;
« 4 ° L'impact sur le budget de l'État ».
3. La commune requérante, rejointe par les parties intervenantes, reproche à ces dispositions de ne pas compenser intégralement la perte de ressources induite par la suppression de la taxe d'habitation, faute d'intégrer, au titre des ressources à compenser, le produit de la part de taxe d'habitation directement perçu par un syndicat de communes sur option de ses membres.
4. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les communes dont la contribution à un syndicat de communes prend la forme de l'affectation du produit d'une part de leur taxe d'habitation, et les autres communes, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi fiscale.
5. Il en résulterait également, au regard de la perte de ressources pour certaines communes, une méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales.
6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le a du 1 ° du A du paragraphe IV de l'article 16 de la loi du 29 décembre 2019.
7. Les communes intervenantes font valoir, pour les mêmes motifs, que ces dispositions méconnaîtraient en outre le principe d'égalité devant les charges publiques.
- Sur le fond :
8. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
9. En application de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, un syndicat de communes est financé par une contribution obligatoire versée sous la forme soit d'une dotation budgétaire de la commune associée, soit d'une contribution fiscalisée résultant de l'affectation d'une part du produit d'impôts locaux, dont celui de la taxe d'habitation. Dans ce dernier cas, le paragraphe III de l'article 1636 B octies du code général des impôts prévoit que le produit à recouvrer dans la commune est réparti entre ces impositions proportionnellement aux recettes que chacune procurerait à la commune en appliquant les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
10. L'article 16 de la loi du 29 décembre 2019 prévoit la suppression progressive de la taxe d'habitation due au titre de la résidence principale pour tous les contribuables à compter de 2023. Afin de compenser cette suppression pour les communes, il leur transfère la part de taxe foncière sur les propriétés bâties antérieurement perçue par les départements. Il institue également un mécanisme correcteur pour que le produit ainsi transféré corresponde au montant du produit de la taxe d'habitation perdu par chaque commune.
11. Les dispositions contestées prévoient que, pour déterminer ce montant, le mécanisme correcteur prend en compte le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales perçu par chaque commune, calculé en appliquant à la base imposable constatée en 2020 le taux communal de taxe d'habitation de 2017.
12. Il résulte des travaux parlementaires que, en instaurant ce mécanisme correcteur, le législateur a entendu compenser intégralement le produit de la taxe d'habitation perdu par les communes et assurer ainsi que la suppression de cette taxe ne se répercute pas sur d'autres impôts locaux au détriment du pouvoir d'achat des contribuables communaux que la réforme visait à améliorer par cette suppression.
13. Or, en prévoyant que le produit de la taxe d'habitation à compenser à une commune est déterminé par l'application de son taux communal à la base imposable, les dispositions contestées n'incluent pas le produit de la part de taxe affecté au syndicat de communes au titre de sa contribution lorsque la commune a choisi de financer le syndicat par une contribution fiscalisée.
14. Ainsi, ces dispositions ont pour effet de priver les seules communes qui affectaient une part de leur taxe d'habitation à un syndicat de communes du bénéfice d'une compensation intégrale de la taxe d'habitation levée sur leur territoire. Il en résulte que ces communes doivent contribuer au financement du syndicat soit au moyen d'une dotation budgétaire, soit par l'augmentation du montant des autres impositions acquittées par le contribuable local et affectées au syndicat, en méconnaissance pour ces communes et pour leurs contribuables de l'objectif poursuivi par le législateur.
15. Dès lors, compte tenu de cet objectif qu'il s'est assigné, le législateur a méconnu, par les dispositions contestées, le principe d'égalité devant les charges publiques. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, ces dispositions doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
16. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
17. D'une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur.
18. D'autre part, la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le a du 1 ° du A du paragraphe IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 17 et 18 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Alain JUPPÉ, Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
M. X et autres [Intervention du juge judiciaire en cas de maintien d'un étranger en zone d'attente]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 décembre 2021 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 809 du 16 décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. X, l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers et l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-983 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, et de l'article L. 222-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;
la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour les requérants par la SCP Spinosi, enregistrées le 10 janvier 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, l'association Cimade, le Conseil national des barreaux, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature par la SCP Spinosi, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour les requérants par la SCP Spinosi, enregistrées le 25 janvier 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les parties requérantes et intervenantes, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 8 mars 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L.
221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans
sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 mentionnée ci-dessus,
prévoit :
« L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne
et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu
dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic
international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un
port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le
temps strictement nécessaire à son départ.
« Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en
France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si
l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre État en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013,
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement,
si sa demande n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée.
« Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le
cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas
irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile,
notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de
viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle,
nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles
avec le maintien en zone d'attente, il est mis fin à ce maintien. L'étranger est
alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité
administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande
d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office.
« Le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement
nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas irrecevable
ou manifestement infondée, n'est possible que de manière exceptionnelle et
seulement dans les cas prévus aux 1 ° et 2 ° du I, au 1 ° du II et au 5 ° du III
de l'article L. 723-2.
« Les dispositions du présent titre s'appliquent également à l'étranger qui se
trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de
transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse
de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé
l'entrée et l'ont renvoyé en France.
« Le présent titre s'applique également à l'étranger qui arrive en Guyane par la
voie fluviale ou terrestre.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du
demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers ».
2. L'article L.
222-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 mars 2016
mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision
initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention
statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une
durée qui ne peut être supérieure à huit jours ».
3. Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, reprochent à ces dispositions de permettre le maintien en zone d'attente d'un étranger pendant un délai de quatre jours sans l'intervention d'un juge judiciaire et sans préciser les règles de computation de ce délai. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté individuelle et du droit à un recours juridictionnel effectif.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale » figurant à l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter. La liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible.
6. En application de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration peut décider de maintenir en zone d'attente l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ainsi que l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile.
7. Les dispositions contestées prévoient que, au-delà d'un délai de quatre jours à compter de la décision de maintien de l'étranger en zone d'attente, la prolongation de cette mesure doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention. Elles ont ainsi pour effet de permettre de le priver de liberté durant ce délai sans l'intervention du juge judiciaire.
8. En premier lieu, le maintien en zone d'attente est destiné à permettre à l'administration d'organiser le départ de l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'entrée en France ou, dans le cas d'un étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, de vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre État membre ou si elle n'est pas irrecevable ou manifestement infondée. L'étranger ne peut être maintenu en zone d'attente que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences.
9. En second lieu, selon les dispositions contestées, le délai de quatre jours commence à courir dès le prononcé de la décision initiale de maintien en zone d'attente. Ces dispositions ne prévoient, par ailleurs, aucun motif de prorogation de ce délai.
10. Dès lors, en permettant à l'administration de maintenir en zone d'attente un étranger pendant un délai maximal de quatre jours sans l'intervention du juge judiciaire, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution.
11. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale » figurant à l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Alain JUPPÉ, Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Société Eurelec trading [Cumul de sanctions administratives]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 décembre 2021 par le Conseil d'État (décision n° 457203 du 29 décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Eurelec trading par Me Olivier Laude, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-984 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce.
Au vu des textes suivants :
Au vu des pièces suivantes :
Après avoir entendu Me Laude, pour la société requérante, Me Utzschneider, pour la société intervenante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 15 mars 2022 ;
Au vu de la note en délibéré présentée pour la société requérante par Me Laude, enregistrée le 18 mars 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 9 mars 2017 mentionnée ci-dessus.
2. Le paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce, dans cette rédaction, prévoit : « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement ».
3. La société requérante, rejointe par la partie intervenante, reproche à ces dispositions de méconnaître le principe de proportionnalité des peines, dès lors qu'elles ne prévoient aucun plafond au cumul des sanctions administratives prononcées pour des manquements en concours. Elle soutient également que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, faute de définir la notion de « manquements en concours ». La partie intervenante dénonce enfin, comme contraire au principe non bis in idem, le cumul de sanctions administratives permis par ces dispositions.
4. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
5. L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
6. En vertu de l'article L. 470-2 du code de commerce, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer des amendes administratives en cas de non-respect des obligations en matière de transparence, de pratiques restrictives de concurrence, d'autres pratiques prohibées ou d'inexécution d'une mesure d'injonction notifiée à un professionnel soumis à ces règles.
7. Selon les dispositions contestées, lorsqu'un manquement à ces règles a été commis par une personne avant que celle-ci ait été définitivement sanctionnée pour un autre manquement, les sanctions administratives prononcées à son encontre s'exécutent cumulativement.
8. En premier lieu, aucune exigence constitutionnelle n'impose que des sanctions administratives prononcées pour des manquements distincts soient soumises à une règle de non-cumul.
9. En second lieu, d'une part, les dispositions contestées n'ont pas pour objet de déterminer le montant des sanctions encourues pour chacun des manquements réprimés. D'autre part, elles ne font pas obstacle à la prise en compte par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de la nature des manquements, de leur gravité et de leur répétition pour déterminer le montant des sanctions, en particulier lorsqu'elles s'appliquent de manière cumulative.
10. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, Michel PINAULT et François SENERS.
Société Eurelec trading [Cumul de sanctions administratives]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 décembre 2021 par le Conseil d'État (décision n° 457203 du 29 décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Eurelec trading par Me Olivier Laude, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-984 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de commerce ;
l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour la société requérante par Me Laude, enregistrées le 21 janvier 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour la société ITM Alimentaire international par Me Yann Utzschneider, avocat au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Laude, enregistrées le 7 février 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Laude, pour la société requérante, Me Utzschneider, pour la société intervenante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 15 mars 2022 ;
Au vu de la note en délibéré présentée pour la société requérante par Me Laude, enregistrée le 18 mars 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 9 mars 2017 mentionnée ci-dessus.
2. Le paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce, dans cette rédaction, prévoit : « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement ».
3. La société requérante, rejointe par la partie intervenante, reproche à ces dispositions de méconnaître le principe de proportionnalité des peines, dès lors qu'elles ne prévoient aucun plafond au cumul des sanctions administratives prononcées pour des manquements en concours. Elle soutient également que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, faute de définir la notion de « manquements en concours ». La partie intervenante dénonce enfin, comme contraire au principe non bis in idem, le cumul de sanctions administratives permis par ces dispositions.
4. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
5. L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
6. En vertu de l'article L. 470-2 du code de commerce, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer des amendes administratives en cas de non-respect des obligations en matière de transparence, de pratiques restrictives de concurrence, d'autres pratiques prohibées ou d'inexécution d'une mesure d'injonction notifiée à un professionnel soumis à ces règles.
7. Selon les dispositions contestées, lorsqu'un manquement à ces règles a été commis par une personne avant que celle-ci ait été définitivement sanctionnée pour un autre manquement, les sanctions administratives prononcées à son encontre s'exécutent cumulativement.
8. En premier lieu, aucune exigence constitutionnelle n'impose que des sanctions administratives prononcées pour des manquements distincts soient soumises à une règle de non-cumul.
9. En second lieu, d'une part, les dispositions contestées n'ont pas pour objet de déterminer le montant des sanctions encourues pour chacun des manquements réprimés. D'autre part, elles ne font pas obstacle à la prise en compte par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de la nature des manquements, de leur gravité et de leur répétition pour déterminer le montant des sanctions, en particulier lorsqu'elles s'appliquent de manière cumulative.
10. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, Michel PINAULT et François SENERS.
Société Concept immo et autre [Aggravation du sort du prévenu par la juridiction de renvoi après cassation intervenue sur son seul pourvoi]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 janvier 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 245 du 26 janvier 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Concept immo et Mme Leila B. par Me Jérôme Rousseau et Me Guillaume Tapie, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-985 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 609 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de procédure pénale ;
l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour les requérantes par Mes Rousseau et Tapie, enregistrées le 15 février 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 16 février 2022 ;
les observations en intervention présentées pour l'association des avocats pénalistes et l'association Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Rousseau, pour les requérantes, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les parties intervenantes, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 22 mars 2022 ;
Au vu des pièces suivantes :
la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 28 mars 2022 ;
la note en délibéré présentée pour les parties intervenantes par la SCP Spinosi, enregistrée le 29 mars 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 609 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 décembre 1958 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée ».
2. Les requérantes, rejointes par les parties intervenantes, reprochent à ces dispositions de permettre à la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation d'aggraver la peine antérieurement prononcée, même dans le cas où la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu. Elles auraient ainsi pour effet de dissuader ce dernier de former un pourvoi, en méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
3. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
4. En application des dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi, statuant sur les appels qui avaient été formés par le prévenu et le ministère public, peut aggraver la peine antérieurement prononcée, y compris lorsque la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu.
5. En premier lieu, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité pour la personne condamnée de former un pourvoi en cassation et d'obtenir l'annulation de la décision attaquée.
6. En second lieu, dans le cas où elle obtient cette annulation, la personne condamnée est replacée, dans les limites du pourvoi et de la cassation, dans la situation où elle se trouvait avant le prononcé de la décision. Son affaire sera à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi. La circonstance que cette juridiction puisse aggraver la peine antérieurement prononcée dans le cas où le ministère public avait fait appel de la décision de première instance est ainsi sans incidence sur l'effectivité du pourvoi en cassation.
7. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.
8. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - L'article 609 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
M. Saïd Z. [Conditions de recours aux moyens des services de l'État soumis au secret de la défense nationale dans le cadre de certaines procédures pénales] Conformité
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 février 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 173 du 1er février 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Saïd Z. par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-987 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 230-1 à 230-5 et 706-102-1 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de la défense ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;
la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ;
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi, enregistrées le 21 février 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour l'association des avocats pénalistes et l'association Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour l'association La Quadrature du net par Me Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, avocat au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi, enregistrées le 8 mars 2022 ;
les secondes observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations en intervention présentées pour l'association La Quadrature du net par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Robin Binsard, avocat au barreau de Paris, pour le requérant, l'association des avocats pénalistes et l'association Ligue des droits de l'homme, Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, pour l'association La Quadrature du net, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 29 mars 2022 ;
Au vu de la note en délibéré présentée pour le Premier ministre, enregistrée le 1er avril 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 230-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 mentionnée ci-dessus, de l'article 230-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 août 2018 mentionnée ci-dessus, de l'article 230-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus, de l'article 230-4 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014, de l'article 230-5 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2001 mentionnée ci-dessus et de l'article 706-102-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus.
2. L'article
230-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 13
novembre 2014, prévoit :
« Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il
apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de
l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant
d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre,
ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, le
procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police
judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner
toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations
techniques permettant d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en
clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la
convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
« Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal
soumet à l'agrément du procureur de la République, de l'officier de police
judiciaire ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des
personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les
opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont
inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées
prêtent, par écrit, le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 et à
l'article 160.
« Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et
que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de
la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire,
sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la
juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens
de l'État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au
présent chapitre ».
3. L'article
230-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 août 2018,
prévoit :
« Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction,
l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République
ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire
décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux
moyens de l'État couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition
écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la
défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les
données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le
délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le
délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. À tout moment, le
procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police
judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis
l'organisme technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
« Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l'organisme technique
mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à procéder à
l'ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux
scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports
physiques qu'il était chargé d'examiner. En cas de risque de destruction des
données ou du support physique qui les contient, l'autorisation d'altérer le
support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la
juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire.
« Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent
être communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L.
2312-8 du code de la défense.
« Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de
communications électroniques, au sein du traitement mentionné au I de l'article
230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné
en application du premier alinéa du présent article ».
4. L'article
230-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016,
prévoit :
« Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont
techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception
de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la
juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation
du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de
jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont
retournés par le responsable de l'organisme technique soit à l'auteur de la
réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été
adressée directement. Sous réserve des obligations découlant du secret de la
défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques
utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation
visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des
résultats transmis.
« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et
sont versés au dossier de la procédure ».
5. L'article
230-4 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014,
prévoit :
« Les décisions prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère
juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours ».
6. L'article
230-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2001,
prévoit :
« Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale,
les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus
d'apporter leur concours à la justice ».
7. L'article
706-102-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019,
prévoit :
« Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour
objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des
données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les
transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles
qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement
automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou
telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques.
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute
personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à
l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la
réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent
article. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également
prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense
nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du
livre Ier ».
8. Le requérant et les associations intervenantes reprochent à ces dispositions de permettre au procureur de la République de recourir discrétionnairement à des moyens couverts par le secret de la défense nationale, qui sont soustraits au débat contradictoire, pour procéder à la captation de certaines données informatiques. La personne mise en cause serait ainsi privée de la possibilité de contester la régularité de l'opération, en méconnaissance des droits de la défense, des principes de l'égalité des armes et du contradictoire et du droit à un recours juridictionnel effectif. Ces dispositions seraient, pour les mêmes motifs, entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant ces exigences constitutionnelles.
9. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du second alinéa de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale.
10. L'une des associations intervenantes soutient, pour les mêmes motifs, que ces dispositions méconnaîtraient également le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données personnelles, le secret des correspondances et la liberté d'expression.
11. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire.
12. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, les droits de la défense et le principe du contradictoire et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, dont participe le secret de la défense nationale.
13. En application des articles 706-95-11 et suivants du code de procédure pénale, sont susceptibles d'être mises en œuvre des techniques spéciales d'investigation applicables à la criminalité et à la délinquance organisées, au nombre desquelles figure la captation de données informatiques.
14. Les dispositions contestées de l'article 706-102-1 du même code permettent au procureur de la République, au cours de l'enquête, et au juge d'instruction, au stade de l'instruction, de recourir aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale pour réaliser les opérations techniques nécessaires à cette captation et à la mise au clair des données. Ces dispositions ont ainsi pour effet de soustraire au débat contradictoire les informations relatives à ces moyens.
15. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux autorités en charge des investigations de bénéficier de moyens efficaces de captation et de mise au clair des données, sans pour autant fragiliser l'action des services de renseignement en divulguant les techniques qu'ils utilisent. Ce faisant, ces dispositions poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
16. En deuxième lieu, il ne peut être recouru à ces moyens que pour la mise en œuvre d'une technique spéciale d'investigation qui doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction et justifiée par les nécessités d'une enquête ou d'une information judiciaire relatives à certains crimes et délits d'une particulière gravité et complexité. Cette technique est mise en œuvre sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui l'a autorisée et qui peut ordonner à tout moment son interruption. Les données captées dans le cadre des investigations sont placées sous scellés en application de l'article 706-95-18 du code de procédure pénale.
17. En troisième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles de soustraire au contradictoire certaines informations techniques soumises au secret de la défense nationale, demeure obligatoirement versée au dossier de la procédure l'ordonnance écrite et motivée du juge qui autorise la mise en œuvre d'un dispositif de captation et mentionne, à peine de nullité, l'infraction qui motive le recours à ce dispositif, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données concernés, ainsi que la durée pendant laquelle cette opération est autorisée. Sont également versés au dossier le procès-verbal de mise en place du dispositif, qui mentionne notamment la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et s'est terminée, et celui décrivant ou transcrivant les données enregistrées jugées utiles à la manifestation de la vérité. Enfin, l'ensemble des éléments obtenus à l'issue des opérations de mise au clair font l'objet d'un procès-verbal de réception versé au dossier de la procédure et sont accompagnés d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
18. En dernier lieu, la juridiction peut demander la déclassification et la communication des informations soumises au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées procèdent à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
20. Ces dispositions, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La seconde phrase du second alinéa de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 avril 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
M. Roland B. [Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à un contrôle fiscal]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 février 2022 par le Conseil d'État (décision n° 458277 du 8 février 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Roland B. par Me Éric Planchat, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-988 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article 1732 du code général des impôts.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code général des impôts ;
le livre des procédures fiscales ;
l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le requérant par Me Planchat, enregistrées le 17 février 2022 ;
les observations en intervention présentées pour la société Byck consulting par Me Laura Jaricot, avocate au barreau de Lyon, enregistrées le 2 mars 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 3 mars 2022 ;
les secondes observations présentées pour le requérant par Me Planchat, enregistrées le 16 mars 2022 ;
les secondes observations en intervention présentées pour la société Byck consulting par Me Jaricot, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Planchat, pour le requérant, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 29 mars 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des deux premiers alinéas de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 7 décembre 2005 mentionnée ci-dessus.
2. Les deux
premiers alinéas de l'article 1732 du code général des impôts, dans cette
rédaction, prévoient :
« La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.
74 du livre des procédures fiscales entraîne :
« a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances
de nature fiscale qui doivent être restituées à l'État ».
3. Le requérant, rejoint par la partie intervenante, reproche à ces dispositions de sanctionner par une majoration de droits l'opposition à contrôle fiscal alors que les dispositions de l'article 1746 du code général des impôts prévoient également une peine d'amende en cas d'entrave aux fonctions des agents de l'administration fiscale. Il en résulterait une méconnaissance du principe non bis in idem.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa de l'article 1732 du code général des impôts.
5. La société intervenante soutient par ailleurs que l'application automatique de la majoration prévue par ces dispositions méconnaîtrait le principe de proportionnalité des peines.
6. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
7. En premier lieu, il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu'une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
8. En application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsqu'un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Les dispositions contestées prévoient que, dans ce cas, cette évaluation d'office entraîne l'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés et aux créances fiscales devant être restituées à l'État.
9. L'article 1746 du code général des impôts punit d'une amende correctionnelle le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions. Cette infraction est constituée en particulier lorsqu'un contribuable s'oppose à la mise en œuvre d'un contrôle fiscal.
10. Toutefois, la seule circonstance que plusieurs incriminations soient susceptibles de réprimer un même comportement ne peut caractériser une identité de faits au sens des exigences résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 que si ces derniers sont qualifiés de manière identique.
11. Or, l'article 1746 du code général des impôts réprime le comportement de toute personne visant à faire obstacle à l'accomplissement par les agents de l'administration de leurs fonctions, indépendamment de la mise en œuvre d'un contrôle fiscal et du fait que des droits aient ou non été éludés. La majoration prévue par les dispositions contestées ne peut, quant à elle, s'appliquer qu'à un contribuable qui s'est opposé à un contrôle fiscal à la suite duquel l'administration établit qu'il a éludé des droits.
12. Dès lors, ces dispositions ne tendent pas à réprimer de mêmes faits, qualifiés de manière identique. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines doit donc être écarté.
13. En second lieu, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
14. D'une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu réprimer les comportements visant à faire obstacle au contrôle fiscal. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
15. D'autre part, en prévoyant une majoration des droits éludés, le législateur a instauré une sanction dont l'assiette est en lien avec la nature de l'infraction. Le taux de cette majoration n'est pas manifestement disproportionné au regard de la particulière gravité du comportement réprimé.
16. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1732 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 avril 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
M. Alexander V. [Recours contre la condition de renvoi vers l'État membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 février 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 314 du 15 février 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Alexander V. par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-989 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 695-11 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le traité sur l'Union européenne ;
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le requérant par Me Bertrand Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et par Me Frédéric Bélot, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 8 mars 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 9 mars 2022 ;
les secondes observations présentées pour le requérant par Mes Périer et Bélot, enregistrées le 22 mars 2022 ;
les observations présentées pour M. Gilles P., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Mes Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 24 mars 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Bélot pour le requérant et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 5 avril 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article
695-11 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars
2004 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État
membre de l'Union européenne, appelé État membre d'émission, en vue de
l'arrestation et de la remise par un autre État membre, appelé État membre
d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou
pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
« L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions
déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des
autres États membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un
mandat d'arrêt européen ».
2. Le requérant reproche à ces dispositions de ne prévoir aucun recours permettant de contester la légalité de la condition de renvoi à laquelle l'État d'exécution a subordonné la remise de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen à l'État qui a émis ce mandat. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. À cet égard, il soutient que ces dispositions ne découleraient pas nécessairement de la décision-cadre du 13 juin 2002 mentionnée ci-dessus et demande, au besoin, au Conseil constitutionnel de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle.
3. En outre, il fait valoir que ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité devant la loi.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le second alinéa de l'article 695-11 du code de procédure pénale.
5. Selon l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne ». Par ces dispositions particulières, le constituant a entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatives au mandat d'arrêt européen. Par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi de dispositions législatives relatives au mandat d'arrêt européen, de contrôler la conformité à la Constitution de celles de ces dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction alors applicable.
6. La décision-cadre du 13 juin 2002 a institué le mandat d'arrêt européen afin de simplifier et d'accélérer l'arrestation et la remise entre les États de l'Union européenne des personnes recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté. L'article 695-11 du code de procédure pénale reproduit la définition de ce mandat prévue au 1 de l'article 1er de la décision-cadre du 13 juin 2002 et attribue à l'autorité judiciaire, en application de son article 6, la compétence pour mettre en œuvre cette procédure.
7. D'une part, les dispositions contestées de l'article 695-11 du code de procédure pénale ont pour seul objet de prévoir que l'autorité judiciaire est compétente pour adresser aux autorités judiciaires des autres États membres de l'Union européenne un tel mandat ou pour l'exécuter sur leur demande.
8. D'autre part, les conditions dans lesquelles une personne condamnée en France peut être remise à un autre État membre de l'Union européenne pour effectuer sa peine, le cas échéant en application de la condition de renvoi à laquelle cet État a subordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen, sont définies à l'article 728-15 du code de procédure pénale, dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi.
9. Dès lors, l'absence alléguée de recours contre l'application de cette condition de renvoi ne pourrait résulter, en tout état de cause, que de ce dernier article et non des dispositions contestées.
10. Par conséquent, ces dispositions découlant nécessairement de la décision-cadre du 13 juin 2002, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le second alinéa de l'article 695-11 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 avril 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Fédération nationale des collectivités de compostage et autres [Restrictions apportées au développement des installations de tri mécano-biologiques des déchets]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 février 2022 par le Conseil d'État (décision nos 456190, 456272 et 456432 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association Fédération nationale des collectivités de compostage et autres par Me Blaise Eglie-Richters, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-990 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du seizième alinéa du paragraphe I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de l'environnement ;
l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour les associations requérantes par Me Eglie-Richters, enregistrées le 9 mars 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées par l'association France nature environnement, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour les associations requérantes par Me Eglie-Richters, enregistrées le 24 mars 2022 ;
les secondes observations en intervention présentées par l'association France nature environnement, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Eglie-Richters, pour les associations requérantes, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 5 avril 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du seizième alinéa du paragraphe I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 29 juillet 2020 mentionnée ci-dessus.
2. Le seizième
alinéa du paragraphe I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans
cette rédaction, prévoit :
« Le service public de gestion des déchets décline localement les objectifs
visés au 4 ° et au 4 ° bis du présent I pour réduire les quantités d'ordures
ménagères résiduelles après valorisation. L'autorisation de nouvelles
installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités
d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au
respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des
biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes
publiques. À compter du 1er janvier 2027, il est interdit d'utiliser
la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la
fabrication de compost. Les collectivités territoriales progressent vers la
généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour
objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en
2020 et vingt-cinq millions en 2025 ».
3. Les associations requérantes soutiennent tout d'abord que, en conditionnant désormais le développement des installations de tri mécano-biologique au respect d'une obligation, au demeurant imprécise, de généralisation du tri à la source des biodéchets et en interdisant de subventionner ces installations, ces dispositions seraient de nature à entraver les choix opérés par les collectivités territoriales au titre de la compétence que la loi leur reconnaît en matière de gestion des déchets. Il en résulterait une méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales.
4. Pour les mêmes motifs, les dispositions renvoyées méconnaîtraient également le droit de propriété des collectivités territoriales ainsi que la sécurité juridique découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et seraient entachées d'inintelligibilité et d'incompétence négative.
5. Les associations requérantes dénoncent ensuite une différence de traitement injustifiée entre les collectivités territoriales qui ont mis en place une installation de tri mécano-biologique et celles qui n'ont pas fait un tel choix, dès lors que seules les premières seraient tenues de généraliser le tri à la source des biodéchets.
6. Elles estiment enfin que, en faisant obstacle au développement de la filière de traitement mécano-biologique des déchets, alors que celle-ci contribuerait à la valorisation des déchets ménagers, ces dispositions seraient contraires aux exigences découlant de l'article 2 de la Charte de l'environnement.
7. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième et troisième phrases du seizième alinéa du paragraphe I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
8. L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ».
9. Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée.
10. L'article L. 541-1 du code de l'environnement est relatif à la politique nationale de prévention et de gestion des déchets. Le seizième alinéa de son paragraphe I prévoit que le service public de gestion des déchets décline localement les objectifs de réduction des quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation.
11. Les dispositions contestées de cet alinéa conditionnent l'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologique, de l'augmentation des capacités d'installations existantes ou de leur modification notable à la généralisation du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale. Elles interdisent également aux personnes publiques d'apporter une aide à ces installations.
12. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, pour mettre en œuvre les objectifs de réduction et de valorisation des déchets ménagers, privilégier le tri à la source des biodéchets plutôt que leur prise en charge par des installations de traitement mécano-biologique dont il a estimé que les performances en termes de valorisation étaient insuffisantes. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé.
13. En second lieu, d'une part, les dispositions contestées se bornent à soumettre la création d'installations de tri mécano-biologique ou l'extension des capacités d'installations existantes au respect de la condition, qui n'est pas imprécise, de généralisation du tri à la source des biodéchets. Elles n'interdisent pas aux collectivités territoriales de recourir à de telles installations et ne font pas davantage obstacle à la poursuite de l'exploitation des installations existantes.
14. D'autre part, par l'interdiction des aides publiques, les dispositions contestées visent uniquement à empêcher les personnes publiques de contribuer au développement des capacités de tri mécano-biologique par la création de nouvelles installations ou l'accroissement des capacités des installations existantes.
15. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de libre administration des collectivités territoriales.
16. Par ailleurs, ces dispositions n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les collectivités territoriales. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
17. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et qui ne méconnaissent ni les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ni le droit de propriété, ni l'article 2 de la Charte de l'environnement non plus qu'aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les deuxième et troisième phrases du seizième alinéa du paragraphe I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 avril 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
M. Lotfi H. [Réquisition de données informatiques dans le cadre d'une enquête de flagrance]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 mars 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 387 du 8 mars 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Lotfi H. par Me Raphaël Chiche, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-993 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le requérant par Me Bertrand Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Chiche, enregistrées le 30 mars 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour M. Ibrahim K. par Mes Périer et Chiche, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Chiche, pour le requérant et la partie intervenante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 10 mai 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article
60-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 23
mars 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le
contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut, par tout moyen,
requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public
ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des
informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système
informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces
informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes
fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif
légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions
concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des
informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
« À l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de
s'abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et s'il y a
lieu selon les normes exigées est puni d'une amende de 3 750 euros.
« À peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par
une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse ».
2. L'article
60-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, prévoit :
« Sur demande de l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce
dernier, de l'agent de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou
informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à
l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du 3 ° du II de l'article 8 et au
2 ° de l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les
informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles
protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes
informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.
« L'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent
de police judiciaire intervenant sur réquisition du procureur de la République
préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention,
peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux
mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures
propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du
contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services
fournis par les opérateurs.
« Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les
informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs
délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni
d'une amende de 3 750 euros.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au
premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de
traitement des informations requises ».
3. Le requérant, rejoint par la partie intervenante, reproche à ces dispositions de permettre au procureur de la République ou à l'officier de police judiciaire, dans le cadre d'une enquête de flagrance, de requérir la communication de données de connexion sans le contrôle préalable d'une juridiction indépendante. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « , y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1 du code de procédure pénale et sur les mots « contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent » figurant au premier alinéa de l'article 60-2 du même code.
5. Aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée.
6. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il lui incombe d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée.
7. L'article 60-1 du code de procédure pénale permet au procureur de la République, à un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, à un agent de police judiciaire, dans le cadre d'une enquête de flagrance, de requérir par tout moyen des informations intéressant l'enquête détenues par toute personne publique ou privée, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.
8. L'article 60-2 du même code prévoit notamment que l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir d'un organisme public ou de certaines personnes morales de droit privé, par voie télématique ou informatique, la mise à disposition d'informations utiles à la manifestation de la vérité non protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans un système informatique ou un traitement de données nominatives.
9. En permettant de requérir des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, les dispositions contestées de ces articles autorisent le procureur de la République ainsi que les officiers et agents de police judiciaire à se faire communiquer des données de connexion ou à y avoir accès.
10. Les données de connexion comportent notamment les données relatives à l'identification des personnes, à leur localisation et à leurs contacts téléphoniques et numériques ainsi qu'aux services de communication au public en ligne qu'elles consultent. Compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, les données de connexion fournissent sur les personnes en cause ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée.
11. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions.
12. En deuxième lieu, d'une part, ces dispositions ne permettent les réquisitions de données que dans le cadre d'une enquête de police portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement. D'autre part, la durée de cette enquête est limitée à huit jours. Elle ne peut être prolongée, pour une nouvelle durée maximale de huit jours, sur décision du procureur de la République, que si l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans et si les investigations ne peuvent être différées.
13. En dernier lieu, ces réquisitions ne peuvent intervenir qu'à l'initiative du procureur de la République, d'un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, d'un agent de police judiciaire. Ces officiers et agents étant placés sous la direction du procureur de la République, les réquisitions sont mises en œuvre sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire auquel il revient, en application de l'article 39-3 du code de procédure pénale, de contrôler la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits.
14. Dès lors, les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée.
15. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « , y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et les mots « contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent » figurant au premier alinéa de l'article 60-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mai 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et François SÉNERS.
M. Mohammed D. [Délivrance d'un permis de communiquer aux seuls avocats nominativement désignés par la personne mise en examen]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 mars 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 389 du 8 mars 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Mohammed D. par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-994 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 115 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 (chambre criminelle, n° 21-85.670) ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le requérant par Me Bertrand Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Raphaël Chiche, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 30 mars 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour l'association des avocats pénalistes par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de France par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour M. Kamel M. par Mes Périer, Chiche et Thomas Bidnic, avocat au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;
les secondes observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 14 avril 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Chiche, pour le requérant, Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le Conseil national des barreaux, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le syndicat des avocats de France, Me Karine Bourdié, avocate au barreau de Paris, pour l'association des avocats pénalistes, Me Bidnic, pour M. Kamel M., et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 10 mai 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 115 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 mentionnée ci-dessus.
2. L'article
115 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge
d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs
avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées
les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront
adressées à l'avocat premier choisi.
« Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou
lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une
audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent
doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La
déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que
la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le
greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction
compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en
application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée
et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne
détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et
par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat
prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également
résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La
déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat
désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du
courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la
déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze
jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective ».
3. Le requérant, rejoint par les parties intervenantes, reproche à ces dispositions de permettre au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés de l'avocat de la personne mise en examen et détenue lorsqu'elle ne les a pas nominativement désignés. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense. En outre, en laissant au juge d'instruction toute latitude pour délivrer ou non un tel permis de communiquer, les dispositions renvoyées seraient contraires au principe d'égalité devant la justice. Enfin, le requérant, rejoint par certaines parties intervenantes, soutient que ces dispositions méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « le nom de l'avocat choisi par elles » figurant au premier alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale.
5. L'une des parties intervenantes fait par ailleurs valoir que, faute pour le législateur d'avoir prévu l'obligation pour le juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux associés et collaborateurs de l'avocat désigné, les dispositions contestées seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant les exigences constitutionnelles précitées.
6. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.
7. L'article 115 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une information judiciaire, les parties portent à la connaissance du juge d'instruction le nom du ou des avocats qu'elles ont choisis pour assurer leur défense.
8. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dispositions contestées permettent au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer à un avocat qui n'a pas été nominativement désigné selon ces modalités par la personne détenue mise en examen.
9. En premier lieu, ces dispositions tendent à garantir la liberté de la personne mise en examen de choisir son avocat.
10. En second lieu, d'une part, la personne mise en examen peut à tout moment de l'information désigner un ou plusieurs avocats, appartenant le cas échéant à un même cabinet, qu'ils soient salariés, collaborateurs ou associés. Ce choix peut être effectué au cours d'un interrogatoire ou par déclaration au greffier du juge d'instruction, mais également, lorsque la personne mise en examen est détenue, résulter d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou d'un courrier de désignation remis au greffier par son conseil et annexé à la déclaration faite par ce dernier.
11. D'autre part, chacun des avocats ainsi désignés peut solliciter la délivrance d'un permis de communiquer que le juge d'instruction est tenu de lui délivrer.
12. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
13. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « le nom de l'avocat choisi par elles » figurant au premier alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mai 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et François SÉNERS.
Commune de Nice [Abandon de terrains à une commune]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 mars 2022 par le Conseil d'État (décision n° 454827 du même jour) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la commune de Nice par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-995 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1401 du code général des impôts.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code général des impôts ;
la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le syndicat de copropriétaires de la résidence Agora, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Henri-Charles Lambert, avocat au barreau de Nice, enregistrées le 5 avril 2022 ;
les observations présentées pour la commune requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 6 avril 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 7 avril 2022 ;
les secondes observations présentées pour la commune requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 21 avril 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la commune requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 17 mai 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 1401 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mai 2013 mentionnée ci-dessus.
2. L'article
1401 du code général des impôts, dans cette rédaction, prévoit : « Les
contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres
vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés
ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces
propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées.
« La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la
mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial.
« Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis
antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé.
« Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune.
« Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et
vagues qui n'ont aucun propriétaire particulier ainsi qu'aux terrains connus
sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne sont point
partagés.
« La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des
habitants d'une commune est acquittée par la section de commune ».
3. La commune requérante considère que ces dispositions, en permettant au propriétaire d'un terrain de l'abandonner à la commune sur le territoire de laquelle il se situe dans le but de s'affranchir de la taxe foncière et de se décharger de son entretien, sans que celle-ci ne puisse s'y opposer, porteraient atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, au droit de propriété de la commune ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics. Au soutien de ces griefs, elle fait valoir que ces dispositions ne poursuivraient aucun motif d'intérêt général et qu'elles ne définiraient pas de manière suffisamment précise les conséquences pouvant résulter de ce transfert de propriété pour la commune.
4. La commune requérante reproche également à ces dispositions d'accorder un avantage fiscal aux seuls propriétaires de terrains improductifs, sans en faire bénéficier d'autres propriétaires, en particulier ceux d'immeubles menaçant ruine ou en état de péril. Elles seraient ainsi contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les quatre premiers alinéas de l'article 1401 du code général des impôts.
6. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En l'absence de privation de propriété au sens de l'article 17, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
7. Les dispositions contestées permettent au propriétaire de certains terrains de s'affranchir de la taxe foncière en renonçant, par une déclaration écrite, à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. Cet abandon n'est pas subordonné à l'acceptation par la commune.
8. En imposant ainsi à la commune de devenir propriétaire de ces terrains, ces dispositions portent atteinte au droit de propriété.
9. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que des terrains improductifs et délaissés par leur propriétaire puissent, en entrant dans le patrimoine de la commune, trouver un usage conforme à l'intérêt de la collectivité. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
10. En second lieu, ces dispositions ne s'appliquent, sous le contrôle du juge, qu'aux terres vaines et vagues, aux landes et bruyères ou aux terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux. En outre, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, parmi ces terrains, seuls ceux qui ne comportent aucun aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation, peuvent faire l'objet d'un transfert de propriété à la commune. Les autorités communales sont tenues de s'opposer à l'abandon de terrains qui n'entreraient pas dans le champ ainsi défini.
11. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit donc être écarté.
12. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni les principes d'égalité devant loi et devant les charges publiques, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les quatre premiers alinéas de l'article 1401 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, Michel PINAULT et François SÉNERS.
M. Jonas A. et autre [Requête en nullité du mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction français contre une personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 avril 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts nos 476 et 477 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour M. Jonas A. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et pour M. Noah W. par la SELARL Le Prado - Gilbert, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2022-996 QPC et 2022-997 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 173 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2000 (chambre criminelle, n° 00-85.221) ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour M. Jonas A. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 20 avril 2022 ;
les observations présentées pour M. Noah W. par la SELARL Le Prado - Gilbert, enregistrées le même jour ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour M. Jonas A. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 5 mai 2022 ;
les secondes observations présentées pour M. Noah W. par la SELARL Le Prado - Gilbert, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Raphaël Dokhan, avocat au barreau de Paris, et Me Élodie Le Prado, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Noah W., Me Ronald Maman, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Jonas A., et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 24 mai 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 173 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus.
3. L'article
173 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure
est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins
d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir
informé les parties.
« Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il
requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa
transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins
d'annulation à cette chambre et en informe les parties.
« Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise,
elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse
copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président
de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire
l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est
constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son
avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la
juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en
examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une
déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration
est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la
signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait
mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en
original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de
l'instruction.
« Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes
de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et
notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de
contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX
du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
« Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de
l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours,
constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou
quatrième alinéas du présent article, de l'article 173-1, du premier alinéa de
l'article 174 ou du IV de l'article 175 ; il peut également constater
l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate
l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction
ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ;
dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il
est dit aux articles 194 et suivants ».
4. Les requérants reprochent à ces dispositions de ne pas imposer à la chambre de l'instruction de statuer à bref délai lorsqu'elle est saisie d'une requête en nullité formée contre le mandat d'arrêt pour l'exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l'étranger. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté individuelle, des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif. Ils dénoncent également la différence de traitement injustifiée résultant de ces dispositions entre la personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger et celle placée en détention provisoire en France dont le recours doit être examiné à bref délai par la chambre de l'instruction.
5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants » figurant à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale.
6. Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
7. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.
8. L'article 173 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie d'une requête en nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté.
9. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, sur le fondement de ces dispositions, une personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction peut saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de ce mandat.
10. En application du deuxième alinéa de l'article 194 du même code, auquel renvoient les dispositions contestées, la chambre de l'instruction dispose de manière générale d'un délai de deux mois, dont la méconnaissance n'est assortie d'aucune sanction, pour statuer sur une requête en nullité.
11. Or, en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence.
12. Dès lors, dans le cas où elle est saisie d'une requête en nullité d'un mandat d'arrêt pour l'exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l'étranger, il incombe à la chambre de l'instruction de statuer dans les plus brefs délais.
13. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences constitutionnelles précitées.
14. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense, ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée au paragraphe 12, être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 12, les mots « dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants » figurant à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 juin 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires [Interdiction de la publicité en faveur des centres de santé]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 avril 2022 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 431 du 13 avril 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association pour le développement de l'accès aux soins dentaires par la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-998 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de la santé publique ;
l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé, ratifiée par l'article 77 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 avril 2022 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour l'association requérante par Me Daphné Bès de Berc, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 12 mai 2022 ;
les secondes observations présentées pour le syndicat des chirurgiens-dentistes de France et le syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis, parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Bès de Berc, pour l'association requérante, Me Bertrand Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le syndicat des chirurgiens-dentistes de France et le syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis, Me Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 24 mai 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le second
alinéa de l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction
issue de l'ordonnance du 12 janvier 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Toute forme de publicité en faveur des centres de santé est interdite ».
2. L'association requérante soutient que ces dispositions, en interdisant toute forme de publicité en faveur des seuls centres de santé, institueraient une différence de traitement injustifiée entre ceux-ci et les professionnels de santé. Elle fait valoir, en outre, que le caractère général et absolu de cette interdiction porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
3. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
4. Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, qui ont pour mission de dispenser des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquent à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins. Selon le premier alinéa de l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, les centres de santé informent le public sur leur localisation, sur les activités et actions de santé publique ou sociales qu'ils mettent en œuvre, sur les modalités et les conditions d'accès aux soins, ainsi que sur le statut de leur gestionnaire.
5. Les dispositions contestées interdisent, en revanche, toute forme de publicité en faveur de ces centres. Il en résulte une différence de traitement avec les professionnels de santé qui ne sont pas soumis à une telle interdiction.
6. Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale relevant de la compétence des professionnels qui y exercent. Ils pratiquent le mécanisme du tiers payant et ne facturent pas de dépassements d'honoraires.
7. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que ces centres, qui peuvent être créés et gérés notamment par des organismes à but lucratif, ne mettent en avant ces conditions de prise en charge pour développer une pratique intensive de soins contraire à leur mission et de nature à porter atteinte à la qualité des soins dispensés. Il a ainsi poursuivi un motif d'intérêt général.
8. Dans la mesure où l'interdiction de la publicité en faveur des centres de santé contribue à prévenir une telle pratique, la différence de traitement critiquée par l'association requérante est en rapport avec l'objet de la loi.
9. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.
10. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté d'entreprendre, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le second alinéa de l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 juin 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Société Lorraine services [Amende fiscale contre les tiers déclarants II]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 avril 2022 par le Conseil d'État (décision n° 458429 du 25 avril 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Lorraine services par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1001 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1 du paragraphe I de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
Au vu des textes suivants :
Au vu des pièces suivantes :
Après avoir entendu Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la société requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 14 juin 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le 1 du
paragraphe I de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction
résultant de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le
fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de
l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en
cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des
trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit
spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de
l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ».
2. La société requérante soutient que, si ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 20 juillet 2012 mentionnée ci-dessus, il résulterait des décisions du 22 juillet 2016, du 16 mars 2017, du 27 octobre 2017 et du 26 mai 2021 mentionnées ci-dessus un changement des circonstances justifiant leur réexamen. En effet, selon elle, dans ces décisions, le Conseil constitutionnel aurait modifié sa jurisprudence relative au principe de proportionnalité des peines en matière de sanctions fiscales dont le montant procède de l'application d'un taux à une assiette.
3. Sur le fond, la société requérante reproche à ces dispositions de méconnaître le principe de proportionnalité des peines dès lors qu'elles répriment le seul fait pour une personne d'avoir manqué à son obligation de déclarer certaines sommes versées à des contribuables d'une amende dont le montant, non plafonné, est fixé à 50 % des sommes non déclarées, quand bien même un tel manquement ne serait pas intentionnel et les sommes versées n'auraient pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. Selon elle, ces dispositions méconnaîtraient également les principes d'égalité devant la loi et devant la justice dans la mesure où elles permettraient à l'administration de choisir discrétionnairement les déclarants auxquels elle peut demander de réparer leur omission.
4. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.
5. Dans sa décision du 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné le 1 du paragraphe I de l'article 1736 du code général des impôts, dans la rédaction contestée par la société requérante. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de sa décision.
6. Pour écarter le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que ces dispositions visent à permettre à l'administration fiscale de procéder aux recoupements nécessaires au contrôle du respect, par les bénéficiaires de versements, de leurs obligations fiscales. Il a également considéré que le législateur avait proportionné la sanction en fonction de la gravité des manquements réprimés et que le taux retenu n'était pas manifestement disproportionné.
7. Il ne résulte pas des décisions rendues postérieurement par le Conseil constitutionnel une modification de la portée du principe de proportionnalité des peines lorsqu'il s'applique à une sanction fiscale dont le montant procède de l'application d'un taux à une assiette.
8. Dès lors, en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 1 du paragraphe I de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 juin 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Société cabinet Lysandre [Saisie spéciale de sommes d'argent sur un compte bancaire]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 mai 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 706 du 11 mai 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Cabinet Lysandre par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1002 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-154 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour la société requérante par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, enregistrées le 27 mai 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour l'association des avocats pénalistes par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour l'ordre des avocats de Paris par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de France par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour l'ordre des avocats au barreau de Paris par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 8 juin 2022 ;
les secondes observations présentées pour la société requérante par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, enregistrées le 13 juin 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Olivier Matuchansky, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la société requérante et M. Atique J., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le Conseil national des barreaux et l'ordre des avocats de Paris, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le syndicat des avocats de France, Me Sabrina Goldman, avocate au barreau de Paris, pour l'association des avocats pénalistes, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 28 juin 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 706-154 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013 mentionnée ci-dessus.
2. L'article
706-154 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 706-153, l'officier de police
judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République
ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie
d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement
habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la
détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se
prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie
dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.
« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère
public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits
sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par
déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la
notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut
prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la
procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants,
le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la
chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à
disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert
auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts,
elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce
compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant
indiqué dans la décision de saisie ».
3. La société requérante, rejointe par les parties intervenantes, soutient que, lorsque la saisie porte sur des sommes versées sur le compte bancaire d'un avocat, ces dispositions contraindraient ce dernier, pour contester cette saisie, à divulguer des informations protégées par le secret professionnel, relatives notamment à ses prestations et à ses clients. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale.
5. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.
6. Selon le premier alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal, l'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire. Cette mesure à caractère conservatoire est maintenue ou levée dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou du juge d'instruction.
7. Les dispositions contestées du deuxième alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale prévoient que l'ordonnance relative à cette saisie peut être déférée à la chambre de l'instruction notamment par le titulaire du compte et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce compte.
8. En premier lieu, ces dispositions ont pour seul objet de prévoir un recours contre la saisie d'une somme d'argent dont l'exécution n'implique en elle-même ni recherche de preuves, ni investigations, ni divulgation d'informations se rapportant à cette somme.
9. En deuxième lieu, cette saisie est justifiée par l'existence d'indices laissant présumer la commission de l'infraction sur la base de laquelle elle est ordonnée et s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites sur un compte bancaire au moment de sa réalisation et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. Sa contestation n'implique pas de justifier de l'origine de la somme qui en fait l'objet. Par conséquent, dans le cas où la saisie porte sur les sommes versées sur le compte professionnel d'un avocat, ce dernier peut la contester sans être tenu de révéler des informations portant sur ses clients ou les prestations à l'origine des sommes saisies.
10. En dernier lieu, à supposer même que l'avocat soit amené, pour exercer ses droits de la défense, à révéler des informations couvertes par le secret professionnel pour contester la saisie d'une somme versée sur son compte, il peut le faire sous la condition que ces révélations lui soient imposées par les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction.
11. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense.
12. Ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le droit au respect de la vie privée ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juillet 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Association Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles [Accès à l'assistance médicale à la procréation]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 mai 2022 par le Conseil d'État (décision n° 459000 du 12 mai 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par l'association Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1003 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par l'association requérante, enregistrées le 25 mai 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 27 mai 2022 ;
les secondes observations présentées par l'association requérante, enregistrées le 8 juin 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Magaly Lhotel, avocate au barreau de Paris, pour l'association requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 28 juin 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article
L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du
2 août 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet
parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute
femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les
entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale
clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à
l'article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment
au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir
préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert
des embryons :
« 1 ° Le décès d'un des membres du couple ;
« 2 ° L'introduction d'une demande en divorce ;
« 3 ° L'introduction d'une demande en séparation de corps ;
« 4 ° La signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par
consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code
civil ;
« 5 ° La cessation de la communauté de vie ;
« 6 ° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du
présent article par l'un ou l'autre des membres du couple auprès du médecin
chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.
« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse,
qui y consent par écrit.
« Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la
procréation sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de
l'Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la
procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître.
« Lorsqu'un recueil d'ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d'une procédure
d'assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le
même temps une autoconservation ovocytaire ».
2. L'association requérante reproche à ces dispositions de priver de l'accès à l'assistance médicale à la procréation les hommes seuls ou en couple avec un homme, alors même que ceux d'entre eux qui, nés femmes à l'état civil, ont changé la mention de leur sexe, peuvent être en capacité de mener une grossesse. Ce faisant, elles institueraient une différence de traitement injustifiée entre les personnes disposant de capacités gestationnelles selon la mention de leur sexe à l'état civil. Elles seraient ainsi contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité entre les hommes et les femmes. Pour les mêmes motifs, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant les principes précités.
3. Selon l'association requérante, les dispositions renvoyées porteraient en outre atteinte à la liberté personnelle et au droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu'elles contraindraient les hommes transgenres à renoncer à modifier la mention de leur sexe à l'état civil pour conserver la possibilité d'accéder à l'assistance médicale à la procréation.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation » figurant à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
5. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit.
6. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
7. Les dispositions contestées ouvrent l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples formés d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ainsi qu'aux femmes non mariées. Elles privent ainsi de cet accès les hommes seuls ou en couple avec un homme. Il s'ensuit que les personnes, nées femmes à l'état civil, qui ont obtenu la modification de la mention relative à leur sexe tout en conservant leurs capacités gestationnelles, en sont exclues.
8. Il ressort des travaux préparatoires que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'égal accès des femmes à l'assistance médicale à la procréation, sans distinction liée à leur statut matrimonial ou à leur orientation sexuelle. Ce faisant, il a estimé, dans l'exercice de sa compétence, que la différence de situation entre les hommes et les femmes, au regard des règles de l'état civil, pouvait justifier une différence de traitement, en rapport avec l'objet de la loi, quant aux conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, d'une telle différence de situation.
9. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.
10. Les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le droit de mener une vie familiale normale, la liberté personnelle, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation » figurant à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juillet 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant des activités cultuelles]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 mai 2022 par le Conseil d'État (décision nos 461800 et 461803 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'union des associations diocésaines de France et autres par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1004 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 19-1 et 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ainsi que des articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, dans leur rédaction résultant de la même loi du 24 août 2021.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ;
la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;
la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour les requérants par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, enregistrées le 1er juin 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour les requérants par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, enregistrées le 16 juin 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Guillaume Valdelièvre, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les requérants, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 5 juillet 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article
19-1 de la loi du 9 décembre 1905 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction issue
de la loi du 24 août 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations
cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute
association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi
doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l'État dans le
département, sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
« Le représentant de l'État dans le département peut, dans les deux mois suivant
la déclaration, s'opposer à ce que l'association bénéficie des avantages
mentionnés au premier alinéa du présent article s'il constate que l'association
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19
de la présente loi ou pour un motif d'ordre public. Lorsqu'il envisage de faire
usage de son droit d'opposition, il en informe l'association et l'invite à
présenter ses observations dans un délai d'un mois.
« En l'absence d'opposition, l'association qui a déclaré sa qualité cultuelle
bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles
pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant
de l'État dans le département dans les conditions mentionnées aux deux premiers
alinéas du présent article.
« Le représentant de l'État dans le département peut, pour les mêmes motifs que
ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à
la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d'une procédure
contradictoire.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les documents
permettant à l'association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions
dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles
s'exerce le droit d'opposition de l'administration, sont précisées par décret en
Conseil d'État ».
2. L'article
19-2 de la loi du 9 décembre 1905, dans la même rédaction, prévoit :
« I. - Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les
conditions prévues au présent article et à l'article 19-3.
« II. - Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à
l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte.
Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services
religieux, même par fondation, pour la location des bancs et sièges et pour la
fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles
dans les édifices religieux ainsi qu'à la décoration de ces édifices.
« Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l'article 910 et
à l'article 910-1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament
destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou
cultuelles.
« Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit,
sans préjudice des 2 ° et 3 ° de l'article 6 de la loi du 1er juillet
1901 précitée.
« Les ressources annuelles qu'elles tirent des immeubles qu'elles possèdent et
qui ne sont ni strictement nécessaires à l'accomplissement de leur objet, ni
grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l'exclusion des ressources provenant
de l'aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à
50 % de leurs ressources annuelles totales.
« Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de
leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
« III. - Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des
subventions de l'État ni des collectivités territoriales ou de leurs
groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour
réparations ainsi que pour travaux d'accessibilité aux édifices affectés au
culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ».
3. L'article 4
de la loi du 2 janvier 1907 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de
la loi du 24 août 2021, prévoit :
« Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, l'exercice public d'un
culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles
en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le
respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905
précitée.
« L'exercice public d'un culte peut également être assuré au moyen
d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association.
« Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi qu'au
troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36,
36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée ».
4. L'article
4-1 de la loi du 2 janvier 1907, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août
2021, prévoit :
« Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente
loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux
deuxième à cinquième alinéas de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Églises et de l'État. Elles établissent leurs
comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l'exercice public
d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont
tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article
L. 521-1 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des
transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte.
« Lorsqu'elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la
générosité destiné à soutenir l'exercice du culte, elles sont soumises à
l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de
représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des
comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des
conditions définies par un décret en Conseil d'État, qui fixe notamment le seuil
à compter duquel le même article 4 s'applique.
« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de
l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l'article 19-3 de la loi
du 9 décembre 1905 précitée :
« 1 ° Lorsqu'elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états,
factures ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une réduction
d'impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
« 2 ° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse
un seuil défini par décret en Conseil d'État ;
« 3 ° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil
d'État.
« Les deux derniers alinéas de l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905
précitée sont applicables en cas de non-respect du présent article ».
5. L'article
4-2 de la loi du 2 janvier 1907, dans la même rédaction, prévoit :
« Le représentant de l'État dans le département, lorsqu'il constate qu'une
association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 ne prévoit pas dans son
objet l'accomplissement d'activités en relation avec l'exercice public d'un
culte, met en demeure l'association, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut
être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l'État
dans le département peut, si l'association n'a pas satisfait à la mise en
demeure, prononcer une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de
retard.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article ».
6. Les requérants soutiennent d'abord que, en obligeant les associations à déclarer leur caractère cultuel pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 instituerait un régime d'autorisation préalable conduisant l'État à reconnaître certains cultes. Ils font également valoir que, les obligations imposées à ces associations ayant été alourdies, ces dispositions permettraient au représentant de l'État de refuser ou de retirer cette qualité cultuelle dans de nombreux cas. Il en résulterait une méconnaissance du principe de laïcité, de la liberté d'association et de la liberté de religion et de culte. Ils estiment par ailleurs que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne définissant pas suffisamment les « avantages propres » auxquels la reconnaissance du caractère cultuel de l'association ouvre ainsi droit.
7. Les requérants critiquent ensuite le plafonnement du montant des ressources annuelles que les associations cultuelles peuvent tirer de leurs immeubles, prévu par l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905, au motif que d'autres associations n'y seraient pas soumises. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, ainsi que des libertés d'association, de religion et de culte.
8. Les requérants dénoncent enfin le caractère excessif des contraintes imposées par les articles 4 et 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 aux associations assurant l'exercice public d'un culte, en méconnaissance de la liberté d'association, de la liberté de religion et de culte, ainsi que de la liberté de réunion. Par ailleurs, faute pour le législateur d'avoir défini à l'article 4-2 de la même loi les « activités en lien avec l'exercice d'un culte » prises en compte par l'administration lorsqu'elle met en demeure une association de mettre ses statuts en conformité avec ses activités, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à affecter ces exigences constitutionnelles.
9. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 19-1 et sur le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905, sur les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée » figurant au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 et sur les articles 4-1 et 4-2 de la même loi.
- Sur l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il en résulte notamment que la République ne reconnaît aucun culte et qu'elle garantit le libre exercice des cultes.
11. Les associations qui ont la qualité d'association cultuelle bénéficient d'avantages dans les conditions définies par la loi et le règlement. Les dispositions contestées de l'article 19-1 prévoient que, pour bénéficier de ces avantages, ces associations doivent déclarer leur qualité cultuelle au représentant de l'État dans le département. Elles bénéficient de ces avantages pendant une durée de cinq années renouvelable dans les mêmes conditions. Le représentant de l'État dans le département peut toutefois, sous certaines conditions, s'opposer à ce qu'elles bénéficient de ces avantages ou leur retirer ce bénéfice.
12. D'une part, les dispositions contestées ont pour seul objet d'instituer une obligation déclarative en vue de permettre au représentant de l'État de s'assurer que les associations sont éligibles aux avantages propres aux associations cultuelles. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'emporter la reconnaissance d'un culte par la République ou de faire obstacle au libre exercice du culte, dans le cadre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles.
13. D'autre part, le représentant de l'État ne peut s'opposer à ce qu'une association bénéficie des avantages propres aux associations cultuelles ou procéder au retrait de ces avantages qu'après une procédure contradictoire et uniquement pour un motif d'ordre public ou dans le cas où il constate que l'association n'a pas pour objet exclusif l'exercice d'un culte ou que sa constitution, sa composition et son organisation ne remplissent pas les conditions limitativement énumérées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905.
14. Dès lors, les dispositions contestées, qui ne privent pas de garanties légales le libre exercice des cultes, ne méconnaissent pas le principe de laïcité. Le grief tiré de la méconnaissance de ce principe doit donc être écarté.
15. En second lieu, le principe de la liberté d'association figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution. Les atteintes portées à cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
16. La déclaration imposée aux associations par les dispositions contestées pour bénéficier de certains avantages n'a pas pour objet d'encadrer les conditions dans lesquelles elles se constituent et exercent leur activité.
17. En revanche, le retrait par le représentant de l'État du bénéfice de ces avantages est susceptible d'affecter les conditions dans lesquelles une association exerce son activité. Dès lors, ce retrait ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'association, conduire à la restitution d'avantages dont l'association a bénéficié avant la perte de sa qualité cultuelle.
18. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve figurant au paragraphe précédent, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'association doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905, qui n'est pas non plus entaché d'incompétence négative et ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit doit, sous la même réserve, être déclaré conforme à la Constitution.
- Sur le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 :
20. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
21. Les dispositions contestées du quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 limitent à 50 % des ressources annuelles totales des associations cultuelles la part des ressources annuelles qu'elles peuvent tirer des immeubles de rapport dont elles sont propriétaires. Ce faisant, elles établissent une différence de traitement entre ces associations et celles exerçant des activités d'intérêt général ou reconnues d'utilité publique qui peuvent tirer des revenus de certains de leurs immeubles sans être soumises à un tel plafonnement.
22. Les associations constituées sur le fondement de la loi du 9 décembre 1905 sont, eu égard à leur objet exclusif qui est d'assurer l'exercice du culte, dans une situation différente des associations qui poursuivent un but d'intérêt général ou sont reconnues d'utilité publique.
23. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi, qui est de permettre aux associations cultuelles de retirer des ressources de leur patrimoine immobilier tout en s'assurant que leur financement demeure en rapport avec les ressources recueillies auprès de leurs fidèles.
24. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
25. Par conséquent, le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905, qui ne méconnaît pas non plus la liberté d'association, le principe de laïcité, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
- Sur les dispositions contestées des articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 :
26. L'exercice public d'un culte peut être assuré au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
27. Dans ce cas, les dispositions contestées des articles 4 et 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 imposent à ces associations diverses obligations administratives et financières. Les dispositions contestées de son article 4-2 permettent par ailleurs au représentant de l'État de mettre en demeure une association ayant des activités en relation avec l'exercice public d'un culte, sans que son objet ne le prévoie, de rendre ce dernier conforme à ces activités.
28. Ces dispositions sont ainsi de nature à porter atteinte à la liberté d'association et au libre exercice des cultes.
29. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la transparence de l'activité et du financement des associations assurant l'exercice public d'un culte. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
30. En deuxième lieu, en application des dispositions contestées des articles 4 et 4-1 de la loi du 2 janvier 1907, les associations sont soumises à des obligations consistant, en particulier, à établir une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement le culte, à présenter les documents comptables et le budget prévisionnel de l'exercice en cours sur demande du représentant de l'État, à établir une comptabilité faisant apparaître séparément les opérations relatives à leurs activités cultuelles, et à certifier leurs comptes lorsqu'elles ont bénéficié de financements étrangers pour des montants dépassant un seuil fixé par décret, qu'elles ont émis des reçus fiscaux, qu'elles ont perçu un montant minimal de subventions publiques ou que leur budget annuel dépasse un seuil minimal également fixé par le pouvoir réglementaire.
31. Si de telles obligations sont nécessaires et adaptées à l'objectif poursuivi par le législateur, il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire de veiller, en fixant les modalités spécifiques de mise en œuvre de ces obligations, à respecter les principes constitutionnels de la liberté d'association et du libre exercice des cultes.
32. En dernier lieu, en prévoyant à l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 que le représentant de l'État peut mettre en demeure une association de rendre son objet social conforme à ses activités lorsqu'elle exerce des « activités en lien avec l'exercice d'un culte », le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant les exigences constitutionnelles précitées. Au demeurant, il résulte en particulier d'une jurisprudence constante du Conseil d'État que ces activités sont celles notamment relatives à l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi qu'à l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte.
33. Dès lors, le législateur n'a pas porté à la liberté d'association et au libre exercice des cultes une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée.
34. Sous la réserve énoncée au paragraphe 31, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'association et du libre exercice des cultes doit donc être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit d'expression collective des idées et des opinions, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la même réserve, être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
Article 2. - Sont conformes à la Constitution :
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juillet 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Mme Marie D. [Interdiction de recevoir des libéralités pour les membres des professions de santé]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 mai 2022 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 521 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Marie D. par Me Brigitte Garnier-Jourdan, avocate au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1005 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 909 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code civil ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour M. Jean-Louis T., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 juin 2022 ;
les observations présentées pour la requérante par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 15 juin 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 30 juin 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Ronald Maman, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, Me François Pinatel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Jean-Louis T., et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 19 juillet 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le premier
alinéa de l'article 909 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du
5 mars 2007 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les
auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la
maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou
testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de
celle-ci ».
2. La requérante reproche à ces dispositions d'interdire à un patient de consentir un don ou legs aux membres des professions de santé qui lui ont prodigué des soins au cours de la maladie dont il décédera. Elle fait valoir que cette interdiction, formulée de façon générale, sans que soit prise en compte la capacité de la personne malade à consentir une libéralité ni que puisse être apportée la preuve de son absence de vulnérabilité ou de dépendance, porterait atteinte à son droit de disposer librement de son patrimoine. Il en résulterait une méconnaissance du droit de propriété.
3. Il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
4. Les dispositions contestées interdisent aux membres de certaines professions de santé de recevoir des libéralités de la part des personnes auxquelles ils ont prodigué des soins au cours de la maladie dont elles sont décédées. Ce faisant, elles limitent la capacité des personnes atteintes d'une telle maladie à disposer librement de leur patrimoine. Le droit de disposer librement de son patrimoine étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.
5. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état de santé, elles étaient placées dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d'une partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.
6. En second lieu, d'une part, l'interdiction contestée ne vaut que pour les libéralités consenties pendant le cours de la maladie dont le donateur ou le testateur est décédé. D'autre part, elle ne s'applique qu'aux seuls membres des professions médicales, de la pharmacie et aux auxiliaires médicaux énumérés par le code de la santé publique, à la condition qu'ils aient dispensé des soins en lien avec la maladie dont est décédé le patient.
7. Ainsi, eu égard à la nature de la relation entre un professionnel de santé et son patient atteint d'une maladie dont il va décéder, l'interdiction est bien fondée sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le donateur ou le testateur à l'égard de celui qui lui prodigue des soins.
8. Dès lors, l'atteinte au droit de propriété qui résulte des dispositions contestées est justifiée par un objectif d'intérêt général et proportionnée à cet objectif. Le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit donc être écarté.
9. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le premier alinéa de l'article 909 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Commune de Bonneuil-sur-Marne et autres [Suppression des régimes de temps de travail dérogeant à la durée de droit commun dans la fonction publique territoriale]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 1er juin 2022 par le Conseil d'État (décision nos 462193, 462194, 462195 et 462196 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les communes de Bonneuil-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine par Me Lorène Carrère, avocate au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1006 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 15 juin 2022 ;
les observations en intervention présentées pour la commune de Bobigny par Me Carrère, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour la commune de Montreuil-sous-Bois par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour la commune de Noisy-le-Sec par Me Carrère, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour la commune de Stains par Me Carrère, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour la Ville de Paris par la SCP Foussard-Froger, enregistrées le même jour ;
les secondes observations en intervention présentées pour la commune de Montreuil-sous-Bois par la SCP Foussard-Froger, enregistrées le 29 juin 2022 ;
les secondes observations en intervention présentées pour la Ville de Paris par la SCP Foussard-Froger, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour la commune de Bonneuil-sur-Marne par Me Carrère, enregistrées le 30 juin 2022 ;
les secondes observations présentées pour la commune de Vitry-sur-Seine par Me Carrère, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Carrère et Me Vincent Cadoux, avocat au barreau de Paris, pour les communes requérantes et les communes de Bobigny, Noisy-le-Sec et Stains, Me Régis Froger, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la commune de Montreuil-sous-Bois et la Ville de Paris, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 19 juillet 2022 ;
Au vu des pièces suivantes :
les notes en délibéré présentées pour les communes de Bonneuil-sur-Marne, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine par Me Carrère, enregistrées le 22 juillet 2022 ;
la note en délibéré présentée par la Première ministre, enregistrée le même jour ;
la note en délibéré présentée pour la commune de Noisy-le-Sec par Me Carrère, enregistrée le même jour ;
la note en délibéré présentée pour la commune de Fontenay-sous-Bois par Me Carrère, enregistrée le 25 juillet 2022 ;
les notes en délibéré présentées pour les communes de Bobigny et Stains par Me Carrère, enregistrées le même jour ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article
47 de la loi du 6 août 2019 mentionnée ci-dessus prévoit : « I. - Les
collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier
alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un
régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n°
2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à
compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans
les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles
entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur
définition.
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir :
« 1 ° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie,
leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date
du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités
territoriales de cette catégorie ;
« 2 ° En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du
prochain renouvellement de l'assemblée délibérante ou du conseil
d'administration.
« II. - Le dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est abrogé à la date mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa
du I du présent article.
« III. - Au deuxième alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée, les références : »9, 10« sont remplacées par les
références : »7-1, 9, 10" ».
2. Les communes requérantes, rejointes par les communes intervenantes, reprochent à ces dispositions d'obliger les collectivités territoriales, qui avaient été autorisées à maintenir des régimes de temps de travail dérogatoires, à définir désormais les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans les limites applicables aux agents de l'État. Selon elles, faute d'être justifiées par un objectif d'intérêt général, ces dispositions méconnaîtraient le principe de libre administration des collectivités territoriales.
3. Les communes requérantes et intervenantes soutiennent également que ces dispositions porteraient une atteinte injustifiée à l'économie des contrats de travail conclus par les collectivités territoriales avec leurs agents contractuels, en méconnaissance de la liberté contractuelle.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi du 6 août 2019.
5. L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ».
6. Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée.
7. En vertu du premier alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus, les collectivités territoriales fixent les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail de leurs agents dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités. Par dérogation, le dernier alinéa de ce même article a permis aux collectivités de maintenir les régimes de temps de travail qu'elles avaient mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 mentionnée ci-dessus.
8. L'article 47 de la loi du 6 août 2019 met fin à cette faculté. Les dispositions contestées imposent aux collectivités territoriales qui en ont fait usage de fixer, par une délibération prise dans le délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans les limites applicables à ceux de l'État.
9. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu contribuer à l'harmonisation de la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale ainsi qu'avec la fonction publique de l'État afin de réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur mobilité. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
10. En second lieu, d'une part, les dispositions contestées se bornent, en matière d'emploi, d'organisation du travail et de gestion de leurs personnels, à encadrer la compétence des collectivités territoriales pour fixer les règles relatives au temps de travail de leurs agents. D'autre part, les collectivités territoriales qui avaient maintenu des régimes dérogatoires demeurent libres, comme les autres collectivités, de définir des régimes de travail spécifiques pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions de leurs agents.
11. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales doit être écarté.
12. Par ailleurs, en modifiant le cadre légal dans lequel sont placés les agents publics en matière de temps de travail, le législateur n'a pas porté atteinte à la liberté contractuelle. Ce grief ne peut donc qu'être écarté.
13. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Société Igdal [Amende pour défaut de déclaration de la TVA exigible au titre d'une opération auto-liquidée]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 juin 2022 par le Conseil d'État (décision n° 462398 du 14 juin 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Igdal par Me Juan Carlos León-Aguirre, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1009 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code général des impôts ;
la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 13 juillet 2022 ;
les observations présentées pour la société requérante par Me León-Aguirre, enregistrées le 14 juillet 2022 ;
les secondes observations présentées pour la société requérante par Me León-Aguirre, enregistrées le 29 juillet 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me León-Aguirre, pour la société requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 13 septembre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2021 mentionnée ci-dessus.
2. Le premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts, dans cette rédaction, prévoit : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible ».
3. La société requérante reproche à ces dispositions de sanctionner le manquement à une simple obligation déclarative par une amende proportionnelle non plafonnée et à taux fixe dont l'assiette serait sans lien avec la nature de l'infraction et qui trouverait à s'appliquer alors même que le contribuable n'aurait pas éludé l'impôt. Elles méconnaîtraient ainsi le principe de proportionnalité des peines.
4. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
5. Conformément à l'article 283 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services est acquittée par la personne qui réalise une telle opération. Par dérogation à ce principe, le même article prévoit que pour certaines opérations, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur, qui peut immédiatement la déduire. Les opérations relevant de ce régime d'auto-liquidation doivent être mentionnées sur la déclaration que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de souscrire en application de l'article 287 du code général des impôts.
6. Les dispositions contestées sanctionnent le manquement à l'obligation de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre d'une opération relevant du régime de l'auto-liquidation d'une amende fiscale égale à 5 % de la somme que le redevable est en droit de déduire.
7. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que, en instituant cette amende, le législateur a entendu assurer l'effectivité de cette obligation déclarative pour permettre le suivi et la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée à chaque étape du circuit économique. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
8. En second lieu, d'une part, en fixant l'amende encourue en proportion de la somme que le redevable est en droit de déduire au titre de l'opération non déclarée, le législateur a instauré une sanction dont l'assiette est en lien avec la nature de l'infraction. D'autre part, le taux de 5 % retenu n'est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement que le législateur a entendu réprimer.
9. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.
10. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 septembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
M. Mounir S. [Droit de visite des agents des douanes]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 juin 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1044 du 22 juin 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Mounir S. par Me Eugène Bangoura, avocat au barreau de Bourges. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1010 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code des douanes ;
le décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, annexé à la loi n° 48-1973 du 31 décembre 1948 de finances pour 1949 ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le requérant par Me Bertrand Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Bangoura, enregistrées le 18 juillet 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 26 juillet 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Bangoura, pour le requérant, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 13 septembre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article
60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret du 8 décembre 1948
mentionné ci-dessus, prévoit :
« Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche
de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des
marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».
2. Le requérant reproche à ces dispositions de permettre aux agents des douanes de procéder, en toutes circonstances et sans contrôle effectif de l'autorité judiciaire, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, le cas échéant par l'emploi de mesures coercitives. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté individuelle, de la liberté d'aller et de venir, du droit au respect de la vie privée et des droits de la défense.
- Sur le fond :
3. Selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». Son article 4 proclame que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».
4. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d'aller et de venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
5. L'article 60 du code des douanes autorise les agents des douanes à procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
6. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation notamment que les agents des douanes ne peuvent pas procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public libre de tout occupant, ni procéder à une fouille à corps de la personne contrôlée. Ils ne peuvent maintenir à leur disposition l'intéressé que le temps strictement nécessaire à leur mission et ne sont autorisés à recueillir que les déclarations faites en vue de la reconnaissance des objets découverts.
7. La lutte contre la fraude en matière douanière, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, justifie que les agents des douanes puissent procéder à la fouille des marchandises, des véhicules ou des personnes.
8. Toutefois, les dispositions contestées permettent, en toutes circonstances, à tout agent des douanes de procéder à ces opérations pour la recherche de toute infraction douanière, sur l'ensemble du territoire douanier et à l'encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique.
9. En ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.
10. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
12. En l'espèce, d'une part, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2023 la date de leur abrogation. D'autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - L'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 septembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Société Amazon EU [Avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 juillet 2022 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 574 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Amazon EU par Mes Yann Utzschneider et Mickaël Rivollier, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1011 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1 ° du paragraphe I de l'article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux pratiques prohibées.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de commerce ;
l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux pratiques prohibées, prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 17 de la loi n° 2018-938 du 30 août 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dont le délai est expiré ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 26 juillet 2022 ;
les observations présentées pour la société requérante par Me Utzschneider, enregistrées le 27 juillet 2022 ;
les observations présentées pour l'association Institut de liaisons des entreprises de consommation, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SARL Cabinet Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour l'association Institut de liaisons des entreprises de consommation par la SARL Cabinet Briard, enregistrées le 10 août 2022 ;
les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Utzschneider, enregistrées le 11 août 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Utzschneider, pour la société requérante, Me Benjamin de Dreuzy, avocat au barreau de Paris, pour l'association Institut de liaisons des entreprises de consommation, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 27 septembre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le 1 ° du paragraphe I de l'article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 24 avril 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : « D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».
2. La société requérante reproche tout d'abord à ces dispositions de méconnaître la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Au soutien de ces griefs, elle fait valoir que ces dispositions permettraient au juge de procéder à un contrôle des conditions économiques de toute relation commerciale, alors même que ces conditions seraient librement négociées entre les parties. Elle reproche également à ces dispositions de prévoir que la personne qui a obtenu ou tenté d'obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné engage sa responsabilité, sans préciser le seuil à partir duquel est caractérisé un tel avantage. Pour ce dernier motif, elle estime ensuite que ces dispositions méconnaîtraient l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ainsi que le principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'elles laisseraient au juge toute latitude pour caractériser cet avantage. Enfin, elle soutient que, compte tenu de leur imprécision et au regard des sanctions prévues, ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines.
3. En premier lieu, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
4. Les dispositions contestées permettent d'engager la responsabilité d'un professionnel exerçant des activités de production, de distribution ou de services ayant obtenu ou tenté d'obtenir, dans le cadre d'une relation commerciale, certains avantages de l'autre partie.
5. D'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, afin de préserver l'ordre public économique, réprimer certaines pratiques restrictives de concurrence et assurer un équilibre des relations commerciales. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
6. D'autre part, ces dispositions permettent, lorsqu'il est saisi, au juge de contrôler les conditions économiques de la relation commerciale uniquement pour constater une pratique illicite tenant à l'obtention d'un avantage soit dépourvu de contrepartie, soit manifestement disproportionné au regard de cette dernière.
7. Dès lors, le législateur n'a pas porté à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il s'ensuit que les griefs tirés de leur méconnaissance doivent être écartés.
8. En second lieu, selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. En vertu du principe de légalité des délits et des peines, le législateur ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir réglementaire, doivent fixer les sanctions ayant le caractère d'une punition en des termes suffisamment clairs et précis.
9. L'article L. 442-4 du code de commerce sanctionne par une amende civile la pratique prohibée par les dispositions contestées. La notion d'avantage « manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » figurant dans ces mêmes dispositions ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le 1 ° du paragraphe I de l'article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux pratiques prohibées, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS
Établissement public territorial Paris Est Marne et Bois [Calcul de la dotation d'équilibre versée à la métropole du Grand Paris]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 juillet 2022 par le Conseil d'État (décision n° 463180 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois par Me Véronique Fontaine, avocate au barreau des Hauts-de-Seine. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1012 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux derniers alinéas du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour la métropole du Grand Paris, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Yvon Goutal, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 26 juillet 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour l'établissement public territorial requérant par Me Julien Occhipinti, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 août 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Occhipinti, pour l'établissement public territorial requérant, Me Goutal, pour la métropole du Grand Paris, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 27 septembre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les deux
derniers alinéas du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi du 7 août
2015 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre
2020 mentionnée ci-dessus, prévoient :
« À titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque
établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée
d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre
le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui
perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la
cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du
prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n°
2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris
une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est
égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de
la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par
la Ville de Paris ».
2. L'établissement public territorial requérant fait valoir que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors que les modalités de calcul de la dotation d'équilibre versée à la métropole du Grand Paris par la Ville de Paris seraient plus favorables que celles de la dotation d'équilibre versée par les établissements publics territoriaux. Il soutient également que ces dispositions méconnaîtraient le principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires ainsi que l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi du 7 août 2015.
4. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
5. La métropole du Grand Paris est un établissement public de coopération intercommunale composé de la Ville de Paris et de communes regroupées au sein d'établissements publics territoriaux, et dont les modalités de financement sont prévues par l'article 59 de la loi du 7 août 2015. Les deux derniers alinéas du 2 du G du paragraphe XV de cet article prévoient un versement exceptionnel en 2021 à la métropole du Grand Paris par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris.
6. L'avant-dernier alinéa de ce même 2 prévoit que ce versement prend la forme, pour les établissements publics territoriaux, d'une augmentation de la dotation d'équilibre qu'ils doivent verser à la métropole égale aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020. Il précise que, pour le calcul de cette différence, le produit de la cotisation perçu en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes versé par l'État aux établissements publics territoriaux en compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1 ° du paragraphe I de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020.
7. Le dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi du 7 août 2015 prévoit, quant à lui, que ce versement exceptionnel prend la forme, pour la Ville de Paris, d'une dotation à la métropole du Grand Paris. Les dispositions contestées fixent le montant de cette dotation aux deux-tiers de la différence entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020. En revanche, elles ne prévoient pas que le produit de la cotisation perçu en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes versé par l'État.
8. Les dispositions renvoyées ont pour objet d'affecter une partie des recettes de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 par la Ville de Paris et les établissements publics territoriaux à la métropole du Grand Paris afin d'assurer son équilibre financier.
9. Or, au regard de cet objet, la Ville de Paris n'est pas placée dans une situation différente de celle des établissements publics territoriaux. Aucun motif d'intérêt général ne justifie non plus que le calcul de la dotation versée par la Ville de Paris à la métropole soit différent de celui de la dotation versée par les établissements publics territoriaux.
10. Dès lors, sauf à méconnaître le principe d'égalité devant la loi, les dispositions contestées ne sauraient être interprétées que comme impliquant que le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par la Ville de Paris en 2021 soit majoré du montant du prélèvement sur recettes que l'État lui a versé en application de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020.
11. Par conséquent, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée au paragraphe 10, être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 10, la seconde phrase du dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération [Modalités de compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 juillet 2022 par le Conseil d'État (décision n° 464934 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération par Me Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1013 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code général des impôts ;
la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 30 juillet 2022 ;
les observations présentées pour la communauté d'agglomération requérante par la SCP Boutet - Hourdeaux, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 août 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Petit, pour la communauté d'agglomération requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 4 octobre 2022 ;
Au vu des pièces suivantes :
la note en délibéré présentée par la Première ministre, enregistrée le 6 octobre 2022 ;
la note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération requérante par la SCP Boutet - Hourdeaux, enregistrée le 11 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le
paragraphe V de l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019 mentionnée ci-dessus,
dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2020 mentionnée ci-dessus,
prévoit :
« A. - À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur
ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des
remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est
affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la
métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité
territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités
définies aux B à D du présent V.
« B. - 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en
appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
« 1 ° La somme :
« a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation
principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux
intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
« b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe
d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en
2018, 2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
« c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la
métropole de Lyon en 2020 ;
« 2 ° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour
l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur
ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances
pour 2021.
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à
l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour
l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une
régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur
ajoutée au titre de l'année est révisé.
« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le
produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu
afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon
soit égal à la somme :
« - de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation
principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux
intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
« - de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe
d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en
2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
« - des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la
métropole de Lyon en 2020.
« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l'objet d'une notification par
arrêté préfectoral.
« 2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est
égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
fusionnés.
« 3. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de
l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la
part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du
présent 3.
« b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :
« - de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation
principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux
intercommunal appliqué en 2017 au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
« - de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe
d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en
2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
« - des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020
relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.
« 4. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée
conformément au 1 de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du
présent B et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.
« 5. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée
conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
« 6. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année
donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme
définie au 1 ° du 1 du présent B, la différence fait l'objet d'une attribution à
due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant
à l'État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit
de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme
définie au même 1 ° est corrigée de l'impact des cas de changement de périmètre
mentionnés aux 3 à 5.
« C. - 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la
collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité
territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette
fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au
rapport entre :
« 1 ° La somme :
« a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la
base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire
départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon
sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les
propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
« b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe
foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du
département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions
supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en
fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de
la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
« c) Des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties
versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour
la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles
qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI
du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;
« 2 ° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour
l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur
ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances
pour 2021.
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à
l'évaluation révisée proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée
pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année.
Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur
ajoutée au titre de l'année est révisé.
« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le
produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu
afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la
métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte,
par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale
de Martinique soit égal à la somme :
« - de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la
base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire
départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon
sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les
propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
« - de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière
sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou
de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions
supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en
fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de
la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
« - des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties
versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en
2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées
de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les
dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur
montant.
« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité territoriale
fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral.
« 2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la
valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées
conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.
« 3. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année
donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme
définie au 1 ° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due
concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à
l'État.
« D. - 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au
produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
« 1 ° La somme :
« a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation
principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux
appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
« b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe
d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en
2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;
« c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de
Paris en 2020 ;
« 2 ° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour
l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur
ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances
pour 2021.
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à
l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour
l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une
régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur
ajoutée au titre de l'année est révisé.
« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le
produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu
afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal
à la somme :
« - de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation
principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux
appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
« - de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe
d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en
2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;
« - des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de
Paris en 2020.
« La somme revenant à la Ville de Paris fait l'objet d'une notification par
arrêté préfectoral.
« 2. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année
donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme
définie au 1 ° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due
concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à
l'État.
« E. - 1. À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la
valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction
faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables
assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la
métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité
territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les
territoires les plus fragiles.
« 3. En 2021, le montant de cette fraction s'élève à 250 millions d'euros. Il
est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de
charges.
« 4. À compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net
de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent E. Elle est
divisée en deux parts :
« 1 ° Une première part d'un montant fixe de 250 millions d'euros est répartie
entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;
« 2 ° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements.
En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et
le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant
est augmenté annuellement de cette différence.
« 5. Les conditions d'application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil
d'État.
« H. - À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements
publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du
code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé
à ces établissements publics en 2020 au titre du produit des taxes spéciales
d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe
d'habitation sur les résidences principales ».
2. La communauté d'agglomération requérante reproche à ces dispositions de ne pas compenser intégralement la perte de ressources subie, du fait de la suppression de la taxe d'habitation, par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu d'une fusion impliquant un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, lorsque cette fusion est intervenue après 2017.
3. Elle fait valoir que, dans une telle hypothèse, dès lors que le calcul de la compensation est établi par référence aux taux de taxe d'habitation applicables en 2017, cette dernière ne prend pas en compte les mécanismes tirant les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle, à savoir la revalorisation du taux intercommunal de taxe d'habitation dont l'établissement doit bénéficier du fait de cette fusion et la majoration des attributions de compensation que le nouvel établissement public doit verser aux communes membres de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant l'impôt.
4. Elle soutient également, pour les mêmes motifs, que ces dispositions méconnaîtraient les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales.
5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » figurant au a du 1 ° du 1 du B du paragraphe V de l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019.
6. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. En outre, si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
7. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
8. L'article 16 de la loi du 28 décembre 2019 prévoit la suppression progressive de la taxe d'habitation due au titre de la résidence principale pour tous les contribuables à compter de 2023 et la compensation de la perte de ressources induite par cette suppression pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Son paragraphe V prévoit qu'est affectée à ces derniers, à compter de 2021, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant du produit de taxe d'habitation ainsi perdu.
9. En application des dispositions contestées, le montant de taxe d'habitation à compenser pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé par référence aux bases d'imposition de 2020, auxquelles est appliqué le taux de taxe d'habitation intercommunal de 2017.
10. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 2019 que, en leur affectant une fraction de taxe sur la valeur ajoutée, le législateur a entendu compenser intégralement le produit de la taxe d'habitation perdu notamment par les communes et leurs groupements et assurer ainsi que la suppression de cette taxe ne se répercute pas sur d'autres impôts locaux au détriment du pouvoir d'achat des contribuables, que la réforme visait à améliorer par cette suppression.
11. En premier lieu, en retenant l'année 2017 comme année de référence du taux intercommunal de taxe d'habitation pris en compte pour le calcul de cette compensation, le législateur a voulu faire obstacle à des augmentations du taux de cette taxe qui n'auraient été motivées que par l'annonce de sa suppression et de sa compensation par l'État. Ce faisant, il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien avec l'objectif poursuivi.
12. En second lieu, d'une part, les dispositions contestées assurent une compensation intégrale du produit de taxe d'habitation au regard des taux intercommunaux de 2017. D'autre part, si, du fait de la mise en œuvre des mécanismes de transfert de taux et de compensation prévus par les articles 1609 nonies C et 1638-0 bis du code général des impôts pour tirer les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, issu d'une fusion postérieure à 2017 et impliquant un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, est susceptible de subir une perte de ressource équivalente à la surcompensation dont bénéficient certaines de ses communes membres, il n'en résulte pas pour autant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
13. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne créent par elles-mêmes aucune différence de traitement entre les établissements publics de coopération intercommunale, ne méconnaissent pas les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
14. Par ailleurs, les établissements publics de coopération intercommunale ne constituent pas des collectivités territoriales au sens de l'article 72 de la Constitution. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté.
15. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » figurant au a du 1 ° du 1 du B du paragraphe V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Société Schneider electric et autres [Précompte mobilier]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 juillet 2022 par le Conseil d'État (décision n° 442224 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Schneider electric et autres par Me Sarah Dardour-Attali, avocate au barreau des Hauts-de-Seine. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1014 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ;
le code général des impôts ;
la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;
l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 mai 2022, n° C-556/20 ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour les sociétés requérantes par Me Dardour-Attali, enregistrées le 29 juillet 2022 ;
les observations en intervention présentées pour la société L'air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude par Me Gauthier Blanluet, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 8 août 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 16 août 2022 ;
les secondes observations en intervention présentées pour la société intervenante par Me Blanluet, enregistrées le 30 août 2022 ;
les secondes observations présentées pour les sociétés requérantes par Me Dardour-Attali, enregistrées le 31 août 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Dardour-Attali, pour les sociétés requérantes, Me Blanluet, pour la société intervenante, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 4 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les trois
premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans
sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1999 mentionnée ci-dessus,
prévoient :
« Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les
produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison
desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal
prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue
d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions
prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des
distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels
qu'en soient les bénéficiaires.
« Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur
les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date
antérieure au 1er janvier 1965.
« Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris
en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies ».
2. Les sociétés requérantes, rejointes par la société intervenante, reprochent à ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'État en conformité avec le droit de l'Union européenne, de prévoir que les sociétés mères qui distribuent des dividendes en provenance de leurs filiales situées en France ou en dehors de l'Union européenne sont redevables d'un précompte alors que celles dont les filiales sont situées dans un autre État membre ne sont pas tenues de s'en acquitter. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les sociétés mères selon que leurs filiales sont établies en France, dans un autre État membre ou en dehors de l'Union européenne, en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts.
4. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
5. En application de l'article 158 bis du code général des impôts, les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises bénéficient d'un avoir fiscal égal à la moitié des sommes versées.
6. Les dispositions contestées de l'article 223 sexies du même code prévoient qu'une société qui distribue des produits n'ayant pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal est redevable d'un précompte égal au montant de cet avoir fiscal.
7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'une société mère qui redistribue des dividendes en provenance d'une filiale doit s'acquitter d'un précompte dès lors que ces dividendes sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application de l'article 216 du même code et, d'autre part, que la société mère bénéficie d'un avoir fiscal si cette filiale est établie en France.
8. Dans sa décision du 12 mai 2022 mentionnée ci-dessus, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la directive du 23 juillet 1990 mentionnée ci-dessus doit s'interpréter en ce sens qu'elle « s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu'une société mère est redevable d'un précompte en cas de redistribution à ses actionnaires de bénéfices versés par ses filiales, donnant lieu à l'attribution d'un avoir fiscal, lorsque ces bénéfices n'ont pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ». Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État, tirant les conséquences de cette décision, que, lorsqu'une société mère redistribue à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales situées dans un autre État membre de l'Union européenne, elle n'est pas redevable du précompte. En revanche, elle est redevable de cet impôt à raison des redistributions de dividendes en provenance de filiales établies en France ou dans des États non membres de l'Union européenne.
9. Il s'ensuit que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, instaurent une différence de traitement entre les sociétés mères procédant à une redistribution des dividendes provenant de leurs filiales selon que ces dernières se situent dans un autre État membre de l'Union européenne ou qu'elles se situent en France ou en dehors de l'Union européenne.
10. Toutefois, lors de leur adoption, les dispositions contestées avaient pour objet d'assurer l'effectivité du mécanisme de l'avoir fiscal qui permet d'éviter la double imposition des dividendes. Or, le respect du droit de l'Union européenne impose, afin d'éviter la double imposition des dividendes, que les sociétés mères ne soient pas redevables du précompte dès lors qu'elles ne bénéficient pas d'un avoir fiscal au titre des sommes qu'elles ont reçues de leurs filiales situées dans un autre État membre. Les dispositions contestées qui, telles qu'interprétées, exonèrent ces sociétés mères du précompte, se sont ainsi bornées à adapter ce régime à leur situation.
11. D'une part, il ne résulte pas de cette exigence découlant du droit de l'Union européenne une dénaturation de l'objet initial de la loi. D'autre part, au regard de l'objet de la loi, telle que désormais interprétée, il existe une différence de situation entre les sociétés mères, tenant à l'établissement de leur filiale en France, dans un autre État membre ou en dehors de l'Union européenne. La différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est ainsi fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.
12. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.
13. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et François SÉNERS.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 juillet 2022 par le Conseil d'État (décision n° 464217 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine par Me Safine Hadri, avocate au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1015 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 513-3, du paragraphe II de l'article L. 513-5 et du paragraphe I de l'article L. 513-6 du code des assurances ainsi que de l'article L. 519-11, du paragraphe II de l'article L. 519-13 et du paragraphe I de l'article L. 519-14 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code des assurances ;
le code monétaire et financier ;
la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour l'association requérante par Me Hadri, enregistrées le 5 août 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 16 août 2022 ;
les observations en intervention présentées pour l'association nationale des conseillers financiers courtage et autres par la SCP Delvové -Trichet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour l'association requérante par Me Hadri, enregistrées le 31 août 2022 ;
les nouvelles observations présentées pour l'association requérante par Me Hadri, enregistrées le 7 septembre 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Hadri, pour l'association requérante, Me Antoine Delvolvé, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les parties intervenantes, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 11 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article
L. 513-3 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 8 avril
2021 mentionnée ci-dessus, prévoit : « I.- Aux fins de leur immatriculation au
registre mentionné au I de l'article L. 512-1, les courtiers d'assurance ou de
réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du
commerce et des sociétés pour l'activité de courtage d'assurance, et leurs
mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à
une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de
l'accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle
représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les
conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des
exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service
d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques
professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.
« Les courtiers ou sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires
exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou
de la liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association
professionnelle agréée mentionnée au présent I.
« II.- Ne sont pas soumises à l'obligation d'adhésion à une association
professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas
échéant, lorsqu'elles exercent le courtage d'assurance à titre de mandataire
d'intermédiaire d'assurance :
« 1 ° Les établissements de crédit et sociétés de financement ;
« 2 ° Les sociétés de gestion de portefeuille ;
« 3 ° Les entreprises d'investissement ;
« 4 ° Les agents généraux d'assurance inscrits sous un même numéro au registre
mentionné à l'article L. 512-1.
« L'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I
du présent article n'est pas applicable aux mandataires d'intermédiaires
d'assurance agissant en application des mandats délivrés par l'une des personnes
mentionnées aux 1 ° à 3 ° du présent II ».
2. Le
paragraphe II de l'article L. 513-5 du même code, dans la même rédaction,
prévoit : « Les associations mentionnées au I de l'article L. 513-3 établissent
par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, lors de leur agrément, les règles qu'elles s'engagent à mettre en
œuvre pour l'exercice de leurs missions définies à la seconde phrase du premier
alinéa du même I ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer
à l'encontre des membres. Elles font également approuver par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces
règles.
« Elles peuvent formuler à l'intention de leurs membres des recommandations
relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention
des conflits d'intérêts.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles
de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ».
3. Le
paragraphe I de l'article L. 513-6 du même code, dans la même rédaction,
prévoit : « Une association mentionnée au I de l'article L. 513-3 peut mettre
fin à l'adhésion d'un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de
membre peut également être décidé d'office par l'association si le courtier, la
société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les
engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son
activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce
plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de
fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l'organisme qui tient le
registre mentionné au I de l'article L. 512-1.
« Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait de la qualité de membre est
notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à
l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.
« Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d'office,
l'association peut également décider d'informer de sa décision les autres
associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3.
« La décision de retrait peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal
judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association ».
4. L'article
L. 519-11 du code monétaire et financier, dans la même rédaction, prévoit : «
I.- Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l'article L.
546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
mentionnés à l'article L. 519-1 et leurs mandataires adhèrent à une association
professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de
ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses
membres un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice de
leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et
organisationnelles et offre un service d'accompagnement et d'observation de
l'activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de
données statistiques.
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant
en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté
d'établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle
agréée mentionnée au présent I.
« II.- L'obligation d'adhérer à une association professionnelle agréée prévue au
I du présent article ne s'applique pas :
« 1 ° Aux mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de
paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement
de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un
établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un
intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le
cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses
activités de gestion de fonds d'investissement alternatifs mentionnées à
l'article L. 511-6, et qui sont soumis à une obligation contractuelle de
travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie
déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement, ainsi qu'à leurs
mandataires ;
« 2 ° Aux mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui
exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs
délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement,
établissements de paiement, établissements de monnaie électronique qui
fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement
participatif, entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts
ou sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de fonds
d'investissement alternatifs mentionnées au même article L. 511-6, ainsi qu'à
leurs mandataires ;
« 3 ° Aux intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre État membre de
l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen pour l'exercice d'activité d'intermédiation en matière de contrats de
crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ».
5. Le
paragraphe II de l'article L. 519-13 du même code, dans la même rédaction,
prévoit : « Les associations mentionnées au I de l'article L. 519-11 établissent
par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, lors de leur agrément, les règles qu'elles s'engagent à mettre en
œuvre pour l'exercice de leurs missions telles que définies à la seconde phrase
du premier alinéa du même I ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles
de prononcer à l'encontre de leurs membres. Elles font également approuver par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure
de ces règles.
« Elles peuvent formuler à l'intention de leurs membres des recommandations
relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention
des conflits d'intérêts.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles
de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ».
6. Le
paragraphe I de l'article L. 519-14 du même code, dans la même rédaction,
prévoit : « Une association mentionnée au I de l'article L. 519-11 peut mettre
fin à l'adhésion d'un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de
membre peut également être décidé d'office par l'association si l'intermédiaire
en opérations de banque et en services de paiement ne remplit plus les
conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a
pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion,
s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu
l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l'organisme qui tient le
registre mentionné au I de l'article L. 546-1.
« Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait de la qualité de membre est
notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à
l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.
« Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d'office,
l'association peut également décider d'informer de sa décision les autres
associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 519-11.
« La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l'objet d'un recours
devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de
l'association ».
7. L'association requérante reproche tout d'abord aux articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier d'obliger les courtiers d'assurance et les courtiers en opérations de banque et en services de paiement à adhérer à une association professionnelle agréée pour être immatriculés au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi la liberté d'entreprendre, la liberté syndicale et la liberté d'association. Il en résulterait également une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, dès lors que cette adhésion est facultative pour les mêmes professionnels exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement et qu'elle n'est pas prévue pour d'autres intermédiaires en assurance, banque et finance.
8. L'association requérante reproche ensuite aux dispositions renvoyées des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier de conférer aux associations professionnelles agréées un pouvoir de sanction sans prévoir une procédure permettant d'assurer la séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction et celles de jugement. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions. Elles seraient par ailleurs contraires au principe non bis in idem dès lors que les sanctions prononcées par les associations professionnelles agréées pourraient, selon elle, se cumuler avec celles prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
9. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur les articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier et, d'autre part, sur les mots « ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre des membres » figurant au paragraphe II de l'article L. 513-5 du code des assurances, sur les mots « ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre de leurs membres » figurant au paragraphe II de l'article L. 519-13 du code monétaire et financier et sur le premier alinéa du paragraphe I des articles L. 513-6 du code des assurances et L. 519-14 du code monétaire et financier.
- Sur les articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier :
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre :
10. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
11. Les dispositions contestées imposent aux courtiers d'assurance ou de réassurance et aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement, ainsi qu'à leurs mandataires respectifs, d'adhérer à une association professionnelle agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins d'immatriculation au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.
12. L'immatriculation à ce registre constituant une condition d'accès et d'exercice des activités d'intermédiation d'assurance et en opérations de banque et services de paiement, ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre.
13. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer le contrôle de l'accès aux activités de courtage et assurer l'accompagnement des professionnels qui exercent ces activités. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général de protection des consommateurs.
14. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions contestées se bornent à prévoir que les associations professionnelles agréées ont pour mission de vérifier les conditions d'accès et d'exercice de l'activité de leurs membres, qui sont déterminées par le code des assurances et le code monétaire et financier. D'autre part, si, dans le cadre de ces vérifications, ces associations peuvent refuser une demande d'adhésion ou retirer la qualité de membre à l'un de leurs adhérents, leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
15. En dernier lieu, leurs autres missions ont pour seul objet d'offrir à leurs membres des services de médiation, d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles.
16. Dès lors, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :
17. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
18. Les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre, d'une part, les courtiers d'assurance ou de réassurance et les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, tenus d'adhérer à une association professionnelle agréée, et, d'autre part, les courtiers exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement et certains intermédiaires visés au paragraphe II des articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier, qui ne sont pas soumis à cette obligation.
19. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 13, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer le contrôle de l'accès aux activités de courtage et assurer l'accompagnement des professionnels concernés.
20. Ces professionnels, qui exercent leurs activités à titre indépendant et sous le statut de commerçant, ne se trouvent pas placés dans la même situation que les courtiers exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement, qui sont déjà immatriculés dans leur État d'origine. Ils ne sont pas non plus placés dans la même situation que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises d'investissement, les agents généraux d'assurance et les mandataires en opérations de banque et en services de paiement, qui sont soumis à des conditions et des contrôles propres à leur activité.
21. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.
22. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
23. Par conséquent, les articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté syndicale et la liberté d'association, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
- Sur les dispositions contestées des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et des articles L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier :
24. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu'une autorité administrative ou publique indépendante ou une autorité administrative non soumise au pouvoir hiérarchique du ministre, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse prononcer des sanctions ayant le caractère d'une punition dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir respecte notamment les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
25. Aux termes du paragraphe II des articles L. 513-6 du code des assurances et L. 519-14 du code monétaire et financier, l'association professionnelle agréée n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
26. Les dispositions contestées prévoient que ces associations établissent et font approuver par cette autorité « les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre de leurs membres ». Elles peuvent en outre décider d'office de retirer la qualité de membre à l'un de leurs adhérents s'il ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
27. Il en résulte que les dispositions contestées, qui se bornent à permettre aux associations professionnelles agréées d'exercer à l'égard de leurs membres les pouvoirs inhérents à l'organisation de toute association en vue d'assurer le respect de leurs conditions d'adhésion et de fonctionnement, n'ont ainsi en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de conférer à ces associations le pouvoir de prononcer des sanctions ayant le caractère d'une punition.
28. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ne peut qu'être écarté. Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789.
29. Par conséquent, les dispositions contestées des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et des articles L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Sont conformes à la Constitution :
l'article L. 513-3 du code des assurances, les mots « ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre des membres » figurant au paragraphe II de l'article L. 513-5 du même code et le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 513-6 de ce même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement ;
l'article L. 519-11 du code monétaire et financier, les mots « ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre de leurs membres » figurant au paragraphe II de l'article L. 519-13 du même code et le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 519-14 de ce même code, dans leur rédaction issue de la même loi du 8 avril 2021.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Société ContextLogic Inc [Déréférencement d'une interface en ligne]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 juillet 2022 par le Conseil d'État (décision n° 459960 du 22 juillet 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société ContextLogic Inc par Me Alexandre Le Mière, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1016 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du a du 2 ° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de la consommation ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour la société requérante par la SCP Melka - Prigent - Drusch, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 17 août 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour la société Google Ireland limited par Me Sébastien Proust, avocat au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 7 septembre 2022 ;
les secondes observations en intervention présentées pour la société Google Ireland limited par Me Proust, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Mes Ludwig Prigent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Alexandre Glatz, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, Me Proust, pour la société intervenante, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 11 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le a du 2 ° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, prévoit que, lorsque sont constatées certaines infractions aux dispositions du même code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut : « Notifier aux personnes relevant du I de l'article L. 111-7 du présent code les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu'elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ».
2. La société requérante, rejointe par la société intervenante, reproche à ces dispositions de permettre à l'administration d'ordonner le déréférencement d'une interface en ligne, sans subordonner une telle mesure à l'autorisation d'un juge ni prévoir qu'elle doit être limitée dans le temps et porter sur les seuls contenus présentant un caractère manifestement illicite. Au regard des conséquences que cette mesure emporterait pour l'exploitant de l'interface et ses utilisateurs, il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'expression et de communication ainsi que de la liberté d'entreprendre.
3. La société intervenante fait valoir également que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le « droit à une bonne administration », dès lors qu'elles ne prévoient pas que la décision ordonnant le déréférencement doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication :
4. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services et de s'y exprimer.
5. L'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant ... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d'instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
6. L'article L. 521-3-1 du code de la consommation prévoit que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prendre des mesures pour faire cesser certaines pratiques commerciales frauduleuses commises à partir d'une interface en ligne. Parmi ces mesures, les dispositions contestées prévoient que, dans certains cas, elle peut enjoindre aux opérateurs de plateforme en ligne de procéder au déréférencement des adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère illicite.
7. Ces dispositions permettent à l'autorité administrative de limiter l'accès des utilisateurs à des sites internet ou à des applications en imposant la disparition de leurs adresses électroniques dans le classement ou le référencement mis en œuvre par les opérateurs de plateforme en ligne. Ce faisant, elles portent atteinte à la liberté d'expression et de communication.
8. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer la protection des consommateurs et assurer la loyauté des transactions commerciales en ligne. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
9. En deuxième lieu, d'une part, la mesure de déréférencement ne s'applique qu'à des sites internet ou à des applications, exploités à des fins commerciales par un professionnel ou pour son compte, et permettant aux consommateurs d'accéder aux biens ou services qu'ils proposent, lorsqu'ont été constatées à partir de ces interfaces des pratiques caractérisant certaines infractions punies d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs. D'autre part, seules peuvent faire l'objet d'un déréférencement les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite.
10. En troisième lieu, les dispositions contestées ne peuvent être mises en œuvre que si l'auteur de la pratique frauduleuse constatée sur cette interface n'a pu être identifié ou s'il n'a pas déféré à une injonction de mise en conformité prise après une procédure contradictoire et qui peut être contestée devant le juge compétent.
11. En quatrième lieu, le délai fixé par l'autorité administrative pour procéder au déréférencement ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Ce délai permet aux personnes intéressées de contester utilement cette décision par la voie d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
12. En dernier lieu, les dispositions contestées permettent, sous le contrôle du juge qui s'assure de sa proportionnalité, que la mesure de déréférencement s'applique à tout ou partie de l'interface en ligne.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication doit être écarté.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre :
14. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
15. En permettant à l'autorité administrative d'ordonner le déréférencement des adresses électroniques des interfaces en ligne proposant des biens ou services, les dispositions contestées portent atteinte à la liberté d'entreprendre. Toutefois, elles n'ont pas pour effet d'empêcher les exploitants de ces interfaces d'exercer leurs activités commerciales, leurs adresses demeurant directement accessibles en ligne. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté.
16. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le a du 2 ° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
M. Lucas S. et autre [Révocation du sursis à exécution d'une sanction disciplinaire II]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juillet 2022 par le Conseil d'État (décisions nos 464975 et 461090 du 26 juillet 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour M. Lucas S. par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et pour M. Emeric L. par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2022-1017 QPC et 2022-1018 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code rural et de la pêche maritime ;
l'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires, ratifiée par l'article 29 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour M. Lucas S. par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, enregistrées le 18 août 2022 ;
les observations présentées pour M. Emeric L. par la SCP Foussard-Froger, enregistrées le même jour ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour M. Emeric L. par la SCP Foussard-Froger, enregistrées le 2 septembre 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Bertrand Colin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Lucas S., Me Régis Froger, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Emeric L., et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 11 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. Le paragraphe III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 31 juillet 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ».
3. Les requérants reprochent à ces dispositions de prévoir que le sursis assortissant une sanction de suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire est automatiquement et obligatoirement révoqué en cas de nouvelle sanction de suspension prononcée dans un délai de cinq ans, sans que le juge prononçant cette nouvelle peine puisse y faire échec ou moduler les effets de la révocation. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance du principe d'individualisation des peines.
4. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires … ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique qu'une sanction disciplinaire ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
5. L'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime détermine les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard des vétérinaires en cas de manquements aux obligations légales, réglementaires et déontologiques auxquelles ils sont soumis. Au nombre de ces sanctions, la juridiction disciplinaire peut prononcer celle de suspension, qui emporte interdiction d'exercice de la profession de vétérinaire pendant un délai fixé par la juridiction. Elle peut assortir cette suspension d'un sursis. Dans ce cas, l'exécution de la sanction est suspendue pendant un délai de cinq ans à compter de son prononcé.
6. Les dispositions contestées de cet article prévoient que ce sursis est révoqué si, dans ce délai de cinq ans, l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle sanction de suspension.
7. En premier lieu, d'une part, le sursis constitue une mesure de suspension de l'exécution d'une peine. Cette mesure est subordonnée à l'absence, durant un délai d'épreuve, de la commission de nouvelles fautes. Lorsqu'elle prononce une sanction et qu'elle décide de l'assortir d'un sursis, la juridiction disciplinaire tient compte des circonstances propres à chaque espèce et de l'adéquation de la sanction aux fautes commises.
8. D'autre part, les dispositions contestées prévoient que le sursis prononcé ne pourra être révoqué que dans le cas où une nouvelle sanction de suspension est prononcée au cours du délai d'épreuve de cinq ans. Cette révocation ne peut ainsi résulter que d'une condamnation définitive pour un manquement d'une nature ou d'une gravité justifiant l'application d'une sanction de suspension.
9. En second lieu, il résulte de ces dispositions que la juridiction disciplinaire peut prononcer une sanction n'entraînant pas la révocation du sursis ou une sanction de suspension du droit d'exercer dont elle fixe la durée. La juridiction peut ainsi prendre en compte les conséquences de sa décision sur l'exécution de la première sanction.
10. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.
11. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le paragraphe III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
M. Bruno M. [Composition des instances disciplinaires de l'ordre des experts-comptables]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juillet 2022 par le Conseil d'État (décision n° 440070 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Bruno M. par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1019 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 49 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et de l'article 50 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, ratifiée par l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour M. Thierry M., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 août 2022 ;
les observations présentées pour le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 16 août 2022 ;
les observations présentées pour le requérant par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle, enregistrées le 17 août 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 18 août 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Jean-Philippe Duhamel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Thierry M., Me Fabrice Sebagh, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 18 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article
49 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction
résultant de la loi du 8 août 1994 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre
régionale de discipline.
« La chambre régionale de discipline est composée :
« 1 ° D'un président désigné par le premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle est situé le conseil régional parmi les magistrats du siège
de cette cour ;
« 2 ° De deux membres du conseil régional de l'ordre, élus par ce conseil lors
de chaque renouvellement.
« Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions ».
2. L'article
50 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 25 mars
2004 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Il est institué auprès du conseil supérieur de l'ordre une chambre nationale
de discipline.
« La chambre nationale de discipline est composée :
« 1 ° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice,
parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ;
« 2 ° D'un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d'un fonctionnaire,
désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
« 3 ° De deux membres du conseil supérieur de l'ordre, élus par ce conseil lors
de chaque renouvellement.
« La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises
par la commission mentionnée à l'article 49 bis. Dans ce cas, un des membres du
Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est remplacé par un
représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les
fédérations mentionnées au 3 ° de l'article 49 bis.
« Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions ».
3. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir la séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction et celles de jugement dans la procédure devant les instances disciplinaires de l'ordre des experts-comptables. Elles méconnaîtraient ainsi les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions.
4. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les principes d'indépendance et d'impartialité, indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.
5. Les dispositions contestées instituent les chambres régionales de discipline et la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, qui sont compétentes pour connaître, en première instance et en appel, des manquements de ces professionnels aux obligations légales, réglementaires et déontologiques auxquelles ils sont soumis.
6. En premier lieu, ces dispositions, qui se bornent à définir la composition de la chambre régionale de discipline et de la chambre nationale de discipline, n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre qu'un membre de ces juridictions qui aurait engagé des poursuites disciplinaires ou accompli des actes d'instruction siège au sein de la formation de jugement.
7. En second lieu, la procédure disciplinaire applicable aux experts-comptables, soumise aux principes d'indépendance et d'impartialité, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire.
8. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées n'institueraient pas les règles de procédure garantissant le respect de ces principes doit être écarté.
9. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - L'article 49 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et l'article 50 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Mme Célia C. [Accès des tiers au dossier de la procédure d'instruction dans le cadre d'une demande de restitution d'un bien saisi]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juillet 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1122 du 27 juillet 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Célia C. par Me Laurent Goldman, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1020 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 19 août 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Goldman, pour la requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 18 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le dernier
alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant
de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit, en cas d'appel de
l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur la restitution de biens placés
sous main de justice :
« Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par le président de
la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction en ses observations,
mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure ».
2. La requérante reproche à ces dispositions d'interdire au tiers à l'information judiciaire d'accéder au dossier de la procédure lorsqu'il conteste l'ordonnance du juge d'instruction refusant de lui restituer un bien saisi, ce qui rendrait excessivement difficile l'exercice de son recours. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure » figurant au dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale.
4. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.
5. L'article 99 du code de procédure pénale prévoit que, outre la personne mise en examen ou la partie civile, toute personne prétendant avoir droit sur un objet placé sous main de justice peut, au cours de l'information judiciaire, demander sa restitution au juge d'instruction.
6. En application des dispositions contestées, lorsqu'il fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution, le tiers ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
7. En premier lieu, en application de l'article 99 du code de procédure pénale, le tiers à la procédure peut contester devant la chambre de l'instruction l'ordonnance du juge d'instruction refusant la restitution d'un objet placé sous main de justice. D'une part, ce refus ne peut être opposé que lorsque cette restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit de l'infraction, lorsque la restitution présente un danger pour les personnes ou les biens, ou lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi. D'autre part, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée. Ainsi, le tiers est mis à même de contester les motifs de la décision de refus.
8. En deuxième lieu, d'une part, à l'occasion de ce recours, le tiers a le droit d'être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations. D'autre part, en lui interdisant d'exiger la communication de pièces relatives à la saisie, le législateur a entendu préserver le secret de l'enquête et de l'instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789. Au demeurant, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la chambre de l'instruction puisse, si elle le juge nécessaire pour exercer son office, communiquer au tiers appelant certaines pièces du dossier se rapportant à la saisie.
9. En dernier lieu, à l'issue de l'instruction, la restitution peut également être sollicitée en cas de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement. Dans ce dernier cas, en application des articles 373 et 479 du code de procédure pénale, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent alors être communiqués aux personnes, autres que les parties, qui prétendent avoir droit sur des objets placés sous main de justice.
10. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.
11. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure » figurant au dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Mme Marie P. [Requête en nullité d'un acte d'investigation déposée par un journaliste n'ayant ni la qualité de partie à la procédure ni celle de témoin assisté]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juillet 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1125 du 27 juillet 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Marie P. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1021 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 60-1, du quatrième alinéa de l'article 100-5 ainsi que des articles 170, 171 et 173 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de procédure pénale ;
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;
la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes ;
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour la requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 18 août 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 19 août 2022 ;
les observations en intervention présentées pour l'association de la presse judiciaire et l'association Reporters sans frontières par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 5 septembre 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 18 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du troisième alinéa de l'article 60-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus, du quatrième alinéa de l'article 100-5 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 2010 mentionnée ci-dessus, de l'article 170 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 mentionnée ci-dessus, de l'article 171 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 24 août 1993 mentionnée ci-dessus et de l'article 173 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi du 23 mars 2019.
2. Le troisième alinéa de l'article 60-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019, prévoit : « À peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
3. Le quatrième alinéa de l'article 100-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 2010, prévoit : « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
4. L'article 170 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004, prévoit : « En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté ».
5. L'article 171 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 août 1993, prévoit : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».
6. L'article
173 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 23
mars 2019, prévoit : « S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une
pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de
l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la
République et avoir informé les parties.
« Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il
requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa
transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins
d'annulation à cette chambre et en informe les parties.
« Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise,
elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse
copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président
de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire
l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est
constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son
avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la
juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en
examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une
déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration
est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la
signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait
mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en
original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de
l'instruction.
« Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes
de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et
notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de
contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX
du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
« Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de
l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours,
constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou
quatrième alinéas du présent article, de l'article 173-1, du premier alinéa de
l'article 174 ou du IV de l'article 175 ; il peut également constater
l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate
l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction
ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ;
dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il
est dit aux articles 194 et suivants ».
7. La requérante, rejointe par les parties intervenantes, reproche à ces dispositions de ne pas permettre à un journaliste de présenter une requête en nullité d'un acte d'investigation accompli en violation du secret de ses sources, lorsqu'il est tiers à la procédure à l'occasion de laquelle un tel acte a été réalisé. Elle fait valoir, en outre, qu'aucune autre voie de droit ne lui permettrait de faire constater l'illégalité de cet acte. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, du droit au respect de la vie privée et de la liberté d'expression. Elle estime par ailleurs qu'en réservant la possibilité de former une telle requête en nullité au journaliste qui a la qualité de partie ou de témoin assisté, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi. Pour les mêmes raisons, le législateur aurait également méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant les exigences constitutionnelles précitées.
8. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le troisième alinéa de l'article 60-1 du code de procédure pénale et sur le quatrième alinéa de l'article 100-5 du même code.
9. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
10. Les articles 60-1 et 100-5 du code de procédure pénale sont relatifs, pour le premier, au pouvoir de réquisition d'informations reconnu aux autorités en charge des investigations dans le cadre d'une enquête de flagrance et, pour le second, au pouvoir d'interception des correspondances émises par la voie de communications électroniques dont dispose le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
11. Les dispositions contestées de ces articles interdisent, à peine de nullité, de verser au dossier de la procédure les éléments obtenus par une réquisition prise en violation du secret des sources d'un journaliste, lequel est protégé par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 mentionnée ci-dessus, et de transcrire les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de ces mêmes dispositions.
12. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'un tiers à la procédure, y compris un journaliste, ne peut pas demander l'annulation d'un acte qui aurait été accompli en violation du secret des sources.
13. En premier lieu, en application des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, au cours de l'information, le juge d'instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté peuvent saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure. En réservant à ces personnes la possibilité de contester la régularité d'actes ou de pièces versés au dossier de la procédure, le législateur a entendu préserver le secret de l'enquête et de l'instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789.
14. En second lieu, lorsqu'un acte d'investigation accompli en violation du secret des sources est constitutif d'une infraction, le journaliste qui s'estime lésé par celle-ci peut mettre en mouvement l'action publique devant les juridictions pénales en se constituant partie civile et demander la réparation de son préjudice. Si, en application de l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée dans le cas où l'illégalité de l'acte ne serait pas soulevée par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté, et définitivement constatée par la juridiction qui en est saisie, le journaliste conserve la possibilité d'invoquer l'irrégularité de cet acte à l'appui d'une demande tendant à engager la responsabilité de l'État du fait de cette violation.
15. Dès lors, en ne permettant pas à un journaliste, comme à tout autre tiers à la procédure, d'obtenir l'annulation d'un acte d'investigation accompli en violation du secret des sources, le législateur n'a pas, compte tenu de l'ensemble des voies de droit qui sont ouvertes, méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif. Ce grief doit donc être écarté.
16. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression, le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le troisième alinéa de l'article 60-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et le quatrième alinéa de l'article 100-5 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Mme Zohra M. et autres [Refus du médecin d'appliquer des directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 août 2022 par le Conseil d'État (ordonnance n° 466082 du 19 août 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mmes Zohra M., Rachida M. et Saïda M. par la SCP Melka - Prigent - Drusch, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1022 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de la santé publique ;
l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations en intervention présentées pour l'association Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 19 septembre 2022 ;
les observations présentées pour les requérantes par la SCP Melka - Prigent - Drusch, enregistrées le 20 septembre 2022 ;
les observations présentées pour le centre hospitalier de Valenciennes, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées pour l'association intervenante par la SPC Piwnica et Molinié, enregistrées le 30 septembre 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Ludwig Prigent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les requérantes, Me Claire Waquet, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier de Valenciennes, Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association intervenante, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 25 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 11 mars 2020 mentionnée ci-dessus.
2. Le
troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans
cette rédaction, prévoit :
« Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision
d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale
pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque
les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non
conformes à la situation médicale ».
3. Les requérantes, rejointes par l'association intervenante, reprochent à ces dispositions de permettre à un médecin d'écarter les directives anticipées par lesquelles un patient a exprimé sa volonté que soient poursuivis des traitements le maintenant en vie. Elles font valoir que, en permettant au médecin de prendre une telle décision lorsque les directives lui apparaissent « manifestement inappropriées ou non conformes » à la situation médicale du patient, ces dispositions ne seraient pas entourées de garanties suffisantes dès lors que ces termes seraient imprécis et confèreraient au médecin une marge d'appréciation trop importante, alors qu'il prend sa décision seul et sans être soumis à un délai de réflexion préalable. Il en résulterait une méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, dont découlerait le droit au respect de la vie humaine, ainsi que de la liberté personnelle et de la liberté de conscience.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » figurant au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique.
5. L'association intervenante fait en outre valoir que ces dispositions instaureraient une différence de traitement injustifiée entre les personnes en état d'exprimer leur volonté sur l'arrêt d'un traitement et celles qui n'ont pu l'exprimer que dans des directives anticipées.
6. Le Préambule de la Constitution de 1946 réaffirme que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle.
7. La liberté personnelle est proclamée par les articles 1er, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
8. Il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, notamment en matière médicale, de déterminer les conditions dans lesquelles la poursuite ou l'arrêt des traitements d'une personne en fin de vie peuvent être décidés, dans le respect de ces exigences constitutionnelles.
9. L'article L. 1111-11 du code de la santé publique prévoit que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées relatives à sa fin de vie, qui s'imposent en principe au médecin, pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.
10. Les dispositions contestées de cet article permettent au médecin d'écarter ces directives anticipées notamment lorsqu'elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient.
11. En premier lieu, en permettant au médecin d'écarter des directives anticipées, le législateur a estimé que ces dernières ne pouvaient s'imposer en toutes circonstances, dès lors qu'elles sont rédigées à un moment où la personne ne se trouve pas encore confrontée à la situation particulière de fin de vie dans laquelle elle ne sera plus en mesure d'exprimer sa volonté en raison de la gravité de son état. Ce faisant, il a entendu garantir le droit de toute personne à recevoir les soins les plus appropriés à son état et assurer la sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie.
12. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles un médecin peut écarter les directives anticipées d'un patient en fin de vie hors d'état d'exprimer sa volonté dès lors que ces conditions ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi.
13. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne permettent au médecin d'écarter les directives anticipées que si elles sont « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » du patient. Ces dispositions ne sont ni imprécises ni ambiguës.
14. En troisième lieu, la décision du médecin ne peut être prise qu'à l'issue d'une procédure collégiale destinée à l'éclairer. Elle est inscrite au dossier médical et portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches.
15. En dernier lieu, la décision du médecin est soumise, le cas échéant, au contrôle du juge. Dans le cas où est prise une décision de limiter ou d'arrêter un traitement de maintien en vie au titre du refus de l'obstination déraisonnable, cette décision est notifiée dans des conditions permettant à la personne de confiance ou, à défaut, à sa famille ou à ses proches, d'exercer un recours en temps utile. Ce recours est par ailleurs examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d'obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée.
16. Il résulte de ce qui précède que le législateur n'a méconnu ni le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ni la liberté personnelle. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
17. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté de conscience ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » figurant au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.
M. Mikaël H. [Mise en mouvement de l'action publique pour certains délits commis hors du territoire français]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 septembre 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1219 du 13 septembre 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Mikaël H. par la SAS Hannotin avocats, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1023 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 113-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code pénal ;
la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le requérant par la SAS Hannotin avocats, enregistrées le 5 octobre 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Guillaume Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 8 novembre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article
113-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1992
mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne
peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée
d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation
officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ».
2. Le requérant reproche à ces dispositions, en conférant au ministère public un monopole pour poursuivre certains délits commis à l'étranger à l'encontre d'un ressortissant français, de priver la victime de ces infractions de la faculté de mettre en mouvement l'action publique. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, faute pour la victime de pouvoir obtenir du juge civil la réparation de son préjudice en raison des difficultés à constituer la preuve de faits commis à l'étranger. Il en résulterait par ailleurs une méconnaissance du principe d'égalité devant la justice, dès lors que la faculté de mettre en mouvement l'action publique est ouverte aux victimes de délits commis sur le territoire français ainsi qu'aux ressortissants français victimes de crimes commis à l'étranger.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et 113-7 » figurant à la première phrase de l'article 113-8 du code pénal.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
5. En application de l'article 113-7 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout délit puni d'emprisonnement commis hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.
6. Les dispositions contestées, qui confèrent au ministère public le monopole de la poursuite de ces délits, font obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.
7. Toutefois, même en l'absence d'engagement de poursuites par le ministère public, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne privent la partie lésée de la possibilité d'obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits délictueux devant le juge civil.
8. Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.
10. En confiant au procureur de la République le monopole des poursuites à l'égard de certains délits commis à l'étranger, le législateur a entendu, en raison de la difficulté de mener des investigations à l'étranger, laisser à cette autorité le soin d'apprécier l'opportunité de poursuivre des infractions de cette gravité.
11. Ce faisant, les dispositions contestées n'instaurent de distinction injustifiée ni entre les victimes d'infractions commises à l'étranger selon le caractère délictuel ou criminel de l'infraction, ni entre les victimes de délits selon qu'ils ont été commis sur le territoire français ou à l'étranger.
12. En outre, les victimes françaises de délits commis à l'étranger peuvent obtenir réparation du dommage causé par ces délits devant le juge civil. Elles peuvent également, dans le cas où l'action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République, se constituer partie civile au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement. Leur sont ainsi assurées des garanties équivalentes pour la protection de leurs intérêts.
13. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté.
14. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « et 113-7 » figurant à la première phrase de l'article 113-8 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 novembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
M. Chams S. [Contestation de la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement ferme]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 septembre 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1241 du 14 septembre 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Chams S. par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1024 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de France par Me Amélie Morineau, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 4 octobre 2022 ;
les observations en intervention présentées pour l'association Avocats pour la défense des droits des détenus par Me Maud Guillemet, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, enregistrées le même jour ;
les observations présentées pour le requérant par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, enregistrées le 5 octobre 2022 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour M. Yann C. par Me Rosanna Lendom, avocate au barreau de Grasse, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour l'association des avocats pénalistes et l'association Section française de l'observatoire international des prisons par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations en intervention présentées pour le syndicat de la magistrature par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, enregistrées le même jour ;
les secondes observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 20 octobre 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Morineau, pour le syndicat des avocats de France, Me Guillemet, pour l'association Avocats pour la défense des droits des détenus, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association des avocats pénalistes et l'association Section française de l'observatoire international des prisons, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 8 novembre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article
710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22
décembre 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le
tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut
également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues
dans ses décisions. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du
comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa
personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
« En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications
et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour
d'assises.
« Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent
article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le
tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le
condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une
demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la
juridiction du lieu de détention.
« Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé
d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la
chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est
composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut
toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la
demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier
devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce
renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de
renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas
susceptible de recours ».
2. L'article
723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009
mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée
soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la
survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le
cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné, le
ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement
pénitentiaire.
« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci a
été saisi en application du deuxième alinéa de l'article 723-15 ».
3. Le requérant reproche à ces dispositions qui, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, permettent à la personne condamnée à une courte peine d'emprisonnement de contester la décision du ministère public de mettre à exécution cette peine, de n'imposer aucun délai à la juridiction saisie pour statuer sur sa contestation, de telle sorte qu'elle est susceptible de se prononcer après que la peine a été entièrement exécutée. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
4. Le requérant soutient également que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la justice en ce que, dans le cas où la décision de mise à exécution de la peine est motivée par la survenance de faits nouveaux, elles créeraient une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui contestent cette décision, selon que la juridiction saisie de cette contestation est ou non la même que celle devant laquelle les faits nouveaux sont poursuivis.
5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence » figurant au premier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale.
6. Les parties intervenantes sont fondées à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité dans la seule mesure où leur intervention porte sur ces mêmes mots. Elles soutiennent également que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d'égalité devant la justice.
7. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
8. En application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un an et qu'il ne s'oppose pas à un aménagement de cette peine, sans pour autant disposer des éléments lui permettant de déterminer lui-même la mesure d'aménagement adaptée, la personne condamnée est convoquée devant le juge de l'application des peines afin que ce dernier puisse déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
9. Par dérogation, l'article 723-16 du même code prévoit que le ministère public peut ordonner la mise à exécution de la peine d'emprisonnement en établissement pénitentiaire en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit par un risque avéré de fuite.
10. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la personne condamnée peut former un recours contre la décision du ministère public par la voie de l'incident contentieux relatif à l'exécution de la peine prévu par les dispositions contestées de l'article 710 du code de procédure pénale. Ces dispositions ne fixent aucun délai à la juridiction saisie pour rendre sa décision.
11. En premier lieu, d'une part, la juridiction saisie statue uniquement sur la décision de mettre à exécution, en urgence, une peine d'emprisonnement qui a été prononcée à titre définitif par un tribunal correctionnel. D'autre part, en l'absence de délai déterminé par la loi, une juridiction doit toujours statuer dans un délai raisonnable.
12. En second lieu, la personne condamnée dont la peine est mise à exécution peut saisir à tout moment le juge de l'application des peines aux fins notamment d'obtenir un aménagement de sa peine. Au demeurant, ce dernier peut également se saisir d'office en vue de se prononcer sur l'opportunité d'accorder une telle mesure, en particulier lorsqu'il est informé immédiatement par le ministère public de la mise à exécution de la peine.
13. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
14. Par ailleurs, les dispositions contestées, qui déterminent la juridiction compétente pour statuer sur la contestation de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement, n'instituent par elles-mêmes aucune différence de traitement entre les personnes condamnées. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit donc être écarté.
15. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence » figurant au premier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 novembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Conseil national de l'ordre des médecins [Dispositif de non-concurrence applicable à certains praticiens exerçant dans un établissement public de santé]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 septembre 2022 par le Conseil d'État (décisions nos 462977 et 462978 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour le Conseil national de l'ordre des médecins par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2022-1027 QPC et 2022-1028 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour la première, du paragraphe II et, pour la seconde, du paragraphe I de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de la santé publique ;
l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 19 octobre 2022 ;
les secondes observations présentées pour le Conseil national de l'ordre des médecins par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, enregistrées le 3 novembre 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Louis Poupot, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 29 novembre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. L'article
L. 6152-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de
l'ordonnance du 17 mars 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I. - Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement
public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être
interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à
l'article L. 6151-1, au 1 ° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2 °
du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de
50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but
lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une
officine de pharmacie.
« Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs
des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis
de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions
de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas
échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire.
« L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut
s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de
l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier
alinéa du I du présent article exercent à titre principal.
« En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les
praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le
montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération
mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
« Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le
respect du contradictoire, le directeur de l'établissement notifie au praticien
la décision motivée fixant le montant de l'indemnité due calculé sur la base de
la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois
d'activité.
« II. - Les praticiens mentionnés au 1 ° de l'article L. 6152-1 exerçant à temps
partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en
concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils
exercent à titre principal dans le cadre d'une activité rémunérée dans un
établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire
de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
« La décision d'exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une
interdiction d'exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix
kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel il exerce à
titre principal.
« Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le
respect du contradictoire, il est mis fin à l'autorisation d'exercer à temps
partiel.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'État ».
3. Le requérant reproche tout d'abord à ces dispositions de prévoir que l'exercice d'une activité rémunérée dans le secteur privé peut être interdit à certains praticiens des établissements publics de santé. Selon lui, une telle interdiction, qui ne tiendrait pas compte des besoins de la population en matière de santé, serait excessive au regard de son périmètre, de sa durée d'application et de la sévérité des sanctions encourues en cas d'inobservation. Elle porterait ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
4. Le requérant fait ensuite grief à ces dispositions de ne pas déterminer les cas et les conditions dans lesquels cette interdiction peut être mise en œuvre. Ce faisant, le législateur aurait méconnu, d'une part, l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre et, d'autre part, le principe de légalité des délits et des peines.
5. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
6. L'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique prévoit qu'il peut être interdit à certains praticiens d'un établissement public de santé d'exercer, dans un périmètre déterminé, une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
7. En application du paragraphe I de cet article, cette interdiction est susceptible de s'appliquer aux membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires ainsi qu'aux médecins, odontologistes et pharmaciens titulaires ou contractuels dont la quotité de travail était au minimum de 50 %, lorsqu'ils quittent l'établissement public au sein duquel ils exerçaient à titre principal. En cas d'inobservation de cette interdiction, une indemnité, dont le montant ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité, est due pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée.
8. Son paragraphe II prévoit qu'une telle interdiction peut également s'appliquer aux médecins, odontologistes et pharmaciens titulaires lorsqu'ils exercent à temps partiel au sein de l'établissement public de santé. En cas d'inobservation de cette interdiction, il est mis fin à l'autorisation d'exercer à temps partiel.
9. En premier lieu, les dispositions contestées ont pour objet de réguler l'installation de praticiens à proximité des établissements publics de santé afin de préserver l'activité de ces établissements qui, en application de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, assurent le service public hospitalier. Le législateur a ainsi entendu garantir le bon fonctionnement de ce service public qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
10. En second lieu, d'une part, l'interdiction d'exercice prévue par les dispositions contestées ne peut être décidée, sous le contrôle du juge, que dans les cas où les praticiens concernés sont susceptibles d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé, en raison de leur profession ou de leur spécialité et, le cas échéant, de la situation de cet établissement. Ces conditions ne sont ni imprécises ni équivoques.
11. D'autre part, cette interdiction ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé et, lorsqu'elle concerne un praticien qui cesse d'exercer ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
12. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.
13. Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, qui est au demeurant inopérant s'agissant des dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique dès lors qu'elles n'instituent aucune sanction ayant le caractère d'une punition.
14. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - L'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
M. Sami C. [Clause statutaire d'exclusion d'un associé d'une société par actions simplifiée]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 octobre 2022 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 699 du 12 octobre 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Sami C. par Me Olivier Dillenschneider, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1029 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 227-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, et du second alinéa de l'article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction résultant la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code civil ;
le code de commerce ;
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;
la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour le requérant par Me Dillenschneider, enregistrées le 25 octobre 2022 ;
les observations présentées pour la société LT Capital et autres, parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 26 octobre 2022 ;
les secondes observations présentées pour la société LT Capital et autres par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 9 novembre 2022 ;
les secondes observations présentées pour le requérant par Me Dillenschneider, enregistrées le 10 novembre 2022 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Dillenschneider, pour le requérant, Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la société LT Capital et autres, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 29 novembre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le premier alinéa de l'article L. 227-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions ».
2. Le second alinéa de l'article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 juillet 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ».
3. Le requérant reproche à ces dispositions de permettre qu'un associé soit tenu de céder ses actions en application d'une clause statutaire d'exclusion à laquelle il n'aurait pas consenti. Selon lui, la privation de propriété qui en résulterait pour l'associé exclu ne serait pas justifiée par une nécessité publique légalement constatée, en méconnaissance des exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En tout état de cause, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'associé, garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article L. 227-16 du code de commerce et sur les mots « et L. 227-16 » figurant au second alinéa de l'article L. 227-19 du même code.
5. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
6. Les articles L. 227-13 à L. 227-19 du code de commerce sont relatifs aux clauses statutaires d'une société par actions simplifiée fixant les conditions d'acquisition ou de cession de ses actions par les associés. En application des dispositions contestées de l'article L. 227-16 du même code, les statuts de la société peuvent prévoir que, dans certaines conditions, un associé peut être tenu de céder ses actions. Selon les dispositions contestées du second alinéa de l'article L. 227-19 de ce code, une telle clause statutaire d'exclusion peut être adoptée ou modifiée sans recueillir l'unanimité des associés. Il en résulte qu'un associé peut se voir exclu de la société et contraint de céder ses actions, le cas échéant, en application d'une clause d'exclusion à laquelle il n'aurait pas consenti.
7. En premier lieu, ces dispositions ont pour seul objet de permettre à une société par actions simplifiée d'exclure un associé en application d'une clause statutaire. S'il en résulte qu'un associé peut être contraint de céder ses actions, elles n'entraînent donc pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
8. En deuxième lieu, en permettant à une société par actions simplifiée de contraindre un associé à céder ses actions, le législateur a entendu garantir la cohésion de son actionnariat et assurer ainsi la poursuite de son activité. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 2019 que, en prévoyant que l'adoption ou la modification d'une clause d'exclusion puisse être décidée sans recueillir l'unanimité des associés, il a également entendu éviter les situations de blocage pouvant résulter de l'opposition de l'associé concerné à une telle clause. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
9. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la décision d'exclure un associé ne peut être prise qu'à la suite d'une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un motif, stipulé par ces statuts, conforme à l'intérêt social et à l'ordre public, et ne pas être abusive.
10. En quatrième lieu, l'exclusion de l'associé donne lieu au rachat de ses actions à un prix de cession fixé, selon l'article L. 227-18 du code de commerce, en application de modalités prévues par les statuts de la société, ou, à défaut, soit par un accord entre les parties, soit par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
11. En dernier lieu, la décision d'exclusion peut être contestée par l'associé devant le juge, auquel il revient alors de s'assurer de la réalité et de la gravité du motif retenu. L'associé peut également contester le prix de cession de ses actions.
12. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
13. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le premier alinéa de l'article L. 227-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, et les mots « et L. 227-16 » figurant au second alinéa de l'article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.