NIQAB BURQA BURKA BOURKA BURKINI
"La liberté religieuse se heurte aux principes de laïcité de
la France"
Frédéric Fabre docteur en droit.
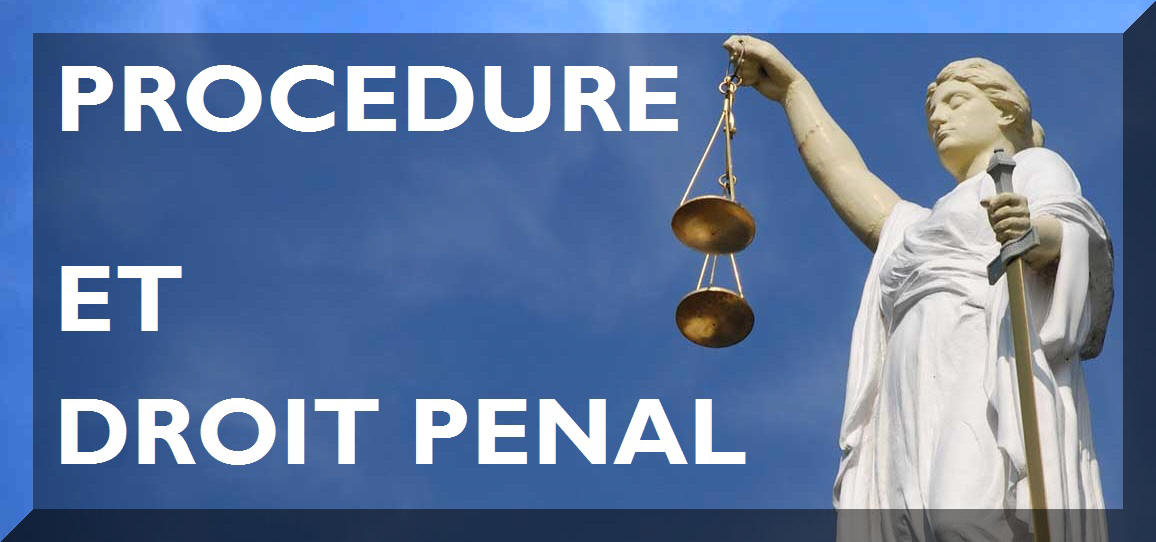 Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites sur :
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites sur :
- la circulaire du 2 mars 2011 sur l'application de la loi
- la décision du Conseil Constitutionnel du 7 octobre 2010
- l'arrêt de la Grande Chambre de la CEDH du 1er juillet 2014 et ses suites
- Les deux arrêts de la Grande Chambre de la CJUE du 14 mars 2017
- la jurisprudence de la cour de cassation
- la jurisprudence du Conseil d'État sur le burkini.
- les deux constatations du CDH pour violation de la liberté religieuse
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
LA CIRCULAIRE DU 2 MARS 2011 DÉTERMINE L'APPLICATION DE LA LOI
La loi sur la Burka a été publiée au Journal officiel du 12 octobre 2010. Elle est applicable depuis le 11 AVRIL 2011. Elle interdit le port de la bourka et de toute dissimulation du visage sur les voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.
Des exceptions sont prévues si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.
Le Conseil constitutionnel a ajouté une autre exception:
"L'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public"
Par conséquent, la loi contre la dissimulation du visage sera d'une application très restreinte puisque les juridictions devront accepter beaucoup d'exceptions.
La Circulaire du 2 mars 2011 est relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.
LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010
interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
Article 2
I. ― Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué
des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un
service public.
II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue
est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou
réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des
motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques
sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.
Article 3
La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
L'obligation d'accomplir le stage de citoyenneté mentionné au
8° de l'article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même temps
ou à la place de la peine d'amende.
Article 4
Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter
« De la dissimulation forcée du visage
« Art. 225-4-10. - Le fait pour toute personne d'imposer à une ou
plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence,
contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe,
est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont
portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende. »
Article 5
Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 6
La présente loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 7
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la
présente loi dix-huit mois après sa promulgation. Ce rapport dresse un
bilan de la mise en œuvre de la présente loi, des mesures d'accompagnement
élaborées par les pouvoirs publics et des difficultés rencontrées.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 11 octobre 2010.
Décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010
LOI INTERDISANT LA DISSIMULATION DU VISAGE DANS L'ESPACE PUBLIC
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 septembre 2010, par le
président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, dans les
conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de
la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le président de l'Assemblée nationale et le président
du Sénat défèrent au Conseil constitutionnel la loi interdisant la
dissimulation du visage dans l'espace public ; qu'ils n'invoquent à
l'encontre de ce texte aucun grief particulier ;
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée dispose : « Nul ne
peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son
visage » ; que l'article 2 de la même loi précise : « I. Pour
l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies
publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service
public. ― II. L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si
la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou
réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des
motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques
sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles »
; que son article 3 prévoit que la méconnaissance de l'interdiction fixée
à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels
de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres
de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent
être déterminées que par la loi » ; qu'aux termes de son article 5 : « La
loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout
ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut
être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ; qu'aux termes de son
article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi » ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946 : « La loi garantit à la femme, dans
tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » ;
4. Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet
de répondre à l'apparition de pratiques, jusqu'alors exceptionnelles,
consistant à dissimuler son visage dans l'espace public ; que le
législateur a estimé que de telles pratiques peuvent constituer un danger
pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la
vie en société ; qu'il a également estimé que les femmes dissimulant leur
visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation
d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes
constitutionnels de liberté et d'égalité ; qu'en adoptant les dispositions
déférées, le législateur a ainsi complété et généralisé des règles
jusque-là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection
de l'ordre public ;
5. Considérant qu'eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte
tenu de la nature de la peine instituée en cas de méconnaissance de la
règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui
assurent, entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits
constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est pas
manifestement disproportionnée ; que, toutefois, l'interdiction de
dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une
atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre
l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au
public ; que, sous cette réserve, les articles 1er à 3 de la loi déférée
ne sont pas contraires à la Constitution ;
6. Considérant que l'article 4 de la loi déférée, qui punit d'un an
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'imposer à autrui de
dissimuler son visage, et ses articles 5 à 7, relatifs à son entrée en
vigueur et à son application, ne sont pas contraires à la Constitution,
Décide :
Article 1
Sous la réserve énoncée au considérant 5, la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public est conforme à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 octobre 2010,
où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme
Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC,
Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.
DECLARE LA LOI CONFORME A LA CONVENTION
SAS Contre France du 1er Juillet 2014 requête 43835/11
Non violation de l'article 8, 9 et 14 de la Convention. La loi française sur l'interdiction de porter sur la voie publique une tenue destinée à dissimuler son visage, n'est pas une violation de la Convention. L’interdiction que pose la loi du 11 octobre 2010 peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation des conditions du « vivre ensemble » en tant qu’élément de la « protection des droits et libertés d’autrui ». L'Islam n'impose pas le port de la burka. L'auteur du site s'étonne des justificatifs prétendument "religieux" du port de la Burka. Il est expliqué que l'homme serait une bête sauvage qui sauterait sur toutes les pauvres femmes. Il ne résisterait pas à leur charme. L'auteur ne se sent pas une bête sauvage. Il ne pense pas que les mâles français en leur très grande majorité, se comportent comme des bêtes sauvages. Le port de la burka n'est pas seulement un outil pour soumettre et humilier les femmes. C'est aussi une insulte intolérable contre les hommes.
CEDH
a) Sur la violation alléguée des articles 8 et 9 de la Convention
106. L’interdiction de porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage pose des questions au regard du droit au respect de la vie privée (article 8 de la Convention) des femmes qui souhaitent porter le voile intégral pour des raisons tenant de leurs convictions, ainsi qu’au regard de leur liberté de manifester celles-ci (article 9 de la Convention).
107. La Cour estime en effet que les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir, dans l’espace public comme en privé, relèvent de l’expression de la personnalité de chacun et donc de la vie privée. Elle en a déjà jugé ainsi s’agissant du choix de la coiffure (Popa c. Roumanie (déc.), no 4233/09, 18 juin 2013, §§ 32-33 ; voir aussi la décision de la Commission européenne des droits de l’homme dans l’affaire Sutter c. Suisse, no 8209/78 du 1er mars 1979). Elle estime, à l’instar de la Commission (voir, en particulier, les décisions McFeeley et autres c. Royaume-Uni, no 8317/78, 15 mai 1980, § 83, Décisions et rapports (DR) 20 et Kara c. Royaume-Uni, no 36528/97, 22 octobre 1998), qu’il en va de même du choix des vêtements. Une mesure émanant d’une autorité publique limitative d’un choix de ce type est donc en principe constitutive d’une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention (voir la décision Kara précitée). Il en résulte que l’interdiction de porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage qu’édicte la loi du 11 octobre 2010 relève de l’article 8 de la Convention.
108. Ceci étant dit, pour autant que cette interdiction est mise en cause par des personnes qui, telles la requérante, se plaignent d’être en conséquence empêchées de porter dans l’espace public une tenue que leur pratique d’une religion leur dicte de revêtir, elle soulève avant tout un problème au regard de la liberté de chacun de manifester sa religion ou ses convictions (voir, en particulier, Ahmet Arslan et autres c. Turquie, no 41135/98, § 35, 23 février 2010). La circonstance que cette pratique est minoritaire et apparaît contestée (paragraphes 56 et 85 ci-dessus) est sans pertinence à cet égard.
109. La Cour examinera donc cette partie de la requête sous l’angle de l’article 8 et de l’article 9, mais en mettant l’accent sur la seconde de ces dispositions.
i. Sur l’existence d’une « restriction » ou d’une « ingérence »
110. Comme la Cour l’a souligné précédemment (paragraphe 57 ci‑dessus), la loi du 11 octobre 2010 met la requérante devant un dilemme comparable à celui qu’elle avait identifié dans les arrêts Dudgeon et Norris : soit elle se plie à l’interdiction et renonce ainsi à se vêtir conformément au choix que lui dicte son approche de sa religion ; soit elle ne s’y plie pas et s’expose à des sanctions pénales. Elle se trouve ainsi, au regard de l’article 9 de la Convention comme de l’article 8, dans une situation similaire à celle des requérants Dudgeon et Norris, dans le cas desquels la Cour a constaté une « ingérence permanente » dans l’exercice des droits garantis par la seconde de ces dispositions (arrêts précités, §§ 41 et 38 respectivement ; voir aussi, notamment, Michaud, précité, § 92). Il y a donc en l’espèce une « ingérence » ou une « restriction » dans l’exercice des droits protégés par les articles 8 et 9 de la Convention.
111. Pour être compatibles avec les seconds paragraphes de ces dispositions, pareilles restriction ou ingérence doivent être « prévue[s] par la loi », inspirées par un ou plusieurs des buts légitimes qu’ils énumèrent et « nécessaire[s] », « dans une société démocratique », à la poursuite de ce ou ces buts.
ii. « Prévue par la loi »
112. La Cour constate que la restriction dont il s’agit est prévue par les articles 1, 2 et 3 de la loi du 11 octobre 2010 (paragraphe 28 ci-dessus). Elle relève en outre que la requérante ne conteste pas que ces dispositions remplissent les critères établis par la jurisprudence de la Cour relative aux articles 8 § 2 et 9 § 2 de la Convention.
iii. But légitime
113. La Cour rappelle que l’énumération des exceptions à la liberté de chacun de manifester sa religion ou ses convictions qui figure dans le second paragraphe de l’article 9 est exhaustive et que la définition de ces exceptions est restrictive (voir, notamment, Svyato-Mykhaylivska Parafiya c. Ukraine, no 77703/01, § 132, 14 juin 2007, et Nolan et K. c. Russie, no 2512/04, § 73, 12 février 2009). Pour être compatible avec la Convention, une restriction à cette liberté doit notamment être inspirée par un but susceptible d’être rattaché à l’un de ceux que cette disposition énumère. La même approche s’impose sur le terrain de l’article 8 de la Convention.
114. La pratique de la Cour est d’être plutôt succincte lorsqu’elle vérifie l’existence d’un but légitime, au sens des seconds paragraphes des articles 8 à 11 de la Convention (voir, par exemple, précités, Leyla Şahin, § 99, et Ahmet Arslan et autres, § 43). Toutefois, en l’espèce, la teneur des objectifs invoqués à ce titre par le Gouvernement et fortement contestés par la requérante, commande un examen approfondi. La requérante estime en effet que l’immixtion dans l’exercice de la liberté de manifester sa religion et du droit au respect de la vie privée qu’elle subit en raison de l’interdiction que pose la loi du 11 octobre 2010 ne répond à aucun des buts énumérés au second paragraphe des articles 8 et 9. Le Gouvernement soutient pour sa part qu’elle vise deux objectifs légitimes : la sécurité publique et « le respect du socle minimal des valeurs d’une société démocratique et ouverte ». Or la Cour constate que le second paragraphe des articles 8 et 9 ne renvoie explicitement ni au second de ces buts ni aux trois valeurs auxquelles le Gouvernement se réfère à cet égard.
115. S’agissant du premier des buts invoqués par le Gouvernement, la Cour observe tout d’abord que la « sécurité publique » fait partie des buts énumérés par le second paragraphe de l’article 9 de la Convention (public safety dans le texte anglais de cette disposition) et que le second paragraphe de l’article 8 renvoie à la notion similaire de « sûreté publique » (public safety également dans le texte en anglais de cette disposition). Elle note ensuite que le Gouvernement fait valoir à ce titre que l’interdiction litigieuse de porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage répond à la nécessité d’identifier les individus afin de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et de lutter contre la fraude identitaire. Au vu du dossier, on peut certes se demander si le législateur a accordé un poids significatif à de telles préoccupations. Il faut toutefois constater que l’exposé des motifs qui accompagnait le projet de loi indiquait – surabondamment certes – que la pratique de la dissimulation du visage « [pouvait] être dans certaines circonstances un danger pour la sécurité publique » (paragraphe 25 ci-dessus), et que le Conseil constitutionnel a retenu que le législateur avait estimé que cette pratique pouvait constituer un danger pour la sécurité publique (paragraphe 30 ci-dessus). Similairement, dans son rapport d’étude du 25 mars 2010, le Conseil d’État a indiqué que la sécurité publique pouvait constituer un fondement pour une interdiction de la dissimulation du visage, en précisant cependant qu’il ne pouvait en aller ainsi que dans des circonstances particulières (paragraphes 22-23 ci-dessus). En conséquence, la Cour admet qu’en adoptant l’interdiction litigieuse, le législateur entendait répondre à des questions de « sûreté publique » ou de « sécurité publique », au sens du second paragraphe des articles 8 et 9 de la Convention.
116. À propos du second des objectifs invoqués – « le respect du socle minimal des valeurs d’une société démocratique et ouverte » – le Gouvernement renvoie à trois valeurs : le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect de la dignité des personnes et le respect des exigences minimales de la vie en société. Il estime que cette finalité se rattache à la « protection des droits et libertés d’autrui », au sens du second paragraphe des articles 8 et 9 de la Convention.
117. Comme la Cour l’a relevé précédemment, aucune de ces trois valeurs ne correspond explicitement aux buts légitimes énumérés au second paragraphe des articles 8 et 9 de la Convention. Parmi ceux-ci, les seuls susceptibles d’être pertinents en l’espèce, au regard de ces valeurs, sont l’« ordre public » et la « protection des droits et libertés d’autrui ». Le premier n’est cependant pas mentionné par l’article 8 § 2. Le Gouvernement n’y a du reste fait référence ni dans ses observations écrites ni dans sa réponse à la question qui lui a été posée à ce propos lors de l’audience, évoquant uniquement la « protection des droits et libertés d’autrui ». La Cour va donc concentrer son examen sur ce dernier « but légitime », comme d’ailleurs elle l’avait fait dans les affaires Leyla Şahin, et Ahmet Arslan et autres (précitées, §§ 111 et 43 respectivement).
118. En premier lieu, elle n’est pas convaincue par l’assertion du Gouvernement pour autant qu’elle concerne le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes.
119. Elle ne doute pas que l’égalité entre les hommes et les femmes puisse à bon droit motiver une ingérence dans l’exercice de certains des droits et libertés que consacre la Convention (voir, mutatis mutandis, Staatkundig Gereformeerde Partij c. Pays-Bas (déc.), 10 juillet 2012). Elle rappelle à cet égard que la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des États membres du Conseil de l’Europe (ibidem ; voir aussi, notamment, Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, § 67, série A no 263, et Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 127, CEDH 2012 (extraits)). Ainsi, un État partie qui, au nom de l’égalité des sexes, interdit à quiconque d’imposer aux femmes qu’elles dissimulent leur visage, poursuit un objectif qui correspond à la « protection des droits et libertés d’autrui », au sens du paragraphe 2 des articles 8 et 9 de la Convention (voir Leyla Şahin, précité, § 111). La Cour estime en revanche qu’un État partie ne saurait invoquer l’égalité des sexes pour interdire une pratique que des femmes – telle la requérante – revendiquent dans le cadre de l’exercice des droits que consacrent ces dispositions, sauf à admettre que l’on puisse à ce titre prétendre protéger des individus contre l’exercice de leurs propres droits et libertés fondamentaux. Elle observe d’ailleurs que, dans son rapport d’étude du 25 mars 2010, le Conseil d’État est parvenu à une conclusion similaire (paragraphe 22 ci-dessus).
Par ailleurs, pour autant que le Gouvernement entende ainsi faire valoir que le port du voile intégral par certaines femmes choque la majorité de la population française parce qu’il heurte le principe d’égalité des sexes tel qu’il est généralement admis en France, la Cour renvoie aux motifs relatifs aux deux autres valeurs qu’il invoque (paragraphes 120-122 ci-dessous).
120. En deuxième lieu, la Cour considère que, aussi essentiel soit-il, le respect de la dignité des personnes ne peut légitimement motiver l’interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public. La Cour est consciente de ce que le vêtement en cause est perçu comme étrange par beaucoup de ceux qui l’observent. Elle souligne toutefois que, dans sa différence, il est l’expression d’une identité culturelle qui contribue au pluralisme dont la démocratie se nourrit. Elle observe, à ce titre, la variabilité des conceptions de la vertu et de la décence appliquées au dévoilement des corps. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun élément susceptible de conduire à considérer que les femmes qui portent le voile intégral entendent exprimer une forme de mépris à l’égard de ceux qu’elles croisent ou porter autrement atteinte à la dignité d’autrui.
121. En troisième lieu, la Cour estime en revanche que, dans certaines conditions, ce que le Gouvernement qualifie de « respect des exigences minimales de la vie en société » – le « vivre ensemble », dans l’exposé des motifs du projet de loi (paragraphe 25 ci-dessus) – peut se rattacher au but légitime que constitue la « protection des droits et libertés d’autrui ».
122. La Cour prend en compte le fait que l’État défendeur considère que le visage joue un rôle important dans l’interaction sociale. Elle peut comprendre le point de vue selon lequel les personnes qui se trouvent dans les lieux ouverts à tous souhaitent que ne s’y développent pas des pratiques ou des attitudes mettant fondamentalement en cause la possibilité de relations interpersonnelles ouvertes qui, en vertu d’un consensus établi, est un élément indispensable à la vie collective au sein de la société considérée. La Cour peut donc admettre que la clôture qu’oppose aux autres le voile cachant le visage soit perçue par l’État défendeur comme portant atteinte au droit d’autrui d’évoluer dans un espace de sociabilité facilitant la vie ensemble. Cela étant, la flexibilité de la notion de « vivre ensemble » et le risque d’excès qui en découle commandent que la Cour procède à un examen attentif de la nécessité de la restriction contestée.
iv. Nécessité dans une société démocratique
α. Principes généraux relatifs à l’article 9 de la Convention
123. La Cour ayant décidé de mettre l’accent sur l’article 9 de la Convention dans son examen de cette partie de la requête, elle juge utile de rappeler les principes généraux relatifs à cette disposition.
124. Telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (voir, entre autres, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 31, série A no 260-A, Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 34, CEDH 1999-I, et Leyla Şahin, précité, § 104).
125. Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (voir, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 73, CEDH 2000-VII, et Leyla Şahin précité, § 105).
L’article 9 ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d’une manière dictée ou inspirée par sa religion ou ses convictions (voir, par exemple, Arrowsmith c. Royaume-Uni, no 7050/75, rapport de la Commission du 12 octobre 1978, DR 19, Kalaç c. Turquie, 1er juillet 1997, § 27, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, et Leyla Şahin, précité, §§ 105 et 121).
126. Dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (Kokkinakis, précité, § 33). Cela découle à la fois du paragraphe 2 de l’article 9 et des obligations positives qui incombent à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention (Leyla Şahin, précité, § 106).
127. La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de l’État en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Comme indiqué précédemment, elle estime aussi que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci (voir, notamment, Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 47, Recueil 1996-IV, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 78, CEDH 2000-XI, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 91, CEDH 2003-II), et considère que ce devoir impose à l’État de s’assurer que des groupes opposés se tolèrent (voir, notamment, Leyla Şahin, précité, § 107). Elle en a déduit que le rôle des autorités dans ce cas n’est pas de supprimer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent (Serif c. Grèce, no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX ; voir aussi Leyla Şahin, précité, § 107).
128. Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une « société démocratique ». Bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui évite tout abus d’une position dominante (voir, mutatis mutandis, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 63, série A no 44, et Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 112, CEDH 1999-III). Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Parti communiste unifié de Turquie et autres, précité, § 45, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, § 99). Si les « droits et libertés d’autrui » figurent eux-mêmes parmi ceux garantis par la Convention ou ses Protocoles, il faut admettre que la nécessité de les protéger puisse conduire les États à restreindre d’autres droits ou libertés également consacrés par la Convention : c’est précisément cette constante recherche d’un équilibre entre les droits fondamentaux de chacun qui constitue le fondement d’une « société démocratique » (Chassagnou et autres, précité, § 113 ; voir aussi Leyla Şahin, précité, § 108).
129. Il faut également rappeler le rôle fondamentalement subsidiaire du mécanisme de la Convention. Les autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe et, ainsi que la Cour l’a affirmé à maintes reprises, se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux. Lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national (voir par exemple, Maurice c. France [GC], no 11810/03, § 117, CEDH 2005‑IX). Il en va en particulier ainsi lorsque ces questions concernent les rapports entre l’État et les religions (voir, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek, précité, § 84, et Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil 1996-V ; voir aussi Leyla Şahin, précité, § 109). S’agissant de l’article 9 de la Convention, il convient alors, en principe, de reconnaître à l’État une ample marge d’appréciation pour décider si et dans quelle mesure une restriction au droit de manifester sa religion ou ses convictions est « nécessaire ». Cela étant, pour déterminer l’ampleur de la marge d’appréciation dans une affaire donnée, la Cour doit également tenir compte de l’enjeu propre à l’espèce (voir, notamment, Manoussakis et autres, précité, § 44, et Leyla Şahin, précité, § 110). Elle peut aussi, le cas échéant, prendre en considération le consensus et les valeurs communes qui se dégagent de la pratique des États parties à la Convention (voir, par exemple, Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 122, CEDH 2011).
130. Dans l’affaire Leyla Şahin, la Cour a souligné que tel était notamment le cas lorsqu’il s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement, d’autant plus au vu de la diversité des approches nationales quant à cette question. Renvoyant à l’arrêt Otto-Preminger-Institut c. Autriche (20 septembre 1994, § 50, série A no 295-A) et à la décision Dahlab c. Suisse (no 42393/98, CEDH 2001-V), elle a précisé qu’il n’était en effet pas possible de discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société et que le sens ou l’impact des actes correspondant à l’expression publique d’une conviction religieuse n’étaient pas les mêmes suivant les époques et les contextes. Elle a observé que la réglementation en la matière pouvait varier par conséquent d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public. Elle en a déduit que le choix quant à l’étendue et aux modalités d’une telle réglementation devait, par la force des choses, être dans une certaine mesure laissé à l’État concerné, puisqu’il dépend du contexte national considéré (Leyla Şahin, précité, § 109).
131. Cette marge d’appréciation va toutefois de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées (voir, notamment, Manoussakis et autres, précité, § 44, et Leyla Şahin, précité, § 110).
β. Application de ces principes dans des affaires antérieures
132. La Cour a eu l’occasion d’examiner plusieurs situations à l’aune de ces principes.
133. Elle s’est ainsi prononcée sur l’interdiction de porter des signes religieux dans les établissements d’enseignement public prescrite aux enseignants (voir, notamment, Dahlab, décision précitée, et Kurtulmuş c. Turquie (déc.), no 65500/01, CEDH 2006-II) ou aux élèves et étudiantes (voir, notamment, Leyla Şahin, arrêt précité, Köse et autres c. Turquie (déc.), no 26625/02, CEDH 2006-II, Kervanci c. France, no 31645/04, 4 décembre 2008, Aktas c. France (déc.), no 43563/08, 30 juin 2009, et Ranjit Singh c. France (déc.), no 27561/08, 30 juin 2009), sur l’obligation de retirer un élément vestimentaire connoté religieusement dans le cadre d’un contrôle de sécurité (Phull c. France (déc.), no 35753/03, CEDH 2005‑I, et El Morsli c. France (déc.), no 15585/06, 4 mars 2008), et sur l’obligation d’apparaître tête nue sur les photos d’identité destinées à des documents officiels (Mann Singh c. France (déc.), no 24479/07, 11 juin 2007). Elle n’a conclu à la violation de l’article 9 dans aucun de ces cas.
134. La Cour a aussi examiné deux requêtes dans lesquelles des personnes se plaignaient en particulier de restrictions par leurs employeurs à la possibilité de porter une croix au cou de manière visible, et soutenaient que le droit national n’avait pas adéquatement protégé leur droit de manifester leur religion. L’une était employée d’une compagnie aérienne, l’autre était infirmière (Eweida et autres, précité). Le premier cas, dans lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 9, est le plus pertinent en l’espèce. La Cour a notamment estimé que les juridictions internes avaient donné trop d’importance au – légitime – souhait de l’employeur de projeter une certaine image commerciale par rapport au droit fondamental de la requérante de manifester ses convictions religieuses. Sur ce dernier point, elle a souligné qu’une société démocratique saine devait tolérer et soutenir le pluralisme et la diversité, et qu’il est important qu’une personne qui a fait de la religion un axe majeur de sa vie puisse être en mesure de communiquer ses convictions à autrui. Elle a ensuite relevé que la croix dont il était question était discrète et ne pouvait pas avoir affecté l’apparence professionnelle de la requérante et qu’il n’était pas démontré que le port autrefois autorisé de signes religieux avait eu un impact négatif sur l’image de la compagnie aérienne qui employait celle-ci. Tout en soulignant que les autorités nationales – les juridictions en particulier – disposent d’une marge d’appréciation lorsqu’elles sont amenées à évaluer la proportionnalité de mesures prises par une société privée à l’égard de ses employés, elle a donc conclu qu’il y avait eu violation de l’article 9.
135. La Cour s’est également penchée, dans l’affaire Ahmet Arslan et autres précitée, sur la question de l’interdiction de porter, en dehors des cérémonies religieuses, certaines tenues religieuses dans les lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques. La tenue en question, caractéristique du groupe Aczimendi tarikati, était composée d’un turban, d’un saroual et d’une tunique, tous de couleur noire, et était assortie d’un bâton. La Cour a admis, eu égard aux circonstances de la cause et aux termes des décisions des juridictions internes, et compte tenu notamment de l’importance du principe de laïcité pour le système démocratique en Turquie, que, dans la mesure où elle visait à faire respecter les principes laïcs et démocratiques, cette ingérence poursuivait plusieurs des buts légitimes énumérés à l’article 9 § 2 : le maintien de la sécurité publique, la protection de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui. Elle a cependant jugé que sa nécessité au regard de ces buts n’était pas établie.
La Cour a en effet relevé que l’interdiction frappait non des fonctionnaires astreints à une certaine discrétion dans l’exercice de leurs fonctions, mais de simples citoyens, de sorte que sa jurisprudence relative aux fonctionnaires – aux enseignants en particulier – ne trouvait pas à s’appliquer. Elle a constaté ensuite qu’elle visait la tenue portée non dans des établissements publics spécifiques, mais dans tout l’espace publique, de sorte que sa jurisprudence mettant l’accent sur l’importance particulière du rôle du décideur national quant à l’interdiction du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement publics ne trouvait pas non plus à s’appliquer. La Cour a de plus observé qu’il ne ressortait pas du dossier que la façon dont les requérants – qui s’étaient réunis devant une mosquée dans la tenue en cause, dans le seul but de participer à une cérémonie à caractère religieux – avaient manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l’ordre public ou une pression sur autrui. Enfin, répondant à la thèse du Gouvernement turc tirée d’un éventuel prosélytisme de la part des requérants, elle a constaté qu’aucun élément du dossier ne montrait qu’ils avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses. La Cour a en conséquence conclu à la violation de l’article 9 de la Convention.
136. Parmi toutes ces affaires relatives à l’article 9, l’affaire Ahmet Arslan et autres est celle dont se rapproche le plus la présente espèce. Cependant, si les deux affaires concernent l’interdiction de porter un habit à connotation religieuse dans l’espace public, la présente affaire se distingue significativement de l’affaire Ahmet Arslan et autres par le fait que le voile islamique intégral est un habit particulier en ce qu’il dissimule entièrement le visage à l’exception éventuellement des yeux.
γ. Application de ces principes au cas d’espèce
137. La Cour souligne en premier lieu que la thèse de la requérante et de certains des intervenants selon laquelle l’interdiction que posent les articles 1 à 3 de la loi du 11 octobre 2010 serait fondée sur le postulat erronée que les femmes concernées porteraient le voile intégral sous la contrainte n’est pas pertinente. Il ressort en effet clairement de l’exposé des motifs qui accompagnait le projet de loi (paragraphe 25 ci-dessus) que cette interdiction n’a pas pour objectif principal de protéger des femmes contre une pratique qui leur serait imposée ou qui leur serait préjudiciable.
138. Cela étant précisé, la Cour doit vérifier si l’ingérence litigieuse est « nécessaire », « dans une société démocratique » à la sûreté publique ou la sécurité publique (au sens des articles 8 et 9 de la Convention ; voir le paragraphe 115 ci-dessus), ou à la « protection des droits et libertés d’autrui » (voir le paragraphe 116 ci-dessus).
139. S’agissant de la nécessité au regard de la sûreté ou de la sécurité publiques, au sens des articles 8 et 9 (voir le paragraphe 115 ci-dessus), la Cour comprend qu’un État juge essentiel de pouvoir identifier les individus afin de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et de lutter contre la fraude identitaire. Elle a d’ailleurs conclu à la non violation de l’article 9 de la Convention dans des affaires relatives à l’obligation de retirer un élément vestimentaire connoté religieusement dans le cadre d’un contrôle de sécurité et à l’obligation d’apparaître tête nue sur les photos d’identité destinées à des documents officiels (paragraphe 133 ci-dessus). Cependant, vu son impact sur les droits des femmes qui souhaitent porter le voile intégral pour des raisons religieuses, une interdiction absolue de porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage ne peut passer pour proportionnée qu’en présence d’un contexte révélant une menace générale contre la sécurité publique. Or le Gouvernement ne démontre pas que l’interdiction que pose la loi du 11 octobre 2010 s’inscrit dans un tel contexte. Quant aux femmes concernées, elle se trouvent obligées de renoncer totalement à un élément de leur identité qu’elles jugent important ainsi qu’à la manière de manifester leur religion ou leurs convictions qu’elles ont choisi, alors que l’objectif évoqué par le Gouvernement serait atteint par une simple obligation de montrer leur visage et de s’identifier lorsqu’un risque pour la sécurité des personnes et des biens est caractérisé ou que des circonstances particulières conduisent à soupçonner une fraude identitaire. Ainsi, on ne saurait retenir que l’interdiction générale que pose la loi du 11 octobre 2010 est nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité publique ou à la sûreté publique, au sens des articles 8 et 9 de la Convention.
140. Il faut encore examiner ce qu’il en est au regard de l’autre but que la Cour a jugé légitime : le souci de répondre aux exigences minimales de la vie en société comme élément de la « protection des droits et libertés d’autrui » (voir les paragraphes 121-122 ci-dessus).
141. La Cour observe qu’il s’agit là d’un objectif auquel les autorités ont accordé beaucoup de poids. Cela ressort notamment de l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi, qui indique que, « si la dissimulation volontaire et systématique du visage pose problème, c’est parce qu’elle est tout simplement contraire aux exigences fondamentales du « vivre ensemble » dans la société française » et que « la dissimulation systématique du visage dans l’espace public, contraire à l’idéal de fraternité, ne satisfait pas (...) à l’exigence minimale de civilité nécessaire à la relation sociale » (paragraphe 25 ci-dessus). Or il entre assurément dans les fonctions de l’État de garantir les conditions permettant aux individus de vivre ensemble dans leur diversité. Par ailleurs, la Cour peut accepter qu’un État juge essentiel d’accorder dans ce cadre une importance particulière à l’interaction entre les individus et qu’il considère qu’elle se trouve altérée par le fait que certains dissimulent leur visage dans l’espace public (paragraphe 122 ci-dessus).
142. En conséquence, la Cour estime que l’interdiction litigieuse peut être considérée comme justifiée dans son principe dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du « vivre ensemble ».
143. Il reste à vérifier si cette interdiction est proportionnée par rapport à ce but.
144. Certains des arguments développés par la requérante et les organisations non gouvernementales intervenantes méritent une attention particulière.
145. Ainsi, il est vrai que le nombre de femmes concernées est faible. Il ressort en effet du rapport « sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national » préparé par la mission d’information de l’Assemblée nationale et déposé le 26 janvier 2010, qu’environ 1 900 femmes portaient le voile islamique intégral en France à la fin de l’année 2009, dont environ 270 se trouvaient dans les collectivités d’outre-mer (paragraphe 16 ci-dessus). Ce nombre est de faible ampleur au regard des quelques soixante-cinq millions d’habitants que compte la France et du nombre de musulmans qui y vivent. Il peut donc sembler démesuré de répondre à une telle situation par une loi d’interdiction générale.
146. En outre, il n’est pas douteux que l’interdiction a un fort impact négatif sur la situation des femmes qui, telle la requérante, ont fait le choix de porter le voile intégral pour des raisons tenant à leurs convictions. Comme indiqué précédemment, elle les place devant un dilemme complexe, et elle peut avoir pour effet de les isoler et d’affecter leur autonomie ainsi que l’exercice de leur liberté de manifester leurs convictions et de leur droit au respect de leur vie privée. De plus, on comprend que les intéressées perçoivent cette interdiction comme une atteinte à leur identité.
147. Il faut d’ailleurs constater que de nombreux acteurs internationaux comme nationaux de la protection des droits fondamentaux considèrent qu’une interdiction générale est disproportionnée. Il en va ainsi notamment de la commission nationale consultative des droits de l’homme (paragraphes 18-19 ci-dessus), d’organisations non-gouvernementales telles que les tierces intervenantes, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (paragraphes 35-36 ci-dessus) et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (paragraphe 37 ci-dessus).
148. La Cour est également consciente de ce que la loi du 11 octobre 2010, et certaines controverses qui ont accompagné son élaboration, ont pu être ressenties douloureusement par une partie de la communauté musulmane, y compris par ceux de ses membres qui ne sont pas favorables au port du voile intégral.
149. À ce titre, la Cour est très préoccupée par les indications fournies par certains des intervenants selon lesquelles des propos islamophobes ont marqué le débat qui a précédé l’adoption de la loi du 11 octobre 2010 (voir les observations du Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand et des organisations non gouvernementales Liberty et Open Society Justice Initiative ; paragraphes 98, 100 et 104 ci-dessus). Il ne lui appartient certes pas de se prononcer sur l’opportunité de légiférer en la matière. Elle souligne toutefois qu’un État qui s’engage dans un processus législatif de ce type prend le risque de contribuer à la consolidation des stéréotypes qui affectent certaines catégories de personnes et d’encourager l’expression de l’intolérance alors qu’il se doit au contraire de promouvoir la tolérance (paragraphe 128 ci-dessus ; voir aussi le point de vue du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, paragraphe 37 ci-dessus). La Cour rappelle que des propos constitutifs d’une attaque générale et véhémente contre un groupe identifié par une religion ou des origines ethniques sont incompatibles avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention et ne relèvent pas du droit à la liberté d’expression qu’elle consacre (voir, notamment, Norwood c. Royaume-Uni (déc.), no 23131/03, CEDH 2004‑XI, et Ivanov c. Russie (déc.), no 35222/04, 20 février 2007).
150. Les autres arguments présentés au soutien de la requête doivent en revanche être nuancés.
151. Ainsi, s’il est vrai que le champ de l’interdiction est large puisque tous les lieux accessibles au public sont concernés (sauf les lieux de culte), la loi du 11 octobre 2010 n’affecte pas la liberté de porter dans l’espace public tout habit ou élément vestimentaire – ayant ou non une connotation religieuse – qui n’a pas pour effet de dissimuler le visage. La Cour est consciente du fait que la prohibition critiquée pèse pour l’essentiel sur les femmes musulmanes qui souhaitent porter le voile intégral. Elle attache néanmoins une grande importance à la circonstance que cette interdiction n’est pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des habits visés mais sur le seul fait qu’ils dissimulent le visage. Cela distingue l’espèce de l’affaire Ahmet Arslan et autres précitée.
152. Quant au fait que l’interdiction est assortie de sanctions pénales, il accroît sans doute l’impact de celle-ci sur les intéressées. Il est en effet compréhensible qu’être poursuivies pour avoir dissimulé leur visage dans l’espace public représente un traumatisme pour les femmes qui ont fait le choix de porter le voile intégral pour des raisons tenant à leurs convictions. Il faut cependant prendre en compte la circonstance que les sanctions retenues par le législateur figurent parmi les plus légères qu’il pouvait envisager, puisqu’il s’agit de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (soit actuellement 150 euros au maximum), avec la possibilité pour le juge de prononcer en même temps ou à la place l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté.
153. En outre, certes, comme le souligne la requérante, en interdisant à chacun de revêtir dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage, l’État défendeur restreint d’une certaine façon le champ du pluralisme, dans la mesure où l’interdiction fait obstacle à ce que certaines femmes expriment leur personnalité et leurs convictions en portant le voile intégral en public. Il indique cependant de son côté qu’il s’agit pour lui de répondre à une pratique qu’il juge incompatible, dans la société française, avec les modalités de la communication sociale et, plus largement, du « vivre ensemble ». Dans cette perspective, l’État défendeur entend protéger une modalité d’interaction entre les individus, essentielle à ses yeux pour l’expression non seulement du pluralisme, mais aussi de la tolérance et de l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’y a pas de société démocratique (voir le paragraphe 128 ci-dessus). Il apparaît ainsi que la question de l’acceptation ou non du port du voile intégral dans l’espace public constitue un choix de société.
154. Or dans un tel cas de figure, la Cour se doit de faire preuve de réserve dans l’exercice de son contrôle de conventionalité dès lors qu’il la conduit à évaluer un arbitrage effectué selon des modalités démocratiques au sein de la société en cause. Elle a du reste déjà rappelé que, lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national (paragraphe 129 ci-dessus).
155. En d’autres termes, la France disposait en l’espèce d’une ample marge d’appréciation.
156. Il en va d’autant plus ainsi qu’il n’y a pas de communauté de vue entre les États membres du Conseil de l’Europe (voir, mutatis mutandis, X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, § 44, Recueil 1997‑II) sur la question du port du voile intégral dans l’espace public. La Cour observe en effet que, contrairement à ce que soutient l’un des intervenants (paragraphe 105 ci‑dessus), il n’y a pas de consensus européen contre l’interdiction. Certes, d’un point de vue strictement normatif, la France est dans une situation très minoritaire en Europe : excepté la Belgique, aucun autre État membre du Conseil de l’Europe n’a à ce jour opté pour une telle mesure. Il faut toutefois observer que la question du port du voile intégral dans l’espace public est ou a été en débat dans plusieurs pays européens. Dans certains, il a été décidé de ne pas opter pour une interdiction générale. Dans d’autres, une telle interdiction demeure envisagée (paragraphe 40 ci-dessus). À cela il faut ajouter que, vraisemblablement, la question du port du voile intégral dans l’espace public ne se pose tout simplement pas dans un certain nombre d’États membres, où cette pratique n’a pas cours. Il apparaît ainsi qu’il n’y a en Europe aucun consensus en la matière, que ce soit pour ou contre une interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public.
157. En conséquence, notamment au regard de l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur en l’espèce, la Cour conclut que l’interdiction que pose la loi du 11 octobre 2010 peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation des conditions du « vivre ensemble » en tant qu’élément de la « protection des droits et libertés d’autrui ».
158. La restriction litigieuse peut donc passer pour « nécessaire », « dans une société démocratique ». Cette conclusion vaut au regard de l’article 8 de la Convention comme de l’article 9.
159. Partant, il n’y a eu violation ni de l’article 8 ni de l’article 9 de la Convention.
b) Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ou l’article 9 de la Convention
160. La Cour note que la requérante dénonce une discrimination indirecte. Elle indique à cet égard qu’en tant que femme musulmane souhaitant porter le voile intégral dans l’espace public pour des motifs religieux, elle appartient à une catégorie de personnes tout particulièrement exposées à l’interdiction dont il s’agit et aux sanctions dont elle est assortie.
161. La Cour rappelle qu’une politique ou une mesure générale qui ont des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes peuvent être considérées comme discriminatoires même si elles ne visent pas spécifiquement ce groupe et s’il n’y a pas d’intention discriminatoire (voir notamment D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, §§ 175 et 184-185, CEDH 2007-IV). Il n’en va toutefois ainsi que si cette politique ou cette mesure manquent de justification « objective et raisonnable », c’est-à-dire si elles ne poursuivent pas un « but légitime » ou s’il n’existe pas de « rapport raisonnable de proportionnalité » entre les moyens employés et le but visé (même arrêt, § 196). Or en l’espèce, s’il peut être considéré que l’interdiction que pose la loi du 11 octobre 2010 a des effets négatifs spécifiques sur la situation des femmes musulmanes qui, pour des motifs religieux, souhaitent porter le voile intégral dans l’espace public, cette mesure a une justification objective et raisonnable pour les raisons indiquées précédemment (paragraphes 144-159 ci-dessus).
162. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ou l’article 9 de la Convention.
EBRAHIMIAN c. FRANCE du 26 novembre 2015 Requête 64846/11
Voile Islamiste : La France État laïc et du vivre ensemble peut interdire le Voile Islamiste dans tous les services publics.
2. Appréciation de la Cour
46. À titre liminaire, la Cour observe que le CASH a toujours employé le mot de coiffe pour désigner la tenue de la requérante. Celle-ci a produit devant la Cour une photo d’elle entourée de ses collègues de service sur laquelle elle apparaît vêtue d’une coiffe qui couvre ses cheveux, sa nuque et ses oreilles, et son visage est complètement apparent. Ce couvre-chef qui s’apparente à un foulard ou à un voile islamique a été majoritairement qualifié par les juridictions nationales saisies du litige de voile, et c’est cette dernière dénomination que la Cour utilisera pour l’examen du grief de la requérante.
a) Sur l’existence d’une ingérence
47. La Cour relève que le non-renouvellement du contrat de la requérante est motivé par son refus d’enlever son voile qui, bien que non désigné ainsi par l’administration, était l’expression non contestée de son appartenance à la religion musulmane. La Cour n’a pas de raison de douter que le port de ce voile constituait une « manifestation » d’une conviction religieuse sincère protégée par l’article 9 de la Convention (mutatis mutandis, Leyla Şahin, précité, § 78 ; Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 111, CEDH 2011 ; Eweida et autres, précité, §§ 82, 89 et 97). C’est à l’État, en tant qu’employeur de la requérante, que doit être imputé la décision de ne pas renouveler son contrat et d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Cette mesure doit en conséquence s’analyser comme une ingérence dans son droit à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction tel qu’il se trouve garanti par l’article 9 de la Convention (Eweida et autres, précité, §§ 83, 84 et 97).
b) Sur la justification de l’ingérence
i. Prévue par la loi
48. Les mots « prévue par la loi » veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit. Cette expression implique donc notamment que la législation interne doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à des mesures affectant leurs droits protégés par la Convention. D’après la jurisprudence constante de la Cour, la notion de « loi » doit être entendue dans son acception « matérielle » et non « formelle ». En conséquence, elle y inclut l’ensemble constitué par le droit écrit, y compris les textes de rang infralégislatif, ainsi que la jurisprudence qui l’interprète (Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 117, CEDH 2014 (extraits) ; Dogru, précité, § 52).
49. En l’espèce, la requérante souligne l’absence de textes dans la législation française, à la date du 11 décembre 2000, visant à interdire le port de signes religieux. Elle estime que l’avis du Conseil d’État du 3 mai 2000 ne concernait que les enseignants et que seul celui du 27 novembre 1989 relatif au port de signes religieux dans les établissements scolaires constituait la « loi » applicable (paragraphe 36 ci-dessus). La Cour observe que ce dernier avis ne concerne que le droit reconnu aux élèves de manifester leurs croyances religieuses et qu’il ne traite pas de la situation des agents du service public.
50. La Cour constate que l’article 1er de la Constitution française dispose notamment que la France est une République laïque, qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens. Elle observe que, dans le droit de l’État défendeur, cette disposition constitutionnelle établit le fondement du devoir de neutralité et d’impartialité de l’État à l’égard de toutes les croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci et qu’elle est interprétée et lue conjointement avec l’application qu’en ont fait les juridictions nationales. À cet égard, la Cour retient qu’il ressort de la jurisprudence administrative que la neutralité des services publics constitue un élément de la laïcité de l’État et que, dès 1950, le Conseil d’État a affirmé le « devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent », notamment dans le domaine de l’enseignement (paragraphes 26 et 27 ci‑dessus). Par ailleurs, elle relève que le Conseil Constitutionnel a souligné que le principe de neutralité, qui a pour corollaire celui d’égalité, constitue un principe fondamental du service public (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour en déduit que la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel constituaient une base légale suffisamment sérieuse pour permettre aux autorités nationales de restreindre la liberté religieuse de la requérante.
51. La Cour reconnaît néanmoins que le contenu de l’obligation de neutralité ainsi affirmée, même s’il était de nature à mettre en garde la requérante, ne comportait pas de mention ou d’application se référant explicitement à la profession qu’elle exerçait. Elle accepte donc que, lorsqu’elle a pris ses fonctions, la requérante ne pouvait pas prévoir que l’expression de ses convictions religieuses subirait des restrictions. Elle considère cependant qu’à compter de la publication de l’avis du Conseil d’État du 3 mai 2000, rendu plus de six mois avant la décision de ne pas renouveler son contrat, et dont les termes lui ont été rappelés par l’administration (paragraphe 8 ci-dessus), ces restrictions étaient énoncées avec suffisamment de clarté pour qu’elle prévoie que le refus d’ôter son voile constituait une faute l’exposant à une sanction disciplinaire. Cet avis, bien que répondant spécifiquement à une question portant sur le service public de l’enseignement, indique en effet que le principe de laïcité de l’État et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble des services publics. Il souligne que l’agent doit bénéficier de la liberté de conscience mais que cette liberté doit se concilier, du point de vue de son expression, avec le principe de neutralité du service, qui fait obstacle au port d’un signe destiné à marquer son appartenance à une religion. En outre, en cas de manquement à cette obligation de neutralité, il précise que les suites à donner sur le plan disciplinaire doivent être appréciées au cas par cas en fonction des circonstances particulières (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour constate ainsi que l’avis du 3 mai 2000 détermine clairement les modalités de l’exigence de neutralité religieuse des agents publics dans l’exercice de leur fonction au regard des principes de laïcité et de neutralité, et satisfait à l’exigence de prévisibilité et d’accessibilité de « la loi » au sens de la jurisprudence de la Cour. La mesure critiquée était donc prévue par la loi au sens du paragraphe 2 de l’article 9.
ii. But légitime
52. À la différence des parties dans l’affaire Leyla Sahin précitée (§ 99), la requérante et le Gouvernement ne s’accordent pas sur l’objectif de la restriction litigieuse. Le Gouvernement invoque le but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui qu’implique le principe constitutionnel de laïcité tandis que la requérante dénie tout incident au cours de l’exercice de ses fonctions qui aurait pu motiver l’ingérence dans son droit à la liberté de manifester ses convictions religieuses.
53. Eu égard aux circonstances de la cause et au motif retenu pour ne pas renouveler le contrat de la requérante, à savoir l’exigence de neutralité religieuse dans un contexte de vulnérabilité des usagers du service public, la Cour estime que l’ingérence litigieuse poursuivait pour l’essentiel le but légitime qu’est la protection des droits et libertés d’autrui (mutatis mutandis, Leyla Şahin, précité, §§ 99 et 116 ; Kurtulmuş précité ; Ahmet Arslan et autres c. Turquie, no41135/98, § 43, 23 février 2010). Il s’agissait en l’espèce de préserver le respect de toutes les croyances religieuses et orientations spirituelles des patients, usagers du service public et destinataires de l’exigence de neutralité imposée à la requérante, en leur assurant une stricte égalité. L’objectif était également de veiller à ce que ces usagers bénéficient d’une égalité de traitement sans distinction de religion. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a considéré que la politique d’un employeur visant à promouvoir l’égalité des chances ou à éviter tout comportement discriminatoire à l’égard d’autrui poursuivait le but légitime de protéger les droits d’autrui (mutatis mutandis, les affaires Ladele et McFarlane, dans Eweida et autres précité, §§ 105, 106 et 109). Elle rappelle également que la sauvegarde du principe de laïcité constitue un objectif conforme aux valeurs sous-jacentes de la Convention (Leyla Şahin, précité, § 114). Dans ces conditions, la Cour est d’avis que l’interdiction faite à la requérante de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions poursuivait un objectif de protection « des droits et libertés d’autrui » et que cette restriction ne devait pas nécessairement être motivée, en plus, par des contraintes de « sécurité publique » ou de « protection de l’ordre » qui figurent au second paragraphe de l’article 9 de la Convention.
iii. Nécessaire dans une société démocratique
α. Principes généraux
54. S’agissant des principes généraux, la Cour renvoie à l’arrêt Leyla Şahin précité (§§ 104 à 111) dans lequel elle a rappelé que si la liberté de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » (§ 104 ; voir, également sur les principes généraux, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 31, série A no 260‑A), l’article 9 de la Convention ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction. Dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun. Cela découle à la fois du paragraphe 2 de l’article 9 et des obligations positives qui incombent à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention (§ 106).
55. Dans cet arrêt, la Cour a également rappelé qu’à maintes reprises, elle avait mis l’accent sur le rôle de l’État en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Ainsi, le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci, et considère que ce devoir impose à l’État de s’assurer que des groupes opposés se tolèrent. Dès lors, le rôle des autorités dans ce cas n’est pas de supprimer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent (§ 107).
56. Par ailleurs, lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’État et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. La Cour a souligné que tel était le cas lorsqu’il s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement, d’autant plus au vu de la diversité des approches nationales quant à cette question. Renvoyant notamment à l’affaire Dahlab précitée, la Cour a précisé qu’il n’était pas possible de discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société et que le sens ou l’impact des actes correspondant à l’expression publique d’une conviction religieuse n’étaient pas les mêmes suivants les époques et les contextes. Elle a observé que la réglementation en la matière pouvait varier par conséquent d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et liberté d’autrui et le maintien de l’ordre public. Elle en a déduit que le choix quant à l’étendue et aux modalités d’une telle réglementation doit, par la force des choses, être dans une certaine mesure laissé à l’État concerné, puisqu’il dépend du contexte national considéré (Leyla Şahin précité, § 109).
57. Dans l’affaire Kurtulmuş précitée, qui concernait l’interdiction faite à une enseignante de l’université d’Istanbul de porter le foulard islamique, la Cour a souligné que les principes rappelés au paragraphe 51 ci-dessus s’appliquent également aux membres de la fonction publique : « s’il apparaît légitime pour l’État de soumettre ces derniers, en raison de leur statut, à une obligation de discrétion dans l’expression publique de leurs convictions religieuses, il s’agit néanmoins d’individus qui, à ce titre, bénéficient de la protection de l’article 9 de la Convention. Elle a indiqué à cette occasion, en renvoyant aux affaires Leyla Şahin et Dahlab précitées, que « dans une société démocratique, l’État peut limiter le port du foulard islamique si cela nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre ». Faisant application de ces principes, la Cour a relevé que « les règles relatives à la tenue vestimentaire des fonctionnaires s’imposent de manière égale à tous les fonctionnaires, quelles que soient leurs fonctions et leurs convictions religieuses. Elles impliquent que tout fonctionnaire, représentant de l’État dans l’exercice de ses fonctions, ait une apparence neutre afin de préserver le principe de la laïcité et celui de la neutralité de la fonction publique qui en découle. Selon ces règles, un fonctionnaire doit être nu-tête sur son lieu de travail » (Kurtulmuş, précité). Elle a admis, eu égard notamment à l’importance du principe de laïcité, fondateur de l’État turc, que « l’interdiction de porter le voile était justifiée par les impératifs liés aux principes de neutralité de la fonction publique », et rappelé à cet égard, en se référant à l’arrêt Vogt c. Allemagne précité, qu’elle avait « admis dans le passé qu’un État démocratique puisse être en droit d’exiger de ses fonctionnaires qu’ils soient loyaux envers les principes constitutionnels sur lesquels il s’appuie ».
58. Toujours dans le contexte de l’enseignement public, la Cour a mis l’accent sur l’importance du respect de la neutralité de l’État dans le cadre de l’activité d’enseignement dans le primaire public, où les enfants en bas âge sont influençables (Dahlab, précité).
59. Récemment, dans plusieurs affaires concernant la liberté de religion au travail, la Cour a énoncé que « vu l’importance que revêt la liberté de religion dans une société démocratique, la Cour considère que, dès lors qu’il est tiré grief d’une restriction à cette liberté sur le lieu de travail, plutôt que de dire que la possibilité de changer d’emploi exclurait toute ingérence dans l’exercice du droit en question, il vaut mieux apprécier cette possibilité parmi toutes les circonstances mises en balance lorsqu’est examiné le caractère proportionné de la restriction » (Eweida et autres, précité, § 83).
β. Application au cas d’espèce
60. La Cour relève d’emblée que, outre le rappel du principe de neutralité des services publics, l’administration a indiqué à la requérante les raisons pour lesquelles ce principe justifiait une application particulière à l’égard d’une assistante sociale dans un service psychiatrique d’un hôpital. L’administration avait identifié les problèmes qu’entrainait son attitude au sein du service concerné et tenté de l’inciter à renoncer à afficher ses convictions religieuses (paragraphe 8 ci-dessus).
61. La Cour observe que les juridictions nationales ont validé le non-renouvellement du contrat de la requérante en affirmant explicitement que le principe de neutralité des agents s’applique à tous les services publics, et pas seulement à celui de l’enseignement, et qu’il vise à protéger les usagers de tout risque d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de conscience. Le tribunal administratif, dans le jugement du 17 octobre 2002, avait accordé du poids à la fragilité de ces usagers et considéré que l’exigence de neutralité imposée à la requérante était d’autant plus impérative qu’elle était en contact avec des patients se trouvant dans un état de fragilité ou de dépendance (paragraphe 11 ci-dessus).
62. La Cour observe encore qu’il n’a pas été reproché à la requérante d’actes de pression, de provocation ou de prosélytisme vis-à-vis des patients ou des collègues de l’hôpital. Le port de son voile fut cependant considéré comme une manifestation ostentatoire de sa religion incompatible avec l’espace de neutralité qu’exige un service public. Il a alors été décidé de ne pas renouveler son contrat et d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre en raison de sa persistance à le porter durant son service.
63. C’est le principe de laïcité, au sens de l’article 1er de la Constitution française, et le principe de neutralité des services publics qui en découle, qui ont été opposés à la requérante, en raison de la nécessité d’assurer l’égalité de traitement des usagers de l’établissement public qui l’employait et qui exigeait, quelles que puissent être ses croyances religieuses ou son genre, qu’elle obéisse au strict devoir de neutralité dans l’exercice de ses fonctions. Il s’agissait, selon les juridictions nationales, d’assurer la neutralité de l’État afin de garantir son caractère laïc et de protéger ainsi les usagers du service, les patients de l’hôpital, de tout risque d’influence ou de partialité, au nom de leur droit à la liberté de conscience (paragraphes 11, 16 et 25 ci-dessus ; voir, également, la formulation retenue par la suite dans la circulaire relative à la laïcité dans les établissements de santé, paragraphe 30 ci-dessus). Il ressort ainsi clairement du dossier que c’est bien l’impératif de la protection des droits et liberté d’autrui, c’est-à-dire le respect de la liberté de religion de tous, et non ses convictions religieuses, qui a fondé la décision litigieuse.
64. La Cour a déjà admis que les États pouvaient invoquer les principes de laïcité et de neutralité de l’État pour justifier des restrictions au port de signes religieux par des fonctionnaires, en particulier des enseignants exerçant dans des établissements publics (paragraphe 57 ci-dessus). C’est leur statut d’agent public, qui les distingue des simples citoyens « qui ne sont aucunement des représentants de l’État dans l’exercice d’une fonction publique » et qui ne sont pas « soumis, en raison d’un statut officiel à une obligation de discrétion dans l’expression publique de leurs convictions religieuses » (Ahmet Arslan et autres c. Turquie, no 41135/98, § 48, 23 février 2010) qui leur impose, vis-à-vis des élèves, une neutralité religieuse. De la même manière, la Cour peut accepter dans les circonstances de l’espèce que l’État qui emploie la requérante au sein d’un hôpital public, dans lequel elle se trouve en contact avec les patients, juge nécessaire qu’elle ne fasse pas état de ses croyances religieuses dans l’exercice de ses fonctions pour garantir l’égalité de traitement des malades. Dans cet esprit, la neutralité du service public hospitalier peut être considérée comme liée à l’attitude de ses agents et exigeant que les patients ne puissent douter de leur impartialité.
65. Il reste donc à la Cour à vérifier que l’ingérence litigieuse est proportionnée par rapport à ce but. Quant à la marge d’appréciation reconnue à l’État en l’espèce, la Cour observe qu’une majorité d’États au sein du Conseil de l’Europe ne réglementent pas le port de vêtements ou symboles à caractère religieux sur le lieu de travail, y compris pour les fonctionnaires (paragraphe 32 ci-dessus) et que seuls cinq États (sur vingt‑six) dont la France sont recensés comme interdisant totalement le port de signes religieux à leur égard. Toutefois, comme cela a été rappelé (paragraphe 56 ci-dessus), il convient de prendre en compte le contexte national des relations entre l’État et les Églises, qui évolue dans le temps, avec les mutations de la société. Ainsi, la Cour retient que la France a opéré une conciliation entre le principe de neutralité de la puissance publique et la liberté religieuse, déterminant de la sorte l’équilibre que doit ménager l’État entre des intérêts privés et publics concurrents ou différents droits protégés par la Convention (paragraphes 21 à 28 ci-dessus), ce qui laisse au gouvernement défendeur une ample marge d’appréciation (Leyla Şahin, précité, § 109 ; Obst c. Allemagne, no 425/03, § 42, 23 septembre 2010). En outre, la Cour a déjà indiqué que le milieu hospitalier implique une large marge d’appréciation, les responsables hospitaliers étant mieux placés pour prendre des décisions dans leur établissement que le juge ou, qui plus est, un tribunal international» (Eweida et autres, précité, § 99).
66. La question principale qui se pose en l’espèce est donc de savoir si l’État a outrepassé sa marge d’appréciation en décidant de ne pas renouveler le contrat de la requérante. À cet égard, la Cour constate qu’en France, les agents du service public bénéficient du droit au respect de leur liberté de conscience qui interdit notamment toute discrimination fondée sur la religion dans l’accès aux fonctions ou dans le déroulement de leur carrière. Cette liberté est spécialement garantie par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et doit se concilier avec les nécessités du fonctionnement du service (paragraphe 25 ci-dessus). Il leur est cependant interdit de manifester leurs croyances religieuses dans l’exercice de leurs fonctions (paragraphes 25 et 26 ci-dessus). L’avis du 3 mai 2000 précité énonce ainsi clairement que la liberté de conscience des agents doit se concilier, exclusivement du point de vue de son expression, avec l’obligation de neutralité. La Cour réitère qu’une telle limitation trouve sa source dans le principe de laïcité de l’État, qui, selon le Conseil d’État, « intéresse les relations entre les collectivités publiques et les particuliers » (paragraphe 28 ci-dessus), et de celui de neutralité des services publics, corollaire du principe d’égalité qui régit le fonctionnement de ces services et vise au respect de toutes les convictions.
67. Or, la Cour souligne qu’elle a déjà approuvé une mise en œuvre stricte des principes de laïcité (désormais érigée au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, paragraphe 24 ci-dessus) et de neutralité lorsqu’il s’agit d’un principe fondateur de l’État, ce qui est le cas de la France (mutatis mutandis, Kurtulmuş et Dalhab précités). Le principe de laïcité-neutralité constitue l’expression d’une règle d’organisation des relations de l’État avec les cultes, qui implique son impartialité à l’égard de toutes les croyances religieuses dans le respect du pluralisme et de la diversité. La Cour estime que le fait que les juridictions nationales ont accordé plus de poids à ce principe et à l’intérêt de l’État qu’à l’intérêt de la requérante de ne pas limiter l’expression de ses croyances religieuses ne pose pas de problème au regard de la Convention (paragraphes 54 et 55 ci‑dessus).
68. Elle observe à cet égard que l’obligation de neutralité s’applique à l’ensemble des services publics, ainsi que l’ont maintes fois rappelé le Conseil d’État, et la Cour de cassation récemment (paragraphes 26 et 27 ci‑dessus), et que le port d’un signe d’appartenance religieuse par les agents dans l’exercice de leurs fonctions constitue, par principe, un manquement à leurs obligations (paragraphe 25 et 26 ci-dessus). Il ne ressort en effet d’aucun texte ou d’aucune décision du Conseil d’État que l’obligation de neutralité litigieuse pourrait être modulée selon les agents et les fonctions qu’ils exercent (paragraphes 26 et 31 ci-dessus). La Cour est consciente qu’il s’agit d’une obligation stricte qui puise ses racines dans le rapport traditionnel qu’entretiennent la laïcité de l’État et la liberté de conscience, tel qu’il est énoncé à l’article 1er de la Constitution (paragraphe 21 ci‑dessus). Selon le modèle français, qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier en tant que tel, la neutralité de l’État s’impose aux agents qui le représentent. La Cour retient toutefois qu’il incombe au juge administratif de veiller à ce que l’administration ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience des agents publics lorsque la neutralité de l’État est invoquée (paragraphes 26 et 28 ci-dessus).
69. Dans ce contexte, la Cour observe que les conséquences disciplinaires du refus de la requérante de retirer son voile pendant son service ont été appréciées par l’administration « compte tenu de la nature et du caractère ostentatoire du signe, comme des autres circonstances (paragraphe 26 ci-dessus)». L’administration a utilement souligné à ce titre que l’exigence de neutralité requise était impérative compte tenu des contacts qu’elle avait avec les patients (paragraphe 13 ci-dessus). Elle a par ailleurs, en des termes qui auraient mérité d’être plus développés, fait état de difficultés dans le service (paragraphe 8 ci-dessus). Les juges du fond ont, pour leur part, essentiellement retenu la conception française du service public et le caractère ostentatoire du voile pour considérer qu’il n’était pas porté une atteinte excessive à la liberté religieuse de la requérante. Ainsi, si le port d’un signe religieux par la requérante a constitué un manquement fautif à son devoir de neutralité, l’impact de cette tenue dans l’exercice de ses fonctions a été pris en compte pour évaluer la gravité de cette faute et décider de ne pas renouveler son contrat. La Cour constate que l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 ne donne pas de définition de la faute (paragraphe 41 ci-dessus) et que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière. Elle remarque que cette dernière a recueilli des témoignages pour considérer qu’elle disposait d’éléments suffisants pour intenter une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante (paragraphe 8 ci‑dessus). Le juge administratif n’a par ailleurs pas censuré la sanction de non-renouvellement du contrat, la considérant proportionnée à la faute, eu égard au devoir de neutralité des agents publics. La Cour considère que les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier la proportionnalité de la sanction, qui doit être déterminée au regard de l’ensemble des circonstances dans lesquelles un manquement a été constaté, afin de respecter l’article 9 de la Convention.
70. La Cour relève que la requérante, pour qui il était important de manifester sa religion par le port visible d’un voile en raison de ses convictions religieuses, s’exposait à la lourde conséquence d’une procédure disciplinaire. Cependant, il ne fait pas de doute que, postérieurement à la publication de l’avis du Conseil d’État du 3 mai 2000, elle savait qu’elle était tenue de se conformer à une obligation de neutralité vestimentaire au cours de l’exercice de ses fonctions (paragraphes 26 et 51 ci-dessus). L’administration le lui a rappelé et lui a demandé de reconsidérer le port de son voile. C’est en raison de son refus de se conformer à cette obligation que la requérante s’est vue notifier le déclenchement de la procédure disciplinaire, indépendamment de ses qualités professionnelles. Elle a alors bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ainsi que des voies de recours devant les juridictions administratives. Elle a par ailleurs renoncé à se présenter au concours d’assistante sociale organisé par le CASH, alors qu’elle était inscrite sur la liste des candidats que cet établissement a dressée en parfaite connaissance de cause (paragraphe 10 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en constatant l’absence de conciliation possible entre les convictions religieuses de la requérante et l’obligation de ne pas les manifester puis en décidant de faire primer l’exigence de neutralité et d’impartialité de l’État.
71. Il ressort du rapport de l’Observatoire sur la laïcité, en sa partie « État des lieux concernant la laïcité dans les établissements de santé » (paragraphe 29 ci-dessus), que les différends nés de la manifestation des convictions religieuses de personnes travaillant au sein des services hospitaliers sont appréciés au cas par cas, la conciliation des intérêts en présence étant faite par l’administration dans le souci de trouver des solutions à l’amiable. Cette volonté de conciliation est confirmée par la rareté du contentieux de cette nature porté devant les juridictions, ainsi qu’il ressort de la circulaire de 2005 ou des études récentes sur la laïcité (paragraphes 26 et 30 ci-dessus). Enfin, la Cour observe que l’hôpital est un lieu où il est demandé également aux usagers, qui ont pourtant la liberté d’exprimer leurs convictions religieuses, de contribuer à la mise en œuvre du principe de laïcité en s’abstenant de tout prosélytisme et en respectant l’organisation du service et les impératifs de santé et d’hygiène en particulier (paragraphes 23, 29 et 30 ci-dessus) ; en d’autres termes, la réglementation de l’État concerné y fait primer les droits d’autrui, l’égalité de traitement des patients et le fonctionnement du service sur les manifestations des croyances religieuses, ce dont elle prend acte.
72. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence litigieuse peut passer pour proportionnée au but poursuivi. Partant, l’ingérence dans l’exercice de sa liberté de manifester sa religion était nécessaire dans une société démocratique, et il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention
DAKIR c. BELGIQUE du 11 juillet 2017 requête 4619/12
Non violation des articles 8 et 9 de la Conv EDH, l’interdiction que posent les règlements coordonnés de la zone de police de Vesdre peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation des conditions du « vivre ensemble » en tant qu’élément de la « protection des droits et libertés d’autrui ».
Note de Frédéric Fabre : Le port de la burka fait peur à la population des Ardennes belges de langue allemande, alors que des camps d'entraînement au djihad y sont implantés. La CEDH s'est rangée derrière la marge d'appréciation de l'État belge, après avoir constaté que l'interdiction de la burka a fait l'objet d'un débat démocratique.
3. Appréciation de la Cour
46. La Cour constate que bien qu’introduite après l’entrée en vigueur de la loi du 1er juin 2011 interdisant le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage, la présente affaire vise une disposition règlementaire antérieure à la loi – l’article 113bis des règlements communaux coordonnés de la zone de police de Vesdre. Il ressort néanmoins de la requête et des observations qui lui ont été soumises que les arguments en présence se réfèrent quasiment exclusivement à la loi du 1er juin 2011 ainsi qu’à l’analyse qu’en a faite la Cour constitutionnelle (voir paragraphes 16-22, ci-dessus). Considérant que la requête touche une problématique dont les termes sont très proches de ceux qui ont présidé à l’adoption de la loi française du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, la Cour se réfèrera dans une large mesure à l’arrêt S.A.S. c. France précité qui examine cette interdiction française à l’aune des dispositions pertinentes de la Convention.
a) Sur la violation alléguée des articles 8 et 9 de la Convention
47. La Cour a souligné que l’interdiction de porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler le visage posait des questions tant au regard du droit au respect de la vie privée des femmes qui souhaitent porter le voile intégral pour des raisons tenant à leurs convictions qu’au regard de leur liberté de manifester celle-ci. Cela étant dit, pour autant que cette interdiction est mise en cause par des personnes qui, telles que la requérante en l’espèce, se plaint d’être en conséquence empêchée de porter dans l’espace public une tenue que sa pratique d’une religion lui dicte de revêtir, il y a lieu d’examiner cette partie de la requête en mettant l’accent sur la liberté garantie par l’article 9 de la Convention de chacun de manifester sa religion ou ses convictions (S.A.S. c. France, précité, §§ 106-109).
i. Sur la qualité de la loi
48. La Cour relève que la qualité de « loi » des règlements communaux coordonnés de la zone de police de Vesdre n’est pas contestée par la requérante. Il y a donc lieu de considérer que l’interdiction litigieuse reposait sur une base « légale » remplissant les critères établis par sa jurisprudence relative au paragraphe 2 des articles 8 et 9 de la Convention.
ii. Sur le but légitime poursuivi
49. La Cour relève à l’examen des observations qui lui ont été soumises que les parties tiennent pour acquis que l’interdiction résultant des règlements communaux litigieux poursuivait les mêmes objectifs que ceux de la loi adoptée plus tard, à savoir : la sécurité publique, l’égalité entre l’homme et la femme et une certaine conception du « vivre ensemble » dans la société.
50. L’organisation intervenante Liberty déduit toutefois du fait que lesdits règlements ont été rédigés en 2008 au départ d’une demande formulée par la commission consultative des femmes de la commune de Verviers que l’objectif d’assurer l’égalité entre l’homme et la femme a largement prévalu (voir paragraphe 34, ci-dessus). La Cour estime qu’elle ne dispose d’aucun élément l’amenant à considérer que cet objectif ait eu plus de poids que les autres objectifs précités.
51. La Cour rappelle que les motifs précités sont similaires à ceux retenus par le législateur français et examinés dans l’arrêt S.A.S. c. France. Dans cet arrêt, elle a admis que le souci de répondre aux exigences minimales de la vie en société pouvait être considéré comme un élément de la « protection des droits et libertés d’autrui » et que l’interdiction litigieuse pouvait être considérée comme justifiée dans son principe dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du « vivre ensemble » (§§ 140-142). Elle estime que la même approche s’applique en l’espèce.
iii. Sur la nécessité de l’interdiction dans une société démocratique
52. La Cour observe, d’après les travaux préparatoires de la loi du 1er juin 2011 ainsi que d’après l’analyse qu’en a faite la Cour constitutionnelle (voir paragraphes 19-21, ci-dessus), que les termes de la problématique telle qu’elle fut débattue en Belgique sont très proches de ceux qui ont présidé à l’adoption de l’interdiction française précitée qu’elle a examinée dans l’arrêt S.A.S. c. France.
53. La partie requérante invite la Cour à changer l’approche choisie dans l’arrêt S.A.S. c. France pour évaluer la proportionnalité de l’interdiction du voile intégral. Les organisations intervenantes font valoir que l’appréciation de cette question doit tenir compte des spécificités de la société belge et du processus législatif qui a précédé l’interdiction en Belgique.
54. Ainsi qu’elle l’a clairement exprimé dans l’arrêt S.A.S. c. France, la Cour se doit de rappeler que le mécanisme de contrôle institué par la Convention a un rôle fondamentalement subsidiaire et que les autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe en ce qui concerne la protection des droits de l’homme. En outre, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les besoins et le contexte locaux (Dubská et Krejzová c. République tchèque [GC], nos 28859/11 et 28473/12, § 175, 15 novembre 2016). Lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. S’agissant de l’article 9 de la Convention, il convient, en principe, de reconnaître à l’État une ample marge d’appréciation pour décider si et dans quelle mesure une restriction au droit de manifester sa religion ou ses convictions est « nécessaire ». Cela étant, pour déterminer l’ampleur de la marge d’appréciation dans une affaire donnée, la Cour doit également tenir compte de l’enjeu propre à l’espèce. Elle peut aussi, le cas échéant, prendre en considération le consensus et les valeurs communes qui se dégagent de la pratique des États parties à la Convention (S.A.S. c. France, précité, § 129).
55. La Cour a pleinement conscience qu’un État qui, comme la Belgique, s’engage dans un tel processus normatif prend le risque de contribuer à la consolidation des stéréotypes affectant certaines catégories de personnes et d’encourager l’expression de l’intolérance, et que la prohibition critiquée, même si elle n’est pas fondée sur la connotation religieuse de l’habit, pèse pour l’essentiel sur les femmes musulmanes qui souhaitaient porter le voile intégral (S.A.S. c. France, précité, § 149). Elle n’ignore pas davantage qu’en interdisant de revêtir dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler le visage, l’État défendeur restreint d’une certaine façon le champ du pluralisme, dans la mesure où l’interdiction fait obstacle à ce que certaines femmes expriment leur personnalité et leurs convictions en portant le voile intégral en public (S.A.S. c. France, précité, § 153).
56. Toutefois, l’État défendeur a entendu, en adoptant les dispositions litigieuses, répondre à une pratique qu’il jugeait incompatible, dans la société belge, avec les modalités de communication sociale et plus généralement l’établissement de rapports humains indispensables à la vie en société (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 décembre 2012, considérant B.21, cité au paragraphe 21, ci-dessus). Ce faisant, il s’agissait de protéger une modalité d’interaction entre les individus essentielle, pour l’État défendeur, au fonctionnement d’une société démocratique (voir l’arrêt précité, considérant B.28, cité au paragraphe 21, ci-dessus). Dans cette perspective, à l’instar de la situation qui s’est présentée en France (S.A.S. c. France, précité, § 153), il apparaît que la question de l’acception ou non du port du voile intégral dans l’espace public belge constitue un choix de société.
57. La Cour réitère, comme elle l’a souligné dans l’arrêt S.A.S. c. France précité (§§ 153-155), que dans un tel cas de figure elle se doit de faire preuve de réserve dans l’exercice de son contrôle de conventionalité dès lors qu’il la conduit à évaluer un arbitrage effectué selon des modalités démocratiques au sein de la société belge. La circonstance invoquée par les organisations intervenantes que le processus démocratique ayant mené en Belgique à l’interdiction du port du voile intégral n’aurait pas été à la hauteur des enjeux ne saurait peser en l’espèce sur l’évaluation de la situation. Outre que cette critique ne s’adresse pas directement aux règlements litigieux mais vise la loi du 1er juin 2011, la Cour relève, en obiter dictum, que le processus décisionnel ayant débouché sur l’interdiction en cause a duré plusieurs années et a été marqué par un large débat au sein de la Chambre des représentants ainsi que par un examen circonstancié et complet de l’ensemble des intérêts en jeu par la Cour constitutionnelle.
58. S’il est vrai que le champ de l’interdiction est large puisque tous les lieux accessibles au public sont concernés, les règlements litigieux n’affectent pas la liberté de porter dans l’espace public tout habit ou élément vestimentaire – ayant ou non une connotation religieuse – qui n’a pas pour effet de dissimuler le visage (S.A.S. c. France, précité, § 151).
59. La Cour souligne enfin qu’il n’y a, entre les États membres du Conseil de l’Europe, toujours aucun consensus en la matière, que ce soit pour ou contre une interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public, ce qui justifie de l’avis de la Cour de reconnaître à l’État défendeur une marge d’appréciation très large (S.A.S. c. France, précité, § 156).
60. En conséquence, notamment au regard de l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur en l’espèce, la Cour conclut que l’interdiction que posent les règlements coordonnés de la zone de police de Vesdre peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation des conditions du « vivre ensemble » en tant qu’élément de la « protection des droits et libertés d’autrui ».
61. La restriction litigieuse peut donc passer pour « nécessaire », « dans une société démocratique ». Cette conclusion vaut au regard de l’article 8 de la Convention comme de l’article 9.
62. Partant, il n’y a eu violation ni de l’article 8 ni de l’article 9 de la Convention.
b) Sur la violation alléguée de l’article 14 combiné avec l’article 8 ou l’article 9 de la Convention
63. La requérante dénonce une discrimination indirecte. Elle fait valoir à cet égard que, malgré la généralité des termes des règlements litigieux, elle appartient en tant que femme musulmane souhaitant porter le voile intégral dans l’espace public pour des motifs religieux, à une catégorie de personnes tout particulièrement exposées à l’interdiction dont il s’agit. Cette interdiction est beaucoup moins contraignante pour les autres personnes vivant ou passant à Dison, qui ne sont pas de confession musulmane et ne touche en tout cas pas à l’exercice par elles de libertés fondamentales.
64. Le Gouvernement estime que les règlements incriminés ne sont pas discriminatoires puisque, pas davantage que la loi française, ils ne visent pas spécifiquement le voile intégral et s’appliquent à toute personne qui porte un attribut dissimulant son visage en public, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme et que le motif soit religieux ou autre.
65. La Cour rappelle qu’une politique ou une mesure générale qui a des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes peut être considérée comme discriminatoire même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe et s’il n’y a pas d’intention discriminatoire. Il n’en va toutefois ainsi que si cette politique ou cette mesure manque de justification « objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’existe pas de « rapport raisonnable de proportionnalité » entre les moyens employés et le but visé (S.A.S. c. France, précité, § 161).
66. En l’espèce, s’il peut être considéré que l’interdiction que posent les règlements litigieux a des conséquences plus contraignantes à l’égard de l’exercice par certaines femmes de confession musulmane de certaines de leurs libertés fondamentales, cette mesure a une justification objective et raisonnable pour les mêmes raisons que celles que la Cour a développées précédemment (voir paragraphes 52-62 ; comparer S.A.S. c. France, précité, § 161).
67. Partant il n’y pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 8 et 9.
c) Sur la violation alléguée de l’article 10 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention
68. La Cour estime qu’aucune question distincte de celles qu’elle a examinées sur le terrain des articles 8 et 9 de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14 de la Convention, ne se pose sous l’angle de l’article 10 de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14 de la Convention.
BELCACEMI ET OUSSAR c. BELGIQUE du 11 juillet 2017 requête 37798/13
Article 8 et 9 de la Conv EDH, au regard de l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur en l’espèce, la Cour conclut que l’interdiction que pose la loi du 1er juin 2011, quoique controversée et présentant indéniablement des risques en termes de promotion de la tolérance au sein de la société (S.A.S. c. France, précité, §§ 146-149), peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation des conditions du « vivre ensemble » en tant qu’élément de la « protection des droits et libertés d’autrui ». La restriction litigieuse peut donc passer pour « nécessaire », « dans une société démocratique ». Cette conclusion vaut au regard de l’article 8 de la Convention comme de l’article 9.
a) Sur la violation alléguée des articles 8 et 9 de la Convention
44. La Cour a souligné que l’interdiction de porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler le visage posait des questions tant au regard du droit au respect de la vie privée des femmes qui souhaitent porter le voile intégral pour des raisons tenant à leurs convictions qu’au regard de leur liberté de manifester celle-ci. Cela étant dit, pour autant que cette interdiction est mise en cause par des personnes qui, telles que les requérantes en l’espèce, se plaignent d’être en conséquence empêchées de porter dans l’espace public une tenue que leur pratique d’une religion leur dicte de revêtir, il y a lieu d’examiner cette partie de la requête en mettant l’accent sur la liberté garantie par l’article 9 de la Convention de chacun de manifester sa religion ou ses convictions (S.A.S. c. France, précité, §§ 106‑109).
i. Sur la qualité de la loi
45. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’expression « prévue par la loi » veut d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais a trait aussi à la qualité de la loi en question : cette expression exige l’accessibilité de la loi aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre – en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé et de régler leur conduite (voir, parmi d’autres, Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 84, CEDH 2005‑XI, et Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, §§ 108-109, CEDH 2015).
46. La Cour note que la Cour constitutionnelle belge a appliqué ces principes en l’espèce et a considéré que la loi du 1er juin 2011 répondait à ces exigences de précision et de prévisibilité, à condition que les termes « lieux accessibles au public » soient interprétés comme ne visant pas les lieux destinés au culte (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 décembre 2012, considérants B.30 et B.31 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, cités au paragraphe 27, ci-dessus). La Cour ne décèle rien d’arbitraire dans le raisonnement de la haute juridiction belge. Sachant que les requérantes ont affirmé avoir été en mesure de prévoir qu’elles risquaient de se voir sanctionnées si elles persistaient à porter le voile intégral dans l’espace public (voir paragraphes 9-10, ci-dessus), la Cour ne saurait parvenir à une autre conclusion et considère que la loi du 1er juin 2011 peut passer pour être libellée avec suffisamment de précision pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité.
47. Au surplus, la Cour observe, avec le Gouvernement, que l’interdiction litigieuse est formulée dans des termes très proches de ceux qui figurent dans la loi française du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public et que la Cour a considéré dans l’affaire S.A.S. c. France (§ 112) qu’ils remplissaient les critères établis par sa jurisprudence relative au paragraphe 2 des articles 8 et 9 de la Convention.
ii. Sur le but légitime poursuivi
48. La Cour constate, comme l’a rappelé l’arrêt de la Cour constitutionnelle sur lequel s’appuie Gouvernement, que les travaux préparatoires de la loi belge (voir paragraphes 18-22, ci-dessus) retiennent, à l’instar de la situation française examinée dans l’affaire S.A.S. c. France, trois objectifs pour justifier l’interdiction litigieuse en Belgique : la sécurité publique, l’égalité entre l’homme et la femme et une certaine conception du « vivre ensemble » dans la société.
49. La Cour rappelle qu’elle a admis, dans l’affaire S.A.S. c. France, que le souci de répondre aux exigences minimales de la vie en société pouvait être considéré comme un élément de la « protection des droits et libertés d’autrui » et que l’interdiction litigieuse pouvait être considérée comme justifiée dans son principe dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du « vivre ensemble » (§§ 140-142). Elle estime que la même approche s’applique en l’espèce.
iii. Sur la nécessité de l’interdiction dans une société démocratique
50. La Cour observe, d’après les travaux préparatoires de la loi ainsi que l’analyse qu’en a faite la Cour constitutionnelle (voir paragraphes 18 et 24, ci-dessus), que les termes de la problématique telle qu’elle fut débattue en Belgique sont très proches de ceux qui ont présidé à l’adoption de la loi française précitée qu’elle a examinée dans l’arrêt S.A.S. c. France.
51. Ainsi qu’elle l’a clairement exprimé dans l’arrêt S.A.S. c. France, la Cour se doit de rappeler que le mécanisme de contrôle institué par la Convention a un rôle fondamentalement subsidiaire et que les autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe en ce qui concerne la protection des droits de l’homme. En outre, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les besoins et le contexte locaux (Dubská et Krejzová c. République tchèque [GC], nos 28859/11 et 28473/12, § 175, 15 novembre 2016). Lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. S’agissant de l’article 9 de la Convention, il convient, en principe, de reconnaître à l’État une ample marge d’appréciation pour décider si et dans quelle mesure une restriction au droit de manifester sa religion ou ses convictions est « nécessaire ». Cela étant, pour déterminer l’ampleur de la marge d’appréciation dans une affaire donnée, la Cour doit également tenir compte de l’enjeu propre à l’espèce. Elle peut aussi, le cas échéant, prendre en considération le consensus et les valeurs communes qui se dégagent de la pratique des États parties à la Convention (S.A.S. c. France, précité, § 129).
52. La Cour a pleinement conscience qu’un État qui, comme la Belgique, s’engage dans un tel processus normatif prend le risque de contribuer à la consolidation des stéréotypes affectant certaines catégories de personnes et d’encourager l’expression de l’intolérance, et que la prohibition critiquée, même si elle n’est pas fondée sur la connotation religieuse de l’habit, pèse pour l’essentiel sur les femmes musulmanes qui souhaitaient porter le voile intégral (S.A.S. c. France, précité, § 149). Elle n’ignore pas davantage qu’en interdisant de revêtir dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler le visage, l’État défendeur restreint d’une certaine façon le champ du pluralisme, dans la mesure où l’interdiction fait obstacle à ce que certaines femmes expriment leur personnalité et leurs convictions en portant le voile intégral en public (S.A.S. c. France, précité, § 153).
53. Toutefois, l’État défendeur a entendu, en adoptant les dispositions litigieuses, répondre à une pratique qu’il jugeait incompatible, dans la société belge, avec les modalités de communication sociale et plus généralement l’établissement de rapports humains indispensables à la vie en société (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 décembre 2012, considérant B.21, cité au paragraphe 27, ci-dessus). Ce faisant, il s’agissait de protéger une modalité d’interaction entre les individus essentielle, pour l’État défendeur, au fonctionnement d’une société démocratique (voir l’arrêt précité, considérant B.28, cité au paragraphe 27, ci-dessus). Dans cette perspective, à l’instar de la situation qui s’est présentée en France (S.A.S. c. France, précité, § 153), il apparaît que la question de l’acception ou non du port du voile intégral dans l’espace public belge constitue un choix de société.
54. La Cour réitère, comme elle l’a souligné dans l’arrêt S.A.S. c. France précité (§§ 153-155), que dans un tel cas de figure elle se doit de faire preuve de réserve dans l’exercice de son contrôle de conventionalité dès lors qu’il la conduit à évaluer un arbitrage effectué selon des modalités démocratiques au sein de la société belge. À ce sujet, elle relève que le processus décisionnel ayant débouché sur l’interdiction en cause a duré plusieurs années et a été marqué par un large débat au sein de la Chambre des représentants ainsi que par un examen circonstancié et complet de l’ensemble des intérêts en jeu par la Cour constitutionnelle.
55. La Cour souligne en outre qu’il n’y a, entre les États membres du Conseil de l’Europe, toujours aucun consensus en la matière, que ce soit pour ou contre une interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public, ce qui justifie de l’avis de la Cour de reconnaître à l’État défendeur une marge d’appréciation très large (S.A.S. c. France, précité, § 156).
56. Reste, pour conclure sur la proportionnalité de la restriction en l’espèce, à examiner la manière dont la règle est appliquée en cas d’infraction. Sur ce point, la loi belge, qui assortit l’interdiction d’une sanction pénale pouvant aller jusqu’à une peine d’emprisonnement (voir paragraphe 17, ci-dessus), se distingue de la législation française qui ne prévoit qu’une peine d’amende. Le poids à donner à ce facteur n’a donc pas été évalué par la Grande Chambre dans l’affaire S.A.S. c. France précitée.
57. La Cour observe que la sanction retenue en premier lieu par le législateur belge, à savoir l’amende, est la sanction pénale la plus légère (voir considérant B.29.1 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, cité au paragraphe 27, ci-dessus et, mutatis mutandis, S.A.S. c. France, précité, § 152), et qu’une sanction plus lourde, à savoir la peine d’emprisonnement, ne peut être appliquée qu’en cas de récidive (voir le considérant précité de l’arrêt de la Cour constitutionnelle).
58. Des explications fournies par le Gouvernement (voir paragraphe 43, ci-dessus), la Cour constate que l’application de la loi par les juridictions pénales doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité et de la Convention et que la lourdeur de la sanction d’emprisonnement à laquelle les requérantes pourraient théoriquement être exposées est tempérée au niveau de sa mise en œuvre par l’absence d’automatisme dans son application.
59. La Cour relève en outre que la situation belge est caractérisée par le fait que l’infraction de dissimulation du visage dans l’espace public est une infraction « mixte » relevant tant de la procédure pénale que de l’action administrative et que, dans le cadre de cette dernière, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, des mesures alternatives sont possibles et entreprises en pratique au niveau communal.
60. Pour le reste, la Cour relève que la présente requête ne porte pas sur une sanction spécifique dont les requérantes auraient fait l’objet. Elle est d’avis que l’appréciation in concreto du caractère proportionné d’une sanction qui devrait être imposée sur base de la loi du 1er juin 2011 est une tâche qui relève de la compétence du juge national, le rôle de la Cour se limitant à constater, conformément au caractère subsidiaire de son contrôle, un éventuel dépassement de la marge d’appréciation accordée à l’État défendeur.
61. En conséquence, notamment au regard de l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur en l’espèce, la Cour conclut que l’interdiction que pose la loi du 1er juin 2011, quoique controversée et présentant indéniablement des risques en termes de promotion de la tolérance au sein de la société (S.A.S. c. France, précité, §§ 146-149), peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation des conditions du « vivre ensemble » en tant qu’élément de la « protection des droits et libertés d’autrui ».
62. La restriction litigieuse peut donc passer pour « nécessaire », « dans une société démocratique ». Cette conclusion vaut au regard de l’article 8 de la Convention comme de l’article 9.
63. Partant, il n’y a eu violation ni de l’article 8 ni de l’article 9 de la Convention.
COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
Grande Chambre Arrêt C2017/204 Bougnaoui et ADDH du 14 mars 2017 affaire C188/15
Si un client demande qu'une femme voilée n'intervienne pas dans son entreprise, l'employeur peut accepter r cette demande sans que cette demande soit considérée comme "une exigence professionnelle essentielle et déterminante" au sens de l'article 4 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, et par conséquent, ne peut constituer une discrimination.
«Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur la religion ou les convictions – Exigence professionnelle essentielle et déterminante – Notion – Souhait d’un client de ne pas voir les prestations assurées par une travailleuse portant un foulard islamique »
Dans l’affaire C‑188/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 9 avril 2015, parvenue à la Cour le 24 avril 2015, dans la procédure
Asma Bougnaoui,
Association de défense des droits de l’homme (ADDH)
contre
Micropole SA, anciennement Micropole Univers SA,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, Mme M. Berger, MM. M. Vilaras et E. Regan, présidents de chambre, MM. A. Rosas, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, F. Biltgen (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2016,
considérant les observations présentées :
– pour Mme Bougnaoui et l’Association de défense des droits de l’homme (ADDH), par Me C. Waquet, avocate,
– pour Micropole SA, par Me D. Célice, avocat,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer‑Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren ainsi que par MM. E. Karlsson et L. Swedenborg, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Simmons, en qualité d’agent, assistée de M. A. Bates, barrister,
– pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et M. Van Hoof, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Asma Bougnaoui et l’Association de défense des droits de l’homme (ADDH), d’une part, à Micropole SA, anciennement Micropole Univers SA (ci-après « Micropole »), d’autre part, au sujet du licenciement par cette dernière de Mme Bougnaoui au motif que celle-ci refusait de retirer son foulard islamique lorsqu’elle était en mission auprès des clients de cette entreprise.
Le cadre juridique
La directive 2000/78
3 Les considérants 1, 4 et 23 de la directive 2000/78 prévoient :
« (1) Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs à tous les États membres et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.
[...]
(4) Le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme, par la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signés par tous les États membres. La Convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail interdit la discrimination en matière d’emploi et de travail.
[...]
(23) Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Ces circonstances doivent être mentionnées dans les informations fournies par les États membres à la Commission. »
4 L’article 1er de la directive 2000/78 dispose :
« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »
5 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit :
« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :
i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, [...]
[...] »
6 L’article 3, paragraphe 1, de la même directive dispose :
« Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:
[...]
c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;
[...] »
7 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 prévoit :
« Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. »
Le droit français
8 Les dispositions de la directive 2000/78 ont fait l’objet d’une transposition en droit français, notamment, aux articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail tels qu’issus de la loi n° 2008-496, du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (JORF du 28 mai 2008, p. 8801).
9 L’article L. 1121-1 du code du travail dispose :
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
10 L’article L. 1132-1 dudit code, dans sa version en vigueur à la date des faits en cause au principal, prévoyait :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, [...], de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
11 L’article L. 1133-1 du même code est libellé comme suit :
« L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. »
12 L’article L. 1321-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits en cause au principal, disposait :
« Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, [...], de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
13 Il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que Mme Bougnaoui a rencontré, au mois d’octobre 2007, lors d’une foire étudiante, préalablement à son embauche par l’entreprise privée Micropole, un représentant de celle-ci, qui l’a informée du fait que le port du foulard islamique pourrait poser problème quand elle serait en contact avec les clients de cette société. Lorsque Mme Bougnaoui s’est présentée, le 4 février 2008, à Micropole pour y effectuer son stage de fin d’études, elle portait un simple bandana. Par la suite, elle a porté un foulard islamique sur son lieu du travail. À la fin de ce stage, Micropole l’a engagée, à compter du 15 juillet 2008, sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur d’études.
14 Après avoir été convoquée, le 15 juin 2009, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, Mme Bougnaoui a été licenciée par une lettre du 22 juin 2009 rédigée comme suit:
« [...] Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amenée à intervenir sur des missions pour le compte de nos clients.
Nous vous avons demandé d’intervenir pour le client [...] le 15 mai dernier sur [son] site [...] À la suite de cette intervention, le client nous a indiqué que le port du voile, que vous portez effectivement tous les jours, avait gêné un certain nombre de ses collaborateurs. Il a également demandé à ce qu’il n’y ait “pas de voile la prochaine fois”.
Lors de votre embauche dans notre société et de vos entretiens avec votre Manager opérationnel [...] et la Responsable du recrutement [...], le sujet du port du voile avait été abordé très clairement avec vous. Nous vous avions précisé que nous respections totalement le principe de liberté d’opinion ainsi que les convictions religieuses de chacun, mais que, dès lors que vous seriez en contact en interne ou en externe avec les clients de l’entreprise, vous ne pourriez porter le voile en toutes circonstances. En effet, dans l’intérêt et pour le développement de l’entreprise, nous sommes contraints, vis-à-vis de nos clients, de faire en sorte que la discrétion soit de mise quant à l’expression des options personnelles de nos salariés.
Lors de notre entretien du 17 juin dernier, nous vous avons réaffirmé ce principe de nécessaire neutralité que nous vous demandions d’appliquer à l’égard de notre clientèle. Nous vous avons à nouveau demandé si vous pouviez accepter ces contraintes professionnelles en acceptant de ne pas porter le voile et vous nous avez répondu par la négative.
Nous considérons que ces faits justifient, pour les raisons susmentionnées, la rupture de votre contrat de travail. Dans la mesure où votre position rend impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise, puisque nous ne pouvons envisager, de votre fait, la poursuite de prestations chez nos clients, vous ne pourrez effectuer votre préavis. Cette inexécution du préavis vous étant imputable, votre préavis ne vous sera pas rémunéré.
Nous regrettons cette situation dans la mesure où vos compétences professionnelles et votre potentiel nous laissaient espérer une collaboration durable. »
15 Considérant que ce licenciement était discriminatoire, Mme Bougnaoui a introduit, le 8 septembre 2009, un recours devant le conseil de prud’hommes de Paris (France). Celui-ci a, le 4 mai 2011, condamné Micropole au paiement d’une indemnité de préavis pour ne pas avoir indiqué dans sa lettre de licenciement la gravité de la faute reprochée à Mme Bougnaoui et a rejeté le recours pour le surplus, au motif que la restriction à la liberté de Mme Bougnaoui de porter le foulard islamique était justifiée par le contact de cette dernière avec des clients de cette société et proportionnée au but recherché par Micropole tendant à la préservation de l’image de celle-ci et à ne pas heurter les convictions de ses clients.
16 Mme Bougnaoui, soutenue par l’ADDH, a introduit un appel contre cette décision devant la cour d’appel de Paris (France). Par décision du 18 avril 2013, celle-ci a confirmé la décision du conseil de prud’hommes de Paris. Dans sa décision, elle a notamment jugé que le licenciement de Mme Bougnaoui ne procédait pas d’une discrimination tenant aux convictions religieuses de la salariée, puisque celle-ci était autorisée à continuer à les exprimer au sein de l’entreprise, et qu’il était justifié par une restriction légitime procédant des intérêts de l’entreprise alors que l’exercice, par la salariée, de la liberté de manifester ses convictions religieuses allait au-delà du périmètre de l’entreprise et s’imposait aux clients de cette dernière sans considération pour leurs sensibilités, ce qui empiétait sur les droits d’autrui.
17 Mme Bougnaoui et l’ADDH ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation (France) contre la décision du 18 avril 2013. Elles ont fait valoir devant cette juridiction que la cour d’appel de Paris avait notamment violé les articles L. 1121-1, L. 1321-3 et L. 1132-1 du code du travail. En effet, les restrictions à la liberté religieuse devraient être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour autant que l’objectif est légitime et l’exigence est proportionnée. Or, le port du foulard islamique par une salariée d’une entreprise privée, en contact avec la clientèle, ne porterait pas atteinte aux droits ou aux convictions d’autrui et la gêne ou la sensibilité de la clientèle d’une société commerciale, prétendument éprouvée à la seule vue d’un signe d’appartenance religieuse, ne constituerait un critère ni opérant ni légitime, étranger à toute discrimination, justifiant de faire prévaloir des intérêts économiques ou commerciaux de ladite société sur la liberté fondamentale de religion d’un salarié.
18 La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par les requérantes au principal, relève que, dans son arrêt du 10 juillet 2008, Feryn (C‑54/07, EU:C:2008:397), la Cour s’est bornée à dire pour droit que le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu’il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale constitue une discrimination directe à l’embauche au sens de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22), mais ne s’est pas prononcée sur le point de savoir si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’un employeur de ne plus voir les prestations de services de celui-ci assurées par un travailleur pour l’un des motifs visés par cette dernière directive.
19 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d’études, portant un foulard islamique ? »
Sur la demande de réouverture de la procédure orale
20 Après la présentation des conclusions de Mme l’avocat général, Micropole a introduit, le 18 novembre 2016, une demande de réouverture de la procédure orale au titre de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.
21 À l’appui de sa demande, Micropole a avancé que la Cour devait prendre connaissance de ses observations après le prononcé desdites conclusions et qu’elle souhaitait apporter des informations complémentaires à la Cour.
22 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
23 En l’espèce, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le recours dont elle est saisie et que celui‑ci ne doit pas être tranché sur le fondement d’un argument qui n’a pas été débattu devant elle.
24 Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réouverture formée par Micropole.
Sur la question préjudicielle
25 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition.
26 En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément à l’article 1er de ladite directive, celle-ci a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.
27 S’agissant de la notion de « religion », figurant à l’article 1er de cette directive, il convient de relever que cette directive ne contient pas de définition de ladite notion.
28 Néanmoins, le législateur de l’Union s’est référé, au considérant 1 de la directive 2000/78, aux droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), qui prévoit, à son article 9, que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit impliquant, notamment, la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
29 Au même considérant, le législateur de l’Union s’est également référé aux traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit de l’Union. Or, parmi les droits qui résultent de ces traditions communes et qui ont été réaffirmés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), figure le droit à la liberté de conscience et de religion consacré à l’article 10, paragraphe 1, de la Charte. Conformément à cette disposition, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public, ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de rites. Ainsi qu’il ressort des explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), le droit garanti à l’article 10, paragraphe 1, de celle-ci correspond au droit garanti à l’article 9 de la CEDH et, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, il a le même sens et la même portée que celui-ci.
30 Dans la mesure où la CEDH et, par la suite, la Charte donnent une acception large de la notion de « religion », en ce qu’elles incluent dans cette notion la liberté des personnes de manifester leur religion, il y a lieu de considérer que le législateur de l’Union a entendu retenir la même approche lors de l’adoption de la directive 2000/78 de sorte qu’il convient d’interpréter la notion de « religion » figurant à l’article 1er de cette directive comme couvrant tant le forum internum, à savoir le fait d’avoir des convictions, que le forum externum, à savoir la manifestation en public de la foi religieuse.
31 En second lieu, il convient de constater que la décision de renvoi ne permet pas de savoir si la question de la juridiction de renvoi repose sur le constat d’une différence de traitement directement fondée sur la religion ou les convictions ou sur celui d’une différence de traitement indirectement fondée sur de tels critères.
32 À cet égard, si, ce qu’il appartient à cette juridiction de vérifier, le licenciement de Mme Bougnaoui a été fondé sur le non-respect d’une règle interne qui était en vigueur au sein de cette entreprise, interdisant le port de tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses, et s’il devait apparaître que cette règle en apparence neutre aboutit, en fait, à un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, telles que Mme Bougnaoui, il y aurait lieu de conclure à l’existence d’une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou sur les convictions, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, G4S Secure Solutions, C-157/15, points 30 et 34).
33 Toutefois, conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), i), de cette directive, une telle différence de traitement ne serait pas constitutive d’une discrimination indirecte, si elle était objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la mise en œuvre, par Micropole, d’une politique de neutralité à l’égard de ses clients, et si les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, G4S Secure Solutions, C-157/15, points 35 à 43).
34 En revanche, pour le cas où le licenciement de Mme Bougnaoui ne serait pas fondé sur l’existence d’une règle interne telle que visée au point 32 du présent arrêt, il convient d’examiner, ainsi qu’y invite la question de la juridiction de renvoi, si la volonté d’un employeur de tenir compte du souhait d’un client de ne plus voir de services fournis par une travailleuse qui, telle Mme Bougnaoui, a été assignée par cet employeur auprès de ce client et qui porte un foulard islamique, constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78.
35 À cet égard, selon les termes de cette disposition, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er de ladite directive ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif est légitime et que l’exigence est proportionnée.
36 Ainsi, il appartient aux États membres de prévoir, le cas échéant, qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er de la même directive ne constitue pas une discrimination. Tel paraît être le cas en l’espèce, en vertu de l’article L. 1133-1 du code du travail, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
37 Cela étant précisé, il convient de rappeler que la Cour a itérativement jugé qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 que c’est non pas le motif sur lequel est fondée la différence de traitement, mais une caractéristique liée à ce motif qui doit constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante (voir arrêts du 12 janvier 2010, Wolf, C‑229/08, EU:C:2010:3, point 35 ; du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C‑447/09, EU:C:2011:573, point 66 ; du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, point 36, ainsi que du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C‑258/15, EU:C:2016:873, point 33).
38 Il convient, par ailleurs, de souligner que, conformément au considérant 23 de la directive 2000/78, ce n’est que dans des conditions très limitées qu’une caractéristique liée, notamment, à la religion peut constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
39 Il importe également de souligner que, selon les termes mêmes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, la caractéristique en cause ne peut constituer une telle exigence qu’« en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice ».
40 Il résulte de ces différentes indications que la notion d’« exigence professionnelle essentielle et déterminante », au sens de cette disposition, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause. Elle ne saurait, en revanche, couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client.
41 Il convient par conséquent de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition.
Sur les dépens
42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition.
Grande Chambre Arrêt C2017/203 G4S Secure Solutions du 14 mars 2017 affaire C157/15
Ne constitue pas une discrimination au sens de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 , l'interdiction de port de signes ostensibles et extérieurs religieux, politiques ou philosophiques du personnel d'une entreprise en contact avec les clients, quand cette entreprise veut afficher vis à vis de ses clients, une neutralité imposée à tous ses salariés ayant eux même un contact avec les clients.
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur la religion ou les convictions – Règlement intérieur d’une entreprise interdisant aux travailleurs le port de signes visibles de nature politique, philosophique ou religieuse sur le lieu de travail – Discrimination directe – Absence – Discrimination indirecte – Interdiction faite à une travailleuse de porter un foulard islamique »
Dans l’affaire C‑157/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décision du 9 mars 2015, parvenue à la Cour le 3 avril 2015, dans la procédure
Samira Achbita,
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
contre
G4S Secure Solutions NV,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, Mme M. Berger, MM. M. Vilaras et E. Regan, présidents de chambre, MM. A. Rosas, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, F. Biltgen (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2016,
considérant les observations présentées :
– pour le Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, par Mes C. Bayart et I. Bosmans, advocaten,
– pour G4S Secure Solutions NV, par Mes S. Raets et I. Verhelst, advocaten,
– pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et M. Jacobs, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes J. Kraehling, S. Simmons et C. R. Brodie, en qualité d’agents, assistées de M. A. Bates, barrister,
– pour la Commission européenne, par MM. G. Wils et D. Martin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 mai 2016,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Samira Achbita et le Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, ci-après le « Centrum »), d’une part, à G4S Secure Solutions NV (ci-après « G4S »), une société ayant son siège en Belgique, d’autre part, au sujet de l’interdiction faite par G4S à ses employés de porter sur leur lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses et d’accomplir tout rite afférent à ces convictions.
Le cadre juridique
La directive 2000/78
3 Les considérants 1 et 4 de la directive 2000/78 prévoient :
« (1) Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs à tous les États membres et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.
[...]
(4) Le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme, par la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signés par tous les États membres. La Convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail interdit la discrimination en matière d’emploi et de travail. »
4 L’article 1er de la directive 2000/78 dispose :
« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »
5 L’article 2 de ladite directive prévoit :
« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :
i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, [...]
[...]
5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6 L’article 3, paragraphe 1, de la même directive dispose :
« Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :
[...]
c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;
[...] »
Le droit belge
7 La wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), du 25 février 2003 (Belgisch Staatsblad, du 17 mars 2003, p. 12844), vise, notamment, à transposer les dispositions de la directive 2000/78.
8 L’article 2, paragraphe 1er, de ladite loi énonce :
« Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique. »
9 L’article 2, paragraphe 2, de la même loi dispose :
« Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s’applique un des motifs de discrimination visés au paragraphe 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 G4S est une entreprise privée qui fournit, notamment, des services de réception et d’accueil à des clients appartenant tant au secteur public qu’au secteur privé.
11 Le 12 février 2003, Mme Achbita, de confession musulmane, a commencé à travailler comme réceptionniste pour le compte de G4S. Elle était employée par cette dernière sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il prévalait, alors, une règle non écrite au sein de G4S en vertu de laquelle les travailleurs ne pouvaient pas porter sur le lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.
12 Au mois d’avril 2006, Mme Achbita a fait savoir à ses supérieurs hiérarchiques qu’elle avait désormais l’intention de porter le foulard islamique pendant les heures de travail.
13 En réponse, la direction de G4S a informé Mme Achbita que le port d’un foulard ne serait pas toléré car le port visible de signes politiques, philosophiques ou religieux était contraire à la neutralité à laquelle s’astreignait l’entreprise.
14 Le 12 mai 2006, après un arrêt de travail pour cause de maladie, Mme Achbita a fait savoir à son employeur qu’elle reprendrait le travail le 15 mai et qu’elle allait porter le foulard islamique.
15 Le 29 mai 2006, le comité d’entreprise de G4S a approuvé une modification du règlement intérieur, qui est entrée en vigueur le 13 juin 2006, aux termes de laquelle « il est interdit aux travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses ou d’accomplir tout rite qui en découle ».
16 Le 12 juin 2006, en raison de la volonté persistante, manifestée par Mme Achbita, de porter, en tant que musulmane, le foulard islamique sur son lieu de travail, celle-ci a été licenciée. Elle a reçu le paiement d’une indemnité de licenciement correspondant à trois mois de salaire et des avantages acquis en vertu du contrat de travail.
17 À la suite du rejet du recours introduit par Mme Achbita contre ce licenciement devant l’arbeidsrechtbank te Antwerpen (tribunal du travail d’Anvers, Belgique), celle-ci a interjeté appel de cette décision devant l’arbeidshof te Antwerpen (cour du travail d’Anvers, Belgique). Cet appel a été rejeté au motif, notamment, que le licenciement ne pouvait pas être considéré comme injustifié dès lors que l’interdiction générale de porter sur le lieu de travail des signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses n’entraînait pas de discrimination directe et qu’aucune discrimination indirecte ou violation de la liberté individuelle ou de la liberté de religion n’était manifeste.
18 S’agissant de l’absence de discrimination directe, cette dernière juridiction a plus précisément relevé qu’il est constant que Mme Achbita a été licenciée en raison non pas de sa foi musulmane, mais du fait qu’elle persistait à vouloir manifester celle-ci, de manière visible, pendant les heures de travail, en portant un foulard islamique. La disposition du règlement intérieur, enfreinte par Mme Achbita, aurait une portée générale en ce qu’elle interdit à tout travailleur de porter sur son lieu de travail des signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Aucun fait ne permettrait de présumer que G4S ait adopté un comportement plus conciliant à l’égard d’un autre salarié placé dans une situation comparable, en particulier à l’égard d’un travailleur ayant d’autres convictions religieuses ou philosophiques qui aurait refusé durablement de respecter cette interdiction.
19 L’arbeidshof te Antwerpen (cour du travail d’Anvers) a rejeté l’argument selon lequel l’interdiction, édictée au sein de G4S, de porter des signes visibles de convictions religieuses ou philosophiques constituerait en soi une discrimination directe de Mme Achbita en tant que croyante, en considérant que cette interdiction concernait non pas uniquement le port de signes se rapportant à des convictions religieuses, mais aussi le port de signes se rapportant à des convictions philosophiques, respectant en cela le critère de protection retenu par la directive 2000/78 qui parle de « religion ou [de] convictions ».
20 À l’appui de son pourvoi en cassation, Mme Achbita fait valoir, notamment, que, en considérant que la conviction religieuse sur laquelle est fondée l’interdiction édictée par G4S constitue un critère neutre et en ne qualifiant pas cette interdiction d’inégalité de traitement entre les travailleurs qui portent un foulard islamique et ceux qui n’en portent pas, au motif que ladite interdiction ne vise pas une conviction religieuse déterminée et qu’elle s’adresse à tous les travailleurs, l’arbeidshof te Antwerpen (cour du travail d’Anvers) a méconnu les notions de « discrimination directe » et de « discrimination indirecte » au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78.
21 Dans ces conditions, le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 doit-il être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard en tant que musulmane sur le lieu de travail ne constitue pas une discrimination directe lorsque la règle en vigueur chez l’employeur interdit à tous les travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes extérieurs de convictions politiques, philosophiques ou religieuses ? »
Sur la question préjudicielle
22 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant de manière générale le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, constitue une discrimination directe prohibée par cette directive.
23 En premier lieu, conformément à l’article 1er de la directive 2000/78, celle-ci a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou sur les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.
24 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, « on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er » de cette directive. L’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive précise que, pour les besoins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci, une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable que l’est une autre personne se trouvant dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs, dont la religion, visés à l’article 1er de la même directive.
25 S’agissant de la notion de « religion » figurant à l’article 1er de la directive 2000/78, il convient de relever que cette directive ne contient pas de définition de ladite notion.
26 Néanmoins, le législateur de l’Union s’est référé, au considérant 1 de la directive 2000/78, aux droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), qui prévoit, à son article 9, que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit impliquant, notamment, la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
27 Au même considérant, le législateur de l’Union s’est également référé aux traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit de l’Union. Or, parmi les droits qui résultent de ces traditions communes et qui ont été réaffirmés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), figure le droit à la liberté de conscience et de religion consacré à l’article 10, paragraphe 1, de la Charte. Conformément à cette disposition, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public, ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de rites. Ainsi qu’il ressort des explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), le droit garanti à l’article 10, paragraphe 1, de celle-ci correspond au droit garanti à l’article 9 de la CEDH et, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, il a le même sens et la même portée que celui-ci.
28 Dans la mesure où la CEDH et, par la suite, la Charte donnent une acception large de la notion de « religion », en ce qu’elles incluent dans cette notion la liberté des personnes de manifester leur religion, il y a lieu de considérer que le législateur de l’Union a entendu retenir la même approche lors de l’adoption de la directive 2000/78, de sorte qu’il convient d’interpréter la notion de « religion » figurant à l’article 1er de cette directive comme couvrant tant le forum internum, à savoir le fait d’avoir des convictions, que le forum externum, à savoir la manifestation en public de la foi religieuse.
29 Il importe, en second lieu, de déterminer s’il résulte de la règle interne en cause au principal une différence de traitement entre les travailleurs en fonction de leur religion ou de leurs convictions et, dans l’affirmative, si cette différence de traitement constitue une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78.
30 En l’occurrence, la règle interne en cause au principal se réfère au port de signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses et vise donc indifféremment toute manifestation de telles convictions. Ladite règle doit, dès lors, être considérée comme traitant de manière identique tous les travailleurs de l’entreprise, en leur imposant, de manière générale et indifférenciée, notamment une neutralité vestimentaire s’opposant au port de tels signes.
31 À cet égard, il ne ressort pas des éléments du dossier dont dispose la Cour que l’application de la règle interne en cause au principal à Mme Achbita ait été différente de l’application de cette règle à tout autre travailleur.
32 Partant, il convient de conclure qu’une règle interne telle que celle en cause au principal n’instaure pas de différence de traitement directement fondée sur la religion ou sur les convictions, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78.
33 Cela étant, en vertu d’une jurisprudence constante, le fait que la juridiction de renvoi a formulé une question en se référant seulement à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir, notamment, arrêt du 12 février 2015, Oil Trading Poland, C‑349/13, EU:C:2015:84, point 45 et jurisprudence citée).
34 En l’occurrence, il n’est pas exclu que la juridiction de renvoi puisse arriver à la conclusion que la règle interne en cause au principal instaure une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou sur les convictions, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78, s’il est établi, ce qu’il lui appartient de vérifier, que l’obligation en apparence neutre qu’elle contient aboutit, en fait, à un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données.
35 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), i), de la directive 2000/78, une telle différence de traitement ne serait toutefois pas constitutive d’une discrimination indirecte, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, si elle était objectivement justifiée par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires.
36 À cet égard, il convient de relever que, s’il appartient en dernier lieu au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits, de déterminer si et dans quelle mesure la règle interne en cause au principal est conforme à ces exigences, la Cour, appelée à fournir au juge national des réponses utiles, est compétente pour donner des indications, tirées du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales qui lui ont été soumises, de nature à permettre à ce même juge de statuer dans le litige concret dont il est saisi.
37 S’agissant, en premier lieu, de la condition relative à l’existence d’un objectif légitime, il convient de relever que la volonté d’afficher, dans les relations avec les clients tant publics que privés, une politique de neutralité politique, philosophique ou religieuse doit être considérée comme légitime.
38 En effet, le souhait d’un employeur d’afficher une image de neutralité à l’égard des clients se rapporte à la liberté d’entreprise, reconnue à l’article 16 de la Charte, et revêt, en principe, un caractère légitime, notamment lorsque seuls sont impliqués par l’employeur dans la poursuite de cet objectif les travailleurs qui sont supposés entrer en contact avec les clients de l’employeur.
39 L’interprétation selon laquelle la poursuite d’un tel objectif permet, dans certaines limites, d’apporter une restriction à la liberté de religion est d’ailleurs corroborée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 9 de la CEDH (arrêt de la Cour EDH du 15 janvier 2013, Eweida et autres c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2013:0115JUD004842010, point 94).
40 En ce qui concerne, en deuxième lieu, le caractère approprié d’une règle interne telle que celle en cause au principal, il y a lieu de constater que le fait d’interdire aux travailleurs le port visible de signes de convictions politiques, philosophiques ou religieuses est apte à assurer la bonne application d’une politique de neutralité, à condition que cette politique soit véritablement poursuivie de manière cohérente et systématique (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2009, Hartlauer, C‑169/07, EU:C:2009:141, point 55, et du 12 janvier 2010, Petersen, C‑341/08, EU:C:2010:4, point 53).
41 À cet égard, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si G4S avait établi, préalablement au licenciement de Mme Achbita, une politique générale et indifférenciée d’interdiction du port visible des signes de convictions politiques, philosophiques ou religieuses à l’égard des membres de son personnel en contact avec ses clients.
42 S’agissant, en troisième lieu, du caractère nécessaire de l’interdiction en cause au principal, il convient de vérifier si cette interdiction se limite au strict nécessaire. En l’occurrence, il faut vérifier si l’interdiction du port visible de tout signe ou vêtement susceptible d’être associé à une croyance religieuse ou à une conviction politique ou philosophique vise uniquement les travailleurs de G4S qui sont en relation avec les clients. Si tel est le cas, ladite interdiction doit être considérée comme strictement nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
43 En l’occurrence, s’agissant du refus d’une travailleuse telle que Mme Achbita de renoncer au port du foulard islamique dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès de clients de G4S, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise, et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il eût été possible à G4S, face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement. Il incombe à la juridiction de renvoi, eu égard à tous les éléments du dossier, de tenir compte des intérêts en présence et de limiter les restrictions aux libertés en cause au strict nécessaire.
44 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi comme suit :
– L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive.
– En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive.
En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION CONSÉQUENT
COUR DE CASSATION Chambre sociale, arrêt du 22 novembre 2017, pourvoi n° 13-19855 cassation
Vu les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, L. 1133-1, L. 1321-3, 2°, du code du
travail, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles
2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, §
2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la
tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché ; qu'aux termes de l'article L.
1321-3, 2°, du code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et
collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
Attendu que, saisie par la Cour de cassation dans le présent pourvoi d'une
question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du
14 mars 2017 (CJUE, Asma X..., aff. C-188/15), a dit pour droit : "L'article 4,
paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000,
portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté
d'un employeur de tenir compte des souhaits d'un client de ne plus voir les
services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard
islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle
essentielle et déterminante au sens de cette disposition" ;
Attendu, par ailleurs, que, par arrêt du même jour (CJUE, 14 mars 2017, G4S
Secure Solutions, C-157/15), la Cour de justice a dit pour droit : "L'article 2,
paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre
2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement
en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que
l'interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d'une règle interne
d'une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique,
philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une
discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de
cette directive ; qu'en revanche, une telle règle interne d'une entreprise
privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de
l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE s'il est établi
que l'obligation en apparence neutre qu'elle prévoit entraîne, en fait, un
désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des
convictions données, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée par un
objectif légitime, tel que la poursuite par l'employeur, dans ses relations avec
ses clients, d'une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que
religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et
nécessaires, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier" ;
Attendu que la Cour de justice a précisé, dans les motifs de cette dernière
décision (§ 43), s'agissant du refus d'une salariée de renoncer au port du
foulard islamique dans l'exercice de ses activités professionnelles auprès de
clients de l'employeur, qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier
si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l'entreprise, et sans que
celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il eût été possible à
l'employeur, face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail
n'impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à
son licenciement;
Attendu qu'il en résulte que l'employeur, investi de la mission de faire
respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et droits
fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de
l'entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le
règlement intérieur, en application de l'article L. 1321-5 du code du travail,
une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique,
philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause
générale et indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en
contact avec les clients ; qu'en présence du refus d'une salariée de se
conformer à une telle clause dans l'exercice de ses activités professionnelles
auprès des clients de l'entreprise, il appartient à l'employeur de rechercher
si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l'entreprise et sans que
celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer
à la salariée un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec ces
clients, plutôt que de procéder à son licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 15
juillet 2008 par contrat de travail à durée indéterminée par la société
Micropole univers, société de conseil, d'ingénierie et de formation spécialisée
dans le développement et l'intégration de solutions décisionnelles, en qualité
d'ingénieur d'études ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un
éventuel licenciement le 15 juin 2009 et licenciée par lettre du 22 juin 2009
pour faute pour avoir refusé d'ôter son foulard islamique lorsqu'elle
intervenait dans des entreprises clientes de la société ; que la salariée a
saisi le 10 novembre 2009 la juridiction prud'homale en contestant son
licenciement et en faisant valoir qu'il constituait une mesure discriminatoire
en raison de ses convictions religieuses ;
Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
l'arrêt retient qu'une entreprise doit tenir compte de la diversité des clients
et de leurs convictions et qu'elle est donc naturellement amenée à imposer aux
employés qu'elle envoie au contact de sa clientèle une obligation de discrétion
qui respecte les convictions de chacun, à la condition toutefois que la
restriction qui en résulte soit justifiée par la nature de la tâche à effectuer
et proportionnée au but recherché, qu'en l'espèce, il est établi qu'une société
cliente a souhaité que les interventions de la salariée se fassent désormais
sans port de voile afin de ne pas gêner certains de ses collaborateurs, que la
restriction que l'employeur a alors imposée à la liberté de la salariée de
manifester ses convictions religieuses par sa tenue vestimentaire a été
proportionnée au but recherché puisque seulement limitée aux contacts avec la
clientèle, les travaux effectués dans ses locaux par un ingénieur d'études
portant un voile ne lui créant aucune difficulté selon ses propres déclarations,
qu'ainsi, il apparaît que le licenciement ne procède pas d'une discrimination
tenant à ses convictions religieuses puisque la salariée était autorisée à
continuer à les exprimer au sein de l'entreprise mais qu'il est justifié par une
restriction légitime procédant des intérêts de l'entreprise alors que la liberté
donnée à la salariée de manifester ses convictions religieuses débordait le
périmètre de l'entreprise et empiétait sur les sensibilités de ses clients et donc sur les droits d'autrui ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique,
philosophique ou religieux sur le lieu de travail n'était prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service soumise aux
mêmes dispositions que le règlement intérieur en application de l'article L. 1321-5 du code du travail et que l'interdiction faite à la salariée de porter le
foulard islamique dans ses contacts avec les clients résultait seulement d'un ordre oral donné à une salariée et visant un signe religieux déterminé, ce dont
il résultait l'existence d'une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses, et alors qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice
en réponse à la question préjudicielle posée que la volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits d'un client de ne plus voir les services dudit
employeur assurés par une salariée portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au
sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive du 27 novembre 2000, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Micropole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X... et à l'association ADDH ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Le port de la burka est condamné mais la peine prononcée est illégale
COUR DE CASSATION Chambre criminelle, arrêt du 5 mars 2013, pourvoi n° 12-80891 cassation partielle avec renvoi
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., le visage dissimulé, a été interpellée par les forces de police, à proximité du palais de l'Elysée, où elle s'était rendue en compagnie d'autres personnes portant des masques, et de journalistes ; que, conduite au commissariat, l'intéressée a refusé de dévoiler son visage
Attendu que, poursuivie pour avoir enfreint les dispositions de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, la prévenue, représentée par un avocat, a soutenu qu'elle avait agi dans l'exercice paisible de ses convictions religieuses et qu'elle entendait attaquer ladite loi qui, selon elle, violait le droit et, plus précisément, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant la liberté de pensée, de conscience et de religion
Attendu que, pour écarter cette argumentation, le jugement énonce qu'une manifestation politique devant la Présidence de la République, en compagnie de personnes portant des masques de carnaval ne peut entrer dans l'exercice de la liberté religieuse et qu'une telle manifestation ainsi que le maintien de la dissimulation du visage dans un commissariat de police, portent nécessairement atteinte à l'ordre public
Attendu que, si c'est à tort que la juridiction de proximité a ignoré la motivation religieuse de la manifestation considérée, le jugement n'encourt pas la censure dès lors que, si l'article 9 de la Convention susvisée garantit l'exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'alinéa 2 de ce texte dispose que cette liberté peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi et constituant, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel est le cas de la loi interdisant la dissimulation intégrale du visage dans l'espace public en ce qu'elle vise à protéger l'ordre et la sécurité publics en imposant à toute personne circulant dans un espace public, de montrer son visage
D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en ses deuxième et troisième branches en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la méconnaissance des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut être accueilli
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-3 et suivants du code pénal et 131-16 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale
Vu l'article 131-5-1 du code pénal
Attendu qu'aux termes de ce texte, la peine de stage de citoyenneté ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience
Attendu que, pour condamner Mme X..., non comparante à l'audience mais représentée par un avocat muni d'un pouvoir, déclarée coupable de la contravention susvisée, à accomplir un stage de citoyenneté, le jugement énonce que la présence de la prévenue n'est exigée que lorsque cette peine est prononcée en matière correctionnelle, l'article 131-16 8° du code pénal, applicable en matière contraventionnelle, n'imposant pas la présence de la prévenue à l'audience
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en l'absence de la prévenue, condamner celle-ci à accomplir un stage de citoyenneté, fût-ce pour une contravention, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 12 décembre 2011, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues
COUR DE CASSATION Chambre criminelle, arrêt du 5 mars 2013, pourvoi n° 12-80891 cassation partielle avec renvoi
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'espace public dans lequel il est interdit de porter une tenue destinée à dissimuler le visage est constitué des
voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ;
Attendu que, pour relaxer Mme Y..., le jugement énonce que celle-ci était encore à l'extérieur du commissariat lorsqu'elle a été contrôlée, et que ce
n'est qu'à l'initiative des fonctionnaires de police qu'elle est entrée dans cet établissement public, revêtue de son voile ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'est répréhensible le port, sur la voie publique, d'un voile couvrant
intégralement le visage, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue
LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ÉTAT SUR LE BURKINI
LE POUVOIR DE POLICE DU MAIRE N'EST JUSTIFIÉ QUE POUR LE MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC DANS SA COMMUNE ET NON PAS POUR D'AUTRES CONSIDÉRATIONS
Une trentaine de communes prennent des arrêtés pour interdire le burkini, suite à l'affaire de SISCO en Corse en date du samedi 13 août 2016, où des djihadistes avaient privatisé une plage et l'avaient défendue contre les touristes puis les enfants et les adolescents de la commune. Une femme musulmane s'était baignée non pas en burkini mais habillées entièrement.
Le débat sur le vêtement islamiste n'est pas arrivé à maturité en France puisqu'il s'agit d'un signe extérieur d'un Islam politique et non plus d'un signe religieux. Les parties qui débattent du sujet à droite comme à gauche confondent religion musulmane et djihad. Le Conseil Français du Culte Musulman est lui même gêné par la distinction à faire.
Si le débat reste sur l'ISLAM religieux l'interdiction par la loi n'est pas possible car il s'agirait d'une atteinte à la liberté religieuse. Si le débat mûrit et porte sur l'ISLAM politique, alors l'interdiction par la loi est possible puisque l'ISLAM politique est un ISLAM radical, cause d'attentats en France.
Avant même l'attentat de SISCO, le maire Lionel Lucas, de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) a été le premier à interdire le port de tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages.
Des associations et des particuliers demandaient la suspension de cette interdiction.
Le juge des référés du Conseil d’État rappelle, conformément à une jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, qu’il appartient au maire de concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois.
Les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public.
Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations. A Villeneuve-Loubet, aucun élément ne permet de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes.
En l’absence de tels risques, le maire ne pouvait prendre une mesure interdisant l’accès à la plage et la baignade.
Le juges des référés du Conseil d’État suspend donc cette mesure d’interdiction.
LES FAITS ET LA PROCÉDURELe 5 août 2016, le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) a pris un nouvel arrêté en vue de règlementer l’usage des plages concédées à la commune par l’État. Cet arrêté comporte un nouvel article 4.3 dont l’objet est d’interdire le port de tenues qui sont regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent accès à celle-ci.
La Ligue des droits de l’homme (LDH) et deux particuliers, d’une part,
l’Association de défense des droits de l’homme-Collectif contre l’islamophobie
en France, d’autre part, avaient formé un référé-liberté pour demander au juge
des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre cet article 4.3.
Cette procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de
justice administrative, permet au juge administratif d’ordonner, dans un délai
de quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une
liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une
atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le
requérant doit justifier d’une situation d’urgence particulière, justifiant que
le juge se prononce dans de brefs délais.
Par une ordonnance du 22 août 2016, le tribunal administratif de Nice, statuant
en formation collégiale de trois juges des référés, a rejeté les deux requêtes.
Les requérants ont alors fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État.
Après avoir tenu une audience publique le 25 août 2016, le juge des référés du
Conseil d’État, statuant également en formation collégiale de trois juges, a rendu aujourd’hui son ordonnance.
LA RÉPONSE DE L'ORDONNANCE EN RÉFÉRÉ DU CONSEIL D'ÉTAT DU 26 AOÛT 2016
Dans l’ordonnance qu’il a rendue le 26 août 2016, le juge des référés du Conseil
d’État commence par préciser le cadre juridique. Il rappelle que le maire est
chargé de la police municipale. Mais il souligne, conformément à une
jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, que le maire doit concilier
l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le
respect des libertés garanties par les lois. Les mesures de police que le maire
d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la
pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et
proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles
qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des
exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi
que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se
fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux
libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
Examinant ensuite l’arrêté contesté, le juge des référés du Conseil d’État
relève qu’aucun élément produit devant lui ne permet de retenir que des risques
de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de
Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines
personnes. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant
des attentats terroristes, notamment de celui commis à Nice le 14 juillet
dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction
contestée. Le juge des référés en déduit que, dans ces conditions, le maire ne
pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui
interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur
des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs
d’hygiène ou de décence.
Le juge des référés du Conseil d’État conclut donc que l’article 4.3 de l’arrêté
contesté a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés
fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et
la liberté personnelle. La situation d’urgence étant par ailleurs caractérisée,
il annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et ordonne la suspension de cet article.
L'ORDONNANCE EN RÉFÉRÉ DU CONSEIL D'ÉTAT DU 26 AOÛT 2016
Vu les procédures suivantes :
I - La Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des dispositions du 4.3 de l’article 4 de l’arrêté du 5 août 2016 du maire de la commune de Villeneuve-Loubet portant règlement de police, de sécurité et d'exploitation des plages concédées par l'Etat à la commune de Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance n° 1603508 et 1603523 du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23
et 25 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des
droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, demandent au juge des
référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont recevables à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté
contesté ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté
préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la
situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre,
d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté
contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la
liberté de manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans
l’espace public et à la liberté d’aller et de venir ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent;
- la restriction apportée aux libertés n’est pas justifiée par des circonstances
particulières locales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 août 2016, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II - L’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du 4.3 de l’article 4.3 du même arrêté du 5 août 2016 du maire de la commune de Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance n° 1603508 et 1603523 du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 24 août 2016 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, l’Association de défense des droits de l’homme
Collectif contre l’islamophobie en France demande au juge des référés du
Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de
justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté
contesté ;
- l’arrêté contesté méconnaît la loi du 9 décembre 1905 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté contesté
préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la
situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre,
d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté
contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au
principe d’égalité des citoyens devant la loi, à la liberté d’expression, à la
liberté de conscience et à la liberté d’aller et venir ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 août 2016, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Des observations, enregistrées le 25 août 2016, ont été présentées par le ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule et l’article 1er ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la Ligue des droits de l’homme et autres et l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France et, d’autre part, la commune de Villeneuve‑Loubet ainsi que le ministre de l’intérieur ;
Vu le procès-verbal de l’audience
publique du 25 août 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la
Ligue des droits de l’homme et autres ;
- les représentants de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif
contre l’islamophobie en France ;
- Me Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la
commune de Villeneuve-Loubet ;
- le représentant de la commune de Villeneuve-Loubet ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
et à l’issue de laquelle l’instruction a été close ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’est constituée une situation d’urgence particulière, justifiant qu’il se prononce dans de brefs délais, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
2. Des arrêtés du maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) du 20 juin 2014 puis du 18 juillet 2016 ont réglementé l’usage des plages concédées à la commune par l’État. Ces arrêtés ont été abrogés et remplacés par un nouvel arrêté du 5 août 2016 qui comporte un nouvel article 4.3 aux termes duquel : « Sur l’ensemble des secteurs de plage de la commune, l’accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune ». Ainsi que l’ont confirmé les débats qui ont eu lieu au cours de l’audience publique, ces dispositions ont entendu interdire le port de tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent accès à celle-ci.
3. Deux requêtes ont été présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour demander, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces dispositions de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet. La première de ces requêtes a été introduite par la Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, la seconde par l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France. Par une ordonnance du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois juges des référés, a rejeté ces deux requêtes. La Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, d’une part, l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, d’autre part, font appel de cette ordonnance par deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre.
4. En vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l’article L. 2212-2 de ce code, « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». L’article L. 2213-23 dispose en outre que : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés…Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance… ».
5. Si le maire est chargé par les dispositions citées au point 4 du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. S’il a été fait état au cours de l’audience publique du port sur les plages de la commune de tenues de la nature de celles que l’article 4.3 de l’arrêté litigieux entend prohiber, aucun élément produit devant le juge des référés ne permet de retenir que de tels risques en auraient résulté. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence. L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Les conséquences de l’application de telles dispositions sont en l’espèce constitutives d’une situation d’urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 22 août 2016 et d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ligue des droits de l’homme, de M. Lavisse, de M. Rossi et de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet, en application de ces dispositions, les sommes que demandent, d’une part, la Ligue des droits de l’homme, M. Lavisse et M. Rossi, d’autre part l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du
22 août 2016 est annulée.
Article 2 : L’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de
Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016 est suspendue.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet et celles
de la Ligue des droits de l’homme, de M. Lavisse, de M. Rossi, et de
l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie
en France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 4. La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de
l’homme, à M. Lavisse, à M. Rossi, à l’Association de défense des droits de
l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, à la commune de Villeneuve-Loubet et au ministre de l’intérieur.
LA RÉACTION DU HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME DE 2016.
Le Haut Commissariat des Droits de l'Homme près de l'ONU rappelle les principes, dans une conférence de presse sur la France et la Bolivie.
Si le Burkini et le voile intégral sont interdits parce que considérés comme une "provocation religieuse", c'est une discrimination et la France sera
systématiquement condamnée.
Par conséquent, si le port du Burkini et du voile intégral en France, sont considérés pour ce qu'ils sont réellement soit une bannière et un drapeau d'un
Islam POLITIQUE radicalisé, une interdiction circonstanciée pourra être tolérée par la CEDH et le Haut Commissariat des Droits de l'Homme près de l'ONU;
Le Conseil d’État a bien posé les limites des pouvoirs d'un maire dans une commune, liés uniquement à la préservation de l'Ordre Public.
Il est indispensable que les maires revoient leur copies dans leurs arrêtés sachant qu'ils ne peuvent pas prendre cette décision par conviction personnelle
comme à Villeneuve les Loubet, (Lionel Lucas est bien connu) Dans leur commune, leurs arrêtés doivent avoir pour seul but de prévenir un trouble à l'ordre
public, contre un Islam radical POLITIQUE.
Je rappelle qu'à Sisco en Corse, contrairement aux déclarations de Monsieur le Procureur de la république de Bastia qui prend bien soin de préciser que ses
propos ne sont qu'une vision des choses, il s'agissait bien d'une tentative de privatisation d'une plage dans le but d'instaurer une plage destinée à des
adeptes d'un Islam Politique radical.
Dire qu'une colombienne ne peut pas tomber dans l'islam radical et dire à contrario que seuls les maghrébins sont concernés, est faux et démontre une forme de racisme.
Pour lutter efficacement contre le djihad, il faudra se débarrasser des œillères de toute forme de racisme.
Un blond aux yeux bleus peut parfaitement devenir un djihadiste particulièrement dangereux !
Frédéric Fabre
Tribunal administratif de Bastia, Ordonnance du 6 septembre 2016 LDH C. commune de Sisco au format PDF
Dans sa décision, le juge des référés a rappelé que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage et qu’il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
Il a toutefois considéré qu’en l’espèce, compte tenu des récents événements du 13 août 2016, de leur retentissement et du fait que l’émotion n’est pas retombée, la présence sur une plage de Sisco d’une femme portant un costume de bain de la nature de ceux visés par l’arrêté du 16 août 2016 serait dans les circonstances particulières de l’espèce de nature à générer des risques avérés d’atteinte à l’ordre public qu’il appartient au maire de prévenir.
Aucun autre moyen ne se révélant propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Sisco, la requête de la Ligue des Droits de l’Homme a été rejetée
Le Considérant 5 de l'Ordonnance en référé :
"5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des explications apportées à l’audience que, le 13 août 2016, une violente altercation est survenue entre deux groupes de baigneurs suite à la présence réelle ou supposée sur la plage d’une femme se baignant dans une tenue très couvrante, au cours desquels plusieurs personnes ont été blessées ; que les affrontements se sont ensuite déplacés à Bastia ; que ces événements, dont le retentissement a été très important et qui ont connu une très importante couverture médiatique, ont causé une vive émotion dans la commune qui n’est pas retombée ; que la présence sur une plage de Sisco d’une femme portant un costume de bain de la nature de ceux visés par l’arrêté du 16 août 2016 serait dans ces conditions de nature à générer des risques avérés d’atteinte à l’ordre public ; qu’il appartient au maire de prévenir ; que par suite, par son arrêté du 16 août 2016, dont l’effet est limité dans le temps au 30 septembre 2016, le maire de Sisco n’a pas pris une mesure qui ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des nécessités de l’ordre public "
LE CDH CONSTATE QUE l'INTERDICTION DU NIQAB VIOLE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
L'interdiction du Niqab dans les espaces publics, viole l'article 18 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques sur la liberté religieuse.
Deux constatations du Comité des droits de l'Homme du 23 octobre 2018 reprochent à l'interdiction du Niqab d'être trop radicale, alors que la dissimulation du visage pour d'autres causes que religieuses, est autorisée. 2 000 femmes portent le niqab en France.
La décision concernant Sonia Yaker est lisible ici au format pdf
La décision concernant Miriana Hebbadj est lisible ici au format pdf
Le Comité des droits de l’homme a été saisi en 2016 de deux plaintes, après que deux françaises avaient été poursuivies et condamnées en 2012 pour avoir porté en public des vêtements qui avaient vocation à couvrir tout leur corps, y compris leur visage. La France a adopté en 2010 une loi qui stipule que “Nul ne peut porter, dans l’espace public, des vêtements destinés à dissimuler le visage”. La loi a pour effet d’interdire le port du voile islamique intégral en public, qui couvre tout le corps, y compris le visage, ne laissant qu’une petite ouverture pour les yeux.
Le Comité a été d’avis que l’interdiction générale à caractère pénal que la loi française impose à ceux qui portent le niqab en public a porté atteinte de manière disproportionnée au droit des deux plaignantes de librement manifester leur religion. De l’avis du Comité, la France n’a pas suffisamment expliqué en quoi l’interdiction du port de ce vêtement était nécessaire. De plus, le Comité n’a pas été convaincu par les arguments avancés par la France, selon lesquels l’interdiction de dissimuler le visage était nécessaire et proportionnée pour des raisons de sécurité et visait à assurer le respect du principe du “vivre ensemble” dans la société. Le Comité reconnaît que les Etats peuvent exiger des individus qu’ils découvrent leur visage dans des circonstances spécifiques dans le cadre de contrôles d’identité, mais il a été d’avis que l’interdiction généralisée du niqab était une mesure trop radicale. Le Comité a également conclu que l’interdiction ne permettrait pas de protéger les femmes portant le voile intégral mais aurait l’effet contraire de les marginaliser en les confinant chez elles en leur fermant l’accès aux services publiques.
“Ces décisions ne portent pas atteinte au principe de laïcité et ne visent pas à promouvoir une coutume, que nombreux au sein du Comité, y compris moi-même, considérons comme une forme d’oppression contre les femmes” a déclaré Yuval Shany, Président du Comité. Il a expliqué au contraire que ces décisions représentent la position du Comité selon laquelle une interdiction généralisée à caractère pénal ne permet pas d’assurer un équilibre raisonnable entre l’intérêt général et les libertés individuelles.
Ce sont les deux premières plaintes de cette nature qui ont été portées à la considération du Comité. En dépit du fait qu’il se prononce régulièrement sur des cas relatifs à la jouissance par les individus de leurs droits civils et politiques, c’est la première fois qu’il est saisi de questions de droits relatives à l’interdiction du voile intégral.
Il est attendu de la France qu’elle envoie un rapport de suivi au Comité dans un délai de 180 jours sur les mesures prises pour mettre en œuvre la décision du Comité qui demande, entre autre, la compensation des plaignantes et la prise de mesures visant à éviter que des cas similaires se reproduisent à l’avenir, y compris en révisant la loi incriminée.
L'INTERDICTION DU NIQAB est autorisée par le CEDH mais interdite par le Comité des Droits de l'Homme près de l'ONU
La CEDH avait considéré dans des arrêts concernant la Belgique et la France qu'un État laïc et du vivre ensemble peut interdire le Voile Islamiste dans tous les services publics.
Le CDH de Genève a considéré que l'interdiction de la burka dans l'espace public viole l'article 18 du Pacte qui protège la liberté religieuse.
Le autorités françaises n'ont pas exposé les moyens liés à la place de la femme et au mouvement féministe en France.
Contrairement aux déclarations des hommes politiques, la France sera contrainte de se soumettre à la décision du CDH de Genève.
Déjà en 2016, Frédéric Fabre avait averti sur la page de référence, que l'interdiction du niqab pouvait être condamnée par le CDH.
La réponse de la CEDH a été d'introduire le délit de blasphème, dans le droit européen :
E.S. c. Autriche du 25 octobre 2018 requête n° 38450/12
Article 10 : La condamnation d’une personne qui avait taxé Mahomet de pédophile pour avoir épousé une fillette de 6 ans, n’a pas emporté violation de l’article 10. La CEDH juge que les juridictions nationales ont apprécié de façon exhaustive le contexte général dans lequel la requérante a formulé les déclarations en cause, qu’elles ont soigneusement mis en balance le droit de celle-ci à la liberté d’expression et le droit des autres personnes à voir protéger leurs convictions religieuses, et qu’elles ont servi le but légitime consistant à préserver la paix religieuse en Autriche. Elle dit qu’en considérant les déclarations litigieuses comme ayant outrepassé les limites admissibles d’un débat objectif, et en les qualifiant d’attaque abusive contre le prophète de l’islam risquant d’engendrer des préjugés et de menacer la paix religieuse, les juridictions nationales ont avancé des motifs pertinents et suffisants à l’appui de leurs décisions. LA JEUNE FEMME A FAIT APPEL DEVANT LA GRANDE CHAMBRE DE LA CEDH. Une commission va examiner sa recevabilité.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.