Contrat de travail à Durée Indéterminée
LE CDI
Contrat de travail à Durée Indéterminée
Pour plus de sécurité, fbls CDI est sur : https://www.fbls.net/CDIARRET.htm
Aucun cookie garanti = liberté préservé pour chacun !
"Dans une société qui connaît le chômage de masse,
le CDI
avec un salaire bas, est devenu le GRAAL"
Frédéric Fabre docteur en droit.
Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) constitue la forme normale et générale de la relation de travail. L’employeur doit avoir recours à ce type de contrat, sauf s’il peut justifier d’une situation autorisant le recours à un Contrat de travail à Durée Déterminée.
 Cliquez sur un lien bleu pour accéder directement aux modèles sur :
Cliquez sur un lien bleu pour accéder directement aux modèles sur :
- ATTESTATION D'EMPLOI POUR UN CDI A TEMPS COMPLET
- ATTESTATION D'EMPLOI POUR UN CDI A TEMPS PARTIEL
- CDI POUR UN COMMERCIAL SALARIE
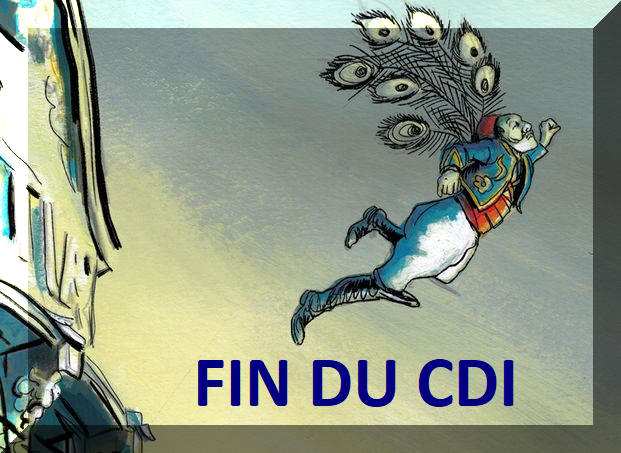 Cliquez sur un lien bleu pour accéder directement aux informations juridiques gratuites sur :
Cliquez sur un lien bleu pour accéder directement aux informations juridiques gratuites sur :
- UN CONTRAT ÉCRIT ÉVITE LES PROCÈS
- LA PÉRIODE D'ESSAI
- LES ÉLÉMENTS DU SALAIRE
- LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
- LE MANQUE DE TERME DU CDI
- LES DROITS ET DEVOIRS DU TRAVAILLEUR A DOMICILE
- LE POUVOIR DE SANCTION DE L'EMPLOYEUR
- LES FAUTES INEXCUSABLES DE L'EMPLOYEUR
- LE DROIT DE GRÈVE.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
MODÈLE GRATUIT DE CDI A TEMPS COMPLET
Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
Contrat de travail à durée indéterminée
Entre les soussignés :
la société
dont le siège social est situé à
représentée par
Nom
Prénom
agissant en qualité de
ci-après dénommé l'employeur d'une part,
- et :
Nom
Prénom
demeurant à:
ci-après dénommé l'employé d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
L'employeur engage, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche et sous réserve de la convention collective concernant l'entreprise, l'employé à compter du
voici la clause fixée par la loi du 25 juin 2008 pour les ouvriers et employés, vérifiez que la convention collective ne prévoit pas de période plus courte.
O
pour une période d'essai de deux mois qui peut être renouvelée une fois pour une période probatoire de deux mois.voici la clause fixée par la loi du 25 juin 2008 pour les agents de maîtrise et les techniciens, vérifiez que la convention collective ne prévoit pas de période plus courte.
O pour une période d'essai de trois mois qui peut être renouvelée une fois pour une période probatoire de trois mois.Si l'employeur met fin au présent contrat durant la période d'essai, il prévient l'employé avec un délai de prévenance de 24 heures en deçà de huit jours de présence, de 48 heures en cas de présence entre huit jours et un mois, de 2 semaines après un mois de présence et de un mois après trois mois de présence.
A la fin de la période d'essai et le cas échéant de la période probatoire, l'employé sera embauché automatiquement en contrat à durée indéterminée sauf pour l'employeur de mettre fin au présent contrat à la fin ou en cours de la période d'essai ou de la période probatoire par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au domicile indiqué ci-dessus de l'employé. La lettre recommandée avec accusé de réception pourra être remplacée par une remise de lettre à l'employé sur le lieu de travail contre signature de reçu par celui-ci.
Après la période d'essai ou la période probatoire, l'employeur prévient l'employé avec le délai prévu par la convention collective de l'entreprise.
Si l'employé met fin au présent de contrat durant la période d'essai, il prévient l'employeur avec un délai de prévenance de 48 heures ramenés à 24 heures en cas de présence inférieure à huit jours. Après la période d'essai ou la période probatoire, l'employé prévient l'employeur avec le délai prévu par la convention collective de l'entreprise.
En aucun cas la période d'essai, renouvellement inclus ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
En cas de démission de l'employé, l'employeur pourra si les nécessités de l'entreprise le permettent, dispenser l'employé de faire son préavis.
Ce droit de résiliation unilatérale ne fait pas échec à la faculté de mettre fin au contrat par accord mutuel, cette résiliation amiable fera l'objet d'une convention particulière.
Article 2
L'employé le sera en qualité de :
avec la qualification professionnelle de :
au coefficient hiérarchique :
Article 3
À titre de rémunération, l'employé percevra un salaire mensuel brut de €
soit en lettres: euros,
qui lui sera versé avant le 30 de chaque mois civil.
Ce salaire correspond à l'horaire collectif en vigueur au sein de l'entreprise soit heures hebdomadaires.
Les frais engagés par l'employé dans l'exercice de ses fonctions seront, sur justificatifs, pris en charge ou remboursés aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de la société, lesquelles pourront être dans le temps modifiées sans que cela constitue une modification d'un élément du présent contrat.
Article 4
L'employé exercera ses fonctions à : Pour les besoins impératifs de l'entreprise et sous réserve de la convention collective concernant l'entreprise, le lieu de travail pourra être déplacé dans un rayon de vingt kilomètres de l'endroit indiqué au précédent alinéa sans que l'employé ne puisse percevoir une compensation et sans que ce changement définitif ou non soit considéré comme une modification d'un élément du présent contrat.
En cas de déplacement de plus de vingt kilomètres, l'employeur et l'employé devront négocier une compensation dans le cadre de la loi et de la convention collective concernant l'entreprise.
En cas de désaccord, le juge désigné sous l'article 10 est saisi par la partie la plus diligente pour trancher le conflit.
L'employé pourra accepter une mobilité externe ou interne du groupe de l'entreprise en application des articles L 1222-12 et suivants du code du travail ou des articles L 2242-21 et suivants du dit code.
Article 5
L'employé le sera à temps complet. Il devra respecter les horaires en vigueur dans l'entreprise. Dans le respect de la convention collective concernant l'entreprise, les horaires pourront en fonction des nécessités être modifiés sans que cela constitue une modification de son contrat de travail.
L'employé pourra le cas échéant travailler en journée continue, de nuit ou en équipes.
Article 6
L'employé bénéficiera de congés payés annuels dans les conditions prévues par la loi et la convention collective concernant l'entreprise. Les dates de prise de congés seront fixés par la direction sur proposition de l'employé et suivant les impératifs et nécessités d'organisation de l'entreprise.
L'employé bénéficiera pour la retraite complémentaire d'une affiliation à:
Il bénéficiera également du régime de prévoyance en vigueur souscrit auprès de :
L'employé ne saurait se soustraire au bénéfice des prestations, ni refuser d'acquitter la quote-part mise à sa charge, telles que ces prestations et cotisations sont actuellement prévues ou telles qu'elles sont susceptibles d'évoluer.
Article 7
L'employé s'engage pendant toute la durée du présent contrat à consacrer son activité exclusive à l'employeur et s'interdit donc l'exercice, à quelque titre que ce soit, de toute activité professionnelle.
Le présent engagement étant conclu sans détermination de durée, il pourra prendre fin après la période d'essai et le cas échéant, de la période probatoire, à la volonté de l'une ou l'autre des parties, sous respect, hormis cas de faute grave ou de force majeure, d'un préavis tel qu'il résulte des dispositions conventionnelles applicables dans le cadre de la loi.
La partie qui met fin au présent contrat devra respecter un délai de préavis de :
En cas de démission de l'employé, l'employeur pourra si les nécessités de l'entreprise le permettent, dispenser l'employé de faire son préavis. Ce droit de résiliation unilatérale ne fait pas échec à la faculté de mettre fin au contrat par accord mutuel, cette résiliation amiable fera l'objet d'une convention particulière.
Article 8
Le présent contrat sera régi par les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise aussi bien la convention présente que avenir. L'employé s'engage à observer la discrétion la plus absolue, pendant la durée du présent contrat et après sa rupture, sur l'ensemble des informations ou renseignements dont il pourra avoir connaissance de par l'exercice de ses fonctions. Tout manquement par l'employé à son obligation de discrétion conduirait la société à envisager la rupture du présent contrat pour faute grave ou lourde ceci indépendamment de la réparation éventuelle du préjudice subi par l'entreprise.
Article 9
En cas d'absence prévisible, l'employé devra solliciter une autorisation préalable. Si l'absence est imprévisible, et notamment si elle résulte de la maladie ou d'un accident, il appartiendra à l'employé d'informer ou de faire informer immédiatement l'employeur dans les 48 heures, justification de l'absence, notamment par l'envoi d'un avis d'arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle.
Article 10
Clause particulière à l'entreprise:
Tout litige dans l'application du présent sera tranché par le conseil des prud'hommes du ressort du siège de l'entreprise rappelé ci-dessus.
Fait en deux exemplaires dont un remis à l'employeur et l'autre à l'employé le :
à :
Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"
L'EMPLOYEUR L'EMPLOYE

MODELE GRATUIT D'ATTESTATION D'EMPLOI POUR UN CDI A TEMPS COMPLET
Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
ATTESTATION D'EMPLOI DE CDI A TEMPS COMPLET
Nous soussignés:
Nom
Prénom
agissant en qualité de:
certifions que
Nom
Prénom
est employé au sein de l'entreprise:
en qualité de:
dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le
sous réserve de la période d'essai renouvelable une fois de
O
deux moisO
trois moisFait à
le
MODÈLE GRATUIT DE CDI A TEMPS PARTIEL
Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel
Entre les soussignés :
la société
dont le siège social est situé à
représentée par
Nom
Prénom
agissant en qualité de
ci-après dénommé l'employeur d'une part,
- et :
Nom
Prénom
demeurant à:
ci-après dénommé l'employé d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
L'employeur engage, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche et sous réserve de la convention collective concernant l'entreprise, l'employé à compter du
voici la clause fixée par la loi du 25 juin 2008 pour les ouvriers et employés, vérifiez que la convention collective ne prévoit pas de période plus courte.
O
pour une période d'essai de deux mois qui peut être renouvelée une fois pour une période probatoire de deux mois.voici la clause fixée par la loi du 25 juin 2008 pour les agents de maîtrise et les techniciens, vérifiez que la convention collective ne prévoit pas de période plus courte.
O
pour une période d'essai de trois mois qui peut être renouvelée une fois pour une période probatoire de trois mois.Si l'employeur met fin au présent contrat durant la période d'essai, il prévient l'employé avec un délai de prévenance de 24 heures en deçà de huit jours de présence, de 48 heures en cas de présence entre huit jours et un mois, de 2 semaines après un mois de présence et de un mois après trois mois de présence.
A la fin de la période d'essai et le cas échéant de la période probatoire, l'employé sera embauché automatiquement en contrat à durée indéterminée sauf pour l'employeur de mettre fin au présent contrat à la fin ou en cours de la période d'essai ou de la période probatoire par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au domicile indiqué ci-dessus de l'employé. La lettre recommandée avec accusé de réception pourra être remplacée par une remise de lettre à l'employé sur le lieu de travail contre signature de reçu par celui-ci.
Après la période d'essai ou la période probatoire, l'employeur prévient l'employé avec le délai de prévenance prévu par la convention collective de l'entreprise.
Si l'employé met fin au présent de contrat durant la période d'essai, il prévient l'employeur avec un délai de 48 heures ramenés à 24 heures en cas de présence inférieure à huit jours. Après la période d'essai ou la période probatoire, l'employé prévient l'employeur avec le délai prévu par la convention collective de l'entreprise.
En aucun cas la période d'essai, renouvellement inclus ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
En cas de démission de l'employé, l'employeur pourra si les nécessités de l'entreprise le permettent, dispenser l'employé de faire son préavis.
Ce droit de résiliation unilatérale ne fait pas échec à la faculté de mettre fin au contrat par accord mutuel, cette résiliation amiable fera l'objet d'une convention particulière.
Article 2
L'employé le sera en qualité de :
avec la qualification professionnelle de :
au coefficient hiérarchique :
Article 3
À titre de rémunération, l'employé percevra un salaire mensuel brut de €
soit en lettres: euros,
qui lui sera versé avant le 30 de chaque mois civil.
Ce salaire correspond à un horaire à temps partiel de heures hebdomadaires selon les nécessités de l'entreprise.
Les frais engagés par l'employé dans l'exercice de ses fonctions seront, sur justificatifs, pris en charge ou remboursés aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de la société, lesquelles pourront être dans le temps modifiées sans que cela constitue une modification d'un élément du présent contrat.
Article 4
L'employé exercera ses fonctions à : Pour les besoins impératifs de l'entreprise et sous réserve de la convention collective concernant l'entreprise, le lieu de travail pourra être déplacé dans un rayon de vingt kilomètres de l'endroit indiqué au précédent alinéa sans que l'employé ne puisse percevoir une compensation et sans que ce changement définitif ou non soit considéré comme une modification d'un élément du présent contrat.
En cas de déplacement de plus de vingt kilomètres, l'employeur et l'employé devront négocier une compensation dans le cadre de la loi et de la convention collective concernant l'entreprise.
En cas de désaccord, le juge désigné sous l'article 10 est saisi par la partie la plus diligente pour trancher le conflit.
Article 5
L'employé le sera à temps partiel de ............. heures par semaine. Il devra respecter les horaires selon les nécessités de l'entreprise. Dans le respect de la convention collective concernant l'entreprise, les horaires pourront en fonction des nécessités être modifiés sans que cela constitue une modification de son contrat de travail. L'employé pourra le cas échéant travailler en journée continue, de nuit ou en équipes.
Article 6
L'employé bénéficiera de congés payés annuels dans les conditions prévues par la loi et la convention collective concernant l'entreprise. Les dates de prise de congés seront fixés par la direction sur proposition de l'employé et suivant les impératifs et nécessités d'organisation de l'entreprise.
L'employé bénéficiera pour la retraite complémentaire d'une affiliation à:
Il bénéficiera également du régime de prévoyance en vigueur souscrit auprès de :
L'employé ne saurait se soustraire au bénéfice des prestations, ni refuser d'acquitter la quote-part mise à sa charge, telles que ces prestations et cotisations sont actuellement prévues ou telles qu'elles sont susceptibles d'évoluer.
Article 7
Le présent engagement étant conclu sans détermination de durée, il pourra prendre fin après la période d'essai et le cas échéant, de la période probatoire, à la volonté de l'une ou l'autre des parties, sous respect, hormis cas de faute grave ou de force majeure, d'un préavis tel qu'il résulte des dispositions conventionnelles applicables dans le cadre de la loi.
La partie qui met fin au présent contrat devra respecter un délai de préavis de :
En cas de démission de l'employé, l'employeur pourra si les nécessités de l'entreprise le permettent, dispenser l'employé de faire son préavis.
Ce droit de résiliation unilatérale ne fait pas échec à la faculté de mettre fin au contrat par accord mutuel, cette résiliation amiable fera l'objet d'une convention particulière.
Article 8
Le présent contrat sera régi par les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise aussi bien la convention présente que avenir. L'employé s'engage à observer la discrétion la plus absolue, pendant la durée du présent contrat et après sa rupture, sur l'ensemble des informations ou renseignements dont il pourra avoir connaissance de par l'exercice de ses fonctions. Tout manquement par l'employé à son obligation de discrétion conduirait la société à envisager la rupture du présent contrat pour faute grave ou lourde ceci indépendamment de la réparation éventuelle du préjudice subi par l'entreprise.
Article 9
En cas d'absence prévisible, l'employé devra solliciter une autorisation préalable. Si l'absence est imprévisible, et notamment si elle résulte de la maladie ou d'un accident, il appartiendra à l'employé d'informer ou de faire informer immédiatement l'employeur dans les 48 heures, justification de l'absence, notamment par l'envoi d'un avis d'arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle.
Article 10
Clause particulière à l'entreprise:
Tout litige dans l'application du présent sera tranché par le conseil des prud'hommes du ressort du siège de l'entreprise rappelé ci-dessus.
Fait en deux exemplaires dont un remis à l'employeur et l'autre à l'employé le: à:
Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"
L'EMPLOYEUR.............................................L'EMPLOYE
MODÈLE GRATUIT D'ATTESTATION D'EMPLOI POUR UN CDI A TEMPS PARTIEL
Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
ATTESTATION D'EMPLOI DE CDI A TEMPS PARTIELNous soussignés:
Nom
Prénom
agissant en qualité de:
certifions que
Nom
Prénom
est employé au sein de l'entreprise:
en qualité de:
dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de heures hebdomadaire, depuis le
sous réserve de la période d'essai renouvelable une fois de
O deux mois
O trois mois
Fait à
le
L'accès au document DUE : https://www.due.urssaf.fr
Notre Conseil: copiez collez le modèle sur une page Word vierge préalablement ouverte et complétez le à votre convenance avant de l'imprimer
Contrat de travail pour un cadre
Entre les soussignés :
la société
dont le siège social est situé à
représentée par
Nom
Prénom
agissant en qualité de
ci-après dénommé l'employeur d'une part,
- et :
Nom
Prénom
demeurant à:
ci-après dénommé l'employé d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
L'employeur engage, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche et sous réserve de la convention collective concernant l'entreprise, l'employé à compter du
vérifiez que la convention collective ne prévoit pas de période plus courte.
pour une période d'essai de quatre mois qui peut être renouvelée une fois pour une période probatoire de quatre mois.
Si l'employeur met fin au présent contrat durant la période d'essai, il prévient l'employé avec un délai de prévenance de 24 heures en deçà de huit jours de présence, de 48 heures en cas de présence entre huit jours et un mois, de 2 semaines après un mois de présence et de un mois après trois mois de présence.
A la fin de la période d'essai et le cas échéant de la période probatoire, l'employé sera embauché automatiquement en contrat à durée indéterminée sauf pour l'employeur de mettre fin au présent contrat à la fin ou en cours de la période d'essai ou de la période probatoire par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au domicile indiqué ci-dessus de l'employé. La lettre recommandée avec accusé de réception pourra être remplacée par une remise de lettre à l'employé sur le lieu de travail contre signature de reçu par celui-ci.
Après la période d'essai ou la période probatoire, l'employeur prévient l'employé avec le délai prévu par la convention collective de l'entreprise.
Si l'employé met fin au présent de contrat durant la période d'essai, il prévient l'employeur avec un délai de prévenance de 48 heures ramenés à 24 heures en cas de présence inférieure à huit jours. Après la période d'essai ou la période probatoire, l'employé prévient l'employeur avec le délai prévu par la convention collective de l'entreprise.
En aucun cas la période d'essai, renouvellement inclus ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
En cas de démission de l'employé, l'employeur pourra si les nécessités de l'entreprise le permettent, dispenser l'employé de faire son préavis.
Ce droit de résiliation unilatérale ne fait pas échec à la faculté de mettre fin au contrat par accord mutuel, cette résiliation amiable fera l'objet d'une convention particulière.
Article 2
L'employé le sera en qualité de cadre avec la qualification professionnelle de:
au coefficient hiérarchique:
Article 3
À titre de rémunération, l'employé percevra un salaire mensuel brut de €
soit en lettres: euros,
auquel il est rajouté un intéressement calculé comme suit :
qui lui sera versé avant le 30 de chaque mois civil.
Ce salaire correspond à l'horaire collectif en vigueur au sein de l'entreprise soit heures hebdomadaires.
Les frais engagés par l'employé dans l'exercice de ses fonctions seront, sur justificatifs, pris en charge ou remboursés aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de la société, lesquelles pourront être dans le temps modifiées sans que cela constitue une modification d'un élément du présent contrat.
Article 4
L'employé exercera ses fonctions à:
Pour les besoins impératifs de l'entreprise et sous réserve de la convention collective concernant l'entreprise, le lieu de travail pourra être déplacé de l'endroit indiqué au précédent alinéa.
L'employé ne pourra prétendre à percevoir une compensation et sans que ce changement définitif ou non soit considéré comme une modification d'un élément du présent contrat.
L'employé par son activité de direction peut être contraint de se déplacer durant son temps de travail en France comme à l'étranger.
Accord sur les frais de déplacement: ........(complétez)
L'employé pourra accepter une mobilité externe ou interne du groupe de l'entreprise en application des articles L 1222-12 et suivants du code du travail ou des articles L 2242-21 et suivants du dit code.
Article 5
L'employé le sera à temps complet. Il devra respecter les horaires en vigueur dans l'entreprise et de ceux causés par la nécessité de ses fonctions de direction au sein de l'entreprise.
Dans le respect de la convention collective concernant l'entreprise, les horaires pourront en fonction des nécessités être modifiés sans que cela constitue une modification de son contrat de travail.
L'employé pourra le cas échéant travailler en journée continue, de nuit ou avec une équipe.
Article 6
L'employé bénéficiera de congés payés annuels dans les conditions prévues par la loi et la convention collective concernant l'entreprise.
Les dates de prise de congés seront fixées par la direction sur proposition de l'employé et suivant les impératifs et nécessités d'organisation de l'entreprise et de ses fonctions.
L'employé bénéficiera pour la retraite complémentaire d'une affiliation à:
Il bénéficiera également du régime de prévoyance en vigueur souscrit auprès de :
L'employé ne saurait se soustraire au bénéfice des prestations, ni refuser d'acquitter la quote-part mise à sa charge, telles que ces prestations et cotisations sont actuellement prévues ou telles qu'elles sont susceptibles d'évoluer.
Article 7
L'employé s'engage pendant toute la durée du présent contrat à consacrer son activité exclusive à l'employeur et s'interdit donc l'exercice, à quelque titre que ce soit, de toute activité professionnelle.
Le présent engagement étant conclu sans détermination de durée, il pourra prendre fin après la période d'essai et le cas échéant, de la période probatoire, à la volonté de l'une ou l'autre des parties, sous respect, hormis cas de faute grave ou de force majeure, d'un préavis tel qu'il résulte des dispositions conventionnelles applicables dans le cadre de la loi.
La partie qui met fin au présent contrat devra respecter un délai de préavis de:
En cas de démission de l'employé, l'employeur pourra si les nécessités de l'entreprise le permettent, dispenser l'employé de faire son préavis. Ce droit de résiliation unilatérale ne fait pas échec à la faculté de mettre fin au contrat par accord mutuel, cette résiliation amiable fera l'objet d'une convention particulière.
Article 8
Le présent contrat sera régi par les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise aussi bien la convention présente que avenir. L'employé s'engage à observer la discrétion la plus absolue, pendant la durée du présent contrat et après sa rupture, sur l'ensemble des informations ou renseignements dont il pourra avoir connaissance de par l'exercice de ses fonctions. Tout manquement par l'employé à son obligation de discrétion conduirait la société à envisager la rupture du présent contrat pour faute grave ou lourde ceci indépendamment de la réparation éventuelle du préjudice subi par l'entreprise.
Article 9
En cas d'absence prévisible, l'employé devra solliciter une autorisation préalable. Si l'absence est imprévisible, et notamment si elle résulte de la maladie ou d'un accident, il appartiendra à l'employé d'informer ou de faire informer immédiatement l'employeur dans les 48 heures, justification de l'absence, notamment par l'envoi d'un avis d'arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle.
Article 10
Des objectifs seront déterminés chaque année par l'employeur après discussion avec l'employé, en tenant compte notamment des résultats antérieurs et de la situation de l'entreprise. La réalisation des objectifs ainsi fixés constitue un élément déterminant du présent engagement.
Article 11
Compte tenu des fonctions essentielles de l'employé pour l'entreprise et du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, l'employé s'interdira de participer, s'associer, s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en toute ou partie celle de l'entreprise et celles des sociétés du groupe présent ou avenir au sein desquelles l'employé aura été amené à intervenir. Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de quarante huit mois, à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail et au secteur géographique d'action de l'entreprise soit précisément:
L'employé reconnaît que son salaire fixe et que son intéressement ont été acceptées par l'employeur en contrepartie des obligations de cette clause particulière de non concurrence. Très précisément, l'indemnité est fixée mensuellement à % du salaire brut de l'employé.
En cas de violation de l'interdiction qui lui est faite, l'employé s'expose au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de ses six derniers mois d'activité, sans préjudice du droit pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice subi, et ce sans autre sommation que le simple constat d'un quelconque manquement. Cette clause ne s'applique pas en cas de rupture du présent par le fait de l'employeur pour quelque raison que ce soit.
L'entreprise peut libérer l'employé de la présente clause de non concurrence.
Article 12
Clause particulière à l'entreprise:
Tout litige dans l'application du présent sera tranché par le conseil des prud'hommes du ressort du siège de l'entreprise rappelé ci-dessus.
Fait en deux exemplaires dont un remis à l'employeur et l'autre à l'employé le :
à :
Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"
L'EMPLOYEUR L'EMPLOYE
ATTESTATION D'EMPLOI
Nous soussignés:
Nom
Prénom
agissant en qualité de:
certifions que
Nom
Prénom
est employé au sein de l'entreprise:
pour une durée indéterminée, depuis le
en qualité de cadre
sous réserve de la période d'essai de quatre mois renouvelable une fois.
Fait à
le
LE CADRE DIRIGEANT PARTICIPE A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 2 juillet 2014 Pourvoi N° 11-18734 CASSATION
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 novembre 2003
en qualité de conseillère en immobilier ; qu'elle a été nommée, à compter du 1er novembre 2004, responsable de l'agence d'Epinay-sur-Seine, statut cadre,
coefficient 380, niveau VII, avec en dernier lieu un salaire de 4 303,89 euros par mois ; qu'elle a saisi le 26 mai 2008 la juridiction prud'homale d'une
demande en paiement d'heures supplémentaires et en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 2009 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que les fonctions telles que définies dans le contrat de travail et exercées attestent
de la qualité de cadre dirigeant de la salarié du fait de la responsabilité de l'agence d'Epinay tenue seule alors que le gérant de la société tient l'autre
agence d'Argenteuil, avec toute autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et alors qu'elle perçoit la rémunération la plus élevée de tous les
salariés des deux agences, avec un écart important, lié à un salaire variable rémunérant son activité ;
Attendu, cependant, que selon le texte susvisé, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont
l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome
et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement;
que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la participation de la salariée à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte
susvisé
LA LIBERTE D'EXPRESSION DU CADRE DECISIONNEL DANS UNE ENTREPRISE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 27 mars 2013 Pourvoi N° 11-18734 CASSATION PARTIELLE
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail
Attendu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, la cour d'appel, tout en admettant que les termes de la lettre litigieuse ne sont pas injurieux, relève que les termes employés tels que « décisions incohérentes et contradictoires qui compromettent la pérennité de l'entreprise », comme ceux de « désordre interne, détournement, abus d'autorité, conséquences financières et sociales désastreuses » n'en sont pas moins violents et dénués de nuance, que « leur usage a pour seule finalité de caractériser l'incurie et l'impéritie du président de la société », que le courrier litigieux « dépasse les standards habituels de communication au sein de l'entreprise, décrit de façon tendancieuse des situations qui s'apparentent à des actes de malveillance, fait une présentation volontairement alarmiste de la situation économique et sociale de l'entreprise, répand des rumeurs sur le devenir de la société et la précarité de la situation des salariés et manifeste l'intention de ses auteurs de mettre en cause et de déstabiliser son président et que ce comportement est d'autant plus fautif qu'il est le fait de cadres supérieurs disposant d'une large autonomie et d'une autorité non négligeable dans l'entreprise qui s'adressent directement et collectivement aux nouveaux actionnaires du groupe », à un moment où «la société Dyneff était en pleine réorganisation»
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre litigieuse, adressée aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère, ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LE CADRE DIRIGEANT EST LIBRE ET PARTICIPE AUX DECISIONS DE L'ENTREPRISE
Article L 3111-2 du code du travail
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 26 novembre 2013 Pourvois N° 12-21758 et 12-22200 CASSATION PARTIELLE
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres
auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande
indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à
prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une
rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de
rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères
cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres
participant à la direction de l'entreprise ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de paiement d'heures
supplémentaires, des congés payés afférents ainsi que d'indemnité compensatrice
de repos compensateur, l'arrêt retient que le salarié avait une grande liberté
dans son emploi du temps, un niveau très élevé de responsabilité puisqu'il était
habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, et bénéficiait
d'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise de sorte qu'il avait la
qualité de cadre dirigeant ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'intéressé participait à la
direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
Contrat pour un commercial salarié
Entre les soussignés :
la société
dont le siège social est situé à
représentée par
Nom
Prénom
agissant en qualité de
ci-après dénommé l'employeur d'une part,
- et :
Nom
Prénom
demeurant à:
ci-après dénommé l'employé d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
L'employeur engage, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche et sous réserve de la convention collective concernant l'entreprise, l'employé à compter du
vérifiez que la convention collective ne prévoit pas de période plus courte.
pour une période d'essai de quatre mois qui peut être renouvelée une fois pour une période probatoire de quatre mois.
Si l'employeur met fin au présent contrat durant la période d'essai, il prévient l'employé avec un délai de prévenance de 24 heures en deçà de huit jours de présence, de 48 heures en cas de présence entre huit jours et un mois, de 2 semaines après un mois de présence et de un mois après trois mois de présence.
A la fin de la période d'essai et le cas échéant de la période probatoire, l'employé sera embauché automatiquement en contrat à durée indéterminée sauf pour l'employeur de mettre fin au présent contrat à la fin ou en cours de la période d'essai ou de la période probatoire par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au domicile indiqué ci-dessus de l'employé. La lettre recommandée avec accusé de réception pourra être remplacée par une remise de lettre à l'employé sur le lieu de travail contre signature de reçu par celui-ci.
Après la période d'essai ou la période probatoire, l'employeur prévient l'employé avec le délai prévu par la convention collective de l'entreprise.
Si l'employé met fin au présent de contrat durant la période d'essai, il prévient l'employeur avec un délai de prévenance de 48 heures ramenés à 24 heures en cas de présence inférieure à huit jours. Après la période d'essai ou la période probatoire, l'employé prévient l'employeur avec le délai prévu par la convention collective de l'entreprise.
En aucun cas la période d'essai, renouvellement inclus ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
En cas de démission de l'employé, l'employeur pourra si les nécessités de l'entreprise le permettent, dispenser l'employé de faire son préavis.
Ce droit de résiliation unilatérale ne fait pas échec à la faculté de mettre fin au contrat par accord mutuel, cette résiliation amiable fera l'objet d'une convention particulière.
Article 2
L'employé le sera en qualité de commercial salarié
avec la qualification professionnelle de:
au coefficient hiérarchique:
Article 3
À titre de rémunération, l'employé percevra un salaire mensuel brut de €
soit en lettres: euros,
auquel il est rajouté une commission d'affaires calculée comme suit:
qui lui sera versé avant le 30 de chaque mois civil.
Ce salaire correspond à l'horaire collectif en vigueur au sein de l'entreprise soit heures hebdomadaires.
Les frais engagés par l'employé dans l'exercice de ses fonctions seront, sur justificatifs, pris en charge ou remboursés aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de la société, lesquelles pourront être dans le temps modifiées sans que cela constitue une modification d'un élément du présent contrat.
Article 4
L'employé exercera ses fonctions à:
Pour les besoins impératifs de l'entreprise et sous réserve de la convention collective concernant l'entreprise, le lieu de travail pourra être déplacé de l'endroit indiqué au précédent alinéa.
L'employé ne pourra prétendre à percevoir une compensation et sans que ce changement définitif ou non soit considéré comme une modification d'un élément du présent contrat.
L'employé par son activité de commercial doit se déplacer durant son temps de travail en France comme à l'étranger.
Accord sur le véhicule destiné au déplacement: .......... (complétez)
Accord sur les autres frais de déplacement: ......... (complétez)
L'employé pourra accepter une mobilité externe ou interne du groupe de l'entreprise en application des articles L 1222-12 et suivants du code du travail ou des articles L 2242-21 et suivants du dit code.
Article 5
L'employé le sera à temps complet. Il devra respecter les horaires en vigueur dans l'entreprise et de ceux causés par la nécessité de ses fonctions commerciales au sein de l'entreprise.
Dans le respect de la convention collective concernant l'entreprise, les horaires pourront en fonction des nécessités être modifiés sans que cela constitue une modification de son contrat de travail.
L'employé pourra le cas échéant travailler en journée continue, de nuit ou en équipes.
Article 6
L'employé bénéficiera de congés payés annuels dans les conditions prévues par la loi et la convention collective concernant l'entreprise.
Les dates de prise de congés seront fixés par la direction sur proposition de l'employé et suivant les impératifs et nécessités d'organisation de l'entreprise et de ses fonctions.
L'employé bénéficiera pour la retraite complémentaire d'une affiliation à:
Il bénéficiera également du régime de prévoyance en vigueur souscrit auprès de:
L'employé ne saurait se soustraire au bénéfice des prestations, ni refuser d'acquitter la quote-part mise à sa charge, telles que ces prestations et cotisations sont actuellement prévues ou telles qu'elles sont susceptible d'évoluer.
Article 7
L'employé s'engage pendant toute la durée du présent contrat à consacrer son activité exclusive à l'employeur et s'interdit donc l'exercice, à quelque titre que ce soit, de toute activité professionnelle.
Le présent engagement étant conclu sans détermination de durée, il pourra prendre fin après la période d'essai et le cas échéant, de la période probatoire, à la volonté de l'une ou l'autre des parties, sous respect, hormis cas de faute grave ou de force majeure, d'un préavis tel qu'il résulte des dispositions conventionnelles applicables dans le cadre de la loi.
La partie qui met fin au présent contrat devra respecter un délai de préavis de:
En cas de démission de l'employé, l'employeur pourra si les nécessités de l'entreprise le permettent, dispenser l'employé de faire son préavis. Ce droit de résiliation unilatérale ne fait pas échec à la faculté de mettre fin au contrat par accord mutuel, cette résiliation amiable fera l'objet d'une convention particulière.
Article 8
Le présent contrat sera régi par les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise aussi bien la convention présente que avenir. L'employé s'engage à observer la discrétion la plus absolue, pendant la durée du présent contrat et après sa rupture, sur l'ensemble des informations ou renseignements dont il pourra avoir connaissance de par l'exercice de ses fonctions. Tout manquement par l'employé à son obligation de discrétion conduirait la société à envisager la rupture du présent contrat pour faute grave ou lourde ceci indépendamment de la réparation éventuelle du préjudice subi par l'entreprise.
Article 9
En cas d'absence prévisible, l'employé devra solliciter une autorisation préalable. Si l'absence est imprévisible, et notamment si elle résulte de la maladie ou d'un accident, il appartiendra à l'employé d'informer ou de faire informer immédiatement l'employeur dans les 48 heures, justification de l'absence, notamment par l'envoi d'un avis d'arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle.
Article 10
Des objectifs seront déterminés chaque année par l'employeur après discussion avec l'employé, en tenant compte notamment du potentiel du secteur, des clients et prospects existants, des résultats antérieurs, de la situation du marché. La réalisation des objectifs ainsi fixés constitue un élément déterminant du présent engagement.
Article 11
Compte tenu des fonctions essentielles de l'employé pour l'entreprise et du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, l'employé s'interdira de participer, s'associer, s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en toute ou partie celle de l'entreprise et celles des sociétés du groupe présent ou avenir au sein desquelles l'employé aura été amené à intervenir. Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de quarante huit mois, à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail et au secteur géographique d'action de l'entreprise soit précisément :
L'employé reconnaît que son salaire fixe et que ses commissions sur affaire ont été acceptées par l'employeur en contrepartie des obligations de cette clause particulière de non concurrence. Très précisément, l'indemnité est fixée mensuellement à % du salaire brut de l'employé.
En cas de violation de l'interdiction qui lui est faite, l'employé s'expose au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de ses six derniers mois d'activité, sans préjudice du droit pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice subi, et ce sans autre sommation que le simple constat d'un quelconque manquement. Cette clause ne s'applique pas en cas de rupture du présent par le fait de l'employeur pour quelque raison que ce soit.
L'entreprise peut libérer l'employé de la présente clause de non concurrence.
Article 12
Clause particulière à l'entreprise:
Tout litige dans l'application du présent sera tranché par le conseil des prud'hommes du ressort du siège de l'entreprise rappelé ci-dessus.
Fait en deux exemplaires dont un remis à l'employeur et l'autre à l'employé le :
à :
Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"
L'EMPLOYEUR L'EMPLOYE
ATTESTATION D'EMPLOI
Nous soussignés:
Nom
Prénom
agissant en qualité de:
certifions que
Nom
Prénom
est employé au sein de l'entreprise:
dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le
en qualité de commercial
sous réserve de la période d'essai de quatre mois renouvelable une fois.
Fait à
le
L'Arrêté du 23 décembre 2013 modifie l'arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de négociateur(trice) technico-commercial(e).
La charge la preuve des ventes pour calculer les commission appartient à l'employeur
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 20 octobre 2015 POURVOI N° 14-17473 cassation partielle
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur , celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion
contradictoire ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de commissions pour les ventes réalisées sur le secteur de Montpellier au cours de
l'année 2008, l'arrêt énonce que le salarié ne fournit aucune précision sur les ventes en question pour permettre de vérifier le bien-fondé et le calcul de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des ventes menées à terme sur le secteur d'activité du salarié pendant la période
sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé
UN ÉCRIT PERMET DE FIXER LE LIEU DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 13 octobre 2016 N° de pourvoi 15-16872 cassation partielle
Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de travail, la cour d'appel retient que l'objet
de l'association est de dispenser une instruction en français, que son mode de fonctionnement lui impose
l'homologation de l'établissement par le ministère de l'éducation nationale, que la nomination du chef d'établissement est assurée par l'agence pour
l'enseignement français à l'étranger, que de nombreux collègues exercent les mêmes fonctions sous le régime des expatriés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la salariée, engagée directement en Inde, accomplissait exclusivement son
travail à Delhi, que les contrats de travail étaient rédigés en langue française ou anglaise, qu'ils contenaient des références à la monnaie locale, que les
bulletins de paie étaient établis à Delhi en roupie ou en euros et que la salariée ne démontrait pas acquitter ses impôts en France, la cour d'appel, qui
n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé
LE LIEU DU CONTRAT DE TRAVAIL PEUT ÊTRE CHANGE
1. Selon l’article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs. Une cour d’appel, qui constate que l’accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d’effectifs au niveau de l’entreprise afin d’apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d’organisation courante au sens du texte précité, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes.
2. Selon l’article L. 2242-23 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique. Dès lors la rupture du contrat de travail résultant d’un tel refus constitue un licenciement pour motif économique sans qu’il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l’activité de l’employeur.
3. Si le refus par le salarié d’accepter l’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne constitue, en application de l’article L. 2242-23 du code du travail alors applicable, un motif économique, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard, d’une part, de la conformité de l’accord aux dispositions des articles L. 2242-21, L. 2242-22 et L. 2242-23 du code du travail et, d’autre part, conformément aux dispositions des article 4, 9.1 et 9.3 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail, de la justification de l’accord par l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 2 décembre 2020 pourvois n° 19-11.986 à 19-11.994 rejet
2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 23 octobre 2018), après avoir perdu un marché couvrant les départements du Gard et de la Lozère, la société Inéo Infracom a déménagé son centre de Nîmes à une autre adresse au sein de la même ville et a proposé aux salariés rattachés à ce centre des affectations temporaires dans d’autres régions à compter du 1er juillet 2013, et ce dans le cadre du régime de grand déplacement prévu par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable. Plusieurs salariés ont fait part de leur refus de cette situation à l’employeur et ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de leur contrat de travail.
3. Le 29 juillet 2013, un accord de mobilité interne a été conclu entre l’employeur et plusieurs organisations syndicales représentatives en application des articles L. 2242-21 et suivants du code du travail. Plusieurs salariés rattachés au centre de Nîmes, licenciés pour motif économique le 8 avril 2014 en raison de leur refus de mobilité interne, ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande subsidiaire contestant le bien-fondé de leur licenciement.
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.
7. La cour d’appel, qui a constaté que l’accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d’effectifs au niveau de l’entreprise, afin d’apporter des solutions pérennes d’organisation de l’entreprise confrontée à des pertes de marché sur des territoires géographiques peu actifs, en a exactement déduit que cette réorganisation constituait une mesure collective d’organisation courante, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes et la ré-affectation des salariés concernés sur d’autres postes.
8. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Les salariés font les mêmes griefs aux arrêts, alors « que le juge doit apprécier si le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse ; qu’en retenant que le motif économique du licenciement des salariés était vainement discuté dès lors que le licenciement d’un salarié qui a refusé l’application à son contrat de travail des stipulations d’un accord de mobilité repose sur un motif économique, la cour d’appel, qui a refusé d’apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements a violé l’article 4 de la convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement, adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990. »
Réponse de la Cour
10. En premier lieu, selon l’article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui est d’application directe en droit interne, un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Selon l’article 9.1 du même texte, le tribunal auquel est soumis un recours devra être habilité à examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement ainsi que les autres circonstances du cas et à décider si le licenciement était justifié. Aux termes de son article 9.3, en cas de licenciement motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, le tribunal devra être habilité à déterminer si le licenciement est intervenu véritablement pour ces motifs, et l’étendue de ses pouvoirs éventuels pour décider si ces motifs sont suffisants pour justifier ce licenciement sera définie par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, ou par voie de législation nationale.
11. En second lieu, selon l’article L. 2242-23 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique.
12. Il en résulte qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l’accord de mobilité aux dispositions des articles L. 2242-21, L. 2242-22 et L. 2242-23 du code du travail et de sa justification par l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise, sans qu’il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l’activité de l’employeur.
13. D’une part, la cour d’appel a, à juste titre ainsi qu’il a été dit au point 7, retenu que l’accord était conforme aux dispositions de l’article L. 2241-21 du code du travail.
14. D’autre part, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que l’accord de mobilité interne n’était pas justifié par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, a exactement décidé que le motif économique du licenciement était vainement discuté sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
UN LIEN DE SUBORDINATION VAUT CONTRAT DE TRAVAIL
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui retient l'existence d'un contrat de travail entre un chauffeur et une plateforme en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la plateforme, sans constater que celle-ci a adressé au chauffeur des directives sur les modalités d'exécution du travail, et qu'elle disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 13 avril 2022 pourvoi n° 20-14.870 cassation
Vu l'article L. 8221-6 du code du travail :
6. Il résulte de ce texte que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère,
sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de
travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque
ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent
dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
7. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous
l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son
subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un
service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
8. Pour dire que M. [T] et la société Voxtur ont été liés par un contrat de
travail, l'arrêt retient que le chauffeur n'avait pas le libre choix de son
véhicule, qu'il y avait interdépendance entre les contrats de location et
d'adhésion à la plateforme, que le GPS permettait à la société de localiser, en
temps réel, chaque véhicule connecté, de manière à procéder à une répartition
optimisée et efficace des courses, en termes de temps de prise en charge de la
personne à transporter et de trajet à effectuer, et d'assurer ainsi un contrôle
permanent de l'activité du chauffeur, que la société fixait le montant des
courses qu'elle facturait au nom et pour le compte du chauffeur, et qu'elle
modifiait unilatéralement le prix des courses, à la hausse ou à la baisse en fonction des horaires.
9. L'arrêt ajoute que la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du
chauffeur, à travers le système de notation par les personnes transportées prévu à l'article 3 de son contrat d'adhésion.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser
l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions
déterminées unilatéralement par la société Voxtur, sans constater que celle-ci
avait adressé à M. [T] des directives sur les modalités d'exécution du travail,
qu'elle disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, pour qualifier de contrat de travail la relation entre un chauffeur VTC et la société utilisant une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des clients et des chauffeurs exerçant sous le statut de travailleur indépendant, retient :
1°) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n’existe que grâce à cette plate-forme, à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport,
2°) que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire,
3°) que la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non,
4°) que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de "comportements problématiques", et déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif.
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 4 mars 2020 N° de pourvoi 19-13.316 REJET
7. Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
8. Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386, Société générale), le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
9. Selon cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
10. A cet égard, la cour d’appel a retenu que M. X... a été contraint pour pouvoir devenir "partenaire" de la société Uber BV et de son application éponyme de s’inscrire au Registre des Métiers et que, loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber BV, qui n’existe que grâce à cette plateforme, service de transport à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber BV.
11. La cour d’appel a retenu, à propos de la liberté de se connecter et du libre choix des horaires de travail, que le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors que lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber BV.
12. Au sujet des tarifs, la cour d’appel a relevé que ceux-ci sont contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme Uber par un mécanisme prédictif, imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix, puisque le contrat prévoit en son article 4.3 une possibilité d’ajustement par Uber du tarif, notamment si le chauffeur a choisi un "itinéraire inefficace", M. X... produisant plusieurs corrections tarifaires qui lui ont été appliquées par la société Uber BV et qui traduisent le fait qu’elle lui donnait des directives et en contrôlait l’application.
13. S’agissant des conditions d’exercice de la prestation de transport, la cour d’appel a constaté que l’application Uber exerce un contrôle en matière d’acceptation des courses, puisque, sans être démenti, M. X... affirme que, au bout de trois refus de sollicitations, lui est adressé le message "Êtes-vous encore là ?", la charte invitant les chauffeurs qui ne souhaitent pas accepter de courses à se déconnecter "tout simplement", que cette invitation doit être mise en regard des stipulations du point 2.4 du contrat, selon lesquelles : "Uber se réserve également le droit de désactiver ou autrement de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’Application Chauffeur ou des services Uber par le Client ou un quelconque de ses chauffeurs ou toute autre raison, à la discrétion raisonnable d’Uber", lesquelles ont pour effet d’inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber BV, sans pouvoir réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui leur convient ou non, ce d’autant que le point 2.2 du contrat stipule que le chauffeur "obtiendra la destination de l’utilisateur, soit en personne lors de la prise en charge, ou depuis l’Application Chauffeur si l’utilisateur choisit de saisir la destination par l’intermédiaire de l’Application mobile d’Uber", ce qui implique que le critère de destination, qui peut conditionner l’acceptation d’une course est parfois inconnu du chauffeur lorsqu’il doit répondre à une sollicitation de la plateforme Uber, ce que confirme le constat d’huissier de justice dressé le 13 mars 2017, ce même constat indiquant que le chauffeur dispose de seulement huit secondes pour accepter la course qui lui est proposée.
14. Sur le pouvoir de sanction, outre les déconnexions temporaires à partir de trois refus de courses dont la société Uber reconnaît l’existence, et les corrections tarifaires appliquées si le chauffeur a choisi un "itinéraire inefficace", la cour d’appel a retenu que la fixation par la société Uber BV d’un taux d’annulation de commandes, au demeurant variable dans "chaque ville" selon la charte de la communauté Uber, pouvant entraîner la perte d’accès au compte y participe, tout comme la perte définitive d’accès à l’application Uber en cas de signalements de "comportements problématiques" par les utilisateurs, auxquels M. X... a été exposé, peu important que les faits reprochés soient constitués ou que leur sanction soit proportionnée à leur commission.
15. La cour d’appel, qui a ainsi déduit de l’ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant de M. X... était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction, a, sans dénaturation des termes du contrat et sans encourir les griefs du moyen, inopérant en ses septième, neuvième et douzième branches, légalement justifié sa décision.
Cour de cassation chambre sociale du 4 décembre 2013 N° de pourvoi 12-26553 REJET
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, sans dénaturation, retenu que MM. Y... recrutaient les artistes, négociaient avec les organisateurs des spectacles le montant de la rémunération globale de l'orchestre, donnaient des instructions précises à M. X..., comme aux autres artistes, caractérisant une réelle autorité sur eux, non seulement sur le programme musical, mais également sur les dates des répétitions qui avaient lieu à leur domicile et des spectacles, sur les déplacements et les costumes à porter pendant les représentations, qu'ils effectuaient eux-mêmes la répartition des cachets entre les artistes et ont pris seuls la décision de faire cesser la participation de M. X... aux activités de l'orchestre ; qu'elle a également fait ressortir que les membres de l'orchestre travaillaient ensemble de façon régulière ; qu'en l'état de ces constatations portant sur des éléments qui excédaient ceux inhérents à l'exécution du mandat donné par M. X... à MM. Y... en application de l'article L. 7121-7 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination entre les parties caractérisant le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé
UNE PROMESSE D'EMBAUCHE VAUT CONTRAT DE TRAVAIL
Cour de cassation chambre sociale 15 décembre 2010 N° de pourvoi: 08-42951 REJET
Mais attendu que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en
fonction ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que
la lettre du 31 juillet 2001 adressée à M. X... le 1er août 2001 lui proposait un contrat de travail, précisait son salaire, la nature de son emploi, ses
conditions de travail et la date de sa prise de fonction, en a exactement déduit qu'elle constituait, non pas une proposition d'emploi mais une promesse
d'embauche et que la rupture de cet engagement par la société X..., s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli (-)
Mais attendu que le contrat de travail ayant été rompu avant son commencement d'exécution, le motif erroné relatif à la clause stipulant une période d'essai est sans portée
SOUS RÉSERVE DE L'AVIS DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL
Cour de cassation chambre sociale 17 décembre 2014 N° de pourvoi: 13-12277 Cassation Partielle
Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et déclarer sa décision opposable à l'association,
l'arrêt retient que cette association n'ayant sollicité l'agrément de ses secteurs médicaux que le 7 juillet 2009, postérieurement aux visites médicales des 8 et 30 décembre 2008,
la déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail s'avérait inopérante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci
s'imposent au juge, la cour d'appel, qui a refusé de donner effet aux avis donnés par ce médecin, a violé le texte susvisé
ELLE NE PEUT ETRE REFUSEE POUR CAUSE DE DISCRIMINATION
COUR DE CASSATION Chambre sociale du 18 janvier 2012 N° pourvoi 10-16926 REJET
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que, contrairement à ce qui était soutenu, il n'était pas établi que la salariée avait refusé son engagement par contrat à durée indéterminée, en a déduit que la rupture de la relation de travail était imputable à l'employeur ;
Attendu, ensuite, que le fait d'avoir statué au delà des prétentions de la salariée ne donne pas ouverture à cassation, cette irrégularité pouvant être réparée selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile
Mais attendu que, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, en raison de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race
Et attendu qu'ayant relevé que la directrice adjointe de la cafeteria avait informé la salariée, laquelle était pourtant " chaudement recommandée " par la direction d'un autre établissement, qu'elle ne pouvait l'engager immédiatement car la directrice lui avait indiqué qu'elle " ne faisait pas confiance aux maghrébines " de sorte qu'elle n'avait pu être recrutée que quinze jours plus tard à la faveur de l'absence de la directrice partie en vacances, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, caractérisé la discrimination raciale
UN CDI A TEMPS PARTIEL DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE ECRIT
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 17 mars 2010 N°pourvoi 08-42305 CASSATION PARTIELLE
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à
temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant,
mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la
semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit
mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est
à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de
rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle
convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de
prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir
constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt
retient que les contrats à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée à
temps partiel ayant lié les parties ont été conclus par écrit à l'exception de
la période du mois d'octobre 1999 de sorte que le salarié ne peut se prévaloir
d'une présomption de contrat à temps plein ; que M. X... n'apporte pas la preuve
qu'il a travaillé à temps plein pour l'association qui l'employait;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'un des contrats
n'avait pas fait l'objet d'un écrit et sans rechercher si les contrats à durée
déterminée écrits mentionnaient ou ne mentionnaient pas la durée hebdomadaire ou
mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de
la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 16 septembre 2015 pourvoi n° 14-10291 CASSATION PARTIELLE
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations et entreprises d'aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait une durée hebdomadaire de travail pouvant varier entre 10 et 30 heures, retient que pour les entreprises d'aide à domicile, il suffit que soit mentionnée au contrat la durée hebdomadaire ou mensuelle garantie au salarié, et que tel est le cas en l'espèce, la durée hebdomadaire garantie à l'intéressée ayant été fixée à 10 heures dans le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé
UN CDI A TEMPS PARTIEL QUI NE PREVOIT PAS D'EMPLOI DU TEMPS EST REQUALIFIE EN CDI A TEMPS COMPLET
COUR DE CASSATION Chambre Sociale
arrêt du 26 janvier 2011 POURVOI N° 09-71349 REJETAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail à temps partiel devait s'analyser en un contrat de travail à temps plein et de le condamner en conséquence au paiement de rappels de salaire, indemnité de préavis et congés payés
Mais attendu que la clause contractuelle par laquelle le
salarié à temps partiel a la faculté de refuser les missions qui lui sont
confiées, est sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans
le contrat de travail de la durée de travail et de sa répartition, et, en
l'absence de celle-ci, sur l'obligation pour l'employeur de rapporter la preuve,
d'une part, de la durée exacte convenue, et, d'autre part, que le salarié
n'était pas placé, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait
travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de
l'employeur
Et attendu, que la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'absence d'un emploi du
temps régulier pré-défini, le nombre d'heures travaillées de la salariée passant
selon les mois de 13,5 heures à 163 heures et que fin août 2007, la salariée
ignorait toujours son programme pour le mois de septembre suivant, ce dont il
résultait que la durée exacte de travail convenue n'était pas établie et que la
salariée, qui ne connaissait pas son rythme de travail, devait se tenir
constamment à la disposition de l'employeur, peu important que le contrat lui
offre la possibilité de refuser des missions, a légalement justifié sa décision.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 8 février 2011 POURVOI N° 09-40027 CASSATION PARTIELLE
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire
l'arrêt retient, d'une part, que le salarié ne demande pas la requalification de
son contrat de travail en un contrat à temps plein mais prétend que son horaire
originaire de 136 heures mensuelles a été modifié unilatéralement, d'autre part,
que l'employeur rapporte la preuve qu'il a rempli ses obligations au regard d'un
travail à temps partiel, le salarié ne démontrant pas qu'il devait rester à la
disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de mention dans le contrat de la durée
hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel, il appartenait à
l'employeur d'établir quelle était la durée exacte du travail qui avait été
convenue et au juge de déterminer les sommes dues au salarié en contrepartie des
heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé les textes susvisés
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 17 décembre 2014 POURVOI N° 13-20627 CASSATION PARTIELLE
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le
25 mai 2005 en qualité de chauffeur à temps partiel, sans contrat de travail écrit, par la société Aubigny cars, laquelle a fait l'objet d'une liquidation
judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 2008, son préavis s'achevant le 9 janvier
2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein
et en paiement d'un rappel de salaire à ce titre pour la période allant du 25 mai 2005 au 9 janvier 2009 ;
Attendu que pour limiter au contraire à 550 heures la durée minimale de travail
depuis l'embauche, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de contrat de travail écrit et que l'intéressée avait travaillé à temps plein au mois de
juin 2007, relève qu'elle était essentiellement chargée de transports scolaires et de transports périscolaires, qu'elle était, sauf cas exceptionnels, avertie,
conformément aux dispositions de la convention collective, au moins trois jours à l'avance de ses horaires de travail, que l'employeur produit mois par mois des
relevés précis des transports effectués, et que l'intéressée s'est entièrement mise à la disposition d'un autre employeur du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée ayant effectué un temps plein au mois de juin 2007, elle aurait
dû à tout le moins en déduire qu'à compter de cette date son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein,
d'autre part, que l'employeur n'établissait pas, pour la période antérieure au mois de juin 2007, la durée du travail convenue, la cour d'appel a, peu
important par ailleurs le respect des dispositions conventionnelles relatives au travail à temps partiel, violé les textes susvisés
UN CDI A TEMPS PLEIN PEUT ÊTRE ORAL MAIS UN ÉCRIT EST CONSEILLÉ
La LOI n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, oblige à un contrat écrit pour le senior de 55 ou 57 ans et pour le jeune de moins de 26 ans ou de moins de 30 ans s'il est handicapé.
Seul le contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein peut être non écrit, sauf disposition d'une convention collective contraire imposant la rédaction d’un contrat écrit. Toutefois un écrit est conseillé ne serait ce que pour fixer d'un commun accord la rémunération puisque cet écrit s'imposera même si l'employeur a surpayé le salarié durant de longues années.
Cour de cassation chambre sociale 30 septembre 2010 N° de pourvoi: 09-40114 REJET
Sur le second moyen, après avertissement donné aux parties
conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile:
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de la condamner à rembourser
à l'association une certaine somme à titre de salaires indûment perçus, alors,
selon le moyen, qu'en accueillant la demande de répétition formée par
l'employeur, dont elle constatait pourtant qu'il avait, sept années durant,
versé à la salariée un salaire supérieur à ce qui avait été contractuellement
convenu, ce qui constituait une erreur inexcusable faisant obstacle à la
réclamation du remboursement du trop-perçu, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil
Mais attendu que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une
condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l'indu ; que par ce
motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui a constaté que la
salariée avait perçu indûment en salaire net la rémunération prévue
contractuellement en brut, se trouve légalement justifié.
TOUT CONTRAT DE TRAVAIL NON ÉCRIT EST PRÉSUMÉ ÊTRE UN CDI A TEMPS PLEIN
Depuis le 1er juillet 1993, en application d'une directive européenne du 14 octobre 1991, l'employeur doit délivrer au salarié, dans les deux mois du début de la relation de travail, un document écrit, acte sous seing privé ou lettre d'engagement. Toutefois, en France, il est considéré que la délivrance des bulletins de paie équivaut à la transposition de la directive européenne puisque la matérialité de ce document contient, nécessairement, par obligation de la législation nationale, les indications ci-dessus évoquées. De plus, si le contrat à durée indéterminée à temps plein reste verbal, l’employeur a l’obligation de remettre au salarié un document écrit reprenant les informations contenues dans la déclaration préalable à l’embauche adressée à l’URSSAF.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale 30 novembre 2010 pourvoi N° 09-41065 REJET
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remise d'autant de bulletins de salaires que de mois concernés par le rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur n'est tenu de remettre au salarié un bulletin de paye qu'au moment du paiement du salaire, cela ne s'oppose pas à ce qu'il soit condamné, lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à obtenir des rappels de primes portant sur plusieurs mois, à lui remettre autant de bulletins de salaires rectifiés que de mois concernés par les primes payées tardivement de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le bulletin de paie est remis au salarié lors du paiement du salaire ou de toutes autres rémunérations en a exactement déduit que le rappel des primes dues sur plusieurs mois pouvait figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement ; que le moyen n'est pas fondé
COUR DE CASSATION Chambre Sociale 11 janvier 2006 pourvoi N° 04-41231 CASSATION PARTIELLE
Nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun posées par les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil.
UN ÉCRIT PERMET DE RÉGLER LES RELATIONS EMPLOYEUR-SALARIE
Toutefois, un écrit est fortement conseillé pour régler simplement les relations entre employeur et salarié. Il permet de fixer les fonctions et de déterminer les évolutions possibles.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale 11 janvier 2006 pourvoi N° 03-46698 REJET
Dès lors que l'avenant à un contrat de travail s'analyse comme une modification du contrat de travail d'un salarié, celui-ci est en droit de refuser une nouvelle modification le replaçant dans la situation antérieure à cet avenant.
UN ÉCRIT PERMET DE FIXER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 3 novembre 2011 Pourvoi N° 10-30033 CASSATION
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de pharmacienne par M. Y... qui exploite une officine ; que ce dernier l'a informée par lettre du 9 mai 2006 de la modification de ses horaires de travail, désormais fixés du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures, au lieu de l'horaire continu de 8 heures à 15 heures qu'elle pratiquait ces mêmes jours ; qu'ayant refusé cette modification des horaires de travail, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le changement d'horaire, consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors qu'il n'est pas contesté que la durée du travail et la rémunération étaient restées identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que l'employeur avait imposé à la salariée le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 3 novembre 2011 Pourvoi N° 10-14702 CASSATION PARTIELLE
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 décembre 2000 par la société Gsf Orion en qualité d'agent de service à temps plein ; que travaillant sur un site du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 10 heures, elle a été affectée sur deux sites par courrier du 6 novembre 2008 selon la répartition de l'horaire de travail suivante : du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures ; qu'ayant refusé ces nouveaux horaires qui, selon elle, représentaient un bouleversement de ses conditions de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que si, en principe, une nouvelle répartition du travail sur la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail et relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, il n'en est pas ainsi lorsque, pour suite de cette nouvelle répartition, le rythme de travail du salarié est totalement bouleversé ; qu'en substituant du lundi au vendredi à des horaires de travail majoritairement du matin avec coupure à midi et horaire limité à deux heures en milieu d'après-midi, un horaire exclusivement l'après-midi jusqu'à 21 heures, sans interruption et en augmentant les horaires de travail à effectuer le samedi à cinq heures et demie, se terminant à 20 heures, la société a imposé à la salariée un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail ; que par suite, l'accord de la salariée sur cette modification devait être recueilli par l'employeur ; qu'en lui imposant sans avoir obtenu son accord cette nouvelle organisation de son travail la société a manqué à ses obligations contractuelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le changement d'horaire portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
UN ÉCRIT PERMET DE PREVOIR UNE CLAUSE DE MOBILITE GEOGRAPHIQUE ET SES CONDITIONS D'APPLICATION
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 3 février 2010 Pourvoi N ° 08-41412 REJET.
Mais attendu que si l'affectation occasionnelle d'un
salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut
ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise,
qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié
est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible;
Et attendu qu'ayant relevé que la notification brutale à la salariée de son changement d'affectation ne comportait aucune indication quant à la durée de
cette affectation, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision
LE TEMPS SUPPLEMENTAIRE DE DEPLACEMENT DOIT ETRE INDEMNISE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 20 novembre 2013 Pourvoi N ° 12-20074 cassation partielle
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnités au
titre des temps de déplacement, l'arrêt retient que selon l'article L. 212-4
du code du travail, devenu L. 3121-4, le temps de déplacement professionnel
pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un
temps de travail effectif et n'a pas à être indemnisé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions du
salarié qui soutenait que ce temps de déplacement dépassait le temps normal de
trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé
UN ECRIT PEUT PREVOIR LES MODIFICATIONS D'HORAIRES DE TRAVAIL
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 2 Avril 2014 Pourvoi N ° 13-11060 Rejet
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter
de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un motif légitime permettant
au salarié de refuser une modification de ses conditions de travail décidée par
l'employeur l'atteinte à sa liberté d'exercer un mandat d'élu local ; qu'en
décidant en l'espèce que la salariée ne justifie d'aucun motif légitime lui
permettant de refuser la modification de ses horaires de travail et pris de
l'atteinte à sa liberté d'exercer un mandat de conseiller municipal, après avoir
relevé de manière inopérante que la salariée pouvait prétendre, pour l'exercice
de ce mandat municipal, bénéficier d'autorisations d'absences de la part de son
employeur, ainsi que de crédits d'heures en fonction du nombre d'habitants de sa
commune, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail,
ensemble les articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la modification des horaires de
travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple
changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de
l'employeur, la cour d'appel, qui a retenu que le changement des horaires de
travail de la salariée ne faisait pas obstacle à l'exercice de son mandat
électif régi par les articles L. 2123-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales, a pu en déduire que la salariée ne justifiait
d'aucun motif légitime pour refuser le changement de ses horaires de travail ;
que le moyen n'est pas fondé
Le contrat de travail constaté par écrit doit être rédigé en français. Il peut toutefois arriver que l’emploi faisant l’objet du contrat ne puisse être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français ; dans ce cas, le contrat de travail doit comporter une explication en français du terme étranger. Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Il appartient à l’employeur et au salarié de déterminer le contenu du contrat de travail et les clauses particulières qui devront éventuellement y figurer suivant l'emploi offert comme une clause de mobilité ou une clause de non-concurrence.
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera exclusivement son travail dans ce lieu.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que dès lors que le lieu de travail figurait dans le contrat de travail un changement de ce lieu constituait une modification du contrat que le salarié n'était pas tenu d'accepter, sans relever l'existence d'une telle stipulation et sans rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique.
UN ECRIT NE PEUT PAS PREVOIR PAR AVANCE LES CONDITIONS DE RUPTURE DU CDI
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 25 janvier 2012 Pourvoi N° 10-26887 REJET
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1231-4 du code
du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au
droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail
à durée indéterminée ; qu'ayant fait ressortir qu'un accord entre la salariée
et son employeur faisait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la
rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et
incertain relatif à son emploi, la cour d'appel a statué à bon droit en
écartant une démission de la salariée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le contrat de travail avait pris fin par
une résiliation amiable, la cour d'appel a, par ce seul motif, exactement
retenu que la salariée était fondée à prétendre au paiement d'une indemnité de préavis
LES CLAUSES CONTRAIRES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES SONT INTERDITES
COUR DE CASSATION Chambre Criminelle. - 3 janvier 2006 Pourvoi N° 05-82331 REJET
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de violation d'une convention collective l'employeur qui refuse l'octroi d'une prime d'expérience à tous les salariés de son entreprise au motif qu'elle est réservée aux seuls ouvriers alors que, d'une part, la convention nationale en cause, qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension, ne prévoit pas une telle limitation et que, d'autre part, la catégorie professionnelle des ouvriers n'existe plus dans la classification des emplois.
Pour lire gratuitement votre convention collective:
LE JUGE JUDICIAIRE N'A PAS A CONTRÔLER LES ACCORDS COLLECTIFS PROFESSIONNELS NI LEURS EXTENSION
Dans le cadre d’un accord collectif professionnel, l’arrêté d’extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’ une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci.
Cette décision concerne le périmètre de contrôle du juge judiciaire sur le champ d’application d’un accord collectif de branche ayant donné lieu à arrêté d’extension. La chambre sociale juge traditionnellement, depuis un arrêt du 16 mars 2005 (soc., 16 mars 2005, pourvoi n+03-16.616, Bull.civ. V, n°97, publié au rapport annuel), que “l’arrêté d’extension du ministre du Travail prévu par l’article L. 133-8 du Code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d’un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d’application territorial ou professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l’article L. 133-2 du Code du travail”.
Elle en déduisait que, dès lors que les organisations patronales ne bénéficiaient pas d’une présomption de représentativité, même lorsque l’accord a été étendu, le juge judiciaire devait en vérifier son champ d’application au regard de la représentativité des organisations patronales signataires. Par conséquent il devait vérifier concrètement si l’employeur auquel il était demandé l’application de l’accord en était signataire, était adhérent d’une organisation patronale signataire, ou si l’organisation patronale signataire était représentative dans le secteur d’activité de l’employeur.
Cette jurisprudence, constamment réaffirmée depuis lors (Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n°05-13.601, Bull. civ. V, n°351 ; Soc., 3 mars 2015 pourvoi n°13-21.792 ; Soc. 6 avril 2016, pourvoi n°14-27.042, Bull. civ. V, n°66) se trouvait cependant en contrariété avec la jurisprudence du Conseil d’Etat relative au contrôle du juge administratif sur la légalité de l’arrêté d’extension.
En effet, pour qu’un arrêté d’extension soit valide, le juge administratif s’assure que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives dans les secteurs entrant dans le champ de l’accord ont été invitées à la négociation, même si elles ne l’ont pas toutes signé (CE, 6 décembre 2006, n°271442), et que “les étapes essentielles de la négociation de l’accord se soient déroulées en présence de toutes les organisations syndicales représentatives dans leur champ d’application” (CE, 4 juillet 2012, n°337698).
La vérification effectuée par le juge judiciaire, après un arrêté d’extension, de la représentativité des organisations patronales ayant signé l’accord dans le secteur d’activité de l’entreprise pour s’assurer de son champ d’application, constituait donc à la fois un double contrôle de cette représentativité, mais également un risque de contradiction, les conditions posées par le Conseil d’Etat pour la validité de l’accord d’extension et par la chambre sociale pour le champ d’application de l’accord étendu n’étant pas parfaitement identiques.
S’agissant plus particulièrement des accords professionnels, dont le champ d’application est nécessairement le ou les secteurs d’activité pour lesquels le juge administratif s’est assuré de la représentativité des organisations patronales invitées à la négociation, la superposition des contrôles n’avait pas de justification. D’ailleurs, si l’attendu de principe des arrêts de la chambre sociale visait indistinctement la vérification à effectuer pour les accords professionnels et interprofessionnels, la quasi-totalité des décisions concernait des accords interprofessionnels.
Pour mettre en cohérence les contrôles administratifs et judiciaires, la chambre sociale décide donc, dans la décision du 27 novembre 2019, d’opérer un revirement partiel et d’affirmer que, lorsqu’il est saisi du champ d’application d’un accord professionnel, le juge judiciaire n’a pas à vérifier la représentativité des organisations patronales signataires dans le secteur d’activité de l’employeur. Cette solution le conduit à censurer la décision de la cour d’appel qui avait déclaré inopposable à plusieurs sociétés un avenant qui avait pour seul objet de rendre applicable un accord de branche (convention dite SYNTEC) dans un nouveau secteur d’activité alors que cet avenant avait fait l’objet d’un arrêté d’extension.
Il convient de noter que la décision concerne un avenant signé et étendu avant la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 qui, désormais, institue des critères de représentativité des organisations patronales aux différents niveaux de négociation.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale du 27 novembre 2019 Pourvoi N° 17-31.442 cassation
Sur le premier moyen du pourvoi principal
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Les fédérations Syntec et Cinov reprochent à
l’arrêt d’avoir accueilli les demandes en inopposabilité formées par les
sociétés alors qu’ « il résulte de l’article L. 2261-15 du code du travail que
l’arrêté d’extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoire
les stipulations d’une convention de branche pour tous les salariés et
employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ; qu’au cas
présent, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que, par arrêté du 17
mai 2010, le ministre du travail a procédé à l’extension de l’avenant n° 37 de
la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets
d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, qui « a notamment
pour finalité d’élargir le champ d’application de la convention […] aux
activités de contrôle technique et de vérifications techniques » ; qu’il résulte
également des constatations de l’arrêt attaqué qu’ « en procédant le 17 mai 2010
à l’extension de cet avenant, le ministre a nécessairement apprécié la
représentativité dans le secteur des analyses, essais et inspections techniques
(code 7120B) des organisations syndicales d’employeurs et de salariés réunies en
commission paritaire pour négocier et signer ledit avenant, de sorte que leur
représentativité dans le secteur du contrôle technique ne peut plus être
contestée devant le juge judiciaire » ;
qu’il résulte enfin des constatations de l’arrêt attaqué qu’ « en tout état de
cause, les appelants ne rapportent pas la preuve du défaut de représentativité
des signataires de l’avenant litigieux dans le secteur du contrôle technique »,
et qu’il n’est pas fait état d’organisations patronales ou syndicales qui
« auraient dû être conviées à la négociation et ne l’ont pas été » ; qu’il
résulte de ces constatations qu’en vertu de l’arrêté d’extension du ministre du
travail du 17 mai 2017, les dispositions de l’avenant n° 37 de la convention
collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs
conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, étaient applicables à
l’ensemble des salariés et employeurs dans le secteur du contrôle technique ;
qu’en déclarant néanmoins cet avenant inopposable aux sociétés Apave, Socotec
France et Bureau Veritas aux motifs inopérants qu’elles n’étaient pas adhérentes
aux fédérations Syntec et Cinov, signataires de l’avenant, et qu’aucune
organisation patronale représentative dans le secteur des activités de contrôle
dont relèvent ces sociétés n’y adhère, la cour d’appel a méconnu les
conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, et a violé l’article
L. 2261-15 du code du travail et l’arrêté d’extension du ministre du travail du
17 mai 2010 ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2261-15 et L. 2261-19 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs :
5. Selon l’article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou cet accord par arrêté du ministre du travail. L’extension suppose, selon l’article L. 2261-19 du code du travail, que la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel ait été négocié et conclu au sein d’une commission paritaire composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré.
6. L’extension étant formalisée par un arrêté, c’est au ministre du travail, sous le contrôle du juge administratif, qu’il appartient donc de vérifier si les conditions de négociation de l’accord permettent son extension.
7. Le Conseil d’Etat a précisé que la légalité de l’arrêté d’extension était subordonnée à la condition que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives dans le secteur aient été invitées à la négociation de l’accord, peu important que toutes ne l’aient pas signé (CE, 6 décembre 2006, n° 273773).
8. En application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n’a pas compétence pour vérifier la régularité des conditions de négociation et de conclusion d’un accord collectif étendu, dès lors que ce contrôle incombe ainsi que rappelé ci-dessus au seul juge administratif dans le cadre de son contrôle de la légalité de l’arrêté d’extension.
9. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d’application sectoriel d’un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ.
10. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 ; Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull. 2006, V, n° 351) que, dans le cadre d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, le juge judiciaire devait vérifier si les employeurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial auxquels il était demandé l’application de l’accord étaient signataires de l’accord ou relevaient d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de l’accord.
11. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un accord collectif professionnel, l’arrêté d’extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci.
12. En l’espèce, l’avenant n° 37 de la convention Syntec avait expressément pour objet de rendre la convention Syntec applicable au secteur des activités d’analyses, essais et inspections techniques. Dès lors que cet avenant avait fait l’objet d’un arrêté d’extension, le juge judiciaire n’avait pas à contrôler qu’il avait été signé par les organisations syndicales et patronales représentatives de ce secteur sauf, en cas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’extension, à saisir le juge administratif d’une exception d’illégalité. Il lui appartenait seulement de vérifier si l’activité des sociétés concernées par le litige relevait du secteur analyses, essais et inspections techniques, champ d’application visé par l’avenant n° 37.
13. Pour déclarer inopposable aux sociétés Apave, Socotec France, et au Bureau Veritas l’avenant n° 37 de la convention Syntec, la cour d’appel retient que ces sociétés n’adhèrent pas aux fédérations signataires et qu’aucune organisation patronale représentative dans le secteur des activités de contrôle dont relèvent ces sociétés n’y adhère.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et la Fédération CFE-CGC métallurgie ;
Sont aussi interdites les clauses contraires à l’ordre public comme les clause de célibat qui furent célèbres chez les hôtesses d'Air France, les rémunérations inférieures au Smic ou les clauses discriminatoires.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 12 juillet 2005 Pourvoi N°04-13342 CASSATION SANS RENVOI
1° Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelle et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Porte atteinte à la liberté individuelle de l'avocat salarié, la clause du contrat de travail faisant obligation à cet avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du cabinet en justifiant cette obligation par la seule nécessité "d'une bonne intégration dans l'environnement local".
2° La clause du contrat de travail permettant à l'employeur en cas de départ de l'avocat salarié de régler sa rémunération dans les six mois de son départ effectif est manifestement contraire aux exigences légales de paiement du salaire définies par l'article L. 143-2 du Code du travail.
L'EMPLOYEUR DOIT RESPECTER LA REPRESENTATION DES SALARIES
Cour de cassation chambre sociale du 17 mai 2011 N° de pourvoi 10-12852 CASSATION PARTIELLE
Vu l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail et 1382 du code civil, l'article 8 § 1 de la directive 2002/ 14/ CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts du fait de l'absence d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel retient que M. X..., en tant que simple salarié, ne peut introduire des demandes relatives à la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LES DISPOSITIFS D'AIDE A L'EMPLOI EXIGENT UN CONTRAT ÉCRIT
LES CONTRATS GENERATION
La LOI n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, contraint au CDI aussi bien pour le jeune de moins de 26 ans ou de moins de 30 ans s'il est handicapé que pour le senior de 55 ou 57 ans.
Le Décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération, impose une grande complexité pour appliquer la loi dite contrat génération.
LES EMPLOIS FRANCS
Le Comité interministériel des villes du 19 février 2013 a
décidé l'expérimentation pour une durée de trois ans d'un dispositif "emplois francs".
Les emplois francs sont un nouveau dispositif pour faciliter l'embauche en CDI
de jeunes de moins de 30 ans, qu'ils soient ou non qualifiés, et vivant dans un quartier situé en ZUS.
Le Décret n° 2013-549 du 26 juin 2013 est relatif à l'expérimentation d'emplois francs.
L'Arrêté du 31 octobre 2013 fixe la liste des communes éligibles au dispositif «emplois francs».
Les conventions collectives prévoient les périodes d'essai.
Article L. 1221-25 du travail
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la
période d'essai définie aux articles
L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article
L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait
de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre
droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité
compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages
que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à
l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 16 septembre 2015 Pourvoi N° 14-16713 Cassation partielle Vu l'article L. 1221-25 du code du travail ; COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 5 novembre 2014 Pourvoi N° 13-18114 Cassation partielle Vu l'article L. 1221-25 code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la période d'essai, renouvellement inclus,
ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ; qu'il en
résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au
terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de
la période d'essai ; que la poursuite de la relation de travail au-delà du terme
de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée
qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement ;
Attendu que pour décider que le contrat de travail avait été rompu pendant la
période d'essai et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du
contrat de travail, l'arrêt, après avoir relevé que la période d'essai de trois
mois prenait fin le 16 avril 2011, retient que le salarié a bénéficié du délai
de prévenance de deux semaines auquel il pouvait prétendre, du 8 avril au 22
avril 2011, l'employeur lui ayant notifié par lettre du 8 avril 2011 que son
essai n'était pas concluant et que, pour respecter le délai légal de prévenance
de quinze jours, son contrat de travail serait rompu à compter du 22 avril 2011
; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la relation de travail
s'était poursuivie au-delà du terme de la période d'essai, la cour d'appel a
violé le texte susvisé
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société
Information Builders France à compter du 15 mars 2010, avec une période
d'essai de quatre mois ; que cette période d'essai a été prolongée pour une
nouvelle durée de quatre mois, devant s'achever le 14 novembre 2010 ; que par
courrier du 13 octobre 2010, la société a informé le salarié qu'elle mettait
fin à la période d'essai et le dispensait de l'exécution de son « préavis »
prenant fin le 2 décembre 2010 ; qu'estimant que la rupture du contrat
s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a
saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre
tant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que
d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que
l'employeur a respecté les prescriptions de l'article L. 1221-25 du code du
travail relatives au délai de prévenance, que les dispositions de l'article 14
de la convention collective Syntec, fixant la durée du préavis et aboutissant
à un dépassement de la période d'essai légale ne peuvent s'appliquer, de sorte
que la rupture intervenue le 2 décembre 2010 au lieu du 15 novembre s'analyse
en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que
l'employeur avait mis fin à la période d'essai avant son terme et avait
dispensé le salarié de l'exécution de son « préavis » lequel avait été réglé, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LA DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI DOIT ÊTRE CONFORME AUX TRAITES INTERNATIONAUX RATIFIES PAR LA FRANCE
UNE PÉRIODE D'ESSAI D'UN AN EST TROP LONGUE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 11 janvier 2012 Pourvoi N° 10-17945 CASSATION PARTIELLE
Vu les principes posés par la Convention internationale n°
158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 novembre
2006 en qualité de directeur de magasin « Champion » à Lézignan, catégorie cadre
niveau 8, par la société Lezidis, suivant contrat de travail à durée
indéterminée prévoyant une période d'essai de six mois renouvelable une fois ;
que le 30 avril 2007, la période d'essai a été renouvelée suivant lettre de
l'employeur signée le jour-même par le salarié ; que l'employeur a notifié au
salarié le 22 octobre 2007 la rupture de sa période d'essai ; que contestant la
rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit dit
que le contrat de travail a été rompu par l'employeur après l'expiration de la
période d'essai et que cette rupture produit les effets d'un licenciement,
l'arrêt retient que la convention collective nationale du commerce de gros et de
détail à prédominance alimentaire, applicable, stipule dans son article 2 de
l'annexe III intitulé « cadres » que la durée normale de la période d'essai est
fixée à 3 mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée
différente pouvant atteindre 6 mois, renouvelable une fois après accord entre
les parties, que l'article 2 du contrat de travail de M. X... prévoit « une
période d'essai de 6 mois renouvelable une fois d'un commun accord » et par la
suite reprend mot pour mot les termes de la convention collective sur la faculté
de se séparer et le délai de prévenance ; que la durée de la période d'essai
fixée dans le contrat de travail de 6 mois renouvelable est strictement conforme
aux dispositions conventionnelles applicables ; que cette durée n'est pas
excessive eu égard non seulement à la qualification professionnelle du salarié
mais également à la finalité de la période d'essai qui est de permettre
l'évaluation de ses compétences, de sa capacité à diriger, à prendre en main la
gestion d'un magasin dans son ensemble et à "manager" l'ensemble du personnel ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'est déraisonnable, au regard de la finalité de la
période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette
période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an, la cour d'appel a violé la convention internationale susvisée
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 26 mars 2013 Pourvoi N° 11-25580 CASSATION PARTIELLE
Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin
1980, ensemble les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982
et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 § 2 b)
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son
contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'il n'existait aucune disposition
d'ordre public en droit français interdisant, au moment de la rupture du contrat
de travail intervenue en 2006, une période d'essai d'un an, et qu'ainsi le
salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la
loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle
le contrat de travail était soumis
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, pendant l'intégralité de la
durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en
France, et alors que les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de
l'OIT constituent des dispositions impératives et qu'est déraisonnable, au
regard des exigences de ce texte, une période d'essai dont la durée,
renouvellement inclus, atteint un an, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées
UNE PERIODE D'ESSAI DE SIX MOIS EST TROP LONGUE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 10 mai 2012 Pourvoi N° 10-28512 CASSATION
Vu les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 mars 2006 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, en qualité d'assistante commerciale, ayant pour fonctions d'accueillir et d'orienter la clientèle, dont elle devait identifier les besoins pour lui donner, notamment en prenant en compte la procédure du traitement du risque, une réponse adaptée; que son contrat de travail stipulait l'obligation d'accomplir, conformément à l'article 10 de la convention collective, une période de stage de six mois ; que l'employeur ayant mis fin à son stage le 29 août 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la période de stage de six mois prévue pour les agents de catégorie A à E, par l'article 10 de la convention collective du Crédit agricole, n'apparaît pas excessive dès lors qu'eu égard à la définition du poste de la salariée, les fonctions qu'elle devait remplir nécessitaient, pour être évaluées dans leur efficacité, une appréciation dans la durée, l'évaluation à mi-parcours permettant à l'employeur de vérifier que la salariée était apte à tenir compte des observations qui lui étaient faites sur la qualité de son travail et à la salariée de rectifier ses carences professionnelles afin d'obtenir sa titularisation
Qu'en statuant ainsi, alors qu'est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée est de six mois, la cour d'appel a violé la Convention internationale susvisée
LA PERIODE D'ESSAI DOIT ETRE CONFORME A LA CONVENTION COLLECTIVE VISEE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 16 mai 2012 Pourvoi N° 11-11100 CASSATION PARTIELLE
Qu'en statuant ainsi, alors que la validité de la clause fixant la durée de l'essai devait s'apprécier à la date de sa conclusion et en se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, peu important qu'il soit ultérieurement établi que cette convention n'était pas celle appliquée dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a écarté les dispositions conventionnelles prévoyant seulement, pour les ingénieurs et cadres, une période non renouvelée d'essai de trois mois, a violé les textes susvisés
LA PERIODE D'ESSAI SE DECOMPTE EN JOUR CALENDAIRE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 28 avril 2011 Pourvoi N° 09-72165 CASSATION
Vu l'article L. 1242-10 du code du travail
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat
d'accompagnement vers l'emploi à durée déterminée de six mois à compter du 23
juillet 2007 par l'association Clé Nord Pas-de-Calais en qualité de technicien
de maintenance informatique, ledit contrat stipulant une période d'essai d'un
mois ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 6 août 2007, le
salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses
sommes pour rupture abusive du contrat de travail comme étant intervenue après
la période d'essai
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir
énoncé qu'en l'espèce, et en application des dispositions de l'article L.
1242-10 du code du travail, la période d'essai ne pouvait excéder deux semaines,
retient que ladite période devait être décomptée en jours travaillés, et que la
rupture de la relation de travail était en conséquence intervenue avant que la
période d'essai n'ait pris fin
Attendu cependant qu'au sens de ce texte, et sauf disposition conventionnelle ou
contractuelle contraire, toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours,
en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations
que la période d'essai s'était achevée le 5 août 2007, la cour d'appel a violé
le texte susvisé
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 15 mars 2006 Pourvoi N° 04-44544 CASSATION
Les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s'appliquent pas au calcul de la durée d'une période d'essai, laquelle, sauf disposition contraire, commence le jour même de la conclusion du contrat de travail et se termine le dernier jour à minuit. Une période d'essai de deux mois commencée le 14 mai se termine donc le 13 juillet à minuit.
EN CAS DE CHANGEMENT DE POSTE UNE NOUVELLE PERIODE D'ESSAI N'EST POSSIBLE QUE SUR ACCORD DU SALARIE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 16 mai 2012 Pourvoi N° 10-24308 Cassation partielle
Vu l'article 1134 du code civil
Attendu que si au cours de l'exécution du contrat de travail l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié
Attendu que pour limiter le rappel de salaire dû au salarié, en raison de sa promotion au poste de responsable de boutique, à la période du 1er au 21 septembre 2007, l'arrêt énonce qu'en l'espèce la période d'essai contractuelle correspond à une promotion professionnelle en cours de contrat et doit être qualifiée de période probatoire dont la rupture a pour seul effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; que M. X... ne conteste pas sérieusement que cette décision est intervenue pendant la période probatoire ; qu'ainsi l'employeur qui a mis fin aux fonctions de cadre de M. X... et l'a maintenu dans ses fonctions d'adjoint n'a pas commis de manquement dans l'exécution du contrat
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la période probatoire avait fait l'objet d'un accord exprès du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale

LE SALAIRE EST UN ÉLÉMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 18 mai 2011 Pourvois N° 09-69175 CASSATION
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à faire juger que la
prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets
d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que
l'augmentation du salaire de base en octobre 2006 (de 7%) permettait de
compenser la baisse du taux des primes (de 6%) de sorte que la modification
n'avait pas d'incidence sur le montant de la rémunération ; que le salarié
avait d'ailleurs admis le principe de l'harmonisation avancée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération contractuelle d'un salarié
constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans
son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que
l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le
montant global de la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé les
textes susvisés
Les stipulations contractuelles ne s'additionnent pas aux conventions collectives si elles ont le même objet et la même cause.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 13 juin 2012
Pourvois N° 10-27395 RejetMais attendu que si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le treizième mois prévu par le contrat de travail constituait une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, alors que la gratification instituée par l'accord d'entreprise du 19 octobre 1988 constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, a pu en déduire que ces avantages n'avaient pas le même objet.
LES AVANTAGES EN NATURE DOIVENT PARAÎTRE SUR LES FICHES DE SALAIRE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 31 janvier 2012 Pourvoi N° 10-24388 CASSATION PARTIELLE
Vu les articles L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail ;
Attendu que la fourniture, par l'employeur, d'un logement et d'un véhicule constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts en réparation de la perte de chance résultant du fait que les avantages en nature qui lui avaient été consentis n'avaient pas été intégrés au montant de sa rémunération brute, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... bénéficiait, au titre des avantages en nature, de la fourniture par son employeur d'un logement et d'un véhicule, retient que ceux-ci n'étaient pas quantifiés par l'employeur et que le salarié ne produit pas les justifications utiles ayant servi à leur calcul ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait perçu des avantages en nature devant être intégrés au montant de sa rémunération brute et qu'il ne pouvait lui être opposé la carence de l'employeur à les faire figurer sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LA PRIME DE PANIER ET DE NON ACCIDENT SONT DES AVANTAGES EN NATURE INCLUS DANS LE SALAIRE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 13 février 2013 Pourvoi N° 11-23880 CASSATION PARTIELLE
Mais attendu qu'ayant constaté que cette prime de panier a pour objet d'indemniser une sujétion liée à l'organisation du travail de l'intéressé, à savoir de nuit de 21h12 à 5h du matin, et que le salarié ne la perçoit pas durant ses congés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle constitue un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé
Mais attendu qu'ayant constaté que cette prime de non-accident compense une servitude permanente de l'emploi occupé par le salarié, consistant dans l'absence d'accident, ce qui témoigne de la bonne exécution de son travail par le salarié qui ne la perçoit pas lors de ses congés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle constitue un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé
LE RÉGIME DES POURBOIRES
Article L3244-1 du Code du Travail
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Article L. 3244-2 du Code du Travail
Les sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.
JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 16 décembre 2015 Pourvoi N° 14-19073 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014) que Mme X..., salariée de la société ISS propreté en qualité d'hôtesse de blocs sanitaires et percevant des pourboires directement des clients, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement des sommes retenues sur son salaire pour la période d'août 2005 à avril 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de la salariée
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3244-2 du code du travail que les pourboires s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur ;
Et attendu qu'ayant relevé l'absence de disposition contractuelle ou conventionnelle relative au régime des pourboires susceptibles d'être perçus par la salariée de la part des usagers des toilettes de l'aérogare d'Orly, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucun salaire minimum qu'il aurait garanti à l'intéressée, a légalement justifié sa décision
LE RÉGIME DES PRIMES DE FIDELITE
Il résulte des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'une clause convenue entre les parties, dont l'objet est de fidéliser le salarié dont l'employeur souhaite s'assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour débouter l'employeur de sa demande tendant au remboursement de la prime d'arrivée au prorata, retient que l'employeur ne pouvait valablement subordonner l'octroi définitif de la prime initiale versée au salarié à la condition que ce dernier ne démissionne pas, et ce, à une date postérieure à son versement, dès lors que cette condition, qui avait pour effet de fixer un coût à la démission, portait atteinte à la liberté de travailler du salarié
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 11 mai 2023 pourvoi n° 21-25.136 cassation
Vu les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail,
et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Aux termes du premier de ces textes, nul ne peut apporter aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne
seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
6. Selon le deuxième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
7. Selon le troisième, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
8. Il résulte de ces textes qu'une clause convenue entre les parties, dont
l'objet est de fidéliser le salarié dont l'employeur souhaite s'assurer la
collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et
disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l'acquisition de
l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de
l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans
l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le
remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa
démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue.
9. Pour débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt, après
avoir relevé que l'article 7.3 du contrat de travail prévoyait le versement dans
les trente jours de l'entrée en fonction du salarié d'une prime initiale d'un
montant de 150 000 euros et que ce dernier devrait rembourser ladite prime
partiellement en cas de démission dans les trente-six mois de sa prise de
fonction, retient que l'employeur ne pouvait valablement subordonner l'octroi
définitif de la prime initiale versée au salarié en janvier 2016 à la condition
que ce dernier ne démissionne pas, et ce, à une date postérieure à son
versement, dès lors que cette condition, qui avait pour effet de fixer un coût à
la démission, portait ce faisant atteinte à la liberté de travailler du salarié.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation
prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de
dispositif de l'arrêt infirmant le jugement ayant condamné le salarié aux dépens
de première instance, ordonnant la remise à ce dernier d'un solde de tout compte
et condamnant l'employeur aux dépens d'appel.
12. Tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L.
411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
L'EMPLOYEUR NE DOIT PAS FAIRE DE DISCRIMINATION ENTRE SALARIÉS
Le Décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 est relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Cour de cassation chambre sociale 30 mars 2011 N° de pourvoi 09-71542 REJET
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de
qualification, de mutation, en raison de son état de santé
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande
tendant à ce que le Crédit Mutuel Antilles-Guyane soit condamné à lui verser
diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt énonce par motifs propres et
adoptés que le changement d'affectation opéré par l'employeur relève de son
pouvoir de direction, s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle
dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant ; que la
maladie de la salariée est certes évoquée dans le courrier de l'employeur mais
l'est à l'appui du choix qu'il a fait pour la salariée d'un poste moins
générateur de stress, alors qu'elle est en train de se rétablir d'un accident
vasculaire et qu'elle ne peut exercer qu'à mi temps
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le changement
d'affectation avait été décidé en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LE PRINCIPE A TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL
Communiqué de la Cour de cassation relatifs aux arrêts dans les pourvois N° 10-14725, N° 10-11933 et 10-13663 du 8 juin 2011 de la chambre sociale
Par deux arrêts rendus le 8 juin 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les conditions de mise en œuvre du principe “à travail égal, salaire égal” lorsque l’inégalité de traitement prétendue repose sur des stipulations conventionnelles.
Elle avait jugé, le 20 février 2008 (n ° 05-45.601, affaire dite des “tickets restaurant”, Bull., V n ° 39) et le 1 er juillet 2009 (n ° 07- 42.675, Bull., V, n ° 168), que la seule différence de catégorie professionnelle (cadre ou employé) ne pouvait justifier une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause, que celui-ci ait été institué unilatéralement par l’employeur (1 ère espèce) ou soit le fruit de la négociation collective (2 ème espèce).
Les réactions parfois vives suscitées par ces deux arrêts et notamment par le second dont certains ont prédit qu’il allait remettre en cause tout l’édifice conventionnel, ont conduit la chambre sociale à approfondir sa réflexion, en particulier par l’organisation d’échanges avec les représentants des organisations patronales et syndicales.
Les décisions du 8 juin 2011 sont l’aboutissement de cette démarche. Sans remettre en cause le principe du contrôle incombant au juge dans la mise en œuvre du principe sus évoqué, ces arrêts s’efforcent toutefois d’en circonscrire les contours lorsque, comme dans chacune des deux espèces, l’inégalité résulte de l’application de dispositions conventionnelles négociées. La chambre sociale admet dans cette hypothèse que la différence de traitement puisse être justifiée par une différence de catégorie professionnelle, dès lors qu’elle a pour but de prendre en compte, notamment - la liste n’est donc pas limitative -, les spécificités des conditions d’exercice des fonctions des uns et des autres, l’évolution de leurs carrières respectives ou les modalités de leurs rémunérations.
Il s’agira cependant, pour les juges du fond, de procéder aux recherches utiles pour vérifier, sous le contrôle de la Cour de cassation, que tel ou tel traitement catégoriel différencié institué conventionnellement est justifié par une raison objective et pertinente tenant, en particulier, à l’une des raisons énumérées.
C’est dans le même sens qu’avait conclu l’avocat général.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt 8 juin 2011 Pourvoi N° 10-14725 CASSATION
Vu le principe d’égalité de traitement, ensemble l’article 22 9 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique
Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement, résultant d’un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Laboratoires Ciba Ceigy, devenue la société Novartis Pharma, en qualité de visiteur médical le 24 septembre 1979 ; qu’ayant été nommé délégué hospitalier, groupe VI, niveau C, selon la convention collective de l’industrie pharmaceutique à compter du 1er janvier 1998, il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté conventionnelle pour la période courant de février 2003 à février 2009
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l’arrêt retient que les cadres et assimilés cadres sont placés dans une situation identique au regard de la prime d’ancienneté litigieuse, car il n’existe aucune raison objective pour que l’ancienneté des seconds soit rémunérée par une prime et que celle des premiers ne le soit pas ; qu’il est donc inutile de rechercher si le salarié est resté cadre ou est devenu assimilé cadre puisque dans les deux cas il avait droit à la prime
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective de l’industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière de prime d’ancienneté n’avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 8 juin 2011 Pourvois N° 10-11933 et 10-13663 CASSATION PARTIELLE
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Mais attendu que, selon l’article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d’un délégué du personnel ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, et que cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l’expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l’institution
Qu’il en résulte que c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a relevé que l’élection des délégués du personnel de la société Sopafom avait été annulée par un jugement du 24 février 2007, et qui a constaté que la période de protection dont bénéficiait M. X... après avoir cessé ses fonctions expirait le 24 août 2007, a décidé que le licenciement, qui reposait sur des faits survenus le 4 juillet 2007, aurait dû être soumis à l’autorisation de l’autorité administrative
Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l’article L. 2411 5 du code du travail
Attendu que la cour d’appel énonce qu’il y a lieu de condamner la société Sopafom à verser à M. X... une somme de 9 948 euros pour violation du statut protecteur
Attendu cependant que l’indemnité pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection qu’il en résulte que le salarié, licencié en méconnaissance de son statut protecteur après l’expiration de la période de protection, ne peut bénéficier de cette indemnité qui couvre le préjudice lié à la perte du mandat
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé
Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu le principe d’égalité de traitement, ensemble les articles 4 et 7 de la convention collective régionale du bâtiment et des travaux publics
Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération
Attendu que pour condamner la société Sopafom à verser à M. X... à titre d’indemnité de préavis d’une part et d’indemnité de licenciement d’autre part, en application de la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne des sommes correspondant à trois mois de salaire, la cour d’appel énonce qu’en vertu des principes d’égalité de traitement et de prohibition des discriminations, l’employeur ne peut arguer de ce que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement auraient été calculées comme s’il était un cadre alors qu’il ne serait qu’ETAM
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence qu’elle constatait dans les dispositions de la convention collective régionale de la région parisienne relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement au bénéfice des cadres, par rapport à celles prévues au bénéfice des employés, techniciens et agents de maîtrise, n’avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
LE PRINCIPE A TRAVAIL ÉGAL SALAIRE ÉGAL EST APPLICABLE AUX SALARIÉS QUI SONT DANS LA MÊME SITUATION
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 30 novembre 2017 cassation sans renvoi pourvois n° 16-20532 16-20533 16-20534 16-20535 16-20536 16-20537 16-20538 16-20539 16-20540 16-20541 16-20542 16-20543 16-20544 16-20545 16-20546 16-20547 16-20548 16-20549
Vu le principe d'égalité de traitement et l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des
entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
Attendu, d'abord, que l'évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le
principe d'égalité de traitement à l'égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée de ce principe à propos du transfert des
contrats de travail organisé par voie conventionnelle ;
Attendu, ensuite, que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi
instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à
l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est
tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas
étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ;
Attendu, selon les jugements attaqués, qu'en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et
services associés du 26 juillet 2011, la société AAF La Providence II, attributaire depuis le 1er janvier 2010 du marché de nettoyage du site "banque
de France", a repris à son service différents salariés affectés sur ce site à la suite de la perte du marché par leur employeur ; que, s'estimant victimes d'une
inégalité de traitement en ce que certains salariés de la société AAF La Providence II, issus d'un transfert antérieur, bénéficiaient d'un treizième mois
en raison de la règle imposant le maintien de leur rémunération lors de la reprise du marché, M. X... et vingt-six autres salariés affectés sur ce site ont
saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement d'une prime de treizième mois pour la période située entre 2010 et 2014 ;
Attendu que pour condamner la société AAF La Providence II à payer à chaque salarié une somme à titre de prime de treizième mois, les jugements retiennent
que les différents salariés demandeurs accomplissent le même travail pour le même employeur sur le même chantier, s'agissant tant des salariés dont le
contrat de travail a été transféré lorsque le marché a fait l'objet d'un changement de prestataire au 1er janvier 2010 que des salariés faisant déjà
partie des effectifs de la société AAF La Providence II à cette date, et que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une raison objective et pertinente
justifiant la différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le principe et le texte susvisés ;
LE SALARIE PROTEGE NE PEUT PAS SUBIR DE PERTE DE SALAIRE
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 12 juin 2013 N° de pourvoi 12-15064 REJET
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2325-9 du code du travail que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; que le moyen n'est pas fondé
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 12 juin 2013 N° de pourvoi 12-12806 Cassation partielle
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2315-3 du code du travail que le délégué du personnel ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
LE SALARIE DOIT APPORTER DES ELEMENTS DE PREUVE
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 12 juin 2013 N° de pourvoi 11-14458 REJET
Mais attendu qu'il appartient au salarié qui
invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de
rémunération ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge
d'en ordonner la production ; que ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de
déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces ;
Et attendu que le salarié s'étant borné dans ses conclusions à alléguer que la
société Kodak avait procédé à une augmentation générale des salaires au premier semestre, sans saisir le juge d'une demande de production des justificatifs
détenus par une autre partie, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision
L'EMPLOYEUR DOIT LES CONGES PAYES ET LE TEMPS DE REPOS
Un employé peut offrir ses jours de repos à un collègue qui a un enfant très gravement malade
Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade
Article L. 1225-65-1 du code du travail
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à
tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la
charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période
d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son
ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article L. 1225-65-2 du code du travail
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
L'EMPLOYEUR DOIT ASSURER LE REPOS DE SES SALARIÉS
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 8 novembre 2016 N° de pourvoi 15-15064 cassation partielle
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à
la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des
durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en annulation de la convention de forfait et en paiement d'heures supplémentaires au delà du 1er mai
2012, l'arrêt retient que la société établit avoir satisfait aux obligations tant conventionnelles, qu'issues des dispositions nationales et européennes, en
matière de protection de la santé du salarié, notamment en garantissant un strict contrôle du droit effectif au repos et aux amplitudes de travail, que
l'entretien annuel afférent à l'organisation de la charge de travail était prévu, et la circonstance que le contrat de travail a été rompu avant
l'expiration du délai pour accomplir cette formalité, n'est pas de nature à faire présumer que l'employeur aurait été défaillant, que surtout avaient bien
été instaurés les documents de contrôle des jours travaillés et des jours de congés par voie d'un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même et que
ce dernier a rempli ces formulaires, visés par le service paye et produits aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1. 09f alors applicables de la convention collective du commerce et de la réparation de
l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30
octobre 1981, qui se bornent à prévoir que le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien
avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées
d'activité, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des
intéressés ainsi que l'instauration d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et la qualification des journées
non travaillées par voie d'un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de
travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et
de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés
L'EMPLOYEUR DOIT PAYER AU MINIMUM LE SMIC AUX SALARIES
LES TEMPS DE POSE OBLIGATOIRES SONT COMPRIS DANS LA REMUNERATION
POUR PERMETTRE AUX SALARIES DE PERCEVOIR LE SMIC
Cour de cassation chambre criminelle du 15 février 2011 N° de pourvoi 10-83998 REJET
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'inspection du travail, M.
X..., directeur de l'établissement "Champion" exploité à Marines (Val- d'Oise)
par la société "Dagui", et cette société, ont été cités à comparaître devant
le tribunal de police pour paiement, entre les mois de juillet et d'octobre
2008, de salaires inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de
croissance (SMIC), sur le fondement des articles R. 3233-1 et L. 3231-2 du
code du travail, en incluant, dans le calcul du salaire de base, la
rémunération des temps de pause prévue, à raison de 5% du temps de travail
effectif, par la convention collective étendue du commerce de détail et de
gros à prédominance alimentaire, alors que, selon cette convention collective,
durant les périodes de repos comprises dans le temps de présence journalier au
sein de l'entreprise, l'exécution du travail était suspendue ; que le tribunal
de police a relaxé les prévenus et débouté de leurs demandes l'Union locale
des syndicats CGT de l'agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs,
l'Union départementale CGT du Val-d'Oise et M. Y..., constitués parties
civiles
Attendu que, pour infirmer la décision du premier juge sur le seul appel
desdites parties civiles, et écarter l'argumentation des prévenus qui
soutenaient que la rémunération forfaitaire du temps de pause, telle que
prévue par la convention collective applicable, répondait à des critères de
fixité, de généralité et de constance et constituait ainsi, de fait, une
composante du salaire minimum garanti, l'arrêt relève tout d'abord qu'il n'est
pas contesté en l'espèce que, durant les pauses, les salariés de la société "Dagui"
pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles et que, dans ces
conditions, la rémunération de ce repos, accordé pour atténuer la pénibilité
du travail et assurer le maintien de la santé du salarié, ne pouvait être
considérée comme versée à l'occasion ou comme contrepartie d'un travail ; que
la cour d'appel en déduit que les salariés n'étant pas restés à la disposition
de leur employeur pendant les temps de pause, la rémunération allouée, même si
elle était systématique et uniforme, ne correspondait pas à un temps de
travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du
travail
Attendu qu'en l'état de ce ces motifs, exempts d'insuffisance
comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision
Qu'en effet, dans le cas où les temps de pause correspondent à un repos
obligatoire durant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de leur
employeur, les primes les rémunérant, qui ne correspondent ni à un travail
effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail ni à un complément de
salaire de fait au sens de l'article D. 3231-6 dudit code, sont exclues du
salaire devant être comparé au salaire minimum de croissance
Cour de cassation chambre criminelle du 15 février 2011 N° de pourvoi 10-87019 CASSATION
Vu l'article L. 212-4 devenu L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble
les articles D. 141-2, devenu D.3231-5, et D. 141-3 devenu D.3231-6 dudit code
et l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il résulte des trois premiers de ces textes que la
durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à
des occupations personnelles ; que l'employeur ne peut inclure dans le calcul
des salaires, afin de les porter au niveau du salaire minimum de croissance, la
rémunération spécifique, prévue par une convention ou un accord collectif ou par
un contrat de travail, dont peuvent faire l'objet les temps consacrés aux
pauses, s'ils ne répondent pas à cette définition ;
Attendu que, d'autre part, selon le quatrième de ces textes, tout jugement ou
arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux
conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs
équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du
procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'à la suite
d'un contrôle effectué au sein d'un établissement Carrefour à Givors, la société
Carrefour hypermarchés a été poursuivie devant le tribunal de police pour
paiement, au cours de l'année 2006, de salaires inférieurs au salaire minimum de
croissance (SMIC) sur le fondement de l'article R.154-1 du code du travail,
alors applicable ; qu'il lui était reproché d'avoir intégré dans le calcul du
salaire de base de cent soixante-douze salariés la rémunération des temps de
pause prévue, à raison de 5% du temps de travail effectif, par la convention
collective étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,
alors que, selon cette convention collective et l'accord conclu dans
l'entreprise, les temps de pause permettaient aux salariés de vaquer librement à
des occupations personnelles et que les primes les rémunérant ne pouvaient être
incluses dans le salaire à comparer au SMIC ; que le tribunal de police ayant
déclaré la prévention établie et prononcé sur l'action civile, la prévenue et le
ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer la prévenue et débouter les
parties civiles de leurs demandes, l'arrêt énonce que la rémunération des temps
de pause, consistant en une majoration de 5% du salaire de base, est directement
liée à l'exécution du contrat de travail, et qu'étant versée de manière fixe et
permanente, elle constitue une rétribution qui est la contrepartie directe du
travail, et non un avantage supplémentaire ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les
salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur pendant les pauses et
qu'il en résultait que la prime rémunérant celles-ci, non reconnues comme du
temps de travail effectif, était exclue du salaire devant être comparé au SMIC,
la cour d'appel, qui, de surcroît, n'a pas répondu aux conclusions des parties
civiles invoquant le fait que, pour certains membres du personnel, même en
incluant le forfait pause au salaire de base, le salaire horaire restait
inférieur au minimum légal, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés
Cour de cassation chambre sociale du 20 février 2013 N° de pourvois 11-26401 11-26404 11-26406 11-26407 REJET
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 21 septembre 2011), que M. X... et six autres agents de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) étaient affectés dans " les formations locales de sécurité " et travaillaient selon un rythme " 24X48 ", alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de " pause ", et une période de quarante-huit heures de repos ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail les quatre heures trente de " pause "
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande
Mais attendu que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Et attendu qu'ayant constaté que, pendant leur temps de " pause ", les salariés étaient tenus de demeurer dans les locaux du CEA qualifiés de base-vie, qu'ils pouvaient être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité, lesquelles étaient fréquentes, tant pendant le sommeil que pendant les repas, devaient se conformer aux directives de leur employeur et rester à sa disposition, de sorte qu'ils ne pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a exactement décidé que cette période constituait un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus
APRES SIX HEURES DE TRAVAIL CONTINU, LE TEMPS DE PAUSE EST DE 20 MINUTES
Cour de cassation chambre sociale du 20 février 2013 N° de pourvois 11-21599 11-21848 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 2011) que Mme X..., engagée le 21 février 2005 en qualité de préparatrice de commandes à temps partiel par la société Lidl, s'est trouvée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 18 février 2006 ; qu'après avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprise des 12 et 27 février 2007, la salariée a été reclassée par l'employeur dans l'emploi de caissière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral et non-respect du temps de pause
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect du temps de pause
Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3121-33 du code du travail,
pris pour l'application de l'article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du
23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6
heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20
minutes ;
Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail
relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail
effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve
du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union
européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur qui détenait les plannings de la
salariée et disposait de l'ensemble des éléments de preuve concernant
l'organisation du temps de travail dans ses établissements ne démontrait pas, ni
ne prétendait pas avoir respecté les temps de pause prévus par l'article L.
3121-33 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du
litige, a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision
LE TEMPS POUR METTRE ET RETIRER UNE TENUE DE TRAVAIL N'EST PAYE
QUE SI L'EMPLOYE EST CONTRAINT DE S'HABILLER DANS L'ENTREPRISE
Article L3121-3 du Code du Travail
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
JURISPRUDENCE
Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2011, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 23 février 2010 sur renvoi après cassation, qui avait débouté des salariés de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme de leur demande en paiement du temps non pris en compte d’habillage et de déshabillage liés au port de la tenue de service auquel ils sont obligés à leur arrivée sur leur lieu de travail.
La cour de renvoi avait statué en application du revirement opéré par l’arrêt de la Chambre sociale en date du 26 mars 2008, alors qu’elle avait été saisie sur le fondement de l’ancienne jurisprudence, aux termes de laquelle l’obligation au port d’une tenue de travail implique nécessairement l’habillage et le déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu du travail.
L’Assemblée plénière a énoncé que « selon l’article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte ». C’est dire que les employés ne peuvent obtenir le bénéfice de ces contreparties que s’ils sont soumis à la double obligation suivante : un port exigé par des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles ; un habillage et un déshabillage imposés dans l’entreprise ou sur le lieu du travail.
Consécutivement, elle a relevé, d’une part, qu’en l’espèce, seule était remplie la première condition, le port d’un uniforme imposé par une clause de leur contrat de travail, puisqu’ils devaient en être revêtus dès leur arrivée sur le lieu de travail en application d’une note de service exigeant corrélativement un habillage et déshabillage à domicile, d’autre part, que l’appréciation de cette note sous l’angle d’une éventuelle restriction aux droits et libertés des salariés ne leur ayant pas été demandée, les juges du fond n’avaient pas à statuer sur ce point.
Par cet arrêt rendu sur l’avis conforme de l’avocat général, l’Assemblée plénière consacre donc le revirement de jurisprudence antérieurement intervenu.
ASSEMBLEE PLENIERE de la COUR DE CASSATION arrêt du 18 novembre 2011
Pourvoi n° 10-16491 REJETMais attendu que, selon l’article L. 3121 3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte ; qu’ayant relevé que les salariés, astreints par leur contrat de travail au port d’une tenue de service, n’avaient pas l’obligation de la revêtir et de l’enlever sur leur lieu de travail, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches non demandées, a fait l’exacte application du texte précité ; que le moyen n’est pas fondé.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 21 novembre 2012 Pourvoi N° 11-15696 REJET
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de
prud'hommes de Montbrison du 14 février 2011) rendu en dernier ressort, que M.
X..., salarié de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne
depuis le 13 septembre 2004 jusqu'en juin 2009, a saisi la juridiction
prud'homale en paiement d'une somme au titre de la contrepartie du temps
d'habillage et de déshabillage ainsi que de rappel de salaire et de congés
payés pour coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Eiffage travaux
publics Rhône-Alpes-Auvergne :
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser au
salarié des sommes au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de
déshabillage et au titre des congés payés afférentsMais attendu que, selon
l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire
aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la
réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié était astreint au port d'un vêtement
de travail et que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerçait son
activité lui imposaient pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de
l'enlever sur le lieu de travail, le conseil de prud'hommes en a déduit à bon
droit que l'employeur devait à ce titre une contrepartie
LA PRIME D'HABILLAGE NE CONCERNE PAS LE TEMPS ET LES FRAIS DE NETTOYAGE DES HABITS
SI LA CONVENTION COLLECTIVE NE LE PREVOIT PAS
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 5 décembre 2012 Pourvoi N° 11-21113 cassation
Mais attendu qu'il résulte des dispositions
des articles 5 de l'accord du 9 mai 2005 et 3 de l'accord du 13 mars 2008 qui
ont le même objet et le même intitulé, que la prime « d'habillement », est la
contrepartie des seuls temps d'habillage et de déshabillage et ne couvre pas
la prise en charge des frais d'entretien des tenues de travail ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 7 du code de procédure civile ;
Attendu que pour évaluer la somme due au salarié pour l'entretien de ses
vêtements professionnels, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que
l'intéressé ne justifiait pas des frais qu'il avait réellement exposés, s'est
fondé sur une recherche réalisée à partir de différents sites internet,
relative à la consommation en électricité et en eau nécessaire au
fonctionnement d'un lave linge, à l'amortissement du matériel utilisé au
prorata du volume lavé, au coût de la poudre à laver et au temps nécessaire
pour que les vêtements soient prêts à être réutilisés ;
Qu'en retenant ainsi, des éléments qui n'étaient pas dans le débat, la cour
d'appel a violé le texte susvisé
QUAND LA TENUE DE TRAVAIL EST IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR,
L'ENTRETIEN EST PRIS EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 12 décembre 2012, pourvoi N°11-26585 Cassation Partielle sans renvoi
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que la clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite ;
Et attendu qu'ayant constaté que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu'il était inhérent à leur emploi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées, qui étaient inopérantes, a, à bon droit, ordonné à l'employeur de prendre en charge leur entretien, nonobstant la clause contractuelle contraire, et accordé aux salariés une provision à valoir sur les frais qu'ils avaient d'ores et déjà exposés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe fondamental de la liberté d'entreprendre ensemble les articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que s'il résulte de ces deux derniers textes que l'employeur doit assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié, il lui appartient de définir dans l'exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge de cet entretien ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Castorama France devait prendre en charge l'entretien des tenues de travail des salariés, lui a prescrit de mettre en place un système de ramassage, de lavage et de repassage chaque semaine, des tenues sales, et de remise à disposition, la semaine suivante, des tenues propres dans des casiers prévus à cet effet
LE TEMPS DE TRANSPORT ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL N'EST PAS PAYE SI UNE CONVENTION NE LE PREVOIT PAS
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 14 novembre 2012 Pourvoi N° 11-18571 CASSATION
Vu l'article L. 3121-4 du code du travail, tel
qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le temps de trajet pour se rendre du
domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que
lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son
domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une
contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en
l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à
l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer
cette contrepartie ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'AFPA à payer au salarié, au titre de
ses temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail pour la période
comprise entre le 20 janvier 2005 et le 10 février 2006, un rappel de salaire
pour heures supplémentaires et repos compensateur calculé selon les mêmes
principes que pour la période 2002-2004, à savoir sur la base d'un temps de
travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement
unilatéral de l'employeur, s'il appartient au juge de fixer le montant de la
contrepartie due, il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre
le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif, la cour
d'appel a violé le texte susvisé
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE
COMPTEES SEMAINE PAR SEMAINE ET PAYEES
Les heures supplémentaires doivent être comptées et ne peuvent être payées au forfait.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 3 mai 2011
Pourvois N° 09-70813 et 09-71037 CASSATIONVu les articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du
code civil
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures
supplémentaires, l'arrêt retient que le niveau de rémunération qu'il a
rapidement atteint ainsi que la classification la plus haute de la convention
collective à laquelle il a accédé dès le 1er juin 2005 impliquant "la plus
large autonomie de jugement et d'initiative" établissent que la rémunération,
qui prenait en compte le fait qu'il était le seul salarié qualifié pour tenir
le poste de responsable incendie et sécurité et qu'il était amené à travailler
au-delà des 151,67 heures prévues, incluait forfaitairement les heures
supplémentaires
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération
forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus
dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de
forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 21 septembre 2011 Pourvoi N° 09-69927 CASSATION
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner
à verser à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures
supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande d'heures supplémentaires ;
qu'en affirmant péremptoirement que le salarié produisait aux débats "des
éléments", la cour d'appel, qui n'a pas exposé en quoi ils étaient de nature à
étayer sa demande, a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires
accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite
; qu'en faisant droit à la demande de paiement des heures supplémentaires
formée par le salarié sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était
invitée, si l'employeur avait donné son accord même implicite pour leur
réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés,
a retenu que le salarié avait produit, pour étayer sa demande d'heures
supplémentaires, des éléments sur lesquels l'employeur avait été en mesure de
répondre, d'autre part, qu'elle en a, considérant implicitement mais
nécessairement que ces heures supplémentaires avaient été accomplies avec
l'accord de l'employeur, souverainement apprécié le montant ; qu'elle a ainsi
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les
articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que l'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de
travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
l'arrêt retient que n'est pas établie la preuve que M. X... avait travaillé à
l'élaboration de ce projet dans le cadre de ses activités salariales ni que
l'invention avait été réalisée au moyen de techniques de la société et de
connaissances acquises auprès de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher au préalable si le contrat de
travail de M. X... comportait une mission inventive, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale
Le salarié doit apporter des éléments de preuves des heures supplémentaires faites. C'est alors à l'employeur de démontrer que le décompte de l'employé est imaginaire.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale du 7 décembre 2011 Pourvoi n° 10-14156 Cassation partielle
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de
travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la
production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement
réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres
éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures
supplémentaires pour la période antérieure au mois de mars 2001, l'arrêt retient
que Mme X... ne produit qu'un récapitulatif de son temps de travail journalier
sans le moindre élément de nature à lui conférer une apparence de crédibilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures
qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 25 janvier 2012 Pourvoi N° 09-42985 CASSATION PARTIELLE
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture anticipée de son contrat de travail, l'arrêt énonce que les documents produits
établissent de manière certaine qu'il s'est absenté sans motif durant plusieurs jours en juillet, août, septembre et octobre 2007 et que ces absences n'ont pas
été justifiées malgré les demandes des responsables de l'établissement ; que ces absences répétées constituent une faute grave de la part du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait
valoir que la faute grave ne pouvait être invoquée pour justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, dès lors qu'aux termes de la lettre de
rupture, l'employeur avait différé l'effet de cette rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 322-4-7 I, alinéa 7 (devenu L. 5134-26) du code du travail
dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2005 et L. 5134-24 du code du travail ;
Attendu que le premier de ces textes n'autorise pas l'employeur à faire varier
la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par
le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'il en résulte que la clause
contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de
salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le contrat de
travail prévoit "qu'une modulation du temps de travail est possible" ; que la
durée moyenne hebdomadaire ne doit pas excéder 28 heures sur l'année ; que les
documents produits par l'employeur permettent de vérifier que cette durée
moyenne n'a pas été dépassée ; que cette modulation est applicable aux contrats à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle prévoyant la modulation
de la durée du travail sur l'année n'était pas opposable au salarié et qu'il lui appartenait, s'agissant d'un contrat de droit privé, de décompter les heures de
travail par semaine, conformément aux dispositions du code du travail sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LE PREAVIS DE LICENCIEMENT DOIT ETRE PAYE MÊME S'IL N'EST PAS EFFECTUE
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-12810 Cassation partielle
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de solde d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'employeur qui l'avait dispensé d'exécuter son
préavis ne devait le rémunérer que dans la mesure où le salarié était à même de l'effectuer ; qu'ainsi l'indemnité de préavis n'était pas due pour la période
d'arrêt maladie du 30 juin au 2 septembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant dispensé le salarié d'exécuter le préavis, l'employeur était tenu de verser, sans déduction des indemnités journalières de
la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis , peu important que le salarié fût déjà en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la
dispense d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LES FRAIS PROFESSIONNELS DOIVENT ÊTRE REMBOURSES
L'employeur peut payer une somme forfaitaire quand les sommes déboursées par les employés sont faibles
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18212 Cassation
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application
de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 2 et 7 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 octobre 2005 ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que l'indemnisation des frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles pour
l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication s'effectue uniquement sous la forme du remboursement des
dépenses réellement exposées ou, lorsque l'employeur ne peut en justifier, d'après la déclaration faite par les salariés évaluant le nombre d'heures
d'utilisation à usage strictement professionnel de ces outils, dans la limite de 50 % de l'usage total ; que cette indemnisation ne peut être évaluée forfaitairement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, devenue
URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Dynamic marketing services (l'employeur) un redressement résultant de la réintégration, dans
l'assiette des cotisations, d'indemnités forfaitaires, dites indemnités web, versées à ses enquêteurs ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction
de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient notamment que la multiplicité des missions réalisées par les enquêteurs, eux-mêmes recrutés en
grand nombre et au moyen de contrats de travail de très courte durée, a pu inciter l'employeur à rechercher un mode forfaitaire d'indemnisation des frais
professionnels qui, pour chaque mission effectuée, représentent des sommes minimes engagées par les salariés rendant difficile la production systématique
de justificatifs ; qu'à cet égard la recherche d'une moyenne des dépenses habituellement exposées pour l'impression des documents et la transmission des
résultats de l'enquête par internet depuis un ordinateur jusqu'aux services de l'entreprise n'apparaît pas devoir faire l'objet d'un rejet systématique pour la
prise en charge des remboursements déductibles des cotisations de sécurité sociale, dès lors que l'employeur justifie de l'obligation pour ses salariés
d'engager des dépenses particulières (papier, encre, connexion) pour l'exécution même du travail fixé par le contrat d'embauche et justifie également, à partir
de plusieurs factures obtenues de la part d'enquêteurs, de la réalité de frais inhérents à l'exercice du travail d'enquêteur (acquisition d'un ordinateur,
d'une imprimante ou d'un scanner, de papier et abonnement à une connexion internet)
La clause de non-concurrence est celle par laquelle le salarié s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur. Elle est insérée dans le contrat de travail ou imposée par la convention collective dès lors que le contrat de travail y fait référence.
Cliquez sur un lien bleu pour accéder directement aux informations juridiques gratuites sur :
- OBLIGATIONS DU SALARIÉ EN L'ABSENCE DE CLAUSE DE NON CONCURRENCE
- LES CONDITIONS DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
- LE SALARIÉ EST INDEMNISÉ D'UNE CLAUSE DE CONCURRENCE ILLICITE
LE SALARIÉ EN L'ABSENCE DE CLAUSE DE NON CONCURRENCE
SANS CLAUSE DE NON CONCURRENCE, UN ANCIEN SALARIÉ PEUT CAPTER SANS CONCURRENCE DÉLOYALE
LA CLIENTÈLE D'UNE ENTREPRISE POUR SON PROPRE COMPTE
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 10 septembre 2013, pourvoi n°12-19356 cassation partielle
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que les sociétés Gescore et Sofidex ont commis des actes de concurrence déloyale envers la société AOI, l'arrêt retient que, s'il peut
être admis que la clientèle d'un cabinet d'expertise comptable ne soit pas captive et puisse s'attacher à un salarié expert-comptable dudit cabinet et le
suivre lorsqu'il s'installe ailleurs, il n'est pas acceptable qu'une nouvelle société d'expertise bénéficie d'une augmentation significative de clientèle
résultant de l'activité antérieure d'une société préexistante sans aucune contrepartie financière ; qu'il relève que la société Gescore a été créée par M.
Y..., expert-comptable qui avait travaillé quelques années plus tôt pour la société AOI, qu'elle a embauché trois salariés de la société AOI, dont M. Z...,
qui exerçait depuis mai 1997 les fonctions de directeur administratif du bureau AOI de Saint-Gilles et qui a usé de moyens déloyaux en démarchant par téléphone
des clients de cette société, et qu'elle a bénéficié d'une augmentation considérable de son chiffre d'affaires en liaison avec l'arrivée de la clientèle
en provenance d'AOI, postérieurement à l'embauche de salariés de cette société ; qu'il ajoute que le même constat peut être fait en ce qui concerne la société
Sofidex, qui a le même dirigeant que la société Gescore et qui a gagné huit clients de la société AOI dès lors qu'elle a embauché Mme A... qui exerçait les
fonctions d'aide-comptable chez AOI depuis le 2 novembre 1999 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce
par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal, la cour d'appel, qui a constaté un simple
transfert de clientèle sans relever un tel acte de la part des salariés concernés, a privé sa décision de base légale
LE SALARIÉ NE PEUT JAMAIS DÉNIGRER SON ANCIEN EMPLOYEUR
L'EXEMPLE DE MONSIEUR POIVRE D'ARVOR LICENCIE PAR TF1
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 14 janvier 2014, pourvoi n°12-27284 rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2012), que M. X..., engagé par la société France Télévision 1 (TF1), en 1987 et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint de la rédaction chargé de la présentation du journal de 20 heures, ou du grand journal du soir susceptible de le remplacer, a été licencié par lettre du 17 juillet 2008 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 17 septembre par laquelle elles s'interdisaient de se critiquer et de se dénigrer ; qu'estimant que le salarié, notamment par la publication de l'ouvrage « A demain ! En chemin vers ma liberté » en octobre 2008, avait manqué à son engagement, la société TF1 a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages-intérêts
Mais attendu que des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché ;
Et attendu qu'après avoir retenu que, par la transaction conclue le 17 septembre 2008, les parties avaient entendu mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement, de nature à nuire à la réputation de son employeur, que cette transaction comportait l'engagement réciproque de cesser tout propos critique et dénigrant, qu'elle était précise dans son objet et quant aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux programmes que le salarié s'engageait à ne pas critiquer ni dénigrer, qu'elle était limitée à dix-huit mois, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle était justifiée et proportionnée au but recherché ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus
LE DÉBAUCHAGE FAUTIF EST UNE FAUTE SANCTIONNÉE, QUE SI ELLE DÉSORGANISE LE CONCURRENT
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 20 septembre 2011 Pourvoi N° 10-19443 CASSATION
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Asterop pour débauchage fautif, l'arrêt retient que parmi les transfuges de la société Géo concept vers la société
Asterop, quatre d'entre eux étaient membre du département recherche et développement de la société Géo concept et les autres étaient membres de la
structure commerciale et, donc, en contact avec la clientèle de leur employeur et que, si les départs litigieux sont intervenus dans un contexte délicat de
difficultés d'organisation et de communication de la société Géo concept, il demeure que ces départs concernent des ingénieurs hautement qualifiés du
département de recherche et développement, dont Asterop louera la compétence dans le dossier qu'elle présentera à l'ANVAR, ainsi que le directeur et son
adjoint du secteur commercial, en sorte qu'ils n'ont pu qu'affecter aussi le fonctionnement de l'entreprise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier de façon concrète si le transfert des employés vers la société Asterop avait entraîné une véritable
désorganisation de la société Géo concept et non une simple perturbation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le quatrième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Asterop à verser à la société Géo concept des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a cru pouvoir faire procéder à
des opérations de saisie-contrefaçon au siège de Géo concept, alors que les droits dont elle pouvait se prévaloir ne légitimaient pas ces opérations et que
leur caractère abusif appelait la condamnation de la société Asterop ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une saisie-contrefaçon ne fait pas peser
sur son auteur une responsabilité objective du seul fait qu'elle se révèle injustifiée, la cour d'appel a violé l'article susvisé
LES CONDITIONS DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
LES CONDITIONS DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE SONT STRICTES
Peu importe l'existence ou non d'une convention collective, une clause de non-concurrence n'est licite que si, cumulativement :
elle est inscrite dans le contrat de travail ou fait l'objet d'un avenant approuvé le salarié
elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
elle est limitée dans le temps et dans l'espace
elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié
elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière qui ne doit pas être dérisoire. Cette contrepartie financière a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 17 janvier 2006, pourvoi N° 04-41038 REJET
Est d'interprétation stricte une clause de non-concurrence qui apporte une restriction aux principes de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle et de la liberté d'entreprendre.
LES LIMITES DE TEMPS ET GEOGRAPHIQUES NE CONCERNENT QUE DES ENTREPRISES VRAIMENT CONCURRENTES
Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 16 mai 2012 pourvoi n° 11-10712 Cassation
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 mars 2001 par la société Flandredis, exploitant un magasin à l'enseigne Leclerc à Bailleul
(Nord), en qualité de directeur de ce magasin ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant une période
limitée à la durée égale à son ancienneté, plafonnée à deux ans, "de travailler dans toute entreprise, d'une surface de vente comprise entre 1 000 m² et 10 000
m², ayant pour objet la vente au public de produits ou marchandises concurrençant directement ou indirectement les nôtres, et ce dans un rayon de
100 kilomètres à vol d'oiseau autour de notre magasin" ; qu'il était prévu qu'en contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevrait le
jour de la cessation effective de son contrat de travail une indemnité égale à 400 % de son dernier salaire mensuel de base ; que M. X... a démissionné le 27
septembre 2006, à effet du 2 octobre 2006, et a été engagé à compter du 3 octobre 2006 par la société Distrifives en qualité de directeur d'un autre
magasin Leclerc exploité à Fives, à une trentaine de kilomètres de Bailleul ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement
d'indemnité de non-concurrence ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est certes exact que chacune des sociétés exploitant un magasin à l'enseigne Leclerc
constitue une entité juridiquement et économiquement autonome et qu'il n'existe pas à proprement parler un groupe Leclerc au sens capitalistique de ce terme, le
"mouvement Leclerc" étant une association de commerçants indépendants, chaque nouvel adhérent de ce mouvement étant simplement parrainé par un ou plusieurs
adhérents et ce parrainage ne se traduisant, sur le plan financier, que par une prise de participation minoritaire des parrains dans la société du nouvel
adhérent ; que, toutefois, tous les magasins à l'enseigne Leclerc ont une centrale d'achat nationale commune et des centrales d'achat régionales, chaque
adhérent participant en outre à des groupes de travail chargés en particulier de piloter les achats dans les différentes catégories de produits devant être
commercialisés et de définir les modalités de commercialisation ; que c'est l'association des centres distributeurs Leclerc qui définit les orientations
générales de l'enseigne, sa stratégie commerciale et veille au respect par les adhérents des politiques définies par elle ; que si le "mouvement Leclerc" doit
être regardé comme une entité originale différente d'un groupe de sociétés classiques, il n'en constitue pas moins un ensemble structuré destiné à faire en
sorte que tous les magasins de la même enseigne Leclerc disposent d'un certain nombre de moyens importants communs, ce afin de leur permettre d'exercer
efficacement, selon une politique commerciale commune et des orientations communes, leur activité en concurrence avec les autres enseignes de la grande
distribution en France, et qu'il ne peut être en tout cas sérieusement soutenu que les magasins à l'enseigne Leclerc sont des entités concurrentes entre elles
; que le salarié n'a donc nullement violé l'obligation de non-concurrence résultant de la clause figurant à son contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intégration dans un même réseau de
distribution ne suffit pas en elle-même à exclure l'existence d'un état de concurrence entre les entreprises qui en font partie, la cour d'appel, à
laquelle il appartenait de vérifier concrètement l'existence d'une situation de concurrence entre les deux magasins concernés, a privé sa décision de base légale
LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE PERMET D'OBTENIR UN SURPLUS DE CONGES PAYES
COUR DE CASSATION Chambre Sociale du 23 juin 2010 pourvoi n°08-70233 CASSATION
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière
de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt énonce que seul le travail effectif ouvre droit à congés payés ; que dès lors, la contrepartie financière de la
clause de non-concurrence versée par l'ancien employeur pour une période non travaillée ne peut donner lieu à une indemnité de congés payés
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre
droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LE MONTANT DE L'INDEMNISATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE DOIT ÊTRE SUBSTANTIEL
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 22 juin 2011 Pourvoi N° 09-71567 CASSATION PARTIELLE
Vu le principe fondamental de libre exercice
d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 février 2004 par la société Isor en qualité d'attachée commerciale ; que son contrat de
travail comportait une clause de non-concurrence prévoyant le versement pendant toute la durée du contrat de travail d'une majoration de 10 % du
salaire de base mensuel brut, à l'exclusion des primes, versée mensuellement et après la rupture, d'une somme de 15 % du dernier salaire de base mensuel
brut, à l'exclusion des primes, versée mensuellement pendant la durée d'effectivité de la clause ; que la salariée a démissionné le 1er octobre 2006
à effet au 2 novembre 2006 et est entrée à cette date au service d'une société concurrente
Attendu que pour déclarer la clause de non-concurrence licite et condamner la salariée à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité contractuelle
pour violation de cette clause, l'arrêt retient que la contrepartie financière versée pendant l'exécution du contrat de travail et après sa rupture n'était pas dérisoire
Qu'en statuant ainsi, alors que, le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du
contrat de travail, seul devait être pris en considération le montant qu'il était prévu de verser après la rupture, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés
SINON LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE EST NULLE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 16 mai 2012 Pourvoi N° 11-10760 CASSATION
Attendu cependant que si une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à
une absence de contrepartie rendant la clause nulle, le juge ne peut, sous couvert de l'appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire
invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties et, après avoir décidé de
l'annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu'il estime justifiée
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés
ELLE NE PEUT ÊTRE RÉDUITE EN CAS DE DÉMISSION DU SALARIÉ
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 25 janvier 2012 Pourvoi N° 10-11590 CASSATION
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que, pour diminuer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence accordée à la salariée, l'arrêt énonce que la clause relative à l'indemnité de non-concurrence figurant dans le contrat de travail prévoit expressément qu'en cas de démission, l'indemnité sera réduite de moitié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, les parties ne pouvaient dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, la cour d'appel, qui devait en déduire que la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière était réputée non écrite, a violé le principe et le texte susvisés
COUR DE CASSATION Chambre Sociale du 8 avril 2010 pourvoi n°08-43056 CASSATION
Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle,
ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 juin 1994 en qualité d'employé commercial par la société Samse ; que le contrat de travail
contenait une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière ; qu'un avenant du 3 mars 2003 a minoré l'indemnité de non-concurrence en cas de
licenciement pour faute ; que le salarié a démissionné par lettre du 12 octobre 2005 et a perçu la contrepartie financière jusqu'en avril 2006 ; qu'il s'est mis
au service d'une entreprise concurrente le 1er février 2006 ; qu'invoquant la violation de la clause de non-concurrence, l'employeur a saisi la juridiction
prud'homale d'une demande en remboursement de l'indemnité de non-concurrence
Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence est nulle compte-tenu de la minoration de la contrepartie financière en cas de
licenciement pour faute et que l'indemnité de non-concurrence perçue par le salarié, qui a nécessairement subi un préjudice en respectant cette clause, lui
reste acquise à titre de dommages-intérêts
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence n'était pas nulle mais devait être réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la
contrepartie en cas de faute, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés
UNE MINORATION D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE EST ILLICITE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale du 9 avril 2015 pourvoi n°13-25847 CASSATION PARTIELLE
Qu'en statuant ainsi, alors que doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui a refusé de faire application de la contrepartie de 25 %, laquelle n'est pas susceptible de réduction par le juge et ouvre droit à congés payés, a violé le principe et le texte susvisé
L'EMPLOYEUR PEUT RENONCER A LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE A CONDITION
DE LE FAIRE AU PLUS TARD DES LE DÉPART DU SALARIÉ DE L'ENTREPRISE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 11 mars 2015 Pourvoi n° 13-22257 cassation partielle
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt après avoir constaté que les parties
étaient convenues d'une clause de non-concurrence pendant un délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, renouvelable une fois, aux termes
de laquelle l'entreprise pouvait lever ou réduire l'interdiction de concurrence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au plus tard dans les
huit jours suivant la notification de rupture du contrat de travail, retient qu'il résulte des termes clairs de cette stipulation contractuelle que
l'employeur pouvait renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, à la seule condition que cette renonciation soit notifiée au salarié avant
l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la rupture, que le salarié est mal fondé à soutenir que l'employeur ne pouvait y
renoncer avant cette notification ;
Attendu cependant que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans
l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au
cours de l'exécution de cette convention ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause de non-concurrence fixait un délai de renonciation à compter de la rupture du contrat de travail et
qu'elle constatait que la renonciation par l'employeur au bénéfice de cette clause était intervenue au cours de l'exécution dudit contrat, la cour d'appel a
violé les textes susvisés
COUR DE CASSATION Chambre Sociale du 13 juillet 2010 pourvoi n°09-41626 CASSATION
Mais attendu que le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la
clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture , de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution
de celle-ci doit être réputée non écrite ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation
par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le
salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l'employeur, et relevé que celui-ci
n'avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu' après le licenciement, en a exactement déduit qu'il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 21 janvier 2015 Pourvoi N° 13-26374 Cassation partielle
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de
respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de
laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ; qu'il en résulte que
l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus
tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur régional par la société GT pièces et services Paris Sud,
dépendant du groupe Todd, a été muté auprès de la société Todd suivant avenant du 17 décembre 2007, lequel stipulait une clause de non-concurrence dont
l'employeur pouvait se libérer, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision
par lettre recommandée au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 24 avril 2008 et
dispensé d'effectuer son préavis ; que l'employeur l'a libéré le 14 mai 2008 de la clause de non concurrence ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que dès
lors que le délai contractuel avait été respecté, c'est-à-dire que la levée était intervenue moins d'un mois après la lettre de licenciement et que le
salarié était toujours en période de préavis même s'il avait été dispensé de son exécution et qu'il était rémunéré, il n'y a pas lieu de considérer que ladite
levée, conforme aux stipulations contractuelles, aurait été tardive ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 21 janvier 2015 Pourvoi N° 13-24471 Cassation partielle
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 mai 2010 en qualité de vendeuse par M. Y..., exploitant un commerce de chaussures ; que son
contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans en contrepartie de laquelle l'intéressée percevait, après la cessation
effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de ses
trois derniers mois de présence dans l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, par jugement du 27 septembre
2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, l'arrêt, après avoir
relevé que le contrat de travail avait pris fin le 20 avril 2011, retient que l'intéressée calcule l'indemnité qui lui serait due sur trois années, la
présente décision intervenant seulement un an après, et que l'employeur ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 27 septembre 2011, elle
n'est plus tenue à une quelconque obligation de non-concurrence à l'égard d'une entreprise qui n'existe plus ;
Attendu, cependant, que la clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de
l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée n'avait pas été libérée de son obligation par l'employeur et qu'il lui appartenait, en conséquence,
d'examiner la demande en paiement de la contrepartie financière au prorata de la durée d'exécution de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LES CONVENTIONS COLLECTIVES PEUVENT PRÉCISER LES CONDITIONS D'INDEMNISATION
ET DE RENONCIATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE arrêt du 30 mars 2011 N° Pourvoi 09-41583 CASSATION
Mais attendu qu'au sens de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai de huit jours dont dispose l'employeur pour prévenir le salarié qu'il le dispense, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, de l'exécution d'une telle clause, a pour point de départ la date d'envoi de la lettre mettant fin au contrat, et son respect s'apprécie à la date d'envoi de la lettre dispensant le salarié d'exécuter la clause de non-concurrence, ledit délai s'imputant de date à date, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés
Attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'employeur a, le 21 avril 2000, adressé au salarié la lettre recommandée avec
accusé de réception l'informant de la rupture de son contrat de travail, et, par motifs propres, que le courrier le libérant de l'obligation de
non-concurrence est daté du 2 mai 2000 et ne lui a été présenté que le 4 mai suivant, ce dont il résulte qu'il n'a pu être envoyé au salarié que le 2 mai 2000 au plus tôt
Qu'il en résulte que la renonciation de l'employeur à l'exécution de la clause de non-concurrence était tardive
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie
Attendu que selon ce texte, l'indemnité mensuelle due au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence est égale à cinq
dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des
douze derniers mois de présence dans l'établissement, laquelle ne comprend pas les congés payés auxquels il avait droit sur la même période
Que la cour d'appel, qui a inclu dans le calcul de l'indemnité due au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence l'indemnité
compensatrice de congés payés à laquelle avait droit le salarié, a violé le texte susvisé
Lorsqu'une convention collective définit les limites d'une clause de non concurrence, elle doit être appliquée strictement sous réserve de nullité
COUR DE CASSATION Chambre Sociale du 12 octobre 2011 pourvoi n°09-43155 rejet
Mais attendu que la convention collective des VRP ayant réglementé la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne pouvait
valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié
Et attendu qu'après avoir rappelé que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 disposait que l'interdiction de
concurrence était limitée aux secteurs et aux catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture, la cour d'appel a constaté que
l'interdiction faite à M. X... de s'occuper de matériels similaires ou concurrents à ceux commercialisés par la société Moreau dans le nord de la
France, au sud d'une ligne Nantes-Lyon, excédait le secteur géographique qui lui avait été confié, de sorte que cette interdiction était plus contraignante que
celle définie par l'accord collectif; que la cour d'appel, qui ne pouvait réduire le champ d'application de la clause de non-concurrence dès lors que
seule sa nullité était invoquée par le salarié, a exactement retenu qu'elle était nulle
LE SALARIÉ EST INDEMNISÉ D'UNE CLAUSE DE CONCURRENCE ILLICITE
SEUL LE SALARIÉ PEUT FAIRE UN RECOURS CONTRE UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE ILLICITE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 2 février 2006, pourvoi N° 04-41.004 CASSATION SANS RENVOI
Le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; il s'ensuit qu'un nouvel employeur ne peut former, en invoquant une telle nullité, tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action.
LE RESPECT D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE ILLICITE PORTE NECESSAIREMENT PREJUDICE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 11 janvier 2006, Pourvoi N° 03-46933 CASSATION PARTIELLE
Le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 16 novembre 2010, Pourvoi N° 03-42389 CASSATION
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil
Attendu, d'une part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat
de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas
dénué de cause, d'autre part, que le salarié qui respecte une clause de non-concurrence nulle a droit à une indemnisation
Attendu que pour condamner le salarié à restituer à l'employeur les sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
et le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de cette clause, l'arrêt retient que celle-ci est nulle dès lors qu'elle prévoyait le versement d'une
indemnité avant la rupture du contrat de travail ; que ce versement se trouve dénué de cause
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle et qu'il résultait de ses
constatations que le salarié avait respecté la clause pendant plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 12 janvier 2011, Pourvoi N° 08-45280 CASSATION
Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que cette annulation, qui était concomitante de la résiliation du contrat de travail, n'avait causé aucun préjudice réel et certain au salarié qui n'avait pas eu à la respecter, disposant de toute liberté pour occuper le même emploi chez un autre employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés
COUR DE CASSATION Chambre Sociale du 30 mars 2011 Pourvoi N° 09-70306 CASSATION
Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence faute de
contrepartie financière, la cour d'appel retient que celui-ci n'a jamais eu à respecter ladite clause, qui n'a produit aucun effet pendant sa période d'emploi
au service de la société Demarle at home, et qui a expiré avant la rupture du contrat le liant à celle-ci
Qu'en statuant ainsi alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la
cour d'appel a violé les textes susvisés
LA LÉGALITÉ DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE EST APPRECIÉE AU JOUR DE SA SIGNATURE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 28 septembre 2011, pourvoi n°09-68537 CASSATION
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence et le condamner à la
cessation de son activité concurrentielle sous astreinte, ainsi qu'au paiement d'une certaine somme au titre de la clause pénale contractuelle, l'arrêt retient
que le dernier contrat de travail conclu entre les parties renvoie expressément à la convention collective en vigueur au moment de la rupture, de sorte que les
dispositions conventionnelles sur la contrepartie financière ont vocation à se substituer aux dispositions illicites du contrat de travail qui limitent le
bénéfice de la contrepartie financière au seul cas de rupture à l'initiative de l'employeur ; que le salarié a été informé de l'existence du contenu de
l'avenant à la convention collective du 23 juin 2004, dont les dispositions sont plus favorables au salarié que celles du contrat de travail ;
Attendu cependant que la validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et que la convention collective intervenue
postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié invoquait la nullité de la clause de non-concurrence et que l'avenant à la
convention collective prévoyant une contrepartie financière était postérieur au contrat de travail stipulant cette clause, la cour d'appel a violé les textes et
le principe susvisés
L'EMPLOYEUR PEUT RENONCER IMMÉDIATEMENT A SA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ILLICITE ET SE DISPENSER DE PAYER L'INDEMNITÉ
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 24 avril 2013 Pourvoi N° 11-26007 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme au titre de la contrepartie financière de la clause de
non-concurrence, l'arrêt retient que l'employeur soutient qu'il a délié la salariée de la clause de non-concurrence dans le dernier paragraphe de la lettre
de licenciement en date du 5 janvier 2009, que, cependant, les stipulations de la convention collective nationale de l'immobilier n'ont pas été respectées à la
lettre, que la salariée aurait dû être déliée de cette clause par un courrier recommandé adressé dans les 15 jours suivant l'envoi de la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permettait à la salariée de connaître
immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répondait ainsi à la finalité de la clause autorisant l'employeur à libérer le salarié de son
obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 10 juillet 2013 Pourvoi N° 12-14080 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande du salarié relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt relève qu'il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception de l'employeur n'a jamais été reçue par le salarié, ayant été perdue par la poste et qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer de la réception du courrier, de sorte que le salarié n'ayant pas été informé de la levée de la clause de non-concurrence la contrepartie financière est due en son principe ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations d'une part que le contrat de travail prévoyait en son article 10 que l'employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence par envoi au salarié d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, d'autre part que l'employeur produisait la preuve de l'envoi d'une lettre recommandée le 14 novembre 2008, soit dans le délai prévu, la rupture étant intervenue le 9 novembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé
SI L'INDEMNITÉ DOIT ÊTRE VERSÉE AVANT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL,
L'EMPLOYEUR NE PEUT ARGUER DE SA NULLITÉ POUR SE LA FAIRE REMBOURSER
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 15 janvier 2014 Pourvoi N° 12-19472 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture
du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni
son paiement intervenir avant la rupture et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie
financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause ;
Attendu que pour condamner le salarié à rembourser une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'aucune cause de nullité
n'affecte cette clause assortie d'une contrepartie financière sous la forme du versement d'une indemnité mensuelle et que l'employeur ayant renoncé à
l'application de cette clause, il en résulte que le salarié n'a jamais été soumis à une obligation de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de non-concurrence qui prévoyait le versement d'une indemnité avant la rupture
du contrat de travail était nulle et que l'employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle, lesquelles
constituaient un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LE CDI CONTINUE EN CAS DE TRANSMISSION D'ENTREPRISE
Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, après avoir retenu que le salarié, consacrant 50% de son activité au secteur transféré , n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions dans ce secteur, juge que l’ensemble du contrat de travail devait se poursuivre avec le cédant.
Cour de Cassation Chambre Sociale arrêt du 30 septembre 2020 pourvoi n° 18-24.881 Cassation partielle
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 :
5. Par plusieurs arrêts, la Cour de cassation a jugé, notamment en cas de cession partielle d’une entreprise emportant transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité avait été poursuivie, qu’en application de l’article susvisé, lorsqu’un salarié était employé en partie au sein de cette entité, son contrat de travail devait être transféré au cessionnaire pour la partie de l’activité qu’il y consacrait (Soc., 22 juin 1993, pourvoi n° 90-44.705, Bulletin 1993, V, n° 171 ; Soc., 9 mars 1994, pourvoi n° 92-40.916, Bulletin 1994, V, n° 83 ; Soc., 2 mai 2001, pourvoi n° 99-41.960, Bull. 2001, V, n° 145).
6. Pour limiter les hypothèses d’une telle division du contrat de travail, la Cour de cassation a ensuite jugé que, si le salarié exerçait l’essentiel de ses fonctions dans le secteur d’activité repris par la nouvelle société, l’ensemble de son contrat de travail devait être transféré à cette société et, dans le cas inverse, que son contrat de travail devait se poursuivre avec la société sortante (Soc., 30 mars 2010, pourvoi n° 08-42.065, Bull. 2010, V, n° 78 ; Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 14-30.056, Bull. 2016, V, n° 169).
7. Par un arrêt du 7 février 1985, (CJCE, arrêt du 7 février 1985, Botzen, aff. 186/83), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements devait être interprété en ce sens qu’il n’englobe pas les droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert et conclu avec des travailleurs qui, bien que n’appartenant pas à la partie transférée de l’entreprise, exerçaient certaines activités comportant l’utilisation de moyens d’exploitation affectés à la partie transférée, ou qui, étant affectés à un service administratif de l’entreprise qui n’a pas été lui-même transféré, effectuaient certaines tâches au profit de la partie transférée.
8. Par arrêt du 26 mars 2020, (CJUE, arrêt du 26 mars 2020, ISS Facility Services NV, aff. C-344/18), la Cour de justice de l’Union européenne, en présence d’un transfert d’entreprise impliquant plusieurs cessionnaires, a écarté tant l’hypothèse consistant à transférer le contrat de travail uniquement au cessionnaire auprès duquel le travailleur exerce ses fonctions à titre principal, que l’hypothèse consistant à ne transférer le contrat de travail à aucun des cessionnaires. Elle a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que les droits et les obligations résultant d’un contrat de travail sont transférés à chacun des cessionnaires, au prorata des fonctions exercées par le travailleur concerné, à condition que la scission du contrat de travail en résultant soit possible ou n’entraîne pas une détérioration des conditions de travail ni ne porte atteinte au maintien des droits des travailleurs garanti par cette directive, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, dans l’hypothèse où une telle scission du contrat de travail se révélerait impossible à réaliser ou porterait atteinte aux droits dudit travailleur, l’éventuelle résiliation de la relation de travail qui s’ensuivrait serait considérée, en vertu de l’article 4 de ladite directive, comme intervenue du fait du ou des cessionnaires, quand bien même cette résiliation serait intervenue à l’initiative du travailleur.
9. Il résulte ainsi de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.
10. Pour juger que la prise d’acte par la salariée était justifiée par un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, l’arrêt, après avoir jugé caractérisé le transfert d’une entité économique autonome, retient que, si la partie de l’activité de la société Interbarreaux X...- Y...- Z...-W... et associés cédée à la société DPR Méditerranée représentait 50 % de l’activité de la salariée, le contrat de travail devait se poursuivre auprès de la société Interbarreaux X...- Y...- Z... - W... et associés dès lors que la salariée n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions au sein de l’entité transférée.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cour de Cassation Chambre Sociale - 28 mars 2006 Pourvoi N° 03-43995 CASSATION PARTIELLE
Il résulte des articles 2 et 3 § 1 de la Directive n° 77/187/CEE, du 14 février 1977, modifiée par la Directive n° 98/50/CEE, du 29 juin 1998, applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement, de partie d'entreprise ou d'établissement, que le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité se poursuit entraîne la poursuite des contrats de travail avec le cessionnaire. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique.
Prive sa décision de base légale au regard de ces textes et de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, une cour d'appel qui, en présence d'une cession intervenue à l'occasion d'une procédure de faillite ouverte en Allemagne à l'égard de l'employeur, retient que le contrat de travail d'un salarié ne s'est pas poursuivi avec le cessionnaire français, sans rechercher si la cession d'éléments d'exploitation n'avait pas entraîné le transfert, à ce cessionnaire, d'une entité économique autonome maintenant son activité, peu important que la rémunération du salarié ait été provisoirement servie par un régime de garantie des salaires ou d'assurance-chômage.
Cour de Cassation Chambre Sociale. - 15 février 2006 Pourvoi N° 04-43923 CASSATION PARTIELLE
1° S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il s'ensuit que les licenciements prononcés à l'occasion d'une telle modification sont privés d'effet et que les salariés licenciés ont le choix de demander au nouvel employeur la poursuite de leur contrat de travail, qui est alors censé n'avoir jamais été rompu, ou la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l'auteur du licenciement.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié a été licencié en fraude de ses droits au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, décide que ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à indemnisation, mais qu'il n'autorise ni la réintégration du salarié, ni, par suite, le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration.
2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail le contrat de travail d'un salarié ne s'était pas poursuivi avec le nouvel employeur, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que ce contrat de travail s'était poursuivi de plein droit, le renvoi étant limité aux points restant en litige.
LE CONTRAT DE TRAVAIL EST TRANSMIS DANS LES MÊMES CONDITIONS
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 11 janvier 2012 Pourvoi N°10-14614 10-14615 10-14616 10-14617 10-14620 10-14621 10-14622 10-14623 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail
Attendu, selon les arrêts attaqués, que les sociétés SPIE Batignolles et Trindel ont fusionné le 1er juillet 1984 pour former la société SPIE-Trindel, devenue ensuite la société SPIE Ile-de-France Nord Ouest, les salariés respectifs des deux sociétés étant transférés à compter de cette date à la nouvelle entreprise ; que dans une note d'orientation générale du 20 octobre 1983 relative à une action d'harmonisation concernant les statuts sociaux, la société SPIE Batignolles avait indiqué maintenir "exclusivement au personnel présent à l'effectif le 31 décembre 1983" la prime d'ancienneté dont les salariés de la société Trindel bénéficiaient par application d'un usage d'entreprise ; que M. X... et 7 autres salariés de la société SPIE Ile-de-France Nord Ouest, qui s'étaient vu refuser le bénéfice de cette prime d'ancienneté au motif qu'ils n'appartenaient pas antérieurement à la société Trindel, ont saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement dans les mêmes conditions
Attendu que pour accueillir cette demande et dire que la société SPIE Ile-de-France Nord Ouest a méconnu le principe d'égalité de
traitement, les arrêts retiennent que si l'employeur peut faire bénéficier certains salariés d'un avantage particulier, c'est à la condition que cette
différence de traitement repose sur des raisons objectives ; que la source d'un avantage ne pouvant constituer à elle seule une telle raison,
l'application d'un usage non dénoncé ne peut être prise en considération ; qu'il n'est par ailleurs ni établi ni soutenu, d'une part, que les salariés ne
se trouvaient pas dans une situation identique, d'autre part, que le maintien de la prime litigieuse ait eu pour objet de compenser un inconvénient propre à
la situation des salariés de la société Trindel, consécutivement au transfert de leur contrat de travail ;
Attendu cependant que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au
bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement
qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe et l'article susvisés
L'EXCEPTION: Sauf en cas de transmission d'entreprise dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire:
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 2 février 2006 Pourvoi N°04-40474 CASSATION
Lorsque la modification dans la situation juridique de l'employeur est intervenue dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur ne peut être tenu au paiement de dommages-intérêts dus au titre d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail antérieur à cette modification.
LE CDI EN CAS DE TRANSFERT D'UN MARCHE PUBLIC
Quand une entreprise ou une personne publique reprend un marché public, elle reprend les salariés affectés à ce marché.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 8 décembre 2016 Pourvois N°15-17176 et 15-17177 REJET
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ; qu'il s'ensuit que, si la personne publique doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail, le défaut de cette notification constitue seulement une irrégularité donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié ;
Et attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que les salariés avaient refusé le 29 décembre 2009 les offres de recrutement formulées par la commune, la cour d'appel en a exactement déduit que leur contrat de travail se trouvait rompu de plein droit, peu important qu'une lettre de rupture ne leur ait pas été notifiée à cet effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 17 mai 2011 Pourvois N°09-67525 et 09-67641 REJET
Mais attendu qu'ayant retenu que, sans raison légitime, la société Lavalade avait décidé de résilier le marché conclu avec le département, alors que la procédure conventionnelle destinée à assurer le maintien des emplois en cas de changement de prestataire était en cours, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait ainsi contribué, par sa faute, au préjudice subi par les salariés non repris, du fait de la perte de leur emploi
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il n'était pas établi que le service de transport scolaire auparavant confié à la société Limocar était exploité par la RDTHV dans des conditions différentes de celles antérieurement imposées à ce transporteur privé et, d'autre part, que les conditions tenant à l'affectation des salariés au marché epris étaient remplies, en a exactement déduit que la RDTHV devait observer les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 imposant à l'entreprise entrante la poursuite des contrats de travail des salariés affectés au marché.
UN CDI PREND FIN PAR FORCE MAJEURE OU LA VOLONTE DES PARTIES
Il ne peut donc prendre fin que pour force majeure comme la mort du salarié.
COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE arrêt du 12 février 2014 N° Pourvoi 12-28571 cassation partielle
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail de Marc X..., de dire que cette
résiliation prenait effet au 4 avril 2011, date du décès de ce dernier, de le condamner à payer aux ayants-droit du salarié les indemnités de préavis et de licenciement
ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, alors, selon le moyen, que lorsque, au moment où le
juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ce contrat de travail a pris fin
par le décès du salarié, la demande de celui-ci est sans objet, qu'en décidant que le décès du salarié ne privait pas d'objet la demande qu'il avait présentée
en vue de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'il y avait seulement lieu de fixer la date de la résiliation à la date du
décès, puis, le cas échéant, d'allouer des dommages-intérêts aux ayants droit du salarié en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi,
la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que le décès du salarié ne rend pas sans objet la demande, reprise en appel par les ayants-droit de celui-ci, en résiliation du contrat de
travail et que la cour d'appel a exactement fixé la date d'effet de la résiliation de ce contrat au jour du décès ; que le moyen n'est pas fondé
Le CDI peut aussi prendre fin par la volonté d’une des parties soit par licenciement, démission du CDI, mise à la retraite ou départ volontaire à la retraite.
Le parties peuvent s'entendre entre elles pour signer un accord entre elles dans le cadre du dispositif de « rupture conventionnelle » jurisprudence confirmée par la loi du 25 juin 2008.
Tenter une séparation d'un commun accord est intelligent et beaucoup moins coûteux même si votre ex salarié est un peu gourmand sur ses indemnités. Si l'acte est bien rédigé, tout le monde y gagne, la tranquillité pour l'employeur et les droits aux allocations chômage pour le salarié.
LE CONTRAT DE TRAVAIL peut également, faire l’objet d’une demande de résiliation judiciaire par le salarié, lorsque ce dernier considère que l’employeur a manqué à ses obligations. Cette demande doit être portée devant le conseil des prud’hommes. Le salarié, considérant que l’employeur a manqué à ses obligations, prend acte de la rupture du contrat et en informe par écrit son employeur. Cette rupture produira alors les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont justifiés, soit, dans le cas contraire, d’une démission. L'appréciation relève de la souveraineté du conseil des prud’hommes.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale 3 novembre 2010. N° POURVOI 09-65254 CASSATION
Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 18 mai 2004 en qualité de rédacteur en chef du journal Paris-Normandie par la société Normande de presse républicaine, aux droits de laquelle se trouve la société Normande de presse, d'édition et d'impression ; que par lettre du 14 mai 2007, le salarié, faisant grief à son employeur de l'avoir remplacé dans ses fonctions sans qu'une nouvelle affectation ne lui soit proposée, a pris acte de la rupture de son contrat de travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu cependant que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été remplacé dans ses fonctions de rédacteur en chef à compter du 28 mars 2007 et qu'aucune autre affectation ne lui avait été proposée, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir à son salarié le travail convenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés
COUR DE CASSATION Chambre Sociale 2 juin 2010. N° POURVOI 09-40216 REJET
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que depuis 2001, M. X... avait été successivement dessaisi de ses attributions de directeur commercial, de directeur du développement, de responsable de l'exploitation puis, après un retour dans des fonctions de directeur commercial, qu'il s'était vu à nouveau retirer cette responsabilité au profit d'un nouveau recrutement ; qu'elle en a exactement déduit qu'il s'agissait de modifications du contrat de travail lesquelles, intervenues sans l'accord exprès du salarié, devaient faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mais attendu qu'ayant décidé que la prise d'acte du salarié, fondée sur la modification unilatérale de son contrat de travail, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non exécuté, n'encourt pas les griefs du moyen
COUR DE CASSATION Chambre Sociale 08 avril 2010. N° POURVOI 09-41134 REJET
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a
souverainement retenu que le manquement de l'employeur à son obligation de
verser à la salariée la prime d'ancienneté prévue par la convention collective
applicable était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du
contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
COUR DE CASSATION Chambre Sociale 25 mars 2010. N° POURVOI 08-43156 CASSATION
Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur;
Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que c'est en vain que Mme X... prétend que l'employeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles à son égard en ne prenant pas en charge ses frais professionnels et en réduisant dès lors d'autant sa rémunération minima contractuellement prévue ; qu'en effet alors que l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP qui prévoit la déduction des frais professionnels des VRP, pour calculer le montant de la rémunération minima due aux VRP bénéficiaires de cet accord, n'est pas applicable à l'intéressée, force est de constater que son contrat de travail prévoyait en outre expressément la prise en charge, par Mme X..., de ses frais professionnels ; qu'au surplus il convient de relever que cette dernière ne communique aucun élément probant sur le montant exact desdits frais, de nature à établir que leur montant était tel que la rémunération minimale que lui garantissait son contrat de travail pendant huit mois n'avait pas été respectée par l'employeur;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du contrat de travail qui mettait à la charge de la salariée les frais engagés par celle-ci pour les besoins de son activité professionnelle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le principe susvisé
COUR DE CASSATION Chambre Sociale 17 février 2010. N° POURVOI 08-42490 CASSATION
Vu l'article L. 1231-1du code du travail ;
Attendu que la démission d'un salarié en raison des faits qu'il reproche à son
employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets
soit d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de la
démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'arrêt retient que contrairement à ce que le salarié tente de soutenir, il
n'y a pas de rapport causal entre sa démission et les manquements réels de la
société Tibbet et Britten à ses obligations d'employeur, dès lors qu'il est
parfaitement établi que c'est uniquement pour fonder, dès le 8 avril 2003, une
société DLM express que M. X... a démissionné de ses anciennes fonctions au sein de la société Tibbet et Britten;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé
COUR DE CASSATION Chambre Sociale 12 juillet 2005. Pourvoi N° 03-43603 REJET
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir recherché si la rupture invoquée par un salarié était imputable à l'employeur et estimé que tel n'était pas le cas, décide que le refus ultérieur du salarié de reprendre son poste, malgré l'injonction de l'employeur, constitue une faute grave justifiant le licenciement intervenu ultérieurement.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale 28 mars 2006. Pourvoi N° 04-41016 CASSATION
1° Une mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile et ne justifie dès lors pas la nullité du licenciement du salarié qui l'a refusée.
2° Peut être privé de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant refusé une mutation géographique lorsque l'employeur a mis en œuvre cette mutation dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
DROITS ET DEVOIRS DES TRAVAILLEURS A DOMCILE
LE TRAVAILLEUR A DOMICILE A LES MÊMES DROIT QU'UN SALARIE QUI TRAVAILLE DANS LES LOCAUX DE L'ENTREPRISE
LIVRE IV DU CODE TRAVAIL: TRAVAILLEURS À DOMICILE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions d'application. (Articles L7411-1 à L7411-2)
Chapitre II : Définitions. (Articles L7412-1 à L7412-3)
Chapitre III : Mise en œuvre. (Articles L7413-1 à L7413-4)
TITRE II: RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux. (Articles L7421-1 à L7421-2)
Chapitre II : Conditions de rémunération
Section 1 : Salaires
Sous-section 1 : Détermination des temps d'exécution. (Articles L7422-1 à L7422-3)
Sous-section 2 : Détermination du salaire. (Articles L7422-4 à L7422-8)
Sous-section 3 : Majorations. (Articles L7422-9 à L7422-10)
Section 2 : Frais d'atelier et frais accessoires. (Articles L7422-11 à L7422-12)
Chapitre III : Règlement des litiges. (Articles L7423-1 à L7423-2)
Chapitre IV : Santé et sécurité au travail. (Articles L7424-1 à L7424-4)
LA PRESOMPTION DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET S'APPLIQUE AU TRAVAILLEUR A DOMICILE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale Arrêt du 3 novembre 2010 N° POURVOI 09-40255 CASSATION
Vu les articles L. 7413-2 , L.
7421-1 , L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail
Attendu, d'une part, que selon l'article L. 721-6 devenu L.7413-2 du code du
travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives
et réglementaires applicables aux salariés ; que, d'autre part, il résulte des
autres articles susvisés que lors de la remise à un travailleur de travaux à
exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au
moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature
et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps
d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables, et que, lors de la
livraison du travail achevé, mention est faite sur ce carnet ou ce bulletin de
la somme des prix de façon, frais et retenues et enfin de la somme nette à payer
au travailleur compte tenu de ces éléments ; qu'en cas de non-respect par
l'employeur de ces dispositions, le contrat de travail est présumé à temps
complet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée suivant contrat à
durée indéterminée en date du 5 janvier 2005 par la société Prim'couture en
qualité d'ouvrière à domicile à temps partiel qu'elle a saisi en juillet 2006 la
juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de
travail en contrat à temps complet ainsi qu'un rappel de salaire sur la base du
salaire minimum et de 35 heures de travail par semaine
Attendu que l'arrêt déboute la salariée de ses demandes après avoir constaté
qu'il n'est pas établi que la société Prim'couture ait satisfait aux obligations
découlant des articles L. 7421-1 , L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du
travail
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait en déduire une présomption
simple de travail à temps complet, a violé les textes susvisés.
UN CONTRAT DE TRAVAIL A DOMICILE NE PEUT ETRE NOVE EN UN CONTRAT DANS L'ENTREPRISE SANS L'ACCORD DU SALARIE
COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE arrêt du 12 février 2014 POURVOI N° 12-23051 Cassation
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger que le licenciement de la salariée reposait sur un motif réel et sérieux, l'arrêt retient qu'au regard de la rédaction de la clause du contrat de travail prévoyant sur un mode purement alternatif l'exercice professionnel des fonctions de l'intéressée dans un établissement de l'Agence sensorielle, soit à Paris, soit à Fontenay-sous-Bois, soit au domicile de la salariée, celle-ci ne justifie pas que cette stipulation était pour elle essentielle et réellement déterminante de son acceptation de travailler pour cet employeur, cette même condition figurant dans les mêmes termes dans le contrat de travail d'une autre salariée engagée en qualité de journaliste reporter d'images ; que Mme X... savait que son employeur pouvait lui demander de venir exercer son travail dans les locaux de Fontenay-sous-Bois ; que même si, à raison de sa situation personnelle de mère célibataire de deux enfants résidant à Boulogne-Billancourt, l'obligation ainsi faite de se rendre quotidiennement à Fontenay-sous-Bois la contraindrait à des temps de parcours oscillant entre 45 minutes et 1 heure 15 en voiture, ce qui lui apparaît impossible, force est aussi de relever qu'il ne s'agit pas d'une modification de son contrat de travail nécessitant son accord, le contrat en question prévoyant cette possibilité d'exercice de fonctions en plusieurs lieux ;
Attendu, cependant, que lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés
UNE TOLERANCE DE L'EMPLOYEUR NE VAUT PAS CONTRAT DE TRAVAIL A DOMICILE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale Arrêt du 27 novembre 2013 N° POURVOI 12-24880 rejet
Mais attendu qu'il résulte de
l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur ayant son domicile
sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre
devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son
travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement
son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur
accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son
employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du
travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs
différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon
la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait
de façon stable et durable ses activités ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'il ressort des pièces versées aux débats et
notamment des termes de son dernier contrat de travail entré en vigueur le 1er
novembre 2009 que l'autorisation d'exécuter pour partie sa prestation de travail
à son domicile situé à Slough, obtenue par le salarié de ses supérieurs
hiérarchiques en 2008, n'a pas remis en cause la localisation de son emploi dans
le service Global Banking & Markets à Londres, que l'employeur n'a jamais donné
son accord à un transfert en France du lieu de travail de son salarié, la
tolérance dont il a bénéficié pour travailler chez lui une partie de la semaine
alors qu'il n'était plus domicilié au Royaume-Uni ne pouvant s'analyser qu'en
une dérogation précaire aux termes du contrat fixant la localisation de son
poste de travail au sein du service Global Banking & Markets à Londres, et que,
par ailleurs, sur l'ensemble de la période d'activité du salarié employé du 5
février 2007 au 29 décembre 2010, celui-ci a accompli la majeure partie de son
temps de travail dans les locaux du service Global Banking & Markets à Londres
qui est constamment demeuré le centre effectif de ses activités
professionnelles, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en l'absence de
volonté claire des parties, il n'a pas été convenu que le travailleur exercerait
de façon stable et durable ses activités à son domicile en France et que le
service Global Banking & Markets à Londres était resté le lieu où le travailleur
accomplit habituellement son travail au sens de l'article 19, paragraphe 2, a),
du Règlement (CE) n° 44/2001
L'occupation du logement à des fins professionnels vaut indemnité de la part de l'employeur
COUR DE CASSATION Chambre Sociale Arrêt du 8 novembre 2017 pourvois n° 16-18499 16-18501 16-18503 16-18504 16-18507 16-18517 rejet
Mais attendu que le salarié peut prétendre à une indemnité au
titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un
local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ;
Et attendu qu'ayant, d'une part, constaté que les personnels itinérants doivent
notamment gérer des commandes, préparer leurs visites et en rendre compte,
actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, accéder aux
formations obligatoires dispensées à distance, alors même qu'ils ne disposent
pas de lieu au sein de l'entreprise pour accomplir ces tâches, et d'autre part,
retenu, que si les intéressés peuvent exécuter certaines tâches courantes grâce
à une connexion en WIFI ou au moyen d'une clé 3G leur permettant de se connecter
en tout lieu, l'employeur ne peut pour autant prétendre que l'exécution par les
salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulte que de leur seul
choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir
s'y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation, la cour d'appel, appréciant souverainement l'importance de la sujétion, a fixé le montant de l'indemnité devant revenir aux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
LE TÉLÉ TRAVAIL AU DOMICILE
Article L. 1222-9 du Code de Travail
Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord
collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur
après avis du comité social économique, s'il existe.
En l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur
conviennent de recourir de manière occasionnelle au télétravail, ils formalisent
leur accord par tout moyen.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.
Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui
exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, notamment en ce qui
concerne l'accès aux informations syndicales, la participation aux élections
professionnelles et l'accès à la formation.
L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui
occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les
conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, doit
motiver sa réponse.
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte
élaborée par l'employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une
exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du
télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge
de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut
habituellement contacter le salarié en télétravail.
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice
de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de
travail au sens des dispositions de l'article
L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 1222-10 du Code de Travail
Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail :
1° D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
2° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;
3° D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail.
Article L. 1222-11 du Code de Travail
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
LE POUVOIR DE SANCTION DE L'EMPLOYEUR
UN ECRIT DANS UN DOSSIER EST UNE SANCTION
Un employé de la Poste est sanctionné pour avoir fait grève.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 30 janvier 2013 N° POURVOI 11-23891 Cassation partielle
Mais attendu que, selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur au sein de La Poste, avait été mise en œuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire que cette mesure constituait une sanction ; que le moyen, qui dans sa seconde branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que l'avertissement avait été délivré au salarié en raison de sa participation au mouvement de grève que l'employeur jugeait illicite ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision
Vu l'article 1147 du code civil
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de sa participation à un mouvement de grève, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'une telle attitude, de nature à décourager les salariés de faire valoir leurs droits, constitue une faute qu'il convient de sanctionner
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser, de la part de l'employeur, un comportement fautif distinct de celui ayant justifié sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de l'avertissement annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile
Attendu que pour condamner La Poste, défendeur en première instance, au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en développant des arguments contradictoires et en tentant de faire porter le débat sur l'illégitimité de la grève, que le conseil de prud'hommes n'a pas la compétence de trancher, La Poste a développé des moyens de défense manifestement dilatoires et qu'il y a lieu de stigmatiser cette attitude
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit de défendre en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé
UNE SANCTION DOIT ÊTRE JUSTIFIEE
Il résulte de l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par l'employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour annuler la sanction disciplinaire prononcée contre un salarié, retient que "l'attestation anonyme" d'un de ses collègues et le compte-rendu de son entretien avec un membre de la direction des ressources humaines produits par l'employeur, sont sans valeur probante aux motifs qu'il est impossible à la personne incriminée de se défendre d'accusations anonymes, alors que la cour d'appel avait constaté que ces deux pièces n'étaient pas les seules produites par l'employeur pour caractériser la faute du salarié et qu'il lui appartenait d'en apprécier la valeur et la portée
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 19 avril 2023 POURVOI n° 21-20.308 cassation
Vu le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale :
4. En matière prud'homale, la preuve est libre.
5. Pour annuler la sanction de mise à pied disciplinaire infligée au salarié en
écartant l'attestation remise à l'employeur par M. [P], intervenant volontaire à
titre accessoire à la procédure d'appel, l'arrêt retient qu'en raison de sa
position de partie à la procédure en cause d'appel, l'attestation n'a plus de
valeur de témoignage mais uniquement de dire puisqu'une partie ne peut, par définition, témoigner de façon impartiale en sa faveur.
6. En statuant ainsi, alors que l'intervenant volontaire à titre accessoire
n'émet aucune prétention à titre personnel mais se limite à soutenir celles
d'une partie principale, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a témoigné
en sa propre faveur et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond d'apprécier
la portée et la valeur de l'attestation remise par lui à l'employeur, de même
que les autres éléments se rapportant à ce salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 9 mars 2011 N° POURVOI 10-11588 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Riom, 8 décembre 2009),
qu'après transfert de leurs contrats de travail à la société Fruprep France le 7 août 2009, les anciens salariés de la société Frulact France située à
Saint-Yorre se sont vu proposer une modification de leur lieu de travail dans des nouveaux locaux à Apt ; qu'à partir du 7 octobre 2009, M. Y... et vingt-huit
autres salariés, qui n'avaient pas accepté cette modification, se sont vu refuser l'accès à l'usine, après décision de l'employeur de procéder à la
cessation de l'activité de cette unité de production, et ont été mis en disponibilité avec maintien de leur rémunération ; que des salariés ont alors
occupé ces locaux par roulement pour protester contre la fermeture brutale du site ; que la société a saisi le juge des référés obtenir leur expulsion
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'occupation de l'usine
par des salariés ne constitue pas un trouble manifestement illicite et de la débouter de toutes ses demandes
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que l'employeur, qui a décidé l'arrêt des activités et fermé l'unité de production sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, a interdit aux salariés l'accès à leur lieu de travail en leur notifiant sans autre explication leur mise en disponibilité ; qu'il constate, d'autre part, que si les salariés ont occupé les locaux, aucun fait de dégradation du matériel, de violence, séquestration ou autre comportement dangereux à l'égard des personnels se trouvant sur le site n'est établi ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que l'occupation des lieux, intervenue en réaction à la fermeture, dans ces circonstances, de l'unité de production, ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 4 octobre 2011. N° POURVOI 10-18862 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 2009), que M. X... engagé le 26 janvier 2004 par la société Connex Allier
aux droits de laquelle vient la société Véolia transports Rhône Alpes interurbain en qualité de chauffeur en période scolaire a été licencié pour faute grave le 2 mai 2007
pour comportement irresponsable et mise en danger de l'intégrité physique d'autrui en introduisant son chien, sur le lieu de travail et à l'intérieur de
son véhicule automobile, puis en le laissant s'échapper, l'animal ayant alors mordu une salariée qui sortait de l'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. X... qui avait laissé son chien pendant trois heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking
de l'entreprise et n'avait pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer une salariée sur ce parking, la cour d'appel a ainsi caractérisé un manquement du salarié à
son obligation de ne pas mettre en danger, dans l'enceinte de l'entreprise, d'autres membres du personnel;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu retenir que la mesure de mise à pied notifiée le jour de la convocation à l'entretien préalable, à l'issue du congé
dont bénéficiait le salarié et dans l'attente de l'issue de la procédure, revêtait un caractère conservatoire
UNE SANCTION DOIT AVOIR UN FONDEMENT LEGAL
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 26 mars 2014 N° POURVOI 12-21372 cassation
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que la suspension de ses fonctions par
l'employeur ne constituait pas un manquement suffisamment grave au regard des griefs énoncés dans la lettre de licenciement notifiée moins d'un mois plus
tard, justifiant que le salarié soit éloigné immédiatement de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mesure de suspension
n'était fondée sur aucune disposition légale, ce dont il résultait que l'employeur avait commis un manquement rendant impossible la poursuite du
contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés
UNE SANCTION DOIT ÊTRE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 4 décembre 2013 Pourvoi n° 12-23930 Rejet
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à
payer à la salariée une somme à titre de dommages intérêts pour violation de
l'interdiction de conserver trace d'une sanction, alors, selon le moyen, qu'en
se bornant pour le condamner de ce chef à affirmer que l'utilisation par
l'employeur d'une sanction en violation des dispositions conventionnelles
applicables causait « nécessairement » un préjudice à la salariée, sans déduire
davantage de motif à l'appui de cette allégation, la cour d'appel qui s'est une
fois de plus déterminée par voie de considérations générales et abstraites a de
nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'utilisation par
l'employeur d'une sanction en violation des dispositions conventionnelles
applicables causait nécessairement un préjudice au salarié dont elle a apprécié
souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé
UNE SANCTION DOIT ÊTRE PREVUE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 26 octobre 2010 N° POURVOI 09-42740 CASSATION
Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur
Attendu, ensuite, qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 janvier 1982 par la société Thomson CSF et dont le contrat de travail a été transféré en second lieu à la société Jabil circuit le 1er juillet 2002 a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés, notifiée le 8 janvier 2006
Attendu que pour refuser d'annuler cette sanction et décider que l'employeur pouvait, eu égard à la faute commise, prononcer une mise à pied de cinq jours, même si le règlement intérieur de la société Jabil Circuit ne comportait pas de dispositions limitant dans le temps une telle sanction et ne pouvait être utilement invoqué, l'arrêt retient qu'une telle sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur, lequel a la faculté, en l'absence de dispositions restrictives d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, d'en faire usage sous la seule réserve du contrôle de l'autorité judiciaire
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 09 MARS 2011 Pourvoi N°09-42150 REJET
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation des avertissements, l'arrêt retient que le règlement intérieur prévoit l'obligation pour l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable lorsqu'il envisage de prendre à son encontre une sanction pouvant avoir une conséquence sur son maintien en activité, sa carrière ou sa rémunération et que, l'avertissement n'ayant pas, par lui-même, une telle incidence, la salariée ne peut invoquer des irrégularités de procédure pour fonder ses demandes en annulation
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le règlement intérieur énonçait que, sauf en cas de faute grave, il ne pourrait y avoir de licenciement que si le salarié a fait l'objet d'au moins deux sanctions, ce dont il résultait qu'un avertissement pouvait avoir une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés
UN SALARIÉ PEUT SOULEVER UNE EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 11 avril 2012 Pourvoi N° 11-14476 REJET
Vu l'article L. 1232-4 du code du travail
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité de Mme X... pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt, après avoir exposé qu'au soutien de cette demande, la salariée fait valoir qu'en raison d'une disposition du règlement intérieur du comité d'entreprise limitant le remboursement de ses frais de déplacement, le membre titulaire du comité qu'elle avait choisi, n'avait pas pu l'assister lors de l'entretien préalable au licenciement et qu'elle n'avait donc eu aucune liberté de choix à cet égard relève que le règlement intérieur du comité d'entreprise de la société Camaieu prévoit effectivement que les heures de travail perdues par les personnes qui assistent un salarié sont indemnisées par l'entreprise, mais que les frais de transport sont limités à un trajet de 200 kilomètres aller et 200 kilomètres retour et ajoute que toutefois, s'il estimait que cette disposition du règlement intérieur du comité d'entreprise était illicite, il appartenait audit membre du comité d'entreprise de la contester en justice et de réclamer, le cas échéant, le remboursement intégral de ses frais de déplacement, sans qu'il en résulte la preuve de ce que, lors de l'entretien préalable, la salariée n'ait pu être assistée par l'intéressé ou par toute autre personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ;
Attendu, cependant, qu'un salarié est recevable à soulever par voie d'exception l'illégalité du règlement intérieur du comité d'entreprise qui lui fait grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 9 mai 2012 Pourvoi N° 11-13687 REJET
Mais attendu que le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à sa salariée un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service ; que le moyen n'est pas fondé
LE REGLEMENT INTERIEUR NE PEUT PAS ÊTRE GENERAL MAIS DOIT ETRE PRECIS ET JUSTIFIE
POUR POUVOIR INTERDIRE UN SIGNE RELIGIEUX
Par deux arrêts rendus le 19 mars 2013, la
chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les contours du principe de laïcité, dans deux affaires de licenciement d’une salariée aux motifs qu’elle
portait un voile islamique laissant voir le visage mais couvrant les cheveux et contrevenait ainsi à une disposition du règlement intérieur de l’employeur.
Dans l’affaire concernant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis, s’agissant d’une salariée travaillant comme “technicienne de prestations
maladie”, la Cour de cassation juge pour la première fois que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des
services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Si les dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer
aux agents des caisses primaires d’assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils
participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs,
en particulier vestimentaires. Le licenciement de la salariée est dès lors déclaré fondé.
En revanche, dans l’affaire Baby Loup ( pourvoi n° 11-28.845), s’agissant d’une crèche privée, qui ne peut dès lors, en dépit de sa mission d’intérêt général,
être considérée comme une personne privée gérant un service public, la Cour de cassation rappelle que le principe de laïcité instauré par l’article
1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Le principe de laïcité
ne peut dès lors être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail.
Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail intégrant les dispositions de la directive de l’Union européenne du 27
novembre 2000 prohibant les discriminations fondées notamment sur les convictions religieuses, les restrictions à la liberté religieuse doivent être
justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but
recherché. Tel n’est pas le cas de la clause générale de laïcité et de neutralité figurant dans le règlement intérieur de l’association
Baby Loup applicable à tous les emplois de l’entreprise. Une telle clause étant invalide, le licenciement de la salariée pour faute grave aux motifs qu’elle
contrevenait aux dispositions de cette clause du règlement intérieur constitue une discrimination en raison des convictions religieuses et doit être déclaré nul.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait déclaré le licenciement fondé est dès lors cassé.
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 19 mars 2013, pourvoi n° 12-11.690 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2011), que Mme X... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 4 septembre 2001 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis en qualité de technicienne prestations maladie; que le règlement intérieur de la caisse a été complété le 10 février 2004 par une note de service interdisant « le port de vêtements ou d’accessoires positionnant clairement un agent comme représentant un groupe, une ethnie, une religion, une obédience politique ou quelque croyance que ce soit » et notamment « le port d’un voile islamique, même sous forme de bonnet » ; qu’elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 29 juin 2004 aux motifs qu’elle portait un foulard islamique en forme de bonnet; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 24 mai 2005 en nullité de son licenciement en soutenant que celui-ci était discriminatoire au regard de ses convictions religieuses
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande
Mais attendu que la cour d’appel a retenu exactement que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer aux agents des caisses primaires d’assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires
Et attendu qu’ayant retenu que la salariée exerce ses fonctions dans un service public en raison de la nature de l’activité exercée par la caisse, qui consiste notamment à délivrer des prestations maladie aux assurés sociaux de la Seine-Saint-Denis, qu’elle travaille en particulier comme «technicienne de prestations maladie» dans un centre accueillant en moyenne six cent cinquante usagers par jour, peu important que la salariée soit ou non directement en contact avec le public, la cour d’appel a pu en déduire que la restriction instaurée par le règlement intérieur de la caisse était nécessaire à la mise en œuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux yeux des usagers la neutralité du service public
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 19 mars 2013, pourvoi n° 11-28.845 Cassation
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail, ensemble l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Attendu que le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ; qu’il ne peut dès lors être invoqué pour les priver de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail; qu’il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1997, lequel faisait suite à un emploi solidarité du 6 décembre 1991 au 6 juin 1992 et à un contrat de qualification du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1995, Mme X... épouse Y... a été engagée en qualité d’éducatrice de jeunes enfants exerçant les fonctions de directrice adjointe de la crèche et halte-garderie gérée par l’association Baby Loup; qu’ayant bénéficié en mai 2003 d’un congé maternité suivi d’un congé parental jusqu’au 8 décembre 2008, elle a été convoquée par lettre du 9 décembre 2008 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, et licenciée le 19 décembre 2008 pour faute grave aux motifs notamment qu’elle avait contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l’association en portant un voile islamique ; que, s’estimant victime d’une discrimination au regard de ses convictions religieuses, Mme X... épouse Y... a saisi la juridiction prud’homale le 9 février 2009, à titre principal, en nullité de son licenciement
Attendu que, pour dire le licenciement fondé et rejeter la demande de nullité du licenciement, l’arrêt retient que les statuts de l’association précisent que celle-ci a pour but de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d’œuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des femmes du quartier, qu’elle s’efforce de répondre à l’ensemble des besoins collectifs émanant des familles, avec comme objectif la revalorisation de la vie locale, sur le plan professionnel, social et culturel sans distinction d’opinion politique ou confessionnelle, que conformément à ces dispositions la crèche doit assurer une neutralité du personnel dès lors qu’elle a pour vocation d’accueillir tous les enfants du quartier quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse, que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, n’ont pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse, que tel est le sens des dispositions du règlement intérieur entré en vigueur le 15 juillet 2003, lequel, au titre des règles générales et permanentes relatives à la discipline au sein de l’association, prévoit que le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche, que les restrictions ainsi prévues apparaissent dès lors justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché au sens des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail, qu’il résulte des pièces fournies, notamment de l’attestation d’une éducatrice de jeunes enfants, que la salariée, au titre de ses fonctions, était en contact avec les enfants
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le règlement intérieur de l’association Baby Loup prévoit que «le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche », ce dont il se déduisait que la clause du règlement intérieur, instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du code du travail et que le licenciement, prononcé pour un motif discriminatoire, était nul, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs visés à la lettre de licenciement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
L'EMPLOYEUR PEUT SUPPRIMER UNE PRIME NON CONTRACTUALISEE SI
LA NOUVELLE AFFECTATION DU SALARIE NE LA JUSTIFIE PLUS
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 16 mars 2011 N° POURVOI 08-42671 CASSATION
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 13 janvier 1997 par la société Domotherm en qualité d'agent de maintenance qu'il occupait ses fonctions dans une agence où il intervenait sur les chaudières au domicile des particuliers et percevait une prime de travaux lorsque, lors d'une intervention, il remplaçait le matériel par une chaudière neuve ; que son contrat de travail ayant été transféré à la société Proxiserve, il a été affecté à une autre agence spécialisée dans l'intervention sur les installations de chauffage collectif ; que reprochant à son nouvel employeur d'avoir modifié son affectation et ainsi supprimé la prime de travaux, il a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 26 octobre 2007 et saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes
Attendu que pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que la prime n'était pas prévue contractuellement ; que l'examen des bulletins de salaire fait apparaître que cette prime a été régulièrement perçue, même si elle était d'un montant variable en fonction des remplacements de chaudière obtenus par le salarié, que la perte de cet avantage a été reconnue par l'employeur qui a reconnu devant la cour, comme devant le conseil de prud'hommes, que le directeur régional avait envisagé la possibilité d'intégrer dans le salaire un montant moyen correspondant à la prime sur travaux précédemment perçue au sein de l'agence de Toulouse mais qu'aucun engagement n'a cependant été souscrit par écrit sur ce point en faveur du salarié ; que dans ces conditions, la perte d'un élément de rémunération non compensée par un avenant au contrat de travail à l'occasion de la modification des conditions d'exécution de celui-ci constitue un manquement de l'employeur à ses obligations qui justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X...
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime variable était liée à une tâche annexe qui a disparu dans la nouvelle affectation du salarié et sans constater que cette prime avait été contractualisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
MAIS L'EMPLOYEUR DOIT FIXER DES OBJECTIFS CHAQUE ANNEE SI LE SALARIE BENEFICIE D'UNE PRIME
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 29 juin 2011 N° POURVOI 09-65710 REJET
Mais, attendu que lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés
annuellement par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié ;
Et, attendu qu' après avoir relevé que la société Prompt s'était abstenue de
fixer les objectifs de son salarié pour les années 2003, 2004 et 2005, la cour d'appel en a déduit que le manquement de l'employeur à son obligation
justifiait, à lui seul, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Cliquez sur le lien pour accéder aux informations juridiques gratuite sur :
- L'EMPLOYEUR DOIT PAYER SES SALARIÉS
- L'EMPLOYEUR NE PEUT PAS PISTER SES SALARIÉS PAR GEO-LOCALISATION
- L'EMPLOYEUR NE PEUT PAS PROVOQUER LA FAUTE DE L'EMPLOYÉ POUR LE LICENCIER
- L'EMPLOYEUR NE PEUT PAS FAIRE DE DIFFÉRENCE ENTRE LES SALARIÉS SANS RAISON OBJECTIVE
- L'EMPLOYEUR NE PEUT PAS FAIRE DE DISCRIMINATION RACIALE OU RELIGIEUSE
- L'EMPLOYEUR NE PEUT PAS FAIRE DE DISCRIMINATION SEXUELLE
- L'EMPLOYEUR NE PEUT PAS FAIRE DE DISCRIMINATION SYNDICALE DU SALARIÉ
- L'EMPLOYEUR NE PEUT PAS FAIRE DE DISCRIMINATION SUR L'ÂGE DU SALARIÉ
- LA DISCRIMINATION N'IMPLIQUE PAS LA COMPARAISON
- L'EMPLOYEUR A UNE OBLIGATION D'INFORMATIONS ET DE SÉCURITÉ
- UN EMPLOYEUR NE PEUT PAS JOUER SUR LES LÉGISLATIONS NATIONALES POUR ÉCHAPPER A SES OBLIGATIONS
- LA PROCÉDURE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'EMPLOYEUR DOIT PAYER SES SALARIÉS
Article L 3171-4 du Code du Travail
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
JURIPRUDENCE
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE arrêt du 7 juin 2023 Pourvoi n° 21-12.841 cassation
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail :
6. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses
directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
7. Pour rejeter la demande en rappel de salaire au titre des heures
supplémentaires, l'arrêt retient que le règlement intérieur sur le site de la
centrale de [Localité 3] mentionne, d'une part, que ces règles ne sont pas
édictées par l'entreprise, c'est-à-dire par la société Arkadia, mais imposées
par la société propriétaire du site, et, d'autre part, qu'avant d'atteindre les
bureaux de la société Arkadia, dans lesquels se situent les pointeuses, le
salarié n'était pas à la disposition de cette société, pouvant vaquer entre le
poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de
l'employeur. L'arrêt en déduit qu'il s'agit d'un temps de trajet ne pouvant être considéré comme du temps de travail effectif.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que le
règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale,
sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait des sujétions qui lui
étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la
durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du
site de la centrale nucléaire et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le
salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives
sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE arrêt du 7 juin 2023 Pourvoi n° 21-22.445 cassation
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail :
4. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses
directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
5. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des
heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté
qu'une seule visite de concession était effectuée par jour et que le salarié
partait en déplacement pour la semaine avec des frais d'hôtel pris en charge par
l'employeur, retient que doivent être assimilés à un temps de travail effectif
les trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs
différents dans le cadre de déplacements prolongés sans retour au domicile,
nécessité par l'organisation du travail selon des plannings d'interventions
déterminés par l'employeur qui plaçaient le salarié dans une situation où il restait à sa disposition.
6. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié ne visitait
qu'une concession par jour et sans vérifier si les temps de trajets effectués
par le salarié pour se rendre à l'hôtel pour y dormir, et en repartir,
constituaient, non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de
simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail
effectif, ni caractériser que, pendant ces temps de déplacement en semaine, et
en particulier pendant ses temps de trajets pour se rendre à l'hôtel afin d'y
dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de
l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation
prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif
de l'arrêt portant sur l'indemnité de précarité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
8. En revanche, elle n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt ayant
condamné l'employeur au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui sont
justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE arrêt du 18 mars 2020 Pourvoi n° 18-10.919 cassation partielle
 Enoncé du moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que d’une part, s’il appartient au salarié de fournir des éléments
de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires, le décompte
qu’il produit n’est pas nécessairement établi au moment de la relation
contractuelle et peut l’être a posteriori ; qu’en écartant les documents
produits par les salarié devant la cour au motif qu’ils n’ont pas été établis au
moment de la relation contractuelle dans la mesure où ils sont différents de
ceux produits devant le conseil des prud’hommes à l’appui de la demande
initiale, la cour a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que d’autre part, en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, le
salarié doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires
effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant
ses propres éléments ; que dès lors que le décompte des heures supplémentaires
effectuées produit devant la cour d’appel, même différent de celui produit en
première instance, est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y
répondre, la cour ne peut écarter les tableaux produits devant elle par le
salarié au seul motif que le décompte produit devant la cour comporterait des
contradictions manifestes avec les documents produits devant le conseil des
prud’hommes ; qu’en considérant que M. X... ne produisait pas devant la cour
d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour
étayer sa demande aux motifs que le décompte correspondant au travail réalisé
pour le conseil général de l’Essonne ainsi que pour les autres dossiers
présentait des incohérences avec les pièces versées aux débats devant le conseil
des prud’hommes, sans même examiner les documents produits devant elle, la cour
a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
9. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
10. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
11. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt retient que les documents produits devant la cour n’ont pas été établis au moment de la relation contractuelle dans la mesure où ils sont différents de ceux produits devant le conseil des prud’hommes à l’appui de la demande initiale, qu’en effet l’employeur produit le décompte des heures supplémentaires présenté par le salarié aux premiers juges duquel il ressort de notables différences avec les tableaux produits dans l’instance devant la cour d’appel, ainsi par exemple le travail réalisé pour le conseil général de l’Essonne, que les mêmes différences et incohérences se retrouvent pour d’autres dossiers Renault Truck, Feu Vert, Polyclinique du pays de Rance notamment, qui présentent des anomalies similaires à celles relevées s’agissant du travail que le salarié prétend avoir effectué pour le conseil général de l’Essonne entre les deux tableaux présentés d’une part devant le conseil des prud’hommes et d’autre part devant la cour d’appel, qu’ainsi il ressort desdits tableaux des contradictions manifestes, le salarié ayant opéré devant la cour d’appel des modifications pour tenter de corriger ses précédentes invraisemblances relevées alors à juste titre par l’employeur devant le conseil des prud’hommes, que pas plus les notes de frais que les « exemples de billets de train » ou l’attestation de l’épouse du salarié émanant d’un proche et, comme telle, dépourvue de valeur probante, ne sont de nature à étayer la demande du salarié, que dès lors les éléments présentés par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour étayer sa demande et permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 7 mars 2012 N° de pourvoi 10-17090 Cassation partielle
Vu l'article 1184 du code civil et les articles 93, 100, 102-1, 102-3 et 102-4
du code du travail maritime alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité
de matelot rémunéré à la part par contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 1999 ; que faisant valoir qu'il ne percevait pas la rémunération
minimale obligatoire, il a saisi, le 2 juillet 2007 l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative préalable de conciliation prévue par
l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ; qu'il a été licencié pour faute grave au motif de ses absences injustifiées par lettre du 7 juillet 2007 ; que,
le 12 décembre 2007, le marin a saisi le tribunal d'instance pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et un rappel de salaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du
contrat, après avoir fait droit à ses demandes de rappel de salaires, l'arrêt énonce, d'une part, que la procédure de licenciement a été engagée le 22 juin
2007, soit antérieurement à la demande de résiliation judiciaire formée le 2 juillet 2007, devant l'administrateur maritime, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner le bien-fondé de cette demande, et d'autre part, que le licenciement est justifié par la faute grave du marin dont les absences répétées sont établies ;
Attendu cependant que si la demande de résiliation judiciaire du contrat de
travail engagée par le salarié postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans
objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors
qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants tirés de la
date de convocation à l'entretien préalable au licenciement, alors, d'une part,
que le contrat avait été rompu le 7 juillet 2007 par l'envoi de la lettre de
licenciement et, d'autre part, que la demande de résiliation judiciaire avait
été formée, non pas le 2 juillet 2007, date de la saisine de l'autorité
administrative pour tentative de conciliation, mais le 12 décembre 2007 devant
le tribunal d'instance, de sorte que postérieure au licenciement, elle était
sans objet, la cour d'appel qui, dans l'appréciation du bien fondé du
licenciement, n'a pas pris en considération les griefs du salarié lequel
soutenait à l'appui de sa demande de résiliation du contrat qu'il ne se
présentait plus à bord parce qu'il n'était pas rémunéré, a privé sa décision de base légale
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 17 octobre 2012 N° de pourvoi 10-17370 Rejet
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé.
L'EMPLOYEUR NE PEUT PISTER SES SALARIES PAR GEO-LOCALISATION
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 3 novembre 2011 N° de pourvoi 10-18036 REJET
Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et
aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but
recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle
ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ;
Attendu, ensuite, qu'un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que selon le contrat de travail, le salarié était libre d'organiser son activité selon un horaire de
35 heures, à charge pour lui de respecter le programme d'activité fixé et de rédiger un compte-rendu journalier précis et détaillé, lequel de convention
expresse faisait preuve de l'activité du salarié, et, d'autre part, que le dispositif avait été utilisé à d'autres fins que celles qui avait été portées
à la connaissance du salarié ; qu'elle en a exactement déduit que cette utilisation était illicite et qu'elle constituait un manquement suffisamment
grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
FAIRE SUIVRE UN SALARIÉ DURANT SES HEURES DE TRAVAIL EST LICITE
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 3 novembre 2011 N° de pourvoi 13-18427 REJET
Mais attendu que le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de
cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite ;
Et attendu qu'ayant relevé que le contrôle organisé par l'employeur, confié à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de
transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail, était limité au temps de travail et n'avait impliqué aucune atteinte
à la vie privée des salariés observés, la cour d'appel a pu en déduire que les rapports "suivi contrôleurs" produits par l'employeur étaient des moyens de preuve licites
L'EMPLOYEUR NE PEUT PROVOQUER LA FAUTE
DE L'EMPLOYÉ POUR LE LICENCIER
cour de Cassation, chambre sociale arrêt du 4 juillet 2012 pourvoi n°11-30266 cassation
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 6 août 2001 par la Poste en qualité d'agent de tri-collecte puis de factrice, a été licenciée pour faute grave le 28 avril 2009 pour avoir ouvert une lettre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des indemnités de rupture conventionnelles et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que la Poste, chargée d'une mission de service public, étant tenue de garantir aux usagers le secret et l'intégrité des correspondances confiées, le nombre accru de signalisations relatives à des lettres ouvertes dans le centre dont dépendait la salariée justifiait l'introduction de lettres dites " festives " dans sa tournée, lettres ayant la particularité de diffuser une encre bleue si elles sont ouvertes, afin de mettre fin à des agissements frauduleux ; que ces lettres banalisées ne constituent pas un procédé de surveillance destiné à collecter des informations sur les salariés mais ont vocation à être traitées de la même façon que les autres correspondances et qu'il n'y a donc ni stratagème ni provocation à commettre une infraction, ni utilisation d'un procédé déloyal par l'employeur
Attendu cependant que si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'utilisation de lettres piégées à l'insu du personnel constitue un stratagème rendant illicite le moyen de preuve obtenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé
L'EMPLOYEUR NE PEUT PAS FAIRE DE DIFFÉRENCE SANS RAISON OBJECTIVE
DIFFÉRENCE DU COÛT DE LA VIE ENTRE L'ÎLE DE FRANCE ET DOUAI, LA DIFFÉRENCE DE SALAIRE EST JUSTIFIÉE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 27 février 2015 Pourvoi n° 15-11386 REJET
Mais attendu qu'une différence de traitement établie par
engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que
si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;
Et attendu qu'ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l'employeur pour justifier la différence de traitement qu'il avait mise en place
entre les salariés d'un établissement situé en Ile-de-France et ceux d'un établissement de Douai était établie, la cour d'appel en a exactement déduit que
cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente ;
DIFFÉRENCE DE SALAIRE ENTRE DEUX ÉTABLISSEMENTS DIFFÉRENTS, LES EFFORTS DES SALARIÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT LE JUSTIFIENT
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 3 novembre 2915 Pourvoi N° 15-18444 rejet
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, qu'une différence de traitement ne peut
être pratiquée entre les salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons
objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en considérant qu'un accord conclu au niveau d'un établissement n'est tenu
de respecter le principe d'égalité qu'à l'intérieur dudit établissement et peut instituer dans ce cadre un régime plus favorable aux salariés que celui existant
au sein de l'entreprise sans caractériser une atteinte illicite au principe d'égalité et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la différence de
traitement instituée par cet accord au bénéfice des salariés de l'établissement considéré repose ou non sur des critères objectifs et pertinents, la cour
d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal ;
Mais attendu que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie
d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des
droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées
justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'un accord d'établissement peut instituer dans le cadre de l'établissement un régime plus favorable aux salariés
que le régime général existant au sein de l'entreprise, sans pour autant caractériser une rupture illicite du principe d'égalité de traitement au
détriment des salariés des autres établissements, et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la différence de traitement instituée par cet accord
au bénéfice des salariés de l'établissement concerné repose ou non sur des critères objectifs et pertinents, et qui a fait ressortir que les avantages
salariaux dont bénéficiaient les salariés de l'établissement Pays de Bray n'étaient pas étrangers à des considérations de nature professionnelle, a légalement justifié sa décision ;
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen
PAS DE DIFFÉRENCE DE SITUATION, LA DIFFÉRENCE DE SALAIRE EST INJUSTIFIÉE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 27 février 2015 Pourvoi n° 13-17622 13-17623 13-17627 13-17628 13-17629 cassation
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu, selon les arrêts attaqués que Mme X... et quatre autres médecins spécialistes ont été engagées par l'Union des mutuelles des travailleurs (UMT), laquelle a été absorbée par le Grand conseil de la mutualité (GCM), en qualité de vacataires rémunérés à la tâche, pour effectuer, aux côtés de médecins généralistes dits « exclusifs » rémunérés par un salaire fixe, des vacations au sein de différents centres de soins mutualistes ; que l'UMT qui avait adhéré, au bénéfice de ses médecins salariés à un régime de retraite complémentaire, l'AGRR (caisse ARRCO) avait affilié les médecins exclusifs à la catégorie 22 tandis que les médecins vacataires relevaient de la catégorie 82 ; qu'après l'absorption, le GCM a harmonisé, le 1er janvier 2005, le régime de retraite des salariés transférés avec celui de ses salariés ; que faisant valoir, que pour la période antérieure, elles avaient bénéficié d'un régime de retraite complémentaire moins avantageux que celui des médecins exclusifs, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la différence de traitement depuis la date de leur embauche jusqu'au 1er janvier 2005 ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, les arrêts retiennent que les médecins vacataires ne sont pas dans une situation identique à celle des médecins exclusifs, puisque leurs tâches exigent des diplômes et une technicité dont ne disposent pas les médecins exclusifs généralistes, et que la compétence professionnelle propre aux premiers n'est pas la même que celle des deuxièmes ; que la différence de leurs tâches se manifeste dans la différence de leur mode de rémunération, la rémunération de vacataire à l'acte, rapportée à la durée de leur vacation, étant très supérieure à celle, fixe, perçue par les médecins à la fonction ; qu'en leur qualité de vacataire, les salariés ne sont pas tenus d'assurer des gardes ou des visites médicales, alors que les médecins généralistes remplissent de telles fonctions ;
Attendu cependant, d'une part, que pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage, ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'avantage litigieux entre les médecins vacataires et les médecins dits exclusifs qui relèvent de la même catégorie professionnelle, sans rechercher si les différences de traitement constatées quant aux conditions d'affiliation au régime de retraite complémentaire étaient justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
L'EMPLOYEUR NE PEUT FAIRE DE DISCRIMINATION RACIALE OU RELIGIEUSE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 8 juillet 2020 Pourvoi n° 18-23.743 Rejet
4. Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Au termes de l’article L. 1321-3, 2° du code du travail dans sa rédaction applicable, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
5. L’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l’article L. 1321-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients.
6. Ayant relevé que l’employeur ne produisait aucun règlement intérieur ni aucune note de service précisant la nature des restrictions qu’il entendait imposer au salarié en raison des impératifs de sécurité invoqués, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que l’interdiction faite au salarié, lors de l’exercice de ses missions, du port de la barbe, en tant qu’elle manifesterait des convictions religieuses et politiques, et l’injonction faite par l’employeur de revenir à une apparence considérée par ce dernier comme plus neutre caractérisaient l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié.
7. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole
Univers, C-188/15), que la notion d’« exigence professionnelle essentielle
et déterminante », au sens de l’article 4 § 1 de la directive 2000/78 du 27
novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les
conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause. Elle ne saurait,
en revanche, couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de
l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client.
8. Dès lors, la cour d’appel a exactement retenu que si les demandes d’un client relatives au port d’une barbe pouvant être connotée de façon religieuse ne sauraient, par elles-mêmes, être considérées comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article 4 § 1 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, l’objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise peut justifier en application de ces mêmes dispositions des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives et, par suite, permet à l’employeur d’imposer aux salariés une apparence neutre lorsque celle-ci est rendue nécessaire afin de prévenir un danger objectif.
9. Ayant relevé que si l’employeur considérait la façon dont le salarié portait sa barbe comme une provocation politique et religieuse, il ne précisait ni la justification objective de cette appréciation, ni quelle façon de tailler la barbe aurait été admissible au regard des impératifs de sécurité avancés, la cour d’appel a constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter, que l’employeur ne démontrait pas les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans le cadre de l’exécution de la mission du salarié au Yémen de nature à constituer une justification à une atteinte proportionnée aux libertés du salarié.
10. La cour d’appel en a déduit à bon droit, sans encourir le grief de la quatrième branche du moyen qui manque en fait, que le licenciement du salarié reposait, au moins pour partie, sur le motif discriminatoire pris de ce que l’employeur considérait comme l’expression par le salarié de ses convictions politiques ou religieuses au travers du port de sa barbe, de sorte que le licenciement était nul en application de l’article L. 1132-4 du code du travail.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 7 février 2012 Pourvoi n° 10-19505 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2010), que M. X... engagé le 1er juillet 1970 par la société Renault en qualité de cadre stagiaire et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de projet de l'organisation informatique d'une direction de cette société, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de son origine et de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race
Mais attendu, d'abord, qu'eu égard à la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de preuve prévues par l'article L. 1134-1 du code du travail, ne viole pas le principe de l'égalité des armes tel que résultant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, relevé, pour rejeter les éléments avancés par l'employeur afin de justifier l'évolution de carrière du salarié, d'une part, que les insuffisances professionnelles alléguées n'étaient pas établies et, d'autre part, que les faits invoqués dans la lettre du 18 septembre 1992 et qualifiés par l'employeur de " problème plutôt disciplinaire " ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas amnistiés par application de l'article 12 de la loi n° 2002-496 du 6 août 2002, n'étaient pas avérés
Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives pouvant expliquer le retard important subi par le salarié dans le déroulement de sa carrière, par rapport à l'ensemble des salariés se trouvant dans une situation comparable, la cour d'appel a pu en déduire que ce retard n'était pas étranger à la discrimination ethnique invoquée par le salarié ;
Et attendu qu'une fois le discrimination établie, la cour d'appel pouvait valablement statuer sur la demande du MRAP en lui allouant une indemnité en réparation d'une atteinte directe aux valeurs correspondant à son seul objet social
L'EMPLOYEUR NE PEUT FAIRE DE DISCRIMINATION SEXUELLE
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 6 juin 2012 Pourvoi n° 10-21489 Rejet
Mais attendu qu'une discrimination indirecte en raison du
sexe est constituée dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique
apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour
des personnes d'un sexe donné par rapport à d'autres personnes, à moins que
cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié
par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient
appropriés et nécessaires ; qu'une telle discrimination est caractérisée lorsque
la mesure affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe.
Et attendu qu'ayant constaté un traitement défavorable, constitué par le refus
d'affiliation à l'AGIRC, au détriment des fonctions d'assistants du service
social, de délégués à la tutelle et de conseillers en économie sociale de la MSA,
dont il n'est pas contesté qu'elles sont très majoritairement occupées par des
femmes, par comparaison avec les fonctions de contrôleurs, inspecteurs, agents
d'animation et techniciens conseils de prévention dépendant de la même
convention collective, principalement occupées par des hommes, la cour d'appel a
exactement décidé que l'AGIRC, qui se bornait à soutenir que le critère de
comparaison avec des fonctions semblables dans des conventions collectives
voisines était le seul qui permette d'atteindre l'objectif de stabilité, de
cohérence et de pérennité du régime, ne justifiait pas du caractère nécessaire
et approprié du refus d'affiliation des catégories essentiellement féminines
d'assistant du service social, de délégué à la tutelle et de conseiller en
économie sociale ; que le moyen n'est pas fondé.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 6 février 2013 Pourvois n° 11-26604 11-26605 11-26606 11-26607 11-26608 11-26609 11-26610 Rejet
Attendu que la Poste fait grief à l'arrêt d'accueillir les
demandes des salariés alors selon le moyen, que constituent des éléments
objectifs et matériellement vérifiables de nature à justifier des disparités de
traitement entre les agents, l'ancienneté, l'historique de carrière – dont peut
résulter l'incorporation dans un complément de rémunération de primes perçues
antérieurement à la création de ce complément – ainsi que l'appréciation des
qualités professionnelles de l'agent ; que le montant du complément Poste versé
à un agent et ses règles d'évolution par le biais de
son rattachement à un champ de normalité spécifique dépendent des éléments
objectifs susvisés et justifient donc des disparités de traitement entre les
agents ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le
principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 3221-2, L.
2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que le complément poste, dont l'objet
est défini non par référence aux catégories juridiques mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste, perçu par les
salariés, agents de droit privé, était inférieur à celui perçu par les fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail et d'autre part, que La
Poste fournissait pour seule explication à cette différence, la mise en place d'un "champ de normalité" qui organisait l'inégalité de traitement entre les
agents en fonction de leur statut juridique, ce dont il résultait que cette différence de traitement n'était justifiée par aucune raison objective
pertinente, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le principe "à
travail égal salaire égal" avait été méconnu ; que le moyen n'est pas fondé
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 24 avril 2013, pourvoi n° 11-15204 Rejet
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que,
postérieurement à son inscription sur la liste d'aptitude de sous-directeur, le
salarié avait postulé en vain à quatorze reprises à un poste de sous-directeur
ou à un poste de niveau équivalent, qu'il a répondu à des propositions de postes
à l'international, à une proposition de poste dans une filiale à Paris, qu'il
est le seul de sa promotion de 1989 à ne pas avoir eu de poste bien que son
inscription sur la liste d'aptitude ait été prorogée à deux reprises en 1995 et
en 2000 et qu'il était parmi les candidats les plus diplômés et que plusieurs
témoins font état d'une ambiance homophobe dans les années 70 à 90 au sein de
l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que ces éléments laissaient présumer
l'existence d'une discrimination en raison de son orientation sexuelle ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la Caisse ne pouvait soutenir
utilement, d'une part, qu'elle n'avait pas disposé de poste de direction en son
sein propre entre 1989 et 2005, d'autre part, qu'elle n'avait pas été en mesure
de recommander activement la candidature de son salarié sur des postes à
l'international, la cour d'appel a pu décider que les justifications avancées
par l'employeur ne permettaient pas d'écarter l'existence d'une discrimination en raison de l'orientation sexuelle du salarié
LA DISCRIMINATION SYNDICALE DU SALARIÉ
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-17748 cassation partielle
Mais attendu d'abord que la pertinence du panel de comparaison est appréciée souverainement par les juges du fond ;
Attendu ensuite qu'ayant constaté que la remplaçante de la salariée avait été dès son embauche en situation de participer aux projets de développement et d'exercer un rôle d'autorité sur plusieurs services plus larges que celui exercé par la salariée, et qu'elle possédait un diplôme de psychologie lui ayant permis en moins de deux ans de devenir directrice opérationnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail et en paiement de sommes aux titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de congés-payés et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors, selon le moyen, que la protection attachée au mandat de conseiller prud'homal suppose seulement que, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, l'employeur ait été informé de l'existence de ce mandat ou qu'il en ait eu connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de la salariée en date du 21 février 2003 stipulait en son article 10 que « La société reconnaît avoir été informée par Mme X... de ses fonctions de juge auprès de la juridiction prud'homale de Chalon-sur-Saône et en accepte la poursuite. En outre, Mme X... s'engage à faire connaître sans délai tout changement qui interviendrait dans sa situation » ; qu'elle a encore relevé que le mandat initial de conseiller prud'homal de la salariée avait été renouvelé le 3 décembre 2008 sans que l'employeur n'en soit informé et que la rupture conventionnelle de son contrat de travail signée le 4 août 2010 à effet du 30 septembre 2010 n'avait pas été autorisée par l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant que la salariée ne pouvait se prévaloir du statut protecteur lorsqu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait connaissance du mandat initial de la salariée lors de la signature de son contrat de travail en 2003 et que, faute d'information ultérieure de la salariée concernant un changement dans sa situation, il était supposé considérer que ce mandat était toujours en vigueur lors de la rupture conventionnelle du contrat de travail et, partant, censé avoir connaissance du mandat protecteur de la salariée lors de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-22 et L. 1237-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le mandat de la salariée avait été renouvelé lors des élections du 3 décembre 2008 et qu'elle n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires l'arrêt retient qu'elle exerçait ses fonctions de façon autonome, sans horaires fixes, organisant ses journées et ne renseignant pas son employeur sur ses absences ; qu'elle produit un décompte qu'elle a elle-même effectué à partir de ses agendas personnels sur lesquels sont simplement notées des heures de début ou de fin de journée sans que soit mentionné le nombre d'heures travaillées et qui ne sont corroborées que par des attestations de directeurs d'établissements ; que dès lors la salariée n'a pas effectué d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés notamment de l'autonomie de la salariée, alors que les décomptes produits constituaient des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés auxquels l'employeur pouvait répondre, de sorte que la demande de la salariée était étayée et qu'il appartenait alors à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-27261 12-27262 12-27263 12-27266 12-27267 12-27268 12-27283 Rejet
Sur les premier, septième et huitième moyens du pourvoi de l'employeur, pris en leur première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les salariés ont été victimes d'une discrimination à raison de leur activité syndicale et de la condamner à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'enquête réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour dire que les salariés avaient subi une discrimination en raison de leur engagement syndical, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport d'enquête établi par l'inspection du travail sur sollicitation des salariés ; qu'en statuant ainsi, sur la seule base d'un rapport établi à la demande d'une des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au nombre de ces éléments peut figurer un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées ;
Et attendu qu'après avoir examiné contradictoirement l'ensemble des éléments de fait relevés par l'inspecteur du travail dans son rapport produit à l'appui de leurs demandes par les salariés, la cour d'appel, qui a constaté que ces éléments, dont elle a vérifié la pertinence, laissaient présumer l'existence d'une discrimination puis relevé que l'employeur n'établissait pas que les différences de traitement dont les intéressés avaient fait l'objet étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, n'encourt pas les griefs du moyen
Preuve de la discrimination syndicale de l'employeur, il peut se défendre en invoquant les fautes amnistiées.
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 4 juin 2014, pourvoi n° 12-28740 12-28741 12-28742 cassation
Vu les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 133-11 du code pénal, l'article 12 de la loi n°
2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour limiter la période sur laquelle porte l'action en discrimination à la période postérieure au 17 mai 2002, la cour d'appel a retenu
que les différentes lois d'amnistie promulguées en 1981, 1988, 1995 et 2002 interdisent à l'employeur de faire état des éventuelles sanctions disciplinaires
qui auraient pu être infligées aux salariés pendant la période couverte par ces lois d'amnistie et qui auraient pu expliquer de manière objective une différence
de traitement avec d'autres salariés et que la seule manière de concilier la recherche des éléments permettant de comparer l'évolution de la situation des
salariés avec le principe de l'égalité des armes est de limiter les investigations de l'expert à la période postérieure au 17 mai 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LE JUGE JUDICIAIRE NE PEUT REMETTRE EN CAUSE LA DECISION DE L'AUTORITE OU DU JUGE ADMINISTRATIF
SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 18 Février 2016, pourvoi n° 14-26706 Rejet
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation du préjudice subi au titre de la perte de son emploi,
alors, selon le moyen, que le principe de la séparation des pouvoirs n'interdit pas au juge judiciaire de réparer le préjudice subi par le salarié, dont le
licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, résultant du harcèlement moral pratiqué par l'employeur et à l'origine de son inaptitude
professionnelle ; qu'en retenant cependant, en l'espèce, que le principe de séparation des pouvoirs empêche la salariée de demander, devant le juge
judiciaire, la réparation de la perte de son emploi et de l'incidence sur sa retraite, quand celle-ci faisait valoir que ce préjudice résultait du
harcèlement moral pratiqué par l'employeur et à l'origine de son inaptitude professionnelle, dont l'existence a été constatée, la cour d'appel a commis un
excès de pouvoir négatif au regard du principe précité, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu que le salarié protégé licencié pour inaptitude en vertu d'une autorisation administrative ne peut faire valoir devant les juridictions
judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude que lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 30 septembre 2015, pourvoi n° 13-27872 cassation
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Comareg le 28 août 2003, placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2011, M. Y...
étant désigné en qualité de liquidateur ; que bénéficiant du statut de salarié protégé, il a été licencié pour motif économique le 20 décembre 2011 après
autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour que la société Groupe Hersant média soit déclarée son
coemployeur et obtenir la nullité du licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que dans son recours devant le ministre du travail, le salarié soutenait que
cette société avait la qualité de coemployeur, que le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail alors qu'il avait connaissance de ce moyen,
que l'intéressé n'avait exercé aucun recours devant le tribunal administratif et que l'autorité judiciaire n'était donc pas compétente pour apprécier la demande
relative à l'existence d'un coemployeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision administrative qui avait autorisé le licenciement du salarié, ne s'était pas prononcée sur une situation de coemploi
entre la société Groupe Hersant média et la société Comareg, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 22 janvier 2014, pourvoi n° 12 22546 cassation
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme visiteur médical par la société UCB Pharma en 1982, a été inclus dans une procédure de licenciement
collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'inspecteur du travail, saisi en raison du mandat représentatif exercé par M. X... a, par décision du 8
septembre 2009 autorisé le licenciement pour motif économique du salarié ; que M. X... a été licencié le 9 octobre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction
prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Attendu que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement
devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de
son obligation de reclassement ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que dans sa décision administrative autorisant le
licenciement en raison du projet du salarié de reclassement externe, l'inspecteur du travail a constaté, dans les motifs de sa décision, que le
licenciement était dénué de motif économique et que les efforts de reclassement n'avaient pas été faits, et qu'en conséquence, le licenciement doit être analysé
comme licite puisqu'autorisé mais dénué de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs par lesquels l'autorité administrative, tout en accordant une autorisation de licenciement, dénie la
cause économique de ce dernier et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ne sont pas le soutien nécessaire de la décision d'autorisation,
et dès lors ne peuvent pas être opposés à l'employeur dans le cadre d'une contestation du bien-fondé du licenciement qui a été autorisé, la cour d'appel a
violé les textes et le principe susvisés
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-10648 cassation partielle
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que la manutention
des fauteuils, en ce qu'elle était l'accessoire de sa fonction, entrait dans ses attributions, l'employeur non seulement n'avait pas modifié son contrat de
travail mais n'avait pas modifié ses conditions de travail de sorte que le refus du salarié d'effectuer cette tâche de manutention était fautif sans toutefois
constituer une faute grave ;
Attendu cependant que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant
l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ;
Qu'il s'ensuit qu'en considérant comme incluses dans son contrat de travail les tâches de manutention des fauteuils et, partant, comme fautif le refus du
salarié de les accomplir alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement du salarié au motif que ces tâches n'étaient
pas inhérentes au contrat et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LA PRISE D'ACTE DU SALARIÉ
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-16369 Rejet
violé l'article L. 2411-8 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, quand bien même l'administration du travail, saisie antérieurement à la prise d'acte du salarié, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement à cette prise d'acte ;
Attendu ensuite qu'ayant constaté que, par lettre du 30 décembre 2008, le salarié s'était vu, sans autorisation de l'inspecteur du travail, redéfinir sa mission au sein de l'entreprise, induisant une modification de son contrat de travail dès lors qu'il se voyait imposer une réduction importante de sa rémunération, passant de 3 153 euros brut mensuel depuis le 1er mai 2008 à 2 000 euros brut mensuel à compter du 1er janvier 2009, et retenu que l'employeur ne peut sérieusement prétendre que le salarié a normalement poursuivi l'exécution de son contrat de travail conformément aux nouvelles directives de la société alors que, dès le 25 février 2009, il saisissait en référé le conseil de prud'hommes afin de faire condamner la société à respecter les termes du contrat originaire, puis saisissait au fond la juridiction prud'homale le 12 juin 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a écarté toute fraude commise par le salarié
LA DISCRIMINATION SUR L'ÂGE DU SALARIÉ
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 18 février 2014, pourvoi n° 13-10294 Rejet
Attendu que la société Air-France fait grief à l'arrêt de dire que sa décision d'écarter le salarié des campagnes de qualification sur A 380 constitue une discrimination fondée sur l'âge et donc un trouble manifestement illicite, et en conséquence, de lui ordonner de retenir la candidature du salarié sur la prochaine campagne de qualification et de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts provisionnels
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge, qu'ayant constaté que l'employeur n'apportait aucun élément faisant apparaître que le refus opposé au salarié était justifié par un objectif légitime, que, notamment, l'argument de la société relatif à la rentabilité du coût de la formation, selon lequel le navigant qui a atteint soixante ans serait susceptible de ne pas renouveler sa demande annuelle de poursuite de son activité jusqu'à l'expiration de la durée minimale d'affectation ou de ne plus pouvoir assurer des vols, suite aux visites médicales auxquelles il est soumis, est inopérant, tout navigant pouvant, à un moment quelconque de sa carrière et quel que soit son âge mettre fin au contrat de travail qui le lie à la société ou ne plus être autorisé à piloter en raison d'un problème de santé constaté lors d'une visite médicale, alors qu'il a pu bénéficier d'une récente qualification non encore amortie, et qu'ayant retenu que l'objectif de sécurité publique est assuré pour les pilotes de plus de soixante ans par les conditions posées par le paragraphe II de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, la cour d'appel a, par ces seuls motifs non critiqués par le moyen, caractérisé une discrimination fondée sur l'âge constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé
DISCRIMINATION N'IMPLIQUE PAS COMPARAISON
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 20 février 2013, pourvoi n° 10-30028 Rejet
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour discrimination,
Mais attendu qu'ayant constaté que la discrimination litigieuse avait été révélée à la salariée par le courrier de l'inspection du travail du 17 octobre 2006, soit moins de cinq ans avant l'introduction le 25 septembre 2009 de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel, faisant une exacte application tant de l'article L. 1134-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que de l'article 26 II et III de ladite loi, a déclaré non prescrite cette demande qui tendait à la réparation du préjudice subi par l'intéressée et résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que le moyen n'est pas fondé
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement à la salariée de dommages-intérêts pour discrimination
Mais attendu, d'abord, que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres
salariés ; ensuite, qu'un employeur ne peut, fût-ce pour partie, prendre en compte les absences d'un salarié liées à ses activités syndicales pour arrêter
ses décisions en ce qui concerne notamment la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement et la rémunération ;
Et attendu qu'ayant relevé que les fiches d'évaluation de la salariée, dont l'évolution de carrière se situait bien en-deçà de la progression de
rémunération enregistrée par la moyenne des salariés de la CPAM des Alpes-Maritimes, faisaient référence à ses activités syndicales et prud'homales,
dénoncées sous l'appellation "présentéisme" comme entraînant une présence insuffisante de l'intéressée au travail, ce dont il se déduisait que ces
éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, alors que l'employeur était défaillant dans l'établissement d'une preuve contraire, la
cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 5 mars 2014, pourvoi n° 12-27701 cassation partielle
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme
à titre de dommages-intérêts pour discrimination, après avoir relevé qu'il ressort effectivement du témoignage du chorégraphe qu'il était nécessaire de
vérifier les capacités physiques et esthétiques de la salariée à l'occasion de deux auditions ayant eu lieu en janvier 2009, l'arrêt retient qu'il apparaît que
l'employeur subordonne la poursuite du contrat de travail à un état physique et esthétique, sans justifier en l'espèce d'un quelconque programme d'aide et de
soutien pour permettre à la salariée de retrouver des capacités optimales à cet égard et qu'une attitude discriminatoire peut être relevée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur à l'obligation de
formation prévue par l'article L. 1225-59 du code du travail ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés
L'EMPLOYEUR A UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ
L'EMPLOYEUR A UNE OBLIGATION D'INFORMATIONS ET DE SÉCURITÉ
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 8 avril 2021 Pourvoi n° 20 -11.935 Rejet
Recevabilité du premier moyen
4. La victime conteste la recevabilité du premier moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce que l’employeur n’a jamais soutenu devant la cour d’appel qu’il aurait été dispensé, en tant que particulier employeur, de respecter les dispositions du code du travail relatives aux principes généraux de prévention prévus au titre II du livre premier de la quatrième partie du code du travail et que la faute inexcusable devait être caractérisée par référence à un acte ou une omission volontaire d’une exceptionnelle gravité à l’origine de l’accident du travail.
5. Cependant, les moyens nouveaux sont recevables lorsque l’application de la règle de droit invoquée ne nécessite la prise en compte d’aucune constatation de fait qui ne soit issue de l’arrêt attaqué. En l’espèce, l’application de la règle de droit invoquée dans le premier moyen repose sur la qualité de particulier de l’employeur, laquelle ressort des propres énonciations de l’arrêt.
6. Le moyen, de pur droit, qui, au surplus, n’est ni incompatible ni contraire avec la thèse soutenue par l’employeur devant les juges du fond, est donc recevable.
Bien fondé des moyens
7. Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l’employé de maison a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu‘il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
8. L’arrêt relève, d’une part, par motifs propres, que les constatations effectuées par les services de police immédiatement après les faits ont permis d’établir que le balcon est une avancée en bois en mauvais état, que les morceaux de bois jonchent le sol, le bois étant en piteux état et qu’il se peut que la victime se soit appuyée sur la rambarde qui a cédé.
9. Il énonce, d’autre part, par motifs adoptés, que l’employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans la résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l’état de cette rambarde qui n’a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine. Il en déduit que l’employeur était conscient du danger ou qu’il aurait dû à tout le moins être conscient du danger auquel son employée était exposée dans le cadre de ses attributions ménagères.
10. Il relève que s’il n’était pas présent dans la pièce au moment de l’accident il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son employée en condamnant l’accès au balcon ou à tout le moins en lui interdisant l’accès à ce balcon ou en la mettant en garde sur la dangerosité des lieux. Il précise que dans le cas présent, le balcon était libre d’accès et qu’aucune information ou consigne n’avait été donnée à l’employée chargée de nettoyer la pièce servant de bureau.
11. De ces constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d’appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l’employeur a commis une faute inexcusable.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2 arrêt du 4 octobre 2018 Pourvoi n° 17-23694 Rejet
Mais attendu que la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code ;
Et attendu que l’arrêt constate, d’une part, que Mme X... , salariée d’une entreprise de travail temporaire, mise à disposition de la société Presta Breizh était affectée, en qualité d’ouvrière pareuse, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés, d’autre part, que cette société ne justifie pas lui avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L. 4153 du code du travail;
D’où il suit que le moyen est inopérant;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation;
COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 15 mars 2016 Pourvoi n° 13-88530 CASSATION PARTIELLE
Attendu que, pour relaxer M. X... du chef d'homicide involontaire et rejeter, en conséquence, les demandes des parties civiles, l'arrêt retient, d'une part, que la chute du salarié ne peut être imputée au manquement à l'obligation de sécurité pour un travail en hauteur, dont le prévenu est déclaré coupable, puisque l'accident est survenu alors que la victime avait pris l'initiative, qui n'était pas commandée par l'employeur, ni n'était nécessaire à l'exécution de sa tâche, de s'éloigner de sa zone de travail, d'autre part, que, si le prévenu n'a pas établi, comme il l'aurait dû, un document unique d'identification et de prévention des risques liés à une opération de rénovation en toiture, cette négligence, qui n'a pas été mentionnée dans l'acte de poursuite, ne peut être sanctionnée ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher si l'omission, par le prévenu, de procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l'opération projetée, qu'elle avait relevée et sur laquelle l'intéressé s'était expliqué bien qu'il n'ait pas été poursuivi spécialement de ce chef, n'était pas à l'origine d'un défaut d'information du salarié sur les risques encourus en cas d'éloignement de sa zone de travail et, partant, si cette carence de l'employeur ne constituait pas une faute entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision
L'EMPLOYEUR DOIT DEMONTRER QU'IL SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL
COUR DE CASSATION Chambre Sociale du 23 mai 2013 Pourvoi n° 12-14027 CASSATION
Vu l'article L. 5132-12 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité est assurée par un examen de médecine préventive ; qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés, de prendre les mesures propres à assurer l'effectivité et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer le suivi médical, l'arrêt énonce qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que Mme X... n'a pas été convoquée régulièrement à l'examen périodique de la médecine préventive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé
L'EMPLOYEUR A UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT ET NON SEULEMENT DE MOYENS, EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
COUR DE CASSATION Chambre Sociale du 12 janvier 2011 Pourvoi n° 09-70838 CASSATION
Attendu, cependant, qu'il appartient à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés
COUR DE CASSATION Chambre Sociale du 6 octobre 2010 Pourvoi n° 09-65103 CASSATION
Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du
travail, ensemble les articles R. 3511-1 et R. 3511-2 du code de la santé
publique dans leur version alors applicable
Attendu que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation
de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme barman le 2 février
2004 par la société L'abbaye de Saint-Ermire (la société), a pris acte par
lettre du 26 octobre 2005 de la rupture de son contrat de travail en
reprochant à son employeur de l'avoir laissé, en violation de la législation
relative à la lutte contre le tabagisme, constamment exposé aux fumées de
cigarettes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande
de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt retient que si le constat d'huissier
dressé le 10 juin 2005 établit que l'employeur ne respectait pas les
dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les
lieux ouverts au public, il ne démontre pas pour autant que la santé du
salarié était compromise par ce seul fait que cette interdiction n'étant pas
absolue dans les locaux d'un bar-restaurant, le salarié était nécessairement
exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de
cigarettes ; que la présence dans son sang d'un taux de nicotine de l'ordre de
81,9 ng/ml est faible, les seuils d'interprétation qualifiant de fumeur passif
un patient dont le taux est au minimum de 50 ng/ml ; qu'en outre un tel taux
ne peut être imputable à ses seules conditions de travail, M. X... vivant dans
une métropole particulièrement polluée ; que le tableau mesurant le taux de
CO2 ne présente aucune garantie ; qu'au surplus, les services de la médecine
du travail n'ont émis aucune observation sur les conditions de travail du salarié
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés notamment de
constatations relatives à l'insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le
sang du salarié exposé aux fumées de cigarettes, alors qu'elle avait constaté
que la société ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique
sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, la
cour d'appel a violé les textes susvisés
Dans son obligation de sécurité, l'employeur doit protéger le salarié contre le harcèlement. Cliquez ci dessous pour tout savoir.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2, arrêt du 22 septembre 2011 Pourvoi n° 09-15756 CASSATION
Vu les articles L. 412-8,8° et L. 413-12,2° du code de la
sécurité sociale, tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, ensemble, l'article 20 du décret-loi
du 17 juin 1938.
Attendu que le marin victime d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime, ou
ses ayants droit, peuvent, en cas de faute inexcusable de l'employeur,
demander devant la juridiction de sécurité sociale le bénéfice du livre IV du
code de la sécurité sociale ainsi que l'indemnisation des préjudices
complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre.
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des ayants droits d'Ange X...
et l'intervention du FIVA, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 20 § 1
du décret régissant ce régime en date du 17 juin 1938 modifié par le décret du
28 janvier 1956 que la notion de faute inexcusable n'existe pas dans ce régime
spécial dérogatoire au régime général de sécurité sociale, que les ayants
droit d'Ange X... estiment que l'application des textes dérogatoires entraîne
une violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi au regard des
dangers liés à l'exposition à une matière toxique comme l'amiante et que ce
moyen ne saurait prospérer en raison de ce que le FIVA indemnise selon le
principe de l'indemnisation intégrale l'ensemble des victimes de l'amiante ainsi que leurs ayants droit.
COUR DE CASSATION Chambre Criminelle, arrêt du 11 avril 2012 Pourvoi n° 10-86974 CASSATION PARTIELLE
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à
justifier la décision ; que l'insuffisance de la contradiction des motifs
équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer la société Gauthey coupable de blessures
involontaires et d'infraction à la sécurité des travailleurs, à la suite d'un
accident du travail subi par M. Y..., salarié sous contrat de
professionnalisation qui avait oeuvré sur un chantier de cette entreprise, la
cour d'appel, infirmant sur ce point le jugement entrepris, retient par les
motifs repris au moyen qu'à défaut d'avoir dispensé une formation pratique et
appropriée, la personne morale a créé la situation ayant permis la réalisation
du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les manquements
relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de la
société Gauthey, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société,
au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2, arrêt du 4 avril 2013 Pourvoi n° 12-13600 Rejet
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 452-1 et L.
461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de
l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause
nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle
s'entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles
visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les
conditions mentionnées dans ce tableau ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le contentieux concerne la
maladie du tableau n° 97 des maladies professionnelles et non celle du tableau
n° 98, soit les affections chroniques du rachis lombaire par la manutention
manuelle de charges lourdes, retient que toutes les réserves émises par les
médecins du travail à compter de l'année 2000 concernaient le port de charges
lourdes, que les travaux susceptibles de causer la maladie figurant au tableau
n° 97 sont celles qui exposent habituellement aux vibrations de basses et
moyennes fréquences transmises au corps entier lors de l'utilisation ou la
conduite de certains engins, matériels ou véhicules, notamment la conduite de
tracteur routier et de camion monobloc, et qu'il s'agit d'activités qui, avant
la visite de reprise du 27 novembre 2006, n'avaient pas fait l'objet de
réserves lors des examens des médecins du travail ;
Que de ces énonciations et constatations, d'où il résulte que la faute
invoquée par le salarié était étrangère aux causes de la maladie
professionnelle dont il est atteint, la cour d'appel a déduit à bon droit que
la responsabilité de l'employeur n'était pas engagée
L'EMPLOYEUR NE PEUT PAS LICENCIER LE SALARIÉ DÉCLARÉ INAPTE AU TRAVAIL POUR CAUSE D'ACCIDENT DU TRAVAIL CAUSÉ PAR L'EMPLOYEUR
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 3 mai 2018 Pourvoi n° 17-10306 Rejet
Mais attendu que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d’autre part, qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;
Et attendu, qu’ayant constaté, sans méconnaître l’objet du litige, que la salariée ne réclamait pas des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou du manquement de son employeur à son obligation de sécurité mais des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que par son manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur était à l’origine de son licenciement pour inaptitude, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était compétente pour statuer sur cette demande ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 3 mai 2018 Pourvoi n° 16-26306 cassation partielle
Vu l’article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, d’une part, que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d’autre part, qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 2001 en qualité de couvreur par M. Y..., a été victime, le 8 avril 2005, d’un accident du travail ; que la juridiction de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et a fixé les préjudices subis par le salarié ; qu’ayant été licencié, le 23 octobre 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. X...a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d’une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient que le salarié demande à la juridiction du travail de dire que son licenciement a pour cause la violation de l’obligation de sécurité de résultat incombant à son employeur et qu’en conséquence, il est sans cause réelle et sérieuse, et, à titre subsidiaire, qu’il a pour cause la faute inexcusable de son employeur, de sorte que cette nouvelle demande relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale comme étant une demande de réparation d’un préjudice né de l’accident du travail, qu’il lui appartient de présenter cette demande devant la juridiction de sécurité sociale seule compétente puisqu’elle constitue une demande d’indemnisation de la perte de son emploi consécutive à l’accident du travail et à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur commise à son égard ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
L'EMPLOYEUR DOIT PROTÉGER LE SALARIÉ CONTRE LES RISQUES DE L'AMIANTE
COUR DE CASSATION Chambre Criminelle, arrêt du 24 juin 2014 Pourvoi n° 13-81302 CASSATION
Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à suivre contre quiconque, l’arrêt retient notamment que les articles R. 232-10 et suivants du code du travail énoncent des mesures générales afin d’assurer la propreté des locaux et non des mesures particulières afin de protéger les travailleurs du risque de l’amiante ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi alors que ces articles, pris en application des dispositions édictées en vue d’assurer la sécurité des travailleurs, imposent, dans les emplacements affectés au travail, d’une part, des mesures de protection collective assurant la pureté de l’air nécessaire à la santé des travailleurs tenant à des modalités particulières de nettoyage, à l’installation de système de ventilation ou d’appareils clos pour certaines opérations, d’autre part, dans le cas où l’exécution de ces mesures serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés mis à la disposition des travailleurs, et caractérisent ainsi l’obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef
COUR DE CASSATION Chambre civile 2, arrêt du 26 novembre 2015 Pourvoi n° 14-26240 Rejet
Mais attendu, d'abord, qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui a constaté qu'il résultait du rapport d'enquête administrative que M. Y... avait été exposé pendant vingt ans au risque d'inhalation de poussières d'amiante en réalisant habituellement des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, que la société Elit figurait sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, a pu en déduire que les critères posés par le tableau n° 30 B étant remplis, le cancer bronchique primitif déclaré le 20 août 2010 par M. Y... avait un caractère professionnel ;
Et attendu, enfin, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait commis une faute inexcusable
LE CARACTÈRE IRRÉVERSIBLE ET IMPRÉVISIBLE DE L'ÉVÉNEMENT EXONÈRE L'EMPLOYEUR
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2, arrêt du 4 avril 2012 Pourvoi n° 11-10570 CASSATION
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1148 du code civil
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1997
en qualité de secrétaire comptable par M. Y..., garagiste ; que le 13 mars
2007, elle a été agressée sur son lieu de travail par Mme Y... et a été placée
en arrêt de travail jusqu'au 18 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction
prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts
de son employeur et de condamnation à des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs
propres, qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est
caractérisé en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait
d'agression, imprévisible et irrésistible, commis par son conjoint, tiers à la
relation de travail, et, par motifs adoptés, que l'employeur non présent lors
de l'agression n'avait jamais été prévenu d'un risque quelconque encouru par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère
irrésistible et imprévisible de l'événement ayant pour effet de rendre
impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LA FAUTE DE L'EMPLOYÉ LIMITE LA RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR
COUR DE CASSATION Chambre Sociale, arrêt du 7 décembre 2011 Pourvoi n° 10-22875 Rejet
Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui contestait dans
le cadre de la procédure engagée devant la juridiction du contentieux de la
sécurité sociale l'application de la législation sur les accidents du travail
pour mettre en cause la recevabilité de l'action introduite devant cette
juridiction, n'est pas recevable à invoquer au soutien de son pourvoi les
effets de cette législation et la compétence exclusive des juridictions du
contentieux général de la sécurité sociale ;
Attendu, ensuite, que le salarié dont l'affection n'est pas prise en charge au
titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies
professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le
fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la salariée, qui se trouvait du fait de
son contrat de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque, avait,
à plusieurs reprises, alerté son employeur sur l'accroissement des dangers
encourus par les ressortissants français à Abidjan, lui demandant expressément
d'organiser son rapatriement et un retour sécurisé en France, la cour d'appel
a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait apporté
aucune réponse aux craintes exprimées par la salariée, qu'il s'était contenté
de faire état du lieu contractuel sans prendre en compte le danger encouru par
elle et n'avait pris aucune mesure de protection pour prévenir un dommage
prévisible ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que
l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles sans qu'une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité puisse être reprochée à la salariée
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PEUT POURSUIVRE L'EMPLOYEUR
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2, arrêt du 22 septembre 2011 Pourvoi n° 10-20085 REJET
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action récursoire de la caisse
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité
sociale que les caisses primaires d'assurance maladie récupèrent contre
l'employeur, dont la faute a été jugée inexcusable, les sommes qu'elles
versent à la victime ou ses ayants-droits de sorte que l'action récursoire de
la caisse, obligatoirement appelée en déclaration de jugement commun en vertu
des dispositions de l'article L. 452-4 du même code par le salarié ou ses
ayants-droit lorsqu'ils poursuivent la reconnaissance de la faute inexcusable
de l'employeur, tend, au sens des dispositions de l'article 565 du code de
procédure civile, aux mêmes fins que celles de sa mise en cause, peu important
alors à la recevabilité de son action contre l'employeur fautif qu'elle ne
soit exercée pour la première fois qu'en cause d'appel ;
D'où il suit que par ce moyen de pur droit, relevé d'office après avis donné
aux parties, la décision attaquée se trouve légalement justifiée nonobstant les critiques formulées par le moyen
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2, arrêt du 16 février 2012 Pourvoi n° 11-12143 REJET
Mais attendu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'il est établi par le rapport de l'inspecteur du travail que la remise en fonctionnement inopinée de l'installation procédait d'une manipulation intempestive de M. Y... à partir de l'armoire renfermant le tableau de commande, laquelle aurait dû rester sans effet en l'absence d'intervention personnelle des techniciens opérant sur l'installation, lesquels, pour garder la maîtrise de la remise en marche, auraient pu, soit verrouiller en position ouverte le sectionneur de puissance et de commande de l'armoire à l'aide de leur cadenas de consignation, soit retirer, après l'avoir mis en position " arrêt ", la clé de sécurité que M. Y... reconnaît avoir manipulée, empêchant ainsi le rétablissement du circuit de commande ; qu'il retient que l'absence de mise en oeuvre des mesures de sécurité élémentaires par des mécaniciens qui n'y recouraient manifestement pas de façon systématique, notamment pour pouvoir effectuer des essais en cours de réalisation de travaux de réparation ou maintenance sans avoir à intervenir eux-mêmes sur le tableau de commande pour assurer la remise en marche, caractérise une faute de l'employeur tenu non seulement de mettre à disposition de ses salariés les dispositifs de sécurité et protection imposés par la loi ou les règlements, mais de leur en imposer l'usage ;
Que par ces seuls motifs suffisant à caractériser le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'il avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
COMMUNIQUE DE LA COUR DE CASSATION DU 4 AVRIL 2012
Selon les termes de l’article L. 452-3 du code
de la sécurité sociale (tels que modifiés en dernier lieu par une loi du 6
décembre 1976), le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur pouvait prétendre,
indépendamment des prestations prévues par la législation professionnelle
(prise en charge des soins, indemnités journalières, rente en cas d’incapacité
permanente) et de la majoration, le cas échéant, de sa rente, à
l’indemnisation de certains préjudices de caractère personnel limitativement
énumérés : souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et
d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des
possibilités professionnelles. Il appartient à la caisse primaire d’assurance
maladie de faire l’avance du montant des sommes allouées à ce titre et de les
récupérer auprès de l’employeur.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil
constitutionnel a retenu la conformité à la Constitution de ces dispositions à
la condition qu’elles soient interprétées comme ne faisant pas obstacle à la
possibilité pour les victimes et leurs
ayants droit "de
demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par
le livre IV du code de la
sécurité sociale" (Cons.
const., 18 juin 2010,
décision n° 2010-8 QPC).
Il appartenait ainsi à la Cour de cassation de déterminer la portée de cette réserve d’interprétation. Tel est l’objet des quatre arrêts rendus, le 4 avril 2012, par la deuxième chambre civile :
1. Ces derniers précisent ainsi, en premier lieu, l’étendue de la réparation due à la victime, à savoir :
La victime peut prétendre à la réparation de chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du livre IV du code de la sécurité sociale : il en va ainsi du déficit fonctionnel temporaire, qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire (2e arrêt)
2. La deuxième chambre civile a retenu, en second lieu, qu’il incombait à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance à la victime de l’ensemble des réparations qui lui sont allouées, sans distinction selon qu’elles correspondent à des chefs de préjudice énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ou se rapportent à d’autres chefs de préjudice, tels le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel temporaire (1e et 2e arrêts).
Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 4 avril 2012 N° de pourvoi: 11-14311/11-14594 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
Joint les pourvois n̊ G 11-14.311 et R 11-14.594
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne et à la société Adia du désistement de leurs pourvois dirigés contre la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adia, a été victime d’un accident le 13 octobre 2003 au cours d’une mission effectuée pour la société Mizzaro ; que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse), une rente lui étant allouée ; que l’accident ayant été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l’employeur, M. X... a sollicité l’indemnisation de divers préjudices
Attendu que la caisse, les sociétés Adia et Mizzaro font grief à l’arrêt d’allouer une certaine somme à M. X... au titre du préjudice sexuel et une autre somme en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
Mais attendu que les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n̊ 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
Et attendu, d’une part, que le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que, d’autre part, les indemnités journalières servies à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique
Que le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire n’étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a décidé à bon droit qu’ils pouvaient être indemnisés sur le fondement du texte précité
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
Mais attendu qu’il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur
Et attendu que la cour d’appel a décidé à bon droit que le bénéfice de ce versement direct s’appliquait également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, l’arrêt retient qu’il s’agit d’un préjudice non indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale
Qu’en statuant ainsi, alors que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité est supérieur à 10 % indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts par le livre précité, la cour d’appel a violé les textes susvisés
Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 4 avril 2012 N° de pourvoi: 11-15393 REJET
Attendu , selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2011), que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime, le 5 juillet 2004, d’un accident du travail qui a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de son employeur ; qu’il a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en réparation de divers préjudices
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et du retentissement professionnel découlant de son incapacité à exercer son métier de maçon ou toute autre profession manuelle
Mais attendu que si l’article L. 452 3 du code
de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa
décision n̊ 2010 8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable,
la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut
demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation
d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la
condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code
de la sécurité sociale
Et attendu qu’après avoir exactement énoncé que la rente dont bénéficiait
M. X... en application de l’article L. 452 2 de ce code indemnisait d’une part
les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de
l’incapacité, et d’autre part le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les
dommages dont la victime demandait réparation étaient déjà indemnisés au titre
du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a décidé à bon droit
qu’ils ne pouvaient donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452 3 du même code
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 4 avril 2012 N° de pourvoi: 11-12299 REJET
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010) et les productions, que Mme X...-Y..., salariée de la société Synergie (l’employeur), a été victime d’une intoxication par inhalation de trichloréthylène le 18 octobre 2002, alors qu’elle avait été mise à disposition de la société Etablissements Jean Perret ; qu’elle a déclaré le 20 décembre 2002 être atteinte d’une pathologie relevant du tableau n° 12 des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a déposé le 23 mars 2003 une autre déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 66, relatif à un asthme d’origine professionnelle, que la caisse a refusé de prendre en charge ; que par jugement définitif du 7 novembre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie a jugé que cette maladie était en relation avec l’inhalation de trichloréthylène subie le 18 octobre 2002 ; que Mme X...-Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale de deux demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l’intoxication par le trichloréthylène dont elle avait été victime le 18 octobre 2002, et de son aggravation reconnue par le jugement du 7 novembre 2005 ; que la cour d’appel a dit que la maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2002 était due à la faute inexcusable de son employeur
Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de dire qu‘elle ne pouvait pas récupérer auprès de l’employeur les majorations et indemnités qu’elle a ou aurait versées à la victime
Mais attendu, d’abord, que l’arrêt relève que la société avait fait valoir que la caisse ne pouvait pas lui réclamer le remboursement des sommes versées ; qu’ensuite en sa seconde branche, le moyen critique une omission de statuer qui ne saurait donner lieu à ouverture à cassation ; qu’enfin l’arrêt relève que la caisse a omis de porter à la connaissance de l’employeur les éléments recueillis lors de l’instruction à laquelle elle a procédé à la suite de la première déclaration de maladie professionnelle, et retient que les deux maladies successivement déclarées ne sont que les manifestations d’un seul et même état pathologique provoqué par l’intoxication subie le 18 octobre 2002, lequel n’a été consolidé que le 31 août 2005 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que, la décision de prise en charge de l’affection déclarée le 20 décembre 2002 étant inopposable à l’employeur, la caisse ne pourrait récupérer auprès de celui-ci les majorations et indemnités versées à la victime ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé en ses troisième et quatrième branches et est irrecevable pour le surplus
Mais attendu qu’il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur
Et attendu qu’ayant reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a décidé à bon droit que la caisse serait tenue de verser à Mme X...-Y... les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l’ensemble des préjudices subis par la victime ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
LES DEMANDES DU SALARIES CONTRE L'EMPLOYEUR SONT IRRECEVABLES
SI ELLES SONT DÉJÀ RÉPARÉES PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Cour de cassation chambre mixte arrêt du 9 janvier 2015 N° de pourvoi 13-12310 REJET
Mais attendu que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut
demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la
condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire,
par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de
l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ;
Que la cour d'appel a donc décidé à bon droit que la perte subie par M. X... se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte
qu'elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 13 février 2014 N° de pourvoi 13-10548 REJET
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par
le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable,
la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation
d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code
de la sécurité sociale et que l'affaire n'ait pas été jugée définitivement à la date de publication de la décision du Conseil ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'en sollicitant, en se fondant sur la décision précitée du Conseil constitutionnel, une mesure d'expertise portant sur des
postes de préjudice dont il soutient qu'ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, M. X... entend voir statuer sur les mêmes droits
que ceux qui constituaient l'objet du litige irrévocablement tranché par l'arrêt du 26 janvier 2010, à savoir l'ensemble des conséquences dommageables de
l'accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, qui sont réparées dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 avant son
interprétation par le Conseil constitutionnel ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans violer les dispositions de l'article 1351 du code civil, que les demandes
de M. X... se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 janvier 2010
LES FRAIS NON REMBOURSÉS PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE SONT DUS PAR L'EMPLOYEUR
Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 18 décembre 2014 pourvois n° 13-25839 Cassation Partielle
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... au titre des frais d'assistance de son médecin lors des opérations d'expertise, l'arrêt
retient que ces frais ne sont pas causés par l'accident, mais par l'instance, et qu'ils doivent être indemnisés au titre des frais irrépétibles sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais litigieux, qui sont la conséquence directe de l'accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice
expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la
faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés
L'EMPLOYEUR DOIT LE PRÉJUDICE D'ANXIÉTÉ AVANT LA DÉCLARATION DE LA MALADIE
Cour de cassation chambre sociale arrêt du 28 mai 2014 pourvois n° 12-12949 12-12950 12-12951 REJET
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu qu'ayant relevé que la demande ne s'inscrivait pas dans une action en réparation d'accidents ou maladies telles que visées par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, mais tendait à l'indemnisation du préjudice économique, moral et d'anxiété subi à la suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a retenu à bon droit la compétence de la juridiction prud'homale dès lors qu'une déclaration de maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne prive pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation du préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie ; qu'elle a, abstraction faite des motifs visés par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision
UN EMPLOYEUR NE PEUT JOUER SUR LES LEGISLATIONS
NATIONALES POUR ECHAPPER A SES OBLIGATIONS
La LOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014 vise à lutter contre la concurrence sociale déloyale.
UN SALARIE MIS A DISPOSITION DANS UNE FILIALE ETRANGERE QUI LE LICENCIE
RESTE EMBAUCHE AU SEIN DE LA MAISON MERE
Cour de cassation chambre sociale du 30 mars 2011 N° de pourvoi: 09-70306 REJET
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L. 1231-5 du code du travail,
lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à
la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de
travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son
rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de
ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; que ce texte ne
subordonne pas son application au maintien d'un contrat de travail entre le
salarié et la maison-mère
Attendu, ensuite, que l'obligation de reclassement à la charge de la société
mère ne concernant que les relations entre celle-ci et le salarié qu'elle met à
disposition, peu importe que le contrat conclu entre ce dernier et la filiale
ait été soumis au droit étranger
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été mis à
disposition de sa filiale américaine par la société Guy Demarle, a, par ces
seuls motifs, exactement décidé qu'en l'absence de son reclassement par la
société mère, la rupture du contrat de travail s'analysait, conformément aux
dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MEME SI L'EMPLOYEUR EST UNE SOCIETE ETRANGERE, IL DOIT PAYER EN FRANCE
LES CHARGES SOCIALES D'UN SALARIE QUI TRAVAILLE EN FRANCE
Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 5 janvier 2011 N° de pourvoi: 09-69035 REJET
Mais attendu que l'assurance prévue par l'article L. 3253-8 du code du travail
est applicable dès lors, d'une part, que le salarié exerce ou exerçait
habituellement son travail en France, sur le territoire métropolitain ou dans un
département d'Outre-mer, et d'autre part, qu'une procédure collective
d'apurement du passif de l'employeur est ouverte ou exécutoire en France ; qu'il
en résulte que l'exclusion prévue par l'article L. 940-1 du code de commerce,
pour le territoire de la Polynésie française, ne peut être opposée lorsque ces
deux conditions sont réunies ;
Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X...
exerçait habituellement son travail en France métropolitaine et que son
employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par
une juridiction française, en sorte que la garantie de l'AGS devait lui
bénéficier ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après
avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié
LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES FRANCAIS EST COMPETENT POUR UN CONTRAT EXECUTE EN FRANCE
Cour de cassation chambre sociale Arrêt du 27 novembre 2013 N° de pourvoi: 12-20426 Cassation
Attendu que pour dire la juridiction prud'homale française
incompétente pour statuer sur les demandes du salarié et le renvoyer à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que la législation en vigueur applicable à la
situation de M. X... en 1997 était bien la loi belge ; que l'AGS réservait à cette époque l'intervention du régime de garantie des salaires découlant de
l'article L. 143-11-1 du code du travail aux seules procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes par des juridictions appartenant à
l'ordre judiciaire français ; que de fait, M. X... avait déclaré des créances au passif de la procédure de faillite belge, créances en partie prises en charge
par le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise ; que cette prise en charge est d'ailleurs toujours en cours et
n'est pas encore clôturée et que c'est dès lors à juste titre que tant les curateurs de la faillite de la société Nova électro international que la
délégation Unedic AGS ont pu soulever l'incompétence du conseil de prud'hommes de Bobigny pour connaître des demandes de M. X... au profit de la juridiction
belge compétente ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants pour déterminer le juge compétent
pour connaître de l'action du salarié dirigée contre son employeur en contestation de son licenciement avec demande de garantie de l'AGS et alors
qu'elle constatait que le salarié avait toujours accompli son travail à Aulnay-sous-Bois, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Les règles sociales du droit du travail sont celles du lieu de l'exercice du contrat de travail par le salarié quelque soit la nationalité de l'employeur. Un conseil de prud'homme italien qui se déclare incompétent pour examiner le contrat de travail d'une italienne employée par l'école française viole la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme pour non accès à un tribunal au sens de l'article 6-1.
SI L'EMPLOYEUR EST FRANCAIS ET QU'IL DETACHE UN SALARIE EN EUROPE
LA CONVENTION DE ROME ET LE DROIT DE L'ETAT QUI ACCUEILLE LE SALARIE S'APPLIQUE
Arrêt de la CEDH Guadagnino contre Italie et France du 18/01/2011 requête 2555/03
La requérante, Marianna Guadagnino est une ressortissante italienne, née en 1936 et résidant à Rome. Elle travailla de 1969 à 1996 à l’Ecole française de Rome (l’Ecole) comme assistante au service des publications, sur la base de contrats individuels conclus avec le ministère français de l’Education Nationale. Ces contrats prévoyaient l’application de la loi italienne au rapport de travail de Mme Guadagnino.
Mme Guadagnino initia deux procédures juridictionnelles en Italie, en lien avec cet emploi.
La première procédure tendait à la reconstitution de sa carrière. N’ayant pas obtenu de l’Ecole un reclassement dans une catégorie supérieure auquel elle prétendait, elle saisit le tribunal d’instance de Rome en décembre 1995 pour faire constater le bien-fondé de sa demande et obtenir le paiement de la différence entre les rétributions qu’elle avait perçues et celles auxquelles elle soutenait avoir droit. L’Ecole répliqua que la compétence pour juger ce litige appartenait aux juridictions françaises et non italiennes. La Cour de cassation italienne confirma, le 20 juin 1997, que les juridictions italiennes n’avaient pas compétence dans cette affaire (le fait que le droit italien s’appliquait au contrat n’étant pas significatif à cet égard).
La deuxième procédure initiée par Mme Guadagnino tendait à contester le licenciement dont elle fit l’objet en 1996, au motif qu’elle avait atteint la limite d’âge de 60 ans. Arguant que la limite d’âge fixée par le droit italien était de 65 ans et non 60, en septembre 2007 elle assigna l’Ecole devant le tribunal d’instance de Rome afin d’obtenir l’annulation du licenciement et sa réintégration à son poste, ainsi que le paiement de certaines rétributions. La Cour de cassation italienne déclara à nouveau le juge italien incompétent, s’agissant des demandes relatives à la légitimité du licenciement ; elle souligna que selon sa jurisprudence constante, les procédures concernant le personnel des institutions culturelles de France relevaient du juge français. Concernant le paiement de rétributions en revanche, le juge italien était compétent. Malgré cela, Mme Guadagnino ne reprit pas la procédure devant le tribunal d’instance italien.
En juillet 2001, Mme Guadagnino saisit le Conseil d’Etat français de demandes portant sur la reconstitution de sa carrière et l’annulation de son licenciement (y inclus le paiement de rétributions). Le Conseil d’Etat rejeta ses demandes, jugeant que les juridictions administratives françaises n’avaient pas compétence dans ces affaires.
Précision concernant le droit français :
Selon le Tribunal des Conflits français, le juge judiciaire est seul compétent pour décider des litiges relatifs à l’exécution et à la rupture de contrats de travail internationaux conclus par les services de l’Etat (Mme Guadagnino et les gouvernements défendeurs n’ayant pas contesté cela). Plus précisément, la compétence des juridictions prud’homales françaises est posée par le code civil français (article 15) et a été affirmée par la Cour de cassation en 1996.
Irrecevabilité de la requête concernant la France
La Cour constate que selon la jurisprudence française (Tribunal des conflits et Cour de cassation), les juridictions prud’homales françaises sont compétentes s’agissant de l’exécution et de la rupture de contrats internationaux de travail conclus par l’Etat français (même si ces contrats ne sont pas régis par le droit français).
Certes, il est regrettable que les contrats de travail de Mme Guadagnino - ou d’ailleurs les accords conclus entre la France et l’Italie lors de la création de l’Ecole française de Rome - aient été muets sur la question de la compétence juridictionnelle en cas de litige. Il n’en demeure pas moins que Mme Guadagnino disposait d’une voie de recours efficace en France et qu’elle n’en a pas fait usage.
La condition de recevabilité selon laquelle il faut épuiser les voies de recours disponibles dans un Etat avant de pouvoir saisir la Cour contre cet Etat (article 35) n’est donc pas réalisée.
Grief tiré de l’article 6 § 1 contre l’Italie
La Cour relève d’emblée que la Cour de cassation italienne avait jugé les juridictions italiennes compétentes pour trancher la question du paiement de rétributions, mais que Mme Guadagnino s’est abstenue de poursuivre la procédure sur ce point en Italie. Elle ne saurait donc soutenir que cette situation a emporté une violation de la Convention.
Il reste pour la Cour à déterminer si le droit d’accès de Mme Guadagnino à un tribunal a été violé du fait que la Cour de cassation italienne a estimé les juges italiens incompétents pour trancher ses autres demandes, tendant à la reconstitution de carrière et à l’annulation du licenciement.
Ainsi, conformément à sa jurisprudence, la Cour recherche si la limitation au droit d’accès à un tribunal voulue par la Cour de cassation poursuivait un but légitime, et si elle était proportionnée au but poursuivi.
Elle estime que la première condition (but légitime) était remplie, car le fait que la Cour de cassation italienne se soit abstenue de juger la présente affaire en ce qu’elle impliquait la France avait pour but de respecter le droit international - qui vise lui-même à favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats par le respect de la souveraineté d’un autre Etat. S’agissant de la deuxième condition (proportionnalité), la Cour rappelle toutefois avoir déjà constaté qu’en réalité, le droit international limite toujours davantage « l’immunité juridictionnelle » des Etats dans les litiges portant sur des questions liées à l’emploi de personnel. En particulier, selon la Convention (Nations-Unies) de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, que l’Italie est tenue de respecter en vertu du droit international, les procédures se rapportant à des contrats de travail conclus entre un Etat et des personnes physiques pour un travail accompli sur le territoire d’un autre Etat échappent à la règle de l’immunité des Etats, dès lors que les intérêts supérieurs de l’Etat employeur ne sont pas mis en cause. Or, l’Italie n’a pas respecté cette règle. Elle a par conséquent disproportionnément restreint l’accès à un tribunal auquel Mme Guadagnino avait droit.
La Cour en conclut, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 a été violé par l’Italie.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE DU 18 JANVIER 2011 N° Pourvoi 09-43190 CASSATION
Mais attendu que si l'article 3 de la Directive 96/ 71/ CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services désigne les conditions de travail et d'emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l'Etat membre où la prestation de travail est exécutée, celle-ci n'exclut pas l'application de la loi désignée par la Convention de Rome pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail qui ne font pas partie des règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d'accueil
Attendu que pour dire que la loi française est applicable à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'article 6 de la convention de Rome doit être appliqué au regard du contrat en cause, conclu à durée déterminée pour une durée d'un an, peu important les missions de même nature accomplies par M. X... pendant des périodes antérieures, qu'il est constant que dans le cadre de ce contrat de travail, il a accompli son travail de façon exclusive en France, sur le site Airbus de Toulouse, et qu'il s'ensuit que par application de l'article 6 § 2 a), le contrat est régi par la loi française
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait été détaché par une entreprise établie en Grande-Bretagne pour être mis temporairement à la disposition d'une société qui exerçait son activité en France, ce dont elle aurait dû déduire qu'il n'y avait pas accompli habituellement son travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 § 2 a) de la Convention de Rome du 19 juin 1980
LA PROCÉDURE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'employé peut faire une prise d'acte. Si elle est justifiée, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sinon c'est une démission.
Cour de cassation chambre sociale, arrêt du 25 novembre 2015 N° de pourvoi: 14-21272 Rejet
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait légitimement exercé son droit de retrait, peu important qu'il ait obtenu l'accord de son employeur pour quitter son poste de travail, et que l'un des reproches formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement reposait sur l'exercice de ce droit de retrait, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués, que le licenciement était nul ; que le moyen n'est pas fondé
Un affrontement violent entre deux cadres, justifie une prise d'acte.
Cour de cassation chambre sociale, arrêt du 23 janvier 2013 N° de pourvoi: 11-18855 CASSATION PARTIELLE
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, intervenue 21 mois après les faits, produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne revêt pas, compte tenu de l'existence d'un affrontement entre deux salariés titulaires de postes de direction, un caractère de gravité de nature à justifier la prise d'acte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LA PRESCRIPTION EST DE DEUX OU CINQ ANS
Article L. 1471-1 du code de travail
Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du
contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail,
aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font
obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L.
1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
COUR DE CASSATION chambre civile 2 arrêt du 9 mars 2017 pourvoi n° 15-26064 Rejet
Mais attendu que les dispositions de l'article 34, alinéa 1er , du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel
dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la
majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les
indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages ;
Et attendu qu'ayant retenu que Mme X..., victime d'un accident du travail survenu sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie est fondée à demander à
l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation des souffrances endurées (pretium doloris) et du déficit fonctionnel temporaire qui
ne sont pas couverts par l'article 34 du décret précité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
L'article L 3245-1 du Code de Travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans.
L'article L. 1134-5 du Code de Travail prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
L'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE, 5 octobre 2010, pourvoi n° 09-41492, Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 2009), que M. X... et sept autres salariés, employés par la Société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH) en qualité de chef mécanicien ou de matelot, ont, le 28 septembre 2007, saisi le tribunal d'instance de demandes d'indemnité de nourriture fondées sur le code du travail maritime, pour une période comprise entre décembre 2005 et mai 2007 (-)
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 110-4, II, 1° du code du commerce, qui concerne les livraisons de nourriture
faites aux armateurs, ne s'applique pas à l'action d'un marin aux fins de paiement d'une indemnité de nourriture ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que cette indemnité
devait être assimilée à un salaire et en a justement déduit que l'action des marins était soumise à la prescription quinquennale en application des articles
2277 ancien du code civil et L. 110-4, III, du code du commerce
Cour de cassation chambre civile 2 du 28 avril 2011 N° de pourvoi: 10-17886 CASSATION
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale
Attendu que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant interrompue, en application de ce texte, par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier 1998, Daniel X..., salarié de la société CMB Y...(la société), a été victime d'un accident mortel du travail ; que M. Y..., en sa qualité de dirigeant de la société, a été condamné pénalement par un arrêt du 6 mai 2003, devenu définitif après le rejet de son pourvoi par une décision de la Cour de cassation du 20 janvier 2004
Attendu que pour déclarer recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduite, le 28 janvier 2008, par Mme Z... ..., après avoir relevé que le délai de prescription biennale a été interrompu, le 4 avril 2001, par l'exercice de l'action pénale diligentée par le procureur de la République à l'encontre de M. Y..., pour les mêmes faits que ceux objet de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, pour prendre fin au 20 janvier 2004, date à laquelle la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. Y...à l'encontre des dispositions pénales et civiles de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2003, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme Z... ... ait été partie ou appelée en cause à cette l'instance, ni que la décision de non-admission lui ait été notifiée ou portée à sa connaissance, de sorte que le délai de prescription n'ayant jamais recommencé à courir à son encontre, son action n'est pas prescrite
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Cour de Cassation 2eme Chambre civile arrêt du 31 mai 2012 requête 11-13814 Rejet
Mais attendu, d'une part, qu'il
ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait fait
valoir que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute
inexcusable de la société n'avait pas commencé à courir du fait qu'il n'avait
pas eu connaissance de la cessation du paiement des indemnités journalières
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2
du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale
opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses
ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les
mêmes faits ; que ne constitue pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une
plainte entre les mains du procureur de la République
Que l'arrêt énonce qu'une plainte, même déposée auprès de ce dernier, ne
constitue pas l'exercice de l'action publique ; qu'il retient que le délai de
prescription biennale, prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité
sociale, ayant commencé à courir, le 17 avril 2000, date de fin de perception
des indemnités journalières, n'a été interrompu, ni par la citation à
comparaître devant le tribunal correctionnel, délivrée, le 23 septembre 2003, au
dirigeant de la société, ni par la saisine de la caisse, le 10 novembre 2005
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement
décidé que l'action de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, engagée le 9 février 2007, était prescrite.
L'EMPLOYÉ DOIT PROUVER LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 9 décembre 2010 N° de pourvoi: 09-72667 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2009), que M. X..., employé en
qualité de conducteur routier par la société Transports Jacques Y..., placée
ultérieurement en redressement judiciaire et bénéficiaire d'un plan de
continuation, a été victime d'un accident du travail le 7 février 2002 ayant
entraîné des arrêts de travail jusqu'au 26 juin 2002 ; qu'il a subi deux
rechutes, déclarées les 10 octobre 2002 puis le 18 juin 2003, et a été consolidé
le 19 juillet 2004 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une
demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en faisant
valoir que celui-ci n'aurait pas respecté les prescriptions du médecin du
travail relatives à l'aménagement de son poste de travail, et que les rechutes seraient dues à cette carence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que les
rechutes ne sont pas dues à la faute inexcusable de son employeur et de le
débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
Mais attendu que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'ouvre droit
à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que
lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur
D'où il suit que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute
inexcusable de l'employeur à l'origine de la rechute, et non de l'accident de
travail, dont le salarié a été victime, est inopérant.
Cour de cassation chambre sociale, arrêt du 10 octobre 2012 Pourvoi N° 11-15296 REJET
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le contrat de travail pouvait prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur ;
Et attendu qu'ayant rappelé que le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permettait pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels il se comparait, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision
Cour de cassation chambre sociale, arrêt du 24 avril 2013 Pourvoi N° 11-28398 Cassation partielle
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre
d'indemnité pour défaut de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis, de
congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du droit individuel à la
formation l'arrêt retient que dès le lendemain de sa lettre de démission, la
salariée a formulé des reproches à son employeur, confirmés dans un second mail
quelques jours plus tard, privant ainsi sa démission du caractère clair et non
équivoque nécessaire pour lui donner son plein effet ; que dès lors, il convient
de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée remettait en cause sa
démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, qu'il
résultait de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la
date où elle avait été donnée celle-ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Le droit de grève est un principe constitutionnel :
L'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Ce principe est limité par les les lois et la jurisprudence
Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 9 mai 2012 pourvois N° 10-26497 10-26499 10-26503 cassation partielle
Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une faute lourde, les arrêts retiennent d'une part que M. X... s'est placé à deux reprises devant un camion pour interdire le passage, a fait obstacle à un autre camion allant chercher une remorque et a empêché le directeur du site d'enlever des barricades obstruant le passage des camions, d'autre part que M. Y... a bloqué un camion, s'est placé devant trois autres camions pour faire obstacle à leur passage et a fait savoir au directeur du site " qu " il ne sert à rien de tenter de faire passer des camions " et, enfin, que M. Z... a empêché un camion d'avancer et un autre de reprendre une remorque ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que le blocage d'un camion entravait le travail des salariés ne participant pas au mouvement de grève ou qu'il entraînait une désorganisation de l'entreprise, faute d'autre accès aux locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Mais le principe est le droit de grève
Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 4 juillet 2012 pourvoi N° 11-18404 rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2011) que le
syndicat CGT Transports Kéolis Bordeaux a déposé un préavis pour une grève
devant débuter le 6 novembre 2010 et s'achever le 31 décembre 2010 au sein de la
société Kéolis Bordeaux qui gère le réseau des transports publics de la
Communauté urbaine de Bordeaux ; que la grève a commencé le 6 novembre 2010 ;
que, le 15 novembre, il n'y avait plus qu'un seul salarié gréviste ; qu'aucun
gréviste n'était déclaré pour les journées des 16, 17 et 18 novembre 2010 ; que
la société Kéolis, par acte d'huissier en date du 25 novembre 2010, a fait
assigner le syndicat aux fins de faire juger que le mouvement de grève avait
pris fin le 14 novembre 2010, un seul salarié étant déclaré gréviste le 15
novembre 2010 et aucun par la suite, et que, depuis, la grève était illicite ;
Attendu que la société Kéolis Bordeaux fait grief à l'arrêt de rejeter cette
demande
Mais attendu d'abord que si, dans les services publics, la
grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si
ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de
l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne
sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le
préavis ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé
que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la
constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette
décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant
déposé le préavis de grève ;
Attendu ensuite que ni la durée du mouvement de grève ni l'existence d'une
pluralité de motifs ne pouvant suffire à caractériser en elles-mêmes une fraude,
la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément pour
démontrer que l'exercice du droit de grève aurait eu un caractère abusif, en a
exactement déduit que le caractère illicite du mouvement n'était pas établi
Créer un syndicat pour faire grève n'est pas interdit
Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 4 juillet 2012 pourvoi N° 11-10793 cassation
Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du
travail ;
Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
la cour d'appel retient que le salarié faisait partie du comité de direction de
la société et que son poste se situait parmi les plus importants de la
hiérarchie, qu'il disposait ainsi, notamment dans le cadre restreint et discret
du comité de direction, des moyens de faire entendre sa voix sur la question de
la mise en œuvre de la restructuration en cours, sans porter préjudice à son
employeur et dans le respect de l'obligation de loyauté renforcée à laquelle il
était soumis en sa qualité de cadre dirigeant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement
reprochait au salarié la création du syndicat UNSA-Scutum à laquelle il avait
participé ainsi qu'un défaut de loyauté pour avoir tardé à informer la direction
de la création de ce syndicat et de sa participation à son bureau exécutif, ce
dont il résultait que le salarié apportait des éléments de fait laissant
supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes
susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail;
Attendu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de
celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions
justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but
recherché peuvent être apportées;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a encore retenu que
le tract du 1er juin 2006 rédigé sur papier à en-tête de l'UNSA-Scutum mentionne
: "l'angoisse, le stress, la méfiance et les incertitudes des uns et des autres
et ce, face aux rumeurs et autres restructurations tant sournoises
qu'hasardeuses, nous ont conduit à la création d'un syndicat autonome
d'entreprise", que les adjectifs utilisés pour qualifier la restructuration «
hasardeux » et surtout « sournois » sont clairement péjoratifs et injurieux
envers la direction qui l'a décidée, la circonstance que ces critiques émanent
d'un cadre qui était jusque là impliqué dans la conception et la mise en oeuvre
de ce projet et qui en connaissait donc les tenants et les aboutissants, ce qui
renforçait le poids de ses critiques, étant de nature à créer ou à nourrir la
défiance des salariés envers la direction de l'entreprise, et que M. X... a
donné à son action le maximum de publicité en affichant ou faisant afficher ce
tract dans les deux établissements de Toulouse et de Cergy et en s'en
entretenant avec certains salariés pendant les heures de travail et sur les lieux de travail;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affichage de ce tract syndical, qui ne
contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisait pas
un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LES SALARIES DOIVENT INFORMER L'EMPLOYEUR DES CAUSES DE LA GRÈVE
Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 30 juin 2015, pourvoi n° 14-11077 REJET
Mais attendu que l'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il
nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu
important les modalités de cette information ;
Et attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que l'employeur avait été tenu dans l'ignorance des motifs de l'arrêt de travail, à savoir le
versement d'un acompte sur le treizième mois, et n'avait été informé de cette revendication qu'en demandant aux intéressés les raisons du blocage des portes
de l'entreprise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié initiateur de ces faits ne pouvait se prévaloir de la protection attachée au droit de grève
L'OBLIGATION D'UN SERVICE PUBLIC MINIMUM NE PEUT PAS INTERDIRE UN DROIT DE GRÈVE
Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 30 juin 2015, pourvoi n° 14-10764 Cassation
Vu l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre
1946, ensemble l'article L. 1222-4 du code des transports ;
Attendu que l'obligation légale faite à l'employeur, entreprise chargée d'un
service public de transport terrestre de personnes, d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne
peut permettre de limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de
négocierAttendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt retient d'une part que l'éclatement complet sur tous les parcours des lignes de bus et de tramway
déployées sur plus d'une dizaine de communes, à des horaires différents chaque jour de la semaine et les arrêts de travail renouvelés sur 55 minutes entraînent
une perturbation complète du trafic des tramways, empêchent l'employeur de prévoir les lieux où les autobus seraient laissés en stationnement pendant les
arrêts de travail et de s'assurer des conditions dans lesquelles les grévistes reprendraient leur activité à l'issue de ceux-ci, et ne lui permettent pas de
disposer des éléments nécessaires à l'élaboration d'un plan de transports et d'information des usagers et d'assurer ainsi le service minimum dû aux usagers
en vertu de la loi et d'autre part, que les troubles générés qui contraignent les passagers à descendre des véhicules en cours de trajet avant d'avoir atteint
leur destination, ne doivent pas être mésestimés s'agissant de jeunes cherchant à rejoindre un établissement scolaire ou leur domicile et de personnes âgées ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une désorganisation de l'entreprise et alors que l'empêchement pour l'employeur,
résultant des modalités de la grève définies dans un préavis régulier, d'organiser un plan de transport et d'information des usagers ne constitue pas
un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés
La LOI n° 2012-375 du 19 mars 2012 prévoit que le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien
Section 1 Champ d'application
Article L. 1114-1 du Code des Transports
Le présent chapitre est applicable, lorsqu'ils concourent directement à l'activité de transport aérien de passagers, aux entreprises, établissements ou parties d'établissement qui exercent une activité de transport aérien ou qui assurent les services d'exploitation d'aérodrome, de la sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l'incendie, de lutte contre le péril animalier, de maintenance en ligne des aéronefs ainsi que les services d'assistance en escale comprenant le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications, le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement, l'assistance aux passagers, l'assistance des bagages, l'assistance des opérations en piste, l'assistance du nettoyage et du service de l'avion, l'assistance du carburant et de l'huile, l'assistance d'entretien en ligne, l'assistance des opérations aériennes et de l'administration des équipages, l'assistance du transport au sol et l'assistance du service du commissariat.
Section 2 Dialogue social et prévention des conflits
Article L. 1114-2 du Code des Transports
I. ― Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail,
dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement entrant dans
le champ d'application du présent chapitre, l'employeur et les organisations
syndicales représentatives peuvent engager des négociations en vue de la
signature d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des
conflits et tendant à développer le dialogue social. En application de cet
accord, l'exercice du droit de grève ne peut intervenir qu'après une
négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales
représentatives qui envisagent de recourir au droit de grève. L'accord-cadre
fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces
règles doivent être conformes aux conditions posées au II.
II. ― L'accord-cadre détermine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles la ou les organisations syndicales
représentatives procèdent à la notification à l'employeur des motifs pour
lesquels elles envisagent de recourir à l'exercice du droit de grève ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est
tenu de réunir la ou les organisations syndicales représentatives qui ont
procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'employeur et la ou les organisations syndicales
représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la
négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours
francs à compter de la notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur à la ou aux
organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en
vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai
dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre la ou les
organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et
l'employeur se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation
préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du
conflit, de la position de l'employeur, de la position de la ou des
organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification
ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé
de conclusions de la négociation préalable.
Section 3 Exercice du droit de grève
Article L. 1114-3 du Code des Transports
En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement,
les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la
réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de
participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de
leur intention d'y participer.
Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui
renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre
heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci
puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a
pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service
en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa
reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n'est pas
requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
Par dérogation au dernier alinéa du présent article, les informations issues
de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l'application de
l'article L. 1114-4.
Sont considérés comme salariés dont l'absence est de nature à affecter
directement la réalisation des vols les salariés des exploitants d'aérodrome
et des entreprises, établissements ou parties d'établissement mentionnés à
l'article L. 1114-1 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui
assurent personnellement l'une des opérations d'assistance en escale
mentionnée au même article L. 1114-1, de maintenance en ligne des aéronefs, de
sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l'incendie ou de lutte
contre le péril animalier.
Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne
peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève
en vue d'en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret
professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute
personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de
l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article L. 1114-4 du Code des Transports
Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1114-3. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre du salarié qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.
Article L. 1114-5 du Code des Transports
Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-9 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l'article L. 1114-6 du présent code.
Article L. 1114-6 du Code des Transports
Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs de la grève et portant sur la poursuite de celle-ci. Les conditions du vote sont définies par l'employeur dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
Section 4 Information des passagers
Article L. 1114-7 du Code des Transports
En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d'établissement entrant dans le champ d'application du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
Recherchez les nouveaux indices et le SMIC : http://www.insee.fr/
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.