Pour plus de sécurité, fbls pyramide des juridictions françaises est sur : https://www.fbls.net/pyramidejuridictions.htm
"La pyramide des juridictions commence par la CJUE
puisque nous sommes un domaine juridique
intégré."
Frédéric Fabre docteur en droit.
 Cliquez sur un bouton ou un lien bleu pour accéder gratuitement aux informations juridiques gratuites sur :
Cliquez sur un bouton ou un lien bleu pour accéder gratuitement aux informations juridiques gratuites sur :
- LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
- LA HAUTE COUR DE JUSTICE DEVENUE LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
- LES HAUTES JURIDICTIONS FRANÇAISES
- LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
- LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES NON PÉNALES
- LES JURIDICTIONS PÉNALES
- LES JURIDICTIONS CIVILES D'ATTRIBUTION
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances et pour un tarif modique, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
 Cliquez
sur le bouton pour accéder au site de la Cour de justice de l'Union Européenne de Luxembourg
Cliquez
sur le bouton pour accéder au site de la Cour de justice de l'Union Européenne de Luxembourg
Elle n'est pas accessible directement au justiciable mais indirectement en posant une question préjudicielle à la juridiction qui doit le juger.
Sa compétence est limitée d'une part aux conflits entre les institutions européennes et leurs fonctionnaires et d'autre part sur l'application des traités par les Etats signataires.
Aucun justiciable ne peut la saisir directement. Seul les Etats peuvent la saisir, soit les autorités gouvernementales qui se plaignent de la pratique d'un autre Etat ou d'une décision de la Commission soit les juridictions internes des Etats, dans le cadre d'une question préjudicielle, avant de statuer au fond.
Le justiciable doit dès la première instance, faire connaître sa volonté de demander la saisine de la C.E.J. Les juridictions l'invitent alors à saisir la plus haute juridiction française à qui appartient finalement la décision de saisir ou non la C.E.J.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 17 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-12442 REJET
Attendu que la société Refcomp fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un fabricant de son exception
d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions italiennes, invoquée contre l'assureur subrogé dans les droits du
sous-acquéreur, en application d'une clause attributive de compétence convenue avec un fabricant intermédiaire alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat initial et désignant un tribunal d'un Etat contractant, prime
les compétences spéciales des articles 5 et 6 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 et est opposable au tiers au contrat initial la contenant dès lors
que, en vertu du droit national applicable, ce dernier succède à l'une des parties originaires dans ses droits et obligations ; qu'en déclarant non
opposable à l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur
intermédiaire au prétexte que les règles communautaires de compétence spéciale en matière contractuelle ne s'appliquaient pas aux litiges opposant le
sous-acquéreur d'une chose au fabricant qui n'était pas le vendeur, de tels litiges se rattachant à la matière délictuelle ou quasi délictuelle, la cour
d'appel a violé, par refus d'application, l'article 23 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 et, par fausse application, les articles 5-1 et 5-3 du même règlement ;
2°/ qu'une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat originaire, est opposable au tiers à ce contrat ou à
l'assureur subrogé dès lors que, en vertu du droit national applicable, le tiers a succédé au vendeur originaire dans ses droits et actions ; qu'en déclarant non
opposable à l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de compétence convenue entre les parties au contrat originaire pour
la raison qu'il ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, ensemble les articles 1165 et 1250 du code civil ;
Attendu que le litige présente des questions d'interprétation du règlement 44/2001 du 20 décembre 2000, qui nécessitent, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne
Cliquez sur le bouton pour accéder au site du Conseil Constitutionnel
Il n'est pas accessible directement au justiciable mais indirectement en posant une question préjudicielle à la juridiction qui doit le juger.
Le Conseil Constitutionnel a d'abord pour rôle de constater si la loi nouvelle est conforme à la constitution. Il est saisi par les parlementaires avant la promulgation de la loi. Aucun justiciable ne peut le saisir directement.
La loi organique du 10 décembre 2009 applicable à partir du 11 mars 2010, ne prévoit pas davantage, qu'un justiciable puisse le saisir directement mais le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation quand un particulier soulève devant une juridiction, une question prioritaire de constitutionnalité. La question du justiciable est alors soumise à deux contrôles:
D'abord celui de la juridiction devant laquelle, le moyen est soulevé. Cette juridiction décide si le moyen est suffisamment sérieux pour être transmis à la Cour de Cassation ou au Conseil d'Etat.
Ensuite, la haute cour ainsi saisie doit décider de le transmettre au non au Conseil constitutionnel.
HAUTE COUR DE JUSTICE ET LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
La haute Cour de justice et la Cour de justice de la République sont aussi des juridictions particulières chargées de juger le Président de la République et les membres du Gouvernement.
La Composition de la Cour de justice de la République au 20 décembre 2021
La Composition de la Cour de justice de la République au 6 novembre 2020
La Composition de la Cour de justice de la République au 17 décembre 2019
AFFAIRE DE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 NON DECLAREE ASSEZ VITE
Cour de cassation Assemblée plénière arrêt du 26 avril 2022 pourvoi n° 21-86.158 cassation
Mme [L] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la
commission d'instruction de la Cour de justice de la République (commission
d'instruction) du 20 octobre 2021 qui, dans l'information suivie contre elle des
chefs de mise en danger d'autrui et abstention volontaire de combattre un
sinistre, a rejeté sa demande de modification d'une mission d'expertise.
Le pourvoi est examiné par l'assemblée plénière en application de l'article 24
de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la
République.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, la première présidente de la Cour de
cassation a prescrit l'examen immédiat du pourvoi et fixé au 20 décembre 2021
l'expiration du délai imparti à la SCP Waquet, Farge et Hazan pour déposer un
mémoire.
Mme [L] [T] invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation
annexés au présent arrêt.
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de
cassation le 17 décembre 2021 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme
[T].
Le rapport écrit de Mme Leprieur, conseiller, et l'avis écrit de M. Desportes,
premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, assistée de M. Dureux, auditeur au
service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP
Waquet, Farge et Hazan, l'avis de M. Desportes, auquel la SCP Waquet, Farge et
Hazan, invitée à le faire, a répliqué, après débats en l'audience publique du 18
mars 2022 où étaient présents, Mme Arens, première présidente, Mme Mouillard,
MM. Pireyre, Soulard, Cathala, Mme Teiller, présidents, Mme Duval-Arnould, doyen
de chambre faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur,
MM. Rémery, Huglo, Maunand, Mme de la Lance, doyens de chambre, Mmes
Taillandier-Thomas, Auroy, conseillers faisant fonction de doyens de chambre,
Mmes Durin-Karsenty, Antoine, Van Ruymbeke, Boisselet, Abgrall, conseillers, M.
Desportes, premier avocat général, Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,
la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première
présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités,
et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
FAITS
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui
suit.
2. Le 3 juillet 2020, la commission des requêtes de la Cour de justice de la
République a transmis au procureur général près la Cour de cassation, ministère
public près la Cour de justice de la République, des plaintes émanant de
médecins, de syndicats et de particuliers, relatives à la gestion
gouvernementale de la pandémie de Covid-19, aux fins de saisine de la commission
d'instruction du chef d'abstention de combattre un sinistre, à l'encontre de M.
[F] [S], premier ministre, de Mme [L] [T], ancienne ministre des solidarités et
de la santé, et de M. [P] [M], ministre des solidarités et de la santé.
3. Par réquisitoire du 7 juillet 2020, le procureur général a requis la
commission d'instruction d'informer, à l'encontre de M. [S], de Mme [T] et de M.
[M], du chef d'abstention de combattre un sinistre, délit prévu et réprimé par
l'article 223-7 du code pénal, faits commis à [Localité 1], courant 2019 et
2020.
4. A la suite d'autres plaintes, notamment celle de M. [X] [H], consécutive au
décès de sa compagne, [V] [Z], des suites, selon le plaignant, d'une infection
par le virus SARS-CoV-2, des réquisitoires supplétifs ont été pris aux fins
d'informer contre les mêmes personnes, du même chef.
5. Mme [T] a été mise en examen, le 10 septembre 2021, par la commission
d'instruction du chef de mise en danger d'autrui et placée sous le statut de
témoin assisté du chef d'abstention volontaire de combattre un sinistre.
6. Par ordonnance du 4 octobre 2021, la présidente de la commission
d'instruction a commis des experts aux fins de procéder à l'examen du dossier
médical de [V] [Z] et répondre à diverses questions.
7. Le 14 octobre 2021, Mme [T] a saisi la commission d'instruction, sur le
fondement de l'article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, d'une
demande de modification ou de complément des questions posées aux experts.
Soutenant que la mission excédait le champ de la saisine in rem de la commission
d'instruction, elle a sollicité la suppression de l'ensemble des questions.
8. Par ordonnance du 20 octobre 2021, la présidente de la commission
d'instruction a rejeté la demande.
MOYENS
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de modification ou
de complément d'expertise et de confirmer la mission d'expertise initiale, alors
:
« 1°/ qu'aux termes des articles 18, 19, 21 et 22 de la loi organique n° 93-1252
du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, l'instruction doit
être menée collégialement au sein de la commission d'instruction ; en prenant
seul une ordonnance « pour la commission d'instruction », le président a excédé
ses pouvoirs et violé lesdits textes.
Réponse de la Cour
10. Selon l'article 18 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la
Cour de justice de la République, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le
chapitre 1er du titre 1er de cette loi, la commission d'instruction procède à
tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les
règles édictées par le code de procédure pénale et spécialement celles relatives
aux droits de la défense.
Ces pouvoirs sont exercés, jusqu'à la réunion de la commission d'instruction,
par le président de cette commission.
11. Selon l'article 21 du même texte, les auditions, interrogatoires et
confrontations des membres du gouvernement sont effectués par la commission
d'instruction.
12. L'article 22 du texte précité dispose que les décisions de caractère
juridictionnel sont rendues par la commission d'instruction après réquisitions
du procureur général.
13. Les travaux préparatoires de la loi organique révèlent que l'article 17 du
projet de loi, devenu l'article 18 de la loi, comportait un alinéa prévoyant que
« lorsqu'elle est saisie, la commission d'instruction peut commettre un de ses
membres qui a compétence pour prescrire sur tout le territoire de la République
tous les actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues
par le chapitre premier du titre troisième du livre premier du code de procédure
pénale ». Cet alinéa a été supprimé, afin, selon ce qu'il ressort des débats
parlementaires, d'éviter que la commission puisse confier à un seul de ses
membres l'examen de l'ensemble du dossier.
14. Par ailleurs, il s'induit de l'article 18 précité que la commission
d'instruction peut donner commission rogatoire à un officier de police
judiciaire ou à un juge d'instruction, dans les conditions prévues par le code
de procédure pénale, pour procéder aux actes d'information qu'elle estime
nécessaires, telle l'audition d'un témoin, non membre du gouvernement.
15. Par conséquent, il ne résulte pas des articles 18, 21 et 22 de la loi
organique du 23 novembre 1993 que tous les actes doivent être accomplis par la
commission d'instruction en formation collégiale.
16. Hors le cas visé par le second alinéa de l'article 18 précité, relatif aux
pouvoirs provisoires du président de la commission d'instruction jusqu'à la
première réunion de celle-ci, les actes d'administration judiciaire et les actes
d'instruction, autres que ceux prévus par les articles 21 et 22 dudit texte,
peuvent être effectués par l'un des membres de la commission d'instruction.
17. Le grief doit par conséquent être écarté.
Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième
branches
Enoncé du moyen
18. Le moyen fait le même grief à l'ordonnance, alors :
« 2°/ qu'à tout le moins, les décisions juridictionnelles doivent être prises de
façon collégiale par la commission d'instruction ; en statuant seul sur la
contestation de la mission des experts initiée par un mis en examen sur le
fondement de l'article 161-1 du code de procédure pénale, le président a excédé
ses pouvoirs et violé l'article 22 de la loi précitée ;
3°/ que les décisions de nature juridictionnelle ne peuvent être rendues par la
commission d'instruction qu'après réquisitions du procureur général ; en
l'absence de toutes réquisitions préalables à son prononcé, l'ordonnance ne
répond pas aux conditions essentielles de son existence légale et a été rendue
en violation de l'article 22 de la loi précitée. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 22 et 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur
la Cour de justice de la République :
19. L'assemblée plénière a jugé (Ass. plén., 21 décembre 2021, pourvoi n°
21-85.560, publié au bulletin) qu'il résulte des articles 18, 22 et 24 de la loi
organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, éclairés
par les travaux préparatoires de cette loi, que les décisions de caractère
juridictionnel rendues par la commission d'instruction, juridiction collégiale
unique, qui exerce à la fois les fonctions d'instruction et de contrôle de
l'instruction, sont des arrêts qui ne peuvent faire l'objet que de pourvois en
cassation portés devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
20. Il résulte des articles 22 et 24 de la loi organique du 23 novembre 1993,
éclairés par ses travaux préparatoires et par l'arrêt précité, que les décisions
de caractère juridictionnel doivent être rendues, par arrêts, par la commission
d'instruction statuant en formation collégiale, après réquisitions du procureur
général.
21. La présidente de la commission d'instruction a statué seule, par ordonnance,
sur une demande de modification ou de complément des questions posées à des
experts, formée par la personne mise en examen sur le fondement de l'article
161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et sans que le procureur général
ait pris des réquisitions.
22. En statuant ainsi, la présidente de la commission d'instruction, qui a
excédé ses pouvoirs, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus
énoncé.
23. En effet, la décision rendue sur une demande de modification ou de
complément des questions posées à des experts, formée par la personne mise en
examen sur le fondement de l'article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure
pénale, qui tranche une contestation relative à la mission d'expertise, est une
décision de caractère juridictionnel.
24. L'annulation est par conséquent encourue de ce chef.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la commission
d'instruction de la Cour de justice de la République, en date du 20 octobre
2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la commission d'instruction de la Cour de
justice de la République autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du
greffe de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République et
sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le vingt-six avril deux mille vingt-deux.
AFFAIRE EDOUARD BALLADUR DIT "AFFAIRE KARACHI"
COUR DE CASSATION Assemblée Plénière arrêt du 13 mars 2020 Pourvoi N° 19-86.609 ; 18-80.162 ; 18-80.164 ; 18-80.165 rejet
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. En 1994, plusieurs contrats de coopération et d’assistance militaire ont été conclus entre la France et deux Etats, l’Arabie Saoudite d’une part, le Pakistan d’autre part, portant notamment sur le carénage et l’entretien de bâtiments militaires, la fourniture de missiles, la livraison de trois frégates, d’un pétrolier ravitailleur et de trois sous-marins. La conclusion de ces accords a été précédée de contrats de consultance liant la Direction des constructions navales internationales (DCNI) à des intermédiaires chargés de convaincre les autorités étrangères de traiter avec la France. Parallèlement, est venu se greffer un autre réseau, souvent dénommé « réseau K », regroupant trois personnes : M. AB..., M. J... et M. H..., auquel ont été versées des commissions.
3. Il est apparu que la participation de ces nouveaux intermédiaires pouvait avoir été inutile et n’avoir eu pour finalité que la mise en place de rétro-commissions. Au printemps 1996, les autorités françaises ont donné pour instructions d’interrompre le versement des commissions au « réseau K ».
4. Le 8 mai 2002, à Karachi (Pakistan), une voiture piégée lancée sur un autobus transportant notamment des salariés de la DCNI, travaillant à la construction d’un sous-marin, a explosé, entraînant la mort de quatorze personnes et faisant plusieurs blessés. Une information concernant ces faits a été ouverte le 27 mai 2002 au tribunal de grande instance de Paris. C’est au cours de cette information qu’a été mise en évidence l’existence possible d’infractions à caractère financier, justifiant l’ouverture d’une enquête puis d’une autre information judiciaire.
5. Les sommes versées au « réseau K » ont transité par des circuits financiers opaques et sur des comptes ouverts à Genève, Vaduz ou à Madrid, avant de faire l’objet d’importants retraits en espèces, tandis que, dans le même temps, le compte de l’Association pour le financement de la campagne d’A... X... (AFICEB) était alimenté par des versements de même nature, notamment, le 26 avril 1995, de 10 050 000 francs, somme identique à l’un des retraits précités.
6. Par une ordonnance du 12 juin 2014, les juges d’instruction ont renvoyé plusieurs personnes devant le tribunal correctionnel de Paris. Avant de clôturer leur information, par une ordonnance du 6 février 2014, ils se sont déclarés incompétents pour connaître des faits susceptibles d’être imputés, notamment, à M. X..., ces faits ayant pu avoir été commis par l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions de Premier ministre.
7. Le 19 juin 2014, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a émis un avis favorable à la saisine de la commission d’instruction de cette Cour. Le 26 juin 2014, le procureur général près la Cour de cassation a requis cette commission d’informer, notamment contre M. X..., en sa qualité de membre du Gouvernement, Premier ministre, sous les qualifications d’abus de biens sociaux, complicité et recel, détournement de fonds publics, complicité et recel.
8. M. X... a contesté toute illégalité dans le financement de sa campagne électorale.
9. Le 29 mai 2017, M. X... a été mis en examen pour avoir d’une part, concouru au sens de l’article 121-7 du code pénal, à la préparation et à la réalisation des abus de biens ou du crédit des sociétés DCNI et Sofresa, en donnant, alors qu’il avait autorisé l’exportation de matériels de guerre vers le Pakistan et l’Arabie Saoudite, des instructions, comme celle notamment du 1er décembre 1994 tendant à ce que le ministre du Budget, qui s’est exécuté le 19 décembre suivant, consente à ce que l’Etat donne sa garantie à hauteur de 485 millions de francs dans le contrat Mouette, déficitaire du fait des commissions versées, ou celle ayant conduit à l’arbitrage du 22 octobre 1994 qui a validé, sans que les directeurs du Trésor et du Budget n’aient été consultés, le sous-financement du contrat Sawari II, le découvert garanti ayant été porté à 1,812 milliard de francs pour trois frégates, d’autre part, bénéficié, au sens de l’article 321-1 du même code, des produits de ces délits.
10. Après cette mise en examen, M. X... s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu, le 28 septembre 2016, par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, se prononçant sur la prescription de l’action publique. Sa requête en admission immédiate du pourvoi a été acceptée. Par arrêt du 13 octobre 2017, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé son pourvoi irrecevable.
11. Entre le 22 septembre et le 28 novembre 2017, les avocats de M. X... ont saisi la commission de l’instruction de la Cour de justice de la République de trois requêtes tendant à ce qu’elle constate la prescription de l’action publique pour les faits déclarés non prescrits par l’arrêt du 28 septembre 2016, et à ce qu’elle prononce l’annulation de diverses pièces, notamment le procès-verbal de mise en examen de M. X....
12. Par trois arrêts du 21 décembre 2017, ladite commission a rejeté ces demandes.
13. M. X... a formé un pourvoi en cassation contre chacune de ces décisions. Le 30 janvier 2018, le premier président de la Cour de cassation a rendu trois ordonnances disant n’y avoir lieu à examen immédiat des pourvois.
14. Par arrêt du 30 septembre 2019, la commission d’instruction de la Cour de justice de la République a ordonné le renvoi de M. X... devant la formation de jugement de cette Cour des chefs de complicité et de recel d’abus de biens sociaux.
Sur le premier moyen dirigé contre l’arrêt n° 1 rendu le 21 décembre 2017 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République
Enoncé du moyen
15. Le moyen est pris de la violation des articles 68-1 de la Constitution et de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête de M. X... aux fins de nullité des actes et pièces de la procédure d’instruction de droit commun
Réponse de la Cour
17. Pour cantonner l’annulation prononcée aux documents concernant les revenus et les déclarations d’impôts de M. X... antérieurs à 1993, la commission d’instruction, après avoir rappelé les termes de l’article 68-1 de la Constitution et les limites posées par cet article, relève que les faits poursuivis, à les supposer avérés, s’inscrivent dans un mode opératoire complexe et ramifié, justifiant des investigations approfondies de la part des magistrats instructeurs, indispensables pour rechercher si la campagne présidentielle a été alimentée par certains financements occultes ou d’origine suspecte, et tirer les conséquences des vérifications entreprises à l’égard tant de M. X... que des autres personnes susceptibles d’être poursuivies.
18. Les juges ajoutent que les magistrats instructeurs, qui se devaient de procéder à ces investigations pour éviter une saisine indue, préjudiciable au requérant, devaient vérifier, d’une part, si une infraction pouvait être imputée à un ministre du Gouvernement français à l’époque de sa commission, d’autre part, si elle avait pu être commise dans l’exercice de ses fonctions.
19. En se déterminant ainsi, la commission d’instruction a justifié sa décision.
20. En effet, d’une part, selon l’article 68-1 de la Constitution, la compétence de la Cour de justice de la République est limitée aux actes constituant des crimes ou délits qui ont été commis par des ministres dans l’exercice de leurs fonctions et ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat, relevant de leurs attributions.
21. D’autre part, la commission d’instruction ne pouvait déclarer que les magistrats instructeurs parisiens étaient incompétents tant qu’ils n’avaient pas effectué les investigations de nature à leur permettre de vérifier cette compétence, dans le respect des dispositions de l’article 68-1 de la Constitution, avant de se dessaisir de la partie des faits pouvant impliquer M. X..., membre du Gouvernement, que celui-ci aurait accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
22. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.
Sur le deuxième moyen dirigé contre l’arrêt n° 2 rendu le 21 décembre 2017 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République
Enoncé du moyen
23. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 4, 6 et 11 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993, et 668 du code de procédure pénale.
24. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête en modification de la composition de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République
Réponse de la Cour
25. Pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X... tendant à ce que la requête en nullité de sa mise en examen soit examinée par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, statuant dans une composition différente de celle ayant prononcé cette mise en examen, le 29 mai 2017, la commission retient que la loi organique prévoit une disposition particulière pour la récusation qui n’a pas été mise en oeuvre.
26. Elle ajoute qu’elle n’a pas la maîtrise de sa propre composition, qui est déterminée conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi organique du 23 novembre 1993 et dont les membres titulaires ne sauraient se dessaisir au profit des trois membres suppléants sans commettre un excès de pouvoir.
27. Elle énonce enfin, qu’à la supposer recevable, cette demande n’aurait pu prospérer puisque la loi organique a attribué à la commission d’instruction le soin d’instruire et de statuer, sur requête ou même d’office, sur d’éventuelles nullités de sa propre procédure et institué un second degré de juridiction, le pourvoi porté devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, laquelle possède, en matière de nullités, pleine compétence pour statuer en fait et en droit.
28. En se déterminant ainsi, la commission de l’instruction a justifié sa décision.
29. En effet, ne méconnaît pas les garanties de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, l’arrêt de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République statuant sur la régularité des actes de l’information qu’elle a conduite, en application de l’article 23 de la loi organique du 23 novembre 1993, dès lors qu’elle se prononce sous le contrôle de l’assemblée plénière de la Cour de cassation ayant, en la matière, pleine compétence pour statuer en fait et en droit.
30. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.
Sur le troisième moyen dirigé contre l’arrêt n° 3 rendu le 21 décembre 2017 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
31. Le troisième moyen, en sa première branche, est pris de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
32. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête aux fins de constatation de la prescription de l’action publique formée par M. X...
Réponse de la Cour
33. M. X... ne saurait reprocher à la commission d’instruction de la Cour de justice de la République de s’être prononcée sur sa demande relative à la prescription de l’action publique dans la même composition que celle ayant rendu l’arrêt du 29 septembre 2016, dès lors que, s’il était nommément cité dans les réquisitions du ministère public et si l’arrêt s’est référé, notamment, à une note de ses conseils, la décision intervenue n’a pas été prononcée sur une demande de sa part et n’a pas, à son égard, autorité de chose jugée.
34. En conséquence, le moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen dirigé contre l’arrêt n° 3 rendu le 21 décembre 2017 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le quatrième moyen dirigé contre l’arrêt du 30 septembre 2019
Enoncé des moyens
35. Le troisième moyen, en ses troisième, quatrième et cinquième branches, est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 4, 6 et 11 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993, 668 du code de procédure pénale.
36. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête aux fins de constatation de la prescription de l’action publique formée par M. X...
37. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale.
38. Le moyen critique l’arrêt attaqué pour avoir dit non prescrits les faits de complicité et de recel d’abus de biens sociaux reprochés à M. X... et de l’avoir renvoyé de ces chefs devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République alors « qu’ainsi que le constate la décision de renvoi attaquée (p. 251), par un arrêt du 21 décembre 2017, la commission d’instruction de la Cour de justice de la République a rejeté la requête aux fins de constatation de la prescription de l’action publique formée par M. X... après avoir fixé le point de départ du délai de prescription des faits poursuivis devant elle au 21 septembre 2006 et relevé qu’à compter de cette date divers actes de poursuite et d’instruction avaient interrompu le délai de prescription ; que la cassation de cet arrêt actuellement frappé de pourvoi (n° G 18-80.165), qui interviendra sur le fondement du troisième moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt de renvoi en ce qu’il a dit non prescrits les faits de complicité et de recel d’abus de biens sociaux reprochés à M. X... et l’a renvoyé de ces chefs devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République. »
Réponse de la Cour
39. Les moyens sont réunis.
40. Pour écarter la prescription des infractions de complicité et de recel d’abus de biens sociaux dont elle était saisie, la commission d’instruction retient notamment que l’existence possible de ces infractions a été dissimulée et que le procureur de la République n’en a eu connaissance que le 21 septembre 2006. Elle ajoute que les révélations de membres du Conseil constitutionnel ne sont intervenues que postérieurement à cette date.
41. En se prononçant ainsi, la commission d’instruction a justifié sa décision pour les motifs suivants.
42. En premier lieu, le contrôle par le Conseil constitutionnel des recettes déclarées par le candidat n’exclut pas la dissimulation de leur origine, de sorte que la validation des comptes est, en l’espèce, sans effet sur le point de départ de la prescription de l’action publique.
43. En second lieu, la date de ce point de départ, appréciée par la commission, correspondait à celle à laquelle les infractions dissimulées étaient apparues dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, les déclarations ultérieures de membres du Conseil constitutionnel étant, à cet égard, sans incidence.
44. Les moyens doivent en conséquence, être écartés.
Sur le troisième moyen de cassation dirigé contre l’arrêt n° 3 rendu le 21 décembre 2017 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, pris en sa deuxième branche, et sur le cinquième moyen de cassation, dirigé contre l’arrêt du 30 septembre 2019, pris en ses deux premières branches
Enoncé des moyens
45. Le troisième moyen, en sa deuxième branche, est pris de la violation de l’article 62 de la Constitution.
46. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête aux fins de constatation de la prescription de l’action publique formée par M. X... alors « que, en application de l’article 62 de la Constitution, les décisions rendues par le Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu’en vertu de ce principe d’autorité absolue de chose jugée, la validation des comptes de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle par le Conseil constitutionnel fait obstacle à toute forme de répression pénale portant sur l’origine des recettes ayant fait l’objet de ce contrôle ;
47. Le cinquième moyen, en ses deux premières branches, est pris de la violation des articles 62 de la Constitution, 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, L. 52-12 du code électoral et 321-1 du code pénal.
48. Le moyen critique l’arrêt attaqué pour avoir écarté l’exception de chose jugée et ordonné le renvoi de M. X... devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République des chefs de complicité et recel d’abus des biens ou du crédit des sociétés DCN-l et Sofresa
Réponse de la Cour
49. Les moyens sont réunis.
50. Pour rejeter l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil constitutionnel publiée le 12 octobre 1995 (Cons. const., 11 octobre 1995, n° 95-91 PDR), ayant validé les comptes de la campagne présidentielle du demandeur, la commission d’instruction retient que l’exception de chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu’il existe une identité de cause, d’objet et de parties entre les deux poursuites et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
51. Elle souligne que la décision du Conseil constitutionnel concerne la validation de comptes de campagne et donc l’appréciation du caractère complet des justificatifs apportés aux dépenses et recettes constituant ledit compte mais ne revêt pas un caractère pénal, les poursuites entamées en ce domaine contre M. X... ne remettant pas en cause la décision des juges constitutionnels.
52. En se prononçant ainsi, la commission d’instruction a justifié sa décision.
53. En effet, en premier lieu, la validation des comptes de campagne, à la date de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, résultait d’un contrôle juridictionnel et l’autorité de la chose jugée de cette décision ne trouvait à s’appliquer qu’au regard des infractions prévues par l’article L. 113-1 du code électoral, sanctionnant l’absence de respect des obligations visées par ce texte et imposées à un candidat.
54. En second lieu, aucune dénonciation relative à l’existence d’infractions n’est intervenue auprès du ministère public à la suite dudit contrôle.
55. Les moyens doivent en conséquence, être écartés.
Sur le cinquième moyen de cassation dirigé contre l’arrêt du 30 septembre 2019, pris en ses autres branches
56. Le moyen, en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, est pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire du code de procédure pénale, 121-4 121-7 et 321-1 du code pénal.
57. Le moyen critique l’arrêt attaqué pour avoir écarté l’exception de chose jugée et ordonné le renvoi de M. X... devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République des chefs de complicité et recel d’abus des biens ou du crédit des sociétés DCN-l et Sofresa
Réponse de la Cour
58. Pour dire qu’il existe des charges suffisantes pour renvoyer M. X... devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République des chefs de complicité et de recel d’abus de biens sociaux, la commission d’instruction relève, notamment, l’existence d’instructions, qui n’avaient aucunement la nécessité d’être écrites, laissées en particulier à M. Y..., s’agissant des arbitrages rendus au bénéfice des membres du « réseau K » et approuvés par Matignon.
59. Elle énonce que M. X... a été avisé par M. Z... de l’existence de ce réseau, a laissé carte blanche à ses proches et ne peut soutenir n’avoir jamais cherché à savoir comment sa campagne serait financée, se sachant de surcroît en délicatesse avec son parti, le Rassemblement pour la République (RPR), dont M. Chirac était également le candidat.
60. Elle cite les nombreux témoignages dénonçant le caractère inutile du « réseau K » et retient que les versements des commissions, qui ont emprunté un circuit opaque utilisant des sociétés écrans, ont été anticipés au seul profit de ce réseau.
61. S’agissant du délit de recel d’abus de biens sociaux, les juges ajoutent que, le 21 avril 1995, trois versements en espèces ont été faits sur le compte de l’AFICEB, dont deux de 500 000 francs chacun, pour un montant total de 1 595 340 francs et que, le 26 avril 1995, deux versements ont été faits, l’un de 10 050 000 francs, l’autre de 200 000 francs, soit un total de 10 250 000 francs. Ils retiennent qu’il est démontré que, dans le même temps, des retraits ont été réalisés, sur les comptes suisses de MM. J... et K... pour 2 010 000 francs le 6 avril 1995, et 10 050 000 francs le 7 avril 1995, l’un des retraits étant exactement identique au versement réalisé le 26 avril sur le compte de l’AFICEB.
62. La commission ajoute que M. X... ne peut pas raisonnablement soutenir n’avoir jamais eu le moindre questionnement sur l’origine de fonds, spécialement en espèces, venus opportunément équilibrer ses comptes, dans des conditions ayant immédiatement attiré l’attention des rapporteurs du Conseil constitutionnel chargés d’en vérifier la régularité, le lien entre le versement de la somme de 10 250 000 francs et l’abondement des comptes de campagne étant évident, par le rapprochement entre les dates, le montant, l’origine suisse de cette somme et l’absence d’explication cohérente d’une autre origine.
63. En l’état de ces énonciations, procédant de l’appréciation souveraine des faits par la commission, l’arrêt n’encourt pas la censure.
64. En effet, la Cour de cassation, à qui il n’appartient pas d’apprécier la valeur des charges dont la commission a retenu l’existence à l’encontre de la personne mise en examen, n’a d’autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée par l’arrêt attaqué justifie la saisine de la Cour de justice de la République.
65. Le moyen doit en conséquence être écarté.
AFFAIRE CHRISTINE LAGARDE
COUR DE CASSATION Assemblée Plénière arrêt du 27 juillet 2016 Pourvoi N° 16-80133 rejet
REJET du pourvoi formé par Mme Christine X... née Y..., domiciliée ... Washington DC (Etats-Unis d'Amérique), contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, qui, pour le délit prévu et réprimé par les articles 432-16 et 432-17 du code pénal, l'a renvoyée devant cette Cour pour y être jugée ;
Le pourvoi a été renvoyé devant l'assemblée plénière en application de l'article 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993
sur la Cour de justice de la République ;
Mme Christine X... invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que Mme X..., en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique, avait la disposition de
fonds publics, relève des manquements dans leur surveillance qui constituent autant de charges à son encontre d'avoir commis des négligences et retient que
ces fautes ont rendu possible le détournement de fonds publics par des tiers ;
Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de leur appréciation souveraine des faits, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, la Cour de cassation, à qui il n'appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont la commission a retenu l'existence à l'encontre de la
personne mise en examen, n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée par l'arrêt attaqué, justifie la saisine de la Cour de justice de la République
CONSÉQUENCES DE L'AFFAIRE LAGARDE
BERNARD TAPIE ET AFFAIRE ADIDAS : Le lendemain de la nomination de François Bayrou en qualité de ministre de la justice, la Cour de Cassation rejette le pourvoi de Bernard Tapie. Il est condamné à rembourser 404 millions d'euros à l'État français.
Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 18 mai 2017 requêtes 15-2.683, 16-10.339 et 16-10.344
Pourvoi n° 15-28.683
Demandeur : Selafa MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme ; et autres
Défendeur : M. Bernard X... ; et autres
Pourvoi n° 16-10.339
Demandeur : SCI Financière et immobilière Bernard Tapie (FIBT)
Défendeur : société CDR créances, anciennement dénommée Société de banque occidentale ; et autres
Pourvoi n° 16-10.344
Demandeur : M. Bernard X... ; et autres
Défendeur : société CDR créances, anciennement dénommée Société de banque occidentale ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015), que M. X... et Mme Y..., son épouse, avaient organisé leurs activités et leur patrimoine en recourant à deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés, la société FIBT et la société GBT ; que tandis que la première regroupait les divers actifs patrimoniaux des époux, la seconde détenait la majorité du capital de la société anonyme Bernard Tapie finance (la société BTF SA), elle-même détentrice des participations industrielles du groupe et notamment de celle acquise en juillet 1990 et janvier 1991, par l’intermédiaire de la société allemande BTF GmbH et avec le concours financier de la Société de banque occidentale (la SDBO), dans le capital de la société Adidas ; que M. X... ayant décidé de cesser ses activités industrielles et commerciales, les sociétés GBT, FIBT et BTF SA ont, les 10 et 16 décembre 1992, conclu avec la SDBO un “mémorandum” puis une “lettre d’engagement” aux termes desquels la société BTF SA s’engageait de manière irrévocable à vendre, au plus tard le 15 février 1993 et pour un prix fixé à 2 085 000 000 francs, à toutes sociétés désignées par la SDBO et à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts représentant 78 % du capital de la société BTF GmbH ainsi qu’à affecter l’intégralité du prix à percevoir de cette cession au remboursement des concours ayant bénéficié aux trois sociétés, lesquelles devaient par ailleurs fusionner au sein d’une société nouvelle ; que ce même 16 décembre 1992, la société BTF SA a confié à la SDBO, pour la même durée, le mandat irrévocable de solliciter des acquéreurs et de recevoir le prix ; que les cessions prévues sont intervenues le 12 février 1993 au profit de huit sociétés, parmi lesquelles la société Clinvest, filiale de la société Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais), qui, alors qu’elle était déjà titulaire de 10 % du capital de la société BTF GmbH, en a acquis 9,9 % supplémentaires, et une société constituée par M. Z..., à l’aide pour certaines d’entre elles d’un prêt spécifique dit “à recours limité” accordé par le Crédit lyonnais et stipulant notamment qu’en cas de revente, la plus-value serait partagée à raison d’un tiers pour l’emprunteur et de deux tiers pour la banque ; que le même jour, l’ensemble des cessionnaires a, par ailleurs, consenti à M. Z..., jusqu’au 31 décembre 1994, une option d’achat de leurs acquisitions respectives pour le prix de 3 498 000 000 francs, option qui a été levée le 22 décembre 1994 ; que le mémorandum n’ayant pu être exécuté, non plus que le protocole signé le 13 mars 1994 avec le Crédit lyonnais pour mettre fin aux relations bancaires des intéressés et solder les comptes du groupe Tapie, les prêts accordés à celui-ci ont été rendus exigibles ; que les sociétés du groupe Tapie ont alors fait l’objet de procédures de redressement puis de liquidation judiciaires, bientôt poursuivies sous patrimoine commun, à l’exception de la société BTF SA qui, bénéficiant d’un plan de continuation, est devenue la Compagnie européenne de distribution et de pesage dont les actions ont été attribuées à la SDBO ; que reprochant au Crédit lyonnais et à la SDBO d’avoir abusivement soutenu le groupe Tapie et frauduleusement conclu, dès le mois de décembre 1992, “un accord secret de revente au double” avec M. Z..., les organes des procédures collectives ont recherché la responsabilité du Crédit lyonnais et de la SDBO ; qu’après avoir déclaré la société Mandataires judiciaires associés (la société MJA) et M. A... recevables à agir en leur qualité de liquidateurs des sociétés GBT, FIBT, BTF SA et Bernard Tapie gestion (la société BT gestion) ainsi que de M. et Mme X..., en réparation du préjudice subi par la société GBT et dit que, bien que n’ayant pas été partie au mandat, le Crédit lyonnais était obligé par celui-ci, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005 a condamné solidairement la société CDR créances, nouvelle dénomination de la SDBO, et le Crédit lyonnais à payer aux liquidateurs la somme de 135 millions d’euros pour avoir manqué à leurs obligations de mandataires et pour avoir fait perdre au groupe Tapie, en ne le faisant pas bénéficier des crédits appropriés, une chance de vendre directement les participations Adidas à M. Z... ; que sur les pourvois de la société CDR créances et du Crédit lyonnais, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 octobre 2006, rejeté les moyens qui critiquaient la décision en ce qu’elle avait déclaré recevable l’action des liquidateurs, mais cassé l’arrêt attaqué du chef des condamnations prononcées contre la société CDR créances et le Crédit lyonnais, aux motifs, en ce qui concerne la condamnation du Crédit lyonnais, que le mandat n’avait été conclu qu’avec la SDBO et que la cour d’appel n’avait caractérisé ni une fictivité de celle-ci, ni une confusion de patrimoine entre elle et le Crédit lyonnais, ni une éventuelle immixtion de ce dernier dans l’exécution du mandat, et, en ce qui concerne la responsabilité de la société CDR créances et du Crédit lyonnais, que le mandataire n’était nullement tenu de financer l’opération pour laquelle il s’entremettait ; que l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris ; qu’à l’automne 2007, outre cette action, plusieurs autres litiges étaient en cours entre, d’une part, les liquidateurs et M. et Mme X..., et d’autre part, la société CDR créances et la société CDR consortium de réalisation (anciennement société CDR participations, anciennement société Clinvest), sociétés dites de “défaisance” de certains actifs du Crédit lyonnais, à savoir, l’action de la société CDR créances en remboursement du prêt octroyé le 30 juin 1992 à la société Alain Colas Tahiti (la société ACT) pour la rénovation du navire “Le Phocea”, l’action en responsabilité délictuelle pour soutien abusif et rupture abusive de concours bancaires, et l’action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles était intervenue la liquidation judiciaire des membres du groupe Tapie ; que, le 16 novembre 2007, les liquidateurs, M. et Mme X... et les sociétés CDR créances et CDR consortium de réalisation (les sociétés CDR) ont signé un compromis qui prévoyait que ces contentieux, ainsi que celui portant sur l’ordonnance d’attribution des actions de la société BTF SA, donneraient lieu à des désistements d’instance et seraient soumis à l’arbitrage de trois arbitres nommément désignés, qui seraient tenus par l’autorité de la chose jugée des décisions de justice “définitives” précédemment rendues et statueraient en faisant application de la loi française et des règles de procédure des articles 1640 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction alors en vigueur ; que, par une sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes ayant consisté dans la violation de l’obligation de loyauté et dans la violation de l’interdiction de se porter contrepartie, les a condamnées solidairement à payer aux liquidateurs, ès qualités, la somme de 240 millions d’euros, outre les intérêts, a fixé à 45 millions d’euros le préjudice moral des époux X... et à 8 448 529,29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation ; que trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l’une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale ; que les sociétés CDR ayant formé un recours en révision, la cour d’appel, par un arrêt du 17 février 2015, a ordonné la rétractation des sentences et invité les parties à conclure sur le fond ; qu’un pourvoi formé contre cet arrêt par les sociétés GBT et FIBT et M. et Mme X... a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2016 ; que la société GBT a été mise en sauvegarde le 30 novembre 2015, et cette procédure étendue à la société FIBT le 3 décembre 2015, la société Abitbol étant désignée administrateur et la société BTSG, mandataire judiciaire ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Z 16-10.344, en tant que formé par M. et Mme X... :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les demandes de M. X... tendant à la condamnation des sociétés CDR à des dommages-intérêts pour des fautes commises à l’occasion de la vente des titres de la société BTF GmbH ainsi que pour la rupture brutale de crédit et le “recouvrement abusif de créances” alors, selon le moyen :
Mais attendu que l’arrêt relève que les sentences litigieuses, rétractées par l’arrêt du 17 février 2015, ont été rendues sur le fondement d’un compromis d’arbitrage conclu le 16 novembre 2007 stipulant, en son article 7.1, que le tribunal arbitral serait tenu notamment par les “attendus définitifs” de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005, et constate que cet arrêt a déclaré recevable, d’un côté, l’action engagée par la Selafa MJA, représentée par M. B..., et par M. A..., en leur qualité de liquidateurs de M. X..., laquelle tendait à la réparation des préjudices matériel et moral subis notamment par M. X..., et, de l’autre, l’intervention volontaire accessoire de M. X... ; qu’il en résulte que c’est sans méconnaître les stipulations du compromis définissant l’étendue de ses pouvoirs ni priver M. X..., débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et représenté par son liquidateur, d’un droit au recours effectif, que l’arrêt retient que M. X... est dépourvu de qualité pour demander la condamnation des sociétés CDR à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice matériel qu’il estime avoir subi en raison des fautes qu’elles auraient commises à l’occasion de la cession des titres de la société BTF GmbH, de la rupture des crédits et du recouvrement abusif des créances ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° N 15-28.683 :
Attendu que la Selafa MJA, en la personne de M. B..., ès qualités, et la Selarl EMJ, en la personne de M. A..., ès qualités, font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les demandes faites au titre du contentieux ACT alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en jugeant qu’elle ne pourrait connaître de la demande des liquidateurs tendant à obtenir la restitution par la société CDR créances de la somme perçue de la vente du bateau Le Phocea séquestrée par l’établissement de crédit au prétexte que la qualification de créance antérieure à la procédure collective relèverait, par application d’une règle d’ordre public, de la seule compétence du juge de cette procédure et que le compromis d’arbitrage qui déterminait les limites de sa saisine ne pouvait porter sur ce point, quand il n’était pas prétendu que la demande des liquidateurs se heurterait à la détermination préalable de la nature de la créance de restitution invoquée par la société CDR créances et serait soumise aux mêmes règles, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que dès lors que les liquidateurs de la société ACT avaient soulevé l’irrecevabilité de la demande en paiement de la créance présentée par la société CDR créances en raison de l’interdiction de compromettre sur la compétence du juge de la procédure collective pour statuer sur la qualification de la créance et son éligibilité à la règle du paiement à l’échéance prévue par l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le moyen d’irrecevabilité de la demande de restitution des sommes séquestrées en vertu de l’hypothèque garantissant la créance en cause formée par les liquidateurs, tiré de la même interdiction et retenu par la cour d’appel, était dans le débat ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° U 16-10.339, le quatrième moyen du pourvoi n° Z 16-10.344 en tant que formé par la société GBT, et le sixième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches du même pourvoi en tant que formé par M. et Mme X..., réunis :
Attendu que les sociétés FIBT et GBT, et M. et Mme X... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés CDR à payer des dommages-intérêts pour des fautes commises à l’occasion de la vente des titres de la société BTF GmbH alors, selon le moyen :
Mais attendu que l’arrêt relève, d’un côté, que la SDBO n’était pas la dispensatrice des prêts à recours limité, et de l’autre, que le projet d’acte de cession des titres de la société BTF GmbH avait été préparé par le propre avocat de la société BTF SA, et transmis à celle-ci par fax le 27 janvier 1993, que ce projet mentionnait, en qualité d’acquéreurs, la société Clinvest, les AGF et d’autres sociétés, dont des sociétés luxembourgeoises, que l’auteur du courrier de transmission indiquait qu’il lui manquait certaines données, notamment, la répartition précise des parts achetées, ainsi que l’identité et l’actionnariat des sociétés luxembourgeoises, et que cet avocat avait confirmé, par télécopie du 26 janvier 1993 adressée à la société BTF SA, un accord téléphonique sur la facturation d’un forfait à titre d’honoraires pour la rédaction du protocole de la vente des parts sociales de la société BTF GmbH aux sociétés Clinvest, AGF, Worms et leurs affiliées luxembourgeoises, qui devait intervenir le 29 janvier 1993 ; que l’arrêt retient ensuite que, dans les semaines précédant la vente qui a été signée le 12 février 1993, la liste des acquéreurs n’était pas définitivement arrêtée, mais qu’il était clair pour les dirigeants de la société BTF SA qu’il s’agissait des sociétés Clinvest, AGF et Worms, auxquelles liberté était laissée de déterminer les conditions dans lesquelles, directement ou par leurs affiliées, elles apparaîtraient à l’acte ; qu’il retient encore qu’il résulte des conditions d’élaboration de l’acte de vente des titres que les sociétés Clinvest, AGF et Worms recueillaient ouvertement aux yeux de la société BTF SA les risques mais aussi les profits éventuels de l’opération et faisaient par conséquent leur affaire de la reprise de la société Adidas ; qu’il ajoute que le secret entourant l’opération ne concernait pas la société BTF SA qui avait accepté que les cessionnaires puissent être les trois établissements financiers et leurs discrètes émanations, qu’en revanche, le recours à une pluralité d’acquéreurs et la confidentialité se justifiaient par le souci de ne pas faire entrer la société Adidas dans le secteur public et de ne pas attirer l’attention sur ce qui pouvait être, et a été, en effet, regardé par la presse comme une faveur consentie à un ministre en exercice par des banques publiques qui endossaient l’intégralité des risques de l’opération ; que de ces constatations et appréciations, excluant la fraude invoquée par la dixième branche, la cour d’appel a pu déduire que la société BTF SA avait donné son consentement éclairé à la vente des titres à son mandataire, directement ou par personnes interposées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° U 16-10.339, le cinquième moyen du pourvoi n° Z 16-10.344 en tant que formé par la société GBT, et le sixième moyen, pris en sa cinquième branche, du même pourvoi en tant que formé par M. et Mme X..., réunis :
Attendu que les sociétés FIBT et GBT, et M. et Mme X..., font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :
Mais attendu que l’obligation de loyauté qui s’impose au mandataire à l’égard de son mandant suppose la révélation de toute information de nature à influer sur le consentement de celui-ci ; que l’arrêt relève qu’à l’été 1992, la cession des actions de la société BTF GmbH était imposée par trois circonstances : l’entrée de M. X... au gouvernement en avril 1992, qui exigeait la transformation des actifs industriels du groupe en actifs patrimoniaux, le règlement de la seconde échéance du prêt consenti en juillet 1990 pour l’acquisition de 80 % d’Adidas par un pool bancaire auquel la SDBO contribuait à hauteur de 30 %, enfin la nécessité de trouver des fonds pour recapitaliser Adidas ; qu’il ajoute que M. X... a entrepris, dès le début de l’année 1992, de rechercher des acquéreurs sans le concours de la SDBO, sans y parvenir ; qu’il relève ensuite que les commissaires aux comptes de la société BTF SA ont lancé deux procédures d’alerte, en mars et en novembre 1992, que la société Pentland, déjà détentrice du capital de la société BTF GmbH, bénéficiaire d’une promesse de vente des titres détenus par la société BTF SA, a renoncé à l’acquisition, en octobre 1992, pour des motifs juridiques et économiques, que ce revirement a créé un climat défavorable vis-à-vis de l’entreprise et des autres repreneurs éventuels, que le 10 décembre 1992, lors de la signature du mémorandum, les experts mandatés par la société BTF SA pour procéder à l’évaluation d’Adidas ont conclu à une valorisation totale de 2 775 000 000 francs et que le mandat de rechercher des acquéreurs confié à la SDBO portait sur 78 % des titres au prix de 2 085 000 000 francs, ce qui correspondait à la valeur réelle d’Adidas à cette date ; qu’il relève enfin qu’à la date de la vente, les dirigeants de la société BTF SA connaissaient les perspectives de redressement d’Adidas, telles qu’elles ressortaient du “business plan” de sa direction, dont le sérieux avait été confirmé par l’expertise, et qu’en décembre 1992, la société BTF SA disposait des mêmes éléments d’analyse que les banques pour apprécier l’évolution future d’Adidas ; qu’ayant ainsi fait ressortir qu’à supposer que la société BTF SA, qui disposait des informations essentielles lui permettant de décider en toute connaissance de cause de céder les titres et d’en déterminer le prix, ait été informée des négociations en cours avec M. Z..., ou une société dont il détenait le capital, en vue de lui consentir une option d’achat valable jusqu’au 31 décembre 1994, fût-ce à un prix supérieur, cette information n’aurait pas été de nature à influer sur sa décision, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu l’objet du litige et a souverainement apprécié la pertinence des éléments de preuve produits, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen et le sixième moyen du pourvoi n° U 16-10.339, le sixième moyen du pourvoi n° Z 16-10.344, en tant que formé par la société GBT, et le sixième moyen, pris en ses première, sixième, et septième branches, du même pourvoi en tant que formé par M. et Mme X..., réunis :
Attendu que les sociétés FIBT et GBT et M. et Mme X... font encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :
Mais attendu que la décision se trouvant légalement justifiée par les motifs, vainement critiqués, par lesquels la cour d’appel a retenu que les société CDR n’avaient pas commis de faute, le moyen, qui attaque des motifs surabondants, est inopérant ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° N 15-28.683, réunis :
Attendu que les liquidateurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation des sociétés CDR à payer des dommages-intérêts pour soutien abusif et de les condamner, solidairement avec la société FIBT, la société GBT et Mme X..., à restituer aux sociétés CDR une somme d’un certain montant et à rembourser les coûts de la procédure d’arbitrage à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient exactement que ne sont pas dépourvus de cause et ne sauraient donner lieu à répétition les paiements faits en exécution de décisions de justice irrévocables et que tel est le cas du règlement de créances dont l’admission au passif par des décisions irrévocables des juges-commissaires n’est pas contestée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu’en condamnant les liquidateurs, ès qualités, à restituer les indemnités mises à la charge des sociétés CDR en exécution de la sentence, la cour d’appel n’a pas remis en cause les paiements des créances contractuelles admises au passif ;
Attendu, en troisième lieu, que, loin de se borner à relever que les liquidateurs n’ont pas soutenu qu’il subsisterait des créances antérieures, l’arrêt constate que les liquidateurs ne produisent aucune pièce établissant qu’à l’issue des règlements faits à l’aide des sommes allouées par la sentence, des créances antérieures aux jugements d’ouverture des procédures collectives sont demeurées impayées ;
Et attendu, en dernier lieu, que la cour d’appel n’avait pas à se livrer à des recherches sur le soutien abusif invoqué, que ses constatations rendaient inopérantes ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi n° N 15-28.683, le septième moyen du pourvoi n° U 16-10.399, et le septième moyen du pourvoi n° Z 16-10.344 en tant que formé par la société GBT, réunis :
Attendu que les liquidateurs, la société FIBT et la société GBT font grief à l’arrêt de rejeter les demandes de condamnation des sociétés CDR à payer des dommages-intérêts pour rupture brutale de crédit et recouvrement abusif de créances alors, selon le moyen :
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a retenu que la volonté commune des parties, telle qu’elle était exprimée dans l’exposé préalable du protocole d’accord du 13 mars 1994, était de mettre fin à l’ensemble de leurs relations et qu’il n’y avait donc pas eu rupture unilatérale de crédit de la part de la SDBO mais cessation conventionnelle des relations bancaires ; que, par ces seuls motifs, desquels elle a exactement déduit, sans méconnaître les effets de la caducité du protocole, que la demande en paiement des dettes échues n’était pas subordonnée à l’observation des prescriptions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° Z 16-10.344 en tant que formé par M. et Mme X... :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de limiter à un euro les dommages-intérêts qui leur ont été alloués alors, selon le moyen :
Mais attendu qu’après avoir écarté, par des motifs non critiqués, les fautes invoquées autres que celle tenant aux conditions dans lesquelles la SDBO avait fait pratiquer la saisie de l’hôtel de [...], la cour d’appel, qui n’a pas remis en cause le fait que cet hôtel constituait le domicile de M. et Mme X..., mais a seulement relevé que ces derniers n’indiquaient pas s’ils y résidaient effectivement lorsque la visite publique en a été organisée ou s’ils étaient hébergés dans un autre logement mis à leur disposition par la société FIBT, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation de l’existence et du montant du préjudice moral causé par cette faute ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° N 15-28.683, le huitième moyen du pourvoi n° U 16-10.339, le huitième moyen du pourvoi n° Z 16-10.344 en tant que formé par la société GBT et sur le septième moyen du même pourvoi en tant que formé par M. et Mme X..., réunis :
Attendu que les liquidateurs, la société FIBT, la société GBT et M. et Mme X... font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer aux sociétés CDR la somme de 404 623 082,54 euros avec les intérêts au taux légal depuis le jour du paiement fait en exécution de la sentence rétractée et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil alors, selon le moyen :
Mais attendu, en premier lieu, qu’une somme qui a été payée, fût-ce par compensation entre créances réciproques, en exécution d’une décision de justice ou d’une sentence arbitrale qui a été ensuite rétractée, doit être restituée par la partie qui l’a reçue à celle qui l’a payée ; qu’après avoir constaté que les sommes allouées par la sentence rétractée sont censées n’être jamais entrées dans l’actif commun de la liquidation judiciaire, l’arrêt retient exactement qu’aucun motif juridique ne justifie que les paiements des créances contractuelles admises viennent en déduction des indemnités à restituer par suite de la rétractation de la sentence ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d’appel ayant exactement relevé que les sociétés FIBT, GBT et M. et Mme X... concluaient au rejet des demandes de restitution sans formuler aucun moyen de défense, c’est sans se contredire, ni dénaturer leurs conclusions, ni méconnaître son office, que la cour d’appel a retenu que ces parties ne contestaient pas le décompte des sommes versées, la solidarité, le point de départ des intérêts et l’anatocisme, et que la demande de restitution était bien fondée dans son montant ;
Attendu, en dernier lieu, que le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, douzième, treizième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième branches, en ce qu’il présente pour la première fois, devant la Cour de cassation, des griefs relatifs à la solidarité et aux intérêts, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 15-28.683 des liquidateurs, le neuvième moyen du pourvoi n° U 16-10.339 de la société FIBT, le neuvième moyen du pourvoi n° Z 16-10.344 en tant que formé par la société GBT, et les huitième et neuvième moyens du même pourvoi en tant que formé par M. et Mme X..., réunis :
Attendu que les liquidateurs, la société FIBT, la société GBT et M. et Mme X... font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à rembourser aux sociétés CDR les coûts de la procédure d’arbitrage, en ce compris les frais et honoraires des arbitres, avec les intérêts au taux légal sur ces sommes depuis le jour du paiement, et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil alors, selon le moyen :
Mais attendu, en premier lieu, qu’en ordonnant le remboursement aux sociétés CDR des coûts de la procédure d’arbitrage, à titre de dommages-intérêts, compte tenu du caractère frauduleux de cet arbitrage, la cour d’appel n’a pas fondé sa décision sur les dispositions invoquées par la onzième branche;
Attendu, en deuxième lieu, que, statuant sur la réparation du préjudice causé par la fraude à la décision du tribunal arbitral, la cour d’appel n’était pas soumise aux stipulations du compromis d’arbitrage répartissant entre les parties la charge des coûts de la procédure ;
Attendu, en troisième lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des écritures des parties que les liquidateurs, les sociétés FIBT et GBT et M. et Mme X... aient soutenu devant la cour d’appel que toutes les parties à l’arbitrage n’avaient pas participé à la fraude ni que les intérêts ne pouvaient courir qu’à compter de la demande en justice ; que le moyen, pris en ses première, deuxième, douzième et quatorzième branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit;
Attendu, en dernier lieu, que M. et Mme X..., qui ont saisi la cour d’appel d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile contre les sociétés CDR, ne sont pas recevables à présenter un moyen contraire à la position qu’ils ont soutenue devant cette juridiction, en faisant grief à la cour d’appel d’avoir fait application de ce texte;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° U 16-10.339, les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Z 16-10.344 en tant que formé par la société GBT et les premier, deuxième, et troisième moyens du pourvoi n° Z 16-10.344 en tant que formé par M. et Mme X..., qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois;
AFFAIRE DU SANG CONTAMINÉ
|
Cour de Justice de la République, 9 Mars 1999, Laurent Fabius, Georgina Dufoix et Edmond Hervé. Affaire n°99-001 A l'audience publique du mardi 9 mars 1999, la Cour de justice de la République a rendu l'arrêt suivant dont il a été donné lecture par le Président : Sur les conclusions 1 ° - Sur les conclusions déposées le 23 février 1999 par Maître Maisonneuve et Maître Welzer pour M. Edmond Hervé et contestant les conditions dans lesquelles il a été procédé à la lecture d'extraits des procès-verbaux d'audition de M. Weisselberg joints à la procédure : Attendu que le magistrat chargé de cette lecture s'est borné à expliciter, par quelques phrases de liaisons, les conditions dans lesquelles avaient été dressés les procès-verbaux dont certains extraits lui paraissaient utiles à la manifestation de la vérité ; Qu'au cours de cette lecture, la parole ayant été donnée au ministère public ainsi qu'aux prévenus et à leurs avocats, et aucune observation de fond n'ayant été présentée, il n'en est résulté aucune violation des droits de la défense, ni de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2° - Sur les conclusions déposées le 25 février 1999 par Maître Cahen pour Mme Georgina Dufoix, en ce qu'elles invoquent la violation de l'article 6, alinéas 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'aucune nullité de procédure ne peut résulter, en droit interne, de la méconnaissance éventuelle du délai raisonnable prévu par ladite convention et que le grief d'impartialité allégué n'aurait pu relever que d'une demande de récusation, laquelle n'a pas été présentée ; Que par ailleurs la Cour a répondu, par arrêt avant dire droit du 9 février 1999, aux réserves formulées sur les conditions dans lesquelles ont été entendues les personnes citées en qualité de témoin, tant par la défense que par le ministère public, bien qu'étant mises en examen, pour faits connexes, dans une procédure actuellement en cours au tribunal de grande instance de Paris ; 3 °- Sur les conclusions déposées le 25 février 1999 par Maître Maisonneuve et Maître Welzer pour M. Edmond Hervé en ce qu'elles invoquent la violation des droits de l'homme, et en ce qu'elles émettent des réserves quant à l'impartialité des débats ou font état d'une atteinte à leur devoir de réserve par des membres de la Cour ; Attendu que ces griefs, qui pour partie auraient pu relever de la procédure de récusation à laquelle il n'a pas été recouru, ne procèdent que d'affirmations inexactes ou non établies ; Qu'il sera, par ailleurs, répondu, dans les motifs du présent arrêt, auxdites conclusions en ce qu'elles tendent à la relaxe d'Edmond Hervé ; 4°- Qu'il en sera également ainsi des autres conclusions, tendant aux mêmes fins de relaxe, déposées le 26 février, pour le même prévenu, par les mêmes avocats, ainsi que par maître Darrois, maître Zaouii et M. le bâtonnier de Bigault du Granrut pour Laurent Fabius ; Au fond Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi organique du 23 novembre 1993, il a été voté par bulletins secrets à la majorité absolue, et séparément pour chaque prévenu, sur chaque chef de la prévention ; Concernant Laurent Fabius, Premier Ministre à l'époque des faits, à la majorité de huit voix au moins il a été répondu négativement à chacun des cinq chefs de prévention retenus à son encontre ; Concernant Georgina Dufoix, ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale à l'époque des faits, à la majorité de huit voix au moins il a été répondu négativement à chacun des cinq chefs de prévention retenus à son encontre ; Concernant Edmond Hervé, secrétaire d'Etat à la Santé à l'époque des faits, à la majorité de huit voix au moins il a été répondu négativement aux chefs de prévention retenus à son encontre visant Paul Pérard, Charles-Edouard Perrot-Cochin, Yves Aupic, Hanattah Malik et Pierre Roustan ; En revanche, à la majorité de huit voix au moins, il a été répondu par l'affirmative aux chefs de prévention retenus à son encontre, visant Sarah Malik ainsi que Sylvie Rouy, et il a été voté sans désemparer, à la majorité absolue des votants, sur l'application de la peine à l'égard de Edmond Hervé Motivation I - Rappel des faits Attendu que le syndrome du sida est apparu aux Etats-Unis en 1981, notamment chez les homosexuels et les toxicomanes ; qu'en janvier 1982, l'agence épidémiologique fédérale des Etats-Unis signale le premier cas d'infection chez un hémophile ; Qu'en décembre 1982, la possibilité d'une contamination par voie sanguine est évoquée et qu'en février 1983, le professeur Montagnier découvre le virus LAV, agent causal du sida, suivi, en mai 1983, par le professeur Gallo qui identifie les rétrovirus HTLV III comme germe de la maladie ; que c'est à cette époque que les chercheurs mettent en évidence la réalité biologique du sida ; Que, le 9 juin 1983, une étude réalisée par les docteurs Habibi, Allain et Courroucé, du Centre national de la transfusion sanguine (CNTS), relève « le caractère gravissime de ce syndrome et l'absence de test de détection approprié », précise qu'aucun traitement n'est alors disponible, que la mortalité de la maladie dépasse largement 70 % et recommande, notamment, la recherche des « donneurs à risques » et l'utilisation prudente des fractions coagulantes ; Que, le 20 juin 1983, une circulaire ministérielle élaborée par le docteur Brunet, épidémiologiste à la Direction générale de la santé, et signée par le Professeur Jacques Roux, directeur général, recommande l'élimination des donneurs à risques lors des collectes de sang ; qu'elle est suivie d'une recommandation adoptée le 6 juin 1983 par le conseil des ministres du Conseil de l'Europe, ayant le même objet et dont le texte avait été préparé par un groupe de travail auquel participaient des experts français, dont deux médecins inspecteurs généraux de la santé ; Que, le 22 novembre 1984, le docteur Brunet, à la commission consultative de la transfusion sanguine, un rapport sur la prévention des risques de transmission du sida par la transfusion sanguine ; qu'il y fait état d'études ayant pu prouver une inactivation du virus après chauffages des dérivés sanguins ; Que, le 16 janvier, 1985, une lettre-circulaire du directeur général de la santé, adressée aux établissements de transfusion sanguine, constatant que la circulaire du 20 juin 1983 aurait été peu appliquée, prescrit d'en respecter strictement les instructions ; Que, le 12 mars 1985, le docteur Brunet attire l'attention du professeur Roux sur les résultats inquiétants de l'enquête effectuée à l'hôpital Cochin, qui fait apparaître que 6 donneurs de sang sur 1000 sont séropositifs ; Que, le 21 avril 1985, le professeur Montagnier, de retour du congrès d'Atlanta sur le sida qui s'est tenu le 15 avril, souligne, lors d'un journal télévisé, le sérieux de l'épidémie du sida qui pourrait devenir un problème majeur d'ici l'an 2000 et précise que, pour éviter sa transmission, il est nécessaire de tester systématiquement tous les dons de sang ; Que, le 30 mai 1985, un rapport établi par le docteur Habibi, au nom du groupe « Sida et transfusion sanguine », est transmis à Edmond Hervé ; que ce rapport préconise une application aussi rapide que possible du dépistage systématique du sida à chaque don de sang ; Attendu que, le 19 juin 1985, Laurent Fabius, en réponse à une question orale d'un parlementaire, annonce à l'Assemblée nationale sa décision de rendre obligatoire le test de dépistage du sida pour tous les donneurs de sang ; Attendu que, le 23 juillet 1985, deux arrêtés, signés par les directeurs de cabinet du ministre des Affaires sociales et du secrétaire d'Etat chargé de la Santé, prescrivent, l'un le dépistage du virus du sida dans les dons du sang à compter du 1er août 1985, l'autre le non-remboursement des produits non chauffés à compter du 1er octobre 1985 ; que, par une circulaire signée du professeur Roux, datée du 2 octobre 1985, diffusée le 15 aux directeurs d'établissements de transfusion sanguine et qui sera publiée au bulletin officiel du secrétariat d'Etat à la date du 20 octobre, il est demandé que les produits sanguins contaminés soient renvoyés au centre de transfusion sanguine qui les a délivrés ; Attendu que l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 a mis en place un fonds d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH et causés par une transfusion de produits sanguins ; Que, par arrêts du 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a constaté la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations sanguines par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Attendu qu'à compter du 20 janvier 1994, des plaintes ont été déposées devant la commission des requêtes près de la Cour de justice de la République contre Laurent Fabius, Georgina Dufoix et Edmond Hervé, respectivement, à l'époque des faits, Premier ministre, ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale, et secrétaire d'Etat à la Santé, et que la commission d'instruction de cette Cour a été saisie par un réquisitoire introductif du procureur général, du 18 juillet 1994, suivi de plusieurs réquisitions supplétives ; Que la qualification des faits dénoncés, telle que la retenue par la commission des requêtes et le parquet général, était celle de complicité de crime d'administration de substance nuisibles à la santé ; Qu'au terme de l'information, la commission d'instruction, après requalification des faits poursuivis en délits d'homicides et de blessures par imprudence, énonce qu'elle ne pouvait, « sans excéder sa saisine, informer sur des faits de contamination commis au préjudice d'adhérents, non identifiés » de l'Association française des hémophiles ; que son arrêt précise, par ailleurs, « que ne peuvent être retenues dans la prévention les contaminations survenues à une date qui n'a pu être déterminée, celles survenues en dehors de la période au cours de laquelle des fautes ont été relevées à la charge des mis en examens, ainsi que celles pour lesquelles n'existe pas un lien certain de causalité entre les fautes et le dommage » ; Qu'en conséquence, après non-lieu à suivre concernant dix-sept victimes ayant fait l'objet de plaintes individualisées, la Cour de justice de la République est saisie, à l'égard des trois prévenus, du cas de sept victimes ; II - Griefs allégués par la commission d'instruction Attendu que l'arrêt de renvoi reproche à Edmond Hervé de n'avoir pas surveiller l'application effective des prescriptions de la circulaire du 20 juin 1983 visant à écarter des collectes de sang les personnes présentant un risque viral ; qu'il lui est, notamment, fait grief d'avoir toléré que se poursuivent les prélèvements de sang dans les établissements pénitentiaires ; Attendu qu'il est, par ailleurs, reproché à l'intéressé ainsi qu'à Laurent Fabius et Georgina Dufoix, d'une part, dans le but de favoriser l'implantation sur le marché du réactif mis au point par la société Diagnostics Pasteur au détriment de firmes étrangères, d'avoir retardé la généralisation des tests de dépistage et leur inscription à la nomenclature des actes de biologie médicale et, d'autre part, de ne pas avoir fait procéder au rappel des personnes susceptibles d'avoir été contaminées, avant le 1er août 1985, par la voie de la transfusion sanguine ; Qu'il est enfin retenu à charge contre Edmond Hervé et Georgina Dufoix de n'avoir pas édicté une réglementation spécifique destinée à préserver, en toutes circonstances, la qualité du sang humain, de son plasma et de leur dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, en tolérant, notamment, la délivrance de produits sanguins non inactivés et en n'ordonnant pas la destruction immédiate des stocks présentant des risques de transmission du virus ; Que la commission d'instruction retient l'existence d'un lien de causalité entre ces fautes et le décès ou l'incapacité de sept des victimes concernées par les plaintes ; III - Sur les réquisitions du ministère public Attendu que, dans ses réquisitions orales, le ministère public reprend la distinction, abordée à plusieurs reprises au cours des débats, entre les notions de responsabilité politique et de responsabilité pénale ; Qu'après avoir estimé que, « prise dans sa globalité la politique sanitaire du gouvernement de la France d'avril à septembre 1985 a été catastrophique en ce qui concerne la lutte contre l'extension du sida », il conclut, s'agissant des ministres, que l'inadéquation de leurs interventions, ainsi qu'une absence d'implication que l'instruction et les débats auraient mises en évidence, ne peuvent pour autant être considérées comme pénalement fautives ; qu'elles ne constituent pas une infraction pénale susceptible de justifier une condamnation et que la juste application du droit impose, en conséquence, la relaxe ; Que le parquet général invite alors la Cour à avoir un « rôle civique » en décernant aux prévenus une forme de « blâme public » ; que la responsabilité politique serait à recréer en France et que la décision de la Cour pourrait y contribuer, à raison des « messages forts que donne ce procès aux gouvernants de notre pays » ; Qu'après avoir souligné, dans ses réquisitions écrites aux fins de non-lieu, que le droit pénal, ne cherchant plus seulement à atteindre les fautes intentionnelles mais aussi les comportements de tous les jours dans les activités les plus élémentaires, devenait un des moyens de la démocratie, le parquet général évoque le risque que les ministres, à l'avenir, soient conduits à s'expliquer devant la Cour de Justice de la République de leurs choix politiques ; qu'une telle perspective aboutirait à substituer un contrôle judiciaire à ce qui relève du contrôle démocratique et à créer une « regrettable confusion des pouvoirs » en soumettant les actions du pouvoir exécutif à l'appréciation des juges ; Mais attendu que la responsabilité politique - à en supposer la notion, les critères et la mise en œuvre précisément définis, ce qui n'est pas de la compétence de la Cour - , n'est pas exclusive ni de la responsabilité civile et administrative de l'Etat, ni de la responsabilité pénale ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 68-1 de la Constitution, applicables en l'espèce, consacrent expressément l'autonomie de la responsabilité pénale des membres du gouvernement en cas de crimes ou de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, sans faire de distinction entre les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles ; Qu'il n'appartient pas non plus à la Cour, dont le rôle est d'appliquer le droit positif et non d'en apprécier l'opportunité, de se prononcer sur les observations du procureur général, fussent-elles pertinentes, relatives aux risques qu'il évoque ainsi qu'au phénomène de l'inflation pénale. Qu'il s'agit là de choix politiques qui ne relèvent que du seul législateur ; que la Cour, exerçant une fonction judiciaire et non civique, ne saurait, en décernant aujourd'hui un blâme ou demain un satisfecit, s'arroger le rôle d'arbitre de la vie politique française sans compromettre le fonctionnement normal des institutions de la République ; Qu'au demeurant, il n'a pas été prétendu en l'espèce, par les prévenus, que le comportement qui leur est reproché dans la conduite de la politique sanitaire, à l'époque visée par la prétention, procédait d'un choix politique délibéré, clairement annoncé ; IV - Les moyens de la défense Attendu que les avocats d'Edmond Hervé sollicitent sa relaxe ; que maître Maisonneuve soutient que la commission d'instruction a refusé d'accomplir les actes et d'ordonner les expertises qu'il avait demandés ; que selon lui, Edmond Hervé, quoique maire d'une grande ville, s'est consacré avec assiduité à son travail ministériel ; qu'enfin, bien qu'au contact d'un monde médical qui aurait sous-estimé les risques du sida, il avait néanmoins été l'un des initiateurs des circulaires sur la sélection des donneurs et des arrêtés relatifs au dépistage du virus du VIH ; Que maître Welzer, après avoir énuméré ce qu'il estime être des « erreurs » de l'arrêt de renvoi, s'attache à soutenir qu'il n'existe pas de lien de cause à effet entre les fautes imputées au secrétaire d'Etat et le dommage subi par chacune des victimes ; Attendu que maître Cahen, avocat de Georgina Dufoix, à l'appui de sa demande de relaxe, souligne que la motivation de l'arrêt de renvoi, selon laquelle le ministre « ne pouvait pas ne pas savoir », n'est pas admissible dans notre droit ; qu'il soutient qu'existait un large consensus, y compris de la part du président de l'Association française des hémophiles, sur la coexistence, pendant une période transitoire, des produits sanguins chauffés et non chauffés ; Attendu que, en faveur de Laurent Fabius, maître Darrois plaide que le Premier ministre, malgré une médecine divisée et la science balbutiante, a pris une décision rapide et claire afin de rendre obligatoire le dépistage des dons du sang ; Que Maître Zaoui s'attache à remettre en cause ce qu'il appelle la thèse du « complot pasteurien » avancée par l'arrêt de renvoi ; qu'il soutient que les tests de la société Diagnostics Pasteur ont été opérationnels dès le mois de mars 1985 et que la formalité de l'enregistrement n'était pas nécessaire pour que les entreprises concurrentes puissent fournir leurs produits aux centres de transfusion sanguine, ce qu'elles ont d'ailleurs fait ; Que le Bâtonnier de Bigault du Granrut, après avoir présenté la personnalité et la carrière de Laurent Fabius, insiste sur la nécessité de replacer les faits dans le contexte de l'époque et de distinguer la responsabilité de l'Etat de celle des ministres ; que, selon lui, Laurent Fabius a appliqué « le principe de précautions » avant même son introduction dans notre droit positif ; V - Sur les faits reprochés à Laurent Fabius Attendu que les griefs invoqués par l'arrêt de renvoi à l'encontre de Laurent Fabius ne portent que sur son comportement en qualité de Premier ministre concernant la généralisation des tests de dépistage du sida chez les donneurs de sang et les mesures d'accompagnement ; Attendu que, selon l'article 21 de la Constitution, il appartient au Premier ministre qui dirige l'action du gouvernement, d'en définir les grandes orientations politiques, en donnant au besoin les impulsions nécessaires, et d'arbitrer les différents qui pourraient survenir entre ses ministre ; qu'il dispose, pour exercer sa fonction, du concours de son Cabinet et du Secrétariat général du gouvernement ; Que chacun des membres du gouvernement, qui bénéficie d'une délégation de pouvoirs du Premier ministre, dispose d'une compétence propre, définie par le décret fixant les attributions du département ministériel dont il a la charge ; Attendu qu'il résulte de l'information que Laurent Fabius a été saisi du problème du dépistage obligatoire des dons de sang par une note de son conseiller industriel, datée du 29 avril 1985 ; qu'il ressort des annotations portées sur ce document que le Premier ministre a exprimé d'emblée une position favorable au principe de la mesure de dépistage obligatoire et a demandé que soit préparée la décision à intervenir, sans pour autant dessaisir le ministre et le secrétaire d'Etat concernés ; qu'à la suite de cette demande, une réunion interministérielle s'est tenue à Matignon le 9 mai 1985 sous la présidence de François Gros, conseiller du Premier ministre chargé de la recherche ; Que, par une note du 13 mai 1985, celui-ci a informé le directeur de cabinet des résultats de la réunion, en faisant état des principales positions en présence et en indiquant que l'instruction du dossier se poursuivait en vue d'une généralisation du test ; que cette note a été portée à la connaissance de Laurent Fabius, qui ne l'a assortie d'aucune observation particulière ; Que le compte rendu officiel de la réunion du 9 mai, ou « bleu », a été établi le 17 mai et diffusé par le Secrétariat général du gouvernement le 22 mai ; que, comme il est d'usage, ce document mentionne in fine les orientations arrêtées à l'issue de la réunion, notamment que « le dossier d'enregistrement d'Abbott soit encore retenu quelque temps au Laboratoire national de la santé » ; que, toutefois, cette question n'était pas évoquée dans la note du 13 mai 1985 remise au Premier ministre et il est établi que celui-ci n'en a jamais été personnellement saisi ; que l'affirmation de l'arrêt du renvoi, selon laquelle l'intention exprimée de différer l'enregistrement du test en cause, concurrent du test de Diagnostics Pasteur, « ne peut être que la traduction d'instructions données par le chef du gouvernement », n'est corroborée par aucun des éléments du dossier ni par les débats ; Attendu que, de même, aucun élément de fait ne permet de confirmer l'allégation de l'arrêt de renvoi selon laquelle le Premier ministre aurait personnellement empêché le secrétaire d'Etat à la Santé d'annoncer le 22 mai 1985, lors d'un colloque tenu à Bordeaux, la résolution du gouvernement de généraliser le dépistage des dons du sang ; Attendu que Laurent Fabius a été à nouveau saisi de la question du dépistage par une note de François Gros en date du 14 juin ; que le Premier ministre a aussitôt demandé, en urgence, des informations complémentaires qui lui ont été fournies par une nouvelle note du 18 juin ; Que c'est à l'issue de cette première partie du processus interministériel que le Premier ministre a annoncé à l'Assemblée Nationale, le 19 juin 1985, la décision prise par le gouvernement de rendre le dépistage obligatoire rapidement ; Que, au cours de la période qui a suivi, l'attention du Premier ministre a été attirée par des courriers des 28 et 29 juin 1985, reçus le 1er juillet, signalant la nécessité de prendre sans délai les mesures d'application de la décision annoncée ; qu'il a transmis ces courriers à son cabinet en soulignant à son tour l'urgence de la mise en œuvre de ces mesures ; Qu'ont alors été organisées, sous la présidence d'un membre du cabinet du Premier ministre, trois réunions interministérielles ayant pour objet de définir les procédures d'exécution de la décision relative au dépistage ; qu'au cours de ces réunions, qui se sont tenues les 12, 17 et 22 juillet 1985 et auxquelles ont participé les représentants des six ministères concernés, les questions relatives à la généralisation du test, à la protection de la production nationale et au financement de la mesure ont été évoquées ; que les arrêtés ministériels rendant obligatoire le dépistage et augmentant le prix des produits sanguins de manière à y intégrer le coût du nouveau test ont été pris le 23 juillet 1985 publiés au Journal Officiel dès le lendemain ; que la date retenue par ces arrêtés pour l'application du dépistage obligatoire a été fixée au 1er août et non au 1er octobre, comme il avait été primitivement envisagé par les directions administratives concernées ; Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte ni du dossier, ni des débats, que la question du rappel des transfusés ait été expressément soumise au Premier ministre ; que l'insuffisance, sur ce point, des prescriptions de la circulaire du directeur général de la Santé du 2 octobre 1985, ne peut en conséquence être retenue à son encontre ; Attendu qu'en définitive le dépistage des dons de sang, mis en œuvre dès juillet 1985 dans la plupart des centres de transfusion, a été imposé et généralisé en France sans retard, par comparaison avec le calendrier observé dans la plupart des autres pays du monde (troisième en Europe, cinquième au niveau mondial) ; Qu'il apparaît dans ces conditions, compte tenu des connaissances de l'époque, que l'action de Laurent Fabius a contribué à accélérer les processus décisionnels et que, dès lors, ne sont pas constitués, à son encontre, les délits prévus par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal ; VI - Sur les faits reprochés à Georgina Dufoix Attendu que Georgina Dufoix, ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale, bien que disposant d'une délégation générale de pouvoirs au titre de l'article 21 de la Constitution pour l'ensemble des problèmes relevant de son ministère, s'en est remise au secrétaire d'Etat à la Santé, placé sous son autorité, pour les questions entrant dans les compétences de ce dernier, dès lors qu'elles n'avaient pas d'implications financières ; Qu'il n'apparaît pas que l'intervention du ministre ait été nécessaire avant la décision du Premier ministre, du 19 juin 1985, sur le dépistage obligatoire de tous les prélèvements sanguins ; Qu'à compter de cette date, aucun retard n'a été apporté dans la mise en place de cette mesure par les arrêtés du 23 juillet 1985, notamment dans sa prise en charge par la Sécurité Sociale, directement rattaché à Georgina Dufoix ; Qu'à cet égard, il résulte des débats que cette dernière a refusé de donner son accord à des projets d'arrêtés, établis le 12 juillet 1985 sous le double timbre de la direction générale de la Santé et de la direction de la Sécurité sociale, qui prévoyaient un système de conventionnement favorisant Diagnostics Pasteur et envisageaient de fixer, non pas au 1er août 1985 mais au 1er octobre seulement, l'entrée en vigueur du dépistage obligatoire ; Qu'en ce qui concerne les mesures d'accompagnement de ce dépistage, il n'est pas établi que l'attention de la prévenue ait été appelée sur la nécessité d'instaurer de telles mesures dont l'initiative incombait au secrétaire d'Etat et à ses services ; Attendu qu'ultérieurement, lorsque s'est posée la question de l'inscription des tests utilisés dans les laboratoires d'analyse médicale à la nomenclature de la Sécurité sociale, il n'est pas contesté que la différenciation, qui a pu intervenir entre les divers tests, a été sans conséquence pour la santé publique, dès lors que le test inscrit à la nomenclature était fiable et disponible en quantité suffisante ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de retenir Georgina Dufoix dans les liens de la prévention ; VII - Sur les faits reprochés à Edmond Hervé Attendu que, par circulaire du 20 juin 1983, signée du professeur Roux, directeur général de la Santé, le secrétaire d'Etat à la Santé a prescrit d'écarter des dons du sang les personnes à risques, au moyen d'un interrogatoire ; que cette circulaire n'a été que peu ou pas appliquée par les transfuseurs ; Que la responsabilité d'une telle situation relève essentiellement de l'organisation de la transfusion sanguine à l'époque des faits, ainsi que de considérations « d'ordre culturel » qui ont prévalu sur les impératifs de santé publique ; que cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les collectes de sang en milieu carcéral ; Mais attendu qu'il n'est pas démontré que le secrétaire d'Etat ait été complètement informé, par ses conseillers et par ses services, de la non - application de la circulaire du 20 juin 1983 et des risques inhérents à l'absence de sélection systématique des donneurs; Qu'au surplus, aucun lien de causalité, même indirect, ne peut être relevé entre cette absence de sélection et la mort ou l'incapacité de celles des victimes que retient l'arrêt de renvoi ; Attendu qu'il est également reproché à Edmond Hervé de ne pas avoir pris conscience de l'ampleur de la contamination sanguine par le virus HIV ni de la nécessité de recourir au dépistage généralisé des dons du sang, au motif que, lors de la réunion interministérielle du 9 mai 1985, son représentant avait estimé qu'un tel dépistage ne se justifiait pas en termes de santé publique ; Que, toutefois, il est établi que le secrétaire d'Etat n'avait pas été informé des questions qui allaient être abordées au cours de cette réunion et que, par ailleurs, il avait l'intention d'annoncer le 22 mai 1985, au congrès d'hématologie de Bordeaux, la décision de généraliser le dépistage ; Que, si cette annonce a été différée jusqu'au 19 juin 1985, il ne résulte ni de l'instruction, ni des débats, que cela lui soit imputable et que, après cette date, il puisse lui être reproché une faute quelconque de négligence dans le délai d'élaboration des arrêtés du 23 juillet suivant ou dans la mise en place obligatoire du dépistage des dons du sang ; Attendu que, par contre, comme l'arrêt de la commission d'instruction le relève, Edmond Hervé devait veiller, à raison de ses responsabilités propres, à édicter la réglementation nécessaire pour que soit préservée, en toutes circonstances, la qualité du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques ; Qu'il aurait dû, en particulier, prendre les mesures d'accompagnement des arrêtés du 23 juillet 1985, afin d'imposer le dépistage obligatoire ou la destruction des produits sanguins prélevés avant le 1er août 1985 et qui n'avaient pas été testés ou inactivés ; qu'il lui appartenait, en outre, de donner les instructions nécessaires pour que soient recherchées et rappelées les personnes susceptibles d'avoir été antérieurement contaminées par voie de transfusion sanguine ; Attendu que, à cet égard, Edmond Hervé a commis une faute d'imprudence ou de négligence et un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence qui lui était imposée par le code de la santé publique ; que cette faute et ce manquement ne sont en relation de causalité, au moins indirecte, qu'avec le décès de Sarah Malik, contaminée au stade fœtal en l'absence du rappel de sa mère, transfusée le 25 avril 1985, ainsi qu'avec l'incapacité totale de travail subie par Sylvie Rouy, à la suite de sa contamination, le 2 août 1985, par un don de sang non testé, prélevé le 13 juillet 1985 ; qu'il doit, en conséquence, être déclaré coupable pour ces faits des articles 319 et 320 anciens et 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal ; Sur l'application de la peine Attendu que quinze ans se sont écoulés depuis les faits et cinq ans entre la mise en mouvement de l'action publique par la commission des requêtes près la Cour de justice de la République et le jugement des trois anciens membres du gouvernement ; qu'au cours de ces années de nombreuses thèses se sont opposées au sujet de l'affaire du sang contaminé, portant des accusations sur l'action et la responsabilité des ministres sans que ceux-ci aient été en mesure de se défendre ; Que, dans un tel contexte, Edmond Hervé n'a pu bénéficier totalement de la présomption d'innocence, en étant soumis, avant jugement, à des appréciations souvent excessives, comme c'est trop fréquemment le cas pour d'autres justiciables ; Que dès lors, compte tenu des circonstances, il y a lieu de le dispenser de peine, par application de l'article 469-1 du code de procédure pénale ; Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, à l'égard des trois prévenus, La Cour, Rejette les conclusions déposées le 23 février 1999 par Maître Maisonneuve et Maître Welzer pour Edmond Hervé, les conclusions déposées le 25 février par Maître Cahen pour Georgina Dufoix, ainsi que les conclusions déposées le même jour par Maître Maisonneuve et Maître Welzer pour Edmond Hervé ; Déclare non constitués, à la charge de Laurent Fabius et de Georgina Dufoix, les délits qui leur sont reprochés, d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité physique des personnes ; Les renvoie des fins de la poursuite ; Déclare non constitués, à la charge d'Edmond Hervé, les délits d'atteintes involontaires à la vie de Paul Pérard, Charles-Edouard Pernot-Cochin, Hanattah Malik et Pierre Roustan et d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'Yves Aupic ; Le renvoie, de ces chefs, des fins de la poursuite ; Déclare Edmond Hervé coupable des délits d'atteinte involontaire à la vie de Sarah Malik et d'atteinte involontaire à l'intégrité physique de Sylvie Rouy prévus et réprimés par les articles 319 et 320 anciens et 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal Le dispense de peine. |
LES HAUTES JURIDICTIONS INTERNES
Présidé par le ministre de la justice dont la voix compte double, le Tribunal des Conflits est saisi que sur le renvoi des juridictions administratives ou judiciaires.
Le Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 est relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
LE CONSEIL D'ÉTAT a pour compétence de constater si les juridictions administratives ont ou non appliqué le droit et s'il n'y a pas eu de violation de la loi.
 Il a aussi une
compétence en premier ressort attribué par des textes spéciaux notamment le contentieux des élections européennes ou les décrets du Président de la République ou du Premier ministre.
Il a aussi une
compétence en premier ressort attribué par des textes spéciaux notamment le contentieux des élections européennes ou les décrets du Président de la République ou du Premier ministre.
Il a aussi une compétence en appel d'attribution par des textes spéciaux notamment contre les décisions des juridictions arbitrales des collectivités locales avec certains de leur fournisseurs ou encore sur les décisions du Conseil des prises pour statuer du sort des prises maritimes en temps de guerre.
LA COUR DE CASSATION a pour compétence unique de constater si les juridictions inférieures ont ou non appliqué le droit et s'il n'y a pas eu violation de la loi
Le ministère d'avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat est obligatoire. Il vous conseille utilement sur les chances de vos pourvois.
 Toutefois, devant la chambre criminelle
de la Cour de cassation, une partie peut déposer seule, son pourvoi dans les cinq jours après la date de la décision attaquée (articles 568 et 576 du C.P.P)
Toutefois, devant la chambre criminelle
de la Cour de cassation, une partie peut déposer seule, son pourvoi dans les cinq jours après la date de la décision attaquée (articles 568 et 576 du C.P.P)
IL FAUT SE DÉPLACER AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION ATTAQUÉE POUR FAIRE SON POURVOI QUI DOIT ÊTRE SIGNÉ PAR LE JUSTICIABLE ET LE GREFFE.
Il faut laisser le greffe rédiger le pourvoi car son éventuelle faute dans sa rédaction ne peut porter préjudice au justiciable.
LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
La Cour Administrative d'Appel a pour compétence d'examiner en appel les jugements des tribunaux administratifs.
Il existe sept cours administratives d'appel en France métropolitaine: Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes et Paris.
Les règles de représentation sont les mêmes que celles appliquées devant les tribunaux administratifs.
LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Pour un recours en excès de pouvoir, il est possible de déposer une requête en excès de pouvoir seul pour tenter de faire annuler une décision administrative de justice.
Pour un recours de "plein contentieux" aux fins de demander une indemnité, le ministère d'un avocat est obligatoire. Il vous conseillera utilement.
LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES NON PÉNALES
LES COURS D'APPEL JUDICIAIRES
Sa compétence s'étend à l'examen de toutes les décisions de première instance du T.G.I et de toutes les décisions des juridictions d'attribution susceptible d'appel. Il existe 30 Cours d'Appel en France métropolitaine:
 Agen, Aix en Provence, Amiens, Angers,
Agen, Aix en Provence, Amiens, Angers,
Bastia, Besançon, Bordeaux, Bourges
Caen, Chambéry, Colmar,
Dijon, Douai, Grenoble,
Limoges, Lyon, Metz, Montpellier,
Nancy, Nîmes, Orléans,
Paris, Pau, Poitiers,
Rennes, Reims, Riom, Rouen,
Toulouse, Versailles.
LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
Le ministère d'avocat est obligatoire. Il vous conseillera utilement. C'est la juridiction civile de droit commun chargée d'étudier tous les recours.
LES COURS D'ASSISES JUGENT LES CRIMES
Il y a une cour d'assises par département pour juger les crimes. Elles sont composées de trois magistrats professionnels et de neuf citoyens jurés tirés au sort. Sur mise en accusation de la chambre d'instruction, elles jugent des reproches qualifiés de crime par la loi. Ses arrêts sont susceptibles d'appel devant une autre Cour d'assises d'un autre département. Un crime fait l'objet d'une instruction avant jugement.
 Article 327 du Code de Procédure Pénale
Article 327 du Code de Procédure Pénale
Le président de la cour d'assises présente, de façon concise,
les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.
Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi.
Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.
A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.
Article 236 du Code de Procédure Pénale
La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
Article 245 du Code de Procédure Pénale
Le président de la cour d'assises est désigné par ordonnance du premier président.
Article 250 du Code de Procédure Pénale
Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président.
Article 296 du Code de Procédure Pénale
Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel.
La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
Article 298 du Code de Procédure Pénale
Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.
Article 306 du Code de Procédure Pénale
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.
L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Par dérogation au huitième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la cour d'assises des mineurs peut décider que le présent article est applicable devant elle si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et que cette dernière, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande. Elle ne fait pas droit à cette demande lorsqu'il existe un autre accusé toujours mineur ou que la personnalité de l'accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soit pas publics. Dans les autres cas, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile, après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Lorsque les débats devant la cour d'assises des mineurs sont publics en application de l'alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l'objet d'une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits, sous peine d'une amende de 15 000 €, sauf si l'intéressé donne son accord à cette publication.
Article 355 du Code de Procédure Pénale
Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.
Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
Article 359 du Code de Procédure Pénale
Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.
Article 362 du Code de Procédure Pénale
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.
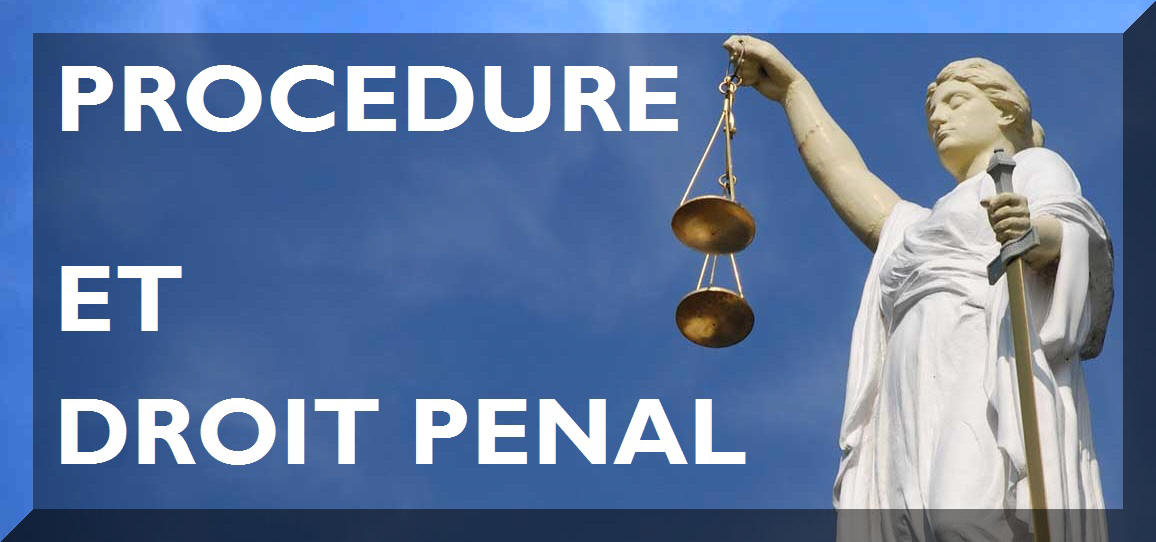 JURIDICTIONS SPÉCIALES POUR MINEURS
JURIDICTIONS SPÉCIALES POUR MINEURS
Jusque l'âge de 13 ans, les enfants sont pénalement irresponsables et ne peuvent donc pas être jugés par une juridiction pénale. Le procureur renvoie le prévenu devant le juge pour enfant.
L'Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 réprime l'enfance délinquante. Le contrôle judiciaire est prévu pour les crimes ou délits les plus graves. Le mineurs de 16 à 18 ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
La Cour d'assises pour mineurs juge à huis clos, les adolescents accusés de crime et âgés d'au moins 16 ans au moment de l'infraction.
Le tribunal pour enfants jugent les faits graves à huis clos pour tous les enfants de 13 à 16 ans et les délits des adolescents âgés d'au moins 16 ans.
Le juge pour enfants juge, seul dans son cabinet, les affaires bénignes reprochés aux enfants et adolescents d'au moins 13 ans.
La LOI n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 vise à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants âgés de plus de seize ans.
LE CURATEUR DOIT ETRE PREVENU DE TOUTE PROCEDURE PENALE CONTRE UN INCAPABLE PROTEGE
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 29 janvier 2013, pourvoi N° 12-82100 Cassation
Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne
fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ;
Attendu que Mme X... a été poursuivie pour violences aggravées alors qu'elle était placée sous curatelle ; que, condamnée en première instance à une peine de
trois mois d'emprisonnement, elle a interjeté appel de ce jugement, le ministère public formant un appel incident ; que la cour d'appel a confirmé cette décision;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le curateur de la prévenue n'avait été informé ni des poursuites ni du jugement de condamnation prononcé à son
encontre et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé
Cliquez sur l'un des boutons pour accéder aux autres juridictions pénales.
LES JURIDICTIONS CIVILES D'ATTRIBUTION
Le Tribunal d'Instance a une compétence dite "matérielle" pour tout litige inférieur à 7 600 euros.
Devant le Tribunal d'Instance, le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire, chacun peut plaider seul ou se faire présenter par un membre familial, s'il a quelques connaissances juridiques.
L'article 828 du Code de Procédure Pénale prévoit que chacun peut se faire représenter par:
"-un avocat;
-leur conjoint;
-leurs parents ou alliés en ligne directe;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise"
TOUT REPRÉSENTANT, S'IL N'EST PAS AVOCAT, DOIT ÊTRE MUNI DEVANT LE TRIBUNAL D'UN MANDAT SPÉCIAL AVEC POUVOIR DE VOTRE PART.
Il existe 473 tribunaux d'instance, situés, en principe, au chef lieu de chaque arrondissement : 462 en métropole, 11 dans les départements d'outre-mer.
La compétence des tribunaux de commerce est prévue par l'article L 411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire:
"Les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux;
2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées."
Article L 411-5 du Code de l'Organisation Judiciaire:
"Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non commerçants.
Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, de trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur"
Article L 411-6 du Code de l'Organisation Judiciaire:
"Les tribunaux de commerce ne connaissent pas des litiges liés aux sociétés civiles de profession libérale"
Article L 411-7 du Code de l'Organisation Judiciaire:
"Les tribunaux de commerce ne connaissent pas des litiges contre les propriétaires, cultivateurs, vignerons et les commerçants pour leurs achats personnels"
Il existe aujourd'hui 191 tribunaux de commerce. En cas d'inexistence du tribunal de commerce dans le ressort du T.G.I, c'est le T.G.I lui - même qui se réunit en chambre commerciale selon les règles de procédure commerciale.
Composés d'employeur et de salariés ils ont compétence pour tous litiges liés dans les relations de travail employé employeur.
Dans chaque Conseil des Prud’hommes il y a une formation de référé, une juridiction de départage et 5 sections :
Activités diverses
Agriculture
Commerce et services commerciaux
Encadrement
Industrie
Chaque section est une juridiction autonome qui a compétence pour traiter des litiges correspondants à son intitulé et est composée d’au moins quatre conseillers salariés et quatre conseillers employeurs et constituée de :
un bureau de conciliation constitué d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur
un bureau de jugement constitué de deux conseillers salariés et deux conseillers employeurs
 LES
TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX
LES
TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX
Le tribunal a pour compétence de trancher les litiges entre les bailleurs et les preneurs en matière de bail rural.
Le juge d'instance préside le tribunal paritaire des baux ruraux. Il est assisté de quatre assesseurs non professionnels élus: deux sont des propriétaires et deux des métayers ou des fermiers.
Le tribunal paritaire des baux ruraux compétent est celui du lieu de situation des terrains.
Le tribunal est saisi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son greffe.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances et pour un tarif modique, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.