ARTICLE 8 DE LA CEDH
Pour plus de sécurité, fbls article 8 est sur : https://www.fbls.net/8.htm
Aucun cookie garanti = liberté préservée pour chacun !
"L'article 8 protège la vie familiale et le domicile
au sens très large"
Frédéric Fabre docteur en droit.
ARTICLE 8 DE LA CEDH : "1/ Toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits de libertés d'autrui" - la méthode de la CEDH pour savoir s'il y a violation de l'article 8, l'exemple des expulsions des étrangers - les expulsions des étrangers
et déchéance de nationalité au regard de l'article 8 - la collecte
et la conservation des données et le droit à la vie privée de l'article 8 - l'article 8 et le fichage de la police - le droit à la vie privée de l'article 8 face au droits artistiques d'une oeuvre littéraire. - les articles de presse et à la radio contre une personne - les témoignages, photos ou vidéos des personnalités publiées dans la presse - le droit à la vie privée de l'article 8 et le secret bancaire - le droit à la protection de la réputation et le droit à l'oubli - la protection des lanceurs d'alerte - L'emploi est protégée par l'article 8 - l'examen de la vie privée et publique d'un citoyen avant ou après l'avoir nommé fonctionnaire CLIQUEZ SUR L'UN DES BOUTONS POUR ACCEDER A LA PROTECTION DE L'ARTICLE 8Cliquez
sur un bouton ou un lien bleu pour accéder gratuitement à LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH :
MOTIVATIONS REMARQUABLES
Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 24 juin 2020 pourvoi n° 19-15198
5. Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
6. Aux termes de l’article 14 de la même Convention, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
EXAMEN D'UN GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8
LA CEDH RECHERCHE UNE RÉPONSE A QUATRE QUESTIONS
UNE APPLICATION CONCRÈTE AUX EXPULSIONS DES ETRANGERS CONDAMNES A UNE PEINE DE PRISON.
MALGRE DES LIENS FAMILIAUX, ILS SUBISSENT LEUR PEINE, PUIS SONT ENSUITE EXPULSES. CETTE EXPULSION EST APPELEE LA "DOUBLE PEINE"
Première question: EST-CE UNE INGERENCE ?
Arrêt Dalia contre France du 19/02/1998 Hudoc 750 requête 26102/95
"La Cour ne doute pas que le rejet par la Cour d'appel de Versailles en 1994 de sa demande en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire adoptée en 1985 s'analyse en une ingérence dans le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale"
Arrêt Boultif contre Suisse du 02/08/2001 Hudoc 2767 requête 54273/00
Deuxième question: CETTE INGERENCE EST-ELLE PERMISE PAR LA LOI ?
Arrêt Geleri contre Roumanie du 15 février 2011 requête 33118/05
Son expulsion n'était pas permise par la loi interne roumaine
Le requérant, Zeyneddin Geleri, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à Chişinău (Moldova). A l’époque des faits de cette affaire, il résidait régulièrement à Bucarest (Roumanie). Le statut de réfugié politique lui avait été accordé en 1998 puis confirmé de façon définitive en 2001. En 2003, il épousa une ressortissante roumaine avec laquelle il eut une fille en 2005. Il était associé de deux sociétés commerciales.
Par une ordonnance du 21 février 2005, le procureur du parquet près la cour d’appel de Bucarest déclara M. Geleri indésirable et l’interdit de séjour en Roumanie pour dix ans, au motif que « des informations suffisantes et sérieuses indiquaient qu’il se livrait à des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ». Le 23 février 2005, cette ordonnance fut communiquée à M. Geleri sans autre explication et, le jour même, il fut expulsé vers l’Italie2.
Le 28 février 2005, l’avocat de M. Geleri contesta l’ordonnance d’expulsion devant la cour d’appel de Bucarest. Il dénonçait notamment le fait que cette ordonnance n’était pas motivée. Il faisait également valoir que M. Geleri vivait depuis longtemps en Roumanie, était marié à une Roumaine avec laquelle il avait eu une fille, et était associé dans des sociétés commerciales en Roumanie. Par une décision définitive du 3 mars 2005, la cour d’appel de Bucarest rejeta la contestation comme mal fondée. Elle jugea en particulier que les éléments sur lesquels est fondée la décision déclarant un étranger indésirable pour des raisons de sûreté nationale ne peuvent, sans exception, être portées à la connaissance de la personne intéressée, car ces informations sont secrètes en vertu de la loi. La cour d’appelle ajouta que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle avait confirmé la constitutionnalité de cette règle.
En avril 2005, l’office roumain pour les réfugiés annula le statut de réfugié de M. Geleri. La contestation en justice de ce dernier fut définitivement rejetée par la Haute Cour de cassation et de justice le 7 décembre 2006.
Atteinte alléguée au droit au respect à la vie privée et familiale (article 8)
La Cour constate tout d’abord que l’expulsion et l’interdiction de territoire prononcées contre M. Geleri ont porté atteinte tant à sa «vie privée» qu’à sa «vie familiale». Une telle situation peut toutefois être conforme à la Convention, si elle est « prévue par la loi », poursuit un but légitime et est «nécessaire dans une société démocratique».
Dans le cas de M. Geleri, la Cour concentre son raisonnement sur le point de savoir si les mesures prises étaient « prévues par la loi ». Elle rappelle que la «loi» en question doit notamment protéger l’intéressé contre l’arbitraire des autorités, en lui offrant la possibilité de faire contrôler la mesure litigieuse par un organe indépendant et impartial, habilité à se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes.
Or, l’organe ayant examiné le recours de M. Geleri - à savoir la cour d’appel de Bucarest - s’est limité à un examen purement formel de son ordonnance d’expulsion. De plus, aucune précision quant aux faits reprochés à M. Geleri n’a été fournie à la cour d’appel, de sorte que cette dernière n’a pas pu aller au-delà des affirmations du parquet pour vérifier si l’intéressé présentait réellement un danger pour la sécurité nationale ou pour l’ordre public.
Les mesures prises contre M. Geleri ne lui ont donc pas garanti un degré minimal de protection contre l’arbitraire. Aussi, l’ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale n’était-elle pas prévue par une « loi » répondant aux exigences de la Convention. L’article 8 a donc été violé.
Troisième question: SI LA LOI L'AUTORISE, LE BUT EST-IL LEGITIME ?
Arrêt Dalia contre France du 19/02/1998 Hudoc 750 requête 26102/95
"Il incombe aux Etats contractant d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôles, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d'expulser les délinquants parmi ceux-ci"
Arrêt Boultif contre Suisse du 02/08/2001 Hudoc 2767 requête 54273/00
"La défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales est au sens de l'article 8§2 car le requérant est expulsé du fait de la gravité des infractions"
Quatrième question: EST-CE NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE ?
La Cour met en balance :
Le but légitime et L'ingérence sur la vie familiale
La Cour constate dans chaque espèce, s'il y a une disproportion ou non entre le but légitime et les conséquences personnelles sur les individus:
LES 10 CRITERES POUR DETERMINER LA NECESSITE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE
Arrêt Udeh C. Suisse du 16 avril 2013 requête 12020/09
La CEDH précise les 10 critères pour savoir si l'expulsion d'un Etranger est compatible avec les nécessités démocratiques prévues dans l'article 8 de la Convention. En l'espèce l'expulsion vers le Nigéria serait une violation .
iii. Nécessité dans une société démocratique de la mesure
α) Principes généraux
43. Il reste donc à examiner si la mesure était nécessaire dans une société démocratique.
44. A titre liminaire, il convient de rappeler que selon un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des étrangers sur leur sol (voir, parmi beaucoup d’autres, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, § 67, 28 mai 1985, série A no 94, Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI). La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de l’ordre public, les Etats contractants ont la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur leur territoire. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Mehemi c. France, 26 septembre 1997, § 34, Recueil 1997-VI, Dalia c. France, 19 février 1998, § 52, Recueil 1998-I, Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 46, CEDH 2001‑IX, et Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X).
45. Dans l’affaire Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, §§ 54-60, CEDH 2006‑XII, la Cour a eu l’occasion de résumer les critères devant guider les instances nationales dans de telles affaires (§§ 57 et suiv.) :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la nationalité des diverses personnes concernées ;
– la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
– la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
– la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
– la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
– l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
β) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
46. En ce qui concerne le cas d’espèce, la Cour reconnaît tout d’abord que la condamnation prononcée le 24 novembre 2006 par le tribunal d’arrondissement de la ville de Kleve (Allemagne) pour l’infraction en matière de stupéfiants (42 mois d’emprisonnement pour avoir essayé d’importer 55 doses de cocaïne pure, d’un poids total de 257 grammes) pèse certes lourdement. En ce qui concerne la condamnation du 18 août 2001, elle a été prononcée par la Cour des affaires relatives à la jeunesse (Jugendgerichtshof) de Vienne, trompée par le requérant sur son identité et son âge (paragraphe 6 ci-dessus). En réalité, il a commis cet acte en tant qu’adulte, soit à l’âge de 29 ans. Dès lors, il ne relève pas de la délinquance juvénile. Cette infraction n’a pas été punie très sévèrement, à savoir par une peine de quatre mois d’emprisonnement. Il s’avéra établi que le requérant ne possédait qu’une faible quantité de cocaïne. Par ailleurs, le requérant a bénéficié d’un sursis à l’exécution de cette peine. La Cour en conclut qu’il convient d’apprécier cette condamnation à sa juste mesure.
47. Il convient d’observer que le comportement criminel du requérant s’est limité à ces deux actes, un fait qui n’a pas été considéré comme pertinent par le Tribunal fédéral. La présente affaire se distingue donc notamment de l’affaire Emre c. Suisse (no 42034/04, §§ 72-76, 22 mai 2008), dans laquelle le requérant avait été condamné pour plus de 30 infractions. On ne saurait dès lors dire que le requérant aurait fait preuve d’une véritable énergie ou d’un potentiel criminel.
48. La Cour rappelle ensuite que le requérant est entré une première fois en Suisse en novembre 2001 et y a déposé une demande d’asile sans succès. Après avoir quitté la Suisse à une date non spécifiée, il y est revenu en septembre 2003 où il a épousé une ressortissante suisse deux mois plus tard. Il y a séjourné jusqu’en août 2006, lorsqu’il a été arrêté et placé en détention en Allemagne. Le 5 mai 2008, après avoir purgé sa peine et bénéficié d’une remise en liberté anticipée, il a regagné la Suisse et y a vécu jusqu’à aujourd’hui (voir paragraphe 12 ci-dessus). Lorsque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt, le 8 janvier 2009, il avait donc séjourné en Suisse depuis plus de 3 ans et demi. Aujourd’hui, au moment de l’adoption du présent arrêt, à défaut d’une mise en œuvre de l’ordre d’éloignement, la durée totale de son séjour en Suisse s’élève à plus de 7 ans et demi, ce qui constitue une durée considérable dans la vie d’un être humain. Il ne semble pas douteux que la Suisse constitue depuis assez longtemps le centre de la vie privée et familiale du requérant.
49. La Cour constate qu’il n’est pas contesté entre les parties que le comportement dont le requérant a fait preuve en prison et après avoir été remis en liberté, le 5 mai 2008, était irréprochable. Or, cette évolution positive, notamment le fait qu’il a été remis en liberté conditionnelle après avoir purgé une partie de sa peine, peut être prise en compte dans la pesée des intérêts en jeu (voir notamment Maslov, précité, §§ 87 et suiv., et Emre c. Suisse (no 2), no 5056/10, § 74, 11 octobre 2011). A cet égard, la Cour considère comme spéculatif l’argument du Gouvernement selon lequel la condamnation du requérant pour 42 mois d’emprisonnement laisse croire que celui-ci constituera à l’avenir un danger pour l’ordre et la sûreté publics.50. La Cour rappelle que le Tribunal fédéral n’a pas mis en doute que le premier requérant entretenait une relation réelle et étroite avec son ex-épouse et leurs enfants communs. Le Gouvernement n’a pas remis en cause cette constatation. Le couple a entre-temps divorcé. En revanche, il découle notamment des lettres du requérant des 21 août et 31 décembre 2012 qu’il s’efforce de maintenir un contact régulier avec ses enfants. Il découle en outre de l’arrêt relatif au divorce du tribunal de district de Liestal du 27 septembre 2012 que le droit de garde des deux enfants communs était attribué à la mère, mais que le requérant s’était vu octroyer un droit de visite, limité actuellement à un après-midi chaque deux semaines au moins. Dès lors, la Cour estime que les requérants peuvent se prévaloir de l’article 8 de la Convention ; par ailleurs, l’infraction principale a été commise par le requérant après la conception des enfants communs ; en d’autres termes, son épouse ne pouvait pas être au courant au moment de la création de la relation familiale, un fait qui joue un rôle considérable dans l’appréciation de la présente affaire. En revanche, en ce qui concerne la relation avec la nouvelle amie du requérant et la naissance de l’enfant issu de cette relation, ces faits ne peuvent pas être pris en compte dans l’examen de la Cour, étant donné qu’ils sont intervenus à un moment où le droit du requérant de séjourner en Suisse était déjà précaire. Il ne peut dès lors pas s’en prévaloir dans le cadre de la présente affaire, même dans l’hypothèse où il va se marier avec cette personne.
51. Ensuite, le Tribunal fédéral a observé que le requérant a grandi au Nigéria et, dès lors, devait y posséder encore un réseau familial intact. Selon cette juridiction, il pourrait s’intégrer assez facilement dans son pays d’origine. Par contre, il ne serait pas véritablement intégré en Suisse, ni professionnellement, ni socialement, et ne parlerait que mal l’allemand. Il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause ses allégations, non contestées par les requérants. Elle rappelle simplement que le Tribunal fédéral a reconnu les efforts des requérants pour échapper à leur dépendance de l’aide sociale et qu’il n’a pas exclu que la maladie du requérant (tuberculose) jouait un rôle sur le fait qu’il n’exerçait pas de véritable activité lucrative.
52. La Cour rappelle également que leurs filles jumelles, qui possèdent la nationalité suisse, sont nées en 2003. L’éloignement forcé du requérant est susceptible d’avoir pour conséquence qu’elles grandissent séparées de leur père. Selon le Tribunal fédéral, l’on ne pouvait guère exiger des requérantes qu’elles suivent le requérant dans ce pays. En tout état de cause, la Cour estime qu’il est dans l’intérêt supérieur des filles qu’elles grandissent auprès des deux parents et, eu égard au divorce intervenu, la seule possibilité de maintenir un contact régulier entre le requérant et les deux enfants est de l’autoriser à séjourner en Suisse, étant donné que l’on ne saurait s’attendre que la mère, avec les enfants communs, suive le requérant au Nigéria.
53. Enfin, le Gouvernement prétend que les contacts entre le requérant et ses filles jumelles ne seraient pas rendus impossibles en cas de renvoi au Nigéria. La Cour rappelle que, par une décision du 25 janvier 2011, l’Office fédéral des migrations a émis une interdiction d’entrée sur le territoire suisse à l’encontre du requérant, valable jusqu’au 26 janvier 2020. Quant à la faculté pour les intéressés de demander une levée temporaire ou définitive de l’expulsion, possibilité qui découle de cette décision (paragraphes 18 et 21 ci‑dessus), la Cour estime que, même dans l’hypothèse où les autorités compétentes accueilleraient favorablement une telle demande, ces mesures temporaires ne sauraient en aucun cas être considérées comme pouvant remplacer le droit des requérants de jouir de leur droit de vivre ensemble, qui constitue l’un des aspects fondamentaux du droit au respect la vie familiale (voir, mutatis mutandis, les arrêts Agraw c. Suisse, no 3295/06, § 51, et Mengesha Kimfe c. Suisse, no 24404/05, §§ 69-72, tous deux du 29 juillet 2010).
54. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier eu égard à leurs enfants communs, à la relation familiale qui existe réellement entre le requérant et les enfants ainsi qu’au fait que le requérant a commis une seule infraction grave et que son comportement ultérieur a été irréprochable, ce qui laisse supposer une évolution positive pour l’avenir, la Cour estime que l’Etat défendeur a outrepassé la marge d’appréciation dont il jouissait dans le cas d’espèce.
55. Partant, il y aurait violation de l’article 8 de la Convention si le requérant était expulsé.
KOLONJA c. GRÈCE du 19 mai 2016 requête 49441/12
Violation de l'article 8 : double peine : l'expulsion du requérant mariée à une grecque et père de deux enfants grecs après le délit d'achat de drogue est disproportionnée alors qu'il ne présentait plus de danger criminogène.
a) Principes généraux
46. La Cour rappelle qu’en matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue de l’obligation pour l’État d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger concerné et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration (par exemple, des précédents d’infractions aux lois sur l’immigration) ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion (Butt c. Norvège, no 47017/09, § 78, 4 décembre 2012).
47. Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsque tel est le cas ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8. Lorsque des enfants sont concernés, il faut prendre en compte leur intérêt supérieur (Jeunesse c. Pays‑Bas [GC], no 12738/10, §§ 108-109, CEDH 2014 et autres références citées).
48. La Cour estime, d’autre part, utile de rappeler les critères énumérés dans l’arrêt Üner c. Pays-Bas ([GC], no 46410/99, §§ 54-60, CEDH 2006‑XII) et devant être utilisés pour l’appréciation de la question de savoir si une mesure d’expulsion, comme celle de l’espèce, était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi. Ces critères sont les suivants :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la nationalité des diverses personnes concernées ;
– la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
– la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
– la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
– la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
– l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
b) Application des principes en l’espèce
49. La Cour estime que l’interdiction pérenne qui a été faite au requérant de revenir sur le territoire grec a constitué une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale, qui était prévue par la loi et qui poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Reste alors à examiner si ladite ingérence était proportionnée aux buts poursuivis et donc nécessaire dans une société démocratique.
50. En l’espèce, le requérant était un albanais d’origine grecque résidant et travaillant en Grèce depuis 1989, marié avec une ressortissante grecque avec laquelle il avait eu deux enfants ayant la nationalité grecque. Ses trois frères avaient des cartes d’identité spéciale pour étrangers d’origine grecque (ομογενείς). Même si le statut officiel du requérant, et notamment la régularité de sa présence sur le territoire grec, entre l’année de son arrivée en 1989 et celle de son expulsion en 2004, ne ressort pas du dossier, la Cour note que ni le Gouvernement dans ses observations devant elle, ni les juridictions nationales ayant eu à se prononcer sur le cas du requérant n’ont fait d’allusion à un éventuel statut de migrant irrégulier de celui-ci. Compte tenu des origines du requérant, du statut spécial reconnu en Grèce aux ressortissants albanais d’origine grecque et de son installation en Grèce longtemps avant la commission de l’infraction lui ayant valu son expulsion, la Cour considère qu’elle peut assimiler son cas à celui d’un « immigré établi » au sens de la jurisprudence Üner précitée. Pour examiner la proportionnalité de l’ingérence litigieuse, la Cour s’appuiera alors sur les critères indiqués dans cet arrêt.
51. La Cour estime opportun de souligner d’emblée les faits suivants. La cour d’appel d’Athènes qui a condamné en 1999 le requérant pour achat de produits stupéfiants a en même temps prononcé une mesure d’interdiction définitive du territoire grec après que celui-ci eût purgé sa peine. Libéré sous condition pendant la même année, il a été renvoyé en Albanie, en 2004, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel. Toutefois, en juin 2007, il est revenu clandestinement en Grèce. Le 5 octobre 2011, il a été arrêté et détenu en vue de son expulsion ordonnée le 6 octobre 2011 par le directeur de la Direction de police de Corfou. Mis en liberté le 7 octobre 2011, le requérant a été expulsé en vertu de la décision du 3 août 2012 du directeur général de la police des îles Ioniennes. Le requérant a donc violé l’interdiction d’entrer sur le territoire grec. Il est revenu et travaillé illégalement pendant plus de quatre ans alors qu’il ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à y rester légalement.
52. Toutefois, en libérant le requérant sous condition, le 2 décembre 1999, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Corfou a considéré dans sa décision no 225/1999, que celui-ci n’aurait pas fait preuve d’un potentiel criminel : elle a souligné que le comportement du requérant pendant son incarcération était bon, qu’il n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire, qu’il était travailleur et semblait regretter son acte. Elle a aussi relevé que son expulsion et donc la séparation de sa famille, lui causerait ainsi qu’à son épouse et sa fille des problèmes psychologiques et économiques très graves. Or, cette évolution positive de la situation du requérant peut être prise en compte dans la pesée des intérêts en jeu.
53. En deuxième lieu, la Cour note qu’à la date de son renvoi en Albanie, en août 2012, la durée totale du séjour du requérant en Grèce s’élevait à vingt ans environ, ce qui constitue une durée considérable équivalant presque à la moitié de son âge. Il ne fait pas de doute que la Grèce constitue depuis très longtemps le centre de sa vie privée et familiale.
54. En troisième lieu, les juridictions internes ont souligné l’atteinte au droit protégé causée par la mesure incriminée. Outre la décision no 225/1999 précitée de la chambre d’accusation, dans sa décision no 14/2011, le président du tribunal administratif de Corfou constatait que, pendant toute la durée de son séjour en Grèce après avoir purgé sa peine, le requérant n’avait pas fait preuve d’un comportement pénalement répréhensible ou d’une incivilité de nature à mettre l’ordre public en danger. Il notait aussi que la famille du requérant résidait de manière stable et constante dans une maison dont elle était propriétaire, que celui-ci n’était pas dangereux pour l’ordre public et ne risquait pas de fuir et que s’il était mis en liberté, il serait facile de le retrouver. Compte tenu de ce raisonnement, la Cour considère que le passé criminel du requérant ne devrait pas représenter un facteur déterminant dans la présente affaire.
55. Enfin, le tribunal administratif de Corfou, dans sa décision no 26/2012, a considéré que l’expulsion du requérant lui causerait un dommage difficilement réparable, qui consisterait en la destruction des relations familiales qu’il avait jusqu’alors tissées en Grèce. À cet égard, il s’est référé aux faits que son épouse et l’un des enfants avaient acquis la nationalité grecque, qu’il résidait dans une maison dont les propriétaires étaient son épouse et ses deux frères et que ses parents et ses frères résidaient légalement en Grèce et étaient munis d’une carte de séjour spéciale d’albanais d’origine grecque. Le tribunal a en outre estimé que la mesure litigieuse n’était pas justifiée par des motifs impérieux d’intérêt public.
56. En quatrième lieu, la Cour note que tant la femme du requérant que ses deux enfants possèdent la nationalité grecque. Si sa fille a déjà 21 ans, son fils, né aussi en Grèce, n’a que six ans et va à l’école primaire. Il a, comme sa sœur, vécu toute sa vie en Grèce et n’a aucune attache avec l’Albanie. Les liens donc du requérant avec la Grèce étaient particulièrement tenus. Son éloignement à vie est susceptible d’avoir pour conséquence que son fils grandisse séparé de son père, alors que son intérêt supérieur est qu’il grandisse auprès de ses deux parents.
57. Compte tenu des critères développés dans sa jurisprudence (Üner précité) et de ce qui précède, en particulier du caractère pérenne de l’interdiction du territoire, de la relation familiale qui existe entre le requérant et sa femme et ses enfants, du fait que le requérant a commis une seule infraction grave en 1999 et que son comportement ultérieur laisse supposer, de l’avis même des juridictions grecques, que celui-ci ne démontre pas une propension à la délinquance, de la durée totale du séjour du requérant en Grèce, de la nationalité grecque des membres de sa famille, de l’âge du deuxième enfant du requérant, de l’intérêt et du bien-être de celui-ci, la Cour juge qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé en l’espèce, dans la mesure où l’interdiction pérenne du territoire grec faite au requérant n’était pas proportionnée aux buts poursuivis.
58. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
Arrêt Moustaquim contre Belgique précité
La Cour constate que d'une part:
-Les premières infractions remontent à l'adolescence, les seconds faits reprochés ont été relaxés, pour les troisièmes faits reprochés, il a subi 16 mois de détention puis est resté libre durant 22 mois sans qu'il ne commette de nouvelles infractions.
D'autre part:
-Tous ses proches, parents frères et soeur vivent à Liège. Il est arrivé en Belgique alors qu'il avait moins de deux ans. Certains de ses frères et soeurs sont de nationalité belge. Son expulsion ne peut que gravement perturber sa vie familiale.
Par conséquent:
"Il y a eu disproportion entre les moyens employés et le but légitime"
Arrêt Mehemi contre France du 26/09/1997 Hudoc 709 requête 25017/94
La Cour constate d'une part:
-Le requérant a trois enfants en bas - âge de nationalité française et une épouse qui vit en France. Il a toujours vécu en France jusqu'à l'âge de 33 ans et y a effectué toute sa scolarité.
D'autre part:
-Il a été arrêté avec quatre français qui eux, n'ont pas été expulsés pour le transport de 142 Kg de haschish.
Par conséquent, il n'y a pas de proportionnalité entre l'ingérence de sa vie familiale et le but légitime poursuivi.
Arrêt Dalia contre France précité
"La tâche de la Cour consiste à déterminer si le refus de relever la requérante de la mesure litigieuse a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la présence des infractions pénales"
La Cour constate d'une part:
-le trafic de drogue, le commerce d'héroïne et la participation directe de la requérante.
D'autre part:
-la nationalité française de ses enfants mais aussi sa situation irrégulière sur le territoire.
Par conséquent:
"la mesure d'interdiction du territoire en son encontre ne peut passer pour disproportionné aux buts légitimes poursuivis"
Partant, il n'y a pas de violation de l'article 8.
Arrêt Boultif contre Suisse précité
"Pour apprécier les critères pertinents en pareil cas, la Cour prendra en compte la nature et la qualité de l'infraction commise par le requérant, la durée de séjour dans le pays ou il va être expulsé, la période qui s'est écoulé depuis la perpétration de l'infraction ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage et d'autres éléments, dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, leur âge.
En outre, la Cour examinera tout autant la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne risque de se heurter à des difficultés en accompagnant son conjoint ne saurait en soi, exclure une expulsion"
La Cour constate d'une part:
-Les faits commis par le requérant sont graves et commis seize mois après son entrée en Suisse. Cependant, sa conduite a été irréprochable durant sa détention. Il a vécu en liberté sans renouveler d'infractions.
D'autre part:
-Il ne peut pas vivre en Algérie car son épouse est suisse et non arabe. Il vit en situation irrégulière en Italie pour pouvoir voir son épouse.
Par conséquent:
"La Cour estime que le requérant a subi une sérieuse entrave à l'établissement d'une vie familiale, puisqu'il lui est pratiquement impossible de mener sa vie familiale dans un autre pays. Par ailleurs, lorsque les autorités suisses ont décidé de ne pas prolonger son autorisation de séjour, le requérant ne présentait qu'un danger relativement limité pour l'ordre public. Dès lors, la Cour est d'avis que l'ingérence n'était pas proportionnée au but poursuivi"
Partant, il y a violation de l'article 8 de la Convention.
Arrêt Benbella contre France du 10/07/2003 Hudoc 4474 requête 53441/99
"§32: La Cour rappelle que dans son arrêt Boultif précité, elle a défini comme suit les principes directeurs devant guider son appréciation en cas de mesure d'éloignement prise par un Etat contractant à l'égard d'un étranger arrivé adulte sur son territoire
-la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant;
-la durée de son séjour dans le pays d'où il va être expulsé;
-la période qui s'est écoulée entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période;
-la nationalité des diverses personnes concernées;
-la situation et les circonstances de l'espèce.
ARRÊT BOUSSARA CONTRE FRANCE DU 23 SEPTEMBRE 2010 REQUETE 25672/07
Le requérant, M. Issam Bousarra, est un ressortissant marocain, né en 1978 et résidant à Taza (Maroc). Arrivé en France avec ses parents à l’âge de trois semaines, il est célibataire et sans famille. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention, il se plaignait de la décision de l’expulser vers le Maroc, suite à sa condamnation en 2001 à cinq ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, extorsion de fonds, séquestration de personne et port d’arme prohibé.
a) Sur l’existence d’une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale
37. La Cour estime que l’arrêté d’expulsion prononcé à l’encontre du requérant et l’exécution de cette mesure constituent une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa « vie familiale ».
38. Le requérant avait vingt ans au moment de son incarcération et vingt-quatre ans au moment de son expulsion. C’est à cette date qu’il convient de se placer pour examiner la question de savoir si le requérant avait une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Le requérant était célibataire et sans enfant. En tout état de cause, la Cour a admis dans un certain nombre d’affaires concernant de jeunes adultes qui n’avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d’autres membres de leur famille proche s’analysaient également en une « vie familiale » (par exemple, Bouchelkia c. France, 29 janvier 1997, § 62, Recueil 1997-I ; Maslov, précité, § 62).
39. En conséquence, la mesure litigieuse porte atteinte à la « vie familiale » du requérant.
40. Pareille ingérence enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cet article, c’est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
b) « Prévue par la loi »
41. Il n’est pas contesté que la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre du requérant se fondait sur l’article 26 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945.
c) But légitime
42. Il n’est pas davantage controversé que l’ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir la « défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ».
d) « Nécessaire dans une société démocratique »
43. Les principes fondamentaux en la matière sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été définis dans l’arrêt Boultif (Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 48, CEDH 2001-IX) et affinés dans l’affaire Üner (Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, §§ 54-58, CEDH 2006-...). La Cour a considéré que ces critères s’appliquaient, à plus forte raison, dans les cas où les requérants étaient nés dans le pays hôte ou y étaient arrivés à un très jeune âge (Maslov, précité, §§ 68-76).
44. Parmi les critères dégagés, les suivants sont pertinents dans la présente espèce :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction et la conduite du requérant durant cette période ;
– la solidité des liens familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination ;
– le caractère définitif de la mesure d’éloignement.
L'APPLICATION EN L'ESPECE
45. En ce qui concerne la nature et la gravité des infractions commises, la Cour relève que le requérant a été condamné à une peine sévère portant sur des faits de trafic de résine de cannabis (voir Joseph Grant c. Royaume-Uni, no 10606/07, § 38, 8 janvier 2009), mais également sur des faits de port d’arme prohibé et de violences avec séquestration. Elle observe cependant que cette condamnation est unique puisqu’il s’agissait de sa première et qu’il n’y en a pas eu d’autres.
46. Lorsque l’on examine la durée du séjour du requérant et la solidité de ses liens familiaux avec le pays hôte, la situation n’est évidemment pas la même si la personne concernée est arrivée dans le pays dès son enfance ou sa jeunesse, voire y est née, ou si elle y est seulement venue à l’âge adulte (Maslov, précité, § 73). Cette différenciation apparaît également dans divers instruments du Conseil de l’Europe, en particulier dans les recommandations Rec(2001)15 et Rec(2002)4 du Comité des Ministres. La Cour a déjà estimé qu’il fallait tenir compte de la situation spéciale des étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l’intégralité, de leur enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et qui y ont reçu leur éducation (Üner, précité, § 57 ; Maslov, précité, § 74).
47. En l’espèce, la Cour constate que le Conseil d’Etat a retenu les preuves de la présence du requérant en France avant 1985, date de sa scolarisation, tirées notamment des carnets de vaccinations mentionnant sa première vaccination en France le 19 décembre 1978 ainsi que des vaccinations ultérieures effectuées régulièrement chaque année. Dès lors, elle prend acte de la présence du requérant sur le territoire français dès son quatrième mois. Elle observe par ailleurs que le requérant n’était jamais retourné au Maroc jusqu’à son expulsion en 2002, à l’âge de vingt-quatre ans.
48. La Cour prend également en considération « le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’[es] infraction[s], et la conduite du requérant pendant cette période » (Boultif, précité, § 51 ; Maslov, précité, §§ 89-95). En l’espèce, la Cour doit tenir compte de la conduite du requérant depuis le moment où il a commis sa dernière infraction, le 16 juin 1999, jusqu’à son expulsion effective, 18 octobre 2002. Il ressort du dossier que l’intéressé a passé l’intégralité de cette période de trois ans et quatre mois en prison. La Cour constate que le requérant a obtenu une autorisation de sortie durant trois jours, du 26 au 29 juillet 2002, après une enquête diligentée par la gendarmerie à la demande du juge de l’application des peines. Elle note que l’intéressé a obtenu une permission de sortir de trois jours pour « maintien des liens familiaux ». Elle constate également que le requérant a bénéficié d’une remise de peine.
49. Quant à la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d’origine, la Cour observe que le requérant a passé l’intégralité de son enfance et de son adolescence en France (voir, notamment, Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001). Il parle la langue française et a reçu toute son éducation en France, où vivent tous ses proches, à l’exception de sa tante qui vit au Maroc. Son père, âgé de quatre-vingts ans, vit également en France et a acquis la nationalité française. En tant qu’immigré arrivé à un âge très précoce en France, la très grande majorité de ses attaches familiales, sociales et culturelles se trouvait en France.
50. La Cour relève que le Gouvernement précise que le requérant vit désormais avec sa tante au Maroc. Elle rappelle cependant qu’elle est appelée à examiner la situation du requérant au moment où la mesure d’expulsion est devenue définitive. Sa tâche consiste à constater si les autorités nationales ont dûment pris en considération la situation familiale du requérant à ce moment précis sans avoir égard à des circonstances survenues ultérieurement (Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, § 45, 17 avril 2003 ; Yildiz c. Autriche, no 37295/97, § 44, 31 octobre 2002). En l’espèce, il n’est pas démontré que, au moment de l’expulsion, le requérant avait d’autres liens avec son pays d’origine que sa nationalité. D’ailleurs, la Cour relève que le requérant soutient avoir, aujourd’hui encore, de grandes difficultés à parler la langue arabe.
51. Enfin, pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence, la Cour tient compte de la durée de l’interdiction de séjour (Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001 ; Emre c. Suisse, no 42034/04, §§ 84-85, 22 mai 2008). En l’espèce, la Cour relève d’une part que la cour d’appel de Besançon avait annulé l’interdiction du territoire ordonnée en première instance et avait prononcé à la place une interdiction de séjour de trois ans dans quatre départements français. Elle note d’autre part qu’en 2002 la Commission d’expulsion des étrangers avait émis un avis défavorable à l’expulsion du requérant. La Cour rappelle que, sous réserve des dispositions de l’article 26 de ce texte, l’article 24 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 disposait, à l’époque des faits, que l’expulsion ne pouvait pas être prononcée si la Commission d’expulsion des étrangers émettait un avis défavorable (voir paragraphe 21 ci-dessus). Toutefois, le ministre de l’Intérieur avait estimé en l’espèce que l’expulsion constituait une « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou pour la sécurité publique » justifiant une dérogation à l’article 24 susmentionné.
52. Même si rien n’est spécifié quant à la durée de l’expulsion du requérant, puisque celui-ci peut solliciter l’abrogation de la mesure d’expulsion en vertu des articles L. 524-1 et suivants du CESEDA (paragraphe 24 ci-dessus), il est possible de considérer qu’il s’agit en l’espèce d’une expulsion définitive. En effet, le requérant sollicita l’abrogation de la mesure d’expulsion en 2007, ce qui lui fut refusé.
A cet égard, la Cour observe que, depuis la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003, un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion sauf si son comportement est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, lié à des activités à caractère terroriste, ou constitue des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Cette loi modifia les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux droits des étrangers, lesquelles furent ensuite codifiées aux articles L. 521-2 et suivants du CESEDA, et inséra de nouvelles dispositions dans le code pénal (voir paragraphes 22 et 25 ci-dessus). Ces dispositions sont applicables à une catégorie d’étrangers qui, du fait de leurs liens sociaux, familiaux et culturels en France, bénéficient d’une protection quasi absolue contre le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire. Certes, ces dispositions n’étaient pas applicables à l’époque des faits de la présente espèce. Cependant, la Cour observe que si l’expulsion avait eu lieu sous l’empire de ces nouvelles dispositions, le requérant aurait pu se prévaloir de celles-ci en tant que personne protégée en vertu des articles L. 521-3 du CESEDA et 131-30-2 du code pénal (résidence en France depuis plus de vingt ans).
53. De l’avis de la Cour, on ne peut raisonnablement soutenir que du fait des infractions commises, le requérant constituait une menace d’une gravité extrême pour l’ordre public justifiant une mesure d’expulsion définitive du territoire français.
54. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure d’expulsion définitive du requérant était disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la « défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ».
55. Partant, il y eu violation de l’article 8 de la Convention.
ARRÊT OSMAN C. DANEMARK DU 14 JUIN 2011 REQUÊTE 38058/09
Le non-renouvellement du permis de séjour d’une fille somalienne élevée au Danemark avec sa famille a porté atteinte à ses droits
LES FAITS
La requérante, Sahro Osman, est une ressortissante somalienne née en Somalie le 1er novembre 1987. Elle habite aujourd’hui à Esbjerg (Danemark).
Mlle Osman vécut en Somalie de 1987 à 1991 et parle somalien. Elle partit ensuite au Kenya, où elle vécut de 1991 à 1995.
Elle se vit octroyer un permis de séjour danois en novembre 1994 puis se rendit au Danemark pour y vivre avec son père et sa sœur (qui y avaient obtenu l’asile) en février 1995, alors qu’elle était âgée de sept ans. Sa mère et ses trois frères et sœurs les rejoignirent ultérieurement.
Elle passa son enfance au Danemark, de sept à 15 ans. Elle apprit le danois et fut scolarisée au Danemark jusqu’en août 2002. Tous les membres proches de sa famille habitent dans ce pays.
Alors qu’elle était âgée de 15 ans, son père la renvoya – selon elle contre son gré – au Kenya en 2003, où elle s’occupa de sa grand-mère paternelle au camp de réfugiés de Hagadera, au nord-est du pays, pendant plus de deux ans.
Le 9 août 2005, âgée de 17 ans et donc toujours mineure, elle demanda à être regroupée avec sa famille au Danemark.
VIOLATION DE L'ARTICLE 8 POUR DISPROPORTION
La Cour constate que le refus de renouvellement du permis de séjour de Mlle Osman constitue une ingérence dans l’exercice tant de son droit à la vie privée que de son droit à la vie familiale. L’intéressée était mineure à la date de sa demande de regroupement avec sa famille au Danemark et, à l’instar des jeunes adultes n’ayant pas encore fondé leur propre famille, la relation avec ses parents et les autres membres proches de sa famille représentait sa «vie familiale». En outre, l’ensemble des attaches sociales entre un immigré établi et la communauté au sein de laquelle il vit formant sa «vie privée», son expulsion emporte ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée.
La mesure dénoncée était prévue par la loi danoise et poursuivait le but légitime du contrôle de l’immigration.
La question principale qui se pose est de savoir si les autorités danoises étaient tenues de renouveler le permis de séjour de Mlle Osman après son séjour au Kenya pendant plus de deux ans.
La Cour relève que Mlle Osman a passé son enfance au Danemark, qu’elle parle danois, qu’elle a été scolarisée au Danemark et que les membres proches de sa famille habitent dans ce pays. Elle a donc des attaches sociales, culturelles et familiales au Danemark ainsi qu’au Kenya et en Somalie.
Mlle Osman soutient que les autorités danoises étaient tenues de protéger ses intérêts et qu’il était évident que la décision prise par son père de l’envoyer au Kenya n’était pas conforme à ses intérêts.
La Cour rappelle que, pour une immigrée établie comme Mlle Osman qui a passé légalement la majeure partie de son enfance dans un pays d’accueil, seules des raisons très solides permettent de justifier son refoulement. Mlle Osman a été refoulée au motif non pas qu’elle avait commis une infraction mais que son permis de séjour avait expiré.
La Cour relève également que, si la loi en question vise à décourager les parents qui souhaitent renvoyer leurs enfants dans leur pays d’origine pour qu’ils y soient rééduqués d’une manière jugée par leurs parents comme plus conforme à leurs origines ethniques, le droit des enfants au respect de leur vie privée et familiale ne peut être négligé.
Mlle Osman affirme qu’elle avait été obligée de quitter le Danemark pour s’occuper de sa grand-mère pendant plus de deux ans, qu’elle avait séjourné au Kenya contre son gré, qu’elle n’avait pas les moyens de quitter le camp et que la décision prise par son père de l’envoyer dans ce pays n’était pas conforme à ses intérêts.
Or les autorités ont écarté ces arguments au motif qu’elle était sous la garde de ses parents au moment des faits. La Cour reconnaît que l’exercice des droits parentaux constitue un élément fondamental de la vie familiale et que l’entretien et l’éducation des enfants exigent normalement et nécessairement des parents qu’ils décident où leurs enfants doivent vivre et imposent, ou autorisent d’autres à imposer, diverses restrictions à la liberté de leurs enfants. Néanmoins, tout en respectant les droits des parents, les autorités ne pouvaient faire abstraction des intérêts de l’enfant, notamment de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le point de vue de Mlle Osman n’a pas non plus été pris en compte par exemple lorsque le service de l’immigration a fait valoir qu’elle n’avait pas vu sa mère pendant quatre ans. Pour la Cour, le fait que sa mère ne lui a pas rendu visite au Kenya et qu’elles n’ont eu apparemment que très peu de contacts pendant quatre ans peut s’expliquer par divers facteurs, notamment des contraintes pratiques financières, et ne permet guère de conclure qu’elles ne souhaitaient pas maintenir ou renforcer les contacts familiaux.
En mai 2003, lorsque Mlle Osman était âgée de 15 ans et fut envoyée au Kenya, même si l’article 17 de la loi sur les étrangers prévoyait que son permis de séjour pouvait expirer après 12 mois consécutifs passés à l’étranger, elle pouvait encore demander un permis de séjour au Danemark sur la base de l’article 9, paragraphe 1 ii), de cette même loi. Or le texte fut modifié alors que Mlle Osman se trouvait toujours au Kenya, limitant le droit au regroupement familial aux enfants âgés de moins de 15 ans et non plus à ceux âgés de moins de 18 ans. La Cour ne conteste pas cette modification de la loi en elle-même mais elle note que Mlle Osman et ses parents n’auraient pu prévoir ce changement ni quand l’intéressée se trouvait au Kenya ni à la date de l’expiration du délai de 12 mois.
La Cour en conclut à une violation de l’article 8 faute pour les autorités danoises d’avoir pris en compte les intérêts de Mlle Osman lorsqu’elles ont refusé le renouvellement de son permis de séjour et d’avoir ménagé un juste équilibre entre ses intérêts et l’intérêt que le contrôle de l’immigration revêt pour l’État.
EMRE C. SUISSE requête 5056/10 du 11 octobre 2011
Une interdiction de territoire de dix ans est trop longue pour un étranger élevé en Suisse depuis l'âge de six ans
Le requérant, M. Emre est un ressortissant turc, né en 1980 et résidant à Stuttgart (Allemagne). Il est entré en Suisse avec ses parents en 1986. Après plusieurs condamnations pour des infractions commises entre 1994 et 2000 (lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, voies de fait, vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, injures, menaces, émeute, violation de la législation sur les armes, et violation grave des règles de la circulation routière), en 2003 le Service des étrangers du canton de Neuchâtel prononça son expulsion administrative pour une durée indéterminée, confirmée par la suite par le Tribunal fédéral.
M. Emre saisit la Cour pour la première fois en 2004, soutenant que son éloignement du territoire suisse pour une durée indéterminée était une violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale). Par un arrêt définitif d’août 2008, la Cour conclut à la violation de l’article 8. A la suite de cet arrêt, en juillet 2009 M. Emre a saisi le Tribunal fédéral afin de faire réviser son premier arrêt. Le Tribunal admit la révision et limita la durée de l’éloignement à dix ans.
En septembre 2009, M. Emre épousa une ressortissante allemande et obtint un titre de séjour allemand. Il demanda, alors, sans succès, la levée de la mesure d’éloignement et à s’établir en Suisse.
ARTICLE 8
En ce qui concerne la recevabilité, la Cour juge que la mesure introduite par le Tribunal fédéral constitue un fait nouveau qui pourrait donner lieu à une nouvelle atteinte à l’article 8 et déclare ce grief recevable.
La Cour ne doute pas que l’expulsion de M. Emre est prévue par la loi et qu’elle poursuit un but légitime (défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales). En revanche, elle estime que le Tribunal fédéral aurait dû prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la requête, comme l’a fait la Cour dans son premier arrêt (notamment la nature des infractions commises, dont une partie relève de la délinquance juvénile, la gravité des sanctions prononcées, la durée du séjour de M.
Emre en Suisse, la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, les problèmes de santé de M. Emre, le changement positif de son comportement et enfin le caractère définitif de la mesure d’éloignement).
La Cour estime que l’Etat ne semble pas avoir respecté un juste équilibre entre les intérêts privés (ceux de M. Emre et de sa famille) et publics (l’ordre et la sécurité publique, ainsi que le risque de récidive).
La Cour conclut que l’interdiction de territoire pour dix ans, durée considérable dans la vie d’une personne, ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. Elle juge que, afin d’exécuter l’arrêt de la Cour et de remédier à la violation de l’article 8, le Tribunal aurait dû annuler purement et simplement l’interdiction de territoire contre M.
Emre, avec effet immédiat. Elle conclut donc à la violation de l’article 8, combiné avec l’article 46.
TRABELSI C. ALLEMAGNE requête n°41548/06 du 13 octobre 2011
L'expulsion d'un tunisien qui a sa famille en Allemagne mais auteur de nombreux délits est conforme à la Convention.
a) Sur l’existence d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant
46. La Cour rappelle qu’elle examine l’expulsion de résidents de longue durée aussi bien sous le volet de la « vie privée » que sous celui de la « vie familiale », une certaine importance étant accordée sur ce plan au degré d’intégration sociale des intéressés (Gezginci c. Suisse, no 16327/05, § 55, 9 décembre 2010).
47. La Cour note que le requérant, célibataire et sans enfants, avait 21 ans au moment de l’imposition de l’interdiction de séjour, et plus de 22 ans lorsque la mesure est devenue définitive, mais vivait encore avec ses parents. Elle rappelle qu’elle a admis dans un certain nombre d’affaires concernant de jeunes adultes qui n’avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d’autres membres de leur famille proche s’analysaient également en une vie familiale. Par ailleurs, la question de l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 doit s’apprécier à la lumière de la situation à l’époque où la mesure d’interdiction de séjour est devenue définitive (Maslov précité, § 61), c’est-à-dire en l’espèce le 30 juin 2005, jour où la cour d’appel administrative a rendu sa décision (Kaya c. Allemagne, no 31753/02, § 57, 28 juin 2007, et Chair et J.B. précité, § 60).
48. La Cour rappelle en outre que si tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n’ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l’article 8, cette disposition protège également le droit de nouer et entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu. Il faut dès lors accepter que l’ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent font partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8. Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », l’expulsion d’un immigré établi s’analyse, partant, en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. C’est en fonction des circonstances de l’affaire portée devant elle qu’elle décide s’il convient de mettre l’accent sur l’aspect « vie familiale » plutôt que sur l’aspect « vie privée » (Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 29, CEDH 2006-XII, et Maslov précité, § 63, Gezginci précité, § 56).
49. En l’occurrence, la Cour estime que la décision d’expulsion litigieuse porte atteinte à la fois à la « vie familiale » du requérant, mais avant tout à sa « vie privée ».
50. Pareille ingérence enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cet article, c’est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou plusieurs buts légitimes énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
b) « Prévue par la loi »
51. La Cour considère que l’expulsion avait une base en droit interne, à savoir l’article 53 no 1 de la loi sur le séjour (paragraphe 23 ci-dessus).
c) But légitime
52. Il n’est pas contesté que l’ingérence poursuit un but légitime, à savoir la « défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ».
d) « Nécessaire dans une société démocratique »
53. En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence est « nécessaire dans une société démocratique », la Cour rappelle qu’elle a résumé les critères pertinents à cet égard dans son arrêt Üner c. Pays-Bas précité (§§ 54-58). En particulier, d’après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des non-nationaux sur leur sol. La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de l’ordre public, les Etats contractants ont la faculté d’expulser un étranger délinquant. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Üner précité, § 54).
54. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays d’hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. Par ailleurs, si un certain nombre d’Etats ont adopté des lois ou des règlements prévoyant que les immigrés de longue durée nés sur leur territoire ou arrivés sur leur territoire à un jeune âge, ne peuvent être expulsés sur la base de leurs antécédents judiciaires (Üner précité, § 55), un droit aussi absolu à la non-expulsion ne peut se déduire de l’article 8 de la Convention, dont le paragraphe 2 est libellé en des termes qui autorisent clairement des exceptions aux droits généraux garantis dans le paragraphe 1 (ibid.).
55. Dans son arrêt Maslov précité, §§ 71-76, la Cour a donné des précisions relatives aux critères pertinents en disant :
« 71. Lorsque, comme c’est le cas ici, la personne qui doit être expulsée est un jeune adulte qui n’a pas encore fondé sa propre famille, les critères pertinents sont les suivants :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction et la conduite du requérant durant cette période ;
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
72. La Cour tient également à préciser que l’âge de la personne concernée peut jouer un rôle dans l’application de certains des critères susmentionnés. Par exemple, pour apprécier la nature et la gravité de l’infraction commise par un requérant, il y a lieu d’examiner s’il l’a perpétrée alors qu’il était adolescent ou à l’âge adulte (...)
73. Par ailleurs, lorsque l’on examine la durée du séjour du requérant dans le pays dont il doit être expulsé et la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, la situation n’est évidemment pas la même si la personne concernée est arrivée dans le pays dès son enfance ou sa jeunesse, voire y est née, ou si elle y est seulement venue à l’âge adulte. Cette différenciation apparaît également dans divers instruments du Conseil de l’Europe, en particulier dans les recommandations Rec(2001)15 et Rec(2002)4 du Comité des Ministres (...)
75. En résumé, la Cour considère que, s’agissant d’un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l’intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d’accueil, il y a lieu d’avancer de très solides raisons pour justifier l’expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l’origine de la mesure d’expulsion pendant son adolescence. »
56. La Cour note d’emblée qu’en dépit de sa naissance en Allemagne, le requérant ne disposait que d’un permis de séjour limité qui avait été renouvelé une dernière fois le 21 octobre 2002 pour une durée d’un an. Elle observe sur ce point que le requérant ne semble pas avoir fait de démarches en vue d’obtenir la prorogation de son titre de séjour ou, à l’instar de ses sœurs, d’introduire une demande de naturalisation. Le requérant ne pouvait donc pas se fier légitimement à l’idée qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire allemand.
i. La nature et la gravité des infractions commises par le requérant
57. En ce qui concerne la nature et la gravité des infractions commises, la Cour relève d’abord que le requérant a été condamné à plusieurs reprises pour extorsion de fonds aggravée et coups et blessures dangereux, délits revêtant un certain degré de gravité et de violence, et aussi pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Elle note ensuite que si les premières condamnations concernaient des délits que le requérant avait commis lorsqu’il était encore mineur (paragraphes 7 et 9 ci-dessus), ses condamnations ultérieures et notamment celle du 14 octobre 2003 portaient sur une série d’infractions commises à l’âge de 19 et 20 ans. S’il est vrai que le tribunal d’instance a néanmoins infligé une peine de prison ferme pour mineurs, on ne saurait pour autant considérer qu’il s’agisse de délits perpétrés au cours de l’adolescence (Onur c. Royaume-Uni, no 27319/07, § 55, 17 février 2009, Grant c. Royaume-Uni, no 32570/03, § 40, CEDH 2006-VII, Yesufa c. Royaume-Uni (déc.), no 7347/08, 26 janvier 2010, et, a contrario, Maslov précité, § 81).
58. La Cour observe aussi que le requérant a commis ces dernières infractions alors qu’il avait été averti par les autorités administratives sur les conséquences d’une nouvelle condamnation (paragraphe 9 ci-dessus), et n’a d’ailleurs pas non plus cessé ses agissements criminels ultérieurement après avoir reçu notification de l’arrêté d’expulsion ou après avoir dû purger sa peine de prison (voir paragraphe 48 ci-dessous). Enfin, il y a lieu de relever le nombre important de délits commis par le requérant sur une période relativement longue (voir Grant précité, § 39, Yesufa, décision précitée, et, a contrario, A.W. Khan c. Royaume-Uni, no 47486/06, § 41, 12 janvier 2010, et Bousarra c. France, no 25672/07, § 45, 23 septembre 2010). La présente affaire peut dès lors être distinguée de l’affaire Maslov précitée à cet égard (cf. Mutlag précité, § 55).
ii. La durée du séjour du requérant
59. Pour ce qui est de la durée du séjour, la Cour note que depuis sa naissance en mars 1983, le requérant a résidé légalement en Allemagne avec ses parents et ses sœurs jusqu’au 20 octobre 2003, jour de l’expiration de la validité de son dernier permis de séjour (voir paragraphe 55 ci-dessus).
iii. Le laps de temps qui s’est écoulé depuis les infractions et la conduite du requérant pendant cette période
60. En ce qui concerne le laps de temps qui s’est écoulé depuis les infractions et la conduite du requérant pendant cette période, la Cour rappelle que le comportement de l’intéressé postérieur à ses condamnations pénales n’a lieu d’être pris en compte que dans les affaires où un long délai s’écoule entre la décision définitive imposant l’expulsion d’une part et le renvoi effectif d’autre part (Maslov précité, § 92).
61. Elle note en l’espèce que la décision d’expulsion est devenue définitive le 30 juin 2005, mais que le requérant n’a pas encore fait à ce jour l’objet d’une mesure de renvoi vers la Tunisie. Si ce laps de temps paraît ainsi suffisamment long pour permettre, le cas échéant, de prendre en considération les faits survenus après la décision définitive, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette question en l’occurrence. En effet, s’il est vrai que le requérant, en détention jusqu’en octobre 2006, a repris ses études scolaires, a obtenu deux diplômes scolaires successifs et suit actuellement des cours du soir en vue de préparer son baccalauréat, il a aussi fait l’objet de nouvelles condamnations pénales en 2008, a de nouveau fait l’objet d’une accusation pour coups et blessures dangereux en décembre 2010 (paragraphes 21 et 24 ci-dessus) et, d’après les informations fournies par le Gouvernement, a fait l’objet de plusieurs mesures disciplinaires durant sa détention. Dès lors, compte tenu du fait que ces circonstances plaident à la fois en faveur du requérant et à son détriment, la Cour ne saurait accorder beaucoup d’importance en l’occurrence à la période postérieure aux condamnations du requérant qui ont amené les autorités administratives à ordonner l’expulsion litigieuse.
iv. La solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d’origine
62. Quant à la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d’origine, la Cour note que le requérant est né en Allemagne et y a passé les années de formation de son enfance et de sa jeunesse. Il parle et écrit la langue allemande et a reçu toute son éducation en Allemagne où vivent tous ses proches. S’il a donc ses principaux liens dans ce pays, il ne ressort cependant ni de ses observations ni des documents présentés à l’appui de sa requête qu’il ait établi des relations sociales particulières autres que celles avec sa famille (voir, mutatis mutandis, Mutlag précité, § 58).
63. En ce qui concerne les liens du requérant avec la Tunisie, la Cour note que
le requérant a soutenu qu’il n’avait plus aucun lien avec la Tunisie et qu’il ne
parlait pas les langues en usage dans le pays. Le Gouvernement pour sa part
déclare ignorer si le requérant a des attaches en Tunisie et s’il parle l’arabe.
Il ajoute cependant que les circonstances en l’espèce
permettent de dire que le requérant comprend l’arabe au moins dans une faible
mesure et qu’il existe des proches en Tunisie avec lesquels le requérant
pourrait reprendre contact.
64. La Cour rappelle que l’intéressé dans l’affaire Maslov précité (§ 97) avait expliqué « de manière convaincante qu’au moment de son renvoi il ne parlait pas la langue bulgare du fait que sa famille appartenait à la minorité turque en Bulgarie ». Or si le requérant dans le cas d’espèce a incontestablement de fortes attaches avec l’Allemagne, on ne saurait pour autant prétendre, au vu des informations présentées par les parties, qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine et qu’il n’a aucune notion d’arabe.
v. La durée de l’interdiction de séjour
65. Enfin, en ce qui concerne la durée de l’interdiction de séjour, la Cour note que les autorités administratives ont prononcé une expulsion à durée illimitée. Les juridictions administratives quant à elles ne se sont pas penchées sur la question de savoir s’il y avait lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une limitation dans le temps au regard des circonstances de l’affaire. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu introduire une demande visant à limiter la durée de celle-ci, ce qui aurait permis aux autorités administratives d’atténuer la mesure dont il était frappé. Le requérant soutient pour sa part que puisque son expulsion à durée illimitée était proportionnée aux yeux des autorités allemandes, une telle demande n’aurait pas eu de chances d’aboutir.
66. La Cour note que, d’après la jurisprudence de la Cour fédérale administrative, les autorités administratives peuvent d’office limiter dans le temps la mesure d’expulsion en fonction des circonstances de l’affaire, même en l’absence d’une demande de l’intéressé dans ce sens (paragraphe 27 ci-dessus). En outre, la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que, dans certains cas concernant des étrangers nés sur le sol allemand qui n’avaient pas de liens familiaux protégés par la Convention, une limitation dans le temps pouvait ne pas suffire pour rendre la mesure d’expulsion proportionnée (paragraphe 28 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, le Gouvernement n’a pas démontré dans les circonstances de l’espèce qu’une demande formulée par le requérant tendant à la limitation dans le temps de la mesure d’expulsion aurait été de nature à influer sur la proportionnalité de la mesure d’expulsion (cf. Mutlag précité, §§ 60-61). La Cour note au demeurant que l’article 11 § 2 de la loi sur le séjour prévoit la possibilité d’obtenir de manière exceptionnelle l’autorisation d’entrer sur le sol allemand pour une courte durée (paragraphe 26 ci-dessus).
vi. Conclusion
67. Eu égard à ce qui précède et, en particulier, à la nature et au nombre considérable des délits commis par le requérant, dont une partie revêtaient une certaine gravité, et avaient été commis par lui à l’âge adulte et bien qu’il eût été averti sur les conséquences de ses agissements criminels (voir, a contrario, Maslov précité, § 81), et compte tenu de la précarité du titre de séjour du requérant et du fait que l’impact de la mesure litigieuse relève essentiellement de la seule vie privée, la Cour parvient à la conclusion que la mesure d’expulsion n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et peut dès lors encore passer pour nécessaire dans une société démocratique.
68. La Cour rejette dès lors l’exception soulevée par le Gouvernement relative à l’absence d’une limitation dans le temps et constate qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la Convention.
ARRÊT GEZGINCI c. SUISSE REQUÊTE 16327/05 DU 9 DECEMBRE 2005
LA CEDH épouse les thèses de l'extrême droite suisse quant à l'expulsion des étrangers qui vivent trente ans dans le pays
a) Sur l’existence d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant
54. La Cour rappelle que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l’article 8 § 1 de la Convention (Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, § 16, série A no 193).
55. La Cour observe en outre que, dans sa jurisprudence, elle a toujours envisagé l’expulsion de résidents de longue date aussi bien sous le volet de la « vie privée » que sous celui de la « vie familiale », une certaine importance étant accordée sur ce plan au degré d’intégration sociale des intéressés (voir, par exemple, l’arrêt Dalia c. France, 19 février 1998, §§ 42-45, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
56. En outre, la Cour rappelle que tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n’ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l’article 8. Toutefois, dès lors que l’article 8 protège également le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu, il faut accepter que l’ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fait partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8. Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », l’expulsion d’un étranger établi s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. C’est en fonction des circonstances de l’affaire portée devant elle que la Cour décidera s’il convient de mettre l’accent sur l’aspect « vie familiale » plutôt que sur l’aspect « vie privée » (Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 59, CEDH 2006-XII).
57. Pour ce qui est des circonstances de l’espèce, la Cour estime que, en raison de la très longue durée du séjour du requérant en Suisse, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie « privée ». Il importe peu à cet égard que, comme le prétend le Gouvernement, l’intéressé ait interrompu sa présence sur le territoire suisse par des séjours à l’étranger. Dans ces circonstances, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner si le requérant a également subi une ingérence dans sa vie « familiale ».
58. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. La Cour est donc amenée à rechercher si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
b) Sur la justification de l’ingérence
i. Base légale et buts légitimes
59. La Cour n’a aucune difficulté à admettre, et le requérant ne le conteste par ailleurs pas, que l’ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait les buts légitimes invoqués par le Gouvernement, à savoir le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention d’infractions pénales, ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui.
ii. Nécessité dans une société démocratique
α) Principes applicables
60. La question essentielle à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux en la matière sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récemment récapitulés, notamment dans les affaires Üner (précitée, §§ 54-55 et 57-58), Maslov c. Autriche ([GC], no 1638/03, §§ 68-76, CEDH 2008-...), et Emre c. Suisse (no 42034/04, §§ 65-71).
61. Lorsque, comme en l’espèce, la personne censée être expulsée est un adulte qui, n’ayant pas fondé sa propre famille dans le pays hôte, se prévaut en premier lieu de son intégration et dont la situation relève plutôt de la vie « privée », les critères à retenir sont les suivants :
– la nature et la gravité des infractions commises par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis la commission des infractions et la conduite du requérant durant cette période ; et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
62. Doivent également être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical (Boultif, précité, § 51, et Emre, précité, §§ 71, 81-83).
63. La Cour rappelle également que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X, et Berrehab c. Pays-Bas, 21 juin 1988, série A no 138, § 28). Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour, sa tâche consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, les droits de l’intéressé protégés par la Convention et, d’autre part, les intérêts de la société (voir, parmi maints autres, Boultif, précité, § 47). Cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis, Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 47, CEDH 2002-III). La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une mesure d’éloignement d’une personne se concilie avec l’article 8.
β) Application au cas d’espèce des principes susmentionnés
– La nature et la gravité des infractions commises par le requérant
64. En ce qui concerne d’abord la nature et la gravité des infractions commises par le requérant, la Cour constate que ces éléments n’ont été pris en compte que de manière secondaire par les instances internes. Elle rappelle toutefois que, à une date non indiquée, le requérant a été condamné à une amende pour avoir occupé un emploi sans disposer des autorisations nécessaires puis, entre 1982 et 1992, à deux mois d’emprisonnement et à une interdiction de séjour de trois ans, les deux peines étant assorties d’un sursis, à une amende de 600 CHF pour facilitation du séjour illégal d’étrangers en Suisse, ainsi qu’à 21 jours d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 900 CHF pour conduite en état d’ébriété.
65. En outre, le Gouvernement allègue que, depuis 2004, une procédure pénale est en cours contre le requérant pour usage frauduleux d’une carte de compte postal. Une seconde procédure aurait été ouverte contre lui pour lésions corporelles simples ou voies de fait à l’encontre de sa fille. En outre, le service social communal aurait entrepris, en février 2008, des démarches en vue du placement de sa fille, en raison du comportement adopté par l’intéressé à son égard. Le requérant réplique qu’il n’a pas été lourdement condamné à l’issue de la procédure pour lésions corporelles, le tribunal n’ayant pas retenu cette qualification pour les faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, la procédure de placement de sa fille aurait été abandonnée, celle-ci ayant confirmé auprès des autorités sa volonté de rester vivre chez son père.
66. A la lumière d’affaires comparables, les condamnations dont le requérant a fait l’objet entre 1982 et 1992 ne pèsent pas lourd, tant du point de vue de leur gravité que de la nature des peines finalement infligées (voir, en ce sens, Mokrani c. France, no 52206/99, § 32, 15 juillet 2003 ; Benhebba c. France, no 53441/99, § 34, 10 juillet 2003 ; C. c. Belgique, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, § 35 ; Dalia c. France, précitée, § 54 ; Baghli c. France, no 34374/97, § 48, CEDH 1999-VIII ; Jankov c. Allemagne (déc.), no 35112/97, 13 janvier 2000 ; Bouchelkia c. France, 29 janvier 1997, §§ 50-53, Recueil 1997-I ; Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, § 44, Recueil 1997-VI, et Üner, précité, § 18).
67. Quant aux allégations du Gouvernement selon lesquelles des procédures pénales seraient actuellement pendantes contre le requérant, la Cour observe que celui-ci ne lui a pas fourni la preuve que ces procédures avaient effectivement abouti à une condamnation, même si le requérant relève qu’il n’a pas été lourdement condamné à l’issue de la procédure pour lésions corporelles (paragraphe 29 ci-dessus).
– La durée du séjour du requérant dans le pays dont il doit être expulsé
68. S’agissant de la durée du séjour du requérant en Suisse, la Cour note que, né en 1954, il arriva illégalement dans ce pays en novembre 1978 et y travailla d’abord sans autorisation. Après un séjour de quelques mois en Turquie, il revint en Suisse, où il obtint une autorisation de séjour en août 1980. Par la suite, cette autorisation fut prolongée chaque année. Fin 1992, l’intéressé quitta la Suisse et se rendit en Roumanie pendant un certain temps. En août 1993, la police des étrangers du canton d’Argovie l’informa que son autorisation de séjour avait expiré. Le 10 août 1993, le requérant obtint néanmoins le prolongement de son autorisation de séjour, à la condition qu’il ait un comportement pénalement irréprochable et qu’il soit indépendant financièrement. En janvier 1994, il quitta à nouveau la Suisse pendant plusieurs mois. Cependant, son autorisation de séjour fut une nouvelle fois prolongée en janvier 1995 et en février 1996. Une fois le requérant disparu de sa commune à partir d’avril 1996, par une décision du 28 avril 1997, son autorisation de séjour ne fut pas renouvelée. Par décision du 12 août 1998, le Conseil d’Etat du canton d’Argovie rejeta un recours introduit par l’intéressé. Cette décision devint définitive faute d’avoir été contestée. Par une décision du 15 octobre 2003, l’office des migrations du canton d’Argovie rejeta la demande d’autorisation de séjour pour raisons humanitaires formulée par le requérant le 24 septembre 2003. Ce jugement devint définitif par l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 2 décembre 2004, qui fait l’objet de la présente requête. Le requérant n’a cependant jamais quitté la Suisse et y réside encore actuellement.
69. Compte tenu de ce qui précède, la Cour observe que le requérant a séjourné régulièrement en Suisse au moins pendant 18 ans, abstraction faite des périodes pendant lesquelles il s’est rendu à l’étranger. Si l’on se place au moment de l’exécution de la mesure litigieuse, comme le fait habituellement la Cour dans les affaires qu’elle examine alors que le requérant n’a pas encore été expulsé (Maslov c. Autriche, précité, § 91 et, mutatis mutandis, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 145, 6 juillet 2010), la durée totale du séjour de l’intéressé en Suisse avoisine même une trentaine d’années.
70. Certes, il s’agit manifestement là d’un séjour d’une durée très longue. La Cour observe néanmoins que le requérant n’est pas parvenu à contrer l’allégation du Gouvernement selon laquelle il s’est rendu à l’étranger à plusieurs reprises (voir l’arrêt Kaya c. Allemagne, no 31753/02, § 65, 28 juin 2007).
71. Par ailleurs, la Cour est également sensible à l’argument du Gouvernement, selon lequel le départ du requérant, initialement fixé au 15 mars 1999, n’est pas intervenu à cette date, pour permettre à celui-ci de suivre un traitement médical dans un premier temps, puis en raison de la procédure engagée afin de déterminer son droit à des prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance-invalidité. La Cour estime que le séjour du requérant s’est ainsi considérablement prolongé du fait de la grande compréhension dont les autorités ont fait preuve à l’égard de l’intéressé.
– Le laps de temps écoulé depuis les infractions et la conduite de l’intéressé durant cette période
72. En ce qui concerne le laps de temps écoulé entre la commission des infractions et l’adoption du présent arrêt, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période, la Cour relève que les condamnations du requérant sont antérieures à 1993. Depuis lors, le comportement de l’intéressé n’apparaît pas avoir été mis en cause, en tout cas d’un point de vue purement pénal. Comme elle l’a indiqué précédemment, le Gouvernement n’est pas parvenu à prouver que les procédures ouvertes contre le requérant ont abouti à de nouvelles condamnations.
– La solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d’origine ou de destination
73. Le Gouvernement relève que, dans sa demande d’asile déposée en Suisse, l’épouse du requérant a affirmé qu’elle résidait avec sa fille en Turquie auprès de la sœur de son mari. Aux yeux du Gouvernement, ces éléments non seulement montrent que le requérant y conserve de la famille, mais donnent aussi à penser que celle-ci pourrait, le cas échéant, être disposée à lui apporter un certain soutien. Le Gouvernement relève en outre que le requérant s’est également rendu à plusieurs reprises en Roumanie et y aurait même exercé une activité économique. Par ailleurs, il estime que l’intéressé a clairement démontré par son comportement qu’il ne pouvait et ne voulait pas s’intégrer au monde du travail. En raison de son attitude, le requérant ne serait jamais parvenu, pendant toute la durée de son séjour légal en Suisse, à conserver durablement un emploi. En outre, il aurait accumulé des dettes d’un montant considérable et aurait bénéficié d’allocations chômage et d’aides de l’assistance publique.
74. La Cour observe que le requérant a quitté la Turquie pour entrer illégalement en Suisse en 1978 au plus tard, soit à l’âge de 24 ans. Depuis lors, il y a certes vécu la grande majorité de sa vie. La Cour reconnaît que, âgé aujourd’hui de 56 ans, il serait sans doute exposé à des difficultés de réintégration dans l’hypothèse d’un retour, bien qu’il soit retourné à plusieurs reprises dans son pays d’origine. Par ailleurs, dans sa demande d’asile déposée en Suisse, l’épouse du requérant a déclaré qu’elle résidait avec sa fille en Turquie auprès de la sœur de son mari. Cela étant, la Cour partage l’avis du Gouvernement, selon lequel le requérant y a conservé un certain cercle familial qui pourrait être un soutien dans sa réintégration sociale et professionnelle dans ce pays. Par ailleurs, il maîtrise parfaitement le turc, langue par laquelle il s’est adressé à la Cour (voir l’arrêt Kaya, précité, § 65).
75. La Cour estime que des considérations semblables s’appliqueraient dans l’hypothèse où le requérant se décidait à vivre en Roumanie, pays qu’il connaît par ses visites, où vit son épouse, où sa fille a passé une grande partie de sa vie et où il semble même avoir exercé une activité lucrative (ibidem.).
76. Par ailleurs, à l’instar du Gouvernement, la Cour estime que l’intéressé a clairement démontré par son comportement qu’il ne pouvait et ne voulait pas s’intégrer au monde du travail. Il est avéré que le requérant a très souvent changé de travail, a accumulé des dettes importantes et dépend des allocations chômage et de l’assistance publique.
77. La Cour rappelle également que, née le 20 janvier 1993 et possédant la double nationalité roumaine et turque, la fille du requérant est entrée en Suisse pour la première fois le 9 mars 2000. Elle y est restée jusqu’au 10 novembre 2003. Depuis que sa mère l’a ramenée le 27 juillet 2004, elle vit aux côtés de son père en Suisse. Selon les dires de ce dernier, elle est scolarisée à Wettingen et ses prestations sont positives. Dès lors, elle serait bien intégrée en Suisse. La Cour estime qu’elle atteindra bientôt l’âge de la majorité – soit 18 ans – et pourra dès lors décider seule de suivre son père ou de demander d’être régularisée en Suisse. Par ailleurs, elle réside de manière illégale en Suisse, un fait que l’intéressé n’a pas pu ignorer. En outre, la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel, à la date des décisions litigieuses, elle n’avait vécu que relativement peu de temps dans ce pays. Ayant passé la plus grande partie de sa vie en Roumanie et en Turquie, pays dont elle possède les nationalités et dont elle a vraisemblablement continué à parler les langues avec ses parents durant ses séjours en Suisse, la Cour estime que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit à même de s’y adapter à nouveau en cas de retour. Enfin, elle n’a jamais demandé d’être requérante dans la présente affaire.
– La particularité des circonstances de l’espèce : le volet médical de l’affaire
78. En ce qui concerne enfin l’état de santé du requérant, la Cour rappelle que le tribunal d’appel, dont le Gouvernement approuve les conclusions dans ses observations, a constaté qu’il souffrait de dépression avec tendance suicidaire et d’un rhumatisme nécessitant un traitement régulier, mais que l’ambassade suisse à Ankara a confirmé que les médicaments et traitements nécessaires étaient faciles d’accès en Turquie, ce que l’intéressé a par ailleurs expressément indiqué dans son recours du 6 août 2004. Le Gouvernement rappelle également que, fixé au 15 mars 1999, le départ du requérant n’a pas été exécuté dans un premier temps pour lui permettre de suivre une thérapie médicale, puis en raison de la procédure en cours afin de déterminer son droit à des prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance-invalidité. La Cour rappelle enfin que, par une décision du 4 juillet 2008, l’intéressé s’est vu octroyer une rente d’invalidité de 25 %, à verser rétroactivement à partir du 1er mars 2003.
79. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l’état de santé du requérant n’est pas susceptible de constituer un obstacle significatif à son intégration en Turquie, étant donné qu’il y disposerait des médicaments et traitements nécessaires et qu’il faut partir de l’hypothèse selon laquelle il toucherait la rente d’invalidité même dans l’hypothèse de son départ de Suisse.
γ) Conclusion
80. Au vu de ce qui précède, et en particulier compte tenu de la nature irrégulière du séjour du requérant en Suisse depuis 1997, de l’absence de volonté de sa part de s’intégrer en Suisse, de son manque de respect des règles suisses et ce malgré les avertissements des autorités compétentes, ainsi que du fait que le lien avec son pays d’origine ne semble pas être complètement rompu, la Cour estime que l’Etat défendeur peut passer pour avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts de l’intéressé et de sa fille d’une part, et son propre intérêt à contrôler l’immigration d’autre part.
81. Partant, il n’y aurait pas violation de l’article 8 si une mesure d’éloignement était mise en œuvre.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE SPIELMANN À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE JEBENS
1. Je ne saurais souscrire à la conclusion qu’il n’y aurait pas de violation de l’article 8 de la Convention en cas d’éloignement du requérant.
2. Comme la majorité l’a relevé à juste titre au paragraphe 69 de l’arrêt, si l’on se place au moment de l’exécution de la mesure litigieuse, comme la Cour le fait habituellement dans des affaires où le requérant n’a pas encore été expulsé lors de l’examen de l’affaire, la durée totale du séjour total de l’intéressé en Suisse avoisine une trentaine d’années.
Il s’agit manifestement là d’un séjour d’une durée extrêmement longue. Je suis d’avis que le comportement des autorités suisses vis-à-vis du requérant était susceptible d’avoir fait naître chez lui un certain sentiment d’être toléré sur le territoire suisse depuis de longues années et, partant, une espérance légitime de pouvoir rester définitivement dans ce pays (voir, mutatis mutandis, Bigaeva c. Grèce, no 26713/05, § 32, 28 mai 2009). Par conséquent, il doit y avoir de très solides raisons pour justifier le refus de prolongation de l’autorisation du séjour dans de telles circonstances.
3. Comme l’a relevé la majorité au paragraphe 64 de l’arrêt, la nature et la gravité des infractions n’ont été prises en compte que de manière secondaire par les instances internes. Les condamnations dont le requérant a fait l’objet entre 1982 et 1992 ne pèsent pas lourd. En ce qui concerne le laps de temps entre la commission des infractions et l’adoption du présent arrêt, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période, je relève que les condamnations du requérant sont antérieures à 1993. Depuis lors, le comportement de l’intéressé n’apparaît pas avoir été mis en cause, d’un point de vue purement pénal. Au demeurant, le Gouvernement n’est pas parvenu à prouver que les procédures ouvertes contre le requérant aient abouti à de nouvelles condamnations (paragraphe 67 de l’arrêt).
4. Le requérant est âgé aujourd’hui de 56 ans. Il retrouve, dans l’hypothèse d’un retour, un tout autre pays que celui qu’il avait quitté et sa réintégration l’exposerait sans doute à des difficultés considérables. Le tribunal d’appel lui-même avait estimé au sujet des liens sociaux du requérant que, faute d’indication contraire ressortant du dossier, son intégration sociale en Suisse devait être présumée (paragraphe 25 de l’arrêt). En tout état de cause, j’estime que, à les supposer avérés, les séjours de l’intéressé en dehors du territoire suisse ne signifient aucunement qu’il ait renoncé à l’idée de s’établir et s’intégrer définitivement dans ce pays (voir, mutatis mutandis, Haliti c. Suisse (déc.), no 14015/02, 1er mars 2005, et Sen c. Pays-Bas, no 31465/96, § 40, 21 décembre 2001).
5. Concernant plus particulièrement la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, je voudrais faire les remarques suivantes. Née le 20 janvier 1993 et possédant la double nationalité roumaine et turque, la fille du requérant est entrée en Suisse pour la première fois le 9 mars 2000. Elle y est restée jusqu’au 10 novembre 2003. Depuis que sa mère l’a ramenée le 27 juillet 2004, elle vit aux côtés de son père en Suisse. Selon les dires de ce dernier, non contestés par le Gouvernement, elle est scolarisée à Wettingen et ses prestations sont très positives et, dès lors, elle serait parfaitement intégrée en Suisse (paragraphe 77 de l’arrêt).
6. Pour ce qui est plus particulièrement de l’absence d’intégration professionnelle du requérant en Suisse, relevée par la majorité au paragraphe 73 de l’arrêt, je dois rappeler que, bien qu’il ait changé fréquemment de travail, l’intéressé a néanmoins pu pendant longtemps subvenir indépendamment à ses propres besoins. Il n’est devenu totalement dépendant de l’assistance sociale que depuis son accident subi en juillet 1999 et l’ayant rendu partiellement invalide du travail. J’exprime dès lors certaines réticences à prendre en compte, dans la pesée des intérêts en jeu, un état de fait qui échappe complètement à la volonté du justiciable, tel qu’un accident ou une maladie (voir, dans un autre contexte, Glor c. Suisse, no 13444/04, § 54, CEDH 2009-...).
7. En ce qui concerne enfin l’état de santé du requérant, je rappelle que le tribunal d’appel a constaté que le requérant souffrait de dépression avec tendance suicidaire et d’un rhumatisme nécessitant un traitement régulier. Le Gouvernement a rappelé que, fixé au 15 mars 1999, le départ du requérant n’a pas été exécuté dans un premier temps pour lui permettre de suivre une thérapie médicale, puis en raison de la procédure en cours afin de déterminer s’il avait droit à des prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance-invalidité. Par ailleurs, par une décision du 4 juillet 2008, l’intéressé s’est vu octroyer une rente d’invalidité de 25 %, à verser rétroactivement à partir du 1er mars 2003 (paragraphe 78 de l’arrêt).
8. Contrairement à l’opinion de la majorité, exprimée au paragraphe 79 de l’arrêt, j’estime dès lors que l’état de santé du requérant constitue un obstacle significatif à son intégration en Turquie.
9. En conclusion et au vu de ce qui précède, et en particulier compte tenu de la nature et de la faible gravité des condamnations prononcées contre le requérant, de l’absence de comportement délictuel de sa part depuis 1993, de la durée extrêmement longue de son séjour en Suisse, qui a pu faire naître chez lui une espérance légitime de pouvoir définitivement rester dans ce pays, de l’intégration certaine de sa fille en Suisse ainsi que de son état de santé, je suis d’avis que l’Etat défendeur ne peut passer pour avoir ménagé un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts de l’intéressé et de sa fille et, d’autre part, son propre intérêt à contrôler l’immigration.
ARRÊT GRANDE CHAMBRE
KURIĆ ET AUTRES c. SLOVÉNIE du 26 juin 2012 Requête no 26828/06
1. Sur l’applicabilité de l’article 8 aux griefs des requérants
339. La Grande Chambre observe d’emblée que le Gouvernement ne conteste pas devant elle que l’« effacement » et ses répercussions aient porté préjudice aux requérants et qu’ils s’analysent en une ingérence dans la « vie privée et familiale » des intéressés au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 96, CEDH 2003‑X). Après avoir examiné les arguments des deux parties, la Grande Chambre ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions de la chambre selon lesquelles, bien que l’« effacement » fût intervenu avant le 28 juin 1994, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovénie, les requérants jouissaient à l’époque des faits en Slovénie d’une vie privée et/ou familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, et que l’« effacement » a porté et continue de porter atteinte à leurs droits découlant de l’article 8 (paragraphe 337 ci-dessus).
340. Il reste à examiner si cette ingérence était compatible avec les exigences du second paragraphe de l’article 8 de la Convention, autrement dit si elle était « prévue par la loi », si elle poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes énumérés dans ledit paragraphe et si elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour réaliser ce ou ces buts.
2. Sur la justification de l’ingérence
a) L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
341. D’après la jurisprudence constante de la Cour, l’expression « prévue par la loi » requiert que la mesure incriminée ait une base en droit interne mais vise également la qualité de la loi en question, exigeant que celle-ci soit accessible à la personne concernée et prévisible quant à ses effets (Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 50, CEDH 2000‑II, et Slivenko, précité, § 100).
342. La Cour observe que l’« effacement » du registre du nom des requérants comme de plus de 25 000 autres ressortissants de l’ex-RSFY est résulté de l’effet combiné de deux dispositions des lois sur l’indépendance adoptées le 25 juin 1991 : l’article 40 de la loi sur la nationalité et l’article 81 de la loi sur les étrangers (paragraphes 25 et 27 ci-dessus). Les ressortissants de l’ex-RSFY ayant la nationalité de l’une des autres républiques et résidant de manière permanente en Slovénie qui n’avaient pas demandé la nationalité slovène au 25 décembre 1991 ou dont la demande avait été rejetée tombèrent sous le coup de l’article 81, deuxième alinéa, de la loi sur les étrangers. Le 26 février 1992, lorsque cette disposition devint directement applicable, les requérants devinrent des étrangers.
343. La Cour estime que l’article 40 de la loi sur la nationalité et l’article 81 de la loi sur les étrangers sont des instruments juridiques qui étaient accessibles à toute personne intéressée. Les requérants pouvaient donc prévoir que s’ils ne demandaient pas la nationalité slovène ils seraient traités comme des étrangers. Toutefois, de l’avis de la Cour, ils ne pouvaient raisonnablement prévoir, en l’absence de toute disposition à cet effet, que leur condition d’étranger entraînerait l’illégalité de leur séjour sur le territoire slovène et conduirait à une mesure aussi extrême que l’« effacement ». A ce propos, il y a lieu de rappeler que l’« effacement » a été effectué automatiquement et sans notification préalable. En outre, les requérants n’ont eu la possibilité ni de contester cette mesure devant les autorités internes compétentes ni d’exposer les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas sollicité la nationalité slovène. L’absence de toute notification ou information personnelle a pu les amener à penser que leur statut de résident demeurait inchangé et qu’ils pourraient continuer à séjourner et travailler en Slovénie comme ils le faisaient depuis de nombreuses années. Ce n’est d’ailleurs qu’incidemment qu’ils ont eu connaissance de l’« effacement » (paragraphes 89, 111, 126, 137, 162 et 177 ci-dessus). On peut donc sérieusement douter de la prévisibilité de la mesure litigieuse.
344. En outre, la Cour ne peut qu’attribuer un poids important au fait que, dans sa décision de principe du 4 février 1999, la Cour constitutionnelle a jugé que le transfert des noms des « personnes effacées » du registre des résidents permanents au registre des étrangers non titulaires d’un permis de séjour n’avait aucune base en droit interne ; ni la loi sur les étrangers ni la loi sur le registre de la population et des résidents ne prévoyaient une telle mesure de radiation du registre et de transfert (paragraphes 41 et 214 ci-dessus). De plus, la Cour constitutionnelle a estimé qu’aucune disposition légale ne régissait le passage de la condition de « personne effacée » à celle d’étranger vivant en Slovénie ; en effet, les articles 13 et 16 de la loi sur les étrangers (paragraphe 207 ci-dessus), conçus pour les étrangers entrant en Slovénie, n’étaient pas applicables aux requérants (paragraphes 41-42, 44-45 et 214 ci-dessus). Il y avait donc un vide juridique dans la législation en vigueur à l’époque, puisque les ressortissants de l’ex-RSFY qui avaient la nationalité de l’une des autres républiques et relevaient de l’article 81, deuxième alinéa, de la loi sur les étrangers ne disposaient d’aucune procédure leur permettant de solliciter un permis de séjour permanent. En vertu de l’article 13 de la loi sur les étrangers en effet, ils pouvaient uniquement demander un permis de séjour temporaire, comme s’ils étaient des étrangers qui entraient en Slovénie au titre d’un visa valable et souhaitaient demeurer plus longtemps sur le territoire.
345. De surcroît, il ressort à l’évidence des circulaires administratives adressées par le ministère de l’Intérieur aux services administratifs, en particulier de celles datées du 27 février et du 15 juin 1992 concernant la mise en œuvre de la loi sur les étrangers, l’interprétation de l’article 81 et la tenue des registres (paragraphes 28, 30 et 35 ci-dessus), que les autorités slovènes étaient conscientes à l’époque des conséquences néfastes de l’« effacement », qui avait été effectué en secret. Par définition, ces circulaires administratives n’étaient pas accessibles aux requérants.
346. Dès lors, la Cour estime que jusqu’au 8 juillet 1999, date d’adoption de la loi sur le statut juridique, la législation et la pratique administrative slovènes dénoncées, qui ont abouti à l’« effacement » litigieux, ne répondaient pas aux critères de prévisibilité et d’accessibilité tels que définis dans la jurisprudence de la Cour.
347. Certes, le 8 juillet 1999, à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle du 4 février 1999, la loi sur le statut juridique fut adoptée pour régulariser le statut des « personnes effacées » (paragraphes 49-50 ci‑dessus). Toutefois, le 3 avril 2003, la Cour constitutionnelle jugea que certaines dispositions de cette loi étaient inconstitutionnelles, au motif en particulier qu’elles n’accordaient pas aux « personnes effacées » des permis de séjour permanent avec effet rétroactif et ne réglaient pas la situation des personnes qui avaient été expulsées (paragraphes 58-60 et 215 ci-dessus). Enfin, il a fallu attendre plus de sept ans, jusqu’au 24 juillet 2010, date d’adoption de la loi modifiée sur le statut juridique (paragraphe 76 ci‑dessus), pour que cette dernière décision de la Cour constitutionnelle, qui ordonnait des mesures générales, soit exécutée.
348. Il s’ensuit que, au moins jusqu’en 2010, le système juridique interne ne réglait pas clairement les conséquences de l’« effacement » et le statut de résident de ceux qui y avaient été soumis. Dès lors, non seulement les requérants n’étaient pas en mesure de prévoir la mesure litigieuse, mais il leur était de surcroît impossible d’en envisager les répercussions sur leur vie privée et/ou familiale.
349. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’ingérence litigieuse dans l’exercice par les requérants de leurs droits découlant de l’article 8 n’était pas « prévue par la loi » et qu’il y a eu violation de cette disposition.
350. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu des vastes répercussions de l’« effacement », la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner également si, indépendamment du fait qu’elle ne reposait pas sur une base légale suffisante, cette mesure poursuivait un but légitime et était proportionnée à ce but.
b) L’ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
351. Le Gouvernement soutient qu’à l’époque de la création du nouvel Etat les lois sur l’indépendance poursuivaient le but légitime que constitue la protection de la sécurité nationale. De plus, le droit pour l’Etat de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur son territoire présupposerait qu’il puisse prendre des mesures de dissuasion, telles que l’expulsion, contre les personnes enfreignant les lois sur l’immigration (paragraphe 325 ci-dessus).
352. La Cour estime que le but des lois sur l’indépendance et des mesures prises à l’égard des requérants ne peut être dissocié du contexte plus vaste de la dissolution de la RSFY, de l’accession de la Slovénie à l’indépendance en 1991 et de la création d’une démocratie politique effective, qui impliquaient la constitution d’un « corps de citoyens slovènes » en vue de la tenue des élections législatives. L’ingérence dénoncée (l’« effacement ») doit être envisagée dans ce contexte général.
353. La Cour considère donc qu’avec l’adoption des lois sur l’indépendance, qui prévoyaient la faculté pour tous les ressortissants des républiques de l’ex-RSFY résidant en Slovénie d’opter pour l’acquisition de la nationalité slovène pendant une courte période seulement, les autorités slovènes ont cherché à créer un « corps de citoyens slovènes » et ainsi à protéger les intérêts de la sécurité nationale du pays (voir, mutatis mutandis, Slivenko, précité, §§ 110-111), but légitime au regard de l’article 8 § 2 de la Convention.
c) L’ingérence était-elle « nécessaire dans une société démocratique » ?
354. Ces lois sur l’indépendance ont toutefois eu des conséquences néfastes pour les ressortissants de l’ex-RSFY qui n’avaient pas demandé la nationalité slovène dans le délai prescrit de six mois et qui sont par conséquent devenus des étrangers séjournant illégalement sur le territoire slovène car leur nom avait été « effacé » du registre des résidents permanents. La Cour appréciera la compatibilité de cette mesure avec le droit des requérants au respect de leur vie privée et/ou familiale. Elle rappelle qu’une mesure constituant une ingérence dans l’exercice de droits garantis par l’article 8 § 1 de la Convention peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » si elle a été prise pour répondre à un besoin social impérieux et si les moyens employés étaient proportionnés aux buts poursuivis. La tâche de la Cour consiste à déterminer si les mesures en question ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, les droits de l’individu concerné au regard de la Convention et, d’autre part, les intérêts de la société (Slivenko, précité, § 113).
355. Ainsi que la Cour l’a déclaré à maintes reprises, la Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier et les Etats contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 73, Recueil 1996‑V ; El Boujaïdi c. France, 26 septembre 1997, § 39, Recueil 1997‑VI ; Baghli c. France, no 34374/97, § 45, CEDH 1999‑VIII ; Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 39, CEDH 2001‑IX ; Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 54, CEDH 2006‑XII ; et Slivenko, précité, § 115). Toutefois, des mesures restreignant le droit d’une personne de séjourner dans un pays peuvent, dans certains cas, donner lieu à une violation de l’article 8 de la Convention s’il en résulte des répercussions disproportionnées sur la vie privée et/ou familiale de l’intéressé (Boultif, précité, § 55 ; Slivenko, précité, § 128 ; Radovanovic c. Autriche, no 42703/98, §§ 36-37, 22 avril 2004, et Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 100, CEDH 2008).
356. En l’espèce, les requérants, qui avant la déclaration d’indépendance de la Slovénie résidaient légalement sur le territoire slovène depuis plusieurs années, jouissaient en tant que ressortissants de l’ex-RSFY de toute une série de droits sociaux et politiques. L’« effacement » a eu pour eux un certain nombre de conséquences néfastes telles que la destruction de leurs papiers d’identité, la perte de possibilités d’emploi, la perte de leur assurance maladie, l’impossibilité de renouveler leurs papiers d’identité et leurs permis de conduire, et des difficultés pour faire valoir leurs droits à pension. De fait, le vide juridique laissé par les lois sur l’indépendance (paragraphe 344 ci-dessus) a privé les requérants du statut juridique qui leur avait donné auparavant accès à tout un éventail de droits.
357. Le Gouvernement explique que l’« effacement » a été opéré parce que les intéressés n’avaient pas cherché à acquérir la nationalité slovène. La Cour souligne toutefois qu’un étranger résidant légalement dans un pays peut souhaiter continuer à y vivre sans forcément en acquérir la nationalité. Comme le montrent les difficultés auxquelles les requérants se sont heurtés pendant de nombreuses années pour obtenir un permis de séjour valable, le législateur slovène n’avait pas adopté de dispositions destinées à permettre aux ressortissants de l’ex-RSFY ayant la nationalité de l’une des autres républiques de régulariser leur statut de résident s’ils avaient choisi de ne pas acquérir la nationalité slovène ou s’ils ne l’avaient pas sollicitée. Pareilles dispositions n’auraient pourtant pas compromis les buts légitimes poursuivis, à savoir le contrôle du séjour des étrangers et la constitution d’un corps de citoyens slovènes.
358. A cet égard, la Cour rappelle que, si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie privée et/ou familiale, en particulier dans le cas d’immigrés de longue durée tels que les requérants (voir, mutatis mutandis, Gül c. Suisse, 19 février 1996, § 38, Recueil 1996‑I ; Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, § 67, Recueil 1996‑VI, et Mehemi c. France (no 2), no 53470/99, § 45, CEDH 2003‑IV).
359. La Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’Etat aurait dû régulariser le statut de résident des ressortissants de l’ex‑RSFY afin d’éviter que la non-acquisition de la nationalité slovène ne porte atteinte de façon disproportionnée aux droits des « personnes effacées » découlant de l’article 8. L’absence de pareille régularisation et l’impossibilité prolongée pour les requérants d’obtenir des permis de séjour valables ont rompu le juste équilibre que l’Etat devait ménager entre le but légitime que constituait la protection de la sécurité nationale et le respect effectif de la vie privée et/ou familiale des requérants.
d) Conclusion
360. La Cour estime que, malgré les efforts déployés par elles après les décisions rendues par la Cour constitutionnelle en 1999 et 2003 et, récemment, avec l’adoption de la loi modifiée sur le statut juridique, les autorités slovènes n’ont pas remédié à tous égards et avec la célérité voulue au caractère généralisé de l’« effacement » et à ses graves conséquences pour les requérants.
361. Pour les motifs exposés ci-dessus, les mesures dénoncées n’étaient ni « prévues par la loi » ni « nécessaires dans une société démocratique » pour atteindre le but légitime que constituait la protection de la sécurité nationale.
362. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE ZUPANČIČ (Traduction)
La présente affaire soulève de très sérieux dilemmes moraux, en particulier au niveau juridictionnel international. Comme nous le verrons, certaines de ces questions n’ont pas pu émerger au niveau des juridictions nationales, dont la sphère est plus restreinte. Toutefois, l’esprit historique de la Convention, qui procède des séquelles de la Seconde Guerre mondiale, comparables à celles du cas d’espèce, permet et requiert – forcément – d’adopter une perspective plus large ! En effet, dans la présente affaire et dans d’autres affaires importantes, cette spécificité d’une perspective plus large et, en particulier, d’une objectivité accrue due à la distance par rapport au théâtre national isolé, semble être le but, mûri au fil du temps, de notre propre compétence internationale.
Depuis 1992, 25 671 personnes auraient été touchées par cette pratique de nettoyage ethnique légaliste – ainsi que l’a qualifiée à juste titre le juge Vučinić –, qui a été officiellement autorisée. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de 1999 sur la nationalité – enfin conforme à la première décision de la Cour constitutionnelle – au moins 6 621 personnes lésées ont jusqu’ici apparemment démontré leur intérêt juridique et ont en fait régularisé leur séjour ou leur nationalité. Au 31 janvier 2012, les services administratifs du ministère de l’Intérieur avaient enregistré 229 demandes de permis de séjour permanent et 101 demandes de régularisation ex tunc. Ils avaient délivré 59 permis de séjour permanent ; 83 de ces demandes avaient été rejetées, et 87 étaient toujours pendantes. Ils avaient rendu 52 décisions positives soit spéciales soit d’office, ainsi que 74 décisions à la suite de demandes spéciales ; sur ces demandes, 10 avaient été rejetées administrativement et 17 étaient toujours pendantes. Ces décisions sont susceptibles d’un recours administratif. Au 31 janvier 2012, 29 recours administratifs étaient pendants devant le ministère de l’Intérieur. On peut supposer que, après un tel recours administratif, il est possible de solliciter une décision judiciaire. Il semble que la moitié environ des 25 671 personnes initialement lésées ne vivent plus en République de Slovénie ou n’ont pas manifesté leur intérêt juridique à régulariser leur statut de résident. Quant à l’indemnisation des victimes, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, le droit interne fixait à cet égard un délai de cinq ans expirant en mars 2004. Le législateur ayant ignoré cette décision de la Cour constitutionnelle jusqu’en 1999 et la violation ayant manifestement continué, cette date d’expiration ne devrait pas être applicable.
En revanche, je m’empresse d’ajouter que l’on ne peut dire avec certitude dans combien de cas les victimes, c’est-à-dire celles ayant qualité pour agir (legitimatio activa) dans des affaires futures potentielles, ont en fait elles-mêmes négligé de demander la nationalité en temps utile. En outre, le délai de vingt ans qu’il a fallu pour résoudre juridiquement cette question – au cas par cas ! – au niveau interne est dans une certaine mesure dû au fait que l’on a trompé l’opinion publique slovène en lui donnant l’impression peu crédible et fausse qu’au moins certaines des personnes lésées avaient causé le problème elles-mêmes ; la procrastination dont les intéressés ont fait preuve aurait été due à leur propre ambivalence nationaliste (serbe, croate, etc.) quant à leur animus manendi (intention d’établir résidence), c’est-à-dire de continuer à séjourner dans la République de Slovénie qui venait alors d’être créée. C’était il y a vingt ans, avant, pendant et après les guerres dans les Balkans. Il faut donc garder à l’esprit que – à l’époque – il était loin d’être évident pour les personnes concernées, eu égard à leurs vœux pieux, que les mythes mégalomanes d’une grande Serbie, ou autre, dans les Balkans étaient infondés. Les personnes véritablement – et pas seulement juridiquement – victimes de ces guerres tribales primitives – caractérisées par le narcissisme des petites différences et par les atrocités indicibles qui s’ensuivirent en Croatie, en Serbie et en Bosnie-Herzégovine – se comptent maintenant en centaines de milliers de personnes tuées, torturées, violées, etc. En outre, l’instigation perfide de certains services de renseignement d’Europe continentale – lesquels avaient un intérêt à la désintégration de la Yougoslavie – qui avait déclenché pour le reste l’activation démente de l’inconscient collectif chauvin et revanchard, a été largement médiatisée, en particulier aux Etats-Unis, et constitue désormais un fait historique établi. Ce processus déplorable a fait émerger des personnages, maintenant connus pour être des psychopathes, qui furent personnellement responsables de toutes sortes de cruautés inhumaines. Celles-ci étaient tout simplement inimaginables en Yougoslavie avant que ce tsunami de cruautés ne commence à déferler sur le pays. L’historien A.J.P. Taylor, par exemple, considérait Josip Broz Tito comme le dernier des Habsbourg, capable d’assurer la cohésion d’une communauté multinationale tolérante ; cet historien ne l’a pas vue se désintégrer. Par ailleurs, il apparaît, avec vingt ans de recul, que la désintégration de la Yougoslavie était et reste un véritable désastre. Dans ce réexamen historique, les Français diraient : « A quoi tout cela a-t-il servi ? » (en français dans le texte) Nulle personne sensée ne peut raisonnablement répondre à cette question, sauf à dire, à l’instar d’Erich Fromm, qu’il s’agissait d’une « folie à millions » (en français dans le texte). Notre intention n’est pas d’établir ici un parallèle avec l’éclatement de l’empire soviétique et ses conséquences ; il suffit de dire, puisqu’il s’agit d’une question de droit international, que Woodrow Wilson, avant de lancer sous l’influence de Tomáš Garrigue Masaryk son célèbre slogan concernant l’autodétermination des nations – avait été clairement et à maintes reprises averti des conséquences possibles de ce principe. Les conséquences sont désormais là, à savoir que la particularisation et la balkanisation d’entités nationales se sont en fait matérialisées. Il faut espérer que ce phénomène sera compensé, ainsi que je l’ai souligné à l’époque dans un article paru dans El País, par l’universalisation dans le contexte de l’Union européenne. Dans ce cadre, les querelles nationalistes seraient transcendées, au sens hégélien, et deviendraient, y compris les conflits frontaliers, en grande partie hors de propos. Avec la libre circulation des personnes en Europe, par exemple, les enjeux de la présente affaire deviennent tout simplement « sans objet » (en français dans le texte). Ce qui s’est désintégré à un niveau commence doucement, avec le retard tragique lié à l’histoire, à se reconstruire à un niveau supérieur. Il devient également de plus en plus clair que la cohésion, à la manière de A.J.P. Taylor, de cela, en d’autres termes de l’entité européenne, exigera beaucoup de sagesse politique. Cependant, le retard historique a engendré cette affaire et beaucoup d’autres conséquences plus épouvantables encore. Certaines ont donné lieu à des affaires qui ont abouti devant les juridictions internationales, mais ce n’est pas le cas de la plupart d’entre elles.
La pratique de nettoyage ethnique examinée dans l’affaire devant la Grande Chambre ayant été menée au moyen d’une construction erronée de la loi slovène sur la nationalité et de ses lacunes juridiques préméditées, la spécificité du cas d’espèce réside dans ses aspects légalistes, minutieusement consignés. C’est pourquoi nous disposons de renseignements historiques précis concernant le nombre de personnes lésées, le nombre de celles qui n’ont pas obtenu satisfaction au niveau interne (comme au titre de l’article 41 de la Convention devant la Cour), etc. L’héritage légaliste hypocrite susmentionné du régime communiste nous rappelle l’affaire Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne ([GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, CEDH 2001‑II) ; dans cette affaire aussi la façade de légalité schizophrène avait été maintenue intacte en apparence en Allemagne de l’Est. Derrière la façade, l’impunité avait continué sans entrave. Dans l’affaire dont nous sommes saisis, nous sommes en présence d’une lacune, laissée intentionnellement dans la loi, qui a été comblée par les « dépêches » (en français dans le texte) semi-officielles mais non publiées émises par le ministre de l’Intérieur et son secrétaire d’Etat qui étaient alors en fonction. Ces dépêches furent expressément approuvées par le premier ministre et le gouvernement d’alors. En droit pénal, nous pouvons donc parler de dolus directus pour les premiers et, pour le moins, de dolus eventualis pour les seconds. En attendant, on a trompé le public en lui faisant croire, comme je l’ai dit, que les milliers de victimes avaient été tout simplement négligentes en ce qu’elles n’avaient pas demandé la nationalité slovène. Fort heureusement, grâce au caractère légaliste de la violation, toutes ces mesures, cette correspondance, etc. ont été enregistrées et sont conservées dans les archives, comme je l’ai souligné ci-dessus ; la Grande Chambre a pu consulter la correspondance et les dépêches en question et les prendre en compte. Il reste à voir si le système pénal national agira en conséquence vis-à-vis des protagonistes ; dans la négative, la question reviendra à Strasbourg sous l’angle des volets procéduraux des articles 3 et 8 notamment. De même, s’agissant de l’indemnisation des 25 671 victimes alléguées, la branche judiciaire du système juridique interne ferait bien, comme dans les affaires de durée de procédure (Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, CEDH 2005‑X), de traiter l’ensemble des situations équitablement et au cas par cas.
Pour être justes envers le système juridique national, nous devons tenir compte de la position honorable et courageuse adoptée par deux fois par la Cour constitutionnelle slovène face à la poursuite de cette situation épouvantable. Cela montre une fois de plus que la défense nationale des droits constitutionnels est la meilleure antichambre de notre propre protection des droits de l’homme. Les arrêts pertinents de la Cour constitutionnelle de Ljubljana ont essuyé une rebuffade des pouvoirs exécutif et législatif à l’époque. C’est le contribuable slovène qui va maintenant en payer le prix. D’après des informations récentes, en raison de son formalisme juridique caractéristique du post-communisme, le restant de la branche judiciaire n’a pas non plus indemnisé les victimes pour les violations continues telles que nous les avons établies dans les cas dont nous sommes saisis.
Cette affaire montre également que la machine judiciaire tourne doucement – mais sûrement. C’est précisément en raison de la compétence internationale que, du moins ici, la justice aura été rendue. En outre, bien qu’il soit impossible de définir la justice en tant que telle, l’injustice est facilement reconnaissable. Se pose donc la question plus large de savoir pourquoi l’injustice n’a pas été perçue au niveau national. En fait, dans les systèmes juridiques post-communistes, il semble y avoir une incompatibilité totale entre le formalisme juridique mécanique d’une part et le simple sens de la justice d’autre part. Nous rencontrons cette incompatibilité – summum ius, summa iniuria ! – bien souvent dans d’autres affaires, y compris dans des affaires dirigées contre des pays occidentaux, sauf que dans cette affaire colossale la Cour constitutionnelle a identifié l’injustice. C’est la volonté politique malveillante qui a fait obstacle à la prééminence du droit et à un redressement judiciaire adéquat.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE VUČINIĆ (Traduction)
En l’espèce, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a manifestement eu une violation de l’article 8 de la Convention, considérant que l’« effacement » du nom des requérants a constitué une ingérence dans la « vie privée et familiale » des intéressés au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 96, CEDH 2003‑X).
La principale conséquence de l’« effacement », et la pire, a été l’impossibilité tant concrète que juridique pour les requérants d’obtenir un permis de séjour permanent et/ou la nationalité slovène, et donc de continuer à jouir de toute la série de droits sociaux et politiques dont ils bénéficiaient en tant que ressortissants de l’ex-RSFY avant l’indépendance de la Slovénie, puisqu’ils résidaient légalement sur le territoire slovène depuis des années, voire des décennies.
Ainsi que la Cour le souligne au paragraphe 356 de l’arrêt, « [l]’« effacement » a eu pour eux un certain nombre de conséquences néfastes telles que la destruction de leurs papiers d’identité, la perte de possibilités d’emploi, la perte de leur assurance maladie, l’impossibilité de renouveler leurs papiers d’identité et leurs permis de conduire, et des difficultés pour faire valoir leurs droits à pension. De fait, le vide juridique laissé par les lois sur l’indépendance (...) a privé les requérants du statut juridique qui leur avait donné auparavant accès à tout un éventail de droits. » (gras ajouté)
Si j’approuve le sens général du paragraphe 356 de l’arrêt, qui résume le fond de l’affaire, j’estime qu’il est dans une certaine mesure juridiquement incomplet et inachevé. Nous ne sommes pas en présence d’une « violation ordinaire » de l’article 8 § 1 de la Convention. Nous avons affaire à des violations à grande échelle du droit de chacun à l’existence juridique, c’est-à-dire du droit de chacun à la personnalité juridique.
Ce droit absolument fondamental est directement prévu par l’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela en soi témoigne amplement de ce que nous sommes confrontés à une affaire hors du commun ! En outre, le droit à la personnalité juridique est bien ancré dans le droit international des droits de l’homme tant universel que coutumier. C’est une condition préalable essentielle à la jouissance non seulement des droits et libertés fondamentaux, mais également d’un large éventail de droits matériels et procéduraux.
L’« effacement » a de facto privé les requérants de leur personnalité juridique, leur nom ayant été tout simplement et sans pitié « effacé » de l’ordre juridique slovène. Ils ont cessé d’exister en tant que « sujets de droit », c’est-à-dire en tant que « personnes physiques », dans le système juridique slovène. On a traité les requérants comme des objets jetables et non comme des sujets de droit. Il va sans dire que cela porte atteinte à la personnalité humaine et à la dignité des requérants.
Si ce droit n’est pas mentionné expressément dans la Convention, cela ne signifie pas qu’il ne relève pas indirectement et tacitement du champ d’application de l’article 8 § 1 de la Convention. La Cour l’a dit à plusieurs reprises, la notion de « vie privée » est large et ne se prête pas à une définition exhaustive. Cette notion recouvre, entre autres, l’identité personnelle et l’intégrité physique, psychologique et morale de la personne. Elle peut donc englober de multiples aspects de l’identité et de la dignité physiques, sociales et morales d’une personne. On ne saurait limiter le droit au respect de la vie privée à un « cercle intime » de l’existence humaine où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et écarter entièrement de ce droit le monde extérieur à ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A no 251‑B). Il s’ensuit par la force des choses que l’article 8 protège également le droit à l’épanouissement personnel et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur, même dans la sphère publique, qui peut également relever de la notion de « vie privée » (S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 66, CEDH 2008, et P.G. et J.H. c. Royaume‑Uni, no 44787/98, CEDH 2001‑IX).
D’une part, il est absolument clair que le droit à la personnalité juridique est une condition préalable fondamentale et indispensable tant à la réalisation et à la jouissance des divers aspects susmentionnés de la vie privée, y compris le « cercle intime », que – dans la sphère publique – à l’« épanouissement extérieur » de la personnalité.
D’autre part, le droit à la personnalité juridique est une conséquence normale, naturelle et logique de la personnalité humaine et de la dignité inhérente à celle-ci ; il s’agit d’une composante naturelle et inhérente de tout être humain et de sa personnalité humaine. De par son caractère large, non exhaustif et souple, l’article 8 de la Convention inclut manifestement ce droit dans son vaste champ d’application. Ce droit est tacitement, mais très clairement, englobé et profondément ancré dans la notion de personnalité individuelle et de dignité humaine inhérente à la personne couverte par l’article 8 de la Convention.
Le droit à la personnalité juridique s’acquiert par la naissance, mais il peut malheureusement être restreint ou une personne peut en être totalement privée par des mesures prises illégalement et arbitrairement par un gouvernement. La restriction ou la privation de ce droit peut s’opérer par deux grands moyens du « positivisme ordinaire » : l’adoption de « lois illégales et illégitimes », c’est-à-dire de lois qui poursuivent des buts illégaux et illégitimes ou qui ont un contenu « anti‑humain », ou la mise en œuvre arbitraire et abusive de « lois légales et légitimes », comme ce fut le cas en l’espèce.
La Cour avait là une excellente occasion de dire que ce droit est inhérent à l’article 8 de la Convention. Malheureusement, la majorité ne l’a pas saisie et n’a précisé ni expressément ni explicitement ce qui entre déjà implicitement et tacitement dans le domaine de l’article 8 de la Convention. Elle aurait pu obtenir ce résultat en ajoutant une phrase simple et courte dans ce sens à la fin du paragraphe 356.
La déchéance des requérants de leur personnalité juridique par l’opération d’« effacement » de grande envergure n’a pas seulement privé les intéressés de leur statut juridique, qui leur donnait auparavant accès à toute une série de droits ; elle a aussi substantiellement diminué leur capacité juridique et procédurale à utiliser les recours internes qui leur auraient été accessibles pour la régularisation de leur statut juridique. Pour cette raison, aucun des recours mentionnés par le Gouvernement ne saurait être considéré comme accessible et adéquat pour les requérants, ainsi qu’il est dit dans l’opinion en partie dissidente commune aux juges Bratza, Tulkens, Spielmann, Kovler, Kalaydjieva, Vučinić et Raimondi. Non seulement le vide juridique laissé dans les lois sur l’indépendance (paragraphes 344-356 de l’arrêt), mais également la mise en œuvre délibérée de ces lois par une réglementation dérivée secrète ayant manifestement des buts illégitimes a placé devant les requérants des obstacles administratifs insurmontables supplémentaires et a fait échec à leurs demandes légitimes de régularisation de leur statut juridique.
Dès lors, on aurait dû considérer que M. Dabetić et Mme Ristanović étaient dispensés de l’obligation de demander officiellement avant toute chose un permis de séjour. Les intéressés ayant auparavant été « effacés » du système juridique slovène, privés de facto de leur capacité juridique et confrontés à une politique du gouvernement organisée et soigneusement planifiée tendant à la réduction du nombre de citoyens « ethniquement non appropriés », leur demande aurait sans aucun doute été totalement inutile et vaine, comme cela a d’ailleurs été le cas pour les autres requérants.
On ne saurait considérer que les requérants, y compris M. Dabetić et Mme Ristanović, ont perdu leur qualité de victime, car ils continuent de subir des préjudices. Ils endurent les conséquences de l’« effacement » et de la perte de leur personnalité juridique. Ils n’ont jusqu’ici obtenu ni redressement ni réparation appropriés !
En outre, pendant des années, le Gouvernement n’a, de manière flagrante, tenu aucun compte des arrêts de la Cour constitutionnelle slovène, qui confirment clairement les violations des droits des requérants. En l’espèce, nous sommes en présence d’un exemple classique de « violation continue » de la Convention.
Enfin, et surtout, j’estime qu’en l’espèce la Cour n’a pas suffisamment pris en considération les circonstances particulièrement aggravantes, à savoir qu’il s’agit ici d’une violation systématique, massive et manifeste de droits humains fondamentaux résultant d’une politique gouvernementale délibérément organisée et planifiée, plus de 25 000 personnes ayant été « effacées » du système juridique slovène et ainsi privées de leur droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique. Nul besoin de préciser que cela constitue un moyen légaliste d’effectuer un nettoyage ethnique.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE
AUX JUGES BRATZA, TULKENS, SPIELMANN, KOVLER,
KALAYDJIEVA, VUĆINIĆ ET RAIMONDI
1. Nous ne pouvons suivre la majorité pour autant qu’elle accueille l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement en ce qui concerne M. Dabetić et Mme Ristanović (point 4 du dispositif de l’arrêt).
2. Dans la présente affaire, la Cour conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention. Au paragraphe 371 de l’arrêt, elle renvoie à son constat selon lequel le Gouvernement n’a pas établi que les recours dont disposaient les requérants fussent « adéquats » et « effectifs » pour faire redresser, à l’époque des faits, la violation alléguée de l’article 8 de la Convention. La Cour lie le constat de violation de l’article 13 de la Convention à sa décision rejetant l’exception de non-épuisement concernant les six requérants qui ont finalement obtenu des permis de séjour (M. Kurić, Mme Mezga, M. Ristanović, M. Berisha, M. Ademi et M. Minić) (paragraphes 295-313 de l’arrêt). Conformément à sa ligne jurisprudentielle traditionnelle, elle fait ainsi application du principe des « affinités étroites » qui caractérisent les liens subtils unissant l’article 35 à l’article 13 de la Convention. En effet, la règle de l’épuisement des voies de recours internes se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – avec laquelle elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, en dernier lieu, Sabeh El Leil c. France [GC], no 34869/05, § 32, 29 juin 2011, et McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010).
3. La Cour a examiné en détail les différentes possibilités exposées par le Gouvernement à l’appui de son exception, à savoir les recours constitutionnels individuels, la requête en contrôle abstrait de la constitutionnalité de la législation, la loi modifiée sur le statut juridique et la procédure d’acquisition de la nationalité. Aucune de ces voies proposées par le Gouvernement n’a emporté la conviction de la Cour, laquelle conclut qu’il y a lieu de rejeter l’exception et, en toute logique et par identité de motifs, qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention.
4. De deux choses l’une. Ou bien il y a des recours qui répondent aux critères d’adéquation et d’effectivité ou bien il n’y en a pas. En optant pour la deuxième branche de l’alternative, la Cour aurait, à notre avis, dû rejeter également l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes pour ce qui est de M. Dabetić et de Mme Ristanović. Le fait que ces deux requérants n’ont ni tenté d’obtenir un permis de séjour ni pris de mesure pour régulariser leur statut de résident (paragraphes 289-294 de l’arrêt) n’est pas pertinent pour conclure au non-épuisement des voies de recours internes.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE COSTA
Je me rallie volontiers à l’excellente argumentation développée par le Juge Spielmann et plusieurs autres collègues dans leur opinion commune : la requête, en tant qu’elle émane de M. Dabetić et de Mme Ristanović, n’aurait à mon avis pas dû être rejetée pour non-épuisement des voies des recours internes : puisque ceux-ci, aux yeux de la Cour, n’étaient pas suffisamment effectifs ils n’avaient donc pas à être épuisés, et le raisonnement de l’arrêt est sur ce point entaché de contradiction ; je n’y insiste pas.
J’ajoute toutefois une remarque qui couvre deux aspects.
Il aurait été à mon avis préférable d’examiner d’abord si ces deux personnes avaient la qualité de victimes ou si, comme l’a soutenu également le gouvernement slovène, le fait qu’ils n’auraient pas demandé à bénéficier des lois leur permettant (peut-être) d’obtenir satisfaction sur le fond démontrerait l’absence ou la perte de leur qualité de victimes.
D’une part, bien qu’il n’y ait aucune hiérarchie rigide, selon la jurisprudence de la Cour, en ce qui concerne les fins de non-recevoir, il semble plus naturel de statuer sur le statut de victime des requérants avant de décider s’ils ont épuisé les recours internes. La première question est d’ailleurs mentionnée à l’article 34 de la Convention et la seconde à l’article 35, même si cet argument de texte n’est pas péremptoire, je l’admets.
D’autre part, le gouvernement à mes yeux se trompe en confondant l’absence apparente d’intérêt manifesté par ces requérants avec la disparition de la qualité de victime. M. Dabetić et Mme Ristanović étaient dans des conditions très difficiles, pour des raisons de maladie et d’éloignement, et la complexité des avatars juridiques affectant leur situation ne rendait pas plus facile la connaissance des textes qui auraient pu fonder leurs demandes. Il est donc sévère de soutenir que leur désintérêt subjectif, apparent je le répète, puisse équivaloir à la perte du statut de victimes, lequel est objectif. Le glissement du subjectif à l’objectif n’est pas impossibles dans certaines circonstances particulières, mais il ne se présume certainement pas.
Certes, l’arrêt, en accueillant l’exception de non-épuisement, n’a pas eu à examiner celle touchant à la qualité de victimes et il dit, justement, que ce n’est pas nécessaire. Mais je tenais à préciser qu’à mon sens M. Dabetić et Mme Ristanović étaient doublement recevables, et probablement fondés, dans leur recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. Je n’en regrette que davantage que celui-ci ait été rejeté.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES KOVLER ET KALAYDJIEVA (Traduction)
Avec les juges Bratza, Tulkens, Spielmann, Vučinič et Raimondi nous avons exprimé notre désaccord avec les conclusions de la majorité concernant la recevabilité des griefs de M. Dabetić et Mme Ristanović. A notre sens, des préoccupations similaires s’appliquent aux conclusions formulées par la chambre de la troisième section dans son arrêt du 31 mai 2007 quant à la qualité de victime de MM. Petreš et Jovanović. A cet égard, la chambre a estimé d’une part que « la délivrance de permis de séjour rétroactifs (...) constitu[ait] un redressement adéquat et suffisant de leurs griefs » (paragraphe 311 de l’arrêt de la chambre), tout en constatant d’autre part une violation de l’article 13 de la Convention, considérant que « l’Etat défendeur n’a[vait] pas démontré que les [mêmes] recours à la disposition des requérants pouvaient passer pour effectifs » (paragraphe 385 de l’arrêt de la chambre).
Nous nous rallions sans réserve à la Grande Chambre lorsqu’elle conclut que « [e]u égard à cette longue période d’insécurité et d’incertitude juridique qu’ont connue les requérants et à la gravité des conséquences de l’« effacement » pour eux, (...) la reconnaissance des violations des droits de l’homme et l’octroi de permis de séjour permanent [aux six autres requérants] n’ont pas constitué un redressement « approprié » et « suffisant » au niveau national » (paragraphe 267 de l’arrêt) et qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 8, étant donné que le Gouvernement n’a pas établi le caractère effectif des recours disponibles. Pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles nous ne pensons pas qu’un requérant puisse être tenu d’utiliser des recours qui ne sont pas de nature à fournir un redressement « adéquat et suffisant », nous ne voyons pas comment la mise en œuvre des mêmes mesures peut priver un requérant de sa qualité de victime. Dans des affaires antérieures, la Grande Chambre a examiné conjointement la question de la qualité de victime des requérants et celle du caractère approprié et suffisant ou non des recours disponibles au niveau national car il s’agit des deux faces d’une même médaille (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, CEDH 2010 ; Sakhnovski c. Russie [GC], no 21272/03, 2 novembre 2010, et Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, 22 mars 2012).
Nous regrettons le point de vue de la majorité selon lequel les conclusions controversées de la chambre sur la qualité de victime de MM. Petreš et Jovanović constituent un « obstacle procédural » à la compétence de la Grande Chambre (paragraphe 263 de l’arrêt), car il permet un résultat manifestement différent dans des affaires individuelles identiques.
Arrêt SHALA c. SUISSE du 15 novembre 2012, requête n° 52873/09
Double peine, il est expulsé pour 10 ans alors qu'il a ses liens familiaux en Suisse. Pas de violation de la Convention.
a) Ingérence dans le droit protégé par l’article 8
38. La Cour rappelle que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l’article 8 § 1 de la Convention (Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, § 16, série A no 193).
39. Ensuite, la Cour rappelle que tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n’ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l’article 8. Toutefois, dès lors que l’article 8 protège également le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu, il faut accepter que l’ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fait partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8. Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », l’expulsion d’un étranger établi s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Dans ce cas, une certaine importance est accordée sur ce plan au degré d’intégration sociale des intéressés (voir, par exemple, l’arrêt Dalia c. France, 19 février 1998, §§ 42-45, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). C’est en fonction des circonstances de l’affaire portée devant elle que la Cour décidera s’il convient de mettre l’accent sur l’aspect « vie familiale » plutôt que sur l’aspect « vie privée » (Üner, précité, § 59).
40. Pour ce qui est des circonstances de l’espèce, la Cour estime que, en raison de la très longue durée du séjour du requérant en Suisse, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie « privée » (voir, mutatis mutandis, Gezginci c. Suisse, no 16327/05, § 57, 9 décembre 2010). Dans ces circonstances, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner si le requérant a également subi une ingérence dans sa vie « familiale » (ibid.), rappelant simplement que les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001 ; et Kwakie-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), no 31519/96, 7 novembre 2000).
b) Justification de l’ingérence
41. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », justifiée par l’un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
i. « Prévue par la loi »
42. Il n’est pas contesté que la mesure prononcée à l’encontre du requérant était fondée sur les dispositions pertinentes de la LSEE (voir le paragraphe 18 ci-dessus).
ii. But légitime
43. Eu égard aux infractions commises par le requérant, il n’est pas davantage controversé que l’ingérence en cause visait des fins pleinement en conformité avec l’article 8 § 2 de la Convention, à savoir la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales, la sûreté publique et la protection des droits et libertés d’autrui.
iii. Nécessité dans une société démocratique de la mesure
α) Principes généraux
44. La question essentielle à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux en la matière sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récapitulés, notamment dans les affaires Üner (précitée, §§ 54-55 et 57-58), Maslov c. Autriche ([GC], no 1638/03, §§ 68-76, CEDH 2008), et Emre (précité, §§ 65-71).
45. La Cour estime que, comme en l’espèce, la personne censée être expulsée est un adulte, sans enfants, qui se prévaut en premier lieu de son intégration dans le pays hôte et dont la situation relève plutôt de la vie « privée », il convient de prendre en compte les critères suivants :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la nationalité des diverses personnes concernées, et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
46. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical (Boultif, précité, § 51, et Emre, précité, §§ 71, 81-83) ou la nature temporaire ou définitive de l’interdiction de territoire (Emre, précité, §§ 84-85 ; et Ezzouhdi, précité, § 34).
47. La Cour rappelle également que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X, et Berrehab c. Pays-Bas, 21 juin 1988, série A no 138, § 28). Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour, sa tâche consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, les droits de l’intéressé protégés par la Convention et, d’autre part, les intérêts de la société (voir, parmi beaucoup d’autres, Boultif, précité, § 47). Cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis, Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 47, CEDH 2002-III). La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une mesure d’éloignement d’une personne se concilie avec l’article 8 (Gezginci, précité, § 53).
48. Lorsqu’il s’agit d’examiner la nécessité de l’éloignement d’une personne qui est arrivée dans le pays hôte en bas âge, a reçu son éducation et a travaillé pendant un certain temps dans ce pays, où vivent également la plupart de ses amis et proches, et qu’elle n’a plus d’autres attaches que la nationalité de son pays d’origine, les autorités doivent démontrer, par des motifs pertinent et suffisant, qu’il existait un besoin social impérieux d’éloigner la personne, et en particulier que la mesure était proportionnée au but légitime poursuivi (dans ce sens Ezzouhdi, précité, § 34).
β) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
49. En ce qui concerne les circonstances du cas d’espèce, la Cour rappelle que le requérant est entré en Suisse en 1990 et qu’il y a régulièrement passé 18 années au moment de son expulsion, intervenue le 31 mars 2008. Il est évident qu’il s’agit là d’une période très longue dans la vie d’un individu et, plus concrètement, de plus de deux tiers de la vie du requérant, qui est né en 1983 (cf., en ce sens, l’affaire Gezginci, précitée, § 69, dans laquelle la durée totale du séjour régulier en Suisse de l’intéressé était également au moins de 18 ans). En outre, il n’apparaît pas, en tout cas le Gouvernement ne le prétend pas, que le requérant se soit livré à de nouvelles activités délictuelles depuis sa dernière condamnation, prononcée le 26 juin 2007.
50. Il convient de rappeler que le requérant a été condamné à des peines privatives de liberté de cinq mois et demi au total pour lésions corporelles par négligence, pour violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir pris la fuite après avoir blessé une personne lors d’un accident de la circulation, ainsi que pour rixe. De plus, il a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende de 90 CHF et à une amende pour abus d’installation de télécommunication ainsi que pour tentative de chantage (voir les bases légales relatives aux condamnations du requérant, ci-dessus, paragraphes 19-20).
51. La Cour estime que, certes, la nature et la gravité des infractions commises par le requérant sont moins importantes comparées, en particulier, à celles prononcées dans l’affaire Emre précitée, qui s’élevaient à 18 mois et demi au total (§ 73 ; voir également les affaires précitées Üner, § 63, et Maslov, § 80). Par ailleurs, les deux peines d’emprisonnement sont assorties d’un sursis. En revanche, la Cour partage l’avis des instances internes et du Gouvernement selon lequel les menaces de mort adressées à son ex-amie de manière répétée paraissaient sérieuses et étaient de nature à effrayer la victime. Il n’a notamment pas hésité à lui dire ou écrire qu’il la jetterait sous un train, la pendrait, l’abattrait devant sa famille ou ferait de sorte qu’elle soit contaminée par le virus du sida.
52. La Cour constate aussi que les activités délictueuses du requérant se sont étendues sur un laps de temps considérable, soit entre mars 2002 et avril 2007 ; son comportement délictuel ne s’épuisait ainsi pas en une seule condamnation (voir, en ce sens, Emre, précité, § 74 ; a contrario, Moustaquim, précité, § 44 ; Bousarra, précité, § 45 ; A.W. Khan, précité, §§ 40-41). Par ailleurs, les avertissements prononcés à son encontre ne l’ont visiblement pas empêché non plus de commettre de nouvelles infractions. Enfin, même si les agissements imputés au requérant remontent à un âge relativement jeune, il les a commis après son adolescence (voir, a contario, Emre précité, § 74 ; Moustaquim, précité, § 44 ; et Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, § 46, 17 avril 2003). Ainsi, l’on ne saurait parler d’infractions relevant de la délinquance juvénile qui tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l’âge adulte (Emre, précité, § 74, avec référence citée). Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l’on ne saurait sous-estimer la gravité des infractions commises par le requérant, vues dans leur ensemble.
53. Quant à la nationalité des diverses personnes concernées et les difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, la Cour rappelle qu’en septembre 2007, celui-ci s’est marié au Kosovo avec une ressortissante kosovare. Le requérant ne prétend pas que son épouse aurait vécu ailleurs qu’au Kosovo, notamment en Suisse, ou qu’elle aurait des difficultés de quelle manière que ce soit d’y rester. Selon les observations du Gouvernement, non contestées par le requérant, la famille de son épouse vit également au Kosovo. La présente affaire se distingue donc sur ces points essentiellement par rapport aux affaires tranchées par la Cour dans lesquelles les personnes menacées d’une expulsion s’étaient mariées avec des ressortissants du pays dont elles devaient être expulsées (voir, notamment les affaires Üner et Boultif, précitées).
54. En ce qui concerne la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux qu’entretient le requérant avec la Suisse, il est certes incontesté que la plupart de sa famille vit en Suisse, notamment ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Or, à l’instar du Gouvernement, la Cour estime que, même à supposer que ces liens tombent dans le champ d’application de l’article 8 (voir Ezzouhdi, précité, § 34 ; et Kwakie-Nti et Dufie, décision précitée), l’éloignement du requérant du territoire suisse ne signifie nullement que les liens familiaux avec ses proches sont définitivement rompus, étant donné que des contacts réguliers peuvent être maintenus par les différents moyens de communication ainsi que par des visites de sa famille au Kosovo (voir, dans ce sens, Üner, précité, § 64).
55. La Cour rappelle ensuite que le requérant, entré en Suisse à l’âge de sept ans, y a effectué toute sa scolarité en Suisse et y a accompli un apprentissage de serrurier. Selon la Cour, il faut des circonstances assez exceptionnelles pour justifier l’éloignement d’un individu qui se trouve dans une telle situation (voir, dans ce sens, paragraphe 48 ci-dessus). Ces circonstances peuvent par exemple résider dans la gravité extraordinaire des infractions commises (Üner, § 65). Ce qui semble pourtant plus important dans le cas d’espèce est le fait que le requérant a maintenu des liens assez forts avec son pays d’origine, ce qui distingue sa cause de certaines affaires tranchées par la Cour (voir, en particulier l’affaire Maslov, précité, § 97, dans laquelle le requérant ne parlait pas la langue bulgare et n’avait pas d’autres liens étroits avec son pays d’origine). En effet, l’on ne saurait prétendre que, dans le cas d’espèce, le requérant n’aurait plus d’autres attaches que la nationalité kosovare. Selon les observations du Gouvernement, non contestées par le requérant, il a passé les sept premières années de sa vie au Kosovo. En outre, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral qu’il s’y est rendu fréquemment, notamment pendant ses vacances et les périodes de chômage, et qu’il possède encore des proches, notamment la famille de son épouse, avec laquelle, selon le Tribunal fédéral, il parle en albanais. A la lumière de ces circonstances, la Cour ne voit pas de raison de remettre en cause les conclusions des instances internes selon lesquelles les coutumes et habitudes en usage au Kosovo étaient encore familières au requérant (voir, dans ce sens, Gezginci, précité, §§ 73-75). Elle ne considère par ailleurs pas complètement dépourvu de fondement l’argument du Gouvernement selon lequel la formation de serrurier qu’il a suivie et accomplie avec succès en Suisse l’aiderait à s’intégrer professionnellement au Kosovo, en dépit de la situation économique difficile.
56. Enfin, pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence, la Cour tient compte de la durée de l’interdiction de séjour (Ezzouhdi, précité, § 34, et Emre, précité, §§ 84-85, avec les nombreuses références). En l’espèce, la Cour constate que l’expulsion du requérant a été prononcée pour une période limitée, soit de dix ans. Il s’agit là d’un élément important qui distingue la cause du requérant de celle qui était à l’origine notamment des affaires précitées, dans lesquelles les intéressés étaient expulsés pour une durée illimitée (ibid.).
57. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier eu égard aux infractions commises par le requérant, vues dans leur ensemble, ainsi qu’aux attaches que le requérant maintient avec le Kosovo, dont témoigne notamment son mariage avec une ressortissante kosovare contracté en 2007, la Cour estime que l’Etat défendeur a ménagé un juste équilibre entre les intérêts privés du requérant, d’une part, et son propre intérêt à contrôler l’immigration, d’autre part.
58. Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Arrêt KISSIWA KOFFI c. SUISSE du 15 novembre 2012 Requête no 38005/07
Le renvoi d'une étrangère pour trafic de drogue est conforme à la convention même si le mari est suisse et que l'un de leur enfant est suisse puisque toute la famille est d'origine ivoirienne.
65. En ce qui concerne le cas d’espèce, la Cour observe tout d’abord que la condamnation de la requérante pour l’infraction en matière de stupéfiants (33 mois d’emprisonnement pour trafic de 2,5 kg de cocaïne) pèse lourdement. S’agissant d’une infraction en matière de stupéfiants, eu égard aux ravages de la drogue dans la population, la Cour a toujours conçu que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation de ce fléau (voir, par exemple, les arrêts Dalia, précité, § 54, Baghli c. France, no 34374/97, § 48, CEDH 1999-VIII, Mehemi, précité, § 37, et Maslov, précité, § 80). Par ailleurs, il importe de soulever que l’infraction est intervenue après seulement deux ans de séjour en Suisse.
66. La Cour observe en outre que la requérante est arrivée en Suisse en mai 2001 ; au moment de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2007, elle y vivait donc depuis moins de six ans. Selon la Haute Cour suisse, elle n’y était ni professionnellement ni socialement intégrée. En outre, elle constate que les requérants n’ont pas véritablement contesté l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante ne parle pas l’allemand et ne maîtrise que mal le français. Par ailleurs, comme l’observe le Gouvernement, elle a passé une bonne partie de son séjour en Suisse en détention. La Cour partage également l’avis du Gouvernement selon lequel la requérante, ayant passé la plupart de sa vie en Côte d’Ivoire, ne peut pas prétendre que ses liens sociaux avec son pays d’origine soient rompus et qu’il n’ait plus de chance de s’y intégrer.
67. La Cour rappelle également que la requérante est ivoirienne, son époux d’origine ivoirienne, possédant la nationalité suisse, et que leur enfant commun, le second requérant, possède également la nationalité suisse. Il n’est pas contesté que le mariage existe réellement. Par ailleurs, l’infraction a été commise par la requérante en octobre 2003, soit après la conclusion du mariage en 1999 ; en d’autres termes, son mari ne pouvait pas être au courant au moment de la création de la relation familiale. En revanche, au moins depuis octobre 2004, lorsque l’office des migrations du canton de Zürich a refusé de prolonger le titre de séjour de la requérante, les époux étaient confrontés au risque d’une éventuelle séparation.
68. Il convient également de rappeler que la requérante, lorsqu’elle a quitté le Côte d’Ivoire, a laissé derrière elle un enfant hors mariage, qui est depuis lors pris en charge par des amis. Elle a dès lors délibérément accepté de couper les liens avec celui-ci. En outre, elle n’allègue pas devant la Cour qu’elle ait tenté des mesures en vue de le faire venir en Suisse. En outre, quant à l’enfant commun, né le 19 mai 2006, la Cour ne saurait spéculer sur la décision des parents concernant le sort de cet enfant, mais de toute façon, il se trouve encore en bas âge et est dès lors censé pouvoir s’intégrer dans la société ivoirienne, d’autant plus qu’il a passé quelques mois dans ledit pays (novembre 2007 – avril 2008).
69. En ce qui concerne le mari de la requérante, la Cour rappelle qu’il séjourne, certes, depuis de longues années en Suisse, dont il possède la nationalité. Son retour en Côte d’Ivoire le placerait devant certaines difficultés. La Cour rappelle, en revanche, qu’il est originaire de ce pays et que, dès lors, son intégration professionnelle et sociale semble envisageable, comme l’a observé le Tribunal fédéral. En outre, il pourrait entretenir un certain contact avec ses deux enfants, issus d’un premier mariage, et remplir ses devoirs de prise en charge même s’il s’installe en Côte d’Ivoire ; par ailleurs, il ne paraît pas qu’il soit investi du droit de garde de ses enfants.
70. Enfin, la Cour rappelle également que l’interdiction du territoire a été prononcée pour une durée indéterminée. Cet élément peut rendre la mesure imposée disproportionnée et constitue l’un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts (voir, par ex., Emre, précité, § 85). En même temps, la Cour observe que la requérante peut demander la levée à titre temporaire de l’interdiction en vue de rendre visite à sa famille en Suisse, ce qui distingue la présente cause notamment de l’affaire Üner (précitée), dans laquelle toute visite, même de courte durée, était exclue (§ 65). A cet égard, la Cour rappelle que la requérante a soumis trois demandes, dont l’une a été accueillie favorablement par les autorités suisses, conformément à la loi pertinente (paragraphe 34 ci-dessus). La requérante allègue qu’elle n’a pas fait usage de cette autorisation pour des raisons financières et à cause des difficultés d’obtenir un visa (paragraphe 31 ci‑dessus). Par ailleurs, il ressort de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 mars 2011 que la requérante n’avait pas soumis d’autres demandes (paragraphe 32 ci-dessus). En tout état de cause, comme l’a observé à juste titre ce dernier tribunal dans le même arrêt, les autorités compétentes avaient démontré, par l’acceptation de l’une de ses demandes, qu’elles voulaient permettre à la requérante de maintenir le contact avec ses proches en Suisse (paragraphe 32 ci-dessus). La Cour interprète cette acceptation comme une preuve que les autorités internes étaient soucieuses de se conformer aux exigences du respect de la vie familiale au sens de l’article 8 et en déduit que la possibilité d’allègement de la mesure d’interdiction de territoire n’existe pas seulement théoriquement, mais réellement et pratiquement.
71. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier eu égard à la gravité de la condamnation pour infraction en matière de stupéfiants prononcée contre la requérante, ainsi qu’au fait qu’elle a passé la majorité de sa vie dans son pays d’origine, ce qui laisse supposer qu’elle pourrait s’y intégrer, la Cour estime que l’Etat défendeur n’a pas dépassé la marge d’appréciation dont il jouissait dans le cas d’espèce.
72. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Arrêt HAMIDOVIC c. ITALIE du 4 décembre 2012 Requête no 31956/05
Une étrangère expulsée d'Italie alors que ses cinq enfants sont nés et ont toujours vécu en Italie est une violation de la Convention.
1. Les principes généraux
36. La Cour rappelle à titre liminaire que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont on n’est pas ressortissant, et que les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, El Boujaïdi c. France, 26 septembre 1997, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI ; Baghli c. France, no 34374/97, § 45, CEDH 1999-VIII, et Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 39, CEDH 2001-IX).
37. Cependant, les décisions prises par les Etats en matière d’immigration peuvent, dans certains cas, constituer une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 § 1 de la Convention, notamment lorsque les intéressés possèdent, dans l’Etat d’accueil, des liens personnels ou familiaux suffisamment forts qui risquent d’être gravement affectés en cas d’application d’une mesure d’éloignement. Pareille ingérence enfreint l’article 8, sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou plusieurs buts légitimes au regard du deuxième paragraphe dudit article et apparaît « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (Moustaquim c. Belgique, 18 février 1991, § 36, série A no 193 ; Dalia c. France, 19 février 1998, § 52, Recueil 1998‑I ; Amrollahi c. Danemark, no 56811/00, § 33, 11 juillet 2002 ; Kaftaïlova c. Lettonie, no 59643/00, 22 juin 2006 et Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 167, 12 septembre 2012).
38. La Cour relève aussi que l’article 8 n’emporte pas une obligation générale pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue des obligations pour l’Etat d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général (Gül c. Suisse, 19 février 1996, § 38, Recueil 1996-I, Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 39, CEDH 2006‑I).
2. L’application des principes susmentionnés dans le cas d’espèce
a) Le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante
39. Dans le cas d’espèce, nul ne peut douter que la requérante a tissé en Italie des liens solides. Il ressort du dossier que la requérante réside en Italie depuis 1985 (moment où elle fut arrêtée pour la première fois), soit depuis l’âge de dix ans. Compte tenu du laps de temps considérable pendant lequel la requérante a vécu sur le territoire italien, il ne prête pas à controverse que la requérante a noué des relations personnelles, sociales et économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain (Kaftaïlova, précité, §§ 63 et 67).
40. La Cour considère en outre que l’existence d’une vie familiale de la requérante est également établie : cette dernière s’est mariée en Italie en 1991, cinq enfants sont nés de cette union et toute la famille réside en Italie depuis lors (voir, mutatis mutandis, C. c. Belgique, 7 août 1996, § 34, in fine, Recueil 1996‑III).
b) L’existence d’une ingérence, d’une base légale et d’un but légitime
41. La Cour relève que la mesure d’expulsion dont la requérante a fait l’objet a constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette mesure était prévue par la loi (à savoir, le décret-loi no 286 du 25 juillet 1998) et poursuivait un but légitime consistant en la sûreté publique et la défense de l’ordre.
c) La proportionnalité de la mesure litigieuse avec le but poursuivi
42. La Cour se réfère aux critères établis par sa jurisprudence sur le respect des obligations découlant de l’article 8 de la Convention en matière d’interdiction du territoire à la suite d’une condamnation pénale (Boultif, précité, § 48, et Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, §§ 57-58, CEDH 2006‑XII) et de respect de la législation sur l’immigration (voir, parmi beaucoup d’autres, Rodrigues da Silva et Hoogkamer, précité, § 39), à savoir :
– la nature et la gravité de l’infraction commise ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– sa situation familiale (le cas échéant, la durée de son mariage) ;
– la naissance éventuelle d’enfants du mariage, leur âge ;
– l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’Etat contractant en cause ;
– la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine ;
– et la question de savoir si la vie familiale en cause s’est développée à une époque où les personnes concernées savaient que la situation de l’une d’elles au regard des règles d’immigration était telle qu’il était immédiatement clair que le maintien de cette vie familiale au sein de l’Etat hôte revêtirait d’emblée un caractère précaire.
43. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour relève tout d’abord que la requérante a été condamnée une fois pour mendicité avec utilisation de mineurs à une peine de réclusion et que cette peine a par la suite été remplacée par une amende. Elle note encore que l’article 671 du code pénal, prévoyant l’infraction litigieuse, a été abrogé par la loi no 94 du 15 juillet 2009. La Cour estime que cette infraction n’est pas de nature à être qualifiée de « grave » au sens de la jurisprudence de la Cour (Kaftaïlova, précité, § 68 ; Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001, et, mutatis mutandis, El Boujaïdi, précité, § 41). La Cour note de surcroît que les procédures pénales entamées à l’encontre de la requérante à la suite de son appréhension en 1995 pour mendicité ont été classées sans suite (voir paragraphe 18 ci-dessus).
44. Quant à l’existence de liens familiaux, la Cour note à nouveau que la requérante, résidant en Italie depuis l’âge de dix ans, s’est mariée dans ce pays et que cinq enfants sont nés de cette union. En tout état de cause, même en concédant que la requérante n’a pas fourni la preuve d’une scolarisation continue et effective de ses enfants, la Cour relève que l’ensemble de la famille a vécu sans interruption jusqu’à ce jour en Italie : la possibilité pour toute la famille de s’établir en Bosnie-Herzégovine pour y rejoindre la requérante est donc peu réaliste, les enfants n’ayant aucune attache dans ce pays.
45. La Cour ne perd pas de vue que la requérante résidait de façon irrégulière en Italie au moment où elle a été touchée par l’arrêté d’expulsion et qu’elle ne pouvait pas ignorer la précarité qui en découlait (Dalia, précité, § 54 ; Useinov c. Pays-Bas (déc.), no 61292/00, 11 avril 2006 ; Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 94, CEDH 2007‑I, et, mutatis mutandis, Mawaka c. Pays-Bas, no 29031/04, § 61, 1er juin 2010). Il n’en demeure pas moins que la requérante a obtenu un permis de séjour pendant une courte période en 1996-1997 et que, d’après les informations reçues par le gouvernement défendeur, elle est à présent titulaire d’un permis de séjour valable jusqu’au 14 décembre 2013. La Cour estime donc que la requérante n’était pas dans une situation où elle ne pouvait à aucun moment raisonnablement s’attendre à pouvoir continuer sa vie familiale dans le pays hôte (Rodrigues da Silva et Hoogkamer, précité, § 43, et Solomon c. Pays-Bas (déc.) no 44328/95, 5 septembre 2000).
46. Qui plus est, la Cour constate que, en dépit de l’application de l’article 39 du règlement de la Cour, la requérante a été expulsée du territoire italien et ainsi éloignée de sa famille pendant environ un an et deux mois (du 6 septembre 2005 au 9 novembre 2006).
47. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que la mesure litigieuse n’a pas été proportionnée à l’objectif poursuivi. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
Arrêt HASANBASIC c. SUISSE du 11 juin 2013 Requête 52 166/09
L'expulsion d'un étranger alors que sa femme et ses enfants sont en Suisse est une violation à cause de L'ETAT DE SANTE dégradé du requérant.
a. Ingérence dans le droit protégé par l’article 8
46. La Cour rappelle que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l’article 8 § 1 de la Convention (Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, § 16, série A no 193).
47. La Cour observe en outre que, dans sa jurisprudence, elle a envisagé l’expulsion de résidents de longue date aussi bien sous le volet de la « vie privée » que sous celui de la « vie familiale », une certaine importance étant accordée sur ce plan au degré d’intégration sociale des intéressés (voir, par exemple, l’arrêt Dalia c. France, 19 février 1998, §§ 42‑45, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
48. En outre, la Cour rappelle que tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n’ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l’article 8. Toutefois, dès lors que l’article 8 protège également le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu, il faut accepter que l’ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fait partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8. Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », l’expulsion d’un étranger établi s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. C’est en fonction des circonstances de l’affaire portée devant elle que la Cour décidera s’il convient de mettre l’accent sur l’aspect « vie familiale » plutôt que sur l’aspect « vie privée » (Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 59, CEDH 2006-XII).
49. Pour ce qui est des circonstances de l’espèce, la Cour estime que, en raison de la très longue durée du séjour des requérants en Suisse, le refus de renouveler le permis de séjour du requérant constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie « privée » (voir, mutatis mutandis, Gezginci c. Suisse, no 16327/05, § 57, 9 décembre 2010). Dans la mesure où ce refus peut entraîner la séparation de son épouse ainsi que de leurs enfants communs résidant en Suisse, qui sont tous titulaires de permis de séjour pour ledit pays, la Cour est d’avis que les requérants ont également subi une ingérence dans leur droit au respect de leur vie « familiale ».
b. Justification de l’ingérence
50. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
i. « Prévue par la loi »
51. Il n’est pas contesté entre les parties que la mesure litigieuse était fondée sur les dispositions pertinentes de la LSEE (voir le paragraphe 24 ci-dessus).
ii. But légitime
52. A l’instar du Gouvernement, la Cour estime que l’ingérence en cause visait a priori des fins pleinement en conformité avec l’article 8 § 2 de la Convention, à savoir le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention d’infractions pénales ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui (voir, mutatis mutandis, Berrehab c. Pays-Bas, 21 juin 1988, série A no 138, § 26).
iii. Nécessité de la mesure dans une société démocratique
α) Principes généraux
53. La question essentielle à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux en ce qui concerne l’expulsion d’une personne ayant passé une durée considérable dans un pays hôte dont elle devrait être expulsée à la suite de la commission des infractions pénales sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récemment récapitulés, notamment dans les affaires Üner (précitée, §§ 54-55 et 57-58), Maslov c. Autriche ([GC], no 1638/03, §§ 68‑76, CEDH 2008), et Emre, précité, §§ 65-71. Dans l’affaire Üner, la Cour a eu l’occasion de résumer les critères devant guider les instances nationales dans de telles affaires (§§ 57 et suiv.) :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la nationalité des diverses personnes concernées ;
– la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
– la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
– la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
– la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
– l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
54. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical (Emre, précité, §§ 71, 81-83).
55. La Cour ne méconnaît pas que la présente affaire se distingue des affaires précitées dans la mesure où les requérants se plaignent du refus des autorités suisses de renouveler le permis d’établissement du requérant en faisant valoir en premier lieu leur intégration profonde dans la société de ce pays après y avoir passé un laps de temps considérable. Par ailleurs, le comportement délictuel du premier requérant ne semble avoir joué qu’un rôle secondaire dans l’appréciation des autorités internes. En tout état de cause, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’appliquer les critères susmentionnés mutatis mutandis à une telle situation.
56. La Cour rappelle également que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X ; et Berrehab, précité, § 28). Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour, sa tâche consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, les droits de l’intéressé protégés par la Convention et, d’autre part, les intérêts de la société (voir, parmi maints autres, Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 47, CEDH 2001‑IX). Cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis, Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 47, CEDH 2002-III). La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une mesure d’éloignement d’une personne se concilie avec l’article 8, et en particulier si elle était nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime poursuivi (Mehemi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, § 34 ; Dalia, précité, § 52 ; Boultif c. Suisse, précité, § 46 ; et Slivenko, précité, § 113).
β) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
57. La Cour observe d’emblée que les deux requérants ont régulièrement résidé en Suisse durant une période considérable. Le requérant est y arrivé en 1986, la requérante dès 1969. La durée de leurs séjours s’élevait donc, au moment de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2009, respectivement à 23 et 40 ans. En outre, la requérante possède depuis 1979 un permis d’établissement pour la Suisse, donc un titre dont la nature est plus stable qu’une simple autorisation de séjour. Par ailleurs, il n’est pas contesté que depuis un temps important, la Suisse constitue le centre de vie privée et familiale des requérants.
La Cour constate également que les requérants séjournèrent en Suisse de façon ininterrompue, abstraction faite de la période de quatre mois, entre août et décembre 2004, à la suite de laquelle les autorités internes ont rejeté la demande de regroupement familial de la requérante (paragraphe 14 ci-dessus). La présente affaire se distingue sur ce point sensiblement de l’affaire Gezginci (précitée, §§ 69 et 70), dans laquelle le requérant s’est rendu à l’étranger à plusieurs reprises pour des périodes prolongées.
Dans ces circonstances, la Cour est d’avis qu’il incombe aux autorités internes de démontrer, de manière convaincante et par des motifs pertinents et suffisants, qu’il existait un besoin social impérieux d’éloigner la personne, et en particulier que la mesure était proportionnée au but légitime poursuivi.
58. En ce qui concerne d’abord le comportement délictuel du requérant, la Cour rappelle que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises entre 1995 et 2002, à savoir à des amendes ne dépassant pas des montants de 400 CHF et à une peine d’emprisonnement de 17 jours (au total) pour des infractions à la législation sur la circulation routière et pour violation du domicile. La Cour observe, à l’instar des requérants, que ces infractions ne pèsent pas très lourdement et en conclut qu’il convient de les apprécier à leur juste mesure. Par ailleurs, elle juge important le fait que le requérant n’a plus récidivé depuis 2002. Compte tenu de ce qui précède, l’on ne saurait considérer le requérant comme un danger ou une menace pour la sécurité ou l’ordre public suisse.
59. Ce qui semble avoir joué un rôle important dans la pesée des intérêts opérée par les instances internes est le cumul des dettes importantes ainsi que les sommes considérables que les requérants avaient touchées de l’assistance publique entre 1994 et 2001, ainsi qu’entre 2003 et 2008 (voir, mutatis mutandis, Gezginci, précité, § 73). Le montant total s’élève à 333 000 CHF (environ 277 500 EUR). Rappelant que le bien-être économique du pays a expressément été prévu par les auteurs de la Convention en tant que but légitime pour justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale (voir, par ex., Miailhe c. France (no 1), 25 février 1993, § 33, série A no 256‑C ; Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 121, CEDH 2003‑VIII ; Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 79, CEDH 2006‑XI ; Mengesha Kimfe c. Suisse, no 24404/05, § 66, 29 juillet 2010 ; Agraw c. Suisse, no 3295/06, § 49, 29 juillet 2010, et Orlić c. Croatie, no 48833/07, § 62, 21 juin 2011), contrairement aux droits protégés en vertu des articles 9-11 de la Convention, la Cour est d’avis que les autorités suisses pouvaient prendre en compte l’endettement et la dépendance de l’assistance publique des requérants dans la mesure où cette dépendance avait une incidence sur le bien-être économique du pays. Elle estime néanmoins que ces éléments ne constituent qu’un aspect parmi d’autres à prendre en compte par la Cour.
60. Quant à la nationalité des diverses personnes concernées, les deux requérants sont des ressortissants de la Bosnie-Herzégovine. La Cour rappelle aussi que le couple a deux enfants communs, nés en 1982 et 1984, qui vivent en Suisse et qui possèdent un permis de séjour pour ce pays ; en outre, l’un des enfants issus du premier mariage du requérant, né en 1979, y vit également. Certes, dans la mesure où les requérants n’ont pas démontré devant la Cour qu’il existe entre eux et leurs enfants des éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001 ; et Kwakie-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), no 31519/96, 7 novembre 2000), ils ne peuvent pas invoquer ces rapports familiaux au regard de l’article 8, eu égard à l’âge adulte des enfants. La Cour estime néanmoins qu’ils ne sont pas complètement dépourvus de pertinence pour l’appréciation de la situation familiale des requérants.
61. De surcroît, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant, qui n’est pas frappé d’une interdiction d’entrée en Suisse, peut rendre régulièrement visite à ses enfants et, le cas échéant, à son épouse si cette dernière ne devait pas le suivre en Bosnie-Herzégovine. Par ailleurs, la Cour a été informée que le requérant peut se rendre sporadiquement en Suisse pour une durée maximale de trois mois (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour estime à cet égard que, même dans l’hypothèse où les autorités compétentes accueilleraient favorablement de telles demandes à l’avenir, ces mesures temporaires, qui sont octroyées, le cas échéant, seulement sur demande, ne sauraient en aucun cas être considérées comme pouvant remplacer le droit des requérants de jouir de leur droit de vivre ensemble, qui constitue l’un des aspects fondamentaux du droit au respect la vie familiale (voir, mutatis mutandis, les arrêts Agraw c. Suisse, no 3295/06, § 51, et Mengesha Kimfe c. Suisse, no 24404/05, §§ 69-72, tous deux du 29 juillet 2010).
62. Un autre critère qui doit être pris en compte dans la pesée des intérêts est la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse et avec la Bosnie-Herzégovine. En l’espèce, le Tribunal fédéral a reconnu lui-même que les requérants possèdent un réseau social important en Suisse et qu’eu égard à la durée considérable de leur séjour en Suisse, leur retour dans leur pays les placerait sans doute devant certaines difficultés (paragraphe 20 ci-dessus).
63. Certes, les autorités suisses ont également relevé que les requérants avaient fait construire une maison dans leur pays d’origine et que l’un des enfants issus du premier mariage du requérant ainsi que la sœur de celui-ci y vivaient. La Cour prend également note du fait que le requérant a annoncé son retour définitif en Bosnie-Herzégovine auprès des autorités suisses, le 24 août 2004, fait qui constitue l’un des arguments principaux des autorités internes pour refuser le renouvellement du permis de séjour. La Cour estime qu’il convient d’apprécier cet argument à la lumière des développements intervenus ultérieurement, soit après l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2009.
64. Compte tenu des nouvelles informations contenues dans les certificats médicaux mentionnés ci-dessus (paragraphes 21 et 22), et rappelant qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause l’appréciation des faits par les instances internes (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, §§ 45-46, série A no 140 ; et García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I), la Cour relève que l’état de santé du requérant s’est sérieusement affaibli et nécessite un suivi constant. Bien qu’elle ait des doutes à propos de la crédibilité de l’argument selon lequel le traitement nécessaire ne serait pas disponible en Bosnie-Herzégovine, Etat membre du Conseil de l’Europe, la Cour n’exclut néanmoins pas qu’un déracinement du requérant de son environnement habituel en Suisse ait des effets déstabilisants sur sa santé déjà fragilisée et provoque de nouvelles complications médicales (voir, mutatis mutandis, Emre, précité, §§ 81-83). Par conséquent, si l’état de santé du requérant ne fût pas suffisant, en lui-même, pour obliger les autorités suisses à renouveler son permis de séjour, la Cour ne saurait totalement l’ignorer dans la pesée des intérêts.
65. La Cour n’exclut pas que le fait selon lequel le requérant ne bénéficierait pas de sa rente d’invalidité s’il devait rentrer dans son pays d’origine – puisqu’une telle rente est seulement versée à l’étranger si elle atteint 50 % (paragraphe 26 ci-dessus) – soit susceptible d’aggraver sa situation. La Cour constate que les requérants n’ont pas explicitement invoqué cet argument devant les instances internes, mais le Gouvernement ne l’a pas non plus contesté dans ses observations adressées à la Cour.
66. Compte tenu de ce qui précède, la Cour admet que le bien-être économique du pays peut certes servir de but légitime pour un refus de renouveler un titre de séjour. Ce motif doit néanmoins être apprécié à sa juste mesure et à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Or, eu égard notamment à la durée considérable du séjour des requérants en Suisse et à leur intégration sociale incontestée dans ledit pays, la Cour estime que la mesure litigieuse n’était pas justifiée par un besoin social impérieux et n’était pas proportionnée aux buts légitimes invoqués. Partant, l’Etat défendeur a dépassé sa marge d’appréciation dont il bénéficiait en l’espèce.
67. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
AU REGARD DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Cliquez sur un lien bleu pour accéder :
- LA DECHEANCE DE NATIONALITE ET EXPULSION DES DJIHADISTES
- LE DROIT DE RENVOYER LES DÉLINQUANTS SI LES DROITS FAMILIAUX SONT RESPECTÉS
- LA DÉTENTION ADMINISTRATIVE D'UN ENFANT
- L'ENTRÉE DU SÉJOUR DOIT ÊTRE RÉGULIER POUR QU'UNE EXPULSION VIOLE LA CONVENTION
- LES DÉLAIS D'EXAMEN NON RAISONNABLES POUR ACCORDER OU NON UN TITRE DE SÉJOUR
La CEDH et le FRA ont publié un MANUEL DE DROIT EUROPÉEN AN MATIERE D'ASILE DE FRONTIERES ET D'IMMIGRATION au format PDF.
LA DECHEANCE DE NATIONALITE ET EXPULSION DES DJIHADISTES
EL AROUD ET SOUGHIR c. BELGIQUE du 5 décembre 2024 requête n° 25491/18 et 27629/18
Art 8 • Vie privée • Déchéance de la nationalité belge prononcée contre deux binationaux condamnés en Belgique pour des faits liés au terrorisme • Prévisibilité de la loi • Gravité de la menace terroriste pour les droits de l’homme • Garanties procédurales • Absence d’apatridie consécutive • Absence d’éloignement du territoire automatique • Ample marge d’appréciation non excédée
CEDH
a) Rappel de la jurisprudence
52. Les organes de la Convention ont pendant longtemps rejeté comme étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention les requêtes portant sur des cas de perte de la nationalité, que celle-ci fût acquise ou de naissance, au motif que la Convention ne garantissait pas pareil droit (Ramadan c. Malte, no 76136/12, § 84, 21 juin 2016, qui cite, à titre d’exemple, X. c. Autriche, no 5212/71, décision de la Commission du 5 octobre 1972 Recueil de décisions 43, p. 69).
53. Dans l’arrêt Ramadan (précité, §§ 84-85), la Cour a noté que, dans les affaires de nationalité qui concernaient des requérants revendiquant le droit d’acquérir une nationalité et se plaignant d’un refus de reconnaissance de cette nationalité, elle avait admis que bien que le droit à la nationalité ne soit pas en tant que tel garanti par la Convention ou par ses Protocoles, il n’était pas exclu qu’un refus arbitraire de la nationalité puisse dans certaines conditions poser un problème au regard de l’article 8 de la Convention à raison de l’impact que pareil refus pouvait avoir sur la vie privée de la personne concernée (Karassev c. Finlande (déc.), no 31414/96, CEDH 1999‑II; Slivenko et autres c. Lettonie (déc.) [GC], no 48321/99, § 77, CEDH 2002-II; Savoia et Bounegru c. Italie (déc.), no 8407/05, 11 juillet 2006; et Genovese c. Malte, no 53124/09, § 30, 11 octobre 2011). La Cour a estimé que la perte d’une nationalité acquise ou de naissance pouvait produire un effet identique (voire un effet plus important encore) sur la vie privée et familiale de la personne concernée. Elle en a déduit que rien ne justifiait d’opérer une distinction entre les deux situations et que c’est le même critère qui devait s’appliquer. Ainsi, la Cour a considéré qu’une déchéance arbitraire de nationalité pouvait dans certaines circonstances poser un problème au regard de l’article 8 de la Convention du fait de son impact sur la vie privée de l’intéressé. Il y avait dès lors lieu de rechercher si les décisions prises par les autorités nationales présentaient pareil caractère arbitraire et si elles avaient produit des conséquences de nature à soulever des questions au regard de l’article 8 de la Convention.
54. À la suite de l’arrêt Ramadan (précité), la Cour a appliqué cet examen en deux étapes dans les affaires relatives à une déchéance de nationalité. Dans certaines affaires, elle a d’abord analysé les allégations relatives au caractère arbitraire de la mesure, puis les conséquences que la mesure avait produites pour la personne concernée (K2 c. Royaume-Uni (déc.), no 42387/13, 7 février 2017, Ghoumid et autres c. France, nos 52273/16 et 4 autres, 25 juin 2020, Johansen c. Danemark (déc.), no 27801/19, 1er février 2022, et Laraba c. Danemark (déc.), no 26781/19, 22 mars 2022). Dans d’autres affaires, la Cour a d’abord examiné les conséquences que la mesure produisait pour la personne concernée afin de déterminer si elle constituait une ingérence dans les droits découlant de l’article 8 de la Convention, puis l’éventuel caractère arbitraire de ladite mesure (Alpeyeva et Dzhalagoniya c. Russie, nos 7549/09 et 33330/11, 12 juin 2018, et Emin Huseynov c. Azerbaïdjan (no 2), no 1/16, 13 juillet 2023 ; voir aussi, s’agissant de refus d’accorder la nationalité, Ahmadov c. Azerbaïdjan, no 32538/10, 30 janvier 2020, Hashemi et autres c. Azerbaïdjan, nos 1480/16 et 6 autres, 13 janvier 2022, et Abo c. Estonie (déc.), no 29295/22, 17 septembre 2024).
55. Dans l’arrêt Usmanov c. Russie (no 43936/18, 22 décembre 2020), la Cour a pris note de l’existence de ces deux approches dans la jurisprudence (§§ 53-54 et § 58) et elle a décidé, par référence à l’arrêt Denisov c. Ukraine ([GC], no 76639/11, §§ 107-109 et 118-134, 25 septembre 2018), de suivre l’approche fondée sur les conséquences pour déterminer si la déchéance de nationalité avait constitué une ingérence dans les droits que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention. Ainsi, elle a examiné, d’abord, les conséquences de la mesure contestée pour le requérant, puis son éventuel caractère arbitraire.
56. Dans toutes les affaires précitées relatives à une déchéance de nationalité, la Cour a jugé que, pour déterminer si les mesures de déchéance de nationalité étaient entachées d’arbitraire, elle devait vérifier si lesdites mesures étaient légales, si les requérants avaient bénéficié de garanties procédurales, notamment s’ils avaient eu accès à un contrôle juridictionnel adéquat, et si les autorités avaient agi avec diligence et promptitude (voir, par exemple, Usmanov, précité, § 63, et les références qui y sont citées).
b) Examen du cas d’espèce
Sur l’existence d’une ingérence
57. Pour ce qui est, tout d’abord, des conséquences de la mesure de déchéance de la nationalité belge pour la vie familiale de la requérante, la Cour rappelle que si l’éloignement d’un étranger d’un pays dans lequel se trouvent ses proches est susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, un arrêt prononçant la déchéance de la nationalité belge n’a pas d’effet automatique sur la présence sur le territoire belge de celui qu’il vise (Ghoumid et autres, précité, § 42). De plus, la Cour note que la requérante fait état de relations familiales avec sa fille majeure et sa petite‑fille, toutes deux de nationalité belge (paragraphe 4 ci-dessus). En l’absence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux, la Cour rappelle que les rapports familiaux entretenus entre adultes, y compris avec leurs enfants majeurs, ne bénéficient pas de la protection de la vie familiale garantie par l’article 8 de la Convention (voir, parmi d’autres, Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 97, CEDH 2003-X, A.H. Khan c. Royaume-Uni, no 6222/10, § 32, 20 décembre 2011, et Saber et Boughassal c. Espagne, nos 76550/13 et 45938/14, § 39, 18 décembre 2018). Du reste, la requérante n’a pas étayé les liens qu’elle entretient avec sa petite‑fille. Il en résulte que la déchéance de nationalité qui a touché la requérante n’est pas constitutive d’une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale. Le requérant, quant à lui, n’invoque pas d’atteinte à sa vie familiale.
58. Il est vrai que si la perte de la nationalité belge n’emporte pas automatiquement éloignement du territoire, la capacité des intéressés à rester en Belgique s’est trouvée en l’espèce fragilisée par la déchéance de leur nationalité belge. Ils ont ainsi tous deux fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire à la suite de celle-ci (paragraphes 14, 16 et 26 ci-dessus). La Cour n’a pas été informée d’une éventuelle exécution de l’ordre en question, ce point ne relevant pas, en tout état de cause, de l’objet de l’affaire portée devant elle (paragraphe 40 ci-dessus).
59. La conséquence de la déchéance de nationalité a également trait à la perte d’un élément de l’identité des requérants (Ghoumid et autres, précité, § 49). Ils sont tous deux arrivés sur le territoire belge à un très jeune âge (respectivement cinq ans et trois ans – paragraphes 4 et 19 ci-dessus) et ont vécu pendant plusieurs dizaines d’années en Belgique avant d’obtenir la nationalité belge par déclaration de nationalité (à, respectivement, 41 ans et 28 ans – paragraphes 5 et 20 ci-dessus).
60. Il en résulte que la décision de déchoir les requérants de leur nationalité belge a constitué une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée.
Sur la justification de l’ingérence
61. Pour déterminer si cette ingérence a emporté violation de l’article 8 de la Convention, la Cour doit rechercher si elle était justifiée au regard du second paragraphe de cet article, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », si elle poursuivait l’un ou plusieurs des buts légitimes énumérés dans cette disposition, et si elle était à cet effet « nécessaire dans une société démocratique » (Vavřička et autres c. République tchèque [GC], nos 47621/13 et 5 autres, § 265, 8 avril 2021).
α) « Prévue par la loi »
62. La Cour rappelle que toute atteinte à un droit garanti par la Convention doit avoir une base en droit interne. En outre, la « loi » doit être suffisamment accessible et énoncée avec assez de précision pour permettre aux personnes auxquelles elle s’applique de régler leur conduite : en s’entourant au besoin de conseils éclairés, elles doivent être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (ibidem, § 266; voir aussi, dans le contexte d’une déchéance de nationalité, Usmanov, précité, § 64).
63. En l’espèce, les décisions litigieuses ont été prises sur le fondement de l’article 23 § 1 du CNB (paragraphe 28 ci-dessus), qui prévoit que les Belges ayant acquis cette nationalité par déclaration de nationalité peuvent en être déchus « s’ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge ».
64. Saisie sur renvoi préjudiciel dans le cadre de l’affaire relative à la requérante, la Cour constitutionnelle a précisé la portée de cette notion en indiquant qu’elle permet d’exclure de la communauté nationale les Belges qui « montrent par leur comportement qu’ils n’acceptent pas les règles fondamentales de la vie en commun et portent gravement atteinte aux droits et libertés de leurs concitoyens ». Elle a indiqué que « cette notion large permet de viser des faits qui n’imposent pas un jugement prononcé par un juge belge et qui ne se limitent pas davantage à des condamnations pénales » (paragraphe 31 ci-dessus). Ainsi, il s’agit d’une notion qu’il appartient au juge d’apprécier en tenant compte de tous les éléments qui lui sont soumis.
65. Aussi, eu égard, à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, mais également à la motivation des arrêts rendus par la cour d’appel concernant les requérants (paragraphes 12 et 24 ci-dessus) ainsi qu’aux exemples de jurisprudence antérieure fournis par le Gouvernement qui portaient sur des déchéances de nationalité prononcée à l’égard de personnes condamnées pour des faits liés au terrorisme (paragraphe 30 ci-dessus), la Cour considère que l’article 23 § 1 du CNB présentait un degré suffisant de prévisibilité.
66. Le fait que de nouvelles dispositions prévoyant explicitement et spécifiquement la possibilité de déchoir un Belge de sa nationalité en cas de condamnation pour infractions terroristes aient été adoptées par la suite (paragraphes 32 et 33 ci‑dessus) n’énerve pas cette conclusion. La Cour observe d’ailleurs qu’au moment de l’adoption des décisions litigieuses, seul l’article 23 § 1 du CNB était en vigueur. L’article 23/1 n’étant, quant à lui, pas en vigueur à ce moment-là, il ne pouvait servir de fondement à la déchéance de nationalité des requérants. La Cour considère en outre que, contrairement à ce qu’avance le requérant (paragraphe 49 ci-dessus), il ne ressort pas des travaux parlementaires de la proposition de loi modifiant le CNB en 2012 (paragraphe 29 ci-dessus) que l’article 23 § 1 du CNB n’était pas suffisamment prévisible. Il en ressort (paragraphe 29 ci-dessus) en effet que la modification de cette disposition visait expressément à étendre la possibilité de déchoir de leur nationalité les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans sans sursis pour certains types d’infractions en particulier, ainsi qu’à simplifier la procédure.
β) Sur l’existence d’un but légitime
67. La Cour peut admettre que la déchéance de la nationalité belge des requérants à la suite de leur condamnation pour participation à la commission d’actes terroristes graves poursuivait les buts légitimes de la défense de la sécurité nationale ainsi que de la prévention des infractions pénales.
γ) Sur la nécessité dans une société démocratique
68. Les principes généraux relatifs à la « nécessité dans une société démocratique » ont été résumés dans l’arrêt Vavřička et autres (précité, §§ 273 et 275).
69. S’agissant de l’ampleur de la marge d’appréciation devant être reconnue à l’État défendeur, la Cour estime que les questions relatives à l’octroi, la perte et – comme en l’espèce – la déchéance de la nationalité relèvent d’un domaine dans lequel les États contractants doivent se voir reconnaître une ample marge d’appréciation.
70. De même, la Cour rappelle que la violence terroriste constitue en elle‑même une grave menace pour les droits de l’homme (Ghoumid et autres, précité, § 50, et, les références qui y sont citées) et, par conséquent, qu’il est légitime que les États parties ne restent pas passifs à l’égard de personnes définitivement condamnées pour des faits qui portent directement atteinte aux valeurs de la Convention (voir, mutatis mutandis, Johansen, décision précitée, § 50).
71. Ainsi, la Cour a déjà jugé à plusieurs reprises que n’étaient pas constitutives d’une violation de l’article 8 de la Convention des mesures de déchéance de la nationalité prises à l’égard de personnes ayant commis des infractions à caractère terroriste (voir Ramadan, K2 c. Royaume-Uni, Ghoumid et autres, Johansen, et Laraba, tous précités).
72. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour rappelle en premier lieu que, dans les affaires relatives à une déchéance de nationalité, elle tient compte du fait qu’un examen juridictionnel adéquat a été effectué (paragraphe 56 ci-dessus ; voir aussi, Ramadan, § 87, K2 c. Royaume-Uni, §§ 50 et 55, Usmanov, § 63, tous précités). Vu la nature de l’ingérence dans la vie privée des requérants et les possibles conséquences que la déchéance de nationalité peut également entraîner à leur égard, la Cour attache de l’importance au fait que cette mesure a été prononcée, en l’espèce, par un tribunal disposant de la plénitude de juridiction et dont l’indépendance n’a pas été mise en question. Par ailleurs, elle constate que les requérants ne contestent pas avoir eu la possibilité de se défendre devant la cour d’appel dans le cadre d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle ils ont bénéficié de l’assistance d’un avocat et ont pu soumettre des observations orales et écrites (voir, dans le même sens, Ghoumid et autres, précité, § 47).
73. La Cour relève ensuite que les mesures litigieuses ont été prononcées par la cour d’appel aux termes d’une motivation qui ne pourrait à l’évidence être considérée comme superficielle (respectivement paragraphes 12 et 24 ci‑dessus). En réponse à l’argument de la requérante selon lequel la cour d’appel aurait fait l’impasse sur les éléments de rattachement qu’elle présentait avec la Belgique avant la commission des faits pour lesquels elle a été condamnée (paragraphe 48 ci-dessus), la Cour observe que, dans son arrêt relatif à la requérante, la cour d’appel a examiné en détail la situation de celle‑ci (paragraphe 24 ci-dessus). Elle estime que les motifs de cet arrêt, ainsi que de l’arrêt relatif au requérant, sont pertinents et suffisants, tenant dûment compte des éléments relatifs à leur vie privée. La cour d’appel a ainsi pu considérer que les actions ayant entraîné les condamnations pénales des requérants avaient révélé le peu d’importance qu’avait eu leur attachement à la Belgique et à ses valeurs dans la construction de leur identité personnelle.
74. Par ailleurs, la Cour note que les requérants ont tous les deux une autre nationalité, ce à quoi elle accorde une grande importance (Ghoumid et autres, précité, § 50). La décision de les déchoir de la nationalité belge n’a donc pas eu pour conséquence de les rendre apatrides, ce qui est d’ailleurs une condition sine qua non de l’application de l’article 23 § 1 du CNB (paragraphe 28 ci-dessus).
75. S’agissant de l’exigence de diligence et promptitude, la Cour observe, en ce qui concerne la requérante, qu’un délai de trois ans s’est écoulé entre la condamnation définitive de l’intéressée et l’introduction par le procureur de la citation en déchéance de nationalité, et que la déchéance en question a été prononcée sept ans après ladite condamnation, après une saisine de la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel. Quant au requérant, la citation en déchéance de nationalité a été introduite deux ans et demi après sa condamnation pénale, et la mesure a été prononcée neuf ans après celle-ci.
76. Même s’il est permis de se demander si, en l’espèce, les autorités ont agi avec diligence et promptitude, la Cour note qu’à supposer qu’il y ait eu un retard, celui-ci n’a pas pénalisé les requérants, qui ont continué de tirer parti de la situation (Ramadan, précité, § 88). Il y a également lieu de tenir compte du fait que les procédures de déchéance de la nationalité des requérants ont été suspendues dans l’attente que la Cour constitutionnelle se prononce à titre préjudiciel, ce qui explique en partie le temps écoulé entre la condamnation des requérants et le prononcé de la mesure litigieuse. La Cour note par ailleurs qu’elle a déjà considéré qu’une durée de sept ans entre la condamnation pénale et l’introduction de la procédure en déchéance de nationalité n’était pas, en elle-même, excessive (Ghoumid et autres, précité, § 45).
77. Enfin, la Cour rappelle que la perte de la nationalité belge n’emporte pas automatiquement éloignement du territoire (paragraphe 57 ci-dessus). Aussi, les requérants n’ont pas allégué et rien n’indique qu’ils ne disposaient pas de recours dans le cadre desquels ils pouvaient faire valoir leurs droits au regard de la Convention pour contester l’ordre de quitter le territoire dont ils ont fait l’objet consécutivement à la mesure de déchéance.
δ) Conclusion
78. L’examen des éléments qui précèdent permet de conclure que, dans la mise en balance des intérêts en jeu, les autorités belges n’ont pas excédé leur ample marge d’appréciation et que dès lors on peut considérer que les mesures litigieuses étaient « nécessaires dans une société démocratique ».
79. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Johansen c. Danemark du 3 mars 2022 requête n° 27801/19
Art 8 : La Cour européenne déboute un homme déchu de la nationalité danoise pour avoir rejoint l’« État islamique »
L’affaire concernait un homme déchu de la nationalité danoise à la suite de sa condamnation en 2017 pour des infractions de terrorisme, en particulier parce qu’il s’était rendu en Syrie pour rejoindre l’« État islamique ». Les autorités avaient également ordonné son expulsion du territoire danois, assortie d’une interdiction définitive de retour. La Cour a jugé en particulier que les décisions concernant le requérant, qui possédait la nationalité danoise et la nationalité tunisienne, avaient été rendues à l’issue d’un examen prompt, complet et diligent de son dossier, compte tenu de la gravité des infractions qu’il avait commises, des arguments et circonstances individuelles qu’il avait fait valoir, de la jurisprudence de la Cour et des obligations internationales du Danemark. La Cour a souligné qu’il était légitime pour les États contractants de faire preuve de fermeté face au terrorisme, qui constitue lui-même une grave menace pour les droits de l’homme.
FAITS
Le requérant, Adam Johansen, né au Danemark en 1990 d’un père danois et d’une mère tunisienne, possédait la nationalité de ces deux pays. Il fut arrêté en avril 2016 peu après que les renseignements danois avaient reçu d’Interpol une liste d’individus soupçonnés d’avoir été recrutés par l’organisation terroriste « État islamique », sur laquelle figurait le nom du requérant. Le requérant fut ultérieurement reconnu coupable de s’être rendu en Syrie en septembre 2013 – avant de regagner le Danemark en février 2014 – et d’avoir accepté d’être recruté et entraîné par l’« État islamique » afin de commettre des actes de terrorisme. Un tribunal le condamna à quatre ans d’emprisonnement mais jugea que rien ne permettait de le déchoir de la nationalité danoise ou de l’expulser. Son jugement fut confirmé par la cour d’appel en avril 2018. Cependant, en novembre 2018, la Cour suprême cassa les décisions des juridictions inférieures. Elle jugea que, compte tenu de la gravité des infractions commises par le requérant, ce dernier devait être déchu de la nationalité danoise et expulsé du territoire danois avec interdiction définitive de retour. Elle conclut que de telles mesures ne seraient pas disproportionnées puisque le requérant avait des attaches non seulement au Danemark mais aussi en Tunisie. Elle releva qu’il était né, élevé et éduqué au Danemark, que sa mère et ses frères et sœurs vivaient dans ce pays, qu’il avait épousé une femme danoise et qu’un enfant était né de cette union, mais qu’il connaissait aussi la culture tunisienne et parlait et écrivait l’arabe. Elle souligna que la conjointe du requérant, qui s’était convertie à l’islam à l’âge de 18 ans, et son fils, qui était scolarisé dans une école islamique au Danemark, n’étaient pas entièrement rétifs à l’accompagner en Tunisie et que, en tout état de cause, ils pouvaient là-bas lui rendre visite et communiquer avec lui par la voie téléphonique et par Internet. Le requérant a purgé sa peine et séjourne actuellement dans un centre de rétention, en instance d’expulsion.
ART 8
Premièrement, la Cour est convaincue que la décision par laquelle la Cour suprême a déchu le requérant de la nationalité danoise n'était pas arbitraire et a minutieusement tenu compte des conséquences qui en résulteraient pour lui au vu de ses attaches tant avec le Danemark qu’avec la Tunisie. Les autorités ont également agi avec diligence et célérité, entre l'arrestation du requérant en 2016 et sa condamnation en 2018, lui donnant la possibilité de contester la demande tendant à le déchoir de la nationalité danoise devant trois degrés de juridiction. L’analyse que la Cour suprême a faite des arguments du requérant ne présente non plus aucune lacune. Le requérant soutient que jamais les autorités tunisiennes n'ont confirmé qu'il possédait la nationalité tunisienne et qu'il deviendrait apatride s'il était déchu de la nationalité danoise. La Cour note cependant que la question de la nationalité du requérant a été minutieusement examinée par les autorités antérieurement à la procédure pénale dirigée contre lui puis par les tribunaux, devant trois degrés de juridiction, qui ont établi qu'il possédait les deux nationalités. Par ailleurs, un passeport tunisien a été trouvé au domicile du requérant. Quant à l’argument que le requérant tire de ce que la Cour suprême aurait dû accorder un poids décisif au fait qu'il avait acquis la nationalité danoise à sa naissance, la Cour estime que cela n’a pas changé ni ajouté grand-chose aux conséquences qui en découlaient pour lui. En effet, les conséquences pour le requérant résultaient de ses propres choix et actions, notamment sa condamnation pour des infractions graves de terrorisme. La Cour souligne qu'il est légitime pour les États contractants de faire preuve de fermeté face au terrorisme, qui constitue lui-même une grave menace pour les droits de l'homme. De même, la Cour est convaincue que la Cour suprême a ordonné l’expulsion du requérant au bout d’une analyse approfondie. La haute juridiction a examiné la situation personnelle du requérant en pesant soigneusement les intérêts concurrents, tout en tenant compte des critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour et en recherchant expressément si la décision d'expulsion était contraire aux obligations internationales du Danemark.
Les autorités nationales ont donc justifié par de « très solides raisons » l'expulsion du requérant, et la décision incriminée ne peut passer pour disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection du public contre la menace terroriste. Dès lors, tant le grief tiré de la déchéance du requérant de la nationalité danoise que son expulsion doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement.
Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020 requête n°43936/18
Le retrait de la citoyenneté russe du requérant et son expulsion vers le Tadjikistan ont violé la Convention européenne
violations de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne tant le retrait de la citoyenneté russe du requérant que la décision de l'expulser du territoire russe. Plainte d'un ressortissant du Tadjikistan relative aux décisions de retrait de sa citoyenneté russe et d'expulsion du territoire russe. M. Usmanov avait obtenu la citoyenneté russe en 2008, mais celle-ci avait été retirée dix ans plus tard lorsque les autorités avaient découvert qu'il avait omis d’indiquer les noms de ses frères et sœurs dans sa demande.
La décision de l'expulser avait été prise après qu'il eut refusé de quitter le pays. Dans l'arrêt rendu ce jour par la ChDans l'ensemble, la Cour estime que les décisions des autorités dans le cas du requérant ont été trop formalistes, ne tenant pas dûment compte des intérêts en jeu. En particulier, elles n'ont pas démontré pourquoi le défaut de communication par le requérant d'informations sur certains de ses frères et sœurs était grave au point de le priver de sa citoyenneté russe tant d'années après son obtention. Ils n'ont pas non plus tenu compte du fait qu'il a vécu en Russie pendant une longue période avec une ressortissante russe, avec laquelle il a eu quatre enfants, et que pendant son séjour il n'a commis aucune infraction. La Cour a également décidé de continuer à indiquer au gouvernement russe, en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, de ne pas expulser le requérant jusqu'à ce que cet arrêt devienne définitif ou jusqu'à nouvel ordre.
FAITS
M. Usmanov a déménagé en Russie en 2007, avec sa femme et ses deux enfants. Sa femme et lui ont eu deux autres enfants par la suite. En 2008, il a demandé avec succès la citoyenneté russe. Cependant, dix ans plus tard, il a été privé de sa citoyenneté parce qu'il avait omis certaines informations (les noms de ses frères et sœurs) dans sa demande. Les autorités nationales ont rejeté ses arguments selon lesquels les informations manquantes n'étaient pas importantes et qu'il avait des liens étroits avec la Russie. En conséquence, il s'est retrouvé sans aucun document d'identité valable. En avril 2018, le Service fédéral de sécurité a décidé de lui interdire l'entrée en Russie pendant 35 ans parce qu'il représentait une menace pour la sécurité nationale. Il était censé quitter le pays avant le 17 août 2018. Il a été arrêté en novembre 2018 et placé dans un centre de détention temporaire pour étrangers pour ne pas avoir respecté l'ordre qui lui avait été donné de quitter le pays. Les tribunaux ont ordonné son expulsion de Russie. Il a contesté en vain devant les tribunaux l'interdiction d'entrée et son renvoi administratif. Les tribunaux ont notamment jugé que l'interdiction d'entrée avait été prononcée par l'autorité compétente et que, dans tous les cas, sa famille pouvait le suivre ou rester en Russie et recevoir un soutien financier de l'étranger. En outre, les tribunaux n'ont trouvé aucune preuve que l'éloignement de M. Usmanov serait contraire à la Convention européenne. L'expulsion de M. Usmanov a été suspendue en décembre 2018 pendant la procédure devant la Cour européenne, après que celle-ci eut fait droit à sa demande de mesures provisoires en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour. Depuis, il a fait appel sans succès de sa détention.
ARTICLE 8
Tout d'abord, la Cour estime que le retrait de la citoyenneté du demandeur a porté atteinte à ses droits au titre de l'article 8 de la Convention. Il a été privé de tout statut juridique en Russie et il est parti sans aucun document d'identité valable. La Cour note, en particulier, que les citoyens russes doivent justifier de leur identité très souvent dans leur vie quotidienne, que ce soit lors de l'achat d'un billet de train ou pour des besoins plus cruciaux, tels que trouver un emploi ou recevoir des soins médicaux. Le retrait de la citoyenneté du demandeur a d'ailleurs été une condition préalable aux décisions d'interdiction d'entrée et d'éloignement de l'État. Le gouvernement a reconnu qu'il y avait eu une ingérence dans les droits du demandeur, mais a fait valoir que les règles législatives ne laissaient aucune marge de manœuvre aux autorités lorsqu’une personne avait omis des informations dans sa demande de citoyenneté russe. Après qu'il eut été établi que les informations fournies par le requérant étaient incomplètes, les autorités n'ont donc eu d'autre choix que d'annuler la décision lui accordant la citoyenneté russe, indépendamment du temps écoulé depuis l'obtention de la citoyenneté, de la solidité de ses liens avec la Russie, de sa situation familiale ou d'autres facteurs importants.
La Cour estime qu'une telle approche a été excessivement formaliste. Elle a été favorisée par le cadre juridique, tel qu'il était en vigueur à l'époque, et a eu pour conséquence de ne pas accorder au demandeur une protection adéquate contre les ingérences arbitraires. Le gouvernement n'a donc pas montré pourquoi le défaut de communication d'informations par le requérant sur certains de ses frères et sœurs était d'une gravité telle qu'il était justifié de le priver de sa citoyenneté russe de nombreuses années après son obtention. En effet, la Cour estime que le retrait de la citoyenneté du requérant pour une telle omission, sans que les autorités ne procèdent à un exercice de mise en balance, a été gravement disproportionnée. La Cour conclut donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention en raison du retrait de la citoyenneté russe du requérant. De même, ni dans la procédure relative à l'interdiction d'entrer en Russie ni dans la procédure relative à l'éloignement administratif, les juridictions internes n'ont dûment mis en balance les intérêts en jeu. Globalement, dans ces deux procédures, il n'a pas été établi de manière convaincante que la menace que le requérant aurait fait peser sur la sécurité nationale l'emportait sur le fait qu'il vivait en Russie depuis longtemps dans un ménage avec une ressortissante russe, avec laquelle il avait quatre enfants, dont deux étaient nés en Russie. Cela est d'autant plus pertinent que le requérant n'a commis aucune infraction pendant son séjour en Russie. Il y a donc eu une autre violation de l'article 8 de la Convention en raison de la décision d'expulser le requérant du pays. Compte tenu des conclusions ci-dessus, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief du requérant au titre de l'article 8 de la Convention concernant l'interdiction d'entrée sur le territoire qui lui est infligée.
Satisfaction équitable (Article 41)
La Cour dit que la Russie doit verser au requérant 162 euros (EUR) au titre du préjudice financier, 10 000 euros au titre du dommage moral et 850 euros au titre des frais et dépens.
Abuhmaid c. Ukraine du 12 janvier 2017 requête n o 31183/13
La Cour ne constate aucune violation de la Convention concernant un palestinien dans l’incertitude quant au prolongement de son séjour en Ukraine
Non-violation de l’article 13, en combinaison avec l’article 8, de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne le droit pour M. Abuhmaid de séjourner sur le territoire ukrainien. Ayant résidé en Ukraine pendant plus de 20 ans sur la base de permis de séjour temporaires, il avait commencé à avoir divers problèmes avec les autorités ukrainiennes au sujet de son droit de séjourner dans le pays. Il a plusieurs fois cherché, jusqu’à présent en vain, à régulariser son séjour en Ukraine, notamment en demandant l’asile et l’autorisation d’y émigrer. Il voyait dans l’incertitude persistante entourant son droit de séjourner en Ukraine et dans le risque qu’il soit ultérieurement expulsé du territoire une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. La Cour a jugé en particulier que, sa nouvelle demande d’asile étant toujours en cours d’examen, M. Abuhmaid n’encourait aucun risque réel ou imminent d’expulsion du territoire ukrainien. Pour ce qui est des griefs tirés par lui de l’atteinte à sa vie privée qui résulterait de l’incertitude entourant son séjour et sa situation en Ukraine, elle a considéré que l’Ukraine avait satisfait à son obligation positive de lui offrir un recours effectif et accessible permettant de trancher ces questions.
Le requérant, M. Hesham A.S. Abuhmaid, est un ressortissant palestinien né en 1970 et résidant actuellement à Kyiv (Ukraine). En 1993, M. Abuhmaid s’installa en Ukraine pour ses études. Jusqu’en novembre 2009, il y séjourna muni de permis de séjour temporaires régulièrement renouvelés par la police ukrainienne. Entre mars et avril 2010, il fut reconnu coupable de trois infractions administratives distinctes pour nonrespect du droit des étrangers. Le 16 septembre 2010, il était sur le point de demander un renouvellement de son permis de séjour lorsqu’il fut appréhendé par des policiers de l’unité des migrations du département de police Solomyanskyy à Kyiv. Les policiers l’avisèrent qu’il était sous le coup d’une décision d’expulsion et saisirent ses papiers.
Le 17 mars 2010, la police avait décidé qu’il y avait lieu d’expulser M. Abuhmaid et demandé devant les tribunaux son éloignement forcé. L’affaire fut jugée le 18 mai 2010 par le tribunal administratif de Kyiv, en l’absence des parties. M. Abuhmaid allègue qu’il n’a eu connaissance de la décision du 18 mai 2010 que le 25 novembre 2011. Le 29 novembre 2011, il fit appel du jugement. M. Abuhmaid soutenait en particulier que la juridiction de première instance n’avait pas examiné tous les faits pertinents en l’espèce et ne l’avait pas entendu. Le 14 novembre 2012, la cour administrative d’appel de Kyiv le débouta.
Le 6 décembre 2012, M. Abuhmaid forma un pourvoi devant la Cour administrative supérieure. En octobre 2013, cette dernière annula les décisions des tribunaux inférieurs au motif qu’ils n’avaient pas examiné si, au regard du droit ukrainien, il y avait des raisons de s’opposer à l’expulsion de M. Abuhmaid. Elle constata également que les tribunaux inférieurs n’avaient pas dûment pris en compte les intérêts de M. Abuhmaid tenant à sa vie privée et familiale en Ukraine. Elle renvoya donc l’affaire devant la juridiction de première instance pour un réexamen.
À la suite de ce réexamen, qui se solda par une décision ordonnant l’expulsion forcée de M. Abuhmaid du territoire ukrainien, la Cour administrative supérieure renvoya de nouveau l’affaire devant la juridiction de première instance, pour les mêmes motifs qu’auparavant. La procédure prit fin avec le rejet par le tribunal du district Desnyanskyy de la demande tendant à l’expulsion forcée de M. Abuhmaid. Le tribunal jugea que son expulsion serait contraire à l’article 8, notamment parce que M. Abuhmaid était marié à une ressortissante ukrainienne. Il estima également qu’il y avait lieu de lui accorder le statut de réfugié ou de personne ayant besoin d’une protection complémentaire. N’ayant fait l’objet d’aucun recours, cette décision devint définitive. M. Abuhmaid engagea également une procédure concernant ses multiples demandes d’asile.
Sa première demande fut rejetée par une décision du Service des migrations de l’État rendue le 17 mai 2012, qu’il attaqua devant la Cour administrative supérieure, en vain. En novembre 2014, M. Abuhmaid forma une nouvelle demande d’asile, que le département à Kyiv du Service des migrations de l’État refusa d’examiner. Ce refus fut annulé par le tribunal administratif de Kyiv, qui jugea que le Service des migrations de l’État avait manqué à étudier minutieusement le dossier et ordonna à celui-ci de réexaminer la nouvelle demande de M. Abuhmaid. Le réexamen de cette demande est actuellement en cours. En vertu des règles pertinentes de droit interne, M. Abuhmaid est ainsi autorisé à séjourner en Ukraine tant qu’il n’aura pas été statué sur sa demande.
Articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif)
Étant donné que la nouvelle demande d’asile de M. Abuhmaid est toujours en cours d’examen et qu’il est légalement autorisé à séjourner en Ukraine en instance de jugement, la Cour estime qu’il n’encourt aucun risque réel ou imminent d’expulsion du territoire ukrainien. Elle déclare donc irrecevable le grief tiré par lui de son éventuel éloignement du pays. Pour ce qui est des griefs tirés par M. Abuhmaid de l’atteinte à sa vie privée qui résulterait de l’incertitude entourant son séjour en Ukraine et de l’impossibilité pour lui de régulariser sa situation dans ce pays, la Cour ne constate aucune violation de l’article 13, en combinaison avec l’article 8, de la Convention. Elle tient compte de ce que les autorités ukrainiennes ont examiné l’affaire en tenant compte des intérêts de M. Abuhmaid tenant à sa vie privée et aussi de ce que différentes procédures internes lui sont encore ouvertes pour éventuellement régulariser son séjour ou sa situation. L’État ukrainien a donc satisfait à son obligation positive d’offrir à M. Abuhmaid une procédure effective et accessible lui permettant d’obtenir une décision sur le prolongement de son séjour et sa situation compte tenu des intérêts tenant à sa vie privée.
Article 1 du Protocole n o 7
La Cour estime que, s’il y a peut-être eu certaines défaillances dans la manière dont les tribunaux ont traité cette affaire d’expulsion forcée, il a été finalement remédié à celles-ci dans le cadre de la procédure devant la Cour administrative supérieure et de celle qui s’est soldée par la décision du 29 octobre 2014. M. Abuhmaid a amplement eu la possibilité de s’opposer effectivement à son expulsion forcée d’Ukraine. Ce grief est donc rejeté
Grande Chambre Jeunesse c Pays Bas du 3 octobre 2014 requête 12738/10
Violation de l'article 8 : Le refus d’octroyer un permis de séjour à une ressortissante surinamaise mère de trois enfants nés aux Pays-Bas a emporté violation du droit au respect de la vie familiale. La Grande Chambre a examiné in concreto la vie intime du couple et l'emploi du père pour savoir s'il fallait ou non renvoyer la mère au Suriname. Cette démarche semble étonnante puisque le père est hollandais. Ils ont eu ensemble, trois enfants. Il travaille et demande seulement à vivre chez lui avec sa famille ! Je pense que la CEDH devait rester sur l'analyse de ces principes généraux pour constater la violation de la convention.
100. La présente affaire concerne essentiellement le refus d’autoriser la requérante à résider aux Pays-Bas sur le fondement de la vie familiale qu’elle y a construite. L’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention entre elle, son mari et leurs trois enfants n’est pas contestée. En ce qui concerne la question du respect de cette disposition, la Cour rappelle que, suivant un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur leur sol. La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier (voir, par exemple, Nunez, précité, § 66). Le corollaire du droit pour les États de contrôler l’immigration est que les étrangers – et donc, en l’espèce, la requérante – ont l’obligation de se soumettre aux contrôles et aux procédures d’immigration et de quitter le territoire de l’État contractant concerné lorsqu’ils en reçoivent l’ordre si l’entrée ou le séjour sur ce territoire leur sont valablement refusés.
101. La Cour note que la requérante a clairement failli à l’obligation d’obtenir un visa de séjour temporaire à l’étranger avant de demander un titre de séjour permanent aux Pays-Bas. Elle rappelle que, en principe, les États contractants ont le droit d’exiger des non-nationaux qui sollicitent le droit de séjourner sur leur territoire qu’ils introduisent la demande appropriée à l’étranger. Ils n’ont donc pas l’obligation d’autoriser les ressortissants étrangers à attendre sur leur territoire le résultat d’une procédure d’immigration (voir, récemment, Djokaba Lambi Longa c. Pays‑Bas (déc.), no 33917/12, § 81, 9 octobre 2012).
102. Même si la requérante se trouve aux Pays-Bas depuis mars 1997, elle ne s’est jamais vu délivrer de permis de séjour par les autorités néerlandaises, hormis pendant la période initiale où elle détenait un visa de tourisme d’une durée de validité de 45 jours. Sa présence dans le pays ne peut donc être considérée comme équivalant à un séjour régulier faisant suite à l’octroi par les autorités d’une autorisation permettant à un ressortissant étranger de s’installer sur le territoire national (Useinov c. Pays-Bas (déc.), no 61292/00, 11 avril 2006). Toutefois, la Cour note que jusqu’au 22 juin 2001, l’article 6:83 du livre premier du code civil lui faisait obligation de vivre avec son mari (paragraphe 61 ci-dessus).
103. Lorsqu’un État contractant tolère la présence sur son sol d’un ressortissant étranger, lui donnant ainsi la possibilité d’attendre la décision relative à sa demande d’octroi d’un permis de séjour, à un recours contre une telle décision ou à une nouvelle demande de permis de séjour, il lui permet de participer à la vie sociale du pays dans lequel il se trouve, d’y nouer des relations et d’y fonder une famille. Pour autant, cela n’implique pas automatiquement que, en conséquence, l’article 8 de la Convention oblige les autorités de cet État à autoriser l’étranger à s’installer sur le territoire national. De même, ce n’est pas parce que la requérante a fondé une famille et mis ainsi les autorités du pays d’accueil devant le fait accompli que cela entraîne pour celles-ci l’obligation, au titre de l’article 8 de la Convention, de l’autoriser à s’installer dans le pays. La Cour a déjà dit que, en général, les personnes qui se trouvent dans cette situation ne sont pas fondées à espérer qu’un droit de séjour leur sera octroyé (Chandra et autres c. Pays-Bas (déc.), no 53102/99, 13 mai 2003, Benamar c. Pays-Bas (déc.), no 43786/04, 5 avril 2005, Priya c. Danemark (déc.) no 13594/03, 6 juillet 2006, Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 43, CEDH 2006-I, Darren Omoregie et autres c. Norvège, no 265/07, § 64, 31 juillet 2008, et B.V. c. Suède (déc.), no 57442/11, 13 novembre 2012).
104. La présente affaire se distingue de celles qui concernent des « immigrés établis » au sens de la jurisprudence de la Cour, à savoir des personnes auxquelles il a déjà été accordé officiellement un droit de séjour dans le pays d’accueil. Le retrait ultérieur de ce droit, par exemple parce que la personne concernée a été reconnue coupable d’une infraction pénale, constitue une ingérence dans l’exercice par celle-ci de son droit au respect de sa vie privée et/ou familiale au sens de l’article 8. En pareil cas, la Cour recherche si cette ingérence est justifiée au regard du paragraphe 2 de cet article. Elle tient compte pour cela des différents critères se dégageant dans sa jurisprudence pour déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les motifs sous-tendant la décision des autorités de retirer le droit de séjour, d’une part, et les droits que l’article 8 garantit à l’individu concerné, d’autre part (voir, par exemple, Boultif c. Suisse, no 54273/00, CEDH 2001‑IX, Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, CEDH 2006‑XII, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, CEDH 2008, Savasci c. Allemagne (déc.), no 45971/08, 19 mars 2013, et Udeh c. Suisse, no 12020/09, 16 avril 2013).
105. La situation d’un immigré établi et celle d’un étranger sollicitant l’admission sur le territoire national étant, en fait et en droit, différentes (même si, comme la requérante, l’étranger a sollicité à plusieurs reprises un permis de séjour et réside sur le territoire depuis plusieurs années), les critères que la Cour a élaborés au fil de sa jurisprudence pour apprécier si le retrait du permis de séjour d’un immigré établi est compatible avec l’article 8 ne peuvent être transposés automatiquement à la situation de la requérante. En l’espèce, la question à examiner est plutôt celle de savoir si, eu égard aux faits de la cause pris dans leur ensemble, les autorités néerlandaises étaient tenues en vertu de l’article 8 d’octroyer un permis de séjour à la requérante afin de lui permettre de mener sa vie familiale sur leur territoire. La présente affaire concerne donc non seulement la vie familiale mais aussi l’immigration. Pour cette raison, elle doit être examinée sous l’angle d’un non-respect par l’État défendeur d’une obligation positive lui incombant en vertu de l’article 8 de la Convention (Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, § 63, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI). Ce faisant, la Cour tiendra compte des principes ci-dessous, rappelés en dernier lieu dans l’affaire Butt c. Norvège (no 47017/09, § 78, 4 décembre 2012, et autres références citées).
2. Les principes pertinents
106. Si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut de surcroît engendrer des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation.
107. En matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue de l’obligation pour l’État d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger concerné et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration (par exemple, des précédents d’infractions aux lois sur l’immigration) ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion (Butt, précité, § 78).
108. Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsque tel est le cas ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 68, série A no 94, Mitchell c. Royaume-Uni (déc.), no 40447/98, 24 novembre 1998, Ajayi et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 27663/95, 22 juin 1999, M. c. Royaume-Uni (déc.), no 25087/06, 24 juin 2008, Rodrigues da Silva et Hoogkamer, précité, § 39, Arvelo Aponte, précité, §§ 57-58, et Butt, précité, § 78).
109. Lorsque des enfants sont concernés, il faut prendre en compte leur intérêt supérieur (Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 44, 1er décembre 2005 ; mutatis mutandis, Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, §§ 139-140, 19 janvier 2012 ; Neulinger et Shuruk, précité, § 135, et X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 96, CEDH 2013). Sur ce point particulier, la Cour rappelle que l’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international (Neulinger et Shuruk, précité, § 135, et X c. Lettonie, précité, § 96). Cet intérêt n’est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui accorder un poids important. Pour accorder à l’intérêt supérieur des enfants qui sont directement concernés une protection effective et un poids suffisant, les organes décisionnels nationaux doivent en principe examiner et apprécier les éléments touchant à la commodité, à la faisabilité et à la proportionnalité d’un éventuel éloignement de leur père ou mère ressortissants d’un pays tiers.
3. Sur la pertinence du droit de l’UE
110. La requérante invoque l’arrêt Ruiz Zambrano de la Cour de justice de l’Union européenne (paragraphe 71 ci-dessus). À cet égard, la Cour souligne que, aux termes des articles 19 et 32 § 1 de la Convention, elle n’est pas compétente pour appliquer les règles de l’Union européenne ou pour en examiner les violations alléguées, sauf si et dans la mesure où ces violations pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. D’une manière plus générale, il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, si nécessaire en conformité avec le droit de l’UE, le rôle de la Cour se bornant à déterminer si les effets de leurs décisions sont compatibles avec la Convention (Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, nos 3989/07 et 38353/07, § 54, 20 septembre 2011, et autres références citées).
111. Dans l’affaire Dereci (paragraphe 72 ci-dessus), même si elle a conclu que le droit de l’UE n’imposait pas l’obligation d’admettre le ressortissant d’un pays tiers, la Cour de justice a précisé que cette conclusion ne préjugeait pas la question de savoir si le droit au respect de la vie familiale faisait obstacle au refus d’un droit de séjour, question qui devait être examinée dans le cadre des dispositions sur la protection des droits fondamentaux.
112. C’est précisément dans ce cadre que la Cour examinera le cas de la requérante : comme indiqué ci‑dessus, il lui faut statuer sur l’allégation selon laquelle les autorités néerlandaises n’ont pas protégé le droit fondamental de l’intéressée au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.
4. Application au cas d’espèce des considérations générales et principes pertinents énoncés ci-dessus
113. La Cour rappelle que la requérante se trouve en situation de séjour irrégulier aux Pays-Bas depuis l’expiration du visa de tourisme de 45 jours qui lui avait été accordé en 1997. Il est vrai qu’à l’époque l’admission aux Pays-Bas était régie par la loi de 1965 sur les étrangers. Cependant, compte tenu de la raison pour laquelle sa demande de permis de séjour du 20 octobre 1997 n’a pas été traitée (paragraphe 14 ci-dessus), la situation de la requérante relève de la loi de 2000 sur les étrangers. Dès lors qu’elle avait tenté à plusieurs reprises d’obtenir la régularisation de sa situation et qu’elle avait à chacune de ces tentatives essuyé un échec, elle savait – et ce bien avant d’entamer une vie familiale aux Pays‑Bas – que son séjour sur place était précaire.
114. Lorsque les autorités se trouvent mises devant le fait accompli, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille qui est ressortissant d’un pays tiers peut être jugé incompatible avec les dispositions de l’article 8 (paragraphe 108 ci-dessus). La Cour doit donc déterminer si, dans le cas de la requérante, il existe des circonstances exceptionnelles justifiant de conclure que les autorités néerlandaises n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en refusant à la requérante le droit de résider aux Pays-Bas.
115. La Cour tient compte d’abord et avant tout de ce que tous les membres de la famille de la requérante à l’exception d’elle-même sont des ressortissants des Pays-Bas et de ce que son mari et leurs trois enfants ont le droit de vivre leur vie familiale ensemble aux Pays-Bas. Elle note également qu’à la naissance la requérante était de nationalité néerlandaise. Elle a perdu cette nationalité avec l’accession à l’indépendance du Surinam et elle est devenue surinamaise non pas par choix mais en vertu de l’article 3 de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Surinam concernant l’attribution de la nationalité (paragraphe 62 ci-dessus). On ne peut donc pas simplement considérer sa situation comme équivalente à celle d’autres candidats à l’immigration qui n’ont jamais eu la nationalité néerlandaise.
116. La Cour estime qu’un deuxième aspect important du cas d’espèce réside dans le fait que la requérante se trouve aux Pays-Bas depuis plus de seize ans et qu’elle n’a pas d’antécédents judiciaires. Si elle n’a certes pas respecté l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire, les autorités néerlandaises ont pour leur part toléré sa présence pendant une durée considérable, tandis qu’elle réitérait ses demandes de permis de séjour et attendait l’issue des recours correspondants. En la laissant demeurer sur le territoire pendant une période aussi longue alors que pendant une grande partie de ce laps de temps elles pouvaient l’expulser, les autorités ont en pratique permis à la requérante d’établir et de développer des liens familiaux, sociaux et culturels étroits avec le pays. Elles ont toujours eu connaissance de l’adresse de l’intéressée, où celle-ci réside depuis quinze ans.
117. Troisièmement, eu égard au passé commun de la requérante et de son mari et à l’âge relativement bas de leurs enfants, la Cour admet qu’il semble ne pas y avoir d’obstacles insurmontables à ce qu’ils s’installent au Surinam. Il est toutefois probable que la requérante et les membres de sa famille se trouveraient dans une situation plutôt difficile s’ils étaient contraints de recourir à cette solution. Pour déterminer si les autorités nationales ont respecté les obligations que leur impose l’article 8, il faut tenir dûment compte de la situation de tous les membres de la famille, car la protection que garantit cette disposition s’étend à toute la famille.
118. Quatrièmement, la Cour considère qu’une autre caractéristique importante de l’espèce réside dans les conséquences que peut avoir pour les trois enfants de la requérante la décision des autorités néerlandaises. Elle observe que, dans la mise en balance des intérêts en jeu, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants (paragraphe 109 ci‑dessus). Sur ce point particulier, elle rappelle que l’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international (Neulinger et Shuruk, précité, § 135, et X c. Lettonie, précité, § 96). Cet intérêt n’est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui accorder un poids important. C’est ainsi que dans les affaires de regroupement familial la Cour attache une attention particulière à la situation des mineurs concernés, en particulier à leur âge, à leur situation dans le ou les pays en cause et à leur degré de dépendance à l’égard de leurs parents (Tuquabo-Tekle et autres, précité, § 44).
119. Notant que la requérante prend soin des enfants au quotidien, la Cour constate qu’il est à l’évidence dans leur intérêt que l’on ne bouleverse pas leur vie actuelle en contraignant leur mère à quitter les Pays-Bas pour retourner au Surinam ou en provoquant par leur séparation un chamboulement de leur relation avec elle. À cet égard, la Cour observe que le mari de la requérante subvient aux besoins de la famille en occupant à temps plein un emploi où les horaires de travail sont parfois décalés, de sorte qu’il est absent du domicile certains soirs. C’est principalement la requérante, en tant que mère au foyer, qui s’occupe des enfants au quotidien. Ceux-ci sont profondément enracinés aux Pays-Bas, pays dont ils ont – comme leur père – la nationalité. Les éléments du dossier ne révèlent aucun lien direct entre eux et le Surinam, pays où ils ne sont jamais allés.
120. Lorsqu’elles ont examiné la question de savoir s’il y avait des obstacles insurmontables à ce que la requérante et sa famille s’installent au Surinam, les autorités internes ont tenu compte dans une certaine mesure de la situation des enfants (paragraphes 23 (2.19 et 2.21), 28 et 34 (2.4.5) ci‑dessus). La Cour estime toutefois qu’elles sont restées en deçà de ce que l’on pouvait attendre d’elles à cet égard. Elle rappelle que, pour accorder à l’intérêt supérieur des enfants qui sont directement concernés une protection effective et un poids suffisant, les organes décisionnels nationaux doivent en principe examiner et apprécier les éléments touchant à la commodité, à la faisabilité et à la proportionnalité d’un éventuel éloignement (paragraphe 109 ci-dessus). Or elle n’est pas convaincue que les autorités internes aient dans le cas présent concrètement pris en compte et évalué les éléments pertinents à cet égard. Force lui est donc de conclure qu’elles n’ont pas attaché un poids suffisant à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante lorsqu’elles ont décidé de rejeter la demande de permis de séjour introduite par celle-ci.
121. La question clé en l’espèce est celle de savoir si, compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux États en matière d’immigration, il a été ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, à savoir, d’une part, l’intérêt personnel de la requérante, de son mari et de leurs enfants à poursuivre leur vie familiale aux Pays-Bas et, d’autre part, l’intérêt d’ordre public de l’État défendeur à contrôler l’immigration. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il est douteux que des considérations générales se rapportant à la politique d’immigration puissent en elles‑mêmes être considérées comme un motif suffisant pour refuser à la requérante le droit de résider aux Pays-Bas.
122. Tout en réaffirmant les principes pertinents énoncés plus haut (paragraphes 106 à 109), la Cour, sur la base des considérations exposées ci‑dessus (paragraphes 115 à 120) et d’une approche cumulative des facteurs pertinents, juge que les circonstances entourant le cas de la requérante doivent être considérées comme exceptionnelles. Dès lors, elle conclut que les autorités néerlandaises n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu et qu’elles n’ont ainsi pas assuré à la requérante le droit au respect de sa vie familiale protégé par l’article 8 de la Convention.
123. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
SENIGO LONGUE ET AUTRES c. FRANCE du 10 juillet 2014, requête n° 19113/09
Violation de l'article 8, une mère ayant obtenu la nationalité française ne peut faire venir ses enfants durant 4 ans en France car ils sont de nationalité camerounaise. Elle a dû retourner au Cameroun pour s'occuper d'eux et elle n'a obtenu ses papiers bien tard et sans aucune explication, alors qu'il n'y avait aucun changement de situation.
a) Principes applicables
59. Dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations négatives, l’Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la communauté dans son ensemble. Il jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 42, 1er décembre 2005 ; Osman c. Danemark, no 38058/09, § 54, 14 juin 2011).
60. La Cour a reconnu que les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur leur sol. L’article 8 n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur son territoire (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A no 94 ; Berisha c. Suisse, no 948/12, § 49, 30 juillet 2013).
61. Cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue des obligations pour l’Etat varie en fonction de la situation particulière de la personne concernée et de l’intérêt général. Les facteur à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’Etat contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion (Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 39, CEDH 2006‑I ; Antwi et autres c. Norvège, no 26940/10, §§ 88-89, 14 février 2012).
62. Lorsqu’il y a des enfants, les autorités nationales doivent, dans leur examen de la proportionnalité aux fins de la Convention, faire primer leur intérêt supérieur (Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 139, 19 janvier 2012 ; Berisha, précité, § 51).
63. La Cour rappelle encore, à titre de comparaison, qu’en cas d’expulsion, les étrangers bénéficient de garanties procédurales spécifiques prévues par l’article 1 du protocole no 7. Si de telles garanties ne sont pas réglementées par la Convention en ce qui concerne la vie familiale des étrangers sous l’angle de l’article 8 de la Convention, et que celui-ci ne contient pas d’exigences procédurales explicites, le processus décisionnel conduisant à des mesures d’ingérence n’en doit pas moins être équitable et respecter comme il convient les intérêts sauvegardés par l’article 8 (voir, en général, McMichael c. Royaume-Uni, 24 février 1995, § 87, série A no 307‑B et, en particulier, Cılız c. Pays-Bas, no 29192/95, § 66, CEDH 2000‑VIII ; Saleck Bardi c. Espagne, no 66167/09, § 30, 24 mai 2011). En la matière, la qualité du processus décisionnel dépend spécialement de la célérité avec laquelle l’Etat agit (Ciliz, précité, § 71 ; Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 82, CEDH 2006‑XI ; Saleck Bardi, précité, § 65 ; Nunez c. Norvège, no 55597/09, § 84, 28 juin 2011).
b) Application au cas d’espèce
64. La Cour observe que le Gouvernement soutenait, au moment de la présentation de ses observations, qu’aucune « vie familiale » ne se trouvait en cause en l’espèce. Elle relève que cette question ne fait plus débat depuis l’obtention des visas par les requérants. Par ailleurs, la Cour relève que la procédure de regroupement se décompose en deux phases. Une fois l’autorisation donnée par le préfet, les membres de la famille doivent obtenir un visa d’entrée en France dont la délivrance n’est pas automatique puisque soumise à des impératifs d’ordre public. La Cour considère donc que le refus litigieux de délivrer les visas ne constitue pas une « ingérence » dans l’exercice par les requérants du droit au respect de leur vie familiale mais que l’affaire concerne une allégation de manquement de l’Etat défendeur à une obligation « positive ».
65. D’après les requérants, le processus décisionnel ayant conduit les autorités nationales à refuser initialement de délivrer les visas ne leur a pas garanti la protection de leurs intérêts car les éléments de preuve apportés au soutien de leur demande n’ont pas été dûment pris en considération. Le Gouvernement plaide que le refus litigieux reposait sur des considérations d’ordre public, vérifiées à plusieurs stades de la procédure, conformément à sa marge d’appréciation en la matière.
66. La Cour admet que les autorités nationales se trouvent devant une tâche délicate lorsqu’elles doivent évaluer l’authenticité d’actes d’état civil, en raison des difficultés résultant parfois du dysfonctionnement des services de l’état civil de certains pays d’origine des migrants et des risques de fraude qui y sont associés. Les autorités nationales sont en principe mieux placées pour établir les faits sur la base des preuves recueillies par elle ou produites devant elles (Z.M. c. France, no 40042/11, § 60, 14 novembre 2013) et il faut donc leur réserver un certain pouvoir d’appréciation à cet égard. C’est ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel français, pour qui le droit des étrangers - dont la résidence en France est stable et régulière - de faire venir auprès d’eux leurs enfants mineurs et leur conjoint, est subordonné à une procédure de vérification des actes d’état civil, qui peut s’avérer difficile et prendre du temps (paragraphe 36 ci-dessus). Force est de constater que, en l’espèce, l’autorité consulaire a considéré que les copies des actes de naissance des deux enfants présentés lors de leur demande de visa n’étaient pas authentiques et que leur filiation à l’égard de la première requérante n’était pas établie (paragraphe 16 ci-dessus).
67. Toutefois, si la résidence séparée des requérants est le résultat d’une décision prise par la première d’entre eux, rien n’indique dans le dossier qu’elle a renoncé à la réunification de la famille, ainsi qu’en attestent les nombreuses démarches accomplies, les déplacements au Cameroun et le maintien des contacts avec eux (paragraphes 11, 12, 20, 24 et 29 ci-dessus ; Sen c. Pays-Bas, no 31465/96, § 40, 21 décembre 2001). En conséquence, le rejet de ses demandes de visa ne lui laissait que le choix d’abandonner son statut acquis en France ou de renoncer à la compagnie de ses enfants, restés isolés au Cameroun. Or, la Cour rappelle qu’elle a considéré qu’un tel choix peut violer l’article 8 de la Convention (Sen, précité, § 41). Dans ce contexte, elle est d’avis qu’il était essentiel que les demandes de visa, sans lesquels il était impossible pour les enfants mineurs de rejoindre leur mère, soient examinées rapidement, attentivement et avec une diligence particulière, et que les autorités nationales lui fassent connaître les raisons qui s’opposaient à la mise en œuvre du regroupement familial. La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes dans l’examen de la question de savoir si les actes d’état civil présentés au soutien de la demande de regroupement familial étaient frauduleux ou pas au sens de l’article 47 du code civil. En revanche, elle est compétente pour rechercher si les autorités nationales, dans l’application et l’interprétation de cette disposition, ont respecté les garanties de l’article 8 de la Convention. A ce titre, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, pesait sur l’Etat défendeur l’obligation de mettre en œuvre, pour répondre à la demande de la première requérante, une procédure prenant en compte l’intérêt supérieur des enfants, les deuxième et troisième requérants. La Cour entend donc faire porter son examen sur la qualité de cette procédure et se placer sur le terrain des « exigences procédurales » de l’article 8 de la Convention (paragraphe 63 ci-dessus).
68. La Cour rappelle que, lorsqu’il s’agit de familles, les autorités doivent, dans leur évaluation de la proportionnalité, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet équilibre doit être sauvegardé en tenant compte des conventions internationales, notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant (Popov, précité, § 139). La Cour souligne qu’il existe un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (ibidem, § 140, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 96, CEDH 2013).
69. La Cour note également que la Convention internationale relative aux droits de l’enfant préconise que les demandes de regroupement familial soient examinées avec souplesse et humanité (paragraphe 39 ci-dessus). Elle attache de l’importance au fait que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a soutenu et précisé cet objectif (paragraphe 42 ci-dessus). Elle relève aussi dans la directive relative au regroupement familial 2003/86 CE de l’Union européenne que les autorités nationales sont incitées à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur (paragraphe 40 ci-dessus). Enfin, elle note que plusieurs rapports dénoncent des pratiques qui font obstacle au regroupement familial, en raison de la longueur excessive de la procédure de délivrance des visas, qui peut avoir des conséquences graves pour les enfants séparés de leur parent (paragraphes 43 et 58 ci-dessus).
70. En l’espèce, le déroulement de la procédure litigieuse retracé plus haut peut se résumer comme suit :
a) En 2006, le consulat de France à Yaoundé interrogea l’hôpital de Yaoundé pour vérifier la conformité des numéros de déclarations de naissance des enfants de la première requérante. L’échange épistolaire qui en résulta indiqua que les déclarations de naissance présentées par la première requérante ne correspondaient pas à celles des deuxième et troisième requérant.
b) En mai 2007, la première requérante présenta sa demande officielle de regroupement familial, laquelle fut acceptée dans son principe en novembre 2007.
c) Le dossier fut transmis aux autorités consulaires à Douala à la fin de l’année 2007 et la requérante obtint un rendez-vous en janvier 2008 pour faire les demandes de visa de long séjour. Elle y présenta les actes d’état civil établis par le consulat du Cameroun le 10 juillet 2006 (paragraphe 10 ci-dessus).
d) Affirmant avoir perdu les originaux des actes de naissance des enfants, elle demanda leur reconstitution en mars 2008 auprès des juridictions camerounaises. Celles-ci ordonnèrent, par deux jugements du 2 avril 2008, la reconstitution des actes de naissance.
e) En juin 2008, le consulat informa la requérante du rejet de sa demande au motif que les copies des actes de naissance des deux enfants présentés lors de leur demande de visa n’étaient pas authentiques.
f) En juillet 2008, la requérante fit un recours contre cette décision auprès de la commission de recours, qui ne répondit pas. Elle introduisit alors une action en référé et un recours en annulation de la décision consulaire. Elle fut déboutée de ces recours, nonobstant les jugements de reconstitution des actes de naissance des enfants rendus le 2 avril 2008 d’une part, et le test ADN effectué par la suite d’autre part.
g) En novembre 2009, soit presque deux ans après sa première demande, le Conseil d’Etat indiqua à la première requérante qu’elle pouvait présenter une nouvelle demande de visa auprès des autorités consulaires.
h) Postérieurement à la communication de la requête au Gouvernement par la Cour, le 12 juillet 2010, les deuxième et troisième requérants obtinrent des visas pour rejoindre leur mère en juin 2011.
71. Au vu de ce rappel, la Cour constate qu’il était difficile pour la première requérante de comprendre précisément ce qui s’opposait à sa demande de regroupement familial. C’est en effet la vérification initiée par les autorités consulaires en 2006, au demeurant inexpliquée par les pièces du dossier (paragraphe 7 ci-dessus), qui a servi de fondement au refus de délivrance des visas tout au long de la procédure commencée en mai 2007. Certes, l’on peut admettre que la décision de rejet du consulat, compte tenu de sa date, le 6 juin 2008, soit seulement moins d’un mois après que la première requérante eût demandé une prolongation de délai pour faire valoir les jugements de reconstitution du 2 avril 2008 et les actes établis en conséquence, repose sur la vérification effectuée en 2006. Le reste de la procédure démontre cependant que la requérante n’a pas été informée des raisons pour lesquelles les actes d’état civil qu’elle a présentés par la suite n’étaient pas probants. En effet, la commission de recours lui a opposé un refus implicite (paragraphes 17 et 22 ci-dessus), le juge des référés s’est fondé sur les actes initiaux et n’a pas tenu compte des actes reconstitués, et le Conseil d’Etat a rendu une ordonnance en ne mentionnant pas quels actes posaient problème pour établir le lien de filiation (paragraphe 26 ci‑dessus). Si la requérante a obtenu les motifs de la décision implicite de la commission de recours par la suite, il lui a été simplement conseillé de faire une nouvelle demande de visas auprès des autorités consulaires, soit deux ans après sa première demande.
72. La Cour note également les difficultés rencontrées par la première requérante pour participer utilement à la procédure et faire valoir l’ensemble des éléments de preuve des liens de filiation. Elle remarque à cet égard que son mémoire en cassation n’a pas été pris en considération par le Conseil d’Etat (paragraphes 26 et 27 ci-dessus) puisque celui-ci a rendu sa décision avant même sa réception. Or, ce mémoire soulevait deux points importants :
i) les autorités compétentes n’avaient pas expliqué en quoi il ne pouvait être accordé force probante aux jugements de reconstitution des actes de naissance et aux actes d’état civil établis par le consulat du Cameroun (paragraphe 44 ci‑dessus) ;
ii) le résultat du test ADN effectué à l’étranger confirmait sa maternité à 99,99 %.
73. Enfin, la Cour constate qu’il aura fallu quatre ans pour que les autorités nationales ne remettent plus en cause le lien de filiation entre la première requérante et ses enfants. Elle considère ce délai excessif, eu égard en particulier à l’intérêt supérieur des enfants.
74. L’ensemble des éléments exposés ci-dessus fait apparaître la situation angoissante et apparemment sans issue dans laquelle la première requérante se trouvait. La Cour constate que l’accumulation et la prolongation des difficultés auxquelles elle s’est heurtée au cours de la procédure ne lui a pas permis de faire valoir son droit de vivre avec ses enfants, les deuxième et troisième requérants, dont la situation méritait une plus grande prise en considération.
75. Compte tenu de ce qui précède, et malgré la marge d’appréciation de l’Etat en la matière, la Cour estime que le processus décisionnel n’a pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité requises pour faire respecter le droit des requérants au respect de leur vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Pour cette raison, l’Etat a omis de ménager un juste équilibre entre l’intérêt des requérants d’une part, et son intérêt à contrôler l’immigration d’autre part.
Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
TANDA-MUZINGA c. FRANCE du 10 juillet 2014 Requête 2260/10
Violation de l'article 8, un homme ayant obtenu le statut de réfugié politique, ne peut faire venir ses enfants et épouse durant 6 ans en France car ils sont de nationalité camerounaise. Le délai est trop long pour un regroupement familial.
a) Principes applicables
64. Dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations négatives, l’État doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la communauté dans son ensemble. Il jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 42, 1er décembre 2005 ; Osman c. Danemark, no 38058/09, § 54, 14 juin 2011).
65. La Cour a reconnu que les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur leur sol. L’article 8 n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur son territoire (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A no 94 ; Berisha c. Suisse, no 948/12, § 49, 30 juillet 2013).
66. Cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue des obligations pour l’État varie en fonction de la situation particulière de la personne concernée et de l’intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion (Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 39, CEDH 2006‑I ; Antwi et autres c. Norvège, no 26940/10, §§ 88-89, 14 février 2012).
67. Lorsqu’il y a des enfants, les autorités nationales doivent, dans leur examen de la proportionnalité aux fins de la Convention, faire primer leur intérêt supérieur (Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 139, 19 janvier 2012 ; Berisha, précité, § 51).
68. La Cour rappelle encore, à titre de comparaison, qu’en cas d’expulsion, les étrangers bénéficient de garanties procédurales spécifiques prévues par l’article 1 du protocole no 7. Si de telles garanties ne sont pas réglementées par la Convention en ce qui concerne la vie familiale des étrangers sous l’angle de l’article 8 de la Convention, et que celui-ci ne contient pas d’exigences procédurales explicites, le processus décisionnel conduisant à des mesures d’ingérence n’en doit pas moins être équitable et respecter comme il convient les intérêts sauvegardés par l’article 8 (voir, en général, McMichael c. Royaume-Uni, 24 février 1995, § 87, série A no 307‑B et, en particulier, Cılız c. Pays-Bas, no 29192/95, § 66, CEDH 2000‑VIII ; Saleck Bardi c. Espagne, no 66167/09, § 30, 24 mai 2011). En la matière, la qualité du processus décisionnel dépend spécialement de la célérité avec laquelle l’État agit (Ciliz, précité, § 71 ; Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 82, CEDH 2006‑XI ; Saleck Bardi, précité, 65 ; Nunez c. Norvège, no 55597/09, § 84, 28 juin 2011).
69. Enfin, la Cour estime opportun de rappeler sa jurisprudence récente selon laquelle, s’agissant du règlement de la preuve pour les demandeurs d’asile, elle a estimé que, eu égard à la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles‑ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (F.N. et autres c. Suède, no 28774/09, § 67, 18 décembre 2012). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents par lui produits (Mo.P. c. France (déc.), no 55787/09, 30 avril 2013).
b) Application au cas d’espèce
70. La Cour constate qu’il n’y a pas de controverse entre les parties sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention à la présente espèce. Elle relève par ailleurs que la procédure de regroupement se décompose en deux phases. Une fois l’autorisation donnée par le préfet, les membres de la famille concernés doivent obtenir un visa d’entrée en France dont la délivrance n’est pas automatique puisque soumise à des impératifs d’ordre public. La Cour considère donc que le refus litigieux de délivrer les visas ne constitue pas une « ingérence » dans l’exercice par le requérant du droit au respect de sa vie familiale mais que l’affaire concerne une allégation de manquement de l’État défendeur à une obligation « positive ».
71. D’après le requérant, le processus décisionnel ayant conduit les autorités nationales à refuser initialement de délivrer des visas aux membres de sa famille ne lui a pas garanti la protection de ses intérêts. Il fait valoir en particulier l’absence de prise en compte à la fois de sa qualité de réfugié et de l’urgence qu’il y avait à examiner attentivement les demandes de visas. Le Gouvernement plaide que le refus litigieux reposait sur des considérations d’ordre public, vérifiées à plusieurs stades de la procédure, conformément à sa marge d’appréciation en la matière, avant que le requérant ne produise le jugement de reconstitution de l’acte de sa naissance de sa fille Michelle.
72. La Cour admet que les autorités nationales se trouvent devant une tâche délicate lorsqu’elles doivent évaluer l’authenticité d’actes d’état civil, en raison des difficultés résultant parfois du dysfonctionnement des services de l’état civil de certains pays d’origine des migrants et des risques de fraude qui y sont associés. Les autorités nationales sont en principe mieux placées pour établir les faits sur la base des preuves recueillies par elle ou produites devant elles (Z.M. c. France, no 40042/11, § 60, 14 novembre 2013) et il faut donc leur réserver un certain pouvoir d’appréciation à cet égard. C’est ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel français, pour qui le droit des étrangers - dont la résidence en France est stable et régulière - de faire venir auprès d’eux leurs enfants mineurs et leur conjoint est subordonné à une procédure de vérification des actes d’état civil, qui peut s’avérer difficile et prendre du temps (paragraphe 39 ci-dessus). Force est de constater que, en l’espèce, l’autorité consulaire a relevé que l’épouse du requérant avait présenté un acte faux, s’agissant de leur fille Michelle, même si on ne peut exclure qu’elle en ignorait le caractère frauduleux (paragraphe 34 ci-dessus), et que les juridictions nationales ont décidé que cette circonstance suffisait à justifier le refus de délivrer l’ensemble des visas demandés.
73. Toutefois, la Cour estime que, compte tenu de la décision intervenue quelques mois plus tôt d’accorder le statut de réfugié au requérant et après la reconnaissance de principe du regroupement familial qui lui avait été accordée, il était capital que les demandes de visas soient examinées rapidement, attentivement et avec une diligence particulière. La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes dans l’examen de la question de savoir si les actes d’état civil présentés au soutien de la demande de regroupement familial étaient frauduleux ou pas au sens de l’article 47 du code civil. En revanche, elle est compétente pour rechercher si les autorités nationales, dans l’application et l’interprétation de cette disposition, ont respecté les garanties de l’article 8 de la Convention, en tenant compte du statut de réfugié accordé au requérant, et de la protection de ses intérêts protégés par cette disposition. À ce titre, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, pesait sur l’État défendeur l’obligation de mettre en œuvre, pour répondre à la demande du requérant, une procédure prenant en compte les évènements ayant perturbé et désorganisé sa vie familiale et conduit à lui reconnaître le statut de réfugié. La Cour entend donc faire porter son examen sur la qualité de cette procédure et se placer sur le terrain des « exigences procédurales » de l’article 8 de la Convention (paragraphe 68 ci-dessus).
74. À cet égard, la Cour observe que la vie familiale du requérant n’a été interrompue qu’en raison de sa fuite, par crainte sérieuse de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 (Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 75 et Tuquabo‑Tekle et autres, précité, § 47). Ainsi, et contrairement à ce qu’a indiqué de manière constante le ministère compétent, au cours de la procédure en référé et au fond (paragraphes 21 et 22 ci-dessus), jusqu’à la communication de la requête au gouvernement défendeur, la séparation du requérant d’avec sa famille ne lui était pas imputable. La venue de son épouse et de ses enfants âgés de trois, six et treize ans à l’époque de la demande de regroupement, eux-mêmes réfugiés dans un pays tiers, constituait donc le seul moyen pour reprendre la vie familiale.
75. La Cour rappelle que l’unité de la famille est un droit essentiel du réfugié et que le regroupement familial est un élément fondamental pour permettre à des personnes qui ont fui des persécutions de reprendre une vie normale (voir le mandat du HCR, paragraphes 44 et 47 ci-dessus). Elle rappelle également qu’elle a aussi reconnu que l’obtention d’une telle protection internationale constitue une preuve de la vulnérabilité des personnes concernées (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 155, CEDH 2012). Elle note à cet égard que la nécessité pour les réfugiés de bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres étrangers fait l’objet d’un consensus à l’échelle internationale et européenne comme cela ressort du mandat et des activités du HCR ainsi que des normes figurant dans la directive 2003/86 CE de l’Union européenne (paragraphes 45 et 47 ci-dessus). Dans ce contexte, la Cour considère qu’il était essentiel que les autorités nationales tiennent compte de la vulnérabilité et du parcours personnel particulièrement difficile du requérant, qu’elles prêtent une grande attention à ses arguments pertinents pour l’issue du litige, qu’elles lui fassent connaître les raisons qui s’opposaient à la mise en œuvre du regroupement familial, et enfin qu’elles statuent à bref délai sur les demandes de visa.
76. De ce point de vue, la Cour juge utile de tenir compte des standards qui émanent des instruments internationaux en la matière et d’avoir à l’esprit les recommandations des organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées en droit des étrangers. Ainsi et avant tout, elle observe que la Convention internationale sur les droits de l’enfant préconise que les demandes de regroupement familial soient examinées avec souplesse et humanité. Elle attache de l’importance au fait que le Comité des ministres et le Commissaire du Conseil de l’Europe ont soutenu et précisé cet objectif (paragraphes 43, 48 et 49 ci-dessus). S’agissant des moyens de preuve, elle relève dans la directive 2003/86/CE de l’Union européenne (paragraphe 45 ci-dessus) et dans divers textes émanant de sources internationales et d’ONG que les autorités nationales sont incitées à prendre en considération « d’autres preuves » de l’existence des liens familiaux si le réfugié n’est pas en mesure de fournir des pièces justificatives officielles. Le HCR, le Conseil de l’Europe et les ONG indiquent de manière concordante l’importance d’élargir ces moyens de preuve (paragraphes 41, 42, 47 et 48 ci-dessus), et la Cimade a souhaité que les autorités françaises compétentes prennent en considération les documents tenant lieu d’actes d’état civil délivrés par l’OFPRA, et ceux déjà contrôlés par cet Office (paragraphe 41 ci-dessus). Enfin, il importe de noter que plusieurs rapports dénoncent des pratiques qui font obstacle au regroupement familial, en raison de la longueur excessive et de la complexité de la procédure de délivrance des visas ; ils insistent sur la nécessité d’écourter les délais de la procédure en montrant plus de souplesse dans l’exigence des preuves attestant des liens familiaux (paragraphes 41, 42, 47 et 49 ci-dessus).
77. En l’espèce, le déroulement de la procédure litigieuse retracé plus haut peut se résumer ainsi :
a) Le requérant formula sa première demande de regroupement familial en juin 2007 et l’accord de principe fut donné le 13 février 2008, soit huit mois plus tard. Sa famille fut alors convoquée au consulat de France à Yaoundé qui entreprit une procédure de vérification dont il n’informa pas le requérant. Ne disposant pas d’indication sur le sort réservé à sa demande et ne connaissant pas les obstacles qui s’opposaient à la délivrance des visas, celui-ci forma, contre la décision implicite de rejet, un recours auquel la Commission de recours ne répondit pas. Ce n’est qu’au cours de l’audience de référé-suspension, en septembre 2008, que le requérant prit connaissance du mémoire du ministre de l’Immigration mettant en cause les actes de naissance de ses enfants Michelle et Benjamin.
b) Suivant une suggestion qu’aurait faite le rapporteur public à l’audience tenue le 20 mai 2009 par le Conseil d’État sur le recours en excès de pouvoir formé par le requérant, la femme de ce dernier saisit le tribunal de grande instance de Yaoundé pour obtenir une rectification judiciaire de l’acte de naissance de leur fille Michelle.
c) Confronté au rejet de son recours par le Conseil d’État en juillet 2009, le requérant présenta une seconde demande de regroupement familial. Celle‑ci fut également rejetée sans motivation en avril 2010 et la Commission de recours ne répondit pas au recours dont il la saisit.
d) Après de nouvelles vérifications effectuées en 2010, soit plus de deux ans après la demande de regroupement familial, l’acte de naissance de Benjamin put être authentifié, ce que le Gouvernement admet (paragraphe 31 ci-dessus).
e) Postérieurement à la communication de la requête au Gouvernement par la Cour, le 21 septembre 2010, le requérant obtint du juge des référés une ordonnance par laquelle celui-ci décida « qu’eu égard à la durée de la séparation entre le requérant et sa famille, la condition d’urgence est satisfaite » et enjoignit au ministre un nouvel examen de la demande de visa.
f) Le 19 novembre 2010, l’avocat du HCR/Cameroun fit parvenir le jugement reconstituant l’acte de naissance de la fille du requérant et les autorités consulaires délivrèrent les visas un mois plus tard.
78. Au vu de ce rappel, la Cour constate que faute d’explications et de motivations pourtant requises par la loi (paragraphe 37 ci-dessus), jusqu’en septembre 2008, soit quinze mois après sa première demande de regroupement familial, le requérant était incapable de comprendre précisément ce qui s’opposait à ce projet. Elle relève également que les autorités compétentes, au courant de la demande de reconstitution de l’acte de naissance de l’enfant Michelle devant la juridiction camerounaise (paragraphe 24 ci-dessus), n’ont pas jugé utile de s’enquérir du développement de cette démarche, lorsqu’elles ont refusé la seconde fois de délivrer les visas (paragraphe 32 ci-dessus). Enfin, à la suite d’une nouvelle vérification en 2010, elles ont finalement estimé que le lien de filiation de son fils Benjamin était établi, alors que celui-ci était contesté de la même manière que celui de sa fille Michelle (paragraphes 21, 24 et 31 ci-dessus).
79. La Cour observe encore les difficultés rencontrées par le requérant pour participer utilement à la procédure et faire valoir les « autres éléments » de preuve des liens de filiation. Pourtant, le requérant avait déclaré ses liens familiaux dès les toutes premières démarches de sa demande d’asile et l’OFPRA, immédiatement à la suite de sa demande de regroupement, avait certifié la composition familiale dans des actes réputés authentiques (paragraphes 8, 12, 28 et 38 ci-dessus). En outre, la Cour attache de l’importante au fait que le HCR, convaincu de l’authenticité de leurs démarches, avait pris en charge le requérant puis sa famille depuis leur fuite de la République démocratique du Congo et jusqu’au dénouement de la procédure (voir les nombreuses attestations aux paragraphes 22 et 23 et paragraphe 28 ci-dessus ; voir, également, mutatis mutandis, Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 82). Le ministère des Affaires étrangères du Cameroun avait aussi donné son accord pour le document de voyage de son épouse, dans lequel il était précisé qu’elle était accompagnée de ses trois enfants (paragraphe 10 ci-dessus) puis, par la suite, pour celui de l’enfant Michelle (paragraphe 22 ci-dessus). Le requérant avait enfin apporté d’autres éléments qui prouvaient le maintien des contacts avec sa famille (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour estime que ces éléments n’étaient pas dénués de pertinence ; le requérant pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils attestent de sa vie familiale passée et à ce que les autorités nationales leur portent une attention suffisante.
80. Enfin, la Cour constate qu’il aura fallu presque trois ans et demi pour que les autorités nationales ne remettent plus en cause le lien de filiation entre le requérant et ses enfants. Ce délai est excessif, eu égard à la situation particulière du requérant et à l’enjeu de la procédure de vérification pour lui.
81. L’ensemble des éléments exposés ci-dessus fait apparaître la situation angoissante et apparemment sans issue dans laquelle le requérant se trouvait. La Cour constate que l’accumulation et la prolongation des multiples difficultés dans lesquelles il s’est trouvé au cours de la procédure ont suscité chez lui, déjà soumis à des expériences traumatiques justifiant son statut de réfugié, un état dépressif sérieux (paragraphe 26 ci-dessus).
82. Compte tenu de tout ce qui précède, et malgré la marge d’appréciation de l’État en la matière, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas dûment tenu compte de la situation spécifique du requérant, et conclut que le processus décisionnel n’a pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité requises pour faire respecter son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Pour cette raison, l’État a omis de ménager un juste équilibre entre l’intérêt du requérant d’une part, et son intérêt à contrôler l’immigration d’autre part.
Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
MUGENZI c. FRANCE du 10 juillet 2014 requête 52701/09
Violation de l'article 8, un homme ayant obtenu le statut de réfugié politique, ne peut faire venir ses enfants les plus vieux en France.
a) Principes applicables
42. Dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations négatives, l’État doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la communauté dans son ensemble. Il jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 42, 1er décembre 2005 ; Osman c. Danemark, no 38058/09, § 54, 14 juin 2011).
43. La Cour a reconnu que les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur leur sol. L’article 8 n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur son territoire (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A no 94 ; Berisha c. Suisse, no 948/12, § 49, 30 juillet 2013).
44. Cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue des obligations pour l’État varie en fonction de la situation particulière de la personne concernée et de l’intérêt général. Les facteur à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion (Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 39, CEDH 2006‑I ; Antwi et autres c. Norvège, no 26940/10, §§ 88-89, 14 février 2012).
45. Lorsqu’il y a des enfants, les autorités nationales doivent, dans leur examen de la proportionnalité aux fins de la Convention, faire primer leur intérêt supérieur (Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 139, 19 janvier 2012 ; Berisha, précité, § 51).
46. La Cour rappelle encore, à titre de comparaison, qu’en cas d’expulsion, les étrangers bénéficient de garanties procédurales spécifiques prévues par l’article 1 du protocole No 7. Si de telles garanties ne sont pas réglementées par la Convention en ce qui concerne la vie familiale des étrangers sous l’angle de l’article 8 de la Convention, et que celui-ci ne contient pas d’exigences procédurales explicites, le processus décisionnel conduisant à des mesures d’ingérence n’en doit pas moins être équitable et respecter comme il convient les intérêts sauvegardés par l’article 8 (voir, en général, McMichael c. Royaume-Uni, 24 février 1995, § 87, série A no 307‑B et, en particulier, Cılız c. Pays-Bas, no 29192/95, § 66, CEDH 2000‑VIII ; Saleck Bardi c. Espagne, no 66167/09, § 30, 24 mai 2011). En la matière, la qualité du processus décisionnel dépend spécialement de la célérité avec laquelle l’État agit (Ciliz, précité, § 71 ; Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 82, CEDH 2006‑XI ; Saleck Bardi, précité, § 65 ; Nunez c. Norvège, no 55597/09, § 84, 28 juin 2011).
47. Enfin, la Cour estime opportun de rappeler sa jurisprudence récente selon laquelle, s’agissant du règlement de la preuve pour les demandeurs d’asile, elle a estimé que, eu égard à la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles‑ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (F.N. et autres c. Suède, no 28774/09, § 67, 18 décembre 2012). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents par lui produits (Mo.P. c. France (déc.), no 55787/09, 30 avril 2013).
b) Application en l’espèce
48. La Cour observe que le Gouvernement soutient qu’aucune « vie familiale » ne se trouve en cause en l’espèce. Elle estime ne pas devoir trancher, à ce stade de l’examen de la requête, la question de l’existence d’une « vie familiale » tant elle est liée au cœur du grief du requérant, qui dénonce les carences de l’État à établir de manière crédible que Lambert Sano et Éric Ndizeye sont majeurs, et comme tels, insusceptibles de bénéficier du regroupement familial.
49. Elle relève par ailleurs que la procédure de regroupement se décompose en deux phases. Une fois l’autorisation donnée par le préfet, les membres de la famille concernés doivent obtenir un visa d’entrée en France dont la délivrance n’est pas automatique puisque soumise à des impératifs d’ordre public. La Cour considère donc que le refus litigieux de délivrer les visas ne constitue pas une « ingérence » dans l’exercice par le requérant du droit au respect de sa vie familiale mais que l’affaire concerne une allégation de manquement de l’État défendeur à une obligation « positive ».
50. D’après le requérant, le processus décisionnel ayant conduit les autorités nationales à refuser de délivrer des visas aux enfants précités ne lui a pas garanti la protection de ses intérêts. Il fait valoir en particulier que la saisine des autorités rwandaises par les autorités consulaires était inappropriée et dangereuse. Il souligne également que la décision de rejet des visas demandés ne pouvait pas se fonder sur l’examen médical car les actes d’état civil des enfants n’étaient pas contestés et que d’autres éléments, dont la possession d’état, prouvaient l’absence de fraude. Le Gouvernement plaide que le refus litigieux reposait sur des considérations d’ordre public, vérifiées à plusieurs stades de la procédure, conformément à sa marge d’appréciation en la matière.
51. La Cour admet que les autorités nationales se trouvent devant une tâche délicate lorsqu’elles doivent évaluer l’authenticité d’actes d’état civil, en raison des difficultés résultant parfois du dysfonctionnement des services de l’état civil de certains pays d’origine des migrants et des risques de fraude qui y sont associés. Les autorités nationales sont en principe mieux placées pour établir les faits sur la base des preuves recueillies par elle ou produites devant elles (Z.M. c. France, no 40042/11, § 60, 14 novembre 2013) et il faut donc leur réserver un certain pouvoir d’appréciation à cet égard. Il en est de même à l’égard de la décision de pratiquer un examen médical des enfants. Pour des raisons évidentes liées aux conséquences attachées à la condition de mineur par la législation, le visa long séjour ne pouvant être délivré qu’aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, l’âge est souvent au cœur de la contestation. Force est de constater que, en l’espèce, l’autorité consulaire a conclu à une discordance entre l’âge physiologique des enfants et l’âge mentionné sur les actes d’état civil présentés au moment de la demande de regroupement de familial, et que les juridictions nationales ont décidé que cette circonstance suffisait à justifier le refus de délivrer des visas.
52. Toutefois, la Cour estime que, compte tenu de la décision intervenue quelques mois plus tôt d’accorder le statut de réfugié au requérant et après la reconnaissance de principe du regroupement familial qui lui avait été accordée, il était capital que les demandes de visa soient examinées rapidement, attentivement et avec une diligence particulière. La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes dans l’examen de la question de savoir si les actes d’état civil présentés au soutien de la demande de regroupement familial étaient frauduleux ou pas au sens de l’article 47 du code civil. En revanche, elle est compétente pour rechercher si les autorités nationales, dans l’application et l’interprétation de cette disposition, ont respecté les garanties de l’article 8 de la Convention, en tenant compte du statut de réfugié accordé au requérant, et de la protection de ses intérêts garantis par cette disposition. À ce titre, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, pesait sur l’État défendeur l’obligation de mettre en œuvre, pour répondre à la demande du requérant, une procédure prenant en compte les évènements ayant perturbé et désorganisé sa vie familiale et conduit à lui reconnaître le statut de réfugié. La Cour entend donc faire porter son examen sur la qualité de cette procédure et se placer sur le terrain des « exigences procédurales » de l’article 8 de la Convention (paragraphe 46 ci-dessus).
53. À cet égard, la Cour observe que la vie familiale du requérant n’a été interrompue qu’en raison de sa fuite, par crainte sérieuse de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 75 et Tuquabo‑Tekle et autres, précité, § 47). Ainsi, la venue des deux enfants, eux-mêmes réfugiés dans un pays tiers, constituait le seul moyen pour reprendre la vie familiale (a contrario, Berisha, précité, § 60).
54. La Cour rappelle que l’unité de la famille est un droit essentiel du réfugié et que le regroupement familial est un élément fondamental pour permettre à des personnes qui ont fui des persécutions de reprendre une vie normale (voir le mandat du HCR, paragraphe 32 ci-dessus). Elle rappelle également qu’elle a aussi reconnu que l’obtention d’une telle protection internationale constitue une preuve de la vulnérabilité des personnes concernées (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 155, CEDH 2012). Elle note à cet égard que la nécessité pour les réfugiés de bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres étrangers fait l’objet d’un consensus à l’échelle internationale et européenne comme cela ressort du mandat et des activités du HCR ainsi que des normes figurant dans la directive 2003/86/CE de l’Union européenne (paragraphe 32 ci-dessus).
55. Dans l’affaire Tuquabo-Teckle précitée, le refus d’accorder un permis de résidence au titre du regroupement familial à la fille de Mme Tuquabo-Tekle, âgée de plus de quinze ans, posait problème à la fois parce que ses parents ne pouvaient pas retourner dans leur pays d’origine, et parce que sa situation dans ce pays était préoccupante au regard des conditions de sa prise en charge (§§ 47 à 52). En l’espèce, la Cour observe que le requérant a, à plusieurs reprises, fait part de sa crainte que ses deux enfants, prétendument âgés de quinze et dix-sept ans au moment de la demande de regroupement familial, ne soient rapatriés au Rwanda et qu’ils risquent d’y subir des mauvais traitements ; il a souligné que l’un d’entre eux avait des problèmes de santé liés aux expériences traumatiques subies au Rwanda et qu’il était soigné pour une dépression, et insisté sur leur isolement, puisque leurs trois frères et sœurs aînés ne vivaient pas au Kenya comme le ministre de l’Immigration l’avait affirmé, mais en Europe où ils avaient tous obtenu le statut de réfugié (paragraphes 17, 18, 22 et 24 ci‑dessus). Dans ce contexte, la Cour considère qu’il était essentiel que les autorités nationales tiennent compte de la vulnérabilité et du parcours personnel particulièrement difficile du requérant, qu’elles prêtent une grande attention à ses arguments pertinents pour l’issue du litige, et enfin qu’elles statuent à bref délai sur les demandes de visa.
56. De ce point de vue, la Cour juge utile de tenir compte des standards qui émanent des instruments internationaux en la matière et d’avoir à l’esprit les recommandations des organisations non gouvernementales (ci‑après « ONG ») spécialisées en droit des étrangers. Ainsi et avant tout, elle observe que la Convention internationale sur les droits de l’enfant préconise que les demandes de regroupement familial soient examinées avec souplesse et humanité. Elle attache de l’importance au fait que le Comité des ministres et le Commissaire du Conseil de l’Europe ont soutenu et précisé cet objectif (paragraphe 32 ci-dessus). S’agissant des moyens de preuve, elle relève dans la directive 2003/86/CE de l’Union européenne (paragraphe 32 ci-dessus) et dans divers textes émanant de sources internationales et d’ONG que les autorités nationales sont incitées à prendre en considération « d’autres preuves » de l’existence des liens familiaux si le réfugié n’est pas en mesure de fournir des pièces justificatives officielles. Le HCR, le Conseil de l’Europe et les ONG indiquent de manière concordante l’importance d’élargir ces moyens de preuve (paragraphe 32 ci-dessus), et la Cimade a souhaité que les autorités françaises compétentes prennent en considération les documents tenant lieu d’actes d’état civil délivrés par l’OFPRA, et ceux déjà contrôlés par cet Office (ibidem). Enfin, il importe de noter que plusieurs rapports dénoncent des pratiques qui font obstacle au regroupement familial, en raison de la longueur excessive et de la complexité de la procédure de délivrance des visas ; ils insistent sur la nécessité d’écourter les délais de la procédure en montrant plus de souplesse dans l’exigence des preuves attestant des liens familiaux (ibidem).
57. En l’espèce, le déroulement de la procédure litigieuse retracé plus haut peut se résumer ainsi :
a) Le 5 mars 2003, le requérant déposa sa demande de regroupement familial. Le 13 janvier 2004, il présenta des demandes de visas pour les deux enfants. Le 31 août 2005, les autorités consulaires rejetèrent sa demande, soit dix-neuf mois plus tard, et neuf mois après l’examen médical pratiqué par le médecin agréé auprès de l’ambassade à Nairobi.
b) En octobre 2005, il introduisit un recours contre cette décision auprès de la commission de recours et manifesta son incompréhension de la remise en cause des actes d’état civil établis au Rwanda juste avant le début de la guerre, les seuls qu’il avait pu emporter avec lui lors de sa fuite, et qu’il avait présenté devant l’OFPRA au moment de sa demande d’asile. En février 2007, quinze mois après sa saisine, la commission de recours rendit un avis favorable.
c) Contre cet avis, le sous-directeur de la circulation des étrangers refusa la délivrance des visas par une décision du 26 février 2007.
d) En avril 2007, le requérant demanda l’annulation de cette décision devant le Conseil d’État, et le 24 janvier 2008, il saisit cette juridiction d’une requête en référé-suspension.
e) Par une ordonnance du 5 février 2008, le juge des référés considéra que la condition d’urgence n’était pas satisfaite car les deux enfants étaient majeurs ou près de le devenir. Il indiqua que la requête au fond serait jugée rapidement.
f) En mars 2009, le Conseil d’État rejeta le recours en annulation de la décision du 26 février 2007, soit presque deux ans après son introduction.
58. Au vu de ce rappel, la Cour constate ce qui suit. À titre liminaire, elle observe qu’il ne ressort pas du dossier qu’un test radiologique ait été effectué en l’espèce (paragraphe 14 ci-dessus). Il faut donc en déduire, à la lumière des deux attestations médicales manuscrites disponibles, que seul un examen sommaire de la cavité buccale a été pratiqué par un médecin (paragraphe 13 ci-dessus). Or, ce constat, de l’avis de la Cour, pose problème à double titre. Premièrement, elle relève que le Conseil d’État a affirmé « qu’il ne ressort pas du dossier » que l’examen en question se limitait à un examen de la cavité buccale, ce qui pourrait indiquer que la charge de la preuve pèse sur le requérant. Deuxièmement, elle observe que cette méthode de détermination de l’âge est discutable (paragraphes 30, 31, 33 et 34 ci-dessus). La Cour a déjà eu l’occasion de constater que, en cas d’absence de radiographie dentaire, le seul examen visuel d’un médecin ne permet pas de donner une indication, même approximative, de l’âge (Ahmade c. Grèce, no 50520/09, § 77, 25 septembre 2012). Il ressort du dossier que tel a été le cas en l’espèce. La Cour estime dès lors que le Gouvernement n’a pas établi, de manière crédible, que les allégations du requérant sur l’âge des enfants étaient non fondées et qu’il ne pouvait pas invoquer l’existence d’une « vie familiale » à leur égard (paragraphes 40 et 48 ci-dessus).
59. La Cour observe pourtant que l’examen médical s’est avéré déterminant dans l’appréciation du caractère apocryphe des actes de naissance présentés lors de la demande de visa alors que d’« autres éléments » de preuve apportés par le requérant corroboraient ses déclarations constantes depuis sa demande d’asile à l’OFPRA. Ainsi, l’ensemble des documents officiels qu’il avait produit indiquaient la même date de naissance des deux enfants. Le requérant avait déclaré Lambert Sano et Éric Ndizeye avec les autres membres de sa famille dans sa demande adressée à l’OFPRA (paragraphe 6 ci-dessus), lequel avait confirmé ses liens conjugaux et sa filiation avec tous ses enfants, ce qui avait permis la reconstitution d’une fiche familiale (paragraphe 7 ci-dessus). La demande de visas avait par ailleurs été faite conjointement pour son épouse et tous ses enfants mineurs, dont il ne ressort pas du dossier qu’ils aient été séparés avant la venue des trois derniers en France (paragraphe 15 ci-dessus). Le requérant avait ainsi fourni aux autorités consulaires les mêmes actes de naissance que ceux qu’il avait produits devant l’OFPRA (paragraphe 12 ci-dessus).
L’ensemble de ces éléments fait apparaître la situation angoissante et apparemment sans issue dans laquelle le requérant se trouvait puisque, d’un côté, les actes d’état civil présentés par lui pour les deux enfants avaient été certifiés par l’OFPRA et par la commission de recours, et que, de l’autre, ils étaient remis en cause par un examen médical sommaire dont rien au dossier n’établit qu’il ait été corroboré par une radiographie (paragraphes 14 et 58 ci-dessus).
60. La Cour souligne encore les difficultés rencontrées par le requérant pour participer utilement à la procédure afin de faire valoir la protection de ses intérêts. Elle note que le requérant n’a été informé de l’avis positif rendu par la commission de recours le 1er février 2007 qu’à l’occasion de la réception des observations du ministère de l’Immigration du 23 mai 2008, et qu’il n’a pas pu s’en prévaloir pour faire valoir ses arguments. En particulier, il n’a pas pu l’invoquer devant le juge des référés qui a considéré que la condition d’urgence n’était pas satisfaite parce que les deux enfants étaient « majeurs ou près de l’être », et que la requête au fond allait être jugée rapidement. Or, la Cour estime que cette motivation démontre avant tout que le requérant n’a pas pu faire examiner ses craintes maintes fois réitérées que les deux enfants fassent l’objet de persécution en cas de retour au Rwanda, ce qui constituait l’essence même de sa demande de regroupement familial à leur égard.
61. Enfin, la Cour constate qu’il aura fallu plus de cinq ans pour que le requérant soit fixé sur son sort. Elle estime qu’il s’agit d’un délai excessif, eu égard à la situation particulière du requérant et à l’enjeu de la procédure de vérification pour lui.
62. Compte tenu de ce qui précède, et malgré la marge d’appréciation de l’État en la matière, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas dûment tenu compte de la situation spécifique du requérant, et conclut que la procédure de regroupement familial n’a pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité requises pour faire respecter le droit du requérant au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Pour cette raison, l’État a omis de ménager un juste équilibre entre l’intérêt du requérant d’une part, et son intérêt à contrôler l’immigration d’autre part. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
DROIT DE RENVOYER LES DÉLINQUANTS
SI LES DROITS FAMILIAUX SONT RESPECTÉS
Ghadamian c. Suisse du 9 mai 2023 requête no 21768/19
Art 8 : Le refus des autorités suisses d’accorder au requérant une autorisation de séjour pour rentiers a entraîné une violation de son droit au respect de la vie privée
L’affaire concerne le prononcé du renvoi du requérant de Suisse à la suite du refus du Tribunal fédéral en 2018 de lui accorder une autorisation de séjour pour rentiers au regard de son séjour illégal sur le territoire depuis 2002 et de ses condamnations pour de graves infractions pénales. Au regard des circonstances particulières qui entourent le cas du requérant, la Cour estime que les considérations invoquées par les autorités nationales pour fonder leurs décisions ne peuvent pas passer pour suffisantes, compte tenu notamment de la durée totale extrêmement longue de son séjour en Suisse, de ses liens familiaux et affectifs déjà établis pendant son séjour légal et de son âge désormais avancé. Il s’agit aussi de tenir compte de l’incertitude quant à ses relations encore existantes dans son pays d’origine, l’Iran, de l’absence de graves infractions pénales depuis 2005, ainsi que des efforts insuffisants des autorités nationales depuis plus de 20 ans pour l’expulser de Suisse. Enfin, la Cour constate que le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 octobre 2018 a rejeté le recours du requérant sans s’être livré à un examen approfondi des critères au regard de l’article 8 de la Convention et sans avoir procédé à une mise en balance complète de tous les aspects pertinents de l’espèce. La Cour conclut que les autorités internes, malgré leur marge d’appréciation, dans les circonstances particulières de la présente affaire, n’ont pas démontré avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, mais ont plutôt attribué un poids excessif à l’intérêt général en refusant d’accorder au requérant l’autorisation de séjour pour rentiers qu’il sollicitait.
Art 8 • Obligations positives • Refus d’autorisation de séjour pour rentiers à un étranger âgé, vivant depuis plus de 50 ans en Suisse, mais depuis 2002 illégalement, en raison d’une décision, non exécutée, de l’expulser suite à ses condamnations pour graves infractions pénales • Inexistence d’une vie familiale entre le requérant et ses enfants majeurs • Circonstances particulières • Durée totale de son séjour extrêmement longue • Vie privée bâtie durant son séjour légal dès son arrivée en 1969 • Existence incertaine de relations dans son pays d’origine l’Iran • Absence de graves infractions pénales depuis 2005 • Efforts insuffisants des autorités nationales depuis plus de 20 ans pour l’expulser • Motifs pertinents mais pas suffisants • Étendue insuffisante du contrôle par le Tribunal fédéral • Poids excessif attribué à l’intérêt général
CEDH
41. La présente affaire concerne essentiellement le refus d’autoriser le requérant à résider en Suisse sur le fondement de sa vie privée et familiale qu’il y a construite tel qu’il l’allègue.
42. La Cour rappelle que l’on ne saurait retenir l’existence d’une vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, entre des parents et leurs enfants adultes sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 97, CEDH 2003‑X, A.S. c. Suisse, no 39350/13, § 49, 30 juin 2015, et Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), no 31519/96, 7 novembre 2000). Or, en l’espèce, la Cour estime, à l’instar du Tribunal fédéral (paragraphe 16 ci‑dessus), que l’intéressé ne peut se prévaloir de tels éléments supplémentaires à l’égard de ses enfants majeurs dans la mesure où il est autonome pour faire face à sa vie quotidienne malgré son âge avancé. Il n’existe pas non plus d’autres éléments équivalant à une « vie familiale » entre le requérant et ses enfants adultes (voir, en ce sens, Emonet et autres c. Suisse, no 39051/03, § 37, 13 décembre 2007, Belli et Arquier-Martinez c. Suisse, no 65550/13, § 65, 11 décembre 2018, I.M. c. Suisse, no 23887/16, § 62, 9 avril 2019, et Kwakye-Nti et Dufie, décision précitée). Dès lors, ses relations avec ses enfants ne relèvent pas du droit au respect de sa vie familiale. La présente affaire pose donc uniquement des questions relatives à la vie privée du requérant.
43. Lorsqu’un État contractant tolère la présence sur son sol d’un ressortissant étranger, lui donnant ainsi la possibilité d’attendre la décision relative à sa demande d’octroi d’un permis de séjour, à un recours contre une telle décision ou à une nouvelle demande de permis de séjour, il lui permet de participer à la vie sociale du pays dans lequel il se trouve, d’y nouer des relations et d’y fonder une famille. Pour autant, cela n’implique pas automatiquement que, en conséquence, l’article 8 de la Convention oblige les autorités de cet État à autoriser l’étranger à s’installer sur le territoire national (Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 103, 3 octobre 2014, A.S. c. Suisse, précité, § 44, Pormes c. Pays-Bas, no 25402/14, §§ 52, 60-61, 28 juillet 2020, et Danelyan, décision précitée).
44. Le requérant ne dispose plus de statut de séjour en Suisse depuis le 1er janvier 2002, date à laquelle la décision d’expulsion du 8 février 2000 était juridiquement contraignante (paragraphe 7 ci-dessus). Comme dans les affaires Jeunesse (précitée, § 104) et A.S. c. Suisse (précitée, § 45), cette affaire concerne un étranger cherchant à être admis et elle peut être distinguée de celles concernant les « migrants établis » à savoir les personnes qui ont déjà reçu un droit de séjour officiel dans un pays d’accueil. Le retrait ultérieur de ce droit, par exemple parce que l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction pénale, constitue une atteinte à son droit au respect de la vie privée et/ou familiale au sens de l’article 8.
45. La question à examiner en l’espèce est de savoir si, eu égard aux faits de la cause pris dans leur ensemble, les autorités suisses étaient tenues en vertu de l’article 8 de la Convention d’octroyer un permis de séjour au requérant afin de lui permettre de mener sa vie privée sur leur territoire et de ne pas l’expulser. Le cas d’espèce concerne donc non seulement la vie privée, mais aussi l’immigration et doit par conséquent être examiné sous l’angle des obligations positives de l’État défendeur (comparer avec Jeunesse, précité, § 105, A.S. c. Suisse, précité, § 46, et voir Danelyan, décision précitée).
46. Quand une personne étrangère bâtit sa vie privée sur le territoire d’un État alors qu’elle y séjourne illégalement, un refus ultérieur de délivrance d’un permis de résidence n’emporte violation de l’article 8 que dans des circonstances exceptionnelles (Pormes, précité, § 58). Or le requérant a bâti sa vie privée en Suisse durant les trente-trois années où il y a séjourné légalement. Ainsi, la Cour procédera à une mise en balance des intérêts en cause fondée sur une analyse de l’ensemble des faits concernés au regard des facteurs, définis dans sa jurisprudence, qu’il faut prendre en compte pour déterminer si un État peut être tenu à l’obligation positive d’admettre le séjour sur son territoire d’un étranger qui y était en situation irrégulière (Pormes, précité, §§ 56-58).
47. Au moment où le Tribunal fédéral a rejeté sa demande d’autorisation de séjour (paragraphe 16 ci-dessus), le requérant savait que sa présence sur le territoire suisse était illégale depuis le 1er janvier 2002, date à laquelle la décision d’expulsion du 8 février 2000 était juridiquement contraignante (paragraphe 7 ci-dessus). Son avocat a eu la confirmation de l’absence de statut de séjour de son client le 3 juin 2003 (paragraphe 9 ci-dessus).
48. L’intéressé avait l’obligation de quitter la Suisse lorsqu’il en a reçu l’ordre dès lors que son séjour sur ce territoire lui avait été valablement refusé. Selon la législation nationale, un réexamen de la décision d’expulsion ne pouvait pas être envisagé vu l’absence de motifs valables (paragraphes 14-15 ci-dessus).
49. Les infractions commises par le requérant ont été des critères décisifs dans la décision du 8 février 2000 de l’expulser de Suisse (paragraphe 6 ci‑dessus) et dans le refus du Tribunal fédéral du 29 octobre 2018 de lui accorder une autorisation de séjour pour rentiers (paragraphe 16 ci-dessus). Entre novembre 1988 et janvier 2004, il fut condamné à des peines d’emprisonnement d’une durée cumulée d’environ cinq ans pour diverses graves infractions pénales (paragraphe 6 ci-dessus).
50. Le requérant allègue (paragraphe 28 ci-dessus) que les condamnations qui ont été déterminantes dans la décision du 8 février 2000 de l’expulser de Suisse se rapportent à un même conflit avec son ex-femme D.B. durant une courte période et qu’il a purgé sa peine d’emprisonnement.
51. Pour le Gouvernement (paragraphe 37 ci-dessus), si les infractions à la base du prononcé de son expulsion du 8 février 2000 sont anciennes et qu’il a purgé ses peines, l’intéressé n’a jamais eu de période étendue sans nouvelle condamnation (Krasniqi, précité, § 52). Il y a ainsi persistance d’un risque de récidive (Vasquez, précité, § 46).
52. Si depuis 2006 le requérant n’a jamais été accusé d’aucune infraction pénale grave (paragraphe 29 ci-dessus) qui indiquerait qu’il représente une menace pour la sécurité publique, la Cour prend note qu’il a été condamné plusieurs fois pour son séjour illégal à des peines d’emprisonnement de six semaines en 2005 et de trois mois en 2006, de travail d’intérêt général en 2008 et de jours-amende en 2015 (paragraphe 10 ci-dessus) et à une amende pour vol d’importance mineure en 2016 (paragraphe 12 ci-dessus). Au regard des multiples condamnations pénales depuis 1999, la Cour accepte que les autorités suisses aient disposé d’un certain intérêt d’ordre public à vouloir l’expulser.
53. Les autorités internes ont tenté d’exécuter la décision d’expulsion (voir, a contrario, Jeunesse, précité, § 116). Elles se sont toutefois heurtées à des difficultés liées notamment à l’établissement de l’identité du requérant qui ne présentait pas un passeport valable nécessaire à l’acceptation du renvoi par l’Iran (paragraphe 8 ci-dessus) (Danelyan, décision précitée, § 27). Or, ce dernier s’est rendu ponctuellement en Iran (paragraphe 30 ci-dessus) et il devait vraisemblablement disposer de son passeport à la douane pour quitter le territoire Suisse et y rentrer à l’aller et au retour de ses voyages dans son pays. Il semble donc douteux que l’État défendeur ait pris toutes les mesures possibles et nécessaires pour se procurer le passeport du requérant et l’expulser.
54. Aussi, il convient de rappeler que les étrangers – et donc, en l’espèce, le requérant – ont l’obligation de se soumettre aux contrôles et aux procédures d’immigration et de quitter le territoire de l’État contractant concerné lorsqu’ils en reçoivent l’ordre si l’entrée ou le séjour sur ce territoire leur sont valablement refusés (Jeunesse, précité, § 100). Le requérant a fait montre de mauvaise foi en séjournant illégalement en Suisse depuis vingt ans et il a activement contrecarré l’exécution de la décision d’expulsion. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a noté que l’intéressé ne peut pas tirer des droits du fait qu’il n’a pas lui-même respecté l’ordre juridique et les décisions finales (paragraphe 16 ci-dessus).
55. Le requérant séjourne en Suisse depuis environ cinquante-quatre ans, si l’on se place au moment de l’exécution de la mesure litigieuse, comme le fait habituellement la Cour dans les affaires qu’elle examine alors que l’intéressé n’a pas encore été expulsé (voir, mutatis mutandis, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 91, CEDH 2008, et Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 145, 6 juillet 2010).
56. La durée de son séjour en Suisse est manifestement très longue. Il y avait passé environ quarante-neuf années au moment où le Tribunal fédéral a rejeté sa demande d’autorisation de séjour pour rentiers (paragraphe 16 ci‑dessus), même si sa présence sur le territoire était illégale depuis seize ans (paragraphe 46 ci-dessus). Dès lors, la durée totale du séjour du requérant ne peut pas se voir accorder le même poids que s’il y avait résidé avec un permis de séjour valable pendant toute la période (Vasquez, précité, § 45 ; et comparer avec Pormes, précité, § 64). Néanmoins, la Cour rappelle que l’intéressé a établi des liens étroits avec la Suisse depuis son séjour légal de trente-trois ans à partir de son arrivée dans le pays en 1969 à l’âge de 29 ans (paragraphe 46 ci-dessus). Il y a vécu la plus grande majorité de sa vie durant laquelle il a eu deux fils qui vivent avec leurs cinq enfants en Suisse et dont il dit être très proche (paragraphe 30 ci-dessus). Selon le Gouvernement, il ne prouve pas de manière approfondie avoir d’autres relations sociales considérables et actuelles (paragraphe 39 ci-dessus). Le requérant décrit lui-même que sa famille domiciliée en Suisse constitue à son âge le centre d’intérêt de sa vie privée, d’autant plus qu’on ne sait pas combien de temps il pourra vivre de manière indépendante dans son propre foyer même s’il n’a pas de problème majeur de santé à ce jour (paragraphe 30 ci-dessus). Il ajoute cependant avoir une compagne suisse depuis quatorze ans et de nombreux amis proches, et avoir des relations avec des membres de l’équipe de volleyeurs dont il a été l’entraîneur (paragraphe 30 ci-dessus).
57. Par ailleurs, la Cour estime que l’intéressé a clairement démontré par son comportement qu’il s’était intégré au monde du travail en Suisse. Il y a exercé une activité professionnelle et il y bénéficie d’une retraite (paragraphe 31 ci-dessus).
58. Selon le requérant, il n’a plus de liens avec son pays d’origine ; tous ses frères et sœurs résidant en Iran sont décédés et il a perdu contact avec le seul membre de sa famille restant qui vivait aux États-Unis (paragraphe 30 ci-dessus). À l’inverse, l’OM-AG et le Gouvernement soutiennent qu’il y dispose d’un réseau familial, sans toutefois motiver ce constat en détail (paragraphes 13 et 40 ci-dessus).
59. Il est incontestable que, même s’il est physiquement et économiquement indépendant, n’a pas de problème de santé majeur et n’est pas marié, le requérant, qui est âgé aujourd’hui de 83 ans, se trouverait dans une situation compliquée s’il était renvoyé en Iran. Il se trouverait séparé de ses enfants et petits-enfants. Il serait sans doute exposé à des difficultés de réintégration, sachant qu’à son âge, il n’est retourné que ponctuellement dans son pays d’origine depuis 1969 et que selon ses dires il n’y dispose plus de ses frères et sœurs.
60. La question-clé en l’espèce est celle de savoir s’il a été ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, à savoir, d’une part, l’intérêt personnel du requérant à continuer à résider en Suisse et à y poursuivre sa vie privée et, d’autre part, l’intérêt d’ordre public de l’État défendeur à contrôler l’immigration, ou si au contraire, dans les circonstances de la présente affaire, les autorités internes ont attribué un poids excessif à l’intérêt général et outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue en matière d’immigration. La portée de l’obligation positive pour l’État d’admettre une personne étrangère sur son sol dépend de la situation particulière de celle-ci et de l’intérêt général (Pormes, précité, § 54).
61. La Cour considère que les circonstances entourant le cas du requérant doivent être considérées comme particulières (paragraphes 56-59 ci-dessus). Au regard de celles-ci, elle estime que les considérations invoquées par les autorités nationales se rapportant aux précédentes décisions contraignantes pour le requérant de quitter le pays, à son séjour illégal sur le territoire depuis 2002 et à ses condamnations antérieures pour de graves infractions pénales peuvent certes être considérées comme des motifs pertinents, mais elles ne peuvent pas passer pour suffisantes compte tenu notamment de la durée totale extrêmement longue de son séjour en Suisse, de ses liens et du centre d’intérêt de sa vie dans ce pays déjà établis pendant son séjour légal, de son âge avancé, de l’incertitude quant aux relations encore existantes dans son pays d’origine, de l’absence de graves infractions pénales depuis 2005 et des efforts insuffisants des autorités nationales depuis plus de 20 ans pour l’expulser.
62. En outre, si le TA-AG, le 27 juin 2018, a fait un examen relativement circonstancié de la situation personnelle du requérant et des possibilités d’octroi d’un titre de séjour pour décider du rejet de son recours (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour constate que le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 octobre 2018 (paragraphe 16 ci-dessus) a rejeté le recours du requérant sans s’être livré à un examen approfondi des critères au regard de l’article 8 de la Convention et sans avoir procédé à une mise en balance complète de tous les aspects pertinents de l’espèce.
63. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les autorités internes, malgré leur marge d’appréciation, dans les circonstances particulières de la présente affaire n’ont pas démontré avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, mais ont plutôt attribué un poids excessif à l’intérêt général en refusant d’accorder au requérant une autorisation de séjour pour rentiers.
64. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
Alami c. France du 16 décembre 2021 requête no 43084/19
Art 8 : La Cour confirme la solution retenue par les juridictions françaises : l’expulsion du requérant vers le Maroc n’emporte pas violation de l’article 8 de la Convention
L’affaire concerne un requérant marocain faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français qui soutenait que son expulsion porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, faisant en particulier valoir ses liens avec ses enfants résidant en France. La Cour note d’abord que les juridictions internes, saisies d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté d’expulsion, ont explicitement opéré un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Elle relève ensuite que dans l’opération de mise en balance qu’elles ont effectuée, elles ont pris en considération à la fois les arguments présentés par le requérant et la gravité des condamnations pénales prononcées à son encontre. Après avoir relevé que les enfants du requérant étaient majeurs et que ce dernier n’alléguait pas être dénué de liens sociaux et culturels dans son pays d’origine où il avait vécu jusqu’à l’âge de vingt quatre ans, la Cour en déduit que, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elles disposent et eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu, il n’existe pas de raison sérieuse de se séparer des conclusions de ces juridictions suivant lesquelles la mise à exécution de l’expulsion du requérant vers le Maroc ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Cette décision est définitive.
FAITS
Le requérant, M. Karim Alami, est un ressortissant marocain, né en 1974 et résidant à Rognonas (France). Il entra en France en 1998, à l’âge de vingt-quatre ans. En 2000, M. Alami fut condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français pendant deux ans pour des faits de vol aggravé commis en 1999. Il fut reconduit au Maroc. En mars 2000, il y épousa une française. De cette union naquirent deux enfants, respectivement en 2001 et 2003. Le 24 mars 2003, M. Alami fut condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols commis sur trois femmes en 1999 et 2000, dont un viol sur une mineure de 15 ans. Le 18 novembre 2008, une mesure de libération conditionnelle lui fut accordée par la Cour d’appel de Nîmes. Le 12 juin 2009, M. Alami fit l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône au motif qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public en raison de l’ensemble de son comportement. En septembre 2009, M. Alami et son épouse se séparèrent et leur divorce fut prononcé en 2014. Après la séparation du couple, M. Alami fut condamné pénalement pour des faits de violences conjugales et harcèlement téléphonique commis à l’encontre de son ex-épouse entre les mois d’octobre 2009 et d’avril 2010. Le 28 novembre 2014, M. Alami demanda au préfet les motifs fondant sa décision implicite de refus d’abrogation, dans le cadre du réexamen quinquenal. Le 12 décembre 2014, le préfet confirma par courrier son refus du fait que l’intéressé constituait toujours une menace pour l’ordre public en raison de la gravité des faits dont il s’était rendu coupable et de l’absence de justificatifs de réinsertion sociale et professionnelle. Le 13 mars 2017, le tribunal administratif rejeta le recours en annulation formé par le requérant contre la décision du 12 décembre 2014. Le 26 juin 2018, la cour administrative d’appel de Marseille rejeta l’appel du requérant et le 12 février 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d’État rejeta définitivement sa demande d’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel.
Article 8
L’exigence d’un « contrôle européen » ne signifie pas que la Cour doive nécessairement réexaminer la proportionnalité de la mesure litigieuse en cause à l’aune de l’article 8 de la Convention. Au contraire, sur le terrain de cette disposition, la Cour considère en général qu’il découle de la marge d’appréciation que, lorsque des juridictions internes indépendantes et impartiales ont soigneusement examiné les faits, en appliquant les normes pertinentes relatives aux droits de l’homme d’une manière conforme à la Convention et à sa propre jurisprudence, et dûment mis en balance les intérêts personnels du requérant et l’intérêt général, elle n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales compétentes. La Cour note tout d’abord que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel saisies d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté d’expulsion ont explicitement opéré un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La Cour relève ensuite que les juridictions internes ont pris en considération à la fois les arguments présentés par le requérant et la gravité des condamnations pénales prononcées à son encontre en 2000 et 2003 puis en 2009, après sa libération conditionnelle, et l’édiction de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre. Dans l’opération de mise en balance qu’elles ont effectuée, ces juridictions ont également relevé que le requérant bénéficiait d’un droit de visite de ses enfants qui résidaient chez leur mère, qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis 2009 alors qu’il était frappé d’un arrêté d’expulsion et qu’il n’était ni intégré professionnellement ni ne présentait des garanties de réinsertion sociale. En outre, les enfants du requérant, divorcé depuis 2014, résident en France et sont entre temps devenus majeurs. Le requérant n’allègue pas de sa dépendance à leur égard, ni n’allègue qu’il subvient à leurs besoins ou qu’ils ne pourraient pas lui rendre visite au Maroc. Enfin, le requérant n’affirme pas être dénué de liens sociaux et culturels dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Compte tenu de la large marge d’appréciation dont elles disposent et eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu, la Cour estime qu’il n’existe pas de raison sérieuse de se séparer des conclusions auxquelles ces juridictions sont parvenues, suivant lesquelles la mise à exécution de l’expulsion du requérant vers le Maroc ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté.
CEDH
26. La Cour relève tout d’abord qu’il n’est pas contestable que la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion du requérant constituerait une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8 ; il convient donc de rechercher si, en l’espèce, elle était « prévue par la loi », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire dans une société démocratique ».
27. Le respect de ces deux premières conditions n’étant pas contesté par le requérant et ne soulevant pas de difficulté en l’espèce, il reste à déterminer si la mesure en cause était « nécessaire dans une société démocratique » et, plus précisément, si, en prenant un arrêté d’expulsion à l’encontre du requérant, les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les droits de ce dernier au regard de la Convention, d’un côté, et les intérêts de la société, de l’autre côté (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003‑X). La Cour rappelle que les principes généraux applicables dans les affaires d’expulsion ont été résumés dans les arrêts Udeh c. Suisse (no 12020/09, §§ 44‑45, 16 avril 2013) et Ndidi c. Royaume-Uni (no 41215/14, §§ 75‑76, 14 septembre 2017).
28. Dans le premier de ces arrêts, la Cour a rappelé les critères résumés dans l’affaire Üner c. Pays-Bas ([GC], no 46410/99, §§ 57‑58, CEDH 2006‑XII) devant guider les instances nationales dans de telles affaires :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la nationalité des diverses personnes concernées ;
– la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
– la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
– la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
– la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
– l’intérêt et le bien‑être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
29. L’exigence d’un « contrôle européen » ne signifie pas que, au moment de déterminer si la mesure en cause a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, la Cour doive nécessairement en réexaminer la proportionnalité à l’aune de l’article 8 de la Convention. Au contraire, dans les affaires portées devant elle sur le terrain de cette disposition, la Cour considère en général qu’il découle de la marge d’appréciation que, lorsque des juridictions internes indépendantes et impartiales ont soigneusement examiné les faits, en appliquant les normes pertinentes relatives aux droits de l’homme d’une manière conforme à la Convention et à sa propre jurisprudence, et qu’elles ont dûment mis en balance les intérêts personnels du requérant et l’intérêt général, elle n’a pas à substituer sa propre appréciation (notamment en ce qui concerne les détails factuels relatifs à la proportionnalité) à celle des autorités nationales compétentes. Il n’en va autrement que lorsqu’il est démontré qu’il y a des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis au leur (Ndidi, précité, § 76).
30. La Cour note tout d’abord que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel saisies d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté d’expulsion ont explicitement opéré, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La cour administrative d’appel a relevé la particulière longueur du séjour en France du requérant en indiquant que celui‑ci avait déclaré être entré sur le territoire français en 1998. La Cour estime elle aussi que cet élément a un poids certain en l’espèce, la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé constituant un critère d’examen devant guider les instances nationales dans les affaires d’expulsion (Udeh, précité, § 45).
31. La Cour relève ensuite que les juridictions internes ont pris en considération à la fois les arguments présentés par le requérant et la gravité des condamnations pénales prononcées à son encontre en 2000 et 2003 puis en 2009, après sa libération conditionnelle et l’édiction de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre. Dans l’opération de mise en balance qu’elles ont effectuée, ces juridictions ont également relevé que le requérant bénéficiait alors une fois par semaine d’un droit de visite de ses enfants nés en 2001 et 2003 qui résidaient chez leur mère, qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis 2009 alors qu’il était frappé d’un arrêté d’expulsion (voir paragraphe 21 ci‑dessus) et qu’il n’était ni intégré professionnellement ni ne présentait des garanties de réinsertion sociale. La Cour estime que ces éléments ont eux aussi un poids certain pour l’examen du grief du requérant.
32. En outre, s’il ressort des pièces au dossier que les enfants du requérant, divorcé depuis 2014, résident en France (paragraphe 21 ci‑dessus), ils sont entre‑temps devenus adultes. Le requérant n’allègue pas qu’il est dépendant de ces membres de sa famille ou, inversement, qu’il subvient à leurs besoins (voir Kwakye‑Nti et Dufie c. France (déc.), no 31519/96, 7 novembre 2000, et Slivenko [GC], précité, § 97). Il n’allègue ni ne démontre pas plus qu’ils ne pourraient pas lui rendre visite au Maroc. Enfin, le requérant n’affirme pas être dénué de liens sociaux et culturels dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt‑quatre ans.
33. Dans ces conditions, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elles disposent en la matière et eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu en l’espèce, au terme de décisions circonstanciées et dûment motivées, la Cour estime qu’il n’existe pas de raison sérieuse de se séparer des conclusions auxquelles elles sont parvenues selon lesquelles la mise à exécution de l’expulsion du requérant vers le Maroc ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
34. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Grande Chambre Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 requête no 57467/15
Cliquez ici pour lire l'arrêt Savran c. Danemark au format pdf
Article 8 : Expulsion, consécutive à des condamnations pénales, d’un ressortissant turc souffrant d’une pathologie mentale qui résidait au Danemark
Par seize voix contre une, qu’il y a eu non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle dit qu’il n’a pas été démontré que le requérant se trouverait exposé en cas d’expulsion à un « déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses » étant donné qu’une diminution de traitement faisait principalement naître un risque pour autrui, et que son expulsion n’appelait donc pas les protections offertes par cet article.
Par onze voix contre six, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée). Elle dit en particulier que les autorités internes n’ont pas correctement apprécié la situation particulière du requérant, et que l’interdiction définitive de retour sur le territoire s’analyse en une mesure disproportionnée.
Art. 3 (Fond) • Expulsion vers son pays d’origine d’un ressortissant étranger atteint de schizophrénie, sans que les risques pour sa santé n’aient atteint le seuil élevé d’application de l’article 3 • Confirmation du critère de franchissement du seuil de gravité posé dans l’arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] et de son applicabilité en cas d’éloignement de personnes atteintes de troubles mentaux
Art. 8 • Expulsion • Vie privée • Mesure d’interdiction définitive du territoire ordonnée contre un immigré établi de longue date atteint de schizophrénie et ayant commis des infractions violentes, en dépit de progrès consécutifs à plusieurs années de soins obligatoires • Absence de prise en compte du constat de non-culpabilité pénale à raison des troubles mentaux de l’intéressé • Manquement des autorités à prendre en compte et mettre en balance les différents intérêts en jeu et les facteurs pertinents
FAITS
Le requérant, Arıf Savran, est un ressortissant turc né en 1985 et résidant à Kütükușağı (Turquie). En 1991, alors qu’il était âgé de six ans, il entra légalement au Danemark pour vivre avec son père. Après avoir été reconnu coupable d’agression en réunion ayant causé la mort de la victime, le requérant fut interné en 2008, pour une durée indéfinie, dans l’unité sécurisée d’un établissement spécialisé pour personnes souffrant de lourds handicaps mentaux. Son expulsion, assortie d’une interdiction définitive de retour sur le territoire, fut ordonnée. En janvier 2012, le tuteur ad litem du requérant saisit le parquet d’une demande de réexamen de la peine qui avait été infligée à l’intéressé. Le parquet porta cette demande devant le tribunal de Copenhague en décembre 2013. Se fondant sur des rapports médicaux, des avis du service de l’immigration et des déclarations du requérant, le tribunal de Copenhague substitua à la mesure d’internement en établissement de psychiatrie légale une obligation de traitement en service de psychiatrie. Il considéra également qu’en dépit de la gravité de l’infraction qui lui était reprochée, il serait inapproprié d’exécuter la décision d’expulsion. En particulier, les experts médicaux estimaient que le maintien du traitement du requérant et d’un suivi étaient nécessaires à sa guérison, et le requérant avançait que toute sa famille vivait au Danemark, qu’il ne parlait pas le turc et n’avait que quelques notions de kurde, et qu’il craignait que le traitement dont il avait besoin ne fût pas disponible en Turquie. Saisie d’un recours par l’accusation, la cour régionale infirma la décision du tribunal de Copenhague en janvier 2015. Dans ses conclusions, elle cita des informations tirées de MedCOI, la base de données médicales de la Commission européenne, sur l’accès en Turquie au traitement du requérant, ainsi qu’un rapport du ministère des Affaires étrangères dans lequel il était indiqué que M. Savran pourrait poursuivre son traitement en Turquie. Elle insista également sur la nature et la gravité de l’infraction qui avait été commise. En mai 2015, M. Savran se vit refuser l’autorisation de contester devant la Cour suprême la décision de la cour régionale. En 2015, il fut expulsé vers la Turquie, où, selon lui, il vit isolé et ne bénéficie pas d’un traitement adapté.
Article 3
La Cour rappelle que l’interdiction des traitements inhumains et dégradants est l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le traitement en cause doit toutefois être suffisamment sérieux pour atteindre le degré de gravité requis par l’article 3. La Cour rappelle en outre que les États ont le droit de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux sur leur territoire, sous réserve des limites posées par l’article 3, telles qu’énoncées dans sa jurisprudence. Sur l’expulsion d’étrangers gravement malades, la Cour réaffirme les principes établis dans l’affaire Paposhvili c. Belgique, et notamment le « seuil » de gravité devant être atteint pour que l’article 3 trouve à s’appliquer. Tout en réaffirmant également que ce « seuil » doit rester élevé, elle considère que le standard en question est suffisamment souple pour être appliqué dans tous les cas où l’expulsion d’une personne gravement malade constituerait un traitement prohibé par l’article 3, et ce quelle que soit la nature de la maladie. Elle observe que la chambre n’a pas examiné le cas d’espèce sous cet angle. Sur les faits, la Cour considère qu’il n’a pas été démontré que le renvoi du requérant vers la Turquie ait exposé l’intéressé à un « déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses », ni, a fortiori, à une « réduction significative de son espérance de vie ». En effet, il apparaît qu’une réduction du traitement ferait naître un risque pour autrui plutôt que pour le requérant lui-même. En conséquence, l’expulsion du requérant n’a pas exposé l’intéressé à un risque suffisant pour déclencher l’application de l’article 3. Partant, il n’y a pas eu violation de cet article.
Article 8
La Cour rappelle que, conformément à sa pratique habituelle, elle doit réexaminer tous les aspects de la requête initiale, y compris les parties relatives à l’article 8 que la chambre n’a pas jugées irrecevables. Elle relève que le requérant est arrivé au Danemark à l’âge de six ans et qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour. Elle prend note des relations familiales du requérant au Danemark et de ses allégations selon lesquelles il dépendait des membres de sa famille en raison de son état et avait donc avec eux une « vie familiale », que son expulsion avait rompue. Elle n’est cependant convaincue ni de l’existence de preuves suffisantes de dépendance à leur égard, ni, compte tenu de son histoire, du fait qu’il ait entretenu des liens familiaux stables. Elle considère donc que la question d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de ses droits garantis par l’article 8 doit être examinée sous l’angle du volet « vie privée » plutôt que du volet « vie familiale ». Eu égard à cette considération, la Cour conclut que l’expulsion du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice par celui-ci de son droit au respect de sa vie privée, et que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime que constitue la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Sur la question de la nécessité de la mesure d’expulsion, la Cour rappelle les critères énoncés dans sa jurisprudence, en particulier dans l’arrêt Maslov c. Autriche. Faisant application de ces critères en l’espèce, elle constate que le requérant était plus vulnérable qu’un « immigré établi » ordinaire visé par une mesure d’expulsion, et que son état de santé était un facteur à prendre en compte dans le cadre de la mise en balance. Elle admet en outre que les aspects médicaux du dossier du requérant ont fait l’objet d’un examen très approfondi par les juridictions internes.
Par ailleurs, la Cour estime que les autorités internes n’ont pas suffisamment pris d’autres facteurs en considération dans le cadre de la mise en balance. Elle observe en particulier que le requérant a certes commis des infractions graves – violentes par nature –, mais que les autorités internes n’ont pas tenu compte du fait qu’à l’époque des faits, l’intéressé souffrait très probablement d’un trouble mental qui se traduisait dans son cas par un comportement physiquement agressif, et qu’en raison de cette maladie mentale, les juridictions internes avaient conclu que l’intéressé n’était pas passible de sanction et avaient ordonné son internement en établissement de psychiatrie légale. La Cour estime que la capacité de l’État défendeur à se fonder légitimement sur la gravité des infractions pénales commises par le requérant pour justifier la décision d’expulsion s’est trouvée limitée par ces éléments. De plus, la conduite du requérant pendant la période qui s’est écoulée entre la date des faits dont il a été reconnu coupable et la date de son expulsion est un facteur particulièrement important aux fins de l’appréciation du risque de récidive. À cet égard, la Cour note que même s’il a au départ continué de manifester un comportement agressif, le requérant a fait des progrès au cours des années en question. Elle prend également note de la solidité des liens que le requérant entretenait avec le Danemark et du peu de liens qu’il avait avec la Turquie. Enfin, dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure, elle juge que le caractère définitif de l’interdiction de retour imposée au requérant rend la mesure disproportionnée. Globalement, les autorités internes n’ont ni tenu compte de la situation individuelle du requérant, ni correctement mis en balance les intérêts en jeu. Il y a donc eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée.
Ngumbu Kikoso c. France du 25 novembre 2021 requête no 21643/19
Article 8 : La Cour juge qu’eu égard à la gravité des faits commis, la sanction pénale d’interdiction du territoire français de dix ans prononcée à l’encontre d’un étranger arrivé en France depuis plus de vingt ans n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale
L’affaire concerne une interdiction du territoire français prononcée à titre complémentaire d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de détention et d’usage de faux documents administratifs.
La Cour a considéré que les juridictions internes pouvaient légitimement estimer, en raison du comportement du requérant, de la gravité des faits réprimés (détention et usage de faux documents administratifs) et de la persistance de ses comportements délictueux, qu’une mesure d’interdiction du territoire de dix ans était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. La Cour considère que la mesure litigieuse était proportionnée aux buts poursuivis et ne portait aucune atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en dépit de la durée de son séjour en France.
FAITS
Le requérant, M. Serge Ngumbu Kikoso, est un ressortissant congolais né en 1971 et résidant à Paris.
Le 6 mars 2014, le tribunal correctionnel de Strasbourg condamna M. Ngumbu Kikoso à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits commis en 2013 de détention et d’usage de faux documents administratifs en vue d’un mariage pour permettre à une compatriote d’obtenir un titre de séjour. Le tribunal correctionnel prononça également une peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français.
La cour d’appel de Colmar confirma ce jugement et les peines prononcées. Elle jugea que le requérant avait intentionnellement cherché à tromper et qu’il avait parfaitement conscience de la falsification des documents administratifs qu’il avait présentés en vue de la célébration de son mariage. Elle souligna que l’intéressé avait plusieurs antécédents de condamnation pénale. La cour d’appel retint enfin que le requérant, qui déclarait se trouver sur le territoire français depuis 1995, ne justifiait pas d’une résidence régulière en France de plus de vingt ans et qu’il pouvait donc être condamné en application de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) à une peine complémentaire d’interdiction du territoire.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi dirigé contre cet arrêt. Le 21 mars 2016, M. Ngumbu Kikoso conclut un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’assistant de vie.
En raison de l’interdiction du territoire français, le préfet du Bas Rhin décida, le 31 mars 2016, de ne pas prolonger la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » de M. Ngumbu Kikoso portant autorisation de travail. De ce fait, l’employeur résilia le contrat de travail de l’intéressé.
M. Ngumbu Kikoso exécuta la peine d’emprisonnement de six mois à laquelle il avait été condamné sous le régime de la semi-liberté entre le 31 janvier et le 19 juin 2017.
Le 7 février 2017, alors détenu en semi-liberté, M. Ngumbu Kikoso déposa une requête en relèvement de l’interdiction du territoire français. La cour d’appel de Colmar rejeta sa requête. Le 17
octobre 2018, la Cour de cassation rejeta son pourvoi en cassation.
Le 17 novembre 2019, le préfet d’Indre et Loire prit à l’encontre de M. Ngumbu Kikoso un arrêté de placement en rétention administrative dans le but de l’éloigner vers le pays de destination – le Congo –fixé dans le cadre de la mise à exécution de l’interdiction du territoire de dix ans.
M. Ngumbu Kikoso déposa alors une demande de réexamen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) avait déjà rejeté une première demande d’asile le 20 juillet 2000, ce qu’avait confirmé la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 7 mars 2001.
Le 28 novembre 2019, l’OFPRA, statuant selon la procédure accélérée, rejeta la demande de réexamen comme irrecevable.
Article 8
La Cour note tout d’abord que les juridictions internes ont expressément effectué, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, un contrôle de la proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La cour d’appel a pris en compte la durée du séjour régulier en France du requérant.
La Cour relève ensuite que la mesure prononcée le 6 mars 2014 par le tribunal correctionnel, confirmée par la cour d’appel, se fonde sur les infractions pénales commises par le requérant.
Par ailleurs, la Cour rappelle que pour déterminer si un étranger frappé d’une mesure d’interdiction du territoire possède une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, il convient de se placer à la date à laquelle la mesure litigieuse est devenue définitive, soit, en l’espèce, le 17 octobre 2018.
Ainsi, né en 1971, le requérant affirme être arrivé en France en 1995, et a donc vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, au moins. Il est célibataire et sans enfant. Devant la cour d’appel, il n’a pas apporté de précision quant aux attaches familiales et privées qu’il aurait eues en France.
Au regard de ces circonstances et compte tenu de la balance des différents intérêts en jeu, la Cour conclut que les juridictions internes pouvaient légitimement considérer, en raison du comportement du requérant, de la gravité des faits commis et de la persistance de ses comportements délictueux, qu’une mesure d’interdiction du territoire de dix ans était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.
La Cour conclut que la mesure litigieuse était proportionnée aux buts poursuivis et ne portait aucune atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le grief du requérant, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
CEDH
19. La Cour rappelle que selon un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des étrangers sur leur sol (voir, parmi beaucoup d’autres, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 164, CEDH 2012). La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de l’ordre public, les États contractants ont la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur leur territoire. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir par exemple, Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 46, CEDH 2001‑IX et, Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X).
20. La Cour rappelle que les principes généraux applicables dans les affaires d’expulsion ont été résumés dans les arrêts Udeh c. Suisse (no 12020/09, §§ 44‑45, 16 avril 2013) et Ndidi c. Royaume-Uni (no 41215/14, §§ 75‑76, 14 septembre 2017). Dans le premier de ces arrêts, la Cour a rappelé les critères résumés dans l’affaire Üner c. Pays-Bas ([GC], no 46410/99, §§ 57‑58, CEDH 2006‑XII) devant guider les instances nationales dans de telles affaires :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la nationalité des diverses personnes concernées ;
– la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
– la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
– la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
– la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
– l’intérêt et le bien‑être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
21. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple la nature temporaire ou définitive de l’interdiction de territoire (voir Bousarra c. France, no 25672/07, § 51, 23 septembre 2010, et les références citées).
22. La Cour rappelle que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi. Sa tâche consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, les droits de l’intéressé protégés par la Convention et, d’autre part, les intérêts de la société (Slivenko, précité, § 113, et Boultif, précité, § 47).
23. La Cour rappelle également que les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée, afin notamment de permettre à la Cour d’assurer le contrôle européen qui lui est confié (voir, mutatis mutandis, X c. Lettonie [GC], n 27853/09, § 107, CEDH 2013 et, El Ghatet c. Suisse, no 56971/10, § 47, 8 novembre 2016). Un raisonnement insuffisant des juridictions internes, sans véritable mise en balance des intérêts en présence, est contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention. C’est le cas lorsque les autorités internes ne parviennent pas à démontrer de manière convaincante que l’ingérence dans un droit protégé par la Convention est proportionnée aux buts poursuivis et qu’elle correspond dès lors à un « besoin social impérieux » au sens de la jurisprudence précitée (voir El Ghatet, précité, § 47, et I.M. c. Suisse, no 23887/16, §§ 72 et 77, 9 avril 2019).
24. La Cour note tout d’abord que les juridictions internes saisies d’une requête en relèvement de l’interdiction de territoire de dix ans ont expressément effectué, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, un contrôle de la proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La cour d’appel, dont la solution a été confirmée par la Cour de cassation, a pris en compte la durée, particulièrement longue, du séjour régulier en France du requérant en relevant que celui‑ci avait déclaré être entré sur le territoire français en 1995. A l’instar des juges internes, la Cour considère que cet élément a un poids certain en l’espèce, la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être éloigné constituant un critère d’examen devant guider les instances nationales dans les affaires d’expulsion (Udeh, précité, § 45).
25. La Cour relève ensuite, s’agissant de la gravité des infractions pénales commises par le requérant, que la mesure prononcée le 6 mars 2014 par le tribunal correctionnel, confirmée par la cour d’appel le 5 février 2015 (voir paragraphes 3 et 4 ci‑dessus), se fonde sur les infractions pénales réprimées par le même jugement ainsi que sur les quatre condamnations pénales antérieures pour deux infractions au code de la route, pour des faits d’agression sexuelle ainsi que pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion.
26. Par ailleurs, la Cour rappelle que pour déterminer si un étranger frappé d’une mesure d’interdiction du territoire possède une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, elle se place à la date à laquelle la mesure litigieuse est devenue définitive (Aoulmi c. France, no 50278/99, § 88, CEDH 2006‑I (extraits)), soit en l’espèce à la date du 17 octobre 2018 (voir paragraphe 10 ci‑dessus). La Cour relève tout d’abord que si le requérant, né en 1971, affirme être arrivé en France en 1995, il n’en demeure pas moins qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt‑quatre ans, au moins. Elle note en outre qu’il est célibataire et sans enfant. Enfin, si le requérant a fait valoir devant les juridictions internes que tous ses proches résidaient à Lyon, la Cour constate, d’une part, que la cour d’appel a estimé qu’il n’étayait pas ses allégations et qu’il était hébergé en région parisienne et, d’autre part, qu’il n’apportait pas davantage devant elle de précision quant aux attaches familiales et privées qu’il aurait alors eues en France. En tout état de cause, la Cour rappelle que les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention à moins que ne soit démontrée l’existence d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux (Ezzouhdi c. France, no 47160/99, 13 février 2001, § 34, Aoulmi, précité, § 87 et, Slivenko c. Lettonie [GC], précité, § 97).
27. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et compte tenu de la balance entre les différents intérêts en jeu opérée par les juridictions internes par des décisions dûment motivées, la Cour conclut qu’elles pouvaient légitimement considérer, en raison du comportement du requérant, de la gravité des faits commis et de la persistance de ses comportements délictueux qu’une mesure d’interdiction du territoire de dix ans était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle ne voit dès lors aucune raison de se séparer de la conclusion à laquelle elles sont parvenues, à savoir que la mesure litigieuse était proportionnée aux buts poursuivis (Benamar c. France (déc.), no 42216/98, 14 novembre 2000 et, Aoulmi, précité) et ne portait aucune atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
28. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Melouli c. France du 25 novembre 2021 requête n o 42011/19
Art 8 : L’affaire concerne un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, opposé à un ressortissant algérien. La Cour relève tout d’abord que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont expressément effectué, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée par les mesures litigieuses au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La Cour constate ensuite que le requérant n’a pas été à même d’établir devant les juridictions internes qu’il aurait vécu de façon habituelle en France depuis 2007, qu’il n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas demandé le renouvellement de son certificat de résidence dont il avait été titulaire dix ans avant sa nouvelle demande de titre de séjour, ni démontré l’existence de liens de dépendance avec ses proches résidant en France, qui auraient nécessité sa présence auprès d’eux. Eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu et compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales en la matière, la Cour estime que l’arrêté préfectoral litigieux, rejetant la demande du requérant d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
FAITS
Le requérant, M. Farouk Melouli, est un ressortissant algérien né en 1968 et résidant à Wittenheim. M. Melouli arriva en France au titre du regroupement familial en 1977, soit à l’âge de 9 ans. Le 23 novembre 2016, M. Melouli fut placé sous contrôle judiciaire pour des faits de viol commis en 2006. Le 13 avril 2017, le préfet du Haut Rhin prit un arrêté rejetant sa demande d’admission au séjour, portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l’Algérie comme pays de destination. Le tribunal administratif de Strasbourg rejeta le recours en annulation de M. Melouli dirigé contre l’arrêté du 13 avril 2017. La cour administrative d’appel de Nancy confirma le jugement. Le 30 avril 2019, le Conseil d’État décida de ne pas admettre le pourvoi en cassation du requérant.
ARTICLE 8
La présente affaire se distingue de celles qui concernent des « immigrés établis », au sens de la jurisprudence de la Cour, c’est-à-dire des personnes auxquelles il a déjà été accordé officiellement un droit de séjour dans le pays d’accueil et qui y résident régulièrement. La situation d’un immigré « établi » et celle d’un étranger sollicitant l’admission au séjour sur le territoire national étant, en fait et en droit, différentes, les critères que la Cour a élaborés au fil de sa jurisprudence pour apprécier si le retrait du permis de séjour d’un immigré établi est compatible avec l’article 8 ne peuvent être transposés automatiquement à la situation du requérant alors même qu’il avait auparavant résidé régulièrement sous couvert de certificats de résidence. En effet si le requérant a sollicité, à plusieurs reprises, un titre de séjour, ce ne fut que dix ans après l’expiration de son dernier certificat de résidence. La Cour doit donc déterminer si les autorités françaises étaient ou non tenues, en vertu de l’article 8, d’octroyer au requérant un certificat de résidence afin de lui permettre de mener sa vie privée et familiale en France. La Cour rappelle que les rapports entre des parents et des enfants adultes ou entre des frères et sœurs adultes ne bénéficient pas de la protection de l’article 8 de la Convention sous le volet de la « vie familiale » à moins que ne soit démontrée l’existence d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux. Ces liens peuvent cependant être pris en considération sous le volet de la « vie privée », selon l’article 8 de la Convention. S’agissant du cas d’espèce, la Cour relève tout d’abord que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont expressément effectué, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La Cour observe que, devant les juridictions internes, le requérant n’a pas été à même d’établir qu’il aurait vécu de façon habituelle en France depuis 2007. Il n’a pas non plus expliqué pour quelles raisons il n’avait pas demandé, dès 2004, un duplicata du certificat de résidence valable jusqu’en 2007, ni n’avait sollicité son renouvellement à cette date. Il n’a pas été en mesure de démontrer l’existence de liens de dépendance avec ses proches résidant en France, tels qu’ils impliqueraient nécessairement sa présence auprès d’eux. En outre, célibataire et sans enfant, le requérant ne justifie d’aucune insertion dans la société française.
Eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu dans la présente affaire, la Cour estime que l’arrêté litigieux du préfet du Haut Rhin rejetant sa demande d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Le grief du requérant, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
CEDH
14. La Cour rappelle tout d’abord que, suivant un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur leur sol. Elle rappelle ensuite que la Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier. Le corollaire du droit pour les États de contrôler l’immigration est que les étrangers ont l’obligation de se soumettre aux contrôles et aux procédures d’immigration et de quitter le territoire de l’État contractant concerné lorsqu’ils en reçoivent l’ordre si l’entrée ou le séjour sur ce territoire leur sont valablement refusés (Jeunesse c. Pays‑Bas [GC], no 12738/10, § 100, 3 octobre 2014).
15. La présente affaire se distingue de celles qui concernent des « immigrés établis » au sens de la jurisprudence de la Cour, à savoir des personnes auxquelles il a déjà été accordé officiellement un droit de séjour dans le pays d’accueil et qui y résident régulièrement. Le non renouvellement ou le retrait ultérieur de ce droit, par exemple parce que la personne concernée a été reconnue coupable d’une infraction pénale, constitue une ingérence dans l’exercice par celle-ci de son droit au respect de sa vie privée et/ou familiale au sens de l’article 8 de la Convention. En pareil cas, la Cour recherche si cette ingérence est justifiée au regard du paragraphe 2 de cet article. Elle tient compte pour ce faire des différents critères se dégageant dans sa jurisprudence pour déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les motifs fondant la décision des autorités de retirer le droit de séjour, d’une part, et les droits que l’article 8 garantit à l’individu concerné, d’autre part (Jeunesse c. Pays‑Bas [GC], précité, § 104).
16. La situation d’un immigré « établi » et celle d’un étranger sollicitant l’admission au séjour sur le territoire national étant, en fait et en droit, différentes, les critères que la Cour a élaborés au fil de sa jurisprudence pour apprécier si le retrait du permis de séjour d’un immigré établi est compatible avec l’article 8 ne peuvent être transposés automatiquement à la situation du requérant alors même qu’il avait auparavant résidé régulièrement sous couvert de certificats de résidence. En effet ce n’est que dix ans après l’expiration de son dernier certificat de résidence qu’il a sollicité, à plusieurs reprises, un titre de séjour, peu importe à cet égard qu’il allègue avoir toujours résidé sur le territoire français. Ainsi, la question à examiner, dans la présente affaire, est celle de déterminer si, eu égard aux circonstances de l’espèce considérées dans leur ensemble, les autorités françaises étaient ou non tenues, en vertu de l’article 8, d’octroyer au requérant un certificat de résidence afin de lui permettre de mener sa vie privée et familiale en France. Pour cette raison, elle doit être examinée sous l’angle d’un non‑respect par l’État défendeur d’une obligation positive lui incombant en vertu de l’article 8 de la Convention (Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, § 63, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI et, Jeunesse c. Pays‑Bas [GC], précité, § 105). Par conséquent, la Cour tiendra compte des principes rappelés notamment dans l’affaire Butt c. Norvège (no 47017/09, § 78, 4 décembre 2012, et autres références citées).
17. La Cour rappelle que les rapports entre des parents et enfants adultes ou entre frères et sœurs adultes ne bénéficient pas de la protection de l’article 8 de la Convention sous le volet de la « vie familiale » à moins que ne soit démontrée l’existence d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 97, CEDH 2003‑X, A.S. c. Suisse, no 39350/13, § 49, 30 juin 2015 et, Levakovic c. Danemark, no 7841/14, §§ 35 et 44, 23 octobre 2018). Elle considère, en tout état de cause, que les liens entre adultes et parents ou autres proches peuvent être pris en considération sous le volet de la « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention (Slivenko [GC], précité, § 97).
18. S’agissant du cas d’espèce, la Cour relève tout d’abord que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel saisis d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 13 avril 2017 ont expressément effectué, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
19. La Cour constate ensuite que devant elle, pas davantage que devant les juridictions internes, le requérant n’a été à même d’établir qu’il aurait vécu de façon habituelle en France depuis 2007. Il n’a pas non plus expliqué pour quelles raisons il n’avait pas demandé, dès 2004, un duplicata du certificat de résidence valable jusqu’en 2007 (voir paragraphe 3 ci‑dessus) ni sollicité son renouvellement à cette date (voir paragraphe 3 ci‑dessus). De même, il n’a pas été en mesure de démontrer, au moyen d’éléments concrets et convaincants, l’existence de liens de dépendance avec ses proches résidant en France tels qu’ils impliqueraient nécessairement sa présence auprès d’eux. En outre, ainsi que l’ont relevé les juges internes, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Enfin, il n’allègue pas que les membres de sa famille ne pourraient pas lui rendre visite en Algérie ni qu’il serait dépourvu d’attaches sociales et culturelles dans son pays d’origine.
20. Dans ces conditions, et eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu dans la présente affaire, la Cour estime que l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
21. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
M.M. c. SUISSE du 8 décembre 2020 Requête no 59006/18
Art 8 • Vie privée • Raisons solides justifiant l’expulsion pour cinq ans, d’un adulte étranger né en Suisse, suite à sa condamnation pénale, en application d’une loi prévoyant l’expulsion obligatoire • Loi n’introduisant pas un automatisme d’expulsion des étrangers criminels condamnés sans contrôle judiciaire de la proportionnalité de la mesure • Application a priori conforme à la Convention au regard de l’interprétation de la loi par le Tribunal fédéral • Condamnation relativement légère du requérant à une peine de douze mois avec un sursis de trois ans • Graves infractions sexuelles sur mineure non isolées et mépris certain pour l’ordre juridique suisse • Risque de récidive • Pas de perspectives de réinsertion sociale et de volonté d’intégration en Suisse • Existence de liens avec l’Espagne pays de destination • Examen sérieux des juridictions internes de la situation personnelle du requérant et des différents intérêts en jeu.
CEDH
a) Sur l’existence d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit protégé par l’article 8
42. Tout d’abord, la Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres et avec références, N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 167, 13 février 2020).
43. La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de l’ordre public, les États contractants ont la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur leur territoire (De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 77, CEDH 2012). Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir, par exemple, Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 46, CEDH 2001‑IX, et Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X).
44. En outre, la Cour rappelle que c’est en fonction des circonstances de l’affaire portée devant elle qu’elle décidera s’il convient de mettre l’accent sur l’aspect « vie familiale » plutôt que sur l’aspect « vie privée » (Üner, précité, § 59).
45. En l’espèce, la Cour note que l’existence d’une ingérence n’est pas contestée. Elle observe que le requérant, adulte de quarante ans et sans enfants, se prévaut en premier lieu de son intégration dans le pays hôte. Par conséquent, elle est d’avis que sa situation relève de la vie « privée » (I.M. c. Suisse, no 23887/16, § 60, 9 avril 2019, et Hasanbasic c. Suisse, no 52166/09, § 49, 11 juin 2013).
b) Sur la justification de l’ingérence
46. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
« Prévue par la loi »
47. Il n’est pas contesté que l’expulsion pénale du requérant et son interdiction du territoire suisse pour une durée de cinq ans étaient prévues par le code pénal (paragraphe 21 ci-dessus).
But légitime
48. Eu égard aux multiples infractions pénales qu’il avait précédemment commises et qui lui avaient valu quatre condamnations, le requérant ne saurait par ailleurs nier que l’ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir notamment « la défense de l’ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
Nécessité de la mesure dans une société démocratique
Principes généraux
49. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, dans les cas où la personne censée être expulsée est un adulte sans enfants qui se prévaut en premier lieu de son intégration dans le pays hôte (Üner, précité, §§ 54-55 et §§ 57-58, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, §§ 68-76, CEDH 2008, Emre c. Suisse, no 42034/04, §§ 65-71, 22 mai 2008, et Saber et Boughassal c. Espagne, nos 76550/13 et 45938/14, § 40, 18 décembre 2018), il convient de prendre en compte les critères suivants :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé́ depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ; et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
50. L’âge de la personne concernée peut jouer un rôle dans l’application de certains des critères susmentionnés. Par exemple, pour apprécier la nature et la gravité de l’infraction dont le requérant s’est rendu coupable, il y a lieu d’examiner s’il l’a commise alors qu’il était adolescent ou à l’âge adulte (Maslov, précité, § 72, et Saber et Boughassal, précité, § 41).
51. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme les éléments d’ordre médical (Veljkovic-Jukic c. Suisse, no 59534/14, § 45, 21 juillet 2020, K.A. c. Suisse, no 62130/15, § 41, 7 juillet 2020, et Shala c. Suisse, no 52873/09, § 46, 15 novembre 2012).
52. La Cour rappelle également que, dans des affaires récentes concernant la conformité à l’article 8 de l’éloignement d’« immigrés établis », elle a dit que lorsque les juridictions internes ont soigneusement examiné les faits et appliqué la jurisprudence des organes de la Convention et qu’elles ont dûment mis en balance l’intérêt particulier du requérant et l’intérêt public de la collectivité, il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation du fond de l’affaire à celle des autorités nationales compétentes (notamment en ce qui concerne les éléments factuels de la proportionnalité), à moins qu’il n’y ait de bonnes raisons de le faire (Ndidi c. Royaume-Uni, no 41215/14, § 76, 14 septembre 2017, Saber et Boughassal, précité, § 41, et Hamesevic c. Danemark (déc.), no 25748/15, §§ 31-46, 16 mai 2017). Dans les cas où un immigré a passé l’intégralité de sa vie dans le pays d’accueil, il y a lieu d’avancer des raisons très solides pour justifier l’expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l’origine de la mesure d’expulsion pendant son adolescence (Maslov, précité, § 75, et Saber et Boughassal, précité, § 41). L’appréciation des faits pertinents doit être « acceptable » (Saber et Boughassal, précité, § 41).
53. En revanche, si les juridictions internes n’ont pas dûment motivé leur décision et n’ont examiné la proportionnalité de la mesure d’éloignement que de manière superficielle, faisant ainsi obstacle à l’exercice par la Cour de son rôle subsidiaire, la mise à exécution de la mesure emporte violation de l’article 8 (I.M c. Suisse, précité, § 78). Il en va de même lorsque les juridictions internes n’ont pas tenu compte de tous les faits pertinents (Makdoudi c. Belgique, no 12848/15, § 97, 18 février 2020).
Application au cas d’espèce des principes susmentionnés
54. À titre liminaire, la Cour note que, dans le domaine des expulsions d’étrangers criminels, l’article 66a du code pénal, qui est la concrétisation du résultat d’une votation populaire (paragraphe 19 ci-dessus), n’introduit pas, malgré son intitulé (« expulsion obligatoire »), un automatisme d’expulsion des étrangers criminels condamnés pour des infractions sans contrôle judiciaire de la proportionnalité de la mesure. Cela serait incompatible avec l’article 8 de la Convention. Elle observe également que l’interprétation donnée par le Tribunal fédéral à la clause de rigueur contenue au deuxième alinéa de l’article 66a du code pénal (paragraphe 21 ci-dessus) permet a priori une application conforme à la Convention. Elle constate par ailleurs qu’en vertu de la deuxième phrase de la clause de rigueur, le juge doit tenir compte, en procédant à la pesée des intérêts, de « la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse ». Il s’ensuit qu’en la matière l’analyse doit se faire au cas par cas selon les critères établis par la Cour.
55. Pour ce qui est de la gravité des infractions commises par le requérant, la Cour observe d’emblée que les infractions dont le requérant, né en 1980, s’est rendu coupable en 2018, n’ont évidemment pas été commises alors qu’il était adolescent.
56. Elle note également que la peine prononcée (douze mois avec un sursis de trois ans) est relativement légère. Elle est cependant plus élevée, par exemple, que celle (cinq mois et demi au total, assortie d’un sursis) qui avait été prononcée dans l’affaire Shala, précitée, § 50. Dans cette dernière affaire, la Cour avait estimé que, malgré la relative faiblesse de la peine prononcée, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans n’avait pas emporté violation de l’article 8 de la Convention (ibidem, § 57). La Cour observe qu’en l’espèce est en jeu l’expulsion du requérant du territoire suisse pour une durée de cinq ans seulement, qui représente la sanction minimale prévue par l’article 66a du code pénal (paragraphe 21 ci-dessus).
57. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a passé l’intégralité de sa vie en Suisse. Elle doit donc s’assurer que les tribunaux internes ont avancé des raisons très solides pour justifier l’expulsion (paragraphe 52 ci‑dessus).
58. À cet égard, la Cour note que le Tribunal fédéral a pris en considération le fait que les infractions en question étaient graves, que le requérant avait porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, à savoir l’intégrité sexuelle d’une mineure, et qu’il s’était ainsi attaqué de manière très grave à la sécurité et à l’ordre public en Suisse. Le Tribunal fédéral a également considéré que le requérant avait manifesté un mépris certain pour l’ordre juridique suisse, relevant qu’il avait été par le passé condamné à trois reprises. La Cour observe par ailleurs que les juges fédéraux ont également évalué le risque de récidive en tenant compte de l’intérêt du requérant pour les filles prépubères, qui ressortait notamment des nombreuses photographies de jeunes filles âgées de dix à douze ans trouvées sur son téléphone, ainsi que des recherches à caractère pédophile effectuées avec cet appareil.
59. En outre, la Cour observe que le tribunal de police a retenu contre le requérant un degré élevé de culpabilité et qu’il a renoncé à diminuer la responsabilité pénale de celui-ci à raison de sa consommation d’alcool et de stupéfiants le jour des faits (paragraphe 4 ci-dessus). Elle note également que l’intéressé n’est pas parvenu à expliquer les faits commis à l’égard de l’enfant autrement que par sa consommation de stupéfiants et d’alcool (paragraphe 6 ci-dessus). De même, elle constate que selon l’appréciation livrée par les autorités internes le requérant ne semblait pas avoir une réelle volonté d’identifier les mécanismes qui l’avaient conduit à agir de la sorte et ne semblait avoir mis aucune stratégie en place pour gérer les situations à risque (ibidem).
60. La Cour constate que le requérant s’est rendu coupable à deux reprises d’actes à caractère sexuel au préjudice d’une mineure. Partant, contrairement à ce qu’il soutient, on ne saurait parler en l’occurrence d’un « acte isolé ». Il est vrai que ses autres antécédents judiciaires n’ont aucun rapport avec la pédophilie et ne constituent pas des infractions graves, ce que le Tribunal fédéral a également précisé dans son arrêt. Il a toutefois relevé, à juste titre, que les antécédents du requérant révélaient un certain mépris de l’ordre juridique suisse. Enfin, dans la mesure où le requérant plaidait qu’il n’y avait aucun risque de récidive, expliquant qu’il n’avait jamais été prouvé que les photos trouvées sur son téléphone eussent été téléchargées par lui et que cet élément n’avait pas été retenu comme constituant une infraction, il déclara ne pouvoir souscrire à son argumentation. La Cour observe également que le requérant n’a nullement remis en cause ces constatations devant les juridictions nationales et qu’il n’a jamais apporté d’éléments de nature à les remettre en cause.
61. En ce qui concerne le laps de temps écoulé depuis l’infraction et la conduite du requérant pendant cette période, la Cour observe que le Tribunal fédéral a constaté dans son arrêt que le requérant se conduisait plutôt bien depuis la commission des infractions. Il a relevé que le rapport établi le 27 avril 2018 par l’Office d’exécution des peines révélait que l’intéressé respectait les entretiens fixés, qu’il s’investissait dans son activité occupationnelle, qu’il se présentait régulièrement au centre de prévention et qu’il semblait bénéficier d’un cadre adéquat qui lui permettait d’évoluer positivement, même s’il devait encore consentir des efforts.
62. Tout en prenant ces éléments en compte, la Cour note que le Tribunal fédéral a cependant constaté que les perspectives de réinsertion sociale du requérant semblaient plutôt sombres et que l’on ne pouvait voir dans l’activité occupationnelle de l’intéressé ou le suivi entrepris par lui auprès du centre de prévention une quelconque volonté d’intégration en Suisse.
63. Devant la Cour, le requérant réitère, en substance, les éléments déjà soumis par lui aux juridictions cantonales et pris en considération par elles. Il ne fait pas valoir en revanche d’éléments qui auraient été omis par les juridictions nationales ou qui auraient été de nature à modifier leurs conclusions.
64. Quant à la situation familiale du requérant, la Cour observe que celui-ci ne remet pas en question les constatations des juridictions nationales : il est majeur (né en 1980), célibataire, n’a pas d’enfants et vit seul. Son père est décédé. Sa mère vit en Suisse, mais il n’a pas de relations avec elle ni avec d’autres membres de sa famille.
65. De même, la Cour note que le Tribunal fédéral a constaté que le requérant ne pouvait se prévaloir de liens sociaux, culturels, familiaux ou professionnels particuliers. Il a observé que les perspectives de réinsertion sociale du requérant semblaient plutôt sombres dès lors que l’intéressé, alors âgé de trente-huit ans, n’avait jamais exercé d’activité professionnelle et ne disposait d’aucune formation. La cour suprême suisse a d’ailleurs constaté qu’elle voyait mal comment l’activité de serveur exercée par le requérant dans le cadre de l’assistance de probation ou la formation en « permaculture » suivie par lui durant six mois auraient pu déboucher sur une véritable insertion professionnelle. La Cour observe à cet égard que les juges fédéraux ont retenu que l’activité occupationnelle ou le suivi entrepris auprès du centre de prévention ne pouvaient passer pour dénoter une quelconque volonté d’intégration en Suisse.
66. Devant la Cour, le requérant n’apporte aucun élément qui aurait été omis par les juridictions nationales ou qui aurait été de nature à modifier leurs conclusions. Il se contente seulement d’affirmer qu’il a de solides liens sociaux en Suisse, sans toutefois étayer au moins en substance ses allégations. La Cour estime donc que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations formulées par les juridictions nationales.
67. Pour ce qui est de la solidité des liens du requérant avec l’Espagne, la Cour relève que les juridictions suisses ont constaté que l’intéressé avait une certaine connaissance de la langue espagnole et qu’il avait dans ce pays de la famille éloignée (paragraphe 4 ci-dessus). De l’avis de la Cour, ces constatations relativisent considérablement les allégations du requérant (paragraphe 36 ci-dessus).
68. En ce qui concerne enfin les circonstances particulières de l’affaire, la Cour note que le requérant n’a jamais évoqué devant les juridictions internes des éléments d’ordre médical (Veljkovic-Jukic, précité, § 45, K.A. c. Suisse, précité, § 41, et Shala, précité, § 46) qui auraient pu faire obstacle à son éloignement du territoire suisse.
69. En résumé, la Cour reconnaît que les juridictions cantonales et le Tribunal fédéral ont effectué un examen sérieux de la situation personnelle du requérant et des différents intérêts en jeu. Elles disposaient donc d’arguments très solides (paragraphe 57 ci-dessus) pour justifier l’expulsion du requérant du territoire Suisse pour une durée limitée. Par conséquent, la Cour conclut que l’ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi et ainsi nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
70. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Veljkovic-Jukic c. Suisse du 21 juillet 2020 requête n° 59534/14
Non violation Article 8 : jésuitisme de la CEDH : La révocation de l’autorisation d’établissement en Suisse d’une Croate condamnée pour trafic de stupéfiants ne viole pas la Convention, mais la CEDH pense qu'il est souhaitable que la personne puisse à nouveau avoir une carte de séjour, si elle en fait la demande.
L’affaire concerne la révocation de l’autorisation d’établissement d’une ressortissante croate résidant en Suisse (depuis l’âge de 14 ans) en raison de sa condamnation pour infraction à la loi sur les stupéfiants et son possible renvoi de la Suisse. La Cour juge que la Suisse n’a pas dépassé la marge d’appréciation dont elle jouissait, eu égard en particulier à la gravité de la condamnation pour infraction en matière de stupéfiants ainsi qu’au fait que la requérante et les membres de sa famille pourraient s’intégrer sans difficultés majeures dans l’un des pays de destination évoqués par le Tribunal fédéral : la Bosnie-Herzégovine, la Croatie ou la Serbie. La Cour note aussi que la requérante s’est vu interdire l’entrée sur le territoire suisse pour une durée de sept ans (jusqu’au 30 août 2021) et que la loi fédérale sur les étrangers lui permet de demander une suspension provisoire de la décision d’interdiction d’entrée afin qu’elle puisse rendre visite à ses proches en Suisse. La Cour estime toutefois souhaitable que les autorités nationales réévaluent la situation de la requérante à la lumière des développements apparus depuis l’arrêt du Tribunal fédéral avant de décider de mettre les mesures à exécution, compte tenu notamment de son comportement depuis sa remise en liberté et de la possibilité dont elle dispose de soumettre une nouvelle demande d’autorisation de séjour.
Art 8 • Vie privée et familiale • Révocation d’une autorisation d’établissement en Suisse d’une mère de famille suite à une peine privative de liberté pour infraction en matière de stupéfiants et interdiction temporaire d’entrée sur le territoire • Dix-neuf ans de séjour et bonne intégration en Suisse • Vie familiale effective de la requérante avec son mari et ses trois enfants • Comportement irréprochable depuis sa remise en liberté • Tribunal fédéral ayant accordé une grande importance à la gravité de l’infraction mais ayant également pris en compte le jeune âge de la requérante, son enfance et la partie de sa jeunesse passées en Bosnie-Herzégovine, la possibilité d’intégration de sa famille dans l’un des pays de destination possibles • Examen suffisant et convaincant des éléments pertinents et mise en balance circonstanciée des intérêts en cause • Interdiction d’entrée sur le territoire suisse pour une durée limitée de sept ans et possible demande de suspension provisoire de la décision pour rendre visite aux proches • Marge d’appréciation des autorités nationales non dépassée • Mesures non mises à exécution • Souhait de la Cour européenne d’une réévaluation par les autorités nationales de la situation de la requérante avant de décider de mettre ces mesures à exécution.
FAITS
La requérante, Renata Veljkovic-Jukic, est une ressortissante croate née en 1980. Elle réside à Gerlafingen, en Suisse, avec son époux de nationalité serbe et leurs trois enfants (nés en 2007, 2008 et 2012). Mme Veljkovic-Jukic et son mari obtinrent chacun une autorisation d’établissement en Suisse respectivement à l’âge de 14 ans (en 1995) et de huit ans (en 1991). En juin 2012, le tribunal supérieur du canton de Zurich, statuant en appel, condamna Mme Veljkovic-Jukic à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont 30 mois avec sursis, pour infraction à la loi sur les stupéfiants et pour conduite d’un véhicule en état d’incapacité. Il lui fut reproché en particulier de s’être rendue coupable, en avril 2010, du trafic d’environ 1 kg d’héroïne et de 56 g de cocaïne, en contrepartie d’une somme de 126 000 francs suisses (CHF) dont 6 000 CHF lui reviendraient, et d’avoir conduit un véhicule après avoir consommé de la cocaïne. L’intéressée purgea sa peine en régime de semi-détention et fut libérée en juillet 2013.
En septembre 2013, invoquant la condamnation de Mme Veljkovic-Jukic à une peine privative de longue durée, l’Office des migrations du canton de Soleure révoqua son autorisation d’établissement et prononça son renvoi de Suisse. L’intéressée fit un recours contre cette décision, mais celui-ci fut rejeté en première instance et en appel. Le Tribunal fédéral estima notamment que l’intérêt en matière de politique de sécurité à l’éloignement de la requérante primait sur ses intérêts privés, et que ce motif était également valable pour les personnes qui, comme la requérante, avaient séjourné en Suisse depuis plus de 15 ans sans interruption et de manière légale. Il jugea aussi que le retour de la requérante en Bosnie-Herzégovine (où elle avait passé 14 années durant son enfance) ou en Serbie ou en Croatie ne paraissait pas inexigible. Il estima en outre que son mari et ses enfants pourraient la suivre ou que, si la famille devait rester en Suisse, des contacts pourraient être maintenus par des visites et l’usage de moyens de communication à disposition. Par ailleurs, il indiqua que la requérante avait également la possibilité de demander une nouvelle autorisation de séjour.
En août 2014, l’Office des migrations du canton de Soleure prononça à l’encontre de Mme Veljkovic-Jukic une interdiction de territoire allant du 31 août 2014 au 30 août 2021. La mesure de renvoi de la requérante n’a toutefois pas été exécutée, dans l’attente de l’issue de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
La Cour estime que la décision de révocation de l’autorisation de l’établissement et de son renvoi de Mme Veljkovic-Jukic de Suisse constitue une ingérence dans le droit au respect de la « vie privée » et « familiale » de l’intéressée, en raison de la très longue durée de son séjour en Suisse et du fait qu’elle y vit avec son mari et ses enfants. L’ingérence était prévue par la loi fédérale sur les étrangers et poursuivait un but légitime : la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. En ce qui concerne la nécessité de la mesure dans une société démocratique, la Cour note ce qui suit. La mesure est intervenue à la suite de la condamnation de Mme Veljkovic-Jukic pour trafic de stupéfiants. La Cour estime que cette condamnation pèse lourdement ; en effet, eu égard aux ravages de la drogue dans la population, la Cour a toujours conçu que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’encontre de ceux qui contribuent activement à la propagation de ce fléau.
À la date de l’adoption de l’arrêt du Tribunal fédéral, Mme Veljkovic-Jukic vivait en Suisse depuis 19 ans et son comportement, après avoir été remise en liberté, était irréprochable. Cette évolution positive, notamment le fait qu’elle a été remise en liberté conditionnelle après avoir purgée une partie de sa peine, peut être prise en compte dans la pesée des intérêts en jeu. Concernant ses liens avec son pays d’origine, Mme Veljkovic-Jukic a passé une partie de sa jeunesse en Bosnie-Herzégovine où réside encore sa mère. Son mari, qui vit en Suisse depuis 1991, a la nationalité serbe. L’intégration de la famille dans l’un des pays de destinations possibles, la BosnieHerzégovine, la Croatie ou la Serbie, même si elle est difficile, ne paraît donc pas impossible. Les enfants (7, 11 et 13 ans) sont encore à un âge où ils peuvent s’adapter à un nouvel environnement. Les autorités internes ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents, en pesant les intérêts personnels de Mme Veljkovic-Jukic et les intérêts plus généraux de la société. Le Tribunal fédéral a certes accordé une grande importance à la gravité de l’infraction à la loi sur les stupéfiants commise par Mme Veljkovic-Jukic, mais il a également pris en compte les critères énoncés par la Cour dans son arrêt Üner2 , dont notamment la situation personnelle de Mme Veljkovic-Jukic, son degré d’intégration en Suisse ainsi que les difficultés que celle-ci et sa famille pourraient rencontrer en cas de retour dans leur pays d’origine. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis que le renvoi de Mme Veljkovic-Jukic après 18 années passées en Suisse constituait une mesure d’une grande dureté, qui était cependant à nuancer compte tenu de son jeune âge et du fait qu’elle était arrivée en Suisse à l’âge de 15 ans après avoir passé toute son enfance et une partie de sa jeunesse en Bosnie-Herzégovine. Un retour vers la Bosnie-Herzégovine, la Croatie ou la Serbie ne serait dès lors pas impossible. Le Tribunal fédéral s’est aussi penché sur la situation des enfants, considérant qu’une séparation avec leur mère constituerait une ingérence importante dans leur vie familiale. Cependant, il a estimé que le mari de Mme Veljkovic-Jukic, de nationalité serbe, pouvait la suivre dans son pays d’origine, et que l’intégration des enfants ne devait pas poser de problème, étant donné qu’ils étaient encore à un âge où ils pouvaient s’adapter. La Cour est dès lors satisfaite que les autorités internes, en particulier le Tribunal fédéral, ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents et à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause. Par ailleurs, elle note que Mme Veljkovic-Jukic s’est vu interdire l’entrée sur le territoire suisse pour une durée de sept ans (jusqu’au 30 août 2021), et que la loi fédérale sur les étrangers lui permet de demander une suspension provisoire de la décision d’interdiction d’entrée afin qu’elle puisse rendre visite à ses proches en Suisse. Par conséquent, eu égard en particulier à la gravité de la condamnation pour infraction en matière de stupéfiants prononcée à l’encontre de Mme Veljkovic-Jukic, ainsi qu’au fait qu’elle-même et les membres de sa famille pourraient s’intégrer sans difficultés majeures dans l’un des pays de destination évoqués par le Tribunal fédéral (la Bosnie-Herzégovine, la Croatie ou la Serbie), la Cour estime que l’État suisse n’a pas dépassé la marge d’appréciation dont il jouissait.
Il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
La Cour estime toutefois souhaitable que les autorités nationales réévaluent la situation de Mme Veljkovic-Jukic à la lumière des développements apparus depuis l’arrêt du Tribunal fédéral avant de décider de mettre les mesures à exécution, eu égard notamment à son comportement au cours de la procédure ainsi qu’à la possibilité dont elle dispose de soumettre une nouvelle demande d’autorisation de séjour (article 43 de la loi fédérale sur les étrangers).
CEDH
a) Ingérence dans le droit protégé par l’article 8
35. La Cour relève que par une décision du 20 septembre 2013, l’Office des migrations du canton de Soleure a révoqué l’autorisation d’établissement de la requérante et prononcé son renvoi de Suisse. Or cette décision est toujours exécutoire.
36. La Cour estime que, en raison de la très longue durée de séjour de la requérante en Suisse, la décision de renvoi constitue une ingérence dans son droit au respect de sa « vie privée » (voir, mutatis mutandis, Gezginci c. Suisse, no 16327/05, § 57, 9 décembre 2010, et I.M. c. Suisse, no 23887/16, § 60, 9 avril 2019).
37. De plus, la requérante a épousé son second mari avec lequel elle vivait depuis 2006 le 14 décembre 2012 et le couple a eu trois enfants, nés respectivement en 2007, 2008 et 2012. L’existence d’une « vie familiale » effective ne fait donc aucun doute.
38. Dès lors, la requérante peut également se prévaloir d’être victime d’une ingérence du droit au respect de sa « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention.
b) Justification de l’ingérence
39. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire dans une société démocratique ».
« Prévue par la loi »
40. Il n’est pas contesté que la révocation de l’autorisation d’établissement de la requérante était fondée sur les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur les étrangers (paragraphe 18 ci-dessus).
But légitime
41. Il n’est pas davantage controversé que l’ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir notamment « la défense de l’ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
Nécessité de la mesure dans une société démocratique
42. Il reste donc à examiner si la mesure était « nécessaire dans une société démocratique ».
Principes généraux
43. La Cour rappelle que selon un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des étrangers sur leur sol (voir, parmi beaucoup d’autres, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 164, CEDH 2012). La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de l’ordre public, les États contractants ont la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur leur territoire. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir, par exemple, Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 46, CEDH 2001‑IX, et Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X).
44. Dans l’affaire Üner (précitée, §§ 54-60), la Cour a eu l’occasion de résumer les critères devant guider les instances nationales dans de telles affaires :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la nationalité des diverses personnes concernées ;
– la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
– la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
– la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
– la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
– l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
45. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical ou la nature temporaire ou définitive de l’interdiction de territoire (Shala c. Suisse, no 52873/09, § 46, 15 novembre 2012, et les références citées).
46. La Cour rappelle que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi. Sa tâche consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, les droits de l’intéressé protégés par la Convention et, d’autre part, les intérêts de la société (Slivenko, précité, § 113, et Boultif, précité, § 47).
47. La Cour rappelle également que les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée, afin notamment de permettre à la Cour d’assurer le contrôle européen qui lui est confié (voir, mutatis mutandis, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 107, CEDH 2013, et El Ghatet c. Suisse, no 56971/10, § 47, 8 novembre 2016). Un raisonnement insuffisant des juridictions internes, sans véritable mise en balance des intérêts en présence, est contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention. C’est le cas lorsque les autorités internes ne parviennent pas à démontrer de manière convaincante que l’ingérence dans un droit protégé par la Convention est proportionnée aux buts poursuivis et qu’elle correspond dès lors à un « besoin social impérieux » au sens de la jurisprudence précitée (El Ghatet, précité, § 47, et I.M. c. Suisse, précité, §§ 72 et 77).
Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
48. En l’espèce, la décision du 20 septembre 2013 de l’Office fédéral des migrations du canton de Soleure de révoquer l’autorisation d’établissement de la requérante est intervenue suite à sa condamnation à une peine privative de liberté de longue durée (trente-six mois d’emprisonnement, dont six mois ferme, pour avoir transporté 1 kilo d’héroïne) par le tribunal supérieur du canton de Zurich du 20 juin 2012.
49. Or la Cour estime que cette condamnation pèse lourdement. S’agissant d’une infraction en matière de stupéfiants, eu égard aux ravages de la drogue dans la population, la Cour a en effet toujours conçu que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation de ce fléau (voir, par exemple, Baghli c. France, no 34374/97, § 48, CEDH 1999-VIII, et Kissiwa Koffic, précité, § 65).
50. Il est vrai qu’à la date de l’adoption de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2014, la requérante vivait en Suisse depuis dix-neuf ans et que le comportement dont elle a fait preuve après avoir été remise en liberté était irréprochable. Or cette évolution positive, notamment le fait qu’elle a été remise en liberté conditionnelle après avoir purgée une partie de sa peine, peut être prise en compte dans la pesée des intérêts en jeu (voir notamment Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, §§ 87 et suiv., CEDH 2008, Emre c. Suisse (no 2), no 5056/10, § 74, 11 octobre 2011, et Udeh, précité, § 49).
51. De plus, à l’époque des faits la requérante s’était bien intégrée en Suisse, avait un travail régulier et maîtrisait l’allemand ; elle n’avait également jamais bénéficié de prestations d’aide sociale dans son canton de domicile (voir, a contrario, Hasanbasic c. Suisse, no 52166/09, § 59, 11 juin 2013). Enfin, elle y avait une vie familiale effective et stable : en 2012 elle avait épousé son mari avec lequel elle vivait depuis 2006, qui lui-même réside en Suisse depuis 1991, et le couple élevait ses trois enfants, nés respectivement en 2007, 2008 et 2012.
52. Quant aux liens avec son pays d’origine, il convient de relever que la requérante a passé une partie de sa jeunesse en Bosnie-Herzégovine et que sa mère y réside encore, même si elle y est hospitalisée. Son mari, qui réside en Suisse depuis 1991, a la nationalité serbe. L’intégration de la famille dans l’un des pays de destinations possibles, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie ou la Serbie, même si elle est difficile, ne paraît donc pas impossible. Quant aux enfants, âgés respectivement de 7, 11 et 13 ans, ils sont encore à un âge où ils peuvent s’adapter à un nouvel environnement. Ces éléments distinguent la présente affaire de l’affaire Udeh, dans laquelle la Cour a considéré qu’on ne pouvait s’attendre à ce que la femme du requérant et ses deux filles le suivent au Nigéria (Udeh, précité, § 52).
53. Par ailleurs, la Cour rappelle que s’il s’avère que les autorités internes ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents, y englobant une pesée adéquate entre les intérêts personnels du requérant et les intérêts plus généraux de la société, il n’appartient pas à la Cour de se substituer à l’appréciation faite par celles-ci, y compris par rapport à l’examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, sauf s’il existe des raisons importantes pour le faire (voir, dans ce sens, Hamesevic c. Danemark (déc.), no 25748/15, § 43, 16 mai 2017, Alam c. Danemark (déc.), no 33809/15, § 35, 6 juin 2017, Ndidi c. Royaume-Uni, no 41215/14, § 76, 14 septembre 2017, et Levakovic c. Danemark, no 7841/14, § 45, 23 octobre 2018).
54. Or, dans son analyse, le Tribunal fédéral a certes accordé une grande importance à la gravité de l’infraction à la loi sur les stupéfiants commise par la requérante ; cependant, afin d’apprécier la proportionnalité de la mesure, il a également pris en compte les critères énoncés par la Cour dans son arrêt Üner (précité – paragraphe 44 ci-dessus), dont notamment la situation personnelle de la requérante, son degré d’intégration en Suisse ainsi que les difficultés que celle-ci ainsi que sa famille pourraient rencontrer en cas de retour dans leur pays d’origine.
55. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis que le renvoi de la requérante après dix-huit années passées en Suisse constituait une mesure d’une grande dureté, qui était cependant à nuancer compte tenu du jeune âge de la requérante et le fait qu’elle était arrivée en Suisse à l’âge de quinze [sic] ans après avoir passé toute son enfance et une partie de sa jeunesse en Bosnie‑Herzégovine. Un retour vers la Bosnie-Herzégovine, la Croatie ou la Serbie ne serait dès lors pas impossible. Le Tribunal fédéral s’est également penché sur la situation des enfants, considérant qu’une séparation avec leur mère constituerait une ingérence importante dans leur vie familiale. Cependant, il a estimé que le mari de la requérante, de nationalité serbe, pouvait la suivre dans son pays d’origine, et que l’intégration des enfants ne devait pas poser de problème, étant donné qu’ils étaient encore à un âge où ils pouvaient s’adapter.
56. La Cour est dès lors satisfaite que les autorités internes, en particulier le Tribunal fédéral, ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents et à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause.
57. Par ailleurs, la Cour note que la requérante s’est vu interdire l’entrée sur le territoire suisse pour une durée de sept ans (jusqu’au 30 août 2021), ce qui différencie le cas d’espèce des affaires dans lesquelles le caractère définitif de l’interdiction prononcée a été retenu par la Cour à l’appui de la conclusion que la mesure était disproportionnée (voir, par exemple, Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001, Radovanovic c. Autriche, no 42703/98, § 37, 22 avril 2004, et Emre c. Suisse, no 42034/04, § 85, 22 mai 2008). En outre, l’article 67 § 5 de la loi fédérale sur les étrangers permet à la requérante de demander une suspension provisoire de la décision d’interdiction d’entrée afin qu’elle puisse rendre visite à ses proches en Suisse.
58. La Cour a déjà indiqué que cette « possibilité d’allègement de la mesure d’interdiction de territoire n’existe pas seulement théoriquement, mais réellement et pratiquement » (Kissiwa Koffi, précité, § 70). Contrairement à la situation dans l’affaire Üner (précitée, § 65), dans laquelle toute visite du requérant aux Pays-Bas était exclue pendant dix ans, des contacts occasionnels en Suisse avec son conjoint et les enfants communs ne seraient donc pas exclus, le cas échéant.
59. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier eu égard à la gravité de la condamnation pour infraction en matière de stupéfiants prononcée contre la requérante, ainsi qu’au fait qu’elle-même et les membres de sa famille pourraient s’intégrer sans difficultés majeures dans l’un des pays de destination évoqués par le Tribunal fédéral, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas dépassé la marge d’appréciation dont il jouissait dans le cas d’espèce.
60. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
61. Par ailleurs, la Cour relève qu’en l’espèce ni la révocation de l’autorisation d’établissement de la requérante ni l’interdiction de séjour du territoire allant du 31 août 2014 au 30 août 2021 n’ont été mis à exécution à ce jour. Elle apprécie, comme le Gouvernement l’a indiqué dans ses écritures (paragraphe 17 ci-dessus), que « les autorités cantonales compétentes ont renoncé à recourir à des mesures visant le renvoi forcé de la requérante, dans l’attente du résultat de la procédure pendante auprès de la Cour ». Or, eu égard à la durée de cette procédure et au comportement de la requérante au cours de cette période, ainsi qu’à la possibilité dont elle dispose de soumettre une nouvelle demande d’autorisation de séjour en vertu de l’article 43 de la loi fédérale sur les étrangers (paragraphe 34 ci‑dessus – voir aussi, mutatis mutandis, Ejimson c. Allemagne, no 58681/12, § 63, 1er mars 2018), la Cour estime souhaitable que les autorités nationales réévaluent la situation de la requérante à la lumière des développements apparus depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2014 avant de décider de mettre ces mesures à exécution.
K.A. c. Suisse du 7 juillet 2020 requête n° 62130/15
Article 8 : L’interdiction temporaire d’entrée en Suisse du requérant après sa condamnation pénale pour infractions liées à la drogue, n’a pas violé la Convention
L’affaire concerne le rejet de la demande du requérant de prolonger son autorisation de séjour en Suisse et l’interdiction temporaire d’entrée sur le territoire suisse prononcée à son encontre à la suite de sa condamnation pénale pour une infraction à la loi sur les stupéfiants. Le requérant a été renvoyé de la Suisse où résident son épouse et son fils, tous les deux malades. La Cour juge que les autorités internes, en particulier le Tribunal fédéral, ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents et à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause. Ainsi, malgré l’intensité des liens personnels du requérant avec la Suisse, les autorités suisses pouvaient légitimement considérer, du fait du comportement du requérant et de la gravité des faits reprochés, qu’il était nécessaire, aux fins de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales, de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de lui interdire l’entrée sur le territoire suisse pour une durée limitée de sept ans.
LES FAITS
K.A. vécut et effectua sa scolarité au Kosovo, avant d’émigrer en Suisse et d’y demander l’asile en septembre 1996. Cette demande fut rejetée le 20 décembre 1996. À la suite d’une période de séjour illégal, K.A. épousa le 30 avril 1999 une ressortissante du Bangladesh, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. K.A. bénéficie à ce titre d’une autorisation de séjour par regroupement familial. En 2002, un fils naquit de cette union. Depuis 2010, ce dernier est placé dans une famille d’accueil. Le 19 novembre 2010, K.A. fut condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à vingt-six mois de prison, dont six mois ferme et vingt mois soumis à un délai d’épreuve de deux ans. En sus, il fit l’objet de dix-huit ordonnances pénales entre 1999 et 2012 et cumula des dettes privées. Le 6 octobre 2008, K.A. déposa une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Considérant que le titre de séjour était périmé, l’autorité cantonale considéra la demande comme une requête de nouvelle autorisation de séjour et, le 31 octobre 2012, y opposa son refus. Elle ordonna en conséquence le renvoi de K.A.
Article 8
La Cour constate que le requérant a été renvoyé de la Suisse et qu’il a rejoint son frère dans un autre pays, non précisé. Séparé de son épouse et de son fils, il a dès lors subi une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale. La Cour observe que les mesures d’éloignement et d’interdiction d’entrée imposées au requérant étaient fondées sur les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers et l’intégration. La Cour ne doute pas que l’ingérence visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir notamment « la défense de l’ordre » et la « prévention des infractions pénales ». Au moment de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2015, le requérant vivait en Suisse depuis presque dix-neuf ans et était marié depuis seize ans. Cependant, il n’avait pas réussi à s’intégrer dans le monde du travail. De plus, il n’avait vécu que par intermittence avec son épouse et ne vivait plus avec son fils depuis le placement de celui-ci dans une famille d’accueil en 2010. La Cour reconnaît qu’il est vrai que le requérant constituait une personne de référence importante pour son épouse, atteinte de schizophrénie, et pour son fils, souffrant de troubles du spectre autistique, et que sa présence auprès d’eux était importante. Néanmoins, il ne s’occupait pas d’eux au quotidien et leurs contacts se sont certainement raréfiés pendant la période où il purgeait sa peine de prison. Le requérant peut toutefois entretenir une relation avec son fils à l’aide des moyens de communications modernes, ou par le biais de ses visites en Suisse. La Cour considère que les autorités internes, en particulier le Tribunal fédéral, ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents et à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause. Ainsi, malgré l’intensité des liens personnels du requérant avec la Suisse, les autorités suisses pouvaient légitimement considérer, du fait du comportement du requérant et de la gravité des faits reprochés, qu’il était nécessaire, aux fins de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales, de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de lui interdire l’entrée sur le territoire suisse pour une durée limitée de sept ans. Dès lors, la Cour peut conclure que les mesures litigieuses étaient proportionnées aux buts poursuivis.
CEDH
a) Principes généraux
39. La Cour rappelle que selon un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des étrangers sur leur sol (voir, parmi beaucoup d’autres, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 164, CEDH 2012). La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de l’ordre public, les États contractants ont la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur leur territoire. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir, par exemple, Boultif, précité, § 46, et Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X).
40. Dans l’affaire Üner (précitée, §§ 54-60), la Cour a eu l’occasion de résumer les critères devant guider les instances nationales dans de telles affaires :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la nationalité des diverses personnes concernées ;
– la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
– la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
– la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
– la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
– l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
41. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical ou la nature temporaire ou définitive de l’interdiction de territoire (voir Shala c. Suisse, no 52873/09, § 46, 15 novembre 2012, et les références citées).
42. La Cour rappelle que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi. Sa tâche consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, les droits de l’intéressé protégés par la Convention et, d’autre part, les intérêts de la société (Slivenko, précité, § 113, et Boultif, précité, § 47).
43. La Cour rappelle également que les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée, afin notamment de permettre à la Cour d’assurer le contrôle européen qui lui est confié (voir, mutatis mutandis, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 107, CEDH 2013, et El Ghatet c. Suisse, no 56971/10, § 47, 8 novembre 2016). Un raisonnement insuffisant des juridictions internes, sans véritable mise en balance des intérêts en présence, est contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention. C’est le cas lorsque les autorités internes ne parviennent pas à démontrer de manière convaincante que l’ingérence dans un droit protégé par la Convention est proportionnée aux buts poursuivis et qu’elle correspond dès lors à un « besoin social impérieux » au sens de la jurisprudence précitée (voir El Ghatet, précité, § 47, et I.M. c. Suisse, no 23887/16, §§ 72 et 77, 9 avril 2019).
b) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
44. La Cour observe que le requérant a été en effet renvoyé de la Suisse et qu’il a, selon ses propres dires, rejoint son frère dans un autre pays (paragraphe 34 ci-dessus). Il a été par conséquent séparé de son épouse, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, et de son fils. Il a dès lors subi une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale.
45. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
46. Il n’est pas contesté que les mesures d’éloignement et d’interdiction d’entrée imposées au requérant étaient fondées sur les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers et l’intégration (paragraphe 19 ci‑dessus).
47. Puis, bien que le requérant le conteste, la Cour ne doute pas que l’ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir notamment « la défense de l’ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
48. Il reste donc à examiner si les mesures litigieuses étaient nécessaires dans une société démocratique.
49. À cet égard, la Cour observe tout d’abord que la condamnation du requérant pour l’infraction à la loi sur les stupéfiants (vingt-six mois de prison, dont six mois ferme, pour avoir transporté 4,5 kilos d’héroïne) pèse lourdement. S’agissant d’une infraction en matière de stupéfiants, eu égard aux ravages de la drogue dans la population, la Cour a toujours conçu que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation de ce fléau (voir, par exemple, Baghli c. France, no 34374/97, § 48, CEDH 1999-VIII, Kissiwa Koffi, précité, § 65).
50. La Cour admet que, au moment de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2015, le requérant vivait en Suisse depuis presque dix-neuf ans et qu’il y était marié depuis seize ans. Il résulte cependant des observations du Gouvernement que, malgré les formations suivies, il n’avait pas réussi à s’intégrer dans le monde du travail (paragraphe 37 in fine ci-dessus) ; de plus, il n’avait vécu que par intermittence avec son épouse et ne vivait plus avec son fils depuis le placement de celui-ci dans une famille d’accueil en 2010. Il est vrai, comme l’ont concédé le Tribunal fédéral ainsi que le Gouvernement, que le requérant constituait une personne de référence importante pour son épouse, atteinte de schizophrénie, et notamment pour son fils, souffrant de troubles du spectre autistique, et que sa présence auprès d’eux était importante. Il y a néanmoins lieu de prendre en compte qu’il ne s’occupait pas d’eux au quotidien et que leurs contacts se sont certainement raréfiés pendant la période où il purgeait sa peine de prison. On ne saurait non plus négliger l’argument du Tribunal fédéral selon lequel le requérant pourrait entretenir la relation avec son fils à l’aide de moyens de communications modernes, ou par le biais de ses visites en Suisse.
51. Sur ce dernier point, la Cour note que le requérant s’est vu interdire l’entrée sur le territoire suisse pour une durée de sept ans, ce qui différencie le cas d’espèce des affaires dans lesquelles le caractère définitif de l’interdiction prononcée a été retenu par la Cour à l’appui de la conclusion que la mesure était disproportionnée (voir, par exemple, Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001, Radovanovic c. Autriche, no 42703/98, § 37, 22 avril 2004, et Emre c. Suisse, no 42034/04, § 85, 22 mai 2008). En outre, l’article 67 § 5 de la loi sur les étrangers et l’intégration permet au requérant de demander une suspension provisoire de la décision d’interdiction d’entrée afin qu’il puisse rendre visite à ses proches en Suisse. À cet égard, la Cour observe que le requérant ne l’a pas informée s’il avait tiré parti de la possibilité de soumettre une telle demande.
52. La Cour est satisfaite également que les autorités internes, en particulier le Tribunal fédéral, ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents et à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause. Dès lors que leurs conclusions n’apparaissent ni arbitraires ni manifestement déraisonnables, il n’appartient pas à la Cour de se substituer à l’appréciation faite par les autorités suisses, y compris par rapport à l’examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse (voir, dans ce sens, Hamesevic c. Danemark (déc.), no 25748/15, § 43, 16 mai 2017, Alam c. Danemark (déc.), no 33809/15, § 35, 6 juin 2017, Ndidi c. Royaume-Uni, no 41215/14, § 76, 14 septembre 2017, et Levakovic c. Danemark, no 7841/14, § 45, 23 octobre 2018).
53. Ainsi, malgré l’intensité des liens personnels du requérant avec la Suisse, la Cour estime que les autorités suisses pouvaient légitimement considérer, du fait du comportement du requérant et de la gravité des faits reprochés, qu’il était nécessaire, aux fins de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales, de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de lui interdire l’entrée sur le territoire suisse pour une durée de sept ans. Outre le caractère temporaire de la mesure, la Cour attribue une grande importance à la gravité de l’infraction à l’origine de la peine de prison prononcée en 2010 : trafic d’héroïne motivé par des raisons financières.
54. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les mesures litigieuses étaient, dès lors, proportionnées aux buts poursuivis (voir également Benhebba c. France, no 53441/99, 10 juillet 2003 et Üner, précité).
55. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
MAKDOUDI c. BELGIQUE du 18 février 2020 requête n° 12848/15
Art 5 § 4 • Contrôle à bref délai • Absence de décision finale avant la libération du requérant sur la légalité de sa détention de près de quatre mois en vue de son éloignement •
Art 8 • Respect de la vie privée et familiale • Mesure de renvoi d’un ressortissant étranger en raison de sa condamnation pénale sans prise en compte de sa paternité envers une enfant belge • Absence de motivation circonstanciée et de mise en balance des intérêts en présence par les juridictions administratives
ARTICLE 5 § 4
68. Les principes généraux relatifs à l’application de l’article 5 § 4 en matière d’éloignement ont été énoncés par la Cour dans Khlaifia et autres c. Italie [GC] (no 16483/12, §§ 128-131, 15 décembre 2016).
69. En l’espèce, la Cour constate que la période de détention en cause a débuté le 15 mai 2014 et que le requérant a été libéré le 11 septembre 2014. La durée globale de sa détention a donc été de près de quatre mois. La Cour doit rechercher si, au cours de cette période, le requérant a pu faire examiner à bref délai la légalité de sa détention par un tribunal.
70. La Cour constate que, le 23 mai 2014, le requérant a introduit devant la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles une requête de mise en liberté contre la mesure initiale de détention du 15 mai 2014. Le 2 juin 2014, la chambre du conseil a ordonné la libération du requérant. Par un arrêt du 25 juin 2014, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a réformé cette ordonnance. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation par un arrêt du 10 septembre 2014, pour un motif technique. Entre-temps, le 14 juillet 2014, la détention avait fait l’objet d’une prolongation contre laquelle le requérant a introduit une nouvelle requête de mise en liberté. Cette requête a été déclarée irrecevable par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles le 28 juillet 2014. Son ordonnance a ensuite été réformée par un arrêt du 13 août 2014 de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles qui a ordonné la libération immédiate du requérant. Le requérant fut toutefois maintenu en détention étant donné que l’État belge s’était pourvu en cassation. Le 10 septembre 2014, la Cour de cassation cassa cet arrêt pour excès de pouvoir. Finalement, les délais légaux de détention étant arrivés à expiration, le requérant a été libéré le 11 septembre 2014, et le 22 septembre 2014, la chambre des mises en accusation, autrement composée, a déclaré les deux requêtes de mise en liberté sans objet.
71. La Cour ne peut que constater que le requérant a introduit une première requête de mise en liberté le 23 mai 2014 et qu’aucune décision finale sur la légalité de sa détention n’est intervenue avant sa libération le 11 septembre 2014. La Cour prend note également du fait que la dernière décision juridictionnelle sur le bien-fondé de la requête de mise en liberté rendue par la chambre des mises en accusation le 13 août 2014 était favorable au requérant et que cette décision a été cassée par la Cour de cassation pour un motif qui ne tenait pas à la légalité de la détention au sens de la Convention (Khlaifia et autres, précité, § 128).
72. Ces éléments suffisent à la Cour pour considérer que du point de vue des exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, la situation en l’espèce ne peut être distinguée de celle qu’elle a sanctionnée dans l’affaire Firoz Muneer précitée (§§ 82-87), à laquelle se réfèrent les parties, ainsi que dans l’affaire M.D. c. Belgique (no 56028/10, §§ 36-43, 14 novembre 2013).
73. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas pu obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention était jugée illégale.
74. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
ARTICLE 8
75. Le requérant se plaint que son renvoi avec interdiction de séjour a constitué une ingérence dans sa vie familiale qui n’est pas conforme à l’article 8 de la Convention dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi formulée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
76. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
Sur le fond
Thèses des parties
a) Le requérant
77. Le requérant indique que l’existence d’une vie familiale affective était connue de l’OE avant l’adoption de l’AMR. Plusieurs courriers faisant état du retard dans ses démarches de reconnaissance de paternité, en raison de la procédure d’identification et de sa détention, avaient été envoyés par son conseil. De plus, le lien de reconnaissance officielle est intervenu avant la fin de la procédure de recours contre l’AMR et le requérant a ensuite établi à suffisance l’existence d’une vie familiale et d’une vie privée en Belgique dans le cadre des procédures en recours contre l’AMR. Les autorités auraient donc dû prendre en compte la paternité du requérant et faire application de l’article 21, § 2, 2o de la loi sur les étrangers interdisant le renvoi d’un étranger père d’un enfant belge condamné pénalement à une peine de moins de cinq ans d’emprisonnement. En passant outre cette disposition, elles ont privé la mesure de renvoi et les ordres d’éloignement consécutifs de toute base légale. Cette carence n’a pas été compensée par les juridictions, qui n’ont pas examiné la réalité de cette vie familiale. À cela s’ajoute que l’OQT du 15 mai 2014 a été adopté alors que le requérant était en séjour régulier, ce qui rend cette mesure illégale pour ce motif également.
78. Le requérant affirme ensuite que les juridictions n’ont pas procédé à l’évaluation des intérêts en présence qui aurait pu et dû les amener à considérer que la mesure d’éloignement était une ingérence disproportionnée dans la vie familiale du requérant. Les faits pour lesquels il a été condamné tant en 2010 qu’en 2014 remontent à 2009, se sont déroulés dans un contexte précis qui n’est pas de nature à se reproduire et ne constituaient pas une menace pour la « sécurité nationale » qui aurait permis de déroger à la disposition précitée de la loi sur les étrangers. Le requérant fait ensuite valoir qu’il a purgé l’intégralité de sa peine, ce qui fait de son éloignement une double peine, et qu’après sa libération, il a fait montre d’intégration dans la société belge, en trouvant du travail et en régularisant son séjour. S’il s’est ensuite de nouveau retrouvé dans la précarité, c’est en raison du retrait de sa carte de séjour. Enfin, le requérant souligne que sa compagne et sa fille sont de nationalité belge et n’ont aucun intérêt à le suivre en Tunisie où il ne dispose pas d’un réseau social solide, où elles n’ont aucune attache et où le niveau de vie et d’éducation est largement inférieur. Son éloignement avec interdiction d’entrée entraîne donc nécessairement une séparation de la famille pendant de longues années, ce qui est en outre contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
79. En ce qui concerne la possibilité mentionnée par l’OE et le CCE de demander la levée de l’AMR, le requérant signale que la loi n’impose aucun délai aux autorités pour répondre et qu’en pratique cela peut mettre des années avant que sa demande soit examinée.
b) Le Gouvernement
80. À titre principal le Gouvernement fait valoir que les arguments que le requérant tire de l’illégalité de l’AMR et des mesures d’exécution reposent sur un postulat erroné. Contrairement à ce qu’il prétend, au moment où l’AMR a été adopté, il n’avait pas démontré sa filiation à un enfant belge et n’exerçait aucune autorité parentale à l’égard d’un enfant séjournant de manière régulière en Belgique ou n’assumait aucune obligation d’entretien de sorte qu’il ne pouvait pas invoquer le bénéfice de l’article 21, § 2, 2o de la loi sur les étrangers.
81. De plus, au moment de délivrer l’AMR, les seuls éléments dont les autorités belges disposaient étaient que le requérant avait reçu la visite de L.M. et de sa fille en prison et qu’il entendait accepter un voyage de retour vers la Tunisie pour épouser L.M. et reconnaître sa fille. La circonstance que la paternité, finalement établie en cours de délibéré du CCE, ne put valablement être invoquée pour la première fois devant le Conseil d’État ne saurait changer la donne, le requérant étant à l’origine de sa propre carence à remédier en temps utile à l’irrégularité de son séjour. Ainsi que le lui ont rappelé les juridictions belges, la seule option qui s’offrait au requérant pour faire valoir l’article 8 de la Convention était d’exécuter l’AMR et ensuite, après une période de deux ans, de solliciter la levée ou la suspension de l’AMR sur la base de l’article 46bis ancien de la loi sur les étrangers, ce qu’il est toujours resté en défaut de faire.
82. À titre subsidiaire, le Gouvernement estime qu’il ne saurait être question d’une obligation positive tirée de l’article 8 à charge de l’État belge étant donné que le requérant n’a bénéficié d’aucune autorisation ou admission au séjour sur le territoire. Du fait de l’interdiction d’entrée dont était assorti l’AMR, il ne pouvait prétendre à aucune régularisation ce qui explique que la carte F fut retirée et sa demande de régularisation déclarée sans objet.
83. Se référant à la jurisprudence de la Cour relative aux étrangers non établis qui demandent une première admission, le Gouvernement souligne que le requérant a créé sa vie familiale à un moment où il savait que son séjour était précaire et que sa situation ne présente aucune circonstance exceptionnelle qui aurait été de nature à rendre son renvoi contraire à l’article 8. Si le développement de sa vie familiale a été rendu difficile, c’est en raison de son comportement personnel qu’il s’agisse de son incarcération pour des faits très graves ou de son refus de procéder ensuite aux démarches procédurales qui s’imposaient. De plus, rien ne s’opposait à ce que le requérant, son amie et leur fille développent leur vie familiale en Tunisie ou que L.M. profite en tant qu’enseignante des congés scolaires pour rejoindre le requérant, ne fut-ce que le temps requis pour demander la suspension ou la levée de l’AMR. Cette possibilité était d’autant plus envisageable que l’enfant était très jeune, que le requérant avait des attaches solides et durables en Tunisie, et qu’il n’avait pas développé de liens étroits avec la Belgique.
84. À titre encore plus subsidiaire, le Gouvernement estime que la mesure de renvoi était conforme à l’article 8. Fondée sur l’article 20 de la loi sur les étrangers, elle poursuivait le but légitime de protection de l’ordre public et de prévention d’une nouvelle atteinte à l’ordre public et était nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2, compte tenu en particulier de la nature et de l’extrême gravité des infractions commises par le requérant et de la balance des intérêts à laquelle les autorités belges ont procédé pour adopter les mesures d’éloignement et ce jusqu’au dernier OQT auquel le requérant a fini par obtempérer.
a) Ingérence dans le droit protégé par l’article 8
85. Il s’agit en premier lieu de déterminer si le requérant pouvait se prévaloir en Belgique d’une vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention.
86. La Cour prend note des doutes du Gouvernement quant à l’existence d’un lien familial entre le requérant et L.M. au moment de la décision de renvoi au motif que leur vie commune semble avoir débuté après la libération du premier en décembre 2012, soit bien après l’adoption de l’AMR en février 2011.
87. Toutefois, cet élément ne permet pas de conclure à l’absence d’une vie familiale. Le requérant a en effet reconnu en juillet 2011, certes plus d’un an après sa naissance, l’enfant mis au monde par L.M. Or la notion de famille sur laquelle repose l’article 8 inclut, même en l’absence de cohabitation, le lien entre un individu et son enfant, que celui-ci soit né dans ou hors mariage (Boughanemi c. France, 24 avril 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996 II). L’enfant s’insère de plein droit dans la cellule « familiale » dès sa naissance et par le fait même de celle-ci (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, §43, CEDH 2000 VIII). De plus, la Cour rappelle que la question de l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 doit s’apprécier à la lumière de la situation à l’époque où la mesure d’éloignement ou d’interdiction de séjour est devenue définitive (Mokrani c. France, no 52206/99, § 34, 15 juillet 2003, et Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 61, CEDH 2008), soit en l’espèce à la date de l’ordonnance du Conseil d’État du 13 septembre 2011. À ce moment, le requérant avait reconnu l’enfant depuis deux mois ; cet élément, acté par le Conseil d’État, n’a toutefois pas été pris en considération pour un motif procédural (paragraphe 15 ci-dessus).
88. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant peut se prévaloir d’être victime d’une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention.
b) Justification de l’ingérence
89. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
90. La Cour observe que la base légale des mesures litigieuses fait controverse entre les parties. Elle note que l’AMR a été pris sur pied de l’article 20 de la loi sur les étrangers qui autorisait les autorités belges à renvoyer un étranger qui n’était pas établi en Belgique lorsque celui-ci avait porté atteinte à l’ordre public. Elle n’a aucune difficulté à admettre la thèse du Gouvernement selon laquelle, en l’absence d’établissement formel de la filiation à l’égard de son enfant au moment de l’adoption de l’AMR, le requérant ne pouvait pas bénéficier de la dérogation à cette disposition prévue à l’article 21, § 2, 2o de la loi (paragraphe 60 ci-dessus). Les OQT qui ont ensuite été adoptés pour concrétiser l’éloignement du requérant l’ont également été sur base de dispositions légales applicables, à savoir l’article 7 de la loi sur les étrangers, notamment par référence à l’AMR et au danger que représentait le requérant pour l’ordre public. La circonstance que l’OQT du 15 mai 2014 ait été adopté alors que le requérant disposait d’une carte de séjour ne change rien à ce constat étant donné que cette même décision lui retirait ce droit de séjour.
But légitime
91. La Cour note qu’il n’est pas contesté que la mesure initiale de renvoi a été prise en raison de la condamnation pénale du requérant en 2010. Quant aux ordres de quitter le territoire subséquents, ils s’inscrivaient en exécution de la mesure initiale et, tenant compte du refus du requérant de quitter le territoire belge malgré les ordres en ce sens, visaient à prévenir de nouvelles atteintes à l’ordre public. Ces éléments suffisent à la Cour pour considérer que les mesures d’éloignement poursuivaient un but compatible avec l’article 8 § 2 de la Convention, à savoir « la défense de l’ordre » et la « prévention des infractions pénales ». L’argument du requérant selon lequel la condamnation pour vol en 2014 concernait des faits datant de 2009 ne change rien à ce constat.
Nécessité de la mesure dans une société démocratique
92. Il reste donc à examiner si la mesure était « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour se réfère aux principes généraux énoncés à ce sujet dans sa jurisprudence et récemment rappelés dans ses arrêts Saber et Boughassal c. Espagne (nos 76550/13 et 45938/14, §§ 38-42, 18 décembre 2018) et I.M. c. Suisse (no 23887/16, §§ 68-73, 9 avril 2019).
93. En l’espèce, le renvoi du requérant a été décidé par l’AMR du 18 février 2011 en raison de sa condamnation pénale en 2010 pour des faits de tentative de meurtre, tentatives de vols avec violences aggravées et coups volontaires datant de 2009. Dans le cadre du recours en annulation qu’il a exercé devant le CCE contre cet arrêté, le requérant s’est plaint que les autorités administratives avaient fait prévaloir la protection de l’ordre public sans évaluation de sa situation personnelle et familiale contrairement aux exigences de l’article 8 de la Convention. À l’appui de cette allégation, le requérant a fourni une attestation sur l’honneur de sa partenaire qu’elle était en couple avec lui ainsi que l’acte de naissance de l’enfant. En réponse à ce moyen, le CCE s’est limité à observer que la réalité d’une vie familiale reposait sur des déclarations contradictoires dans le premier cas et n’était établie par aucun commencement de preuve dans le second, pour conclure que l’argument du requérant selon lequel l’AMR aurait été disproportionné au sens de l’article 8 n’était pas fondé. Dans son appréciation en droit, le Conseil d’État n’a pas remis en cause l’appréciation en fait du lien avec sa partenaire que le CCE avait opérée souverainement et a considéré que le requérant n’était pas recevable à faire état, pour la première fois en cassation, de l’effet rétroactif de l’établissement de sa filiation intervenue en cours de délibéré du CCE.
94. Il s’ensuit qu’à défaut de reconnaissance de l’existence d’une vie familiale en Belgique dans le chef du requérant, une mise en balance des intérêts en présence requise par l’article 8 de la Convention n’a été faite ni par le CCE ni par le Conseil d’État.
95. La Cour constate que cette carence n’a pas été redressée dans le cadre des recours en annulation des OQT subséquents puisque ceux-ci ont tous été déclarés irrecevables au motif qu’ils n’étaient que des mesures d’exécution de l’AMR. Conformément à la jurisprudence du CCE, ces OQT n’ayant pas d’existence autonome, ils n’étaient pas susceptibles de recours. S’il est vrai que, malgré les constatés répétés d’irrecevabilité des recours introduits par le requérants contre les différents OQT, le CCE a rappelé au requérant qu’il lui appartenait de faire valoir les griefs tirés de l’article 8 de la Convention dans le cadre d’une demande de levée de l’AMR, une telle demande ne pouvait utilement être introduite qu’après l’exécution de l’ordre de renvoi conformément à l’article 46bis ancien de la loi sur les étrangers. Aucune des demandes de levée de l’AMR introduites par le requérant n’a été, pour cette raison, prise en considération par l’OE. Quant à la demande faite par le requérant de régularisation de son séjour au titre du regroupement familial, elle a également échoué au motif qu’il faisait l’objet d’un AMR, et qu’il n’avait dès lors pas le droit de se trouver sur le territoire belge.
96. La Cour relève que dans le cadre de la procédure de mise en liberté contre la détention contenue dans l’OQT du 4 mars 2015 (paragraphes 52-53 ci-dessus), les juridictions d’instruction – en l’occurrence la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles et la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles – ont, contrairement aux instances et juridictions administratives, procédé à une mise en balance des intérêts en présence. Considérant que la mesure initiale de renvoi était illégale et que le requérant ne pouvait plus être considéré comme une menace pour la sécurité publique, les juridictions saisies ont conclu que la privation de liberté constituait une atteinte disproportionnée à la vie familiale et ont, pour cette raison, ordonné sa libération.
97. La Cour estime qu’il incombait aux autorités nationales compétentes de motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée, afin notamment de permettre à la Cour d’assurer le contrôle européen qui lui est confié (voir, mutatis mutandis, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 107, CEDH 2013, El Ghatet c. Suisse, no 56971/10, § 47, 8 novembre 2016, et I.M. c. Suisse, précité, § 72). Un raisonnement insuffisant des autorités internes, sans véritable mise en balance des intérêts en présence, est contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention. Dans un tel cas, ces autorités ne démontrent pas que l’ingérence dans le droit protégé par la Convention correspond à un besoin social impérieux ou, à tout le moins, qu’elle est proportionné aux buts poursuivis (voir I.M. c Suisse, précité, § 72). C’est ce qui s’est passé en l’espèce. La Cour tient à ajouter que si, comme l’ont fait les juridictions d’instruction à propos de la détention du requérant, l’OE, le CCE ou le Conseil d’État avait procédé à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause, prenant en compte les différents critères établis par la jurisprudence de la Cour (paragraphe 92 ci‑dessus), et si ces autorités avaient indiqué des motifs pertinents et suffisants pour justifier leurs décisions, elle aurait, en ligne avec le principe de subsidiarité, pu le cas échéant être amenée à considérer que les autorités internes n’avaient ni manqué de ménager un juste équilibre entre les intérêts du requérant et de l’État demandeur ni excédé la marge d’appréciation dont elles jouissent dans le domaine de l’immigration (voir, mutatis mutandis, El Ghatet, précité, § 52, et I.M. c. Suisse, précité, § 77).
98. Eu égard aux circonstances, il y a lieu de conclure que la mesure de renvoi du requérant a été adoptée en violation de l’article 8 de la Convention.
I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 requête n° 23887/16
Article 8 sur l'expulsion d'un étranger délinquant alors que toute sa famille vit en Suisse. Ce papy pervers a été condamné pour viol alors qu'il est à la charge financière est à la charge de ses de ses fils majeurs qui vivent en Suisse.
L’examen insuffisant d’une mesure de renvoi dans une affaire d’expulsion d’un ressortissant kosovar viole la Convention.
L’affaire porte sur le refus des autorités suisses de renouveler le permis de séjour d’I.M. (un ressortissant kosovar établi en Suisse depuis 1993) et l’obligation faite à celui-ci de quitter le territoire suisse, à la suite de sa condamnation pour un viol commis en 2003. I.M., dont le taux d’invalidité a été évalué à 80 %, vit actuellement en Suisse avec ses enfants majeurs dont il dépend.
La Cour juge que, alors qu’il statuait en 2015 – soit plus de 12 ans après l’infraction commise par le requérant –, le Tribunal administratif fédéral n’a pas pris en compte l’évolution du comportement de l’intéressé, ni évalué l’impact de l’aggravation considérable de son état de santé sur le risque de récidive.
Le Tribunal administratif fédéral n’a pas non plus pris en considération la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux du requérant avec le pays d’hôte (Suisse) et le pays de destination (Kosovo), ni fait une analyse suffisamment approfondie des implications de la dépendance d’I.M. à l’égard de ses enfants majeurs.
Les autorités internes ont donc effectué un examen superficiel de la proportionnalité de la mesure de renvoi et elles ne sont pas parvenues à démontrer de manière convaincante que cette mesure était proportionnée aux buts légitimes poursuivis (la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales) et nécessaire dans une société démocratique.
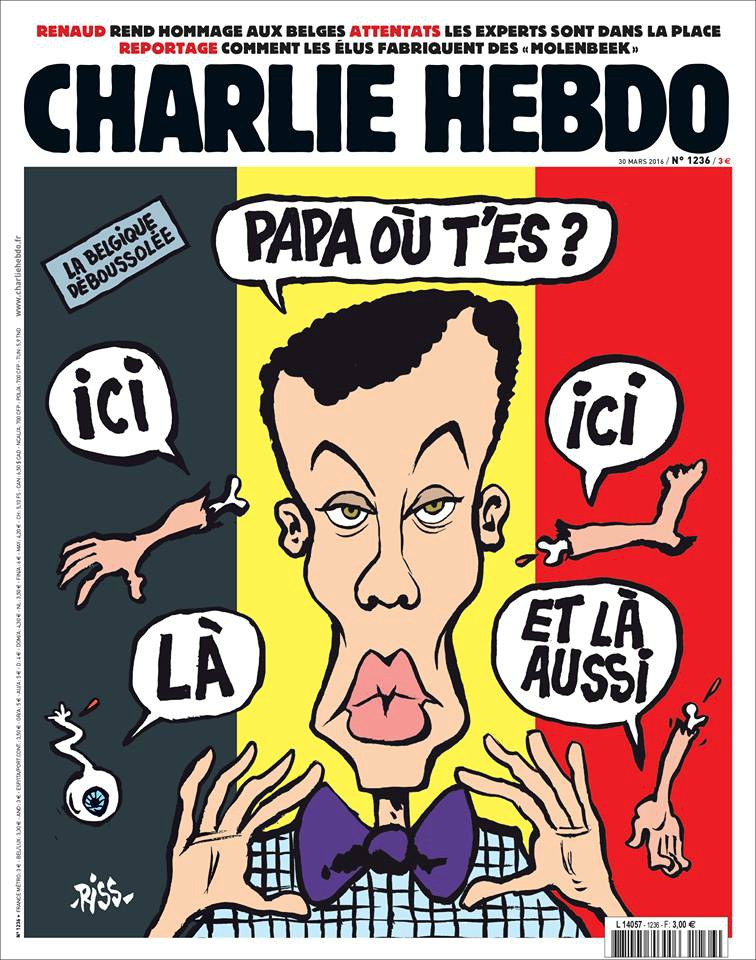 LES FAITS
LES FAITS
En 1993, I.M. déposa une demande d’asile auprès des autorités suisses. Ces dernières rejetèrent sa demande mais le mirent temporairement au bénéfice de l’admission provisoire. En août 1998, l’exfemme d’I.M., qui vivait au Kosovo et dont il divorça en mai 1998, arriva en Suisse avec les trois enfants du requérant. La demande d’asile de ces derniers fut admise. Par la suite, I.M. épousa une ressortissante suisse et obtint une autorisation de séjour en raison de ce mariage. Le couple divorça en 2006. En 2003, I.M. fut condamné, notamment pour contrainte sexuelle et viol, en raison de faits survenus la même année. En 2005, le Tribunal d’appel, qui ne retint que le chef d’accusation de viol, réduisit la peine initialement prononcée à deux ans et trois mois de réclusion et confirma l’expulsion d’I.M. du territoire suisse pour une durée de 12 ans avec sursis, avec une mise à l’épreuve de cinq ans. En 2006, l’office des migrations du canton de Bâle-Campagne rejeta la demande de prolongation de l’autorisation de séjour d’I.M., relevant que sa condamnation à plus de deux ans de réclusion pour viol constituait un motif d’expulsion du territoire suisse. En 2007, le Conseil d’État du Canton de Bâle-Campagne, puis le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne rejetèrent les recours d’I.M. En 2010, le Secrétariat d’État aux migrations étendit la décision cantonale de renvoi à tout le territoire suisse. En 2013, I.M., atteint dans sa santé, fut mis au bénéfice d’une rente d’invalidité complète, avec effet rétroactif au 1 er octobre 2012, son taux d’invalidité ayant été évalué à 80 %. En 2015, le Tribunal administratif fédéral rejeta le recours d’I.M. – déposé contre la décision d’extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire suisse de 2010 –, considérant en particulier que la peine de privation de liberté de deux ans et trois mois prononcée à son encontre en 2003 allait clairement au-delà du seuil suffisant pour admettre une violation ou une mise en danger grave de l’ordre et de la sécurité publics. En 2016, la rente d’invalidité d’I.M. fut suspendue. Depuis lors, il est pris en charge financièrement par ses enfants. Il habiterait avec deux de ses enfants majeurs qui s’occuperaient du ménage, feraient des achats, le soigneraient, le laveraient, l’habilleraient et seraient les premières personnes de référence pour lui
Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
La Cour estime que la décision de renvoi constitue une ingérence dans le droit d’I.M. au respect de sa vie privée et familiale, en raison, d’une part, de la très longue durée de séjour de l’intéressé en Suisse, et, d’autre part, de ses relations avec ses enfants. La Cour note par ailleurs que l’ingérence était fondée sur des dispositions pertinentes du droit national et visait la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. La Cour constate que, dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a estimé que, bien que les faits se fussent déroulés plus de 10 ans auparavant, le viol constituait un crime grave pour lequel même un faible risque de récidive ne devait pas être accepté en matière de droit des étrangers. Le tribunal a aussi considéré que l’application de la clause d’exclusion, même en tenant compte des difficultés non négligeables que le requérant devrait surmonter à son retour dans son pays d’origine, s’avérait proportionnée. Il s’est donc prononcé sur la gravité de l’infraction commise, en traitant brièvement la question du risque de récidive et en faisant mention des difficultés auxquelles serait confronté I.M. à son retour au Kosovo. Cependant, alors qu’il statuait plus de 12 ans après l’infraction, le tribunal n’a nullement pris en compte l’évolution du comportement d’I.M. depuis la commission de l’infraction. Il n’a pas non plus évalué l’impact de l’aggravation considérable de l’état de santé de l’intéressé (taux d’invalidité de 80 % depuis le 1 er octobre 2012) sur le risque de récidive et ne s’est pas penché sur plusieurs critères établis par la jurisprudence pour apprécier la nécessité de la mesure d’expulsion. Le tribunal n’a en particulier pas pris en considération la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux d’I.M. avec le pays d’hôte (Suisse) et avec le pays de destination (Kosovo), ainsi que les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical. S’agissant plus spécifiquement du respect de la vie familiale, bien que les tribunaux aient reconnu la dépendance, au moins financière du requérant par rapport à ses enfants majeurs, ils n’ont pas fait une analyse plus approfondie des implications de cette dépendance pour la jouissance des droits du requérant en vertu de l’article 8 de la Convention. Dès lors, la Cour considère que, en appliquant les critères établis dans sa jurisprudence, aucune conclusion claire ne peut être tirée quant à savoir si les intérêts privés et familiaux du requérant à continuer à pouvoir résider sur le territoire de l’État défendeur l’emporte sur l’intérêt public de ce dernier d’expulser le requérant dans le but d’assumer sa mission de maintien de l’ordre public. Si les autorités internes avaient procédé à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause, en prenant en compte les différents critères établis par la jurisprudence de la Cour, et si elles avaient indiqué des motifs pertinents et suffisants pour justifier leur décision, la Cour aurait, en ligne avec le principe de subsidiarité, pu le cas échéant être amenée à considérer que les autorités internes n’avaient ni manqué de ménager un juste équilibre entre les intérêts du requérant et de l’État demandeur ni excédé la marge d’appréciation dont elles jouissent dans le domaine de l’immigration. Par conséquent, la Cour considère que le Tribunal administratif fédéral a effectué un examen superficiel de la proportionnalité de la mesure de renvoi. Compte tenu de l’absence d’une véritable mise en balance des intérêts en jeu, la Cour estime que les autorités internes ne sont pas parvenues à démontrer de manière convaincante que la mesure d’éloignement prise était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc nécessaire dans une société démocratique. Il y aurait par conséquent violation de l’article 8 si I.M. était expulsé.
CEDH
a) Ingérence dans le droit protégé par l’article 8
58. La Cour observe que, dans sa jurisprudence, elle a envisagé l’expulsion de résidents de longue date aussi bien sous le volet de la « vie privée » que sous celui de la « vie familiale », une certaine importance étant accordée sur ce plan au degré d’intégration sociale des intéressés (Dalia c. France, 19 février 1998, §§ 42‑45, Recueil 1998-I, et Ukaj c. Suisse, no 32493/08, § 28, 24 juin 2014).
59. La Cour précise que la décision d’extension de la mesure de renvoi à tout le territoire suisse constitue l’ingérence dont il est question en l’espèce.
60. La Cour estime que, en raison de la très longue durée de séjour du requérant en Suisse, la décision de renvoi constitue une ingérence dans son droit au respect de sa « vie privée » (voir, mutatis mutandis, Gezginci c. Suisse, no 16327/05, § 57, 9 décembre 2010).
61. Se pose encore la question de savoir si la « vie familiale » du requérant est également en jeu dans la présente affaire. La Cour rappelle que pour juger du respect de l’article 8, elle doit tenir compte des développements qui se sont produits depuis la décision interne ordonnant le renvoi du requérant (voir, mutatis mutandis, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 145, CEDH 2010 ; Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, 24 avril 2003). La Cour doit en effet se placer au moment de l’exécution de la mesure litigieuse (Neulinger et Shuruk, précité, § 145, et Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 91, CEDH 2008). À cet égard, elle note certes que le requérant n’a invoqué auprès des autorités suisses le fait qu’il était le père des jumeaux nés en 2006 qu’après l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 octobre 2015, cependant elle estime qu’elle ne saurait complètement faire abstraction de ce fait pour garantir la protection concrète et effective des droits découlant de l’article 8 de la Convention.
62. Par ailleurs, les enfants majeurs du requérant sont respectivement âgés de 23, 26 et 28 ans. La Cour rappelle que l’on ne saurait retenir l’existence d’une vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, entre des parents et leurs enfants adultes ou entre frères et sœurs adultes sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 97, CEDH 2003-X, et Danelyan c. Suisse (déc.), nos 76424/14 et 76435/14, § 29, 29 mai 2018). Or, en l’espèce, la Cour estime que le requérant peut se prévaloir de tels éléments supplémentaires à l’égard de ses enfants majeurs dans la mesure où il est dépendant d’une aide extérieure pour faire face à sa vie quotidienne. En effet, il fait valoir que, depuis la suspension de sa rente d’invalidité, en février 2016, ses trois enfants majeurs le prennent en charge financièrement. De plus, il habiterait avec deux de ses enfants majeurs qui s’occuperaient du ménage, feraient des achats, le soigneraient, le laveraient, l’habilleraient et, dès lors, seraient les premières personnes de référence pour lui. La Cour n’a pas de raison valable de douter de la véracité de ces allégations et le Gouvernement ne les conteste par ailleurs pas. En outre, les tribunaux suisses ont pris en compte, dans leur évaluation de l’opportunité du renvoi du requérant, le fait que les membres de sa famille pourraient contribuer à ses frais médicaux (paragraphe 25 ci-dessus). Le fait que ces contributions pourraient lui être versées au Kosovo en provenance de sa famille résidant en Suisse et en Allemagne ne remet pas en question l’existence même d’un lien de dépendance pertinent pour faire entrer en jeu le volet « vie familiale » de l’article 8. Dès lors, la Cour estime que les relations du requérant avec ses enfants relèvent également du droit au respect de sa vie familiale.
63. Compte tenu de ce qui précède, le requérant peut se prévaloir d’être victime d’une ingérence du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention.
b) Justification de l’ingérence
64. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
i. « Prévue par la loi »
65. Il n’est pas contesté que le refus de renouveler le permis de séjour du requérant et l’obligation de quitter le territoire suisse était fondés sur les dispositions pertinentes de la LSEE (paragraphe 36 ci-dessus).
ii. But légitime
66. Il n’est pas davantage controversé que l’ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir notamment « la défense de l’ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
iii. Nécessité de la mesure dans une société démocratique
67. Il reste donc à examiner si la mesure était « nécessaire dans une société démocratique ».
α) Principes généraux
68. La Cour rappelle que selon un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des étrangers sur leur sol (voir, parmi beaucoup d’autres, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 164, CEDH 2012, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, § 67, 28 mai 1985, série A no 94, Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, § 42, Recueil 1997‑VI). La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de l’ordre public, les États contractants ont la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur leur territoire. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Mehemi c. France, 26 septembre 1997, § 34, Recueil 1997-VI, Dalia c. France, 19 février 1998, § 52, Recueil 1998-I, Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 46, CEDH 2001‑IX, et Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X).
69. Dans l’affaire Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, §§ 54-60, CEDH 2006‑XII, la Cour a eu l’occasion de résumer les critères devant guider les instances nationales dans de telles affaires :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la nationalité des diverses personnes concernées ;
– la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
– la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
– la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
– la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
– l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
70. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical ou la nature temporaire ou définitive de l’interdiction de territoire (Shala c. Suisse, no 52873/09, § 46, 15 novembre 2012, et les références citées).
71. La Cour rappelle que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi. Sa tâche consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, les droits de l’intéressé protégés par la Convention et, d’autre part, les intérêts de la société (Slivenko, précité, § 113, et Boultif, précité, § 47).
72. La Cour rappelle également que les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée, afin notamment de permettre à la Cour d’assurer le contrôle européen qui lui est confié (voir, mutatis mutandis, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 107, CEDH 2013, et El Ghatet c. Suisse, no 56971/10, § 47, 8 novembre 2016). Un raisonnement insuffisant des juridictions internes, sans véritable mise en balance des intérêts en présence, est contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention. C’est le cas lorsque les autorités internes ne parviennent pas à démontrer de manière convaincante que l’ingérence dans un droit protégé par la Convention est proportionnée aux buts poursuivis et qu’elle correspond dès lors à un « besoin social impérieux » au sens de la jurisprudence précitée (El Ghatet, précité, § 47, et mutatis mutandis, Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Suisse, no 34124/06, § 65, 21 juin 2012, Saber et Boughassal c. Espagne, nos 76550/13 et 45938/14, § 51, 18 décembre 2018).
73. En revanche, s’il s’avère que les autorités internes ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents, y englobant une pesée adéquate entre les intérêts personnels du requérant et les intérêts plus généraux de la société, il n’appartient pas à la Cour de se substituer à l’appréciation faite par celles-ci, y compris par rapport à l’examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, sauf s’il existe des raisons importantes pour le faire (voir, dans ce sens, Ndidi c. Royaume-Uni, no 41215/14, § 76, 14 septembre 2017, Hamesevic c. Danemark (déc.), no 25748/15, § 43, 16 mai 2017 and Alam c. Danemark (déc.), no 33809/15, § 35, 6 juin 2017).
β) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
74. En l’occurrence, l’expulsion du requérant a été décidée à la suite de la condamnation de celui-ci pour un viol commis en 2003.
75. Dans son arrêt du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral a estimé que, bien que les faits se fussent déroulés plus de dix ans auparavant, le viol constituait un crime grave pour lequel même un faible risque de récidive ne devait pas être accepté en matière de droit des étrangers. Il a indiqué que, dans le cadre de la pesée des intérêts selon l’article 8 § 2 de la Convention, il fallait choisir, parmi plusieurs interprétations possibles, celle qui était la plus fidèle à la Constitution suisse, tant que cela ne contredisait pas le droit supérieur et n’entrait pas en conflit avec la marge de manœuvre laissée par la Cour aux Hautes Parties contractantes dans l’application de leur politique migratoire. Le Tribunal administratif fédéral a ajouté que la clause d’exclusion de l’article 14a alinéa 6 LSEE (paragraphe 36 ci-dessus) devait être appliquée et que son application, même en tenant compte des difficultés non négligeables que le requérant devrait surmonter à son retour dans son pays d’origine, s’avérait proportionnée.
76. La Cour note que le Tribunal administratif fédéral s’est prononcé sur la gravité de l’infraction commise, a brièvement traité la question du risque de récidive et a fait mention des difficultés auxquelles serait confronté le requérant à son retour au Kosovo. Elle relève cependant que le tribunal a limité son analyse sous l’angle de l’article 8 de la Convention à ces seuls éléments. Alors qu’il statuait plus de douze ans après l’infraction, il n’a nullement pris en compte l’évolution du comportement du requérant depuis la commission de cette infraction (K.M. c. Suisse, no 6009/10, § 54, 2 juin 2015, et les références citées). Il n’a pas non plus évalué l’impact de l’aggravation considérable de l’état de santé de l’intéressé (taux d’invalidité de 80 % depuis le 1er octobre 2012) sur le risque de récidive et ne s’est pas penché sur plusieurs critères établis par la jurisprudence pour apprécier la nécessité de la mesure d’expulsion. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral n’a en particulier pas pris en considération la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux du requérant avec le pays d’hôte, la Suisse, et avec le pays de destination, le Kosovo, ainsi que les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical (Üner, précité, § 58, et Shala, précité, § 46). S’agissant plus spécifiquement du respect de la vie familiale, bien que les tribunaux aient reconnu la dépendance, au moins financière du requérant par rapport à ses enfants majeurs, ils n’ont pas fait une analyse plus approfondie des implications de cette dépendance pour la jouissance des droits du requérant en vertu de l’article 8 de la Convention.
77. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, en appliquant les critères établis dans sa jurisprudence (paragraphes 68 et 69 ci-dessus), aucune conclusion claire ne peut être tirée quant à savoir si les intérêts privés et familiaux du requérant à continuer à pouvoir résider sur le territoire de l’État défendeur l’emporte sur l’intérêt public de ce dernier d’expulser le requérant dans le but d’assumer sa mission de maintien de l’ordre public (voir, mutatis mutandis, El Ghatet, précité, § 52). Si les autorités internes avaient procédé à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause, prenant en compte les différents critères établis par la jurisprudence de la Cour, et si elles avaient indiqué des motifs pertinents et suffisants pour justifier leur décision, la Cour aurait, en ligne avec le principe de subsidiarité, pu le cas échéant être amenée à considérer que les autorités internes n’avaient ni manqué de ménager un juste équilibre entre les intérêts du requérant et de l’État demandeur ni excédé la marge d’appréciation dont elles jouissent dans le domaine de l’immigration (voir, El Ghatet, précité, § 52).
78. Toutefois, la Cour considère que, dans la présente affaire, le Tribunal administratif fédéral a effectué un examen superficiel de la proportionnalité de la mesure de renvoi. Compte tenu de l’absence d’une véritable mise en balance des intérêts en jeu, la Cour estime que les autorités internes ne sont pas parvenues à démontrer de manière convaincante que la mesure d’éloignement prise était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc nécessaire dans une société démocratique.
79. Dès lors, il y aurait violation de l’article 8 de la Convention si le requérant était expulsé.
NARJIS c. ITALIE du 14 février 2019 requête n° 57433/15
 Non violation de l'article 8 :
Non violation de l'article 8 :
Renvoi d'un délinquant étranger au Maroc. La CEDH constate que les juridictions ont mis en balance les liens familiaux du délinquant, en Italie et l'expulsion dans un but de protection de l'ordre public. La montée des actes de récidives, a été déterminante.
Le requérant allègue que son expulsion vers le Maroc a entraîné la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale car il a été obligé de quitter sa mère, son frère et ses sœurs résidant en Italie.
La CEDH relève que le casier judiciaire du requérant comporte une série de condamnations définitives pour des faits graves tels que vol aggravé, vol en habitation, vol avec arme, vol avec violence, plusieurs faits de recel, port d’armes prohibées et évasion (paragraphe 22, ci-dessus), qui dénotent, comme l’indiquent les juridictions nationales et le Gouvernement, une tendance manifeste et croissante à la récidive.
CEDH
a) Ingérence dans le droit protégé par l’article 8
33. La Cour rappelle que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un État. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l’article 8 § 1 de la Convention (Moustaquim c. Belgique, 18 février 1991, § 16, série A no 193).
34. La Cour observe en outre que, dans sa jurisprudence, elle a envisagé l’expulsion de résidents de longue date aussi bien sous le volet de la « vie privée » que sous celui de la « vie familiale », une certaine importance étant accordée sur ce plan au degré d’intégration sociale des intéressés (voir, par exemple, l’arrêt Dalia c. France, 19 février 1998, §§ 42‑45, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
35. En outre, la Cour rappelle que tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n’ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l’article 8. Toutefois, dès lors que l’article 8 protège également le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu, il faut accepter que l’ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8. Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », l’expulsion d’un étranger établi s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. C’est en fonction des circonstances de l’affaire portée devant elle que la Cour décidera s’il convient de mettre l’accent sur l’aspect « vie familiale » plutôt que sur l’aspect « vie privée » (Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 59, CEDH 2006-XII).
36. En l’espèce, la Cour estime que, en raison de la très longue durée du séjour du requérant en Italie (vingt ans), le refus de renouveler son permis de séjour et la décision de le renvoyer du territoire constituent une ingérence dans son droit au respect de la vie « privée » (Hasanbasic c. Suisse, no 52166/09, § 49, 11 juin 2013 et K.M. c. Suisse, no 6009/10, § 47, 2 juin 2015).
37. En revanche, considérant que le requérant n’est ni un mineur, ni un « jeune adulte » (a contrario, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 62, CEDH 2008), mais un adulte de 39 ans, non-marié, sans enfants et qu’il n’a pas démontré l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux, vis-à-vis de sa mère, de ses sœurs et de son frère, tous adultes, la Cour n’examinera pas son grief sous le volet de la vie « familiale » (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 97, CEDH 2003‑X).
b) Justification de l’ingérence
38. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
i. « Prévue par la loi »
39. Il n’est pas contesté que le refus de renouveler le permis de séjour du requérant et l’obligation de quitter le territoire italien étaient prévus par la loi. La Cour relève par ailleurs que les dispositions pertinentes du Texte unique (paragraphe 24 ci-dessus) sont suffisamment claires et précises.
ii. But légitime
40. Il n’est pas davantage controversé que l’ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir notamment « la défense de l’ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
iii. Nécessité de la mesure dans une société démocratique
α) Principes généraux
41. La question essentielle à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux en ce qui concerne l’expulsion d’une personne ayant passé une durée considérable dans un pays hôte dont elle devrait être expulsée à la suite de la commission des infractions pénales sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour (voir notamment Üner, précité, §§ 54-55 et 57-58 ; Maslov c. Autriche [GC] (no 1638/03, §§ 68‑76, CEDH 2008 ; et K.M. c. Suisse, précité). Dans l’affaire Üner, la Cour a eu l’occasion de résumer les critères devant guider les instances nationales dans de telles affaires (§§ 57 et suiv.) :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la nationalité des diverses personnes concernées ;
– la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
– la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
– la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
– la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
– l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
42. La Cour rappelle également que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (Slivenko, précité, § 113). Cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir Maslov, précité, § 76). La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une mesure d’éloignement d’une personne se concilie avec l’article 8 et, en particulier, si elle était nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime poursuivi (Mehemi c. France, 26 septembre 1997, § 34, Recueil 1997-VI ; Dalia, précité, § 52 ; Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 46, CEDH 2001‑IX).
43. Cela étant, l’obligation d’un « contrôle européen » ne signifie pas que lorsqu’elle est amenée à déterminer si une mesure litigieuse a ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence, la Cour doive nécessairement apprécier de nouveau la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits garantis par l’article 8. Au contraire, dans les affaires qui traitent de l’article 8, la Cour considère généralement que dès lors que les juridictions internes ont examiné les faits avec soin, en toute indépendance et impartialité, qu’elles ont appliqué, dans le respect de la Convention et de sa jurisprudence, les normes applicables en matière de droits de l’homme et qu’elles ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts personnels du requérant et l’intérêt général, elle n’a pas à substituer sa propre appréciation du fond de l’affaire (en particulier, sa propre appréciation des éléments factuels relatifs à la question de la proportionnalité) à celle des autorités nationales compétentes. Seuls font exception à cette règle les cas où il est démontré que des raisons sérieuses justifient d’y déroger (Ndidi c. Royaume-Uni, no 41215/14, § 76, 14 septembre 2017).
β) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
44. La Cour relève que le casier judiciaire du requérant comporte une série de condamnations définitives pour des faits graves tels que vol aggravé, vol en habitation, vol avec arme, vol avec violence, plusieurs faits de recel, port d’armes prohibées et évasion (paragraphe 22, ci-dessus), qui dénotent, comme l’indiquent les juridictions nationales et le Gouvernement, une tendance manifeste et croissante à la récidive.
Même après avoir fait l’objet d’une première mesure d’expulsion, motivée précisément par sa tendance à récidiver, le requérant fut à nouveau arrêté, à sa sortie du C.I.E. de Milan, et encore une fois condamné pour vol aggravé (paragraphe 17, ci-dessus).
45. Il est vrai que le requérant a séjourné en Italie depuis longtemps avec sa mère, ses deux sœurs et son frère.
46. Il n’est pas non plus contesté que, à l’époque des faits, bien qu’ayant passé la plus part de son enfance au Maroc, avant de rejoindre son père en Italie à l’âge de dix ans, le requérant ne semblait pas avoir d’attaches particulières avec son pays, autres que sa culture et sa nationalité.
47. Cela étant, la Cour rappelle que le requérant est un adulte de 39 ans, non marié, sans enfants et sans liens de dépendance particuliers vis-à-vis de sa famille (paragraphe 38, ci-dessus).
48. En outre, au vu de son parcours délictuel, de l’usage courant de stupéfiants et de son apparente incapacité à s’intégrer dans le monde du travail, les autorités italiennes ont pu légitimement douter de la solidité de ses liens sociaux et culturels dans le pays hôte.
La Cour relève d’ailleurs que, comme l’indique le Gouvernement, si le requérant devait retourner en Italie, il serait immédiatement arrêté et emprisonné pour purger une peine de quatre ans et sept mois de prison pour recel (paragraphes 23 et 29 ci-dessus).
49. La Cour note que le Conseil d’État, dans un arrêt longuement motivé, ne révélant aucune trace d’arbitraire et se référant explicitement à l’article 8 de la Convention, a pris toutes ces circonstances en compte pour mettre en balance l’intérêt du requérant à la protection de sa vie privée avec l’intérêt de l’État à la sauvegarde de l’ordre public, en application des critères établis par la Cour (paragraphe 41, ci-dessus).
50. Cet arrêt fut prononcé suite à une longue procédure au cours de laquelle le TAR de Milan, exerçant pleinement son rôle de juge conventionnel, avait une première fois suspendu la décision de non renouvellement du titre de séjour du requérant, considérant que les autorités de police n’avaient pas procédé à un exercice suffisant de mise en balance des différents intérêts en jeu, comme l’exigeait la jurisprudence de la Cour (paragraphe 13, ci-dessus).
Dans un deuxième temps, le 14 février 2012, le TAR avait considéré que les autorités de police, en application de sa première décision, s’étaient conformées aux exigences de l’article 8 de la Convention, en procédant à la mise en balance des différents intérêts en jeu et en prenant dûment en compte la durée de séjour du requérant en Italie, sa position familiale et les liens sociaux qu’il avait tissés dans le pays (paragraphe 20, ci-dessus).
51. Dans de pareilles circonstances, la Cour n’aperçoit aucune raison sérieuse l’amenant à substituer son avis à celui des juridictions internes (Ndidi précité, § 81 et Levakovic c. Danemark, no 7841/14, § 45, 23 octobre 2018).
52. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Saber et Boughassal c. Espagne du 18 décembre 2018 requête n° 76550/13
Violation de l'article 8 : L’expulsion de deux ressortissants marocains condamnés pénalement, sans examen suffisant de leurs situations, a violé leur droit au respect de leur vie privée
L’affaire concerne l’ordre d’expulsion de deux ressortissants marocains à la suite de condamnations pénales en Espagne. La Cour juge en particulier que les autorités nationales ne se sont pas penchées sur la nature et la gravité des infractions pénales en cause, pas plus que sur les autres critères établis par la jurisprudence de la Cour, pour apprécier la nécessité des mesures d’expulsion et d’interdiction du territoire. Elle conclut que les autorités n’ont pas mis en balance tous les intérêts en jeu afin d’apprécier, dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, si les mesures litigieuses étaient proportionnées aux buts légitimes poursuivis et donc nécessaires dans une société démocratique.
LES FAITS
Les requérant, Aziz Saber et Hamza Boughassal, sont des ressortissants marocains, nés en 1985 et 1987 au Maroc. En juin 2008 pour l’un et à une date indéterminée pour l’autre, Aziz Saber fut condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et Hamza Boughassal à une peine d’emprisonnement de trois ans et un jour d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. La direction générale de la police et de la garde civile entama des procédures d’expulsion en raison de ces condamnations pénales. Le 11 novembre 2010 et le 1 er août 2011, les sous-délégations du gouvernement central décrétèrent l’expulsion des requérants, assortie d’une interdiction de territoire d’une durée de quatre ans pour Aziz Saber et de dix ans pour Hamza Boughassal. Les requérants firent opposition à leur expulsion. Le 22 juin 2011, le juge du contentieux administratif rejeta le recours de Aziz Saber et confirma son expulsion. Le 9 juillet 2012, le juge du contentieux administratif fit partiellement droit à la demande de Hamza Boughassal et réduisit l’interdiction du territoire à une durée de trois ans. En octobre 2012 et en mai 2013, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne débouta les requérants de leur recours. Le Tribunal précisa que les arrêtés d’expulsion pris à leur encontre en application de l’article 57 § 2 de la loi portant sur les droits des étrangers ne constituaient pas une sanction, mais étaient la conséquence légale de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal. Il s’ensuivait aussi que l’article 57 § 5 de la même loi n’était pas applicable et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les liens des requérants avec l’Espagne. Le Tribunal ajouta que le titre de séjour de Aziz Saber n’était pas pertinent en l’espèce, étant donné que l’expulsion entraînait automatiquement l’extinction de toute autorisation de séjour. Enfin, le Tribunal estima que sa condamnation pénale mettait en évidence le fait qu’il ne respectait pas les règles de la convivialité et qu’il ne pouvait, par conséquent, être considéré comme enraciné en Espagne. Les requérants formèrent chacun un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. La haute juridiction déclara le recours irrecevable au motif que les requérants n’avaient pas satisfait à l’obligation de démontrer que leurs recours revêtaient une importance constitutionnelle spéciale.
ARTICLE 8
a) Principes généraux
38. La Cour rappelle que tous les personnes immigrées établies, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont elles sont censées être expulsées, n’ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention. Toutefois, dès lors que cet article protège également le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu, il faut accepter que l’ensemble des liens sociaux entre les personnes immigrées établies et la communauté dans laquelle elles vivent fait partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de cet article. Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », l’expulsion d’une personne immigrée établie s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. C’est en fonction des circonstances de l’affaire portée devant elle que la Cour décidera s’il convient de mettre l’accent sur l’aspect « vie familiale » plutôt que sur l’aspect « vie privée » (Üner, précité, § 59) et Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 63, CEDH 2008).
39. La Cour a établi dans le passé que les rapports entre des parents et enfants adultes ou entre frères et sœurs adultes ne bénéficient pas de la protection de l’article 8 de la Convention sous le volet de la « vie familiale » sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Slivenko, précité, § 97), CEDH 2003‑X, Balogun, précité, § 43, et Senchishak c. Finlande, no 5049/12, § 55, 18 novembre 2014). Toutefois, elle a admis dans un certain nombre d’affaires concernant de jeunes adultes qui n’avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d’autres membres de leur famille proche s’analysaient également en une « vie familiale » (Bouchelkia c. France, 29 janvier 1997, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, et Maslov, précité, § 62). Elle estime que, en tout état de cause, les liens entre adultes et parents ou autres proches peuvent être pris en considération sous le volet de la « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention (Slivenko, précité, § 97).
40. Pour apprécier la question de savoir si une mesure d’expulsion et/ou d’interdiction du territoire est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi au titre de l’article 8 § 2 de la Convention, la Cour a, dans sa jurisprudence, énuméré les critères devant être utilisés (Üner, précité, §§ 54-60, et Maslov, précité, §§ 68-76). Ces critères sont les suivants (Üner, précité, §§ 57 et 58) :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la nationalité des diverses personnes concernées ;
– la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
– la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
– la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, si oui, leur âge ;
– la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
– l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
41. La Cour rappelle que ces critères s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né (Üner, précité, § 55, et Balogun, précité, § 45). Toutefois, l’âge de la personne concernée peut jouer un rôle dans l’application de certains des critères susmentionnés. Par exemple, pour apprécier la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant, il y a lieu d’examiner s’il l’a perpétrée alors qu’il était adolescent ou à l’âge adulte (Maslov, précité, § 72). Par ailleurs, lorsque l’on examine la durée du séjour du requérant dans le pays dont il doit être expulsé et la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, la situation n’est évidemment pas la même si la personne concernée est arrivée dans le pays dès son enfance ou sa jeunesse, voir y est née, ou si elle y est seulement venue à l’âge adulte (idem, § 73). La Cour a déjà établi que, s’agissant d’un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l’intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d’accueil, il y a lieu d’avancer de très solides raisons pour justifier l’expulsion (idem, § 75).
42. Enfin, la Cour rappelle que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article 8 de la Convention et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi. Cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une mesure d’expulsion se concilie avec l’article 8 (Maslov, précité, § 76). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 8 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Gablishvili c. Russie, nº 39428/12, § 48, 26 juin 2014). Elle rappelle que, si l’article 8 ne contient pas d’exigences procédurales explicites, le processus décisionnel conduisant à des mesures d’ingérence n’en doit pas moins être équitable et respecter comme il se doit les intérêts de l’individu protégés par cet article (Liou c. Russie (no 2), no 29157/09, § 86, 26 juillet 2011). Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (voir, dans ce sens, Ndidi c. Royaume-Uni, no 41215/14, §§ 76-82, 14 septembre 2017, et Hamesevic c. Danemark (déc.), no 25748/15, §§ 31-46, 16 mai 2017).
b) Application des principes susmentionnés aux cas d’espèce
43. La Cour note d’emblée que le premier requérant était célibataire au moment de l’imposition de la mesure litigieuse et que ses liens avec sa mère et ses frères et sœurs résidents en Espagne ne sauraient être qualifiés de « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention, en l’absence d’éléments supplémentaires démontrant une dépendance. Quant au second requérant, elle note qu’il s’était marié avec une ressortissante marocaine entrée en Espagne dans le cadre du regroupement familial, ce qui permet de constater l’existence d’une « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention. En tout état de cause, elle relève que, même si l’âge exact auquel les requérants étaient arrivés en Espagne n’a pas pu être déterminé avec exactitude (paragraphes 6, 7 et 12 ci-dessus), il n’est pas contesté qu’ils y étaient scolarisés au moins depuis l’âge de douze ans et que le second requérant y était arrivé même avant (paragraphe 7 ci-dessus). Elle note qu’ils ont reçu l’enseignement obligatoire secondaire en Espagne et qu’ils ont obtenu des permis de résidence temporaires jusqu’à l’obtention de leurs permis de résidence de longue durée. Compte tenu de la durée du séjour des requérants en Espagne, ainsi que des rapports qu’ils entretenaient avec leurs proches parents établis dans cet État, la Cour considère que les mesures litigieuses doivent s’analyser en une ingérence dans leur droit au respect de leur « vie privée ».
44. La Cour n’a aucune difficulté à admettre que les mesures incriminées étaient prévues par la loi et qu’elles poursuivaient les buts légitimes que constituent la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé.
45. Il reste donc à examiner si les mesures litigieuses étaient nécessaires dans une société démocratique.
46. À titre liminaire, la Cour note que le Tribunal supérieur de justice de Catalogne, ainsi que le juge du contentieux administratif s’agissant du second requérant, ont considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les attaches des requérants avec l’Espagne, au motif que l’obligation de prendre en considération les circonstances personnelles et familiales des résidents de longue durée imposée par l’article 57 § 5 b) de la loi portant sur le droit des étrangers ne s’appliquait pas au cas de figure visé à l’article 57 § 2 de cette loi, sur le fondement duquel les arrêtés d’expulsion contre les requérants avaient été prononcés. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche d’interpréter la législation interne ni de déterminer quelle était l’interprétation la plus correcte de ces dispositions. Toutefois, elle observe, tel que le juge dissident l’a souligné dans son opinion partiellement dissidente aux deux arrêts du Tribunal supérieur de justice de Catalogne, que d’autres Tribunaux supérieurs de justice interprétaient la notion de « sanction » de l’article 57 § 5 de la loi portant sur le droit des étrangers dans un sens large, de manière à ce que la mise en balance des circonstances personnelles et familiales du ressortissant étranger fût exigée aussi dans le cas de figure prévu à l’article 57 § 2 de la loi (paragraphe 16 ci-dessus ; voir dans un sens similaire, l’arrêt de la CJUE du 7 décembre 2017, paragraphe 23 ci-dessus). Elle note de surcroît la position du Gouvernement selon laquelle, conformément à un arrêt du Tribunal constitutionnel de 2013, les juridictions administratives doivent faire une interprétation combinée de ces deux dispositions lorsque le droit à la vie familiale d’autrui, par exemple d’un mineur, entre en conflit avec une mesure d’expulsion, même dans les cas où celle-ci est prononcée sur la base de l’article 57 § 2 de la loi portant sur le droit des étrangers (paragraphes 20-21 et 35 ci-dessus).
47. La Cour ne voit pas de raison de ne pas appliquer ce raisonnement à toutes les mesures d’expulsion des personnes immigrées, indépendamment de l’existence ou non des droits des tiers affectés, d’une vie familiale, ainsi que de la modalité ou de la base juridique de la mesure d’expulsion en droit interne (voir, sur ce dernier aspect, l’arrêt de la CJUE du 7 décembre 2017, paragraphe 23 ci-dessus). Elle rappelle à cet égard que l’ensemble des critères établis dans sa jurisprudence (paragraphes 40-41 ci-dessus) doivent être pris en compte et guider les instances nationales dans toutes les affaires concernant des personnes immigrées établies censées être expulsées et/ou interdites du territoire à la suite d’une condamnation pénale, au regard soit de l’aspect « vie familiale » soit de l’aspect « vie privée », en fonction des circonstances de chaque affaire (voir, mutatis mutandis, Üner, précité, § 60).
48. La Cour ne saurait accepter la thèse du Gouvernement selon laquelle la mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et familiale et le respect de l’ordre public a été déjà réalisé par le législateur avec l’adoption de l’article 57 § 2 de la loi portant sur le droit des étrangers, qui prévoit une mesure d’expulsion en cas de condamnation pénale pour un délit intentionnel passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an. La Cour rappelle à cet égard que la nature et la gravité de l’infraction commise par le ressortissant étranger n’est qu’un des critères qui doivent être mis en balance par les autorités nationales lorsqu’elles apprécient la nécessité d’une mesure d’expulsion au regard des droits protégés par l’article 8 de la Convention.
49. La Cour observe que les autorités nationales ont procédé en l’espèce à une mise en balance des intérêts présents uniquement en ce qui concerne la durée de l’interdiction du territoire frappant les deux requérants. Pour ce qui est du premier requérant, les autorités administratives ont fixé l’interdiction à quatre ans, alors que l’instructeur de la procédure administrative avait proposé qu’elle soit de cinq ans. S’agissant du second requérant, le juge du contentieux administratif a fait partiellement droit à son recours et a réduit la durée de l’interdiction du territoire de dix à trois ans, compte tenu du principe de proportionnalité et de ses circonstances personnelles et familiales. Par ailleurs, alors que le juge du contentieux administratif dans le cas du premier requérant s’est référé de manière succincte à l’absence de liens sociaux et professionnels de l’intéressé avec l’Espagne, la Cour observe que le Tribunal supérieur de justice de Catalogne a refusé explicitement d’examiner la proportionnalité des mesures litigieuses sur le fondement de la non-applicabilité de l’article 57 § 5 b) de la loi portant sur le droit des étrangers au cas de figure des requérants. Elle note également que cette juridiction a considéré que la condamnation pénale frappant le premier requérant mettait en évidence qu’il ne pouvait pas être considéré comme enraciné en Espagne car il ne respectait pas les règles de convivialité du pays d’accueil. Or elle considère que la nature et la gravité de l’infraction commise par un ressortissant étranger doit être mise en balance avec les autres critères issus de sa jurisprudence (paragraphes 40-41 ci-dessus), mais que ladite infraction ne saurait démontrer à elle seule le manque de liens sociaux ou familiaux de l’intéressé avec le pays hôte.
50. Si la Cour admet que les condamnations pénales des requérants pour trafic de stupéfiants (comparer avec Maslov, précité, § 80, Baghli c. France, no 34374/97, § 48, CEDH 1999‑VIII, et Salem c. Danemark, no 77036/11, § 66, 1er décembre 2016) ainsi que leur conduite depuis la commission des infractions (paragraphe 10 ci-dessus) ne semblaient pas plaider en leur faveur, il n’en reste pas moins que les autorités nationales, notamment dans les décisions litigieuses du Tribunal supérieur de justice, ne se sont pas penchées sur la nature et la gravité des infractions pénales commises dans les cas concrets ni sur les autres critères établis par sa jurisprudence pour apprécier la nécessité des mesures d’expulsion et d’interdiction du territoire en l’espèce. Ainsi, par exemple, le Tribunal supérieur de justice n’a pas pris en considération dans ses décisions la durée du séjour des requérants en Espagne (notamment le fait qu’ils étaient scolarisés en Espagne au moins depuis l’âge de douze ans et qu’ils y avaient passé une grande partie de leur adolescence et de leur jeunesse), la situation familiale du second requérant ou la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux que les intéressés entretenaient avec le pays hôte, l’Espagne, et le pays de destination, le Maroc (comparer avec Ndidi, précité, §§ 77-81).
51. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les autorités nationales n’ont pas mis en balance tous les intérêts en jeu afin d’apprécier, dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, si les mesures litigieuses étaient proportionnées aux buts légitimes poursuivis et donc nécessaires dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Gablishvili, précité, § 60).
52. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
Ndidi c. Royaume-Uni du 14 septembre 2017 requête no 41215/14
Article 8 : Pas de motif pour remettre en question la décision des autorités d’expulser un ressortissant nigérian. Le fait qu'il a un enfant avec une anglaise ne peut pas s'imposer face aux faits pénaux de plus en plus graves qu'il commet, alors que le ministère d l'intérieur l'avait auparavant personnellement prévenu, à sa majorité.
LES FAITS
Le requérant, Ifeanyi Chukwu Ndidi, est un ressortissant nigérian né en 1987 et résidant à Londres. M. Ndidi entra au Royaume-Uni avec sa mère en 1989 et obtint une autorisation de séjour illimitée dans ce pays en 2003. En 1999, alors qu’il était âgé de 12 ans, il reçut des avertissements de la police pour des infractions de vol avec violences.
À quatre occasions en 2003 et 2004, il fut reconnu coupable d’un certain nombre d’infractions, et notamment de vol qualifié, de coups et blessures et de cambriolage. À ldernière de ces occasions, en novembre 2004, il fut condamné à trois années de détention dans un établissement spécial pour jeunes délinquants.
En 2006, le ministre de l’Intérieur l’avertit que s’il commettait une nouvelle infraction à l’avenir, il pourrait être passible d’expulsion.
En 2008, M. Ndidi plaida coupable de vente de stupéfiants de catégorie A.
En mars 2009, il fut condamné à une peine de sept années d’emprisonnement à laquelle la cour d’appel substitua ultérieurement une peine de sept années de détention dans un établissement pour jeunes délinquants. Lorsqu’il fut remis en liberté en mars 2011, il lui fut notifié une décision indiquant qu’il était passible d’un renvoi automatique et qu’un renvoi n’emporterait pas violation de ses droits, ni au titre de la Convention relative au statut des réfugiés ni au titre de la Convention européenne des droits de l’homme. Son recours contre cette décision fut initialement accueilli, mais cette décision fut ultérieurement annulée et son recours fut rejeté par le tribunal supérieur (Upper Tribunal) en avril 2012. Le tribunal supérieur considérait que même si M. Ndidi résidait depuis longtemps au Royaume-Uni et s’il y avait des liens familiaux, des raisons sérieuses justifiaient de l’expulser. En particulier, il avait un long passé de délinquant ; il avait été dûment mis en garde mais il avait eu beau s’engager à changer de vie, il avait continué à se livrer au trafic de stupéfiants et à s’enfoncer dans la délinquance et enfin, pendant qu’il purgeait sa dernière peine en date, il avait fait l’objet de 16 procédures disciplinaires, majoritairement pour des faits de violence et de désobéissance. Concernant le danger qu’il représentait pour la société, le tribunal supérieur jugeait difficile de croire l’intéressé lorsqu’il assurait qu’il était en train de changer de vie, étant donné qu’il avait déjà promis de le faire dans le passé. De plus, il avait un âge auquel il pouvait passer pour capable de prendre un nouveau départ au Nigéria, où vivaient un certain nombre de membres de sa famille. Les tribunaux refusèrent à M. Ndidi l’autorisation de faire appel. En novembre 2012, M. Ndidi communiqua à la ministre de l’Intérieur de nouveaux arguments qui mettaient en avant sa relation avec une ressortissante britannique n’ayant aucun lien avec le Nigéria ainsi que la naissance de leur fils, en octobre 2012. Cependant, la ministre de l’Intérieur refusa d’annuler l’arrêté d’expulsion. Elle confirma ce refus dans une nouvelle décision en avril 2013, après avoir étudié les arguments de M. Ndidi à la lumière des nouvelles règles sur l’immigration.
À la suite de modifications adoptées le 9 juillet 2012, les règles sur l’immigration disposaient en particulier qu’il était dans l’intérêt général d’expulser des délinquants étrangers dès lors que ceux-ci avaient été condamnés à une peine de quatre ans d’emprisonnement ou plus et qu’en pareil cas, seules des « circonstances exceptionnelles » permettaient de faire passer l’intérêt général au second plan. Le tribunal de première instance (first-tier Tribunal) rejeta le recours de M. Ndidi en septembre 2013. Il considérait en premier lieu que la relation qu’entretenait l’intéressé avec une ressortissante britannique et la naissance de leur enfant ne s’assimilaient pas à des « circonstances exceptionnelles » telles que les concevaient les règles sur l’immigration. Il estimait en second lieu que les droits de M. Ndidi garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne l’emportaient pas sur l’intérêt légitime à maintenir un contrôle approprié de l’immigration. Il notait en particulier que M. Ndidi n’avait révélé sa situation au regard du droit des étrangers à sa partenaire qu’après que celle-ci fût enceinte ; que lui et sa partenaire n’avaient jamais vécu ensemble ; que la famille de sa partenaire résidant au Royaume-Uni apportait à celle-ci et à son enfant toute l’aide nécessaire et qu’elle continuerait de le faire après l’expulsion de M. Ndidi et que son enfant pourrait lui rendre visite au Nigéria afin d’entretenir les liens familiaux. En décembre 2013, les tribunaux refusèrent à M. Ndidi l’autorisation de faire appel.
LA CEDH
Pour ce qui concerne le grief relatif à la version modifiée des règles sur l’immigration, la Cour conclut que M. Ndidi ne l’a pas soulevé devant le dernier degré de juridiction national – dans sa demande d’autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel – et le déclare donc irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes.
En ce qui concerne le second grief soulevé par M. Ndidi, la Cour rappelle que les États contractants disposent d’une certaine marge de manœuvre (la « marge d’appréciation ») pour décider si une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale était nécessaire dans une société démocratique et si elle présentait un caractère proportionné. La marge de manœuvre consentie à l’État va de pair avec un contrôle européen.
Cependant, pareil contrôle ne signifie pas que la Cour doive procéder à une nouvelle appréciation de la proportionnalité au regard de l’article 8, surtout lorsque des juridictions nationales indépendantes et impartiales ont soigneusement examiné les faits de la cause, appliquant les normes pertinentes dans le domaine des droits de l’homme conformément à la Convention européenne et à la jurisprudence y afférente. Il faut des raisons sérieuses pour que la Cour substitue sa propre appréciation du fond de l’affaire à celle qui a été effectuée par les autorités nationales. En l’espèce, indépendamment du point de savoir si les règles sur l’immigration ont imposé des exigences plus strictes que celles découlant de la Convention, toutes les autorités internes, du ministre de l’Intérieur jusqu’au tribunal de première instance et au tribunal supérieur, ont procédé à un examen détaillé et attentif de l’impératif de proportionnalité requis par l’article 8 de la Convention, y compris des critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour relative à l’expulsion des immigrés établis. Ainsi, ayant mis en balance les droits de M. Ndidi et l’intérêt général à ce que celui-ci soit expulsé, les autorités nationales ont conclu que son expulsion ne constituerait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il ne fait aucun doute que les faits dans l’affaire de M. Ndidi requièrent un examen scrupuleux étant donné la durée du séjour de l’intéressé au Royaume-Uni, les relations qu’il entretient avec son fils et d’autres membres de sa famille dans ce pays et ses liens ténus avec son pays d’origine.
Cependant, au vu de son long passé de délinquant durant lequel il a enchaîné des infractions de plus en plu graves, même après que le ministre de l’Intérieur lui a adressé un avertissement en 2006 et même après que l’intéressé a atteint l’âge de la majorité, la Cour ne décèle aucun motif de remettre en question la décision de l’expulser prise par les autorités nationales. De plus, depuis que les autorités nationales ont rendu leur dernière décision en date, il n’est intervenu dans la situation de M. Ndidi aucun changement qui pourrait fournir à la Cour des raisons sérieuses de substituer sa propre appréciation de la proportionnalité à celle qui a été effectuée par les autorités internes. En fait, depuis la dernière décision rendue au niveau interne, la relation entre M. Ndidi et sa partenaire a pris fin et celui-ci ne voit plus son fils qu’un dimanche sur deux. Partant, la Cour dit que l’expulsion de M. Ndidi ne serait pas contraire à l’article 8 de la Convention.
K2 c. Royaume-Uni Irrecevabilité du 9 mars 2017 requête no 42387/13
Article 8 : La déchéance de nationalité d’une personne soupçonnée de terrorisme a été conforme à la Convention.
Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
Déchéance de la nationalité britannique
La Cour considère qu’un refus d’octroi ou une déchéance de nationalité arbitraires peuvent dans certaines circonstances poser problème sur le terrain de l’article 8 en raison de leurs répercussions sur la vie privée de l’intéressé. Deux questions appellent un examen : celle du caractère arbitraire ou non de la déchéance et celle des conséquences de cette mesure pour le requérant. La déchéance de nationalité dont K2 est frappé n’est pas arbitraire. Premièrement, elle est « prévue par la loi » puisque l’article 40(2) de la loi de 1981 sur la nationalité britannique habilite le ministre de l’Intérieur à prononcer la déchéance de la nationalité britannique, et que la Couronne jouit d’une prérogative de common law lui permettant de refouler toute personne du territoire britannique. Deuxièmement, les autorités ont agi avec célérité et diligence : des éléments indiquaient que K2 avait quitté le territoire en octobre 2009 et s’était livré en Somalie à des activités en rapport avec le terrorisme, et la ministre de l’Intérieur l’a déchu de la nationalité en juin 2010. Troisièmement, la Cour relève que K2 a joui de garanties procédurales suffisantes concernant cette décision. La loi permettait à K2 de saisir la SIAC, devant laquelle un exposé clair des éléments à charge relevant de la sécurité nationale lui avait été remis. Pour ce qui est des pièces confidentielles, la Cour constate que K2 a été représenté par un conseil et par des avocats spéciaux désignés aux fins de l’examen de ces éléments. Elle rappelle avoir précédemment jugé que les procédures similaires devant la SIAC offraient les garanties suffisantes prescrites par l’article 81. K2 soutenait qu’on lui avait refusé la possibilité d’être effectivement associé à la procédure du fait de son interdiction de territoire, affirmant que les autorités soudanaises risquaient de se servir de tout échange avec ses avocats depuis le Soudan pour lui nuire. Or, ce n’est pas parce qu’un recours contre une déchéance de nationalité est formé depuis l’étranger que celle-ci est forcément « arbitraire » et l’article 8 ne peut être interprété comme donnant à l’État l’obligation positive de faciliter le retour de toute personne déchue de sa nationalité de manière à lui permettre d’attaquer cette mesure. La SIAC a estimé que les craintes de K2 concertant l’interception de ses communications étaient infondées – et cette conclusion ne contredisait pas les constats de la High Court et de la Cour d’appel dans le cadre de la procédure en contrôle judiciaire. De plus, si elle a analysé avec une rigueur particulière le dossier, K2 n’ayant pas constitué avocat, elle n’en a pas moins relevé des éléments concluants prouvant qu’il s’était livré à des activités en rapport avec le terrorisme. Elle a ajouté que, de toute manière, c’était au départ K2 qui avait choisi de quitter le pays. Enfin, la Cour a également noté la raison pour laquelle K2 avait dû former son recours hors du territoire britannique : sa décision de quitter le pays au lieu de comparaître après avoir été libéré sous caution.Quant aux conséquences de la déchéance de nationalité, la Cour observe que cette mesure n’a pas rendu K2 apatride étant donné que ce dernier avait droit à un passeport soudanais (et en avait obtenu un). De plus, elle note que la SIAC a constaté que K2 avait quitté le territoire britannique antérieurement à la décision ordonnant son expulsion ; que son époux et son enfant n’habitaient plus au Royaume-Uni et étaient libres de se rendre au Soudan ; et que la propre famille natale du requérant pouvait lui rendre visite et le faisait assez souvent. Au vu de ces éléments, la Cour estime manifestement infondée la thèse de K2 voyant dans sa déchéance de nationalité une violation de l’article 8.
Interdiction de territoire
Si la Cour estime que l’interdiction de territoire dont K2 a été frappé s’analyse en une ingérence dans sa vie privée et familiale, elle relève également que cette ingérence est limitée et prend note des constats sans équivoque de la SIAC sur l’ampleur des activités de K2 en rapport avec le terrorisme. L’interdiction de territoire n’était donc pas disproportionnée au but légitime consistant à protéger la population de la menace du terrorisme. La Cour en conclut que ce volet de la requête de K2 est lui aussi manifestement infondé.
Article 14 (interdiction de discrimination) en combinaison avec l’article 8
Pour ce qui est du grief tiré par K2 de la différence de traitement dont il aurait fait l’objet par rapport aux ressortissants britanniques considérés comme une menace pour la sécurité nationale – parce qu’il possède une seconde nationalité –, la Cour constate que les juridictions internes n’en ont pas été saisies. K2 n’a donc pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes. K2 considère également qu’il a fait l’objet d’une différence de traitement par rapport aux résidents étrangers parce que ceux-ci jouissent d’un recours suspensif contre la révocation de leur permis de séjour sur le territoire britannique. La Cour juge cette thèse infondée. K2 s’est vu refuser un recours dans le pays non pas parce qu’il avait la nationalité britannique, mais parce qu’il avait déjà quitté le territoire à la date d’adoption des décisions litigieuses. Un résident étranger dont le permis de séjour serait annulé alors qu’il se trouve hors du territoire ne serait pas non plus autorisé à y revenir aux fins d’un recours. Dès lors, la Cour juge ce volet du grief manifestement infondé, et donc irrecevable.
Grande Chambre PAPOSHVILI c. BELGIQUE du 13 décembre 2016 requête 41738/19
Article 8, atteint d'une leucémie, le requérant auteur de plusieurs vols ne pouvait pas être éloigné de sa famille sans apprécier si sa famille pouvait ou non rentrer avec lui, en Georgie.
221. En ce qui concerne l’applicabilité de l’article 8 et l’angle d’examen, la Grande Chambre part des mêmes postulats que la chambre (§§ 136-138 de l’arrêt de la chambre). Tout d’abord, il n’est pas contesté qu’il existait une vie familiale entre le requérant, son épouse et les enfants nés en Belgique, rendant sans pertinence la controverse quant à la paternité du requérant vis-à-vis de l’enfant qui est née avant leur arrivée en Belgique et a, depuis, atteint l’âge adulte (ibidem, § 136). De plus, à supposer que la mesure de renvoi ait pu être examinée sous l’angle de la vie privée du requérant, eu égard aux questions particulières posées par l’espèce et aux arguments développés par les parties, c’est le volet « vie familiale » qui l’emporte. Ensuite, si l’affaire concerne à la fois le refus par les autorités nationales d’autoriser le requérant à résider en Belgique et la menace de le renvoyer en Géorgie, vu les particularités de l’affaire et ses récents développements, la chambre a considéré que la question centrale était celle de savoir si les autorités belges avaient l’obligation d’autoriser le requérant à séjourner en Belgique pour lui permettre de demeurer auprès de sa famille (ibidem, § 138). La Grande Chambre est d’avis qu’envisager ainsi le grief tiré d’une violation de l’article 8 sous l’angle des obligations positives des autorités belges s’impose de manière plus évidente encore en raison de l’évolution de l’affaire et en particulier de la détérioration de l’état de santé du requérant et finalement de son décès. Enfin, la Grande Chambre rappelle que, sur le terrain des obligations positives comme sur celui des obligations négatives, l’État doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble, et que l’étendue des obligations pour l’État varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général (ibidem, § 140, et références citées).
222. Cela étant, à la différence de la chambre, après avoir observé que les autorités belges n’ont examiné les données médicales du requérant et l’impact de son éloignement sur son état de santé dans aucune des procédures diligentées par lui, la Grande Chambre a conclu qu’il y aurait eu violation de l’article 3 de la Convention si le requérant avait été éloigné vers la Géorgie sans une telle évaluation (voir paragraphe 206, ci-dessus).
223. La Cour observe que les autorités belges n’ont a fortiori pas non plus examiné, sous l’angle de l’article 8, le degré de dépendance à la famille que la dégradation de l’état de santé avait induit dans le chef du requérant. Dans le cadre de la procédure en régularisation pour raison médicale, le CCE a en effet écarté le grief tiré par le requérant de l’article 8 au motif que la décision de refus de séjour n’était pas assortie d’une mesure d’éloignement du territoire (voir paragraphe 58, ci-dessus).
224. Or, pas davantage que sur le terrain de l’article 3, il ne revient à la Cour de procéder à une évaluation, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, de l’impact de l’éloignement sur la vie familiale du requérant, compte tenu de l’état de santé de ce dernier. À ce titre, la Cour considère que non seulement cette tâche appartient aux autorités nationales, responsables en la matière, mais aussi qu’il s’agit d’une obligation procédurale incombant à ces autorités pour assurer l’effectivité du droit au respect de la vie familiale. Comme elle l’a rappelé ci-dessus (voir paragraphe 184), le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme.
225. Il en résulte que si les autorités belges avaient, in fine, conclu que l’article 3 de la Convention tel qu’interprété ci-dessus ne faisait pas obstacle au renvoi du requérant en Géorgie, il leur aurait appartenu, pour se conformer à l’article 8, d’examiner en outre si, eu égard à la situation concrète du requérant au moment du renvoi (voir, mutatis mutandis, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 93, CEDH 2008), on pouvait raisonnablement attendre de la famille qu’elle le suivît en Géorgie ou si, dans le cas contraire, le respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale exigeait qu’il fût autorisé à séjourner en Belgique pour le temps qui lui restait à vivre.
>226. Il s’ensuit que, si le requérant avait été éloigné vers la Géorgie sans évaluation desdites données, il y aurait également eu violation de l’article 8 de la Convention.
KM C. Suisse du 2 juin 2015 requête 6009/10
Non violation article 8 de la Convention : Le requérant albanais n'a pas de famille en Suisse , il y est arrivé à l'âge de 29 ans et a été condamné pour trafic de drogue. Son renvoi ne porte pas atteinte à la CEDH.
a. Ingérence dans le droit protégé par l’article 8
44. La Cour rappelle que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un État. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l’article 8 § 1 de la Convention (Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, § 16, série A no 193).
45. La Cour observe en outre que, dans sa jurisprudence, elle a envisagé l’expulsion de résidents de longue date aussi bien sous le volet de la « vie privée » que sous celui de la « vie familiale », une certaine importance étant accordée sur ce plan au degré d’intégration sociale des intéressés (voir, par exemple, l’arrêt Dalia c. France, 19 février 1998, §§ 42‑45, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
46. En outre, la Cour rappelle que tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n’ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l’article 8. Toutefois, dès lors que l’article 8 protège également le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu, il faut accepter que l’ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8. Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », l’expulsion d’un étranger établi s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. C’est en fonction des circonstances de l’affaire portée devant elle que la Cour décidera s’il convient de mettre l’accent sur l’aspect « vie familiale » plutôt que sur l’aspect « vie privée » (Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 59, CEDH 2006-XII).
47. Pour ce qui est des circonstances de l’espèce, la Cour estime que, en raison de la très longue durée du séjour du requérant en Suisse, le refus de renouveler son permis de séjour et le prononcé de son renvoi du territoire constituent une ingérence dans son droit au respect de la vie « privée » (Hasanbasic c. Suisse, no 52166/09, § 49, 11 juin 2013). La question de savoir si la vie familiale du requérant est également en jeu dans la présente espèce est plus délicate. En effet, la Cour note que les enfants du requérant sont respectivement âgés de 21 et 25 ans. En outre, le couple ne s’est remarié qu’en mars 2007, soit après la levée de l’autorisation de séjour du requérant et son séjour en prison. Compte tenu des considérations à suivre (paragraphes 54-62 ci-dessous), la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si les relations du requérant avec son épouse et ses enfants relèvent de son droit au respect de la vie familiale (Berisha c. Suisse, no 948/12, § 46, 30 juillet 2013).
b. Justification de l’ingérence
48. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
i. « Prévue par la loi »
49. Il n’est pas contesté que le refus de renouveler le permis de séjour du requérant et l’obligation de quitter le territoire suisse était fondés sur les dispositions pertinentes de la LSEE (voir le paragraphe 33 ci-dessus).
ii. But légitime
50. Il n’est pas davantage controversé que l’ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir notamment « la défense de l’ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
iii. Nécessité de la mesure dans une société démocratique
α) Principes généraux
51. La question essentielle à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux en ce qui concerne l’expulsion d’une personne ayant passé une durée considérable dans un pays hôte dont elle devrait être expulsée à la suite de la commission des infractions pénales sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récemment récapitulés, notamment dans les affaires Üner (précitée, §§ 54-55 et 57-58), Maslov c. Autriche ([GC], no 1638/03, §§ 68‑76, CEDH 2008), et Emre c. Suisse (no2) (no 5056/10, §§ 65-71, 11 octobre 2011). Dans l’affaire Üner, la Cour a eu l’occasion de résumer les critères devant guider les instances nationales dans de telles affaires (§§ 57 et suiv.) :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la nationalité des diverses personnes concernées ;
– la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
– la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
– la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
– la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
– l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
52. Ces critères ont également été appliqués plus récemment dans les affaires Kissiwa Koffi c. Suisse (no 38005/07, 15 novembre 2012), Udeh c. Suisse (no 12020/09, 16 avril 2013), Hasanbasic (précitée, § 53), Vasquez c. Suisse (no 1785/08, § 38, 26 novembre 2013) et Ukaj c. Suisse (no 32493/08, § 34, 24 juin 2014).
53. La Cour rappelle également que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X). Cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir Maslov, précité, § 76). La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une mesure d’éloignement d’une personne se concilie avec l’article 8 et, en particulier, si elle était nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime poursuivi (Mehemi c. France, 26 septembre 1997, § 34, Recueil 1997-VI ; Dalia, précité, § 52 ; Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 46, CEDH 2001‑IX). Sa tâche consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, les droits de l’intéressé protégés par la Convention et, d’autre part, les intérêts de la société (voir, parmi maints autres, Boultif, précité, § 47).
β) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
54. En ce qui concerne le cas d’espèce, la Cour prend note de ce que la condamnation, prononcée le 1er novembre 2001 par le tribunal correctionnel de la Côte du canton de Vaud pour blanchiment d’argent par métier dans le cadre d’un trafic de stupéfiants (deux ans et demi d’emprisonnement et dix ans, avec sursis pendant cinq ans, d’expulsion du territoire suisse) et portant sur des faits datant de 1999, est la seule ayant été prononcée à l’encontre du requérant. Il n’est pas contesté entre les parties que le comportement dont le requérant a fait preuve en prison et après avoir été remis en semi-liberté, en avril 2004, était irréprochable. Or, cette évolution positive, notamment le fait qu’il a été remis en liberté conditionnelle après avoir purgé une partie de sa peine, peut être prise en compte dans la pesée des intérêts en jeu (voir notamment Maslov, précité, §§ 87 et suiv., Emre, précité, § 74, et Udeh, précité, § 49).
55. Il n’en reste pas moins que le requérant a été condamné pour des faits graves en lien avec le trafic de drogue et portant sur des sommes d’argent importantes. Or, s’agissant d’une infraction en matière de stupéfiants, eu égard aux ravages de la drogue dans la population, la Cour a toujours conçu que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation de ce fléau (voir, par exemple Dalia, précité, § 54 ; Baghli c. France, no 34374/97, § 48, CEDH 1999-VIII ; Mehemi, précité, § 37 ; Maslov, précité, § 80, et Kissiwa Koffi, précité, § 65).
56. La Cour rappelle ensuite que le requérant est entré en Suisse avec son épouse et sa fille en avril 1991. Il y bénéficiait d’une admission provisoire au séjour depuis sept ans lorsqu’il fut arrêté en 1999 et y résidait depuis douze ans lorsque son admission provisoire fut levée en 2003. Après sa sortie de prison en 2004, le requérant se maintint sur le territoire durant l’examen de sa demande de permis de séjour et des recours subséquents. Au total, le requérant séjourne donc en Suisse depuis 24 ans. D’origine albanaise, l’épouse du requérant a obtenu la nationalité suisse le 18 décembre 2006, en même temps que leur fils. Leur fille était déjà citoyenne suisse depuis le 10 septembre 2003.
57. La Cour note qu’après une vie maritale de plus de 14 ans, l’épouse du requérant a obtenu, en février 2004, le divorce qu’elle aurait demandé en raison du comportement criminel de son époux. Ils se sont remariés le 3 mars 2007. Par conséquent, il ne fait aucun doute qu’au moment de leur remariage, l’épouse du requérant avait connaissance de l’infraction et de la subséquente levée de l’admission provisoire au séjour de celui-ci et qu’elle pouvait donc prévoir le risque d’une éventuelle expulsion.
58. L’épouse du requérant étant d’origine albanaise et ayant vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 29 ans, la Cour n’aperçoit pas de difficulté particulière qui se poserait en cas de retour en Albanie.
59. Par ailleurs, deux enfants sont issus de cette union et sont, à ce jour, respectivement âgés de 21 et 25 ans. À cet égard, la Cour rappelle que les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001 ; Kwakie-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), no 31519/96, 7 novembre 2000, et Shala c. Suisse, no 52873/09, § 40, 15 novembre 2012). Les deux enfants possèdent la nationalité suisse et seule la fille du couple a vécu en Albanie, durant moins de deux ans. Il est donc peu probable qu’ils suivraient leur père en Albanie en cas de retour. Cependant, à supposer que ces liens tombent dans le champ d’application de l’article 8, l’éloignement du requérant du territoire suisse ne signifierait nullement que les liens familiaux avec ses proches seraient définitivement rompus étant donné que des contacts réguliers peuvent être maintenus par les différents moyens de communication ainsi que par des visites de sa famille en Albanie (Shala c. Suisse, précité, § 54).
60. Le requérant fait certes état de l’absence de toute parenté en Albanie – ses parents et ses deux frères ayant émigré aux États-Unis – et de ce qu’il n’est jamais retourné dans son pays d’origine depuis son arrivée en Suisse. Cependant, le requérant n’est arrivé en Suisse qu’à l’âge de 29 ans. Il avait auparavant vécu toute sa vie en Albanie. Il y avait effectué toute sa scolarité, s’y était marié et y avait eu son premier enfant (voir a contrario Shala, précité, § 55).
61. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier eu égard à la gravité de la condamnation pour infraction en matière de stupéfiants prononcée contre le requérant, ainsi qu’au fait qu’il a passé la majorité de sa vie dans son pays d’origine, ce qui laisse supposer qu’il pourrait s’y intégrer, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas dépassé la marge d’appréciation dont il jouissait dans le cas d’espèce.
62. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
MPEV et autres C. SUISSE du 8 juillet 2014 requête 3910/13
Violation de l'article 8 : L’expulsion suite à une condamnation pour vol et recel, d’un Équatorien divorcé dont l’épouse et la fille sont autorisées à rester en Suisse serait injustifiée.
La Cour européenne des droits de l’homme rejette l’exception d’irrecevabilité tirée du non épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement suisse. Celui-ci avait en effet fait valoir que les requérants n’avaient pas contesté la décision rendue par le tribunal administratif fédéral en septembre 2012. La Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré qu’un recours de droit public eût été susceptible d’offrir aux requérants le redressement de leurs griefs tirés de l’article 8, et relève notamment que le tribunal administratif fédéral a expressément déclaré que sa décision était définitive.
La Cour juge recevable la requête pour autant qu’elle concerne Monsieur E.V. (« M. E.V. »), l’épouse de celui-ci et leur fille mineure. Elle confirme que les relations existant entre M. E.V. et sa fille mineure relèvent de la « vie familiale » au sens de l’article 8, point qui n’a pas été contesté par le gouvernement suisse. En outre, si M. E.V. et son épouse sont séparés, ils n’ont pas divorcé, ils gardent des contacts l’un avec l’autre et affirment que cette dernière aide M. E.V. à faire face à sa maladie. Ces éléments sont suffisants pour que leur relation soit considérée comme relevant de l’article 8.
En revanche, la Cour déclare la requête irrecevable pour autant qu’elle concerne la belle-fille majeure de M. E.V. Elle constate que celle-ci a fondé sa propre famille et que les requérants n’ont pas établi l’existence d’un rapport de dépendance suffisant pour que les relations entre M. E.V. et sa belle-fille puissent relever de l’article 8.
En ce qui concerne la question de savoir si la décision d’expulsion vers l’Équateur prise à l’encontre de M. E.V. ménageait un juste équilibre entre les intérêts en cause – à savoir, d’une part, le droit des trois requérants dont la requête a été déclarée recevable au respect de leur vie privée et familiale et, d’autre part, l’intérêt général –, la Cour relève que les infractions commises par M. E.V. étaient relativement peu graves. Elle observe qu’il a été condamné à quatre reprises entre 2005 et 2009 – trois fois pour atteintes aux biens et une fois pour infraction routière –, et que la sanction la plus sévère prononcée contre lui était une peine de neuf mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve. Elle constate de surcroît que M. E.V. n’a pas récidivé depuis 2009. Par ailleurs, les procédures d’asile engagées par la famille se sont étalées sur plus de dix ans.
En ce qui concerne la situation de la famille de M. E.V., la Cour rappelle que celui-ci a gardé des contacts avec sa femme, qui l’aide à faire face à sa maladie. Le tribunal administratif fédéral suisse a reconnu que l’état de santé du requérant était préoccupant et que, selon son médecin, son renvoi vers l’Équateur risquait de nuire à sa santé.
Enfin, la Cour observe que les autorités suisses n’ont pas tenu compte de l’intérêt mutuel de M. E.V. et de sa fille mineure à maintenir des liens étroits. À cet égard, elle relève que M. E.V. participe à l’éducation de sa fille. Celle-ci étant parfaitement intégrée en Suisse, où elle doit rester puisque les juridictions suisses ont conclu qu’un renvoi vers l’Équateur lui serait néfaste, il est probable que les contacts personnels entre le père et sa fille seraient grandement réduits si celui-ci devait être renvoyé vers l’Équateur. Les juridictions suisses n’ont pas fait état de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’elles ont examiné le dossier de M. E.V.
Au vu de ce qui précède, la Cour juge que la décision des autorités suisses est disproportionnée en ce qu’elle n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en cause. En conséquence, le renvoi de M. E.V. vers l’Équateur emporterait violation de l’article 8 de la Convention.
Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 8.
PAPOSHVILI c. BELGIQUE du 17 avril 2014 requête 41738/10
Le requérant a été condamné avec sa femme plusieurs fois pour vols.
137. La Cour constate que l’OE a, par sa décision du 7 juillet 2010, rejeté la demande introduite par le requérant en vue d’obtenir la régularisation de son séjour pour circonstances exceptionnelles, en l’occurrence son intégration dans la société belge, sa vie familiale et son état de santé. L’OE a également, par décision du 7 juillet 2010, délivré au requérant un ordre de quitter le territoire dont l’exécution fut mise en mouvement avec l’obtention d’un laisser-passez auprès de l’ambassade de Géorgie. L’ordre de quitter le territoire s’inscrit dans la suite de l’arrêté ministériel de renvoi du requérant, pris le 16 août 2007 et devenu définitif le 27 février 2008, qui interdisait au requérant l’entrée sur le territoire belge pendant dix ans.
138. Il résulte de ce qui précède que la présente espèce concerne à la fois le refus par les autorités nationales d’autoriser le requérant à résider en Belgique et la menace de le renvoyer en Géorgie. Cela dit, vu les particularités de l’affaire, la Cour estime que la question centrale est celle de savoir si les autorités belges avaient l’obligation d’autoriser le requérant à séjourner en Belgique pour lui permettre de demeurer auprès de sa famille. Eu égard à cette question centrale, la Cour considère que le présent grief se situe dans le champ des obligations positives de l’État défendeur (voir, Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 38, CEDH 2006-I).
i. Principes généraux applicables
139. La Cour a reconnu que les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur leur sol ; la Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier. L’article 8 n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence (voir, parmi beaucoup d’autres, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A no 94, Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, § 42, Recueil 1997‑VI, Nunez c. Norvège, no 55597/09, § 66, 28 juin 2011).
140. Cela dit, l’État doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble. Il jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, § 63, Recueil 1996‑VI). L’étendue des obligations pour l’État varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général (Gül c. Suisse, 19 février 1996, § 38, Recueil 1996‑I, Rodrigues da Silva et Hoogkamer, précité, § 39).
141. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte font l’objet d’une jurisprudence bien établie qui concerne tant les immigrés de longue durée que les immigrés qui, comme en l’espèce, sont arrivés dans le pays à l’âge adulte. Dans les affaires Boultif c. Suisse (no 54273/00, § 48, CEDH 2001‑IX), Üner (précitée, §§ 54 et 55 et §§ 57 et 58) et Maslov c. Autriche [GC] (no 1638/03, § 68, CEDH 2008), la Cour a eu l’occasion de résumer les critères devant guider les instances nationales dans les affaires d’expulsion pour motifs d’ordre public, sachant que leur poids respectif varie inévitablement selon les circonstances particulières de chaque affaire :
– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la nationalité des diverses personnes concernées ;
– la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple
– la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
– la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
– la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
– l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
142. Un autre point important est celui de savoir si la vie familiale en cause s’est développée à une époque où les personnes concernées savaient que la situation au regard des règles d’immigration de l’une d’elles était telle qu’il était clair immédiatement que le maintien de cette vie familiale au sein de l’État hôte revêtirait d’emblée un caractère précaire. Lorsqu’une telle situation se présente, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le renvoi du membre de la famille n’ayant pas la nationalité de l’État hôte emporte violation de l’article 8 de la Convention (Abdulaziz, Cabales et Balkandali, précité, § 68, Rodrigues da Silva et Hoogkamer, précité, § 39, Darren Omoregie et autres c. Norvège, no 265/07, § 57, 31 juillet 2008, Nunez, précité, § 70, Antwi et autres c. Norvège, no 26940/10, § 89, 14 février 2012). 143. Lorsqu’il y a des enfants, la question fondamentale est celle de savoir si ceux-ci sont d’un âge où ils peuvent s’adapter à un environnement différent (voir, parmi d’autres, Darren Omoregie et autres, précité, § 66, Arvelo Aponte c. Pays-Bas, no 28770/05, § 60, 3 novembre 2011). 144. Il ressort au surplus de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’il s’agit de familles avec enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante des autorités nationales dans l’évaluation de la proportionnalité aux fins de la Convention (voir, parmi d’autres, Nunez, précité, § 84, Kanagaratnam c. Belgique, no 15297/09, § 67, 13 décembre 2011, Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 109, 19 janvier 2012).ii. Application des principes généraux au cas d’espèce
145. En ce qui concerne la nature et la gravité des infractions commises par le requérant, la Cour relève que la décision de renvoi du requérant avec interdiction d’entrée en Belgique pendant dix ans est consécutive à plusieurs condamnations pénales pour des faits graves. Le requérant fut condamné une première fois en 1999 à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis pour faits de vol. Ensuite, en 2001, il fut condamné pour vol avec violences et menaces à une peine de quatorze mois d’emprisonnement avec sursis. Enfin, en 2005, il fut condamné à une peine d’emprisonnement ferme de trois ans pour participation à une organisation criminelle recourant notamment à l’intimidation, à des manœuvres frauduleuses ou à la corruption.
146. La Cour note en outre qu’une partie de ces infractions a été commise alors qu’il avait déjà été diagnostiqué que le requérant était atteint de tuberculose. Ni ce diagnostic ni les condamnations antérieures n’ont empêché le requérant de poursuivre ses agissements criminels. Il y a également lieu de relever le nombre important de délits commis par le requérant sur une période relativement longue (voir, parmi d’autres, Trabelsi c. Allemagne, no 41548/06, § 58, 13 octobre 2011).
147. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les condamnations dont le requérant a fait l’objet pèsent lourd tant du point de vue de leur gravité, de leur nombre que de la nature de la dernière peine infligée. La présente affaire doit dès lors être distinguée des affaires telles que Nunez (précité, §§ 71 et 72) et Udeh c. Suisse (no 12020/09 , § 46, 16 avril 2013).148. S’agissant du laps de temps qui s’est écoulé depuis les infractions et la conduite du requérant pendant cette période, la Cour constate qu’après avoir purgé la peine de trois années d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné en 2005, le requérant est resté en détention sur la base de l’arrêt ministériel de renvoi délivré en août 2007 et n’a été libéré qu’en juillet 2010 peu après l’indication d’une mesure provisoire par la Cour. Le Gouvernement allègue que, depuis sa libération, le requérant se serait rendu coupable de plusieurs actes de vol (voir paragraphe 115, ci-dessus). La Cour observe toutefois que le Gouvernement ne lui a pas fourni la preuve que ces soupçons avaient effectivement abouti à des procédures pénales dirigées contre le requérant (voir, mutatis mutandis, Gezginci c. Suisse, no 16327/05 ,§ 67, 9 décembre 2010). Le requérant soutient, quant à lui, que son état de santé ne lui permet plus de mener une vie normale et qu’il n’est plus en état de commettre les agissements que lui attribue le Gouvernement. Dès lors, compte tenu du fait que ces circonstances plaident à la fois en faveur du requérant et à son détriment, la Cour ne saurait accorder beaucoup d’importance en l’occurrence à la période postérieure aux condamnations du requérant qui ont amené les autorités administratives à lui refuser une autorisation de séjour et à ordonner son éloignement (voir, mutatis mutandis, Trabelsi, précité, § 61).
149. Pour ce qui est de la durée et de la régularité du séjour, la Cour note que le requérant est arrivé en Belgique en 1998 et qu’il y a passé, au moment de l’adoption du présent arrêt, un peu plus de quinze ans. Elle constate qu’à aucun moment, durant ces quinze années, le requérant n’a bénéficié d’un titre de séjour régulier (voir, a contrario, Udeh, précité, § 50). De plus, de novembre 1998, date à laquelle le requérant et son épouse sont arrivés en Belgique, à juillet 2010, date à laquelle l’épouse du requérant et leurs enfants ont obtenu la régularisation de leur séjour, la vie familiale s’est développée alors que le séjour de toute la famille était précaire.
150. La Cour est particulièrement sensible au fait que, malgré les condamnations répétées du requérant, les autorités belges se sont montrées d’une remarquable tolérance à l’égard du requérant et de sa famille. Leur séjour fut toléré et l’éloignement du requérant reporté eu égard à l’accouchement imminent de l’épouse du requérant ainsi qu’aux traitements médicaux nécessités par l’état de santé du requérant et de sa famille. Ensuite, à partir de sa condamnation en 2005, le séjour du requérant en Belgique, déjà précaire, a perdu le peu de fondement qu’il avait eu jusque-là. Le requérant n’a donc raisonnablement pu, à aucun moment, s’attendre à pouvoir développer sa vie familiale en Belgique (voir mutatis mutandis, Solomon c. Pays-Bas (déc.), no 44328/98, 5 septembre 2000).
151. Quant à la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays d’origine et le pays d’accueil, la Cour note que le requérant est né en Géorgie et y a vécu jusqu’à son départ en 1998, à l’âge de quarante ans, pour la Belgique. Il ne mentionne pas de liens sociaux particuliers en Belgique. Par ailleurs, il a passé un nombre d’années en prison ou en centre fermé en vue de son éloignement, ce qui l’a empêché de développer de tels liens. De plus, le requérant indique avoir un frère en Géorgie. Il est également probable que son épouse y dispose d’un réseau social et/ou familial.
152. La Cour n’est pas sans ignorer que l’épouse du requérant et les enfants ont obtenu le droit de séjour illimité en Belgique, qu’ils y ont développé des liens sociaux, que deux des enfants, âgés de presque quatorze et sept ans, sont nés en Belgique, y ont toujours vécu et y sont scolarisés. Toutefois, elle note que l’épouse du requérant et les enfants n’ont obtenu le droit de séjour en Belgique qu’en 2010 et que tous les membres de famille ont la nationalité géorgienne, ce qui distingue la présente espèce notamment des affaires Nunez (précitée, § 42) et Udeh (précitée, § 52) dans lesquelles un des parents et/ou les enfants avaient la nationalité du pays d’accueil.
153. En outre, il n’apparaît pas des circonstances de la cause que les enfants aient des besoins spécifiques ou que leur mère serait incapable de leur apporter les soins et soutien suffisants dans l’hypothèse où ils devaient rester avec elle seule, comme ce fut le cas durant les années de privation de liberté du requérant. Par ailleurs, sachant qu’ils disposent d’un titre de séjour en Belgique et qu’ils peuvent quitter le pays et y revenir en toute régularité, qu’il n’y a pas d’obstacles insurmontable au maintien de contacts réguliers entre les membres de la famille. Enfin, la Cour souligne que ni l’épouse du requérant ni ses enfants ne sont requérants devant elle.
154. La Cour admet toutefois, eu égard au volet médical particulier à la présente espèce, que le seul maintien de contacts réguliers pourrait ne pas suffire à satisfaire « l’intérêt supérieur » des enfants. Le requérant est en effet atteint de plusieurs pathologies graves, dont une leucémie lymphoïde chronique, et, selon ses propres allégations, risque, en tout état de cause, de décéder à court terme s’il était renvoyé en Géorgie où la qualité des soins n’est pas la même qu’en Belgique. Ce contexte particulier pourrait amener l’épouse du requérant et leurs enfants à prendre la décision de quitter temporairement la Belgique pour s’installer pendant un certain temps en Géorgie. Tout en se gardant de sous-estimer les difficultés qu’impliquerait pour la famille une telle décision, la Cour n’y voit pas, eu égard aux facteurs examinés ci-dessus (voir paragraphes 152 et 153, ci-dessus), des circonstances exceptionnelles qui obligeraient les autorités belges à renoncer au renvoi du requérant ou à régulariser son séjour. Elle relève en outre, d’après les données médicales versées au dossier, que les affectations dont souffre le requérant sont pour l’instant stabilisées grâce aux traitements médicaux reçus en Belgique, qu’il n’y a pas de menace imminente pour sa vie et qu’il est capable de voyager (voir paragraphe 120, ci-dessus).
155. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la nature et à la gravité des infractions commises par le requérant ainsi qu’au fait que le lien avec son pays d’origine n’est pas rompu, la Cour est d’avis que les autorités belges, en lui refusant la régularisation de son séjour, n’ont pas fait prévaloir de manière disproportionnée l’intérêt public par rapport aux droits du requérant.
156. En conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Mallah c. France requête no 29681/08 arrêt du 10 novembre 2011
Une condamnation avec dispense de peine pour aide au séjour irrégulier ne constitue pas une violation de la Convention.
Les faits :
Une dénonciation conduit le requérant en garde à vue alors que le racisme anti-magrébin est de notoriété, en Corse.
5. Le requérant, de nationalité marocaine, est né en 1957 et réside à Ajaccio.
6. Il réside régulièrement en France depuis plus de trente ans. Lui et son épouse hébergeaient leurs cinq enfants, dont F., âgée de vingt-deux ans, qui réside régulièrement en France depuis sa naissance.
7. Le 28 août 2003, F. se maria avec B.A., ressortissant marocain résidant au Maroc. Ils entreprirent des démarches afin que ce dernier puisse la rejoindre en France au titre du regroupement familial.
8. Le 10 décembre 2005, B.A. entra régulièrement en France avec un visa de trois mois pour retrouver F., qui résidait chez ses parents (le requérant et son épouse).
9. Le 10 mars 2006, après l’expiration de son visa, B.A. resta en France auprès de F. qui était alors enceinte.
10. Le 19 avril 2006, la police aux frontières de Corse du Sud reçut un courrier anonyme dénonçant la présence d’une personne sans papiers au domicile du requérant.
11. Le 25 avril 2006, à six heures, des policiers se présentèrent au domicile du requérant et effectuèrent une perquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République d’Ajaccio. Ils placèrent B.A. et le requérant en garde à vue.
12. Le 18 mai 2006, le requérant refusa une mesure de composition pénale proposée par le procureur de la République. Le 24 juillet 2006, ce dernier fit citer le requérant devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio le 8 septembre 2006 pour aide au séjour irrégulier d’un étranger, infraction prévue à l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Le 10 août 2006, B.A. et son épouse déposèrent une demande de regroupement familial.
14. Le 30 août 2006, le procureur de la République adressa au requérant un courrier l’informant qu’il avait décidé d’abandonner les poursuites à son encontre, eu égard à de nouveaux éléments portés à sa connaissance quant à la situation administrative de son gendre, B.A. Ce courrier se lit comme suit :
« Eu égard aux nouveaux éléments portés à ma connaissance, quant à la situation administrative de votre gendre, [B.A.], le délit d’aide au séjour irrégulier ne me paraît plus constitué. La procédure à votre encontre fait en conséquence l’objet d’une décision de classement sans suite à ce jour. »
15. Nonobstant ce courrier, le tribunal correctionnel, saisi de la citation du procureur de la République du 24 juillet 2006, rendit un jugement le 8 septembre 2006, dans lequel il déclara le requérant coupable du délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger et le dispensa de peine en raison de la cessation de l’infraction, en application de l’article 132-59 du code pénal.
16. Le 11 septembre 2006, le requérant interjeta appel du jugement.
17. Le 10 octobre 2006, la demande de regroupement familial de B.A. et de son épouse fut accueillie.
18. Le 14 novembre 2006, F. et B.A. eurent un fils.
19. Par un arrêt du 11 avril 2007, la cour d’appel de Bastia confirma le jugement, dispensant de peine le requérant au motif que son comportement avait été dicté uniquement par la générosité.
20. Le 12 avril 2007, le requérant se pourvut en cassation, dénonçant une violation de l’article 8 de la Convention.
21. Par un arrêt du 5 décembre 2007, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis.
A. Sur l’applicabilité de l’article 8
27. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, série A no 94, Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, p. 33, § 7, série A no 6, et Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 94, CEDH 2003-X). Selon lui, la relation invoquée par le requérant n’entre pas dans la définition de la « vie familiale » donnée par la Cour qui restreint cette notion à la cellule formée par le père, la mère et les enfants mineurs. Or, en l’espèce, les liens familiaux invoqués par le requérant sont ceux qui unissent un beau-père et son gendre. Le Gouvernement précise que ce dernier s’est marié avec la fille du requérant en 2003, qu’il est arrivé en France à la fin de l’année 2005 et qu’il n’a séjourné qu’un peu plus de trois mois chez le requérant. Il n’existerait aucun lien de dépendance direct entre le requérant et son gendre.
28. Selon le requérant, la jurisprudence citée par le Gouvernement n’est pas pertinente.
29. Conformément à sa jurisprudence, la Cour relève que la question de l’existence ou de l’absence d’une « vie familiale » est d’abord une question de fait, qui dépend de l’existence de liens personnels étroits (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A no 31, et K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 150, CEDH 2001-VII).
30. La Cour rappelle que la notion de « famille » visée par l’article 8 ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d’autres liens « familiaux » de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital (voir, entre autres, Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, § 55, série A no 112, Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 44, série A no 290, Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, § 30, série A no 297-C, et X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
31. En l’espèce, la Cour relève ainsi qu’il ressort du dossier que le requérant et son épouse hébergeaient leurs cinq enfants, dont F., ainsi que leur gendre B.A. Dès lors que ce dernier résidait sous le toit familial avec le requérant, fait qui constitue d’ailleurs l’objet du litige, que F. et B.A. étaient mariés depuis deux ans, qu’ils avaient entrepris des démarches administratives au titre du regroupement familial et enfin, qu’ils attendaient un enfant, la Cour considère que l’existence d’un lien familial entre le requérant et son gendre B.A. est établi. L’article 8 est donc applicable en l’espèce.
32. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. Le requérant soutient que sa condamnation porte atteinte au respect de sa vie familiale. Il explique qu’au moment des faits son épouse et lui-même hébergeaient leur fille et qu’ils ont accueilli à leur domicile l’époux de celle-ci, lequel était alors autorisé à rester sur le territoire français pour une durée de trois mois afin qu’ils puissent avoir une vie commune. Le requérant fait également état de circonstances particulières. Il indique que sa fille était enceinte, que sa grossesse présentait des complications médicales et que des démarches administratives au titre du regroupement familial étaient en cours. Il ajoute que B.A. n’est resté sur le territoire français que pour être aux côtés de son épouse enceinte et malade, et qu’il a vécu au domicile du requérant pour l’unique raison que son épouse y habitait. Le requérant ajoute que les faits tendaient vers un classement sans suite en raison du lien de parenté entre lui-même et B.A. et de la régularisation de la situation de ce dernier, ce que la position du ministère public confirme.
34. Le Gouvernement soutient que la condamnation pénale du requérant a été prononcée sur le fondement de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Il ajoute que la mesure litigieuse était proportionnée au but recherché. Le Gouvernement rappelle à cet égard que le législateur a prévu des immunités pour les membres de la famille proche de l’étranger à l’article L. 622-4 du code précité. Il souligne qu’en l’espèce le requérant ne rentrait pas dans le cadre des immunités et que le mobile qu’il a invoqué, à savoir la solidarité familiale, est indifférent, dès lors qu’il n’est pas couvert par une immunité pénale offerte par la loi.
35. La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre d’éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble.
36. En l’espèce, la Cour observe qu’après avoir constaté que le requérant avait hébergé son gendre B.A. alors même qu’il connaissait sa situation irrégulière, les juridictions internes l’ont déclaré coupable d’aide au séjour irrégulier, tout en prononçant une dispense de peine, par application des articles L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) et 132-59 du code pénal (voir paragraphes 22 et 24 ci-dessus).
37. Elle constate que les parties s’accordent sur le fait que la condamnation pénale du requérant constitue une ingérence au sens de l’article 8. La Cour partage ce point de vue.
38. Elle relève que cette ingérence était prévue par l’article L. 622-1 du CESEDA et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.
39. Reste donc à déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en présence, étant rappelé que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X et Berrehab c. Pays-Bas, 21 juin 1988, série A no 138, § 28).
40. La Cour constate qu’en créant le délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France, l’objectif du législateur était de lutter contre l’immigration clandestine et les réseaux organisés tels que les passeurs qui aident, en contrepartie de sommes importantes, les étrangers à entrer ou à se maintenir illégalement sur le territoire (voir paragraphe 23 ci-dessus). Elle note qu’un mécanisme d’impunité légale a été prévu pour les membres de la famille les plus proches de l’étranger en situation irrégulière, à savoir les ascendants de l’étranger, ses descendants, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui (voir paragraphe 22 ci-dessus). Toutefois, en l’espèce, il faut constater qu’en dépit du lien familial qui l’unit à son gendre, le requérant n’entrait pas dans la catégorie des personnes fixée par la loi et ne pouvait donc bénéficier de l’immunité pénale. A l’instar du Gouvernement, la Cour relève que le délit étant constitué au regard de la loi, qui est au demeurant suffisamment claire et prévisible, les juridictions internes ne pouvaient que statuer dans le sens de la responsabilité pénale du requérant. Cependant, tenant compte des circonstances particulières de l’espèce et du comportement du requérant qui n’avait été dicté uniquement par la générosité, les juridictions ont assorti la déclaration de culpabilité d’une dispense de peine, par application de l’article 132-59 du code pénal. Le procureur de la République avait décidé le classement sans suite de l’affaire (voir paragraphe 14 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les divers intérêts en présence, à savoir la nécessité de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions pénales d’une part, et de protéger le droit du requérant au respect de sa vie familiale, d’autre part.
41. Partant, la mesure prise à l’égard du requérant n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale. De surcroît, elle n’a eu que des conséquences limitées sur son casier judiciaire.
LA RELATION GENDRE BEAU PERE EST BIEN UNE RELATION FAMILIALE AU SENS DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Cet arrêt a été voté par une chambre de sept juges. Six juges ont voté pour cette décision, convaincus de "la grande utilité " de leur pression sur l'Etat français. Un juge s'y est opposé et a émis une opinion dissidente.
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE POWER-FORDE (Traduction)
Je ne partage pas l’opinion de la majorité en l’espèce. J’estime en effet qu’il y a eu violation des droits que le requérant tire de l’article 8. Il ressort du dossier que ce dernier, qui réside en France depuis plus de 30 ans, est père de cinq enfants qu’il a élevés dans ce pays depuis leur naissance. En 2003, sa fille F. épousa un ressortissant marocain. Peu après, le couple demanda aux autorités françaises le regroupement familial. L’époux de F. entra régulièrement sur le territoire français en 2005, muni d’un visa de trois mois. En mars 2006, après l’expiration de son visa, il resta en France auprès de la famille de son épouse alors que celle-ci était enceinte et que sa grossesse connaissait des complications médicales.
Un matin, à 6 heures, le requérant reçut à son domicile la visite de la police, qui avait reçu un courrier anonyme. Soupçonné d’héberger un étranger en séjour irrégulier sur le territoire de l’Etat défendeur – une infraction relevant de l’article L.622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers –, il fut interrogé à ce sujet. Peu après, la police l’emmena, lui et son gendre, hors du domicile familial puis les mit en garde à vue. Par la suite, le requérant fut poursuivi pour cette même infraction prévue à l’article L.622-1. Au bout du compte, il fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés alors que, parallèlement, les autorités avaient finalement examiné et accepté la demande de regroupement familial formée par son gendre.
Le dossier montre que l’« ingérence » commise en l’espèce par les autorités dans la vie familiale du requérant n’était pas proportionnée et, à mon sens, l’Etat défendeur n’est pas parvenu à établir en quoi une ingérence aussi grave aurait été « nécessaire dans une société démocratique ». Alors que l’« étranger » en question était son gendre qui logeait au domicile familial à une époque où son épouse connaissait une grossesse difficile, le requérant – son beau-père – a pourtant été considéré par les autorités comme un criminel et traité comme tel. Il fut dérangé au petit matin par la police puis interrogé, arrêté, mis en garde à vue, poursuivi dans le cadre d’une procédure qui dura 20 mois, avant d’être finalement reconnu coupable d’une infraction pénale. La majorité n’y a vu aucune ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l’intéressé qui aurait été constitutive d’une violation de l’article 8 de la Convention. Je ne puis me rallier à elle.
Avec le respect que je dois à mes collègues de la majorité, leur raisonnement repose sur une conception plutôt « positiviste » de la loi en question. Elle s’est contentée de relever que le lien familial entre le requérant et son gendre n’entrait pas dans les catégories fixées par la loi et qu’il n’avait donc pas pu bénéficier d’une impunité pénale (§ 40). Pour elle, un juste équilibre avait été ménagé du seul fait que la condamnation du requérant n’avait été assortie d’aucune peine, autrement dit parce que la dispense de peine prononcée par application de l’article 132-59 du code pénal avait atténué les conséquences de sa condamnation.
Contrairement à la majorité, j’estime que, de par sa gravité, l’ingérence en l’espèce était totalement disproportionnée et qu’il n’a pas été établi qu’elle fût nécessaire dans une société démocratique. On peut en effet se demander en quoi il y avait un « besoin social impérieux » d’arrêter, d’incarcérer, de poursuivre et de condamner le requérant comme un criminel. Quel danger ou risque avait-il fait courir à la société en permettant à son gendre de rester sous son toit alors que l’épouse de celui-ci, sa fille, connaissait une grossesse difficile et qu’une demande de regroupement familial avait été adressée aux autorités et était en cours d’examen ?
Une dernière observation semble s’imposer. Si, de manière générale, les lois en matière d’immigration peuvent poursuivre des buts légitimes, y compris notamment la prévention du trafic d’êtres humains, les dispositions de l’article L.622-1, dont il avait été donné application en l’espèce, sont particulièrement étendues dans leur portée. Cet article prévoit que toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 Euros Son interprétation et son application dans le cas du requérant mettent en lumière, selon moi, le caractère globalement problématique de cette loi et montrent à l’évidence qu’une modification du texte s’impose de manière à ce qu’une réponse proportionnée puisse être apportée et un juste équilibre ménagé dans chaque cas d’espèce.
La législation en question a fait l’objet de nombreuses critiques et opinions négatives, notamment de la part d’organes tels que la Commission nationale consultative des droits de l’homme. A mon sens, ses dispositions sont libellées de manière tellement vague et générale que la « qualité de la loi » peut être mise en cause dans le cadre d’un examen conduit sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Il apparaîtrait que, dès lors qu’il est établi qu’une personne – n’importe qui – a, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter le séjour irrégulier d’un immigré en France, les conditions de l’infraction ont été réunies, appelant une condamnation. Mais que veut dire « aider » ou « faciliter » le séjour irrégulier d’un immigré ? Lui acheter une carte téléphonique grâce à laquelle il pourra appeler chez lui, lui offrir un pull-over chaud ou un bol de soupe en hiver ou l’héberger un soir de Noël est-ce « aider » ou « faciliter » – directement ou indirectement – son séjour en France ? Rien dans la législation n’indique le contraire ni ne permet au juge de tenir compte de motifs humanitaires lorsqu’il statue sur la culpabilité d’une personne poursuivie sur la base de ces dispositions. La condamnation du requérant en l’espèce en est une illustration et montre que la qualité de la loi en cause est pour le moins problématique. A mes yeux, ses dispositions trop générales et sans nuances sont incompatibles avec le respect des droits de l’homme dans un Etat régi par la prééminence du droit.
LA DÉTENTION ADMINISTRATIVE D'UN ENFANT
A.M et autres c. FRANCE du 12 juillet 2016 requête 24587/12
Vu le comportement de la requérante condamnée à un mois de prison avec sursis, il n'y a pas violation de l'article 8 pour une rétention de huit jours avec ses enfants en bas âge.
85. La Cour estime que l’existence d’une « vie familiale » au sens de la jurisprudence Marckx c. Belgique (13 juin 1979, série A no 31) ne fait pas de doute en l’espèce, elle n’est d’ailleurs pas contestée par le Gouvernement. Cette disposition est donc applicable à la situation dénoncée par les requérantes.
86. La Cour considère ensuite, comme elle l’a fait dans l’affaire Popov c. France, (précitée, § 134), que le fait d’enfermer les requérantes dans un centre de rétention, pendant huit jours, les soumettant à la privation de liberté et aux contraintes inhérentes à ce type d’établissement s’analyse comme une ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale.
87. Pareille ingérence enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cet article, c’est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
88. La Cour observe que, bien qu’il n’en soit pas de même pour ses enfants dont le sort suivait néanmoins le sien, la base légale de la rétention de la requérante trouvait son fondement dans l’article L. 554-1 du CESEDA.
89. Concernant le but poursuivi par la mesure litigieuse, la Cour constate qu’elle a été prise dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire. Cette action peut se rattacher à des objectifs tant de protection de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre, de bien-être économique du pays que de prévention des infractions pénales. La Cour parvient par conséquent à la conclusion que l’ingérence dont il est question poursuivait un but légitime au regard de l’article 8 § 2 de la Convention.
90. Elle doit enfin examiner si le placement en rétention de la famille, pour une durée telle qu’en l’espèce, s’avérait nécessaire au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, c’est-à-dire justifié par un besoin social impérieux et, notamment, proportionné au but légitime poursuivi (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 80).
91. La Cour rappelle à cet égard que les autorités se doivent de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290). Elle insiste sur le fait que cet équilibre doit être sauvegardé en tenant compte des conventions internationales, notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant (mutatis mutandis, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 120, 28 juin 2007). Il y a donc nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique d’immigration des États.
92. Ainsi, une mesure d’enfermement doit être proportionnée au but poursuivi par les autorités, à savoir l’éloignement. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’il s’agit de familles, les autorités doivent, dans leur évaluation de la proportionnalité, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, la Cour souligne qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (Rahimi, précité, § 108, et, mutatis mutandis, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010).
93. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant préconise que l’intérêt supérieur des enfants soit une considération primordiale dans toute décision les concernant (article 3). De même, la directive « accueil » (voir le paragraphe 79 de l’affaire A.B. et autres c. France précitée), transposée dans le CESEDA, prévoit expressément que les États membres accordent une place d’importance à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Il découle par ailleurs des rapports internationaux (voir les paragraphes 82 et suivants de l’affaire A.B.et autres c. France, précitée) que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant implique, d’une part, de maintenir, autant que faire se peut, l’unité familiale et, d’autre part, d’envisager des alternatives afin de ne recourir à la détention des mineurs qu’en dernier ressort. Tant la Convention internationale relative aux droits de l’enfant que les directives européennes « retour » et « accueil » ou l’Assemblée parlementaire prévoient ainsi que le placement en rétention des mineurs ne doit intervenir qu’en dernier ressort, après examen de toutes les alternatives à la rétention. La Cour note enfin que la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et la Défenseure des enfants se sont prononcées, à plusieurs reprises, contre la privation de liberté d’enfants n’ayant pas commis d’infraction pénale, accompagnés ou non, au nom du respect de leur intérêt supérieur. Selon elles, lorsque les parents de jeunes mineurs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, l’assignation à résidence ou, si celle-ci s’avère impossible, la location de chambres d’hôtel devrait être envisagée en priorité (voir les paragraphes 51 et suivants de l’affaire A.B. et autres c. France, précitée).
94. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Popov c. France, précité, elle avait conclu que les requérants avaient subi une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de leur vie familiale après avoir relevé trois éléments. D’une part, les requérants ne présentaient pas de risque particulier de fuite nécessitant leur rétention. D’autre part, aucune alternative à la rétention n’avait été envisagée. Enfin, les autorités n’avaient pas mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion et limiter le temps d’enfermement.
95. La Cour relève qu’en l’espèce, pour caractériser le risque de fuite et l’impossibilité de recourir à une alternative à la rétention, le Gouvernement s’appuie sur les éléments retenus par le préfet : le refus de la requérante de se présenter auprès des services de la direction départementale de la police aux frontières afin d’organiser son départ, l’absence de document d’identité et le caractère précaire du logement de la requérante. Au vu des pièces du dossier, la Cour n’estime pas disposer d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les autorités nationales sur ces points.
96. Elle note ensuite que, compte tenu du comportement de la requérante, les autorités internes ont mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’éloignement et limiter le temps d’enfermement. Elles avaient en effet programmé un vol à destination de la Pologne pour le lendemain du placement en rétention et ce n’est qu’à la suite du refus de la requérante d’embarquer que l’exécution de la mesure d’éloignement a été retardée et que le temps d’enfermement s’est prolongé. La Cour en déduit qu’aucun retard dans la mise à exécution de la mesure d’expulsion n’est à imputer aux autorités françaises.
97. Aussi, la rétention, pour une durée totale de huit jours, n’apparaît pas disproportionnée par rapport au but poursuivi. Partant, la Cour considère que les requérantes n’ont pas subi une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de leur vie familiale et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
RK et autres C. France du 12 juillet 2016 requête 68264/14
Violation de l'article 8 en ce qui concerne l'enfant, une rétention de neuf jours alors qu'il n'y a pas de risques de fuite est disproportionné.
105. La Cour estime que l’existence d’une « vie familiale » au sens de la jurisprudence Marckx c. Belgique (13 juin 1979, série A no 31) ne fait pas de doute en l’espèce, elle n’est d’ailleurs pas contestée par le Gouvernement. Cette disposition est donc applicable à la situation dénoncée par les requérants.
106. La Cour considère ensuite, comme elle l’a fait dans l’affaire Popov (précitée, § 134), que le fait d’enfermer les requérants dans un centre de rétention, pendant neuf jours, les soumettant à la privation de liberté et aux contraintes inhérentes à ce type d’établissement s’analyse comme une ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale.
107. Pareille ingérence enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cet article, c’est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
108. La Cour observe que, bien qu’il n’en soit pas de même pour leur enfant dont le sort suivait néanmoins le leur, la base légale de la rétention des deux premiers requérants trouvait son fondement dans l’article L. 554-1 du CESEDA.
109. Concernant le but poursuivi par la mesure litigieuse, la Cour constate qu’elle a été prise dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire. Cette action peut se rattacher à des objectifs tant de protection de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre, de bien-être économique du pays que de prévention des infractions pénales. La Cour parvient par conséquent à la conclusion que l’ingérence dont il est question poursuivait un but légitime au regard de l’article 8 § 2 de la Convention.
110. Elle doit enfin examiner si le placement en rétention de la famille, pour une durée telle qu’en l’espèce, s’avérait nécessaire au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, c’est-à-dire justifié par un besoin social impérieux et, notamment, proportionné au but légitime poursuivi (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 80).
111. La Cour rappelle à cet égard que les autorités se doivent de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290). Elle insiste sur le fait que cet équilibre doit être sauvegardé en tenant compte des conventions internationales, notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant (mutatis mutandis, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 120, 28 juin 2007). Il y a donc nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique d’immigration des États.
112. Ainsi, une mesure d’enfermement doit être proportionnée au but poursuivi par les autorités, à savoir l’éloignement. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’il s’agit de familles, les autorités doivent, dans leur évaluation de la proportionnalité, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, la Cour souligne qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (Rahimi, précité, § 108, et, mutatis mutandis, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010).
113. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant préconise que l’intérêt supérieur des enfants soit une considération primordiale dans toute décision les concernant (article 3). De même, les directives européennes (voir les paragraphes 71 et suivants de l’affaire A.B. et autres c. France précitée), transposées dans le CESEDA, prévoient expressément que les États membres accordent une place d’importance à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Il découle par ailleurs des rapports internationaux (voir les paragraphes 82 et suivants de l’affaire A.B. et autres c. France précitée) que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant implique, d’une part, de maintenir, autant que faire se peut, l’unité familiale, d’autre part, d’envisager des alternatives afin de ne recourir à la détention des mineurs qu’en dernier ressort. Tant la Convention internationale relative aux droits de l’enfant que les directives européennes ainsi que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe prévoient ainsi que le placement en rétention des mineurs ne doit intervenir qu’en dernier ressort, après examen de toutes les alternatives à la rétention. La Cour note enfin que la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Défenseure des enfants se sont prononcées, à plusieurs reprises, contre la privation de liberté d’enfants n’ayant pas commis d’infraction pénale, accompagnés ou non, au nom du respect de leur intérêt supérieur. Selon elles, lorsque les parents de jeunes mineurs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, l’assignation à résidence ou, si celle-ci s’avère impossible, la location de chambres d’hôtel devrait être envisagée en priorité (voir les paragraphes 51 et suivants de l’affaire A.B. et autres c. France précitée).
114. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Popov précité, elle avait conclu que les requérants avaient subi une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de leur vie familiale après avoir relevé trois éléments. D’une part, les requérants ne présentaient pas de risque particulier de fuite nécessitant leur rétention. D’autre part, aucune alternative à la rétention n’avait été envisagée. Enfin, les autorités n’avaient pas mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion et limiter le temps d’enfermement.
115. La Cour relève qu’en l’espèce, pour caractériser le risque de fuite et l’impossibilité de recourir à une alternative à la rétention, le Gouvernement s’appuie principalement sur les refus des requérants d’embarquer dans l’avion devant les ramener en Fédération de Russie. La Cour n’est pas convaincue que cet élément suffise à caractériser la réalité du risque de fuite et l’impossibilité de trouver une solution alternative à la rétention. S’il démontre, à l’évidence, l’absence de volonté des requérants d’être expulsés du territoire français, il n’établit pas leur volonté de se soustraire aux autorités. Ainsi, l’enfermement dans un centre n’apparaissait pas justifié par un besoin social impérieux. La Cour observe, au vu des informations à sa disposition, que d’autres solutions, telles que l’assignation dans un hôtel, assortie, comme le suggèrent les requérants, d’un pointage régulier auprès d’un commissariat, n’ont pas été envisagées.
116. La Cour note ensuite que si les autorités ont, dans un premier temps, mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion et limiter le temps d’enfermement, le premier vol étant programmé deux jours après le placement en rétention et le second deux jours encore après, elles ont en revanche tardé après l’application de la mesure provisoire pour ordonner la remise en liberté des requérants. En effet, alors même que la Cour a indiqué au Gouvernement, le 20 octobre 2014, qu’il était souhaitable de ne pas renvoyer les requérants vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour et, partant, qu’aucune expulsion n’était plus possible, ce n’est que quatre jours plus tard, le 24 octobre que leur rétention a pris fin.
117. Aussi, en l’absence de risque particulier de fuite, la rétention, pour une durée de neuf jours, apparaît disproportionnée par rapport au but poursuivi. Partant, la Cour considère que les requérants ont subi une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de leur vie familiale et qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
RV ET CV C. France du 12 juilet 2016 requête 76491/14
Non violation de l'Article 8 : la maman a été condamnée à 3 ans de prison, une rétention administrative de 8 jours d'elle et son enfant avant expulsion, n'est pas disproportionnée.
71. La Cour estime que l’existence d’une « vie familiale » au sens de la jurisprudence Marckx c. Belgique (13 juin 1979, série A no 31) ne fait pas de doute en l’espèce, elle n’est d’ailleurs pas contestée par le Gouvernement. Cette disposition est donc applicable à la situation dénoncée par les requérants.
72. La Cour considère ensuite, comme elle l’a fait dans l’affaire Popov précitée (§ 134), que le fait d’enfermer la requérante et son enfant dans un centre de rétention, pendant dix jours, les soumettant à la privation de liberté et aux contraintes inhérentes à ce type d’établissement peut s’analyser comme une ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale.
73. Pareille ingérence enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cet article, c’est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
74. La Cour observe que, bien qu’il n’en soit pas de même pour l’enfant dont le sort suivait néanmoins le sien, la base légale de la rétention de la requérante trouvait son fondement dans l’article L. 554-1 du CESEDA.
75. Concernant le but poursuivi par la mesure litigieuse, la Cour constate qu’elle a été prise dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire. Cette action peut se rattacher à des objectifs tant de protection de la sécurité nationale, de défense de l’ordre, de bien-être économique du pays que de la prévention des infractions pénales. En effet, la requérante a été reconnue coupable et condamnée pour des faits de provocation directe de mineur à commettre des crimes ou des délits, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et recel en bande organisée de biens provenant d’un délit (voir paragraphes 9 et 10 ci-dessus). La Cour parvient par conséquent à la conclusion que l’ingérence dont il est question poursuivait un but légitime au regard de l’article 8 § 2 de la Convention.
76. Elle doit enfin examiner si le placement en rétention de la famille, pour une durée telle qu’en l’espèce, s’avérait nécessaire au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, c’est-à-dire justifié par un besoin social impérieux et, notamment, proportionné au but légitime poursuivi (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 80).
77. La Cour rappelle à cet égard que les autorités se doivent de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290).
Elle insiste sur le fait que cet équilibre doit être sauvegardé en tenant compte des conventions internationales, notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant (mutatis mutandis, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 120, 28 juin 2007). Il y a donc nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique d’immigration des États.
78. Ainsi, une mesure d’enfermement doit être proportionnée au but poursuivi par les autorités, à savoir l’éloignement. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’il s’agit de familles, les autorités doivent, dans leur évaluation de la proportionnalité, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, la Cour souligne qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (Rahimi, précité, § 108, et, mutatis mutandis, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010).
79. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant préconise que l’intérêt supérieur des enfants soit une considération primordiale dans toute décision les concernant (article 3). De même, les directives européennes (voir les paragraphes 71 et suivants de l’affaire A.B. et autres précitée), transposées dans le CESEDA, prévoient expressément que les États membres accordent une place d’importance à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Il découle par ailleurs des rapports internationaux (voir les paragraphes 82 et suivants de l’affaire A.B. et autres précitée) que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant implique, d’une part, de maintenir, autant que faire se peut, l’unité familiale et, d’autre part, d’envisager des alternatives afin de ne recourir à la rétention des mineurs qu’en dernier ressort. Tant la Convention internationale relative aux droits de l’enfant que les directives européennes ainsi que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe prévoient ainsi que le placement en rétention des mineurs ne doit intervenir qu’en dernier ressort, après examen de toutes les alternatives à cette mesure. La Cour note enfin que la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et la Défenseure des enfants se sont prononcées, à plusieurs reprises, contre la privation de liberté d’enfants, accompagnés ou non, n’ayant pas commis d’infraction pénale, au nom du respect de leur intérêt supérieur. Selon elles, lorsque les parents de jeunes mineurs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, l’assignation à résidence ou, si celle-ci s’avère impossible, la location de chambres d’hôtel devrait être envisagée en priorité (voir les paragraphes 51 et suivants de l’affaire A.B. et autres précitée).
80. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Popov précité, elle avait conclu que les requérants avaient subi une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de leur vie familiale après avoir relevé trois éléments. D’une part, les requérants ne présentaient pas de risque particulier de fuite nécessitant leur détention. D’autre part, aucune alternative à la rétention n’avait été envisagée. Enfin, les autorités n’avaient pas mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion et limiter le temps d’enfermement.
81. La Cour observe qu’en l’espèce, les deux parties s’opposent sur le point de savoir s’il existait un risque particulier de fuite et si une solution alternative avait été recherchée par les autorités. Pour caractériser le risque de fuite et l’impossibilité de recourir à une solution de remplacement, le Gouvernement s’appuie sur les éléments suivants relevés par les juridictions internes : l’interdiction judiciaire du territoire français dont la requérante fait l’objet, la circonstance que l’enfant de la requérante l’accompagnait dans son incarcération depuis sa naissance, l’intention de rester en France que la requérante avait indiquée au juge des libertés et de la détention, les faits graves qu’elle avait commis, nécessitant la préservation de l’ordre public, le fait que la requérante avait circulé et résidé en France après avoir confié l’entretien et l’éducation de ses enfants à des tiers. La Cour observe que, sur la base de ces éléments, les autorités internes et notamment la cour d’appel de Toulouse (voir paragraphe 14) ont jugé que ni l’assignation à résidence, ni un placement sous surveillance électronique ne permettraient d’empêcher le risque de fuite. Au vu des éléments à sa disposition, la Cour estime ne pas pouvoir remettre en cause l’appréciation portée par les autorités nationales sur ce risque et sur la possibilité de recourir à une mesure alternative à la rétention.
82. La Cour observe, par ailleurs, que la requérante a été condamnée le 19 novembre 2014 à trois ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis ainsi qu’à une peine d’interdiction du territoire français de dix ans et qu’elle a été placée en rétention le 2 décembre suivant, le lendemain de la date d’expiration du délai d’appel contre ce jugement. Il n’est pas contesté par les parties que le préfet de Haute-Garonne a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités roumaines le jour même du placement en rétention et que celles-ci n’ont délivré ce document que le 19 décembre 2014, empêchant, en conséquence, les autorités françaises de procéder à l’éloignement des requérants avant cette date. La Cour en déduit qu’aucun retard dans la mise à exécution de la mesure d’expulsion n’est à imputer aux autorités françaises.
83. Dans de telles circonstances, la rétention de la famille pour une durée de dix jours n’apparaît pas disproportionnée par rapport au but poursuivi. Partant, la Cour considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
POPOV C. FRANCE requêtes no 39472/07 et 39474/07 du 19 janvier 2012
La rétention de jeunes migrants accompagnés de leurs parents dans un centre inadapté aux enfants était irrégulière et contraire au respect de la vie familiale
132. La Cour estime que l’existence d’une « vie familiale » au sens de la jurisprudence Marckx c. Belgique (13 juin 1979, série A no 31) ne fait pas de doute en l’espèce, elle n’est d’ailleurs pas contestée par le Gouvernement. Cette disposition est donc applicable à la situation dénoncée par les requérants.
133. La Cour rappelle que l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 69, CEDH 2003-VII). Il pèse en effet sur les Etats une obligation « d’agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale » (Marckx, précité, § 31).
134. La Cour est d’avis que si le fait pour les parents et les enfants de ne pas être séparés est un élément fondamental garantissant l’effectivité de la vie familiale (Olsson c. Suède (no 1), 24 mars 1988, § 59, série A no 130), il ne saurait en être déduit que le seul fait que la cellule familiale soit maintenue garantit nécessairement le respect du droit à une vie familiale et ce, particulièrement lorsque la famille est détenue. Elle considère que le fait d’enfermer les requérants dans un centre de rétention, pendant quinze jours, les soumettant à la vie carcérale inhérente à ce type d’établissement peut s’analyser comme une ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale.
135. Pareille ingérence enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cet article, c’est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
136. La Cour observe que la base légale de la détention des parents trouvait son fondement dans l’article L. 554-1 du CESEDA.
137. Concernant le but poursuivi par la mesure litigieuse, la Cour constate qu’elle a été prise dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire. Cette action peut se rattacher à des objectifs tant de protection de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre, de bien-être économique du pays que de prévention des infractions pénales. La Cour parvient par conséquent à la conclusion que l’ingérence dont il est question poursuivait un but légitime au regard de l’article 8 § 2 de la Convention.
138. Elle doit enfin examiner si le placement en rétention de la famille, pour une durée telle qu’en l’espèce, s’avérait nécessaire au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, c’est-à-dire justifié par un besoin social impérieux et, notamment, proportionné au but légitime poursuivi (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 80).
139. La Cour rappelle à cet égard que les autorités se doivent de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290). Elle insiste sur le fait que cet équilibre doit être sauvegardé en tenant compte des Conventions internationales, notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant (mutatis mutandis, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 120, 28 juin 2007 (extraits)). Il y a donc nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique d’immigration des Etats.
140. Ainsi, une mesure d’enfermement doit être proportionnée au but poursuivi par les autorités, à savoir l’éloignement. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’il s’agit de familles, les autorités doivent, dans leur évaluation de la proportionnalité, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. A cet égard, la Cour souligne qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (Rahimi, précité, § 108, et, mutatis mutandis, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010).
141. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant préconise que l’intérêt supérieur des enfants soit une considération primordiale dans toute décision les concernant (article 3). De même, la directive « accueil » (paragraphe 60 ci-dessus), transposée dans le CESEDA, prévoit expressément que les Etats membres accordent une place d’importance à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Il découle par ailleurs des rapports internationaux (ci-dessus, droit international pertinent) que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant implique d’une part de maintenir, autant que faire se peut, l’unité familiale, d’autre part, d’envisager des alternatives afin de ne recourir à la détention des mineurs qu’en dernier ressort (paragraphes 64 à 68 ci-dessus).
142. La Cour relève que la pratique française de maintenir les familles en instance d’expulsion dans des lieux de privation de liberté est mise en cause et que la France compte parmi les trois seuls pays européens qui recourent systématiquement à la rétention de mineurs migrants accompagnés (rapport de la commission LIBE, paragraphe 62 ci-dessus).
143. La Cour constate de plus que dès 1999, le HCR invita les Etats à étudier toutes les alternatives à la détention dans le cas d’enfants accompagnant leurs parents et de n’avoir recours à la détention que si elle est le seul moyen de maintenir l’unité familiale (paragraphe 65 ci-dessus).
144. La Cour note enfin que la CNDS et la Défenseure des enfants se sont prononcées, à plusieurs reprises, contre la privation de liberté d’enfants n’ayant pas commis d’infraction pénale, accompagnés ou non, au nom du respect de leur intérêt supérieur. Selon elles, lorsque les parents de jeunes mineurs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, l’assignation à résidence ou, si celle-ci s’avère impossible, la location de chambres d’hôtel devrait être envisagée en priorité (paragraphes 47 à 51 ci-dessus).
145. En l’espèce, les requérants ne présentaient pas de risque particulier de fuite nécessitant leur détention. Ainsi, leur enfermement dans un centre fermé n’apparaissait pas justifié par un besoin social impérieux, et ce d’autant plus que l’assignation dans un hôtel durant la première phase de leur rétention administrative ne semble pas avoir posé de problème.
146. La Cour constate qu’il ne ressort pas des éléments communiqués par le Gouvernement qu’une alternative à la détention ait été envisagée, assignation à résidence ou, à l’instar de la préfecture du Maine-et-Loire, maintien en résidence hôtelière (paragraphe 19 ci-dessus). De même, il n’apparaît pas que les autorités aient réexaminé la possibilité d’une détention hors centre de rétention durant la période en cause.
Enfin, il ne ressort pas des faits en présence que les autorités aient mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion et limiter le temps d’enfermement. En effet, les requérants furent maintenus pendant quinze jours sans qu’aucun vol ne soit organisé.
147. La Cour est consciente de ce qu’un grief similaire a précédemment été déclaré irrecevable concernant la détention de quatre enfants avec leur mère pour une durée d’un mois, et alors qu’aucune alternative à la détention n’avait été envisagée (Muskhadzhivyeva et autres, précité). Cependant, au vu des éléments qui précèdent et des récents développements jurisprudentiels concernant l’« intérêt supérieur de l’enfant » dans le contexte de la rétention de mineurs migrants (Rahimi, précité), la Cour estime qu’elle ne peut souscrire aux arguments du Gouvernement qui prétend que l’intérêt supérieur des enfants a été sauvegardé en l’espèce. En effet, elle est d’avis que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale mais que les autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale. Aussi, en l’absence de tout élément permettant de soupçonner que la famille allait se soustraire aux autorités, la détention, pour une durée de quinze jours, dans un centre fermé, apparaît disproportionnée par rapport au but poursuivi.
148. Partant, la Cour considère que les requérants ont subi une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de leur vie familiale et qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
L'ENTRÉE DU SÉJOUR DOIT ÊTRE RÉGULIER
POUR QU'UNE EXPULSION VIOLE LA CONVENTION
Antwi et autres C. Norvège requête N° 26940/10 du 14 février 2012
Les autorités norvégiennes ne violeraient pas la Convention des droits de l’homme en procédant à une expulsion assortie d’une interdiction du territoire de cinq ans alors qu'il est marié a un enfant.
Les requérants sont Henry Antwi, de nationalité ghanéenne, ainsi que son épouse et sa fille, Vivian Awere Osei et Nadia Ryan Pinto, toutes deux ressortissantes norvégiennes.
Ils sont nés en 1975, 1979 et 2001 respectivement et résident à Oslo. En 1998, M. Antwi arriva en Allemagne, où il se procura un faux passeport indiquant qu’il était un ressortissant portugais né en 1969. Il y rencontra sa future épouse – qui avait quitté le Ghana à l’âge de 17 ans pour rejoindre son père, ses frères et ses sœurs en Norvège – et s’installa en Norvège en 2000 pour la rejoindre. Leur fille naquit en 2001 en Norvège et ils se marièrent au Ghana en 2005.
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants dénoncent la décision prise en 2006 par les services de l’immigration d’expulser M. Antwi et de l’interdire de territoire pendant cinq ans après qu’ils eurent découvert que son passeport était un faux.
Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). La Cour relève que M. Antwi a obtenu un permis de séjour et de travail après avoir présenté un passeport et un certificat de naissance falsifiés qu’il s’était procurés en 1998 en se faisant passer pour quelqu’un d’autre. Il s’ensuit que le séjour de l’intéressé en Norvège n’a jamais été régulier. La Cour conclut que les autorités norvégiennes n’ont pas agi de manière arbitraire ou excédé autrement la marge d’appréciation dont elles doivent bénéficier en la matière. Elles ont ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général qu’il y a à assurer un contrôle effectif de l’immigration et l’intérêt des requérants à ce que M. Antwi soit autorisé à rester en Norvège. En conséquence, l’expulsion de M. Antwi de la Norvège assortie d’une interdiction du territoire de cinq ans ne porterait pas atteinte à l’article 8.
Arrêt GRANDE CHAMBRE
De Souza Ribeiro C. France du 13 décembre 2012 requête 22689/07
a) Principes généraux applicables
77. Dans les affaires concernant le droit des étrangers, la Cour a constamment affirmé que, d’après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux sur leur sol. La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de l’ordre public, les Etats contractants ont la faculté d’expulser un étranger délinquant. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent avoir une base légale, poursuivre un but légitime et se révéler nécessaires dans une société démocratique, (voir Boultif, précité, § 46, et Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 54, CEDH 2006‑XII).
En vertu de l’article 1 de la Convention, ce sont les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI).
78. La Cour l’a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Les Etats jouissent en effet d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 48, CEDH 2000‑VIII). Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (Kudła, précité, § 157).
79. L’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’est pas nécessairement juridictionnelle. Cependant, ses pouvoirs et les garanties procédurales qu’elle présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 67, série A no 28). S’agissant des « instances » non juridictionnelles, la Cour s’attache à en vérifier l’indépendance ( voir, par exemple, Leander c. Suède, 26 mars 1987, §§ 77 et 81 à 83, série A no 116, Khan c. Royaume-uni, no 35394/97, §§ 44 à 47, CEDH 2000‑V), ainsi que les garanties de procédure offertes aux requérants (voir, mutatis mutandis, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 152 à 154, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 69, CEDH 2000‑V).
80. Pour être effectif, le recours exigé par l’article 13 doit être disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 112, CEDH 1999‑IV).
81. Une attention particulière doit aussi être prêtée à la rapidité du recours lui-même puisqu’il n’est pas exclu que la durée excessive d’un recours le rende inadéquat (Doran c. Irlande, no 50389/99, § 57, CEDH 2003‑X).
82. Lorsqu’il s’agit d’un grief selon lequel l’expulsion de l’intéressé l’exposera à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, compte tenu de l’importance que la Cour attache à cette disposition et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 448, CEDH 2005‑III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 (Jabari, précité, § 50) ainsi qu’une célérité particulière (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004‑IV (extraits)). Dans ce cas, l’effectivité requiert également que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 200, 23 février 2012). Les mêmes principes s’appliquent lorsque l’expulsion expose le requérant à un risque réel d’atteinte à son droit à la vie, protégé par l’article 2 de la Convention. Enfin, l’exigence d’un recours de plein droit suspensif a été confirmée pour les griefs tirés de l’article 4 du Protocole no 4 (Čonka, précité, §§ 81-83, et Hirsi Jamaa et autres, précité, § 206).
83. En revanche, s’agissant d’éloignements d’étrangers contestés sur la base d’une atteinte alléguée à la vie privée et familiale, l’effectivité ne requiert pas que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif. Il n’en demeure pas moins qu’en matière d’immigration, lorsqu’il existe un grief défendable selon lequel une expulsion risque de porter atteinte au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale, l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention exige que l’Etat fournisse à la personne concernée une possibilité effective de contester la décision d’expulsion ou de refus d’un permis de séjour et d’obtenir un examen suffisamment approfondi et offrant des garanties procédurales adéquates des questions pertinentes par une instance interne compétente fournissant des gages suffisants d’indépendance et d’impartialité (M. et autres c. Bulgarie, no 41416/08, §§ 122 à 132, 26 juillet 2011, et, mutatis mutandis, Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, § 133, 20 juin 2002).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
84. La Cour relève que la question qui se pose concerne l’effectivité des recours exercés en Guyane par le requérant, dont l’éloignement était en cours, pour faire valoir un grief tiré de l’article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour estime nécessaire de souligner à nouveau qu’en ce qui concerne les requêtes relatives à l’immigration, telles que celle du requérant, elle se consacre et se limite, dans le respect du principe de subsidiarité, à évaluer l’effectivité des procédures nationales et à s’assurer que ces procédures fonctionnent dans le respect des droits de l’homme (voir, mutatis mutandis, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 286‑287, CEDH 2011, et I.M. c. France, no 9152/09, § 136, 2 février 2012).
85. La Cour rappelle également que l’article 13 de la Convention ne va pas jusqu’à exiger une forme particulière de recours et que l’organisation des voies de recours internes relève de la marge d’appréciation des Etats (voir Vilvarajah et autres c. Royaume‑Uni, 30 octobre 1991, § 122, série A no 215, et, parmi d’autres, G.H.H. et autres c. Turquie, no 43258/98, § 36, CEDH 2000‑VIII).
86. Dans la présente affaire, le requérant a exercé les voies de recours disponibles avant son éloignement dans le système en vigueur en Guyane : il a saisi le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir à l’encontre de l’APRF dont il avait fait l’objet, ainsi que d’une demande en référé suspension ; il a ensuite soumis, au même tribunal administratif, une demande en référé liberté.
87. La Cour doit dès lors rechercher si le requérant a bénéficié de garanties effectives le protégeant contre la mise en œuvre d’une décision d’éloignement prétendument contraire à l’article 8.
88. A cet égard, la Cour ne peut manquer de relever tout d’abord la chronologie de la présente affaire : interpellé le matin du 25 janvier 2007, le requérant fit l’objet d’un APRF et fut placé en rétention administrative le même jour à 10 heures, pour être ensuite éloigné le lendemain à 16 heures. Il a donc été éloigné de Guyane moins de trente-six heures après son interpellation.
La reconduite à la frontière a été prononcée par le préfet de Guyane au moyen d’un arrêté dont la Cour note, avec le requérant, le caractère succinct et stéréotypé de la motivation (voir paragraphe 17). La Cour constate aussi que cet arrêté a été notifié au requérant immédiatement après son interpellation. Ces éléments paraissent révéler le caractère superficiel de l’examen de la situation du requérant effectué par l’autorité préfectorale.
89. La Cour note également qu’il existe un désaccord entre les parties quant à la raison pour laquelle le requérant a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. Selon le Gouvernement, le requérant se trouvait en situation irrégulière par sa propre négligence, puisqu’il avait omis de régulariser sa situation administrative. Le requérant, en revanche, souligne que, puisqu’il se trouvait alors dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, il pouvait encore demander la régularisation de sa situation et qu’en tout état de cause, il était protégé de tout éloignement du territoire français.
90. Or, la Cour constate, comme cela a été allégué dès la première saisine des juridictions nationales par le requérant (voir paragraphe 18), que quelle que soit la raison de l’irrégularité de la situation du requérant au moment de son interpellation, il était protégé de tout éloignement du territoire français par le droit national (voir l’article L. 511-4 du CESEDA). Cette analyse a été retenue par le tribunal administratif de Cayenne, qui, ayant examiné les éléments initialement fournis par le requérant, a prononcé par la suite l’illégalité de l’APRF (voir paragraphe 23).
91. Ainsi, il est avéré que, dès le 26 janvier 2007, les autorités françaises étaient en possession des éléments tendant à établir que l’éloignement du requérant n’était pas prévu par la loi et pouvait donc constituer une ingérence illégale, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (voir paragraphe 18). A l’instar de la chambre, la Grande Chambre considère, par conséquent, qu’au moment où le requérant a été reconduit à destination du Brésil, une question sérieuse se posait quant à la compatibilité de son éloignement avec l’article 8 de la Convention et estime que le grief soumis par le requérant sur ce point est dès lors « défendable » aux fins de l’article 13 (voir paragraphe 53).
92. Envisageant ensuite les possibilités dont disposait le requérant pour contester la décision d’éloignement dont il avait fait l’objet, la Cour observe que l’intéressé, avec l’assistance de la CIMADE, a pu saisir le tribunal administratif de Cayenne. La Cour reconnaît que ce recours a été exercé devant un juge remplissant les conditions d’indépendance, d’impartialité et de compétence pour examiner les griefs tirés de l’article 8.
93. Toutefois, elle rappelle que, sans préjudice du caractère suspensif ou non des recours, l’effectivité requiert, pour éviter tout risque de décision arbitraire, que l’intervention du juge ou de « l’instance nationale » soit réelle.
94. En l’espèce, le dossier soumis à « l’instance nationale » compétente ne saurait être qualifié de particulièrement complexe. A cet égard, la Cour le réitère, les recours introduits comportaient une argumentation juridique précise dûment exposée par le requérant. Pour contester son éloignement, celui-ci avait en effet allégué à la fois la non-conformité à la Convention de la mesure prise ainsi que son illégalité au regard du droit national. Il s’était notamment référé à l’article L. 511-4 du CESEDA et il avait exposé de façon détaillée les éléments tendant à prouver que l’essentiel de sa vie privée et familiale s’était jusqu’alors déroulée en Guyane (voir paragraphe 18), assurant ainsi une saisine suffisamment étayée de façon à faciliter l’examen du dossier (voir, mutatis mutandis, I.M. c. France, précité, § 155).
Ensuite et surtout, la Cour ne peut que constater que, ayant saisi le tribunal administratif le 26 janvier 2011 à 15 heures et 11 minutes, le requérant a été éloigné vers le Brésil le même jour à 16 heures. Aux yeux de la Cour, la brièveté de ce délai exclut toute possibilité pour le tribunal d’examiner sérieusement les circonstances et arguments juridiques qui militent pour ou contre la violation de l’article 8 de la Convention en cas de mise à exécution de la décision d’éloignement.
Il en résulte donc qu’au moment de l’éloignement, les recours introduits par le requérant et les circonstances concernant sa vie privée et familiale n’avaient fait l’objet d’aucun examen effectif par une instance nationale. En particulier, compte tenu du déroulement chronologique des faits de la présente espèce, la Cour ne peut que constater qu’aucun examen judiciaire des demandes du requérant n’a pu avoir lieu, ni au fond ni en référé.
95. Or, si la procédure en référé pouvait en théorie permettre au juge d’examiner les arguments exposés par le requérant ainsi que de prononcer, si nécessaire, la suspension de l’éloignement, toute possibilité à cet égard a été anéantie par le caractère excessivement bref du délai écoulé entre la saisine du tribunal et l’exécution de la décision d’éloignement. D’ailleurs, le juge des référés saisi n’a pu que déclarer sans objet la demande introduite par le requérant. Ainsi, l’éloignement du requérant a été effectué sur la seule base de la décision prise par l’autorité préfectorale.
Par conséquent, dans les circonstances de la présente espèce, la Cour estime que la hâte avec laquelle la mesure de renvoi a été mise en œuvre a eu pour effet en pratique de rendre les recours existants inopérants et donc indisponibles. Si la Cour reconnaît l’importance de la rapidité des recours, celle-ci ne saurait aller jusqu’à constituer un obstacle ou une entrave injustifiée à leur exercice, ni être privilégiée aux dépens de leur effectivité en pratique.
96. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la reconduite à la frontière du requérant a été effectuée selon une procédure mise en œuvre selon des modalités rapides, voire expéditives. Ces circonstances n’ont pas permis au requérant d’obtenir, avant son éloignement, un examen suffisamment approfondi et offrant des garanties procédurales adéquates de la légalité de la mesure litigieuse par une instance interne (voir paragraphe 79 ci-dessus).
97. Quant à la situation géographique de la Guyane, et à la forte pression migratoire subie par ce département-région d’outre-mer, le Gouvernement soutient que ces éléments justifieraient le régime d’exception prévu par la législation ainsi que son fonctionnement. Au vu du cas d’espèce, la Cour ne saurait souscrire à cette analyse. Certes, elle est consciente de la nécessité pour les Etats de lutter contre l’immigration clandestine et de disposer des moyens nécessaires pour faire face à de tels phénomènes, tout en organisant les voies de recours internes de façon à tenir compte des contraintes et situations nationales.
Toutefois, si les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose l’article 13 de la Convention, celle-ci ne saurait permettre, comme cela a été le cas dans la présente espèce, de dénier au requérant la possibilité de disposer en pratique des garanties procédurales minimales adéquates visant à le protéger contre une décision d’éloignement arbitraire.
98. Enfin, en ce qui concerne le risque d’engorgement des juridictions pouvant entraîner des conséquences contraires à la bonne administration de la justice en Guyane, la Cour rappelle que, tout comme l’article 6 de la Convention, l’article 13 astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition. A cet égard, il y a lieu de souligner l’importance de l’article 13 en vue du maintien du caractère subsidiaire du système de la Convention (voir, mutatis mutandis, Kudła, précité, § 152, et Čonka, précité, § 84).
99. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour constate que le requérant n’a pas disposé en pratique de recours effectifs lui permettant de faire valoir le bien-fondé du grief tiré de l’article 8 de la Convention alors que son éloignement était en cours. Cela n’a pu être réparé par la délivrance ultérieure d’un titre de séjour.
100. Partant, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la perte de la qualité de « victime » du requérant au sens de l’article 34 de la Convention.
Elle conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention.
LE DROIT DES MIGRANTS EN FRANCE
Commission nationale consultative des droits de l'homme : Déclaration d'Alerte sur le traitement des personnes migrantes en 2017.
Pour toucher les allocations familiales, les étrangers doivent justifier d'un certificat médical de l'OFII
COUR DE CASSATION ASSEMBLEE PLENIERE ARRÊT DU 3 JUIN 2011 Pourvoi N° 09-71.352 CASSATION PARTIELLE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité marocaine, qui justifie d’une carte de résident valable jusqu’en juin 2011, a sollicité, en septembre 2005, de la caisse d’allocations familiales de Paris (la caisse) le bénéfice des prestations familiales au titre de ses deux filles, N... et A..., nées respectivement en 1986 et en 1989 au ... et arrivées en France en 2003 en dehors de la procédure de regroupement familial ; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif qu’il ne produisait pas le certificat médical de l’Office des migrations internationales, devenu l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours.
Mais attendu que l’arrêt constate que M. X..., dont il n’est pas contesté qu’il assume la charge effective et permanente de ses deux enfants, justifie être titulaire d’une carte de résident valable de juin 2001 à juin 2011 ; que la cour d’appel en a exactement déduit que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 qui a modifié les conditions d’attribution des prestations familiales, le bénéfice de celles-ci ne pouvait être subordonné à la production d’un certificat de l’OFII.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à obtenir les prestations familiales pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, l’arrêt retient que la nouvelle réglementation qui subordonne le bénéfice des prestations familiales à la justification de la régularité du séjour des enfants porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l’origine nationale et au droit à la protection de la vie familiale garantis par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Qu’en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
COUR DE CASSATION ASSEMBLEE PLENIERE ARRÊT DU 3 JUIN 2011 Pourvoi N° 09-69052 REJET
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2009), que M. et Mme X..., de nationalité congolaise, qui résident en France de façon régulière depuis octobre 2000, ont sollicité de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (la caisse) le bénéfice des prestations familiales au titre de leurs deux enfants, C... et J..., nés à ... respectivement en 1994 et en 1997, entrés en France en mai 2002, en dehors de la procédure de regroupement familial ; que la caisse ayant rejeté leur demande au motif qu’ils ne produisaient pas le certificat médical de l’Office des migrations internationales devenu l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ils ont saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours
Mais attendu que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n̊ 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n̊ 2006-234 du 27 février 2006, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d’un document attestant d’une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l’OFII ; que ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant
Mais attendu que l’arrêt constate que les époux X... justifient qu’ils résident légalement sur le territoire national français depuis le mois d’octobre 2000 ; que la cour d’appel en a exactement déduit que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 qui a modifié les conditions d’attribution des prestations familiales, le bénéfice de celles-ci ne pouvait être subordonné à la production d’un certificat de l’OFII
Par deux arrêts rendus le 3 juin 2011, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a statué sur le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers entrés en France sans respecter les règles du regroupement familial.
Dans ces espèces, l’attribution des allocations familiales avait été refusée à des parents étrangers au motif qu’ils ne produisaient pas le certificat de contrôle médical de leurs enfants, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La Cour de cassation a distingué deux périodes.
- Dans le prolongement d’un précédent arrêt d’assemblée plénière du 16 avril 2004 (n° 02-30.157, Bull. Ass. Plén., n° 8), qui avait fait prévaloir le principe du droit aux prestations familiales pour les bénéficiaires étrangers en situation régulière, énoncé à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, sur les modalités d’application définies par les articles R. 511-1 et R. 511-2 du même code, elle a jugé qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, le bénéfice des prestations familiales ne pouvait être subordonné à la production d’un certificat de l’OFII.
- L’article 89 de la loi du 19 décembre 2005, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2005-528 du 15 décembre 2005), a modifié l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que les ressortissants étrangers peuvent demander à bénéficier des prestations familiales pour les enfants à leur charge, sous réserve, s’agissant de l’enfant à charge, de son entrée régulière « dans le cadre de la procédure de regroupement familial ».
Examinant la conventionalité de ces nouvelles dispositions, la Cour de cassation a jugé qu’elles revêtaient « un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants » et qu’elles ne portaient pas « une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », ni ne méconnaissaient les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Elle en a déduit que, depuis l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bénéfice des prestations familiales pouvait être subordonné à l’accomplissement de la procédure de regroupement familial.
C’est dans le même sens qu’avait conclu l’avocat général.
Une demande d'asile donne des droits
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n° 10-21431 CASSATION
Vu l’article L. 552-7
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour
d’appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité
irakienne, en
situation irrégulière en France, a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la
frontière et d’une décision de maintien en rétention qui lui ont été notifiés le
28 mai 2010 ; que, le 30 mai 2010, un juge des libertés et de la détention a
prolongé sa rétention pour une durée maximale de quinze jours ; que le 31 mai
2010, M. X... a déposé une demande d’asile
Attendu que, pour prolonger la rétention de l’intéressé pour une nouvelle période de quinze jours, l’ordonnance retient que la demande d’asile présentée par M. X... apparaissait dilatoire et abusive et qu’il s’agissait d’une obstruction volontaire faite à son éloignement
Qu’en statuant ainsi, alors que le dépôt d’une demande d’asile est constitutif de l’exercice d’un droit de sorte qu’une telle demande ne peut jamais être regardée comme une obstruction volontaire faite par l’étranger à son éloignement rendant impossible l’exécution de cette mesure, le premier président a violé le texte susvisé
Vu l’article L. 411 3 du code de l’organisation judiciaire
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger
Une détention peut être prolongée par une rétention de l'étranger
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n° 10-20602 CASSATION
Vu l’article L. 553-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Attendu que M. X..., de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière du 2 avril 2010 alors qu’il était détenu au centre de détention de Chateaudun ; que, le 12 mai 2010, à l’issue de sa période d’incarcération, le préfet d’Eure et Loir a pris une décision de placement en rétention et M. X... a été conduit au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot ; qu’un juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée maximale de quinze jours
Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention, l’ordonnance attaquée retient que la preuve n’est pas rapportée devant la juridiction d’appel de ce que les prescriptions de l’article L. 553-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été mises en œuvre et que la procédure est irrégulière
Qu’en statuant ainsi alors que M. X... n’avait pas été déplacé, pendant la durée de sa rétention, d’un lieu de rétention vers un autre, mais maintenu dans un centre de rétention à l’issue de sa période d’incarcération, de sorte que les prescriptions de l’article L. 553-2 n’avaient pas à être mises en œuvre, le premier président a, par fausse application, violé l’article susvisé ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger
Un ou une étrangère en situation irrégulière peut être renvoyée suite à une garde à vue en cas d'enquête de flagrance
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 6 juin 2012 pourvoi n° 10-20602 CASSATION
Vu les articles 63 3 du code de procédure pénale et L. 552 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, qu’au cours d’une enquête en flagrance ouverte pour des faits de viol, une personne disant se nommer M. Robertas Y... a été interpellée et placée en garde à vue, le 23 novembre 2010 à 7h15 par les services de la gendarmerie ; qu’à la suite d’une demande de sa famille, elle a fait l’objet, le même jour, d’un examen par un médecin en application de l’article 63 3 du code de procédure pénale ; que la mesure de garde à vue a été prolongée à compter du 24 novembre à 7h15 avant d’être levée le même jour à 15h ; qu’à la suite de vérifications des services enquêteurs, il s’est avéré que les documents d’identité lituaniens présentés par la personne gardée à vue au nom de M. Y... étaient faux et qu’il se nommait M. Arman X..., de nationalité arménienne et était en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’une première procédure incidente a été ouverte pour détention et usage de faux documents administratifs et l’intéressé a fait l’objet d’un deuxième placement en garde à vue, à l’issue de la précédente mesure, le 24 novembre 2010, de 15h à 18h15 ; qu’une seconde procédure incidente a été ouverte pour entrée et séjour irréguliers d’un étranger en France et M. X... a fait l’objet d’une troisième garde à vue, à l’issue de la deuxième mesure, le 24 novembre 2010 de 18h15 à 19h30, heure à laquelle la garde à vue a été levée et l’intéressé placé en rétention administrative ; que le même jour, le préfet d’Eure et Loir a pris deux arrêtés à l’encontre de M. X..., le premier prononçant sa reconduite à la frontière et le deuxième décidant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de Versailles, par ordonnance du 26 novembre 2010, a accueilli l’exception de nullité, présentée par M. X... et tirée du défaut de versement au dossier du certificat établi par le médecin pendant la première garde à vue, et a ordonné sa remise en liberté ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise et prononcer la nullité de la procédure, l’ordonnance énonce que le certificat médical n’a pas été versé à la procédure en infraction à l’article 63 3, alinéa 3, du code de procédure pénale et que cette défaillance a privé le gardé à vue de la possibilité de prouver que son état de santé n’était, effectivement, pas compatible avec la mesure de contrainte et n’a pas permis au juge de vérifier cette compatibilité de sorte qu’elle a nécessairement porté atteinte à l’exercice des droits de la défense ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’irrégularité alléguée affectait une garde à vue qui ne précédait pas immédiatement la mesure de rétention litigieuse, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l’article L. 411 3 du code de l’organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger
Les passagers d'un bus de la communauté européenne ne peut être contrôlé dans le but de remplacer les contrôles à la frontière
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 6 juin 2012 pourvoi n° 10-25.233 Cassation
Vu les articles 67, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
Attendu que la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 2010 (C 188/10 et C 189/10), dit pour droit que l’article 67, paragraphe 2, du TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, le 20 juillet 2010, M. Ali X..., qui voyageait dans un autocar effectuant la liaison Milan Paris, a fait l’objet d’un contrôle sur le fondement de l’article L. 611 1, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; que ce contrôle ayant révélé que M. Ali X..., de nationalité somalienne, se trouvait en situation irrégulière en France, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire national et détention et usage de faux documents ; que, le même jour, le préfet de Haute Savoie lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu’un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention
Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ordonnance relève que l’immatriculation de l’autocar à l’étranger constituait un élément objectif d’extranéité justifiant le contrôle des passagers en application de l’article L. 611 1 du CESEDA
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en ce qu’il confère aux policiers la faculté, sur l’ensemble du territoire national, en dehors de tout contrôle d’identité, de requérir des personnes de nationalité étrangère, indépendamment de leur comportement ou de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, la présentation des documents au titre desquels celles-ci sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, l’article L. 611 1, alinéa 1, du CESEDA ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés dès lors qu’il n’est assorti d’aucune disposition de nature à garantir que l’usage de cette faculté ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, le premier président les a violés par refus d’application ;
Vu l’article L. 411 3 du code de l’organisation judiciaire
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger
Un étranger ne peut pas être en garde à vue sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Cour de Cassation chambre criminelle avis n°9002 du 5 juin 2012
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille douze, a rendu l’avis suivant :
Vu la demande d’avis formulée le 3 avril 2012 par la première chambre civile à l’occasion de l’examen des pourvois B1119250, Q1121792, R1119378, C1119251, N1130530, D1130384, Q11130371 et ainsi libellée : "A la lumière des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 avril 2011(El Dridi) et du 6 décembre 2011 (Achugbabian) ainsi que, d’une part, de l’article 63 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 14 avril 2011, d’autre part, des articles 62-2 et 67 du code de procédure pénale dans leur rédaction actuellement en vigueur, un ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne peut-il être placé en garde à vue, sur le fondement du seul article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?" ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ;
Vu les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 avril 2011(El Dridi) et du 6 décembre 2011 (Achugbabian) ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Spinosi, et les conclusions de M. l’avocat général Mathon, Me Spinosi ayant eu la parole en dernier ;
A émis l’avis suivant :
“Il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 qu’une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement ; qu’en outre, la mesure doit obéir à l’un des objectifs nécessaires à la conduite de la procédure pénale engagée ; qu’à la suite de l’entrée en application de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants d’Etats tiers en séjour irrégulier, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, le ressortissant d’un Etat tiers mis en cause, pour le seul délit prévu par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’encourt pas l’emprisonnement lorsqu’il n’a pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l’article 8 de ladite directive ; qu’il ne peut donc être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée de ce seul chef ;
Pour les mêmes raisons, il apparaît que le ressortissant d’un Etat tiers ne pouvait, dans l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée pour entrée ou séjour irréguliers selon la procédure de flagrant délit, le placement en garde à vue n’étant possible, en application des articles 63 et 67 du code de procédure pénale alors en vigueur, qu’à l’occasion des enquêtes sur les délits punis d’emprisonnement. Le même principe devait prévaloir lorsque l’enquête était menée selon d’autres formes procédurales.
Un enfant peut demander sa nationalité française jusqu'à sa majorité s'il est élevé en France depuis 5 ans par un ou une français(e)
COUR DE CASSATION, Avis n° 1200004 du 4 juin 2012
LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 1er mars 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, reçue le 8 mars 2012, dans une instance opposant M. X... à M. le procureur de la République et ainsi libellée :
"L’enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite en application de l’article 21-12 1̊ du code civil exige-t-il que la personne ayant recueilli l’enfant depuis au moins cinq années ait été de nationalité française durant toute la période de ce recueil ou suffit-il qu’elle justifie remplir cette condition au moment de la souscription de la dite déclaration ?"
Sur le rapport de Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Pages, avocat général entendu en ses observations orales ;
EN CONSÉQUENCE, EST D’AVIS QUE :
Peut, jusqu’à sa majorité, réclamer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du code civil, la nationalité française en application de l’article 21-12, alinéa 3, 1̊ de ce code, l’enfant recueilli en France, depuis au moins cinq années au jour de la déclaration et élevé par une personne ayant la nationalité française depuis au moins cinq années au jour de la déclaration, pourvu qu’à l’époque de celle-ci, il réside en France.
GUERRE AU MALI ET TITRE DE SEJOUR DES MALIENS
Avis du Conseil d'Etat n° 366481 du 7 mai 2013
Le Conseil d'Etat, (section du contentieux, 2e et 7e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux,
Vu l'arrêt n° 12PA02479 du 28 février 2013, enregistré le même jour au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative
d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête de M. A. B. tendant à
l'annulation du jugement n° 1115430/6 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal
administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation
de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui
délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus
d'une obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de
destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui
délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la
notification du jugement, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard, a
décidé, par application de l'article
L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de
cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions
suivantes :
1. Faut-il considérer que les stipulations des articles 5 et 6 de la convention
franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des
personnes se bornent à régir les conditions d'admission des ressortissants
maliens sur le territoire français ou qu'elles traitent également de la
délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée et, s'il
convient de retenir cette seconde interprétation, que ces stipulations
définissent les conditions d'attribution de tels titres à ces ressortissants de
façon suffisamment précise pour faire obstacle à ce que ceux-ci puissent
utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée
des étrangers et du droit d'asile ?
2. Dans cette dernière hypothèse, faut-il considérer que le préfet, lorsqu'il
est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice
d'une activité salariée présentée sur le seul fondement de l'article L. 313-14
précité, est tenu de refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, les
moyens du requérant dirigés contre ce refus étant dès lors inopérants, ou qu'il
doit alors requalifier la demande de l'intéressé comme ayant été présentée sur
le fondement de la convention ?
3. Dans l'hypothèse où le préfet s'est, à tort, fondé sur l'article L. 313-14
précité pour statuer sur la demande de l'intéressé, le juge doit-il censurer sa
décision pour erreur de droit et, s'agissant d'une méconnaissance du champ
d'application de la loi, soulever d'office ce moyen si celui-ci n'est pas
invoqué par le requérant ? Ou bien le juge peut-il procéder à une substitution
de base légale de la décision en examinant si l'étranger remplit les conditions
posées par la convention bilatérale, étant observé que l'autorité administrative
dispose d'un plus large pouvoir d'appréciation pour l'examen d'une demande
fondée sur l'article L. 313-14 ? Ou encore, et dans la mesure où les
stipulations de cette convention n'interdisent pas au préfet de délivrer un
titre de séjour à un ressortissant malien qui ne remplit pas l'ensemble des
conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant de
son pouvoir discrétionnaire, le juge peut-il examiner si le préfet aurait pris,
dans les circonstances de l'espèce, la même décision si celui-ci s'était
prononcé sur la demande dans le seul cadre du pouvoir général de régularisation
dont il dispose ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et
Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des
personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le
code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service
extraordinaire,
― les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Rend l'avis suivant :
1. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers
et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le
rappelle l'article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions
internationales ».
2. En ce qui concerne les ressortissants maliens, l'article 15 de la convention
du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des
personnes stipule que : « Les points non traités par la convention en matière
d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat
d'accueil. » L'article 4 de cette même convention stipule que : « Pour un séjour
de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français
et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis
d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9
ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L'article 5 stipule
que : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le
territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en
outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession
: 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le
départ (...). 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail
dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. » Enfin,
l'article 10 stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire malien devant
excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour.
/ Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les
nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour
sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. »
3. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne
renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le
renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à
eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats,
de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité
salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité
professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article
6. Ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en
France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant
sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de répondre aux autres questions posées par la cour administrative d'appel de Paris.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Paris, à M. A. B. et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
DÉLAIS NON RAISONNABLES DE L'EXAMEN
POUR ACCORDER OU NON UN TITRE DE SÉJOUR
Medjaouri c. France du 5 juillet 2018 requête n o 45196/15
Non victime au sens de l'article 8 et 3 de la Convention, un arrêté d'expulsion de 1997, ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre de séjour !
La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention que s’il est ou a été directement touché par un acte ou omission litigieux. La Cour constate que M. Medjaouri est toujours sous le coup de l’arrêté d’expulsion du 11 avril 1997, qui n’a été ni annulé ni abrogé. Elle note que le gouvernement français souligne que la mise à exécution de cette décision ne saurait être considérée comme imminente et que M. Medjaouri ne risque pas, pour le moment, d’être expulsé. Premièrement, la Cour note que la fixation du pays de renvoi fait l’objet d’une décision séparée et spécifique. Si elle devait être prise, M. Medjaouri aurait la possibilité de la contester devant le tribunal administratif. Deuxièmement, la Cour relève que le Gouvernement indique qu’en cas d’inexécution d’un arrêté d’expulsion pendant plusieurs années, un nouvel arrêté doit se substituer à l’ancien et l’autorité administrative doit procéder à un nouvel examen de la situation du concerné. La Cour note aussi qu’à la suite de la récente levée de l’interdiction du territoire par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, M. Medjaouri s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce qui indique que l’arrêté d’expulsion n’est pas un obstacle insurmontable à la délivrance d’un titre de séjour. En conclusion, la Cour estime que M. Medjaouri n’encourt pas de risque d’éloignement du territoire français proche ou imminent. Il ne peut donc pas se prétendre victime d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention. Enfin, soulignant qu’il aurait la possibilité de saisir la Cour d’une nouvelle requête si des décisions internes lui faisaient courir un risque, la Cour conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.
31. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (Norris c. Irlande, 26 octobre 1988, §§ 30 et 31, série A no 142, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, 20 septembre 1994, § 39, série A no 295‑A). Elle observe que dans certaines affaires, où les requérants sont sous le coup d’une mesure d’éloignement dont la mise en œuvre n’est ni imminente ni proche, elle considère qu’ils ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention (Vijayanathan et Pusparajah, précité, § 46, Arjan Pellumbi c. France (déc.), no 65730/01, 18 janvier 2005, Ay c. France (déc.) [Comité], no 6629/12, 3 mars 2015; voir, également, les affaires dans lesquelles la Cour a rayé les requêtes du rôle dans les mêmes circonstances, Khan c. Allemagne [GC], no 38030/12, § 34, 21 septembre 2016 ; voir, cependant, A.N. c. France, no 19919/13, 2 mai 2017.
32. En l’espèce, la Cour constate que le requérant est toujours sous le coup de l’arrêté d’expulsion du 11 avril 1997, qui n’a été ni annulé ni abrogé. Cela étant, la Cour note que le Gouvernement français souligne que la mise à exécution de cette décision ne saurait être considérée comme imminente et que le requérant ne risque pas, pour le moment, d’être expulsé.
33. La Cour n’aperçoit aucune raison de douter du sérieux de cette affirmation. Elle note, premièrement, que la fixation du pays de renvoi d’un étranger sous le coup d’un arrêté d’expulsion fait l’objet d’une décision séparée et spécifique (paragraphe 19 ci-dessus). Une telle mesure constitue, d’après le Gouvernement, un préalable juridique obligatoire à l’exécution d’une mesure d’éloignement (paragraphe 26 ci-dessus) et, si elle devait être prise, le requérant aurait la possibilité de la contester devant le tribunal administratif afin de formuler les griefs qu’il fait valoir devant la Cour. La Cour relève, deuxièmement, que le gouvernement français indique qu’en cas d’inexécution d’un arrêté d’expulsion pendant plusieurs années, un nouvel arrêté d’expulsion « implicite » doit se substituer à l’ancien, et l’autorité administrative, à cette occasion, devrait procéder à un nouvel examen de la situation du requérant. La Cour a déjà eu, en effet, l’occasion de constater que « selon la jurisprudence du Conseil d’État français, lorsqu’un arrêté d’expulsion est trop ancien, il ne peut plus être mis à exécution : l’autorité administrative doit, le cas échéant, prendre un autre arrêté au vu des circonstances à la date de cette nouvelle décision » (Arjan Pellumbi, précité). Enfin, la Cour note que, à la suite de la récente levée de l’interdiction du territoire par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le requérant s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce qui indique que l’arrêté d’expulsion, contrairement à ce qu’il affirme, n’est pas, dans son cas, un obstacle insurmontable à la délivrance d’un titre de séjour.
34. Il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur le comportement futur des autorités françaises. Compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, et eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le requérant, bien que restant sous le coup de l’arrêté d’expulsion du 11 avril 1997, n’encourt pas de risque d’éloignement du territoire français proche ou imminent. Il ne peut donc se prétendre victime d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention au sens de l’article 34. Soulignant par ailleurs que, le cas échéant, il aura la possibilité de saisir la Cour d’une nouvelle requête si des décisions internes lui faisant courir un tel risque devaient être prises, la Cour conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention (mutatis mutandis, Arjan Pellumbi et Ay précités).
Hoti c. Croatie du 26 avril 2018 requête n°63311/14
Article 8 : La Croatie a porté atteinte au droit à la vie privée d’un immigré apatride en négligeant pendant des années de régulariser son statut de résident.
Le requérant, Bedri Hoti, est né au Kosovo en 1962 d’un couple d’Albanais qui avaient fui leur pays d’origine en tant que réfugiés politiques. À l’époque, le Kosovo était une province autonome de la Serbie, au sein de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (« la RFSY »). À l’âge de 17 ans, M. Hoti quitta le Kosovo et s’installa à Novska, en Croatie, qui à l’époque faisait également partie de la RFSY. Il vit là depuis cette date. Bien qu’il soit depuis de longues années soumis au régime du séjour temporaire, que les autorités du Kosovo lui ont appliqué en raison de son statut de réfugié albanais – statut qui était reconnu dans l’ensemble de l’ex-RFSY –, selon son acte de naissance il n’a en fait pas de nationalité. Pendant des années, M. Hoti a en vain sollicité la citoyenneté croate ainsi qu’un permis de séjour permanent. Cette dernière demande, en particulier, a été rejetée en 2003, essentiellement parce que M. Hoti n’avait pas été employé en Croatie pendant trois années ininterrompues. M. Hoti contesta ces décisions du ministère de l’Intérieur devant les juridictions administratives, mais fut débouté. Un recours constitutionnel formé par lui fut rejeté en 2008.
À l’heure actuelle, M. Hoti tente de faire régulariser sa situation au moyen d’une procédure fondée sur la loi sur les étrangers, grâce à laquelle il lui serait possible de faire prolonger son séjour chaque année pour des motifs humanitaires, soit en fournissant un document de voyage valable soit à la discrétion du ministère. S’il parvient à se prévaloir d’un séjour de cinq ans ininterrompus sous ce régime, il remplira les conditions d’obtention d’un permis de séjour permanent. Pour l’heure il n’y est toutefois pas parvenu, car son séjour, prolongé provisoirement pour des raisons humanitaires de 2011 à 2013, a été interrompu en 2014 lorsque le ministère lui a refusé une prorogation au motif qu’il n’avait pas fourni de document de voyage valable. Plus récemment, en 2015 et en 2016, le ministère, considérant M. Hoti comme un ressortissant du Kosovo, lui a accordé une prolongation de son séjour temporaire. M. Hoti n’a pas de famille en Croatie. Ses parents sont décédés et au fil des ans il a perdu le contact avec deux sœurs qui résident en Allemagne et en Belgique. Pendant les 40 ans qu’il a passés jusqu’ici en Croatie, il a travaillé par intermittence, comme serveur et mécanicien automobile. À l’heure actuelle, il subsiste en donnant des coups de main dans des fermes du secteur de Novska.
La Cour observe tout d’abord que M. Hoti a sans nul doute une vie privée en Croatie. Depuis près de 40 ans, il vit dans ce pays et y travaille par intermittence, et il n’a aucun lien avec un autre pays puisque dans l’intervalle il a perdu tout contact avec l’ensemble de ses proches. Actuellement au chômage faute de posséder le statut de résident, il subsiste grâce à des travaux agricoles. Il se retrouve ainsi dans une situation précaire à l’âge de 55 ans, ayant peu de chances de trouver un emploi ou d’obtenir une assurance maladie ou des droits à pension. La situation de M. Hoti est donc complexe et non comparable à celle d’autres immigrés qui chercheraient à être admis dans un pays d’accueil. La complexité de cette situation a été accentuée par son apatridie et par l’éclatement de la RFSY, où son statut de réfugié albanais était jadis reconnu.
Alors qu’elles connaissaient les particularités du cas de M. Hoti et qu’il était possible en vertu de la législation pertinente d’accorder le droit au séjour permanent à des étrangers « sur le fondement de motifs individuels particuliers », les autorités nationales n’ont aucunement évalué ses caractéristiques personnelles et la situation dans laquelle il se trouve. Les autorités ont ainsi refusé sa demande de permis de séjour permanent parce qu’il ne pouvait se prévaloir de trois années d’emploi ininterrompu. Un document montre qu’en fait il a été employé de juillet 1986 à décembre 1989, avec une interruption de 15 jours. Compte tenu de la situation personnelle de M. Hoti, la Cour estime qu’une telle décision, bien que correcte sur la forme, est excessivement formaliste. De même, il n’a pas été tenu compte des circonstances propres à M. Hoti dans la procédure par laquelle il tente actuellement de faire régulariser son statut de résident. Le ministère n’a motivé ni son refus de prolonger son séjour temporaire en 2014 ni sa décision de lui accorder une prorogation en 2015 et en 2016. Ainsi, l’exercice de son droit au séjour temporaire a été inconstant et cela a encore éloigné la perspective d’obtenir un permis de séjour permanent après cinq ans de séjour ininterrompu, pour des motifs humanitaires et avec l’accord du ministère. Il ne semble pas non plus qu’il puisse un jour parvenir à un séjour ininterrompu de cinq ans pour des motifs humanitaires ; il lui faudrait pour cela fournir un document de voyage valable, c’est-à-dire un passeport biométrique national valable du pays d’origine actuel, condition que M. Hoti, personne apatride, ne pourra jamais remplir. En outre, les autorités croates n’ont jamais envisagé d’apporter à M. Hoti un soutien administratif afin de faciliter ses contacts avec les autorités d’un autre pays, alors qu’elles le savent apatride. Au contraire, elles soutiennent qu’il est un ressortissant du Kosovo. Ayant examiné la globalité des procédures et des circonstances, et eu égard également aux faits que M. Hoti n’a pas de casier judiciaire et que son séjour en Croatie est toléré depuis plus de 40 ans, la Cour estime que la Croatie ne lui a pas offert une procédure effective et accessible pour lui permettre d’obtenir une décision sur son séjour et son statut à venir, compte dûment tenu de sa vie privée. Partant, il y a eu violation de l’article 8.
B.A.C. c. GRÈCE du 13 octobre 2016 requête 11 981/15
Violation des articles 8 et 3 de la Conv EDH : Le requérant tenait un café pro kurde en Turquie. Quand son café a intéressé les autorités judiciaires turques, il s'est sauvé pour se réfugier en Grèce. Il a demandé l'asile politique mais les autorités mettent un temps infini à examiner sa demande. Il y a violation à sa vie familiale au sens de l'article 8? car en attendant il est dans une situation financièrement précaire. Il ne peut même pas s'inscrire à la FAC. Il y aurait violation de l'article 3 s'il subissait une extradition vers la Turquie.
ARTICLE 8 DE LA Conv EDH
35. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la Convention ne garantit pas le droit d’une personne d’entrer ou de résider dans un État dont elle n’est pas ressortissante ou de n’en être pas expulsée, et les États contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non‑nationaux. Par ailleurs, l’article 8 de la Convention ne va pas jusqu’à garantir à l’intéressé le droit à un type particulier de titre de séjour (permanent, temporaire ou autre), à condition que la solution proposée par les autorités lui permette d’exercer sans entrave ses droits au respect de la vie privée et familiale (Aristimuño Mendizabal c. France, no 51431/99, §§ 65-66, 17 janvier 2006).
36. La Cour souligne avoir, à maintes reprises, affirmé qu’au regard de l’article 8 de la Convention l’obligation positive de l’État inhérente à un respect effectif de la vie privée peut impliquer la mise en place d’une procédure effective et accessible en vue de protéger le droit à la vie privée, et notamment la création d’un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné à protéger les droits des individus et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures spécifiques appropriées. Si la frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au titre de la Convention ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables (Fernández Martínez c. Espagne ([GC], no 56030/07, § 114, CEDH 2014 (extraits)).
37. Parmi ces obligations positives figure aussi celle des autorités compétentes d’examiner les demandes d’asile des personnes concernées dans de brefs délais afin de raccourcir autant que possible la situation de précarité et d’incertitude dans laquelle ces personnes se trouvent (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (no 30696/09, § 262, 21 janvier 2011).
38. La Cour tient d’abord à distinguer la présente affaire de l’affaire M.E. c. Suède ([GC] no 71398/12, 8 avril 2015) dans laquelle le requérant se plaignait, entre autres, de l’inquiétude, de l’incertitude et de la tension que les décisions initiales des autorités de le renvoyer en Libye lui avaient causées. La Cour avait rayé l’affaire du rôle (article 37 § 1 b) de la Convention) car, entretemps, les autorités lui avaient délivré un permis de séjour permanent.
39. La Cour relève ensuite que la situation du requérant en l’espèce diffère également de celle dans laquelle les autorités refusent d’octroyer un permis de séjour à des requérants installés de manière irrégulière sur le territoire et qui recherchent sur la base de la vie familiale à mettre les autorités du pays d’accueil devant le fait accompli (voir la jurisprudence citée dans l’arrêt Jeunesse c. Pays-Bas ([GC] no 12738/10, § 103, 3 octobre 2014). Dans la présente affaire, ce qui est en cause est l’omission du ministre de l’Ordre public, douze ans durant, de statuer sur la demande d’asile du requérant, alors que la Commission consultative d’asile avait émis un avis favorable et les autorités judiciaires grecques, y compris la Cour de cassation, avaient rejeté une demande d’extradition formulée par les autorités turques. Il est clair que dans ce contexte, l’incertitude éprouvée par le requérant quant à son statut prenait une dimension toute particulière par rapport à celle d’un requérant qui attend la fin, dans des délais raisonnables, de la procédure d’asile le concernant.
40. En l’espèce, pour la Cour la violation alléguée de l’article 8 de la Convention provient ainsi, non pas de mesures d’éloignement ou d’expulsion, mais de la situation de précarité et d’incertitude que le requérant a connue pendant une longue période, soit du 21 mars 2002 – date à laquelle l’intéressé a introduit son recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile – à la date de prononcé du présent arrêt.
41. La Cour observe en outre que le requérant a travaillé dans le secteur du bâtiment sans toutefois être muni d’un permis de travail.
42. À cet égard, il convient de relever que, à l’époque, les conditions d’obtention d’un permis de travail pour un demandeur d’asile étaient restrictives. En effet, selon l’article 4 du décret no 189/1998 (aboli en avril 2016), il fallait démontrer qu’aucun intérêt pour exercer un métier spécifique n’avait été manifesté, entre autres, par une personne ayant déjà le statut de réfugié. De plus, une circulaire du ministre du Travail du 19 octobre 2012 précisait que, pour obtenir un permis de travail, un demandeur d’asile devait produire un certificat d’un organisme public attestant qu’il n’y avait pas de chômeurs nationaux, de ressortissants communautaires ou de personnes ayant le statut de réfugié qui désiraient travailler dans le domaine considéré. À cette difficulté réglementaire s’ajoutait en outre une difficulté pratique liée à la crise économique et au grand nombre de chômeurs en recherche d’emploi.
43. Par ailleurs, la Cour relève que, en raison de la précarité de son statut, le requérant, qui déclare avoir souhaité s’inscrire à l’université, n’a pas pu le faire et que, en tant que simple détenteur d’une carte de demandeur d’asile, il n’a pas pu non plus ouvrir un compte bancaire ou se voir attribuer un numéro d’enregistrement fiscal – conditions essentielles pour exercer une activité professionnelle –, ni même obtenir un permis de conduire.
44. Quant à la vie privée du requérant, la Cour observe que la cohabitation entre celui-ci et son épouse n’a été rendue possible et légale qu’à partir de 2008, par le fait que cette dernière avait obtenu un permis de travail en Grèce pour une période limitée, et non pas en application des dispositions permettant le regroupement familial.
45. La Cour conclut au caractère injustifié de l’omission du ministre de l’Ordre public de statuer sur la demande d’asile du requérant, qui ne reposait sur aucun motif et qui a perduré pendant plus de douze ans – et perdure encore –, alors que les instances nationales s’étaient prononcées en faveur de la nécessité d’accorder l’asile à l’intéressé et qu’elles avaient rejeté la demande d’extradition introduite par les autorités turques.
46. Partant, la Cour considère que les autorités compétentes ont manqué, dans les circonstances de l’espèce, à leur obligation positive tirée de l’article 8 de la Convention, consistant à mettre en place une procédure effective et accessible en vue de protéger le droit à la vie privée, au moyen d’une réglementation appropriée tendant à faire examiner la demande d’asile du requérant dans des délais raisonnables afin de raccourcir autant que possible sa situation de précarité (voir aussi paragraphe 37 ci-dessus). Il y a donc eu violation de cette disposition.
47. Compte tenu de ses conclusions aux paragraphes précédents, elle dit qu’il y a eu aussi violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8.
48. Enfin, eu égard à sa conclusion sur le grief relatif à l’article 8 de la Convention, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer sur le terrain de l’article 14 de la Convention.
ARTICLE 3 DE LA Conv EDH
59. La Cour rappelle que l’extradition par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (R.U. c. Grèce, précité, § 67). Elle rappelle aussi que l’effectivité d’un recours ayant pour finalité d’empêcher un renvoi demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale, un examen indépendant et rigoureux de tout grief selon lequel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention, ainsi qu’une célérité particulière ; elle requiert également que l’intéressé dispose d’un recours automatiquement suspensif (idem, §§ 72-73).
60. La Cour rappelle aussi que lorsqu’elle examine si un requérant demandeur d’asile est exposé à un risque réel de mauvais traitements en cas d’expulsion dans un Etat tiers, elle prend en considération un certain nombre des principes et critères tels que : le principe de non-refoulement, le risque de mauvais traitements émanant de groupes privés, le principe d’une évaluation ex nunc des circonstances pertinentes, le principe de subsidiarité, la nécessité de l’appréciation rigoureuse de l’existence d’un risque réel, la répartition de la charge de la preuve, l’éventualité de mauvais traitements antérieurs en tant qu’indices de l’existence d’un risque réel et l’appartenance à un groupe ciblé (J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 77-105, 23 août 2016).
61. La Cour note qu’il existe plusieurs similitudes entre la présente espèce et l’affaire R.U. c. Grèce, précitée. En effet, dans ces deux causes, la demande d’asile des intéressés a été rejetée en première instance par une décision du secrétaire général du ministère de l’Ordre public motivée de manière stéréotypée, contre laquelle les deux requérants ont exercé un recours devant le ministre de l’Ordre public. Dans le cas du requérant R.U., ce recours était pendant, avant que la Cour ne se prononce, depuis plus de trois ans et sept mois. Dans le cas du requérant de la présente espèce, la durée en cause est de plus de douze ans.
62. La Cour attache de l’importance au fait que le pays de renvoi du requérant, la Turquie, est un État partie à la Convention, qui s’est en tant que tel engagé à respecter le droit à la vie et l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants. La Cour ne peut toutefois fonder son appréciation sur cette seule circonstance. Elle doit prendre en compte les éléments concrets du dossier tout d’abord et le fait que le requérant, pro-kurde et militant de gauche, était accusé de participation à une organisation terroriste armée et d’assassinat du fondateur d’une autre organisation terroriste.
63. En examinant ces éléments, la Cour rappelle qu’elle attache une importance particulière à l’existence de mauvais traitements antérieurs. Elle relève, à cet égard, que l’existence de tels traitements fournit un indice solide d’un risque réel futur qu’un requérant subisse des traitements contraires à l’article 3, dans le cas où il a livré un récit des faits globalement cohérent et crédible qui concorde avec les informations provenant de sources fiables et objectives sur la situation générale dans le pays concerné (J.K. et autres c. Suède, précité, § 102). Or, en l’espèce, la Cour note que dans son rapport du 25 juillet 2002, le Centre médical grec pour la réhabilitation des victimes de torture a confirmé que le requérant avait été torturé lors de ses incarcérations en Turquie ; en outre, dans un document reproduisant les allégations du requérant, l’avocat de ce dernier en Turquie décrivait quelle avait été la situation de son client dans son pays d’origine. Il ressort ce qui suit de ce document : le requérant avait été arrêté à six reprises entre 1992 et 1996 et avait subi des tortures ; pendant sa détention provisoire, alors qu’il aurait été à son trentième jour de grève de la faim, il avait à nouveau subi des tortures ; et en outre, alors qu’il aurait été mourant et aurait souffert du syndrome de Wernicke‑Korsakoff, diagnostiqué par un médecin légiste, il avait été libéré sous condition pour une période de six mois (paragraphe 13 ci-dessus).
64. De surcroît, ce risque de mauvais traitements a été aussi relevé par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Patras et la Cour de cassation qui ont rejeté la demande d’extradition qui avait été faite par les autorités turques, en se fondant notamment sur le risque de mauvais traitements en cas de renvoi du requérant vers la Turquie. Pour autant, le rejet de la demande d’extradition du requérant vers ce pays ne peut pas être assimilé à un octroi de la protection internationale : en effet, tant que le ministre compétent ne se prononce pas, la décision en vigueur concernant la demande d’asile du requérant est celle prise par le secrétaire général du ministère de l’Ordre public, portant rejet de cette demande.
65. La Cour considère ainsi que le requérant a présenté des éléments probants à l’appui de sa demande d’asile en Grèce, fondés sur les traitements auxquels il été soumis en Turquie dans le passé, à savoir la soumission à des actes qualifiés de contraires à l’article 3 de la Convention – réalité reconnue tant par deux juridictions que par la Commission consultative d’asile.
66. Or, étant donné que la demande d’asile litigieuse est toujours pendante, la situation juridique du requérant demeure incertaine, ce qui l’expose à un renvoi inopiné en Turquie, sans avoir la possibilité de bénéficier d’un examen effectif de sa demande d’asile, et alors qu’il existe, à première vue, des risques sérieux et avérés qu’il pourrait subir dans ce pays des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
67. En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement et conclut qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13 si le requérant était renvoyé en Turquie en l’absence d’une appréciation ex nunc par les autorités grecques de la situation personnelle du requérant sous l’angle des critères énoncés ci-dessus (voir, mutatis mutandis, F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, §§ 115 et 158, CEDH 2016).
L'ARTICLE 8 EN FAVEUR DE LA VIE PRIVEE
Cliquez sur un bouton ou un lien bleu :
Drelon c. France du 8 septembre 2022 requêtes no 3153/16 et 27758/18
Art 8 : Collecte et conservation, par l’Établissement français du sang, de données personnelles reflétant l’orientation sexuelle supposée du requérant mais dépourvues de base factuelle avérée : violation de l’article 8 de la Convention
Vie privée • Collecte des données relatives aux pratiques sexuelles d’un donneur du sang potentiel basée sur une spéculation et durée excessive de leur conservation par un établissement public • Requérant exclu du don de sang sur la base de la loi imposant une contre-indication des hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme • Motifs pertinents et suffisants de sécurité transfusionnelle • Simples spéculations du fait du refus du requérant de donner l’information sur ses pratiques sexuelles lors de l’entretien médical préalable au don • Marge d’appréciation outrepassée
Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. Les requêtes concernent d’une part, la collecte et la conservation, par l'Établissement français du sang, de données personnelles reflétant l’orientation sexuelle supposée du requérant ainsi que le rejet, par les juridictions pénales, de la plainte pour discrimination qu'il avait déposée et, d’autre part, les refus opposés à ses candidatures au don du sang ainsi que le rejet, par le Conseil d'État, de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 5 avril 2016 modifiant les critères de sélection des candidats au don de sang. S'agissant de la première requête, la Cour considère que la collecte et la conservation de données personnelles sensibles constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant. Elle juge que cette ingérence était fondée sur une base légale prévisible, le pouvoir d’appréciation laissé aux autorités concernant la création de fichier de santé étant, en la matière, suffisamment encadré par la loi du 6 janvier 1978 alors applicable. Après avoir considéré que la collecte et la conservation de données personnelles relatives aux résultats des procédures de sélection des candidats au don du sang contribuent à garantir la sécurité transfusionnelle, elle précise que, pour autant, il est particulièrement important que les données sensibles concernées par ce traitement soient exactes, mises à jour, adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités poursuivies, et que leur durée de conservation n’excède pas celle qui est nécessaire. Or, la Cour relève en premier lieu qu'alors que le requérant avait refusé de répondre aux questions relatives à sa sexualité lors de l’entretien médical préalable au don, le traitement de données a été renseigné par la contre-indication au don propre aux hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme. Elle en déduit que les données collectées, fondées sur de simples spéculations, ne reposaient sur aucune base factuelle avérée. En second lieu, après avoir relevé que le Gouvernement ne démontrait pas que la durée de conservation des données litigieuses, (jusqu'en 2278 à l’époque des faits litigieux), était encadrée de telle sorte qu’elle ne puisse pas excéder celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles avaient été collectées, la Cour juge que la durée excessive de conservation des données litigieuses a rendu possible leur utilisation répétée à l’encontre du requérant, entraînant son exclusion automatique du don de sang. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention en raison de la collecte et de la conservation des données personnelles litigieuses.
S'agissant de la seconde requête, la Cour rejette comme tardifs les griefs relatifs aux mesures d'exclusion du don de sang des 16 novembre 2004 et 9 août 2006. En ce qui concerne la mesure du 26 mai 2016, la Cour indique au requérant qu'il ne saurait invoquer la violation des articles 8 et 14 de la Convention qu'aurait entraînée la mise en œuvre de l'arrêté du 5 avril 2016 qui n'était pas encore en vigueur à la date du refus qu'il conteste devant elle.
FAITS
Le requérant, M. Laurent Drelon, est un ressortissant français, né en 1970 et résidant à Paris (France). Le 16 novembre 2004, le requérant tenta d’effectuer un don de sang dans un site de collecte de l’Établissement français du sang (EFS). Au cours d’un entretien médical préalable, il lui fut demandé s’il avait déjà eu un rapport sexuel avec un homme. Il refusa de répondre et sa candidature au don fut rejetée.
À cette occasion, des données personnelles le concernant furent saisies dans un fichier informatique. Il y fut renseigné que la contre-indication au don de sang « FR08 », correspondant à celle qui était prévue, à l’époque, pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un autre homme lui avait été appliquée.
Le 9 août 2006, le requérant renouvela sa démarche. Il lui fut opposé qu’il était référencé sous le code « FR08 » et il fut exclu du don.
Le 6 février 2007, il déposa plainte avec constitution de partie civile du chef de discrimination, en dénonçant les refus opposés à ses candidatures au don de sang en 2004 et 2006 et le référencement par l’EFS de ses pratiques homosexuelles supposées. Le juge d’instruction prit une ordonnance de refus d’informer. Sur l’appel du requérant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris jugea, par un arrêt du 15 septembre 2009, que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’une discrimination pénalement répréhensible mais qu’il incombait néanmoins au juge d’instruction de vérifier s’ils étaient susceptibles de caractériser le délit d’enregistrement ou de conservation de données à caractère personnel sensibles sans le consentement de l’intéressé, prévu à l’article 226-19 du code pénal.
Après des investigations complémentaires, le non-lieu fut ordonné.
Le 18 avril 2013, la chambre de l’instruction confirma cette décision.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, au motif que le traitement de données litigieux était prévu par l’article 8, II, 6 e de la loi du 6 janvier 1978 et qu’il ne relevait donc pas du domaine de l’incrimination prévue à l’article 226-19 du code pénal.
À partir de 2009, les contre-indications au don de sang furent définies par le ministre chargé de la Santé par voie d’arrêtés.
Le 26 mai 2016, le requérant tenta une nouvelle fois de donner son sang, en vain. M. Drelon contesta ensuite à deux reprises la nomenclature des contre-indications au don en tant qu’elle excluait les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme. Il sollicita d’abord l’abrogation de l’arrêté du 12 janvier 2009. Le ministre chargé de la Santé rejeta cette demande, ce qu’il contesta dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Cependant, l’arrêté litigieux fut abrogé en cours d’instance et le Conseil d’État constata le non-lieu à statuer par une décision du 18 juillet 2016.
Par une requête du 10 juin 2016, M. Drelon demanda ensuite l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 avril 2016, qui avait modifié les critères de sélection des candidats au don de sang.
Le 28 décembre 2017, le Conseil d’État rejeta son recours. Il estima, au vu des données statistiques et épidémiologiques discutées devant lui et en l’état des connaissances scientifiques, que le ministre de la Santé n’avait pas adopté une mesure discriminatoire illégale en prévoyant une contre-indication au don de sang total de douze mois pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un autre homme.
CEDH
Principes généraux
79. La Cour rappelle que la conservation de données relatives à la « vie privée » d’un individu entre dans le champ d’application de l’article 8 § 1 (Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 48, série A no 116, et Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 65, CEDH 2000‑II). Cette notion large englobe notamment des éléments comme l’identification sexuelle, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle (voir, parmi d’autres, E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 43, 22 janvier 2008).
80. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 à moins qu’elle soit « prévue par la loi », qu’elle poursuive un but légitime, et, qu’elle soit de surcroît « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre celui-ci.
81. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les termes « prévue par la loi » signifient que la mesure litigieuse doit avoir une base en droit interne qui soit compatible avec la prééminence du droit. Cette base légale doit être accessible et prévisible, c’est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre à l’individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite. Pour que l’on puisse la juger conforme à ces exigences, elle doit fournir une protection adéquate contre l’arbitraire et, en conséquence, définir avec une netteté suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation conféré aux autorités compétentes (Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, §§ 66-68, série A no 82, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 55, CEDH 2000‑V, S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 95, CEDH 2008, et L.H. c. Lettonie, no 52019/07, §§ 47-59, 29 avril 2014).
82. La Cour a résumé les principes applicables à l’examen de la nécessité de la collecte et de la conservation de données à caractère personnel dans l’affaire S. et Marper (précité, §§ 101-104). Une telle mesure doit être proportionnée au but légitime poursuivi et reposer sur des motifs « pertinents et suffisants ». La législation interne doit, par ailleurs, ménager des « garanties appropriées » pour empêcher toute utilisation de données à̀ caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues à l’article 8 (ibidem, § 103). À cet égard, la Cour prend en considération les stipulations de la Convention de 1981 (Z c. Finlande, 25 février 1997, § 95, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, et S et Marper, précité, §§ 103 et 107). Pour contrôler si une mesure portant atteinte à la protection des données à caractère personnel est « nécessaire dans une société démocratique », la Cour examine si elle respecte l’une ou l’autre des exigences énumérées par l’article 5 de cette Convention, à savoir, notamment, les exigences de minimisation des données stockées, d’exactitude des données, de limitation de leur utilisation et de limitation de leur durée de conservation. En particulier, le droit interne doit assurer que les données traitées sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées (ibidem, § 103). Ces considérations valent tout spécialement lorsqu’est en jeu la protection de catégories particulières de données plus sensibles visées à l’article 6 de la Convention de 1981 (ibidem, § 103).
83. En ce qui concerne plus particulièrement l’exigence d’exactitude et de mise à jour des données collectées, la Cour a eu à connaître de plusieurs affaires relatives à la conservation, par les autorités, de données dont l’inexactitude était avérée ou alléguée (voir, notamment, Cemalettin Canlı c. Turquie, no 22427/04, §§ 34-37, 18 novembre 2008, sur la présence d’informations inexactes dans un fichier de police, et Rotaru, précité, § 36, sur la tenue d’un registre par un service de renseignement comprenant des données erronées sur le passé du requérant). Des données personnelles, fausses ou incomplètes, recueillies et conservées par les autorités peuvent rendre plus difficile la vie quotidienne de la personne concernée (Khelili c. Suisse, no 16188/07, § 64, 18 octobre 2011) ou s’avérer diffamatoires (Rotaru, précité, § 44). Leur mésusage peut être aggravé par la méconnaissance de certaines garanties procédurales prévues en droit interne pour protéger les droits des personnes concernées (voir, pour la transmission parcellaire d’une information inexacte issue d’un fichier de police aux autorités judiciaires, Cemalettin Canlı, précité, §§ 42-43).
84. La Cour reconnait en la matière une certaine marge d’appréciation aux autorités nationales compétentes ; son étendue dépend d’un certain nombre de facteurs, dont la nature du droit en cause garanti par la Convention, son importance pour la personne concernée, la nature de l’ingérence et la finalité de celle-ci (S. et Marper, précité, § 102). La Cour prend également en compte le fait que le consentement de la personne n’ait pas été obtenu ou recherché lors de la collecte, de la conservation ou de l’utilisation de données intrinsèquement privées (ibidem, § 104, et Avilkina et autres c. Russie, no 1585/09, §§ 48-49, 6 juin 2013). Ainsi, la Cour a jugé que la divulgation de données relative à la séropositivité (Z c. Finlande, précité, § 96) ou la conservation et l’utilisation sans limites de données relatives aux empreintes digitales et génétiques à des fins policières (S. et Marper, précité, §§ 104 et 112) effectuées sans le consentement de la personne concernée appellent un examen rigoureux de sa part.
Application au cas d’espèce
α) Sur la question de savoir si est en cause une obligation négative ou une obligation positive
85. La Cour rappelle que l’article 8 a d’abord pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics. L’ÉFS étant un établissement public de l’État (paragraphe 57 ci-dessus), la Cour examinera ce grief sous l’angle des obligations négatives (Libert c. France, no 588/13, § 41, 22 février 2018 ; voir également, a contrario, Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, §§ 109-111, 5 septembre 2017 et Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, §§ 78-79, CEDH 2013).
β) Sur l’existence d’une ingérence
86. En l’espèce, la Cour constate qu’ont été collectées et conservées dans une base de données initialement exploitée par l’un des établissements de l’ÉFS des données personnelles selon lesquelles le requérant était concerné par la contre-indication au don de sang alors prévue pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme en droit interne. Aux yeux de la Cour, de telles données comportent des indications explicites sur la vie sexuelle et sur l’orientation sexuelle supposée du requérant. À cet égard, le fait que cette contre-indication ait été conservée avec la simple référence à un code et non la description explicite d’un comportement sexuel n’est pas déterminant. Il était en outre prévu que les données saisies en 2004 soient conservées jusqu’en 2278. Dès lors, la Cour considère, avec les parties, qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant.
γ) Sur la base légale de l’ingérence
87. La Cour relève que l’article 8, II, 6o de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version applicable au litige, faisait exception, en matière médicale, à l’interdiction de collecter et de traiter des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes édictée à son paragraphe I. Ces dispositions autorisaient en particulier la mise en œuvre de traitements comportant de telles données en cas de nécessité pour la « gestion de services de santé », en conférant aux autorités internes un pouvoir d’appréciation s’agissant de la création de tels fichiers. Reste à déterminer si cette base légale était suffisamment prévisible et accessible, du point de vue d’un donneur de sang, et si elle fournissait une protection adéquate contre l’arbitraire.
88. De l’avis de la Cour, la prévisibilité de cette base légale doit être appréciée dans son contexte juridique. Or, la Cour relève qu’à la date des faits litigieux, l’article 18 de la directive 2002/98/CE imposait l’enregistrement des résultats des procédures d’évaluation et d’examen des donneurs (paragraphe 32 ci-dessus). L’arrêté du 10 septembre 2003 prévoyait en outre la tenue d’un « dossier informatisé du donneur » comprenant « les éventuelles contre-indications au don temporaires ou définitives, indiquées de façon codée » le concernant (paragraphe 39 ci‑dessus). La Cour en conclut que ce cadre légal, pris dans son ensemble, définissait avec suffisamment de précision l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation conféré aux autorités internes et permettait ainsi au requérant de régler sa conduite, c’est-à-dire de poursuivre ou de renoncer à sa démarche de don de sang en connaissance de cause. Elle estime donc que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi ».
δ) Sur la poursuite d’un but légitime
89. De l’avis de la Cour, l’ingérence litigieuse poursuivait au moins un des buts légitimes énumérés à l’article 8 § 2, à savoir la protection de la santé. À cet égard, la Cour ne perd pas de vue qu’un grand nombre de personnes ont été contaminées par le VIH ou par des virus hépatiques par voie de transfusion de produits sanguins insuffisamment sécurisés, en France comme dans de nombreux États contractants, avant que des techniques de détection, d’inactivation et d’élimination des agents pathogènes soient développées et généralisées. Les instruments de droit international précités (paragraphes 44‑54 ci-dessus) ont été adoptés pour répondre à cette crise sanitaire majeure et poursuivent ce même objectif de protection de la santé publique. Au demeurant, la Cour rappelle que les obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention impliquent la mise en place d’un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades (G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, §§ 80, 85-95, 1er décembre 2009, Oyal c. Turquie, no 4864/05, §§ 53-54, 23 mars 2010, et Karchen et autres c. France (déc.), no 5722/04, 4 mars 2008).
ε) Sur la nécessité de l’ingérence
90. La Cour doit d’abord examiner si l’ingérence litigieuse était fondée sur des motifs pertinents et suffisants.
91. Sur ce point, le Gouvernement fait valoir que la collecte et la conservation des données litigieuses permettaient d’assurer le respect effectif de la contre-indication au don de sang alors prévue pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme. Il soutient que celle-ci n’était pas fondée sur une orientation sexuelle, mais sur un comportement sexuel corrélé à un risque transfusionnel élevé selon différentes études médicales et épidémiologiques.
92. Le requérant soutient au contraire que cette ingérence ne reposait pas sur des motifs pertinents et suffisants. Il dénonce en outre le caractère discriminatoire du critère de sélection des donneurs qui a conduit à la collecte et à la conservation des données personnelles litigieuses.
93. Au vu des explications fournies par le Gouvernement, des documents qui lui ont été communiqués et des instruments de droit international précités (paragraphes 44-54 ci-dessus), la Cour considère que la collecte et la conservation de données personnelles relatives aux résultats des procédures de sélection des candidats au don du sang, et en particulier aux motifs d’exclusion du don éventuellement retenus, contribuent à garantir la sécurité transfusionnelle. Sans qu’il soit besoin de rechercher si d’autres critères de sélection des donneurs étaient envisageables (voir, mutatis mutandis, S. et Marper, précité, § 117), la Cour considère que la collecte et la conservation des données litigieuses reposaient sur des motifs pertinents et suffisants.
94. Afin d’apprécier si l’ingérence litigieuse était proportionnée et ménageait un juste équilibre entre les intérêts publics et privés en concurrence, la Cour doit ensuite rechercher si la législation interne prévoyait des garanties appropriées.
95. Eu égard à la sensibilité des données personnelles litigieuses, qui comportent des indications sur les pratiques et l’orientation sexuelles du requérant (paragraphe 86 ci-dessus), la Cour considère qu’il est particulièrement important qu’elles répondent aux exigences de qualité prévues à l’article 5 de la Convention de 1981. Il importe en particulier qu’elles soient exactes et, le cas échéant, mises à jour, qu’elles soient adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités du traitement, et que leur durée de conservation n’excède pas celle qui est nécessaire. Par ailleurs, la Cour constate que les données litigieuses, qui touchaient à l’intimité du requérant, ont été collectées et conservées sans le consentement explicite du requérant – ce que le Gouvernement défendeur ne conteste pas. En conséquence, elle se doit de procéder à cet examen de façon rigoureuse (S. et Marper, précité, § 104, et Z. c. Finlande, précité, § 96).
96. En premier lieu, s’agissant de l’exactitude des données personnelles, la Cour estime que celle-ci doit être appréciée au regard de la finalité pour laquelle ces données ont été collectées. Dans le traitement litigieux, cette catégorie de données avait pour finalité d’assurer le respect d’une contre-indication au don spécifique, que le droit interne prévoyait alors de façon permanente. À cette fin, elle devait reposer sur une base factuelle précise et exacte. Or, le requérant s’est vu appliquer une contre-indication propre aux hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme au seul motif qu’il avait refusé de répondre à des questions relatives à sa sexualité lors de l’entretien médical préalable au don. Aucun des éléments soumis à l’appréciation du médecin ne lui permettait de tirer une telle conclusion sur ses pratiques sexuelles. C’est pourtant ce motif d’exclusion du don qui fut renseigné et conservé. La Cour en déduit que les données collectées se fondaient sur de simples spéculations et ne reposaient sur aucune base factuelle avérée. Or, la Cour rappelle que c’est aux autorités qu’il incombe de démontrer l’exactitude des données collectées (voir Khelili, précité, §§ 66-70). Elle relève de surcroît qu’elles n’ont pas avoir été mises à jour à la suite des protestations et de la plainte du requérant.
97. La Cour tient à souligner par ailleurs qu’il est inadéquat de collecter une donnée personnelle relative aux pratiques et à l’orientation sexuelles sur le seul fondement de spéculations ou de présomptions. Au surplus, il aurait suffi, aux yeux de la Cour, pour atteindre l’objectif de sécurité transfusionnelle recherché, de garder trace du refus du requérant de répondre aux questions relatives à sa sexualité, cet élément étant de nature à justifier, à lui seul, un refus de la candidature au don de sang.
98. En second lieu, le Gouvernement ne démontre pas qu’à l’époque des faits, la durée de conservation des données litigieuses était encadrée de telle sorte qu’elle ne puisse pas excéder celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. La Cour note qu’au moment de la collecte de ces données en 2004, l’outil informatique employé par l’ÉFS prévoyait leur conservation jusqu’en 2278 (paragraphe 6 ci-dessus), rendant ainsi possible leur utilisation de manière répétée. À la date du 26 mai 2016, soit près de douze ans après leur collecte, les données relatives au motif d’exclusion étaient encore conservées. À cet égard, la Cour tient à souligner que la durée de conservation des données doit être encadrée pour chacune des catégories de données concernées et qu’elle doit être révisée si les finalités pour lesquelles elles ont été collectées ont évolué. La Cour relève, au vu de la pratique constante de l’ÉFS, que la durée excessive de conservation des données litigieuses a rendu possible leur utilisation répétée à l’encontre du requérant, entraînant son exclusion automatique du don de sang.
99. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour conclut que l’État défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation en la matière.
100. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention en raison de la collecte et de la conservation des données personnelles litigieuses.
Breyer c. Allemagne du 4 février 2020 requête n° 50001/12
Article 8 : L’obligation de collecter des données permettant l’identification des utilisateurs de cartes SIM prépayées n’a pas emporté violation du droit à la vie privée
L’affaire concerne la conservation par les opérateurs de télécommunications des données relatives aux utilisateurs de cartes SIM prépayées. La Cour juge en particulier que la collecte des noms et adresses des requérants dans le cadre de l’utilisation par eux de cartes SIM prépayées a constitué une ingérence limitée dans l’exercice de leurs droits. La loi pertinente offre des garanties complémentaires et, par ailleurs, les justiciables peuvent saisir des organes indépendants chargés de la protection des données afin qu’ils contrôlent les demandes de données émanant des autorités et, le cas échéant, former un recours. L’Allemagne n’a pas outrepassé les limites de la latitude (« marge d’appréciation ») dont elle jouissait dans l’application de la loi en question, et la collecte des données n’a pas emporté violation des droits des requérants.
FAITS
Les requérants, Patrick Breyer et Jonas Breyer, sont des ressortissants allemands nés respectivement en 1977 et en 1982 et résidant à Wald-Michelbach (Allemagne). En application des modifications apportées en 2004 à la loi sur les télécommunications, les opérateurs furent placés dans l’obligation de recueillir et de conserver les données personnelles relatives à tous leurs clients, y compris les utilisateurs de cartes SIM prépayées, ce qui n’était pas le cas auparavant. Les requérants, qui militaient pour la défense des libertés publiques et réprouvaient la surveillance opérée par l’État, utilisaient ce type de cartes et durent par conséquent faire enregistrer auprès de leurs opérateurs leurs données personnelles telles que leur numéro de téléphone, leur date de naissance, leur nom et leur adresse. En 2005, ils introduisirent un recours constitutionnel contre divers articles de cette loi, notamment les articles 111, 112 et 113. Ces dispositions, dans leurs parties pertinentes en l’espèce, couvraient l’obligation de collecter les données en question et de permettre aux autorités d’y accéder, à la fois par des moyens automatiques et sur demande. Le 24 janvier 2012, la Cour constitutionnelle fédérale estima que les dispositions en question étaient proportionnées et justifiées, et donc compatibles avec la Loi fondamentale.
Article 8
La Cour relève que l’ingérence incriminée a trait à la conservation des données personnelles relatives à l’abonné (numéro de téléphone, nom et adresse, date de naissance et date du contrat) et à la possibilité pour les autorités nationales de consulter ces données dans certaines circonstances déterminées ; elle examine donc les griefs des requérants sous l’angle du seul article 8. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, la protection de ce type de données joue un rôle fondamental pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, et nécessite des garde-fous juridiques suffisants destinés à prévenir toute utilisation de données qui serait contraire aux garanties de l’article 8. Les États jouissent d’une certaine latitude (« marge d’appréciation ») dans la poursuite du but légitime consistant à protéger la sécurité nationale. Lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe sur un intérêt particulier ou sur le meilleur moyen de le protéger, la marge d’appréciation doit être plus large.
Existence d’une ingérence et nature de celle-ci
Les requérants estimaient que la mesure en question constituait une grave ingérence dans l’exercice de leurs droits. Ils exposaient que les opérateurs devaient collecter des données sur tous les utilisateurs, dont la plupart n’avaient commis aucune infraction. Le Gouvernement a admis que l’article 111 de la loi pertinente avait porté atteinte au droit à la vie privée des requérants. Il a toutefois estimé qu’il s’agissait d’une ingérence limitée et que celle-ci avait poursuivi des buts légitimes, s’était bornée aux données nécessaires à des fins d’identification, avait été associée à une période de conservation clairement définie et limitée, et assortie de garanties suffisantes contre les abus. La Cour reconnaît qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits et elle recherche si celle-ci était conforme aux exigences de la Convention, c’est-à-dire si elle était prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique.
L’ingérence était-elle conforme aux exigences de la Convention ?
Sur le premier point, la Cour estime que les dispositions légales concernées étaient claires et prévisibles. De plus, l’ingérence poursuivait les buts légitimes que sont la sûreté publique, la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits d’autrui. Concernant la nécessité de l’ingérence, la Cour admet tout d’abord que les méthodes d’enquête doivent être adaptées aux moyens de communication modernes lorsqu’il s’agit de lutter contre le crime organisé et le terrorisme. Les États membres bénéficiant dans ces circonstances d’une certaine marge d’appréciation, la Cour considère que l’obligation de conserver les données constitue de manière générale une réponse adéquate à l’ évolution des moyens de télécommunication et des comportements en matière de communication. La Cour traite ensuite la question de savoir si l’ingérence était proportionnée et si elle a ménagé un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents qui étaient en jeu. Elle s’intéresse tout d’abord au degré d’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la vie privée. Elle souscrit aux conclusions de la Cour constitutionnelle fédérale, laquelle a jugé que la conservation n’avait concerné qu’un éventail limité de données – n’incluant pas d’informations très personnelles ou relatives au flux des communications – et qu’il fallait clairement distinguer le niveau d’ingérence propre à cette affaire de celui observé dans de précédentes affaires traitées par la Cour. Par ailleurs, la Cour se penche sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) invoquée par les requérants (Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a.) et elle considère que les données en cause dans la présente espèce s’apparentent davantage à celles dont il était question dans Ministerio Fiscal. Dans cette affaire, relative aux demandes d’accès de la police à des données telles que des noms et des adresses, aux fins de l’identification des titulaires de cartes SIM activées avec un téléphone mobile volé, la CJUE a conclu que l’accès aux données ne pouvait pas être tenu pour une ingérence grave dans l’exercice par les personnes concernées de leurs droits fondamentaux. La Cour conclut que l’ingérence incriminée en l’espèce avait une portée relativement limitée, mais non négligeable. De plus, elle estime que la période de conservation n’était pas inappropriée, et que les informations détenues semblaient limitées aux éléments nécessaires à l’identification des abonnés.
Accès aux données
La Cour se penche sur la proportionnalité de l’ingérence liée aux dispositions sur l’accès aux données. Le Gouvernement avançait que les articles 112 et 113, combinés avec d’autres dispositions spécifiques sur l’extraction de données, limitaient l’accès aux données ainsi que leur utilisation et offraient des garanties effectives contre les abus. Les requérants estimaient quant à eux qu’il fallait tenir compte des possibilités d’utilisation ultérieure de leurs données personnelles par les autorités. La Cour observe que la procédure automatisée visée à l’article 112 a grandement simplifié l’extraction de données, mais elle voit un « facteur limitant » dans le fait que les autorités habilitées à demander l’accès étaient spécifiquement énumérées à l’article 112 et œuvraient toutes pour l’application des lois ou la protection de la sécurité nationale. En outre, l’article 113, qui traite de la procédure relative aux demandes écrites d’obtention de données, n’indiquait pas les noms précis des organes concernés mais leurs fonctions, ce qui pour la Cour était suffisamment clair pour permettre de prévoir quels organes étaient habilités à demander des informations. Par ailleurs, les deux dispositions en question offraient des garanties complémentaires contre les demandes abusives. Enfin, la Cour se penche sur les possibilités d’examen et de contrôle des demandes d’informations offertes par les deux articles, et conclut que ceux-ci prévoient également un contrôle indépendant par les autorités qui, au niveau fédéral et au niveau des Länder, sont chargées de la protection des données. En outre, la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré que les règles de droit générales permettaient de former des recours pour se plaindre de l’extraction d’informations. Conclusions En bref, l’Allemagne n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont elle jouissait lorsqu’elle a choisi les moyens d’atteindre les buts légitimes que sont la protection de la sécurité nationale et la lutte contre les infractions pénales. La Cour conclut que la conservation des données personnelles des requérants était proportionnée et « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, il n’y a pas eu violation de la Convention.
Romet C. Pays-Bas requête n°7094/06 du 14 février 2012
Le défaut d’adoption de mesures pour empêcher l’utilisation frauduleuse par des inconnus d’un permis de conduire déclaré perdu est contraire à la Convention
Article 8
La Cour constate que le défaut d’invalidation du permis de conduire de M. Romet dès sa déclaration de perte, qui a permis à des inconnus d’utiliser frauduleusement son identité, s’analyse en une « ingérence » dans sa vie privée tombant sous le coup de l’article 8.
Alors que M. Romet avait déclaré la perte de son permis de conduire le 3 novembre 1995, les autorités ne l’ont invalidé qu’en mars 1997, lorsqu’elles lui en ont délivré un autre. Après cette date, apparemment, aucun autre véhicule n’a été illégalement enregistré en son nom.
Par conséquent, les autorités n’ont pas agi avec une célérité qui aurait permis de priver le permis de conduire de son utilité en tant que papier d’identité. Elles n’ont pas non plus convaincu la Cour qu’elles n’avaient pas été en mesure de le faire immédiatement après la déclaration de perte de ce permis par son titulaire.
Il y a donc eu violation de l’article 8.
Arrêt M. K. c. FRANCE du 18 avril 2009 requête 19522/09
LA DETENTION DES EMPRUNTES AU FICHIER FAED POUR DES CAUSES PENALES EST NON CONFORME A LA CONVENTION QUAND L'INDIVIDU EST RELAXE
6. Le 10 février 2004, une enquête fut ouverte à l’encontre du requérant pour vol de livres. Les services d’enquête prélevèrent ses empreintes digitales.
7. Par un arrêt du 15 février 2005, sur appel d’un jugement rendu le 28 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Paris, la cour d’appel de Paris relaxa le requérant.
8. Le 28 septembre 2005, le requérant fut placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance, également pour vol de livres. Il fit à nouveau l’objet d’un prélèvement d’empreintes digitales.
9. Le 2 février 2006, cette procédure fut classée sans suite par le procureur de la République de Paris.
10. Les empreintes relevées lors de ces procédures furent enregistrées au fichier automatisé des empreintes digitales (« FAED »).
11. Par une lettre du 21 avril 2006, le requérant demanda au procureur de la République de Paris que ses empreintes soient effacées du FAED.
12. Le 31 mai 2006, le procureur de la République fit procéder uniquement à l’effacement des prélèvements effectués lors de la première procédure. Il fit valoir que la conservation d’un exemplaire des empreintes du requérant se justifiait dans l’intérêt de celui-ci, en permettant d’exclure sa participation en cas de faits commis par un tiers usurpant son identité.
LA CEDH
i. Base légale
30. Une telle ingérence doit donc être prévue par la loi, ce qui suppose l’existence d’une base en droit interne, qui soit compatible avec la prééminence du droit. La loi doit ainsi être suffisamment accessible et prévisible, c’est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre à l’individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite. Pour que l’on puisse la juger conforme à ces exigences, elle doit fournir une protection adéquate contre l’arbitraire et, en conséquence, définir avec une netteté suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir conféré aux autorités compétentes (voir, entre autres, Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, §§ 66-68, série A no 82, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95,§ 55, CEDH 2000-V, et S. et Marper, précité, § 95). Le niveau de précision requis de la législation interne – laquelle ne peut du reste parer à toute éventualité – dépend dans une large mesure du contenu du texte considéré, du domaine qu’il est censé couvrir et du nombre et de la qualité de ses destinataires (voir, parmi d’autres, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI, et S. et Marper, précité, § 96).
31. En l’espèce, la Cour constate que l’ingérence est prévue par la loi, à savoir l’article 55-1 du code de procédure pénale et le décret no 87-249 du 8 avril 1987 modifié. Quant à la question de savoir si la législation en cause est suffisamment claire et précise s’agissant des conditions de mémorisation, d’utilisation et d’effacement des données personnelles, la Cour note que le requérant évoque ces problèmes dans le cadre de ses développements sur la proportionnalité de l’ingérence. En tout état de cause, elle estime que ces aspects sont en l’espèce étroitement liés à la question plus large de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique et qu’un tel contrôle de la « qualité » de la loi dans la présente affaire renvoie à l’analyse ci-après de la proportionnalité de l’ingérence litigieuse (S. et Marper, précité, § 99).
ii. But légitime
32. La Cour note ensuite que l’ingérence vise un but légitime : la détection et, par voie de conséquence, la prévention des infractions pénales (S. et Marper, précité, § 100).
iii. Nécessité de l’ingérence
α) Les principes généraux
33. Il reste donc à déterminer si l’ingérence litigieuse peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique », ce qui commande qu’elle réponde à un « besoin social impérieux » et, en particulier, qu’elle soit proportionnée au but légitime poursuivi et que les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (S. et Marper, précité, § 101).
34. S’il appartient tout d’abord aux autorités nationales de juger si toutes ces conditions se trouvent remplies, c’est à la Cour qu’il revient de trancher en définitive la question de la nécessité de l’ingérence au regard des exigences de la Convention (Coster c. Royaume-Uni [GC], no 24876/94, § 104, 18 janvier 2001, et S. et Marper, précité). Une certaine marge d’appréciation, dont l’ampleur varie et dépend d’un certain nombre d’éléments, notamment de la nature des activités en jeu et des buts des restrictions (voir, notamment, Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 88, CEDH 1999-VI ; Gardel c. France, no 16428/05, Bouchacourt c. France, no 5335/06, et M.B. c. France, no 22115/06, 17 décembre 2009, respectivement §§ 60, 59 et 51), est donc laissée en principe aux Etats dans ce cadre (voir, parmi beaucoup d’autres, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 49, série A no 28). Cette marge est d’autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre « intime » qui lui sont reconnus (Connors c. Royaume-Uni, no 66746/01, § 82, 27 mai 2004, et S. et Marper, précité, § 102). Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’Etat est restreinte (Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 77, CEDH 2007-I, S. et Marper, précité, et Gardel, Bouchacourt et M.B., précités, respectivement §§ 61, 60 et 52). En revanche, lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe, que ce soit sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, la marge d’appréciation est plus large (Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 78, CEDH 2007‑XIII).
35. La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention. La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans cet article (S. et Marper, précité, § 103, et Gardel, Bouchacourt et M.B., précités, §§ 62, 61 et 53 respectivement). A l’instar de ce qu’elle a dit dans l’arrêt S. et Marper (précité), la Cour est d’avis que la nécessité de disposer de telles garanties se fait d’autant plus sentir lorsqu’il s’agit de protéger les données à caractère personnel soumises à un traitement automatique, en particulier lorsque ces données sont utilisées à des fins policières. Le droit interne doit notamment assurer que ces données soient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles soient conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Il doit aussi contenir des garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs (ibidem).
36. Enfin, il appartient à la Cour d’être particulièrement attentive au risque de stigmatisation de personnes qui, à l’instar du requérant, n’ont été reconnues coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d’innocence, alors que leur traitement est le même que celui de personnes condamnées. Si, de ce point de vue, la conservation de données privées n’équivaut pas à l’expression de soupçons, encore faut-il que les conditions de cette conservation ne leur donne pas l’impression de ne pas être considérés comme innocents (S. et Marper, précité, § 122).
β) L’application des principes susmentionnés au cas d’espèce
37. En l’espèce, la mesure litigieuse, qui n’emporte en elle-même aucune obligation à la charge du requérant, obéit à des modalités de consultation suffisamment encadrées, qu’il s’agisse des personnes habilitées à consulter le fichier ou du régime d’autorisation auxquelles sont soumises les opérations d’identification qui correspondent à la finalité du fichier (voir, a contrario, Khelili c. Suisse, no 16188/07, § 64, 18 octobre 2011).
38. La Cour observe qu’il en va différemment du régime de collecte et de conservation des données.
39. En effet, la Cour note d’emblée que la finalité du fichier, nonobstant le but légitime poursuivi, a nécessairement pour résultat l’ajout et la conservation du plus grand nombre de noms possibles, ce que confirme la motivation retenue par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 25 août 2006 (paragraphe 14 ci-dessus).
40. Elle relève par ailleurs que le refus du procureur de la République de faire procéder à l’effacement des prélèvements effectués lors de la seconde procédure était motivé par la nécessité de préserver les intérêts du requérant, en permettant d’exclure sa participation en cas d’usurpation de son identité par un tiers (paragraphe 12 ci-dessus). Or, outre le fait qu’un tel motif ne ressort pas expressément des dispositions de l’article 1er du décret litigieux, sauf à en faire une interprétation particulièrement extensive, la Cour estime que retenir l’argument tiré d’une prétendue garantie de protection contre les agissements des tiers susceptibles d’usurper une identité reviendrait, en pratique, à justifier le fichage de l’intégralité de la population présente sur le sol français, ce qui serait assurément excessif et non pertinent.
41. De plus, à la première fonction du fichier qui est de faciliter la recherche et l’identification des auteurs de crimes et de délits, le texte en ajoute une seconde, à savoir « faciliter la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie » dont il n’est pas clairement indiqué qu’elle se limiterait aux crimes et délits. En visant également « les personnes, mises en cause dans une procédure pénale, dont l’identification s’avère nécessaire » (article 3, 2o du décret), il est susceptible d’englober de facto toutes les infractions, y compris les simples contraventions dans l’hypothèse où cela permettrait d’identifier des auteurs de crimes et de délits selon l’objet de l’article 1 du décret (paragraphe 17 ci‑dessus). En tout état de cause, les circonstances de l’espèce, relatives à des faits de vol de livres classés sans suite, témoignent de ce que le texte s’applique pour des infractions mineures. La présente affaire se distingue ainsi clairement de celles qui concernaient spécifiquement des infractions aussi graves que la criminalité organisée (S. et Marper, précité) ou des agressions sexuelles (Gardel, Bouchacourt et M.B., précités).
42. En outre, la Cour note que le décret n’opère aucune distinction fondée sur l’existence ou non d’une condamnation par un tribunal, voire même d’une poursuite par le ministère public. Or, dans son arrêt S. et Marper, la Cour a souligné le risque de stigmatisation, qui découle du fait que les personnes qui avaient respectivement bénéficié d’un acquittement et d’une décision de classement sans suite - et étaient donc en droit de bénéficier de la présomption d’innocence - étaient traitées de la même manière que des condamnés (§ 22). La situation dans la présente affaire est similaire sur ce point, le requérant ayant bénéficié d’une relaxe dans le cadre d’une première procédure, avant de voir les faits reprochés par la suite classés sans suite.
43. Aux yeux de la Cour, les dispositions du décret litigieux relatives aux modalités de conservation des données n’offrent pas davantage une protection suffisante aux intéressés.
44. S’agissant tout d’abord de la possibilité d’effacement de ces données, elle considère que le droit de présenter à tout moment une demande en ce sens au juge risque de se heurter, pour reprendre les termes de l’ordonnance du 25 août 2006, à l’intérêt des services d’enquêtes qui doivent disposer d’un fichier ayant le plus de références possibles (paragraphe 14 ci-dessus). Partant, les intérêts en présence étant - ne serait‑ce que partiellement - contradictoires, l’effacement, qui n’est au demeurant pas un droit, constitue une garantie « théorique et illusoire » et non « concrète et effective ».
45. La Cour constate que si la conservation des informations insérées dans le fichier est limitée dans le temps, cette période d’archivage est de vingt-cinq ans. Compte tenu de son précédent constat selon lequel les chances de succès des demandes d’effacement sont pour le moins hypothétiques, une telle durée est en pratique assimilable à une conservation indéfinie ou du moins, comme le soutient le requérant, à une norme plutôt qu’à un maximum.
46. En conclusion, la Cour estime que l’Etat défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation en la matière, le régime de conservation dans le fichier litigieux des empreintes digitales de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non condamnées, tel qu’il a été appliqué au requérant en l’espèce, ne traduisant pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. Dès lors, la conservation litigieuse s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique.
47. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
COVID-19 : LES DRONES DE LA PREFECTURE DE POLICE DE PARIS RESTENT AU SOL
Le recours : La Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’homme ont demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner l’arrêt de la surveillance par drones mis en place par la préfecture de police afin de faire respecter les mesures de confinement. Leur requête ayant été rejetée par le tribunal, les associations ont fait appel devant le Conseil d’État.
La décision du Conseil d’État : Le juge des référés
du Conseil d’État a ordonné à l’État de cesser immédiatement la surveillance par
drone du respect des règles sanitaires en vigueur lors de la période de
déconfinement.
La préfecture de police de Paris avait indiqué que les drones n’étaient pas
utilisés pour identifier des personnes, mais uniquement pour détecter des
rassemblements du public à Paris contraires aux mesures sanitaires en vigueur et
pouvoir ainsi procéder à la dispersion du rassemblement ou l’évacuation des
lieux (les drones survolant la ville à une hauteur de 80 à 100 mètres, en
utilisant un grand angle et sans capturer d’images en l’absence de carte
mémoire).
Le juge des référés a toutefois relevé que les drones utilisés sont dotés d’un
zoom optique et peuvent voler en dessous de 80 mètres, ce qui permet de
collecter des données identifiantes. Il a observé que les drones ne sont dotés
d’aucun dispositif technique permettant de s’assurer que les informations
collectées ne puissent conduire à identifier des personnes filmées, et ce, pour
un autre usage que l’identification de rassemblements publics.
Dès lors, le juge des référés a estimé que l’utilisation de ces drones relève d’un traitement de données à caractère personnel et doit respecter le cadre de la loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978. Constatant que ce cadre n’avait pas été respecté, il a par conséquent ordonné à l’État de cesser sans délai la surveillance par drone, tant qu’un arrêté ou décret ministériel n’aura pas été pris sur le sujet après avis de la CNIL, ou tant que les drones ne seront sont pas dotés d’un dispositif de nature à rendre impossible l’identification des personnes filmées.
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N°s 440442, 440445 ASSOCIATION LA QUADRATURE DU NET ET LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME Ordonnance du 18 mai 2020
L’association « La Quadrature du Net » et la Ligue des droits de l’homme ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police ayant institué depuis le 18 mars 2020 un dispositif visant à capturer des images par drones et à les exploiter afin de faire respecter les mesures de confinement et d’enjoindre au préfet de police de cesser immédiatement, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de capter des images par drones, de les enregistrer, de les transmettre ou de les exploiter, puis de détruire toute image déjà captée dans ce contexte, sous astreinte de 1 024 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2006861 du 5 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
1° Sous le n° 440442, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 14 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « La Quadrature du Net » demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 096 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle
subordonne la caractérisation d’une atteinte au droit à la vie privée à la
condition que le dispositif en cause caractérise un traitement de données
personnelles ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qu’elle
retient que le préfet de police ne peut être regardé comme ayant procédé à un
traitement de données personnelles alors qu’il résultait de ses propres
constatations que les caractéristiques techniques des drones en cause permettent
l’identification d’un individu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été fait une
application illégale de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020
portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre
administratif ;
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la gravité et du caractère
manifestement illégal de l’atteinte portée par la préfecture au droit au respect
de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles dans
l’utilisation des drones, de la circonstance que ce dispositif est actuellement
en cours et du fait qu’il n’était pas matériellement possible de solliciter plus
tôt une mesure d’urgence dès lors que cette pratique n’a été révélée que le 25
avril 2020 ;
- l’usage de drones survolant l’espace public, hors de tout cadre juridique,
associé à un dispositif de captation d’images, constitue un traitement de
données à caractère personnel illicite et, à tout le moins, une ingérence grave
et manifestement illégale dans l’exercice du droit au respect de la vie privée
et du droit à la protection des données personnelles ;
- l’absence de toute acte administratif explicite encadrant spécifiquement le
dispositif en cause viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le I de l’article 31 de la
loi informatique et libertés et l’article 6, paragraphe 3, du règlement général
pour la protection des données ;
- l’absence de délai de conservation des données viole gravement et
manifestement l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 5 du règlement général pour
la protection des données, l’article 4 de la directive police-justice et les
articles 4 et 87 de la loi informatique et libertés ;
- l’absence d’information des personnes concernées viole gravement et
manifestement l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 du règlement général pour
la protection des données, l’article 13 de la directive police-justice et les
articles 48 et 104 de la loi informatique et libertés ;
- l’absence de garantie organisationnelle viole gravement et manifestement
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, l’article 25 du règlement général pour la protection
des données et l’article 20 de la directive police-justice ;
- l’absence de proportionnalité du dispositif au regard des finalités
poursuivies méconnaît les règles générales relatives au droit à la vie privée
et les règles régissant les traitements de données à caractère personnel ;
- le préfet de police était incompétent pour adopter le dispositif en cause.
2° Sous le n° 440445, par une requête, enregistrée le 7 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure contestée, qui n’a
été révélée par la presse que le 25 avril 2020 et devrait se poursuivre après le
déconfinement, a vocation à préjudicier de manière suffisamment grave et
immédiate à un intérêt public, à sa situation ainsi qu’aux intérêts qu’elle
entend défendre et emporte une atteinte grave, illégale, injustifiée et
disproportionnée aux libertés fondamentales ;
- la décision du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement
illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la
protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir ;
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une dénaturation
des faits de l’espèce en ce qu’elle conclut à l’absence d’une telle atteinte.
Par un mémoire en défense commun aux requêtes n°s 440442 et 440445, enregistré le 13 mai 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes. Il soutient que le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière est inopérant et, en tout état de cause, mal fondé, que la demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police ayant institué un dispositif visant à capturer des images par drones et à les exploiter afin de faire respecter les mesures de confinement est privée d’objet, que la condition d’urgence n’est pas remplie et que le dispositif contesté ne porte pas atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Les deux requêtes ont été communiquées au Premier ministre qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’association « La Quadrature du Net » et la Ligue des droits de l’homme et, d’autre part, le Premier ministre et le ministre de l’intérieur ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur les circonstances :
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des plusieurs arrêtés successifs.
3. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets ont été prolongés en dernier lieu par décret du 14 avril 2020. Par un nouveau décret du 11 mai 2020, applicable les 11 et 12 mai 2020, le Premier ministre a modifié les mesures précédemment ordonnées par le décret du 23 mars 2020. Enfin, par un décret du 11 mai 2020, pris sur le fondement de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le Premier ministre a prescrit les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Sur le cadre juridique du litige, l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :
4. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
6. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée qui comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
Sur la demande en référé :
7. « La Quadrature du Net » et de la Ligue des droits de l’homme ont saisi, le 2 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de cesser d’utiliser le dispositif visant à capter des images par drones, les enregistrer, les transmettre et les exploiter aux fins de faire respecter les mesures de confinement en vigueur à Paris pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, elles relèvent appel de l’ordonnance du 5 mai 2020 par laquelle le juge des référés a rejeté leurs demandes au motif qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’était portée aux libertés fondamentales invoquées.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier de la fiche technique de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police en date du 14 mai 2020 relative aux modalités d’engagement des drones lors de la surveillance du respect du confinement covid-19 dans Paris qui a été versée au débat contradictoire ainsi que des éléments échangés au cours de l’audience publique, que l'unité des moyens aériens de la préfecture de police a été engagée afin de procéder à une surveillance du respect des mesures de confinement mises en place à compter du 17 mars 2020. Depuis le 18 mars 2020, un drone de la flotte de quinze appareils que compte la préfecture de police a ainsi été utilisé quotidiennement pour effectuer cette mission de police administrative. Il est constant que la préfecture de police continue de recourir à ces mesures de surveillance et de contrôle dans le cadre du plan de déconfinement mis en œuvre à compter du 11 mai 2020. Il s’ensuit que les conclusions des associations requérantes qui tendent à ce qu’il soit ordonné au préfet de police de cesser de recourir à de telles mesures ont conservé leur objet.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles d’en faire l’objet et, d’autre part, à leurs effets, la fréquence et le caractère répété des mesures de surveillance litigieuses créent une situation d’urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées :
10. Il résulte de l’instruction, en particulier de la fiche citée au point 8 et des éléments échangés au cours de l’audience publique, que l'ensemble des vols sont réalisés à partir des quatre appareils de marque D.JJ type Mavic Enterprise, équipés d'un zoom optique X 3 et d'un haut-parleur. Un seul drone est utilisé à la fois. Il ne filme pas de manière continue mais seulement deux à trois heures en moyenne par jour. La mise en œuvre de ce dispositif de surveillance repose sur la mobilisation simultanée d’une équipe sur site et de personnels situés au centre d'information et de commandement de la préfecture de police. La première est composée de trois personnes, le télépilote en charge de manier le drone, un télépilote adjoint et un agent chargé de leur protection. Le télépilote procède au guidage de l’appareil à partir de son propre écran vidéo ou en effectuant un vol à vue afin qu’il accède au site dont l’opérateur a demandé, depuis la salle de commandement, le survol. Lorsque le drone survole le site désigné, le télépilote procède à la retransmission, en temps réel, des images au centre de commandement afin que l’opérateur qui s’y trouve puisse, le cas échéant, décider de la conduite à tenir. Il peut également être décidé de faire usage du haut-parleur dont est doté l’appareil afin de diffuser des messages à destination des personnes présentes sur le site.
11. Il résulte de l’instruction que le recours à ces mesures de surveillance est seulement destiné, en l’état de la doctrine d’usage telle qu’elle a été formalisée par la fiche du 14 mai 2020 et réaffirmée à l’audience publique par les représentants de l’Etat, à donner aux forces de l’ordre chargées de faire respecter effectivement les règles de sécurité sanitaire une physionomie générale de l'affluence sur le territoire parisien en contribuant à détecter, sur des secteurs déterminés exclusivement situés sur la voie ou dans des espaces publics, les rassemblements de public contraires aux mesures de restriction en vigueur pendant la période de déconfinement. La finalité poursuivie par le dispositif litigieux n’est pas de constater les infractions ou d’identifier leur auteur mais d'informer l'état-major de la préfecture de police afin que puisse être décidé, en temps utile, le déploiement d’une unité d’intervention sur place chargée de procéder à la dispersion du rassemblement en cause ou à l’évacuation de lieux fermés au public afin de faire cesser ou de prévenir le trouble à l’ordre public que constitue la méconnaissance des règles de sécurité sanitaire.
12. Il résulte également de l’instruction qu’en l’état de la pratique actuelle formalisée par la note du 14 mai 2020, les vols sont réalisés à une hauteur de 80 à l00 mètres de façon à donner une physionomie générale de la zone surveillée, qui est filmée en utilisant un grand angle sans activation du zoom dont est doté chaque appareil. En outre, dans le cadre de cette doctrine d’usage, les drones ne sont plus équipés d’une carte mémoire de sorte qu’il n’est procédé à aucun enregistrement ni aucune conservation d'image.
13. En premier lieu, telle qu’elle est décrite au point 11, la finalité poursuivie par le dispositif litigieux, qui est, en particulier dans les circonstances actuelles, nécessaire pour la sécurité publique, est légitime.
14. En deuxième lieu, il est constant qu’un usage du dispositif de surveillance par drone effectué conformément à la doctrine d’emploi fixée par la note du 14 mai 2020 n’est pas de nature à porter, par lui-même, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
15. En troisième lieu, eu égard à la finalité qu’il poursuit, le dispositif de surveillance litigieux relève du champ d’application matériel de la directive du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil dont l’article 1er prévoit qu’elle s’applique aux traitements de données à caractère personnel institués « y compris [pour] la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ».
16. D’une part, l’article 3 de la directive du 27 avril 2016 définit, à son point 1, les données à caractère personnel comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » et précise qu’est réputée être une «personne physique identifiable » « une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». Alors même qu’il est soutenu que les données collectées par les drones utilisés par la préfecture de police ne revêtent pas un caractère personnel dès lors, d’une part, que l’usage qui est fait de ces appareils, tel qu’il est prévu par la note du 14 mai 2020, ne conduit pas, en pratique, à l’identification des personnes filmées et, d’autre part, qu’en l’absence de toute conservation d’images, le visionnage en temps réel des personnes filmées fait en tout état de cause obstacle à ce qu’elles puissent être identifiées, il résulte de l’instruction que les appareils en cause qui sont dotés d’un zoom optique et qui peuvent voler à une distance inférieure à celle fixée par la note du 14 mai 2020 sont susceptibles de collecter des données identifiantes et ne comportent aucun dispositif technique de nature à éviter, dans tous les cas, que les informations collectées puissent conduire, au bénéfice d’un autre usage que celui actuellement pratiqué, à rendre les personnes auxquelles elles se rapportent identifiables. Dans ces conditions, les données susceptibles d’être collectées par le traitement litigieux doivent être regardées comme revêtant un caractère personnel.
17. D’autre part, l’article 3 de la directive du 27 avril 2016 définit, à son point 2, un traitement comme « toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ». Il résulte de ces dispositions que le dispositif de surveillance litigieux décrit aux points 10 à 12 qui consiste à collecter des données, grâce à la captation d’images par drone, à les transmettre, dans certains cas, au centre de commandement de la préfecture de police pour un visionnage en temps réel et à les utiliser pour la réalisation de missions de police administrative constitue un traitement au sens de cette directive.
18. Il s’ensuit que le dispositif litigieux constitue un traitement de données à caractère personnel qui relève du champ d’application de la directive du 27 avril 2016. Ce traitement, qui est mis en œuvre pour le compte de l’Etat, relève dès lors des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui sont applicables aux traitements compris dans le champ d’application de cette directive parmi lesquelles l’article 31 impose une autorisation par arrêté du ou des ministres compétents ou par décret, selon les cas, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Compte tenu des risques d’un usage contraire aux règles de protection des données personnelles qu’elle comporte, la mise en œuvre, pour le compte de l’Etat, de ce traitement de données à caractère personnel sans l’intervention préalable d’un texte réglementaire en autorisant la création et en fixant les modalités d’utilisation devant obligatoirement être respectées ainsi que les garanties dont il doit être entouré caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
19. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’Etat de cesser, à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement tant qu’il n’aura pas été remédié à l’atteinte caractérisée au point précédent, soit par l’intervention d’un texte réglementaire, pris après avis de la CNIL, autorisant, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 applicables aux traitements relevant du champ d’application de la directive du 27 avril 2016, la création d’un traitement de données à caractère personnel, soit en dotant les appareils utilisés par la préfecture de police de dispositifs techniques de nature à rendre impossible, quels que puissent en être les usages retenus, l’identification des personnes filmées.
20. L’association « La Quadrature du Net » et la Ligue des droits de l’homme sont donc fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance qu’elles attaquent, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 mai 2020 est annulée.
Article 2 : Conformément aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint à l’Etat de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement.
Article 3 : L’Etat versera à l’association « La Quadrature du Net » et à la Ligue des droits de l’homme chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « La Quadrature du Net », à la Ligue des droits de l’homme et au ministre de l’intérieur.
M.D. et autres c. Espagne du 28 juin 2022 requête no 36584/17
Art 8 : Juges catalans fichés par la police en raison de leurs opinions politiques : violation
L’affaire porte sur la constitution, par la police catalane, de fichiers concernant des juges qui avaient exprimé leurs opinions sur l’indépendance de la Catalogne par rapport à l’Espagne. Un certain nombre de documents provenant de ces fichiers, notamment des photos, avaient par la suite fait l’objet de fuites dans la presse. La Cour juge en particulier que la simple existence des rapports de police litigieux, dont l’établissement n’avait aucune base légale, emporte violation de la Convention. Par ailleurs, elle estime que les investigations menées sur les fuites ont été insuffisantes, car le chef de la police de Barcelone, un personnage clé de l’enquête, n’a pas été entendu.
FAITS
Les requérants sont 20 ressortissants espagnols. Ils exercent les fonctions de magistrat en Catalogne (Espagne). En février 2014, les requérants rédigèrent avec 13 autres juges un manifeste dans lequel ils déclaraient que, au regard de la Constitution et du droit international, la population catalane avait le « droit de décider » (de la question de l’indépendance de la Catalogne). En mars de la même année, un article intitulé « la conspiration de 33 juges séparatistes » fut publié au sujet de ce manifeste dans le journal La Razón. Cet article contenait des informations personnelles et des photos des requérants tirées de la base de données de la police. Une procédure pénale fut engagée sur plainte des requérants, qui demandèrent également réparation. Cette plainte fut rejetée par le juge d’instruction n° 15 de Madrid, celui-ci ayant estimé que bien que « (…) les faits objet de l’enquête [fussent] constitutifs d’une infraction, (…) il n’y a[vait] pas d’éléments suffisants pour les imputer à une personne déterminée ». Les requérants interjetèrent appel de cette décision. Statuant sur l’appel des requérants, le même juge d’instruction les en débouta derechef, au motif que personne ne pouvait être tenu pour pénalement responsable des faits incriminés. Ces derniers interjetèrent un nouvel appel, dont ils furent déboutés par l’Audiencia Nacional en avril 2016.
En 2014, les requérants avaient également porté plainte auprès de l’Agence de protection des données au sujet de l’article litigieux, mettant en cause le ministère de l’Intérieur et le journal La Razón. Leur plainte n’aboutit pas, mais l’Audiencia Nacional ordonna l’ouverture d’une enquête approfondie, qui est semble-t-il toujours pendante. La même année, le syndicat de fonctionnaires Manos Limpias porta plainte contre les juges signataires du manifeste auprès du Conseil général du pouvoir judiciaire. Il fut débouté de sa plainte ainsi que son appel subséquent.
CEDH
La Cour rappelle que l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences de la police dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Toutefois, cette disposition emporte également l'obligation de protéger activement l’individu contre les ingérences arbitraires des autorités dans sa vie privée. En ce qui concerne les rapports de police, la Cour relève qu’aucune disposition du droit interne n’autorise l’établissement de tels rapports en l’absence d’infraction. Les rapports litigieux contenaient des données personnelles, des photos, des renseignements professionnels (provenant en partie de la base de données d’identification de la police) et, dans certains cas, des informations sur les opinions politiques des intéressés. La Cour conclut que la simple existence de ces rapports de police emporte violation de l’article 8. En ce qui concerne les fuites dans la presse et l’enquête à laquelle elles ont donné lieu, la Cour juge indéniable que les photos et certaines autres informations provenaient de la base de données d’identification de la police. Les autorités internes ont conclu que l’État espagnol était responsable de ces fuites. Bien que certains témoins aient été entendus, il aurait fallu prendre la déposition du chef de la police de Barcelone – à qui les rapports avaient été adressés et qui était responsable des bases de données – pour que l’enquête menée sur les fuites pût être effective, ce qui n’a pas été fait.
Fauted’avoir procédé à cette mesure d’enquête, l’État défendeur a manqué à ses obligations au titre de l’article 8 de la Convention. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.
Gaughran c. Royaume-Uni du 13 février 2020 requête n° 45245/15
L'article 8 : La conservation indéfinie du profil ADN, des empreintes digitales et de la photographie d’un homme condamné pour conduite en état d’ivresse a enfreint son droit au respect de la vie privée
violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme La Cour précise que ce n’est pas la durée de la détention des données en question qui a été déterminante, mais l’absence de certaines garanties. Dans le cas du requérant, les autorités ont décidé de conserver sans limitation de durée les données personnelles le concernant, sans tenir compte ni de la gravité de l’infraction commise ni de la nécessité de conserver les données en question sans limitation de durée, et sans lui offrir une réelle possibilité de réexamen. Notant que la technologie utilisée de nos jours est plus complexe que les juridictions internes ne l’avaient envisagé dans cette affaire, notamment en ce qui concerne la conservation et l’analyse des photographies, la Cour considère que la conservation des données personnelles du requérant ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents.
LES FAITS
Le requérant, Fergus Gaughran, est un ressortissant britannique né en 1972 et résidant à Newry (Irlande du Nord, Royaume-Uni). Il fut arrêté en octobre 2008 pour conduite en état d’ivresse (une infraction emportant inscription dans les fichiers de la police, ou recordable offence). Il fut conduit au commissariat, où il fut soumis à un prélèvement d’haleine qui se révéla positif. Les policiers le prirent également en photo, relevèrent ses empreintes digitales et procédèrent à un prélèvement d’ADN. Par la suite, il plaida coupable, fut condamné au paiement d’une amende et se vit interdire de conduire pendant 12 mois. Sa condamnation fut rayée de son casier judiciaire en 2013. Le prélèvement ADN du requérant fut détruit en 2015, à sa demande. La police d’Irlande du Nord (Police Service Northern Ireland – « la PSNI ») conserve encore sans limitation de durée le profil ADN (données numériques) réalisé à partir de son échantillon d’ADN, ainsi que ses empreintes digitales et sa photographie.
Le requérant contesta en justice la conservation de ses données personnelles par la PSNI, sans succès.
ARTICLE 8
La Cour considère que la conservation du profil ADN, des empreintes digitales et de la photographie du requérant s’analyse en une atteinte à son droit à la vie privée, et que celle-ci visait un but légitime, à savoir la détection et, partant, la prévention des infractions pénales. Elle insiste sur la nécessité d’examiner la question du droit au respect de la vie privée dans les cas où les pouvoirs conférés à l’État sont obscurs et où les technologies disponibles gagnent continuellement en complexité. Elle cite à titre d’exemple les techniques de traitement des photographies et de reconnaissance faciale, qui ont déjà évolué depuis que les juridictions internes ont eu à connaître du cas d’espèce. Elle examine ensuite la question de savoir si l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée était justifiée. Elle rappelle qu’il faut reconnaître à cet égard une certaine marge d’appréciation aux autorités nationales compétentes. Cette marge d’appréciation serait cependant réduite s’il y avait au sein des États membres un fort consensus concernant la durée de conservation des données personnelles de personnes reconnues coupables d’une infraction.
La Cour considère que, dans leur majorité, les États membres ont mis en place des dispositions qui limitent la durée de conservation des données biométriques - empreintes digitales et profils ADN - des personnes reconnues coupables d’une infraction. Le Royaume-Uni est l’un des rares États membres du Conseil de l’Europe à autoriser la conservation sans limitation de durée des profils ADN2 . Par conséquent, la marge d’appréciation accordée aux États, en particulier à l’égard des profils ADN, doit être réduite. La Cour souligne toutefois que la durée de conservation des données personnelles de personnes reconnues coupables d’une infraction ne constitue pas un critère déterminant lorsqu’il s’agit de rechercher si un État a outrepassé sa marge d’appréciation en la matière. Le risque de stigmatisation associé à la conservation de pareilles données n’est pas aussi élevé que dans l’affaire S. et Marper c. Royaume-Uni, qui concernait des personnes qui avaient été soupçonnées d’avoir commis des infractions mais n’avaient pas été reconnues coupables. L’élément déterminant est le point de savoir si des garanties effectives ont été mises en place. Dès lors qu’il décide de s’accorder à lui-même le pouvoir le plus étendu en matière de conservation de données, à savoir le pouvoir de conserver des données personnelles sans limitation de durée, l’État se place à la limite de sa marge d’appréciation. Il doit donc veiller à l’existence de certaines garanties effectives. En l’espèce, les données biométriques et la photographie du requérant ont été conservées sans qu’il soit tenu compte ni de la gravité de l’infraction commise ni de la nécessité de conserver indéfiniment les données en question. En outre, la police d’Irlande du Nord n’est autorisée à supprimer les données biométriques et les photographies en sa possession que dans des cas exceptionnels. En conséquence, le requérant n’avait pas la possibilité de demander un réexamen de la décision de conserver sans limitation de durée ses données personnelles, puisqu’aucune disposition ne permettait la suppression des données en question dans les cas où il apparaissait que leur conservation n’était plus nécessaire compte tenu de la nature de l’infraction, de l’âge et de la personnalité actuelle de l’intéressé, ainsi que du temps écoulé. La Cour estime que la nature de ces pouvoirs ne traduisait pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents.
L’État défendeur a donc outrepassé la marge d’appréciation qui était la sienne, et la conservation litigieuse s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée, ne pouvant passer pour nécessaire dans une société démocratique. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
Catt c. Royaume-Uni du 24 novembre 2019 requête n° 43514/15
Violation de l'article 8 : Le Royaume-Uni a manqué à son obligation de protéger la vie privée d’un militant de longue date mentionné dans une base de données relative à l’extrémisme.
Le requérant se plaignait de la collecte et de la conservation, dans une base de données de la police relative à l’« extrémisme national », de données personnelles le concernant. La Cour juge en particulier que les informations détenues sur le requérant révélaient ses opinions politiques et qu’elles nécessitaient de ce fait une protection particulière. Elle tient également compte de l’âge de M. Catt, qui a maintenant 94 ans, et du fait qu’il ne s’est jamais rendu coupable d’actes de violence et qu’il est peu probable qu’il en commette à l’avenir. Si la collecte d’informations sur son compte était justifiée, leur conservation ne l’était pas, compte tenu notamment de l’absence de garanties telles que des délais. Il y a donc eu violation de la Convention.
FAITS
M. Catt milite depuis longtemps en faveur de la paix et il assiste régulièrement à différents types de manifestations. En 2005, il commença à prendre part aux protestations organisées par un groupe appelé Smash EDO contre l’usine de la société américaine d’armement EDO MBM Technology Ltd installée à Brighton. Ces manifestations provoquèrent des troubles et une présence policière importante fut mise en place. M. Catt n’a jamais été condamné pour une quelconque infraction. En mars 2010, en vertu de la loi sur la protection des données de 1998, il demanda à la police la communication des informations détenues sur son compte. La police lui révéla l’existence dans ses bases de données de soixante-six inscriptions le concernant. Recueillies entre mars 2005 et octobre 2009, ces données portaient essentiellement sur Smash EDO, même si certaines concernaient également treize autres manifestations et événements, dont une conférence du Congrès des syndicats britanniques qui s’était tenue à Brighton en 2006, une manifestation lors d’une conférence du parti travailliste en 2007 et une réunion en faveur de Gaza en 2009. Ces informations étaient conservées dans une base de données de la police relative à l’« extrémisme national » et elles figuraient dans des fiches concernant d’autres personnes ou dans des rapports le mentionnant de manière incidente. Y étaient généralement consignés son nom, le lieu où sa présence avait été relevée, sa date de naissance, son adresse et parfois son aspect physique. En août 2010, l’intéressé demanda à l’association des commissaires de police (« Association of Chief Police Officers ») d’effacer les données le mentionnant mais l’association refusa. M. Catt saisit les juridictions internes, arguant que la conservation de ses données n’était pas « nécessaire » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention européenne. En mai 2012, la High Court estima que l’article 8 ne trouvait pas à s’appliquer et que même s’il avait été applicable, l’ingérence aurait été justifiée. M. Catt obtint gain de cause devant la cour d’appel qui jugea disproportionnée la conservation de ses données mais en mars 2015, la Cour suprême accueillit, par quatre voix contre une, un recours formé par l’association des commissaires de police et par le préfet de police du Grand-Londres. La Cour suprême déclara que la conservation des données était prévue par la loi et qu’elle était proportionnée. Elle jugea en particulier que l’atteinte à la vie privée de M. Catt avait été mineure et observa que les informations détenues étaient déjà dans le domaine public et qu’elles n’étaient ni intimes ni sensibles. Elle considéra également que la collecte et la conservation de telles données répondaient à des raisons policières fondées même si elles concernaient des manifestants sans casier judiciaire et non susceptibles d’actes de violence. Par ailleurs, elle releva qu’il n’était pas envisagé de transmettre les informations à des tiers, tels que des employeurs, ni de les utiliser dans un but politique et que la question de savoir s’il fallait les conserver ou les effacer était périodiquement réexaminée. Dans ses réponses aux questions posées par la Cour lors de la communication de l’affaire, le Gouvernement a reconnu que quatre inscriptions supplémentaires avaient été trouvées dans la base de données litigieuse mentionnant M. Catt et il a indiqué que la police n’avait pu expliquer pourquoi ces rapports n’avaient pas été dévoilés plus tôt
ARTICLE 8
Comme l’a constaté la Cour suprême, la collecte de telles données répondait à des raisons policières fondées. Dans le cas de M. Catt, la collecte de ses données était justifiée en ce que les activités de Smash EDO étaient connues pour être violentes et potentiellement criminelles. Même si l’intéressé n’avait jamais été violent ni n’avait jamais montré aucune tendance à la violence, il s’était lui-même assimilé à plusieurs reprises et publiquement à ce groupe. La Cour juge toutefois que la conservation prolongée des données dans le cas de M. Catt était disproportionnée en ce qu’il s’agissait de données à caractère personnel qui révélaient des opinions politiques et méritaient ainsi une protection accrue. Elle relève également que M. Catt ne constituait de menace pour personne, compte tenu notamment de son âge, et estime que les garanties procédurales n’étaient pas effectives. Sur ce dernier point, elle note en particulier que la durée pendant laquelle les données pouvaient être conservées n’était pas définie, la seule règle à cet égard étant que leur réexamen était prévu au terme d’une période minimum de six ans. Dans le cas de M. Catt, il n’apparaît pas clairement que de tels réexamens ont réellement eu lieu au bout de six ans ou à une autre date. La Cour juge pareille situation contraire notamment aux résolutions relatives à la protection de la vie privée adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe selon lesquelles un délai maximal doit être déterminé pour la conservation de certaines catégories d’information. Elle se déclare également préoccupée par l’effectivité, en termes de garantie, des voies de recours ouvertes en l’espèce puisqu’au moment de la procédure interne, la police conservait en réalité plus de données sur M. Catt qu’elle ne l’avait auparavant admis. En tout état de cause, elle observe que l’utilité de la garantie d’un réexamen est discutable puisque la décision de conserver des informations sur l’intéressé n’a pas tenu compte de la protection renforcée applicable aux données révélant les opinions politiques d’une personne. Enfin, la Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel il serait trop difficile de réexaminer et d’effacer toutes les données concernant M. Catt en ce que la base de données relative à l’extrémisme ne serait pas automatisée. Elle relève en effet que le réexamen et l’effacement de données sont prévus par les directives internes et qu’ils ont effectivement été mis en œuvre pour certaines des données concernant M. Catt.
Dans l’ensemble, il y a eu violation des droits garantis à M. Catt par l’article 8.
DROITS D'AUTEUR D'UNE OEUVRE DE FICTION
Jelševar et autres c. Slovénie du 3 avril 2014 requête no 47318/07
Les tribunaux slovènes ont ménagé un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté artistique dans une affaire concernant une oeuvre littéraire de fiction
En 1998, un écrivain, B.M.Z., publia à compte d’auteur un roman décrivant la vie d’une femme de la campagne slovène qui émigra aux Etats-Unis au début du 20e siècle, épousa un ressortissant slovène du nom de Brinovc puis rentra chez elle pour reprendre la ferme familiale, faire commerce de fruits et légumes et fonder une famille. Le personnage principal, Rozina, est dépeint comme une femme vivante, ambitieuse et pleine de ressources. Toutefois, le livre décrit également comment elle a utilisé le sexe pour parvenir à ses fins avec son mari, a vendu illégalement de l’alcool pendant la Prohibition aux Etats-Unis et accordait plus d’importance à l’argent qu’à ses enfants.
Les requérantes ont reconnu dans cette histoire celle de leur famille, et plus particulièrement de leur défunte mère. Le roman se déroule notamment dans la région où vivait leur famille et le nom de Brinovc, sans être leur véritable patronyme, est celui sous lequel ils étaient connus au sein de la communauté locale. Les recours civils internes furent tous rejetés.
La Cour indique que la liberté artistique dont jouissent les auteurs d’ouvrages littéraires constitue en soi une valeur, qui doit à ce titre être protégée par la Convention.
En l’espèce, recherchant si les autorités slovènes ont ménagé un juste équilibre entre la réputation des requérantes et le droit de B.M.Z. à la liberté d’expression, elle note que les juridictions nationales ont accordé une importance primordiale à la question de savoir s’il était possible de reconnaître la famille des requérantes dans les personnages du roman, et si ces personnages étaient dépeints d’une manière offensante susceptible de s’analyser en diffamation. Elle observe aussi que, dans son arrêt de 2007, la Cour constitutionnelle a évalué les portraits littéraires selon un critère objectif et a conclu que l’histoire racontée dans le roman ne pouvait ni être considérée comme correspondant à la réalité ni comme offensante par le lecteur moyen.
La Cour juge que la méthode employée par la Cour constitutionnelle slovène pour statuer sur la question de savoir si un juste équilibre avait été ménagé entre les intérêts concurrents en présence – à savoir rechercher si le lecteur moyen considérerait l’histoire comme véridique (et non comme relevant de la fiction) et s’il la trouverait offensante compte tenu du contexte général de l’ouvrage – était une approche raisonnable qui s’inscrivait dans le droit fil de sa propre jurisprudence. Elle juge particulièrement important le fait que les témoins aient pour la plupart déclaré qu’il n’était pas possible que le personnage principal du roman constitue une description fidèle de la défunte mère des requérantes.
Partant, la Cour conclut que la réputation des requérantes n’a pas été sérieusement ternie et rejette leur requête pour défaut manifeste de fondement (article 35 § 3 a) de la Convention).
ALMEIDA LEITÃO BENTO FERNANDES c. PORTUGAL du 12 mars 2015 requête 25790/11
Non violation de l'article 10 : la condamnation de la requérante qui écrit un roman pour balancer sur la vie privé de sa famille est justifiée et proportionnée.
43. Une ingérence est contraire à la Convention si elle ne respecte pas les exigences prévues au paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si la présente ingérence était « prévue par la loi », si elle visait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et si elle était « nécessaire, dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts.
i. Prévue par la loi
44. En l’espèce, la Cour constate que l’ingérence était prévue par les articles 180, 182, 183 et 185 du code pénal et les articles 30 et 31 de la loi de la presse.
ii. But légitime
45. La Cour note que l’ingérence visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, ce qui peut englober, selon la jurisprudence de la Cour (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 52, CEDH 2004‑VI ; et Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007), le droit des personnes concernées au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention.
46. La question qui se pose est donc celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique ». Il s’agit plus particulièrement d’examiner si les autorités ont ménagé un juste équilibre entre le droit de la requérante à la liberté d’expression et le droit des membres de sa belle‑famille au respect de leur vie privée.
iii. Nécessaire dans une société démocratique
47. La Cour rappelle que sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur adéquate d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 60, CEDH 2001-I ; et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 68, CEDH 2004‑XI). Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui en font application, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis, Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, § 77, CEDH 2003‑I ; et Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 38, CEDH 2004-X).
48. La Cour rappelle aussi qu’il y a lieu de prendre en compte le fait que le roman est une forme d’expression artistique qui, bien que susceptible d’atteindre un lectorat sur une période plus longue, s’adresse généralement à un public plus restreint que la presse écrite (sur ce dernier point, Alınak et autres c. Turquie, précité, § 41).
49. Lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur un conflit entre deux droits également protégés par la Convention, la Cour doit effectuer une mise en balance des intérêts en jeu. L’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de l’ouvrage ou, sous l’angle de l’article 10, par son auteur. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. France, no 12268/03, § 41, 23 juillet 2009 ; Timciuc c. Roumanie (déc.), no 28999/03, § 144, 12 octobre 2010 ; et Mosley c. Royaume-Uni, no 48009/08, § 111, 10 mai 2011). Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 106, CEDH 2012 ; Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 87, 7 février 2012).
50. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011 ; Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011 ; et, dernièrement, Jelševar et autres c. Slovénie (déc.), no 47318/07, § 32, 11 mars 2014).
51. En l’espèce, la Cour constate que le roman litigieux est une œuvre de fiction qui a été éditée par la requérante. Elle note aussi que le tirage du roman a été de 100 exemplaires, publiés et distribués gratuitement, pour l’essentiel à des proches et amis. Par conséquent, la diffusion du roman a été restreinte et celui-ci semble en l’occurrence avoir essentiellement circulé dans le cercle de la requérante et de sa belle-famille, notamment dans leur ville d’origine, Torre do Moncorvo.
52. La Cour observe que l’œuvre litigieuse raconte l’histoire d’une famille, avec ses drames et ses conflits dans le contexte de la diaspora portugaise aux États-Unis et de la guerre coloniale. Elle note ensuite que les personnes visées sont connues dans leur milieu, notamment dans la ville de Torre de Moncorvo, mais ne sont pas de notoriété publique. La marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la sanction prononcée contre les requérants était en conséquence large (voir, a contrario Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, précité, § 48 ; Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006‑XIII ; Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 88-89, CEDH 2005‑II).
53. Dans l’examen de l’affaire, le tribunal de Torre de Moncorvo a d’abord cherché à déterminer si certains des faits racontés et des jugements de valeur formulés par la requérante pouvaient être regardés comme diffamatoires. Dans son jugement du 26 mars 2010, il a considéré que portaient atteinte à l’honneur et la réputation d’autrui le fait de dire, entre autres de telle personne, qu’elle est de mauvaise vie et trompe son mari ; de telle autre personne, qu’elle abuse financièrement de son fils et meurt du sida parce qu’elle fréquentait des prostituées ; de telle autre, qu’elle est avare et abandonne son mari alors qu’il est sur le point de mourir ; d’une autre encore, qu’elle est frivole et légère et offre son corps à tout homme lui ouvrant son portefeuille, qu’elle est débauchée et libertine ; de telle autre, qu’elle a collaboré avec la police d’État et a fait emprisonner des centaines de personnes ; ou d’une autre, enfin, qu’elle est grossière et a une haleine repoussante (voir ci-dessus paragraphe 22).
54. Le tribunal a ensuite cherché à établir s’il existait un lien entre les personnages du roman litigieux et les plaignants. Dans son jugement, il a conclu que les personnages d’Aurora, Rogério, Beatriz, Inocência, Imaculada, Floro et António présentaient des similitudes flagrantes avec respectivement la tante, l’oncle, la cousine, la mère, la sœur et les défunts père et grand-père du mari de la requérante (voir ci-dessus paragraphe 23).
55. Mettant en balance les intérêts divergents en jeu, le tribunal a conclu que la requérante avait dépassé les limites de sa liberté de création artistique en méconnaissant le droit des plaignants au respect de leur vie privée, étant donné certains des faits racontés et des jugements de valeur formulés au sujet de ces derniers et de deux membres défunts de leur famille (voir ci-dessus paragraphe 24).
56. La cour d’appel de Porto a intégralement confirmé ces considérations dans son arrêt du 27 octobre 2010 (voir ci-dessus paragraphe 27), réitérant l’orientation prise dans celui qu’elle avait rendu le 11 mars 2009 (voir ci-dessus paragraphe 20).
57. La Cour observe que les juridictions internes ont toujours cherché à mettre en balance, d’une part, le droit de la requérante à la liberté d’expression et, d’autre part, le droit des plaignants au respect de leur vie privée. Elle estime que la condamnation prononcée en l’espèce est fondée sur des motifs pertinents et suffisants, et ne voit aucune raison de s’écarter de l’analyse à laquelle ont procédé les juridictions internes, ou de considérer que celles-ci ont entendu trop restrictivement le principe de la liberté d’expression ou de façon trop extensive l’objectif de protection de la réputation et des droits d’autrui. En outre, les motifs énoncés par les tribunaux nationaux à l’appui de leurs conclusions respectent les critères suivis par la Cour dans ce type d’affaires (voir, notamment, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, précité, §§ 48-60 ; Chauvy et autres c. France, précité, § 77).
58. Pour finir, la Cour rappelle que la nature et la gravité des sanctions infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence par rapport aux buts qu’elle poursuit (Pedersen et Baadsgaard, précité, § 93 ; et Jokitaipale et autres c. Finlande, no 43349/05, § 77, 6 avril 2010).
59. En l’espèce, le tribunal de Torre de Moncorvo a appliqué une peine cumulée de 400 jours-amende au taux journalier de dix EUR, soit un taux proche du minimum prévu par l’article 47 § 2 du code pénal. S’il est vrai que la requérante a en outre été condamnée au versement de 53 500 EUR de dommages et intérêts aux plaignants, ce montant s’explique par le fait que l’atteinte à la réputation concernait personnellement les cinq plaignants et deux personnes défuntes de leur famille, soit sept personnes en tout. Le tribunal a par ailleurs pris en considération la situation socio-économique de la requérante (voir ci-dessus paragraphe 25).
60. Au vu de ces observations, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficiaient en l’espèce les autorités nationales dans la mise en balance d’intérêts divergents, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression n’a pas été disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi.
61. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
LES ARTICLES DE PRESSE ET DE RADIO
Sağdıç c. Turquie du 9 février 2021 requête n° 9142/16
Article 8 : Atteinte à la réputation d’un militaire dans des articles non conformes aux normes d’un journalisme responsable
Dans cette affaire, M. Sağdıç se plaignait d’une atteinte à son droit à la protection de sa réputation en raison de la publication d’une série d’articles dans les quotidiens Taraf et Yeni Şafak, en novembre et décembre 2009, le mettant en cause dans une affaire portant sur un plan d’action baptisé « Cage » qui aurait visé à créer des conditions propices au renversement du gouvernement. La Cour juge en particulier que, eu égard à la gravité des allégations contenues dans les articles litigieux, qui imputaient à M. Sağdıç des actes sérieux et pénalement répréhensibles, l’atteinte à la réputation atteint le seuil de gravité requis pour entrer dans le champ d’application de l’article 8. La Cour estime ensuite que les juridictions nationales n’ont pas dûment mis en balance le droit de M. Sağdıç au respect de sa vie privée d’un côté et la liberté de la presse de l’autre ; que le contenu des articles litigieux n’était pas conforme aux normes d’un journalisme responsable ; et que les juridictions internes auraient dû faire preuve d’une plus grande rigueur lorsqu’elles ont soupesé ces différents intérêts. Ces dernières n’ont pas suffisamment pris en compte le sérieux de l’atteinte que portait au droit de M. Sağdıç à la protection de sa réputation la publication d’allégations qui lui imputaient des faits d’une particulière gravité et qui comportaient le risque de le livrer à la vindicte publique.
Art 8 • Vie privée • Manquement des juridictions nationales à protéger la réputation du requérant contre les atteintes portées par des articles de presse ayant publiés des allégations couvertes par le secret de l’instruction, lui imputant des faits d’une particulière gravité, et comportant le risque de le livrer à la vindicte publique • Mise en balance inadéquate des différents intérêts en jeu.
FAITS
Le requérant, Kadir Sağdıç, est un ressortissant turc né en 1952. Il réside à Istanbul (Turquie). À l’époque des faits, il était militaire de carrière ; il occupait un poste dans le commandement des forces navales turques et avait le grade de vice-amiral. En novembre et décembre 2009, parurent dans les quotidiens Taraf et Yeni Şafak une série d’articles relatant qu’un plan d’action dénommé « Cage » aurait été découvert par les procureurs en charge, à l’époque des faits, de l’affaire Ergenekon. Selon ces articles, le plan « Cage » aurait été élaboré au sein de la marine par un groupe de militaires, dont faisait partie M. Sağdıç, dans le but de commettre des attentats ciblant les minorités religieuses du pays afin de créer des conditions propices au renversement du gouvernement de l’époque. Le nom complet et la photographie de M. Sağdıç furent publiés en marge de certains de ces articles, où l’intéressé fut désigné comme l’un des principaux responsables de la conjuration d’où était né le plan « Cage ».
En 2011, M. Sağdıç intenta une procédure en dommage et intérêts contre les deux quotidiens mais ses demandes furent rejetées par les juridictions du fond. Il introduisit ensuite un recours individuel devant la Cour constitutionnelle qui aboutit, en avril 2015, à un arrêt de non-violation de son droit à la protection de sa réputation.
Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
La Cour note que, eu égard à la gravité des allégations contenues dans les articles litigieux, qui imputaient au requérant des actes sérieux et pénalement répréhensibles, l’atteinte à la réputation atteint le seuil de gravité requis pour entrer dans le champ d’application de l’article 8. Pour la Cour, même si les limites de la critique admissible étaient plus larges pour le requérant (qui était officier de haut rang dans les forces armées turques, à l’époque des faits) que pour de simples particuliers, sa qualité de fonctionnaire ne l’exposait pas au même niveau d’examen public de ses actes que les hommes politiques, et ce d’autant moins que les allégations publiées à son sujet ne se limitaient pas à une critique de la manière dont il s’acquittait de ses fonctions : les publications litigieuses relataient qu’il avait commis de graves infractions pénales, et étaient donc propres à provoquer par la force des choses une perte de confiance du public à son égard. Or, vu la nature de sa mission, qui était importante et qui relevait d’un domaine sensible et stratégique, il était de l’intérêt général qu’il jouisse de la confiance du public et qu’il soit protégé contre des accusations infondées. La Cour tient à souligner sur ce point que le contenu des articles litigieux était particulièrement infamant pour le requérant, dont le nom complet et la photographie étaient même publiés en marge de certains d’entre eux. Pour rédiger ces articles, les journalistes se sont appuyés sur des documents dont l’authenticité n’avait pas encore été établie ni déclarée par les autorités, qui étaient couverts par le secret de l’instruction et qui imputaient au requérant des infractions graves, telles que la préparation d’attentats visant à renverser le gouvernement.
Or, la Cour estime que rien ne leur permettait de penser, dans la situation telle qu’elle se présentait à l’époque des faits, qu’ils pouvaient se fier à ces documents sans mener leurs propres investigations. Les organes de presse concernés ne pouvaient ignorer l’origine des pièces sur lesquelles les articles reposaient, ni le caractère confidentiel des informations qu’ils publiaient. Ils devaient savoir que la divulgation de ces informations se heurtait à la prohibition énoncée à l’article 285 du code pénal, qui réprimait la violation du secret de l’instruction. Il y a lieu de rappeler que, malgré le rôle essentiel qui revient aux médias dans une société démocratique, les journalistes ne sauraient en principe être déliés, par la protection que leur offre l’article 10, de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. Par conséquent, la manière dont le sujet a été traité dans les articles litigieux ne peut passer pour conforme aux normes d’un journalisme responsable. Quant aux décisions adoptées par les juridictions nationales, la Cour note que, le tribunal de grande instance a indiqué que les publications litigieuses étaient conformes à la réalité apparente, étant donné que leur contenu figurait dans l’acte d’accusation, qu’elles contribuaient à un débat d’intérêt public et qu’elles n’étaient pas outrancières, compte tenu, d’une part, de la gravité des allégations qu’elles renfermaient et, d’autre part, des fonctions exercées par le requérant. La Cour de cassation a confirmé cette décision sans motiver davantage sa conclusion. La Cour constitutionnelle a rejeté le recours individuel du requérant, considérant que dans sa décision le tribunal de grande instance avait dûment mis en balance les intérêts divergents. La Cour estime que les juridictions nationales n’ont pas dûment mis en balance le droit du requérant au respect de sa vie privée d’un côté et la liberté de la presse de l’autre. Elle est d’avis que, eu égard au contenu des articles litigieux, qui n’était pas conforme aux normes d’un journalisme responsable, les juridictions internes auraient dû faire preuve d’une plus grande rigueur lorsqu’elles ont soupesé ces différents intérêts. Or, en l’espèce, ni le jugement du tribunal de grande instance, confirmé ensuite par la Cour de cassation, ni l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle sur le recours individuel introduit par le requérant ne semblent avoir suffisamment pris en compte le sérieux de l’atteinte que portait au droit du requérant à la protection de sa réputation la publication d’allégations qui étaient couvertes par le secret de l’instruction à l’époque des faits, qui lui imputaient des faits d’une particulière gravité, et qui comportaient ainsi le risque de le livrer à la vindicte publique. Par conséquent, les juridictions nationales ont manqué à protéger le droit du requérant au respect de sa vie privée contre les atteintes portées par les articles de presse litigieux.
Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
CEDH
a) Les principes généraux
24. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression. Ces principes sont résumés notamment dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83‑93, CEDH 2015).
25. La Cour rappelle aussi que la notion de vie privée est une notion large, qui comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, son image et son intégrité physique et morale (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 50, CEDH 2004‑VI). Il est admis dans sa jurisprudence que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est couvert par l’article 8 de la Convention en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012, Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 137, CEDH 2015, Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 72, 29 mars 2016, et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC], no 17224/11, § 76, 27 juin 2017). La Cour a déjà jugé que la réputation d’une personne fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale, et que celles-ci relèvent de la vie privée même si les critiques dont la personne fait l’objet sont exprimées dans le cadre d’un débat public (Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007, et Petrie c. Italie, no 25322/12, § 39, 18 mai 2017). Les mêmes considérations s’appliquent à l’honneur d’une personne (Sanchez Cardenas c. Norvège, no 12148/03, § 38, 4 octobre 2007, et A. c. Norvège, no 28070/06, § 64, 9 avril 2009). Cependant, pour que l’article 8 trouve à s’appliquer, l’atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (Axel Springer AG, § 83, Delfi AS, § 137, Bédat, § 72, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, § 76, tous précités).
26. La Cour rappelle par ailleurs que la presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui se rapportent à l’administration de la justice (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999‑III, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, §§ 43‑45, CEDH 2001‑III, et Tourancheau et July c. France, no 53886/00, § 65, 24 novembre 2005). La marge d’appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, parmi beaucoup d’autres, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59, Thoma, précité, § 45, et Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, no 37840/10, § 25, 3 avril 2014). Les journalistes doivent cependant agir de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournir des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999‑I, Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 37, CEDH 2004‑II, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, § 69, CEDH 2008).
27. En effet, la protection que l’article 10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition qu’ils agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect des principes d’un journalisme responsable. Le concept de journalisme responsable, activité professionnelle protégée par l’article 10 de la Convention, est une notion qui ne couvre pas uniquement le contenu des informations recueillies et/ou diffusées par des moyens journalistiques (Pentikäinen c. Finlande [GC], no 11882/10, § 90, CEDH 2015), mais qui englobe aussi la licéité du comportement des journalistes. Le fait qu’un journaliste a enfreint la loi doit être pris en compte, mais il n’est pas déterminant pour établir s’il a agi de manière responsable (ibidem).
28. La Cour reconnaît qu’une distorsion de la réalité, opérée de mauvaise foi, peut parfois transgresser les limites de la critique acceptable : une affirmation véridique peut se doubler de remarques supplémentaires, de jugements de valeur, de suppositions, voire d’insinuations, susceptibles de créer une image erronée aux yeux du public (voir, par exemple, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 45, 27 mai 2004). Ainsi, la mission d’information comporte nécessairement des devoirs et des responsabilités ainsi que des limites que les organes de presse doivent s’imposer spontanément. C’est particulièrement le cas lorsque le récit médiatique tend à imputer des faits d’une particulière gravité à des personnes nommément citées, une telle imputation comportant le risque de désigner ces personnes à la vindicte publique (Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie, no 11461/03, § 27, 19 décembre 2006, et Mater c. Turquie, no 54997/08, § 55, 16 juillet 2013).
29. La Cour rappelle en outre que, dans les arrêts Lingens c. Autriche (8 juillet 1986, § 46, série A no 10) et Oberschlick c. Autriche ((no 1), 23 mai 1991, § 63, série A no 204), elle a opéré une distinction entre déclarations de fait et jugements de valeur. La matérialité des déclarations de fait peut se prouver ; en revanche, les jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, l’obligation de les prouver est impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 de la Convention (De Haes et Gijsels, précité, § 42). Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux : à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif (De Haes et Gijsels, précité, § 47, Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997‑IV, Brasilier c. France, no 71343/01, § 36, 11 avril 2006, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 55, CEDH 2007‑IV). Pour distinguer une imputation de fait d’un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce et de la tonalité générale des propos (Brasilier, précité, § 37), étant entendu que des assertions sur des questions d’intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait (Paturel c. France, no 54968/00, § 37, 22 décembre 2005).
30. La Cour rappelle de surcroît que les obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention peuvent impliquer l’adoption de mesures visant à assurer le respect de la vie privée même dans le domaine des relations entre les individus. Le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États (Egill Einarsson c. Islande (no 2), no 31221/15, §§ 33 et 35, 17 juillet 2018). Dans les affaires comme celle de l’espèce, il lui incombe de déterminer si, dans le cadre des obligations positives découlant pour lui de l’article 8 de la Convention, l’État a ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 (Petrie, précité, § 40). Elle a résumé dans plusieurs arrêts les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression. Ces critères sont les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication (Von Hannover (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108‑113, CEDH 2012, et Axel Springer AG, précité, §§ 89‑95, voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93). Si la mise en balance entre ces deux droits s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06 et 3 autres, § 57, CEDH 2011).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
31. La Cour note que la présente requête porte sur des articles de presse dont le requérant allègue qu’ils ont par leur contenu porté atteinte à sa réputation. À cet égard, elle rappelle que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de la protection de l’article 8 de la Convention (paragraphe 25 ci-dessus). Elle estime qu’en l’espèce, eu égard à la gravité des allégations contenues dans les articles litigieux, qui imputaient au requérant des actes sérieux et pénalement répréhensibles, l’atteinte à la réputation atteint le seuil de gravité requis pour entrer dans le champ d’application de l’article 8.
32. Elle note ensuite que le requérant ne reproche pas à l’État une action mais un manquement à protéger sa réputation contre les atteintes qu’y ont portées, selon lui, les articles en question. En l’espèce, elle doit donc déterminer si les juridictions nationales ont manqué à protéger le requérant contre les atteintes dont il s’estime victime dans le cadre de leurs obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée dans les rapports interindividuels. À cet effet, elle procédera à une appréciation des circonstances litigieuses à la lumière des critères pertinents qui se dégagent de sa jurisprudence, notamment en ce qui concerne le juste équilibre à ménager entre le droit de chacun à la protection de sa réputation d’une part et la liberté de la presse d’autre part (paragraphe 30 ci-dessus).
33. Elle observe d’emblée qu’à l’époque des faits le requérant était officier de haut rang dans les forces armées turques. Elle rappelle que, comme pour les hommes politiques, les limites de la critique admissible sont plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour les simples particuliers. Cependant, on ne saurait dire que des fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme les hommes politiques (Oberschlick (no 2), précité, § 29, Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999‑I, et Thoma, précité, § 47). Ainsi, même si les limites de la critique admissible étaient plus larges pour le requérant que pour de simples particuliers, sa qualité de fonctionnaire ne l’exposait pas au même niveau d’examen public de ses actes que les hommes politiques, et ce d’autant moins que les allégations publiées à son sujet ne se limitaient pas à une critique de la manière dont il s’acquittait de ses fonctions : les publications litigieuses relataient qu’il avait commis de graves infractions pénales, et étaient donc propres à provoquer par la force des choses une perte de confiance du public à son égard (Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 80, CEDH 2004‑XI). Or, vu la nature de sa mission, qui était importante et qui relevait d’un domaine sensible et stratégique, il était de l’intérêt général qu’il jouisse de la confiance du public et qu’il soit protégé contre des accusations infondées (voir, mutatis mutandis, Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, § 54, CEDH 2003‑IV).
34. La Cour observe ensuite que les articles de presse incriminés concernaient une enquête pénale menée par les procureurs de la République dans le cadre d’une affaire à laquelle le public portait un certain intérêt à l’époque des faits, à savoir l’affaire Ergenekon. Ces articles relataient la découverte récente par les enquêteurs d’un plan d’action supposément conçu par des militaires conjurés appartenant à l’organisation criminelle Ergenekon, parmi lesquels le requérant, ainsi que l’adoption par les autorités judiciaires de certaines mesures à l’égard des suspects. Selon les allégations publiées, les conjurés projetaient, dans ce plan d’action, de commettre des attentats contre les minorités religieuses du pays afin de créer un climat propice au renversement du gouvernement (paragraphe 7 ci-dessus). Étant donné, d’une part, la place importante qu’occupaient les débats relatifs à l’affaire Ergenekon dans l’opinion publique à l’époque des faits et, d’autre part, la gravité de la menace pour l’ordre public et la sécurité du pays décrite dans les articles en question, force est de constater qu’il s’agissait de publications qui concernaient des thèmes d’intérêt général et d’actualité et qui contribuaient à un débat d’intérêt public.
35. La Cour observe ensuite que le contenu des articles litigieux, tel qu’il est décrit ci-dessus, renfermait essentiellement des imputations factuelles. Se pose ainsi la question de savoir si les allégations publiées sur le requérant dans ces articles étaient conformes à la réalité.
36. La Cour note à cet égard que l’enquête pénale, dont le requérant était, semble-t-il, l’un des suspects, était toujours en cours lorsque les articles litigieux ont été publiés, aux mois de novembre et décembre 2009. Le dossier ne renferme aucune information précise sur le déroulement ultérieur de cette enquête ni sur les poursuites pénales engagées contre le requérant par la suite. Il ressort cependant des opinions dissidentes émises par trois membres de la Cour constitutionnelle qu’à l’issue de l’enquête, un acte d’accusation, qui visait notamment le requérant, a été accepté et rendu public, en mars 2010 (paragraphe 13 ci-dessus). Le requérant indique de son côté, sans être contredit par le Gouvernement, qu’il a finalement été acquitté en mars 2015 des accusations portées contre lui dans le cadre de cette procédure pénale (paragraphe 22 ci-dessus).
37. La Cour rappelle que l’on ne saurait considérer que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, dans la presse ou au sein de la population en général. À la fonction des médias consistant à communiquer des informations et des idées, notamment sur ces sujets, s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir (Bédat, précité, § 51). La Cour estime par ailleurs que la crédibilité des sources d’un article doit s’envisager sous l’angle de la situation telle qu’elle se présentait aux journalistes à l’époque des faits, et non avec le recul, à partir des constatations ultérieures des tribunaux (Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 66).
38. Elle note à cet égard qu’en l’espèce, les auteurs des articles litigieux, qui semblent s’être procuré des documents relatifs au plan d’action qu’ils mentionnaient dans leurs articles, ne citaient aucune source à l’appui de leurs allégations, et se contentaient d’indiquer que les procureurs de la République avaient obtenu ces informations au cours de l’enquête pénale menée dans l’affaire Ergenekon (paragraphe 7 ci-dessus). Or, au moment de la parution des articles, les informations qui y figuraient, telles qu’elles ressortaient des documents relatifs au plan d’action, étaient encore couvertes par le secret de l’instruction : l’acte d’accusation établi dans le cadre des poursuites pénales engagées contre le requérant n’a été accepté par le tribunal compétent qu’en mars 2010 (paragraphe 13 ci-dessus). Les auteurs des articles n’ont pas expliqué comment ils s’étaient procuré les documents sur lesquels reposaient les informations qu’ils révélaient – et qui n’étaient pas encore publiques – et ils n’ont pas dit s’ils avaient vérifié l’exactitude et l’authenticité de ces documents et de leur contenu ni s’ils avaient mené leurs propres investigations sur les accusations qui y étaient portées contre le requérant.
39. La Cour rappelle qu’il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l’obligation ordinaire qui leur incombe de vérifier que les déclarations factuelles qu’ils publient à l’égard de particuliers ne sont pas diffamatoires (Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 55, Recueil 1997‑V, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, §§ 66 et 68, Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 65, CEDH 2002‑V, et Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 108, CEDH 2004‑XI). À cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le média peut raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des allégations qu’il entend publier (voir, entre autres, McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, § 84, CEDH 2002‑III, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 66, Pedersen et Baadsgaard, précité, § 78, Tønsbergs Blad A.S. et Haukom c. Norvège, no 510/04, § 89, 1er mars 2007).
40. La Cour tient à souligner sur ce point que le contenu des articles litigieux était particulièrement infamant pour le requérant, dont le nom complet et la photographie étaient même publiés en marge de certains d’entre eux. Les termes employés dans certains titres, tels que « Sağdıç, le conjuré modéré » ou encore « Le [plan] Cage paraphé par le pacha équilibreur », le mettaient directement en cause. Ainsi, ces articles, lus conjointement, affirmaient, avant même qu’une procédure pénale officielle n’ait été engagée contre lui, que le requérant appartenait à une organisation criminelle, qu’il faisait partie d’un groupe de militaires conjurés qui voulaient renverser le gouvernement et qu’il avait participé à la conception d’un plan d’action qui prévoyait de commettre dans ce but des attentats contre des non-musulmans (paragraphe 6 ci-dessus).
41. Pour rédiger ces articles, les journalistes se sont appuyés sur des documents dont l’authenticité n’avait pas encore été établie ni déclarée par les autorités, qui étaient couverts par le secret de l’instruction et qui imputaient au requérant des infractions graves, telles que la préparation d’attentats visant à renverser le gouvernement. Or la Cour estime que rien ne leur permettait de penser, dans la situation telle qu’elle se présentait à l’époque des faits, qu’ils pouvaient se fier à ces documents sans mener leurs propres investigations (voir, a contrario, Erla Hlynsdόttir c. Islande (no 3), no 54145/10, § 73, 2 juin 2015). Les organes de presse concernés ne pouvaient ignorer l’origine des pièces sur lesquelles les articles reposaient, ni le caractère confidentiel des informations qu’ils publiaient. Ils devaient savoir que la divulgation de ces informations se heurtait à la prohibition énoncée à l’article 285 du code pénal (paragraphe 15 ci-dessus), qui réprimait la violation du secret de l’instruction (Giesbert et autres c. France, nos 68974/11 et 2 autres, § 86, 1er juin 2017). Il y a lieu de rappeler que, malgré le rôle essentiel qui revient aux médias dans une société démocratique, les journalistes ne sauraient en principe être déliés, par la protection que leur offre l’article 10, de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun (Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 102, CEDH 2007‑V).
42. La Cour considère par conséquent que la manière dont le sujet a été traité dans les articles litigieux ne peut passer pour conforme aux normes d’un journalisme responsable (voir, notamment, Flux c. Moldova (no 6), no 22824/04, §§ 31‑34, 29 juillet 2008, et, a contrario, Welsh et Silva Canha c. Portugal, no 16812/11, 17 septembre 2013, Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, no 37840/10, § 35, 3 avril 2014, Delfi AS, précité, § 134, et De Carolis et France Télévisions c. France, no 29313/10, § 62, 21 janvier 2016).
43. Quant aux décisions adoptées par les juridictions nationales à cet égard, la Cour note que, pour motiver le rejet de la demande de réparation introduite par le requérant, le tribunal de grande instance a indiqué que les publications litigieuses étaient conformes à la réalité apparente, étant donné que leur contenu figurait dans l’acte d’accusation, qu’elles contribuaient à un débat d’intérêt public et qu’elles n’étaient pas outrancières, compte tenu, d’une part, de la gravité des allégations qu’elles renfermaient et, d’autre part, des fonctions exercées par le requérant (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour de cassation a confirmé cette décision sans motiver davantage sa conclusion (paragraphes 10‑11 ci-dessus). La Cour constitutionnelle, quant à elle, a rejeté le recours individuel du requérant, considérant que dans sa décision le tribunal de grande instance avait dûment mis en balance les intérêts divergents. Elle a observé notamment que les articles litigieux ne portaient pas sur le requérant en sa qualité de militaire, mais sur les événements qui étaient à l’origine de son arrestation et sur les poursuites pénales engagées contre lui. Elle a souligné qu’ils ne contenaient pas d’injures, qu’ils n’incitaient pas à la violence contre l’intéressé et qu’ils ne l’empêchaient pas d’exercer ses fonctions (paragraphe 13 ci-dessus).
44. La Cour constate que dans la présente affaire les juridictions nationales ne peuvent être considérées comme ayant dûment mis en balance le droit du requérant au respect de sa vie privée d’un côté et la liberté de la presse de l’autre, conformément aux critères pertinents rappelés ci-dessus (paragraphe 30 ci-dessus). Elle est d’avis que, eu égard au contenu des articles litigieux, qui n’était pas conforme aux normes d’un journalisme responsable (paragraphes 39‑44 ci-dessus), les juridictions internes auraient dû faire preuve d’une plus grande rigueur lorsqu’elles ont soupesé ces différents intérêts. Or, en l’espèce, ni le jugement du tribunal de grande instance, confirmé ensuite par la Cour de cassation, ni l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle sur le recours individuel introduit par le requérant ne semblent avoir suffisamment pris en compte le sérieux de l’atteinte que portait au droit du requérant à la protection de sa réputation la publication d’allégations qui étaient couvertes par le secret de l’instruction à l’époque des faits, qui lui imputaient des faits d’une particulière gravité, et qui comportaient ainsi le risque de le livrer à la vindicte publique (Mater, précité, § 55).
45. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que, en l’espèce, les juridictions nationales ont manqué à protéger le droit du requérant au respect de sa vie privée contre les atteintes portées par les articles de presse litigieux.
46. Partant, elle juge qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
Marina c. Roumanie du 26 mai 2020 requête n° 50469/14
Violation de l’article de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme
L’affaire concerne la lecture, lors d’une émission de radio, d’une lettre contenant des informations sur la vie privée et familiale de M. Marina commissaire de police et de son ex-épouse, à l’insu de ces derniers et à l’initiative de la sœur du requérant qui reproche un détournement d'héritage. Après l’émission, la station de radio dut publier un désaveu, réalisant que les informations diffusées sur M. Marina étaient fausses. Cependant, l’action en responsabilité civile introduite par M. Marina contre la radio fut rejetée, le tribunal départemental estimant que « lorsque des questions d’intérêt public visant des personnes publiques étaient en jeu, celles-ci devaient faire preuve de plus de tolérance en raison de leur statut dans la société ». À l’époque des faits, M. Marina était un commissaire de police, inconnu du public. La Cour juge que le tribunal départemental n’a pas opéré une mise en balance circonstanciée entre les deux droits en cause : le droit de communiquer des idées et celui de voir protéger la réputation et les droits d’autrui. La Cour juge notamment que, dans la mise en balance des intérêts en jeu, le tribunal n’a pas tenu compte du contenu même des informations et de leur contribution à un débat sur une question d’intérêt général, ni de leur défaut de fondement dans la réalité. La Cour constate aussi que le tribunal départemental n’a pas expliqué en quoi le simple fait d’occuper une fonction de commissaire de police réduisait l’espérance de protection de la vie privée. La Cour déclare le grief de M. Marina portant sur l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et mettant en cause l’impartialité de deux juges du tribunal départemental manifestement mal fondé.
LE TEXTE REPROCHE EST :
"C’est une lettre qui probablement contient... tout le conflit intérieur de Madame A.M. ... donc il est d’abord question de C.D., avocate au tribunal, qui a couché avec tous les hommes et qui maintenant veut la dot pour le bâtard, et ensuite de la dédicace pour Monsieur Marina Viorel... qui n’a pas été capable d’aller aux cérémonies religieuses après le décès de son père et maintenant il veut de l’argent, la bête du diable.
Qui a couché avec tous les hommes et maintenant veut la dot pour le bâtard... elle organise des sessions de chiromancie et d’autres conneries du genre, c’est pourquoi... hé, est-ce qu’il y a quelque chose d’autre dans l’enveloppe ? ... c’est pourquoi..."
Art 8 • Obligations positives • Vie privée • Réputation • Lecture lors d’une émission radio satirique, d’une lettre offensant le requérant, écrite par sa sœur, et dévoilant ses problèmes familiaux • Absence de contribution à un débat d’intérêt général • Absence de tri des informations contenues dans la lettre • Protagonistes désignés par leur nom sans leur consentement • Lecture du qualificatif injurieux contre le requérant • Aucune vérification préalable des informations s’étant révélées fausses • Diffusion durant trois jours par la radio d’un communiqué de désaveu ayant rendu sans objet l’exercice par le requérant de son droit de réplique • Absence de motivation circonstanciée et de mise en balance des intérêts en présence par les juridictions nationales
LES FAITS
Le requérant, Viorel Marina, est un ressortissant roumain né en 1968. Il réside à Ploieşti (Roumanie). À l’époque des faits, il était commissaire au sein de la police départementale de Prahova. En juin 2011, deux commentateurs d’une station de radio lurent en direct une lettre adressée à leur rédaction par la sœur de M. Marina. Le même jour, M. Marina et son ex-épouse se rendirent au siège de la radio et se plaignirent d’une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, indiquant que des allégations diffamatoires avaient été proférées à leur encontre sans leur consentement et en l’absence de vérification. Constatant que l’expéditrice de la lettre avait exposé des affabulations, la radio diffusa un désaveu pendant quatre jours. Elle invita également M. Marina à exercer son droit de réplique, ce qu’il ne fit pas.
En août 2011, l’ex-épouse de M. Marina saisit les juridictions internes d’une action en responsabilité civile contre la chaîne de radio, lui réclamant un dédommagement pour le préjudice causé à sa réputation. Elle obtint gain de cause et la radio fut condamnée à réparer son préjudice moral. En aout 2012, M. Marina engagea à son tour une action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la station de radio. L’année suivante, le tribunal fit droit à sa demande et condamna la partie adverse à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que l’émission litigieuse avait porté préjudice à l’image et à la vie privée de M. Marina, qui, en raison de sa profession de commissaire de police, se devait d’assurer une image irréprochable. Cette somme lui fut versée en trois échéances. Entretemps, la chaîne de radio fit appel de ce jugement devant le tribunal départemental Prahova et obtint gain de cause. L’action de M. Marina fut donc rejetée. Le tribunal département estima que l’intéressé n’avait pas subi de préjudice, relevant notamment que les animateurs s’étaient bornés à lire la lettre d’une tierce personne et que la radio n’avait pas commis d’acte illicite, leur intervention visant la « stigmatisation des aspects négatifs de la réalité sociale ». Il précisa également que lorsque des questions d’intérêt public visant des personnes publiques étaient en jeu, celles-ci devaient faire preuve de plus de tolérance en raison de leur statut dans la société. Il observa enfin que M. Marina n’avait pas fait usage de son droit de réplique. Cet arrêt fut rendu par une formation de juges dont deux avaient siégé dans le cadre de l’action en responsabilité civile engagée par l’ex-épouse de M. Marina. La demande de déport formulée par ces deux juges avait été rejetée par le tribunal départemental au début de la procédure. En février 2015, le tribunal de première instance de Ploieşti ordonna la restitution de la somme versée par la station de radio à M. Marina. Une procédure d’exécution forcée fut engagée à son encontre.
Article 6 § 1 (droit à un tribunal indépendant et impartial)
En ce qui concerne le manque allégué d’impartialité de deux des juges du tribunal départemental, la Cour constate que M. Marina et son ex-épouse ont chacun allégué devant les juridictions nationales des atteintes à leurs droits à la réputation et à la vie privée, aspects essentiellement personnels qui devaient être établis et appréciés par les tribunaux en fonction de la situation personnelle des deux intéressés et des affirmations diffusées à la radio à leur propos. Les deux procédures portaient sur des éléments différents : dans chacune d’entre elles, le tribunal départemental devait rechercher si les éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle étaient réunis, en partant de la situation personnelle concrète de chacun des demandeurs. Cette appréciation a été faite sur la base des éléments produits et débattus à l’audience et notamment de la manière où les affirmations de la sœur de M. Marina ont affecté la position individuelle respective de M. Marina, d’un côté, et de son ex-épouse, de l’autre. Les deux actions n’étaient en outre pas étayées par les mêmes éléments de preuve et le tribunal départemental a apprécié le bien-fondé de l’action de M. Marina au regard des allégations concernant l’atteinte à sa vie privée et des éléments de preuve qu’il avait fournis. Enfin, M. Marina n’a, à aucun moment de la procédure, formulé de demande de récusation des deux juges afin d’exprimer ses propres craintes quant à leur impartialité. Par conséquent, la Cour estime que les appréhensions de M. Marina ne se trouvent pas objectivement justifiées. Par ailleurs, la Cour ne relève pas d’éléments établissant que les deux juges aient montré un préjugé personnel en l’espèce. Ce grief est donc manifestement mal fondé (article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention) et est rejeté.
Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
En ce qui concerne le contenu de la lettre litigieuse, la Cour observe que celle-ci comportait des informations sur la vie privée de l’ex-épouse de M. Marina, et elle faisait part du refus de M. Marina de participer aux cérémonies religieuses qui avaient eu lieu après le décès de son père et d’une revendication financière adressée à la famille. Elle contenait aussi des qualificatifs injurieux visant M. Marina. En ce qui concerne l’arrêt rendu par le tribunal département, la Cour relève que le tribunal départemental a rattaché le sujet traité au cours de l’émission à une question d’intérêt général, à savoir la stigmatisation des aspects négatifs de la réalité sociale. Or, le texte rendu public se concentrait sur la vie familiale de M. Marina et révélait des aspects de sa vie privée qui ne peuvent être considérés comme ayant contribué à un « débat d’intérêt général » pour la collectivité.
Par ailleurs, se référant à la jurisprudence de la Cour, le tribunal départemental a énoncé de façon générale, en se référant à la fonction publique exercée par M. Marina, que, « lorsque des questions d’intérêt public visant des personnes publiques étaient en jeu, celles-ci devaient faire preuve de plus de tolérance étant donné leur statut au sein de la société ». Or, le tribunal aurait donc dû expliciter les raisons pour lesquelles le simple fait d’occuper la fonction de commissaire de police réduisait l’espérance de protection de la vie privée de M. Marina, lequel n’était pas connu du public. En outre, le tribunal départemental ne s’est pas prononcé sur le comportement antérieur de M. Marina vis-à-vis des médias, dont rien ne prouve qu’il ait auparavant manifesté une tolérance ou une complaisance éventuelle sur la publication d’aspects concernant sa vie privée ; sa réaction immédiate face aux propos rendus publics semble par ailleurs constituer un indice du contraire.
De plus, bien qu’il s’agissait d’une une émission de radio satirique, le tribunal aurait dû procéder à un examen nuancé du contenu des messages rendus publics afin de déterminer dans quelle mesure les informations révélées sur la vie privée de M. Marina et les termes utilisés contribuaient effectivement à un débat d’intérêt général. La Cour note à cet égard que les informations dévoilées, étaient offensantes et pouvaient entraîner des répercussions sur l’image et la réputation de M. Marina. Enfin, les animateurs de l’émission ont lu cette lettre sans procéder à aucune vérification préalable des informations qui y étaient mentionnées. Or, il s’est avéré, après vérifications, que celles-ci ne correspondaient pas à la réalité.
Par conséquent, la Cour estime que le tribunal départemental n’a pas opéré une mise en balance circonstanciée entre le droit de communiquer des idées et celui de voir protéger la réputation et les droits d’autrui. Elle précise aussi qu’un examen trop général a mené en l’occurrence le tribunal départemental à ne pas tenir compte de certains aspects de l’affaire, ce qui l’a conduit à considérer qu’il était en présence d’un débat d’intérêt général et que M. Marina faisait partie d’une catégorie de personnes qui pouvaient voir leur espérance de protection de la vie privée être restreinte.
Par ailleurs, le contenu même des informations, leur contribution à un débat sur une question d’intérêt général et leur défaut de fondement dans la réalité n’ont pas été pris en compte dans la mise en balance des intérêts en jeu. La Cour conclut donc que le tribunal départemental a manqué à ses obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention et qu’il y a violation de cette disposition.
CEDH
FAITS
LE TEXTE REPROCHE EST :
"C’est une lettre qui probablement contient... tout le conflit intérieur de Madame A.M. ... donc il est d’abord question de C.D., avocate au tribunal, qui a couché avec tous les hommes et qui maintenant veut la dot pour le bâtard, et ensuite de la dédicace pour Monsieur Marina Viorel... qui n’a pas été capable d’aller aux cérémonies religieuses après le décès de son père et maintenant il veut de l’argent, la bête du diable.
Qui a couché avec tous les hommes et maintenant veut la dot pour le bâtard... elle organise des sessions de chiromancie et d’autres conneries du genre, c’est pourquoi... hé, est-ce qu’il y a quelque chose d’autre dans l’enveloppe ? ... c’est pourquoi..."
6. Le même jour, le requérant et C.D. se rendirent au siège de la radio, où ils rencontrèrent le responsable de celle-ci et eurent une discussion avec lui. Au cours de cet échange, ils se plaignirent que la lecture de la lettre de A.M. lors de l’émission de radio avait porté atteinte à leur vie privée. Ils indiquèrent que des allégations diffamatoires avaient ainsi été proférées contre eux en l’absence de vérifications préalables et en l’absence de leur consentement pour la diffusion d’informations relevant de leur vie privée.
7. Après avoir procédé à des vérifications et établi que l’expéditrice de la lettre y exposait des affabulations auxquelles elle se livrait depuis des années à l’égard du requérant, la chaîne de radio désavoua (dezminți) les propos transmis en direct. Par ce désaveu, la radio exprima son regret que le sens de la lecture de la lettre – qui était censée être un pamphlet dirigé contre l’expéditrice – eût été mal perçu par certains auditeurs et que cela eût porté atteinte à l’image du requérant et de C.D.
8. La chaîne de radio diffusa ce message de désaveu trois fois le 3 juin 2011, deux fois le 4 juin 2011, une fois le 5 juin 2011 et deux fois le 6 juin 2011.
9. Le requérant fut invité par la chaîne de radio à exercer un « droit de réplique » (paragraphe 31 ci-dessous), prévu par la réglementation interne, le 6 juin 2011, dans le cadre d’une autre émission de radio, droit que l’intéressé n’exerça pas.
10. Après l’évènement décrit ci-dessus, le requérant et C.D. se séparèrent et l’intéressé fut amené à quitter le domicile commun.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. Le requérant dénonce un manque d’impartialité du tribunal départemental de Prahova, au motif que la formation de jugement à l’origine de l’arrêt du 14 mai 2014 comprenait deux juges ayant eu à connaître de l’action formée par son ex-épouse au sujet de la même émission de radio et ayant vu leur demande de déport être rejetée. À ses dires, le fait que le tribunal départemental a écarté la déclaration du témoin proposé par lui pour prouver son préjudice constitue un exemple de parti pris dans l’affaire. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Arguments des parties
33. Le Gouvernement considère que l’affaire du requérant a été jugée par un tribunal impartial. À cet égard, il expose que les deux procédures successives examinées par les magistrates mises en cause portaient sur des objets et des personnes différents. Il indique ensuite que le requérant, représenté par un avocat, n’a pas soulevé d’exception d’incompatibilité relative aux juges devant les juridictions nationales (paragraphe 18 ci‑dessus).
34. Enfin, il soutient que le tribunal départemental s’est livré à un examen détaillé de l’affaire sur la base des éléments de preuve versés au dossier par le requérant et sans prise en compte des aspects mentionnés par C.D. ou des éléments de preuve utilisés par celle-ci dans la procédure la concernant. Le Gouvernement estime que le fait pour le tribunal départemental de ne pas avoir fondé son arrêt sur la déclaration du témoin proposé par le requérant ne constitue pas une preuve de partialité, et ce d’autant moins que le témoignage en question aurait été écarté de manière motivée.
35. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce grief. Toutefois, il a demandé à la Cour de faire droit à sa demande « pour les raisons exposées dans sa requête ».
Appréciation de la Cour
Principes généraux
36. La Cour renvoie aux principes déjà bien établis en matière de critères pour apprécier l’impartialité d’un tribunal, tels que définis dans l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal ([GC], nos 55391/13 et 2 autres, §§ 145-149, 6 novembre 2018). Plus particulièrement, la Cour rappelle que l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris et peut s’apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c’est‑à‑dire en recherchant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans le cas d’espèce, ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, par exemple, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 118, CEDH 2005-XIII, et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 93, CEDH 2009).
37. La Cour rappelle que, quant à la démarche subjective, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (voir, par exemple, Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 26, série A no 257‑B). Quant à la démarche objective, celle-ci conduit à se demander, lorsqu’une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l’attitude personnelle de tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de craindre d’une juridiction un défaut d’impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (Morel c. France, no 34130/96, § 42, CEDH 2000‑VI).
38. La Cour précise que, en « matière civile », le simple fait, pour un juge, d’avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte, c’est l’étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n’implique pas un préjugé qui empêcherait de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin, l’appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer comme préjugeant l’appréciation finale. Il importe que cette appréciation intervienne avec le jugement et s’appuie sur les éléments produits et débattus à l’audience (Sacilor‑Lormines c. France, no 65411/01, § 61, CEDH 2006‑XIII).
Application des principes au cas d’espèce
39. En l’espèce, la Cour prend note de la position du requérant, qui allègue que son recours n’a pas été jugé par un tribunal impartial car, selon lui, deux des juges de la formation de jugement s’étaient déjà prononcées sur l’affaire dès lors qu’elles avaient eu à connaître de l’action en responsabilité civile délictuelle intentée par son ex-épouse.
40. En ce qui concerne la démarche subjective, et compte tenu des arguments du requérant, la Cour n’est pas persuadée de l’existence d’éléments établissant que les deux juges aient montré un préjugé personnel.
41. Pour ce qui est de la démarche objective, la Cour note qu’en l’occurrence les craintes quant à un défaut d’impartialité tiennent au fait que deux des juges faisant partie de la formation de jugement amenée à statuer sur le recours du requérant s’étaient auparavant prononcées dans le cadre de l’action en responsabilité civile délictuelle engagée par l’ex-épouse de l’intéressé contre la même station de radio pour les faits survenus le 3 juin 2011. Il lui appartient dès lors de déterminer si les doutes que cette situation a pu créer chez le requérant se révèlent objectivement justifiés.
42. À cet égard, la Cour note d’emblée que les juges dont l’impartialité est mise en cause par le requérant ont tranché l’affaire à laquelle l’ex-épouse de l’intéressé était partie en faveur de cette dernière, condamnant notamment la station de radio à réparer le préjudice moral causé à la partie demanderesse à la suite de la diffusion de l’émission du 3 juin 2011 (paragraphe 12 ci-dessus). Compte tenu de l’issue de cette première affaire, la Cour doute que le requérant puisse légitimement craindre, de la part de ces mêmes juges, un parti pris en sa défaveur.
43. En tout état de cause, la Cour rappelle que la réponse à la question concernant l’impartialité objective varie suivant les circonstances de la cause (Morel, précité, § 45). Plus particulièrement, elle doit vérifier si, compte tenu de la nature et de l’étendue des fonctions des deux juges susmentionnées dans la procédure en responsabilité civile engagée par l’ex‑épouse du requérant contre la station de radio, ces dernières ont fait preuve d’un parti pris quant à la décision à rendre par le tribunal départemental dans l’affaire concernant l’intéressé. Tel serait le cas si les questions traitées par les deux juges dans la première procédure avaient été « les mêmes » (voir, a contrario, Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98 et 3 autres, § 200, CEDH 2003‑VI) ou « analogues » (Morel, précité, § 47) par rapport à celles tranchées par elles dans le cadre de l’action du requérant.
44. Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que cela a été le cas. En effet, selon le droit interne applicable en la matière (paragraphe 28 ci‑dessus), le tribunal saisi d’une action en responsabilité civile délictuelle devait rechercher s’il y avait une faute civile, un dommage et un lien de causalité entre ces deux éléments. L’existence d’une responsabilité civile dans une situation donnée devait être établie à la lumière du dommage allégué par celui qui s’estimait lésé par le fait à l’origine du dommage. En l’occurrence, devant les juridictions nationales saisies de leurs actions respectives, tant le requérant que son ex‑épouse ont allégué des atteintes à leur droit à la réputation et à leur droit à la vie privée (paragraphes 12 et 14 ci-dessus), aspects essentiellement personnels qui devaient être établis et appréciés par les tribunaux à la lumière de la situation de chacune des parties lésées et des affirmations les concernant contenues dans la lettre de la sœur du requérant lue au cours de l’émission de radio.
45. Sans nier l’existence d’un élément commun entre les deux procédures à raison des faits à l’origine des deux litiges, la Cour considère que ces procédures portaient sur des éléments différents : dans chacune d’elles, le tribunal départemental devait rechercher si les éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle étaient réunis, en partant de la situation personnelle concrète de chacun des demandeurs. Cette appréciation a été faite sur la base des éléments produits et débattus à l’audience et notamment de la manière où les affirmations de Mme A.M. ont affecté la position individuelle respective du requérant, d’un côté, et de son ex-épouse, de l’autre.
46. En outre, il ne ressort pas du dossier que les deux actions portées devant le tribunal départemental étaient étayées par les mêmes éléments de preuve. Le requérant était en droit de présenter les éléments de preuve qu’il estimait pertinents pour prouver son préjudice. Le simple fait que, dans le cadre de l’action concernant le requérant, le tribunal départemental ait décidé que la déposition du témoin proposé par l’intéressé ne suffisait pas à prouver le préjudice allégué ne constitue pas une preuve de parti pris, et ce d’autant moins qu’une justification objective a été fournie par les juges pour écarter ledit témoignage (paragraphe 23 ci-dessus).
47. La Cour relève donc que les deux juges susmentionnées ont été confrontées à deux affaires bien distinctes. Si, du fait de leur rôle dans la procédure intentée par l’ex-épouse du requérant, ces juges avaient eu connaissance des faits à l’origine du litige, elles ne pouvaient pour autant pas avoir déjà adopté un point de vue sur l’action engagée par le requérant, dont le tribunal départemental a apprécié le bien-fondé au regard des allégations concernant l’atteinte à la vie privée de l’intéressé et des éléments de preuve fournis par ce dernier.
48. La Cour note enfin que, dans leur demande d’abstention dans la procédure, les deux juges ont seulement indiqué de manière générale qu’elles avaient examiné l’affaire concernant l’ex-épouse du requérant (paragraphe 18 ci-dessus). N’ayant indiqué aucune raison spécifique pour justifier leur déport, la Cour déduit que les deux juges avaient plutôt fait leur demande par souci de précaution (voir, en ce sens, Ilie c. Roumanie, (déc.) [Comité], no 26220/10, § 44, 3 septembre 2019, et Gogan c. Roumanie, (déc.) [Comité], no 41059/11, § 38, 1er octobre 2019). En outre, elle observe que la demande de déport a été examinée par une formation de trois juges, qui, après avoir comparé les objets des deux affaires, a rendu une décision motivée en expliquant que les deux affaires portaient sur des questions différentes et que les deux juges ne s’étaient pas prononcées sur l’affaire concernant le requérant (paragraphe 19 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour remarque qu’à aucun moment de la procédure le requérant n’a formulé de demande de récusation des deux juges afin d’exprimer ses propres craintes quant à leur impartialité (paragraphe 18 ci‑dessus).
49. Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que les appréhensions du requérant ne se trouvent pas, en l’espèce, objectivement justifiées, et qu’aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait être décelée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
a) Principes généraux
61. La Cour rappelle que, dans les affaires du type de celle à l’examen, se trouve en cause non pas un acte de l’État, mais l’insuffisance alléguée de la protection accordée par les juridictions internes à la vie privée des requérants. Or, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 98, CEDH 2012). La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au regard de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu (ibid., § 99).
62. Lorsque le grief présenté à la Cour a trait à une méconnaissance des droits protégés par l’article 8 de la Convention du fait de l’exercice par d’autres de leur droit à la liberté d’expression, il convient de tenir dûment compte, lors de l’application de l’article 8, des exigences de l’article 10 de la Convention (voir, par exemple et mutatis mutandis, Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 58, CEDH 2004‑VI). Ainsi, dans de tels cas, la Cour devra mettre en balance le droit du requérant au respect de sa vie privée et l’intérêt général à protéger la liberté d’expression, en gardant à l’esprit qu’il n’existe aucune relation hiérarchique entre les droits garantis par les deux articles (Sousa Goucha c. Portugal, no 70434/12, § 42, 22 mars 2016).
63. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a déjà eu l’occasion d’énoncer les principes pertinents qui doivent guider son appréciation dans ce domaine (Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, §§ 90-93, CEDH 2015 (extraits), et Von Hannover (no 2), précité, §§ 95-99). Elle a ainsi posé un certain nombre de critères dans le contexte de la mise en balance des droits en présence (Axel Springer AG, précité, §§ 90-95). Les critères définis applicables en la matière – pour autant qu’ils sont pertinents en l’espèce – sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication (voir, en ce sens, Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93, et Von Hannover (no 2), précité, §§ 109‑113). Ces critères, qui ne sont pas exhaustifs, doivent être transposés et adaptés aux circonstances de la cause (Axel Springer SE et RTL Television GmbH c. Allemagne, no 51405/12, § 42, 21 septembre 2017).
64. Dans ce contexte, la Cour rappelle que, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. À sa fonction qui consiste à diffuser des informations et des idées sur de telles questions s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (Axel Springer AG, précité, § 79).
65. La Cour a également souligné que la contribution de la presse à un débat d’intérêt général ne saurait être limitée aux seuls faits d’actualité ou débats préexistants. La presse est certes un vecteur de diffusion des débats d’intérêt général, mais elle a également pour rôle de révéler et de porter à la connaissance du public des informations susceptibles de susciter l’intérêt et de faire naître un tel débat au sein de la société (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 114). Certains évènements de la vie privée et familiale doivent toutefois conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution lors de leur traitement (voir, en ce sens, Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 140).
66. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention (Axel Springer AG, précité, § 86). Si la mise en balance, par les autorités nationales, des droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (ibid., §§ 87-88).
b) Applications des principes au cas d’espèce
67. La Cour observe que les allégations litigieuses, qui étaient contenues dans la lettre adressée par la sœur du requérant à une station de radio, avaient été formulées au cours d’une émission de radio lors de la lecture de ce document par les animateurs de ce programme. Cette lettre, qui comportait d’abord des informations sur la vie privée de l’ex-épouse et compagne du requérant (paragraphe 3 ci-dessus), faisait part du refus de ce dernier de participer aux cérémonies religieuses qui avaient eu lieu après le décès de son père et d’une revendication financière adressée à la famille. Elle contenait également des qualificatifs injurieux visant le requérant (paragraphe 5 ci-dessus).
68. À cet égard, la Cour estime utile de souligner, à titre liminaire, que son rôle en l’espèce consiste avant tout à vérifier que le tribunal départemental, dont le requérant conteste la décision (paragraphes 20 à 23 ci‑dessus), a procédé à une juste pondération des droits en cause en statuant à l’aune des critères qu’elle a définis pour ce faire, rappelés au paragraphe 63 ci‑dessus.
Sur la question de la contribution à un débat d’intérêt général
69. La Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression lorsqu’est en cause une question d’intérêt général (voir, entre autres, Wingrove c. Royaume‑Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). La marge d’appréciation des États est en effet réduite en matière de débat touchant à l’intérêt général (Editions Plon c. France, no 58148/00, § 44, CEDH 2004‑IV). Pour vérifier qu’une émission constitue une information d’importance générale, il faut en apprécier la totalité et rechercher si cette émission, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général (voir, mutatis mutandis et concernant une publication portant sur la vie privée d’autrui, Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 102).
70. À cet égard, la Cour précise qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 103 avec les références qui y sont citées). L’intérêt public ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme (Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 162, 8 novembre 2016).
71. Dans les circonstances de la présente affaire, il est donc essentiel de déterminer si l’émission dans son ensemble et le message qu’elle essayait de transmettre, y compris par la lecture de la lettre en cause, peuvent s’entendre comme constitutifs d’une information de nature à contribuer à un débat d’intérêt général.
72. En l’occurrence, la Cour note que le tribunal départemental a considéré que l’émission de radio litigieuse visait à « la stigmatisation des aspects négatifs de la réalité sociale » et que la lecture de la lettre de la sœur du requérant avait comme objectif de critiquer la démarche de cette dernière, dont le but était de dénigrer publiquement les membres de sa famille (paragraphe 21 ci-dessus).
73. La Cour ne remet pas en question le fait – relevé par le tribunal départemental – que, par la lecture de la lettre en cause, l’émission s’était proposé comme but d’attirer l’attention du public sur la circonstance que des relations tendues existant au sein d’une famille pouvaient pousser certains de ses membres à rendre publics, via les chaînes de radio, des aspects liés à la vie privée d’autres membres de leur famille. Pour autant, la Cour note que rien ne prouve que l’aspect évoqué s’inscrivait dans un débat général qui avait lieu au moins au niveau des auditeurs de la station de radio concernée. Bien qu’il puisse être concevable que certains auditeurs veuillent savoir que des personnes peuvent faire appel à la radio pour rendre publics, par vengeance, des aspects de leur vie familiale ou privée, il n’en reste pas moins que la question touche de très près la manifestation des relations entre les membres d’une famille, ce qui relève de la sphère de leur vie privée. Le fait que la sœur du requérant a choisi de rendre publiques des relations de famille par la voie de la radio ne transforme pas sa démarche en une question « d’intérêt général ».
74. La Cour note en outre que, pour illustrer leur sujet, les animateurs de l’émission de radio ont donné lecture de la lettre en relevant des informations de nature intime concernant l’ex-épouse du requérant, laquelle était toujours en couple avec ce dernier à l’époque des faits, et des aspects de la vie privée de l’intéressé (paragraphe 5 ci-dessus). Il y a ici lieu de rappeler que, dans la jurisprudence de la Cour, les éventuels problèmes conjugaux d’un président de la République ou les difficultés financières d’un chanteur célèbre n’ont pas été considérés comme relevant d’un débat d’intérêt général (Standard Verlags GmbH c. Autriche (no 2), no 21277/05, § 52, 4 juin 2009, et Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. France, no 12268/03, § 43, 23 juillet 2009). La Cour note également que des qualificatifs injurieux formulés à l’adresse du requérant – tels que « bête du diable » – ont été lus à l’antenne sans aucune retenue. Or, par leur nature même, ces informations ne contribuaient pas à un « débat d’intérêt général » et n’aidaient pas la presse à remplir son rôle de « chien de garde ».
75. La Cour considère donc que, bien que le tribunal départemental ait rattaché le sujet traité au cours de l’émission à une question qu’il a jugée comme étant d’intérêt général – à savoir « la stigmatisation des aspects négatifs de la réalité sociale » –, le texte rendu public se concentrait sur la vie familiale du requérant et révélait des aspects de sa vie privée qui, dans le contexte de la présente affaire, ne peuvent être considérés comme ayant contribué à un « débat d’intérêt général » pour la collectivité, au sens donné par sa jurisprudence.
Sur la notoriété de la personne visée et l’objet de l’émission
76. La Cour constate, à l’instar des juridictions nationales (paragraphes 15 et 21 ci-dessus), que le requérant occupait la fonction de commissaire de police. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé était une personne connue du public ou renommée au moins au niveau départemental.
77. En l’espèce, la Cour note que le tribunal départemental a seulement énoncé de façon générale, en se référant à la fonction publique exercée par l’intéressé, à savoir celle de commissaire de police, que, « eu égard à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, lorsque des questions d’intérêt public visant des personnes publiques étaient en jeu, celles-ci devaient faire preuve de plus de tolérance étant donné leur statut au sein de la société » (paragraphe 21 ci-dessus). Elle estime que, bien qu’il ait fait mention du critère retenu dans sa jurisprudence concernant le niveau de protection accordée aux personnes publiques, le tribunal départemental aurait dû expliciter dans son arrêt les raisons pour lesquelles le simple fait d’occuper la fonction de commissaire de police réduisait l’espérance de protection de la vie privée du requérant.
Sur le comportement antérieur de la personne concernée
78. La Cour note aussi que le tribunal départemental ne s’est pas prononcé sur le comportement antérieur du requérant vis-à-vis des médias. Aux yeux de la Cour, rien ne prouve que l’intéressé avait auparavant manifesté une tolérance ou une complaisance éventuelle sur la publication d’aspects concernant sa vie privée ; sa réaction immédiate face aux propos rendus publics (paragraphe 6 ci-dessus) semble par ailleurs constituer un indice du contraire.
Sur le contenu, la forme et les répercussions de l’émission
79. La Cour rappelle que, dans leur pratique quotidienne, les journalistes prennent des décisions par lesquelles ils choisissent la ligne de partage entre le droit du public à l’information et le droit d’autrui au respect de sa vie privée. Ils ont ainsi la responsabilité première de préserver les personnes, y compris les personnes publiques, de toute intrusion dans leur vie privée. Les choix qu’ils opèrent à cet égard doivent être fondés sur les règles d’éthique et de déontologie de leur profession (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 138). Toutefois, si les journalistes sont libres de choisir, parmi les informations qui leur parviennent, celles qu’ils traiteront et la manière dont ils le feront, cette liberté n’est pas exempte de responsabilités (ibid., § 139 in fine).
80. Comme déjà indiqué ci-dessus, la Cour accorde de l’importance au fait que les informations révélées en l’espèce étaient de nature privée (paragraphe 74 ci‑dessus). Or, bien que les éléments révélés au public relevaient de la sphère de la vie privée de l’intéressé, les animateurs de l’émission n’ont pas pris de mesures pour protéger ce dernier. Ainsi, la Cour constate que les présentateurs de l’émission n’ont aucunement trié les informations contenues dans la lettre : ils ont lu le contenu de celle-ci, y compris les termes injurieux adressés au requérant.
81. La Cour remarque également que les animateurs de radio ont nommément désigné les différents protagonistes, à savoir le requérant, son ex‑épouse et sa sœur, au cours de l’émission, sans cependant solliciter leur consentement, pourtant exigé par les règles de déontologie nationales (paragraphes 11 et 30 ci-dessus). Or, compte tenu des propos tenus à l’égard du requérant et de son ex-épouse et compagne, et surtout des mots injurieux employés dans la lettre à l’endroit de l’intéressé, les animateurs de radio devaient bien se douter que les expressions utilisées étaient de nature à porter atteinte à la réputation de ceux concernés lorsque leurs noms allaient être dévoilés.
82. La Cour note ensuite que le tribunal départemental a considéré que la lecture de la lettre constituait un pamphlet (paragraphe 21 ci-dessus). À cet égard, elle rappelle que la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il convient d’examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste ou de toute autre personne – tels des animateurs de radio, comme en l’espèce – à s’exprimer par ce biais (Alves da Silva c. Portugal, no 41665/07, § 27, 20 octobre 2009). Dans l’affaire Sousa Goucha (précitée, § 50), la Cour s’est référée au critère du « lecteur raisonnable » pour aborder des questions concernant des formes d’expression satirique et a reconnu que la parodie bénéficiait d’une marge d’appréciation particulièrement large dans le contexte de la liberté d’expression.
83. En l’occurrence, la Cour ne remet pas en question le constat des juridictions nationales quant au caractère satirique de l’émission de radio litigieuse. Elle note toutefois que le communiqué de désaveu publié les jours suivant l’émission a exprimé le regret que le sens de la lecture de la lettre – qui était censée être un pamphlet dirigé contre l’expéditrice – eût été mal perçu par certains auditeurs et que cela eût porté atteinte à l’image du requérant et de C.D. (paragraphe 7 ci‑dessus). Au demeurant, la Cour estime que les animateurs de l’émission auraient pu faire passer leur message sans procéder à la lecture du qualificatif injurieux « bête du diable » employé contre le requérant, qui, de toute évidence n’apportait aucune plus-value au sujet débattu et avait été vraisemblablement gardé pour capter l’attention des auditeurs (voir, par exemple et mutatis mutandis, Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 67, CEDH 2001‑I, et Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 74, CEDH 2000-VIII).
84. La Cour tient à rappeler qu’il appartenait aux instances nationales de procéder à une appréciation du contenu de l’émission litigieuse de manière à opérer une mise en balance des intérêts en cause. Toutefois, pour elle, même si l’émission en cause était une émission satirique, un examen nuancé du contenu des messages rendus publics était nécessaire afin de déterminer dans quelle mesure les informations révélées sur la vie privée du requérant et les termes utilisés contribuaient effectivement au débat que le tribunal considérait comme d’intérêt général. Cela étant, la Cour estime que les informations dévoilées étaient en elles-mêmes offensantes et pouvaient entraîner des répercussions sur l’image et la réputation du requérant.
Sur le mode d’obtention des informations et leur véracité
85. La Cour souligne tout d’abord l’importance que revêt à ses yeux le respect par les journalistes de leurs devoirs et de leurs responsabilités ainsi que des principes déontologiques qui encadrent leur profession. À cet égard, elle rappelle que l’article 10 de la Convention protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général dès lors qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts, et qu’ils fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999‑I).
86. En l’espèce, la Cour note qu’en poursuivant le but de mettre en évidence le comportement de la sœur du requérant, qui avait expédié la lettre litigieuse à la station de radio, les animateurs de l’émission ont donné lecture de cette lettre, qui contenait des références à la vie privée de l’intéressé, sans procéder à aucune vérification préalable des informations qui y étaient mentionnées. Or il s’est avéré, après vérifications, que celles-ci ne correspondaient pas à la réalité (paragraphe 7 ci-dessus).
87. La Cour relève enfin que les constats faits après les vérifications du contenu de la lettre ont déterminé la station de radio à diffuser un message de désaveu (paragraphe 7 ci-dessus). D’ailleurs, de l’avis de la Cour, il est compréhensible que la publication de ce communiqué pendant trois jours ait effectivement pu rendre sans objet l’exercice par le requérant de son droit de réplique (paragraphes 8, 9 et 29 ci-dessus).
c) Conclusion
88. S’agissant de la manière dont les autorités nationales ont traité l’affaire, la Cour note que les tribunaux roumains ont parfaitement admis que le différend qui leur était soumis portait sur un conflit entre le droit de communiquer des idées et celui de voir protéger la réputation et les droits d’autrui. Toutefois, elle estime que le tribunal départemental n’a pas opéré une mise en balance circonstanciée. Pour la Cour, un examen trop général a mené en l’occurrence le tribunal départemental à ne pas tenir compte de certains aspects de l’affaire, ce qui l’a conduit à considérer qu’il était en présence d’un débat d’intérêt général et que le requérant faisait partie d’une catégorie de personnes qui pouvaient voir leur espérance de protection de la vie privée être restreinte. Qui plus est, le contenu même des informations, leur contribution à un débat sur une question d’intérêt général et leur défaut de fondement dans la réalité n’ont pas été pris en compte dans la mise en balance des intérêts en jeu.
89. Dans ces conditions, et nonobstant la marge d’appréciation dont les juridictions nationales jouissent en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents (voir notamment la jurisprudence citée au paragraphe 66 ci-dessus), la Cour conclut que le tribunal départemental a manqué à ses obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
H.K. c. TURQUIE du 7 janvier 2019 requête n° 23591/10
Violation article 8 pour un article de presse sur la mort d'un inconnu avec un exposé des faits non exacts.
25. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de la liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c. Turquie (no 63903/10, §§ 36-38, 21 novembre 2017).
26. En l’espèce, la Cour note que l’article de presse que la requérante dénonce présentait le frère de l’intéressée comme un travesti qui avait été retrouvé mort chez lui alors qu’il était en possession d’une importante somme d’argent. Elle note ensuite que le procès-verbal d’incident ne contenait aucune information relativement à la somme d’argent indiquée dans cet article. Ce procès-verbal mentionnait que la police avait retrouvé au domicile du défunt, entre autres, des perruques et des vêtements de femme, ainsi que des objets et vidéos à caractère pornographique (paragraphe 5 ci‑dessus). Il indiquait en outre que les divers objets pour femme retrouvés dans l’appartement du frère de la requérante étaient disposés comme dans une boutique (paragraphe 5 ci-dessus) – ce qui semble confirmer les dires de l’intéressée à cet égard (paragraphe 23 ci‑dessus).
27. La Cour note par ailleurs que les juridictions nationales ont rejeté l’action en dommages et intérêts intentée par la requérante, qui alléguait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée à raison de la publication de l’article litigieux. À cet égard, il convient de relever que, bien que le tribunal de grande instance ait donné gain de cause à la requérante à deux reprises, dans ses arrêts de cassation du 29 mars 2007 et du 6 mai 2009 la Cour de cassation a pour l’essentiel considéré, en se fondant sur les pièces du dossier de l’enquête pénale menée en l’espèce, que le contenu de l’article litigieux était conforme aux apparences à la date de sa publication (paragraphes 9 et 11 ci‑dessus).
28. La Cour ne peut que constater, en l’occurrence, que les juridictions nationales se sont contentées de vérifier la conformité du contenu de l’article litigieux aux apparences et qu’elles n’ont pas mis en balance le droit de la requérante au respect de sa vie privée et la liberté de la presse de façon adéquate, conformément aux critères établis dans sa jurisprudence (Tarman, précité, § 38). En effet, elle relève que les décisions des juridictions nationales n’apportent pas de réponse satisfaisante à la question de savoir si la liberté de la presse pouvait justifier, en l’espèce, l’atteinte portée au droit de la requérante à la protection de sa réputation par la forme et le contenu de l’article litigieux, lequel révélait l’identité et la photographie du frère de l’intéressée et présentait celui-ci comme un travesti possédant une importante somme d’argent alors que cette indication ne figurait pas dans le procès-verbal d’incident établi par la police (paragraphe 5 ci-dessus).
29. La Cour considère dès lors que, en l’espèce, les autorités nationales n’ont pas effectué une mise en balance adéquate, conformément aux critères établis par sa jurisprudence, entre le droit de la requérante à la protection de sa réputation et la liberté de la presse.
30. Ces éléments lui suffisent pour conclure que, dans les circonstances de l’espèce, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
Lewit c. Autriche du 10 octobre requête n° 4782/18
Article 8 : Les tribunaux autrichiens n’ont pas adéquatement pris en compte la plainte pour diffamation d’un survivant d’un camp de concentration.
Dans cette affaire, un survivant de l’holocauste, alors âgé de 96 ans, se plaignait d’avoir été diffamé par un périodique de droite et de ce que les juridictions internes n’aient pas protégé son droit à sa réputation. La Cour a jugé que les tribunaux autrichiens n’avaient pas protégé les droits du requérant parce qu’ils n’avaient pas examiné la question centrale dans ce procès : celle de savoir s’il avait été diffamé par un article qui avait employé les expressions « meurtriers en masse », «criminels» et « peste » pour qualifier les personnes qui, comme lui, avaient été libérées du camp de concentration de Mauthausen en 1945. Au lieu de cela, les tribunaux avaient conclu que M. Lewit n’avait pas qualité pour les saisir au motif que le nombre de personnes libérées était si important qu’il ne pouvait pas être personnellement touché par les propos tenus dans cet article où il n’était pas désigné nommément. Cependant, ils n’avaient pas retenu le fait que, à la date de l’article, le nombre de survivants était bien moindre. Les tribunaux avaient conclu en outre que l’article s’était contenté de répéter des déclarations faites auparavant sur le même sujet et que, dès lors, les propos n’avaient pas de portée diffamatoire distincte. La Cour a estimé que cette conclusion ne reposait sur aucun motif et que, en réalité, le contexte et la finalité des deux articles étaient très différents. Globalement, le requérant a été lésé dans son droit à la protection de sa vie privée parce que les tribunaux n’avaient pas statué adéquatement sur son action en diffamation.
LES FAITS
Le requérant, Aba Lewit, est un ressortissant autrichien né en 1923 et habitant à Vienne (Autriche). Il est le dernier survivant de l’Holocauste encore en vie. En été 2015, le périodique Aula publia un article dans lequel des personnes libérées du camp de concentration de Mauthausen étaient qualifiées de « meurtriers en masse », de « criminels » et de « fléaux ». Les autorités ouvrirent une enquête pénale visant l’auteur de l’article mais elle fut ultérieurement classée sans suite. Dans le numéro d’Aula de février 2016, le même auteur évoqua le classement sans suite de l’enquête pénale et répéta mot pour mot ses propos antérieurs. M. Lewit, avec neuf autres survivants, qui avaient tous étés emprisonnés dans des camps de concentration et libérés en 1945, formèrent une action fondée sur la loi relative aux médias (Mediengesetz) contre Aula et l’auteur des propos. Les demandeurs soutenaient qu’ils avaient été diffamés et insultés par l’article de 2016, bien qu’ils n’y eussent pas été nommés personnellement. Ils rappelèrent qu’ils avaient été tous été victimes du régime national-socialiste et qu’ils avaient été emprisonnés à Mauthausen en raison de leurs origines, de leurs croyances ou de leurs convictions, puis libérés après la guerre. Ils ajoutèrent qu’ils n’avaient jamais vraiment commis d’infraction pénale. Le tribunal correctionnel régional de Graz les débouta au motif que le nombre de personnes libérées de Mauthausen, environ 20 000 en 1945, était si important que les demandeurs ne pouvaient pas être individuellement touchés par les propos tenus dans l’article. Il en conclut que les demandeurs n’avaient pas qualité pour le saisir. Il jugea en outre que l’article ne comportait aucun propos diffamatoire distinct par rapport à ceux publiés en 2015. En appel, les demandeurs soutinrent qu’ils étaient au contraire reconnaissables, d’abord parce que seule une poignée d’anciens prisonniers de Mauthausen étaient encore en vie, et ensuite parce qu’ils étaient connus comme étant des survivants de l’Holocauste militants. La cour d’appel de Graz rejeta l’appel formé par eux, sans aborder les questions de la taille du groupe et de la qualité pour ester des demandeurs. Elle confirma la conclusion de première instance selon laquelle les propos en question n’avaient pas de portée distincte par rapport à ceux publiés dans l’article de 2015.
Recevabilité
Rappelant sa jurisprudence selon laquelle la vie privée de chaque membre d’un groupe peut être touchée par des stéréotypes négatifs ou des propos diffamatoires, la Cour constate tout d’abord que M. Lewit et les autres anciens prisonniers de Mauthausen, en tant que survivants de l’holocauste, constituent un groupe social. Elle estime donc que, si M. Lewit n’était pas désigné nommément dans l’article, l’affaire relève de sa vie privée et que l’article 8 de la Convention est applicable.
La Cour prend note de l’argument tiré par le Gouvernement de ce que M. Lewit était censé épuiser les voies de recours internes avant de la saisir, en particulier au moyen d’une action sur la base de l’article 1330 du Code civil concernant l’article initial de 2015 ou sa suite en 2016. La Cour rappelle que, dans les affaires de respect de la vie privée relatives aux médias, le droit interne doit ouvrir un recours permettant au moins la réparation de tout dommage morale causé. Or, selon la jurisprudence de la Cour suprême autrichienne, une action basée sur l’article 1330 du Code civil n’offrait aucun recours de ce type, de sorte que M. Lewit, qui cherchait notamment à obtenir réparation du dommage moral qu’il disait avoir subi, n’était pas tenu d’emprunter cette voie de droit. La Cour écarte également les autres recours évoqués par le Gouvernement car elle les juge ineffectifs à cette fin.
Sur le fond
La Cour rappelle que l’article 8 impose de ménager un juste équilibre entre des intérêts en conflit : ceux de l’individu et ceux de la société en général. Or, les juridictions internes ne se sont même pas livrées à un tel exercice dans le procès de M. Lewit. Se fondant sur la jurisprudence interne antérieure, la juridiction de première instance a conclu que le nombre de prisonniers libérés était trop important pour permettre d’identifier M. Lewit, si bien qu’il n’avait pas qualité pour la saisir et ce, alors même que les tribunaux n’avaient jamais statué auparavant sur la question très particulière du préjudice causé par des propos sur un groupe de personnes dont la taille avait considérablement diminué avec le temps, comme ici. La cour d’appel n’a pas du tout analysé la question de la qualité pour ester, alors que M. Lewit avait présenté des arguments très détaillés. De ce fait, les tribunaux n’ont jamais examiné ce qui était au cœur de ses prétentions, à savoir qu’il avait été personnellement touché et diffamé par les propos parce que seule une poignée de membres du groupe était encore en vie. Les tribunaux n’ont pas non plus justifié leurs conclusions par des motifs pertinents et suffisants. Le tribunal de première instance a également conclu que l’article de 2016 ne faisait que relater l’enquête préliminaire conduite sur l’article de 2015 et que les propos tenus dans le second article n’avaient aucune portée diffamatoire distincte. Il n’a nulle part indiqué comment il était parvenu à cette conclusion, alors qu’il s’agissait d’un point qui appelait une analyse détaillée. La cour d’appel, quant à elle, a expressément relevé l’absence de motivation du jugement de première instance, mais elle en a pourtant ensuite partagé les conclusions. Pour sa part, la Cour n’est pas convaincue par les conclusions selon lesquelles M. Lewit et les autres demandeurs n’auraient pas pu être personnellement touchés par le second article parce que le contexte des deux articles aurait été très différent. Le premier article s’intéressait à l’événement historique que constituait la libération du camp de Mauthausen, tandis que le second concernait l’enquête pénale visant l’auteur des propos. Il aurait donc fallu que les juridictions internes exposent de manière détaillée les raisons de l’interprétation retenue par eux.
La Cour en conclut que les juridictions internes n’ont jamais réellement analysé ce qui était au cœur de l’action en diffamation formée par M. Lewit parce qu’elles n’ont pas minutieusement examiné la question de la qualité pour agir et la question de savoir si les propos en cause avaient la même portée ou une portée distincte au regard de l’article de 2016. Les tribunaux n’ont donc pas minutieusement examiné le problème qui avait porté atteinte au droit de M. Lewit au respect de sa vie privée, emportant violation procédurale de l’article 8.
TAŞKAYA ET ERSOY c. TURQUIE du 22 janvier 2019 Requête n° 72068/10
Non violation de l'article 8 : La requérante a eu un droit de réponse contre un article la concernant sur ses relations personnelles avec un attaché d'ambassade.
LA REQUERANTE
47. La requérante soutient qu’elle n’est pas un personnage public et qu’il n’y avait pas d’intérêt public à publier les détails de sa relation avec İ.N.Y. Elle allègue que l’article litigieux contenait plusieurs erreurs factuelles et présente ensuite sa version des faits. Elle indique qu’aucune plainte pénale n’a été déposée contre elle mais que, au contraire, c’est elle qui a porté plainte contre İ.N.Y. et contre H.D. ; qu’elle a eu recours à une action légale et non à des moyens illégaux contre H.D. pour recouvrer sa créance ; que c’est elle qui a déposé plainte en premier contre H.D. pour escroquerie et que cette dernière a ensuite porté plainte auprès du barreau afin de la dissuader de maintenir sa plainte ; que le barreau a rendu une décision de non-lieu concernant la plainte de H.D. ; que le rapport d’expertise a conclu que H.D. avait créé un faux chèque et que celle-ci a été condamnée à l’issue de la procédure pénale diligentée contre elle pour faux sur un document officiel. La requérante soutient donc que l’article litigieux présentait des allégations dépourvues de fondement comme des faits établis en ce qui concernait sa relation amoureuse avec İ.N.Y. et sa relation professionnelle avec H.D.
2. L’appréciation de la Cour
a) Principes généraux
49. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)).
50. Elle rappelle aussi que la notion de vie privée est une notion large, qui comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, son image et son intégrité physique et morale (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 50, CEDH 2004‑VI). Il est admis dans la jurisprudence de la Cour que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est couvert par l’article 8 de la Convention en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée (Axel Springer AG, précité, § 83, Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 137, CEDH 2015, Bédat, précité, § 72, et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 76). La Cour a déjà jugé que la réputation d’une personne fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale, qui relèvent de sa vie privée même si cette personne fait l’objet de critiques dans le cadre d’un débat public (Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007, et Petrie c. Italie, no 25322/12, § 39, 18 mai 2017). Les mêmes considérations s’appliquent à l’honneur d’une personne (Sanchez Cardenas c. Norvège, no 12148/03, § 38, 4 octobre 2007, et A. c. Norvège, no 28070/06, § 64, 9 avril 2009). Cependant, pour que l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer, l’atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (Axel Springer AG, précité, § 83, Delfi AS, précité, § 137, Bédat, précité, § 72, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 76).
51. La Cour rappelle par ailleurs que la liberté de la presse joue un rôle fondamental et essentiel dans le bon fonctionnement d’une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui se rapportent à l’administration de la justice. La marge d’appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, parmi beaucoup d’autres, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 45, CEDH 2001-III, et Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, no 37840/10, § 25, 3 avril 2014). Les journalistes doivent cependant agir de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournir des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 37, CEDH 2004-II, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, § 69, CEDH 2008). Une certaine dose « d’exagération » ou de « provocation » est permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (Fressoz et Roire, précité, § 45, et Mamère c. France, no 12697/03, § 25, CEDH 2006-XIII).
52. La Cour reconnaît cependant qu’une distorsion de la réalité, opérée de mauvaise foi, peut parfois transgresser les limites de la critique acceptable : une affirmation véridique peut se doubler de remarques supplémentaires, de jugements de valeur, de suppositions, voire d’insinuations, susceptibles de créer une image erronée aux yeux du public (voir, par exemple, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 45, 27 mai 2004). Ainsi, la mission d’information comporte nécessairement des devoirs et des responsabilités ainsi que des limites que les organes de presse doivent s’imposer spontanément. C’est particulièrement le cas lorsque le récit médiatique tend à imputer des faits d’une particulière gravité à des personnes nommément citées, une telle imputation comportant le risque de désigner ces personnes à la vindicte publique (Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie, no 11461/03, § 27, 19 décembre 2006, et Mater c. Turquie, no 54997/08, § 55, 16 juillet 2013).
53. La Cour rappelle en outre que, dans les arrêts Lingens c. Autriche (8 juillet 1986, § 46, série A no 10) et Oberschlick c. Autriche ((no 1), 23 mai 1991, § 63, série A no 204), elle a distingué entre déclarations de fait et jugements de valeur. La matérialité des déclarations de fait peut se prouver ; en revanche, les jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, l’obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 de la Convention (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux : à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif (De Haes et Gijsels, précité, § 47, Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997-IV, Brasilier c. France, no 71343/01, § 36, 11 avril 2006, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 55, CEDH 2007‑IV). Pour distinguer une imputation de fait d’un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce et de la tonalité générale des propos (Brasilier, précité, § 37), étant entendu que des assertions sur des questions d’intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait (Paturel c. France, no 54968/00, § 37, 22 décembre 2005).
54. La Cour rappelle de surcroît que, dans les affaires comme celle de l’espèce, il lui incombe de déterminer si l’État, dans le cadre de ses obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, a ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression protégé par l’article 10 (Petrie, précité, § 40). Elle dit avoir résumé dans plusieurs arrêts les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, qui sont les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de l’espèce (Von Hannover (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108-113, CEDH 2012, et Axel Springer AG, précité, §§ 89‑95 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93). Si la mise en balance entre ces deux droits s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
55. La Cour note que la présente requête porte sur un article de presse dont la requérante allègue qu’il a, par son contenu, porté atteinte à sa réputation. À cet égard, elle rappelle que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention (paragraphe 50 ci-dessus). Elle estime que, en l’espèce, eu égard à la gravité des allégations concernant la requérante contenues dans l’article litigieux, l’atteinte à la réputation de l’intéressée atteint le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 8 de la Convention.
56. La Cour note ensuite que la requérante ne se plaint pas d’une action de l’État mais du manquement de celui-ci à protéger sa réputation contre les atteintes portées à celle-ci par l’article en question. Dans les circonstances de l’espèce, il lui appartient donc de rechercher si les juridictions nationales ont manqué à protéger la requérante contre les atteintes alléguées. À cet effet, elle procédera à une appréciation des circonstances litigieuses de la requête à la lumière des critères pertinents se dégageant de sa jurisprudence, notamment en ce qui concerne le juste équilibre à ménager entre le droit de la requérante à la protection de sa réputation et la liberté de presse (paragraphe 54 ci-dessus).
57. Elle estime que, pour apprécier l’existence d’une atteinte au droit à la vie privée de la requérante, elle doit analyser l’article litigieux en prenant en compte sa teneur mais aussi le contexte dans lequel il s’insère. À cet égard, elle observe d’emblée que la requérante est un personnage qui a été connu du public à l’occasion des articles de presse publiés sur sa relation avec İ.N.Y. et de la plainte pénale qu’elle a déposée contre ce dernier. En ce sens, elle note que l’article de presse incriminé reprenait en partie les informations déjà publiées dans les articles successifs qui relataient les versions des faits données par la requérante et par İ.N.Y. sur leur relation. À cet égard, la Cour estime que, dans la mesure où la requérante s’est exposée volontairement à l’attention du public et s’est engagée elle-même dans le débat public par ses déclarations à la presse, les limites de la critique admissible étaient plus larges à son égard que pour un simple individu (Kuliś c. Pologne, no 15601/02, § 47, 18 mars 2008).
58. En ce qui concerne le contenu de l’article litigieux, la Cour note que cet article faisait d’abord un résumé des informations déjà publiées sur la relation de la requérante avec İ.N.Y. dans les articles de presse antérieurs (paragraphe 17 ci-dessus) et relatait ensuite la plainte et les allégations de H.D. concernant la requérante (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Sur ce dernier point, l’article rapportait notamment les dires de H.D. selon lesquels la requérante avait essayé d’encaisser des chèques illégalement extorqués à H.D. et indiquait en outre que, malgré la déclaration de la requérante lors du dépôt de sa plainte contre H.D. selon laquelle les chèques en cause avaient été signés par cette dernière à ses côtés, il avait été définitivement établi par un rapport d’expertise que les signatures sur les chèques n’étaient pas celles de H.D. (paragraphe 18 ci-dessus).
59. La Cour constate par ailleurs que l’article litigieux revêtait essentiellement le caractère de déclarations de fait. Elle note à cet égard que des informations contenues dans cet article ne peuvent être considérées comme étant non conformes aux réalités pour autant qu’elles concernent la relation de la requérante avec İ.N.Y. et les allégations de H.D. concernant la requérante, mais qu’il n’en est pas de même pour les assertions de l’auteur de l’article concernant « la contre-attaque » de la requérante et les signatures sur les chèques faisant l’objet du différend entre H.D. et la requérante.
60. Ainsi, en ce qui concerne le titre de l’article, la Cour note que ce titre insinuait que la requérante avait causé du tort non seulement à İ.N.Y. mais aussi à H.D. (paragraphe 17 ci-dessus). À cet égard, tout en observant que la responsabilité de la requérante pour les faits traités dans l’article litigieux relativement à ces deux personnes était pour le moins discutable à la date de la publication de l’article, la Cour rappelle qu’une certaine dose « d’exagération » ou de « provocation » est permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (Fressoz et Roire, précité, § 45, et Mamère, précité, § 25).
61. S’agissant de la partie de l’article qui relate les événements survenus entre la requérante et İ.N.Y., la Cour note que cette partie reprenait les contenus des publications précédentes à ce sujet, contenus qui n’avaient pas été contestés par la requérante (paragraphe 7 ci-dessus).
62. Pour ce qui est de la partie de l’article relative aux allégations de H.D., la Cour observe que, si la plainte déposée par cette dernière auprès du barreau d’Istanbul contre la requérante ainsi que les allégations contenues dans cette plainte étaient vérifiables dans les faits, il n’en allait pas de même pour « la contre-attaque » de la requérante par le biais de sa plainte devant le procureur de la République contre H.D., ni pour l’affirmation selon laquelle il avait été définitivement constaté que les signatures sur les chèques n’appartenaient pas à H.D.
63. En effet, en ce qui concerne le terme « contre-attaque » employé dans l’article, la Cour note que, la requérante ayant déposé sa plainte pénale contre H.D. le 26 octobre 2005, soit avant le dépôt de la plainte de H.D. contre elle, qui avait eu lieu le 26 novembre 2005, il n’était pas approprié de parler d’une contre-attaque de la requérante en l’espèce.
64. Quant aux signatures sur les chèques en question, la Cour note d’emblée que, au regard des pièces du dossier de la requête, elle ne saurait spéculer sur le nombre et la nature des chèques qui faisaient en réalité l’objet du litige entre la requérante et H.D. Elle observe cependant que le rapport d’expertise du 17 décembre 2005, sur lequel l’auteur de l’article semble s’appuyer pour affirmer que les signatures sur les chèques litigieux n’appartenaient pas à H.D., concernait d’autres chèques que ceux relatifs à la procédure pénale diligentée contre H.D. pour faux sur un document officiel (paragraphe 26 ci-dessus), et que les rapports d’expertise obtenus les 31 octobre 2005 et 25 avril 2006, dans le cadre de l’enquête pénale diligentée contre H.D., soit avant la publication de l’article litigieux, parvenaient à une conclusion différente de celle du rapport du 17 décembre 2005 (paragraphe 14 ci-dessus). Elle estime donc que compte tenu de ces faits et en particulier des résultats de tous les rapports d’expertise relatifs au litige entre les intéressées rendus avant la publication de l’article litigieux, l’auteur de cet article aurait dû au moins nuancer son affirmation selon laquelle il avait été « définitivement » établi que les signatures au dos des chèques n’appartenaient pas à H.D. À cet égard, la Cour tient aussi à noter que, à l’issue des procédures relatives à l’article litigieux diligentées ultérieurement, une ordonnance de non-lieu a été rendue concernant les allégations relatives à la requérante (paragraphes 23 et 24), alors que H.D. a été condamnée pour faux sur un document officiel (paragraphes 15-16).
65. La Cour constate donc que cet article semble comporter deux éléments qui peuvent être considérés comme étant non conformes aux faits à la date de sa publication, à savoir le terme « contre-attaque » employé pour qualifier la plainte pénale déposée par la requérante contre H.D. et l’affirmation selon laquelle il avait été « définitivement » établi que les signatures au dos des chèques n’appartenaient pas à H.D.
66. La Cour observe toutefois qu’il s’agit de deux imputations factuelles, présentées en marge des allégations principales relatées dans l’article litigieux, et dont il était relativement aisé de démontrer le contraire. Elle constate à cet égard que la requérante a eu la possibilité de présenter sa version des faits et rectifier ces deux « erreurs factuelles » par la réponse rectificative qu’elle a pu faire publier dans le même quotidien à la suite de la décision du juge d’instance pénal de Şişli (paragraphes 19-22 ci-dessus).
67. Eu égard au jugement du tribunal de grande instance, qui a rejeté l’action en dommages et intérêts intentée par la requérante concernant l’article litigieux, la Cour prend acte du fait que cette juridiction a effectué un examen sur la base des pièces dont elle disposait pour apprécier la réalité des faits relatés à la date de leur publication et a conclu que cet article semblait conforme à la réalité, qu’il avait un intérêt public et que, même s’il utilisait des expressions de nature à attirer l’attention du public, il ne portait pas atteinte aux droits de la personnalité de la requérante, en se référant à cet égard au dossier de l’enquête relative à la plainte que la requérante avait déposée contre le consul azerbaïdjanais İ.N.Y., au dossier de l’enquête du barreau d’Istanbul relatif à la plainte de H.D. contre la requérante ainsi qu’au dossier de l’enquête pénale concernant l’ex-mari de la requérante, E.E. et en soulignant la liberté de presse (paragraphe 27 ci-dessus).
68. La Cour est d’avis que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se plaçait l’article en cause. À cet égard, elle considère que le juge d’instance pénal, ayant ordonné la publication de la réponse rectificative de la requérante, qui a offert à l’intéressée les moyens de rectifier les erreurs factuelles qu’aurait contenu l’article litigieux, et le tribunal de grande instance, ayant jugé que, nonobstant des expressions quelque peu immodérées employées, cet article ne portait pas atteinte aux droits de la personnalité de la requérante, ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre la liberté de la presse et le droit de la requérante au respect de sa vie privée. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation des intérêts divergents, les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles ont manqué à leurs obligations positives à l’égard de la requérante au titre de l’article 8 de la Convention.
69. À la lumière de tout ce qui précède et compte tenu des décisions rendues par les juridictions nationales à l’issue de deux procédures auxquelles la requérante a eu recours concernant l’article litigieux, la Cour conclut qu’en l’espèce les juridictions nationales n’ont pas manqué à leurs obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention. Partant, elle juge qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.
KABOĞLU ET ORAN c. TURQUIE du 30 octobre 2018 Requêtes n° 1759/08, 50766/10 et 50782/10
Violation de l'article 8 : Le lynchage des experts et militants des droits de l'homme, dans la presse, est une violation de l'article 8 de la Convention.
LES FAITS
48. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir pu obtenir réparation du dommage moral qu’ils allèguent avoir subi en raison des articles de presse qui, selon eux, contenaient des insultes, des menaces et des discours de haine à leur encontre, portaient atteinte à leur dignité et participaient à une campagne de « lynchage moral » tendant à dresser l’opinion publique contre eux.
49. Invoquant en outre l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent, dans le cadre de la requête no 1759/08, que les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour les protéger dans la campagne de lynchage qui, selon eux, les désignait comme cibles et créait une menace pour leur vie. Ils exposent à cet égard que la Turquie est coutumière de cette pratique visant à intimider, effrayer, mettre en danger, voire éliminer, des personnes ayant exprimé des opinions différentes de celles de la majorité de la société en les désignant comme cibles, et que les universitaires et journalistes assassinés ces dernières années, tels que Fırat Dink, sont des exemples concrets de cette pratique. Ils reprochent donc aux autorités nationales de les avoir laissés sans protection contre les discours de haine et les appels à la violence contre eux qu’auraient contenus les articles de presse, et d’avoir ainsi contribué à encourager les menaces de mort qui leur auraient été adressées.
50. La Cour note, en ce qui concerne l’allégation des requérants relative au manquement des autorités à les protéger contre les menaces de mort et réactions violentes, que les intéressés n’apportent aucun élément concernant un éventuel acte concret de violence qui aurait été perpétré contre eux à la suite des articles litigieux. Elle rappelle à cet égard qu’un traitement qui ne présente pas la gravité d’un traitement relevant des articles 2 et 3 de la Convention peut néanmoins nuire à l’intégrité physique et morale au point d’enfreindre l’article 8 sous l’angle de la vie privée (Király et Dömötör c. Hongrie, no 10851/13, § 42, 17 janvier 2017). Elle note aussi que la seule voie de recours que les requérants semblent avoir utilisée en l’espèce est celle des actions civiles en dommages et intérêts qu’ils ont introduites contre les articles litigieux.
51. La Cour considère que, par leurs griefs tirés des articles 2 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent essentiellement d’un manquement des autorités internes à protéger leur intégrité physique et morale contre les atteintes que ces articles auraient constituées. Elle rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les parties. En l’espèce, eu égard à la formulation des griefs des requérants et à la nature des procédures dont ceux-ci contestent l’issue, la Cour estime qu’il convient d’examiner les faits dénoncés sous le seul angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
a) Principes généraux
65. La Cour rappelle d’abord que la notion de vie privée est une notion large, qui comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, son image et son intégrité physique et morale (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 50, CEDH 2004‑VI). Il est admis dans la jurisprudence de la Cour que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est couvert par l’article 8 de la Convention en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012, Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 137, CEDH 2015, Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 72, CEDH 2016, et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie‑Herzégovine [GC], no 17224/11, § 76, CEDH 2017). La Cour a déjà jugé que la réputation d’une personne fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale, qui relèvent de sa vie privée même si cette personne fait l’objet de critiques dans le cadre d’un débat public (Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007, et Petrie c. Italie, no 25322/12, § 39, 18 mai 2017). Les mêmes considérations s’appliquent à l’honneur d’une personne (Sanchez Cardenas c. Norvège, no 12148/03, § 38, 4 octobre 2007, et A. c. Norvège, no 28070/06, § 64, 9 avril 2009). Cependant, pour que l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer, l’atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (Axel Springer AG, précité, § 83, Delfi AS, précité, § 137, Bédat, précité, § 72, et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 76).
66. La Cour rappelle ensuite que la liberté de la presse joue un rôle fondamental et essentiel dans le bon fonctionnement d’une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui se rapportent à l’administration de la justice. La marge d’appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, parmi beaucoup d’autres, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 45, CEDH 2001-III, et Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, no 37840/10, § 25, 3 avril 2014). Les journalistes doivent cependant agir de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournir des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 37, CEDH 2004-II, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, § 69, CEDH 2008). Cela dit, une certaine dose « d’exagération » ou de « provocation » est permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (Fressoz et Roire, précité, § 45, et Mamère c. France, no 12697/03, § 25, CEDH 2006-XIII).
67. La Cour reconnaît cependant qu’une distorsion de la réalité, opérée de mauvaise foi, peut parfois transgresser les limites de la critique acceptable : une affirmation véridique peut se doubler de remarques supplémentaires, de jugements de valeur, de suppositions, voire d’insinuations, susceptibles de créer une image erronée aux yeux du public (voir, par exemple, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 45, 27 mai 2004). Ainsi, la mission d’information comporte nécessairement des devoirs et des responsabilités ainsi que des limites que les organes de presse doivent s’imposer spontanément. C’est particulièrement le cas lorsque le récit médiatique tend à imputer des faits d’une particulière gravité à des personnes nommément citées, une telle imputation comportant le risque de désigner ces personnes à la vindicte publique (Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie, no 11461/03, § 27, 19 décembre 2006).
68. La Cour rappelle en outre que, dans les arrêts Lingens c. Autriche (8 juillet 1986, § 46, série A no 10) et Oberschlick c. Autriche ((no 1), 23 mai 1991, § 63, série A no 204), entre autres, elle a distingué entre déclarations de fait et jugements de valeur. Si la matérialité des déclarations de fait peut se prouver, les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude et dans ce cas l’obligation de preuve, impossible à remplir, porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 de la Convention (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux : à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif (De Haes et Gijsels, précité, § 47, Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997-IV, Brasilier c. France, no 71343/01, § 36, 11 avril 2006, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 55, CEDH 2007‑IV). Pour distinguer une imputation de fait d’un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce et de la tonalité générale des propos (Brasilier, précité, § 37), étant entendu que des assertions sur des questions d’intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait (Paturel c. France, no 54968/00, § 37, 22 décembre 2005).
69. La Cour rappelle encore que, lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur un conflit entre deux droits également protégés par la Convention, elle doit effectuer une mise en balance des intérêts en jeu. L’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de l’article litigieux ou, sous l’angle de l’article 10, par l’auteur de cet article. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. France, no 12268/03, § 41, 23 juillet 2009, Timciuc c. Roumanie (déc.), no 28999/03, § 144, 12 octobre 2010, Mosley c. Royaume‑Uni, no 48009/08, § 111, 10 mai 2011, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § ..., CEDH 2015 (extraits) § 91). Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 106, CEDH 2012, Axel Springer AG, précité, § 87, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 91).
70. La Cour rappelle de surcroît que, dans les affaires comme celle de l’espèce, il lui incombe de déterminer si l’État, dans le cadre de ses obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, a ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression protégé par l’article 10 (Petrie c. Italie, précité, § 40). Elle a résumé dans plusieurs arrêts les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, qui sont les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de l’espèce (Von Hannover (no 2) [GC], précité, §§ 108-113, et Axel Springer AG, précité, §§ 89-95 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93). Si la mise en balance de ces deux droits s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011).
71. Notant enfin que dans la présente affaire les requérants ont fait l’objet des atteintes alléguées portées à leur droit au respect de leur vie privée en raison de l’exercice de leur liberté d’expression, la Cour rappelle à cet égard que l’exercice réel et effectif de cette liberté ne dépend pas simplement du devoir de l’État de s’abstenir de toute ingérence, mais peut exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux. En effet, dans certains cas, l’État a l’obligation positive de protéger le droit à la liberté d’expression, même contre des atteintes provenant de personnes privées (Palomo Sánchez et autres, précité, § 59 et Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, § 39, CEDH 2003‑VI).
b) Application de ces principes en l’espèce
72. La Cour note que les présentes requêtes portent sur des articles de presse dont les requérants allèguent qu’ils ont, par leur contenu, porté atteinte à leur vie privée, en particulier à leur réputation. Pour ce qui concerne le droit à la protection de la réputation, elle rappelle qu’il s’agit d’un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention (paragraphe 65 ci-dessus). Elle estime qu’en l’espèce, eu égard aux critiques virulentes formulées à l’égard des requérants dans les articles litigieux, l’atteinte à la réputation des intéressés atteint le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 8 de la Convention.
73. La Cour note ensuite que les requérants ne se plaignent pas d’une action de l’État, mais du manquement de celui-ci à protéger leur vie privée contre les atteintes portées à celle-ci par les articles en question. Dans les circonstances de l’espèce, il appartient donc à la Cour de rechercher si les juridictions nationales ont manqué à protéger les requérants contre les atteintes alléguées. À cet effet, la Cour procédera à une appréciation des circonstances litigieuses de l’affaire à la lumière des critères pertinents se dégageant de sa jurisprudence (paragraphe 70 ci-dessus).
74. La Cour observe d’emblée que les requérants sont des professeurs d’université spécialistes des droits de l’homme, et que, à l’époque des faits, ils avaient été nommés membres du Conseil consultatif des droits de l’homme, un organisme public chargé de conseiller le gouvernement sur des questions des droits de l’homme (paragraphe 6 ci-dessus). Elle estime que, eu égard au statut et à la fonction des intéressés au sein du Conseil consultatif, qui s’apparentaient à ceux des experts nommés par les autorités publiques sur des questions spécifiques, et à la mission consultative confiée au Conseil consultatif, les requérants ne sauraient être assimilés à des hommes politiques tenus de faire preuve d’un plus grand degré de tolérance (Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 52, CEDH 1999‑VIII). Dès lors, dans la mesure où les critiques proférées à l’encontre des requérants se fondaient sur le travail qu’ils avaient effectué dans le cadre de leurs fonctions au sein du Conseil consultatif, l’on ne peut admettre que les intéressés auraient dû faire montre d’un plus grand degré de tolérance face à ces critiques.
75. La Cour observe ensuite que les articles de presse incriminés contenaient les réactions de leurs auteurs au rapport sur les droits des minorités et les droits culturels adopté par le Conseil consultatif. Ce rapport, dont le contenu a suscité dans l’opinion publique une vive polémique, qui a été relayée par les médias, faisait des propositions censées remédier aux problèmes rencontrés en matière de droits des minorités et de droits culturels en Turquie, et il prônait d’une façon générale la transition de l’idée de nation homogène et monoculturelle, qui aurait été la politique poursuivie par les gouvernements antérieurs, vers la conception d’une société multi-identitaire, multiculturelle, démocratique, libérale et pluraliste, qui serait le modèle adopté dans les démocraties européennes contemporaines (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Les articles en question, qui avaient trait à ce rapport, portaient ainsi sur des thèmes d’intérêt général et d’actualité.
76. Procédant ensuite à un examen scrupuleux du contenu des écrits litigieux, la Cour observe que ceux-ci comportaient des critiques sévères, exprimées tantôt d’une manière directe et incisive, tantôt dans un style ironique, avec des allusions visant non seulement le rapport en question, mais aussi ses auteurs. Elle note à cet égard que ces articles semblent présenter les requérants comme les principaux auteurs du rapport, sans doute, d’une part, du fait de leurs fonctions de président du Conseil consultatif et de président du groupe de travail qui a élaboré le rapport (paragraphe 7 ci-dessus), et, d’autre part, en raison de leurs opinions en la matière, qui étaient connues du public et qui, selon le Gouvernement, se reflétaient dans le rapport (paragraphe 61 ci-dessus).
77. La Cour observe que les articles litigieux, dans leur ensemble, mettaient en cause la bonne foi et l’intégrité des requérants et qu’ils les traitaient d’intellectuels insensibles aux intérêts de la nation turque, guidés et soudoyés par les puissances étrangères. À cet égard, ils leur reprochaient notamment, en les désignant par leurs noms, d’être dans la traîtrise (paragraphes 26, 29 et 31 ci-dessus), d’être pro-Sèvres (paragraphes 26, 28 et 30 ci-dessus) – c’est-à-dire partisans de la désintégration de la Turquie (paragraphe 8 ci-dessus) –, d’être de mauvaise foi (paragraphes 28 et 29 ci‑dessus) et de « se nourrir à la (...) gamelle » (paragraphe 31 ci-dessus). En outre, ils employaient, pour qualifier les membres du Conseil consultatif et, en particulier, les principaux instigateurs du rapport – comprenant vraisemblablement les requérants –, mais cette fois sans préciser de noms, des termes tels que « traître » (paragraphes 15, 28, 30 et 36 ci-dessus), « personnes subversives (...) à condamner à mort » (paragraphe 27 ci‑dessus), « lèche-bottes » (paragraphes 29 et 36 ci-dessus), « sournoiserie » (paragraphe 30 ci-dessus), « entretenus par l’ouest sauvage » (paragraphe 36 ci-dessus), « petits chiens » (paragraphe 36 ci-dessus), « cheval de Troie infiltré parmi nous » (paragraphe 36 ci-dessus), « minables » (paragraphe 36 ci-dessus), « apostats » (paragraphe 36 ci-dessus), « espion » (paragraphe 36 ci-dessus), « caniche » (paragraphe 36 ci-dessus) et « sans racines et sans pedigree » (paragraphe 35 ci-dessus).
78. La Cour considère que ces articles, eu égard à leur contenu tel que décrit ci-dessus, revêtaient le caractère de jugements de valeur. Elle relève que les vives critiques dirigées dans les articles litigieux contre les requérants faisaient écho au contenu du rapport en question, qui se démarquait de la législation et des pratiques existantes en matière de protection des droits des minorités en Turquie à l’époque des faits, en raison notamment des idées et des propositions qui y étaient développées et qui impliquaient un changement de mentalité fondamental en la matière.
79. La Cour constate donc que les articles en question faisaient incontestablement partie d’un débat d’intérêt général, déclenché par le rapport susmentionné, relativement à la place et aux droits des minorités dans l’organisation sociétale. Elle rappelle à cet égard que le rôle de « chien de garde » que joue la presse autorise les journalistes, dans le contexte d’un débat public, à recourir à une certaine dose d’exagération ou de provocation, voire de rudesse. Si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général est tenu de ne pas dépasser certaines limites notamment quant au respect de la réputation et des droits d’autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos (Kuliś c. Pologne, no 15601/02, § 47, 18 mars 2008). Notant en outre que certains des articles litigieux – notamment celui de S.K., publié par le quotidien Akşam (paragraphe 36 ci-dessus) – avaient recours au mode satirique, la Cour rappelle que la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter (Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, no 68354/01, § 33, 25 janvier 2007), et elle estime que la satire contribue au débat public.
80. S’agissant du caractère offensant de certains passages des articles litigieux, la Cour rappelle que des propos offensants peuvent sortir du champ de la protection de la liberté d’expression lorsqu’ils reviennent à dénigrer gratuitement, par exemple si l’insulte est son seul but ; en revanche, l’utilisation de formules vulgaires n’est pas en elle-même déterminante dans l’appréciation d’un propos offensant, car elle peut fort bien avoir une visée strictement stylistique (Tuşalp c. Turquie, nos 32131/08 et 41617/08, § 48, 21 février 2012.
81. En l’espèce, la Cour considère que les articles litigieux employaient des termes acerbes servant à manifester la réaction et l’indignation des auteurs des articles à l’égard du rapport du Conseil consultatif et à décrédibiliser aux yeux du public les rédacteurs de ce texte, dont les requérants. Elle estime que le style et le contenu provocateurs, agitateurs et quelque peu offensants des articles en question ne peuvent être considérés, dans l’ensemble, comme dépourvus d’une base factuelle suffisante et comme gratuitement insultants dans le contexte du vif débat public relatif au rapport qui portait sur des questions essentielles pour la société turque.
82. La Cour en vient ensuite à l’allégation des requérants selon laquelle les articles litigieux comportent aussi des passages qu’ils qualifient d’appel à la violence et de discours de haine à leur égard. Elle estime que, aux fins de l’examen de cette allégation, elle doit s’inspirer des principes établis dans sa jurisprudence sous l’angle de l’article 10 de la Convention concernant les propos, verbaux ou écrits, présentés comme alimentant ou justifiant la violence, la haine ou l’intolérance (Király et Dömötör, précité, § 73). Les facteurs clés dans l’appréciation de la Cour dans ces affaires sont le point de savoir si les propos ont été tenus dans un contexte politique ou social tendu (Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, §§ 57-60, Recueil 1997‑VII, Soulas et autres c. France, no 15948/03, §§ 38-39, 10 juillet 2008, et Balsytė-Lideikienė c. Lituanie, no 72596/01, § 78, 4 novembre 2008) ; la question de savoir si les propos, correctement interprétés et appréciés dans leur contexte immédiat ou plus général, peuvent passer pour un appel direct ou indirect à la violence ou pour une justification de la violence, de la haine ou de l’intolérance (voir, entre autres, Özgür Gündem c. Turquie (no 23144/93, CEDH 2000‑III) § 64, Féret c. Belgique, no 15615/07, §§ 69-73 et 78, 16 juillet 2009, et Fáber c. Hongrie, no 40721/08, §§ 52 et 56-58, 24 juillet 2012) ; et la manière dont les propos ont été formulés et leur capacité – directe ou indirecte – à nuire (Karataş c. Turquie ([GC], no 23168/94, §§ 51-52, CEDH 1999-IV, et Vejdeland et autres c. Suède, no 1813/07, § 56, 9 février 2012). Dans toutes les affaires ci-dessus, c’est la conjonction de ces différents facteurs plutôt que l’un d’eux pris isolément qui a joué un rôle déterminant dans l’issue du litige. On peut donc dire que la Cour aborde ce type d’affaires en tenant éminemment compte du contexte (Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 208, CEDH 2015 (extraits)).
83. Aussi, en l’espèce, la Cour examinera-t-elle avec une attention particulière, à la lumière des critères susmentionnés, les termes employés dans les articles litigieux, le contexte de leur publication et leur capacité à nuire. À cet égard, elle note d’abord que les écrits litigieux ont été publiés dans un contexte de débat public agité sur les propositions que présentait le rapport précité relativement à une protection efficace des droits des minorités en Turquie. Elle reconnaît qu’il s’agit d’un sujet délicat susceptible de provoquer des inquiétudes sur la structure unitaire de la nation et de l’État turcs dans les milieux nationalistes. Les déclarations et les articles de presse critiquant les requérants s’inscrivaient donc dans le contexte d’une campagne réactionnaire menée par ces milieux contre le rapport et les principaux auteurs de celui-ci, les requérants. Ces derniers avaient en fait exercé leur liberté d’expression par le biais de ce rapport en y présentant leur point de vue sur le statut et la place des minorités dans une société démocratique sans toutefois employer des termes dénigrants ou insultants contre les tenants d’une perspective différente à ce propos. La Cour considère à cet égard que, pour prendre la mesure de la tension régnant dans ce contexte, il suffit de se remémorer, d’une part, l’incident survenu à la conférence de presse, qui avait été organisée par le requérant İbrahim Kaboğlu, où F.Y., un syndicaliste de tendance nationaliste, a déchiré une copie du rapport se trouvant devant M. Kaboğlu et a ainsi empêché la tenue de la conférence (paragraphe 11 ci-dessus), et, d’autre part, les menaces de mort reçues par les intéressés, qui ont obligé les autorités à adopter des mesures de protection rapprochée à leur égard (paragraphe 14 ci-dessus) et qui, en l’absence d’une réponse judiciaire effective, ont conduit la Cour constitutionnelle à constater une violation des droits du requérant Baskın Oran à la vie et à la liberté d’expression (paragraphe 45 ci-dessus).
84. Quant aux termes employés dans les articles litigieux, la Cour estime que certains passages de ces articles sont ambigus en ce sens qu’ils semblent être des phrases stéréotypées formulées dans un langage idéologique nationaliste, mais qu’ils peuvent tout aussi bien être interprétés comme une apologie de la violence, à tout le moins par certains lecteurs qui n’ont pas de connaissance suffisante de ce jargon et qui sont susceptibles de prendre les termes en question au premier degré. Selon la Cour, il en est ainsi notamment des passages suivants : « si [la majorité turque du pays] se met à gronder, à s’exclamer et à rugir, les traîtres ne trouveront plus un endroit où respirer (...) » (paragraphe 15 ci-dessus) ; « (...) Je dis à certains qui [poussent trop loin] certaines choses : ne jouez pas avec le feu » (paragraphe 15 ci-dessus), et « Ce rapport est une vraie traîtrise, ceux qui ont élaboré ce rapport veulent le voir mis en pièces sur leurs têtes. Ceux qui veulent voir la nation turque comme une minorité dans ce pays auront affaire à nous. » (paragraphe 20 ci‑dessus).
85. La Cour considère en revanche que certains autres passages sont clairement de nature à appeler directement ou indirectement à la violence ou à constituer une justification de la violence. Elle place notamment dans cette catégorie les passages suivants : « je vous le jure, le prix du sol est le sang et, s’il le faut, le sang sera versé. » (paragraphe 21 ci-dessus) ; « À mon avis, si on avait tabassé ces personnes, les gens auraient été soulagés. Ces pro-Sèvres méritaient une bonne raclée (...) » (paragraphe 30 ci-dessus). De l’avis de la Cour, ces phrases, doublées des expressions stigmatisantes abondamment utilisées dans les articles litigieux, telles que « traître », « personnes subversives (...) à condamner à mort », « cheval de Troie infiltré parmi nous » et « espion », attisaient la haine contre les personnes visées, à savoir les auteurs du rapport, dont les requérants, et les exposait à un risque de violence physique (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV), d’autant plus qu’elles étaient publiées dans des quotidiens à diffusion nationale.
86. La Cour considère qu’en l’espèce il ne fallait pas minimiser le risque que de tels écrits pussent pousser à la commission d’actes violents contre les requérants. Elle tient à rappeler à cet égard, comme les requérants l’ont signalé (paragraphe 45 ci-dessus), qu’un journaliste turc, Fırat Dink, a été assassiné par un individu ultranationaliste à la suite d’une campagne de stigmatisation qui avait été accompagnée de menaces de mort proférées en raison de ses opinions hétérodoxes sur une question jugée sensible dans la société turque (Dink c. Turquie (nos 2668/07 et 4 autres, 14 septembre 2010) §§ 8-17 et 107).
87. La Cour estime donc que les attaques verbales et les menaces physiques, proférées dans ce contexte à l’encontre des requérants dans les articles litigieux, visaient à réprimer leur personnalité intellectuelle, en leur inspirant des sentiments de peur, d’angoisse et de vulnérabilité propres à les humilier et à briser leur volonté de défendre leurs idées (voir, mutatis mutandis, Ülke c. Turquie, no 39437/98, § 62, 24 janvier 2006).
88. La Cour en vient enfin aux jugements des juridictions internes, lesquelles ont rejeté toutes les actions en dommages et intérêts intentées par les requérants contre les articles litigieux. Elle observe que ces juridictions, sans procéder à une qualification explicite des articles – déclaration de fait, jugement de valeur ou encore discours haineux ou violent –, ont conclu qu’ils ne visaient pas directement les requérants et qu’ils ne contenaient pas d’attaques gratuites contre eux, que les requérants devaient tolérer les critiques sévères émises contre eux, d’une part, en raison de leur statut et, d’autre part, en raison des critiques qu’ils avaient eux-mêmes faites dans le rapport contre leurs adversaires idéologiques, et que ces articles relevaient des dispositions protégeant la liberté d’expression de leurs auteurs (paragraphes 17, 23, 33, 39 ci-dessus). La Cour note aussi que les juridictions internes n’ont porté aucune attention particulière aux expressions menaçantes et violentes contenues dans les articles litigieux, à l’exception du tribunal de grande instance d’Ankara. Celui-ci a estimé, dans son jugement du 25 juillet 2006, que la phrase « le prix du sol est le sang et, s’il le faut, le sang sera versé » était bien connue du grand public et qu’elle ne constituait pas une menace pour les requérants, et que la phrase « ceux qui veulent voir la nation turque comme une minorité dans ce pays auront affaire à nous » n’était qu’une critique formulée en réaction aux opinions exprimées dans le rapport (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour ne peut souscrire à ces considérations pour les raisons susmentionnées.
89. Elle estime que les conclusions ainsi adoptées par les juridictions internes ne sont pas de nature à lui permettre d’établir qu’elles ont effectué une mise en balance adéquate entre le droit des requérants au respect de leur vie privée et la liberté de la presse, conformément aux critères pertinents susmentionnés (paragraphe 70 ci-dessus). En effet, elle considère que les jugements des juridictions internes n’apportent pas de réponse satisfaisante à la question de savoir si la liberté de la presse pouvait justifier, dans les circonstances de l’espèce, l’atteinte portée au droit des requérants au respect de leur vie privée par des passages de nature à constituer un discours de haine et un appel à la violence, et susceptibles ainsi de livrer les intéressés à la vindicte publique (Mater c. Turquie, no 54997/08, § 55, 16 juillet 2013).
90. À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour conclut que, en l’espèce, les juridictions nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants au respect de leur vie privée et la liberté de la presse. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
TARMAN c. TURQUIE du 21 novembre 2017 requête 63903/10
Article 8 : La publication dans la presse, d'articles représentant la requérante comme une Kamikaze djihadiste, a porté atteinte à sa vie privée et a mis sa vie en danger.
1. Arguments des parties
34. La requérante soutient que les articles litigieux ont mis sa vie en danger en la présentant au public comme une terroriste et que cette atteinte à sa vie privée ne peut être justifiée par la défense de la liberté de la presse.
35. Le Gouvernement estime que, en l’espèce, les juridictions internes ont établi une juste balance entre le droit à la vie privée de la requérante et la liberté de la presse. Selon lui, les articles litigieux contribuaient à un débat d’intérêt général et les informations révélées étaient conformes à ce qui apparaissait à ses yeux comme étant la vérité.
2. Appréciation de la Cour
36. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)).
37. Elle rappelle aussi que la notion de vie privée est une notion large, qui comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, son image et son intégrité physique et morale (voir Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 50, CEDH 2004‑VI). Il est admis dans la jurisprudence de la Cour que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est couvert par l’article 8 de la Convention en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012, Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 137, CEDH 2015, Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 72, CEDH 2016, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC], no 17224/11, § 76, CEDH 2017 ; voir également parmi d’autres, Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, § 40, 21 septembre 2010). La Cour a déjà jugé que la réputation d’une personne fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale, qui relèvent de sa vie privée même si cette personne fait l’objet de critiques dans le cadre d’un débat public (Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007 et Petrie c. Italie, no 25322/12, § 39, 18 mai 2017). Les mêmes considérations s’appliquent à l’honneur d’une personne (Sanchez Cardenas c. Norvège, no 12148/03, § 38, 4 octobre 2007 et A. c. Norvège, no 28070/06, § 64, 9 avril 2009). Cependant, pour que l’article 8 trouve à s’appliquer, l’atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (Axel Springer AG, précité, § 83, Delfi AS, précité, § 137, Bédat, précité, § 72, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 76).
38. Elle observe que, en l’espèce, la requérante ne se plaint pas d’une action de l’État mais du manquement de celui-ci à protéger sa vie privée contre l’ingérence de tiers. Elle rappelle à cet égard que, dans les affaires comme celle de l’espèce, il lui incombe de déterminer si l’État, dans le cadre de ses obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, a ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention (Petrie, précité, § 40, 18 mai 2017). Elle dit avoir résumé dans plusieurs arrêts les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, qui sont les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de l’espèce (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108-113, CEDH 2012, et Axel Springer AG, précité, §§ 89-95 ; voir également, Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93).
39. La Cour note que, en l’espèce, la requérante a été présentée par deux articles de presse comme étant une kamikaze préparant un attentat suicide et que sa photo a été publiée dans lesdits articles (paragraphes 9 et 14 ci‑dessus) alors même que l’enquête pénale menée à l’encontre l’intéressée, ouverte à la suite de la plainte déposée par celle-ci, portait sur les chefs de menace et de chantage et qu’une ordonnance de non-lieu avait finalement été rendue à son égard à l’issue de cette enquête (paragraphes 6-8 ci‑dessus). Elle constate aussi que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de dommages et intérêts de la requérante à l’issue des procédures intentées par cette dernière, qui alléguait des atteintes à ses droits de la personnalité en raison de la publication des articles litigieux.
40. La Cour estime que, pour apprécier si la mise en balance par les autorités nationales entre le droit de la requérante à la protection de la réputation et la liberté de la presse s’est faite, en l’espèce, dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, elle doit essentiellement prêter attention à la motivation retenue par le juge national (Sapan c. Turquie, no 44102/04, § 37, 8 juin 2010, et Kaos Gl c. Turquie, no 4982/07, § 57, 22 novembre 2016).
41. Elle observe à cet égard que, dans le jugement du 7 octobre 2008 rendu par le TGI concernant la procédure intentée contre le quotidien Takvim et dans l’arrêt de cassation du 4 février 2010 rendu par la Cour de cassation s’agissant de la procédure intentée contre le quotidien Star, ces dernières juridictions, sans procéder à une qualification explicite – déclaration de fait ou jugement de valeur – des articles litigieux, indiquent seulement que les contenus de ces articles étaient conformes aux apparences à la date de leur publication, en se fondant à cet égard sur les pièces du dossier de l’enquête pénale menée en l’espèce (paragraphes 11 et 18 ci‑dessus).
42. La Cour ne peut que constater, en l’occurrence, que les juridictions nationales se sont contentées de vérifier la conformité du contenu des articles litigieux aux apparences et n’ont pas mis en balance le droit de la requérante au respect de la vie privée et la liberté de la presse de façon adéquate, conformément aux critères pertinents susmentionnés (paragraphe 38 ci-dessus). En effet, elle relève que les décisions des juridictions nationales n’apportent pas de réponse satisfaisante à la question de savoir si la liberté de la presse pouvait justifier, en l’espèce, l’atteinte portée au droit de la requérante à la protection de la réputation par la forme et le contenu des articles litigieux, qui révélaient l’identité et la photo de l’intéressée en la présentant comme une terroriste dangereuse, alors qu’elle n’était que soupçonnée des infractions de menace et de chantage selon le dossier de l’enquête pénale menée par les autorités judiciaires.
43. La Cour considère dès lors que, en l’espèce, les autorités nationales n’ont pas effectué une mise en balance adéquate, conformément aux critères établis par sa jurisprudence, entre le droit de la requérante à la protection de sa réputation et la liberté de la presse.
44. Ces éléments lui suffisent pour conclure que, dans les circonstances de l’espèce, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
LES TÉMOIGNAGES PHOTOS DES PERSONNALITÉS PUBLIÉES DANS LA PRESSE
Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan du 10 janvier 2019 requête n° 65286/13
Violation des articles 8 et 10 : Les autorités azerbaidjanaises n’ont pas enquêté sur une intrusion grave dans l’intimité d’une journaliste d’investigation bien connue. Elle a été filmée pendant une relation sexuelle avec son petit ami chez elle, pour partager la vidéo sur les réseaux sociaux. La journaliste faisait une enquête d'investigation sur le Gouvernement.
 LES
FAITS
LES
FAITS
L’affaire concerne une campagne de dénigrement alléguée contre une journaliste bien connue, Khadija Rovshan qizi Ismayilova. En particulier, la journaliste reçut une lettre la menaçant d’humiliation publique si elle ne cessait pas son travail d’investigation. Mme Ismayilova ayant refusé d’obtempérer, une « vidéo à caractère sexuel » qui la montrait en compagnie de son petit ami d’alors et qui avait été filmée à son insu fut postée sur Internet. À la même époque, des journaux publièrent des articles l’accusant de parti pris anti-gouvernemental et d’immoralité. Elle découvrit plus tard des caméras dissimulées dans tout son appartement. La Cour estime que pareils actes constituent un affront à la dignité humaine de Mme Ismayilova sur lequel l’État était tenu d’enquêter. Or, l’enquête a été entachée de carences et de retards significatifs, alors même qu’il existait des pistes évidentes. Par exemple, la déposition officielle d’un ingénieur des télécommunications travaillant chez l’opérateur d’État Baktelekom, qui avait reconnu avoir reçu pour instruction d’installer une seconde ligne téléphonique dans l’appartement de Mme Ismayilova et de procéder à son raccordement, n’a pas été recueillie. Et surtout, les autorités d’enquête n’ont pas cherché à déterminer s’il existait un lien entre le fait que Mme Ismayilova était une journaliste d’investigation bien connue qui se montrait très critique à l’égard du gouvernement et les actes criminels qui avaient été perpétrés contre elle. Cette situation a été exacerbée par les articles publiés dans des journaux censément progouvernementaux ainsi que par la divulgation par les autorités d’un rapport d’avancement sur l’enquête qui, sans raison apparente, contenait des informations relatives à la vie privée de Mme Ismayilova. La Cour prend particulièrement note des informations faisant état de cas de persécution de journalistes en Azerbaïdjan ainsi que du sentiment que les auteurs de ces actes resteraient impunis.
Article 8 (concernant la lettre de menace, l’enregistrement vidéo secret et la publication des vidéos intimes sur Internet)
La Cour juge, d’un côté, qu’il n’a pas été possible d’établir « au-delà de tout doute raisonnable » que l’État était lui-même responsable de la très grave atteinte faite à la vie privée de Mme Ismayilova. Les arguments que celle-ci avance reposent en effet sur des preuves circonstancielles ou sur des assertions qui nécessitent d’être corroborées et appellent une enquête plus poussée. D’un autre côté, l’article 8 de la Convention imposait à l’État l’obligation d’enquêter sur des actes qui ont fait affront à la dignité humaine de Mme Ismayilova. La lettre de menace qu’elle a reçue, l’entrée sans autorisation dans son appartement suivie de l’installation de câbles et de caméras vidéo, l’enregistrement secret, à son domicile, d’images révélant les aspects les plus intimes de sa vie privée ainsi que l’humiliation publique que lui a ensuite infligée la diffusion de ces images, ont été constitutifs d’une atteinte grave, flagrante et extraordinairement intense à sa vie privée. L’enquête que les autorités ont menée dans l’affaire a cependant été entachée de carences et de retards significatifs. Pourtant, les infractions commises contre Mme Ismayilova ont résulté d’une opération qui avait manifestement été soigneusement planifiée et exécutée et qui avait nécessité une coordination de la part d’un certain nombre d’individus, ce qui offrait plusieurs pistes évidentes.
Tout d’abord, le Gouvernement s’est contenté de fournir des copies des décisions qui avaient ordonné les actes de procédure, sans prouver que ces actes aient effectivement été exécutés. Il n’a pas non plus produit de procès-verbal formel de l’interrogatoire d’un témoin très important, l’ingénieur de Baktelekom, qui aurait pu permettre de savoir de qui celui-ci avait reçu ses instructions. De fait, selon Mme Ismayilova, l’enquêteur qui était présent lors d’une rencontre qu’elle avait organisée dans son appartement avec l’ingénieur juste après qu’elle eut découvert les caméras dissimulées et les câbles avait soigneusement évité d’enregistrer les déclarations de l’ingénieur.
De plus, le dossier ne contenait aucun élément de nature à démontrer que la lettre de menace renfermant les photographies, qui avait apparemment été envoyée depuis Moscou, ait fait l’objet d’une enquête. Il aurait été possible d’adresser une demande officielle aux autorités russes, par exemple. Une autre mesure d’enquête immédiate aurait consisté à identifier les propriétaires et/ou les exploitants des deux sites Web qui avaient été utilisés pour la mise en ligne des vidéos afin de déterminer la provenance des images ainsi que l’identité des personnes qui les avaient téléchargées. Et surtout, les autorités d’enquête n’ont pas cherché à déterminer s’il existait un lien entre le fait que Mme Ismayilova était une journaliste d’investigation bien connue qui se montrait très critique à l’égard du gouvernement et la série d’actes criminels qui avaient été perpétrés contre elle. Nonobstant les doléances de Mme Ismayilova, aucune avancée n’a été réalisée dans l’enquête après août 2013.
En résumé, la Cour estime que les autorités azerbaïdjanaises n’ont pas honoré l’obligation positive que leur imposait l’article 8 de protéger la vie privée de Mme Ismayilova à raison des carences significatives dans l’enquête et de la durée globale de la procédure dans son affaire.
Article 8 (concernant la publication d’informations personnelles dans le rapport d’avancement de l’enquête)
Mme Ismayilova reprochait au rapport d’avancement d’avoir divulgué de manière excessive et inutile des données sensibles à caractère privé. La Cour considère que la publication de ces informations a manifestement constitué une atteinte du droit de la requérante au respect de la vie privée et qu’elle n’était pas justifiée. Se contentant d’avancer que ce rapport avait pour finalité « d’informer le public des avancées de l’enquête », le Gouvernement n’a pas expliqué quel objectif légitime avait servi la publication de l’adresse et de l’identité du partenaire d’une personne qui avait été filmée à son insu et illégalement dans l’intimité de son domicile pendant un rapport sexuel. De fait, étant donné que l’enquête elle-même a porté sur une intrusion injustifiée et flagrante dans la vie privée de Mme Ismayilova, les autorités auraient dû davantage veiller à ne pas aggraver l’atteinte aux droits de celle-ci.
Article 10 (concernant le défaut de protection de la liberté d’expression)
La Cour prend note du fait que la lettre de menace reçue par Mme Ismayilova était liée à son activité de journaliste professionnelle. Elle tient également compte des informations concernant la situation générale des journalistes en Azerbaïdjan, notamment de leur persécution alléguée pouvant aller jusqu’à des agressions physiques, ainsi que de la perception que les responsables de ces actes bénéficient d’une impunité.
Mme Ismayilova elle-même a dit qu’elle craignait d’avoir été la victime d’une campagne qui aurait été orchestrée contre elle en représailles de son travail journalistique. Dans pareille situation, l’État n’était pas uniquement tenu de prendre des mesures pour la protéger des intrusions dans sa vie privée, mais avait aussi l’obligation, découlant de l’article 10 de la Convention, de protéger sa liberté d’expression. Cependant, comme le relève la Cour, l’enquête pénale a été entachée de carences et de retards, et les articles publiés dans des journaux censément pro-gouvernementaux ainsi que la divulgation par les autorités d’un rapport d’avancement sur l’enquête qui, sans raison apparente, contenait des informations relatives à sa vie privée, vont venus aggraver la situation. Tous ces éléments étaient contraires à l’esprit d’un environnement protecteur à l’égard du journalisme.
Ainsi, les autorités n’ont pas non plus honoré l’obligation positive qui leur incombait au titre de l’article 10 de protéger la liberté d’expression de Mme Ismayilova.
RUBIO DOSAMANTES c. ESPAGNE du 21 février 2017, requête 20996/10
Article 8 : La bisexualité d'une chanteuse connue en Espagne révélée à la télévision. La CEDH estime que les motifs définis par les juridictions internes n’étaient pas suffisants pour protéger la vie privée de la requérante et que cette dernière aurait dû bénéficier dans les circonstances de la cause d’une « espérance légitime » de protection de sa vie privée.Les juridictions nationales n’ont aucunement procédé à une mise en balance circonstanciée des droits en litige pour apprécier si la « nécessité » de la restriction imposée au droit à la vie privée de la requérante était établie de manière convaincante. Les juridictions en question se sont en effet bornées à considérer que les commentaires en cause ne constituaient pas une atteinte à l’honneur de la requérante. Force est de constater qu’elles n’ont pas examiné les critères à prendre en compte en vue d’une juste appréciation du droit au respect de la liberté d’expression et du droit à la vie privée d’autrui.
4. La requérante est née en 1971. Elle est une chanteuse très connue en Espagne sous le nom de Paulina Rubio.
5. Dans le cadre de trois émissions de télévision, F.B., l’ancien manager de la requérante, fut interviewé par d’autres invités sur divers aspects de la vie privée de la chanteuse. Les échanges en question peuvent se transcrire ainsi :
 Émission
Dónde estás corazón,
22 avril 2005 :
Émission
Dónde estás corazón,
22 avril 2005 :
« (...) [La requérante] est l’une des plus importantes chanteuses latino-américaines et a la réputation d’être une diva capricieuse. Sa biographie est truffée de rumeurs au sujet de son homosexualité, de ses flirts avec les drogues et de ses coucheries.
(...)
– P. : Définirais-tu la relation [entre la requérante et R.B.] comme orageuse ?
– F.B. : Oui.
– P. : Pour moi, une relation orageuse inclut des bagarres, des humiliations.
– F.B. : Oui, oui.
– P. : Et même de la violence... n’est-ce pas ?
– F.B. : De la violence ? Je ne sais pas à quel point.
– P. : Peux-tu nous décrire en quoi consistaient ces humiliations, qui humiliait qui, et nous dire si tu as été témoin de bagarres et si quelqu’un a été blessé ?
– F.B. : D’accord, je te raconte. Comme je l’ai déjà dit, je crois que leur relation était... Bref, le méchant était R.B. Il était totalement débridé (...). Mais, à l’époque où j’ai fait leur connaissance, l’omelette avait été retournée. C’était [la requérante] qui punissait R.B., (...) la relation était très orageuse, insupportable pour leur entourage, c’était toujours des discussions, toujours des humiliations de lui par elle (...)
– F.B. : Elle l’insultait constamment, le rabaissait devant tout le monde...
(...)
– G.C. : Mais elle l’était ou elle ne l’était pas ? Tu as connu [la requérante]. Je te demande si elle est ou non bisexuelle.
– F.B. : Pour affirmer une telle chose, j’aurais dû être avec elle là-bas, or ce sont des choses que je n’ai pas vues. Oui, nous sommes amis et je vais te dire une chose, elle a toujours beaucoup joué avec ça, et tout a été très commenté et...
– P. : Mais qu’est-ce que ça veut dire, « jouer avec ça » ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
– F.B. : Avec cette dualité... Dans les conférences de presse, elle a toujours beaucoup joué avec ça.
– P. : Mais toi, tu sais si elle vit avec quelqu’un ou si elle a eu une relation durable avec quelqu’un ou si elle s’est bagarrée...
– F.B. : Oui, elle a une amie spéciale que...
– G.C. : Elle ne s’appellerait pas L., par hasard ?
– G.C. : Oui, son nom a été prononcé dans l’émission de télévision [Aquí hay tomate], elle vit avec elle depuis très longtemps et, bon, c’est la personne dont on dit que...
(...) »
Émission Aquí hay tomate, 26 avril 2005 :
« – F.B. : (...) La relation [entre la requérante et R.B.] est devenue très orageuse, souvent en plein dîner elle lui parlait très mal, l’appelait « pédé », lui disait « dégage ».
– Voix off : une relation rentable ?
(...)
– F.B. : Je crois que le problème que R.B. avait avec les drogues, c’est [la requérante] qui l’a provoqué, elle le rendait fou...
– Voix off : Une rumeur, en 2004, puis des images compromettantes de [la requérante] avec son amie intime E. ont fait penser que cela allait bien plus loin...
– F.B. : Il fallait trouver d’urgence un ami à [la requérante], elle devait sortir avec un homme pour faire taire les rumeurs relatives à son homosexualité (...) »
Émission Crónicas marcianas, 4 mai 2005 :
« (...)
– F.B. : Si, mais la rumeur au sujet de l’homosexualité de [la requérante] existe, la rumeur existe, en fait...
– B. : Cette rumeur existe parce que cette fille [E.] est une lesbienne très connue dans les milieux de Los Angeles, de Miami ; elle est sortie avec Madonna.
– F.B. : E. est un mannequin vénézuélien bien connu, elle est très belle et, bon... La rumeur est... la rumeur existe depuis très longtemps, et [la requérante] ne l’a ni confirmée ni niée. En fait, elles habitent ensemble...
– B. : Dans la vidéo, on le voit très bien – on me l’a aussi raconté –, elles se tartinent mutuellement de la crème d’une façon plus caressante qu’on ne le fait habituellement.
– F.B. : Elles sont des amies intimes, tous ceux qui les connaissent le savent. En fait, maintenant, il y a un très, très grand scandale à Los Angeles, parce que cette fille, E., a été surprise en train d’embrasser Paris Hilton (...)
– M. : Si R.B. retombe dans la drogue parce que l’autre [la requérante] n’en fait qu’à sa tête, c’est le problème de R.B., pas de [la requérante], tu comprends ? R.B. est un grand garçon.
– F.B. : Mais c’est elle qui l’a poussé.
(...)
– V. : Tu dis qu’elle le ridiculisait, qu’elle l’appelait « pédé », qu’elle le traitait de tous les noms devant tout le monde.
– F.B. : C’est la réalité, c’est la vérité, et je veux que la vérité se sache.
(...)
– F.B. : Ce qui compte n’est pas qu’elle soit homosexuelle, moi je pense qu’il se peut qu’elle soit bisexuelle ; elle a cette amie intime et en a eu d’autres aussi, d’après les rumeurs (...)
– I. : Non. E. est une fille absolument charmante, et elle a vraiment tenu compagnie à [la requérante] lorsqu’elles vivaient en Amérique en simples copines. Ce qui m’embête (...), c’est qu’on utilise l’homosexualité pour l’épingler, il s’agit d’une simple amitié et de rien d’autre.
– F.B. : Au contraire, I., elle devrait éclaircir ce point, mais elle ne dit ni une chose ni son contraire, elle joue avec cette ambiguïté.
– I. : Mais pourquoi devrait-elle répondre ?
(...)
– L.C. : Que [la requérante] soit homosexuelle, cela me semble possible, je la vois joueuse, elle peut encore donner du fil à retordre
L’appréciation de la CEDH
a) Principes généraux relatifs à la protection de la vie privée et à la liberté d’expression
26. La Cour rappelle que la notion de vie privée est une notion large, qui comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, son image et son intégrité physique et morale. Il existe une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée. Ainsi, la publication d’une photographie, tout comme la diffusion d’images dans le cadre d’émissions de télévision accompagnées, comme en l’espèce, d’opinions, de critiques ou de commentaires portant sur des aspects de la vie strictement privée d’une personne (voir, mutatis mutandis, Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003, et Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. France, no 12268/03, § 40, 23 juillet 2009), interfère avec la vie privée de cette dernière, même si elle est une personne publique (Von Hannover, précité, §§ 50 et 53, Petrina c. Roumanie, no 78060/01, § 27, 14 octobre 2008 et Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 95, CEDH 2012). Dans certaines circonstances, une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 53, et Von Hannover (no 2) [GC], précité, § 97).
27. La Cour rappelle que, dans les affaires comme celle de l’espèce, il lui incombe de déterminer si l’État, dans le cadre de ses obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, a ménagé un juste équilibre entre le droit de la requérante au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention. Le paragraphe 2 de l’article 10 reconnaît que la liberté d’expression peut être soumise à certaines restrictions nécessaires à la protection de la vie privé ou la réputation d’autrui.
28. Le choix des mesures propres à garantir le respect de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants, que les obligations à la charge de l’État soient positives ou négatives. De même, sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (Von Hannover (no 2) [GC], précité, § 104).
29. Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand celles-ci émanent d’une juridiction indépendante. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe cependant de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions que celles-ci ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention (ibidem, § 105, avec les références citées, Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, § 41, 21 septembre 2010).
30. Dans les affaires qui nécessitent une mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression, la Cour considère que l’issue de la requête ne saurait en principe varier selon que l’affaire a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet du reportage ou, sous l’angle de l’article 10, par l’éditeur qui l’a publié. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect. Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas (Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 91, CEDH 2015 (extraits)).
31. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la condition de « nécessité dans une société démocratique » commande de déterminer si l’ingérence litigieuse correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi, et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 62, série A no 30). La marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales pour déterminer s’il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre n’est pas illimitée, elle va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d’expression telle que la protège l’article 10. Si la mise en balance à laquelle ont procédé les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis dans la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Von Hannover (no 2), précité, § 107, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011).
32. La Cour a déjà eu l’occasion d’énoncer les principes pertinents qui doivent guider son appréciation dans ce domaine. Elle a ainsi posé un certain nombre de critères dans le contexte de la mise en balance des droits en présence (Von Hannover (no 2), précité, §§ 109-113) : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de l’espèce (Couderc et Hachette Filipacchi Associés [GC], précité, § 93). La Cour estime que les critères ainsi définis peuvent être transposés à la présente affaire.
b) Application de ces principes en l’espèce
33. En l’espèce, la Cour note que, dans le cadre de diverses émissions de télévision, des commentaires, pour le moins frivoles, ont été émis sur certains aspects de la vie privée de la requérante. Ils sont reproduits au paragraphe 5 ci-dessus. Ils portent essentiellement sur l’orientation sexuelle de la requérante et sur la relation orageuse qu’elle aurait entretenue avec son compagnon, les humiliations qu’elle lui aurait infligées et son rôle dans la consommation par lui de stupéfiants.
i. Quant à la contribution des émissions de télévision à un débat d’intérêt général et la notoriété de la personne y visée
34. La Cour note que, s’il existe un droit du public à être informé des publications ou des émissions de télévision ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain public à l’égard de détails de la vie privée d’une personne, quelle que soit la notoriété de celle-ci, en s’immisçant dans son intimité, celles-ci ne sauraient passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société (voir, mutatis mutandis, Campmany y Diez de Revenga et López-Galiacho Perona c. Espagne (déc.), no 54224/00, 12 décembre 2000, et MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, § 143, 18 janvier 2011), à supposer même que cette personne ait une certaine notoriété sociale (Von Hannover, précité, § 65). La Cour réaffirme à cet égard que l’intérêt général ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel, voire pour le voyeurisme (Couderc et Hachette Filipacchi Associés [GC], précité, § 101). Elle rappelle que le caractère public ou notoire d’une personne influe sur la protection dont sa vie privée peut bénéficier. Elle relève toutefois qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une personne publique investie de fonctions officielles, donc le droit à préserver le secret de sa vie privée est en principe plus large (Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103).
35. La Cour observe que les juridictions internes ne se sont pas penchées sur ces questions en tant que telles et qu’elles se sont bornées à considérer que la requérante était une personne bien connue du public. Elle note que le fait que la requérante, chanteuse de profession, est connue du public espagnol en tant qu’artiste n’implique pas nécessairement que ses activités ou ses comportements dans la sphère privée puissent être considérés comme relevant de l’intérêt public. Elle note que les émissions basées sur des aspects strictement privés de la vie de la requérante ne comportaient pas la composante essentielle de l’intérêt public à même de légitimer la divulgation de ces informations, et ce malgré la notoriété sociale de l’intéressée, le public n’ayant pas un intérêt légitime à connaître certains détails intimes de la vie de celle-ci. Force est de constater que les invités des émissions litigieuses ont abordé et commenté exclusivement des détails ‑ salaces aux yeux d’un certain type de public – de la vie privée de l’intéressée (voir, mutatis mutandis, Julio Bou Gibert et El Hogar y La Moda S.A., no 4929/02 (déc.), 13 mai 2003). Même si cet intérêt du public existe bel et bien, tout comme il existe pour les chaînes télévisées émettant ce type de programme « à sensation » un intérêt commercial, en l’espèce ces intérêts doivent l’un et l’autre s’effacer devant le droit de la requérante à la protection effective de sa vie privée.
ii. Quant au comportement antérieur de la personne concernée
36. Pour ce qui est du comportement de la requérante avant la diffusion des émissions télévisées litigieuses, la Cour rappelle que les informations portées à la connaissance du public par l’intéressé lui-même cessent d’être secrètes et deviennent librement disponibles (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 52), affaiblissant le degré de protection à laquelle ce dernier pouvait prétendre au titre de sa vie privée. Toutefois, toute tolérance réelle ou supposée d’un individu vis-à-vis de publications portant sur sa vie privée n’est pas de nature à le priver nécessairement de son droit à la protection de celle-ci (Couderc et Hachette Filipacchi Associés [GC], précité, § 130, et Lillo-Stenberg et Sæther c. Norvège, no 13258/09, § 38, 16 janvier 2014) dans le cadre, comme en l’espèce, des émissions de télévision mises en cause.
37. La Cour observe qu’en l’espèce, selon le juge de première instance, la question des goûts sexuels de la requérante n’appartenait plus à la sphère de sa vie privée bien avant la diffusion des émissions de télévision litigieuses et les intervenants dans lesdites émissions s’étaient bornés à faire état de l’existence de rumeurs ayant cours depuis longtemps en Amérique latine. Le juge a également considéré que la relation sentimentale que la requérante entretenait avec R.B. était entrée depuis longtemps dans la sphère publique dès lors que celle-ci en parlait ouvertement. Les propos tenus par les défendeurs dans les trois émissions de télévision en cause n’avaient pas violé, selon le jugement de première instance, le droit de la requérante au respect de sa vie privée, dans la mesure où ils auraient porté sur des aspects de sa vie qui étaient entrés dans la sphère publique et dans l’opinion publique, et où la requérante n’aurait fait montre d’aucun mécontentement à cet égard.
38. La Cour éprouve des difficultés à suivre le raisonnement du juge de première instance quant à l’existence des rumeurs mentionnées. Elle note que les documents produits par le Gouvernement, qui auraient aussi été portés à la connaissance des juridictions internes par les parties défenderesses, font état de rumeurs concernant la requérante et se réfèrent à des propos de tiers à son sujet. Elle observe qu’il s’agit, en tout état de cause, d’affirmations reprises par une pléthore de médias, espagnols et surtout latino-américains, qui se sont fait l’écho des commentaires ou des opinions d’une pléthore de tiers sur la vie privée de la requérante.
39. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le fait pour la requérante d’avoir profité de l’attention de la presse, comme le soutient le Gouvernement, ne saurait donner carte blanche aux chaînes de télévision en cause pour enlever toute protection à l’intéressée contre des commentaires incontrôlés sur sa vie privée.
iii. Quant au contenu, à la forme et aux répercussions des émissions de télévision litigieuses
40. Le Gouvernement estime que les commentaires en cause n’ont pas été obtenus au moyen de méthodes ignobles, qu’ils portaient sur un personnage public ayant toujours exposé sa vie privée et qu’ils n’avaient pas de contenu injurieux (paragraphe 20 ci-dessus). Il ajoute que, pour résoudre le conflit entre les droits fondamentaux en cause, il faut évaluer le zèle avec lequel la requérante protégeait sa vie privée et établir jusqu’à quel point elle a tiré profit de l’exposition publique de sa personne.
41. La Cour rappelle que, dès lors qu’est en cause une information ou des commentaires mettant en jeu la vie privée d’autrui, il incombe aux journalistes – ou à tout intervenant dans des émissions télévisées telles celles de l’espèce – de prendre en compte, dans la mesure du possible, l’impact des informations et des images à publier, avant leur diffusion. En particulier, certains événements de la vie privée et familiale font l’objet d’une protection particulièrement attentive au regard de l’article 8 de la Convention et doivent donc conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution lors de leur traitement (Editions Plon c. France, no 58148/00, §§ 47 et 53, CEDH 2004‑IV). Au demeurant, le fait de répandre de façon indiscriminée des rumeurs non vérifiées et de faire des commentaires, sans contrôle ni limite, sur n’importe quel sujet relatif à la vie privée d’autrui ne devrait pas être vu comme anodin.
42. En tout état de cause, il appartenait aux instances nationales de procéder à une appréciation des émissions télévisées litigieuses de manière à opérer une distinction et une mise en balance entre ce qui était susceptible de toucher au cœur de la vie privée de la requérante et ce qui pouvait présenter un intérêt légitime pour le public.
43. La Cour observe que, dans son jugement, le juge a affirmé que l’homosexualité d’une personne ne devait plus aujourd’hui être vue comme « déshonorante ». Ce magistrat n’a toutefois pas examiné la question de savoir si le fait que des tiers s’expriment ouvertement sur ces aspects de la vie privée de la requérante, dans trois émissions de télévision auxquelles elle n’avait pas été invitée, auxquelles elle n’était pas présente et pour lesquelles elle n’avait pas donné son consentement, avait ou non porté atteinte à la vie privée de la requérante et était ou non protégé par le droit à la liberté d’expression des défendeurs.
44. S’agissant des propos relatifs à la prétendue incitation de la requérante à la consommation de stupéfiants par R.B., la Cour relève que le juge de première instance a noté qu’ils n’avaient été tenus que dans l’une des émissions en cause, et qu’il n’avait pas été suggéré que la requérante eût initié R.B. à la consommation des stupéfiants ou qu’elle lui en eût fourni, mais seulement que leur relation sentimentale orageuse avait pu pousser R.B. à consommer des stupéfiants. Selon le juge de première instance, cela avait porté atteinte au droit à la vie privée non pas de la requérante, mais de R.B. La Cour estime toutefois qu’aucune attention n’a été prêtée au fait que des tiers – les personnes intervenues dans ces émissions – s’étaient permis de questionner le caractère orageux ou non de la relation de la requérante avec son ex-compagnon ni aux libertés qu’ils avaient prises dans leurs propos.
45. Enfin, s’agissant des déclarations relatives à l’existence de mauvais traitements que la requérante aurait infligés à R.B., la Cour observe que, selon le juge de première instance, C., V., Ca. et F.B. s’étaient bornés à répondre par l’affirmative à des questions posées par des tiers et à exprimer leur point de vue sur une relation sentimentale qui, loin de rester dans la sphère intime de la requérante, aurait fait depuis longtemps son entrée dans la sphère publique, et ce avec l’assentiment de cette dernière.
46. La Cour relève que, bien que l’affaire ait été réexaminée en appel et en cassation ainsi que dans le cadre d’un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, les juridictions internes se sont bornées à constater que la prétendue homosexualité, voire la bisexualité, de la requérante n’était pas déshonorante en soi, qu’il n’avait pas été suggéré que la requérante eût incité R.B. à consommer des stupéfiants, mais seulement que leur relation sentimentale orageuse avait pu être à l’origine de la prise de stupéfiants par ce dernier, et que la requérante n’avait pas elle-même démenti certaines rumeurs circulant dans l’opinion publique relativement à sa vie privée. La Cour considère que, grâce à leurs contacts directs et constants avec les réalités du pays, les cours et tribunaux internes se trouvent certes souvent mieux placés que le juge international pour apprécier l’intention des auteurs des commentaires et le but des programmes télévisés ainsi que les réactions potentielles du public aux commentaires en question. Elle observe toutefois qu’aucune réflexion de la sorte ne figurait dans les arrêts rendus en l’espèce, les juridictions nationales n’ayant aucunement procédé à une mise en balance circonstanciée des droits en litige pour apprécier si la « nécessité » de la restriction imposée au droit à la vie privée de la requérante était établie de manière convaincante. Les juridictions en question se sont en effet bornées à considérer que les commentaires en cause ne constituaient pas une atteinte à l’honneur de la requérante. Force est de constater qu’elles n’ont pas examiné les critères à prendre en compte en vue d’une juste appréciation du droit au respect de la liberté d’expression et du droit à la vie privée d’autrui.
47. Enfin, la Cour estime que les motifs définis par les juridictions internes n’étaient pas suffisants pour protéger la vie privée de la requérante et que cette dernière aurait dû bénéficier dans les circonstances de la cause d’une « espérance légitime » de protection de sa vie privée.
48. Dans ces conditions, eu égard à la marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, la Cour conclut que celles-ci ont manqué à leurs obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
ALEXEY PETROV c. BULGARIE du 31 mars 2016 requête 30336/10
Violation de l'article 8 : opération pieuvre en Bulgarie contre la Mafia, le requérant est filmé pendant son arrestation par la police et la vidéo est balancée à la presse !
79. Le requérant allègue que les autorités ont enregistré son arrestation et que la vidéo a été par la suite livrée aux médias. Il allègue que ces agissements des agents du ministère de l’Intérieur n’étaient pas prévus par la législation interne et ne poursuivaient aucun but légitime.
80. Le Gouvernement estime que ce grief est non étayé. En particulier, le requérant n’aurait apporté aucune preuve à l’appui de son allégation selon laquelle l’enregistrement en cause avait été transmis aux médias par le service de presse du ministère de l’Intérieur.
81. La Cour constate que les propos du secrétaire du ministère de l’Intérieur, publiés le 18 février 2010 par un quotidien national, corroborent la version du requérant selon laquelle la vidéo sur l’opération « Pieuvre », contenant des séquences de son arrestation, a été créé et divulguée sur Internet par le service de communication du ministère (voir paragraphe 20 ci‑dessus). Nul ne conteste que cela ait été fait sans l’autorisation de l’intéressé. Sur cet enregistrement, dont la Cour dispose d’une copie (voir paragraphe 11 ci-dessus), le requérant est reconnaissable. La Cour estime que cette situation s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant à l’image, qui fait partie intégrante de sa vie privée (voir, à cet égard, Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 50, CEDH 2004‑VI).
82. En vertu du deuxième paragraphe de l’article 8, pour qu’une telle ingérence soit justifiée, elle doit être d’abord « prévue par la loi ». Sur la base des informations dont elle dispose, la Cour estime que la matière n’était pas régie par une « loi » répondant aux critères fixés par sa jurisprudence, mais qu’il s’agissait plutôt d’une pratique des organes du ministère de l’Intérieur accompagnant les opérations qui suscitaient un grand intérêt de la part du public et des médias (voir, pour un autre exemple de cette pratique, l’arrêt Slavov et autres c. Bulgarie, no 58500/10, § 37, 10 novembre 2015). La Cour note également que le code de procédure pénale bulgare prévoit la possibilité de procéder à des enregistrements vidéo dans le cadre de la procédure pénale quand il s’agit de rassembler des preuves, par exemple lors d’une inspection des lieux du crime, d’une perquisition ou d’un interrogatoire. Or, en l’occurrence ce ne sont pas les mesures d’instruction effectuées au domicile du requérant qui ont été filmées, mais son arrestation. Il n’a donc pas été démontré devant la Cour que l’ingérence en cause était prévue par la loi.
83. Ce constat suffit à la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention.
KAHN c. ALLEMAGNE du 17 mars 2016 requête 16313/10
Non Violation de l'article 8 : Les requérants sont les enfants d'Oliver Kahn, le célèbre gardien de but de la Mannschaft. Leur père a eu une aventure amoureuse avec une jeune femme japonaise. Des photos paraissent dans les journaux allemands avec des textes particulièrement traumatisants pour les enfants du footballeur. Les tribunaux allemands ont constaté l'illégalité des photos et n'ont pas indemnisés les requérants en plus d'astreintes prononcées. La CEDH confirme que l'indemnisation n'est pas nécessaire. Des astreintes d'un montant de 68% des sommes réclamées par les requérants, ont été prononcées et exécutées rapidement alors que les visages des enfants étaient cachés sous des pixels.
63. La Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels le nom ou des éléments se rapportant au droit à l’image. Cette notion comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement. La publication d’une photo interfère dès lors avec la vie privée d’une personne, même si cette personne est une personne publique (Von Hannover c. Allemagne (no 3), no 8772/10, § 41, 19 septembre 2013). Dans la mesure où les requérants fondent leur grief aussi sur le droit au respect de leur vie familiale, la question se pose de savoir si et dans quelle mesure la publication d’une photo interfère aussi dans la vie familiale d’une personne lorsque celle-ci personne est montrée en compagnie de ses parents. La Cour estime cependant qu’elle peut laisser ouverte cette question en l’espèce car la publication des photos litigieuses concerne assurément la vie privée des requérants et elle n’aperçoit pas d’aspects relatifs à la vie familiale des requérants qui ne seraient pas couverts par l’analyse de la conformité des décisions litigieuses avec les obligations positives découlant de l’article 8 sous son volet de vie privée (cf., mutatis mutandis, Anayo c. Allemagne, no 20578/07, § 58, 21 décembre 2010).
64. La Cour observe que les requérants ne se plaignent pas d’une action de l’Etat, mais du manquement de celui-ci à les protéger efficacement contre les publications répétées par l’éditeur de photos les montrant en dépit d’une interdiction prononcée à cet effet. Elle rappelle que si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent nécessiter l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, § 78, CEDH 2013). Cela vaut également pour la protection du droit à l’image contre des abus de la part de tiers (Müller c. Allemagne (déc.), no 43829/07, 14 septembre 2010).
65. Le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des Etats contractants, que les obligations à la charge de l’Etat soient positives ou négatives. En particulier, la Cour a déjà constaté qu’il existe différentes manières d’assurer le respect de la vie privée, notamment en ce qui concerne les questions de compensation pour dommage moral (Armonienė c. Lituanie, no 36919/02, §§ 46-47, 25 novembre 2008, et Biriuk c. Lituanie, no 23373/03, §§ 45-46, 25 novembre 2008 ; voir aussi, mutatis mutandis, Zavoloka c. Lettonie, no 58447/00, § 40, 7 juillet 2009). Par ailleurs, si les autorités nationales étaient amenées à mettre en balance plusieurs droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, notamment les articles 8 et 10 de la Convention, et si cette mise en balance s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que la Cour substitue son avis à celui des juridictions internes (voir, mutatis mutandis, MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011 ; Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 107, CEDH 2012 ; Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 88, 7 février 2012).
66. Cette marge va toutefois de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention (Von Hannover (no 2) précité, §§ 105 et 102, Axel Springer AG, précité, §§ 86 et 81).
67. La Cour note qu’à la suite de la parution de plusieurs photos dans l’un des magazines de l’éditeur, les requérants ont saisi le tribunal régional de Hambourg qui, par ses jugements du 21 janvier 2005, a constaté une violation du droit à l’image des requérants et a interdit toute future publication de photos montrant les requérants sous peine d’astreintes pouvant allant jusqu’à 250 000 EUR. Puis, après que l’éditeur eut publié d’autres photos en dépit de cette interdiction, le tribunal régional, sur action des requérants, a imposé à l’éditeur des sanctions pécuniaires sous forme de trois astreintes.
68. La question qui se pose dès lors en l’espèce n’est pas celle de savoir si les requérants ont bénéficié d’une protection contre les atteintes non contestées à leur droit au respect de la vie privée, mais si, au regard de l’article 8 de la Convention, la protection accordée, c’est-à-dire la possibilité d’obtenir l’imposition des astreintes contre l’éditeur était suffisante, ou si seulement l’octroi d’une compensation pécuniaire était de nature à procurer aux requérants la protection nécessaire contre l’atteinte à leur droit au respect de la vie privée.
69. À cet égard, les requérants font valoir que le montant des astreintes infligées était insuffisant et, par conséquent, que les tribunaux allemands auraient été tenus de leur accorder la compensation pécuniaire réclamée. Le Gouvernement soutient notamment que l’infliction des astreintes a procuré aux requérants une protection suffisante et souligne par ailleurs que même la condamnation de l’éditeur par le tribunal régional le 11 juillet 2008 au paiement de la compensation pécuniaire réclamée n’a pas empêché l’éditeur à publier d’autres photos par la suite (paragraphes 21 et 22).
70. La Cour note d’abord que lorsque la photo ayant fait l’objet de la deuxième astreinte (« la sixième publication ») fut publiée, il n’existait pas encore de sanction pécuniaire à l’encontre de l’éditeur pour manquement à l’interdiction de publication générale de 2005, parce que les requérants n’avaient pas encore saisi le tribunal régional de leur première demande d’astreinte. Elle relève que le tribunal régional a néanmoins augmenté le montant de la deuxième astreinte par rapport à la première. En ce qui concerne la troisième astreinte concernant la huitième publication, la Cour observe que le montant de celle-ci a été doublé par le tribunal régional par rapport à l’astreinte précédente.
71. La Cour relève ensuite, à l’instar du Gouvernement, que les requérants avaient la possibilité de contester le montant des astreintes fixé par le tribunal régional devant la cour d’appel. Or, force est de constater que les requérants n’ont introduit aucun recours contre les trois décisions d’astreinte dont deux n’ont par ailleurs été confirmées par la cour d’appel que parce que l’éditeur avait formé un recours. La Cour observe notamment que les requérants n’ont pas expliqué pourquoi un tel recours à la cour d’appel aurait été voué à l’échec ou n’aurait pas été capable de remédier à la fixation d’une astreinte à leurs yeux trop faible.
72. La Cour note aussi que les requérants ont retiré leur demande devant le tribunal régional portant sur une quatrième astreinte au motif que cette demande n’avait plus de chance d’aboutir à la suite de l’arrêt de la Cour fédérale de justice du 6 octobre 2009. Sur ce point, la Cour observe que la jurisprudence de la Cour fédérale de justice mettant en cause la possibilité de prononcer des interdictions de publication générales est antérieure à cet arrêt (voir paragraphe 44). Cela étant, les requérants ont néanmoins obtenu l’infliction d’astreintes à l’encontre de l’éditeur, et notamment l’imposition de la troisième astreinte en juillet 2009. La Cour note par ailleurs que, dans son arrêt du 6 octobre 2009, la Cour fédérale de justice a indiqué que la situation des requérants était différente en raison du caractère définitif de l’interdiction de publication générale prononcée en 2005 (voir paragraphes 36-38), si bien que sa nouvelle jurisprudence ne semble pas avoir nécessairement fait obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’astreinte après octobre 2009. Au vu de ces circonstances, la Cour ne saurait spéculer ni sur le résultat de la quatrième procédure d’astreinte si les requérants avaient maintenu leur demande, ni sur le résultat d’une éventuelle demande de compensation pécuniaire fondée sur la nouvelle jurisprudence de la Cour fédérale de justice.
73. La Cour note que le résultat des actions dont les requérants ont fait usage était que l’éditeur était obligé de payer des astreintes d’un montant correspondant à environ 68 % de la somme réclamée par les requérants dans la procédure litigieuse. Par ailleurs, la procédure d’astreinte revêtait un caractère rapide et simplifié dans la mesure où le tribunal régional s’était limité à constater que l’éditeur avait enfreint l’interdiction générale de publication tout en ajoutant quelques considérations pour apprécier les montants appropriés – et croissants – des astreintes.
74. Dans ce contexte, la Cour estime aussi nécessaire de prendre en considération la nature des publications litigieuses dont, il convient de le rappeler, l’illégalité a été constatée par les tribunaux internes et n’est pas contestée par les parties. Elle note que la cour d’appel a estimé que si la publication avait enfreint le droit à l’image des requérants, l’ingérence ne revêtait pas une gravité particulière qui aurait justifié ou rendu nécessaire l’octroi d’une compensation financière. La Cour fédérale de justice, quant à elle, a précisé que les requérants (dont les visages n’étaient pas visibles ou pixellisés) ne pouvaient être identifiés sur les photos que par le biais des photos de leurs parents et par les textes accompagnant et que le sujet déterminant des reportages n’était pas les requérants, mais la relation de leurs parents à la suite de l’échec du mariage de ceux-ci. La Cour peut souscrire aux conclusions des tribunaux allemands que la nature des photos publiées ne commandait pas l’octroi d’une compensation supplémentaire. Elle note par ailleurs que, d’après la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (paragraphes 37-38, et aussi 44-46) et contrairement à ce que prétend la tierce partie, la possibilité d’obtenir une compensation pécuniaire n’est pas exclue du seul fait que l’intéressé peut demander l’infliction d’astreintes à l’encontre de l’éditeur, mais que cette question dépend avant tout de la gravité de l’atteinte et de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
75. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’on ne saurait soutenir que la protection offerte par les tribunaux allemands aux requérants n’était pas efficace ni suffisante au regard des obligations positives pesant sur l’Etat et qu’elle aurait vidé la substance du droit des requérants au respect de leur vie privée (Armoniené, précité, § 46 ; Biriuk précité, § 45). En particulier, on ne saurait tirer de l’article 8 de la Convention le principe que, pour protéger la vie privée d’une personne de manière effective, la condamnation d’un éditeur au paiement d’une somme pour avoir enfreint une interdiction de publier ne saurait être suffisante que si cette somme revient à la victime, si tant est que l’Etat, dans l’exercice de sa marge d’appréciation qui lui revient dans ce domaine, met à la disposition des personnes lésées d’autres moyens qui peuvent se révéler effectifs et dont on ne saurait dire qu’ils limitent la possibilité d’obtenir le redressement des violations alléguées de manière disproportionnée (cf. Müller précitée).
76. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les autorités allemandes n’ont pas manqué à leurs obligations positives à l’égard des requérants et leur ont procuré une protection suffisante au regard de l’article 8 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cet article.
VAN HANNOVER C. ALLEMAGNE du 19 Septembre 2013 requête 8772/10
Les juridictions allemandes ont respecté un équilibre s’agissant du respect de la vie privée et familiale de la princesse Caroline de Hanovre, en refusant d'interdire la publication d'une photo de la princesse dans un journal.
41. La Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels le nom ou des éléments se rapportant au droit à l’image (Von Hannover (no 2), précité, §§ 95-96). Cette notion comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement (Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, § 75, 6 avril 2010, Saaristo et autres c. Finlande, no 184/06, § 61, 12 octobre 2010). La publication d’une photo interfère dès lors avec la vie privée d’une personne, même si cette personne est une personne publique (Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002 ; Von Hannover (no 2), précité, § 95).
42. La présente requête appelle un examen du juste équilibre à ménager entre le droit de la requérante au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention, et le droit de la maison d’édition à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Lors de cet examen, la Cour doit notamment avoir égard aux obligations positives qui incombent à l’Etat au regard de l’article 8 de la Convention et aux principes qu’elle a dégagés dans sa jurisprudence constante quant au rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Elle rappelle en particulier que si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général et de publier des photos. À cette fonction s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (Von Hannover (no 2), précité, §§ 98 et 101-103).
43. Le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des Etats contractants, que les obligations à la charge de l’Etat soient positives ou négatives. La Cour rappelle à ce sujet avoir récemment précisé que cette marge d’appréciation est en principe la même que celle dont les Etats disposent sur le terrain de l’article 10 de la Convention pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cet article (Von Hannover (no 2), précité, § 106, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 87, 7 février 2012).
44. Cette marge va toutefois de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention. Il ne lui appartient en outre pas, ni d’ailleurs aux juridictions internes, de se substituer à la presse dans le choix du mode de compte rendu à adopter dans un cas donnée (Von Hannover (no 2) précité, §§ 105 et 102, Axel Springer AG, précité, §§ 86 et 81).
45. La Cour rappelle que si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, il faut des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011, Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011, von Hannover (no 2), précité, § 107, Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, §§ 66 et 67, 15 mars 2012, et aussi Mouvement raëlien c. Suisse [GC], no 16354/06, § 66, 13 juillet 2012).
46. Dans ses arrêts précités Axel Springer AG et Von Hannover (no 2), la Cour a résumé les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et, en ce qui concerne des photos, les circonstances de leur prise (Von Hannover (no 2), précité, §§ 108-113, Axel Springer AG, précité, §§ 89-95 ; voir également Tănăsoaica c. Roumanie, no 3490/03, § 41, 19 juin 2012).
47. La Cour rappelle d’abord qu’à la suite de l’arrêt Von Hannover de 2004, la Cour fédérale de justice a apporté des modifications à sa jurisprudence antérieure en mettant l’accent sur la question de savoir si le reportage litigieux contribuait à un débat factuel et si son contenu allait au‑delà d’une simple volonté de satisfaire la curiosité du public, et que la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé cette approche (voir Von Hannover (no 2), précité, §§ 114-116).
48. En ce qui concerne l’existence d’un débat d’intérêt général, la Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que si la photo litigieuse ne contenait pas d’informations liées à un événement de l’histoire contemporaine et, de ce fait, ne contribuait pas à un débat d’intérêt général, il en allait autrement de l’article qui rendait compte d’une nouvelle tendance parmi des célébrités de mettre leurs résidences de vacances en location. La Cour rappelle à cet égard que le fait d’apprécier la valeur informative d’une photo à la lumière de l’article que celle-ci accompagne et illustre, ne prête pas à la critique au regard de la Convention (Von Hannover (no 2), précité, § 118).
49. Dans la mesure où la requérante dénonce le risque que les médias contournent les conditions fixées par le juge allemand en utilisant n’importe quel événement de l’histoire contemporaine comme prétexte pour justifier la publication de photos la montrant, la Cour estime qu’il incombe en premier lieu au juge allemand d’apprécier cette question dans chaque cas précis. Elle note à cet égard que la Cour constitutionnelle fédérale et la Cour fédérale de justice ont précisé que, dans l’hypothèse où un article ne serait qu’un prétexte pour publier la photo d’une personne connue du grand public, il n’existerait pas de contribution à la formation de l’opinion publique et il n’y aurait dès lors pas lieu de faire prévaloir l’intérêt de publier sur la protection de la personnalité.
50. La Cour estime que, compte tenu de sa tâche de contrôle européen (voir paragraphe 44 ci-dessus), seules des raisons sérieuses sauraient l’amener à substituer son avis à celui du juge national dans ce contexte, par exemple, lorsque le lien entre la photo litigieuse et le texte l’accompagnant s’avère purement artificiel et arbitraire.
51. Dans la mesure où la requérante dénonce le risque que le juge allemand ne serait pas suffisamment exigeant quant à l’existence d’un débat d’intérêt général, comme ce serait le cas dans la présente affaire, la Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale et, à sa suite, la Cour fédérale de justice, ont relevé que l’intention du reportage était de rendre compte d’une tendance parmi les personnes célèbres de mettre leurs résidences de vacances en location et que ce comportement pouvait donner lieu à des réflexions de la part des lecteurs et, dès lors, contribuer à un débat d’intérêt général. La Cour constitutionnelle fédérale a souligné que les deux phrases écrites en lettres plus grandes au centre de la page confirmaient ce constat. La Cour note de plus que le texte ne donne pratiquement pas d’éléments appartenant à la vie privée de la requérante ou de son mari, mais se consacre pour l’essentiel aux aspects pratiques concernant la villa et sa location.
52. De l’avis de la Cour, on ne saurait dès lors soutenir que l’article n’était qu’un prétexte afin de pouvoir publier la photo litigieuse et qu’il y avait un lien purement artificiel entre les deux. La qualification, par la Cour constitutionnelle fédérale, puis par la Cour fédérale de justice, de l’objet de l’article d’événement d’intérêt général ne saurait passer pour déraisonnable. La Cour peut donc accepter que la photo litigieuse, considérée dans le contexte avec l’article, a apporté, au moins dans une certaine mesure, une contribution à un débat d’intérêt général (cf., mutatis mutandis, Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 45, CEDH 2004‑X ; Von Hannover (no 2), précité, § 118).
53. Pour ce qui est de la notoriété de la requérante, la Cour relève que les juridictions allemandes ont considéré que la requérante était un personnage public. Elle rappelle qu’elle a déjà estimé à plusieurs reprises que la requérante et son mari devaient être considérés comme des personnes publiques (voir les références jurisprudentielles dans Von Hannover (no2), précité », § 120) qui ne peuvent pas prétendre de la même manière à une protection de leur droit à la vie privée que des personnes privées inconnues du public (Von Hannover (no 2), précité, § 110).
54. Pour ce qui est de l’objet du reportage, la Cour renvoie à ses conclusions ci-dessus (paragraphe 51).
55. En ce qui concerne le comportement antérieur de la requérante, la Cour constate que la requérante a montré, notamment par l’introduction d’actions judiciaires (voir, par exemple, les paragraphes 6-8 ci-dessus), qu’elle ne souhaitait pas que des photos sur sa vie privée apparaissent dans la presse. Elle relève en l’espèce que les juridictions allemandes ne se sont pas explicitement penchées sur ce point. Il ressort cependant des conclusions notamment de la Cour fédérale de justice que celle-ci a tenu compte de cette circonstance en substance lors de l’appréciation du degré de notoriété de la requérante et des circonstances de la prise de photo (voir, mutatis mutandis, Küchl c. Autriche, no 51151/06, § 80, 4 décembre 2012 ; Verlagsgruppe News GmbH et Bobi c. Autriche, no 59631/09, § 83, 4 décembre 2012). La Cour en conclut que cet élément a dès lors été suffisamment pris en considération lors de la mise en balance des intérêts divergents en jeu.
56. La Cour note aussi que la Cour constitutionnelle fédérale a qualifiée la photo litigieuse de petit format. La Cour fédérale de justice quant à elle a estimé que la photo en tant que telle n’avait pas d’effet de violation propre. En ce qui concerne enfin les circonstances de sa prise, la Cour observe que la Cour fédérale de justice, dans son deuxième arrêt, a constaté que la requérante n’avait pas soutenu que la photo avait été prise clandestinement ou à l’aide de moyens équivalents et n’avait pas non plus avancé d’autres arguments qui, d’après le concept de protection échelonnée, rendraient la publication illicite en l’absence d’un consentement de la requérante. La Cour en conclut que ces éléments ne commandaient pas un examen plus approfondi, faute d’indications pertinentes de la part de la requérante et en l’absence de circonstances particulières de nature à justifier l’interdiction de la publication de la photo (voir Von Hannover (no2), précité, § 123).
57. La Cour constate que les juridictions nationales ont pris en considération les critères essentiels pour la mise en balance des différents intérêts en jeu, ainsi que la jurisprudence de la Cour.
58. Dans ces conditions, et eu égard à la marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents (Von Hannover (no 2), précité, § 126), la Cour conclut que les juridictions nationales n’ont pas manqué à leurs obligations positives à l’égard de la requérante au titre de l’article 8 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
LE SECRET BANCAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 8
G.S.B. c. SUISSE du 22 décembre 2015 Requête 28601/11
Non violation de l'article 8 : La fin du secret bancaire en Suisse , la transmission des relevés de comptes aux USA est conforme à la Convention.
LES FAITS
A LA FIN DU SECRET BANCAIRE EN SUISSE
8. Au cours de l’année 2008,
l’administration fiscale américaine (l’Internal Revenue Service [IRS], à Washington)
découvrit – essentiellement à partir d’une dénonciation
émanant d’un ex‑employé de la banque UBS SA à Genève, ancien gestionnaire de
patrimoine pour la clientèle privée nord-américaine – que des milliers de
contribuables de nationalité américaine étaient titulaires auprès d’UBS de
comptes bancaires non déclarés à leurs autorités nationales, ou bien ayants
droit économiques vis-à-vis de tels comptes.
Du fait du rôle qu’elle semblait avoir joué à cet égard, la banque fut mise devant le risque d’un procès pénal.
9. Le 18 février 2009, un « accord sur la suspension de poursuites pénales » (deferred prosecution agreement, ou « DPA ») fut conclu entre UBS SA et le département de la Justice (DOJ) des États-Unis. La banque y reconnaissait avoir notamment permis à des contribuables américains, par le biais de comptes extraterritoriaux (off-shore), de dissimuler leur fortune et leurs revenus aux autorités fiscales américaines, et avoir rencontré et conseillé sur place, aux États-Unis, des clients qui n’avaient pas déclaré leurs comptes au fisc américain. L’abandon des poursuites était convenu en contrepartie du paiement d’une somme transactionnelle (settlement amount) de 780 millions de dollars américains (USD).
10. Le 19 février 2009, l’IRS introduisit devant le même tribunal une procédure civile (dite John Doe summons, ou « JDS ») tendant à ce qu’il soit enjoint à UBS SA de livrer l’identité de ses 52 000 clients américains et un certain nombre de données sur les comptes dont ils étaient titulaires auprès d’elle.
11. La Suisse ayant émis la crainte que le différend entre les autorités américaines et UBS n’engendre un conflit entre le droit suisse et le droit américain si l’IRS obtenait ces informations, la procédure civile fut suspendue dans la perspective d’une conciliation extrajudiciaire.
12. Afin de permettre l’identification des contribuables concernés, le Conseil fédéral (gouvernement) de la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique (« les États-Unis ») conclurent le 19 août 2009 un « Accord concernant la demande de renseignements de l’Internal Revenue Service des États-Unis relative à la société de droit suisse UBS SA » (dit « Accord 09 » ; paragraphe 30 ci-dessous).
Selon l’article premier de l’Accord 09, la Suisse s’engageait à traiter la demande d’entraide administrative des États-Unis concernant les clients américains d’UBS SA selon les critères établis dans l’annexe dudit accord et conformément, par ailleurs, à la Convention du 2 octobre 1996 entre la Suisse et les États-Unis en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (CDI-US 96 ; paragraphe 29 ci-dessous).
Sur la base desdits critères, les parties à l’Accord 09 estimaient que la demande d’entraide administrative portait sur « environ 4 450 comptes ouverts ou clos ».
La Suisse s’engageait en outre à créer « une unité opérationnelle spéciale » permettant à l’Administration fédérale des contributions (AFC) suisse de rendre dans certains délais ses décisions finales dans le cadre de la demande d’entraide administrative.
En contrepartie, l’accord prévoyait que les États-Unis et UBS SA présenteraient au tribunal américain du district sud de Floride une requête conjointe tendant au classement de la demande d’exécution du John Doe summons (voir l’article 3 de l’Accord 09 ; paragraphe 30 ci‑dessous).
13. Le 31 août 2009, l’IRS adressa à l’AFC une demande d’entraide administrative, en vue d’obtenir des informations sur les contribuables américains qui, dans la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2008, avaient eu « le droit de signature ou un autre droit de disposer » des comptes bancaires « détenus, surveillés ou entretenus par une division d’UBS SA ou une de ses succursales ou filiales en Suisse ».
14. Le 1er septembre 2009, l’AFC prit une décision imposant à UBS SA de fournir des renseignements au sens de l’ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention américano-suisse du 2 octobre 1996 sur la double imposition (CDI-US 96, voir paragraphe 29 ci-dessous). Elle décida d’ouvrir une procédure d’entraide administrative et demanda à UBS SA de fournir en particulier les dossiers complets des clients visés par l’annexe de l’Accord 09.
15. Par un arrêt du 21 janvier 2010 (A-7789/2009), le Tribunal administratif fédéral (TAF) admit un recours contre une décision de l’AFC qui concernait, dans le cadre de l’annexe à l’Accord 09, une contestation relevant de la catégorie définie sous le point 2/A/b. Dans ses motifs, le TAF considéra :
– que l’Accord 09 était un accord mutuel, qui devait rester à l’intérieur du cadre fixé par la convention dont il dépendait, à savoir la CDI-US 96 ;
– qu’aux termes de cette dernière, l’entraide administrative était accordée en cas de fraude fiscale, mais pas en cas de soustraction à l’impôt (c’est‑à‑dire, de simple omission de déclarer un compte bancaire au fisc ; sur cette distinction en droit fiscal suisse, voir paragraphes 36 et 37 ci‑dessous) ;
– que, partant, la CDI-US 96 ne permettait l’échange d’informations qu’en cas de « fraude ou délit semblable » au sens du droit suisse, c’est‑à‑dire en cas d’escroquerie fiscale (soustraction à l’impôt par le biais d’un montage astucieux) ou d’usage de faux dans les titres ;
– qu’au vu des obligations qu’il mettait à la charge de la Suisse, cet accord aurait dû revêtir la forme d’un traité international ratifié par le parlement fédéral suisse et être soumis à « référendum facultatif » ;
– que, partant, la forme d’un simple accord amiable conclu par le Conseil fédéral seul était insuffisante.
En conséquence, le Tribunal administratif fédéral invalida les décisions rendues par l’AFC sur la base de l’Accord 09.
16. Avec l’entrée en force de cet arrêt du TAF du 21 janvier 2010, l’application de l’Accord 09 se trouvait remise en cause.
En effet, sur les quelque 4 450 cas individuels visés par cet accord, environ 4 200 concernaient des cas de soustraction continue à l’impôt atteignant une ampleur importante. Or, de l’avis du gouvernement suisse, l’impossibilité de fournir une entraide administrative dans ces cas était de nature à mettre la Suisse en grande difficulté dans ses relations bilatérales avec les États-Unis. Le Conseil fédéral estima qu’il était probable que les États-Unis imposeraient des mesures compensatoires et qu’il fallait s’attendre, au minimum, à ce qu’ils réactivent la procédure d’exécution pour les clients d’UBS par la voie de l’entraide administrative. Un tribunal américain pourrait alors, craignait-il, condamner UBS SA à fournir à l’IRS les données en question et faire exécuter le jugement au moyen d’astreintes très élevées.
Afin d’éviter cela, après de nouvelles négociations avec les États-Unis, le Conseil fédéral conclut le 31 mars 2010 un « Protocole modifiant l’Accord entre la Suisse et les États-Unis concernant la demande de renseignements de l’IRS relative à la société de droit suisse UBS SA, signé à Washington le 19 août 2009 », dit « Protocole 10 ».
Les dispositions de ce protocole venaient s’intégrer à l’Accord 09. Elles étaient applicables à titre provisoire dès le jour de sa signature par les parties.
17. Par un arrêté fédéral du 17 juin 2010 « portant approbation de l’Accord entre la Suisse et les États-Unis concernant la demande de renseignements relative à UBS SA, ainsi que du protocole modifiant cet accord », l’Assemblée fédérale (parlement suisse) approuva l’Accord 09 et le Protocole 10, et autorisa le Conseil fédéral à les ratifier.
La version consolidée de l’Accord 09 tel que modifié par le Protocole 10 est parfois désignée sous l’appellation de « Convention 10 » (voir au paragraphe 30 ci-dessous la traduction française du texte, l’original étant rédigé en anglais).
L’arrêté fédéral susmentionné précisait que la possibilité de référendum facultatif prévue par l’article 141 de la Constitution fédérale pour certains traités internationaux conclus par la Suisse (paragraphe 35 ci-dessous) n’était pas ouverte en l’espèce.
18. Le 15 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral rendit un arrêt dans une affaire pilote (A-4013/2010) au sujet de la validité de la Convention 10. Dans cet arrêt, le TAF jugea :
– que la Convention 10 le liait pleinement au sens de l’article 190 de la Constitution (voir paragraphe 34 ci-dessous) ;
– que le droit international ne connaissait pas de hiérarchie matérielle (hormis la prééminence du ius cogens) ; et que, partant, la Convention 10 était de même rang que la CDI-US 96 ;
– que la CDI-US 96 étant, tout comme la Convention (de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« Pacte ONU II »), antérieure à la Convention 10, ses dispositions ne trouvaient application que pour autant qu’elles n’étaient pas contredites par les règles de cette dernière, la Convention 10 primant en vertu de sa postériorité.
B. La procédure concernant le requérant
1. L’origine de l’affaire
19. Le dossier du requérant fut transmis par UBS à l’AFC le 19 janvier 2010.
Dans sa décision finale, qui fut prise le 7 juin 2010, l’AFC retint que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l’entraide administrative à l’IRS et ordonner que lui soient fournis les documents édités par UBS SA.
20. Le 7 juillet 2010, le requérant introduisit un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par un arrêt du 21 septembre 2010, sans entrer dans l’examen de sa légalité intrinsèque, le tribunal annula la décision du 7 juin 2010, en relevant que le droit du requérant d’être entendu n’avait pas été respecté. En conséquence, il renvoya l’affaire à l’AFC pour qu’elle donne l’occasion au requérant de présenter ses observations et rende une nouvelle décision au sujet de l’entraide administrative à accorder ou non aux autorités américaines dans son cas.
21. Par une lettre du 28 septembre 2010, l’AFC impartit au requérant un délai allant jusqu’au 29 octobre 2010 pour transmettre ses éventuelles observations avant qu’une nouvelle décision ne soit rendue.
Le 13 octobre 2010, le requérant déposa l’exposé de sa position.
Dans sa décision finale du 4 novembre 2010, l’AFC considéra derechef que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l’entraide administrative à l’IRS et enjoindre à UBS SA de lui communiquer les documents demandés.
22. Le 8 décembre 2010, le requérant forma un recours contre la décision du 4 novembre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il dénonçait, en substance, l’absence de base légale des décisions du 1er septembre 2009 et du 4 novembre 2010, ainsi que la violation de la Convention et d’autres traités internationaux, à travers notamment le non‑respect selon lui de l’interdiction de la rétroactivité des lois, du droit au respect de sa vie privée, de la présomption d’innocence, du principe de l’égalité et de la non-discrimination, ou encore de son droit de se taire.
2. L’arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 2 mars 2011
23. Statuant en tant que dernière instance nationale, le Tribunal administratif fédéral rendit son arrêt le 2 mars 2011.
Il jugea tout d’abord, en substance, que la Convention 10 liait les autorités suisses, considérant que celles-ci n’avaient pas à vérifier sa conformité au droit fédéral et aux conventions antérieures.
Se référant ensuite à l’affaire pilote A-4013/2010 du 15 juillet 2010 (voir paragraphe 18 ci-dessus), le Tribunal administratif fédéral s’exprima comme suit :
« 3.2. La décision du 1er septembre 2009 de l’AFC à l’égard d’UBS SA ne porte pas sur l’octroi de l’entraide administrative. Il s’agit simplement d’une décision par laquelle l’autorité inférieure a requis d’UBS SA des renseignements au sens de l’article 20c alinéa 3 CDI-US 96. Dès lors, il y a lieu d’admettre que l’Accord 09, en relation avec la disposition précitée, constituait une base légale suffisante pour permettre à l’AFC de prendre une décision à l’encontre d’UBS SA, exigeant en particulier que les dossiers complets des clients tombant sous l’annexe à l’Accord 09 lui soient fournis. Dans ces conditions, le grief du recourant est mal fondé.
4.1.1. Dans l’affaire pilote A-4013/2010 du 15 juillet 2010, le Tribunal de céans est arrivé à la conclusion que la Convention 10 était contraignante pour les autorités suisses. Ni le droit interne ni la pratique interne des autorités ne permettaient d’y déroger. Il a exposé que, en vertu de l’article 190 [de la Constitution], les autorités étaient tenues d’appliquer le droit international, dont fait en particulier partie la Convention 10 et que – en tout état de cause – la conformité du droit international avec la constitution fédérale et les lois fédérales ne pouvait être examinée lorsque le droit international était plus récent. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi admis que la Convention 10 devait être appliquée, même si elle était contraire à la constitution fédérale ou à des lois fédérales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A‑4013/2010 du 15 juillet 2010 considérant 3 et les références citées ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7014/2010 du 3 février 2011 considérant 4.1.1 et les références citées, A-4835/2010 du 11 janvier 2011 considérant 5.1.1 et A‑6053/2010 du 10 janvier 2011 considérant 2.1).
4.1.2 Concernant plus précisément la relation entre les différentes conventions (la Convention 10, la CDI-US 96 [en particulier son article 26], la CEDH [en particulier son article 8] et le Pacte ONU II [en particulier son article 17]), il a indiqué qu’elle était déterminée d’après les seules règles de l’article 30 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (CV) et que le droit international ne connaissait pas – à l’exception de la prééminence du ius cogens – de hiérarchie matérielle. Le Tribunal de céans a ainsi considéré que les règles de la Convention 10 primaient sur les autres dispositions de droit international, y compris l’article 8 CEDH et l’article 17 Pacte ONU II, ces deux dernières dispositions ne contenant pas de ius cogens. Il a toutefois retenu que, même si l’article 8 alinéa 1 CEDH était applicable, les conditions prescrites à l’article 8 alinéa 2 CEDH, qui permet de restreindre le droit au respect de la vie privée et familiale, étaient réalisées. La Convention 10 était en effet une base juridique suffisante à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Les importants intérêts économiques de la Suisse ainsi que l’intérêt à pouvoir respecter les engagements internationaux pris prévalaient en outre sur l’intérêt individuel des personnes concernées par l’entraide administrative à tenir secrète leur situation patrimoniale (...).
4.1.3 Le Tribunal de céans a également exposé, dans l’arrêt A-4013/2010 précité, que l’article 7 alinéa 1 CEDH (pas de peine sans loi) n’était pas pertinent en matière de procédure d’entraide administrative. Cette disposition était exceptionnellement applicable dans le cadre de la procédure d’entraide suisse si la personne concernée par l’entraide était menacée, dans l’État requérant, par une procédure violant l’article 7 CEDH (...). Or, tel n’était pas le cas en l’espèce (...).
4.1.5 Le Tribunal de céans a aussi jugé que les parties à un accord international étaient libres de prévoir expressément ou de manière implicite son application rétroactive (...). Des règles de procédure pouvaient par ailleurs être appliquées de manière rétroactive à des faits antérieurs, car l’interdiction de la non-rétroactivité ne valait que pour le droit pénal matériel et non pas pour le droit de procédure, dont les dispositions en matière d’entraide administrative faisaient partie (...). Par ailleurs, les parties à la Convention 10 avaient voulu qualifier différemment des faits qui s’étaient déroulés antérieurement à la signature de l’Accord 09, ce qui était communément appelé « effet rétroactif ». Cette volonté d’appliquer avec effet rétroactif l’Accord 09 – devenu la Convention 10 – ressortait clairement des critères pour accorder l’entraide fixés dans l’annexe à la Convention 10. Bien que les parties eussent précisé, à l’article 8 de la Convention 10, que cette dernière entrerait en vigueur au moment de sa signature, elles avaient voulu cet effet rétroactif (...).
4.1.7. En l’espèce, il y a lieu de constater, à la lumière des arrêts susdits, que les objections suivantes relatives à la validité et à l’applicabilité de la Convention 10 peuvent sans autre être écartées : contradiction avec la CEDH et d’autres traités internationaux, violation du principe de l’interdiction de la rétroactivité des lois (cf. article 7 CEDH et article 15 Pacte ONU II), ainsi que violation du droit au respect de la sphère privée (cf. article 8 CEDH). De plus, contrairement à l’opinion du recourant, la Convention 10 est en l’occurrence une base légale suffisante pour accorder l’entraide et ce nonobstant la non-soumission au référendum (facultatif). Enfin, même si la Suisse ne pouvait – dans le cas précis – obtenir les mêmes informations selon son propre droit, elle reste liée par ses engagements internationaux et doit accorder l’entraide lorsque les conditions sont remplies.
4.2. Le recourant considère en outre que la Convention 10 violerait le principe de l’égalité et celui de non-discrimination, en pénalisant uniquement une certaine catégorie de personnes, c’est-à-dire les clients d’UBS SA. La Convention 10 ne s’appliquerait en effet qu’aux clients d’UBS SA et non pas aux clients d’autres banques. Le recourant invoque les articles 8 Cst., 14 CEDH, 2 paragraphe 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I ; RS 0.103.1) ainsi que 2 paragraphe 1 et 26 Pacte ONU II.
Comme exposé ci-avant, le Tribunal de céans ne peut pas vérifier la conformité de la Convention 10 avec la constitution fédérale et les lois fédérales. Celle-là prime en outre les accords internationaux antérieurs qui lui seraient contraires (cf. considérant 4.1.2 ci-avant). La Convention 10 doit dès lors être appliquée même si elle instaure un régime juridique différent pour les clients d’UBS SA par rapport à des clients d’autres banques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7156/2010 du 17 janvier 2011 considérant 5.2.1).
(...). »
24. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral rejeta le recours du requérant.
3. Développements ultérieurs
25. Le 24 mars 2011, le requérant forma un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, au motif que les considérations de l’arrêt attaqué seraient propres à l’entraide pénale et non pertinentes en matière d’entraide administrative.
Par un arrêt du 11 avril 2011, celui-ci déclara le recours irrecevable, en renvoyant essentiellement à un arrêt du 20 décembre 2010 (ATF 137 II 128) selon lequel les recours dirigés contre les décisions de l’AFC rendues en application de la convention de double imposition et des accords ultérieurs passés avec les États-Unis relevaient bien de l’entraide administrative.
26. Le 14 décembre 2012, les données bancaires concernant le requérant ont été transmises aux autorités fiscales américaines.
LE DROIT DEVANT LA CEDH
1. Existence d’une ingérence
48. Le requérant soutient que la décision de l’Administration fédérale des contributions (AFC) ordonnant à UBS SA de lui transmettre tous les dossiers répondant aux critères de l’Annexe ainsi que celle de donner suite à la requête de l’IRS (Internal Revenue Service) constituent des ingérences dans sa vie privée et sa correspondance.
49. Le Gouvernement ne conteste pas que la mesure incriminée constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8.
50. La Cour ne voit pas de raison de mettre en doute les opinions exprimées par les parties. Dès lors, il convient d’admettre que le requérant a été victime d’une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée au plus tard le 14 décembre 2012, lorsque ses données bancaires ont effectivement été transmises aux autorités fiscales américaines (paragraphe 26 ci-dessus).
51. Il n’est pas douteux non plus que des informations relevant des comptes bancaires sont à considérer des données personnelles protégées par l’article 8 de la Convention (M.N. et autres c. Saint-Marin, no 28005/12, § 51, 7 juillet 2015, avec d’autres références).
2. Justification de l’ingérence
52. Pareille ingérence enfreint l’article 8, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a) « Prévue par la loi »
i. Les thèses des parties
α) Le requérant
53. Pour ce qui est de la base légale de l’ingérence, le requérant expose trois séries d’arguments.
Premièrement, il rappelle que l’Accord 09 et le Protocole 10 n’ont pas été soumis à « référendum facultatif », comme le prévoyait le droit suisse pour les traités contenant des dispositions importantes fixant des règles de droit, ce qui était selon lui le cas en l’espèce.
Le requérant ne partage pas l’avis du Tribunal administratif fédéral (TAF) selon lequel, du fait que la Suisse est liée sur le plan international par l’accord, les autorités suisses sont tenues de l’appliquer en vertu de l’article 190 de la Constitution fédérale (voir ci-dessous) indépendamment de toute méconnaissance éventuelle des formalités applicables à son adoption.
54. Deuxièmement, le requérant estime que la condition de prévisibilité n’était pas remplie, faisant valoir que l’Accord 09 et le Protocole 10 étaient d’application rétroactive.
Pour le requérant, l’exigence d’une base légale pour toute ingérence dans la vie privée trouve son fondement dans l’impératif de la sécurité juridique, qui constitue l’un des éléments fondamentaux de l’État de droit.
Or, explique-t-il, entre 2001 et 2008 l’entraide internationale entre la Suisse et les États-Unis en matière fiscale était régie par la CDI-US 96, qui excluait l’échange d’informations en cas de simple « soustraction » fiscale. Le requérant estime donc qu’à cette époque, les contribuables américains qui possédaient un compte non déclaré chez UBS SA pouvaient escompter que la Suisse ne donnerait aucune suite à une éventuelle demande des États-Unis au titre de l’entraide administrative. En l’élargissant aux simples cas de soustraction fiscale, l’Accord 09 tel qu’amendé par le Protocole 10 a modifié radicalement, à ses yeux, les conditions d’octroi de l’entraide administrative internationale.
55. Troisièmement, le requérant fait valoir qu’à la date de la décision rendue par l’AFC à l’encontre d’UBS SA concernant la remise des dossiers des clients remplissant les critères de l’Accord 09, soit le 1er septembre 2009, cet instrument n’avait pas encore été approuvé par le parlement fédéral.
56. De tout ce qui précède, le requérant conclut que les mesures incriminées ne reposaient pas sur une base légale suffisante.
β) Le Gouvernement
57. Sur le premier point soulevé par le requérant, le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qu’affirme ce dernier, l’Accord 09 n’entrait pas dans le champ d’application du « référendum facultatif ». Aux termes de l’article 141 lettre d) ch. 3) de la Constitution fédérale (paragraphe 35 ci‑dessus), le droit de réclamer l’organisation d’un référendum à propos d’un traité international ne concerne que les traités qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
La notion de « dispositions importantes fixant des règles de droit » n’étant pas définie, le Gouvernement considère, à titre liminaire, que le parlement dispose d’une certaine marge d’appréciation dans l’application de ladite disposition.
58. Au soutien du choix ainsi opéré, le Gouvernement souligne que le Conseil fédéral a exprimé l’avis, partagé par le parlement fédéral, selon lequel l’ensemble formé par l’Accord 09 et le Protocole 10 ne contenait pas de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l’article 141 de la Constitution fédérale, et n’avait donc pas lieu d’être exposé à l’éventualité d’un référendum sur demande.
59. Un argument supplémentaire en faveur de l’existence d’une base légale suffisante peut être trouvé, selon le Gouvernement, dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. En effet, aux termes de l’article 46 de celle-ci, le fait que le consentement d’un État à être lié par un traité ait été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été « manifeste » (c’est-à-dire – selon l’alinéa 2 du même article – objectivement évidente pour tout État se comportant en la matière conformément au principe de la bonne foi) et ne concerne une règle de droit interne d’importance fondamentale.
Or, en l’espèce, renvoyant à ce qui est exposé plus haut, le Gouvernement estime que l’on ne saurait prétendre que ne pas soumettre l’Accord 09 et le Protocole 10 au référendum facultatif constituait une violation « objectivement évidente » de l’article 141 de la Constitution fédérale.
60. Sur le deuxième point soulevé par le requérant – à savoir, que l’Accord 09 ne remplirait pas le critère de la prévisibilité, de par son application rétroactive –, le Gouvernement rappelle (en citant à titre d’exemple l’affaire Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII) qu’il est communément admis que, sauf disposition expresse contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours.
61. Le Gouvernement ajoute que, dans l’article 28 de la Convention de Vienne, précitée, l’énoncé du principe selon lequel une partie n’est pas liée par les dispositions d’un traité en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à sa date d’entrée en vigueur au regard de cette partie, ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date, est accompagné de la mention « à moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie » (paragraphe 34 ci-dessus). Les parties à un traité international sont donc libres, en déduit-il, de convenir de l’application rétroactive de ses dispositions.
62. Le Gouvernement fait également valoir que, selon une jurisprudence constante en Suisse, les dispositions sur l’entraide administrative et pénale s’appliquent en principe à toutes les procédures en cours ou à venir, y compris lorsque ces procédures portent sur des exercices fiscaux antérieurs à leur adoption (arrêts du Tribunal fédéral (ATF) 2A.551.20001, 12 avril 2002, cons. 2 ; 2A.250/2001, 6 février 2002, cons. 3 ; paragraphe 39 ci-dessus). Dès lors, il n’y a selon lui rien d’anormal à ce que l’Accord 09, conclu le 19 août 2009, soit venu régler l’entraide administrative pour le recouvrement d’impôts se rapportant à des avoirs détenus entre 2001 et 2008 : l’entraide administrative relevant du droit procédural selon la jurisprudence en question, l’interdiction de la rétroactivité ne trouvait pas à s’appliquer.
63. Le Gouvernement expose plusieurs raisons justifiant, selon lui, l’application rétroactive du dispositif en question.
Tout d’abord, explique-t-il, les conséquences juridiques auxquelles le requérant se trouve exposé à la suite de la transmission de données concernant ses comptes chez UBS SA relèvent du droit matériel américain tel qu’il était en vigueur durant la période considérée, à savoir les années 2001-2008.
Ensuite, en se référant aux affaires Cantoni c. France (15 novembre 1996, § 35, Recueil 1996‑V), et Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (nos 11082/06 et 13772/05, § 784, 25 juillet 2013), le Gouvernement estime que comme tout contribuable, évoluant de surcroît dans le monde des affaires, le requérant devait connaître ses obligations fiscales et les risques qu’il encourait en les contournant.
64. Pour le Gouvernement, le requérant ne pouvait raisonnablement exclure, en s’entourant de conseils juridiques, que le principe de la « rétroactivité » des normes de procédure soit un jour appliqué aux dispositions d’entraide administrative en matière fiscale entre la Suisse et les États-Unis ; et cela d’autant plus que la pression exercée à cette fin par les États-Unis et au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) était connue de longue date.
65. Le Gouvernement invite également à garder en vue l’objet de l’interdiction de la rétroactivité : à ses yeux, ce principe vise à permettre aux personnes concernées de prévoir les conséquences de droit matériel pouvant résulter d’un acte incriminé, mais pas à protéger des comportements qui visent sciemment à contourner le droit matériel par des astuces fondées sur le droit procédural applicable.
66. Enfin, sur le troisième point soulevé par le requérant – à savoir, le fait que l’Accord n’avait pas encore été approuvé par le parlement au moment de la décision de l’AFC du 1er septembre 2009 –, le Gouvernement objecte que cette décision ne portait pas sur l’octroi de l’entraide administrative mais faisait suite à un examen préalable de la demande par l’AFC et devait permettre à cette dernière d’examiner si les conditions requises pour accorder l’entraide étaient remplies.
En tout état de cause, le Gouvernement fait valoir que l’application à titre provisoire de l’Accord avant l’approbation du parlement a reçu l’aval de ce dernier lors de l’approbation de l’Accord 09 et du Protocole 10.
67. Compte tenu de tout ce qui précède, le Gouvernement est convaincu que l’Accord 09, en combinaison avec la CDI-US, donnait une base légale à la mesure incriminée au regard de l’article 8 § 2.
ii. L’appréciation de la Cour
α) Les principes pertinents
68. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les termes « prévue par la loi » signifient que la mesure litigieuse doit avoir une base en droit interne et être compatible avec la prééminence du droit, expressément mentionnée dans le préambule de la Convention et inhérente à l’objet et au but de l’article 8. La loi doit ainsi être suffisamment accessible et prévisible, c’est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre à l’individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite. Pour que l’on puisse la juger conforme à ces exigences, elle doit fournir une protection adéquate contre l’arbitraire et, en conséquence, définir avec une netteté suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir conféré aux autorités compétentes (Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, §§ 66-68, série A no 82 ; Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 55, CEDH 2000-V ; et Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 56, CEDH 2000-II).
69. Le niveau de précision requis de la législation interne – laquelle ne peut, naturellement, parer à toute éventualité – dépend dans une large mesure du contenu du texte considéré, du domaine qu’il est censé couvrir et du nombre et de la qualité de ses destinataires (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI, et références citées).
70. Par ailleurs, il appartient aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, Recueil 1998-II, § 59 ; et Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A).
β) L’application des principes susmentionnés
71. Le requérant se plaint essentiellement de deux aspects : d’une part, les carences d’ordre formel qui entacheraient la base légale de la mesure litigieuse ; d’autre part, le défaut de prévisibilité de la mesure découlant selon lui de l’application rétroactive des instruments en question.
– Sur le défaut de « référendum facultatif » et d’approbation parlementaire préalable quant à la base légale de la mesure
72. En ce qui concerne le premier aspect, la Cour constate que les opinions des parties diffèrent considérablement en ce qui concerne la question de savoir si, d’un point de vue constitutionnel, ces instruments auraient dû être soumis à la possibilité d’un « référendum facultatif ».
Toutefois, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de trancher cette question, dans la mesure où, comme il ressort de sa jurisprudence ci-dessus rappelée, elle se désintéresse largement de la question de la procédure qui a pu mener à l’adoption de telle ou telle loi invoquée à l’appui d’une ingérence dans un droit protégé par la Convention, la seule limite étant l’arbitraire.
73. À cet égard, la Cour rappelle que l’Accord 09 et le Protocole 10 ont été négociés et conclus par le Conseil fédéral, approuvés par le parlement fédéral puis ratifiés par le gouvernement, selon la procédure de conclusion des traités prévue par le droit constitutionnel. Même à supposer que l’Accord 09 et le Protocole 10 auraient dû être soumis à la possibilité d’un « référendum facultatif », question restant controversée entre les parties, les bases légales de la mesure litigieuse n’en seraient pas pour autant devenues inexistantes.
74. Enfin, dans la mesure où le requérant soutient que la décision de l’AFC du 1er septembre 2009 manquait également de base légale à cause du défaut d’approbation de l’Accord 09 par le parlement à cette date, la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel cette décision ne portait pas sur l’octroi de l’entraide administrative, mais devait simplement permettre à l’AFC d’examiner si les conditions d’octroi de l’entraide étaient remplies. En tout état de cause, l’application immédiate de l’Accord 09 à titre provisoire a été confirmée par le gouvernement lors de son approbation, et celle du Protocole 10 l’a été par le parlement fédéral le 17 juin 2010.
– Sur le défaut allégué de prévisibilité tenant à l’application rétroactive des traités litigieux
75. La Cour rappelle que son rôle est de s’assurer de la qualité de la base légale de l’ingérence, et en particulier de son accessibilité et de la prévisibilité suffisante de son application. En l’espèce, le requérant ne soutient pas que les deux instruments concernés lui auraient été inaccessibles. Par contre, il se plaint du défaut de prévisibilité de leur mise en œuvre.
76. Quant à la prévisibilité de la mesure litigieuse, la Cour rappelle que la Convention ne doit pas être interprétée isolément mais en harmonie avec les principes généraux du droit international. Il convient en effet, en vertu de l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, de tenir compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties », en particulier celles relatives à la protection internationale des droits de l’homme (voir, par exemple, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 131, CEDH 2010, avec les renvois qui y figurent).
Dans le cas d’espèce, la Cour ne considère pas comme dépourvu de pertinence l’argument du Tribunal fédéral et du Gouvernement selon lequel l’article 28 de la Convention de Vienne ménage lui-même la faculté pour les parties à un traité international d’aller à l’encontre du principe de non‑rétroactivité et de prévoir qu’un fait d’occurrence antérieure soit pris en compte.
En ce qui concerne, toutefois, la convention intéressant la Cour au premier chef – la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, instrument déployant des effets juridiques immédiats vis-à-vis des individus –, l’éventuelle application rétroactive d’un autre traité international doit s’apprécier à l’aune des exigences de ses propres dispositions ; et notamment, en l’espèce, de l’article 8.
77. La Cour rappelle que dans son arrêt Brualla Gómez de la Torre (précitée, § 35), cité par le Gouvernement, elle a admis comme un « principe généralement reconnu » celui selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours (voir également Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 148, CEDH 2000-VII). Or, comme le souligne le Gouvernement, aucune exception expresse de cette nature n’existait en l’espèce. La Cour observe qu’il n’est, par ailleurs, pas contesté par le requérant que l’entraide administrative en matière fiscale relève du droit procédural.
78. Dans le présent cas, il existait une jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle les dispositions sur l’entraide administrative et pénale obligeant des tiers à donner certains renseignements sont de nature procédurale et, partant, s’appliquent en principe à toutes les procédures en cours ou à venir, même portant sur des exercices fiscaux antérieurs à leur adoption (paragraphe 39 ci-dessus).
Le requérant, dûment représenté par un avocat devant les instances internes, ne pouvait valablement ignorer cette pratique judiciaire. Partant, il ne saurait arguer devant la Cour que l’ingérence est intervenue d’une manière imprévisible pour lui.
79. De surcroît, on ne saurait prétendre que la pratique auparavant restrictive des autorités suisses en matière d’entraide administrative fiscale avait pu créer dans le chef du requérant l’attente de pouvoir continuer à placer ses avoirs en Suisse en restant à l’abri de tout contrôle de la part des autorités américaines compétentes, ou même seulement de l’éventualité de contrôles rétroactifs (voir, a contrario, Bigaeva c. Grèce, no 26713/05, § 32, 28 mai 2009).
80. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que la mesure litigieuse était « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
b) But légitime
i. Les thèses des parties
81. Le requérant estime que les mesures incriminées ne visaient aucun but légitime au sens de l’article 8 § 2.
Selon lui, le « bien-être économique du pays » ne peut guère être invoqué : l’Accord 09 et le Protocole 10, de même que les décisions prises sur leur fondement, servaient à ses yeux uniquement l’intérêt d’UBS SA, et non celui de la Suisse.
Pour ce qui est de la « prévention des infractions pénales », le requérant estime qu’elle ne peut pas non plus entrer en ligne de compte, la soustraction fiscale étant en droit suisse une simple contravention et non un délit.
82. De son côté, le Gouvernement fait valoir que la transmission à l’IRS des données bancaires relatives au requérant est intervenue dans le cadre de l’entraide administrative fiscale, et qu’elle contribuait à cet égard au maintien de l’ordre et à la prévention de certaines infractions pénales.
De plus, il estime que la présente affaire s’inscrit dans un contexte particulier. Selon lui, l’enjeu était de parvenir à concilier trois préoccupations : la résolution du conflit qui avait pris naissance avec les procédures intentées par l’IRS aux États-Unis ; la garantie aux personnes concernées d’une procédure conforme aux exigences de l’État de droit ; et la prévention de risques économiques importants, non seulement pour UBS SA, mais pour la Suisse entière. Ces objectifs, explique-t-il, ne pouvaient être atteints par le biais d’une mise en œuvre complète des dispositions de l’Accord 09.
Par ailleurs, ajoute le Gouvernement, les mesures contestées servaient également au maintien de la sécurité nationale et au bien-être économique du pays.
ii. L’appréciation de la Cour
83. Le secteur bancaire représentant une branche économique importante pour la Suisse, la Cour estime que la mesure incriminée, qui participait d’une tentative globale du gouvernement suisse de régler le conflit entre UBS SA et les autorités fiscales américaines, pouvait valablement être considérée comme de nature à contribuer à la protection du bien-être économique du pays. À cet égard, elle accepte l’argument du Gouvernement selon lequel les prétentions des autorités fiscales américaines contre les banques suisses pouvaient mettre en danger la survie même d’UBS SA, acteur important de l’économie suisse et employeur d’un nombre considérable de personnes ; d’où l’intérêt, pour la Suisse, de trouver un règlement juridique efficace avec les États-Unis.
84. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la mesure incriminée poursuivait un but légitime au sens de l’article 8 § 2.
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
i. Les thèses des parties
85. Le requérant ne présente aucun argument à cet égard. Il estime, de façon générale, que les idéaux et valeurs d’une société démocratique ne sont pas sauvegardés et promus, mais au contraire heurtés et malmenés, par les décisions litigieuses et les textes sur lesquels elles s’appuient.
86. De son côté, le Gouvernement rappelle que lors de la conclusion de l’Accord 09, la Suisse se trouvait dans une situation délicate, face à un conflit de droit et de souveraineté avec les États-Unis. Dans cette situation particulière, explique-t-il, si la Suisse n’avait pas mis en œuvre les dispositions de l’accord, il y avait lieu de s’attendre à ce que les procédures intentées aux États-Unis soient réactivées, avec toutes les conséquences que cela impliquerait. Le Gouvernement rappelle à cet égard le message du Conseil fédéral relatif à l’approbation de l’Accord 09 et du Protocole 10, d’où il ressort que, compte tenu de l’importance systémique d’UBS SA, sa défaillance aurait causé des dommages considérables au reste du secteur bancaire en Suisse et à l’économie du pays dans son ensemble (paragraphe 32 ci-dessus).
87. Dans ce contexte, le Gouvernement rappelle encore qu’un objectif central de l’Accord 09 et des procédures d’entraide mises en œuvre était de ramener ces procédures dans le cadre légal de la CDI-US 96. Sans quoi, explique-t-il, il fallait s’attendre à ce que les autorités américaines fassent tout ce qui était en leur pouvoir pour se procurer les données en question en agissant directement contre la banque. L’Accord 09 a ainsi permis selon lui de ménager aux personnes concernées – dont le requérant – les garanties d’une procédure ordinaire d’entraide administrative, avec possibilité de recours.
Au sujet du requérant, étant donné les pratiques reconnues par UBS dans le cadre de son accord transactionnel avec les autorités de poursuite (le DPA), le Gouvernement estime qu’il y a tout lieu de croire que celui-ci a profité de services spécifiques de la banque pour dissimuler certains avoirs aux autorités fiscales américaines.
Quand bien même ce ne serait pas le cas, le Gouvernement note que le seul intérêt que le requérant avait à faire valoir contre la transmission aux États-Unis des données le concernant était celui de ne pas être exposé à une procédure fiscale concernant les avoirs en question, soit rien d’autre que d’échapper aux obligations fiscales qui sont les siennes en vertu du droit américain.
88. Compte tenu de tout ce qui précède, le Gouvernement conclut que la mesure était nécessaire dans une société démocratique.
ii. L’appréciation de la Cour
α) Les principes applicables
89. Les organes de la Convention ont eu l’occasion d’établir certains principes régissant la divulgation de données de nature sensible, en particulier médicale (Z. c. Finlande, 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I ; et M.S. c. Suède, 27 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV), concernant la situation financière d’un homme politique (Wypych c. Pologne (déc.), no 2428/05, 25 octobre 2005) ou des données fiscales (Lundvall c. Suède, no 10473/83, décision de la Commission du 1er décembre 1985, Décisions et rapports (DR) 45, p. 121).
90. Il découle des principes posés par ces affaires que la Cour tient compte, en cette matière, du rôle fondamental que joue la protection des données à caractère personnel pour l’exercice du droit au respect de la vie privée garantie par l’article 8. Ainsi, la législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux exigences de l’article 8. Par ailleurs, la Cour admet que la protection de la confidentialité de certaines données personnelles peut parfois s’effacer devant la nécessité d’enquêter sur des infractions pénales, d’en poursuivre les auteurs et de protéger la publicité des procédures judiciaires lorsqu’il s’avère que ces derniers intérêts revêtent une importance encore plus grande. Enfin, la Cour reconnaît qu’il convient d’accorder aux autorités nationales compétentes une certaine latitude pour établir un juste équilibre entre la protection des intérêts publics poursuivis, d’une part, et celle des intérêts d’une partie ou d’une tierce personne à voir de certaines données rester confidentielles, d’autre part (voir notamment Z. c. Finlande, précité, §§ 94, 95 et 97-99).
91. Ces principes concernant la divulgation de certaines informations ont largement été confirmés et développés par la Cour dans des affaires relatives à la conservation d’informations à caractère personnel (voir, en particulier, les affaires S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, CEDH 2008 ; et Khelili c. Suisse, no 16188/07, §§ 61 et suiv., 18 octobre 2011). C’est dans ce cadre que la Cour étudiera l’ingérence litigieuse dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.
β) L’application des principes susmentionnés
92. La Cour constate d’abord que le requérant n’avance pas d’arguments très étayés au soutien de l’idée d’une nature disproportionnée de la mesure litigieuse, se contentant de dire que cette mesure ne poursuivait pas un but légitime.
Elle relève, par contre, que le Tribunal administratif fédéral a jugé que les conditions auxquelles l’article 8 § 2 de la Convention soumet toute ingérence dans la vie privée ou familiale étaient remplies en l’espèce ; et ce, en estimant que les importants intérêts économiques en jeu pour le pays ainsi que l’intérêt pour la Suisse à pouvoir respecter ses engagements internationaux prévalaient sur l’intérêt individuel des personnes concernées par l’entraide administrative à tenir secrète leur situation patrimoniale (cons. 4.1.2 de l’arrêt, paragraphe 23 ci-dessus). Cette argumentation est largement reprise par le Gouvernement dans ses observations devant la Cour.
93. En ce qui concerne l’intérêt privé du requérant, il ressort de la jurisprudence précitée que la protection accordée aux données à caractère personnel dépend d’un certain nombre de facteurs, dont la nature du droit en cause garanti par la Convention, son importance pour la personne concernée, la nature de l’ingérence et la finalité de celle‑ci. Selon l’arrêt S. et Marper (précité, § 102), la marge d’appréciation d’un État est d’autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre « intime » qui lui sont reconnus. Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’État est restreinte.
S’agissant de la situation du requérant, il échet d’observer que seules sont en question ses données bancaires, soit des informations purement financières ; il ne s’agissait donc nullement de données intimes ou liées étroitement à son identité qui auraient mérité une protection accrue. Il s’ensuit que la marge d’appréciation de la Suisse était ample.
94. Se référant à ce qu’elle a observé sur la question du but légitime poursuivi (paragraphes 83 et 84 ci-dessus), la Cour admet que la Suisse avait un intérêt important à donner une suite favorable à la demande d’entraide administrative des États-Unis afin de permettre aux autorités américaines de retracer les avoirs qui pouvaient avoir été dissimulés en Suisse. Par la conclusion de l’Accord 09 et du Protocole 10, elle a pu éviter un conflit majeur avec les États-Unis.
95. En ce qui concerne l’effet pour le requérant de la mesure litigieuse, la Cour observe ici encore que celle-ci intervenait dans le cadre d’une procédure d’entraide administrative, et non d’une procédure pénale menée aux États-Unis, qui restait – et reste encore – purement éventuelle, la première ne constituant tout au plus qu’un stade préalable à la seconde.
En d’autres termes, les données bancaires concernées ont été transmises aux autorités américaines compétentes en vue de permettre à ces dernières de vérifier, dans le cadre des procédures prévues, que le requérant s’était bien acquitté de ses obligations fiscales et, dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, d’en tirer les conséquences juridiques.
96. La Cour observe également que le requérant a bénéficié de certaines garanties procédurales contre le transfert de ses données aux autorités fiscales américaines (voir, a contrario, M.N. et autres c. Saint-Marin, précité, §§ 82 et suiv.). D’abord, il a pu introduire un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l’AFC du 7 juin 2010 (paragraphe 20 ci-dessus). Ce tribunal a par la suite annulé ladite décision à cause d’une violation du droit du requérant d’être entendu. L’AFC a par conséquent invité le requérant à transmettre ses éventuelles observations dans le délai imparti. Le requérant a fait usage de ce droit. Le 4 novembre 2010, l’AFC a rendu une nouvelle décision, dûment motivée, dans laquelle elle est parvenue à la conclusion que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l’entraide administrative. Par la suite, le requérant a pour une deuxième fois saisi le Tribunal administratif fédéral qui l’a débouté par l’arrêt du 2 mars 2011 (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Il s’ensuit que le requérant avait à sa disposition plusieurs garanties effectives et réelles d’ordre procédural pour contester la remise de ses données bancaires et, dès lors, de le protéger contre une mise en œuvre arbitraire des accords conclus entre la Suisse et les États-Unis.
97. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment au vu de la nature peu personnelle des données révélées, il n’était pas déraisonnable pour la Suisse de faire primer l’intérêt général d’un règlement efficace et satisfaisant avec les États-Unis sur l’intérêt privé du requérant. Dès lors, la Suisse n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation.
98. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
PROTECTION DE LA REPUTATION ET DROIT A L'OUBLI
MCCANN ET HEALY c. PORTUGAL du 20 septembre 2022 requête n° 57195/17
Art 8 • Obligations positives • Vie privée • Rejet de l’action civile des requérants accusés du crime contre leur fille disparue par un ancien policier chargé de l’enquête médiatisée classée sans suite pour défaut de preuves • Question d’intérêt public • Requérants, s’étant exposés aux médias, entrés dans la sphère publique • Jugements de valeur fondés sur une base factuelle suffisante • Affaire médiatique amplement débattue avant l’accès du public à l’enquête et la publication du livre • Absence de répercussions sérieuses des affirmations du policier sur les requérants • Mise en balance circonstanciée des intérêts en jeu dans le respect de la jurisprudence de la Cour
CEDH
Principes généraux
78. Si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale. Ces obligations peuvent nécessiter l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, § 78, CEDH 2013, et Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 98, CEDH 2012). La responsabilité de l’État peut ainsi se trouver engagée si les faits litigieux résultent d’un manquement de sa part à garantir aux personnes concernées la jouissance des droits consacrés par l’article 8 de la Convention (Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, § 110, 5 septembre 2017, et Schüth c. Allemagne, no 1620/03, §§ 54 et 57, CEDH 2010). La frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au regard de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu (Von Hannover (no 2), précité, § 99).
79. Le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports entre individus relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants, et ce que les obligations à la charge de l’État soient positives ou négatives (ibidem, § 104, avec les références qui y figurent). De même, sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (ibidem). Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand celles‑ci émanent d’une juridiction indépendante. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions de la Convention invoquées (ibidem, § 105, avec les références citées).
80. Dans les affaires qui nécessitent une mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression, la Cour considère que l’issue de la requête ne saurait en principe varier selon que l’affaire a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet du reportage ou, sous l’angle de l’article 10, par l’éditeur qui l’a publié. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect. Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas (Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 91, CEDH 2015 (extraits) et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 77).
81. Les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression sont les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de l’espèce (voir, Von Hannover (no 2), précité, §§ 108-113, Axel Springer AG, précité, §§ 89-95, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93). Si les autorités nationales ont réalisé cette mise en balance dans le respect de ces critères, il faut des raisons sérieuses pour que la Cour substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011).
82. La Cour rappelle enfin que, pour évaluer la justification d’une déclaration contestée, il y a lieu de distinguer entre déclarations factuelles et jugements de valeur. Si la matérialité des faits peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. L’exigence voulant que soit établie la vérité de jugements de valeur est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10. Toutefois, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive (Do Carmo de Portugal e Castro Câmara c. Portugal, no 53139/11, § 31, 4 octobre 2016, et Egill Einarsson c. Islande, no 24703/15, § 40, 7 novembre 2017).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
83. En l’espèce, les requérants reprochent aux juridictions nationales d’avoir manqué à l’obligation positive, qui leur revenait selon eux, de protéger leur droit à la présomption d’innocence et leur réputation (paragraphe 74 ci-dessus). La Cour relève que les juridictions nationales ont bien cerné les intérêts qui étaient en jeu, à savoir, d’une part, la liberté d’expression et la liberté d’opinion de G.A. et, d’autre part, le droit au respect de la réputation qui était lié au droit à la présomption d’innocence des requérants, et qu’elles ont fait prévaloir les droits du premier sur ceux des seconds. Elles ont également observé que ces droits méritaient égale protection et que, dans ces conditions, il était nécessaire de les mettre en balance (paragraphes 41, 44 et 48 ci-dessus).
84. La question qui se pose est donc celle de savoir si les juridictions nationales ont procédé à une mise en balance de ces droits dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour (paragraphe 81 ci-dessus). Pour les besoins de la présente espèce, la Cour examinera la contribution des éléments litigieux à un débat d’intérêt général, le comportement antérieur et la notoriété des requérants, l’objet du livre, du documentaire et de l’entretien et le mode d’obtention des informations ainsi que le contenu des affirmations litigieuses, leurs répercussions et les circonstances particulières de l’espèce.
La contribution à un débat d’intérêt général
85. En ce qui concerne l’existence d’une question d’intérêt général, la Cour observe que les juridictions nationales ont relevé que l’action pénale ouverte concernant la disparition de la fille des requérants avait eu un grand retentissement médiatique tant au niveau national qu’international et qu’elle avait fait l’objet de nombreux débats (paragraphes 40 (point 76), 45 et 50 ci-dessus). Dans son arrêt du 31 janvier 2017, se référant à la jurisprudence de la Cour, la Cour suprême a conclu que l’affaire constituait une question d’intérêt public (paragraphe 50-52 ci-dessus). Le Gouvernement souscrit à une telle analyse (paragraphe 76 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, il ne fait effectivement pas de doute que le livre de G.A., son adaptation en documentaire et l’entretien accordé par ce dernier au quotidien Correio da Manhã concernaient un débat qui présentait un intérêt public. En effet, l’importante couverture médiatique qu’a reçue l’affaire témoigne bien de l’intérêt qu’elle avait suscité tant au niveau national qu’international. La Cour rappelle à cet égard que le public a un intérêt légitime à être informé et à s’informer sur les procédures en matière pénale (Morice c. France [GC], no 29369/10, § 152, CEDH 2015, et Bédat, précité, § 63). En outre, l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression en ce qui concerne des questions d’intérêt général, la marge d’appréciation des États en la matière étant ainsi réduite (voir, mutatis mutandis, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 167, 27 juin 2017). La Cour estime que cela est le cas en l’espèce (comparer avec Morice, précité, § 153, et Prompt c. France, no 30936/12, § 43, 3 décembre 2015).
86. En ce qui concerne le comportement des requérants avant la publication du livre et la diffusion des autres pièces litigieuses, la Cour note que les juridictions internes ont jugé établi que les requérants avaient informé la presse au sujet de la disparition de leur fille et qu’ils avaient fait appel à des agences de communication et recruté des attachés de presse (paragraphe 40 ci-dessus – voir les faits établis nos 67 et 77). Dans son arrêt du 14 avril 2016, la cour d’appel de Lisbonne a considéré que ces derniers s’étaient volontairement exposés aux médias (paragraphe 44 ci-dessus). La Cour suprême a, quant à elle, conclu dans son arrêt du 31 janvier 2017 que les requérants étaient devenus des personnes publiques et qu’ils devaient dès lors faire preuve d’une plus grande tolérance concernant le contrôle opéré par le public à leur égard (paragraphe 50 ci-dessus). Le Gouvernement souscrit à cette analyse (paragraphe 76 ci-dessus).
87. La Cour rappelle que, si les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard de toute personne qui fait partie de la sphère publique, que ce soit par ses actes ou par sa position (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 122), dans certaines circonstances, une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée (Standard Verlags GmbH c. Autriche (no 2), no 21277/05 § 53, 4 juin 2009, et Von Hannover (no 2), précité, § 97).
88. La Cour comprend que, en ayant fait appel aux médias les requérants aient voulu exploiter tous les moyens possibles pour retrouver leur fille. Il n’empêche que, alors qu’ils étaient inconnus du public avant les faits, les requérants ont, du fait de leur exposition aux médias, fini par acquérir une notoriété publique certaine et par entrer dans la sphère publique. Ils se sont, par voie de conséquence, exposés inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes (voir Axel Springer AG, précité, § 54, et comparer avec Ristamäki et Korvola c. Finlande, no 66456/09, § 53, 29 octobre 2013, Salumäki c. Finlande, no 23605/09, § 55, 29 avril 2014, et M.L. et W.W. c. Allemagne, nos 60798/10 et 65599/10, § 106, 28 juin 2018). Cela étant dit, la Cour rappelle que le seul fait d’avoir coopéré avec la presse antérieurement n’est pas de nature à priver de toute protection la personne visée par un article (Egeland et Hanseid c. Norvège, no 34438/04, § 62, 16 avril 2009). Il conviendra donc de déterminer si les limites de la critique admissible ont été dépassées eu égard aux circonstances de l’espèce.
L’objet du livre, du documentaire et de l’entretien et le mode d’obtention des informations
89. La Cour relève que, en l’espèce, l’élément litigieux central est le livre « Maddie : a verdade da mentira » dont G.A. est l’auteur et qui a été publié le 24 juillet 2008 (paragraphes 19-22 ci-dessus). En effet, le documentaire qui a été diffusé sur la chaîne de télévision TVI les 13 avril et 12 mai 2009 puis commercialisé en est une adaptation (paragraphe 24-27 ci-dessus). L’entretien au quotidien Correio da Manhã paru le 24 juillet 2008, jour du lancement du livre, s’inscrit, quant à lui, dans une démarche tendant à en faire la publicité (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour note que les juridictions internes ont relevé que le livre avait été traduit en plusieurs langues (paragraphe 40 (point 28) ci-dessus). Il ne fait donc pas de doute que cet ouvrage a été largement diffusé.
90. La Cour observe que les éléments litigieux concernaient l’enquête pénale que G.A. avait menée sur la disparition de Madeleine McCann jusqu’à ce qu’il en fût écarté (paragraphes 20 et 14 ci-dessus). Dans son arrêt du 31 janvier 2017, la Cour suprême a considéré que les informations litigieuses formulées par G.A. n’étaient pas nouvelles étant donné qu’elles figuraient déjà dans le dossier d’enquête pénale qui avait été mis à la disposition des médias (paragraphes 50 et 17 ci-dessus). Elle a en outre relevé que c’était sur la base de ces éléments que les requérants avaient été mis en examen et que cela avait fait l’objet de plusieurs discussions. Aux yeux de la Cour, il ne semble pas faire de doute, en l’espèce, que les informations contenues dans le livre, le documentaire et l’entretien provenaient du dossier relatif à l’enquête pénale qui était public.
91. En ce qui
concerne le contenu du livre, du documentaire et de l’entretien, les requérants
dénoncent essentiellement les affirmations selon lesquelles ils auraient, d’une
part, dissimulé le cadavre de leur fille qui serait morte des suites d’un
accident domestique, et d’autre part, simulé un enlèvement. Ils déplorent que de
telles insinuations aient été faites alors qu’à leurs yeux les soupçons qui
pesaient sur eux venaient d’être levés au niveau interne avec le classement sans
suite de l’affaire (paragraphes 72-73
ci-dessus).
92. La Cour a déjà estimé que les affirmations litigieuses étaient graves d’autant plus qu’elles avaient été formulées non pas par un journaliste ou un quelconque particulier mais par G.A., l’inspecteur qui avait dirigé l’enquête jusqu’à en être écarté le 2 octobre 2007 (paragraphes 70, 8 et 14 ci-dessus). Elle note que, se référant à la jurisprudence de la Cour, les juridictions internes ont néanmoins considéré qu’elles reflétaient l’opinion de G.A. au sujet de l’affaire et qu’elles contribuaient à la discussion d’un sujet d’intérêt public (paragraphes 41, 44 et 51 ci-dessus). Plus particulièrement, dans son arrêt du 31 janvier 2017, la Cour suprême tendait à les considérer comme des jugements de valeur se fondant sur des éléments de fait, à savoir les éléments qui figuraient dans le dossier d’enquête jusqu’au 2 octobre 2007, date à laquelle G.A. avait été dessaisi de l’enquête (paragraphes 50-51 ci-dessus). En outre, d’après la Cour suprême, compte tenu des fins que G.A. disait poursuivre dans l’avant-propos de son livre (paragraphe 21 ci-dessus), celui-ci ne témoignait pas d’une intention diffamatoire à l’égard des requérants (paragraphe 52 ci-dessus).
93. Eu égard au contexte de l’affaire, la Cour est également d’avis que les affirmations litigieuses constituaient des jugements de valeur fondés sur une base factuelle suffisante (voir, mutatis mutandis, Falter Zeitschriften GmbH c. Autriche, no 26606/04, § 23, 22 février 2007). En effet, les éléments sur lesquels se fonde la thèse défendue par G.A. sont ceux qui ont été recueillis au cours de l’enquête et qui ont été portés à la connaissance du public (paragraphe 40 (points 6-7 et 80), et paragraphes 50-51 ci-dessus). En outre, cette thèse avait été envisagée dans le cadre de l’enquête pénale et avait même déterminé la mise en examen des requérants le 7 septembre 2007 (paragraphes 10-13 ci-dessus).
94. La Cour note, par ailleurs, que l’affaire pénale a passionné l’opinion publique tant nationale qu’internationale et qu’elle a suscité de nombreux débats et discussions (paragraphe 40 (point 76) et paragraphe 50 ci-dessus). Comme l’ont relevé la cour d’appel de Lisbonne et la Cour suprême, les affirmations litigieuses s’inscrivaient incontestablement dans un débat d’intérêt public et la thèse de G.A. constituait dès lors une opinion parmi d’autres (paragraphes 44-45 et 50-51 ci-dessus).
95. La Cour note que l’affaire pénale a été classée sans suite par le parquet le 21 juillet 2008 (paragraphe 16 ci-dessus). À cet égard, elle observe que si le livre avait été publié avant la décision de classement sans suite du parquet, les affirmations litigieuses auraient pu porter atteinte à la présomption d’innocence des requérants, garantie par l’article 6 § 2 de la Convention, en préjugeant l’appréciation des faits par l’autorité d’enquête (voir à cet égard, Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 41, série A no 308 et Khoujine et autres c. Russie, no 13470/02, § 96, 23 octobre 2008). Puisque ces affirmations ont été formulées après le classement sans suite, c’est la réputation des requérants, garantie par l’article 8 de la Convention, et la manière dont ceux-ci sont perçus par le public qui sont en jeu (voir, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 314, 28 juin 2018, Istrate c. Roumanie, no 44546/13, § 58, 13 avril 2021 et les références qui y sont citées et, mutatis mutandis, Marinoni c. Italie, no 27801/12, § 32, 18 novembre 2021). Il y va également de la confiance du public dans le fonctionnement de la justice (voir, mutatis mutandis, Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 34, série A no 313).
96. En l’espèce, la Cour estime néanmoins que, à supposer même que la réputation des requérants avait été atteinte, ce n’est pas à cause de la thèse défendue par G.A. mais à cause des soupçons qui avaient été émis à leur égard, lesquels avaient déterminé leur mise en examen au cours de l’enquête et avaient fait l’objet d’une couverture médiatique très importante ainsi que de nombreux débats. En bref, il s’agissait d’informations dont le public avait pris amplement connaissance, avant même la mise à disposition du dossier d’enquête auprès des médias et la publication du livre litigieux (paragraphe 40 (point 76) ci-dessus). Pour ce qui est de la mauvaise foi de G.A. alléguée par les requérants (paragraphe 72 ci-dessus), la Cour note que le livre a été publié trois jours après le classement sans suite de l’affaire (paragraphes 16 et 19 ci-dessus) ce qui indique qu’il a été rédigé puis imprimé alors que l’enquête était encore en cours (paragraphe 21 ci-dessus). En décidant de mettre en vente le livre trois jours après la décision de classement sans suite, la Cour estime que G.A. aurait pu, par prudence, ajouter une note alertant le lecteur quant à l’issue de la procédure. L’absence d’une telle mention ne saurait toutefois, à elle seule, prouver la mauvaise foi de G.A. D’ailleurs, la Cour note que le documentaire fait, quant à lui, bien référence au classement sans suite de l’affaire (paragraphe 25 ci-dessus).
97. La Cour constate enfin que, après la publication du livre, les requérants ont poursuivi leurs actions auprès des médias. Ils ont notamment réalisé un documentaire au sujet de la disparition de leur fille et continué à accorder des entretiens à des médias au niveau international (paragraphe 40 - (points 68 et 71) ci-dessus). Même si la Cour comprend que la publication du livre ait indéniablement causé colère, angoisse et inquiétude chez les requérants (paragraphe 40 (point 81) ci-dessus), il n’apparaît pas que cet ouvrage ou la diffusion du documentaire aient eu des répercussions sérieuses sur les relations sociales des intéressés ou sur les recherches légitimes qu’ils poursuivent toujours pour retrouver leur fille.
Les circonstances particulières de l’espèce
98. Pour ce qui est des circonstances particulières de la présente espèce, la Cour observe que l’auteur des affirmations litigieuses est précisément l’inspecteur de la PJ qui avait coordonné l’enquête autour de la disparition de la fille des requérants jusqu’au 2 octobre 2007 (paragraphes 8 et 14 ci-dessus). En tenant compte de cet élément, les juridictions internes se sont penchées sur la question de savoir si G.A. avait manqué aux devoirs professionnels auxquels il était tenu. Si le tribunal de Lisbonne a jugé que, même s’il était à la retraite au moment des faits, G.A. avait enfreint son devoir de réserve ainsi que le secret professionnel qui le liait (paragraphe 42 ci-dessus), la cour d’appel de Lisbonne et la Cour suprême ne l’ont pas entendu ainsi (paragraphes 45 et 55 ci-dessus). Pour parvenir à leur conclusion, elles se sont fondées sur le fait que les affirmations litigieuses avaient déjà été amplement divulguées et commentées (paragraphe 55 ci-dessus).
99. La Cour peut souscrire à cette analyse. Certes, les affirmations litigieuses se fondent sur la connaissance approfondie du dossier que détenait G.A. du fait de ses fonctions. Cependant, il ne fait pas de doute que celles-ci étaient déjà connues du public compte tenu de l’importante couverture médiatique de l’affaire (paragraphes 8, 10 et 40 (point 76) ci-dessus) suivie de la mise à disposition du dossier d’enquête auprès des médias après la clôture de l’enquête (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour est donc d’avis que les éléments litigieux ne sont que l’expression de l’interprétation de G.A. au sujet d’une affaire médiatique qui avait déjà été amplement débattue. En outre, il n’apparaît pas que G.A. était mû par une animosité personnelle à l’égard des requérants (voir Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 77, CEDH 2008 ; voir aussi le paragraphe 21 ci-dessus).
100. Eu égard aux circonstances particulières de la présente espèce, la Cour partage l’avis du Gouvernement (paragraphe 76 ci-dessus) quant à l’effet dissuasif qu’une condamnation aurait eu, dans la présente espèce, pour la liberté d’expression au sujet d’affaires d’intérêt public (voir, mutatis mutandis, Koudechkina c. Russie, no 29492/05, § 99, 26 février 2009).
vi. Conclusion
101. Au vu de l’ensemble des considérations exposées ci-dessus, la Cour estime que, alors qu’elle statuait en dernière instance, la Cour suprême a procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre le droit des requérants au respect de leur vie privée et le droit de G.A. à la liberté d’expression, en les appréciant à l’aune des critères se dégageant de sa jurisprudence et en se référant amplement à la jurisprudence de la Cour (paragraphes 49, 51, 53 et 55 ci-dessus). Compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissaient en l’espèce les autorités nationales, la Cour n’aperçoit aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui de la Cour suprême. Il n’apparaît donc pas que les autorités nationales eussent manqué à l’obligation positive qui leur incombait de protéger le droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention.
102. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
VĂCEAN c. ROUMANIE du 16 novembre 2021 Requête no 47695/14
Art 8 • Vie privée • Obligations positives • Manquement des autorités nationales à protéger le droit à la réputation du requérant • Pas d’examen de la contribution à une question d’intérêt général de l’interview et des articles parus sur Internet, et de la nature des propos de la personne interviewée • Absence de mise en balance des intérêts en jeu dans le respect de la jurisprudence de la Cour
FAITS
4. À une date non précisée en 2011, le requérant, qui était professeur de musique, concourut pour le poste de directeur de la Philharmonie d’Arad (« la Philharmonie »), un établissement public. Pour pouvoir se porter candidat, il fallait avoir un casier judiciaire vierge. À l’issue du concours, le requérant obtint la meilleure note. Il devait être nommé au poste en question, par la mairie d’Arad.
5. Au même moment, un enregistrement vidéo circulait sur Internet. Capté en 2008 par une caméra de surveillance, il montrait un homme en train de voler le rétroviseur d’une voiture de luxe sur un parking. À partir d’une ressemblance physique entre le requérant et la personne qui apparaissait sur la vidéo, une journaliste réalisa un reportage sur la nomination de l’intéressé au poste de directeur de la Philharmonie. Dans le cadre de ce reportage, elle interrogea successivement M.D., président du Syndicat des artistes interprètes de la Philharmonie (« le syndicat »), puis deux autres personnes travaillant pour la Philharmonie et le conseil local, afin de recueillir leur avis quant à la ressemblance entre le requérant et la personne qui apparaissait sur la vidéo de 2008.
7. Les deux autres personnes interrogées (paragraphe 5 ci-dessus) répondirent ainsi : la première déclarait qu’elle ne pouvait pas affirmer que la personne figurant sur l’enregistrement fût le requérant. Elle précisait que la vidéo avait déjà donné lieu par le passé à des discussions qui s’étaient ensuite calmées, et qu’elle ne savait pas comment elle était réapparue. La seconde soulignait que le requérant devait bénéficier de la présomption d’innocence.
8. À la fin du reportage, la journaliste interrogeait la sous-commissaire de police C.T. Celle-ci indiquait que le propriétaire de la voiture avait mis l’enregistrement à la disposition de la police et qu’une enquête préliminaire contre X était en cours.
9. Ce reportage fut publié le 29 août 2011 sur le site du journal Adevărul (www.adevarul.ro).
10. Le même jour, la société de médias Antena 3 publia sur sa page Internet un article intitulé « Le nouveau directeur de la Philharmonie d’Arad soupçonné de vol de rétroviseurs sur une voiture de luxe ».
11. Toujours le 29 août 2011, le journal régional en ligne Vestic publia sur sa page Internet une brève intitulée « Voici l’homme à qui va le soutien du PDL [Parti démocrate libéral] d’Arad : le directeur de la Philharmonie, visé par une enquête pour vol ! ». On pouvait y lire notamment ceci : « le nouveau directeur de la Philharmonie (...) fait l’objet d’une enquête de police depuis trois ans pour le vol (...) d’un rétroviseur sur une voiture de luxe ! L’information a été rendue publique par Antena 3 cet après-midi ».
12. Le 31 août 2011, le journal Adevărul publia sur sa page Internet un article intitulé « Le directeur soupçonné de vol » et sous-titré « Alin Văcean va être nommé directeur de la Philharmonie d’Arad ». L’article était illustré d’une photographie du requérant. Il rapportait que celui-ci allait devenir le nouveau directeur de la Philharmonie alors qu’il était soupçonné de vol de rétroviseurs.
13. Ces articles comprenaient aussi un lien renvoyant à la vidéo de 2008.
14. Avant de confirmer la nomination du requérant au poste de directeur de la Philharmonie, la mairie d’Arad demanda à la police d’Arad des informations sur l’éventuelle implication de l’intéressé dans une enquête pénale liée à un vol. Le 6 septembre 2011, la police informa la mairie qu’aucun dossier pénal n’avait été enregistré au nom du requérant et que ce dernier n’avait fait l’objet d’aucune enquête pour vol d’objets provenant d’une voiture sur le territoire de la ville d’Arad.
15. Le requérant fut donc nommé directeur de la Philharmonie.
16. Le 20 juillet 2012, le requérant engagea devant le tribunal de première instance d’Arad (« le tribunal de première instance ») une action en responsabilité civile délictuelle contre M.D. et contre les sociétés de médias Adevărul, Arbitim Media et Antena 3, pour atteinte à son droit à l’image et à la réputation. Invoquant les dispositions légales régissant la responsabilité civile délictuelle (paragraphe 28 ci-dessous), l’article 30 de la Constitution (paragraphe 27 ci-dessous) et l’article 10 § 2 de la Convention, il soutenait que la déclaration de M.D. et les articles publiés sur les sites Internet par les différentes sociétés de médias contenaient des allégations diffamatoires à son égard en ce qu’ils indiquaient qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour vol.
26. Le tribunal départemental constata que c’était dans ce contexte que M.D. avait répondu aux questions de la journaliste en indiquant qu’il lui « sembl[ait] » connaître la personne qui apparaissait sur la vidéo et qu’il ne savait pas si elle avait des antécédents judiciaires, puis en précisant que cette personne se nommait Alin Văcean. Il considéra que par ces réponses M.D. n’avait pas désigné le requérant de manière catégorique comme étant l’auteur du vol ni entamé une campagne de presse contre l’intéressé en l’attaquant et en le dénigrant publiquement. Il jugea donc que les propos litigieux n’étaient pas des affirmations factuelles échappant à la protection du droit à la liberté d’expression. Il conclut que M.D. ne pouvait se voir reprocher aucun fait illicite à cet égard, et que la publication de l’interview litigieuse s’inscrivait dans le cadre d’une enquête journalistique d’intérêt public au sens de l’article 10 de la Convention.
ARTICLE 8
a) Les principes généraux
35. La Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression résumés notamment dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)).
36. En particulier, les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression sont les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne visée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de l’espèce (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108-113, CEDH 2012, et Axel Springer AG, précité, §§ 90-95 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93). Si la mise en balance s’est faite dans le respect de ces critères, il faut des raisons sérieuses pour que la Cour substitue son avis à celui des juridictions internes (Von Hannover, précité, § 107 ; Axel Springer AG, précité, § 89 ; et Kaboğlu et Oran c. Turquie, nos 1759/08 et 2 autres, § 70, 30 octobre 2018).
37. Par ailleurs, la Cour rappelle la distinction qui est faite entre déclarations de fait et jugements de valeur. La matérialité des déclarations de fait peut se prouver ; en revanche, les jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, l’exigence voulant que soit établie leur vérité est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle‑même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10. Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux : à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif. Pour distinguer une imputation de fait d’un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce et de la tonalité générale des propos, étant entendu que des assertions sur des questions d’intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait (Morice c. France [GC], no 29369/10, § 126, CEDH 2015, et les références qui y sont citées).
b) Application de ces principes en l’espèce
38. En l’occurrence, le tribunal départemental a considéré que l’interview de M.D. s’inscrivait dans une démarche journalistique qui portait sur un problème d’intérêt public, et qui consistait à informer les citoyens et les autorités de ce qu’une personne apparemment identifiable avait été filmée en train de voler le rétroviseur d’une voiture (paragraphe 25 ci-dessus).
39. Sans remettre en cause le constat du tribunal départemental, la Cour note que ce dernier a certes considéré que les articles publiés portaient sur une question d’intérêt général, mais que concrètement ces articles portaient essentiellement sur la question de savoir si le requérant répondait aux conditions requises pour présenter sa candidature au poste de directeur de la Philharmonie alors que, selon les journalistes, il était soupçonné de vol. Ainsi, comme le soutient aussi le Gouvernement (paragraphe 34 ci-dessus), le problème d’intérêt général pour la communauté sur lequel portait la démarche journalistique était plutôt la question de savoir si le requérant pouvait occuper le poste de directeur d’un établissement public que l’infraction de vol de rétroviseur en elle-même.
40. De l’avis de la Cour, compte tenu, d’une part, de ce que les faits que montrait la vidéo s’étaient déroulés plusieurs années avant la diffusion du reportage et, d’autre part, du contenu concret de celui-ci et des articles litigieux, il aurait été souhaitable que le tribunal départemental expliquât dans son arrêt les raisons pour lesquelles il considérait que ces publications relevaient d’un débat d’intérêt général.
41. La Cour constate, comme les juridictions nationales (paragraphes 20 et 25 ci-dessus), qu’à l’époque des faits litigieux le requérant visait à exercer la fonction de directeur de la Philharmonie de la ville, un établissement public. Elle observe toutefois qu’il ne ressort pas du dossier qu’il était connu du public ni qu’il ait eu la moindre notoriété ne serait-ce qu’au niveau départemental avant d’avoir manifesté son intérêt pour ce poste. Elle note aussi que les juridictions nationales ne se sont pas prononcées sur le comportement qu’il avait pu avoir antérieurement vis‑à‑vis des médias.
42. Elle observe ensuite que, lorsqu’il a rejeté l’action en indemnisation introduite par le requérant, le tribunal départemental a seulement indiqué de façon générale que l’intéressé était « le directeur d’un établissement public culturel, la Philharmonie » (paragraphe 25 ci-dessus). En toute hypothèse, la Cour estime que, eu égard au statut et à la fonction du directeur d’un établissement public local, le requérant est inévitablement et sciemment entré dans la sphère publique lorsqu’il a passé le concours d’accès à ce poste, et que, ce faisant, il s’est exposé à un examen attentif de ses actes. Elle convient que les limites de la critique acceptable doivent par conséquent être plus larges en l’espèce que dans le cas d’un individu qui ne serait absolument pas connu du public (voir, mutatis mutandis, Egill Einarsson c. Islande, no 24703/15, § 44, 7 novembre 2017). Ces limites n’atteignent toutefois pas ici celles qui découlent du degré de tolérance dont doivent faire preuve par exemple les hommes politiques (voir, mutatis mutandis, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 52, CEDH 1999‑VIII). Or en l’espèce, les allégations portées à l’égard du requérant concernaient son implication supposée dans la commission d’un acte pénalement répréhensible. Si les faits avaient été avérés, ils auraient eu une incidence certaine sur sa carrière professionnelle. Dans ces conditions, on ne peut pas dire qu’il aurait dû faire montre d’un plus grand degré de tolérance face aux affirmations litigieuses.
Sur le contenu, la forme et les répercussions des allégations de M.D. et des publications
43. La Cour note que le requérant a soutenu devant les juridictions nationales que les propos tenus par M.D. lors de l’interview et les articles parus par la suite sur les pages Internet de plusieurs journaux avaient porté atteinte à sa réputation (paragraphe 16 ci-dessus).
44. En ce qui concerne les propos de M.D., elle observe que la question posée devant les juridictions internes était celle de savoir s’ils constituaient des déclarations de fait ou des jugements de valeur (voir, par exemple, Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, §§ 42-43, CEDH 2001 II, et Brosa c. Allemagne, no 5709/09, §§ 43-47, 17 avril 2014). Le tribunal de première instance a jugé que dans ses réponses aux questions posées par la journaliste, M.D. avait désigné le requérant comme étant l’auteur d’un vol, et que ces affirmations constituaient des déclarations de fait (paragraphes 20 et 21 ci-dessus). Le tribunal départemental a estimé, au contraire, que dans ses réponses M.D. n’avait pas désigné de manière catégorique le requérant comme étant l’auteur du vol, et que ses propos n’étaient pas des affirmations factuelles (paragraphe 26 ci-dessus).
45. La Cour rappelle que la qualification d’une déclaration en fait ou en jugement de valeur est une question qui relève au premier chef des autorités nationales, en particulier des juridictions internes. Elle peut toutefois juger nécessaire de procéder à sa propre appréciation des déclarations litigieuses (Egill Einarsson, précité, § 48, et Brosa, précité, §§ 43-50).
46. Ayant examiné le contenu des propos litigieux tenus en l’espèce par M.D., la Cour estime qu’une analyse nuancée s’impose. Elle constate que, dans un premier temps M.D. a, à la demande de la journaliste, décrit le contenu de l’enregistrement vidéo (paragraphe 6 ci-dessus). Il s’agissait là d’une simple description objective des agissements – non contestés par les parties – de la personne figurant sur l’enregistrement. Ensuite, la journaliste a posé à M.D. d’autres questions (paragraphe 6 ci-dessus), notamment sur la condition d’absence d’antécédents judiciaires, requise pour une participation au concours, et sur la perspective que le requérant soit nommé directeur de la Philharmonie. En répondant à ces questions, M.D. a exprimé des avis personnels qui constituent des jugements de valeur. Qui plus est, il s’agissait d’assertions orales prononcées lors d’une interview, et M.D. ne pouvait donc pas les reformuler, les parfaire ou les retirer (voir, mutatis mutandis, Andreescu c. Roumanie, no 19452/02, § 95, 8 juin 2010).
47. La Cour considère que la question cruciale que pose l’affaire portée devant elle est celle de déterminer la nature des propos par lesquels M.D. a déclaré reconnaître le requérant sur l’enregistrement. Interrogé par la journaliste, M.D. a d’abord répondu qu’il lui « semblait » connaître la personne qui apparaissait sur les images (paragraphe 6 ci-dessus). Répondant aux questions répétées de la journaliste, il a finalement donné le nom du requérant. La Cour admet que, en reconnaissant la personne présentée sur l’enregistrement, M.D. a fait usage de ses capacités de mémoire et de reconnaissance visuelle. Toutefois, la Cour remarque que M.D. n’avait exprimé aucune retenue lorsqu’il avait donné le nom du requérant et qu’il avait fait une affirmation qui ne laissait pas de doute quant à la personne en cause. S’il est vrai que M.D. n’a pas affirmé expressément que le requérant était l’auteur du vol, il l’a néanmoins identifié et désigné comme étant la personne qui apparaissait sur la vidéo et qu’il avait décrite comme étant en train de commettre un vol. Or, de l’avis de la Cour, une telle succession de déclarations constitue une déclaration objective et factuelle.
48. Elle considère donc que, en ce qui concerne les propos de M.D., le tribunal départemental n’a pas réalisé un examen assez nuancé et n’a pas recherché si les allégations qu’il avait portées pouvaient, prises dans leur ensemble et dans le contexte des questions posées, avoir, au moins dans une certaine mesure, une connotation factuelle. Qui plus est, le tribunal départemental a simplement conclu qu’il ne se trouvait pas en présence d’affirmations factuelles échappant à la protection du droit à la liberté d’expression (paragraphe 26 ci-dessus), sans plus d’explications. De telles explications étaient d’autant plus nécessaires dans la présente espèce, où le tribunal de première instance était parvenu à une conclusion différente, à savoir que les propos de M.D. comportaient des affirmations factuelles (paragraphe 21 ci-dessus).
49. Pour ce qui est des articles parus sur Internet (paragraphes 10 à 12 ci-dessus), elle constate que le tribunal départemental a simplement considéré que la publication de l’interview litigieuse s’inscrivait dans le cadre d’une enquête journalistique d’intérêt général (paragraphe 26 ci‑dessus), centrant son analyse principalement sur les propos imputés à M.D. sans apporter de réponse à la question de savoir si, en l’espèce, la liberté de la presse pouvait justifier leur publication réitérée et l’atteinte que la forme et le contenu des articles litigieux pouvaient porter au droit du requérant à la protection de sa réputation (paragraphes 25 et 26 ci-dessus ; voir, a contrario, Petrie c. Italie, no 25322/12, § 52, 18 mai 2017, où la juridiction statuant en appel avait analysé de manière approfondie le contexte factuel et les différents propos en cause). Elle considère que pareille approche est incompatible avec les principes qui se dégagent de sa jurisprudence (paragraphes 36 et 37 ci-dessus).
50. En particulier, la Cour note que le tribunal départemental n’a examiné ni la nature des déclarations que renfermaient les articles litigieux ni la question de savoir si les journalistes devaient justifier la teneur de leurs écrits par une base factuelle. Or ces articles visaient à transmettre à l’opinion publique un message sans équivoque – à savoir que le requérant, futur directeur d’un établissement public, faisait ou aurait dû faire l’objet d’une enquête pénale pour vol (paragraphes 10-12 ci-dessus). Dans ces conditions, le tribunal départemental aurait dû rechercher s’ils reposaient sur une base factuelle objective et suffisante.
51. Par ailleurs, la Cour note que, outre la déclaration de M.D., l’un des articles mentionnait expressément la déclaration de la sous-commissaire de police qui exposait qu’une enquête pénale contre X était en cours (paragraphe 12 ci-dessus). Dans le même article, il était noté que le requérant niait les faits (paragraphe 12 ci-dessus). Dans un tel contexte, étant donné le choix des journalistes de présenter le requérant comme un individu « soupçonné de vol », alors qu’il ne faisait l’objet d’aucune enquête judiciaire et qu’aucun autre élément objectif que les déclarations de M.D. ne permettait de penser que tel fût le cas, le tribunal départemental aurait même pu se poser la question de savoir si les journalistes avaient agi de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir, mutatis mutandis, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999 I, et Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, § 53, CEDH 2000 IV).
52. Enfin, le tribunal départemental n’a à aucun moment analysé l’ampleur de la diffusion sur Internet des articles litigieux, l’accessibilité de ces articles (voir, mutatis mutandis, Savva Terentyev c. Russie, no 10692/09, § 80, 28 août 2018, et, a contrario, M.L. et W.W. c. Allemagne, nos 60798/10 et 65599/10, § 113, 28 juin 2018) ou leur impact sur la situation du requérant. La Cour rappelle à cet égard que les communications en ligne et leur contenu risquent assurément bien plus que dans la presse de porter atteinte à l’exercice et à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée (Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 133, CEDH 2015).
53. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que, pour ce qui est des articles publiés sur Internet, le tribunal départemental a omis de prendre en considération les critères qu’elle a énoncés dans sa jurisprudence et de mettre en balance le droit du requérant au respect de sa réputation et le droit des journalistes à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Gheorghe-Florin Popescu c. Roumanie, no 79671/13, § 34, 12 janvier 2021).
Conclusion
54. La Cour constate que le tribunal départemental n’a pas suffisamment examiné ni la question de savoir si l’interview de M.D. et les articles litigieux apportaient véritablement une contribution à une question d’intérêt général (paragraphe 40 ci-dessus) ni celle concernant la nature des propos de M.D., et qu’il n’a pas mis en balance conformément aux critères qu’elle a établis dans sa jurisprudence le droit des journalistes à la liberté d’expression et le droit du requérant au respect de sa vie privée (paragraphes 49 à 53 ci-dessus). Dans ces conditions, elle conclut que les autorités nationales ont manqué aux obligations positives qui leur incombaient en vertu de l’article 8 de la Convention (voir, a contrario, Petrie, précité, § 54).
55. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
M.L. et W.W. c. Allemagne du 28 juin 2018 requêtes n° 60798/10 et 65599/10
Article 8 : Le droit du public d’accéder aux informations archivées sur Internet a prévalu sur le droit à l’oubli de personnes condamnées
L’affaire concerne le refus de la Cour fédérale de justice d’interdire à trois médias différents le maintien de l’accès à des dossiers de presse concernant la condamnation des requérants pour meurtre d’un acteur connu, mentionnés par leurs noms complets.
La Cour partage la conclusion de la Cour fédérale allemande qui a rappelé que les médias avaient pour mission de participer à la formation de l’opinion démocratique en mettant à la disposition du public des informations anciennes conservées dans leurs archives.
La Cour rappelle que la manière de traiter un sujet relève de la liberté journalistique et que l’article 10 de la Convention laisse aux journalistes le soin de décider quels détails doivent être ou non publiés, sous la condition que ces choix répondent aux normes éthiques et déontologique de la profession. L’inclusion dans un reportage d’éléments individualisés, tel le nom complet de la personne visée, constitue un aspect important du travail de la presse, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une procédure pénale ayant suscité un intérêt public considérable que l’écoulement du temps n’a pas fait disparaître.
La Cour note qu’au cours de leur dernière demande de révision du procès en 2004, M.L. et W.W. se sont eux-mêmes tournés vers la presse à laquelle ils ont transmis un certain nombre de documents tout en l’invitant à en tenir le public informé. Cette attitude relativise leur espérance d’obtenir l’anonymisation des reportages en cause ou encore un droit à l’oubli numérique.
En conclusion, compte tenu de la marge d’appréciation des autorités nationales lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, de l’importance de conserver l’accessibilité à des reportages acceptés comme licites et du comportement des requérants vis-à-vis de la presse, la Cour estime qu’il n’y a pas de raisons sérieuses de substituer son avis à celui de la Cour fédérale de justice.
C. Le droit de l’Union européenne
1. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
57. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données avait pour but de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques (notamment leur droit à la vie privée) lors du traitement des données à caractère personnel, tout en éliminant les obstacles à la libre circulation de ces données. À l’article 9 de la directive, les États membres prévoyaient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations.
2. Le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
58. Les articles 17 et 85 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (applicable à partir du 25 mai 2018) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui a abrogé la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), sont ainsi libellés :
Article 17 - Droit à l’effacement (« droit à l’oubli »)
« 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique :
a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;
(...)
2. Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire :
a) à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
(...)
d) à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement (...) »
Article 85 - Traitement et liberté d’expression et d’information
« 1. Les États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire.
2. Dans le cadre du traitement réalisé à des fins journalistiques ou à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire, les États membres prévoient des exemptions ou des dérogations (...) si celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information. (...) »
3. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 mai 2014 (Google Spain et Google)
59. Dans son arrêt du 13 mai 2014 (affaire C‑131/12, EU:C:2014:317 ; Google Spain SL et Google Inc. – ci-après « Google Spain »), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était appelée à définir la portée des droits et obligations découlant de la directive 95/46/CE. À l’origine de l’arrêt se trouvait l’introduction par un ressortissant espagnol d’une réclamation auprès de l’Agence espagnole de protection des données contre un quotidien espagnol et contre Google. Le ressortissant s’était plaint que, lorsqu’un internaute introduisait son nom dans le moteur de recherche de Google, la liste de résultats affichait des liens vers deux pages du quotidien mentionnant son nom en lien avec une vente aux enchères à la suite d’une saisie. L’intéressé avait demandé au quotidien soit de supprimer ou de modifier les pages en cause pour en faire disparaître ses données personnelles, soit de recourir à certains outils fournis par les moteurs de recherche pour protéger ces données. Il avait également demandé à Google de supprimer ou d’occulter ses données personnelles afin qu’elles disparaissent des résultats de recherche et des liens du quotidien. Alors que l’Agence espagnole avait rejeté la réclamation dirigée contre le quotidien, elle avait accueilli celle dirigée contre Google, qui saisit la justice espagnole d’un recours. C’est dans le cadre de ce litige judiciaire que la CJUE avait été saisie de l’affaire à titre préjudiciel.
60. La CJUE a estimé que les opérations menées par l’exploitant d’un moteur de recherche devaient être qualifiées de « traitements de données » dont celui-ci était « responsable » (article 2 b et d), et ce indépendamment du fait que ces données avaient déjà fait l’objet d’une publication sur Internet et n’avaient pas été modifiées par le moteur de recherche. Elle a indiqué que, dans la mesure où l’activité d’un moteur de recherche se distinguait du traitement effectué par les éditeurs de sites web et s’y ajoutait, et qu’elle affectait de manière additionnelle les droits fondamentaux de la personne concernée, l’exploitant de ce moteur devait notamment assurer que les garanties prévues par la directive pussent développer leur plein effet. Par ailleurs, compte tenu de la facilité avec laquelle des informations publiées sur un site web pouvaient être répliquées sur d’autres sites, une protection efficace et complète des personnes concernées, notamment de leur droit au respect de leur vie privée, ne pouvait effectivement être réalisée si ces personnes devaient d’abord ou en parallèle obtenir l’effacement des informations les concernant auprès des éditeurs de sites web. La CJUE a conclu que l’exploitant d’un moteur de recherche était obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations n’avaient pas été effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur ces pages était licite.
61. La CJUE a ajouté que même un traitement initialement licite de données exactes pouvait devenir, avec le temps, incompatible avec la directive lorsque ces données n’étaient plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles avaient été collectées ou traitées. Elle a précisé que cela était notamment le cas lorsqu’elles apparaissaient inadéquates, qu’elles n’étaient pas ou plus pertinentes ou qu’elles étaient excessives au regard de ces finalités et du temps qui s’était écoulé. La CJUE a conclu que si, au regard des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la personne concernée avait un droit à ce que l’information en question relative à sa personne ne fût plus liée à son nom par une liste de résultats et si elle pouvait ainsi demander que l’information ne fût plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalaient, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à accéder à cette information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne. Selon la CJUE, cela n’était cependant pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par la personne concernée dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux était justifiée par l’intérêt prépondérant du public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l’information en question.
62. Concernant la différence de traitement de l’éditeur d’une page web et de l’exploitant d’un moteur de recherche la CJUE a relevé le suivant :
« 85. En outre, le traitement par l’éditeur d’une page web, consistant dans la publication d’informations relatives à une personne physique, peut, le cas échéant, être effectué «aux seules fins de journalisme» et ainsi bénéficier, en vertu de l’article 9 de la directive 95/46, de dérogations aux exigences établies par celle-ci, tandis que tel n’apparaît pas être le cas s’agissant du traitement effectué par l’exploitant d’un moteur de recherche. Il ne peut ainsi être exclu que la personne concernée soit dans certaines circonstances susceptible d’exercer les droits visés aux articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 contre ledit exploitant, mais non pas contre l’éditeur de ladite page web.
86. Enfin, il importe de constater que non seulement le motif justifiant, en vertu de l’article 7 de la directive 95/46, la publication d’une donnée à caractère personnel sur un site web ne coïncide pas forcément avec celui qui s’applique à l’activité des moteurs de recherche, mais que, même lorsque tel est le cas, le résultat de la mise en balance des intérêts en cause à effectuer en vertu des articles 7, sous f), et 14, premier alinéa, sous a), de cette directive peut diverger selon qu’il s’agit du traitement effectué par l’exploitant d’un moteur de recherche ou de celui effectué par l’éditeur de cette page web, étant donné que, d’une part, les intérêts légitimes justifiant ces traitements peuvent être différents et, d’autre part, les conséquences qu’ont lesdits traitements pour la personne concernée, et notamment pour sa vie privée, ne sont pas nécessairement les mêmes.
87. En effet, dans la mesure où l’inclusion dans la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, d’une page web et des informations qui y sont contenues relatives à cette personne facilite sensiblement l’accessibilité de ces informations à tout internaute effectuant une recherche sur la personne concernée et peut jouer un rôle décisif pour la diffusion desdites informations, elle est susceptible de constituer une ingérence plus importante dans le droit fondamental au respect de la vie privée de la personne concernée que la publication par l’éditeur de cette page web. »
4. Les lignes directrices du Groupe de l’article 29
63. Le 26 novembre 2014, les autorités européennes de protection des données réunies au sein du Groupe de l’article 29 ont adopté des lignes directrices pour assurer une application harmonisée de l’arrêt de la CJUE du 13 mai 2014. La deuxième partie des lignes directrices concerne des critères communs que les autorités de protection des données sont invités à appliquer pour traiter des plaintes qu’elles reçoivent suite à des refus de déréférencement par les moteurs de recherche. Le treizième de ces critères se lit ainsi :
« 13. Does the data relate to a criminal offence?
EU Member States may have different approaches as to the public availability of information about offenders and their offences. Specific legal provisions may exist which have an impact on the availability of such information over time. DPAs will handle such cases in accordance with the relevant national principles and approaches. As a rule, DPAs are more likely to consider the de-listing of search results relating to relatively minor offences that happened a long time ago, whilst being less likely to consider the de-listing of results relating to more serious ones that happened more recently. However, these issues call for careful consideration and will be handled on a case-by-case basis. »
LA CEDH
a) Les principes généraux
86. La Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels l’identification et l’orientation sexuelle, le nom, ou des éléments se rapportant au droit à l’image. Cette notion comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement (Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, § 75, 6 avril 2010, et Saaristo et autres c. Finlande, no 184/06, § 61, 12 octobre 2010).
87. La Cour rappelle aussi que les considérations liées à la vie privée entrent en jeu dans les situations où des informations ont été recueillies sur une personne bien précise, où des données à caractère personnel ont été traitées ou utilisées et où les éléments en question avaient été rendus publics d’une manière ou dans une mesure excédant ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s’attendre. Elle a reconnu que la protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 136, CEDH 2017 (extraits)). Dans cet arrêt la Cour a en outre conclu que l’article 8 de la Convention consacre le droit à une forme d’auto-détermination informationnelle, qui autorise les personnes à invoquer leur droit à la vie privée en ce qui concerne des données qui, bien que neutres, sont collectées, traitées et diffusées à la collectivité, selon des formes ou modalités telles que leurs droits au titre de l’article 8 peuvent être mis en jeu (ibid., § 137).
88. Cependant, pour que l’article 8 entre en ligne de compte, l’attaque à la réputation personnelle doit atteindre un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée. De même, on ne saurait invoquer cette disposition pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012).
89. La Cour relève que les requêtes comme celles de l’espèce appellent un examen du juste équilibre à ménager entre le droit au respect de la vie privée des requérants, garanti par l’article 8 de la Convention, et la liberté d’expression de la station de radio et des maisons d’édition ainsi que la liberté d’information du public, garanties par l’article 10 de la Convention. Lors de cet examen, la Cour doit notamment avoir égard aux obligations positives qui incombent à l’État au regard de l’article 8 de la Convention (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91, et Von Hannover (no 2) [GC], précité, § 98) et aux principes qu’elle a dégagés dans sa jurisprudence constante quant au rôle essentiel que la presse joue dans une société démocratique et qui inclut la rédaction de comptes rendus et de commentaires sur les procédures judiciaires. On ne saurait en effet penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, dans la grande presse ou au sein du public en général. À la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait pas jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Axel Springer AG, précité, §§ 79-81). Par ailleurs, il n’appartient pas à la Cour, ni d’ailleurs aux juridictions internes, de se substituer à la presse dans le choix du mode de compte rendu à adopter dans un cas donné (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298, et Mosley c. Royaume-Uni, no 48009/08, § 113, 10 mai 2011).
90. À ce rôle premier de la presse s’ajoute une fonction accessoire mais néanmoins d’une importance certaine, qui consiste à constituer des archives à partir d’informations déjà publiées et à les mettre à la disposition du public. À cet égard, la Cour rappelle que la mise à disposition d’archives sur Internet contribue grandement à la préservation et à l’accessibilité de l’actualité et des informations. Les archives numériques constituent en effet une source précieuse pour l’enseignement et les recherches historiques, notamment en ce qu’elles sont immédiatement accessibles au public et généralement gratuites (Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (nos 1 et 2), nos 3002/03 et 23676/03, §§ 27 et 45, CEDH 2009, et Węgrzynowski et Smolczewski c. Pologne, no 33846/07, § 59, 16 juillet 2013 ; voir aussi la Recommandation Rec(2000)13 du Comité des Ministres – paragraphe 54 ci‑dessus).
91. La Cour estime également utile de rappeler dans ce contexte que les sites Internet sont des outils d’information et de communication qui se distinguent particulièrement de la presse écrite, notamment quant à leur capacité à emmagasiner et à diffuser l’information, et que les communications en ligne et leur contenu risquent bien plus que la presse de porter atteinte à l’exercice et à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée (Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 133, CEDH 2015, Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, no 33014/05, § 63, CEDH 2011 (extraits), et Cicad c. Suisse, no 17676/09, § 59, 7 juin 2016), et ce notamment en raison du rôle important que jouent les moteurs de recherche.
92. Le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants, que les obligations à la charge de l’État soient positives ou négatives. Cette marge est en principe la même que celle dont les États disposent sur le terrain de l’article 10 de la Convention pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cet article (Von Hannover (no 2), précité, § 106, Axel Springer AG, précité, § 87, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 91, CEDH 2015 (extraits)).
93. La marge d’appréciation va toutefois de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention (Von Hannover (no 2), précité, § 105, et Axel Springer AG, précité, § 86).
94. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011, et Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 54, CEDH 2016). En d’autres termes, la Cour reconnaît de façon générale à l’État une ample marge d’appréciation lorsqu’il doit ménager un équilibre entre des intérêts privés ou différents droits protégés par la Convention (Delfi AS, précité, § 139, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie, no 22947/13, § 59, 2 février 2016, et Fürst-Pfeifer c. Autriche, nos 33677/10 et 52340/10, § 40, 17 mai 2016).
95. La Cour a déjà eu l’occasion d’énoncer les principes pertinents qui doivent guider son appréciation – et, surtout, celle des juridictions internes – de la nécessité. Elle a ainsi posé un certain nombre de critères dans le contexte de la mise en balance des droits en présence. Les critères pertinents qui ont été jusqu’ici ainsi définis sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy, précité, § 165, et les références qui y sont citées).
96. La Cour estime que les critères ainsi définis peuvent être transposés à la présente affaire, même si certains d’entre eux peuvent revêtir plus ou moins de pertinence eu égard aux circonstances particulières de l’espèce (ibid., § 166 ; Falzon c. Malte, no 45791/13, § 55, 20 mars 2018 ; Axel Springer et RTL Television GmbH c. Allemagne, no 51405/12, § 42, 21 septembre 2017).
b) Application de ces principes à l’espèce
97. La Cour note d’abord que c’est avant tout en raison des moteurs de recherche que les informations sur les requérants tenues à disposition par les médias concernés peuvent facilement être repérées par les internautes. Il n’en demeure pas moins que l’ingérence initiale dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie privée résulte de la décision des médias concernés de publier ces informations et, surtout, de les garder disponibles sur leurs sites web, fût-ce sans intention d’attirer l’attention du public, les moteurs de recherche ne faisant qu’amplifier la portée de l’ingérence en question. Cela dit, en raison de cet effet amplificateur concernant le degré de diffusion des informations et de la nature de l’activité dans laquelle s’inscrit la publication de l’information sur la personne concernée, les obligations des moteurs de recherche à l’égard de la personne concernée par l’information peuvent être différentes de celles de l’éditeur à l’origine de l’information. Par conséquent, la mise en balance des intérêts en jeu peut aboutir à des résultats différents selon que se trouve en cause une demande d’effacement dirigée contre l’éditeur initial de l’information dont l’activité se trouve en règle générale au cœur de ce que la liberté d’expression entend protéger, ou contre un moteur de recherche dont l’intérêt principal n’est pas de publier l’information initiale sur la personne concernée, mais notamment de permettre, d’une part, de repérer toute information disponible sur cette personne et, d’autre part, d’établir ainsi un profil de celle-ci (à cet égard voir aussi l’arrêt de la CJUE du 13 mai 2014, no C-131/12,– paragraphes 59 – 62 ci-dessus).
i. La contribution à un débat d’intérêt général
98. En ce qui concerne la question de l’existence d’un débat d’intérêt général, la Cour observe que la Cour fédérale de justice a relevé l’intérêt considérable que le crime et le procès pénal avaient suscité à l’époque en raison de la gravité des faits et de la notoriété de la victime, et elle a noté que les requérants avaient essayé au-delà de l’année 2000 d’obtenir la réouverture de leur procès. La haute juridiction a souligné en outre le caractère véridique et objectif des reportages. La Cour peut souscrire à cette analyse étant donné que le public a en principe un intérêt à être informé des procédures en matière criminelle et à pouvoir s’informer à cet égard, surtout lorsque celles-ci portent sur un fait judiciaire particulièrement grave et ayant suscité une attention considérable (voir, par exemple, Schweizerische Radio‑ und Fernsehgesellschaft SRG c. Suisse, no 34124/06, § 56, 21 juin 2012, et Egeland et Hanseid c. Norvège, no 34438/04, § 58, 16 avril 2009). Cela ne concerne pas seulement des reportages parus pendant la tenue du procès pénal en question mais peut inclure également, en fonction des circonstances de l’affaire, des reportages rendant compte d’une demande de réouverture de ce procès quelques années après la condamnation.
99. La Cour relève que les présentes requêtes ont ceci de particulier que ce n’est pas la licéité des reportages lors de leur première parution ou leur mise à disposition sur les portails Internet des médias concernés que les requérants mettent en cause, mais la possibilité d’accès à ces reportages longtemps après et, notamment, à l’approche de la date prévue de leur sortie de prison. Elle doit donc examiner la question de savoir si la mise à disposition des reportages litigieux a continué à contribuer à un débat d’intérêt général.
100. La Cour rappelle que, après l’écoulement d’un certain temps et en particulier à l’approche de la sortie de prison d’une personne condamnée, l’intérêt de celle-ci est de ne plus être confrontée à son acte en vue de sa réintégration dans la société (Österreichischer Rundfunk c. Autriche, no 35841/02, § 68, 7 décembre 2006, et Österreichischer Rundfunk, décision précitée ; voir aussi, mutatis mutandis, Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède, no 62332/00, §§ 90-91, CEDH 2006-VII). Ceci peut être d’autant plus vrai après la libération définitive d’une personne condamnée. De même, l’étendue de l’intérêt du public quant aux procédures pénales est variable, car il peut évoluer au cours de la procédure en fonction, entre autres, des circonstances de l’affaire (Axel Springer AG, précité, § 96).
101. Revenant à la présente espèce, la Cour observe que la Cour fédérale de justice, tout en reconnaissant aux requérants un intérêt élevé à ne plus être confrontés à leur condamnation, a souligné que le public avait un intérêt non seulement à être informé sur un événement d’actualité, mais aussi à pouvoir faire des recherches sur des événements passés. La haute juridiction a également rappelé que les médias avaient pour mission de participer à la formation de l’opinion démocratique en mettant à la disposition du public des informations anciennes conservées dans leurs archives.
102. La Cour souscrit entièrement à cette conclusion. Elle n’a en effet cessé de souligner le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 65, série A no 30), et ce également par le biais de ses sites Internet et par la constitution d’archives numériques qui contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’information et à sa diffusion (Times Newspapers Ltd (nos 1 et 2), précité, § 27, et Węgrzynowski et Smolczewski, précité, § 65). Par ailleurs, d’après la jurisprudence de la Cour, l’intérêt légitime du public à pouvoir accéder aux archives électroniques publiques de la presse est protégé par l’article 10 de la Convention (ibidem), et toute mesure limitant l’accès à des informations que le public a le droit de recevoir doit être justifiée par des raisons particulièrement impérieuses (Timpul Info-Magazin et Anghel c. Moldova, no 42864/05, § 31, 27 novembre 2007, et Times Newspapers Ltd (nos 1 et 2), précité, § 41).
103. Dans ce contexte, la Cour observe que la Cour fédérale de justice a pointé le risque d’un effet dissuasif sur la liberté d’expression de la presse en cas d’accueil de demandes telles que celle des requérants, en particulier le risque que les médias, faute de moyens suffisants en personnel et en temps pour examiner pareilles demandes, soient amenés à ne plus inclure dans leurs reportages d’éléments identifiants susceptibles de devenir ultérieurement illicites.
104. La Cour constate que les requérants ne demandent pas que les médias vérifient leurs archives de manière systématique et permanente, mais qu’ils procèdent à une telle vérification uniquement en cas de demande individuelle expresse. Cela étant, elle ne saurait écarter l’existence du risque pour la presse dont a fait état la Cour fédérale de justice. En effet, l’obligation d’examiner à un stade ultérieur la licéité d’un reportage à la suite d’une demande de la personne concernée, qui implique, comme l’a souligné le Gouvernement à juste titre, une mise en balance de tous les intérêts en jeu, comporterait le risque que la presse s’abstienne de conserver des reportages dans ses archives en ligne ou qu’elle omette des éléments individualisés dans des reportages susceptibles de faire l’objet d’une telle demande. Tout en reconnaissant l’importance des droits d’une personne ayant fait l’objet d’une publication disponible sur Internet, ces droits doivent aussi être mis en balance avec le droit du public à s’informer sur des événements du passé et de l’histoire contemporaine, notamment à l’aide des archives numériques de la presse. La Cour rappelle à cet égard qu’elle doit faire preuve de la plus grande prudence lorsqu’elle est appelée à examiner, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, des mesures ou des sanctions infligées à la presse qui sont de nature à dissuader celle-ci de participer à la discussion de problèmes d’un intérêt général légitime (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 64, CEDH 1999-III, et Times Newspapers Ltd (nos 1 et 2), précité, § 41).
105. Dans la mesure où les requérants soulignent ne pas demander que les reportages litigieux soient supprimés, mais seulement que leurs noms n’y figurent plus, la Cour note que l’anonymisation d’un reportage constitue certes une mesure moins attentatoire à la liberté d’expression qu’une suppression du reportage tout entier (voir, mutatis mutandis, Times Newspapers Ltd (nos 1 et 2), précité, § 47). Elle rappelle cependant que la manière de traiter un sujet relève de la liberté journalistique et que l’article 10 de la Convention laisse aux journalistes le soin de décider quels détails doivent être publiés pour assurer la crédibilité d’une publication sous réserve que les choix que ceux-ci opèrent à cet égard soient fondés sur les règles d’éthique et de déontologie de leur profession (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy, précité, § 186). La Cour estime, à l’instar des médias tiers intervenants, que l’inclusion dans un reportage d’éléments individualisés, tel le nom complet de la personne visée, constitue un aspect important du travail de la presse (Fuchsmann c. Allemagne, no 71233/13, § 37, 19 octobre 2017), et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit de reportages sur des procédures pénales ayant suscité un intérêt considérable. Elle conclut que, dans la présente affaire, la disponibilité des reportages litigieux sur les sites web des médias au moment de l’introduction des demandes des requérants contribuait toujours à un débat d’intérêt général que l’écoulement d’un laps de temps de quelques années n’a pas fait disparaître.
ii. La notoriété de la personne visée et l’objet du reportage
106. En ce qui concerne la notoriété des requérants, la Cour relève que les juridictions allemandes ne se sont pas explicitement prononcées sur ce sujet. Elle observe cependant que la notoriété des intéressés était étroitement liée à la commission par eux de l’assassinat et au procès pénal qui s’en est suivi. Dès lors, si rien ne semble indiquer que les requérants étaient connus du public avant leur crime, ils ont néanmoins acquis une notoriété certaine pendant la tenue du procès, lequel, d’après les constatations des juridictions civiles, a suscité une attention considérable de l’opinion publique en raison de la nature et des circonstances du crime et de la célébrité de la victime. Si, par la suite et avec l’écoulement du temps, l’intérêt du public à l’égard de ce crime et, partant, la notoriété des requérants ont décliné, la Cour observe que les requérants ont connu un regain de notoriété après avoir tenté, à plusieurs reprises, d’obtenir la réouverture de leur procès pénal et après s’être adressés à la presse à ce propos. La Cour en conclut que les requérants n’étaient pas de simples personnes privées inconnues du public au moment de l’introduction de leurs demandes d’anonymat.
107. En ce qui concerne l’objet des reportages, la Cour note que ceux-ci avaient trait soit à la tenue du procès pénal à l’époque, soit à l’une des demandes des requérants tendant à la réouverture du procès, autant d’éléments susceptibles de contribuer à un débat dans une société démocratique. Elle renvoie à cet égard à ses conclusions (paragraphe 111 ci‑dessous).
iii. Le comportement antérieur de la personne visée à l’égard des médias
108. En ce qui concerne le comportement des requérants depuis leur condamnation, la Cour observe, comme l’a relevé la Cour fédérale de justice, que les intéressés ont introduit tous les recours judiciaires « possibles et imaginables » pour obtenir la réouverture de leur procès pénal. De surcroît, comme le Gouvernement l’a souligné, au cours de leur dernière demande en révision, effectuée en 2004, c’est-à-dire deux ans et demi et trois ans respectivement avant leur libération, les requérants se sont tournés vers la presse, à laquelle ils ont transmis un certain nombre de documents en partie liés à leur demande en révision, tout en l’invitant à en tenir le public informé. Par ailleurs, il n’est pas non plus sans intérêt de noter que, comme l’a indiqué la Cour fédérale de justice dans son arrêt du 22 février 2011 concernant le deuxième requérant (paragraphe 45 ci‑dessus), l’on pouvait trouver, jusqu’en 2006, sur le site web de l’avocat pénaliste du deuxième requérant, de nombreux reportages sur son client.
109. Dans ce contexte, si l’on ne peut reprocher à une personne condamnée – qui, de surcroît, proteste de son innocence – de faire usage des recours judiciaires disponibles en droit interne pour contester sa condamnation, la Cour relève que les tentatives des requérants sont allées bien au-delà de la simple utilisation des voies de recours disponibles en droit pénal allemand. En particulier, du fait de leur comportement notamment à l’égard de la presse, l’intérêt des requérants à ne plus être confrontés à leur condamnation par le biais des informations archivées sur les portails Internet d’un certain nombre de médias revêtait une moindre importance en l’espèce. La Cour conclut que les requérants, même à l’approche de leur libération, n’avaient dès lors plus qu’une espérance légitime limitée (voir, mutatis mutandis, Axel Springer AG, précité, § 101) d’escompter l’anonymisation des reportages, voire un droit à l’oubli numérique.
iv. Le contenu, la forme et les répercussions de la publication
110. La Cour rappelle que la façon dont le reportage ou la photo sont publiés et dont la personne visée y est présentée peut également entrer en ligne de compte. De même, l’ampleur de la diffusion du reportage ou de la photo peut, elle aussi, revêtir une importance, selon qu’il s’agit d’un journal à tirage national ou local, important ou faible (Von Hannover (no 2), précité, § 112, et les références qui y sont citées).
111. En ce qui concerne l’objet, le contenu et la forme des dossiers litigieux, la Cour estime que la manière dont la Cour fédérale de justice a apprécié des reportages de la Deutschlandradio et du Mannheimer Morgen ne saurait prêter à critique. Il s’agit en effet de textes qui ont été écrits par des médias dans l’exercice de leur liberté d’expression, qui relatent de manière objective une décision de justice et dont la véracité et la licéité d’origine n’ont à aucun moment été mises en cause (voir, a contrario, Węgrzynowski et Smolczewski, précité, § 60). S’agissant du dossier de Spiegel online, la Cour admet que certains articles, en particulier celui paru dans l’édition du 30 novembre 1992 (paragraphe 28 ci-dessus), peuvent donner lieu à des interrogations en raison de la nature des informations données. Cela dit, elle observe que les détails relatifs à la vie des accusés dont l’auteur des articles rendait compte font partie des informations qu’un juge pénal doit régulièrement prendre en considération pour apprécier les circonstances du crime et les éléments de culpabilité individuelle, et qui font de ce fait en règle générale l’objet de débats lors des audiences publiques. Par ailleurs, ces articles ne reflètent pas une intention de présenter les requérants d’une manière dépréciative ou de nuire à leur réputation (Lillo‑Stenberg et Sæther c. Norvège, no 13258/09, § 41, 16 janvier 2014, et Sihler-Jauch et Jauch c. Allemagne (déc.), nos 68273/10 et 34194/11, § 38, 24 mai 2016).
112. En ce qui concerne le degré de diffusion des publications litigieuses, la Cour note que la Cour fédérale de justice a estimé que, à la différence d’un sujet télévisé diffusé à une heure de grande écoute, les informations litigieuses avaient une diffusion limitée en raison de leur accessibilité restreinte et de leur emplacement non pas sur les pages consacrées à l’actualité sur les portails Internet des médias concernés, mais dans des rubriques indiquant clairement qu’il s’agissait de reportages anciens. Les requérants contestent ce raisonnement et reprochent à la Cour fédérale de justice notamment d’avoir méconnu les réalités de l’ère Internet et d’avoir sous-estimé les dangers liés à la pérennité des informations figurant sur ce média, dus notamment à l’existence de moteurs de recherche puissants et efficaces.
113. La Cour observe que, du fait de leur emplacement sur les portails Internet, les reportages litigieux n’étaient pas susceptibles d’attirer l’attention de ceux des internautes qui n’étaient pas à la recherche d’informations sur les requérants (voir, a contrario et mutatis mutandis, Mouvement raëlien c. Suisse [GC], no 16354/06, § 69, CEDH 2012). De même, la Cour n’aperçoit pas d’indices montrant que le maintien de l’accès à ces reportages aurait eu pour but de propager de nouveau des informations sur les requérants. Dans cette mesure, la Cour peut suivre les conclusions de la Cour fédérale de justice selon lesquelles le degré de diffusion des reportages était limité (Fuchsmann, précité, § 52), d’autant qu’une partie des informations était frappée de restrictions supplémentaires (l’accès payant dans le cas du Spiegel online ou réservé aux abonnés dans le cas du Mannheimer Morgen).
114. Dans la mesure où les requérants soutiennent que cette façon de mesurer le degré de diffusion ne tient pas compte du caractère amplificateur et ubiquitaire d’Internet et, partant, de la possibilité, indépendamment du degré de diffusion initiale, de trouver les informations sur eux de manière permanente, notamment à l’aide de moteurs de recherche, la Cour, tout en étant consciente de l’accessibilité durable de toute information une fois publiée sur Internet, constate que les requérants n’ont pas fait part des tentatives qu’ils auraient faites de s’adresser aux exploitants des moteurs de recherche pour réduire la détectabilité des informations sur leurs personnes (Fuchsmann, précité, § 53, et Phil c. Suède (déc.), no 74742/14, 7 février 2017). Par ailleurs, la Cour estime qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la possibilité, pour les juridictions internes, d’ordonner des mesures moins attentatoires à la liberté d’expression des médias mis en cause qui n’ont pas fait l’objet de débats devant celles-ci au cours de la procédure interne ni, par ailleurs, au cours de la procédure devant la Cour.
v. Les circonstances de la prise des photos
115. Enfin, en ce qui concerne les photos mises en cause (voir paragraphes 37-38 ci-dessus), la Cour note que ni les requérants ni les juridictions civiles ne se sont prononcés sur les circonstances de leur prise. Elle n’aperçoit cependant sur ces photos aucun élément compromettant et observe par ailleurs, comme la Cour fédérale de justice l’a relevé à juste titre, que les images montraient les requérants dans l’apparence qui était la leur en 1994, soit près de treize ans avant leur libération, ce qui diminue la probabilité d’être reconnu par des tiers sur la base des photos.
c) Conclusion
116. Compte tenu de la marge d’appréciation des autorités nationales en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, de l’importance de garder disponibles des reportages dont la licéité lors de leur parution n’est pas contestée et du comportement des requérants vis-à-vis de la presse, la Cour estime qu’il n’y a pas de raisons sérieuses qui justifieraient qu’elle substitue son avis à celui de la Cour fédérale de justice. On ne saurait dès lors dire que, en refusant de donner suite à la demande des requérants, la Cour fédérale de justice a manqué aux obligations positives de l’État allemand de protéger le droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. Partant il n’y a pas eu violation de cette disposition.
LA PROTECTION DU LANCEUR D'ALERTE
Špadijer c. Monténégro du 9 novembre 2021 requête no 31549/18
Art 8 : Brimades présumées à l'encontre d'une gardienne de prison lanceuse d'alerte
L'affaire concerne l'intimidation présumée d'une gardienne de prison suite au signalement qu’elle a fait d'un incident impliquant des gardiens de prison masculins entrant dans la prison pour femmes où elle travaillait et leur contact inapproprié avec des détenues, ainsi que ses tentatives pour aborder cette question avec les autorités. La Cour estime, en particulier, que la manière dont les mécanismes juridiques ont été mis en œuvre dans le cas de la requérante a été inadéquate, ce qui constitue une violation de l'obligation de l'État de protéger ses droits.
FAITS
En 2013, Mme Špadijer, alors cheffe de quart dans une prison pour femmes, a dénoncé cinq collègues pour un incident au cours duquel des gardiens de prison masculins avaient été autorisés à entrer dans la prison et l'un d'entre eux avait eu des " contacts physiques " avec deux détenues. Peu après, elle a eu un appel téléphonique prétendument intimidant avec un collègue, puis son pare-brise a été fracassé. Elle a porté plainte auprès de la police. Aucune action en justice n'a suivi. D'autres incidents présumés de comportement d'intimidation se sont produits. En 2013, les collègues de Mme Špadijer qui avaient été impliqués dans l'incident ont été condamnés à une amende représentant entre 20 et 30 % de leur salaire pendant deux à trois mois. L'un des gardiens de prison masculins a également été suspendu de son travail pendant la procédure, avec une réduction de salaire de 40 %. Plus tard dans l'année, ce dernier gardien de prison a craché devant elle et l'a insultée en disant : "Voilà la salope qui pue. Si seulement elle perdait 50 kilos, elle aurait l'air acceptable". Elle s'est plainte auprès de la sécurité de la prison. Le directeur n'ayant pas donné suite à sa plainte, elle s'est adressée au directeur adjoint. Celui-ci a déclaré que "même si le ministre de la Justice l'appelait, la requérante ne serait plus chef d'équipe". Mme Špadijer a allégué que des incidents d'intimidation, nombreux et répétés, ont suivi, et qu'à plusieurs reprises, la hiérarchie de la prison n'a pas réussi à la soutenir. En septembre 2013, elle s'est mise en congé de maladie. Une plainte auprès du médiateur a été rejetée. En novembre 2013, elle a saisi le tribunal, sans succès. Le tribunal a déclaré que les incidents n'avaient pas constitué des brimades, mais a estimé qu'elle souffrait d'un stress post-traumatique dû à ces incidents. Alors que la procédure était en cours, elle a été attaquée, battue et avertie par un agresseur inconnu. Le jugement de première instance a été confirmé par la Haute Cour et la Cour suprême, et la plainte constitutionnelle qu'elle a déposée n'a pas abouti. De même, une plainte auprès du médiateur est restée vaine. En 2016, Mme Špadijer a pris sa retraite pour des raisons de santé.
article 8
Article 8 Tout d'abord, la Cour estime que le principal grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article 8 plutôt que sous celui des articles 3 et 6. La Cour considère qu'il est établi qu'il existe un lien entre les incidents et la prétendue réaction déficiente des autorités compétentes, d'une part, et les problèmes psychologiques de la requérante, d'autre part. La Cour rappelle que les États ont le devoir de protéger l'intégrité physique et psychologique des individus contre les tiers, y compris en mettant en place un cadre juridique dans ce but. La Cour confirme qu'il existe, en droit interne, des recours contre les brimades. Toutefois, ces recours doivent également fonctionner dans la pratique. Elle considère que le processus de médiation n'a pas été conforme à la loi. Bien qu'un lien entre les incidents en question et l'état de santé de la requérante ait été établi, celle-ci n'a reçu aucune protection de la part des tribunaux, qui ont jugé la fréquence des incidents insuffisante pour justifier une action. La Cour rappelle que les plaintes pour harcèlement moral doivent être examinées en détail et dans leur globalité, et non rejetées sur la seule base de leur fréquence ou de leur rareté, en tenant compte de l'ensemble du contexte ; certains des incidents individuels n'ont pas été examinés du tout. La Cour estime, en outre, que la réaction des procureurs a été trop lente, ce qui a privé la requérante de la possibilité de faire avancer son dossier.
Dans l'ensemble, la Cour estime que la manière dont les mécanismes juridiques ont été mis en œuvre dans le cas de la requérante - y compris l'important contexte de dénonciation - a été inadéquate, ce qui constitue une violation de l'obligation positive de l'État de protéger la requérante
L'EMPLOI EST PROTEGE PAR L'ARTICLE 8
Thevenon c. France du 6 octobre 2021 requête no 46061/21
Covid et article 8 : la CEDH rejette, il s'agit des droits de l'hommes qui doivent s'écarter face au Covid alors que les injections peuvent être dangereuses, mais il ne faut pas le dire au public. J'étais pris pour un imbécile pour refuser de faire le recours devant la CEDH. Cette décision me donne tristement raison !
La Cour européenne déclare la requête d’un sapeur-pompier qui contestait l’obligation de vaccination contre la covid 19 posée à l’égard de certaines professions par la loi du 5 août 2021 irrecevable pour non épuisement des voies de recours interne
L’affaire concerne le refus d’un sapeur-pompier de respecter l’obligation de vaccination contre la covid 19 posée à l’égard des membres de certaines professions par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ayant refusé se faire vacciner sans se prévaloir d’un des motifs de contre-indication prévus par la loi, le requérant fut suspendu de ses fonctions et de son engagement. Il saisit directement la Cour en invoquant des violations des articles 8 (droit au respect de la vie privée), 14 (interdiction de discrimination) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). La Cour rejette la requête comme irrecevable faute pour le requérant d’avoir épuisé les voies de recours internes avant de la saisir. Pour ce faire, elle rappelle qu’en droit français, le recours pour excès de pouvoir est une voie de recours interne à épuiser et que, pour pleinement épuiser les voies de recours internes, il faut donc en principe mener la procédure interne, le cas échéant, jusqu’au juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour. Écartant l’argumentation du requérant sur ce point, elle précise qu’une telle exigence vaut indépendamment, d’une part, de l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi du 5 août 2021 conforme à la Constitution dès lors qu’il ne se prononce pas au regard des dispositions de la Convention et, d’autre part, de l’avis rendu sur le projet de loi par la commission permanente du Conseil d’État, dans le cadre des fonctions consultatives de ce dernier. La Cour en déduit qu’un recours effectif était donc ouvert en droit interne qui aurait permis au requérant de contester devant le juge administratif, outre les décisions individuelles de suspension professionnelle, le respect par la loi n° 2021 1040 du 5 août 2021 et son décret d’application du 7 août 2021 des articles de la Convention invoqués devant la Cour. Dans ces conditions, elle déclare sa requête irrecevable.
FAITS
Le requérant, M. Pierrick Thevenon, est un ressortissant français né en 1988 et résidant à SaintMartin-en-Haut. Il est sapeur-pompier professionnel et volontaire. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé déclara que le monde se trouvait confronté à une pandémie causée par un nouveau coronavirus nommé SARS-CoV-2, responsable d’une maladie infectieuse appelée covid-19. La propagation de ce coronavirus conduisit les autorités françaises à prendre des mesures pour prévenir et réduire les conséquences des menaces sanitaires sur la santé de la population. Un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire fut notamment élaboré.
La loi n° 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire fut adoptée définitivement le 25 juillet 2021 et promulguée le 5 août 2021. Elle rendit obligatoire la vaccination contre la covid-19 pour les employés des secteurs sanitaire et médico-social, exception faite des personnels chargés d’une tâche ponctuelle au sein des locaux concernés et sauf contre-indication médicale. Les sapeurspompiers, expressément cités dans l’article 12 de la loi, y furent donc soumis. N’étant pas vacciné contre la covid-19, M. Thevenon fut informé des conséquences qu’emporterait une interdiction d’exercer son activité de sapeur-pompier, tant professionnel que volontaire, ainsi que des moyens de régulariser sa situation, par courriers des 31 août et 7 septembre 2021. Il refusa néanmoins de se faire vacciner. Le 15 septembre 2021, comme M. Thevenon ne justifiait pas du respect de l’obligation vaccinale ou d’un certificat médical de contre-indication, la présidente du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours de la ville de Lyon et du département du Rhône prit deux arrêtés de suspension de fonctions et d’engagement de l’intéressé, respectivement en sa qualité de sapeur-pompier professionnel et de sapeur-pompier volontaire, dans l’intérêt du service pour des raisons d’ordre public, afin de protéger la santé des personnes, avec interruption de sa rémunération s’agissant de son activité professionnelle. M. Thevenon n’exerça aucun recours. Le 19 août 2021, M. Thevenon et d’autres sapeurs-pompiers ou salariés travaillant en milieu hospitalier demandèrent, sur le fondement de l’article 39 du Règlement de la Cour, la suspension de « l’obligation vaccinale telle que prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 ». Le 24 août 2021, la Cour ne fit pas droit à cette demande, estimant qu’elle se situait hors du champ d’application de l’article 39.
CEDH
57. La Cour rappelle d’emblée que lorsqu’un doute existe quant à l’efficacité d’un recours interne, c’est là un point qui doit être soumis aux tribunaux nationaux (Roseiro Bento c. Portugal (déc.), no 29288/02, CEDH 2004-XII (extraits), Lienhardt c. France (déc.), no 12139/10, 13 septembre 2011, Vučković et autres, précité, § 74, et Zambrano, précitée, § 28).
58. Elle relève que le requérant n’a pas saisi les juridictions administratives de recours pour excès de pouvoir à l’encontre des arrêtés de suspension de fonctions et d’engagement, en sa qualité de sapeur-pompier professionnel et volontaire, en date du 15 septembre 2021 (paragraphes 25‑26 ci-dessus). Elle note qu’à compter de cette dernière date, il disposait pourtant d’un délai de deux mois pour introduire des requêtes en ce sens.
59. La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt, et c’est primordial, un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller [en premier lieu] à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014). Dans le contexte de l’épuisement des voies de recours internes et à l’égard du caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour a toujours reconnu que les autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et que grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les besoins et le contexte locaux (voir, par exemple, Dubská et Krejzová c. République tchèque [GC], nos 28859/11 et 28473/12, § 175, CEDH 2016, et Maurice c. France [GC], no 11810/03, § 117, CEDH 2005‑IX, avec d’autres références).
60. La règle de l’épuisement des recours internes se fonde sur l’hypothèse, reflétée dans l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, parmi beaucoup d’autres, Vučković et autres, précité, § 69, et Anagnostakis et autres c. Grèce, no 46075/16, § 47, 23 septembre 2021). Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection (ibidem), dont la mise en œuvre effective repose notamment sur le principe de subsidiarité inhérent à la Convention et consacré dans la jurisprudence de la Cour. À la suite de l’entrée en vigueur du Protocole no 15 le 1er août 2021, le préambule de la Convention s’y réfère d’ailleurs expressément (Bouras c. France, no 31754/18, § 44, 19 mai 2022). Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours effectifs qu’offre le système juridique de celui-ci.
61. Ainsi, en droit français, le recours pour excès de pouvoir, dans le cadre duquel il est possible de développer, à l’appui des conclusions d’annulation, des moyens fondés sur une violation de la Convention, est une voie de recours interne à épuiser (voir, en dernier lieu, Graner c. France (déc.), no 84536/17, § 44, 5 mai 2020). La Cour rappelle également que le pourvoi en cassation figure parmi les procédures dont il doit ordinairement être fait usage pour se conformer à l’article 35 de la Convention (voir, par exemple, Renard et autres c. France (déc.), nos 3569/12, 9145/12, 9161/12 et 37791/13, 25 août 2015, et Graner, précitée, § 61). Pour pleinement épuiser les voies de recours internes, il faut donc en principe mener la procédure interne, le cas échéant, jusqu’au juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour. Or, une telle exigence vaut indépendamment de l’intervention d’une décision du Conseil constitutionnel, qui ne se prononce pas au regard des dispositions de la Convention (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH 1999‑VII). En effet, le contrôle du respect de la Convention effectué par le « juge ordinaire » est distinct du contrôle de conformité de la loi à la Constitution effectué par le Conseil constitutionnel : une mesure prise en application d’une loi (acte réglementaire ou décision individuelle) dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux a été déclarée par le Conseil constitutionnel peut être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention à raison, par exemple, de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (Charron et Merle-Montet, précité, § 28, et Graner, précitée, § 53). Par ailleurs, il est loisible à un requérant qui saisit le juge de l’excès de pouvoir d’un recours, que celui-ci soit dirigé contre un décret d’application d’une loi, une décision refusant d’abroger un tel décret ou une décision individuelle prise sur son fondement d’invoquer, par la voie de l’exception, l’inconventionnalité de cette loi à l’appui de ses conclusions d’annulation. Un recours effectif était donc ouvert en droit interne qui aurait permis au requérant de contester devant le juge administratif, outre les décisions individuelles le concernant, à savoir les deux arrêtés de suspension du 15 septembre 2021 (paragraphe 25 ci‑dessus), le respect par la loi no 2021‑1040 du 5 août 2021 et son décret d’application du 7 août 2021 des articles de la Convention invoqués devant la Cour (Zambrano, précitée, § 27).
62. Certes, le requérant estime également que l’avis consultatif du Conseil d’État en date du 19 juillet 2021 était de nature à le dispenser de contester la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 par voie d’exception à l’occasion d’une procédure intéressant sa situation personnelle (paragraphe 53 ci-dessus).
63. La Cour rappelle cependant, d’une part, qu’il ne lui appartient pas de statuer dans l’abstrait sur la question de savoir si les attributions consultatives du Conseil d’État sont compatibles avec ses fonctions juridictionnelles et les exigences d’indépendance et d’impartialité qu’elles impliquent, et d’autre part, que le principe de la séparation des pouvoirs n’est « pas déterminant dans l’abstrait ». Il lui revient seulement de déterminer dans chaque espèce si l’avis rendu par la haute juridiction a constitué « une sorte de préjugement » de l’arrêt critiqué, « entraînant un doute sur l’impartialité « objective » de la formation de jugement du fait de l’exercice successif des fonctions consultatives et juridictionnelles » (Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98 et 3 autres, § 198, CEDH 2003-VI, Sacilor-Lormines c. France, no 65411/01, §§ 70-74, CEDH 2006-XIII, et Union fédérale des consommateurs Que choisir de Côte d’Or c. France, précitée). Le simple fait qu’une institution cumule des fonctions consultatives et des fonctions juridictionnelles ne suffit pas pour mettre en cause l’impartialité de cette institution exerçant ses fonctions juridictionnelles (Union fédérale des consommateurs Que choisir de Côte d’Or, précitée, Greneche et autres c. France (déc.), nos 34538/08, 43556/09 et 59765/08, 15 octobre 2013, et Ryon et autres c. France (déc.), no 33014/08 et autres, 15 octobre 2013).
64. Partant, aux yeux de la Cour, on ne saurait déduire de l’avis rendu le 19 juillet 2021 par la commission permanente du Conseil d’État, qui est une formation consultative, que son contenu et ses conclusions seraient de nature à constituer un préjugement ou à lier les membres de la section du contentieux du Conseil d’État qui auraient été appelés à statuer sur un recours introduit par le requérant. La Cour note d’ailleurs que la commission permanente du Conseil d’État a non seulement émis des réserves sur le projet de loi, mais également mis en exergue deux éléments de nature à relativiser la portée de son avis pour l’avenir : d’une part, le fait qu’eu égard à la date et aux conditions de sa saisine, elle avait disposé de moins d’une semaine pour rendre cet avis, considérant cette situation d’autant plus regrettable que le projet de loi soulevait des questions sensibles et pour certaines inédites qui imposaient la recherche d’une conciliation délicate entre les exigences qui s’attachent à la garantie des libertés publiques et les considérations sanitaires mises en avant par le Gouvernement (paragraphe 12 ci-dessus) ; d’autre part, que si le projet de loi répondait, sous certaines réserves, de manière proportionnée aux objectifs de santé publique poursuivis, c’était toutefois au regard de la situation sanitaire telle qu’elle existait à la date de son avis et qu’il était donc nécessaire de réévaluer ce cadre juridique en fonction de l’évolution de la situation sanitaire pour ne pas maintenir des dispositions qui ne seraient plus adaptées à la lutte contre l’épidémie (paragraphe 16 ci‑dessus).
65. Dès lors, la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Pişkin c. Turquie du 15 décembre 2020 requête n° 33399/18
Article 8 : Un licenciement fondé sur le décret-loi d’état d’urgence n° 677, sans un contrôle juridictionnel effectif, viole la Convention
L’affaire concerne le licenciement de M. Pişkin au motif qu’il avait des liens avec une organisation terroriste, à la suite de la déclaration de l’état d’urgence en Turquie après la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016, ainsi que le contrôle juridictionnel subséquent de cette mesure. M. Pişkin se plaignait que ni la procédure relative à son licenciement ni la procédure juridictionnelle subséquente n’avaient respecté les garanties d’équité du procès. Il se plaignait aussi d’avoir été étiqueté en tant que « terroriste » et « traître ». La Cour relève que le décret-loi n o 667 non seulement autorisait la révocation des fonctionnaires, mais aussi astreignait les institutions publiques telles que l’employeur de M. Pişkin à révoquer les employés de la fonction publique selon une procédure simplifiée. Le processus décisionnel préalable ayant abouti à la résiliation du contrat de travail n’exigeait pas la moindre procédure contradictoire et aucune garantie procédurale spécifique n’était prévue dans le décret-loi. Il suffisait donc que l’employeur considérât que l’employé appartenait, était affilié ou était lié aux structures illégales définies dans ledit décret-loi sans même fournir une motivation sommaire et individualisée. En ce qui concerne le droit à un procès équitable, la Cour estime que la question cruciale était celle de savoir si l’impossibilité pour M. Pişkin de prendre connaissance des motifs ayant conduit son employeur à résilier son contrat de travail était suffisamment contrebalancée par un contrôle juridictionnel effectif de la décision son employeur. La Cour juge à cet égard que les juridictions internes n’ont pas procédé à un examen approfondi et sérieux des moyens de M. Pişkin, qu’elles n’ont pas fondé leur raisonnement sur les éléments de preuve présentés par celui-ci et qu’elles n’ont pas valablement motivé le rejet de ses contestations. Ces défaillances ont donc placé M. Pişkin dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Alors que d’un point de vue théorique, les juridictions nationales disposaient de la pleine juridiction pour statuer sur le litige opposant M. Pişkin et l’administration, elles ont renoncé à la compétence leur permettant d’examiner toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont elles étaient saisies, comme l’exige pourtant l’article 6 § 1 de la Convention. Enfin, elle considère que le manquement aux exigences d’une procédure équitable ne saurait être justifié par la dérogation de la Turquie (article 15 de la Convention, dérogation en cas d’état d’urgence). En ce qui concerne le respect au droit à la vie privée, la Cour juge que le licenciement de M. Pişkin a eu de graves conséquences négatives sur son « cercle intime », sur la possibilité pour lui de nouer et de développer des relations avec autrui, ou sur sa réputation. Notamment, selon M. Pişkin, il est sans emploi depuis la résiliation de son contrat et les employeurs n’osent pas lui proposer un emploi en raison du fait que son licenciement était fondé sur le décret-loi n o 667. Par conséquent, la résiliation du contrat de travail de M. Pişkin a eu des répercussions négatives lourdes sur sa vie privée et a atteint le niveau de gravité nécessaire pour que l’article 8 trouve à s’appliquer. Pour la Cour, même lorsque des considérations liées à la sécurité nationale entrent en ligne de compte, les principes de légalité et d’état de droit applicables dans une société démocratique exigent que toute mesure touchant les droits fondamentaux de la personne puisse être soumise à une forme de procédure contradictoire devant un organe indépendant compétent pour examiner les motifs de l’ingérence en question et les preuves pertinentes. Or, en l’occurrence, les juridictions nationales ont failli à déterminer quelles raisons concrètes avaient justifié la résiliation du contrat de travail de M. Pişkin. Le contrôle juridictionnel de l’application de la mesure n’a donc pas été adéquat et M. Pişkin n’a pas joui du degré minimal de protection contre l’arbitraire voulu par l’article 8 de la Convention. En outre, la mesure litigieuse ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par les circonstances particulières de l’état d’urgence.
Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Art 8 • Vie privée • Contrôle juridictionnel inadéquat du licenciement d’un employé d’un institut public, en vertu d’un décret-loi d’état d’urgence, pour ses liens présumés avec une organisation terroriste considérée être l’instigatrice de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 • Révocation autorisée selon une procédure simplifiée non contradictoire et sans garantie procédurale ni motivation sommaire et individualisée • Stigmatisation et conséquences lourdes sur la réputation professionnelle et sociale du requérant • Absence d’examen approfondi et sérieux par les tribunaux internes
Art 15 • Manquement aux exigences d’une procédure équitable non justifiés par la dérogation en cas d’état d’urgence • Procédure simplifiée de licenciement pouvant être justifiée au regard des circonstances très particulières de l’état d’urgence • Décret-loi d’état d’urgence n’excluant pas clairement et explicitement un contrôle judiciaire des mesures prises pour son exécution
FAITS
M. Pişkin travaillait depuis décembre 2010 en qualité d’expert à l’agence de développement d’Ankara (Ankara Kalkınma Ajansı), personne de droit public ayant pour mission de coordonner les activités régionales des organismes publics et privés. Son contrat de travail, à durée indéterminée, était régi par le code du travail (loi n° 4857) et son statut juridique était soumis aux règles de droit privé. Le 26 juillet 2020, soit quelques jours après la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016, le comité directeur de l’agence d’Ankara se réunit afin d’évaluer la situation de ses employés. Le jour même, il décida de résilier les contrats de travail de six personnes, dont M. Pişkin, en application du décret-loi n° 667, estimant que les intéressés appartenaient à des structures menaçant la sécurité nationale ou en raison de leurs rapports d’affiliation, liens ou relations avec de telles structures. Le 14 août 2016, M. Pişkin introduisit un recours devant le tribunal du travail d’Ankara pour demander l’annulation de la décision de résiliation de son contrat de travail. Il invoqua, entre autres, que son licenciement n’était pas fondé sur un motif valable, qu’il était abusif et entaché de nullité. Il réclama en outre des indemnités de licenciement. Le 25 octobre 2016, le tribunal du travail débouta M. Pişkin. Ce dernier fit appel, puis se pourvut en cassation, sans succès. En dernier lieu, il introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle qui déclara ses griefs irrecevables le 10 mai 2018. Le 5 septembre 2018, le parquet général d’Ankara rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard de M. Pişkin, estimant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves justifiant les soupçons requis pour intenter une procédure pénale à son encontre.
Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
L’applicabilité de l’article 8
D’une part, la Cour relève que les tribunaux nationaux ne se sont aucunement référés à l’enquête pénale et qu’en outre il n’existe aucun élément dans le dossier donnant à penser que cette enquête ou la procédure devant les tribunaux internes relative au licenciement de M. Pişkin avaient permis aux autorités nationales d’obtenir des informations ou éléments factuels susceptibles de justifier le motif de licenciement. La Cour conclut qu’il n’existe pas le moindre élément laissant à suggérer que la résiliation du contrat de travail de M. Pişkin résultait de manière prévisible de ses propres actions. D’autre part, la Cour constate que le licenciement de M. Pişkin a eu de graves conséquences négatives sur son « cercle intime », sur la possibilité pour lui de nouer et de développer des relations avec autrui, ou sur sa réputation. L’intéressé a perdu son emploi, c’est-à-dire son moyen de subsistance. Par ailleurs, selon ses dires, il est sans emploi depuis la résiliation de son contrat et les employeurs n’osent pas lui proposer un emploi en raison du fait que son licenciement était fondé sur le décret-loi n o 667. En outre, le motif de licenciement retenu, à savoir l’existence de liens avec une structure illégale, a certainement eu des conséquences lourdes sur sa réputation professionnelle et sociale.
Par conséquent, la résiliation du contrat de travail de M. Pişkin a eu des répercussions négatives lourdes sur sa vie privée et a atteint le niveau de gravité nécessaire pour que l’article 8 trouve à s’appliquer en l’espèce.
L’existence d’une ingérence et sa justification
La Cour estime que la mesure de licenciement de M. Pişkin était fondée sur une disposition du décret-loi d’état d’urgence n o 667, qui astreignait l’employeur à résilier le contrat de travail de ses employés lorsqu’il considérait que ceux-ci avaient des liens avec une structure illégale. Ainsi, ce licenciement pourrait être vu comme une obligation découlant dudit décret-loi, qui dépasse largement le cadre juridique régissant le contrat de travail de M. Pişkin. Dès lors, ce licenciement, motivé par ses liens présumés avec une structure illégale, peut être considéré comme une ingérence dans le droit de M. Pişkin au respect de sa vie privée. Eu égard aux circonstances liées à l’état d’urgence, ainsi qu’au fait que les juridictions nationales disposaient de la plénitude de juridiction pour contrôler les mesures prises en application de l’article 4 § 1 g) du décret-loi d’état d’urgence n o 667, la Cour est disposée à partir de l’hypothèse que l’ingérence en cause était prévue par la loi. Elle relève ensuite que cette ingérence poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, le contrôle de la Cour portera sur deux points : 1) si le processus décisionnel ayant conduit au licenciement du requérant était entouré des garanties contre l’arbitraire ; 2) si l’intéressé a bénéficié de garanties procédurales, notamment s’il a eu accès à un contrôle juridictionnel adéquat, et si les autorités ont agi avec diligence et promptitude. En ce qui concerne le premier aspect, la Cour observe tout d’abord que le processus décisionnel ayant abouti à la résiliation du contrat de travail du requérant était très sommaire. À la suite d’une réunion tenue le 26 juillet 2016, il a été décidé de résilier le contrat de travail de six salariés, dont le requérant, en application de l’article 4 § 1 g) du décret-loi d’état d’urgence n o 667, pour cause d’appartenance à des structures menaçant la sécurité nationale, ou existence de liens ou de relations avec de telles structures. La Cour relève le caractère vague et incertain d’une telle indication et constate que la décision du comité directeur de ladite agence n’était étayée par aucune autre motivation que la simple référence aux termes de l’article 4 § 1 g) du décret-loi d’état d’urgence n o 667, qui prévoyait le licenciement des employés considérés comme appartenant, affiliés ou liés à une structure illégale. Elle observe ensuite que l’employeur du requérant n’a pas précisé la nature des activités de l’intéressé qui pouvaient justifier la considération selon laquelle celui-ci avait des liens avec une structure illégale. Au cours de la procédure devant les juridictions nationales, aucun reproche concret relatif à la prétendue existence de liens avec une telle structure n’a été expressément formulé. Il ressort des observations du Gouvernement que le requérant a été licencié au motif qu’il avait été impliqué dans des activités liées à des organisations terroristes de son propre chef. De même, il ressort des décisions des juridictions nationales que la considération de l’employeur du requérant portait sur la prétendue existence de liens entre ce dernier et l’organisation FETÖ/PDY6 . En résumé, le requérant a été licencié au motif qu’il avait des liens avec une structure illégale et secrète ayant été considérée par les autorités nationales comme l’instigatrice de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016.
La Cour peut accepter, à l’exemple de ce qu’elle a constaté au regard de l’article 6, que la procédure simplifiée instaurée par le décret-loi no 667 permettant de licencier les fonctionnaires ou les autres employés de la fonction publique pouvait être considérée comme étant justifiée au regard des circonstances très particulières de la situation apparue au lendemain de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, eu égard au fait que les mesures prises pendant l’état d’urgence étaient soumises à un contrôle juridictionnel. Par conséquent, elle estime qu’il ne s’impose pas d’examiner plus avant la procédure en question compte tenu des circonstances décrites ci-dessus. En ce qui concerne le second aspect, à savoir le caractère approfondi du contrôle juridictionnel de la mesure en question, la Cour rappelle le principe en vertu duquel toute personne qui fait l’objet d’une mesure basée sur des motifs de sécurité nationale doit avoir des garanties contre l’arbitraire. La Cour est disposée à admettre que l’appartenance à des structures ayant une organisation interne de type militaire ou établissant un lien de solidarité rigide et incompressible entre leurs membres ou encore poursuivant une idéologie contraire aux règles de la démocratie, élément fondamental de « l’ordre public européen », pourrait poser un problème pour la sécurité nationale et la défense de l’ordre lorsque les membres de ces entités sont appelés à remplir des fonctions publiques. De l’avis de la Cour, l’indication par l’administration publique ou par d’autres organismes opérant dans le domaine de la fonction publique de ce qui constitue une menace pour la sécurité nationale a naturellement un poids important. Les tribunaux nationaux doivent pourtant pouvoir réagir au cas où l’invocation de cette notion n’a aucun fondement raisonnable dans les faits ou dénote une interprétation arbitraire. En l’espèce, la Cour ne dispose pas réellement des moyens de se prononcer sur la considération des autorités nationales ayant constitué le fondement du licenciement du requérant. En effet, bien que cette mesure était fondée sur la prétendue existence de liens entre l’intéressé et une structure illégale, le Gouvernement s’est contenté de se référer aux décisions judiciaires adoptées par les juridictions nationales. Or, ces décisions n’éclairent en rien les critères ayant servi de base pour justifier la considération de l’employeur et déterminer la nature exacte des faits reprochés à M. Pişkin. Les juridictions internes ont admis, sans procéder à un examen approfondi de la mesure en cause, dont les répercussions étaient pourtant importantes sur le droit au respect de la vie privée du requérant, que ladite considération avait constitué un motif valable pour décider la résiliation du contrat de travail de l’intéressé. Pour la Cour, même lorsque des considérations liées à la sécurité nationale entrent en ligne de compte, les principes de légalité et d’état de droit applicables dans une société démocratique exigent que toute mesure touchant les droits fondamentaux de la personne puisse être soumise à une forme de procédure contradictoire devant un organe indépendant compétent pour examiner les motifs de l’ingérence en question et les preuves pertinentes. En effet, s’il était impossible de contester effectivement un impératif de sécurité nationale invoqué par l’administration, les autorités de l’État pourraient porter arbitrairement atteinte aux droits protégés par la Convention. Dans ces conditions, il apparaît en l’occurrence que les juridictions nationales ont failli à déterminer quelles raisons concrètes avaient justifié la résiliation du contrat de travail du requérant. Par conséquent, le contrôle juridictionnel de l’application de la mesure litigieuse n’a donc pas été adéquat en l’espèce. La Cour conclut donc que M. Pişkin n’a pas joui du degré minimal de protection contre l’arbitraire voulu par l’article 8 de la Convention. En outre, pour les motifs exposés dans le cadre de son examen au titre de l’article 6, elle estime que la mesure litigieuse ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par les circonstances particulières de l’état d’urgence. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
CEDH
RECEVABILITE
i) Principes pertinents
172. La Cour note que se pose en l’espèce la question de savoir si les faits dont se plaint le requérant relèvent du champ d’application de l’article 8 de la Convention.
173. À ce stade de son examen, elle estime utile de rappeler que l’on ne saurait déduire de l’article 8 un droit générique à l’emploi ou au renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée (Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 109, CEDH 2014 (extraits)). Cela étant, la Cour a déjà eu à se pencher sur l’applicabilité de l’article 8 à la sphère de l’emploi. À cet égard, elle rappelle que la « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive (voir, parmi d’autres, Schüth c. Allemagne, no 1620/03, § 53, CEDH 2010). Il serait trop restrictif de limiter la notion de « vie privée » à un « cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’en écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A no 251-B).
174. Selon la jurisprudence de la Cour, il n’y a aucune raison de principe de considérer que la « vie privée » exclut les activités professionnelles (Bigaeva c. Grèce, no 26713/05, § 23, 28 mai 2009, et Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, § 165-167, CEDH 2013). Des restrictions apportées à la vie professionnelle peuvent tomber sous le coup de l’article 8 lorsqu’elles se répercutent sur la façon dont l’individu forge son identité sociale par le développement des relations avec ses semblables. En outre, la vie professionnelle est souvent étroitement mêlée à la vie privée, tout particulièrement si des facteurs liés à la vie privée, au sens strict du terme, sont considérés comme des critères de qualification pour une profession donnée (Özpınar c. Turquie, no 20999/04, §§ 43-48, 19 octobre 2010). La vie professionnelle fait donc partie de cette zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (Fernández Martínez, précité, § 110, avec les références qui y sont citées).
175. La typologie des affaires dont la Cour a été saisie dans le cadre de litiges professionnels relevant de l’article 8 est variée. La Cour a ainsi traité en particulier du retour à la vie civile de militaires (Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, CEDH 1999‑VI), de révocations de la magistrature (Özpınar, précité, Oleksandr Volkov, précité, et Kulykov et autres c. Ukraine, nos 5114/09 et 17 autres, 19 janvier 2017), ou d’une mutation au sein de la fonction publique (Sodan c. Turquie, no 18650/05, 2 février 2016). Dans d’autres affaires, elle a eu à connaître de restrictions à l’accès à l’emploi dans la fonction publique (Naidin c. Roumanie, no 38162/07, 21 octobre 2014), de la perte d’un emploi hors du secteur public (Obst c. Allemagne, no 425/03, 23 septembre 2010, Schüth, précité, Fernández Martínez, précité, Şahin Kuş c. Turquie, no 33160/04, 7 juin 2016, et Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, 5 septembre 2017 (extraits)), ainsi que de restrictions à l’accès à certains métiers du secteur privé (Sidabras et Džiautas, décision précitée, Campagnano c. Italie, no 77955/01, CEDH 2006-IV, et Bigaeva, précité).
176. En ce qui concerne les affaires entrant dans la catégorie susmentionnée, la Cour applique la notion de « vie privée » en suivant deux approches différentes consistant en : a) le constat de l’existence d’une question relevant de la « vie privée » comme motif du litige (approche fondée sur les motifs) et b) la déduction de l’existence d’une question relevant de la « vie privée » au regard des conséquences de la mesure dénoncée (approche fondée sur les conséquences) (Denisov, précité, § 102). Lorsque l’approche fondée sur les motifs ne permet pas de justifier l’applicabilité de l’article 8, il faut analyser les conséquences de la mesure dénoncée sur les éléments susmentionnés de la vie privée pour déterminer si le grief tombe sous le coup de la notion de « vie privée ». Néanmoins, cette division n’exclut pas que la Cour puisse juger bon de suivre les deux approches de manière combinée, en recherchant s’il existe une question touchant la vie privée dans les motifs à l’origine de la mesure dénoncée et, de surcroît, en analysant les conséquences de la mesure (Fernández Martínez, précité, §§ 110-112). La Cour ne reconnaîtra l’applicabilité de l’article 8 que si ces conséquences sont très graves et touchent sa vie privée de manière particulièrement notable (Denisov, précité, § 116).
177. La Cour rappelle également que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012, et Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, § 40, 21 septembre 2010). Cependant, pour que l’article 8 entre en ligne de compte, l’attaque à la réputation personnelle doit atteindre un certain niveau de gravité et avoir été effectué de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée.
178. Toutefois, il est important de souligner qu’une personne ne saurait invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle la commission d’une infraction pénale (Sidabras et Džiautas, décision précitée, § 49, et Axel Springer AG, précité, § 83). Ce principe plus large vaut non seulement pour les infractions pénales mais aussi pour les irrégularités d’une autre nature, qui engagent d’une certaine manière la responsabilité juridique d’une personne et emportent des conséquences négatives prévisibles sur la « vie privée ».
ii) Application de ces principes
179. En l’espèce, la Cour note que le requérant, qui n’était pas fonctionnaire, était néanmoins employé et rémunéré par une agence de développement, à savoir par une personne de droit public, sur la base d’un contrat à durée indéterminée. À la lumière des critères qui se dégagent de l’arrêt Denisov précité, elle recherchera ainsi de quelle manière une question touchant la vie privée peut se poser dans le présent litige professionnel – soit du fait des motifs à l’origine de la résiliation du contrat de travail, soit du fait des conséquences de celle-ci sur la vie privée de l’intéressé.
180. La Cour observe d’emblée que les motifs expressément avancés par l’employeur pour justifier la résiliation litigieuse ne concernaient pas les résultats professionnels du requérant. Aux yeux de la Cour, le motif de licenciement fondé sur les termes de l’article 4 du décret-loi no 667 (le fait entretenir des liens avec une structure illégale) pouvait toucher intimement la personne concernée, ce qui le rend susceptible d’atteindre un niveau de gravité suffisant pour rendre l’article 8 de la Convention applicable au cas d’espèce, à moins qu’il ne soit démontré qu’une telle mesure résultait de manière prévisible des propres actions de l’intéressé (Denisov, précité, § 98).
Or, d’après le requérant, aucune action pénale n’a été engagée contre lui relativement à ses liens présumés avec l’organisation terroriste en question. En effet, il ressort des éléments du dossier que, le 30 juillet 2016 – soit après que l’employeur du requérant eut décidé de résilier le contrat de travail de ce dernier –, le parquet général a engagé une enquête pénale contre 95 personnes, dont l’intéressé, pour appartenance à une organisation terroriste armée. La Cour souligne que les parties ont donné très peu d’informations sur cette enquête pénale et qu’elles se sont contentées de produire une copie de l’ordonnance de non-lieu du 5 septembre 2018 rendu par le même parquet, par laquelle il a été procédé à la clôture de ladite enquête. Il en ressort qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves justifiant des soupçons pour intenter une action pénale (paragraphe 31 ci-dessus).
181. La Cour est disposée à admettre que, indépendamment du résultat de l’enquête pénale, l’employeur aurait pu fournir devant les juridictions nationales des informations ou des éléments de fait susceptibles de justifier les liens présumés du requérant avec une structure illégale et expliquer ainsi les motifs de la rupture de la relation de confiance avec son employé. En effet, à l’instar du Gouvernement, elle observe que la procédure de licenciement en cause, autonome tant dans ses conditions de mise en œuvre que dans son régime procédural, n’était pas le corollaire direct de la procédure pénale (voir, mutatis mutandis, Moullet, décision précitée). À cet égard, elle accorde du poids aux conclusions de la Commission de Venise, qui a considéré que « le lien requis pour justifier une suspension (voire une révocation) peut être moins étroit que celui requis pour qualifier une personne de « membre » d’une organisation criminelle » (paragraphe 50 ci-dessus, point no 130).
182. La Cour relève cependant qu’il ressort de la procédure judiciaire devant les tribunaux nationaux que ceux-ci ne se sont aucunement référés à l’enquête pénale et qu’en outre il n’existe aucun élément dans le dossier donnant à penser que, bien que closes ultérieurement, cette enquête ou la procédure devant les tribunaux internes relative au licenciement du requérant avaient permis aux autorités nationales d’obtenir des informations ou éléments factuels susceptibles de justifier le motif de licenciement.
183. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’existe pas le moindre élément laissant suggérer que la résiliation du contrat de travail en question résultait de manière prévisible des propres actions du requérant.
184. Par ailleurs, s’agissant des répercussions de la mesure en question sur le droit au respect de la vie privée, la Cour souligne qu’il faut rechercher si, au vu du dossier et des allégations étayées formulées par le requérant, cette mesure a eu de graves conséquences négatives sur les aspects constitutifs de la « vie privée » de l’intéressé, à savoir i) son « cercle intime », ii) la possibilité pour lui de nouer et de développer des relations avec autrui, ou iii) sa réputation (Denisov, précité, § 120).
185. Pour ce qui est des conséquences de la révocation en cause sur le « cercle intime » du requérant, la Cour rappelle qu’il faut y voir un argument tiré d’une détérioration du bien-être matériel de l’intéressé et de sa famille. À cet égard, il suffit de constater que le requérant a perdu son emploi, c’est-à-dire son moyen de subsistance.
186. Quant aux possibilités de nouer et de maintenir des relations avec autrui, la Cour observe que, même si, d’après le Gouvernement, la résiliation en question a eu principalement des effets et des conséquences sur le contrat de travail entre le requérant et son employeur, aux termes de l’article 4 § 2 du décret-loi d’état d’urgence no 667, « les personnes révoquées de leurs fonctions en application du premier paragraphe ne sont plus recrutées dans la fonction publique et ne peuvent plus se voir attribuer directement ou indirectement de telles fonctions ». À ce propos, elle note avec intérêt l’argument du Gouvernement selon lequel rien n’empêche le requérant de postuler à un emploi dans le secteur public ou privé. Cependant, à la lumière de l’article 4 § 2 du décret-loi no 667, qui a été cité dans l’arrêt du tribunal régional (paragraphe 50 ci-dessus), elle se doit d’accorder du poids à l’argument du requérant qui se plaignait de s’être retrouvé étiqueté dans la société en tant que « terroriste » et de ce fait stigmatisé. À cet égard, l’intéressé expose notamment que, bien que titulaire de diplômes d’études post-licence, il est sans emploi depuis la résiliation de son contrat et que les employeurs n’osent pas lui proposer un emploi en raison du fait que cette mesure était fondée sur le décret-loi no 667. Par conséquent, il existe bel et bien des répercussions sur ses possibilités de nouer et de maintenir des relations, y compris de nature professionnelle.
187. Enfin, s’agissant de la question de savoir si la mesure litigieuse a porté atteinte ou non à la réputation du requérant au point de sérieusement écorner l’estime dont celui-ci jouissait, de sorte à avoir une incidence grave sur ses relations sociales, la Cour se contente de se référer à ses conclusions au regard du motif de licenciement retenu, à savoir l’existence de liens avec une structure illégale. Une telle considération a certainement eu des conséquences lourdes sur la réputation professionnelle et sociale du requérant.
188. Ainsi, si l’on analyse l’effet combiné du motif du licenciement à l’aune des éléments objectifs de l’affaire et si l’on apprécie les conséquences matérielles et non matérielles de cette révocation sur la base des éléments produits devant la Cour, il y a lieu de conclure que cette mesure a eu des répercussions négatives lourdes sur la vie privée de l’intéressé et a atteint le niveau de gravité nécessaire pour qu’une question se pose sur le terrain de l’article 8 de la Convention.
Partant, cette disposition trouve à s’appliquer au cas d’espèce.
Autres motifs d’irrecevabilité
189. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
SUR LE FOND
a) Sur le point de savoir s’il convient d’examiner l’affaire sous l’angle des obligations négatives ou des obligations positives de l’État
200. En l’espèce, la Cour observe que la mesure contestée par le requérant, à savoir la résiliation de son contrat de travail, a été prise non pas par une autorité étatique, mais par une agence locale de développement. En dépit de son statut de personne morale de droit public en droit turc, il n’est pas allégué que cette agence exerçait des prérogatives de puissance publique. Qui plus est, le contrat de travail du requérant était régi par le code du travail.
Cela étant, la Cour note que la mesure prise par ladite agence était fondée sur une disposition du décret-loi d’état d’urgence no 667, qui astreignait l’employeur à résilier le contrat de travail de ses employés lorsqu’il considérait que ceux‑ci avaient des liens avec une structure illégale. Par conséquent, le licenciement en cause pourrait être vu comme une obligation découlant dudit décret-loi, qui dépasse largement le cadre juridique régissant le contrat de travail en question (voir, mutatis mutandis, Fernández Martínez, précité, § 115). Par ailleurs, il convient de souligner que la responsabilité des autorités serait engagée si les faits litigieux résultaient d’un manquement de leur part à garantir au requérant la jouissance d’un droit consacré par l’article 8 de la Convention (comparer avec Bărbulescu, précité, § 110).
201. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que le licenciement du requérant, motivé par ses liens présumés avec une structure illégale, peut être considéré comme une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée (voir, mutatis mutandis, Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 44, série A no 323, et Oleksandr Volkov, précité, § 165, avec les références qui y sont citées).
202. Quant à la question de savoir dans quelle mesure le licenciement du requérant pourrait s’analyser en une méconnaissance des obligations positives de l’État au regard de la Convention, la Cour rappelle qu’à l’engagement plutôt négatif d’un État de s’abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par la Convention « peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes » à ces droits (Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], no 16354/06, § 50, CEDH 2012). Si la frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au titre de la Convention ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables (Fernández Martínez, précité, § 114). Le licenciement litigieux constituant en tout état de cause une ingérence, celle-ci n’est justifiée que si les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 8 se trouvent remplies.
b) Sur la justification de l’ingérence
203. Pour déterminer si ladite ingérence a emporté violation de la Convention, la Cour doit rechercher si elle a satisfait aux exigences de l’article 8 § 2, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un but légitime au regard de cette disposition et était « nécessaire dans une société démocratique ».
i) Sur la légalité de l’ingérence
204. Le Gouvernement soutient que, à supposer qu’il y ait eu une ingérence, celle-ci était prévue par la loi, à savoir l’article 4 §1 g) du décret-loi d’état d’urgence no 667 et l’article 18 du code du travail. Il dit qu’il s’agissait là de textes prévisibles et accessibles. D’après lui, lorsqu’une personne s’affilie à une organisation terroriste, elle doit être en mesure de prévoir qu’elle perdra la confiance de son employeur, ce qui entraînera la résiliation de son contrat de travail.
205. Le requérant ne s’est pas prononcé sur cette question.
206. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, non seulement veulent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais aussi ont trait à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui, de surcroît, doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit. La question de savoir si la première condition se trouve remplie en l’espèce ne prête pas à controverse. En effet, nul ne conteste que l’ingérence litigieuse – en l’occurrence le licenciement du requérant – avait une base légale, à savoir l’article 4 §1 g) du décret-loi d’état d’urgence no 667. Pour ce qui est de l’article 18 du code du travail, disposition invoquée par le Gouvernement, la Cour se contente de souligner que cette disposition n’a pas été mentionnée dans les décisions adoptées par les tribunaux nationaux.
Reste la question de savoir si ladite base légale remplissait également les exigences d’accessibilité et de prévisibilité. La Cour rappelle que le niveau de précision requis de la législation interne – laquelle ne saurait parer à toute éventualité – dépend dans une large mesure du texte considéré, du domaine que celui-ci couvre et de la qualité de ses destinataires. Par ailleurs, une disposition légale ne se heurte pas à l’exigence qu’implique la notion « prévue par la loi » du simple fait qu’elle se prête à plus d’une interprétation. Enfin, il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Vogt, précité, § 48).
207. En l’occurrence, la Cour observe d’emblée que les termes employés à l’article 4 § 1 g) du décret-loi d’état d’urgence no 667, tels que « appartenant », « affilié » ou « lié » à une structure illégale sont de caractère général. Il convient également de relever que le Gouvernement n’a cité aucun critère concernant la définition des notions mentionnées dans cette disposition. Par ailleurs, la Cour prend note des considérations de la Commission de Venise sur la prévisibilité des critères utilisés pour évaluer les liens d’une personne avec une structure illégale (paragraphe 50 ci-dessus).
Toujours est-il que, s’agissant des normes relatives aux comportements des employés de la fonction publique, aux yeux de la Cour, il convient d’adopter une approche raisonnable pour apprécier la précision de la loi, car il est objectivement nécessaire que l’actus reus de ces comportements incompatibles avec la fonction publique soit formulé en termes généraux. À défaut, le risque serait que le texte ne couvre pas la question de manière complète et doive constamment être révisé au gré des nombreuses circonstances nouvelles qui pourraient survenir en pratique. Ainsi, une disposition légale décrivant un tel agissement à partir d’une liste de comportements spécifiques tout en ayant vocation à s’appliquer de manière générale et illimitée ne garantit pas à elle seule la prévisibilité de la loi : les autres facteurs qui influent sur la qualité de la norme de droit et le caractère suffisant de la protection juridique contre l’arbitraire doivent être identifiés et examinés (voir, mutatis mutandis, Oleksandr Volkov, précité, § 178).
208. À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà dit que l’existence d’une pratique d’interprétation précise et cohérente de la disposition en cause constituait un facteur permettant d’aboutir à la conclusion que cette disposition était prévisible quant à ses effets (ibidem, § 179). C’est aux organes juridictionnels qu’il appartient d’interpréter de manière cohérente les dispositions générales d’une loi pour en dégager la signification exacte et de dissiper tout doute dans ce domaine (ibidem, § 179).
209. La Cour note que la mesure prise en l’espèce en application de l’article 4 § 1 g) du décret-loi no 667, qui est une disposition d’état d’urgence, a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel (voir, mutatis mutandis, a contrario, Oleksandr Volkov, précité, § 184). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le litige dont il s’agit devait être l’une des premières affaires relatives à l’application de la disposition en question (comparer avec Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 150, 27 juin 2017). Par conséquent, compte tenu de leur rôle interprétatif dans la garantie de la prévisibilité des dispositions normatives, il incombait aux juridictions nationales d’offrir une protection juridique contre l’arbitraire.
Eu égard aux circonstances liées à l’état d’urgence, ainsi qu’au fait que les juridictions nationales disposaient de la plénitude de juridiction pour contrôler les mesures prises en application de l’article 4 § 1 g) susmentionné, la Cour est disposée à partir de l’hypothèse que l’ingérence en cause était prévue par la loi.
ii) Sur l’existence d’un but légitime
210. Les parties ne contestent pas en substance que l’ingérence dans l’exercice par le requérant du droit au respect de sa vie privée poursuivait plusieurs buts légitimes au regard de l’article 8 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.
iii) Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique
1) Principes pertinents
211. La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires d’une autorité publique dans l’exercice par lui de son droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (Libert c. France, no 588/13, §§ 40-42, 22 février 2018). Il s’agit d’une obligation négative classique, décrite par la Cour comme étant l’objet essentiel de l’article 8 (Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, § 31, série A no 297‑C).
212. Il y a lieu de préciser que, aux fins de déterminer si les mesures incriminées étaient « nécessaires dans une société démocratique », il convenait de considérer l’affaire dans son ensemble et d’examiner si les motifs invoqués pour les justifier étaient pertinents et suffisants et si lesdites mesures étaient proportionnées aux buts légitimes poursuivis (Z c. Finlande, 25 février 1997, § 94, Recueil 1997‑I).
213. À cet égard, la Cour rappelle que, par principe, les États ont un intérêt légitime à réguler les conditions d’emploi dans le service public. Un État démocratique est en droit d’exiger de ses fonctionnaires qu’ils soient loyaux envers les principes constitutionnels sur lesquels il s’appuie (Vogt, précité, § 59, et Sidabras et Džiautas, décision précitée, § 52).
214. Les garanties procédurales dont dispose l’individu seront particulièrement importantes pour déterminer si l’État défendeur est resté, lors de la fixation du cadre réglementaire, dans les limites de sa marge d’appréciation. En particulier, la Cour doit examiner si le processus décisionnel ayant conduit à des mesures d’ingérence était équitable et de nature à respecter les intérêts garantis à l’individu par l’article 8 (Connors c. Royaume-Uni, no 66746/01, § 83, 27 mai 2004, Buckley, c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, § 76, Recueil 1996‑IV, et Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 92, CEDH 2001-I)
215. Enfin, la Cour reconnaît qu’il appartient aux autorités nationales de juger les premières de la nécessité de l’ingérence, bien qu’il lui revienne de trancher la question de savoir si les motifs de l’ingérence étaient pertinents et suffisants. Les États contractants gardent dans le cadre de cette évaluation une marge d’appréciation qui dépend de la nature des activités en jeu et du but des restrictions (Smith et Grady, précité, § 88).
2) Application de ces principes
216. La Cour relève tout d’abord que son contrôle portera sur deux points. Premièrement, elle vérifiera si le processus décisionnel ayant conduit au licenciement du requérant était entouré des garanties contre l’arbitraire. Deuxièmement, elle se penchera sur la question de savoir si l’intéressé a bénéficié de garanties procédurales, notamment s’il a eu accès à un contrôle juridictionnel adéquat, et si les autorités ont agi avec diligence et promptitude. À cet égard, dans son analyse, elle tiendra compte de ses conclusions au regard de l’article 6 de la Convention (paragraphes 150 et 151 ci-dessus)
217. En ce qui concerne le premier aspect, la Cour observe tout d’abord que le processus décisionnel ayant abouti à la résiliation du contrat de travail du requérant était très sommaire. À la suite d’une réunion tenue le 26 juillet 2016, destinée à évaluer la situation des employés travaillant pour l’agence d’Ankara, il a été décidé de résilier le contrat de travail de six salariés, dont le requérant, en application de l’article 4 § 1 g) du décret-loi d’état d’urgence no 667, pour cause d’appartenance à des structures menaçant la sécurité nationale, ou existence de liens ou de relations avec de telles structures. La Cour ne peut manquer de relever le caractère vague et incertain d’une telle indication et de constater que la décision du comité directeur de ladite agence n’était étayée par aucune autre motivation que la simple référence aux termes de l’article 4 § 1 g) du décret-loi d’état d’urgence no 667, qui prévoyait le licenciement des employés considérés comme appartenant, affiliés ou liés à une structure illégale.
218. La Cour observe ensuite que l’employeur du requérant n’a pas précisé la nature des activités de l’intéressé qui pouvaient justifier la considération selon laquelle celui-ci avait des liens avec une structure illégale. Au cours de la procédure devant les juridictions nationales, aucun reproche concret relatif à la prétendue existence de liens avec une telle structure n’a été expressément formulé.
219. À cet égard, la Cour note que le Gouvernement a argué de la nature atypique de l’organisation en question – qui était considérée par les autorités turques comme ayant prémédité la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, et qui se serait profondément infiltrée dans les institutions influentes de l’État et la justice sous une couverture légale – et de la menace que ladite organisation représentait à ses yeux pour la sécurité nationale. Il ressort par ailleurs des observations du Gouvernement que le requérant a été licencié au motif qu’il avait été impliqué dans des activités liées à des organisations terroristes de son propre chef. De même, il ressort des décisions des juridictions nationales que la considération de l’employeur du requérant portait sur la prétendue existence de liens entre ce dernier et l’organisation FETÖ/PDY. En résumé, le requérant a été licencié au motif qu’il avait des liens avec une structure illégale et secrète ayant été considérée par les autorités nationales comme l’instigatrice de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016.
220. La Cour est d’avis que le contexte très spécifique entourant la présente affaire impose d’examiner les faits avec la plus grande attention. À cet égard, elle est prête à tenir compte des difficultés auxquelles la Turquie devait faire face au lendemain de la tentative de coup d’État militaire du 15 juillet 2016 (Alparslan Altan c. Turquie, no 12778/17, § 137, 16 avril 2019). Ces difficultés constituent un élément contextuel dont elle doit pleinement tenir compte pour interpréter et appliquer l’article 8 de la Convention en l’espèce (ibidem, § 147).
221. La Cour estime ici, à l’instar du Gouvernement, que les considérations relatives au devoir de loyauté des fonctionnaires sont mutatis mutandis applicables en l’espèce, compte tenu de la fonction des agences de développement (paragraphe 5 ci-dessus). À ce sujet, elle se réfère à ses conclusions concernant la procédure relative à la résiliation du contrat de travail du requérant développées au regard de l’article 6 de la Convention (paragraphes 121-127 ci-dessus). Ces considérations valent a fortiori en l’occurrence.
222. À la lumière de ce qui précède, la Cour peut accepter, à l’exemple de ce qu’elle a constaté au regard de l’article 6, que la procédure simplifiée instaurée par le décret-loi no 667 permettant de licencier les fonctionnaires ou les autres employés de la fonction publique pouvait être considérée comme étant justifiée au regard des circonstances très particulières de la situation apparue au lendemain de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, eu égard au fait que les mesures prises pendant l’état d’urgence étaient soumises à un contrôle juridictionnel. Par conséquent, elle estime qu’il ne s’impose pas d’examiner plus avant la procédure en question compte tenu des circonstances décrites ci-dessus.
223. En ce qui concerne le second aspect, à savoir le caractère approfondi du contrôle juridictionnel de la mesure en question, la Cour rappelle le principe en vertu duquel toute personne qui fait l’objet d’une mesure basée sur des motifs de sécurité nationale doit avoir des garanties contre l’arbitraire (Al Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, §§ 123-124, 20 juin 2002 ; voir aussi, parmi plusieurs autres, Lupsa c. Roumanie, no 10337/04, § 38, CEDH 2006‑VII).
224. La Cour est disposée à admettre que l’appartenance à des structures ayant une organisation interne de type militaire ou établissant un lien de solidarité rigide et incompressible entre leurs membres ou encore poursuivant une idéologie contraire aux règles de la démocratie, élément fondamental de « l’ordre public européen », pourrait poser un problème pour la sécurité nationale et la défense de l’ordre lorsque les membres de ces entités sont appelés à remplir des fonctions publiques (voir, mutatis mutandis, Grande Oriente d`Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie (no 2), no 26740/02, § 55, 31 mai 2007).
225. Par conséquent, de l’avis de la Cour, l’indication par l’administration publique ou par d’autres organismes opérant dans le domaine de la fonction publique de ce qui constitue une menace pour la sécurité nationale a naturellement un poids important. Les tribunaux nationaux doivent pourtant pouvoir réagir au cas où l’invocation de cette notion n’a aucun fondement raisonnable dans les faits ou dénote une interprétation arbitraire (voir, mutatis mutandis, Al Nashif, précité, § 124).
226. La Cour observe qu’en l’espèce elle ne dispose pas réellement des moyens de se prononcer sur la considération des autorités nationales ayant constitué le fondement du licenciement du requérant. En effet, bien que cette mesure était fondée sur la prétendue existence de liens entre l’intéressé et une structure illégale, le Gouvernement s’est contenté de se référer aux décisions judiciaires adoptées par les juridictions nationales. Or, comme il a été indiqué plus haut (paragraphe 183 ci-dessus), ces décisions n’éclairent en rien les critères ayant servi de base pour justifier la considération de l’employeur du requérant et déterminer la nature exacte des faits reprochés à l’intéressé. Les juridictions internes ont admis, sans procéder à un examen approfondi de la mesure en cause, dont les répercussions étaient pourtant importantes sur le droit au respect de la vie privée du requérant, que ladite considération avait constitué un motif valable pour décider la résiliation du contrat de travail de l’intéressé.
227. Pour la Cour, même lorsque des considérations liées à la sécurité nationale entrent en ligne de compte, les principes de légalité et d’état de droit applicables dans une société démocratique exigent que toute mesure touchant les droits fondamentaux de la personne puisse être soumise à une forme de procédure contradictoire devant un organe indépendant compétent pour examiner les motifs de l’ingérence en question et les preuves pertinentes. En effet, s’il était impossible de contester effectivement un impératif de sécurité nationale invoqué par l’administration, les autorités de l’État pourraient porter arbitrairement atteinte aux droits protégés par la Convention (voir, mutatis mutandis, Liou c. Russie (no 2), no 29157/09, §§ 85-87, 26 juillet 2011, et Al-Nashif, précité, §§ 123-124).
228. Dans ces conditions, il apparaît en l’occurrence que les juridictions nationales ont failli à déterminer quelles raisons concrètes avaient justifié la résiliation du contrat de travail du requérant (voir, en particulier, les standards pertinents relatifs au droit international du travail mentionnées aux paragraphes 53 et 54 ci-dessus). Par conséquent, le contrôle juridictionnel de l’application de la mesure litigieuse n’a donc pas été adéquat en l’espèce.
229. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que le requérant n’a pas joui du degré minimal de protection contre l’arbitraire voulu par l’article 8 de la Convention. En outre, pour les motifs exposés dans le cadre de son examen au titre de l’article 6 (paragraphes 152-153 ci-dessus), elle estime que la mesure litigieuse ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par les circonstances particulières de l’état d’urgence.
Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
EXAMEN DE LA VIE PRIVEE ET PUBLIQUE D'UN CITOYEN
AVANT OU APRES SA NOMMINATION DE FONCTIONNAIRE
Yılmaz c. Turquie du 4 juin 2019 requête n° 36607/06
Violation de l'article 8 : Refus de nommer un enseignant à un poste en raison de renseignements recueillis sur sa vie privée lié au code vestimentaire islamique de sa femme.
L’affaire concerne le refus du ministère de l’éducation nationale de nommer M. Yılmaz à un poste d’enseignant à l’étranger bien qu’il ait réussi un concours. M. Yılmaz soutenait que sa nomination avait été refusée en raison de motifs liés à sa vie privée et à celle de son épouse. La Cour juge que la procédure a connu une durée excessive. La Cour juge aussi que la décision de ne pas nommer M. Yılmaz à un poste à l’étranger était motivée par des éléments relevant de sa vie privée et reposait sur les conclusions d’une enquête de sécurité qui avait révélé des informations sur son mode de vie et la tenue vestimentaire de son épouse. L’ingérence dans le droit au respect de la vie privée de M. Yılmaz n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique
LES FAITS
À l’époque des faits, M. Yılmaz, qui était enseignant en culture religieuse, passa avec succès un concours organisé par le ministère de l’Éducation nationale pour accéder à un poste d’enseignant à l’étranger. Il arriva deuxième au concours. En août 2000, après la clôture du concours, un document portant la mention « secret » et comportant des informations sur M. Yılmaz et sur son épouse fut établi. Il y était notamment indiqué que M. Yılmaz avait été placé quelques jours en garde à vue en 1987 pour des faits de dégradation d’un buste d’Atatürk ; qu’il pratiquait une séparation « hommes-femmes » (haremlik selamlık) chez lui ; et que son épouse s’habillait selon le code vestimentaire islamique dans sa vie quotidienne et portait une perruque à l’école où elle exerçait ses fonctions. Par la suite, la commission d’évaluation du ministère établit une liste de 14 enseignants ayant réussi le concours mais qui, en raison du résultat de l’examen de leur situation, réalisé en application de l’article 15 de la directive relative à la sécurité et aux archives, ne pouvaient accéder à ces postes. Le nom de M. Yılmaz figurait sur cette liste. En novembre 2000, M. Yılmaz adressa une demande d’informations aux instances administratives compétentes, les invitant à lui expliquer pourquoi il n’avait pas encore obtenu de poste à l’étranger alors que le candidat arrivé troisième au concours avait déjà été nommé. Le ministère lui répondit que sa situation n’avait pas permis sa nomination, se fondant sur les dispositions d’une circulaire. En janvier 2001, M. Yılmaz intenta une action en sursis à exécution et une action en annulation contre la décision portant refus de sa nomination, mais il fut débouté. Par la suite, le Conseil d’État rejeta sa demande de sursis (en janvier 2002) et son recours en annulation (en décembre 2005 – arrêt notifié en février 2006).
A. Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention
36. La Cour note tout d’abord que la présente affaire porte sur un litige professionnel opposant un individu à un État. Elle rappelle ensuite qu’elle a déjà été plusieurs fois saisie de litiges mettant en cause la question de l’applicabilité de la notion de « vie privée », au sens de l’article 8 de la Convention, aux griefs relatifs à l’exercice de fonctions professionnelles.
37. Dans son arrêt Denisov c. Ukraine ([GC], no 76639/11, 25 septembre 2018), elle a récemment dressé une typologie évolutive des affaires relatives à des litiges professionnels sur lesquelles elle a eu à statuer. Reconnaissant que ces litiges ne sont pas, par nature, exclus du champ d’application de la notion de « vie privée », elle s’est prononcée sur les critères qui fondaient l’applicabilité de l’article 8 de la Convention dans de tels contextes. Elle a ainsi établi que, d’une manière générale, un problème peut se poser au regard de la vie privée de deux manières distinctes : soit du fait des motifs à l’origine de la mesure litigieuse (auquel cas elle retient l’approche fondée sur les motifs), soit du fait des conséquences sur la vie privée de la mesure en cause (auquel cas elle retient l’approche fondée sur les conséquences) (ibidem, § 115).
38. La Cour examinera la présente affaire à la lumière des approches ainsi définies. Il lui faut donc déterminer de quelle manière une question touchant la vie privée peut se poser en l’espèce : du fait des motifs à l’origine de la non-nomination du requérant ou du fait des conséquences de celle-ci sur sa vie privée.
39. Le requérant soutient que sa nomination à l’étranger a été refusée en raison de motifs liés à sa vie privée et à celle de son épouse. À cet égard, il convient de rappeler que le requérant – alors enseignant en culture religieuse – a passé avec succès un concours qui devait lui permettre d’être affecté à l’étranger. À la suite de la réussite de ce concours, il a également suivi un séminaire d’adaptation (paragraphe 16 ci-dessus). Une commission d’évaluation du ministère a toutefois estimé que le requérant était dans une situation qui ne lui permettait pas d’être nommé à l’étranger. Au vu des pièces du dossier et, en particulier, des décisions des juridictions administratives, la Cour observe que le refus de nomination du requérant résultait des conclusions d’une enquête de sécurité qui avait révélé des informations relatives à la vie privée de l’intéressé, telles que son mode de vie et la tenue vestimentaire de son épouse. Une arrestation ancienne qui avait abouti à un non-lieu à poursuivre était également mentionnée.
40. La Cour constate également que, en dehors des informations obtenues au terme de l’enquête de sécurité, les instances administratives compétentes n’ont pas exposé les motifs d’ordre professionnel et/ou administratif qui avaient pu justifier l’impossibilité pour le requérant d’être nommé en poste à l’étranger (paragraphes 8 et 10 ci-dessus). Cette circonstance fut d’ailleurs dénoncée par le procureur général près le Conseil d’État à deux reprises (paragraphes 19 et 21 ci-dessus). La Cour relève en outre que les instances administratives n’ont pas non plus exposé en quoi les informations obtenues au terme de l’enquête de sécurité étaient de nature à constituer en soi un empêchement à l’exercice par le requérant de ses fonctions à l’étranger.
41. Au vu de tous ces éléments, la Cour souscrit à la thèse du requérant selon laquelle les motifs à l’origine de sa non-nomination reposaient uniquement sur des informations relatives à sa vie privée. Or des motifs à l’origine de mesures touchant à la vie professionnelle peuvent avoir un rapport avec la vie privée de la personne concernée et, par eux-mêmes, faire entrer en jeu l’article 8 de la Convention (Denisov, précité, § 103, Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 71, CEDH 1999‑VI, Obst c. Allemagne, no 425/03, § 43 et suivants, 23 septembre 2010 et Özpınar c. Turquie, no 20999/04, §§ 47-48, 19 octobre 2010). La Cour estime en conséquence que l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce.
C. Sur le fond
43. En l’espèce, la Cour estime que le refus de nomination auquel le requérant s’est heurté s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
44. La Cour observe que le Gouvernement n’a indiqué ni la base légale de cette ingérence, ni le but légitime qu’elle poursuivait, ni les raisons pour lesquelles elle pourrait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique.
45. À cet égard, la Cour estime utile de rappeler qu’en se fondant sur les dispositions d’une circulaire et d’une directive, les instances nationales estimèrent que le requérant n’était pas en mesure de pourvoir un poste à l’étranger (paragraphes 8, 10 et 13 ci-dessus). Le ministère de l’éducation renvoya au principe de l’intérêt public et à des impératifs de nécessités pour justifier cette décision, sans pour autant apporter d’explications quant aux raisons d’intérêt public en cause ou quant aux nécessités et aux spécificités des services d’éducation et d’enseignement qui auraient pu expliquer qu’un enseignant, employé par le ministère, ne puisse occuper un poste à l’étranger (paragraphe 13 ci-dessus).
46. À la lecture de la décision de la Commission d’évaluation (paragraphe 8 ci-dessus), la Cour souligne également que cette Commission ne s’était pas prononcée sur les compétences ou les capacités du requérant à exercer les fonctions en cause mais tint uniquement compte des résultats de l’enquête de sécurité. Or, ces résultats accordaient une place prépondérante à des éléments de la vie privée du requérant et de celle de son épouse, et notamment à la circonstance qu’elle portait le voile (paragraphe 7 ci‑dessus).
47. À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà considéré que le souci de préserver la neutralité du service public ne pouvait justifier l’entrée en compte, dans la décision de muter un fonctionnaire, de la circonstance que son épouse portait le voile, élément qui relevait de la vie privée des intéressés (Sodan, § 57, précité). Certes, la Cour n’exclut pas que dans certaines circonstances, les exigences propres à la fonction publique puissent requérir la prise en compte des constats opérés au cours d’enquêtes de sécurité. Pour autant, elle comprend mal en l’espèce dans quelle mesure le port du voile par l’épouse du requérant et la manière dont il se comporte à son domicile (paragraphe 7 ci-dessus) – questions relevant de la sphère privée – pourraient porter atteinte aux impératifs d’intérêt public ou aux nécessités des services d’enseignement et d’éducation. Elle relève en outre que l’arrestation passée du requérant n’avait pas donné lieu à des poursuites pénales et n’avait pas non plus été une cause d’empêchement à l’accès du requérant à la fonction publique enseignante.
48. Au terme de cette appréciation des circonstances de l’espèce, la Cour tient pour établi que la décision de ne pas nommer le requérant à l’étranger était motivée par des éléments relevant de sa vie privée. À supposer que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait l’un des buts légitimes énoncés à l’alinéa 2 de l’article 8, la Cour considère qu’en tout état de cause celle-ci n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
49. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.
ŞAHİN KUŞ c. TURQUIE du 7 mai 2016 requête 33160/04
Violation de l'article 8 : le requérant a obtenu son diplôme d e Licence en théologie en Syrie, il a une équivalence en Turquie pour suivre son master. Son master réussi, il devient instituteur. Son équivalence de licence lui est retirée après sa nomination alors qu'il exerçait depuis quelques années sans aucun reproche sur son travail. Il ne peut plus être instituteur.
a) Sur l’existence d’une ingérence dans l’exercice du droit protégé par l’article 8 de la Convention
34. La Cour rappelle avoir déjà dit que l’imposition de restrictions à l’accès à une profession pouvait porter atteinte à la « vie privée » (voir Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 47, CEDH 2004‑VIII, et Bigaeva c. Grèce, no 26713/05, § 22-25, 28 mai 2009). De même, elle a déjà jugé qu’une mesure de révocation pouvait porter atteinte au droit au respect de la vie privée (voir Özpınar c. Turquie, no 20999/04, §§ 43-48, 19 octobre 2010, Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, §§ 165-167, 9 janvier 2013, et İhsan Ay c. Turquie, no 34288/04, §§ 30-32, 21 janvier 2014).
35. En l’occurrence, la Cour note que le diplôme universitaire du requérant obtenu à l’étranger avait initialement été reconnu par le YÖK. Le requérant a, de surcroît, été autorisé à poursuivre ses études au sein d’une université turque où il a obtenu un master. Il a donc réintégré avec succès, et à un niveau supérieur d’études, une université turque. Néanmoins, quatre ans après la reconnaissance de son diplôme, alors qu’il s’était vu offrir un poste d’instituteur par le ministère de l’Éducation nationale et qu’il avait terminé avec succès la formation pédagogique organisée par ce dernier, le YÖK a décidé d’annuler l’équivalence de diplôme du requérant. Se fondant sur cette décision, le ministère a annulé la nomination du requérant en tant qu’instituteur. Bien que le YÖK ait ultérieurement modifié sa décision en rétablissant le certificat d’équivalence du requérant, cette circonstance n’a eu aucun effet sur sa révocation de son poste d’instituteur dans la mesure où le nouveau certificat d’équivalence contenait une annotation limitant sa portée, de sorte qu’il ne donnait pas accès à la profession d’enseignant. La Cour note que cette restriction est intervenue au moment où le requérant exerçait une profession correspondant à ses qualifications acquises grâce à ses efforts personnels et académiques. En ayant affecté la possibilité pour le requérant d’exercer la profession d’instituteur, la restriction litigieuse a ainsi entraîné des répercussions évidentes sur la jouissance par celui-ci du droit au respect de sa vie privée (voir, mutatis mutandis, Bigaeva, précité, §§ 24‑25, Mateescu c. Roumanie, no 1944/10, § 21, 14 janvier 2014).
36. Par ailleurs, la révocation du requérant a eu des incidences sur une grande partie de ses relations avec autrui, notamment sur ses relations de nature professionnelle dans la mesure où son niveau de qualification a été remis en cause et la carrière qu’il avait choisie a été brusquement interrompue. Sa révocation a également eu des incidences sur son « cercle intime », car la perte de son emploi a inévitablement entraîné des répercussions négatives sur son bien-être matériel et celui de sa famille (voir, Oleksandr Volkov, précité, § 166), notamment par la remise en cause implicite de son niveau de compétences et donc de son aptitude à exercer correctement sa profession.
37. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour est d’avis que l’annulation et la modification subséquente du certificat d’équivalence du requérant ainsi que la révocation qui en est résultée peuvent être considérées comme une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention.
b) Sur la justification de l’ingérence
38. Pour déterminer si l’ingérence ainsi constatée emporte violation de l’article 8, la Cour doit rechercher si elle était justifiée au regard du paragraphe 2 de cet article, autrement dit si elle était « prévue par la loi » et « nécessaire, dans une société démocratique » pour atteindre l’un ou l’autre des « buts légitimes » énumérés dans ce texte.
i. Sur la base légale de l’ingérence
39. La Cour rappelle que si les mots « prévue par la loi » expriment d’abord l’exigence que la mesure contestée ait une base en droit interne, ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : il faut que celle-ci soit accessible à la personne concernée, que cette dernière puisse de surcroît en prévoir les conséquences pour elle, et qu’elle soit compatible avec la prééminence du droit (voir, entre autres, Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II). Cette expression implique donc notamment que la législation interne doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à des mesures affectant leurs droits protégés par la Convention (C.G. et autres c. Bulgarie, no 1365/07, § 39, 24 avril 2008). La loi doit en outre offrir une certaine garantie contre les atteintes arbitraires de la puissance publique. L’existence de garanties procédurales spécifiques est déterminante à cet égard. Les garanties requises dépendent, au moins dans une certaine mesure, de la nature et de la portée de l’ingérence en question (P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 46, CEDH 2001-IX).
40. La Cour observe qu’en l’espèce, le YÖK a d’abord annulé le certificat d’équivalence du requérant en se fondant sur l’article 7, alinéa p) de la loi no 2547 relative à l’enseignement supérieur. C’est ensuite et sur la base de cette décision du YÖK que le ministère de l’Éducation nationale a révoqué le requérant en vertu de l’article 98 b) de la loi no 647 sur les fonctionnaires de l’État. Ultérieurement, agissant en vertu de l’article 43 de la loi no 2547, le YÖK a modifié sa décision : il a rétabli le certificat d’équivalence du requérant, mais en y apposant une annotation selon laquelle celui-ci n’était « pas valable pour la nomination des instituteurs ». En raison de cette annotation, la décision de révoquer le requérant est restée valable. Ainsi, l’ingérence litigieuse a pris pour base légale les articles 7, alinéa p) et 43 de la loi no 2547 relative à l’enseignement supérieur ainsi que l’article 98 b) de la loi no 647 sur les fonctionnaires de l’État.
41. La Cour note que selon l’article 7, alinéa p) de la loi no 2547 relative à l’enseignement supérieur, le YÖK était chargé, entre autres, de « constater l’équivalence » des diplômes d’enseignement supérieur obtenus à l’étranger.
Le Gouvernement soutient que le YÖK, compétent pour reconnaître ces équivalences était également habilité à annuler ou modifier un certificat d’équivalence déjà accordé par lui. Or, la Cour observe que ni l’article 7, alinéa p) de la loi no 2547 ni les dispositions du règlement du 14 juillet 1996 portant application dudit article, ni du reste l’article 43 de la loi no 2547 ne mentionnaient expressément une quelconque compétence du YÖK pour annuler ou modifier un certificat d’équivalence déjà accordé (voir ci-dessus sous l’intitulé « droit et pratique internes pertinents »). À supposer qu’il faille considérer que les dispositions en question donnaient implicitement un pouvoir de cette nature au YÖK, elles ne précisaient aucunement dans quelles circonstances et selon quelle procédure le YÖK pouvait, de manière rétroactive, annuler une équivalence ou y apposer une annotation propre à en exclure l’exercice d’une profession en particulier.
42. De surcroît, la Cour relève que la question fondamentale de savoir si le YÖK avait compétence, selon les dispositions législatives en vigueur, pour adopter les actes contestés, n’a pas été tranchée par les juridictions nationales. En effet, elles ont débouté le requérant au seul motif que le certificat d’équivalence dont il disposait « ne lui permett[ait] pas d’exercer le métier d’instituteur », sans se prononcer sur la légalité de l’annulation ou de l’annotation litigieuses, alors même que cette question constituait l’objet du recours du requérant. Sur ce point, il convient de relever que la question de la légalité de la mesure a été mise en exergue dans l’opinion dissidente jointe à la décision du 3 février 1999 du Conseil d’État.
43. La Cour considère donc que de sérieux doutes peuvent surgir quant à la prévisibilité pour le requérant de l’annulation de son équivalence, puis de l’apposition d’une mention limitant considérablement la portée de celle-ci. Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à la nécessité de l’ingérence litigieuse (paragraphes 52-53 ci-après), la Cour juge qu’il ne s’impose pas ici de trancher cette question (voir en ce sens, Dink c. Turquie, nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, § 116, 14 septembre 2010).
ii. Sur le but légitime de l’ingérence
44. La Cour observe que le Gouvernement justifie essentiellement l’annulation/modification du certificat d’équivalence du requérant ainsi que la révocation qui s’en est suivie par le faible niveau de l’enseignement dispensé à l’étranger. Le Gouvernement estime que si les diplômés ayant eu une formation universitaire insuffisante étaient autorisés à enseigner, les élèves se trouveraient privés de la possibilité de bénéficier d’un enseignement de qualité.
45. La Cour estime qu’en réglementant l’accès à la profession d’instituteur, l’ingérence litigieuse visait à garantir un bon niveau d’enseignement dans les écoles. Elle peut donc se rattacher au but légitime de « la défense de l’ordre » et de « la protection des droits et libertés d’autrui », à savoir ceux des élèves (voir, mutatis mutandis, İhsan Ay, précité, § 36, et Bigaeva, précité, § 31).
iii. Sur la nécessité de l’ingérence
46. Selon la jurisprudence constante de la Cour, une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi. À cet égard, il faut que les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 181, CEDH 2012, et Animal Defenders International c. Royaume‑Uni [GC], no 48876/08, § 105, CEDH 2013 (extraits)).
47. En l’occurrence, la Cour note d’abord que, le requérant remplissant toutes les conditions requises à l’époque des faits, le YÖK lui a initialement accordé le certificat d’équivalence demandé sans aucune annotation propre à exclure l’exercice de la profession d’instituteur. Le requérant a pu ensuite poursuivre en Turquie des études de niveau master, qui nécessitent naturellement un diplôme de licence reconnu comme valable dans ce pays. De surcroît, il s’est vu offrir un poste d’instituteur par le ministère de l’Éducation nationale et a terminé avec succès la formation pédagogique organisée par celui-ci. Ainsi, les autorités compétentes ont non seulement reconnu l’équivalence du diplôme du requérant, mais ont aussi et surtout confirmé au vu de leurs propres critères nationaux que celui-ci possédait les qualifications nécessaires pour exercer la profession d’instituteur.
48. Cependant, quatre ans après la reconnaissance du diplôme du requérant, le YÖK a, dans un premier temps, annulé l’équivalence de son diplôme, ce qui a motivé sa révocation par le ministère de l’Éducation. Ensuite, près de dix mois plus tard, réalisant que le requérant avait obtenu en Turquie un diplôme de master au terme d’études engagées sur la base de la reconnaissance de l’équivalence de son diplôme étranger à une licence turque, le YÖK a modifié sa décision, en remplaçant l’annulation par une mention portée sur le certificat selon laquelle celui-ci n’était pas valable pour la nomination des instituteurs. Ainsi, la modification de la décision du YÖK est restée sans effet sur la révocation du requérant.
49. La Cour estime que le cœur du problème réside dans le fait que le YÖK est revenu sur sa décision initiale de reconnaître sans aucune restriction l’équivalence du diplôme du requérant pour, finalement, le priver de l’autorisation d’exercer la profession d’instituteur. À cet égard, le Gouvernement invoque le niveau potentiellement insatisfaisant de l’enseignement dispensé à l’étranger et ses répercussions éventuelles sur l’éducation des élèves.
50. La Cour note toutefois que la mesure litigieuse s’est appliquée de manière générale à tous les diplômés des universités au sein desquelles la théologie était enseignée, sans prendre en compte la situation personnelle de chacune des personnes visées. Or, il convient de rappeler qu’après l’obtention de son équivalence, le requérant avait poursuivi avec succès des études post‑licence en Turquie, et que sa formation avait été considérée comme suffisante par le ministère de l’Éducation pour le nommer à un poste d’enseignant et qu’après sa nomination, il avait accompli avec succès la formation pédagogique.
51. Surtout, la Cour relève que les autorités ont modifié le certificat d’équivalence du requérant quatre ans après sa délivrance, alors qu’il avait déjà pris effectivement ses fonctions en tant qu’instituteur stagiaire. Les autorités compétentes ont par ce biais brusquement bouleversé la situation professionnelle du requérant, alors qu’aucun manquement ne lui était reproché et que rien ne permettait de penser qu’il n’était pas au niveau de sa tâche. Elles ont ainsi engendré une insécurité juridique et une incertitude inacceptables pour le requérant, ce dernier étant fondé à croire qu’il avait le droit d’exercer la profession d’instituteur et à organiser en conséquence non seulement sa vie professionnelle, mais aussi sa vie privée. Il était légitimement en droit de se projeter avec confiance dans l’avenir en considérant comme acquise la poursuite de sa carrière d’instituteur. À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà conclu, dans une affaire précédente, à la violation de l’article 8 au motif que le comportement des autorités nationales avait manqué de cohérence et de respect pour la personne et la vie professionnelle d’une diplômée étrangère ayant été empêchée d’accéder à la profession d’avocat (Bigaeva, précité, §§ 35-36).
52. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que les mesures incriminées ne répondaient pas à un besoin social impérieux et qu’en tout état de cause elles n’étaient pas proportionnées aux buts légitimes visés. De ce fait, elles n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique.
53. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
NAIDIN c. ROUMANIE du 21 octobre 2014 requête 38162/07
Non Violation de l'article 8, l'État roumain a droit de refuser la nomination d'un ancien sous préfet parfaitement zélé en faveur de l'ancien régime communiste
46. La Cour rappelle qu’une différence de traitement est discriminatoire si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité́ entre les moyens employés et le but visé » (Sidabras et Džiautas, précité, § 51).
47. En l’espèce, la Cour note que l’article 50 de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics introduit entre les personnes souhaitant intégrer ou réintégrer le service public une distinction fondée sur leur passé. À l’instar des restrictions instaurées dans de nombreux pays postcommunistes, les personnes ayant collaboré avec la Securitate ne peuvent pas intégrer ou réintégrer la fonction publique (pour les dispositions de certains systèmes juridiques nationaux relatives aux restrictions à l’emploi pour des motifs politiques, voir Sidabras et Džiautas, précité, §§ 30 et suiv.).
48. La Cour prend note de la décision de la Cour constitutionnelle du 24 janvier 2006, selon laquelle l’interdiction d’accès à la fonction publique des anciens collaborateurs de la police politique est justifiée par la loyauté à attendre de tous les fonctionnaires envers le régime démocratique.
49. À cet égard, la Cour rappelle que, par principe, les États ont un intérêt légitime à réguler les conditions d’emploi dans le service public. Un État démocratique est en droit d’exiger de ses fonctionnaires qu’ils soient loyaux envers les principes constitutionnels sur lesquels il s’appuie (Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 59, série A no 323 et Sidabras et Džiautas, précité, § 52).
50. En l’espèce, la Cour doit notamment tenir compte de la situation qu’a connue la Roumanie sous le régime communiste et du fait que, pour éviter de voir son expérience passée se répéter, l’État doit se fonder sur une démocratie capable de se défendre par elle-même (Vogt, précité, § 59 ; Sidabras et Džiautas, précité, § 54 ; Bester c. Allemagne (déc.), no 42358/98, 22 novembre 2001 et Knauth c. Allemagne (déc.), no 41111/98, 22 novembre 2001).
51. Vu les considérations qui précèdent, la Cour admet que la différence de traitement appliquée au requérant, à savoir la suppression pour lui de toute possibilité d’emploi dans la fonction publique, visait des buts légitimes, en l’occurrence la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique et des droits et libertés d’autrui (voir, mutatis mutandis, Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 41, CEDH 1999-III et Sidabras et Džiautas, précité, § 55).
52. Reste à déterminer si la mesure litigieuse était proportionnée.
53. Le requérant dénonce le caractère absolu de l’interdiction et l’absence de prise en considération de l’insignifiance, selon lui, de ses actes.
54. S’agissant du premier argument du requérant, la Cour note que les perspectives professionnelles du requérant n’ont été supprimées que dans la fonction publique. Les fonctionnaires publics, a fortiori ceux qui occupent des postes à haute responsabilité, de la nature de ceux que le requérant souhaitait réintégrer, exercent une parcelle de la souveraineté de l’État. L’interdiction frappant le requérant n’est donc pas disproportionnée par rapport à l’objectif légitime de l’État de s’assurer de la loyauté des personnes chargées de la sauvegarde de l’intérêt général.
55. La Cour note également qu’il n’existe aucune restriction imposée par l’État aux perspectives d’emploi du requérant dans le secteur privé, même dans des entreprises pouvant présenter une certaine importance pour les intérêts de l’État en matière économique, politique ou de sécurité. Pareillement, il n’est pas interdit au requérant d’occuper un poste dans un autre domaine du secteur public, n’impliquant pas l’exercice de la puissance publique.
56. Enfin, quant à la prétendue absence de prise en compte de la nature et des conséquences des actes du requérant, la Cour constate que ces aspects ont fait l’objet d’un examen contradictoire devant la cour d’appel de Bucarest, qui a rendu son arrêt le 20 août 2001. S’agissant d’éléments factuels, qui s’inscrivent manifestement dans la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales, la Cour ne saurait remettre en cause les conclusions auxquelles sont parvenues ces juridictions.
57. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention.
CLIQUEZ SUR L'UN DES BOUTONS POUR ACCEDER A LA PROTECTION DE L'ARTICLE 8
Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH, lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organismede règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.