AU SENS DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1
Pour plus de sécurité, fbls atteinte à un bien est sur : https://www.fbls.net/P1-1atteinte.htm
Aucun cookie garanti = liberté préservée pour chacun !
"
L'atteinte au bien est la soustraction arbitraire d'un bien sans
indemnisation adéquate"
Frédéric Fabre docteur en droit.
Article 1 du Protocole 1 de la CEDH
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes"
Cliquez sur un bouton ou un lien bleu pour
accéder gratuitement à LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH :
- LA SUPPRESSION OU CONFISCATION DU TITRE DE PROPRIÉTÉ
- L'EXPROPRIATION INDIRECTE OU DE FAIT D'UN BIEN
- L'ABATTAGE D'UN TROUPEAU POUR CAUSE DE SANTE PUBLIQUE
- LES RÈGLES DE CRÉDIT POUR PROTÉGER LE CONSOMMATEUR
- LA SAISIE D'UN BIEN PAR UN CRÉANCIER DOIT ÊTRE PROPORTIONNÉE ET LÉGALE
- LE DROIT AU LOGEMENT CONTRE LE DROIT DU BAILLEUR
- LES PROCÉDURES DE FAILLITE
- LA PROCÉDURE PÉNALE ET L'ATTEINTE A LA PROPRIÉTÉ
- LA RÉTENTION OU LA SAISIE D'UN BIEN PAR LES DOUANES
- LE REDRESSEMENT FISCAL
- LA PROCÉDURE COMPENSATOIRE DE RÉPARATION D'UN BIEN SAISI
La SUISSE et MONACO ont signé mais n'ont pas ratifié le Protocole n°1. Les deux États ne peuvent donc pas être condamnés.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
SUPPRESSION OU CONFISCATION DU TITRE DE PROPRIÉTÉ
Grand Rabbinat de Communauté Juive d'Izmir c. Turquie du 21 mars 2023 requête n° 1574/12
Art 34 • Locus standi • Art 35 § 3 a) • Ratione personae • Grand rabbinat considéré comme requérant • Représentant ses fidèles et constituant une institution cultuelle régie par des dispositions datant de l’époque ottomane • Ayant acquis en son nom et utilisé librement des biens immobiliers • Capacité à ester en justice et à acquérir des biens immobiliers jamais remise en cause par les autorités administratives ou les tribunaux nationaux
Art 1 P1 • Respect des biens • Refus imprévisible des tribunaux nationaux d’inscrire au nom du requérant au registre foncier un terrain où est édifiée une ancienne synagogue lui appartenant en application de dispositions non pertinentes • Inscription du terrain au nom du Trésor public • Art 1 P1 applicable • Intérêt patrimonial constituant un bien • Requérant ayant exercé une possession non équivoque, ininterrompue et incontestée sur la synagogue depuis environ quatre siècles • Terrain et bâtiment caractérisés par des particularités et un usage spécifiques liés à la vie religieuse de la communauté juive
40. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas qualité pour agir devant la Cour, au motif qu’au moment de l’introduction de la présente requête, l’intéressé était dépourvu de personnalité juridique et qu’il ne pouvait être qualifié d’organisation non gouvernementale au sens de l’article 34 de la Convention. S’appuyant sur la loi provisoire du 1912 et sur la loi no 2762, il allègue que le requérant n’a accompli aucune démarche pour acquérir la personnalité juridique et qu’il ne pouvait par conséquent être titulaire de droits et d’obligations ou acquérir la propriété d’un bien avant la reconnaissance, en 2011, de son statut de fondation. La présente requête serait dès lors irrecevable pour incompatibilité ratione personae avec l’article 34 de la Convention.
41. S’appuyant sur l’ordonnance du Grand rabbinat du 19 mars 1865 et sur le jugement adopté le 14 avril 1950, puis confirmé par la Cour de cassation le 23 septembre 1957, le requérant conteste cette thèse.
42. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, une personne morale qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles peut se porter requérante devant elle, pour peu qu’elle ait la qualité d’« organisation non-gouvernementale » au sens de l’article 34 de la Convention (Granitul S.A. c. Roumanie, no 22022/03, § 25, 22 mars 2011, avec les références citées). S’agissant des institutions religieuses auxquelles le droit interne ne reconnaît pas la personnalité juridique, la Cour a déjà jugé qu’une Église ou l’organe ecclésial d’une Église peut, comme tel, exercer au nom de ses fidèles les droits garantis par l’article 9 de la Convention (Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 101, CEDH 2001-XII). En particulier, dans l’affaire Église catholique de La Canée c. Grèce (arrêt du 16 décembre 1997, §§ 38-42, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII), la Cour a jugé que l’incapacité de l’église requérante à ester en justice, faute pour celle-ci d’avoir acquis ipso facto la personnalité juridique en droit grec, lui avait imposé une véritable restriction qui l’avait empêchée de faire trancher par les tribunaux tout litige relatif à ses droits de propriété et qui avait dès lors porté atteinte à la substance même de son « droit à un tribunal » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
43. En l’espèce, la Cour observe d’emblée que la procédure litigieuse concernait le Grand rabbinat d’Izmir et non le grand rabbin de cette ville en sa capacité personnelle. Indépendamment de la question de savoir si le Grand rabbinat d’Izmir disposait ou non de la personnalité juridique, il est constant que celui-ci représentait ses fidèles et constituait ainsi une institution cultuelle dont le statut juridique était régi par des dispositions datant de l’époque ottomane.
44. Par ailleurs, même si le requérant ne jouissait pas du statut de fondation appartenant aux communautés religieuses non-musulmanes au sens de la loi no 2762, il ressort du dossier que sa capacité à ester en justice et à acquérir des biens immobiliers n’a jamais été remise en cause sur le plan interne par les autorités administratives ou les tribunaux (comparer avec Bektashi Community et autres c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, nos 48044/10 et 2 autres, § 49, 12 avril 2018). En particulier, les tribunaux de grande instance et du cadastre ayant connu de la procédure diligentée par le requérant ne se sont nullement penchés sur la question de la personnalité juridique du requérant, qui a agi pour défendre ses intérêts sans que son locus standi ne fût remis en cause.
45. De surcroît, il n’est pas contesté que le requérant a acquis en son nom et utilise librement des biens immobiliers. En effet, il ressort du jugement du 14 avril 1950, auquel le requérant a renvoyé ci-dessus, que le tribunal de grande instance d’Izmir a ordonné l’inscription, au nom de l’intéressé, d’un autre bien immobilier sis à Izmir. Pour se prononcer ainsi, cette juridiction avait rejeté la thèse du Trésor public selon laquelle le Grand rabbinat d’Izmir ne jouissait pas de la personnalité juridique, considérant au contraire que celui-ci avait l’acquise par l’effet de l’ordonnance du Grand rabbinat édictée le 19 mars 1865 (23 Sevval 1281 – paragraphe 7 ci-dessus).
46. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le Grand rabbinat d’Izmir peut être considéré comme requérant au sens de l’article 34 de la Convention. En conséquence, elle rejette l’exception ratione personae soulevée par le Gouvernement.
SUR LE FOND
a) Sur l’existence d’un « bien »
63. La Cour note que les parties ont des vues divergentes quant à la question de savoir si le requérant était ou non titulaire d’un bien susceptible d’être protégé par l’article 1 du Protocole no 1. Par conséquent, elle est appelée à déterminer si la situation juridique dans laquelle se trouve le requérant est de nature à relever du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1.
64. S’agissant de la portée autonome de la notion de « bien », la Cour renvoie à sa jurisprudence constante (Iatridis c. Grèce [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH 1999-II, et Beyeler c. Italie [GC], nº 33202/96, § 100, CEDH 2000-I). À cet égard, le fait pour les lois internes d’un État de ne pas reconnaître un intérêt particulier comme « droit », voire comme « droit de propriété », ne s’oppose pas à ce que l’intérêt en question puisse néanmoins, dans certaines circonstances, passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Brosset-Triboulet c. France [GC], no 34078/02, § 71, CEDH 2010). En l’espèce, la Cour doit rechercher si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole nº 1 (Fabris c. France [GC], no 16574/08, § 51, CEDH 2013 (extraits)). Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte des éléments de droit et de fait suivants.
65. En l’espèce, la Cour observe d’emblée que le bien en question se composait d’un bâtiment édifié en 1605 pour servir de synagogue, et d’un terrain d’une superficie initiale de 794 m2 qui fut par la suite divisé en deux parcelles (paragraphe 8 ci-dessus). Il ressort du cadastrage réalisé en 1930 sur l’ensemble de ce bien que le bâtiment en question a d’abord servi de synagogue, puis de logement au Grand rabbin d’Izmir. En somme, selon le cadastrage et les documents mentionnés au paragraphe 8 ci-dessus, le requérant possédait – sans acte – l’ensemble de ce bien. Il ressort également du rapport d’expertise établi le 24 avril 2002 que le Grand rabbinat d’Izmir utilisait le bâtiment en question comme bâtiment administratif en 2002 (paragraphe 11 ci-dessus), c’est-à-dire après l’engagement, par le requérant, d’une action tendant à faire inscrire le bien en question à son nom (paragraphe 10 ci-dessus). Par conséquent, après le cadastrage réalisé en 1930, et jusqu’en 2000, année où le requérant a engagé une procédure devant le tribunal cadastral, le statut de ce bien n’a pas changé. Il ressort en effet des éléments du dossier que pendant toute cette période, personne – pas même le Trésor public – n’a engagé de procédure judiciaire afin de se voir reconnaître la qualité de propriétaire de ce bien. En outre, il n’est pas allégué que ce bien appartenait au domaine public. Par conséquent, il peut passer pour établi que, depuis la construction de la synagogue en 1605, c’est-à-dire pendant environ quatre siècles, le requérant a exercé une possession non équivoque, ininterrompue et incontestée sur le bien litigieux. En outre, le bien en question se caractérisait par des particularités et un usage spécifiques liés à la vie religieuse de la communauté juive d’Izmir.
66. Au vu de ce qui précède, la Cour ne doute pas que le requérant était titulaire d’un intérêt patrimonial constituant un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Cette disposition est donc applicable. Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompatibilité ratione materiae de ce grief avec la Convention.
b) Sur l’existence d’une ingérence
67. La Cour constate que la première procédure engagée par le requérant a permis à celui-ci de faire inscrire à son nom le bâtiment ici en cause (une ancienne synagogue), mais non de se voir attribuer la propriété du terrain sur lequel ce bâtiment est édifié. Or le cadastrage réalisé en 1930 sur l’ensemble de ce bien démontrait que le requérant en possédait l’intégralité, sans toutefois disposer d’un acte. La procédure ultérieure engagée par le requérant s’est soldée par la reconnaissance d’un droit subjectif – un « muhdesat » – au profit de celui-ci sur le bien en question, mais non de sa qualité de propriétaire de celui-ci. Au vu de ce qui précède, la Cour relève que l’inscription au nom du Trésor public – consécutive à l’arrêt de la Cour de cassation – du terrain sur lequel était édifié le bâtiment (une ancienne synagogue) appartenant au requérant peut s’assimiler à une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de ses biens (voir, mutatis mutandis, Trgo c. Croatie, no 35298/04, § 54, 11 juin 2009). La Cour doit donc rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
c) Sur la justification de l’ingérence
68. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi ». De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est une notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 95, 25 octobre 2012, avec les références citées).
69. Toutefois, l’existence d’une base légale en droit interne ne suffit pas, en tant que telle, à satisfaire au principe de légalité. Il faut, en plus, que cette base légale présente une certaine qualité, celle d’être compatible avec la prééminence du droit et d’offrir des garanties contre l’arbitraire. À cet égard, il faut rappeler que la notion de « loi », au sens de l’article 1 du Protocole no 1, a la même signification que celle qui lui est attribuée par d’autres dispositions de la Convention. Il s’ensuit qu’en plus d’être conformes au droit interne de l’État contractant, en ce compris la Constitution, les normes juridiques sur lesquelles se fonde une privation de propriété doivent être suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application (ibidem, §§ 96-97, avec les références citées, voir aussi, N.M. et autres c. France (fond), no 66328/14, § 59, 3 février 2022, avec les références citées).
70. La Cour rappelle par ailleurs que l’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens. Il ne fait aucun de doute que les États contractants doivent jouir d’une ample latitude pour réglementer l’acquisition de biens immobiliers et fonciers par des personnes morales. Il s’agit en effet de leur laisser la possibilité de mettre en œuvre, conformément à l’intérêt général, les mesures nécessaires pour protéger l’ordre public et les intérêts de la collectivité tout en permettant à ces personnes morales de réaliser leurs buts et objectifs déclarés (Fener Rum Erkek Lisesi Vakfi c. Turquie, no 34478/97, § 52, 9 janvier 2007, avec les références citées).
71. En
l’espèce, la Cour observe d’emblée que la procédure
litigieuse portait sur un bien immobilier non enregistré
composé d’un bâtiment édifié et utilisé par le
requérant et du terrain sur lequel ce bâtiment avait été
construit. L’intéressé a engagé une action tendant à
contester les conclusions du second cadastrage et à se voir
attribuer la propriété de l’ensemble de ce bien. à cet
effet, il s’est fondé, entre autres, sur les conclusions du
cadastrage initial réalisé en 1930. Toutefois, par un jugement
du 21 mars 2008, le tribunal du cadastre a rejeté la demande du
requérant pour deux motifs. En premier lieu, il s’est
fondé principalement sur l’absence d’approbation du
Conseil des fondations et de décision du Conseil des ministres (paragraphes 18
et 22 ci-dessus). En second lieu, il a constaté qu’il n’existait
pas d’élément de preuve décisif commandant l’inscription
des parcelles litigieuses au nom du requérant. Pour sa part, la
Cour de cassation s’est également fondée sur la loi
provisoire de 1912 (paragraphe 23
ci-dessus), en sus des motifs retenus par le tribunal de
première instance. La Cour examinera ces motifs séparément.
72. S’agissant en premier lieu de l’absence d’approbation du Conseil des fondations et de décision du Conseil des ministres, la Cour observe que dans les observations qu’il lui a soumises, le Gouvernement n’a pas évoqué ces motifs ni précisé quelle était la base légale exigeant de telles autorisations pour la reconnaissance d’un titre de propriété sur le bien ici en cause. Au vu des éléments du dossier, la Cour constate que le tribunal du cadastre a appliqué les dispositions de la loi no 2762 sur les fondations. Or n’ayant pas fait usage de la possibilité offerte par la loi no 2762 de déposer une déclaration précisant son patrimoine et d’obtenir ainsi le statut de fondation (paragraphe 6 ci-dessus), le requérant n’avait pas le statut de fondation créée par des minorités non-musulmanes au moment où il a fait la demande objet de cette procédure. Dans ces conditions, la Cour ne voit pas comment cette loi, qui régit entre autres le régime d’acquisition des biens immobiliers par les fondations, aurait pu trouver application en l’espèce.
73. Il est vrai que le tribunal du cadastre a également considéré qu’il n’existait aucun élément de preuve décisif qui aurait commandé l’inscription des biens immobiliers litigieux au nom de l’intéressé. Toutefois, cette considération formulée par le tribunal ne se fondait sur aucun élément de fait et ne tenait pas compte de la réalité de la situation – décrite ci-dessus – relative au statut du bien litigieux (paragraphe 65 ci-dessus). En effet, il n’est pas contesté qu’une synagogue a été édifiée en 1605 sur le terrain litigieux et qu’elle a été utilisée par le requérant pendant des siècles. Même si l’affectation de cet édifice a ultérieurement changé, il ressort notamment du rapport d’expertise établi le 24 avril 2002 que le bâtiment en question était toujours utilisé comme bâtiment administratif par le Grand rabbinat d’Izmir en 2002 (paragraphe 11 ci-dessus), c’est-à-dire après l’engagement par le requérant d’une action tendant à faire inscrire le bien en question à son nom (paragraphe 10 ci-dessus). Force est donc de constater que le requérant a exercé sur le bien litigieux une possession non équivoque, ininterrompue et paisible pendant environ quatre siècles à compter de la construction de la synagogue. Par ailleurs, rien ne donne à penser en l’espèce que la possession du terrain litigieux était dissociable de celle du bâtiment en question.
74. Certes, il ressort de l’inspection sur place effectuée par le tribunal de grande instance d’Izmir en 2006 (paragraphe 17 ci-dessus) que le Grand rabbinat d’Izmir avait déclaré avoir cessé d’utiliser ce bâtiment, précisant cependant qu’il continuait à payer les taxes foncières y afférentes. La Cour observe que le Gouvernement a mis l’accent sur ce prétendu abandon pour justifier le jugement rendu par le tribunal du cadastre. Toutefois, dans son jugement, ce dernier n’a accordé aucun poids à cet élément de fait qui, au demeurant, concernait le bâtiment sur lequel ce même tribunal avait reconnu au requérant un droit subjectif, c’est-à-dire un « muhdesat ».
75. Pour la Cour, la reconnaissance d’un droit subjectif – un « muhdesat » – au profit du requérant sur le bâtiment en question constitue un élément de poids aux fins de l’appréciation des faits. Toutefois, comme le Gouvernement l’a expliqué (paragraphe 61 ci-dessus), en droit turc, ce droit n’équivaut pas à un droit de propriété. En outre, il n’est pas allégué que le bâtiment a été édifié sur un terrain qui aurait appartenu ab initio à une tierce personne ou au Trésor public, et il est manifeste que cet édifice a été construit sur un terrain non enregistré. En effet, le droit de propriété du Trésor public – qui n’a jamais revendiqué un tel droit – n’a été reconnu qu’à l’issue de la procédure litigieuse.
76. Enfin, la Cour de cassation s’est aussi fondée sur la loi provisoire du 1912 pour justifier la non-inscription du bien litigieux au nom du requérant. La Cour observe que, comme le Gouvernement l’a souligné, le requérant n’a pas usé de la possibilité qui lui était offerte par les lois de 1912 et de 1935. Cependant, elle ne voit pas comment ce défaut de dépôt d’une demande en 1912 ou en 1935 pourrait avoir constitué un obstacle à l’obtention d’un titre de propriété sur le bien en question. En effet, il ressort du dossier de l’affaire que l’absence de demande au sens de la loi provisoire du 1912 ou de déclaration dite « de 1936 » n’a jamais constitué un obstacle à l’acquisition, par le requérant, de la propriété d’autres biens immobiliers. Dans un premier temps, en sa qualité de Grand rabbinat d’Izmir, le requérant a pu obtenir l’inscription au registre foncier des biens immobiliers qui étaient en sa possession (voir le jugement adopté le 14 avril 1950, puis confirmé par la Cour de cassation le 23 septembre 1957, paragraphe 7 ci-dessus). Par la suite, lorsqu’il a acquis en 2011 le statut de fondation, il a été reconnu propriétaire des biens qui étaient inscrits au registre foncier sous la dénomination de « synagogue » ou de « lieu de culte de la communauté juive Karatas d’Izmir » ou encore « au nom de la communauté juive ».
77. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est convaincue que l’absence d’approbation du Conseil des fondations et de décision du Conseil des ministres a été le motif principal du rejet de la demande du requérant tendant à faire inscrire les parcelles litigieuses à son nom. Or, ces conditions étaient applicables à l’acquisition de biens immobiliers par les fondations appartenant aux minorités non-musulmanes créées en vertu de la loi no 2762. Au moment de l’introduction de sa demande, le requérant ne relevait pas de cette catégorie. Par conséquent, on ne saurait considérer que la non-inscription des titres de propriété ici en cause, due à l’application de dispositions qui n’étaient manifestement pas pertinentes pour trancher l’affaire du requérant, était prévisible. En effet, l’intéressé ne pouvait raisonnablement prévoir que sa demande, fondée sur les conclusions du cadastre effectué en 1930, serait rejetée, alors qu’il possédait le bien en question sans titre depuis plusieurs années, et même depuis plusieurs siècles (voir, mutatis mutandis, Fener Rum Erkek Lisesi Vakfi, précité, § 57 ; Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi c. Turquie, nos 37639/03 et 3 autres, § 54, 3 mars 2009).
78. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit du requérant au respect de ses biens.
79. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
KRIVTSOVA c. RUSSIE du 12 juillet 2022 Requête no 35802/16
Art 1 P1 • Privation de propriété • Annulation du titre de propriété sur une parcelle de terrain sans versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien • Autorité publique ayant outrepassé ses compétences qu’incombe la responsabilité de l’aliénation de la parcelle litigieuse
CEDH
60. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’annulation rétroactive d’un titre de propriété valide constitue une privation de propriété, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Bidzhiyeva, précité, § 61, Gavrilova et autres c. Russie, no 2625/17, § 69, 16 mars 2021, et les références qui y sont citées). Elle ne voit aucune raison de conclure autrement en l’espèce. Ainsi, elle estime que la décision de justice portant radiation du droit de propriété de la requérante sur la parcelle de terrain s’analyse en une « privation de propriété ».
61. La Cour doit rechercher si l’ingérence se justifie sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Pour être compatible avec cette disposition, une ingérence doit remplir trois conditions : elle doit être effectuée « dans les conditions prévues par la loi », poursuivre un but d’utilité publique et être proportionnée à ce but, c’est-à-dire ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit de l’individu au respect de ses biens.
62. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. Il faut, en plus, que cette base légale présente une certaine qualité, celle d’être compatible avec la prééminence du droit et d’offrir des garanties contre l’arbitraire (Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, §§ 95-96, 25 octobre 2012). La Cour dispose d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué ; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste (voir, parmi beaucoup d’autres, Tkachenko c. Russie, no 28046/05, § 52, 20 mars 2018).
63. La Cour note que les parties sont en désaccord sur la question de la légalité de l’ingérence. Le Gouvernement est d’avis que la mesure était conforme à la loi en vigueur, tandis que la requérante soutient que les conclusions des juridictions internes étaient entachées d’arbitraire. La requérante estime en effet que les juridictions internes auraient dû déclarer prescrite l’action de son adversaire (paragraphe 53 ci-dessus).
64. Concernant l’allégation de la prescription, la Cour ne peut suivre la requérante en effectuant une analyse aussi poussée du droit national. Constatant que l’ingérence est fondée sur l’article 302 du code civil et les articles 1 et 35 du code foncier, elle ne décèle aucun élément qui lui permette de conclure que la décision de justice litigieuse ordonnant l’annulation du titre de propriété de la requérante était entachée d’arbitraire ou manifestement déraisonnable. Elle considère donc que l’ingérence a été opérée « dans les conditions prévues par la loi » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
65. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la mesure poursuivait « un but d’utilité publique ». Le Gouvernement soutient que son objectif était la préservation de l’héritage culturel du pays (paragraphe 44 ci-dessus). La requérante allègue qu’aucune valeur historique n’est attachée à la parcelle supportant le bâtiment, dont seul le sous-sol présente une telle valeur (paragraphe 55 ci-dessus).
66. La Cour est attentive à l’analyse opérée par la justice nationale qui a expliqué que le principe sous-tendant sa décision était celui de l’unité du bâtiment et du terrain le supportant. Le tribunal du district Centralny de Volgograd a précisé que ce principe visait à assurer aux propriétaires de biens immobiliers les meilleures conditions de jouissance de leur droit (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette analyse et estime donc que la mesure litigieuse a été opérée « pour cause d’utilité publique ».
67. En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, la Cour rappelle qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par une mesure privant une personne de sa propriété (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 93, CEDH 2006-V). Analysant la question de l’annulation de titres de propriété délivrés par les autorités ou de contrats de vente conclus avec celles-ci, la Cour a pris en compte, en tant que critères essentiels, la question de la responsabilité des parties dans l’irrégularité sanctionnée par l’annulation du titre. Elle a dit qu’aucune erreur commise par une autorité publique ne devait être réparée au détriment de la personne concernée (Çataltepe, précité, § 70, Gashi c. Croatie, no 32457/05, § 40, 13 décembre 2007, et Gladysheva, précité, § 80). Sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 (Gladysheva, précité, § 67).
68. En l’espèce, la Cour observe que les juridictions internes n’ont relevé aucune faute dans le chef de la requérante, ni n’ont imputé à celle-ci la responsabilité de la privatisation entachée d’irrégularité du bien litigieux.
69. En revanche, il ressort des décisions rendues par les juridictions russes que c’est à l’autorité publique qui a agi en outrepassant ses compétences qu’incombe la responsabilité de l’aliénation de la parcelle litigieuse (paragraphes 10, 13-15 ci-dessus). Cette erreur ne doit donc pas être réparée au détriment de la requérante. La Cour ne perd pas de vue que l’intéressée a acquitté le prix du terrain au profit du Trésor public, quelle qu’ait été sa branche (régionale ou fédérale) (voir, a contrario, Anna Popova c. Russie (no 59391/12, §§ 17 et 35, 4 octobre 2016, et Gladysheva, précité, §§ 24 et 72, dans lesquels les acquéreurs de bonne foi ont acquitté le prix des biens, aliénés à l’insu de leur propriétaire, une autorité publique, au profit de tiers non autorisés par le propriétaire). Dans cette situation, priver la requérante de la parcelle sans versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien constitue une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (Gladysheva, précité, § 67).
70. Ainsi, le « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et celui de l’individu n’a pas été ménagé. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Gavrilova et autres c. Russie du 16 mars 2021 requête no 2625/17
Article 1 du Protocole 1 : Annulation rétroactive des titres de propriété portant sur des terrains classés « ressources forestières » : ingérence injustifiée
L’affaire concerne l’annulation en justice des titres de propriété que détenaient les requérants sur des parcelles de terrain qu’ils avaient achetées après une chaîne de transactions, et la réintégration de ces parcelles dans le patrimoine de l’État au motif qu’il s’agissait de « ressources forestières ». La Cour juge en particulier que les requérants, qui n’avaient commis aucune faute, ont dû subir les conséquences des erreurs et omissions des autorités, sans qu’il leur soit versé aucune forme d’indemnisation. Le juste équilibre qui devait régner entre les exigences de l’intérêt public et la nécessité de protéger le droit de propriété des requérants a donc été rompu.
Art 1 P1 • Annulation des titres de propriété sur des parcelles de terrain achetées et réintégration de celles-ci dans le patrimoine municipal • Absence de faute des requérants ayant subi les conséquences des erreurs des autorités et de l’application rigide des dispositions sur la revendication • Absence d’indemnisation • Juste équilibre rompu au détriment des requérants
FAITS
Les requérants sont cinq ressortissants russes, nés entre 1944 et 1985. Ils résident en Russie. L’affaire concerne l’annulation en justice des titres de propriété que détenaient les requérants sur des parcelles de terrain qu’ils avaient achetées après une chaîne de transactions, et la réintégration de ces parcelles dans le patrimoine de l’État au motif qu’il s’agissait de « ressources forestières ». Le terrain était situé dans le parc résidentiel de loisirs Lesnoïé, ouvert dans le district de Gatchina (région de Leningrad). En septembre 2014, l’agence fédérale de gestion du patrimoine de l’État (« agence fédérale ») introduisit une action en revendication contre les requérants et cinq autres acheteurs des parcelles issues du terrain litigieux. Le tribunal de Gatchina rejeta l’action en estimant que l’État avait perdu, depuis 1991, la propriété et la possession du terrain et que c’était aux autorités publiques de veiller à la préservation du patrimoine de l’État, et que les requérants – acquéreurs de bonne foi – ne devaient pas être pénalisés pour la négligence des autorités. Toutefois, la cour régionale de Leningrad, statuant en appel, fit droit à la demande de l’agence fédérale en avril 2016. Elle estima en particulier que le terrain relevait des ressources forestières, qu’il était la propriété de l’État et qu’il ne pouvait pas être privatisé à moins que sa catégorie ne fût changée selon les modalités légales, ce qui n’avait pas été fait en l’espèce. Les pourvois en cassation des requérants furent rejetés par deux décisions rendues en juillet 2016.
Article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété)
La Cour constate que l’annulation des droits de propriété des requérants s’analyse en une « privation de propriété ». Elle note ensuite que la mesure litigieuse répondait à un but d’utilité publique, à savoir la gestion des terrains par les autorités et la préservation de la forêt en tant que composante de l’environnement appelant une politique d’aménagement du territoire appropriée. Elle rappelle à cet égard que la protection de l’environnement est devenue une valeur dont la défense suscite dans l’opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu. La Cour rappelle que la proportionnalité de l’ingérence implique l’existence d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à supporter « une charge spéciale et exorbitante ». Dans son analyse de la proportionnalité, outre le comportement des autorités, la Cour examine souvent l’attitude du propriétaire, notamment le degré de faute ou de prudence dont il a fait preuve. En l’espèce, en ce qui concerne le comportement des autorités, la Cour relève que celles-ci ont d’une part fait preuve d’inertie : elles ont omis d’enregistrer le droit de propriété de l’État sur le terrain et la catégorisation de celui-ci en tant que terrain relevant des ressources forestières, elles sont restées inactives pendant près de 24 ans (depuis 1991) alors qu’elles savaient que l’État avait perdu la possession et la propriété du terrain, et elles ont permis l’abandon et la destruction progressive de la forêt dont celui-ci était couvert. D’autre part, elles ont validé la catégorisation et l’affectation du terrain ainsi que les transactions portant sur celui-ci et sur les parcelles issues de sa division. En agissant de la sorte, les autorités ont manqué à leur devoir d’agir en temps utile et avec diligence. En outre, en statuant sur l’action en revendication engagée par l’État, la juridiction d’appel – qui a admis la bonne foi des requérants – n’a pas procédé à une mise en balance des intérêts concurrents, publics et privés : elle s’est bornée à constater que le terrain litigieux avait toujours été propriété de l’État et qu’il ne pouvait pas être privatisé. La Cour considère que la juridiction n’a tenu aucun compte de la bonne foi des acquéreurs, contrairement aux exigences conventionnelles et aux indications des Cours suprême et constitutionnelle Par ailleurs, alors que le tribunal de Gatchina avait indiqué que le but d’utilité publique aurait pu être atteint par l’application de mesures moins drastiques, par exemple au moyen du rachat par l’État des parcelles des requérants ou de l’attribution aux intéressés d’autres parcelles équivalentes, la juridiction d’appel n’a pas envisagé ces possibilités. De surcroît, la cour régionale a conclu que la prescription ne devait pas être utilisée comme un moyen de légitimer des agissements illicites commis au détriment du propriétaire – l’État – et que l’agence fédérale n’avait eu connaissance de la violation des droits de l’État qu’après en avoir été informée par le parquet, alors que, selon les constatations faites par le tribunal, non contredites par la cour régionale, plus de 20 ans s’étaient écoulés depuis la première transaction avec le terrain. Non seulement cette approche va à l’encontre de la pratique de la Cour supérieure de commerce, mais encore elle prive d’effet réel les règles de prescription établies par la loi en faisant dépendre la prescription des résultats des vérifications faites par le parquet, lesquelles peuvent être menées sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, après la privatisation d’un bien immobilier. Cela donne un avantage disproportionné aux autorités publiques, rend les actions en revendication virtuellement imprescriptibles et contribue à créer une insécurité sur le marché de l’immobilier. En ce qui concerne le comportement des requérants, la Cour observe qu’il n’a jamais été allégué qu’ils eussent été de mauvaise foi ou négligents lors de l’achat des parcelles. Elle ne décèle aucun élément permettant de penser que ce soit le cas. Elle note aussi que les forêts situées sur le territoire des municipalités ne constituaient pas des ressources forestières selon l’ancien code forestier, et pouvaient se trouver sur des terrains ne relevant pas des ressources forestières selon le nouveau code forestier, de sorte qu’elles pouvaient être privatisées. Il en résulte que les requérants, étant de bonne foi, se fiant aux autorités et disposant de moyens réduits pour déceler les irrégularités affectant les acquisitions des parcelles, pouvaient légitimement croire qu’en achetant des parcelles dont certaines au moins étaient boisées, situées sur le territoire de la municipalité, ils agissaient conformément à la loi et qu’ils étaient juridiquement en sécurité. Or, ni la bonne foi des requérants, ni le fait que la situation ne leur était pas imputable n’ont joué le moindre rôle dans la procédure interne. Par conséquent, la Cour conclut que les requérants, qui n’avaient commis aucune faute, ont dû subir les conséquences des erreurs des autorités et de l’application rigide des dispositions relatives à la revendication, sans qu’il leur soit versé aucune forme d’indemnisation. Le juste équilibre qui devait régner entre les exigences de l’intérêt public et la nécessité de protéger le droit de propriété des requérants a donc été rompu et il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.
CEDH
a) Sur la nature de l’ingérence
69. En l’espèce, le droit de propriété des requérants sur les parcelles a été annulé quelques années après les achats de ces parcelles. La Cour observe d’emblée il s’agit d’un contentieux opposant les requérants - particuliers - à l’État (voir, a contrario, Kanevska c. Ukraine (déc.), no 73944/11, 17 novembre 2020, s’agissant d’un litige purement privé). Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’annulation rétroactive d’un titre de propriété valide constitue une privation de propriété, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Turgut et autres c. Turquie, no 1411/03, §§ 87-88, 8 juillet 2008, Satir c. Turquie, no 36192/03, § 31, 10 mars 2009, Silahyürekli c. Turquie, no 16150/06, § 33, 26 novembre 2013, Maksymenko et Gerasymenko c. Ukraine, no 49317/07, § 50, 16 mai 2013, Vukušic c. Croatie, no 69735/11, § 50, 31 mai 2016, avec les références qui y sont citées, et Bidzhiyeva c. Russie, no 30106/10, § 61, 5 décembre 2017). Elle ne voit aucune raison de conclure autrement en l’espèce. Ainsi, elle estime que l’annulation des droits de propriété des requérants s’analyse en une « privation de propriété ».
b) Sur la justification de l’ingérence
70. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, pour être conforme à l’article 1 du Protocole no 1, toute mesure doit être opérée « dans les conditions prévues par la loi », poursuivre un but d’utilité publique et être proportionnée à ce but, c’est-à-dire ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit de l’individu au respect de ses biens.
71. Selon le Gouvernement, l’ingérence a été opérée « dans les conditions prévues par la loi ». Les requérants n’ont pas présenté de contre-arguments sur ce point. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » (Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 95, 25 octobre 2012).
72. En l’espèce, les juridictions russes ont établi que le terrain litigieux relevait des ressources forestières et qu’il ne pouvait pas être privatisé à moins d’être converti en une autre catégorie de terrain conformément à la procédure spéciale de conversion, et qu’elles ont finalement considéré que l’action en revendication n’était pas prescrite et était bien fondée. En l’absence de moyens présentés par les requérants sur ce point, la Cour ne saurait se prononcer de manière péremptoire sur le point de savoir si la revendication peut passer pour avoir été opérée « dans les conditions prévues par la loi ». Toutefois, rappelant qu’elle ne dispose que d’une compétence limitée pour contrôler le respect du droit interne, elle n’estime pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que la mesure méconnaît l’article 1 du Protocole no 1 pour d’autres raisons (paragraphes 75 et suivants ci-dessous ; voir, pour une approche similaire, Vistinš et Perepjolkins, précité, § 105, et Pchelintseva et autres c. Russie, nos 47724/07 et 4 autres, § 95, 17 novembre 2016).
73. La Cour note ensuite qu’il ne fait pas controverse entre les parties que la mesure litigieuse répondait à un but d’utilité publique, à savoir la gestion des terrains par les autorités et la préservation de la forêt en tant que composante de l’environnement appelant une politique d’aménagement du territoire appropriée. Elle rappelle à cet égard que la protection de l’environnement est devenue une valeur dont la défense suscite dans l’opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu (voir Depalle c. France [GC], no 34044/02, CEDH 2010, § 81 et les références qui y sont citées, et, mutatis mutandis, Beinarovic et autres c. Lituanie, nos 70520/10 et 2 autres, § 135, 12 juin 2018)
1) Les principes généraux relatifs à la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect des biens
74. La Cour rappelle que la proportionnalité de l’ingérence implique l’existence d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à supporter « une charge spéciale et exorbitante ». La vérification de l’existence d’un juste équilibre exige un examen global des différents intérêts en jeu. Les aspects examinés par la Cour varient d’une affaire à une autre et dépendent des faits et de l’ingérence en cause. Dans son analyse de la proportionnalité, outre le comportement des autorités, la Cour examine souvent l’attitude du propriétaire, notamment le degré de faute ou de prudence dont il a fait preuve (AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, § 54, série A no 108, et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 301, 28 juin 2018). Plus particulièrement, lorsqu’une personne acquiert un bien immobilier, elle doit faire preuve de vigilance au cas où des indices évidents pointent vers des fraudes commises en amont de la chaîne des transmissions de propriété. La Cour examine également les conséquences de l’ingérence pour le requérant et, en cas de privation de propriété, le point de savoir s’il a été indemnisé et selon quelles modalités (Turgut et autres, précité, § 91, et les références qui y sont citées), et cela indépendamment des préoccupations environnementales. Elle rappelle à cet égard que lorsque, en corrigeant leurs propres erreurs, les autorités se trouvent amenées à porter atteinte au droit au respect des biens, le principe de la bonne gouvernance (good governance) exige qu’elles agissent en temps utile et de façon correcte et cohérente (voir, par exemple, Osipkovs et autres c. Lettonie, no 39210/07, § 80, 4 mai 2017, Beinarovic et autres, précité, §§ 138-139, et, dernièrement, Maltsev et autres c. Russie, nos 77335/14 et 2 autres, § 32, 17 décembre 2019), et qu’elles veillent aussi à ne pas corriger ce type d’erreurs au détriment du particulier concerné, surtout en l’absence d’un autre intérêt privé qui irait dans le sens contraire (voir, mutatis mutandis, Gladysheva c. Russie, no 7097/10, § 80, 6 décembre 2011, et Beinarovic et autres, précité, § 140, et les références qui y sont citées).
2) Le comportement des autorités dans la présente affaire
75. La Cour observe tout d’abord que les autorités n’ont jamais fait enregistrer de droit de propriété de l’État sur le terrain litigieux – ce dont elles avaient légalement la possibilité – et n’ont pas fait inscrire ce terrain au cadastre en tant que ressource forestière. Elle estime que, fondamentalement, ce sont ces omissions qui ont rendu possible le transfert du terrain à la collectivité locale, sa privatisation, sa division et la vente des parcelles ainsi créées (voir également, dans le même ordre d’idées, les considérations exposées dans le raisonnement de la Cour constitutionnelle, au paragraphe 57 ci-dessus).
76. Elle note également que l’autorité chargée de l’enregistrement et le service du cadastre n’ont émis aucune objection quant au terrain puis aux parcelles en cause. Or l’enregistrement du droit de propriété immobilière était, et reste à ce jour, un acte juridique valant reconnaissance par l’État du droit en question, effectué après une « expertise juridique » des documents présentés à cette fin, et l’autorité chargée de l’enregistrement était compétente pour rejeter la demande d’enregistrement si elle n’était pas certaine du pouvoir de disposition du cédant (paragraphes 42-43 et 48-49 ci-dessus). De son côté, le service du cadastre avait le pouvoir de rejeter la demande d’inscription cadastrale si les informations soumises étaient contradictoires ou incomplètes, si les documents ne satisfaisaient pas aux exigences légales ou si le terrain et les parcelles, présentées comme urbains, n’étaient pas en conformité avec les dispositions légales applicables notamment en matière de gestion forestière (paragraphes 46-47 ci-dessus).
77. Compte tenu des omissions indiquées au paragraphe 75 ci-dessus et du fait que les autorités citées au paragraphe 76 ci-dessus ne pouvaient pas se rendre sur place pour déterminer si le terrain relevait des ressources forestières, si c’était une forêt ne relevant pas des ressources forestières ou encore s’il s’agissait d’une autre catégorie de terrain, la Cour ne saurait sans spéculer se prononcer sur l’obligation ou même sur la simple possibilité pour ces autorités de déceler des irrégularités et d’empêcher les transactions portant sur le terrain et les parcelles (voir, mutatis mutandis, Zhidov et autres c. Russie, nos 54490/10 et 3 autres, § 101, 16 octobre 2018, et Kvyatkovksiy c. Russie (déc.), no 6390/18, § 31, 18 octobre 2018).
78. En revanche, elle considère, comme le tribunal de Gatchina, que l’État, en tant que propriétaire du terrain litigieux, disposait d’autres organes qui pouvaient, d’une part, détecter les irrégularités susceptibles d’en affecter le devenir (paragraphes 23, 24 et 27 ci-dessus) et, d’autre part, agir le cas échéant avant l’expiration du délai de prescription (voir, dans le même ordre d’idées, l’arrêt de la Cour supérieure de commerce, au paragraphe 60 ci-dessus). Elle ne peut que souscrire à la conclusion du tribunal de Gatchina selon laquelle le service forestier, le comité créé pour les besoins de la réforme foncière et le comité de gestion du patrimoine de l’État, devenu en 2004 l’agence fédérale, ne pouvaient pas ignorer que l’État avait perdu depuis 1991 la propriété et la possession du terrain en question et que celui-ci avait été divisé et revendu (paragraphes 26-27 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard que l’État ne peut à bon droit se prévaloir de son organisation interne ou d’une distinction entre les différentes autorités publiques (Hamer c. Belgique, no 21861/03, § 76, CEDH 2007-V (extraits)).
79. En résumé, les autorités ont d’un côté fait preuve d’inertie – elles ont omis d’enregistrer le droit de propriété de l’État sur le terrain et la catégorisation de celui-ci en tant que terrain relevant des ressources forestières, elles sont restées inactives pendant près de vingt-quatre ans alors qu’elles savaient que l’État avait perdu la possession et la propriété du terrain, et elles ont permis l’abandon et la destruction progressive de la forêt dont celui-ci était couvert (voir, a contrario, Maltsev et autres c. Russie, nos 77335/14 et 2 autres, § 33, 17 décembre 2019, affaire où les autorités ont réagi rapidement). D’un autre côté, elles ont validé la catégorisation et l’affectation du terrain ainsi que les transactions portant sur celui-ci et sur les parcelles issues de sa division. En agissant de la sorte, les autorités ont manqué à leur devoir d’agir en temps utile et avec diligence.
80. En outre, en statuant sur l’action en revendication engagée par l’État, la juridiction d’appel – qui a admis la bonne foi des requérants (sur ce point, voir les paragraphes 83-85 ci-dessous) – n’a pas procédé à une mise en balance des intérêts concurrents, publics et privés : elle s’est bornée à constater que le terrain litigieux avait toujours été propriété de l’État et qu’il ne pouvait pas être privatisé. La Cour considère que la juridiction n’a tenu aucun compte de la bonne foi des acquéreurs, contrairement aux exigences conventionnelles et aux indications des Cours suprême et constitutionnelle (paragraphes 52-57 ci-dessus).
81. Par ailleurs, alors que le tribunal de Gatchina avait indiqué que le but d’utilité publique aurait pu être atteint par l’application de mesures moins drastiques, par exemple au moyen du rachat par l’État des parcelles des requérants ou de l’attribution aux intéressés d’autres parcelles équivalentes (paragraphe 28 ci-dessus), la juridiction d’appel n’a pas envisagé ces possibilités.
82. La Cour note de surcroît que la cour régionale a conclu que la prescription ne devait pas être utilisée comme un moyen de légitimer des agissements illicites commis au détriment du propriétaire – l’État – et que l’agence fédérale n’avait eu connaissance de la violation des droits de l’État qu’après en avoir été informée par le parquet (paragraphe 30 ci-dessus), alors que, selon les constatations faites par le tribunal (paragraphe 27 ci-dessus), non contredites par la cour régionale, plus de vingt ans s’étaient écoulés depuis la première transaction avec le terrain. Non seulement cette approche va à l’encontre de l’arrêt de la Cour supérieure de commerce (paragraphe 60 ci-dessus), mais encore elle prive d’effet réel les règles de prescription établies par la loi en faisant dépendre la prescription des résultats des vérifications faites par le parquet, lesquelles peuvent être menées sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, après la privatisation d’un bien immobilier. Cela donne un avantage disproportionné aux autorités publiques (comparer avec Zouboulidis c. Grèce (no 2), no 36963/06, §§ 32 et 35, 25 juin 2009), rend les actions en revendication virtuellement imprescriptibles et contribue à créer une insécurité sur le marché de l’immobilier.
3) Le comportement des requérants dans la présente affaire
83. La Cour observe qu’il n’a jamais été allégué que les requérants eussent été de mauvaise foi ou négligents lors de l’achat des parcelles. Pour sa part, elle ne décèle aucun élément permettant de penser que ce soit le cas (voir, a contrario, Maltsev et autres, précité, § 34), eu égard en particulier au droit interne et à la présomption de bonne foi applicable en la matière (paragraphes 50-54 ci-dessus).
84. Par ailleurs, les forêts situées sur le territoire des municipalités ne constituaient pas des ressources forestières selon l’ancien code forestier, et pouvaient se trouver sur des terrains ne relevant pas des ressources forestières selon le nouveau code forestier (paragraphes 39 et 41 ci-dessus), de sorte qu’elles pouvaient être privatisées.
85. De l’avis de la Cour, il résulte de ce qui précède que les requérants, étant de bonne foi, se fiant aux autorités et disposant de moyens réduits pour déceler les irrégularités affectant les acquisitions des parcelles (paragraphe 57 ci-dessus), pouvaient légitimement croire qu’en achetant des parcelles dont certaines au moins étaient boisées, situées sur le territoire de la municipalité Siverski, ils agissaient conformément à la loi et qu’ils étaient juridiquement en sécurité.
86. Or, ni la bonne foi des requérants, ni le fait que la situation ne leur était pas imputable n’ont joué le moindre rôle dans la procédure interne (Zhidov et autres, précité, § 110).
87. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants, qui n’avaient commis aucune faute, ont dû subir les conséquences des erreurs des autorités et de l’application rigide des dispositions relatives à la revendication, sans qu’il leur soit versé aucune forme d’indemnisation. Partant, le juste équilibre qui devait régner entre les exigences de l’intérêt public et la nécessité de protéger le droit de propriété des requérants a été rompu.
Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Semenov c. Russie du 16 mars 2021 requête n° 17254/15
Article 1 du Protocole 1 : L’annulation du droit de propriété du requérant sur une parcelle de terrain au profit de la municipalité : violation du droit au respect de la propriété.
L’affaire concerne l’annulation du droit de propriété que le requérant avait sur une parcelle de terrain destinée au maraîchage qu’il avait achetée à une personne physique, et la réintégration de cette parcelle dans le patrimoine municipal d’Omsk à la demande du procureur. La Cour considère que les juridictions internes n’ont pas procédé à une mise en balance des intérêts publics et privés concurrents. Elles se sont bornées à considérer qu’il était interdit de créer en ville des parcelles destinées au maraîchage et en ont déduit que la ville d’Omsk avait été dépossédée de la parcelle contre sa volonté. En particulier, les tribunaux n’ont pas envisagé la possibilité de protéger le droit de propriété du requérant en l’absence de raisons impératives de réintégrer la parcelle en cause dans le patrimoine municipal. La Cour observe également que le procureur a engagé l’action en revendication presque quatre ans après l’achat de la parcelle par le requérant. En prenant pour point de départ du délai de prescription la fin des vérifications faites par le procureur, les juridictions internes ont en l’espèce privé d’effet réel les règles de prescription établies par la loi et ont donné un avantage disproportionné aux autorités. Une telle approche des tribunaux rend les actions en revendication virtuellement imprescriptibles et contribue à créer une insécurité juridique sur le marché de l’immobilier.
Art 1 P1 • Annulation des titres de propriété sur une parcelle de terrain achetée à une personne physique et réintégration de celle-ci dans le patrimoine municipal • Absence d’impératif public absolu et peut-être de nécessité • Charge exorbitante supportée par le requérant • Juste équilibre rompu au détriment du requérant
FAITS
Le requérant, M. Andrey Mikhaylovich Semenov, est un ressortissant russe, né en 1974 et résidant à Omsk. M. Semenov était propriétaire à Omsk d’une parcelle de terrain (n° 23 au cadastre) en zone résidentielle sur laquelle était édifiée sa maison. Le 6 décembre 2007, Mme G. demanda à l’administration municipale d’Omsk l’attribution d’une parcelle de terrain pour maraîchage. Le 25 décembre 2008, la direction municipale lui attribua une parcelle, en zone résidentielle, attenante à celle de M. Semenov. En mai 2009, elle fut enregistrée au cadastre sous le n° 24, en tant que parcelle destinée au maraîchage. En septembre 2009, la direction municipale octroya la propriété de la parcelle n° 24 à Mme G., puis établit l’acte de vente au mois de décembre 2009.
Le 12 mars 2010, M. Semenov acheta la parcelle n° 24 à Mme G., et fit inscrire son droit de propriété au registre unifié et installa sur la parcelle un garage, une serre, un poulailler et une aire de jeux. Le 12 février 2014, le procureur de la ville d’Omsk assigna en justice M. Semenov et la direction municipale, demandant l’annulation du droit de propriété de M. Semenov sur la parcelle n° 24 et sa réintégration dans le patrimoine municipal d’Omsk. Le 30 avril 2014, le tribunal rendit son jugement. Il indiqua que dans la zone résidentielle d’Omsk, les parcelles étaient à usage principal de construction et ne pouvaient être exclusivement utilisées pour le maraîchage. Le tribunal estima qu’en affectant la parcelle à un usage de maraîchage et en l’aliénant, la direction municipale avait outrepassé ses pouvoirs. Le tribunal jugea que le contrat de vente passé entre la direction municipale et Mme G. avait été conclu en violation de la procédure applicable. En conséquence, le tribunal annula le contrat de vente passé entre la direction municipale et Mme G. ainsi que celui conclu entre Mme G. et M. Semenov, ordonna la radiation de la mention du droit de propriété de M. Semenov sur la parcelle n° 24 et la réintégration de celle-ci dans le patrimoine municipal d’Omsk. M. Semenov contesta ce jugement devant la cour régionale d’Omsk qui rejeta son appel. Ses pourvois en cassation, puis devant la Cour suprême essuyèrent des refus. Après l’introduction de la requête devant la Cour, la mention du droit de propriété de M. Semenov sur la parcelle n° 24 fut rayée du registre unifié. M. Semenov demanda à la direction municipale d’effectuer un redécoupage des terrains (????????????????? ??????) aux fins d’augmenter la superficie de sa propre parcelle n° 23. Par un jugement rendu le 18 février 2016, le tribunal ordonna à la direction municipale de procéder au redécoupage demandé. En application de ce jugement, deux parcelles nouvellement issues de ce redécoupage furent inscrites au cadastre sous de nouveaux numéros. En août 2016, la direction municipale et M. Semenov conclurent un acte par lequel M. Semenov devint propriétaire d’une des nouvelles parcelles à destination de construction d’un bâtiment à usage individuel avec terrain attenant, pouvant être utilisé pour le jardinage. Le jugement du 30 avril 2014 ne fut pas exécuté dans la partie relative à la réintégration de la parcelle n° 24 dans le patrimoine municipal.
Article 1 du Protocole n° 1
La Cour estime que l’annulation du droit de propriété du requérant s’analyse en une « privation de propriété » et note qu’il ne fait pas controverse entre les parties que la mesure litigieuse répondait à un but d’utilité publique. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsqu’une personne acquiert un bien immobilier, elle doit faire preuve de vigilance au cas où des indices évidents pointent vers des fraudes commises en amont de la chaîne des transmissions de propriété. En même temps, le principe de « bonne gouvernance » exige que les autorités agissent en temps utile et de façon correcte et cohérente, dans tous les cas où, corrigeant leurs propres erreurs, elles se trouvent amenées à porter atteinte au droit au respect des biens. En ce qui concerne le comportement des autorités dans la présente affaire, la Cour relève que les autorités fédérales ont inscrit la parcelle litigieuse (n° 24) au cadastre en tant que destinée au maraîchage, et qu’elles ont enregistré le droit de propriété de Mme G., puis du requérant sur cette parcelle sans déceler d’irrégularités. Par ailleurs, l’enregistrement du droit de propriété immobilière est un acte juridique valant reconnaissance de ce droit par l’Etat, et l’autorité chargée de l’enregistrement avait le pouvoir de rejeter la demande d’enregistrement au cas où elle n’aurait pas été certaine du pouvoir de disposition du cédant. Au moment de l’enregistrement du droit de propriété de Mme G., cette autorité aurait pu détecter l’excès de pouvoir commis par la direction municipale en réalisant une expertise des documents présentés par Mme G. En ce qui concerne les autorités locales, la Cour observe en outre que la direction de la gestion du patrimoine municipal a adopté plusieurs actes qui validaient la vente de la parcelle à Mme G. aux fins de maraîchage. Elle estime donc que les autorités n’ont pas agi en temps utile et avec cohérence. La Cour considère que les juridictions internes n’ont pas procédé à une mise en balance des intérêts publics et privés concurrents. Elles se sont bornées à considérer qu’il était interdit de créer en ville des parcelles destinées au maraîchage et à en déduire que la ville d’Omsk avait été dépossédée de la parcelle contre sa volonté. En particulier, les tribunaux n’ont pas envisagé la possibilité de protéger le droit de propriété du requérant en l’absence de raisons impératives de réintégrer la parcelle en cause dans le patrimoine municipal. Enfin, la Cour observe que le procureur a engagé l’action en revendication presque quatre ans après l’achat de la parcelle par le requérant. Ainsi, en prenant pour point de départ du délai de prescription la fin des vérifications faites par le procureur, les juridictions internes ont en l’espèce privé d’effet réel les règles de prescription établies par la loi et ont donné un avantage disproportionné aux autorités. Une telle approche des tribunaux rend les actions en revendication virtuellement imprescriptibles et contribue à créer une insécurité juridique sur le marché de l’immobilier. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour note que selon le code de l’urbanisme, les activités d’horticulture sont possibles dans les zones résidentielles et tient la différence assez subtile entre les activités de maraîchage et d’horticulture. Aussi, compte tenu de la permission légale et du comportement des autorités, en l’absence de tout autre motif permettant d’incliner vers la mauvaise foi ou la négligence du requérant, la Cour estime que l’intéressé a pu légitimement croire qu’en achetant la parcelle, il agissait conformément à la loi et qu’il était juridiquement en sécurité. La Cour note qu’après l’annulation du droit de propriété du requérant sur la parcelle litigieuse, à l’issue de la procédure de redécoupage des terrains, l’intéressé a pu racheter une partie de cette parcelle et a conservé la possession sans droit ni titre de l’autre partie, à présent propriété municipale, enregistrée sous un autre numéro cadastral. Ces faits, ainsi que le manquement de la ville d’Omsk à demander l’exécution forcée du jugement du 30 juin 2014 dans le délai légal de trois ans ont compromis la réintégration de la parcelle dans le patrimoine municipal. Il en découle, premièrement, que la réintégration de la parcelle dans le patrimoine municipal ne constituait pas un impératif public absolu ni peut-être même une nécessité, et deuxièmement, que le requérant a dû supporter des conséquences négatives réelles en raison de l’ingérence portée dans le droit au respect de ses biens. La Cour conclut que les autorités internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt public et la nécessité de protéger le droit de propriété du requérant auquel elles ont fait supporter une charge exorbitante. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
CEDH
a) Sur la nature de l’ingérence
53. Le droit de propriété du requérant sur la parcelle a été annulé un peu plus de quatre ans après l’achat de cette parcelle. La Cour observe il s’agit d’un contentieux opposant le requérant – particulier – à la collectivité publique (voir, a contrario, Kanevska c. Ukraine (déc.), no 73944/11, 17 novembre 2020, s’agissant d’un litige purement privé). Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’annulation rétroactive d’un titre de propriété valide constitue une privation de propriété, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Turgut et autres c. Turquie, no 1411/03, §§ 87-88, 8 juillet 2008, Satir c. Turquie, no 36192/03, § 31, 10 mars 2009, Silahyürekli c. Turquie, no 16150/06, § 33, 26 novembre 2013, Maksymenko et Gerasymenko c. Ukraine, no 49317/07, § 50, 16 mai 2013, Vukušic c. Croatie, no 69735/11, § 50, 31 mai 2016, avec les références qui y sont citées, et Bidzhiyeva c. Russie, no 30106/10, § 61, 5 décembre 2017). Elle ne voit aucune raison de conclure autrement en l’espèce. Ainsi, elle estime que l’annulation du droit de propriété du requérant s’analyse en une « privation de propriété ».
b) Sur la justification de l’ingérence
54. La Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle, pour être conforme à l’article 1 du Protocole no 1, toute mesure doit être opérée « dans les conditions prévues par la loi », poursuivre un but d’utilité publique et être proportionnée à ce but, c’est-à-dire ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit de l’individu au respect de ses biens.
55. Le requérant soutient que l’ingérence litigieuse n’était pas légale, pour deux raisons. Premièrement, il affirme que contrairement à ce qu’ont conclu les tribunaux russes, la ville d’Omsk avait bien exprimé sa volonté de disposer de la parcelle no 24, et que dès lors, il était juridiquement impossible de réintégrer cette parcelle dans le patrimoine municipal en vertu de l’article 302 du code civil. Deuxièmement, il estime que l’action engagée par le procureur aurait dû être rejetée pour cause de prescription.
56. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » (Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 95, 25 octobre 2012).
57. En l’espèce, eu égard en particulier à l’application de l’article 302 du code civil et des règles de la prescription par les tribunaux, elle demeure dubitative quant au point de savoir si la mesure litigieuse peut passer pour avoir été opérée « dans les conditions prévues par la loi ». Toutefois, rappelant qu’elle ne dispose que d’une compétence limitée pour contrôler le respect du droit interne, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que la mesure méconnaît l’article 1 du Protocole no 1 pour d’autres raisons (paragraphes 60 et suivants ci-dessous ; voir, pour une approche similaire, Vistinš et Perepjolkins, précité, § 105, et Pchelintseva et autres c. Russie, nos 47724/07 et 4 autres, § 95, 17 novembre 2016).
58. La Cour note ensuite qu’il ne fait pas controverse entre les parties que la mesure litigieuse répondait à un but d’utilité publique, à savoir la gestion des terrains par les autorités et le respect des règles d’urbanisme.
1) Les principes généraux relatifs à la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect des biens
59. La Cour rappelle que la proportionnalité de l’ingérence implique l’existence d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à supporter « une charge spéciale et exorbitante ». La vérification de l’existence d’un juste équilibre exige un examen global des différents intérêts en jeu. Les aspects examinés par la Cour varient d’une affaire à une autre et dépendent des faits et de l’ingérence en cause. Dans son analyse de la proportionnalité, outre le comportement des autorités, la Cour examine souvent l’attitude du propriétaire, notamment le degré de faute ou de prudence dont il a fait preuve (AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, § 54, série A no 108, et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 301, 28 juin 2018). Plus particulièrement, lorsqu’une personne acquiert un bien immobilier, elle doit faire preuve de vigilance au cas où des indices évidents pointent vers des fraudes commises en amont de la chaîne des transmissions de propriété. La Cour examine également les conséquences de l’ingérence pour le requérant et, en cas de privation de propriété, le point de savoir s’il a été indemnisé et selon quelles modalités (Turgut et autres, précité, § 91, et les références qui y sont citées). Elle rappelle à cet égard que lorsque, en corrigeant leurs propres erreurs, les autorités se trouvent amenées à porter atteinte au droit au respect des biens, le principe de la bonne gouvernance (good governance) exige qu’elles agissent en temps utile et de façon correcte et cohérente (voir, par exemple, Osipkovs et autres c. Lettonie, no 39210/07, § 80, 4 mai 2017, Beinarovic et autres c. Lituanie, nos 70520/10 et 2 autres, §§ 138-139, 12 juin 2018, et, dernièrement, Maltsev et autres c. Russie, nos 77335/14 et 2 autres, § 32, 17 décembre 2019), et qu’elles veillent aussi à ne pas corriger ce type d’erreurs au détriment du particulier concerné, surtout en l’absence d’un autre intérêt privé qui irait dans le sens contraire (voir, mutatis mutandis, Gladysheva c. Russie, no 7097/10, § 80, 6 décembre 2011, et Beinarovic et autres, précité, § 140, et les références qui y sont citées).
2) Le comportement des autorités dans la présente affaire
60. La Cour relève que les autorités fédérales ont inscrit la parcelle litigieuse au cadastre en tant que parcelle destinée au maraîchage, et ont enregistré le droit de propriété de Mme G. puis du requérant sur celle-ci sans déceler d’irrégularités.
61. Or le service du cadastre était compétent pour rejeter la demande d’inscription cadastrale si les informations soumises étaient contradictoires ou incomplètes et si les documents présentés ne satisfaisaient pas aux exigences légales ou si la parcelle créée n’était pas en conformité avec les dispositions légales applicables notamment en matière d’urbanisme (paragraphes 34-35 ci-dessus).
62. Par ailleurs, l’enregistrement du droit de propriété immobilière était, et reste à ce jour, un acte juridique valant reconnaissance par l’État du droit en question, effectué après une « expertise juridique » des documents présentés à cette fin, et l’autorité chargée de l’enregistrement avait le pouvoir de rejeter la demande d’enregistrement si elle n’était pas certaine du pouvoir de disposition du cédant (paragraphes 30-33 ci-dessus). Certes, il peut être admis que lorsqu’elle a traité la demande d’enregistrement du droit de propriété du requérant, l’autorité chargée de l’enregistrement, n’ayant à sa disposition que le contrat de vente, ne pouvait pas vérifier si la direction municipale avait agi en excès de pouvoir (voir, mutatis mutandis, Zhidov et autres c. Russie, nos 54490/10 et 3 autres, § 101, 16 octobre 2018, et Kvyatkovksiy c. Russie (déc.), no 6390/18, § 31, 18 octobre 2018). En revanche, avant cela, au moment de l’enregistrement du droit de propriété de Mme G., cette autorité aurait pu détecter l’excès de pouvoir commis par la direction municipale, en réalisant une « expertise juridique » des documents que Mme G. avait présentés. Or, la présence d’un tel excès de pouvoir constituait un obstacle à l’enregistrement du droit de propriété de la venderesse du requérant, en amont à l’achat de la parcelle par lui.
63. Quant aux autorités locales, la Cour observe que la direction de la gestion du patrimoine municipal – une entité de la municipalité – a adopté plusieurs actes qui validaient la vente de la parcelle à Mme G. aux fins de maraîchage : le plan parcellaire, trois décisions municipales et le contrat de vente (paragraphes 6, 7 et 9 ci-dessus). Elle considère que ces actes témoignaient de la volonté de la ville d’être dépossédée de cette parcelle, au sens de l’article 302 du code civil. Elle estime que la ville d’Omsk, en tant que collectivité publique, ne pouvait pas se prévaloir des particularités de son organisation institutionnelle pour exciper d’une absence de volonté de disposer du bien, et que, par conséquent, les questions tenant à la répartition des compétences entre les différentes entités municipales et régionales étaient sans incidence sur cette volonté apparente (voir, mutatis mutandis, Hamer c. Belgique, no 21861/03, § 76, CEDH 2007-V (extraits).
64. La Cour considère ainsi qu’en agissant de la sorte, les autorités fédérales et locales ont, d’un côté, manqué à leur devoir d’agir en temps utile et avec diligence, et, d’un autre côté, ont validé l’affectation de la parcelle au maraîchage et la licéité des transactions dont celle-ci a fait l’objet et ont exprimé la volonté de disposer de ce bien.
65. En outre, en appliquant l’article 302 du code civil à l’action en revendication engagée par le procureur, les juridictions internes n’ont pas procédé à une mise en balance des intérêts concurrents, publics et privés, contrairement aux exigences conventionnelles : elles se sont bornées à considérer qu’il était interdit de créer en ville des parcelles destinées au maraîchage et à en déduire que la ville d’Omsk avait été dépossédée de la parcelle contre sa volonté. En particulier, les tribunaux n’ont pas envisagé la possibilité de protéger le droit de propriété du requérant en l’absence de raisons impératives de réintégrer la parcelle dans le patrimoine municipal (sur l’absence de telles raisons, voir paragraphe 71 ci-dessous).
66. Enfin, la Cour observe que le procureur a engagé l’action en revendication presque quatre ans après l’achat de la parcelle par le requérant, après que l’intéressé eut déjà exploité celle-ci et y eut installé certains ouvrages. Or il appartient à ce représentant de l’État d’apprécier l’opportunité de mener ces vérifications et d’engager les poursuites lesquelles peuvent être menées sur plusieurs années, voire décennies. Ainsi, de l’avis de la Cour, en prenant pour point de départ du délai de prescription la fin des vérifications faites par le procureur, les juridictions internes ont en l’espèce privé d’effet réel les règles de prescription établies par la loi et ont donné un avantage disproportionné aux autorités (comparer avec Zouboulidis c. Grèce (no 2), no 36963/06, §§ 32 et 35, 25 juin 2009). Plus généralement, de l’avis de la Cour, une telle approche des tribunaux rend les actions en revendication virtuellement imprescriptibles et contribue à créer une insécurité juridique sur le marché de l’immobilier.
3) Le comportement du requérant dans la présente affaire
67. La Cour note que la juridiction d’appel a considéré que le requérant aurait dû savoir que la zone entourant sa maison était une zone résidentielle où les parcelles ne pouvaient pas être exploitées pour des activités de maraîchage. Elle note en même temps que, selon l’article 35 du code de l’urbanisme, les activités d’horticulture sont possibles dans les zones résidentielles (paragraphe 29 ci-dessus). Elle est d’avis que la différence entre les activités de maraîchage et les activités d’horticulture est plutôt subtile.
68. Aussi, compte tenu de la permission légale précitée et du comportement des autorités (paragraphes 60-64 ci-dessus), et en l’absence de tout autre motif permettant de penser que le requérant a été de mauvaise foi ou négligent (voir, en particulier, le droit applicable en la matière, paragraphes 38-41 ci-dessus), la Cour estime que l’intéressé a pu légitimement croire qu’en achetant la parcelle, il agissait conformément à la loi et était juridiquement en sécurité. Elle note par ailleurs que le juge unique de la cour régionale d’Omsk a confirmé la bonne foi de l’intéressé (paragraphe 19 ci-dessus).
69. Enfin, pour ce qui est de l’argument du Gouvernement consistant à dire que le requérant n’a pas saisi l’opportunité de demander à Mme G. le remboursement du prix qu’il lui avait payé, la Cour constate que c’étaient les autorités qui étaient à l’origine de l’ingérence, et non Mme G., dont la bonne foi n’a jamais été remise en question. En outre, elle n’exclut pas que, à la date du prononcé du jugement annulant son droit de propriété, le requérant fût déjà forclos à exercer une action en indemnisation contre sa venderesse. Dans ces conditions, elle estime qu’il serait excessif d’exiger de lui qu’il engage une nouvelle procédure marquée par une totale incertitude quant à une chance raisonnable de succès et dont le Gouvernement n’a pas démontré l’effectivité pratique, et que, par ailleurs, faire porter le fardeau par un autre particulier de bonne foi n’aiderait pas à restaurer l’équilibre voulu (Gladysheva, précité, § 81, et Zhidov et autres, précité, §§ 111-113, avec les références citées).
4) Les faits survenus après l’annulation du droit de propriété du requérant
70. Après l’annulation du droit de propriété du requérant sur la parcelle litigieuse, à l’issue de la procédure de redécoupage des terrains, l’intéressé a pu racheter une partie de cette parcelle moyennant un prix de plus de 3 600 EUR, et il a conservé la possession, sans droit ni titre, de l’autre partie de la parcelle, qui est à présent une propriété municipale, enregistrée sous un autre numéro cadastral. Ces faits, combinés avec le manquement de la ville d’Omsk à demander l’exécution forcée du jugement du 30 juin 2014 dans le délai légal de trois ans (paragraphe 45 ci-dessus), ont compromis la réintégration de la parcelle dans le patrimoine municipal.
71. La Cour estime que deux conclusions, contraires à ce que soutient le Gouvernement (paragraphe 52 ci-dessus), découlent de ce qui précède. D’une part, la réintégration de la parcelle dans le patrimoine municipal ne constituait pas un impératif public absolu, et n’était peut-être pas nécessaire du tout. D’autre part, le requérant a dû supporter des conséquences négatives réelles en raison de l’ingérence portée dans son droit au respect de ses biens.
72. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, la Cour conclut que les autorités internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt public et la nécessité de protéger le droit de propriété du requérant, et qu’elles ont fait supporter à l’intéressé une charge exorbitante.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Seregin et autres c. Russie du 16 mars 2021 requêtes n o 31686/16, n° 45709/16, n° 50002/16, n° 3706/18, n° 24206/18
Art 1 du Protocole 1 : Annulation de titres de propriété privée sur des terrains au profit des municipalités : violation des droits à la protection de la propriété des requérants
L’affaire concerne l’annulation par les tribunaux, au profit de municipalités, des titres de propriété des requérants au motif que les transferts initiaux de propriété – les privatisations – avaient été illicites. La Cour observe que le système légal et administratif russe d’enregistrement de la propriété foncière, tel qu’il était en vigueur dans les années 1990-2000, comportait des lacunes. Il ne permettait pas de retracer l’historique d’une parcelle de terrain donnée, de déterminer l’identité des précédents propriétaires, et parfois même, en l’absence d’arpentage, d’en établir l’emplacement et les limites. Ce système favorisait les fraudes dans le domaine foncier. Par ailleurs, l’autorité chargée de l’enregistrement réalisait une « expertise juridique » des documents présentés, et se trouvait compétente pour rejeter la demande d’enregistrement si elle n’était pas certaine du pouvoir de disposition du cédant. De son côté, le service du cadastre avait le pouvoir de rejeter la demande d’inscription cadastrale si les informations soumises étaient contradictoires ou incomplètes ou si les documents ou les parcelles créées ne satisfaisaient pas aux exigences légales. Par ailleurs, que les administrations municipales chargées du contrôle municipal foncier disposaient des instruments juridiques et des moyens factuels pour se rendre compte, en temps utile, qu’elles perdaient la propriété et la possession des parcelles litigieuses et pouvaient alors empêcher les reventes des parcelles. La Cour conclut que les requérants, n’ayant commis aucune faute, ont dû subir les conséquences de faits imputables exclusivement au système interne, aux autorités et à des tiers. Ils n’ont reçu aucune indemnisation pour la privation de leurs biens et le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt public et la nécessité de protéger le droit de propriété des requérants a été rompu.
Art 1 P1 • Annulation des titres de propriété sur des parcelles de terrain acquises auprès de tiers et réintégration de celles-ci dans le patrimoine municipal • Absence de faute des requérants ayant subi les conséquences de faits imputables exclusivement au système interne, aux autorités et à des tiers, et de l’application rigide des dispositions sur la revendication • Absence d’indemnisation • Juste équilibre rompu au détriment des requérants
CEDH
a) Sur la nature de l’ingérence
89. En l’espèce, le droit de propriété des requérants sur les parcelles a été annulé quelques années après les acquisitions de ces parcelles. La Cour observe d’emblée il s’agit d’un contentieux opposant les requérants – particuliers – aux collectivités publiques (voir, a contrario, Kanevska c. Ukraine (déc.), no 73944/11, 17 novembre 2020, s’agissant d’un litige purement privé). Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’annulation rétroactive d’un titre de propriété valide constitue une privation de propriété, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Turgut et autres c. Turquie, no 1411/03, §§ 87-88, 8 juillet 2008, Satir c. Turquie, no 36192/03, § 31, 10 mars 2009, Silahyürekli c. Turquie, no 16150/06, § 33, 26 novembre 2013, Maksymenko et Gerasymenko c. Ukraine, no 49317/07, § 50, 16 mai 2013, Vukušic c. Croatie, no 69735/11, § 50, 31 mai 2016, avec les références qui y sont citées, et Bidzhiyeva c. Russie, no 30106/10, § 61, 5 décembre 2017). Elle ne voit aucune raison de conclure autrement en l’espèce. Ainsi, elle estime que l’annulation des droits de propriété des requérants s’analyse en une « privation de propriété ».
b) Sur la justification de l’ingérence
90. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, pour être conforme à l’article 1 du Protocole no 1, toute mesure doit être mise en œuvre « dans les conditions prévues par la loi », poursuivre un but d’utilité publique et être proportionnée à ce but, c’est-à-dire ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit de l’individu au respect de ses biens.
91. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » (Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 95, 25 octobre 2012).
92. En l’espèce, eu égard en particulier à l’application de l’article 302 du code civil et des règles de la prescription par les tribunaux, elle demeure dubitative quant au point de savoir si la mesure litigieuse peut passer pour avoir été opérée « dans les conditions prévues par la loi ». Toutefois, rappelant qu’elle ne dispose que d’une compétence limitée pour contrôler le respect du droit interne, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que la mesure méconnaît l’article 1 du Protocole no 1 pour d’autres raisons (paragraphes 95 et suivants ci-dessous ; voir, pour une approche similaire, Vistinš et Perepjolkins, précité, § 105, et Pchelintseva et autres c. Russie, nos 47724/07 et 4 autres, § 95, 17 novembre 2016).
93. La Cour estime ensuite que la mesure en question répondait à un but d’utilité publique, à savoir la gestion des terrains par les autorités municipales.
1) Les principes généraux relatifs à la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect des biens
94. La Cour rappelle que la proportionnalité de l’ingérence implique l’existence d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à supporter « une charge spéciale et exorbitante ». La vérification de l’existence d’un juste équilibre exige un examen global des différents intérêts en jeu. Les aspects examinés par la Cour varient d’une affaire à une autre et dépendent des faits et de l’ingérence en cause. Dans son analyse de la proportionnalité, outre le comportement des autorités, la Cour examine souvent l’attitude du propriétaire, notamment le degré de faute ou de prudence dont il a fait preuve (AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, § 54, série A no 108, et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 301, 28 juin 2018). Plus particulièrement, lorsqu’une personne acquiert un bien immobilier, elle doit faire preuve de vigilance au cas où des indices évidents pointent vers des fraudes commises en amont de la chaîne des transmissions de propriété. La Cour examine également les conséquences de l’ingérence pour le requérant et, en cas de privation de propriété, le point de savoir s’il a été indemnisé et selon quelles modalités (Turgut et autres, précité, § 91, et les références qui y sont citées). Elle rappelle à cet égard que lorsque, en corrigeant leurs propres erreurs, les autorités se trouvent amenées à porter atteinte au droit au respect des biens, le principe de la bonne gouvernance (good governance) exige qu’elles agissent en temps utile et de façon correcte et cohérente (voir, par exemple, Osipkovs et autres c. Lettonie, no 39210/07, § 80, 4 mai 2017, Beinarovic et autres c. Lituanie, nos 70520/10 et 2 autres, §§ 138-139, 12 juin 2018, et, dernièrement, Maltsev et autres c. Russie, nos 77335/14 et 2 autres, § 32, 17 décembre 2019), et qu’elles veillent aussi à ne pas corriger ce type d’erreurs au détriment du particulier concerné, surtout en l’absence d’un autre intérêt privé qui irait dans le sens contraire (voir, mutatis mutandis, Gladysheva c. Russie, no 7097/10, § 80, 6 décembre 2011, et Beinarovic et autres, précité, § 140, et les références qui y sont citées).
2) Le comportement des autorités agissant dans le cadre du système légal et administratif interne
95. Avant de se pencher sur le comportement des autorités internes, la Cour examinera le système légal et administratif russe en vigueur dans les années 1990-2000.
96. Ce système, qui est au cœur de la présente affaire, était le suivant. À partir des années 1990, les personnes physiques eurent la possibilité de devenir propriétaires de terrains. Or, jusqu’en 1997, il n’existait pas en Russie de registre unifié recensant les titres de propriété foncière. De plus, même après 1997, l’enregistrement des droits de propriété nés avant 1998 n’était pas une obligation mais une simple possibilité ouverte aux titulaires de ces droits. L’enregistrement du droit de propriété immobilière était, et reste à ce jour, un acte juridique valant reconnaissance par l’État du droit en question, effectué après une « expertise juridique » des documents présentés à cette fin. Cependant, dans le cas du droit de propriété portant sur des parcelles octroyées à des fins de construction individuelle ou d’agriculture vivrière, l’enregistrement était réalisé selon une procédure simplifiée : pour l’obtenir, il suffisait de présenter l’acte délivré par l’autorité locale. L’absence d’arpentage ne faisait obstacle ni à l’inscription d’une parcelle au cadastre d’État ni à l’enregistrement du droit de propriété sur cette parcelle. Enfin, le procédé de « délimitation de la propriété foncière » n’a été introduit qu’en 2001, et il n’est toujours pas obligatoire actuellement (paragraphes 50-58 ci-dessus). Rien n’empêchait, dès lors, les administrations locales de disposer de terrains sans les avoir fait délimiter au préalable.
97. La Cour considère que ce système comportait des lacunes en ce qu’il entravait la possibilité de retracer l’historique d’une parcelle de terrain donnée, de déterminer qui en avaient été les précédents propriétaires, et parfois même, en l’absence d’arpentage, d’en établir l’emplacement et les limites (Karpov c. Russie [comité], no 53099/10, §§ 59-60, 30 juin 2020). Elle estime que ces lacunes facilitaient les fraudes en matière foncière (voir également, dans le même ordre d’idées, les considérations exposées dans le raisonnement de la Cour constitutionnelle, au paragraphe 69 ci-dessus).
98. Se tournant vers la présente affaire, elle observe qu’il n’y a pas eu de « délimitation de la propriété foncière » et qu’aucun droit de propriété municipal, régional ou fédéral n’a été enregistré sur les parcelles litigieuses. Par ailleurs, ces parcelles n’ont été arpentées et inscrites au cadastre d’État qu’entre 2007 et 2010, à l’initiative de personnes physiques – les premiers acquéreurs des terres.
99. La Cour note également que l’autorité chargée de l’enregistrement et le service du cadastre n’ont émis aucune objection quant aux parcelles litigieuses. Or la première de ces autorités réalisait une « expertise juridique » des documents présentés, et était compétente pour rejeter la demande d’enregistrement si elle n’était pas certaine du pouvoir de disposition du cédant (paragraphes 52 et 56 ci-dessus). De son côté, le service du cadastre avait le pouvoir de rejeter la demande d’inscription cadastrale si les informations soumises étaient contradictoires ou incomplètes ou si les documents ou les parcelles créées ne satisfaisaient pas aux exigences légales (paragraphes 59-61 ci-dessus).
100. Certes, il n’est pas toujours aisé d’identifier le caractère faux d’un document présenté comme étant authentique, même lors d’un contrôle documentaire. La Cour estime donc concevable que personne en l’espèce – ni les deux autorités susmentionnées, ni les notaires dans les requêtes nos 31686/16 et 45709/16, ni les autorités municipales – n’ait décelé de falsification des documents justificatifs du droit de propriété sur les parcelles, d’autant plus que dans la requête no 3706/18 un maire, un clerc de notaire et un fonctionnaire étaient impliqués dans les délits (paragraphes 36-37 ci-dessus).
101. En revanche, la Cour constate que les administrations municipales étaient chargées du contrôle municipal foncier (paragraphe 75 ci-dessus), de sorte qu’elles disposaient des instruments juridiques et des moyens factuels pour se rendre compte bien avant les vérifications du procureur ou l’ouverture des enquêtes pénales qu’elles avaient perdu la propriété et la possession des parcelles litigieuses et pour empêcher les reventes des parcelles. Ce constat s’impose plus particulièrement dans les affaires faisant l’objet des requêtes nos 31686/16 et 45709/16, dans lesquelles l’administration avait participé aux opérations d’arpentage des parcelles, et dans l’affaire objet de la requête no 50002/16, dans laquelle l’administration avait modifié l’affectation du terrain.
102. Par ailleurs, il est surprenant que, même après l’ouverture des enquêtes pénales dans les affaires faisant l’objet des requêtes nos 3706/18 et 24206/18, les autorités n’aient rien fait – par exemple, imposer des saisies provisoires sur les parcelles visées par ces procédures pénales ou interdire les transactions portant sur ces parcelles – pour empêcher les requérants d’acquérir de telles parcelles (voir, mutatis mutandis, Alentseva c. Russie, no 31788/06, § 75, 17 novembre 2016).
103. De l’avis de la Cour, en agissant dans ce cadre juridique lacunaire (paragraphe 97 ci-dessus) et en commettant les omissions relevées ci-dessus, les autorités ont manqué à leur devoir d’agir en temps utile et avec diligence.
104. En outre, en appliquant l’article 302 du code civil aux actions en revendication engagées par les autorités, les juridictions internes – qui ont pour la plupart admis la bonne foi des requérants (sur ce point, voir les paragraphes 108-110 ci-dessous) – n’ont pas procédé à une mise en balance des intérêts concurrents, publics et privés, contrairement aux exigences conventionnelles et aux préconisations de la Cour constitutionnelle (paragraphe 67 ci-dessus) : elles se sont bornées à constater que les transferts de propriété initiaux avaient été illicites et à en déduire automatiquement que les municipalités avaient été dépossédées des terrains contre leur volonté.
105. En particulier, les juridictions n’ont envisagé ni la possibilité de protéger le droit de propriété des requérants en l’absence de raisons impératives d’intérêt public de réintégrer les parcelles dans les patrimoines municipaux, ni la possibilité pour l’administration d’indemniser les défendeurs et, le cas échéant, de se retourner contre les personnes condamnées pénalement, en présence de telles raisons impératives (voir aussi, pour un raisonnement similaire, Pchelintseva et autres, précité § 99). Dès lors, la Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel certains des requérants n’ont pas formé d’action récursoire contre leurs cocontractants (paragraphe 88 ci-dessus).
106. Dans le même ordre d’idées, elle relève que, dans l’affaire de M. Afentyev (requête no 3706/18), les tribunaux n’ont pas mis en balance l’intérêt du requérant et de sa famille à vivre dans la maison construite sur la parcelle litigieuse avec l’intérêt de la municipalité à faire réintégrer cette parcelle dans le patrimoine municipal.
107. Enfin, en ce qui concerne les règles de prescription applicables aux actions en revendication, selon lesquelles les personnes morales ne peuvent pas être relevées de la prescription extinctive (paragraphe 73 ci-dessus), la Cour observe que les juridictions internes ont pris pour point de départ du délai de prescription tantôt la date des vérifications faites par le procureur tantôt celle de différents actes adoptés dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux fraudes foncières. Or il appartient au procureur d’apprécier l’opportunité d’effectuer ces vérifications et d’engager des poursuites, et une enquête pénale peut durer plusieurs années et s’enliser sans jamais aboutir à un jugement de condamnation. Cette approche des juridictions internes ne prend pas en compte les intérêts légitimes des acquéreurs de bonne foi et donne un avantage disproportionné aux autorités publiques (comparer avec Zouboulidis c. Grèce (no 2), no 36963/06, §§ 32 et 35, 25 juin 2009) car elle leur permet d’engager une action en revendication plusieurs années, voire plusieurs décennies, après la privatisation foncière, au détriment des personnes physiques – acquéreurs de bonne foi (en ce concerne l’appréciation de la bonne foi des requérants, voir infra). Plus généralement, elle contribue à créer une insécurité sur le marché de l’immobilier.
3) Le comportement des requérants
108. Dans les procédures qui ont donné lieu aux requêtes nos 31686/16, 45709/16, 50002/16 et 3706/18, il n’a jamais été allégué que les requérants eussent été de mauvaise foi ou négligents lors de l’achat des parcelles en question. En revanche, dans celle qui a donné lieu à la requête no 24206/18, la cour régionale de Krasnodar a jugé que la requérante n’avait pas démontré sa bonne foi. De l’avis de la Cour, il est difficile de souscrire à cette conclusion. En effet, la cour régionale n’a mentionné aucune action ou omission concrètes qui fût de nature à révéler une mauvaise foi ou une négligence de la part de la requérante, de nature à renverser la présomption de bonne foi (paragraphes 63, 65 et 66 ci-dessus).
109. La Cour ne décèle, eu égard au droit interne applicable en la matière et, en particulier, à la présomption de la bonne foi dans les relations juridiques (paragraphes 63-66 ci-dessus), aucun élément de nature à démontrer une négligence ou une mauvaise foi des requérants lors de l’achat des parcelles, ni aucune irrégularité qui leur serait imputable. Elle estime que les intéressés ont agi de bonne foi et que, disposant de moyens limités pour détecter d’éventuelles irrégularités susceptibles d’entacher l’acquisition des parcelles (paragraphe 69 ci-dessus), ils se sont légitimement fiés aux autorités, qui n’ont alors pas démenti par leur comportement le sentiment qu’ils avaient d’agir en conformité avec la loi et d’être juridiquement en sécurité.
110. La Cour observe enfin qu’il n’a jamais été allégué que les requérants eussent tenté de bénéficier d’un effet d’aubaine dû aux lacunes du système interne (paragraphe 97 ci-dessus). Or ce sont eux qui ont dû finalement supporter les conséquences de ces lacunes (comparer avec Ion Constantin c. Roumanie, no 38515/03, § 42, 27 mai 2010), des agissements frauduleux de tiers et des négligences et omissions des autorités (voir aussi, mutatis mutandis, Pchelintseva et autres, précité, § 98, et Alentseva, précité, § 77) ; et ni leur bonne foi ni le fait que la situation ne leur était pas imputable n’ont joué le moindre rôle dans les procédures internes (Zhidov et autres c. Russie, nos 54490/10 et 3 autres, § 110, 16 octobre 2018, avec les références qui y sont citées).
111. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants, qui n’avaient commis aucune faute, ont dû subir les conséquences de faits imputables exclusivement au système interne, aux autorités et à des tiers, et de l’application rigide des dispositions relatives à la revendication. En même temps, ils n’ont reçu aucune indemnisation pour la privation de leurs biens. Partant, le juste équilibre qui devait régner entre les exigences de l’intérêt public et la nécessité de protéger le droit de propriété des requérants a été rompu.
Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Kaynar et autres c. Turquie du 7 mai 2019 requêtes nos 21104/06, 51103/06 et 18809/07
Violation article 1 du Protocole 1 : Violation du droit de propriété, faute d’indemnisation : dorénavant, un recours devant la commission d’indemnisation permet d’obtenir un dédommagement
La Cour juge en particulier que la modification législative a privé les requérants de la possibilité d’obtenir le titre de propriété des terrains, alors qu’ils pouvaient légitimement croire qu’ils avaient satisfait à toutes les exigences qui leur auraient permis de se voir reconnaître la qualité de propriétaire. Elle juge aussi que les requérants, qui n’ont reçu aucune indemnité pour l’atteinte à leurs biens, ont dû supporter une charge individuelle exorbitante. La Cour juge aussi que le droit national permet dorénavant d’effacer les conséquences d’une telle violation. En effet, un recours devant la commission d’indemnisation, dont les compétences ont été élargies en mars 2019 par l’ordonnance présidentielle n o 809, permettra aux requérants d’obtenir une indemnisation. Estimant que ce recours représente un moyen approprié de redresser la violation constatée au regard de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la Cour décide donc de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’article 41 de la Convention.
Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).
La Cour juge que la durée des procédures (environ 10 ans), dans le cadre des requêtes introduites par deux requérantes, ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable. Elle accorde à ces requérantes une satisfaction équitable pour le dommage moral subi.
LES FAITS
En 1993 et 1995, les requérants achetèrent des terrains situés sur l’île de Gökçeada. Ces terrains étaient classés « sites naturels » et ne faisaient l’objet d’aucun titre de propriété. En 1996, lors de la réalisation des travaux cadastraux, ces terrains furent enregistrés au nom du Trésor public. La même année, les requérants saisirent le tribunal cadastral de Gökçeada en vue d’obtenir l’inscription des terrains à leur nom au registre foncier en application des règles relatives à la prescription acquisitive. En 1999, le tribunal fit droit à leur demande, considérant que les conditions de la prescription acquisitive étaient réunies. Ce jugement fut infirmé par la Cour de cassation, qui estima que les juges de fond n’avaient pas dûment recherché si les terrains litigieux étaient des pâturages, lesquels ne pouvaient pas faire l’objet d’une prescription acquisitive dans un tel cas. En 2004, alors que la procédure devant le tribunal cadastral était en cours, la loi relative à la protection du patrimoine culturel et naturel fut modifiée. Ainsi, les terrains classés « sites naturels » ne pouvaient plus s’acquérir par le jeu de la prescription acquisitive. En conséquence, le tribunal débouta les requérants et ordonna l’inscription des terrains litigieux au nom du Trésor public.
LA CEDH
a) Sur l’existence d’un bien
32. La Cour note que les parties ont des vues divergentes quant à la question de savoir si les requérants étaient ou non titulaires d’un bien susceptible d’être protégé par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Par conséquent, elle est appelée à déterminer si la situation juridique dans laquelle se sont trouvés les requérants est de nature à relever du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
33. S’agissant de la portée autonome de la notion de « bien », la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Iatridis c. Grèce [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH 1999-II, et Beyeler c. Italie [GC], nº 33202/96, § 100, CEDH-2000-I). Il importe donc d’examiner, dans chaque affaire soumise à son examen, si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention. Dans cette optique, la Cour estime qu’il y a lieu de tenir compte des éléments de droit et de fait suivants.
34. Elle rappelle que, en droit turc, l’inscription d’un bien immeuble au registre foncier est en principe le seul acte juridique constitutif du droit de propriété (Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi c. Turquie, nos 37639/03 et 3 autres, § 42, 3 mars 2009, et Ipseftel c. Turquie, no 18638/05, § 50, 26 mai 2015). À cet égard, elle note qu’il n’est pas contesté que les requérants ne disposaient pas d’un titre de propriété inscrit au registre foncier. Elle observe cependant que, avant la modification législative, les requérants avaient obtenu un jugement de première instance en leur faveur (comparer avec Smokovitis et autres c. Grèce, no 46356/99, § 32, 11 avril 2002). En effet, elle note que, dans son jugement du 7 octobre 1999, le tribunal cadastral de Gökçeada, qui a tranché la cause en première instance, a conclu que les conditions d’acquisition de la propriété par prescription acquisitive étaient réunies. Elle note aussi que, pour établir que les requérants avaient réellement exercé une possession continue sur les terrains en cause, le tribunal a tenu compte d’un certain nombre d’éléments, comme les rapports des expertises agricoles, les déclarations des témoins et des experts locaux et techniques ainsi que des documents présentés par les parties ou recueillis d’office, dont les plans cadastraux et les registres des impôts et du cadastre relatifs aux biens en question (paragraphe 11 ci-dessus).
35. Quant à la Cour de cassation, la Cour constate que celle-ci, dans son arrêt rendu le 12 octobre 2001, a infirmé le jugement du 7 octobre 1999 au motif que les juges du fond n’avaient pas dûment recherché si les terrains litigieux étaient des pâturages, lesquels ne pouvaient pas faire l’objet d’une acquisition par prescription acquisitive. Elle observe que la Cour de cassation a aussi relevé que, selon les déclarations des témoins et des experts locaux, les requérants n’utilisaient plus le terrain depuis plusieurs années et qu’elle a estimé qu’il y avait lieu de rechercher si les intéressés avaient abandonné la possession et, dans l’affirmative, depuis combien de temps (paragraphe 12 ci-dessus).
36. La Cour constate que, lors de la procédure qui s’est déroulée après l’infirmation du jugement de première instance par la Cour de cassation, le tribunal a complété le dossier, conformément à la demande de la Cour de cassation. Il a ainsi établi avec certitude que les terrains litigieux n’étaient pas des pâturages (paragraphe 15 ci-dessus). Quant à la question de savoir si les terrains en question avaient réellement été utilisés par les requérants sans interruption, il ressort du dossier que le tribunal avait établi dans son premier jugement que, même si les terrains en question n’étaient pas cultivés depuis un certain temps, cela était dû au fait que du bétail y était élevé (paragraphe 11 ci-dessus). Par ailleurs, lors de la seconde phase de la procédure, les experts et les témoins ont confirmé la possession continue des biens en question par les requérants et aucun élément de fait donnant à penser que ceux-ci avaient abandonné ces biens n’a été identifié (paragraphe 13 ci-dessus).
37. Par conséquent, de l’avis de la Cour, avant l’intervention de la loi litigieuse, les requérants pouvaient prétendre avoir satisfait à toutes les exigences qui leur auraient permis de se voir reconnaître la qualité de propriétaire relativement aux biens immeubles qu’eux-mêmes ou leurs vendeurs possédaient depuis très longtemps. Ils avaient donc au moins une « espérance légitime » de voir se concrétiser leur créance, c’est-à-dire d’obtenir la reconnaissance effective d’un droit de propriété. La Cour estime que leurs prétentions à être déclarés propriétaires des terrains en question avaient une base suffisante en droit national pour être qualifiées de « valeurs patrimoniales » et donc de « biens » protégés par l’article 1 du Protocole no 1 (voir, notamment, Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal, 16 septembre 1996, § 75, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, Ipseftel, précité, §§ 56-57, et, mutatis mutandis, Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 35 et 52, CEDH 2004-IX, Maurice c. France [GC], no 11810/03, § 70, CEDH 2005-IX, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi, précité, § 50, et Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 143-144, 20 mars 2018).
b) Sur la nature de l’ingérence
38. Pour la Cour, le cas d’espèce présente des similitudes avec l’affaire Ipseftel précitée, qui concernait l’impossibilité pour la requérante d’obtenir le titre de propriété d’un bien immobilier, alors que son donateur avait satisfait à l’exigence de possession paisible et ininterrompue à titre de propriétaire pendant plus de vingt ans. Dans cette affaire, elle rappelle avoir considéré que les décisions judiciaires portant rejet des revendications de propriété de la requérante constituaient une « privation de propriété » au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Ipseftel, précité, § 62).
39. Par ailleurs, elle indique que, dans l’affaire Maurice précitée, où il était question d’une loi ayant supprimé avec effet rétroactif une partie substantielle des créances en réparation dont les requérants pouvaient légitiment espérer bénéficier, elle a considéré que ladite loi avait entraîné une ingérence dans l’exercice des droits de créance en réparation que l’on pouvait faire valoir en vertu du droit interne en vigueur jusqu’alors et, partant, du droit des requérants au respect de leurs biens. Elle a ainsi conclu que cette ingérence s’analysait en une « privation de propriété » au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Maurice, précité, §§ 79-80).
40. En l’espèce, la Cour estime opportun de suivre sa jurisprudence précitée. À cet égard, elle observe que, le 14 juillet 2004, l’article 11 de la loi no 2863 a été modifié de manière à étendre sa portée aux sites naturels. Elle estime que cette modification législative a privé les requérants de la possibilité d’obtenir le titre de propriété des biens en question, alors que, comme il a été expliqué ci-dessus (paragraphe 37), les intéressés pouvaient légitimement croire qu’ils avaient satisfait à toutes les exigences qui leur auraient permis de se voir reconnaître la qualité de propriétaire relativement aux biens immeubles qu’eux-mêmes ou leurs vendeurs possédaient depuis très longtemps. La Cour considère donc que la loi litigieuse a entraîné une ingérence dans l’exercice des droits de propriété que l’on pouvait faire valoir en vertu du droit interne en vigueur jusqu’alors et, partant, du droit des requérants au respect de leurs biens.
41. Dans ces conditions, force est de conclure que les décisions judiciaires portant rejet des revendications de propriété des requérants constituent une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Ipseftel, précité, § 62, Maurice, précité, § 80 ; voir aussi, mutatis mutandis, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 34, série A no 332, et Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italie, no 6154/11, § 63, 23 septembre 2014).
c) Sur la justification et la proportionnalité de l’ingérence
42. L’article 1 du Protocole no 1 à la Convention exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » ; le second alinéa reconnaît aux États le droit de réglementer l’usage des biens en mettant en vigueur des « lois ». De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III, et Iatridis, précité, § 58).
43. La Cour relève que l’ingérence est constituée par la législation entrée en vigueur en 2004 et par son application en l’espèce. Elle est donc convaincue que l’ingérence a satisfait à la condition de légalité énoncée dans la disposition précitée.
44. La Cour rappelle également que les autorités nationales disposent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer ce qui est « d’utilité publique » car, dans le système de la Convention, il leur appartient de se prononcer les premières tant sur l’existence de problèmes d’intérêt public justifiant des privations de propriété que sur les mesures à prendre pour les résoudre (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 37). En l’espèce, elle observe que, dans son jugement du 9 juin 2005, le tribunal a considéré que, par dérogation au principe de non-rétroactivité qui interdit normalement l’application d’une loi nouvelle à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, il convenait d’appliquer cette nouvelle modification législative à la procédure en question au motif qu’il s’agissait d’une question d’ordre public (paragraphe 15 ci-dessus).
45. À cet égard, aux yeux de la Cour, une simple référence à l’ordre public dans le jugement du tribunal de première instance ne suffit pas à justifier une telle application rétroactive d’une loi. Certes, la Cour dit être disposée à admettre que la modification législative a pour objectif de protéger l’environnement (voir, mutatis mutandis, Hamer c. Belgique, no 21861/03, § 79, CEDH 2007-V (extraits), et Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A., précité, § 67). Elle considère qu’il s’agirait certainement là d’un motif légitime, conforme à l’intérêt général. Cependant, elle se doit de noter que, le 22 mai 2007, c’est-à-dire après un délai de moins de trois ans, ladite loi a été à nouveau modifiée de manière à exclure tous les terrains classés en sites naturels – dont relèvent les biens litigieux – de son champ d’application (voir, mutatis mutandis, Agrati et autres c. Italie, nos 43549/08 et 2 autres, § 63, 7 juin 2011). Dorénavant, de même qu’au moment de l’introduction de l’instance en l’espèce, les terrains se trouvant dans les sites naturels peuvent s’acquérir par voie d’usucapion (paragraphe 21 ci-dessus). Par conséquent, pour la Cour, compte tenu de l’absence de toute information de quelque nature que ce soit sur la portée de l’application rétroactive de la modification législative en question, il est difficile de conclure qu’il existait une corrélation pratique entre la rétroactivité de la loi en cause, restée en vigueur moins de trois ans, et la protection de l’environnement en général.
46. En outre, la Cour rappelle qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure appliquée par l’État, y compris les mesures privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 38, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 93, CEDH 2006-V). Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le « juste équilibre » voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. Même si l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne garantit pas dans tous les cas le droit à une réparation intégrale (James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 54, série A no 98, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 182, CEDH 2004-V), sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive (Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A., précité, § 71).
47. La Cour observe que, comme il est déjà établi que l’ingérence litigieuse satisfaisait à la condition de légalité, une réparation non intégrale ne rendrait pas illégitime en soi la mainmise de l’État sur les biens des requérants. Cependant, comme dans l’affaire Ipseftel précitée (§ 67), elle constate que les requérants n’ont reçu aucune indemnité pour l’atteinte à leurs biens. Elle note que le Gouvernement n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence totale d’indemnisation.
48. La Cour estime donc que, même à supposer que l’ingérence litigieuse ait pour finalité de protéger l’environnement, une telle ingérence dans les droits des requérants n’est pas conciliable avec le juste équilibre à préserver entre les intérêts en jeu (voir, mutatis mutandis, Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 43) et il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés. Elle en conclut que, nonobstant la marge d’appréciation dont l’État dispose en la matière, les requérants ont dû supporter une charge individuelle exorbitante, ce qui a emporté violation de leurs droits protégés par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
ARTICLE 6-1
56. La Cour note que la période à considérer a commencé le 10 juin 1996 avec la saisine du tribunal et qu’elle s’est terminée le 6 juin 2006, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté la demande de rectification d’arrêt. La procédure a donc duré environ dix ans.
57. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier eu égard à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes ainsi qu’à l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 209, 27 juin 2017).
58. À la lumière de sa jurisprudence en la matière et compte tenu notamment de la durée qui s’était écoulée après l’infirmation du jugement de première instance par la Cour de cassation, elle considère que la durée totale de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
59. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
ÇATALTEPE c. TURQUIE du 19 février 2019 requête n° 51292/07
Violation de l'article 1 du Protocole 1 : Lors d'un remembrement, le requérant perd une partie de ses biens. La Cour relève que l’annulation du titre de propriété du requérant a été exclusivement justifiée par des faits imputables aux autorités, et que l’intéressé ne s’est pas vu verser une quelconque indemnité ou proposer un terrain équivalent. Partant, elle estime que le juste équilibre a été rompu et que le requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante par le fait d’avoir été privé de son droit de propriété sans contrepartie.
Article 1 du Protocole 1
43. Le requérant allègue que l’annulation, sans contrepartie, de son titre de propriété, ainsi que les limitations apportées à son droit de propriété concernant l’ensemble de ses parts ont enfreint son droit au respect de ses biens
49. Le requérant indique qu’il s’est retrouvé indivisaire de la parcelle litigieuse avec trois autres personnes, inconnues de lui, à la suite d’un remembrement urbain réalisé par les autorités. Il indique ensuite qu’il a acheté les parts de ces personnes sur ce bien lors d’une vente aux enchères réalisée en application d’une décision de justice définitive portant dissolution de l’indivision, et que l’inscription de son droit de propriété au registre foncier reposait donc sur une décision de justice définitive.
50. Le requérant ajoute que le Trésor public est intervenu dans la procédure relative à la dissolution de l’indivision et qu’il a eu la possibilité de défendre ses intérêts. Il dit que le tribunal d’instance ayant décidé la dissolution de l’indivision, en l’occurrence le 10e tribunal d’instance d’Ankara, n’a pas jugé utile d’accéder à la demande de sursis à statuer présentée par le Trésor public. Le requérant reproche à ce dernier d’avoir attendu près de quatre ans avant d’introduire une action en annulation du certificat d’héritier de Kazim Tiftikçi. Il estime que le Trésor public aurait dû engager une action en indemnisation contre Kazim Tiftikçi au lieu d’introduire une action en annulation de son titre de propriété.
51. Le requérant soutient qu’il n’était pas question d’une inscription irrégulière de son droit de propriété au registre foncier, et il argue que la Cour de cassation est allée au-delà de sa pratique et qu’elle a jugé qu’il devait payer pour des erreurs commises par le Trésor public et les juges du fond. Il dit que, à supposer que l’inscription eût été irrégulière, pour décider l’annulation de son titre de propriété, il aurait fallu établir sa mauvaise foi – ce qui d’après lui n’a pas été le cas. Le requérant affirme qu’il s’est retrouvé in fine privé de sa propriété, sans aucune contrepartie.
CEDH
56. L’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et d’assurer le paiement des amendes. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, entre autres, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999-II, et plus récemment, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 289, 28 juin 2018).
57. La Cour note que le requérant a acheté les parts litigieuses lors d’une vente aux enchères ordonnée par une décision de justice, et réalisée d’une manière strictement encadrée par les autorités. Ensuite, l’intéressé a fait inscrire son droit de propriété au registre foncier. Bien que ce titre de propriété ait été annulé par la suite, la Cour considère que le requérant disposait d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, en ce sens, Ahmet Nuri Tan et autres c. Turquie, no 18949/05, § 23, 31 mai 2011, et Gladysheva c. Russie, no 7097/10, § 69, 6 décembre 2011).
58. La Cour estime que l’annulation de l’inscription au registre foncier du droit de propriété du requérant a bien constitué une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de ses biens, et s’analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. En ce qui concerne la légalité de cette ingérence, ladite ingérence ayant résulté d’une décision judiciaire, la Cour est appelée à vérifier si la manière dont le droit interne a été interprété et appliqué par les juridictions internes a produit des effets conformes aux principes de la Convention. Pour déterminer si l’ingérence contestée cadrait avec le principe de légalité, elle doit se situer essentiellement par rapport à la motivation donnée à cet égard par les juridictions nationales pour conclure que l’inscription foncière était irrégulière et que le requérant était de mauvaise foi, en gardant à l’esprit que c’est aux juridictions nationales que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef (voir, par exemple, Wittek c. Allemagne, no 37290/97, § 49, CEDH 2002-X).
59. En l’espèce, la Cour ne peut que constater l’insuffisance de la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005, de sorte que cet arrêt ne permet guère d’identifier ni la disposition de loi ayant servi de fondement à la haute juridiction ni la jurisprudence appliquée au cas du requérant. Sans faire aucune mention à un texte de loi ou à une jurisprudence, et après un exposé lapidaire des procédures, la Cour de cassation a conclu à la hâte à l’irrégularité de l’inscription foncière et à la mauvaise foi du requérant, sans aucune explication (paragraphe 31 ci-dessus).
60. La Cour éprouve des difficultés à suivre la Cour de cassation dans son raisonnement. Elle estime nécessaire de rappeler ici le contexte de la présente affaire. En 1995, le requérant et deux autres indivisaires ont introduit une action en dissolution de l’indivision, étant donné que le quatrième et dernier indivisaire, Tiftikçi Dede, demeurait introuvable. Dans le cadre de la procédure ainsi engagée, un dénommé Kazim Tiftikçi s’est manifesté, affirmant qu’il était l’héritier de Tiftikçi Dede. L’intéressé a produit un certificat d’héritier que le tribunal d’instance de Beypazari lui avait délivré à la suite de la rectification de son registre d’état civil par une autre décision de justice. La qualité d’héritier de Kazim Tiftikçi a ainsi été reconnue par les juridictions nationales. Le 27 janvier 2000, le 10e tribunal d’instance, s’appuyant aussi sur ce certificat héritier, a prononcé la dissolution de l’indivision et la mise en vente du terrain par voie d’adjudication. Le tribunal n’a pas jugé utile d’attendre l’issue de l’action en annulation du certificat d’héritier introduite par le Trésor public, écartant ainsi la demande expresse de sursis à statuer formulée par ce dernier. La procédure d’adjudication a été menée par le service de l’exécution forcée, conformément à la décision de justice. Le requérant a acheté les parts litigieuses par le biais de la vente aux enchères réalisée sous le contrôle des autorités, et il a fait inscrire son droit de propriété dans le registre foncier.
61. La Cour note que l’examen des éléments du dossier ne révèle aucune irrégularité imputable au requérant. Rien ne permet de penser que celui-ci ait été, dans une quelconque mesure, à l’origine de l’annulation du certificat d’héritier de Kazim Tiftikçi ou de son titre de propriété. À cet égard, l’on ne saurait reprocher au requérant, comme le fait le Gouvernement, de n’être pas intervenu dans la procédure introduite par le Trésor public devant le 11e tribunal d’instance aux fins de l’annulation du certificat d’héritier de Kazim Tiftikçi, aux côtés de ce dernier. La Cour ne voit pas en quoi une telle intervention – à supposer qu’elle eût été acceptée – aurait permis de changer l’issue de cette procédure. Elle note du reste que le requérant n’a pas été assigné en intervention forcée dans cette procédure.
62. Dès le début de la procédure en dissolution de l’indivision, le requérant a demandé la désignation d’un agent de la trésorerie principale comme tuteur, pour la défense des intérêts du propriétaire indivis absent (paragraphe 8 ci-dessus). Lors de la dernière audience, en date du 27 janvier 2000, il a demandé le blocage de l’argent de la vente sur un compte bancaire, dans l’éventualité de la désignation du Trésor public comme héritier (paragraphe 12 ci-dessus). Pour la Cour, l’on ne saurait déduire la mauvaise foi du requérant du seul fait que celui-ci était représenté par la même avocate que Kazim Tiftikçi.
63. La Cour considère au contraire que l’annulation du titre de propriété du requérant a été exclusivement justifiée par des faits imputables aux autorités. Elle note ici que le 10e tribunal d’instance d’Ankara, alors qu’il était parfaitement au courant de l’action en annulation du certificat d’héritier introduite par le Trésor public, et malgré la demande expresse de sursis à statuer formulée par ce dernier, n’a pas jugé nécessaire d’attendre l’issue de l’action en question. Ce tribunal a prononcé la dissolution de l’indivision et la vente aux enchères du bien, alors qu’il lui était parfaitement loisible d’attendre l’issue de l’action introduite par le Trésor public.
64. La Cour note également que le 3e tribunal de grande instance a décidé d’inscrire une mesure conservatoire au registre foncier concernant l’ensemble des parts du requérant, tant sur celles que ce dernier avait achetées à l’indivisaire Tiftikçi Dede que sur celles qu’il détenait à l’origine, alors même que seules les parts achetées étaient objet de l’affaire. De même, le 30 juin 2005, ce même tribunal a annulé le titre de propriété du requérant dans son intégralité.
65. Quant au Trésor public, la Cour constate que celui-ci, bien qu’informé de la procédure en dissolution de l’indivision dès le début, a attendu plusieurs années avant de demander à être désigné comme héritier. Elle note également qu’il n’est pas intervenu dans la procédure introduite par Kazim Tiftikçi devant le tribunal d’instance de Beypazari, alors qu’une telle intervention lui aurait permis de contester à temps la qualité d’héritier de celui-ci. Par ailleurs, comme le requérant le fait remarquer, le Trésor public aurait aussi pu demander l’application d’une saisie conservatoire sur l’argent de la vente.
66. Pour la Cour, l’approche de la Cour de cassation dans la présente affaire dénote une volonté de protéger l’intérêt du Trésor public au détriment de celui du requérant, cette haute juridiction ayant essayé de faire supporter à ce dernier l’entière responsabilité de faits imputables exclusivement aux autorités.
67. La Cour note en outre que la présente affaire diffère sensiblement des affaires citées par le Gouvernement quant à la matière concernée. Dans les affaires en question, des héritiers avaient fait inscrire des terrains à leur nom au registre foncier en tant que propriétaires de première main grâce à des certificats d’héritiers frauduleux, en ce sens qu’ils avaient sciemment tenu à l’écart d’autres héritiers, puis ils avaient vendu ces biens à d’autres personnes qui étaient en mesure d’avoir connaissance de cette irrégularité. Les affaires citées par le Gouvernement ne sauraient donc être pertinentes dans l’examen de la présente affaire.
68. Aussi la Cour considère-t-elle que de sérieux doutes surgissent quant à la prévisibilité pour le requérant de l’annulation de son titre de propriété. Toutefois, elle juge qu’il ne s’impose pas ici de trancher cette question, l’ingérence litigieuse n’étant de toute façon pas proportionnée, pour les raisons exposées ci-après.
69. S’agissant donc de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour rappelle à cet égard qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par une mesure privant une personne de sa propriété (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 93, CEDH 2006-V).
70. La Cour rappelle aussi avoir déjà examiné dans d’autres affaires la question de l’annulation par les tribunaux internes, après plusieurs années, de titres de propriété délivrés par les autorités ou de contrats de vente conclus avec celles-ci. Elle a toujours pris en compte, en tant que critères essentiels dans l’examen de la proportionnalité de la privation, la question de la responsabilité des parties dans l’irrégularité sanctionnée par l’annulation du titre et le caractère essentiel ou au contraire plutôt mineur de cette irrégularité (voir, entre autres, Ion Constantin c. Roumanie, no 38515/03, § 43, 27 mai 2010, et les références qui y figurent).
71. La Cour rappelle également le principe selon lequel les erreurs commises par les autorités publiques doivent profiter à la personne concernée, spécialement quand aucun autre intérêt privé n’est en jeu. En d’autres termes, le risque de toute erreur de la part d’une autorité publique doit être supporté par l’État et aucune erreur ne doit être réparée au détriment de la personne concernée (Gashi c. Croatie, no 32457/05, § 40, 13 décembre 2007, et Gladysheva, précité, § 80).
72. Or, en l’espèce, la Cour relève que l’annulation du titre de propriété du requérant a été exclusivement justifiée par des faits imputables aux autorités, et que l’intéressé ne s’est pas vu verser une quelconque indemnité ou proposer un terrain équivalent. Partant, elle estime que le juste équilibre a été rompu et que le requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante par le fait d’avoir été privé de son droit de propriété sans contrepartie. Pour la Cour, cette charge a été aggravée par l’impossibilité pour le requérant de disposer librement, pendant plusieurs années, des parts qu’il détenait à l’origine.
73. Partant, la Cour rejette les exceptions du Gouvernement et conclut à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
BASA c. TURQUIE du 15 janvier 2019 requêtes n° 18740/05 et 19507/05
Non violation de l'article 1 du Protocole 1 : Le Trésors Public a déclaré que des surfaces lui appartenait alors que les requérants considèrent qu'elles sont leur propriété. La Cour de Cassation a rendu une décision arbitraire, en faveur du Trésor public. Si la propriété est contestée, ce n'est pas un bien au sens de la Convention. La CEDH n'a pas compétence pour examiner l'interprétation des juridictions internes. Une différences de surface est dans la marge d'appréciation des Etats.
1. Les principes généraux
80. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, c), CEDH 2004-IX, et Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 142, 20 mars 2018). La notion de « biens » a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des valeurs patrimoniales et donc des « biens » aux fins de cette disposition (Centro Europa 7 s.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 171, CEDH 2012). Si l’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens (Kopecký, précité, § 35, a)), la notion de « biens » peut recouvrir tant des biens actuels que des créances suffisamment établies pour être considérées comme des valeurs patrimoniales (Kopecký, précité, § 42, et Radomilja et autres, précité, § 142).
81. La Cour rappelle ensuite qu’un titre de propriété régulièrement enregistré peut constituer, en vertu du droit interne applicable, la preuve de l’existence d’un droit de propriété sur le bien en cause (voir, en ce qui concerne le droit turc, Riemer et autres c. Turquie, no 18257/04, § 36, 10 mars 2009, Dogancan c. Turquie (déc.), no 17934/10, § 22, 15 octobre 2013, et Dönmez et autres c. Turquie (déc.), no 19258/07, § 71, 30 janvier 2018).
82. Lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une valeur patrimoniale protégée par l’article 1 du Protocole no 1 que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence constante des tribunaux internes, c’est-à-dire lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible (Kopecký, précité, §§ 49 et 52, Centro Europa 7 s.r.l. et Di Stefano, précité, § 173, et Radomilja et autres, précité, § 142). À cet égard, des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir se concrétiser, c’est-à-dire d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété, peuvent constituer des valeurs patrimoniales (voir, entre autres, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII, Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII, et Kopecký, précité, § 35, c)). Toutefois, une espérance légitime n’a pas d’existence indépendante : elle doit être rattachée à un intérêt patrimonial pour lequel il existe une base juridique suffisante en droit national (Kopecký, précité, §§ 45-53, et Radomilja et autres, précité, § 143). En outre, un requérant ne peut en principe passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une valeur patrimoniale aux fins de l’article 1 du Protocole no 1 lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir, par exemple, Kopecký, précité, § 50, et Centro Europa 7 s.r.l. et Di Stefano c. Italie, précité, § 173 ; comparer Radomilja et autres, précité, § 149).
2. Application en l’espèce des principes généraux
83. La Cour observe que les revendications de propriété des requérants reposaient principalement sur leur titre de propriété datant de 1887.
84. Un tel titre immatriculé au registre foncier constitue en droit turc la preuve incontestable d’un droit de propriété.
85. Toutefois, si les limites décrites sur celui-ci couvraient un ensemble d’environ 51 291 m², la superficie mentionnée n’était que de 5 décarres (environ 5 000 m²).
86. La question qui se pose dès lors est de déterminer l’entendue du terrain que le titre couvrait.
87. Or, la Cour observe que cette question, liée à la valeur des titres immatriculés, relève du droit national, lequel, en l’occurrence l’article 20 de la loi sur le cadastre, régit ce type de contradiction en indiquant les situations dans lesquelles c’est la superficie mentionnée sur le titre qui doit être retenue et celles dans lesquelles c’est la superficie découlant des limites qui doit prévaloir.
88. Interprétant et appliquant le droit turc, les juridictions nationales ont estimés que le titre des requérants ne concernait qu’un bien de 5 décarres, étant donné que les limites décrites dans ledit titre n’étaient pas stables et ne pouvaient dès lors être retenues pour fixer la superficie du bien.
89. Il y avait certes eu une controverse en droit interne sur la question de savoir si c’étaient les limites ou bien la superficie indiquées par le titre qui devaient prévaloir. Si le TGI a initialement tranché la question en faveur des requérants, son jugement a été cassé et les juridictions ont finalement estimé que le titre des requérants correspondait à un bien de 5 décarres. Or, on ne peut conclure à l’existence d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (Kopecký, précité, § 50).
90. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes dans l’interprétation de la loi nationale ; c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII).
91. Elle ne relève rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation de la Cour de cassation. À cet égard, elle ne perd pas de vue que les experts avaient pu identifier le cours de la rivière, et donc les limites du bien, en 1927, c’est-à-dire avant les inondations de 1946. Elle relève toutefois, comme l’invite d’ailleurs à la faire le Gouvernement, que le titre avait été établi en 1887 et que rien ne permettait de déterminer le cours du fleuve à cette époque et donc d’identifier les limites du terrain. Dès lors, l’approche consistant à privilégier la superficie, qui avait été mentionnée au moment de l’établissement du titre, est loin d’être déraisonnable.
92. En ce qui concerne le jugement du tribunal d’instance de 1947 qui considère que la superficie du bien des requérants étaient de 51 291 m², la Cour de cassation a estimé que celui-ci ne liait pas le Trésor. La Cour observe que ce jugement du tribunal a été rendu dans le cadre d’une action en partage à laquelle le Trésor n’a pas participé et que les requérants ne fournissent aucun argument permettant d’affirmer que ledit jugement était opposable au Trésor.
93. Il en va de même des autres jugements présentés par les intéressés.
94. Quant à la circonstance que les requérants aient perçu une indemnité pour l’expropriation d’une partie du terrain litigieux, la Cour estime que celle-ci ne pouvait avoir pour conséquence de modifier la superficie couverte par le titre, ni de contraindre les juridictions nationales à fixer la superficie du bien d’une manière autre que celle qui était prévue par la loi. Elle pouvait tout au plus signifier qu’au moment de l’expropriation les requérants avaient été reconnus propriétaires ou possesseurs des parcelles expropriées.
95. La Cour relève qu’outre le titre, les requérants fondent également leur revendications de propriété sur la prescription acquisitive. À cet égard, les intéressés semblent s’être appuyés sur l’article 639 de l’ACC (actuellement l’article 713 du NCC), en vertu duquel toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier, peut demander l’inscription au registre foncier de ce bien comme étant sa propriété (paragraphe 53 ci-dessus). De ce point de vue, la « possession » pour laquelle les requérants demandent la protection de l’article 1 du Protocole no 1 était de la nature d’une créance plutôt que d’un bien actuel (voir, mutatis mutandis, Majcan c. Croatie (déc.), no 45366/14, § 26, 18 septembre 2018).
96. Les tribunaux ont conclu que, même si les requérants pouvaient faire valoir qu’ils exerçaient une possession de longue date sur le bien litigieux, le droit turc excluait la possibilité d’acquérir par prescription les terrains constituant le lit d’une rivière (paragraphe 37 ci-dessus).
97. Là encore, la Cour rappelle qu’elle dispose d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, sauf si les décisions de ces derniers sont entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste.
98. Or, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation des juridictions nationales. Rien ne lui permet donc de s’écarter des conclusions desdites juridictions qui ont rejeté les arguments des intéressés et jugé que ces derniers ne pouvaient se prévaloir de la prescription acquisitive.
99. La Cour rappelle que dans plusieurs affaires où les prétentions des requérants se fondaient également sur les règles de la prescription acquisitive, elle a estimé qu’en l’absence de base légale suffisante en droit interne, aucune espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du « bien » et d’en devenir propriétaire n’avait pu juridiquement naître dans le chef des requérants (Sarisoy et autres c. Turquie, no 21303/07, §§ 26 à 36, 14 octobre 2014). Elle n’aperçoit aucune raison pour parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.
100. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que le « bien » des requérants, au sens de la Convention, n’était pas de 51 291 m² comme ils le soutiennent, mais de 5 décarres, surface indiquée sur leur titre.
101. Les requérants ne pouvant se prévaloir d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, pour la partie des terrains litigieux excédant les 5 décarres mentionnées sur leur titre, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer dans ce contexte.
102. Il est vrai que les requérants n’ont pas obtenu la totalité de cette surface mais seulement 2 555 m² en raison de la déduction d’une surface que les intéressés avaient cédée aux autorités pour la construction d’une route (voir paragraphe 38 ci-dessus). Toutefois, ces derniers n’ont jamais fait grief de cette déduction opérée par les juridictions nationales au titre de la construction d’une route.
103. Il s’ensuit que le grief tiré du droit au respect des biens est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Tkachenko c. Russie du 20 mars 2018, requête n° 28046/05
Article 1 du Protocole 1 : Les requérants ont été privés de leur droit de propriété en méconnaissance de la procédure d’expropriation prévue par la loi russe
L’affaire concerne une procédure d’expropriation portant sur la maison des requérants, laquelle était sise sur un terrain appartenant à la municipalité. La municipalité décida de louer ledit terrain à un entrepreneur privé en vue de la construction d’un immeuble multi-habitation. Ce dernier assigna les requérants en justice, demandant qu’il soit mis fin à leur droit de propriété. Cette demande fut accueillie par les juridictions internes. La Cour juge en particulier que l’ingérence dans le droit de propriété des requérants n’a pas été opérée selon les conditions prévues par la loi russe. D’une part, la procédure prévue par le code civil concernant l’expropriation et destinée à fournir aux propriétaires expropriés certaines garanties n’a pas été respectée. D’autre part, le tribunal s’est référé à l’article 239 du code civil pour accueillir la demande en justice de l’entrepreneur privé de mettre fin au droit de propriété des requérants alors que cet article ne permettait qu’à une autorité publique de former une telle demande.
CEDH
a) Sur l’existence et la nature de l’ingérence
48. En l’espèce, nul ne conteste que la partie de la maison dont les requérants étaient copropriétaires s’analyse en un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
50. La Cour doit rechercher si l’ingérence se justifie sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Pour être compatible avec cette disposition, une ingérence doit remplir trois conditions: elle doit être effectuée « dans les conditions prévues par la loi », « pour cause d’utilité publique » et dans le respect d’un juste équilibre entre les droits du propriétaire et les intérêts de la communauté.
b) Sur le respect du principe de légalité
51. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est une notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, §§ 94-95, 25 octobre 2012). Il en découle que la nécessité d’examiner la question du juste équilibre « ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n’était pas arbitraire » (Guiso-Gallisay c. Italie, no 58858/00, § 80, 8 décembre 2005, avec les références qui y sont citées). L’expression « dans les conditions prévues par la loi » présuppose l’existence et le respect de normes de droit interne suffisamment accessibles et précises (Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 110, série A no 102) et offrant des garanties contre l’arbitraire (Vistinš et Perepjolkins, précité, § 95).
52. La Cour a déjà eu l’occasion de dire qu’une ingérence effectuée en violation des dispositions internes ne satisfaisait pas au critère de la « légalité » (voir, par exemple, East West Alliance Limited c. Ukraine, no 19336/04, §§ 179-181 et 195, 23 janvier 2014). Cependant, toute irrégularité procédurale n’est pas de nature à rendre l’ingérence incompatible avec l’exigence de « légalité » (Ukraine-Tioumen c. Ukraine, no 22603/02, § 52, 22 novembre 2007). La Cour rappelle à cet égard qu’elle dispose d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué ; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste (voir, parmi beaucoup d’autres, Kushoglu c. Bulgarie, no 48191/99, § 50, 10 mai 2007).
53. En l’espèce, les requérants étaient copropriétaires d’une moitié de la maison. Comme la Cour l’a déjà constaté au paragraphe 49 ci-dessus, ils en ont été privés dans le contexte de la reconstruction d’une partie de la ville selon le plan général d’urbanisme. La Cour considère que, dans ces circonstances, l’ingérence ne peut s’analyser qu’en une expropriation pour les besoins de la municipalité, au sens des articles 11 et 83 § 3 du code foncier et de l’article 239 du code civil (paragraphes 20-21 ci-dessus).
54. La Cour relève que les dispositions du code civil relatives à l’expropriation prévoyaient une procédure en plusieurs étapes : 1) l’autorité publique compétente prend la décision d’expropriation et en informe le propriétaire de l’immeuble au moins un an avant la mise en œuvre du rachat ; 2) l’autorité publique fait enregistrer la décision d’expropriation au registre unifié des droits immobiliers et en informe le propriétaire ; 3) l’autorité publique prépare une convention de rachat du bien auprès du propriétaire ; 4) en cas de désaccord du propriétaire sur le principe de l’expropriation ou sur les termes de la convention de rachat, l’autorité publique peut former une action en justice dans un délai de deux ans à compter de la notification au propriétaire de la décision d’expropriation. Dans le cadre du contentieux de l’expropriation, la charge de preuve de la nécessité de mettre fin au droit de propriété sur l’immeuble concerné incombe à l’autorité publique.
55. La Cour considère que la procédure précitée était destinée à fournir aux propriétaires expropriés certaines garanties. Elle constate cependant que, dans la présente affaire, cette procédure n’a pas été respectée et que les requérants n’ont pas pu bénéficier de ces garanties légales. Par ailleurs, elle note que la cour régionale n’a pas répondu au moyen des requérants tiré de l’application obligatoire de la procédure d’expropriation (paragraphes 15-16 ci-dessus). En outre, le Gouvernement s’est borné à soutenir qu’aucune disposition légale n’obligeait les autorités publiques à procéder elles-mêmes au paiement de l’indemnité de rachat ou de reloger les habitants, et que, si la procédure d’expropriation avait été respectée, les requérants n’auraient pas obtenu une meilleure indemnisation (paragraphes 42 et 44 ci-dessus), mais il n’a fourni aucune explication quant au non-respect par les autorités de la procédure-même d’expropriation.
56. De l’avis de la Cour, il ne s’agissait pas de simples irrégularités procédurales (comparer, par exemple, dans un contexte similaire concernant une expropriation, avec Volchkova et Mironov, précité) mais d’une privation de propriété en méconnaissance totale de la procédure applicable.
57. Enfin, la Cour relève que, pour accueillir la demande en justice de l’entrepreneur privé de mettre fin au droit de propriété des requérants, le tribunal s’est référé à l’article 239 du code civil. Or cet article ne permettait de former une telle demande qu’à une autorité publique, à l’exclusion de toute autre personne.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’ingérence n’a pas été opérée selon les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Cette conclusion rend superflu l’examen des autres exigences de cette disposition (voir, par exemple, Minasyan et Semerjyan c. Arménie, no 27651/05, § 76, 23 juin 2009).
58. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
KOSMAS ET AUTRES c. GRÈCE du 29 juin 2017 requête 20086/13
Article 1 du Protocole 1 : La qualité de victime ne concerne pas la saisie des terrains litigieux mais aussi les conséquences pour l'exploitation commerciale de la taverne MAMA MIA. Les victimes n'ont pas visé l'article 1 du Protocole 1 mais ils l'ont bien soulevé en substance. La Taverne est connue dans le monde entier grâce au film MAMA MIA et à la chanson éponyme du dit film chantée par le groupe ABBA. La famille du requérant est propriétaire des terrains depuis 1916. L'un des requérants a construit la taverne de ses mains et a apporté tous les moyens pour l'exploitation commerciale. Un monastère revendique les terrains achetés le 26 septembre 1824. Il présente son titre de propriété et gagne devant les tribunaux internes. L'État grec doit indemniser les requérants pour une somme ridiculement basse de 75 000 euros.
1.
Sur la qualité de victime 46.
En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la
requête irrecevable à l’égard des deuxième, troisième,
quatrième et cinquième requérants pour défaut de qualité de
victime : selon le Gouvernement, ces requérants n’ont pas
participé à la procédure devant les juridictions nationales,
et ils n’invoquent pas et ne démontrent pas l’existence
d’un droit de propriété sur le terrain litigieux. Plus
particulièrement, en ce qui concerne la deuxième requérante,
le Gouvernement estime que l’exécution forcée des
décisions internes contre son époux ne signifie pas qu’elle-même
se trouve lésée dans ses droits de nature patrimoniale. Il
ajoute que, à supposer même que l’obtention et l’usage
de la licence de son restaurant puissent être considérés comme
un « bien » – ce qu’il conteste –, il n’est
pas démontré que le monastère ait refusé de consentir à la
continuation de l’exploitation du restaurant par la
requérante. 47.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants
soutiennent qu’ils sont eux aussi victimes de la privation
de propriété du terrain du premier requérant. Pour démontrer
l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés pour
agir, ils renvoient à leurs arguments concernant l’objection
du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours
internes. 48.
La Cour rappelle que, pour pouvoir introduire une requête en
vertu de l’article 34 de la Convention, une personne
physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de
particuliers doit pouvoir se prétendre victime d’une
violation des droits reconnus dans la Convention. Pour pouvoir se
prétendre victime d’une telle violation, un individu doit,
en principe, avoir subi directement les effets de la mesure
litigieuse (Tanase c. Moldova [GC], no 7/08, § 104, CEDH 2010, et Aksu c. Turquie
[GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 50, CEDH 2012). L’existence
d’une victime personnellement touchée par la violation
alléguée d’un droit garanti par la Convention est une
condition de la mise en œuvre du mécanisme de protection de
la Convention, même si ce critère ne doit pas s’appliquer
de manière rigide et inflexible (Bitenc c. Slovénie (déc.), no
32963/02, 18 mars 2008). La Cour
interprète le concept de victime de façon autonome,
indépendamment des notions internes telles que celles d’intérêt
à agir ou de qualité pour agir (Aksu, précité, § 52). 49.
En l’espèce, la Cour note que la procédure en
revendication de la propriété du terrain litigieux a été
introduite par le monastère contre le premier requérant, qui
arguait de son propre droit de propriété sur ce terrain, et qu’elle
a pris fin par l’arrêt de la Cour de cassation qui a donné
gain de cause au monastère de manière définitive et par la
mise en œuvre de l’éviction des requérants. Or cette
situation a affecté non seulement le premier requérant, mais
aussi les membres de sa famille dont les activités commerciales
étaient liées à la propriété du terrain. La licence de
fonctionnement de la taverne avait été transférée en 2002 (à
la suite du départ à la retraite du premier requérant) à la
deuxième requérante, qui l’exploitait avec les quatrième
et cinquième requérants. Les deuxième et troisième
requérantes possédaient en outre deux bateaux qui servaient à
transporter les touristes de la ville de Skopelos à la plage et
à la taverne. Un système de dessalement de l’eau de mer
fonctionnait sur le terrain litigieux et permettait, entre autres,
l’arrosage de 350 oliviers dont la deuxième requérante
extrayait de l’huile pour les besoins de son restaurant (paragraphe
8 ci-dessus). Or, cette activité commerciale a fait l’objet
d’un examen de la part des juridictions internes dans le
cadre du moyen du premier requérant relatif à l’abus de
droit du monastère : le tribunal de première instance a relevé
que les frais engagés pour exploiter commercialement le terrain
étaient compensés par les profits de l’entreprise (paragraphe
17 ci-dessus). 50.
Eu égard à ce qui précède ainsi qu’à la nécessité d’appliquer
de manière flexible les critères déterminant la qualité de
victime, la Cour admet que l’épouse et les enfants du
premier requérant, bien que n’étant pas directement
impliqués dans la procédure devant les juridictions internes,
peuvent, au regard de l’article 34 de la Convention, passer
pour être victimes des faits qu’ils dénoncent. Dès lors,
elle rejette l’exception préliminaire du Gouvernement
concernant la qualité de victime de ces requérants. 2.
Sur l’épuisement des voies de recours internes 51.
En deuxième lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des
voies de recours internes. 52.
En ce qui concerne le premier requérant, il indique qu’à
aucun stade de la procédure celui-ci ne s’est référé,
même en substance, au droit protégé par l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention. Plus particulièrement, l’intéressé
n’aurait pas allégué que l’interdiction d’acquérir
par usucapion des biens de l’État et des monastères ainsi
que l’imprescribilité des droits de propriété de l’État
et des monastères sur leurs biens étaient contraires à la
disposition susmentionnée. Le Gouvernement estime que la simple
allégation du premier requérant devant les tribunaux selon
laquelle il était devenu propriétaire du terrain litigieux par
usucapion n’était pas suffisante aux fins de l’épuisement
des voies de recours internes. 53.
Quant à l’épouse et aux enfants du premier requérant, le
Gouvernement indique qu’à aucun moment au cours de la
procédure, y compris celle devant la Cour de cassation, ces
requérants n’ont fait usage du droit d’intervenir dans
la procédure (intervention accessoire – article 80 du code
de procédure civile) en faveur du premier requérant et n’ont
fait valoir un intérêt légitime à voir infirmer le jugement
de première instance. D’après le Gouvernement, ces quatre
requérants n’ont d’ailleurs procédé à aucune autre
démarche judiciaire ou extrajudiciaire pour faire valoir leurs
droits. 54.
Le premier requérant soutient que non seulement il a épuisé
les voies de recours internes en ce qui le concernait, mais qu’il
a aussi attiré l’attention de la Cour de cassation sur les
conséquences néfastes de l’aliénation de sa propriété
pour sa famille. 55.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants
indiquent qu’ils ne pouvaient pas former opposition contre
la procédure d’exécution forcée du jugement du tribunal
de première instance qui ordonnait leur éviction de la
propriété litigieuse, au motif qu’ils ne disposaient pas d’un
droit de propriété sur le terrain litigieux, mais seulement d’un
droit de créance envers le premier requérant. Quant à la
procédure d’intervention accessoire, ils indiquent qu’elle
ne leur donnait pas la possibilité de faire valoir leurs propres
droits et leur propre dommage, selon eux distincts de ceux du
premier requérant. Ils soutiennent que le Gouvernement ne
fournit d’ailleurs aucun précédent jurisprudentiel
susceptible de démontrer que l’intervention de tiers, ayant
des intérêts d’une nature différente de ceux de la
personne se revendiquant propriétaire d’un terrain, dans
une procédure de contestation de droits de propriété aurait pu
influencer l’issue de la procédure quant à ces droits.
Enfin, ils estiment qu’une action en dommages-intérêts
fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du
code civil n’aurait pas prospéré dès lors que, selon eux,
elle présupposait l’existence d’une illégalité
commise par l’État. 56.
La Cour rappelle que, conformément à l’article 35 § 1 de
la Convention, elle ne peut examiner une question que lorsque
tous les recours internes ont été épuisés. La finalité de
cette disposition est de ménager aux États contractants l’occasion
de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux
avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Ainsi,
le grief dont on saisit la Cour doit d’abord avoir été
soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais
prescrits par le droit interne, devant les juridictions
nationales appropriées. Toutefois, selon la règle de l’épuisement
des voies de recours internes, un requérant doit se prévaloir
des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre
juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation
des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister
à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en
théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité
voulues. Rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni
adéquats ni effectifs (Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 55, CEDH 2009). 57.
En ce qui concerne le premier requérant, la Cour note que la
procédure litigieuse portait sur la revendication par le
monastère de la propriété du terrain du premier requérant. Il
est vrai que l’enjeu principal de la procédure devant les
juridictions internes était la question de savoir si le terrain
litigieux que le premier requérant prétendait posséder en
vertu de titres de propriété et même par l’effet de l’usucapion
devait ou non être transmis au monastère auteur de l’action
en revendication. Il n’en reste pas moins, cependant, que le
litige portait aussi sur la possession du terrain par le biais du
grief relatif à l’abus de droit commis par le monastère.
En effet, tout comme devant le tribunal de première instance et
la cour d’appel, dans son pourvoi en cassation, le premier
requérant soulevait divers moyens, dont notamment l’abus de
droit que le monastère aurait commis en introduisant son action
: à cet égard, en se prévalant de la jurisprudence de la Cour
de cassation, le premier requérant soulignait que, pendant une
longue période antérieure à l’introduction de l’action,
il avait accompli sur le terrain litigieux des actes de
possession (??µ??), comprenant du travail personnel et des
dépenses (investissements, constructions, etc.), et que le
monastère, qui, d’après le requérant, s’était rendu
compte ou aurait dû se rendre compte de ces actes, n’avait
pas réagi et n’avait pas contesté ceux-ci, de sorte qu’il
aurait suscité auprès des tiers la conviction qu’il n’exercerait
jamais ses droits. Cette attitude du monastère avait diminué la
force du droit dont celui-ci pourrait se prévaloir. La longue
inaction du monastère devait être appréciée en combinaison
avec les actes de possession du requérant, ce qui donnait à l’abus
de droit une nature particulièrement caractérisée, car la
modification de la situation entrainerait pour le requérant un
dommage différent et multiple, supérieur à la simple perte du
bien. Or, si la Cour de cassation avait accueilli l’argument
relatif à l’abus de droit, le requérant, même sans être
reconnu propriétaire, n’aurait pas été évincé du
terrain et y serait maintenu en sa qualité de possesseur. 58.
Sans s’appuyer en termes exprès sur l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention, le premier requérant a invoqué
à la fois l’atteinte à son droit de propriété que celle
à sa possession du terrain au sens des dispositions du droit
interne applicable. Ce faisant, il a, à l’évidence,
présenté des arguments qui revenaient à dénoncer, en
substance, une atteinte à tous les aspects pertinents du droit
garanti par cet article. Il a ainsi donné à la Cour de
cassation l’occasion d’éviter ou de redresser les
violations alléguées, conformément à la finalité de l’article
35 de la Convention. Il convient donc de rejeter l’exception
de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. 59.
Quant aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième
requérants, la Cour note que selon le droit grec, il leur était
loisible de demander aux juridictions internes, sur le fondement
de l’article 80 du code de procédure civile, de pouvoir
intervenir dans la procédure à n’importe quel stade de
celle-ci. Certes, les juridictions internes étaient appelées à
déterminer laquelle des deux parties, du premier requérant ou
du monastère, qui invoquaient chacun des droits de propriété
sur le terrain litigieux, était le véritable propriétaire de
celui-ci. Toutefois, de l’avis de la Cour, les autres
requérants, bien qu’ils ne pouvaient pas faire valoir des
droits de propriété sur le terrain litigieux, ils étaient
exploitants du restaurant sis sur le terrain et des bateaux de
transports de touristes. Leur intervention en vertu de l’article
80 du code de procédure civile aurait permis aux deuxième,
troisième, quatrième et cinquième requérants d’appuyer
les prétentions du premier requérant et donc d’influencer
l’issue du litige qui était déterminant pour eux. En même
temps, une telle intervention aurait donné aux juridictions
internes l’occasion de prendre en considération l’enjeu
du litige dans sa totalité et de décider en conséquence. Par
ailleurs, l’intervention en question aurait conduit les
requérants à démontrer leur intérêt pour agir et les
juridictions compétentes à se prononcer à cet égard. Il s’ensuit
que les quatre requérants en question ont failli à leur
obligation d’épuiser les voies de recours internes. Partant,
la Cour accueille l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle
concerne les deuxième, troisième, quatrième et cinquième
requérants. 3.
Conclusion 60.
Constatant que la requête n’est pas manifestement mal
fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et
qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité,
la Cour la déclare recevable à l’égard du premier
requérant. SUR
LE FOND 79.
La Cour note qu’il n’est pas contesté en l’espèce
que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi »,
comme l’exige l’article 1 du Protocole no 1 : par l’article
21 du décret du 22 avril/16 mai 1926 relatif à l’éviction
administrative des terrains appartenant à la défense aérienne
et à l’interdiction de prise de mesures provisoires contre
l’État et la défense aérienne, le législateur a étendu
aux biens des monastères la protection qu’il accordait à
ceux de l’État, afin de les protéger de ceux qui
tenteraient de se les approprier en invoquant l’usucapion.
Par ailleurs, l’article 4 de la loi no 1539/1938 prévoit l’imprescriptibilité
des droits de l’État sur des biens du domaine public. En
outre, les monastères du Mont Athos, dont La Grande Laure fait
partie, bénéficient d’un statut particulier en vertu de l’article
105 de la Constitution et d’une protection particulière en
ce qui concerne leurs biens, l’article 181 de la Charte
statutaire du Mont Athos prévoyant que leurs biens immeubles
sont totalement inaliénables en tant que biens de droit divin. 80.
L’ingérence poursuivait aussi un but légitime, à savoir
protéger de l’empiétement par des tiers la propriété
immobilière des monastères. La Cour est consciente du souci du
législateur d’accorder une protection particulière aux
biens des monastères. Elle note que les monastères créés
pendant la période byzantine ont acquis des biens par donations
impériales ou privées et que, au fil des siècles, leurs titres
de propriété ayant été détruits, perdus ou volés, l’usucapion
est venue remplacer les titres non conservés (paragraphe 36 ci-dessus).
Le recours à cette notion d’usucapion a été nécessaire
afin de protéger leurs terres de l’empiétement par des
tiers ou par l’invocation par des tiers de l’usucapion
et des revendications fréquentes en justice par des personnes
privées concernant des terrains possédés de bonne foi par les
monastères. La jurisprudence des tribunaux grecs a d’ailleurs
toujours admis que, jusqu’à l’introduction du code
civil (soit jusqu’au 23 février 1946), les biens des
monastères et de l’Église étaient insusceptibles d’être
acquis par usucapion par des tiers (paragraphe 36 ci-dessus). 81.
Il incombe toutefois à la Cour d’examiner, à la lumière
de la norme générale de cet article, si un juste équilibre a
été maintenu entre les exigences de l’intérêt général
et les droits des individus concernés. La Cour rappelle à cet
égard que le souci d’assurer un « juste équilibre »
entre les exigences de l’intérêt général de la
communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu se reflète dans la structure de
l’article 1 du Protocole no 1 tout entier et qu’il se
traduit par la nécessité d’un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir,
entre autres, Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, §§ 108-109, 25
octobre 2012, et Ruspoli Morenes c. Espagne, no 28979/07, § 36, 28 juin 2011).
La vérification de l’existence d’un tel équilibre
exige un examen global des différents intérêts en cause. 82.
En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît
à l’Etat une large marge d’appréciation tant pour
choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si
leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt
général, par le souci d’atteindre l’objectif de la
loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III).
Elle ne saurait renoncer pour autant à son pouvoir de contrôle,
en vertu duquel il lui appartient de vérifier que l’équilibre
voulu a été préservé de manière compatible avec le droit du
requérant au respect de ses biens (Jahn et autres c. Allemagne [GC],
nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 93, CEDH 2005-VI). 83.
Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le « juste
équilibre » voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur
le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de
prendre en considération les modalités d’indemnisation
prévues par la législation interne. Sans le versement d’une
somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une
privation de propriété constitue normalement une atteinte
excessive. Un défaut total d’indemnisation ne saurait se
justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1
que dans des circonstances exceptionnelles (Les saints
monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 71, série A no 301-A,
et Ex-roi de Grèce et autres, précité, § 89). Cependant, l’article
1 du Protocole no 1 ne garantit pas dans tous les cas le droit à
une réparation intégrale (James et autres c. Royaume-Uni, 21
février 1986, § 54, série A no 98, et Broniowski c. Pologne [GC],
no 31443/96, § 182, CEDH 2004-V). 84.
En l’espèce, la Cour note que, pour donner gain de cause au
monastère, les juridictions nationales, et notamment la cour d’appel,
se sont fondées, d’une part, sur les actes de possession
accomplis par le monastère sur ces terrains de 1882 à 1915 (les
moines faisaient paître leurs moutons sur le terrain litigieux,
défrichaient celui-ci et dissuadaient les tiers de se l’approprier
– paragraphe 28 ci-dessus), puis sur l’inaliénabilité
de ses droits de propriété à partir de 1915, et, d’autre
part, sur l’impossibilité pour le requérant de prouver que
lui-même et ses prédécesseurs s’étaient livrés à des
actes de possession de bonne foi pendant une période continue de
quarante ans avant 1915 puis jusqu’à la saisine du tribunal
de première instance par le monastère en 2004. En outre, dans
son arrêt no 749/2010, la cour d’appel a relevé que le
monastère possédait de bonne foi le terrain litigieux depuis
1824, car il l’avait acheté à la vraie propriétaire par
un acte de transfert de propriété certifié par la chancellerie
de Skopelos. 85.
De son côté, le premier requérant se prévalait de sa qualité
de propriétaire du terrain litigieux en se fondant sur des
titres de propriété légalement établis au fil de plusieurs
dizaines d’années. Il présentait des actes de propriété
du terrain établis au nom de ses prédécesseurs et datant de
1883, 1902 et 1909 (paragraphe 22 ci-dessus), ainsi qu’au
nom des membres de sa famille qui se succédaient de 1916 à 1933.
Il produisit, en outre, un acte du 19 septembre 1916 selon lequel
son grand-père avait acquis la propriété du terrain, un
testament de 1933 selon lequel ce grand-père avait transmis la
propriété du terrain à son père, un acte d’acceptation
de succession (no 3357) de son père établi le 2 novembre 1960
devant notaire, et un acte d’acceptation de succession no 18052/29-12-1982, établi devant
notaire lors de la transmission de la propriété par son père
et transcrit au service du registre foncier de Skopelos (paragraphe
11 ci-dessus). 86.
S’estimant ainsi propriétaire légal et de bonne foi du
terrain litigieux, le premier requérant et sa famille avaient
créé et exploité une entreprise de restauration sur ce terrain
et développé autour de cette exploitation d’autres
activités liées au tourisme. La Cour attache aussi de l’importance
au fait que plusieurs autorités publiques de l’île de
Skopelos ont consenti à accorder au premier requérant
différents permis comme s’il était le propriétaire du
terrain : ainsi, en 1986, le commissariat de police lui a
délivré une licence lui permettant d’exploiter un bar-restaurant
et, en 1994, le service de l’urbanisme de l’île lui a
accordé un permis de construire un bâtiment d’une
superficie de 135 m² pour l’exploitation d’un
restaurant (paragraphe 21 ci-dessus). À cela s’ajoute le
fait que le requérant devait payer des taxes foncières à l’Etat
(paragraphe 63 ci-dessus). Certes, en 1986 et en 1994, ces
autorités ne pouvaient pas savoir qu’en 2004 une action en
revendication de la propriété serait intentée par le
monastère et qu’elle aurait une issue favorable. Toutefois,
la Cour estime que des actes administratifs légaux établis par
des autorités étatiques telles que les autorités de police et
le service de l’urbanisme ne peuvent que conforter le
sentiment des destinataires de ces actes que le système d’acquisition
et de transmission des biens est stable et fiable et qu’ils
possèdent de bon droit le bien objet de ces actes. En tout état
de cause, le premier requérant a soulevé devant toutes les
juridictions qui ont examiné l’affaire le moyen tiré de l’abus
de droit du monastère afin de conserver la possession du bien
litigieux. 87.
Au fait que les juridictions grecques n’ont pas pris en
considération les titres de propriété soumis devant elles par
le premier requérant se rajoute celui qu’elles n’ont
pas pris en compte la perte de l’outil de travail du
requérant entraînée par leur décision, et dont celui-ci et sa
famille tiraient leurs moyens de subsistance depuis 1986 (voir, mutatis
mutandis, Lallement c. France, no 46044/99, §§ 20-24, 11 avril
2002, et Di Marco c. Italie, no 32521/05, § 65, 26 avril 2011),
et ce sans aucune indemnité. En effet, le tribunal de première
instance de Volos a considéré que les frais engagés par le
premier requérant pour exploiter commercialement le terrain
litigieux avaient été compensés par les profits de son
entreprise et que celui-ci avait bénéficié de ces avantages
pendant une longue période sans verser de loyer au monastère en
contrepartie de l’usage du terrain (paragraphe 17 ci-dessus).
Les juridictions internes ont ainsi rejeté le moyen tiré de l’abus
de droit du monastère. Or, si ce moyen avait été accueilli, le
premier requérant aurait au moins conservé la possession du
terrain. 88.
A la lumière de ce qui précède, et compte tenu de la
spécificité des circonstances de l’espèce, la Cour estime
que le requérant a subi une « charge spéciale et exorbitante
», qui ne peut être justifiée par l’existence d’un
intérêt général légitime poursuivi par les autorités. Il y
a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. 89.
Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’aucune
question distincte ne se pose au regard de l’article 14 de
la Convention. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner
ce grief. MAMATAS
ET AUTRES c. GRÈCE du 21 juillet 2016 requête
63066/14 et 64297/14 et 66106/14 NON VIOLATION
DE L'ARTICLE 1 du PROTOCOLE 1 : l'échange de titres du
trésor au porteur à la place de leur paiement est conforme à l'intérêt
général supérieur au droit de propriété des 6320
particuliers requérants, pour la Grèce qui connaît la pire
crise économique de son histoire. 84.
Comme elle l’a précisé à plusieurs reprises, la Cour
rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime
dans la première phrase du premier alinéa et revêt un
caractère général, énonce le principe du respect de la
propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du
même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à
certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le
second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre
autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général. Il ne s’agit pas pour autant de règles
dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième
ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit
de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à
la lumière du principe consacré par la première (Scordino c.
Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 78, CEDH 2006-V). 85.
La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, un
requérant ne peut se plaindre d’une violation de l’article
1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il
incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette
disposition. La notion de « bien » évoquée à la première
partie de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée
autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens
corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications
formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts
constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits
patrimoniaux » et donc des « biens » aux fins de cette
disposition. Dans chaque affaire, il importe d’examiner si
les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le
requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé
par l’article 1 du Protocole no 1 (Anheuser-Busch Inc. c.
Portugal [GC], no 73049/01, § 63, CEDH 2007-I). 86.
L’article 1 du Protocole no 1 ne vaut que pour les biens
actuels. Un revenu futur ne peut ainsi être considéré comme un
« bien » que s’il a déjà été gagné ou s’il fait
l’objet d’une créance certaine. En outre, l’espoir
de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est
dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut
non plus être considéré comme un « bien », et il en va de
même d’une créance conditionnelle s’éteignant du
fait de la non-réalisation de la condition (ibid. § 64). 87.
Cependant, dans certaines circonstances, l’« espérance
légitime » d’obtenir une valeur patrimoniale peut
également bénéficier de la protection de l’article 1 du
Protocole no 1. Ainsi, lorsque l’intérêt patrimonial est
de l’ordre de la créance, l’on peut considérer que l’intéressé
dispose d’une espérance légitime si un tel intérêt
présente une base suffisante en droit interne, par exemple
lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie
des tribunaux. Toutefois, on ne saurait conclure à l’existence
d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a
controverse sur la façon dont le droit interne doit être
interprété et appliqué et que les arguments développés par
le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les
juridictions nationales (ibid. § 65). 88.
La Cour rappelle en outre qu’elle a déjà construit une
jurisprudence relative à la marge d’appréciation des
États dans le contexte de la crise économique qui sévit en
Europe depuis 2008 et plus particulièrement en relation avec des
mesures d’austérité prises par voie législative ou autre
et visant des couches entières de la population (Valkov et
autres c. Bulgarie, no 2033/04, 25 octobre 2011, Frimu
et 4 autres requêtes c. Roumanie (déc.), nos
45312/11, 45581/11, 45583/11, 45587/11 et 45588/11, § 40, 7 février 2012,
Panfile c. Roumanie (déc.), no 13902/11, 20 mars 2012, Koufaki
et ADEDY c. Grèce (déc.), nos 57665/12 et 57657/12, 7 mai 2013, N.K.M. c.
Hongrie, no 66529/11, 14 mai 2013, da
Conceição Mateus et Santos Januário c. Portugal (déc.), nos 62235/12 et 57725/12, 8 octobre 2013, Savickas
c. Lituanie (déc.), no 66365/09, 15 octobre 2013, et da
Silva Carvalho Rico c. Portugal (déc.), no 13341/14, 1er septembre 2015).
Dans ce contexte, la Cour rappelle aussi que les Etats parties à
la Convention jouissent d’une marge d’appréciation
assez ample lorsqu’il s’agit de déterminer leur
politique sociale. L’adoption des lois pour établir l’équilibre
entre les dépenses et les recettes de l’Etat impliquant d’ordinaire
un examen de questions politiques, économiques et sociales, la
Cour considère que les autorités nationales se trouvent en
principe mieux placées qu’un tribunal international pour
choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir à cette
fin et elle respecte leurs choix, sauf s’ils se révèlent
manifestement dépourvus de base raisonnable (voir, notamment,
Koufaki et Adedy (déc.), précitée, § 31, et Da Silva Carvalho
Rico (déc.), précitée, § 37). 89.
La Cour a aussi jugé que, dans des situations qui concernent un
dispositif législatif ayant de lourdes conséquences et prêtant
à controverse, dispositif dont l’impact économique sur l’ensemble
du pays est considérable, les autorités nationales devaient
bénéficier d’un large pouvoir discrétionnaire non
seulement pour choisir les mesures visant à garantir le respect
des droits patrimoniaux ou à réglementer les rapports de
propriété dans le pays, mais également pour prendre le temps
nécessaire à leur mise en œuvre (Broniowski c. Pologne [GC],
no 31443/96, § 182, CEDH 2004-V). a)
Sur l’existence d’un « bien » et d’une
ingérence dans le droit de propriété 90.
La Cour note que, à l’instar des titres qui font l’objet
de transactions sur le marché des capitaux, les obligations sont
négociables en bourse, se transfèrent d’un porteur à l’autre,
et que leur valeur peut fluctuer en fonction de divers facteurs.
Toutefois, à leur arrivée à maturité, elles doivent, en
principe, être remboursées à leur valeur nominale. 91.
Les porteurs d’obligations de l’État grec, dont les
requérants, avaient, en application de l’article 8 de la
loi no 2198/1994 et à l’échéance de leurs titres, une
créance pécuniaire envers l’État d’un montant
équivalent à la valeur nominale de leurs obligations. Les
requérants pouvaient donc prétendre voir leurs titres de
créance remboursés conformément à la loi précitée et ils
avaient donc un « bien », au sens de la première phrase de l’article
1 du Protocole no 1, devant bénéficier des garanties de cette
disposition. 92.
Or l’adoption de la loi no 4050/2012 a modifié les
conditions précitées par le jeu des clauses d’action
collective que ce texte incluait. Ces clauses prévoyaient la
possibilité, au moyen d’un accord conclu entre, d’une
part, l’État et, d’autre part, les porteurs d’obligations
décidant collectivement par une majorité renforcée, de
modifier ces conditions régissant les obligations, une telle
modification s’imposant aussi aux porteurs minoritaires. Les
requérants, qui n’ont pas consenti à la modification
proposée, se sont vu imposer les nouvelles conditions contenues
dans la loi no 4050/2012, et notamment une diminution de 53,5 %
de la valeur nominale de leurs obligations. 93.
Dans ces conditions, la Cour partage l’argument principal
des requérants selon lequel les modalités en fonction
desquelles l’échange a eu lieu démontrent clairement le
caractère involontaire de leur participation au processus de la
décote. Elle estime que, si l’argument en question n’est
pas suffisant en tant que tel pour conduire à un constat de
violation de l’article 1 du Protocole no 1, la participation
forcée des requérants à ce processus s’analyse en une
ingérence dans leur droit au respect de leurs biens. Elle
souligne d’ailleurs à cet égard que tous les cas de figure
envisagés à l’article 1 du Protocole no 1 constituent des
ingérences involontaires dans le droit de propriété. 94.
La Cour estime par ailleurs que, contrairement à ce qu’affirment
les requérants, la modification des titres sélectionnés, telle
qu’organisée par la loi no 4050/2012 et les actes
ministériels litigieux, ne peut être considérée comme une «
privation de propriété » au sens de l’article 1 du
Protocole no 1. En effet, en acquérant des obligations, les
requérants ont fait un investissement dont la valeur aurait pu
fluctuer en fonction des aléas des marchés et de la situation
économique de l’Etat émetteur. La Cour rappelle à cet
égard que dans les affaires Thivet c. France ((déc.), no 57071/00, 24 octobre 2000), Bäck
c. Finlande (no 37598/97, 20 juillet 2004), Lobanov
c. Russie (no 15578/03, 2 décembre 2010) et Andreyeva
c. Russie (no 73659/10, 10 avril 2012) qui
impliquaient aussi des baisses drastiques des créances des
requérants, la Cour a appliqué la première phrase du premier
paragraphe de l’article 1. Elle estime que la même approche
doit être suivie en l’espèce. En d’autres termes, la
modification des titres sélectionnés s’analyse en une
ingérence qui relève de la première phrase de cet article.
Cette qualification n’affecte pas les garanties accordées
aux requérants par cette disposition, quelle que soit la norme
applicable, étant donné que la deuxième et la troisième
normes contenues dans cet article s’interprètent à la
lumière du principe consacré par la première qui s’exprime
dans la première phrase du premier alinéa (voir, parmi beaucoup
d’autres, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999-II) 95.
Reste à savoir si cette ingérence était justifiée en l’espèce. b)
Sur la justification de l’ingérence dans le droit de
propriété 96.
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige,
avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité
publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit
légale et poursuive un but légitime « d’utilité publique
». Une telle ingérence doit aussi être proportionnée au but
légitime poursuivi, c’est-à-dire ménager un juste
équilibre entre les exigences de l’intérêt général de
la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu. Un tel équilibre n’est pas
respecté si la personne concernée a dû subir une charge
individuelle excessive (Vistins et Perepjolkins, précité, § 94). i.
« Prévue par la loi » 97.
La Cour rappelle que l’existence d’une base légale en
droit interne ne suffit pas, en tant que telle, à satisfaire au
principe de légalité. Il faut, en plus, que cette base légale
présente une certaine qualité, celle d’être compatible
avec la prééminence du droit et d’offrir des garanties
contre l’arbitraire. À cet égard, il faut rappeler que la
notion de « loi », au sens de l’article 1 du Protocole no
1, a la même signification que celle qui lui est attribuée par
d’autres dispositions de la Convention (voir, par exemple, Špacek,
s.r.o. c. République tchèque, no 26449/95, § 54, 9 novembre 1999). 98.
Il s’ensuit que, en plus d’être conformes au droit
interne de l’État contractant, qui comprend la Constitution
(Ex-roi de Grèce et autres (fond) précité, §§ 79 et 82, et Jahn
et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 81, CEDH 2005-VI),
les normes juridiques sur lesquelles se fonde une privation de
propriété doivent être suffisamment accessibles, précises et
prévisibles dans leur application (Guiso-Gallisay c. Italie, no
58858/00, §§ 82-83, 8
décembre 2005). Quant à la portée de la notion de «
prévisibilité », elle dépend dans une large mesure du contenu
du texte dont il s’agit, du domaine que celui-ci couvre
ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (voir,
mutatis mutandis, Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie, no 75909/01, § 109, 20 janvier
2009). En particulier, une norme est « prévisible » lorsqu’elle
offre une certaine garantie contre des atteintes arbitraires de
la puissance publique (Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, § 65, 30 mai 2000).
De même, la loi applicable doit offrir des garanties
procédurales minimales, en rapport avec l’importance du
droit en jeu (voir, mutatis mutandis, Sanoma Uitgevers B.V. c.
Pays-Bas [GC], no 38224/03, § 88, 14 septembre
2010). 99.
En l’espèce, la Cour ne doute pas que l’ingérence
litigieuse était « prévue par la loi », comme l’a d’ailleurs
relevé le Conseil d’Etat dans son arrêt no 1507/2014 (paragraphe
34 ci-dessus). L’échange des obligations des requérants
contre de nouveaux titres était fondé sur la loi no 4050/2012,
les deux actes du Conseil des Ministres des 24 février et 9 mars
2012, la décision du ministre adjoint de l’Économie du 9
mars 2012 et la décision du gouverneur de la Banque de Grèce de
la même date. Ces textes étaient accessibles aux requérants,
lesquels en avaient forcément pris connaissance puisqu’ils
devaient donner ou refuser leur consentement quant au processus d’échange
que ces textes mettaient en place. 100.
De l’avis de la Cour, les conséquences d’un refus
éventuel des requérants étaient aussi prévisibles. À cet
égard, la Cour distingue la présente affaire de l’arrêt Vistins
et Perepjolkins (précité), invoqué par les requérants pour
mettre en cause la compatibilité de la loi litigieuse avec les
principes de l’État de droit. Il est vrai que, dans cet
arrêt, la Cour s’est dite « dubitative » quant au point
de savoir si l’ingérence litigieuse pouvait passer pour
avoir été opérée « dans les conditions prévues par la loi
». Il n’en reste pas moins que, dans cette affaire, la loi
visait individuellement et nommément les requérants et leur
propriété (Vistins et Perepjolkins, précité, § 54). Or une
législation ad hominem peut effectivement soulever des doutes
quant à sa compatibilité avec les principes de l’État de
droit. En l’espèce, cependant, la loi no 4050/2012 s’appliquait
uniformément et de manière générale à des milliers de
porteurs d’obligations. De plus, la mise en œuvre des
dispositions de la loi no 4050/2012 était conditionnée à l’accord
d’une majorité qualifiée de tous les acteurs impliqués. ii.
« Pour cause d’utilité publique » 101.
La Cour note que la crise financière internationale qui a
commencé en 2008 a eu de graves répercussions sur l’économie
grecque. Le 27 avril 2009, le Conseil de l’Union européenne
constatait déjà que la Grèce se trouvait dans une situation de
déficit extrême : alors que, pour faire partie de l’union
monétaire, un pays doit avoir un ratio dette publique/PIB
inférieur à 60 %, pour la Grèce ce ratio atteignait 100 %. En
2010, le coût de l’emprunt sur les marchés financiers
internationaux a été augmenté à un niveau prohibitif, ce qui
a eu pour résultat d’exclure la Grèce de ces marchés et a
entraîné l’impossibilité pour elle de financer ses
propres créances échues. Les besoins en emprunt pour s’acquitter
de ses obligations ont été pris en charge par un mécanisme de
stabilité auquel participaient les États membres de la zone
euro et le FMI. 102.
La crise financière en Grèce s’est encore aggravée au
cours des années qui ont suivi. En 2011, d’après la
Commission européenne, les données macroéconomiques du pays
démontraient que la dette augmenterait à 186 % jusqu’en
2013 et qu’elle demeurerait supérieure à 150 % en 2020. Le
deuxième semestre de 2011, les partenaires de la Grèce ont
conditionné la poursuite du financement de la dette à la
participation du secteur privé à l’effort de
restructuration de l’économie du pays au moyen de la
réduction de ses obligations et de la prolongation de leur
échéance dans le temps. Selon les partenaires, une telle
démarche produirait une diminution immédiate et substantielle
de la dette publique grecque et assurerait sa viabilité. Le
Sommet des États de la zone euro du 26 octobre 2011 a posé
comme condition de la viabilité de la dette la diminution de 50
% de la dette du secteur privé (paragraphe 11 ci-dessus). 103.
La Cour estime que, pendant la période de grave crise politique,
économique et sociale que la Grèce a récemment traversée et
qu’elle traverse toujours, les autorités auraient dû s’atteler
à la solution de telles questions. Elle admet en conséquence
que l’État défendeur pouvait légitimement prendre des
mesures en vue d’atteindre ces buts, à savoir le maintien
de la stabilité économique et la restructuration de la dette,
dans l’intérêt général de la communauté. 104.
Selon les informations fournies par le Gouvernement, l’opération
d’échange a abouti à la diminution de la dette grecque d’environ
107 milliards d’EUR. À la fin de 2012, un pourcentage de 85
% de la dette est passé des personnes privées aux États
membres de la zone euro. En 2013, le coût du service de la dette
a baissé considérablement : alors que les intérêts prévus
initialement pour 2012 devaient s’élever à 17,5 milliards
d’EUR, à la suite de l’échange, une somme de 12,2
milliards a dû être versée alors que, en 2013, les intérêts
n’ont pas dépassé 6 milliards. 105.
L’ingérence incriminée poursuivait donc un but d’utilité
publique. iii.
Proportionnalité de l’ingérence 106.
Il reste à déterminer si l’ingérence litigieuse était
proportionnée au but poursuivi. 107.
La Cour note que, par l’effet du jeu des clauses d’action
collective prévues par la loi no 4050/2012, les requérants ont
vu leurs titres annulés et remplacés par des nouveaux titres,
ce qui a eu pour conséquence une baisse du montant que ceux-ci
pouvaient espérer percevoir à la date à laquelle les anciens
titres arriveraient à maturité. 108.
La Cour estime nécessaire de distinguer la présente affaire des
affaires Malysh et autres c. Russie (no 30280/03, 11 février 2010) et Lobanov
précité, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article
1 du Protocole no 1. La première concernait l’omission de l’État
défendeur d’établir, en application d’une loi, une
procédure de rachat des titres des requérants, ce qui a eu pour
effet de laisser les intéressés dans un état d’insécurité
pendant plusieurs années. La deuxième portait aussi sur l’omission
des autorités de légiférer au sujet de la procédure de
paiement au titre de l’emprunt obligataire d’État de
1982, qui avait été garanti et reconnu comme faisant partie de
la dette de l’État. Il est clair que dans ces affaires il n’était
pas question, comme en l’espèce, de modification des termes
des titres pour lesquels l’État, en sa qualité de
débiteur, était en situation d’insolvabilité imminente. 109.
La Cour estime aussi nécessaire de distinguer la présente
affaire d’autres affaires dans lesquelles elle a constaté
qu’une indemnisation représentant un pourcentage très
réduit, de l’ordre de 2 % par exemple (Broniowski,
précité, § 186), de la valeur de ce à quoi le requérant
pouvait prétendre entraînait une charge disproportionnée et
excessive qui ne pouvait être justifiée par un intérêt
général légitime poursuivi par les autorités. De même, elle
a constaté une violation de l’article 1 du Protocole no 1
à l’égard d’une requérante qui s’était vu
imposer une charge excessive en raison de la taxation à 98 % d’une
partie de l’indemnité de licenciement qu’elle avait
reçue (N.K.M. c. Hongrie, précité). 110.
En l’espèce, il n’appartient pas à la Cour d’estimer
de manière abstraite ce que les requérants auraient dû
percevoir en échange de leurs anciens titres dans les
circonstances de la cause. La Cour note, comme l’a d’ailleurs
relevé le Conseil d’État dans son arrêt no 1116/2014 (paragraphe
38 ci-dessus), que l’échange des titres des requérants a
entraîné à leurs dépens une perte de capital de 53,5 %, voire
plus élevée si l’on tient compte de la modification de la
date de leur arrivée à maturité. Or une telle perte, si elle
paraît à première vue substantielle, n’est pas
conséquente au point qu’elle puisse être assimilée à une
extinction ou à une rétribution insignifiante par voie
législative des créances des requérants à l’encontre de
l’État. 111.
La Cour estime aussi utile de rappeler qu’elle a rejeté
comme manifestement mal fondé le grief d’une requérante d’après
lequel, en raison du plafonnement de l’indemnisation prévue
par une loi pour ses titres d’emprunt russe, la somme qu’elle
devait percevoir ne correspondait qu’à une faible fraction
de la valeur nominale de ses titres (Thivet (déc.), précitée). 112.
De l’avis de la Cour, le point de référence pour
apprécier le degré de la perte subie par les requérants ne
saurait être le montant que ceux-ci espéraient percevoir au
moment de l’arrivée à maturité de leurs obligations. Si
la valeur nominale d’une obligation reflète la mesure de la
créance de son détenteur à la date de l’arrivée à
maturité, elle ne représente pas la véritable valeur marchande
à la date à laquelle l’État a adopté la réglementation
litigieuse, en l’occurrence le 23 février 2012, date à
laquelle la loi no 4050/2012 a été adoptée. Cette valeur avait
sans doute déjà été affectée par la solvabilité en baisse
de l’État qui avait déjà commencé au milieu de 2010 et s’était
poursuivie jusqu’à la fin de 2011. Cette baisse de la
valeur marchande des titres des requérants laisse présager que,
le 20 août 2015, l’État n’aurait pas été en mesure
d’honorer ses obligations découlant des clauses
conventionnelles incluses dans les anciens titres, c’est-à-dire
avant l’adoption de la loi no 4050/2012 (voir aussi
paragraphe 82 ci-dessus). 113.
Tenant compte de la nature des mesures litigieuses, le fait que
les requérants ne figuraient pas parmi ceux qui avaient consenti
à la réalisation de l’opération d’échange, mais qu’ils
avaient au contraire subi celle-ci par l’effet des clauses d’action
collective, n’affecte pas en tant que tel l’appréciation
de la proportionnalité de l’ingérence. 114.
D’abord, la Cour considère que, si les porteurs d’obligations
non consentants, comme les requérants, craignaient une baisse de
la valeur de leurs créances dès l’activation des clauses d’action
collective, ils auraient pu exercer leurs droits de porteurs et
écouler leurs titres sur le marché jusqu’au dernier délai
de l’invitation qui leur avait été faite de déclarer s’ils
acceptaient ou non l’échange. 115.
Certes, à la date de l’émission des anciens titres
détenus par les requérants, ni ces titres ni le droit grec ne
prévoyaient la possibilité de la mise en œuvre de telles
clauses. La Cour ne méconnaît pas le fait que les obligations
qui font sans cesse l’objet de transactions sur les marchés
tant nationaux qu’internationaux peuvent être disséminées
entre les mains d’un très grand nombre des porteurs.
Toutefois, les clauses d’action collective sont courantes
dans la pratique des marchés internationaux de capitaux et elles
ont été incluses, en application de l’article 12 § 3 de
la convention instituant le Mécanisme européen de stabilité,
dans tous les titres de dette publique des États membres de la
zone euro d’une durée supérieure d’un an (paragraphe
18 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour admet que, s’il avait
fallu rechercher parmi tous ces porteurs un consensus en vue du
projet de restructuration de la dette grecque ou limiter l’opération
seulement à ceux qui y avaient consenti, cela aurait contribué
à coup sûr à l’échec de ce projet. 116.
La Cour relève en outre que l’une des conditions posées
par les investisseurs institutionnels internationaux pour
réduire leurs créances consistait en l’existence et l’activation
de clauses de ce type. Le défaut de ces clauses aurait
entraîné l’application d’un pourcentage de réduction
plus grand à l’égard des créances de ceux qui auraient
été prêts à accepter une décote et aurait contribué à
dissuader un grand nombre des porteurs des titres de faire partie
du processus. Il apparaît ainsi que les clauses d’action
collective et la restructuration de la dette publique obtenue
grâce à elles constituaient une mesure appropriée et
nécessaire à la réduction de la dette publique grecque et à
la prévention de la cessation des paiements de l’État
défendeur. 117.
De plus, la Cour considère qu’un investissement en
obligations ne peut être exempt de risques. En effet, entre l’émission
d’un tel titre et son arrivée à maturité, il s’écoule
en principe un laps de temps assez long pendant lequel se
produisent des événements imprévisibles pouvant avoir pour
effet de réduire considérablement la solvabilité de leur
émetteur, même si celui-ci est un État, et donc d’entraîner
une perte patrimoniale subséquente pour le créancier. 118.
La Cour estime opportun de souligner à cet égard certains des
motifs par lesquels le Tribunal de l’Union européenne a
rejeté un recours introduit contre la BCE par deux cents
particuliers de nationalité italienne qui détenaient des
obligations de l’État grec. Le tribunal a souligné que, au
regard de la situation économique de la République hellénique
et des incertitudes la concernant à l’époque, les
investisseurs concernés ne pouvaient prétendre avoir agi en
tant qu’opérateurs économiques prudents et avisés,
susceptibles de se prévaloir de l’existence d’attentes
légitimes. Au contraire, lesdits investisseurs étaient censés
connaître la situation économique hautement instable
déterminant la fluctuation de la valeur des titres de créance
grecs acquis par eux ainsi que le risque non négligeable d’une
cessation de paiement. De telles transactions s’effectuaient
sur des marchés particulièrement volatils, souvent soumis à
des aléas et à des risques non contrôlables s’agissant de
la baisse ou de l’augmentation de la valeur de tels titres,
ce qui pouvait inciter à spéculer pour obtenir des rendements
élevés dans un laps de temps très court. Dès lors, à
supposer même que tous les requérants ne fussent pas engagés
dans des transactions de nature spéculative, ils devaient être
conscients desdits aléas et risques quant à une éventuelle
perte considérable de la valeur des titres acquis. Cela est d’autant
plus vrai que, même avant le début de sa crise financière en
2009, l’État grec émetteur faisait déjà face à un
endettement et à un déficit élevés (paragraphe 54 ci-dessus). 119.
La Cour estime donc que la Grèce, en prenant les mesures
litigieuses, n’a pas rompu le juste équilibre entre l’intérêt
général et la protection des droits de propriété des
requérants et qu’elle n’a pas fait subir aux
intéressés une charge spéciale excessive. 120.
Eu égard à ces considérations, la Cour conclut que, compte
tenu de la large marge d’appréciation dont les États
contractants jouissent en ce domaine, les mesures en cause ne
sauraient être considérées comme disproportionnées à leur
but légitime. Partant, elle estime qu’il n’y a pas eu
en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1. DÜRRÜ MAZHAR ÇEVIK ET ASUMAN MÜNIRE ÇEVIK
DAGDELEN c. TURQUIE du
14 avril 2015 requête n 2705/05 Violation
article 1 du Protocole 1 : La suppression du titre de propriété
sur un terrain est une atteinte au bien au sens de l'article 1 du
Protocole 1. CEDH 31. Sur
le fond, la Cour relève que les requérants se plaignent de l’inscription
de leurs terrains au nom du Trésor public en l’absence de
toute indemnisation en leur faveur. 32. Le
Gouvernement récuse les griefs présentés. Selon lui, il n’y
a eu aucune ingérence, dans la mesure où les requérants ne
possédaient pas de titre de propriété pour les terrains en
question, du fait que leurs limites n’avaient pas été
désignées par les autorités cadastrales. À
supposer qu’il y ait bien eu une ingérence, le Gouvernement
fait valoir que l’enregistrement au nom du Trésor public a
eu lieu par la voie d’une décision judiciaire, que cette
décision relevait de l’intérêt public et qu’elle
était destinée à assurer la protection de l’environnement. 33. La
Cour observe qu’en 1958, l’ascendante des requérants,
Z.B.C, avait acquis deux titres de propriété sur deux terrains
situés dans la région de Dikili à Izmir, et dont les limites n’avaient
pas été précisées par les autorités du cadastre. Après les
travaux de cadastre effectués dans la région de Dikili en 1981,
le tribunal du cadastre a ordonné l’inscription d’une
partie des terrains au nom du Trésor public au motif que ceux-ci
faisaient partie d’un marais et contenaient des sources d’eaux
chaudes et il a ordonné l’inscription du reste des terrains
au nom des requérants. 34. La
Cour relève que les terrains litigieux avaient été inscrits en
1958 au registre foncier au nom de Z.B.C. Bien que le
Gouvernement conteste les effets juridiques de cette inscription
sur le droit de propriété des requérants, la validité de
cette dernière n’a pas été contestée par les parties.
Dès lors, la Cour conclut que les requérants avaient un « bien »
au sens de l’article 1 du Protocole no 1. 35. La
Cour a déjà examiné des cas similaires concernant l’annulation
de titres de propriété à raison du fait que les terrains
litigieux ne pouvaient faire l’objet d’une propriété
privée et a conclu à la violation de l’article 1 du
Protocole no 1 (voir parmi d’autres, N.A. et autres c.
Turquie, no 37451/97, §§ 38-43, CEDH 2005-X).
En effet, elle a dit que, sans le versement d’une somme
raisonnable en rapport avec la valeur du bien, une privation de
propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu’une
absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur
le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des
circonstances exceptionnelles (voir, mutatis mutandis, Jahn et
autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111, CEDH 2005-VI,
et Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 71,
série A no 301-A). 36. Dans
la présente affaire, même si les raisons pour lesquelles les
terrains ont été récupérés par l’État sont
différentes, du fait qu’il s’agissait de sources d’eaux
chaudes et d’un marais, une partie importante des biens des
requérants a, par une décision judiciaire, été inscrite au
nom de l’État dans le registre foncier sans qu’il y
ait lieu à indemnisation, au motif que les terrains en cause ne
pouvaient faire l’objet d’une propriété privée. À
cet égard, la Cour constate effectivement que les requérants n’ont
reçu aucune indemnisation à la suite du transfert d’une
partie de leur bien au Trésor public. Or, l’examen du
dossier ne révèle aucune circonstance exceptionnelle de nature
à justifier une absence totale d’indemnisation (N.A. et
autres, précité, §§ 41-42). 37. À
la lumière de ce qui précède, la Cour considère que sa
jurisprudence s’applique également à la présente affaire
(voir, par exemple, I.R.S. et autres c.Turquie, no 26338/95, 20 juillet 2004, et N.A.
et autres, précité). La Cour constate qu’en l’espèce
le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument
convaincant pouvant mener à une conclusion différente. 38. Partant,
il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no1. SILAHYÜREKLI
c. TURQUIE du 26 novembre 2013 requête n°16150/06 LE
CLASSEMENT D'UN TERRAIN EN SITE ARCHEOLOGIQUE ET NATUREL SUPPRIME
LE TITRE DE PROPRIETE CEDH 33. La
Cour note d’abord que le requérant ne se plaint pas du
classement du terrain litigieux en site archéologique et naturel
ainsi que des restrictions pouvant en résulter pour son droit de
propriété, mais uniquement de l’annulation de son titre de
propriété. A cet égard, la Cour estime que le requérant
disposait d’un droit protégé par l’article 1 du
Protocole no 1 dans la mesure où il était titulaire, jusqu’à
son annulation, d’un titre de propriété parfaitement
valide. La Cour considère que l’annulation du titre de
propriété du requérant constitue une ingérence dans son droit
au respect de ses biens, laquelle s’analyse en une «
privation » de propriété au sens de la seconde phrase du
premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Brumarescu
c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII). 34. Elle
observe que le terrain litigieux est classé en site naturel et
archéologique. Cependant, au cours de la procédure devant le
tribunal de grande instance de Kale, il a en outre été
constaté qu’une partie de ce terrain faisait partie du
domaine public littoral et le titre de propriété correspondant
à cette partie a été annulé pour cette raison. Le domaine
public littoral étant soumis à un régime juridique différent,
la Cour estime nécessaire de l’examiner séparément du
reste du terrain. a) La
partie du terrain classée en site naturel et archéologique 35. L’article
1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une
ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du
droit au respect des biens soit légale. La prééminence du
droit, l’un des principes fondamentaux d’une société
démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de
la Convention (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II).
Le principe de légalité présuppose l’existence de normes
de droit interne suffisamment accessibles, précises et
prévisibles (Hentrich c. France, 22 septembre 1994, §
42, série A no 296-A, Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8
juillet 1986, § 110, série A no 102, et Fener Rum Erkek Lisesi
Vakfi c. Turquie, no 34478/97, § 50, 9 janvier 2007). 36. La
Cour observe que le tribunal de grande instance de Kale a annulé
le titre de propriété du requérant après avoir conclu que le
jugement rendu le 7 octobre 1942 par le tribunal d’instance
de Kas n’était pas juridiquement valide. Pour cela, le
tribunal de grande instance a relevé, d’une part, que l’action
avait alors été introduite sans qu’aucune partie à la
procédure ne fût désignée ni invitée par la suite à
participer à la procédure ; et, d’autre part, que le
jugement en question n’avait pas fait l’objet d’un
pourvoi en cassation. Le tribunal en a conclu que le titre de
propriété relatif à ce terrain reposait sur une décision de
justice rendue au terme d’une procédure ne remplissant pas
les conditions de validité posées par la loi. Il a estimé qu’une
telle décision et l’inscription consécutive au registre
foncier ne liaient pas le Trésor. 37. La
Cour note que dans son jugement du 7 octobre 1942 le tribunal d’instance
de Kas jugea que S.K. avait acquis par voie de prescription, en
application de l’article 639 de l’ancien code civil, la
propriété du terrain litigieux. Or selon cette disposition, l’action
en prescription acquisitive devait être introduite contre le
Trésor et l’administration concernée. C’est le non-respect
de cette dernière exigence procédurale qui a conduit le
tribunal de grande instance de Kale à conclure à l’invalidité
du jugement de 1942. Le Gouvernement allègue aussi la
méconnaissance des normes de fond, alors que la décision
relative à l’annulation du titre de propriété n’en
fait pas mention. 38. La
Cour note que le requérant avait acheté ce bien en 2002 et l’avait
alors fait inscrire à son nom sur le registre foncier. Selon ses
explications, non contestées par le Gouvernement, il était le
dixième propriétaire de ce terrain. Entre le propriétaire
initial et le requérant, le bien est donc devenu successivement
la propriété de différentes personnes. Il ne ressort
aucunement du dossier que les propriétaires successifs de ce
terrain se sont vu contester leur titre de propriété. 39. Pour
la Cour, il ne fait aucun doute qu’au moment de son
acquisition en 2002, le requérant avait la certitude que cette
transaction était conforme au droit turc. En effet, la
régularité de l’inscription au registre foncier et la
validité du titre de propriété ne prêtaient pas à
controverse au regard du droit interne. Le requérant pouvait
légitimement se croire en situation de « sécurité
juridique » quant à la validité de son titre de
propriété, jusqu’à son annulation par le tribunal de
grande instance de Kale. Le registre foncier ne contenait aucune
indication quant à l’invalidité du jugement de 1942 ni
aucune autre mention permettant de douter de la validité du
droit de propriété relatif à ce terrain. Quant au classement
du terrain en site naturel et archéologique, qui en revanche
était connu du requérant, il ne constituait pas un empêchement
à l’acquisition du terrain par voie d’achat. La Cour
note en outre que la bonne foi du requérant quant à l’acquisition
du bien en question n’a été contestée ni au niveau
national ni devant elle. 40. Par
conséquent, on ne saurait considérer que l’annulation du
titre de propriété du requérant à la suite de l’invalidation
du jugement du 7 octobre 1942, plus de soixante ans après,
était prévisible. En effet, le requérant ne pouvait
raisonnablement prévoir que son titre de propriété serait
annulé par le biais d’une remise en cause du jugement ayant
servi de fondement à la constitution du titre de propriété
initial. 41. La
Cour note en outre que l’ingérence dans le droit de
propriété du requérant ne peut reposer sur la loi no 2863 et
la loi no 3402 comme le prétend le Gouvernement. 42. S’agissant
d’abord de la loi no 2863 (loi relative à la protection du
patrimoine culturel et naturel) qui était en vigueur lorsque le
requérant acheta le bien, la Cour observe que l’article 11
de cette loi n’interdit que l’acquisition de la
propriété des lieux classés en patrimoine culturel et naturel
par la voie de la prescription acquisitive. Or cette interdiction
n’est pas pertinente dans le chef du requérant, puisqu’il
est devenu propriétaire de ce terrain en l’achetant. La
Cour relève également que cette même loi donne à l’Etat
la possibilité d’exproprier les lieux classés au titre de
la protection du patrimoine culturel et naturel et appartenant à
des personnes privées. Dans le cas du requérant, les pouvoirs
publics n’ont pas utilisé cette voie. 43. Quant
à la loi no 3402 (loi sur le cadastre), la Cour note que le
Gouvernement évoque des travaux de cadastre réalisés en 1999
sans apporter plus de précisions sur ce point ou produire des
documents relatifs à ces travaux. En tout état de cause, il
ressort des observations du Gouvernement que ces travaux ont
alors confirmé le titre de propriété existant et ne remettait
aucunement en question la validité du jugement du 7 octobre
1942. 44. Enfin,
la Cour note que la présente affaire diffère sensiblement de la
matière des décisions citées par le Gouvernement. Dans les
affaires en question, les terrains des requérants avaient été
frappés d’une interdiction de construire, mesure qui s’analyse
en une réglementation de l’usage des biens, tandis que dans
la présente affaire, le titre de propriété du requérant a
purement et simplement été annulé, ce qui s’analyse en
une privation du droit de propriété. Aussi, les affaires
citées par le Gouvernement ne sauraient être pertinentes dans l’examen
de la présente affaire. 45. A
la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence
litigieuse n’est pas compatible avec le principe de
légalité et qu’elle a donc méconnu le droit du requérant
au respect de ses biens. 46. Il
y a eu donc violation de l’article 1 du Protocole no 1 sur
ce point.
b) La
partie du terrain faisant partie du domaine public littoral 47. Ici
la Cour estime que l’ingérence dans le droit du requérant
au respect de ses biens avait une base légale – l’article
43 de la Constitution – et poursuivait un but légitime qui
était dans l’intérêt général : protéger le littoral et
permettre le libre accès au rivage (N.A. et autres c. Turquie,
no 37451/97, § 40, CEDH 2005-X). 48. La
Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit
au respect des biens doit en outre ménager un « juste
équilibre » entre les exigences de l’intérêt général
de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu. En particulier, il doit exister
un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé par une mesure privant une personne de
sa propriété (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 93, CEDH 2006-V).
Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste
équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le
requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre
en considération les modalités d’indemnisation prévues
par la législation interne. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle
a déjà examiné un grief identique à celui du requérant et
conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (N.A.
et autres, précité, §§ 41-43). En effet, elle a dit que, sans
le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la
valeur du bien, une privation de propriété constitue
normalement une atteinte excessive, et qu’une absence totale
d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article
1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles. 49. La
Cour constate qu’en l’espèce le Gouvernement n’a
fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent. Le requérant n’a
reçu aucune indemnisation à la suite de l’annulation de
son titre de propriété. Or l’examen du dossier ne révèle
aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence
totale d’indemnisation. 50. Partant,
il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no1. ION
CONSTANTIN C. ROUMANIE du 27 MAI 2010 Requête n° 38513/03 Un droit de
propriété obtenu légalement est annulé par les tribunaux onze
ans après. 9. Après
la reconstitution de son droit de propriété sur le terrain, le
père du requérant, puis le requérant lui-même, après l’acte
de donation, pouvaient légitimement espérer bénéficier
paisiblement du droit de propriété. Ce n’est que onze ans
plus tard, période pendant laquelle le requérant et son père
ont exploité ensemble le terrain, que les autorités locales ont
entamé des démarches pour éclaircir la situation juridique du
terrain. 40. La Cour
estime en outre qu’il revenait aux autorités locales et
départementales compétentes pour assurer la reconstitution
effective du droit de propriété du requérant de porter à la
connaissance de celui-ci, par une décision formelle, les raisons
de la modification de l’emplacement de son terrain et de
faire les démarches nécessaires pour s’assurer que son
droit de propriété valable, reconnu en vertu de la loi no
18/1991, soit concret et effectif (mutatis mutandis, Ioachimescu
et Ion c. Roumanie, no 18013/03, § 31,
12 octobre 2006 et Grosu c. Roumanie, no 2611/02,
§ 52, 28 juin 2007). 41. La Cour
note à cet égard que l’article II de la loi no
169/1997 prévoyait que les modifications apportées à la loi no
18/1991 ne pouvaient pas porter atteinte aux droits de
propriété déjà reconstitués dans le respect des dispositions
de cette dernière loi. Seule la nullité absolue des actes
délivrés à des personnes physiques pour non-respect des
dispositions de la loi no 18/1991
pouvait être invoquée pour modifier les situations juridiques
créées. Dès lors, la constatation de nullité absolue
constituait le préalable à l’adoption de tout nouvel acte
juridique en vertu de la nouvelle loi, afin d’assurer une
cohérence dans l’application des dispositions légales. Or
en l’espèce, et à la différence de l’affaire Ioan précitée,
les juridictions nationales ont annulé tant l’acte
administratif d’attribution dans le domaine de la commune de
Oarja du terrain de 194 hectare, dont faisait partie le terrain
litigieux de 1,30 hectares, que le titre individuel de
propriété sur ce dernier terrain, émis en faveur du père du
requérant. Toutefois, le titre de propriété de D.I. a été
délivré avant que la nullité absolue du titre du requérant
soit prononcée, donc en violation des dispositions légales
susmentionnées. 42. La Cour
peut accepter que l’annulation de la décision dans sa
partie concernant le terrain de 194 ha était nécessaire pour
assurer la reconstitution du droit de propriété des habitants
de Bradu, sans quoi ces derniers auraient également pu se
plaindre d’une violation de leur droit de propriété, dans
la mesure où ils avaient le droit de se voir délivrer des
titres de propriété (a contrario Gashi précité, § 40).
Cependant, la Cour rappelle avoir jugé que l’atténuation
de certaines atteintes ne doit pas créer de nouveaux torts
disproportionnés (voir, mutatis mutandis, Pincová et Pinc, no 36548/97,
CEDH 2002-VIII, § 58, et Raicu c. Roumanie, no
28104/03, § 25, 19 octobre 2006) et que les erreurs
des autorités administratives ne doivent pas être supportées
exclusivement par les particuliers en cause. Il ne revient pas au
bénéficiaire d’un titre administratif de propriété, qui
a eu la possession d’un terrain pendant onze ans, et dont le
titre a été annulé après quinze ans, comme dans le cas d’espèce,
de supporter les conséquences du système administratif mis en
place, lequel a abouti en l’espèce à la coexistence, au
moins jusqu’au moment de l’annulation du titre du
requérant, de deux titres administratifs sur le même terrain,
portant ainsi atteinte au principe de la sécurité des rapports
juridiques. 43. La Cour
rappelle avoir déjà examiné dans d’autres affaires la
question de l’annulation par les tribunaux internes, après
plusieurs années, de titres de propriété ou de contrats de
vente délivrés ou conclus avec les autorités. Qu’il s’agisse
de l’application de la législation spécifique relative à
la réparation des injustices commises par un ancien régime ou
de l’attribution ou de la vente d’un bien par les
autorités en vertu de dispositions légales d’autre nature,
la Cour a toujours pris en compte, comme un critère essentiel
dans l’examen de la proportionnalité de la privation, la
question de la responsabilité des parties dans l’irrégularité
sanctionnée par l’annulation du titre et le caractère
essentiel ou au contraire plutôt mineur de cette irrégularité
(voir, entre autres et mutatis mutandis, Velikovi et autres c. Bulgarie,
nos 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99,
51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01 et 194/02, § 186, 15 mars
2007 ; Gashi c. Croatie, no 32457/05,
§§ 33-40, 13 décembre 2007, Ichim c. Roumanie, no 164/02,
§ 38, 10 mars 2009, Toscuta et autres c. Roumanie, no 36900/03,
§ 38, 25 novembre 2008, et Ciovica c. Roumanie,
no 3076/02, § 92, 31 mars 2009). 44. En l’espèce,
la Cour ne décèle pas des éléments conduisant à conclure que
le comportement du requérant serait dans une quelconque mesure
à l’origine de l’annulation de son titre de
propriété (voir, a contrario, l’affaire Elena et Mihai
Toma c. Roumanie, no 16563/03, décision
d’irrecevabilité du 12 janvier 2010). 45. La Cour
considère dès lors que l’annulation du titre de
propriété du requérant a été exclusivement justifiée par
des faits imputables aux autorités et sans qu’il se soit vu
verser une quelconque indemnité ou proposer un terrain
équivalent (voir Toscuta et autres c. Roumanie, no
36900/03, § 38, 25 novembre 2008). 46. Ces
éléments suffisent à la Cour pour rejeter l’exception d’incompatibilité
ratione materiae soulevée par le Gouvernement et conclure que l’État
a manqué à son obligation d’assurer au requérant la
jouissance effective de son droit de propriété garanti par l’article
1 du Protocole no1. COUR
DE CASSATION FRANÇAISE LE CLASSEMENT D'UN
CHEMIN N'EST PAS UN TITRE DE PROPRIETE, LE JUGE JUDICIAIRE N'A
PAS POUVOIR D'ENJOINDRE L'ADMINISTRATION Cour de
Cassation chambre civile 3, du 16 mai 2019 pourvoi n° 17-26.210
cassation partielle sans renvoi Mais attendu qu’ayant
retenu à bon droit que la délibération du conseil municipal
classant un chemin dans la voirie communale ne constitue pas un
titre de propriété et que, en cas de revendication, il
appartient à la commune de fonder son droit de propriété sur
un titre ou sur la prescription acquisitive, la cour d’appel,
qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses
constations rendaient inopérante, a légalement justifié sa
décision en retenant, sans en dénier le caractère exécutoire,
que ni les délibérations successives du conseil municipal ayant
notamment classé le chemin dans la catégorie des voies
communales le 15 mars 1962, approuvé le tableau de classement de
ces voies le 29 août 1964 ou approuvé la carte communale le 24
juillet 2003, ni le plan de réorganisation foncière homologuant
le plan des voies communales, devenu définitif à la suite de l’arrêté
préfectoral du 2 juin 1999, ni l’arrêté d’alignement
individuel du 20 mai 1999 ne constituaient des titres de
propriété ; Mais sur le moyen relevé d’office, après
avis donné aux parties en application de l’article 1015 du
code de procédure civile Vu l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790
et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que, pour condamner, sous astreinte, la
commune de Gorrevod à procéder au déclassement du chemin, l’arrêt
retient qu’il constitue un chemin d’exploitation qui,
en l’absence de titre en attribuant la propriété exclusive
aux consorts X..., est présumé appartenir aux propriétaires
riverains, chacun en droit soi, et est affecté à un usage
commun ; Qu’en statuant ainsi, alors que, en l’absence
de voie de fait, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre
à l’administration de déclasser un bien ayant fait par
erreur l’objet d’une décision de classement dans la
voirie communale, et qu’un tel classement, bien qu’illégal,
n’est constitutif d’une voie de fait que s’il
procède d’un acte manifestement insusceptible de se
rattacher à l’un des pouvoirs de l’administration, la
cour d’appel a violé les textes susvisés ; Cliquez
sur les boutons pour accéder aux informations juridiques et aux
modèles gratuits. Cliquez sur un
lien bleu pour accéder : - A L'EXPROPRIATION
D'UN BIEN DANS UN BUT D'INTERÊT GENERAL - EN MATIÈRE
DE DÉLAI TROP LONG ENTRE LA DATE DE L'EXPROPRIATION
ET LE DÉBUT DES TRAVAUX PUBLICS - AUX
REQUÉRANTS QUI NE PEUVENT BÉNÉFICIER D'UN
EFFET D'AUBAINE - QUAND LE BUT D'INTERÊT
GÉNÉRAL EST ABANDONNÉ - la jurisprudence
française. EXPROPRIATION DANS L'INTERÊT GENERAL ARSIMIKOV
ET ARSEMIKOV c. RUSSIE du 9 juin 2020 requête n° 41890/12 Art
1 P1 • Privation de propriété • Démolition de
la maison du requérant, déclarée en péril, par les autorités
et dans le cadre de la reconstruction de la ville • Non-respect
de la procédure obligatoire d’expropriation pour cause d’utilité
publique • Prévention des risques liés à l’occupation
d’immeubles dangereux • Octroi d’un bail social à
titre d’indemnisation • Appartement inhabitable et
contrat de bail annulé sans autre réparation 57. Le
premier requérant estime que les autorités ont commis à son
égard des infractions pénales. Il se plaint d’avoir été de
facto exproprié arbitrairement de sa maison, et considère que l’appartement
dont il était devenu locataire ne constitue pas une
indemnisation valable de son préjudice. 58. Renvoyant
aux conclusions des juridictions internes, le Gouvernement
soutient pour sa part que le premier requérant n’a pas
démontré de manière incontestable que les autorités
tchétchènes aient joué un rôle dans la destruction de sa
maison. Il argue que ces autorités n’ont jamais pris de
mesures d’expropriation à l’égard de l’intéressé,
et que ce sont des personnes privées inconnues qui ont démoli
la maison. 59. La
Cour rappelle que, pour être compatible avec l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention, une ingérence doit remplir
trois conditions : elle doit être effectuée « dans
les conditions prévues par la loi », « pour cause d’utilité
publique » et dans le respect d’un juste équilibre
entre les droits du propriétaire et les intérêts de la
communauté (Tkachenko, précité, § 50). a) Sur
la légalité et le but d’utilité publique de l’ingérence 60. La
Cour observe ce qui suit. Par un acte du 4 juin 2010, la
commission pluridisciplinaire a déclaré la maison du premier
requérant en péril et à démolir. Le 1er avril 2011, la
commission du logement de la mairie de Grozny a décidé de louer
un appartement à l’intéressé dans le cadre d’un
contrat de bail social, qu’il a signé le même jour. Puis,
le 29 mars 2012, les juridictions nationales ont annulé le
contrat au motif que l’appartement était inhabitable. Par
ailleurs, les autorités internes ont reconnu que la maison du
requérant avait été démolie non seulement pour cause de
péril, mais aussi dans le cadre de la reconstruction de la ville
(paragraphes 19, 22 et 23 ci-dessus). Partant, la Cour ne peut
accepter la thèse du Gouvernement consistant à dire que les
autorités tchétchènes n’ont joué aucun rôle dans la
démolition du bâtiment. 61. Il
apparaît que si les autorités ont procédé à la démolition
pour les besoins de la reconstruction de la ville, elles n’ont
pas respecté la procédure obligatoire d’expropriation pour
cause d’utilité publique (paragraphe 37 ci-dessus).
Cependant, il a aussi été avancé que la maison avait été
démolie pour cause de péril. 62. Bien
que les parties n’aient pas émis d’observations à ce
sujet, la Cour note que le droit russe prévoit la procédure et
les modalités d’adoption des déclarations de péril
rendant nécessaire la démolition d’un bâtiment, ainsi que
les droits des propriétaires en pareil cas. Il ressort en
particulier des dispositions internes que, lorsqu’un
bâtiment déclaré en péril doit être démoli, les autorités
doivent d’abord le racheter ou, avec l’accord du
propriétaire, attribuer à celui-ci un autre logement (paragraphes
35-36 ci-dessus). La Cour considère que, quelle qu’eût
été la procédure légale dans cette situation, dès lors que
le premier requérant n’a contesté ni l’acte du 4 juin
2010, qui avait été dressé plus d’un an avant l’ingérence
alléguée, ni la décision du 1er avril 2011 et qu’il a
signé le contrat de bail social, il a renoncé à son droit au
rachat de son bien par les autorités et il a accepté le bail
social à titre d’indemnisation. 63. La
Cour considère donc que la démolition de la maison du premier
requérant avait pour base légale les dispositions relatives aux
habitats en péril et poursuivait au moins un but d’utilité
publique, à savoir la prévention des risques liés à l’occupation
d’immeubles dangereux (voir, pour une situation similaire, Saliy
c. Russie (déc.) [comité], no 3068/06, 26 septembre 2017). b) Sur
la proportionnalité de l’ingérence 64. La
Cour rappelle que, afin d’apprécier si la mesure litigieuse
respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait
pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a
lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation
prévues par la législation interne (Platakou c. Grèce, no 38460/97, § 55, CEDH 2001-I). 65. En
l’espèce, elle estime que, en principe, un bail social
aurait pu représenter une indemnisation adéquate pour la
démolition de la maison en cause, d’autant que les
locataires de logements sociaux peuvent en obtenir gratuitement
la propriété (paragraphe 38 ci-dessus). Toutefois, l’appartement
qui a été fourni au premier requérant était inhabitable :
il n’était raccordé ni au gaz ni à l’électricité
ni au tout-à-l’égout, et il n’avait ni portes
intérieures ni planchers. Qui plus est, après que le contrat de
bail social a été annulé, les autorités n’ont rien fait
pour offrir au premier requérant une autre réparation. En
conséquence, près de neuf ans après la démolition de sa
maison, l’intéressé n’a toujours pas obtenu d’indemnisation. 66. Dans ces
conditions, la Cour considère que l’ingérence dont se
plaint le premier requérant a fait peser sur lui une charge
disproportionnée et excessive, et qu’elle a ainsi rompu le
« juste équilibre » à ménager entre la protection
du droit au respect des biens et les exigences de l’intérêt
général. Partant, elle rejette l’exception tirée de ce
que le requérant n’aurait pas subi de préjudice important
puisqu’il avait bénéficié d’un bail social, et elle
conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention. Svitlana
Ilchenko c. Ukraine du 4 juillet 2019 requête n° 47166/09 Violation de l'article
1 du Protocole 1 : La démolition d’un garage sans octroi d’une
indemnité calculée selon une procédure en bonne et due forme a
emporté violation des droits de la requérante. L’affaire
concerne la démolition du garage de la requérante visant à
libérer un terrain en vue de la construction de logements
commerciaux. La Cour juge en particulier que la requérante, qui
possédait le garage et utilisait le terrain sousjacent depuis
les années 1980, a en fin de compte été traitée comme un
squatter par la justice et qu’il n’a été tenu aucun
compte du caractère spécifique de sa situation. La requérante
a simplement été invitée à négocier une possible indemnité
allouée à titre gracieux et les autorités n’ont pas
engagé de procédure en bonne et due forme pour calculer une
réparation équitable fondée sur la valeur marchande du bien FAITS Mme Ilchenko
était propriétaire d’un garage, enregistré à son nom en
février 1995, qui se trouvait dans la cour de son immeuble d’habitation.
Elle utilisait le garage, ainsi que le terrain sur lequel il
était bâti, depuis les années 1980. En 2002, les autorités
locales commencèrent à élaborer un projet de construction de
logements commerciaux englobant le terrain sur lequel était sis
le garage, lequel devait par conséquent être démoli. Elles
invitèrent Mme Ilchenko à négocier une indemnisation sur une
base informelle, mais celle-ci ne donna pas suite à ces offres.
Une procédure judiciaire s’ouvrit en juillet 2003. Le
tribunal de première instance trancha en faveur de Mme Ilchenko
en février 2004, mais ce jugement fut annulé en appel et des
huissiers firent démolir le garage en août 2005. En février
2006, la Cour suprême annula ces deux jugements et renvoya l’affaire
aux juridictions inférieures en leur demandant d’éclaircir
la question du statut du terrain sur lequel le garage avait été
sis. En mai 2007, le tribunal de première instance qui
réexamina l’affaire conclut que Mme Ilchenko avait disposé
d’un permis temporaire pour la construction d’un garage
et que le terrain ne lui avait jamais été cédé. Se fondant
sur une disposition du code foncier régissant l’occupation
non autorisée de terrains, il ordonna à Mme Ilchenko d’évacuer
les lieux. La Cour suprême confirma ces conclusions en 2009. LE DROIT :
VIOLATION DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1 La Cour note que
le droit de Mme Ilchenko sur le garage est demeuré incontesté
pendant vingt ans, jusqu’à ce que les autorités ne
commencent à élaborer le projet d’immeuble résidentiel.
Qui plus est, l’absence d’autorisation pour le garage
ne résultait apparemment pas d’un manquement à la
législation qui aurait été commis à l’époque où le
garage avait été construit mais s’expliquait plutôt par
le passage de la législation de l’ère soviétique, qui ne
reconnaissait ni la propriété foncière privée ni les baux
classiques, au système actuel. La Cour doit alors
rechercher si l’ingérence des autorités dans l’exercice
par Mme Ilchenko de ses droits patrimoniaux était proportionnée
ou servait une cause d’utilité publique. Elle prend note
des arguments de Mme Ilchenko, qui avançait que le projet visait
la construction d’appartements de luxe destinés à être
commercialisés, que la zone du centre de Kiev concernée
présentait déjà une forte densité de population, et que ce
projet n’avait fait qu’intensifier les pressions sur l’infrastructure
locale. Le Gouvernement n’a
pas répondu à ces arguments. La Cour dit que ce projet
immobilier ne servait pas un intérêt général si impérieux qu’il
justifiât que Mme Ilchenko fût privée de son bien sans être
indemnisée. D’ailleurs, ayant été qualifiée de squatter
par la justice, celle-ci ne pouvait prétendre à une réparation
et aurait pu être contrainte à rembourser les frais de
démolition à la ville. Les tribunaux n’ont tenu aucun
compte des spécificités de sa situation. Il est vrai que Mme
Ilchenko n’a pas donné suite à une proposition de
négociation, mais, compte tenu de la manière dont les
juridictions internes ont interprété sa situation, elle n’aurait
dans le cas contraire perçu qu’une indemnité versée à
titre gracieux au lieu de recevoir une réparation entourée de
garanties juridiques et fondée sur un droit. Son défaut de
coopération à la négociation de l’indemnité ne s’analyse
donc pas en un renoncement à ses droits. En réalité, il n’existait
pas pour ce type de négociations de cadre juridique qui lui eût
permis d’obtenir les informations nécessaires pour prendre
une décision éclairée. Le Gouvernement est resté silencieux
sur le montant qui lui aurait été proposé ou sur le mode de
calcul qui aurait été retenu, faute d’une procédure
établie à cet effet. Dans les circonstances de l’espèce,
seule une indemnité définie dans le cadre d’une procédure
aboutissant à une appréciation globale des conséquences de l’expropriation
et à l’attribution d’une somme correspondant à la
valeur marchande du bien pouvait satisfaire aux exigences de la
Convention. Mme Ilchenko ne s’étant
pas vu offrir une telle réparation entourée des garanties
adéquates, elle a donc subi une violation de ses droits au
regard de l’article 1 du Protocole n° 1. MAUPAS
et autres c. FRANCE du 19 septembre 2006 requête 13844/02 17. L'expropriation d'une partie du
bien des requérants constitue manifestement une privation de
propriété, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article
1 du Protocole no 1. 18. La Cour doit en premier lieu
déterminer si cette privation de propriété reposait sur une « cause
d'utilité publique » au sens de cette disposition. Elle
rappelle à cet égard qu'elle reconnaît aux Etats contractants
et aux autorités qui en constituent l'émanation, une grande
marge d'appréciation pour juger si, dans telles ou telles
circonstances, une question de cette nature se pose et justifie
des privations de propriété (voir, pour exemples, les arrêts James
et autres c. Royaume-Uni, du 26 juin 1985, série A no
98-A, § 46, et Motais de Narbonne c. France, no 48161/99,
du 2 juillet 2002, § 18) ; elle respecte la
manière dont ils conçoivent les impératifs d'« utilité
publique » au sens de l'article 1 du Protocole no
1 sauf si leur jugement se révèle manifestement dépourvu de
base raisonnable (arrêt James et autres précité, mêmes
références). Elle ne saurait donc se substituer aux autorités
internes pour évaluer l' « utilité publique »
de l'aménagement dont la réalisation fonde l'expropriation des
requérants, et il lui suffit en l'espèce de relever que la « cause
d'utilité publique » se trouvait en l'occurrence dans la
réalisation d'un ouvrage destiné à l'usage de la collectivité. 19. Toute ingérence dans le droit au
respect des biens doit aussi ménager un « juste équilibre »
entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et
les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, il doit exister un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le
but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ;
l'équilibre à ménager entre les exigences de l'intérêt
général et les impératifs des droits fondamentaux est rompu si
la personne concernée a eu à subir « une charge
disproportionnée » (voir, parmi beaucoup d'autres, les
arrêts Saints monastères c. Grèce, du 9 décembre 1994,
Série A no 301-A, §§ 70-71, et Motais
de Narbonne, précité, § 19). La Cour a en conséquence jugé
que l'individu exproprié doit en principe obtenir une
indemnisation « raisonnablement en rapport avec la valeur
du bien » dont il a été privé, même si « des
objectifs légitimes « d'utilité publique » (...)
peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine
valeur marchande » (ibidem) ; il en résulte que,
sous cet angle, l'équilibre susmentionné est en règle
générale atteint lorsque l'indemnité versée à l'exproprié
est raisonnablement en rapport avec la valeur « vénale »
du bien, telle que déterminée au moment où la privation de
propriété est réalisée (arrêt Motais de Narbonne précité,
mêmes références). Par ailleurs, notamment, nonobstant le silence de
l'article 1 du Protocole no 1 en
matière d'exigences procédurales, les procédures applicables
en l'espèce doivent offrir à la personne concernée une
occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes
afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux
droits garantis par cette disposition ; pour s'assurer du
respect de cette condition, il y a lieu de considérer les
procédures applicables d'un point de vue général (voir, par
exemple, les arrêts AGOSI c. Royaume-Uni, du 24 octobre 1986,
série A no 108, § 55, Hentrich c.
France, du 22 septembre 1994, série A no
296-A, § 49, et Jokela c. Finlande, du 21 mai 2002, no
28856/95, CEDH 2002-IV, § 45). 20. Sur ce second point, la
Cour relève en l'espèce que, comme tout riverain, les
requérants pouvaient, en droit, saisir le juge administratif d'une
recours en excès de pouvoir contre le décret portant
déclaration d'utilité publique du 17 mars 1995 (lequel avait
fait l'objet de mesures de publicité) et obtenir ainsi un
contrôle juridictionnel effectif de la « cause d'utilité
publique » fondant l'expropriation dont ils ont fait l'objet. Il est vrai que le tracé initial de l'infrastructure
litigieuse, tel que présenté lors de l'enquête publique et
retranscrit sur le plan annexé au décret du 17 mars 1995
déclarant l'utilité publique du projet, épargnait la
propriété des requérants. Le tracé a été modifié par
la suite, après la clôture de l'enquête publique ; il
passe désormais sur la propriété des requérants. Ils n'ont eu
connaissance de cette modification qu'à la fin de l'année 1997,
après expiration du délai de recours contre le décret d'utilité
publique, à l'occasion de l'enquête parcellaire organisée dans
le contexte de la procédure d'expropriation. 21. Il apparaît ainsi que les
requérants n'avaient initialement pas de motif lié à la
privation de leur propriété d'user de cette procédure puisque
le tracé soumis à enquête publique et annexé à ce décret
épargnait leur propriété, et qu'ils n'ont su que celle-ci
était finalement concernée par l'opération qu'après la
clôture du délai de recours contre ledit décret. Ainsi, in
concreto, ils se sont trouvés privés de l'opportunité de
bénéficier de cette voie procédurale pour obtenir un contrôle
juridictionnel du fondement de l'expropriation dont ils ont fait
l'objet. Néanmoins, comme le souligne le Gouvernement,
les requérants avaient également la possibilité, dans le cadre
de leur recours contre l'arrêté de cessibilité, de soulever
par voie d'exception l'illégalité du décret du 17 mars 1995
portant déclaration d'utilité publique et d'obtenir ainsi un
contrôle juridictionnel de l'acte fondant l'expropriation
litigieuse ; par cette voie, ils auraient pu parvenir à l'annulation
de cet arrêté sur le fondement de l'illégalité dudit décret,
ce qui aurait fait obstacle au transfert de propriété. En sus,
ils eurent, dans les circonstances de leur cause, l'opportunité
de contester la légalité de ce décret dans le cadre d'un
recours en annulation du décret du 15 mars 2000 prorogeant les
effets du premier. Or il apparaît que, contrairement aux
allégations des intéressés, le juge administratif ainsi saisi
ne les a pas déboutés pour tardiveté mais au fond, retenant
notamment que le déplacement de l'échangeur et de l'axe de la
voie litigieux par rapport au projet soumis à l'enquête
publique ne constituait pas une modification substantielle
affectant l'économie générale du projet et rendant nécessaire
une nouvelle procédure de déclaration d'utilité publique (paragraphes
10 et 11 ci-dessus). 22. La Cour constate ensuite que le
montant final de l'indemnité d'expropriation allouée au
requérant a été fixé par les juridictions judiciaires (paragraphe
9 ci-dessus), et que rien ne permet de considérer qu'il n'est
pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien dont ils
ont été privés. 23. La Cour conclut en conséquence
que l'expropriation dont il est question n'a pas rompu le juste
équilibre devant être maintenu entre les exigences de l'intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde
des droits fondamentaux des requérants, et qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 1 du Protocole no
1. 24. Enfin, la Cour estime qu'aucune
question distincte ne se pose en l'espèce sur le terrain de l'article
6 § 1 de la Convention et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner l'affaire
sous l'angle de cette disposition. LE DÉLAI TROP LONG
ENTRE L'EXPROPRIATION ET LES TRAVAUX DU PROJET SONT UNE VIOLATION POULIMENOS
ET AUTRES c. GRÈCE du 20 juillet 2017 Requête n° 41230/12 L'article 1 du
Protocole 1 de la Conv EDH n'a pas été respecté. Le délai
entre la date de la première audience et la date de la décision
est trop long. Le prix du m2 est passé de 420 euros à 1300
euros : En retenant comme date critique pour la détermination de
la valeur du bien exproprié, et donc pour la fixation de l’indemnité
définitive, la date de la première audience tenue au cours de
la procédure devant le tribunal de première instance
relativement à l’établissement de l’indemnité
susmentionnée, soit le 9 novembre 1999, la cour d’appel a
fait abstraction de tout écart qui pouvait exister entre la
valeur de la créance des requérants à cette date et celle à
la date à laquelle elle a statué, soit le 18 janvier 2012. 43.
En l’espèce, la Cour note, dans la mesure où les
requérants se plaignent de la dépréciation de leur indemnité
d’expropriation, que la situation litigieuse relève de la
première phrase du premier alinéa de l’article 1 du
Protocole n° 1 à la Convention, qui énonce de manière
générale le principe du respect des biens (Almeida Garrett,
Mascarenhas Falcao et autres c. Portugal, nos29813/96 et30229/96, §§ 43 et 48, CEDH
2000-I, et Zacharakis, précité, § 29). Dès lors, la Cour doit
rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les
impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu
(voir, parmi d’autres, Nastou c. Grèce (no 2), no16163/02,
§ 31, 15 juillet 2005). 44.
Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la
structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier. En
particulier, il doit exister un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par
toute mesure privant une personne de sa propriété (Pressos
Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, §
38, série A no 332). 45.
Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste
équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le
requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre
en considération les modalités d’indemnisation prévues
par la législation interne. À cet égard, la Cour a déjà dit
que, sans le versement d’une somme raisonnablement en
rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété
constitue normalement une atteinte excessive au droit au respect
des biens (Malama c. Grèce, no43622/98, § 48, CEDH 2001-II). En
particulier, le caractère adéquat d’un dédommagement se
trouverait diminué si son paiement faisait abstraction d’éléments
susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement
d’un laps de temps que l’on ne saurait qualifier de
raisonnable (Angelov c. Bulgarie, no44076/98, § 39, 22 avril
2004, et Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres,
précité, § 54). Dans pareil cas, la Cour recherche
principalement si l’administration a procédé à la
réactualisation de la somme due pour compenser sa dépréciation
en raison du laps du temps écoulé (voir, parmi d’autres, Akkus
c. Turquie, 9 juillet 1997, §§ 29-31, Recueil des arrêts et
décisions 1997-IV, et Zacharakis, précité, § 31). 46.
En l’occurrence, la Cour note d’emblée que, d’après
l’article 17 § 2 de la Constitution, si l’audience
pour la fixation de l’indemnité définitive a lieu plus d’un
an après l’audience sur la fixation de l’indemnité
provisoire, il convient de prendre en compte la valeur à la date
de l’audience pour la fixation de l’indemnité
définitive. Elle en déduit que le but de cette disposition est
de faire en sorte que la date critique pour la fixation de l’indemnité
soit la date la plus proche de celle de son versement aux ayants
droit, afin que la compensation soit « intégrale » comme l’exige
ce même article. La Cour note aussi que, par son arrêt no 14/2011,
la Cour de cassation, statuant en formation plénière, et
interprétant la disposition susmentionnée, a considéré que l’audience
qu’il fallait prendre en compte pour calculer l’indemnité
était celle à laquelle l’affaire avait été appelée
devant le tribunal, même si, à cette audience, le tribunal n’avait
pas examiné le fond de l’affaire en raison de l’ajournement
de celle-ci, de la prescription par lui d’une expertise ou
pour toute autre cause. 47.
En l’espèce, la Cour est attentive aux arguments du
Gouvernement relatifs aux considérations de sécurité juridique
et de nécessité pour les autorités étatiques de prévoir
suffisamment à l’avance leurs obligations financières pour
l’indemnisation des propriétaires expropriés dont les
biens ont vu leur valeur être multipliée pendant des périodes
d’urbanisation galopante. Toutefois, de l’avis de la
Cour, l’utilisation de la possibilité de réactualisation
de l’indemnité par les tribunaux en cas de non-respect des
exigences de l’article 17 § 2 de la Constitution est
avantageuse pour les deux parties concernées par l’expropriation
: d’une part, pour l’autorité à l’origine de l’expropriation,
car elle permet de réduire les cas de levée d’office des
expropriations en cas de non-versement de l’indemnité (pareille
levée étant susceptible de perturber la programmation de l’exécution
des travaux) ; d’autre part, pour le propriétaire
exproprié, car elle permet à ce dernier de percevoir une
compensation « intégrale » au sens de l’article 17 § 2
précité et, le cas échéant, d’obtenir en remplacement de
sa propriété un bien d’une même valeur. 48.
La Cour note que, en l’espèce, le tribunal de première
instance a calculé le montant de l’indemnité provisoire d’expropriation
à la date de l’audience devant lui, soit le 27 mars 1998. L’audience
pour la fixation de l’indemnité définitive a eu lieu
devant ce même tribunal le 9 novembre 1999. Toutefois, à cette
dernière date, ledit tribunal n’a pas procédé à la
fixation de cette indemnité : il a en effet ordonné une
expertise aux fins de la détermination de la valeur du bien au
27 mars 1998. Puis, par un jugement du 24 janvier 2005, le
tribunal a fixé l’indemnité en question en tenant compte
de la valeur du terrain au 27 mars 1998. Par la suite, le 29
décembre 2006, la cour d’appel a rejeté l’appel des
requérants, et, le 28 avril 2009, la Cour de cassation a
débouté ceux-ci de leur pourvoi. Enfin, par un arrêt du 18
janvier 2012, statuant à la suite de la réintroduction de leur
appel par les requérants, qui se fondaient sur une augmentation
substantielle de la valeur du terrain objet du litige pour
demander une réactualisation de l’indemnité allouée, la
cour d’appel a fixé un nouveau montant en tenant compte de
la valeur que ledit terrain avait au 9 novembre 1999, soit à la
date de la première audience relative à la fixation de l’indemnité
définitive devant le tribunal de première instance. 49.
La Cour constate ainsi que la procédure relative à la
détermination de l’indemnité à accorder aux requérants a
débuté le 30 novembre 1997, avec la saisine du tribunal de
première instance en vue de la fixation de l’indemnité
provisoire, et qu’elle a pris fin le 18 janvier 2012, avec l’arrêt
de la cour d’appel statuant sur le montant de l’indemnité
définitive. Il convient en outre de noter que l’expropriation
litigieuse, aux fins de l’élargissement d’une rue,
avait été déclarée dès 1959 et qu’une procédure
judiciaire, engagée par le père des requérants, avait déjà
eu lieu devant le Conseil d’État en 1979 (paragraphe 5 ci-dessus).
Certes, les procédures engagées par les requérants ont
contribué à retarder la date du versement de l’indemnité
définitive d’expropriation, mais les intéressés n’ont
fait qu’utiliser toutes les possibilités que leur offrait
le droit national pour réactualiser le montant de celle-ci. 50.
La Cour observe ensuite que le 31 août 1998, l’indemnité
provisoire a été fixée à 264 EUR le mètre carré après
prise en compte de la valeur du bien au 27 mars 1998. Par la
suite, le 24 janvier 2005, l’indemnité définitive a été
fixée à 320 EUR le mètre carré sur la base de la valeur du
bien à cette même date. Enfin, le 18 janvier 2012, à l’issue
de la dernière procédure menée devant les juridictions
internes – procédure au cours de laquelle les requérants
évaluaient le montant de l’indemnité définitive à 1 300
EUR le mètre carré, celle-ci a été recalculée à 420 EUR le
mètre carré après prise en considération de la valeur du bien
au 9 novembre 1999, date de la première audience tenue devant le
tribunal de première instance, lors de laquelle celui-ci avait
ordonné une expertise. 51.
La Cour estime qu’il ne lui appartient pas de s’exprimer
sur le montant exact de l’indemnité définitive que les
requérants devaient percevoir en fonction des fluctuations des
prix du marché, de l’inflation ou de toute autre
éventuelle cause. 52.
Toutefois, en retenant comme date critique pour la détermination
de la valeur du bien exproprié, et donc pour la fixation de l’indemnité
définitive, la date de la première audience tenue au cours de
la procédure devant le tribunal de première instance
relativement à l’établissement de l’indemnité
susmentionnée, soit le 9 novembre 1999, la cour d’appel a
fait abstraction de tout écart qui pouvait exister entre la
valeur de la créance des requérants à cette date et celle à
la date à laquelle elle a statué, soit le 18 janvier 2012. 53.
Aussi la Cour considère-t-elle que les requérants ont dû
supporter une charge disproportionnée et excessive qui a rompu
le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit
de propriété et les exigences de l’intérêt général (voir,
mutatis mutandis, Zacharakis, précité, § 33, et Yetis et
autres c. Turquie, no40349/05, § 56, 6 juillet 2010). Partant,
la Cour rejette l’objection du Gouvernement tirée de l’irrecevabilité
ratione personae de la requête et constate qu’il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. ODESCALCHI
ET LANTE DELLA ROVERE c. ITALIE du 7 juillet 2015, requête 38754/07 Violation
article 1 du Protocole 1 de la Convention : les requérants n'ont
pas eu le droit de construire depuis 1975 car leurs terrains
devaient être expropriés mais ils n'ont jamais été
expropriés. Non respect du droit d'usage du bien. 53. La
Cour note que la requête porte sur les mesures relevant de l’urbanisme
qui visent le terrain de requérants. Les parties s’accordent
pour dire qu’en raison de ces mesures, il y a eu ingérence
dans le droit des requérants au respect de leurs biens. 54. Il
reste à examiner si ladite ingérence a enfreint ou non l’article
1 du Protocole no 1. À cet égard, la Cour relève que les
effets dénoncés par les requérants découlent tous de la
diminution de la disponibilité du bien en cause. Ils résultent
des limitations apportées au droit de propriété ainsi que des
conséquences de celles-ci sur la valeur de l’immeuble.
Pourtant, bien qu’il ait perdu de sa substance, le droit en
cause n’a pas entièrement disparu. Les effets des mesures
en question ne sont pas tels qu’on puisse les assimiler à
une privation de propriété. La Cour note à ce sujet que les
requérants n’ont perdu ni l’accès au terrain ni la
maîtrise de celui-ci et qu’en principe, la possibilité de
vendre le terrain, même rendue plus malaisée, a subsisté. Elle
estime dès lors qu’il n’y a pas eu d’expropriation
de fait et que la seconde phrase du premier alinéa ne trouve
donc pas à s’appliquer en l’espèce (Scordino c.
Italie (no 2), précité, § 70 ; Elia S.r.l. c. Italie, no 37710/97, § 56, CEDH 2001-IX ; Matos
e Silva, Lda., et autres c. Portugal, 16 septembre 1996,
§ 89, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). 55. La
Cour est d’avis que les mesures litigieuses ne relèvent pas
non plus de la réglementation de l’usage des biens, au sens
du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. En effet,
s’il est vrai qu’il s’agit d’interdictions de
construire réglementant l’usage des biens (Sporrong et
Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 64, série A no
52), il n’en demeure pas moins que les mêmes mesures
visaient au final l’expropriation du terrain. 56. Dès
lors, la Cour estime que la situation dénoncée par les
requérants relève de la première phrase de l’article 1 du
Protocole no 1 (Maioli, précité, § 54 ; Sporrong et
Lönnroth, précité, § 65 ; Elia Srl, précité, § 57 ; Scordino (no
2), précité, § 73). 57. La
Cour juge naturel que, dans un domaine aussi complexe et
difficile que l’aménagement du territoire, les États
contractants jouissent d’une grande marge d’appréciation
pour mener leur politique urbanistique Elle tient pour établi
que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de
leurs biens répondait aux exigences de l’intérêt
général. Elle ne saurait se soustraire pour autant à son
devoir de contrôle. La Cour doit donc rechercher si un juste
équilibre a été préservé entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde
des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth,
précité, § 69 ; et Phocas c. France, 23 avril 1996,
§ 53, Recueil 1996-II, p. 542). 58. À
ce propos, la Cour constate que le terrain des requérants a
été soumis à une interdiction de construire en vue de son
expropriation en vertu du plan général d’urbanisme entré
en vigueur en 1975. En 1980, le permis d’exproprier ayant
expiré, le terrain a été soumis au régime des « zones
blanches » et aux limitations au droit de bâtir prévus
par la loi no 10 de 1977. En juin 2011, le commissaire ad acta a
pris la décision de renouveler le permis d’exproprier mais
cette décision n’est pas entrée en vigueur, de sorte que
le terrain tombe sous le coup des « mesures de sauvegarde »
(paragraphe 23 ci-dessus) de ladite décision en attendant
que celle-ci soit approuvée, le cas échéant. 59. Indépendamment
du fait que les limitations visant le terrain découlent d’un
acte administratif ou de l’application d’une loi, il en
résulte que le terrain litigieux a été frappé d’interdiction
de construire de manière continue (Terazzi S.r.l., précité, §
83 ; Elia S.r.l., précité, § 76 ; Rossitto c. Italie,
no 7977/03, § 38, 26 mai 2009). L’ingérence
litigieuse qui en découle dure depuis plus de quarante ans, si l’on
prend comme point de départ la date d’entrée en vigueur du
plan général d’urbanisme de 1975, et depuis presque
quarante-quatre ans si l’on part de la décision de la
municipalité en vue de son adoption (paragraphe 8 ci-dessus). 60. La
Cour estime que, pendant toute la période concernée, les
requérants sont restés dans une incertitude totale quant au
sort de leur propriété : l’administration n’a
pas exproprié pendant la période de validité du permis d’exproprier.
Une fois celui-ci expiré en 1980, le terrain pouvait être
frappé d’un nouveau permis d’exproprier à tout moment. Le
droit interne permet aux intéressés de se plaindre de l’inaction
de l’administration lorsque, comme en l’espèce, des
années s’écoulent sans qu’une décision ne soit prise
quant au sort d’un terrain. Cette possibilité ne semble pas
avoir remédié à l’incertitude affectant le terrain des
intéressés, et la Cour rappelle d’ailleurs que Cour
constitutionnelle (paragraphe 27 ci-dessus) avait affirmé
que « le recours permettant d’attaquer l’inaction
de l’administration devant le tribunal administratif était
inopérant et de ce fait peu efficace. » 61. Ensuite,
la Cour estime que l’existence d’interdictions de
construire pendant toute la période concernée a entravé la
pleine jouissance du droit de propriété des requérants et a
accentué les répercussions dommageables sur la situation de
ceux-ci en affaiblissant considérablement, entre autres, les
chances de vendre le terrain. 62. En
outre, la Cour constate que les requérants n’ont pas reçu
d’indemnisation. À cet égard, elle estime utile de
rappeler qu’aux termes de la jurisprudence des cours
nationales (paragraphes 31, 32 ci-dessus), seule la période
faisant suite au renouvellement d’un permis d’exproprier,
une fois celui-ci entré en vigueur, est en principe indemnisable
au sens de l’article 39 du Répertoire. Il
s’ensuit que l’exception de non-épuisement des voies
de recours internes jointe au fond doit être rejetée car,
contrairement à la situation factuelle de Tiralongo et Carbe
où le permis d’exproprier avait été effectivement
renouvelé à plusieurs reprises, aucune possibilité d’indemnisation
ne subsiste en l’espèce, notamment pour les raisons
suivantes : a) la
période allant de 1975 à 1980, pendant laquelle le permis d’exproprier
prévu par le plan général d’urbanisme a été en vigueur,
est considérée comme une période de franchise non indemnisable ; b) la
période précédant l’entrée en vigueur dudit plan d’urbanisme,
et allant de 1971 à 1975, concernée par les mesures de
sauvegarde, n’est pas non plus indemnisable non plus ; c) la
période allant de 1980 à 2011, pendant laquelle le terrain a
été soumis au régime des « zones blanches » n’est
pas non plus indemnisable ; d) la
période à partir de juin 2011 n’est pas indemnisable non
plus car le permis d’exproprier décidé par le commissaire ad
acta n’est pas entré en vigueur. 63. Les
circonstances de la cause, notamment l’incertitude et l’inexistence
de tout recours interne effectif susceptible de remédier à la
situation litigieuse, combinées avec l’entrave à la pleine
jouissance du droit de propriété et l’absence d’indemnisation,
amènent la Cour à considérer que les requérants ont eu à
supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre, d’une part, les
exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la
sauvegarde du droit au respect des biens. 64. En
conclusion, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole
no1. MACHARD
c. FRANCE du 25 AVRIL 2006 Requête no
42928/02 OPÉRATION
FONCIÈRE TROP LONGUE QUI LESENT LE REQUÉRANT "14. La
Cour constate que la procédure s’est déroulée quelque peu
confusément, ceci du fait de plusieurs décisions irrégulières
successives des commissions départementale et nationale d’aménagement
foncier quant à l’inclusion de certaines parcelles des
requérants dans le périmètre de remembrement – lesquelles
décisions furent censurées par le juge administratif – et
du fait qu’en limitant la motivation de leurs décisions d’annulation
à certains aspects du litige, les juridictions administratives
saisies ont pu parfois laisser planer un doute quant à la
légalité de l’inclusion de telle ou telle parcelle. Il est
clair cependant que la procédure est aujourd’hui purgée de
toute difficulté d’exécution, en raison de la modification
du périmètre de remembrement par un arrêté préfectoral du 10
août 1999, validée ensuite par les juridictions administratives. Ainsi, s’il est compréhensible que les
requérants tirent de ces circonstances le sentiment que les
décisions rendues en leur faveur n’ont pas été
exécutées, les faits montrent le contraire ; aucune
question d’exécution ne se pose donc en l’espèce, de
sorte qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6
§ 1 de la Convention d’un tel chef. 15. Il n’en reste pas moins que
le litige relatif à l’inclusion de certaines parcelles des
requérants dans le périmètre de remembrement a duré une
trentaine d’années sans que cette durée puisse être
imputée à ces derniers et alors que, comme le concède le
Gouvernement, l’affaire ne présentait aucune complexité
particulière. Durant cette très longue période, les
requérants sont restés dans l’incertitude quant au sort
des biens litigieux, leur droit de propriété sur ceux-ci
étant en quelque sorte en sursis. Par ailleurs, l’inclusion
d’un fonds dans le périmètre d’une opération de
remembrement implique, de fait sinon en droit, des limitations à
la faculté d’en user ; la Cour relève ainsi –
même si les parties n’apportent aucune précision quant aux
mesures éventuellement prises en l’espèce sur ce fondement
– qu’aux termes de l’article L. 121-19 du code
rural (dans sa version applicable à l’époque des faits de
la cause), notamment, le préfet pouvait interdire tous travaux
jusqu’à la fin des opérations. Il en va de même de la
faculté d’en disposer, tout projet de mutation de
propriété entre vifs étant soumis à un régime d’autorisation
préalable (article L. 121-20 du code rural) ; il est
en outre peu douteux qu’un propriétaire qui désire vendre
un bien inclus dans le périmètre d’un remembrement –
ou même simplement susceptible de l’être – aurait du
mal à trouver acquéreur. Selon la Cour, ce type d’ingérence dans l’exercice
du droit au respect des biens des requérants relève de la
première phrase du premier alinéa de l’article 1 du
Protocole no 1 (voir, par exemple,
l’arrêt Erkner et Hofauer c. Autriche du 23 avril 1987,
série A no 117 B, § 74) : il y a
lieu de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre
les exigences de l’intérêt général de la communauté
– indéniable en l’espèce, s’agissant d’un
remembrement rural (voir, par exemple, l’arrêt Piron
précité, § 40) – et les impératifs de la sauvegarde des
droits fondamentaux de l’individu (voir, notamment, l’arrêt
Erkner et Hofauer précité, § 75). La Cour a déjà eu l’occasion
de juger à cet égard que la durée d’une procédure
relative à un remembrement « entre en ligne de compte,
avec d’autres éléments, pour déterminer si le transfert [de
propriété] litigieux se concilie avec la garantie du droit de
propriété » (ibidem, § 76) ; voir aussi, parmi d’autres,
l’arrêt Piron précité, § 44). Cet élément est en l’espèce
déterminant : vu la durée particulièrement longue de la
procédure de remembrement – considérable à l’échelle
individuelle – et, en corollaire, de l’ingérence dans
l’exercice du droit des requérants au respect de leurs
biens, la Cour considère que ces derniers se sont vu imposer une
charge spéciale et exorbitante et qu’en conséquence, il y
a eu violation de l’article 1 du Protocole no
1. 16. Enfin, eu égard aux motifs pour
lesquels elle a constaté une violation de l’article 1 du
Protocole no 1, la Cour estime qu’aucune
question distincte ne se pose sous l’angle du « délai
raisonnable » de l’article 6 § 1 de la Convention, à
supposer un tel grief recevable au regard du délai de six mois
de l’article 35 § 1 de la Convention." Motais
de Narbone contre France du 02/07/2002 requête 48161/99 En l'espèce,
la Cour a sanctionné le délai de 19 ans entre l'expropriation
et la réalisation des travaux cause de l'utilité publique. Durant ce
délai, le terrain a augmenté de valeur et les propriétaires
ont été privé de cette plus-value. La Cour a
interrogé le gouvernement pour savoir quelle justification il
donnait à la réserve foncière et les causes d'un délai de 19
ans entre l'expropriation et les constructions de logements
sociaux. Le Gouvernement
avait répondu que les terrains manquaient de réseaux d'assainissement
dont la mise en œuvre relevait des autorités locales. La Cour
constate alors qu'il s'agit d'un état de fait entièrement
imputable aux autorités publiques et qui n'équivaut pas à une
cause d'intérêt public au sens de l'article 1 du Protocole n°
1. UNE ATTEINTE A
LA PROPRIETE PREVUE PAR LA LOI "§18: La
Cour relève qu'il n'est contesté ni que l'expropriation en
question était légale au regard du droit français, ni qu'elle
s'analyse en une privation de propriété au sens de la seconde
phase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1"
BUT LEGITIME DE
LA LOI: "La Cour
constate que le terrain litigieux a été "exproprié"
en vue de la constitution de réserves foncières destinées à l'habitat
très social". Il n'est pas
douteux qu'un tel but - qui tient de l'organisation foncière et
de sa mise en oeuvre d'une politique sociale - est "légitime
en principe" et relève de l'intérêt public () Par ailleurs,
vu la marge d'appréciation dont jouissent en ce domaine les
Etats contractants et les autorités qui en constituent l'émanation,
pour juger si, dans telles ou telles circonstances, un problème
d'intérêt public se pose et justifie des privations de
propriété, la Cour tient pour établie l'existence d'un besoin
en habitats sociaux dans la zone où se situe le terrain
litigieux" Les Etats ont
donc une grande latitude ET UNE MARGE DE MANOEUVRE pour
déterminer s'il y a ou non un but d'intérêt général. L'EQUILIBRE
ENTRE INTERET GENERAL ET DROIT INDIVIDUEL: "§19:
Le problème n'est pas tranché pour autant. En effet, il ne
suffit pas qu'une mesure privative de propriété poursuive, en l'espèce
comme en principe, un objectif légitime "d'utilité
publique": il doit exister un rapport raisonnable de
proportionnalité entre le dit but et les moyens employés. L'équilibre
à ménager entre les exigences de l'intérêt général et les
impératifs des droits fondamentaux est ainsi rompu si la
personne concernée a eu à subir "une charge
disproportionnée". La Cour a en
conséquence jugé que l'individu exproprié doit en principe
obtenir une indemnisation "raisonnablement en rapport avec
la valeur du bien" dont il a été privé, même si
des objectifs légitimes "d'utilité publique" ()
peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine
"valeur marchande". Il en résulte
que l'équilibre susmentionné en rapport avec la "valeur
vénale" du bien, telle que déterminée au moment où la
privation de propriété est réalisée. Cela n'exclut cependant
pas que, dans certaines circonstances, cet équilibre soit rompu
nonobstant le versement d'une somme de cette nature" En l'espèce,
la Cour constate qu'une durée de 19 ans entre l'expropriation et
la réalisation de logements sociaux est une durée longue durant
laquelle le terrain a augmenté de valeur: "Dans l'affaire
Akkus contre Turquie du 9 juillet 1997 qui mettait en cause le
retard de l'administration à payer une indemnité
complémentaire d'expropriation, réduisant celle-ci en raison de
l'inflation, la Cour a ainsi jugé que "le caractère
adéquat d'un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci
faisant abstraction des éléments susceptibles d'en réduire la
valeur, tel l'écoulement d'un laps de temps que l'on ne saurait
qualifier de raisonnable. Selon la Cour,
il peut également en aller de la sorte lorsqu'un laps de temps
notable s'écoule entre la prise d'une décision portant
expropriation d'un bien et la réalisation concrète du projet d'utilité
publique fondant la privation de propriété. Dans un tel cas,
l'expropriation peut avoir pour effet de priver l'individu
concerné d'une plus-value générée par le bien en cause; si
cette privation spécifique ne repose pas elle-même sur une
raison légitime tenant de l'utilité publique, l'individu
concerné ne peut subir une charge additionnelle, incompatible
avec les exigences de l'article 1 du Protocole n°1. §20: En l'espèce,
les requérants ne prétendent pas que l'indemnité d'expropriation
perçue par l'ancienne propriétaire du bien litigieux était
sans rapport avec la valeur vénale de celui-ci, telle qu'elle
pouvait être évaluée au moment de l'expropriation. Ils exposent en
revanche que dix neuf ans se sont écoulés depuis lors sans que
le terrain en question ait fait l'objet d'un aménagement en vue
de a réalisation d'équipements à vocation sociale
conformément au but d'utilité publique poursuivi, et que la
valeur marchande de ce terrain a notablement augmenté durant
cette période; ils en déduisent qu'ils se trouvent indûment
privés d'une partie de la valeur dudit bien. Les requérants
peuvent donc soutenir que la "cause" fondant "l'utilité
publique" de l'expropriation dont il est question n'a pas ,
après un longs laps de temps, été justifiée par une
réalisation. Selon la Cour,
le maintien en réserve d'un bien exproprié, même durant une
longue période, ne constitue pas nécessairement un manquement
à l'article 1 du Protocole n°1. Un problème se
pose en revanche clairement sous l'angle de cette disposition
lorsque, comme en l'espèce, le maintien du bien en réserve
durant une longue période en repose pas lui-même sur des
raisons tenant de l'utilité publique et où, durant cette
période, ledit bien engendre une plus-value appréciable dont
les anciens propriétaires se voient privés. L'article 1 du
Protocole n°1 oblige en effet les Etats à prémunir les
individus contre le risque d'un usage de la technique des
réserves foncières autorisant ce qui pourrait être perçu
comme une forme de spéculation foncière à leur détriment. En l'espèce,
la Cour ne décèle aucun élément dont il pourrait être
déduit que la non réalisation de l'opération d'urbanisation
prévue et, conséquemment, le maintien du terrain en réserve
foncière, reposent sur une quelconque raison tenant à l'utilité
publique. §23: Bref,
dans les circonstances particulières de leur cause, les
requérants sont fondés à soutenir qu'ils ont été indûment
privés d'une plus value engendrée par le bien exproprié et ont,
en conséquence, subi une charge excessive du fait de l'expropriation
litigieuse. Partant, il y a
violation de l'article 1 du Protocole n° 1" Piron
contre France du 14/11/2000 requête 2064 Hudoc 36436/97 la Cour,
constate qu'un remembrement agricole est une ingérence prévue
par la loi qui poursuit un but légitime: "Il sert l'intérêt
des propriétaires concernés comme la collectivité dans son
ensemble en accroissant la rentabilité des exploitations dans
son ensemble et en rationalisant la culture" Puis, la Cour
sanctionne le long délai de l'opération dans l'examen de la
proportionnalité des moyens avec le but poursuivi: "§43: Le
rétablissement en nature s'étant avéré impossible,
essentiellement en raison du temps passé, la Cour est d'avis que,
dans le cadre de la marge d'appréciation dont disposent en la
matière les Etats membres, il était loisible aux autorités de
décider de procéder à une indemnisation. Toutefois,
ainsi qu'elle l'a affirmé dans l'arrêt Guillemin contre France:
" l'indemnisation du préjudice subi par l'intéressé ne
peut constituer une réparation adéquate que lorsqu'elle prend
aussi en considération le dommage tenant à la durée de la
privation. Elle doit en outre avoir lieu dans un délai
raisonnable. §46: Ainsi qu'elle
l'a relevé mutatis mutandis dans l'arrêt Guillemin contre
France précité, la Cour estime que la somme qui pourra être
octroyée au terme de la procédure ne compense pas l'absence de
dédommagement et ne saurait être déterminante eu égard à la
durée de l'ensemble des recours déjà engagés par la
requérante. §47:Dès lors,
en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, la Cour arrive
à la conclusion qu'il y a violation de l'article 1 du Protocole
n°1 à la Convention" Phocas
contre France du 23/04/1991 Hudoc 567 requête 17869/91 la Cour n'avait
pas sanctionné le fait que le requérant avait été privé de l'usage
de son immeuble durant 27 ans pour un prétendu projet de
carrefour qui n'a jamais été réalisé. La cour a
reproché au requérant de ne pas avoir saisi le juge de l'expropriation
et par conséquent, de ne pas avoir épuisé les voies de recours
internes. LES REQUÉRANTS NE PEUVENT BÉNÉFICIER
D'UN EFFET D'AUBAINE ALFA
GLASS ANONYMI EMBORIKI ETAIRIA YALOPINAKON c. GRÈCE du 28
janvier 2021 requête n° 74515/13 Article 1 du
Protocole 1 pour atteinte à la procédure unique Art 1 P1 •
Respect des biens • Présomption d’avantage apporté au
restant (non exproprié) du terrain par les travaux à réaliser
sur la partie expropriée • Avantage légalement censé
justifier une réduction de l’indemnité d’expropriation
• Refus des juridictions civiles compétentes pour fixer l’indemnité
d’examiner une contestation de la présomption, au motif de
l’existence d’une procédure administrative spécifique,
non exercée en l’espèce • Question présentant
pourtant un caractère connexe à l’expropriation •
Atteinte au principe de la « procédure unique » consacré par
la jurisprudence européenne et nationale FAITS 2. La
requérante est une société anonyme qui a son siège social à
Athènes. Elle est représentée par Me I. Choromidis,
avocat. 4. Par
une décision du 65 mai 2006, le Secrétaire général de la
Région de l’Attique procéda à l’expropriation d’une
zone de 33 619 m² en vue de l’extension d’une
route. La zone incluait des parties de trois terrains appartenant
à la requérante sous les numéros de cadastre 11, 13.1 et 13.2.
Conformément aux dispositions de la loi no 653/1977, les parties
non expropriées des terrains litigieux furent considérées
comme étant avantagées par la réalisation des travaux de sorte
que des parties des 511,46 m², 1 404,74 m² et 484,82
m² des terrains expropriés respectivement ne furent pas l’objet
d’une indemnisation car elles seraient « auto-indemnisées ». 5. Lors
de la procédure de la fixation du montant provisoire de l’indemnité
d’expropriation devant le tribunal de première instance d’Athènes,
la requérante soutint que les parties non-expropriées de ses
terrains n’étaient pas avantagées par la réalisation des
travaux et qu’il n’y avait pas lieu à « auto-indemnisation »
de certaines parties des terrains expropriés. 6. Toutefois,
en fixant le montant provisoire de l’indemnité d’expropriation
(jugement no 884/2008), le tribunal de première instance n’inclut
pas l’indemnité correspondant aux parties « auto-indemnisées »
des terrains. Le tribunal souligna que la présomption que le
propriétaire d’un terrain exproprié tirait un avantage de
la réalisation des travaux par rapport aux parties non-expropriées
de celui-ci n’était pas irréfragable et s’agissait
là d’une question qui devait être examinée par la cour d’appel
qui devait se prononcer sur la fixation du montant définitif de
l’indemnité d’expropriation, conformément à la
procédure spéciale de l’article 33 de la loi no 2971/2001. 7. Le
19 avril 2009, la requérante demanda à la cour d’appel d’Athènes
de fixer le montant définitif de l’indemnité d’expropriation
et de reconnaître qu’elle ne tirait pas un avantage de la
réalisation des travaux quant aux parties non-expropriées de
ses terrains. 8. Par
son arrêt no 5317/2010, la cour d’appel d’Athènes
fixa le montant définitif de l’indemnité et rejeta comme
irrecevable la demande susmentionnée de la requérante. 9. La
cour d’appel releva que l’expropriation litigieuse
était soumise aux dispositions de l’article 33 de la loi no
2971/2001. Par conséquent, pour que la demande de la requérante
soit recevable, celle-ci aurait dû respecter la procédure
prévue par l’article 33 §§ 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi, en
introduisant une requête à l’organisme chargé des travaux
dans un délai de deux mois à compter de la publication du
jugement fixant le montant provisoire de l’indemnité d’expropriation.
Or, la requérante n’avait pas introduit une telle requête.
Une demande introduite par la requérante auprès du Secrétaire
général de la Région de l’Attique le 14 janvier 2008 ne
saurait être assimilée à la requête exigée par l’article
33 §§ 2 et 3 car elle ne contenait aucune prétention relative
à la présomption selon laquelle le propriétaire d’un
terrain exproprié tirait un avantage de la construction d’une
route. 10. La
requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt. Elle
invoquait l’article 1 du Protocole no 1 et se prévalait de
la jurisprudence de la Cour et de celle de la Cour de cassation (arrêts
no 10 et 11/2004, 851/2004, 1014/2004, 152/2007 et 1060/2008).
Elle soutenait que la procédure relative à la fixation de l’indemnité
d’expropriation devait avoir pour objet l’indemnité
dans sa globalité et inclure toute question y afférente. Par
conséquent, dans le cadre de la fixation du montant définitif
de cette indemnité, il était possible d’introduire une
demande tendant à faire admettre que le propriétaire dont le
bien acquiert une façade sur une route ne tirait pas un avantage
de l’expropriation et ne devait pas être obligé à « auto-indemnisation ». 11. Par
un arrêt no 1275/2013, du 17 juin 2013, la Cour de cassation
rejeta le pourvoi. Elle considéra que la cour d’appel avait
correctement appliqué les dispositions de l’article 33 de
la loi no 2971/2001 qui prévoyait une procédure spéciale pour
contester la présomption selon laquelle le propriétaire d’un
bien exproprié tirait un avantage de la réalisation de travaux. 12. Le
25 juillet 2012, le tribunal de première instance d’Athènes
reconnut la requérante comme ayant-droit de l’indemnité
fixée provisoirement puis définitivement par le jugement no 884/2008
et l’arrêt no 5317/2010 suite à l’expropriation
de ses propriétés. Dans le cadre de cette procédure, le
tribunal exclut toute possibilité d’existence des droits de
propriété de l’État sur les terrains de la requérante (jugement
no 533/2012). CEDH 32. La
requérante soutient que les juridictions de fond, qui ont fixé
l’indemnité d’expropriation provisoire et définitive
et ont refusé d’examiner sa demande tendant à réfuter la
présomption de l’avantage tiré par le propriétaire de la
réalisation des travaux, ont méconnu la jurisprudence de la
Cour et de la Cour de cassation. 33. Le
Gouvernement souligne que dans le cadre de la procédure relative
à la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation,
la cour d’appel, se conformant à la jurisprudence de la
Cour de cassation (paragraphe 18 ci-dessus) a examiné, dans
une procédure unique, toutes les demandes de la requérante
relatives à la fixation de l’indemnité définitive,
de l’indemnité spéciale prévue à l’article 13 § 4
de la loi no 2882/2001 et enfin à celle tendant à réfuter la
présomption en question (article 33 de la loi no 2971/2001). 34. Le
Gouvernement rajoute que la Cour de cassation a rejeté le moyen
de cassation de la requérante, qui alléguait que la cour d’appel
avait rejeté sa demande pour défaut de compétence, comme
étant fondé sur une prémisse erronée. Le Gouvernement
précise que la cour d’appel a effectivement examiné la
demande de la requérante mais elle l’a déclaré
irrecevable au motif que la requérante n’avait pas
respecté l’obligation procédurale posée par l’article
33 : l’introduction préalable de la demande à l’organisme
chargé de la réalisation de l’ouvrage pour lequel l’expropriation
a eu lieu. Or, l’obligation faite à l’intéressé de
respecter une certaine procédure administrative afin de réfuter
la présomption d’un avantage tiré par un propriétaire
exproprié, avant de saisir les juridictions, est une question
distincte de celle du respect de la procédure unique devant les
juridictions aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation. 35. Enfin,
le Gouvernement affirme que dans le cadre de la procédure devant
la cour d’appel, la requérante avait aussi demandé le
versement d’une indemnité spéciale (article 13 § 4 de la
loi no 2882/2001) et, dans ce cas, elle avait respecté à cet
égard l’obligation du dépôt préalable de sa demande à l’autorité
compétente. 36. La
Cour rappelle que dans l’arrêt précité, elle a
considéré que lorsque les biens d’un individu font l’objet
d’une expropriation, il doit exister une procédure qui
assure une appréciation globale des conséquences de l’expropriation,
incluant l’octroi d’une indemnité en relation avec la
valeur du bien exproprié, la détermination des titulaires du
droit à indemnité et toute autre question afférente à l’expropriation,
y compris les frais de procédure./p> 37. La
Cour a aussi souligné, dans l’arrêt Bibi c. Grèce (no 15643/10, 13 novembre 2014), que la procédure
appelée à assurer, au sens de l’arrêt Azas, l’appréciation
globale des conséquences de l’expropriation ne saurait se
limiter à la reconnaissance des titulaires du droit à
indemnité, à la détermination de l’indemnité spéciale,
à l’appréciation de l’existence d’un avantage
tiré par le propriétaire et à la fixation des frais de justice.
Elle doit aussi englober d’autres questions, comme, par
exemple, celles relevant de la réévaluation éventuelle de l’indemnité. 38. Par
la suite, dans l’arrêt Koutsokostas c. Grèce (no 64732/12, 13 juin 2019), la Cour a estimé que le
refus d’examiner l’action en recouvrement des
requérants introduite devant la juridiction qui allait se
prononcer sur le montant de l’indemnité d’expropriation
définitive et la sollicitation faite aux requérants de saisir
à nouveau les juridictions civiles avaient porté atteinte aux
principes de l’économie et de la célérité de la
procédure ainsi qu’au principe de la procédure unique
consacré par l’arrêt Azas précité. 39. Enfin,
dans l’arrêt Moustakidis c. Grèce (no 58999/13, 3 octobre 2019), la Cour a considéré
que certaines demandes du requérant (tendant à ce qu’il
soit examiné la question du prétendu avantage tiré par lui du
fait de la réalisation des travaux et qu’une indemnité
soit fixée pour la partie ayant été considéré auto-indemnisée,
à ce qu’il soit reconnu qu’en raison de l’expropriation
et de la nature de l’ouvrage, la propriété non expropriée
avait été dévalorisée et devait alors être indemnisée, et
à ce qu’il se voit accorder certaines sommes pour frais de
transfert de son entreprise et pour perte des chances due à l’interruption
du fonctionnement de l’entreprise) constituaient des
questions connexes relatives à l’expropriation et auraient
dû faire l’objet d’un examen par les juridictions
civiles lors de la fixation de l’indemnité d’expropriation. 40. En
l’espèce, la Cour considère que la question de savoir si
le propriétaire d’un terrain exproprié tire un avantage de
la réalisation des travaux, ce qui justifierait, selon les
termes de la loi no 653/1977, qu’une partie de ce terrain ne
soit pas indemnisée, constitue à n’en pas douter une
question connexe relative à l’expropriation. 41. La
Cour note que cette question est effectivement examinée par les
juridictions civiles, notamment au stade de la fixation de l’indemnité
d’expropriation définitive par la cour d’appel.
Toutefois, en l’espèce, la cour d’appel a refusé de
procéder à l’examen de cette question car la requérante n’avait
pas fait usage de la procédure administrative préalable prévue
par l’article 33 de la loi no 2971/2001. Or, la Cour note
que cette procédure qui se déroule devant des organes
administratifs comporte plusieurs étapes qui s’étalent sur
plusieurs mois et que la loi ne prévoit aucune garantie quant au
respect des délais qu’elle pose pour la réalisation de
chaque étape. Cette procédure contribue alors à rallonger la
procédure se déroulant devant les juridictions civiles et
constitue un écart par rapport à la procédure unique devant
les juridictions civiles pour l’examen de toutes les
questions relatives à la fixation de l’indemnité d’expropriation. 42. À
cet égard, la Cour note aussi que selon la jurisprudence
constante de la Cour de cassation, dans le cas où la demande
tendant à réfuter la présomption selon laquelle le
propriétaire tire avantage de la réalisation des travaux était
examinée en même temps que la fixation de l’indemnité il
n’était pas nécessaire d’avoir recours à la
procédure de la loi no 2971/2001 (paragraphes 16-18 ci-dessus). 43. Par
conséquent, en refusant d’examiner la question de la
présomption précitée, faute pour la requérante d’avoir
fait usage de la procédure prévue à l’article 33 de la
loi no 2971/2001, les autorités de l’État défendeur ont
porté atteinte au principe de la procédure unique en la
matière, consacré par la jurisprudence susmentionnée de la
Cour ainsi que par celle de la Cour de cassation. 44. Partant,
il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. Perepjolkins
c. Lettonie du 8 mars 2011 requête 71243/01 Les droits d’anciens
propriétaires de terrains expropriés pour agrandir le port de
Riga n’ont pas été violés. La valeur des terrain est due
uniquement au port et par conséquent à l'expropriation qui est
un effet d'aubaine. Les requérants
Janis Vistinš et Genadijs Perepjolkins, sont deux
ressortissants lettons. Par des contrats de donation entre vifs
signés en 1994, ils devinrent propriétaires de terrains de
plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés situés sur l’île
de Kundzinsala. Cette île fait partie de Riga et est
essentiellement constituée d’infrastructures portuaires.
Les terrains avaient été illégalement expropriés par l’Union
soviétique après 1940 et les personnes qui les ont offerts à
MM. Vistinš et Perepjolkins (en contrepartie de services
rendus) avaient recouvré le droit de propriété y relatif dans
le cadre de la « dénationalisation » au début des années
1990. La valeur purement indicative des terrains mentionnée sur
les contrats de donation - pour le calcul de l’impôt
foncier - était de 500 ou 1000 lati lettons (LVL) par terrain (environ
705 et 1410 euros (EUR)). En juillet 1994,
MM. Vistinš et Perepjolkins furent enregistrés au livre
foncier comme propriétaires des terrains. Hormis une taxe
notariale de 0,25 LVL, ils ne durent acquitter aucun impôt suite
aux donations décrites ci-dessus. Le 15 août
1995, le conseil des ministres adopta un règlement relatif à la
fixation des limites du port de Riga, qui inclut les terrains de
MM. Vistinš et Perepjolkins dans le périmètre du port.
Cette inclusion fut confirmée par la loi du 6 novembre 1996 sur
le Port autonome de commerce de Riga. Cette loi greva également
tous les terrains privés situés dans les limites du port d’une
servitude, en contrepartie d’une compensation. En janvier 1996,
le Centre d’évaluation immobilière du Service foncier de l’Etat,
saisi par MM. Vistinš et Perepjolkins, évalua en janvier
1996 la valeur (« valeur cadastrale ») du terrain de M.
Vistinš à 564 410 LVL (environ 900 000 EUR) et de ceux de M.
Perepjolkins à plus de 3,12 millions LVL au total (environ 5,01
millions EUR). En 1997, la direction du port saisit à son tour
le Centre d’évaluation et lui demanda de calculer le
montant des indemnités qui seraient dues en cas d’expropriation
de ces terrains. Cette évaluation fut réalisée en vertu de la
décision du Conseil suprême sur les modalités de l’entrée
en vigueur de la loi générale de 1923 sur l’expropriation,
qui plafonne les indemnités d’expropriation de terrains
tels que ceux concernés par cette affaire à hauteur de leur
valeur cadastrale au 22 juillet 1940, multipliée par un
coefficient de conversion. Le 12 juin 1997, les indemnités d’expropriation
le cas échéant dues à MM. Vistinš et Perepjolkins furent
ainsi évaluées respectivement à 548,26 LVL (environ 850 EUR)
et 8 616,87 LVL (environ 13 500 EUR). Par un
règlement du 5 août 1997, le conseil des ministres ordonna l’expropriation
des terrains en cause au profit de l’Etat. Par une loi
spéciale du 30 octobre 1997, le Parlement confirma l’expropriation
et ordonna le paiement à MM. Vistinš et Perepjolkins d’indemnités
égales aux montants indiqués par le Centre d’évaluation (environ
850 et 13 500 EUR). Ces montants furent versés sur des comptes
ouverts au nom de chacun des requérants à la Banque
hypothécaire et foncière de Lettonie. MM. Vistinš et
Perepjolkins ne retirèrent toutefois pas ces sommes. Fin 1998, le
juge des livres fonciers de Riga ordonna l’enregistrement du
droit de propriété des terrains expropriés au nom de l’Etat.
MM.
Vistinš et Perepjolkins intentèrent des actions en justice
visant à obtenir des arriérés de loyers pour l’usage de
leurs terrains par le Port autonome de Riga depuis 1994. Au terme
de ces procédures en 1999, ils se virent accorder respectivement,
au total, l’équivalent d’environ 85 000 EUR et 593 150
EUR. En janvier 1999,
MM. Vistinš et Perepjolkins assignèrent le ministère des
Transports, demandant que l’enregistrement cadastral du
droit de propriété de l’Etat soit annulé et à être à
nouveau inscrits en tant que propriétaires des terrains dans les
livres fonciers. Ils soutenaient que la procédure d’expropriation
prévue par la loi générale sur l’expropriation,
prévoyant notamment la négociation du montant des indemnités
et la possibilité d’un recours judiciaire en cas de litige
sur ce montant, n’avait pas été respectée. Le 29 mars
2000, la cour régionale de Riga les débouta de leur demande, au
motif que l’expropriation de leurs terrains n’avait pas
été fondée sur la loi générale sur l’expropriation mais
sur la loi spéciale du 30 octobre 1997. Le 28 septembre 2000, la
chambre des affaires civiles confirma cette décision en appel,
de même que, le 20 décembre 2000, le sénat de la Cour suprême,
saisi d’un recours en cassation. Courant 1999,
des procédures de redressement fiscal au titre de l’impôt
foncier relatif aux terrains en cause dans cette affaire furent
ouvertes contre MM. Vistinš et Perepjolkins, mais ils ne
durent payer aucune somme à ce titre au final. Depuis 2000, l’Etat
loue les terrains en cause à une société privée de transport.
Article
1 du Protocole n°1 La Cour doit s’assurer
que l’expropriation remplissait trois conditions
fondamentales. Premièrement,
l’expropriation doit avoir été réalisée « dans les
conditions prévues par la loi ». Comme les juridictions
lettones l’ont constaté, la procédure normale d’expropriation
en Lettonie à l’époque des faits était fixée dans la loi
générale de 1923, mais le cas de MM. Vistinš et
Perepjolkins a été réglé par la loi spéciale de 1997, qui
prévoyait une procédure dérogatoire d’expropriation.
Certes, avant l’adoption de la loi spéciale, MM.
Vistinš et Perepjolkins pouvaient s’attendre à ce qu’une
expropriation éventuelle se déroule selon les conditions
prévues par la loi de 1923, mais cela ne suffit pas en soi à
contester la légalité des dispositions spéciales adoptées
dans leur cas. De plus, la Cour accepte la thèse de la Lettonie
selon laquelle l’expropriation des terrains dans cette
affaire s’inscrivait dans le processus de dénationalisation
après le retour de la Lettonie à l’indépendance (le
Législateur lui-même ayant précisé cela). Or, précisément
dans ce domaine, il est possible qu’une loi particulière
établisse des règles spéciales pour une ou plusieurs personnes
sans nécessairement porter atteinte à l’exigence de
légalité : le Législateur doit en effet disposer d’une
marge de manoeuvre particulièrement large notamment pour
corriger, pour des motifs d’équité et de justice sociale,
des lacunes ou injustices créées lors de la dénationalisation.
La Cour ne voit rien de déraisonnable ou manifestement contraire
aux objectifs fondamentaux de l’article 1 du Protocole no 1
dans la loi spéciale du 30 octobre 1997, et l’expropriation
des terrains de MM. Vistinš et Genaijs Perepjolkins a donc
été effectuée « dans les conditions prévues par la loi ». Deuxièmement,
l’expropriation doit avoir été menée « pour cause d’utilité
publique ». La Cour admet également que tel était le cas, dans
la mesure où la mesure imposée à MM. Vistinš et Genaijs
Perepjolkins tendait à l’optimisation de la gestion des
infrastructures du port autonome de Riga, question qui relève de
la politique des transports et, plus généralement, de la
politique économique du pays. Troisièmement
et dernièrement, un « juste équilibre » doit avoir été
ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la
communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu – ce qui touche ici à la
question du montant de l’indemnité d’expropriation. La
Cour précise à cet égard qu’elle ne peut pas se
substituer aux juridictions lettones pour déterminer sur quelle
base elles avaient à fixer le montant de l’indemnisation.
Certes, elle constate une extrême disproportion entre la valeur
cadastrale actuelle des terrains en cause et celle – prise
en compte pour déterminer le montant de l’expropriation
– des terrains en 1940, la première étant environ 350 fois
supérieure à la seconde. Toutefois, il est évident que cette
augmentation très forte de la valeur des terrains a résulté du
développement des infrastructures portuaires qui s’y
trouvent et du changement total de l’importance stratégique
de ces terrains au cours de plusieurs décennies, facteurs
objectifs auxquels ni MM. Vistinš et Perepjolkins ni les
anciens propriétaires n’ont contribué. La Cour relève
ensuite que MM. Vistinš et Perepjolkins avaient acquis les
terrains en question gratuitement et ne les ont possédés que
trois ans, sans rien y investir ni sans payer d’impôts y
relatifs. Les autorités lettones étaient donc fondées à ne
pas rembourser à MM. Vistinš et Perepjolkins la pleine
valeur marchande des biens expropriés. La Cour note encore que
MM. Vistinš et Perepjolkins ont perçu environ 85 000 EUR et
593 150 EUR au titre d’arriérés de baux sur leurs terrains.
Même si ces sommes leur ont été payées sur un fondement
juridique totalement distinct de l’expropriation, il n’en
demeure pas moins qu’ils ont profité d’un « effet d’aubaine
» et, si l’on observe la situation dans son ensemble, les
montants payés au titre de l’indemnisation (environ 850 EUR
et 13 500 EUR) ne paraissent pas disproportionnés. La Cour
relève encore que MM. Vistinš et Perepjolkins ont
bénéficié de garanties procédurales adéquates et que le cas
présent est comparable à celui de 23 terrains occupés par l’aéroport
de Riga et expropriés de la même façon auparavant. La Cour en
conclut, par six voix contre une, à l’absence de violation
de l’article 1 du Protocole n°1. L'ABANDON DU PROJET D'INTERÊT GÉNÉRAL KANAGINIS
c. GRÈCE du 27 octobre 2016 requête 27662/09 Violation
de l'article 1 du Protocole 1 : Les biens sont expropriés pour
cause d'intérêt général abandonné. L'État revend les biens
à un prix bien supérieur que celui auquel, il a exproprié.
Les requérants ne peuvent pas suivre. La violation est
constatée. a)
Applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 37.
L’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 n’est
pas contestée en l’espèce. La Cour rappelle cependant que
la notion de « biens » évoquée à la première partie de l’article
1 du Protocole no1 a une portée autonome qui ne se limite pas à
la propriété de biens corporels et qui est indépendante par
rapport aux qualifications formelles du droit interne : certains
autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi
passer pour des « droits patrimoniaux » et donc des « biens »
aux fins de cette disposition. Dans chaque affaire, il importe d’examiner
si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu
le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé
par l’article 1 du Protocole no1 (voir, parmi d’autres,
Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 129, CEDH 2000-V et
Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-I). 38.
La Cour note, d’une part, que l’article 12 de la loi no
2882/2001 prévoyait la révocation d’une expropriation
déjà accomplie moyennant la restitution par le propriétaire de
l’indemnité qui lui avait été versée, mais réajustée (paragraphe
15 ci-dessus). D’autre part, elle relève que par son arrêt
no 2319/2004, le Conseil d’Etat a annulé le refus de l’administration
de révoquer l’expropriation, jugeant que le but de celle-ci
avait été abandonné (paragraphe 7 ci-dessus). 39.
La Cour se déclare convaincue que les éléments susmentionnés
montrent que le requérant avait un intérêt patrimonial qui
était reconnu en droit grec et qui relevait de la protection de
l’article 1 du Protocole no 1. b)
Observation de l’article 1 du Protocole no 1 i.
Principes généraux 40.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 1 du
Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété,
contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime
dans la première phrase du premier alinéa et revêt un
caractère général, énonce le principe du respect de la
propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du
même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à
certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le
second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le
pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens
conformément à l’intérêt général. Les deuxième et
troisième normes, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes
au droit de propriété, doivent s’interpréter à la
lumière du principe consacré par la première (voir, parmi d’autres,
Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 62, CEDH 2007-I). 41.
Tant une atteinte au respect des biens qu’une abstention d’agir
doivent ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde
des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres,
Nastou c. Grèce (no 2), no 16163/02, § 31, 15 juillet 2005).
Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la
structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier. En
particulier, il doit exister un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par
toute mesure appliquée par l’Etat, y compris les mesures
privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera
S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 38, série A no
332). Dans chaque affaire impliquant la violation alléguée de
cette disposition, la Cour doit vérifier si, en raison de l’action
ou de l’inaction de l’Etat, la personne concernée a
dû supporter une charge disproportionnée et excessive (Broniowski,
précité, § 150). 42.
Pour apprécier la conformité de la conduite de l’Etat à l’article
1 du Protocole no 1, la Cour doit se livrer à un examen global
des divers intérêts en jeu, en gardant à l’esprit que la
Convention a pour but de sauvegarder des droits qui sont «
concrets et effectifs ». Elle doit aller au-delà des apparences
et rechercher la réalité de la situation litigieuse. Cette
appréciation peut porter non seulement sur les modalités d’indemnisation
applicables – si la situation s’apparente à une
privation de propriété – mais également sur la conduite
des parties, y compris les moyens employés par l’Etat et
leur mise en œuvre. À cet égard, il faut souligner que l’incertitude
– qu’elle soit législative, administrative, ou tenant
aux pratiques appliquées par les autorités – est un
facteur qu’il faut prendre en compte pour apprécier la
conduite de l’Etat. En effet, lorsqu’une question d’intérêt
général est en jeu, les pouvoirs publics sont tenus de réagir
en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande
cohérence (Vasilescu c. Roumanie, arrêt du 22 mai 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998-III, § 51 ; Beyeler, précité,
§§ 110 in fine, 114 et 120 in fine ; Broniowski, précité, §
151). 43.
La Cour estime utile de relever aussi qu’elle jouit d’une
compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne (Håkansson
et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 47, série A no 171-A)
et qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux
juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités
nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe
d’interpréter la législation interne (Waite et Kennedy c.
Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I). Néanmoins,
le rôle de la Cour est de rechercher si les résultats auxquels
sont parvenues les juridictions nationales sont compatibles avec
les droits garantis par la Convention et ses Protocoles. La Cour
relève que, nonobstant le silence de l’article 1 du
Protocole no 1 en matière d’exigences procédurales, une
procédure judiciaire afférente au droit au respect des biens
doit aussi offrir à la personne concernée une occasion
adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes
afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux
droits garantis par cette disposition. Pour s’assurer du
respect de cette condition, il y a lieu de considérer les
procédures applicables d’un point de vue général (voir Capital
Bank AD c. Bulgarie, no 49429/99, § 134, CEDH 2005-XII
(extraits) ; Zafranas c. Grèce, no 4056/08, § 36, 4 octobre 2011). ii.
Application des principes en l’espèce 44.
À titre liminaire, la Cour estime opportun de rappeler le
libellé précis du grief du requérant devant elle : celui-ci se
plaint qu’en raison de la manière dont l’article 12 de
la loi no 2882/2001 régissait la détermination de l’indemnité
à payer pour le rachat d’un terrain déjà exproprié, la
somme qu’il doit rembourser afin de récupérer son bien n’est
pas raisonnablement en rapport avec celle qu’il avait
perçue à titre d’indemnité d’expropriation. Le
requérant estime que l’État fait ainsi peser sur lui une
charge disproportionnée et excessive qui ne peut être
justifiée par aucune cause générale d’utilité publique. 45.
Au vu des spécificités de la présente affaire, la Cour estime
que la situation litigieuse ne constitue ni une expropriation ni
une réglementation de l’usage des biens, mais relève de la
première phrase du premier alinéa de l’article 1 du
Protocole no 1 qui énonce, de manière générale, le principe
du respect des biens (voir en ce sens, Almeida Garrett,
Mascarenhas Falcao et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, §§ 43 et 48, CEDH
2000-I). 46.
En l’occurrence, l’ingérence dans le droit du
requérant au respect de ses biens réside dans son
impossibilité de se voir retourner le terrain exproprié suite
à la révocation de l’expropriation par l’arrêt no
2319/2004 du Conseil d’État pour non accomplissement de son
but en raison du prix prétendument exorbitant qu’il devait
payer à l’État. Il n’est contesté ni que l’ingérence
était prévue par la loi, à savoir l’article 12 de la loi
no 2882/2001, ni qu’elle poursuivait un but légitime, à
savoir s’assurer que le rachat du terrain en cause par le
requérant ne se ferait pas au détriment des intérêts
financiers de l’État. Il appartient ainsi à la Cour de
vérifier, dans le cas d’espèce, que l’équilibre
voulu a été préservé de manière compatible avec le droit du
requérant au respect de ses biens (voir Saliba c. Malte, no 4251/02, § 45, 8 novembre 2005,
et Housing Association of War Disabled et Victims of War of
Attica et autres c. Grèce, no 35859/02, § 37, 13 juillet 2006). 47.
La Cour rappelle que le requérant avait obtenu, en vertu de l’arrêt
no 2319/2004 du Conseil d’État, la révocation de l’expropriation
du terrain dont il avait été le propriétaire et qu’il
avait au moins l’espérance légitime de récupérer son
bien. Sur ce point, la Cour convient avec le Gouvernement que
cette récupération n’aurait pas dû s’effectuer au
détriment de l’intérêt public. Ainsi, étant donné le
fait que le requérant s’était vu allouer une indemnité
complète lors de l’expropriation de son terrain, il n’est
pas déraisonnable que l’État ait procédé environ trente
ans environ plus tard, sur la base de la législation pertinente,
à un réajustement du montant perçu par le premier. 48.
Se penchant sur la formule de réajustement prévue par l’article
12 de la loi no 2882/2001, la Cour note que ladite disposition ne
prévoit qu’une équation qui consiste à multiplier l’indemnité
d’expropriation perçue par l’intéressé avec le
rapport entre l’indice annuel moyen des prix à la
consommation de l’année de fixation de l’indemnité
pour la récupération du bien et celui de la date d’encaissement
de l’indemnité d’expropriation par son titulaire. En d’autres
termes, le système mis en œuvre à l’époque des faits
par la législation pertinente reposait sur l’évolution des
prix à la consommation pendant la période où le terrain
concerné était exproprié ; il permettait l’actualisation
du montant correspondant à l’indemnité d’expropriation
sur la base du pouvoir d’achat de la même somme à la date
où l’intéressé avait demandé la récupération du
terrain. 49.
La Cour convient avec le Gouvernement que l’indice annuel
moyen des prix à la consommation constitue un critère simple et
objectif pour le réajustement de la somme à payer à l’État
en vue de la récupération du terrain litigieux. Il sert ainsi
à l’actualisation de la somme reçue par l’intéressé
à titre d’indemnité d’expropriation à l’aune d’un
indice économique qui permet d’estimer entre deux périodes
données la variation moyenne des prix de produits et donc l’évolution
de la valeur de la monnaie. 50.
La Cour note cependant, comme l’indique le requérant, que
le critère de l’indice annuel moyen des prix à la
consommation est de caractère abstrait, se focalise sur la
situation économique générale du pays et ne permet pas de
tirer de conclusions pertinentes sur l’évolution du marché
immobilier de celui-ci pendant une période donnée et, d’autant
plus, sur l’évolution de la valeur d’un bien
immobilier particulier. Etant l’unique outil à employer
pour le réajustement de la somme à payer, ledit critère se
caractérise par une certaine rigidité qui peut compromettre sa
pertinence lors de son application dans des cas concrets. 51.
À cet égard, la Cour rappelle que dans une affaire issue d’une
requête individuelle, il lui faut se borner à l’examen du
cas concret dont on l’a saisie. Sa tâche ne consiste point
à contrôler in abstracto la loi applicable en l’espèce au
regard de la Convention, mais à rechercher si la manière dont
elle a été appliquée au requérant ou l’a touchée a
enfreint la Convention (Olsson c. Suède (no 1), arrêt du 24
mars 1988, série A no 130, § 54). Pour revenir au cas d’espèce,
l’application du critère précité n’a pas permis à l’autorité
compétente de prendre en compte d’autres éléments qui
étaient pertinents, ou même nécessaires, pour un juste calcul
de la somme à rembourser à l’État. Ainsi, à titre d’exemple,
l’autorité compétente n’a pas pu tenir compte de la
valeur vénale du terrain à l’époque des faits ainsi que
de la valeur de terrains limitrophes ou d’autres terrains
sis au même quartier qui avaient été expropriés à l’époque.
La Cour a d’ailleurs affirmé que l’indemnité d’expropriation
pour un terrain constructible doit correspondre à la valeur
marchande de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Guiso-Gallisay c.
Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 105, 22 décembre
2009). 52.
En outre, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de
fixer à quel moment dans le temps l’administration aurait
dû se placer pour fixer le montant réajusté de l’indemnité
d’expropriation. Toutefois, pour apprécier la
proportionnalité entre ce montant et la valeur réelle du bien
du requérant, la Cour ne peut pas ignorer l’évolution du
marché immobilier en Grèce, telle qu’elle ressort du
dossier, et la durée de la procédure de révocation de l’expropriation
litigieuse. En effet, si la procédure relative à la fixation de
la somme à payer par le requérant pour récupérer son bien a
pris fin le 5 février 2009 (avec la mise au net de l’arrêt
no 2492/2008 du Conseil d’Etat), la Cour note que le
requérant a pour la première fois demandé cette révocation en
1992 et que le Conseil d’Etat s’est prononcé sur celle-ci
en 2004, jugeant que le but de l’expropriation avait été
abandonné. 53.
Il n’appartient pas non plus à la Cour de dire quel est le
montant exact que le requérant devait verser à l’Etat au
titre de l’indemnité réajustée. Toutefois, compte tenu
des considérations ci-dessus, la Cour estime qu’il existe
une grande différence entre le montant réclamé par l’Etat
(paragraphes 8 et 10 ci-dessus) et la valeur réelle du terrain
telle qu’elle ressort des éléments du dossier (voir
notamment le paragraphe 13 ci-dessus). Cette différence ne
saurait passer pour raisonnable en l’espèce. 54.
Par ailleurs, selon la nouvelle formulation de l’article 12
de ladite loi (paragraphe 16 ci-dessus), le Comité administratif
ou l’expert indépendant prennent en compte plusieurs
éléments pertinents pour évaluer le prix du bien immobilier,
tels que la valeur des terrains adjacents ou similaires ainsi que
le possible revenu résultant de l’exploitation du terrain.
De plus, en cas de désaccord sur le montant de l’indemnité
due entre l’État et l’intéressé, les juridictions
compétentes tranchent le différend sans être obligées par la
loi d’appliquer un critère tel que l’indice annuel
moyen des prix à la consommation. 55.
En outre, la Cour estime important de relever qu’en l’occurrence
les deux décisions administratives nos 1087631/6632/?0010 et
1064217/4182/?0010, par lesquelles l’autorité compétente a
fixé l’indemnité à payer pour la récupération du
terrain litigieux, sont toujours valides. Comme il est confirmé
par le Gouvernement, c’est à la discrétion totale de l’administration
de recalculer l’indemnité à payer au cas où le requérant
reviendrait devant elle avec une nouvelle demande de ce type. Or,
la valeur actuelle du terrain en cause selon l’estimation de
l’autorité fiscale compétente est aujourd’hui de 254
853,03 euros, à savoir bien inférieure à celle fixée par la
décision no 1064217/4182/?0010 (paragraphe 10 ci-dessus). Il est
donc évident que le requérant se trouve devant une situation d’impasse
qui rend de fait impossible la récupération de sa propriété. 56.
Au demeurant, force est de constater que devant le Conseil d’État
le requérant a soulevé des arguments précis tirés de l’article
17 de la Constitution et de l’article 1 du Protocole no 1.
Or la haute juridiction administrative s’est bornée à
rappeler sa jurisprudence sur la nature administrative de la
révocation d’une expropriation accomplie et de considérer,
sans autre explication, qu’une atteinte au droit au respect
des biens n’était pas établie. La Cour considère alors
que le requérant n’a pas eu une occasion adéquate de
contester effectivement devant les autorités judiciaires les
mesures portant atteinte à son droit garanti par l’article
1 du Protocole no 1 (paragraphe 43 ci-dessus). 57.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, dans le cas d’espèce,
le critère tel qu’appliqué au requérant à l’époque
des faits en vertu de l’article 12 de la loi no 2882/2001,
ainsi que le raisonnement du Conseil d’État dans son arrêt
no 2492/2008 ont rompu le juste équilibre devant régner entre
les exigences de l’intérêt public et les impératifs de la
sauvegarde du droit de l’intéressé au respect de ses biens. 58.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no1. EXPROPRIATION
EN FRANCE : Le Rapport au Président de
la République relatif à l'ordonnance n° 2014-1345
du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, explique que la procédure est
simplifiée. LA COUR
CONSTATE QUE LES ARTICLES L12-1 et L12-2 DU CODE DE L'EXPROPRIATION
EST CONFORME A LA CONSTITUTION cour de
cassation chambre civile 3 arrêt du 26 mai 2011 N° de pourvoi:
10-25923 rejet Attendu que les
époux X..., les époux Y..., Mme Z..., M. A... et M. B...
soutiennent que les dispositions des articles L. 12-1 et L. 12-2
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont
incompatibles avec les articles 16 et 17 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 UNE PERSONNE
EXPROPRIEE DE SON HABITATION A DROIT AU RELOGEMENT cour de
cassation chambre civile 3 arrêt du 27 février 2013 pourvoi N°
12-11995 cassation Vu les articles
L. 14-1 et R. 14-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, ensemble l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme ; LE CUMUL DES
PROCEDURES D'EXPROPRIATION ET D'INDEMNISATION EST POSSIBLE Cour de
Cassation chambre commerciale arrêt du 7 septembre 2011 requête
n° 10-10597 REJET Mais attendu qu'ayant
relevé que, compte tenu de la présence sur le même site de
logements frappés d'insalubrité irrémédiable et de bâtiments
salubres ou commerciaux, la procédure d'expropriation s'était
déroulée selon le droit commun et exactement retenu que rien n'interdisait
l'application simultanée des textes de droit commun et de la loi
du 10 juillet 1970 dès lors que les conditions requises pour l'application
de cette loi aux logements insalubres étaient réunies, la cour
d'appel a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, que l'indemnité
relative à l'expropriation de ces logements insalubres devait
être fixée conformément aux dispositions de l'article 18 de
cette loi. LES DÉLAIS
BREFS DE LA PROCÉDURE D'EXPROPRIATION SONT PROPORTIONNES A L'ARTICLE
1 DU PROTOCOLE 1 Cour de
Cassation chambre civile 3, arrêt du 5 mars 2014 requête n° 12-28578
12-28579 12-28580 12-28581 12-28582 12-28583 12-28584 12-28585 12-28586
Rejet Attendu que les
expropriés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 2012),
de dire que l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique est conforme à l'article 6, § 1er de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et de prononcer la déchéance de leur
appel, alors, selon le moyen, que si l'article R. 13-49 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que l'appelant
doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser « son
mémoire et les documents qu'il entend produire » au greffe de
la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel, cette
déchéance de son appel ne saurait s'appliquer dans les cas où
la partie expropriée appelante, tout en ayant déposé ou
adressé son mémoire à l'intérieur du dit délai, a, cependant,
produit ses pièces et documents à l'extérieur de celui-ci,
sauf à porter une atteinte disproportionnée à son droit à un
procès équitable et à son droit à un recours effectif, ainsi
qu'à son droit de propriété ; que, dès lors, en ayant retenu
la licéité d'une telle mesure pour sanctionner le seul dépôt
tardif des pièces produites par les parties expropriées
appelantes, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble
l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son
Protocole additionnel n° 1 ; LE BIEN
EXPROPRIÉ NON UTILISÉ DOIT ÊTRE RETROCÉDÉ Cour de
cassation chambre civile 3 arrêt du 18 avril 2019 pourvois n°
18-11.414 cassation partielle Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
28 septembre 2017), que M. Y... et M. Z..,
propriétaires d’une parcelle de terre située dans un
emplacement réservé par le plan d’occupation des sols, ont
mis en demeure la commune de Saint-Tropez (la commune) de l’acquérir
en application de la procédure de délaissement alors prévue
par l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme ; qu’aucun
accord n’étant intervenu sur le prix de cession, un
jugement du juge de l’expropriation du 20 septembre 1982 a
ordonné le transfert de propriété au profit de la commune et
un arrêt du 8 novembre 1983 a fixé le prix d’acquisition ;
que, le 22 décembre 2008, le terrain a été revendu et, le 18
octobre 2011, a fait l’objet d’un permis de construire ;
que Mme X..., venant aux droits de MM. Y... et Z..., a
assigné la commune en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses deux
premières branches : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt
de rejeter sa demande sur le fondement du droit de rétrocession, Mais attendu qu’en vertu de l’article L.
123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable
à la cause, le propriétaire d’un fonds grevé d’un
emplacement réservé dispose du droit de délaissement qui
consiste à enjoindre à la collectivité publique d’acquérir
le bien faisant l’objet de la réserve ; Attendu que l’article L. 12-6 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique, alors applicable, permet à
l’exproprié de demander la rétrocession du bien si celui-ci
n’a pas reçu dans les cinq ans la destination prévue par l’acte
déclaratif d’utilité publique ; Attendu qu’il est jugé que l’exercice du
droit de délaissement, constituant une réquisition d’achat
à l’initiative du propriétaire du bien, ne permet pas au
cédant de solliciter la rétrocession de ce bien sur le
fondement de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique, même lorsque le juge de l’expropriation
a donné acte aux parties de leur accord sur la fixation du prix
et ordonné le transfert de propriété au profit de la
collectivité publique (3e Civ., 26 mars 2014, pourvoi n° 13-13.670,
Bull. 2014, III, n° 44) ; Attendu que, en matière d’expropriation, si le
droit de rétrocession est applicable en cas de cession amiable
postérieure à une déclaration d’utilité publique, il ne
l’est pas en cas de cession antérieure à celle-ci lorsque
les cédants n’ont pas demandé au juge de l’expropriation
de leur en donner acte en application des dispositions de l’article
L. 12-2, devenu L. 222-2, du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique, une telle cession ne pouvant
avoir les mêmes effets qu’une ordonnance d’expropriation
(3e Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 07-13.972, Bull.
2008, III, n° 138) ; Que, toutefois, le droit de rétrocession est
également applicable en cas de cession amiable précédée d’une
déclaration d’utilité publique prise en application de l’article
1042 du code général des impôts, dans sa rédaction
antérieure à celle issue de la loi n° 82-1126 du 29
décembre 1982 (3e Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 07-21.589,
Bull. 2009, III, n° 146) ; Attendu qu’ayant, par motifs propres et
adoptés, relevé que les décisions ayant ordonné le transfert
de propriété au profit de la commune et fixé le prix d’acquisition
ne faisaient pas état d’une déclaration d’utilité
publique et retenu qu’il n’était pas établi qu’un
arrêté d’utilité publique de l’acquisition ait été
pris par l’autorité administrative, la cour d’appel,
qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que
ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu,
abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant
relatif aux effets de la déclaration d’utilité publique
prise en application de l’article 1042 précité, que Mme X...
ne pouvait pas prétendre à la rétrocession du terrain, ni à
une indemnité compensatrice, sur le fondement de l’article
L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, alors applicable ; D’où il suit que le moyen n’est pas
fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa
troisième branche, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l’article 1er du premier protocole
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ; Attendu, selon ce texte, que toute personne physique
ou morale a droit au respect de ses biens ; Attendu que Mme X... est fondée à se
prévaloir du droit garanti par ce texte, dès lors que la
parcelle ayant fait l’objet du droit de délaissement
constitue un bien protégé au sens de celui-ci ; Que la mesure contestée, en ce qu’elle prive
de toute indemnisation consécutive à l’absence de droit de
rétrocession le propriétaire ayant exercé son droit de
délaissement sur le bien mis en emplacement réservé et donc
inconstructible, puis revendu après avoir été déclaré
constructible, constitue une ingérence dans l’exercice de
ce droit ; Que cette ingérence a une base claire et accessible
en droit interne dès lors qu’elle est fondée sur les
textes et la jurisprudence précités ; Qu’elle est justifiée par le but légitime
visant à permettre à la personne publique de disposer, sans
contrainte de délai, dans l’intérêt général, d’un
bien dont son propriétaire a exigé qu’elle l’acquière ; Que, cependant, il convient de s’assurer,
concrètement, qu’une telle ingérence ménage un juste
équilibre entre les exigences de l’intérêt général et
les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux et, en
particulier, qu’elle est proportionnée au but légitime
poursuivi ; Qu’à cet égard, il y a lieu de relever qu’un
auteur de Mme X... avait, sur le fondement du droit de
délaissement et moyennant un prix de 800 000 francs (121 959,21
euros), cédé à la commune son bien, qui faisait alors l’objet
d’une réserve destinée à l’implantation d’espaces
verts, et que la commune, sans maintenir l’affectation du
bien à la mission d’intérêt général ayant justifié sa
mise en réserve, a modifié les règles d’urbanisme avant
de revendre le terrain, qu’elle a rendu constructible, à
une personne privée, moyennant un prix de 5 320 000 euros Qu’il en résulte que, en dépit du délai de
plus de vingt-cinq années séparant les deux actes, la mesure
contestée porte une atteinte excessive au droit au respect des
biens de Mme X... au regard du but légitime poursuivi ; Que, dès lors, en rejetant la demande en paiement
de dommages-intérêts formée par Mme X..., la cour d’appel
a violé le texte susvisé ; Cour de
cassation chambre civile 3 arrêt du 17 décembre 2014 pourvois
n° 13-18990 Rejet Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2013), que la parcelle bâtie
BJ 150, expropriée au profit de la commune de Drancy n'ayant pas
reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité
publique, la société civile immobilière Jacpat (la SCI) a
assigné la commune afin de voir reconnaître son droit à
rétrocession ; que les bâtiments ayant été détruits par l'expropriant,
la SCI a sollicité des dommages-intérêts en réparation,
notamment, du préjudice résultant de l'impossibilité de
procéder à cette rétrocession Attendu que la
société Jacpat fait grief à l'arrêt de dire que la
rétrocession est possible et que le prix sera fixé à l'amiable
ou à défaut par le juge de l'expropriation Mais attendu
que la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite de
motifs surabondants relatifs à l'état du bien à la date de l'ordonnance
d'expropriation, que la démolition de l'immeuble construit sur
la parcelle ne rendait pas impossible la rétrocession RTE NANTI D'UNE
DUP, PEUT PÉNÉTRER SUR LES TERRAINS PRIVÉS, POUR INSTALLER DES
PYLÔNES ÉLECTRIQUES COUR DE
CASSATION Chambre Civile 3, arrêt du 11 mars 2015 Pourvoi n° 13-24133
REJET Attendu, selon
l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Caen, 4
juin 2013), que M. X... et Mme Y... et la société de l'Avenir
ont assigné la société Réseau de transport d'électricité (la
société RTE) pour voir dire qu'en pénétrant sur leur
propriété, sans leur accord et sans autorisation d'occupation
temporaire, pour y effectuer des travaux d'implantation de deux
pylônes d'une ligne électrique aérienne, la société RTE
avait commis une voie de fait et lui enjoindre de cesser les
travaux et d"évacuer les lieux Mais attendu qu'il
n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant,
par exception au principe de séparation des autorités
administratives et judiciaires, la compétence des juridictions
de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la
réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a
procédé à l'exécution forcée, dans des conditions
irrégulières, d'une décision, même régulière, portant
atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction
d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les
mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction
d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible
d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité
administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un
ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède
pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un
pouvoir dont dispose l'administration ; EXPROPRIATION
PARTIELLE D'UN BIEN, LE DOCUMENT D'ARPENTAGE EST OBLIGATOIRE COUR DE
CASSATION Chambre Civile 3, arrêt du 13 juin 2019 Pourvoi n° 17-27.868
rejet Attendu que Mme A... X... s’est pourvue en
cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation
du département du Gard du 3 août 2017 ayant ordonné le
transfert de propriété, au profit du conseil départemental du
Gard, d’une partie d’une parcelle dont elle est
propriétaire en indivision avec M. B... X... ; Mais attendu, d’une part, qu’il
résulte du dossier de la procédure que le dépôt du dossier
des enquêtes préalable à la déclaration d’utilité
publique et parcellaire à la mairie a été notifié à Mme X...
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
envoyée à l’adresse mentionnée dans l’état
parcellaire et délivrée le 18 février 2017, sans qu’il
soit établi que l’autorité expropriante ait eu
connaissance à cette date d’une autre adresse, et que les
enquêtes publiques se sont déroulées du 6 au 24 mars 2017
inclus ; Attendu, d’autre part, que les annexes
jointes à l’ordonnance et établies après un document d’arpentage
délimitent avec précision la fraction expropriée de la
parcelle dans sa superficie et indiquent les désignations
cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance
et sa situation ; D’où il suit que le moyen n’est pas
fondé ; COUR DE
CASSATION Chambre Civile 3, arrêt du 13 juin 2019 Pourvoi n° 18-14.225
cassation sans renvoi Vu les articles
R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique, ensemble l’article 7 du
décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière; Attendu que l’ordonnance
prononçant l’expropriation désigne chaque immeuble ou
fraction d’immeuble exproprié et précise l’identité
des expropriés, conformément aux dispositions de l’article
R. 132-2 renvoyant aux prescriptions de l’article 7 du
décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière ; Que l’article
7, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1955 prévoit que, lorsqu’il
y a division de la propriété du sol entraînant changement de
limite, l’acte doit désigner l’immeuble tel qu’il
existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles
résultant de cette division ; Que le dernier
alinéa de cet article dispose que, dans la plupart des cas, la
désignation est faite conformément à un extrait cadastral et,
en cas de changement de limite, d’après les documents d’arpentage
établis spécialement en vue de la conservation du cadastre ; Que l’article
25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la conservation du
cadastre précise que tout changement de limite de propriété
doit être constaté par un document d’arpentage qui est
soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de
l’acte réalisant le changement de limite, pour
vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété ; Attendu qu’il
résulte de ces textes qu’en cas d’expropriation
partielle impliquant de modifier les limites des terrains
concernés, un document d’arpentage doit être
préalablement réalisé afin que les parcelles concernées
soient désignées conformément à leur numérotation issue de
ce document ; Attendu que,
pour transférer, au profit de la commune de Millau, des
parcelles appartenant à Mmes B... C..., A... C..., D... C...
et F... Z..., à M. G... Z... et à M. et Mme Y...,
l’ordonnance attaquée (juge de l’expropriation du
département de l’Aveyron, 28 décembre 2017) désigne les
biens expropriés en annexant un état parcellaire ; Qu’en
statuant ainsi, en l’absence de document d’arpentage
désignant les parcelles issues de la division opérée par l’expropriation
partielle, le juge de l’expropriation a violé les textes
susvisés ; D’où il
suit que l’ordonnance est entachée d’un vice de forme
qui doit en faire prononcer l’annulation ; Et vu l’article
627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties
en application de l’article 1015 du même code ; L'EXPROPRIATION INDIRECTE D'UN BIEN Catak et autres C. Turquie arrêt du 3 décembre 2024 requête n° 33189/21 Art 1 P1 • Administration, qui avait légalement pris
possession d’une partie du bien des requérants lors d’une expropriation
d’urgence, ayant retardé durant six ans le paiement de l’intégralité de
l’indemnité • Droit interne n’ayant pas offert aux requérants des garanties
suffisantes contre des atteintes arbitraires de la puissance publique •
Privation de propriété ne pouvant passer pour avoir satisfait à l’exigence de légalité CEDH a) Sur la norme applicable 96. La Cour rappelle que l’article
1 du Protocole no 1 contient trois normes
distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier
alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la
propriété ; la deuxième, qui figure dans la seconde phrase du même alinéa, vise
la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la
troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir,
entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La
deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes
au respect des biens, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré
par la première (voir, entre autres,



Mais attendu que les questions posées ne présentent pas un
caractère sérieux, d'une part, en ce que le juge de l'expropriation
ne peut prononcer l'ordonnance portant transfert de propriété
qu'au vu d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique
et d'un arrêté de cessibilité exécutoires et donc après qu'une
utilité publique ait été légalement constatée et, d'autre
part, en ce que le juge doit seulement constater à ce stade, par
une ordonnance susceptible d'un pourvoi en cassation, la
régularité formelle de la procédure administrative
contradictoire qui précède son intervention
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil
constitutionnel
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les
questions prioritaires de constitutionnalité
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2011),
que par un jugement du 28 mai 2009, la juridiction de l'expropriation
du département de la Gironde a fixé l'indemnité devant revenir
aux consorts X..., par suite de l'expropriation au profit de la
communauté urbaine de Bordeaux (la CUB), d'immeubles leur
appartenant, en la calculant sur une valeur libre de toute
occupation ; que par un arrêté du 9 février 2010, le
président de la CUB a consigné le montant de l'indemnisation à
la caisse des dépôts et consignations, les consorts X... ayant
refusé de fournir leurs coordonnées bancaires et que la CUB a
assigné les consorts X... en expulsion, en application de l'article
L. 15-1 du code de l'expropriation
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient,
par motifs propres, que l'article R. 14-10 du code de l'expropriation
prévoit qu'il ne peut être offert un local de relogement à un
propriétaire exproprié que si cette offre a été acceptée par
le propriétaire avant la fixation des indemnités
d'expropriation, afin de permettre au juge de l'expropriation de
tenir compte de ce relogement lors de la fixation de l'indemnité
d'expropriation ; qu'en l'espèce le débat sur l'indemnité d'expropriation
est clos sans que nul n'ait évoqué le problème du relogement,
si bien que l'indemnité a été calculée sur la valeur d'un
immeuble libre d'occupation, que les appelants ne peuvent donc
prétendre à un droit au relogement et, par motifs adoptés, que
si les consorts X... avaient fait une demande de relogement dans
des documents non versés aux débats de l'audience du 12 mars
2009 du juge de l'expropriation, il y avait été renoncé lors
de cette audience, faute d'information du juge sur cette demande,
qu'il avait été produit divers documents révélant que les
consorts X... avaient bien présenté une demande de relogement
après cette audience, que cependant cette demande était tardive
car elle était intervenue après la renonciation implicite lors
de la fixation des indemnités d'expropriation et que du fait de
diligences tardives, la cour d'appel n'avait pas pu prendre en
compte la demande de relogement dans la fixation des indemnités,
les consorts X... ayant été déchus de leur appel en raison du
dépôt de leur mémoire plus de deux mois après leur
déclaration d'appel
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les
consorts X... bénéficiaient d'un droit au relogement et sans
relever que la CUB, qui en avait l'obligation, leur avait fait
deux propositions de relogement portant sur des locaux
satisfaisant aux normes visées à l'article L. 314-2 du code de
l'urbanisme avant la fixation définitive des indemnités d'expropriation,
la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation
claire et non équivoque des expropriés à leur droit au
relogement, a violé les textes susvisés
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 13-49 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'appliquant
indifféremment à l'expropriant ou à l'exproprié selon que l'un
ou l'autre relève appel principal de la décision et l'obligation
de déposer les pièces visées dans le mémoire d'appel en même
temps que celui-ci étant justifiée par la brièveté du délai
imparti à l'intimé et au commissaire du gouvernement pour
déposer, à peine d'irrecevabilité, leurs écritures et leurs
pièces, la cour d'appel a fait une exacte application de cet
article, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits
garantis par l'article l'article 6, § 1er de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1
Attendu qu'ayant relevé que le principe de la construction de la
ligne à très haute tension qui devait survoler les parcelles
non bâties appartenant à M. X... et Mme Y... et exploitées par
la société de l'Avenir avait fait l'objet d'une déclaration d'utilité
publique du 25 juin 2010 et qu'un arrêté préfectoral de mise
en servitude avait été pris le 27 mars 2012, la cour d'appel,
qui a retenu à bon droit que les articles L. 323-3, L. 323-4 et
L. 325-5 du code de l'énergie se bornaient à organiser le
réseau de transport et de distribution d'électricité et
prévoyaient une juste indemnisation en contrepartie de la
servitude, ce dont il résultait que l'action de l'autorité
administrative, en application de ces textes, dont il n'appartient
pas à la Cour de cassation d'apprécier la constitutionnalité
au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789 et qui ne sont pas contraires à l'article
1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme, n'emportait pas extinction
du droit de propriété appartenant aux propriétaires des
parcelles concernées et ne procédait pas d'un acte
manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont
dispose l'administration, en a exactement déduit, répondant aux
conclusions, que la société RTE n'avait pas commis de voie de
fait et que les juridictions judiciaires étaient incompétentes
pour connaître du litige
97. Elle note que l’ingérence dans le droit au respect de leurs biens dont se plaignent les requérants est une expropriation, c’est-à-dire une privation de propriété, laquelle doit être examinée sur le terrain de la deuxième norme.
b) Sur le respect des exigences de l’article 1 du Protocole no 1
Principes applicables
98. La Cour rappelle que toute atteinte aux droits protégés par l’article 1 du Protocole no 1 doit satisfaire à l’exigence de légalité (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 112, 13 décembre 2016).
99. L’existence d’une base légale en droit interne ne suffit pas, en tant que telle, à satisfaire au principe de légalité. Il faut, en plus, que cette base légale présente une certaine qualité, celle d’être compatible avec la prééminence du droit et d’offrir des garanties contre l’arbitraire (Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 96, 25 octobre 2012).
100. À cet égard, il convient de noter que le terme « loi » figurant à l’article 1 du Protocole no 1 renvoie au même concept que lorsqu’il est utilisé dans le reste de la Convention. Il s’ensuit que les normes de droit sur lesquelles se fonde l’ingérence doivent être suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application. En particulier, une norme est « prévisible » lorsqu’elle offre une certaine garantie contre des atteintes arbitraires de la puissance publique. Toute ingérence dans l’exercice du droit au respect des biens doit, par conséquent, s’accompagner de garanties procédurales offrant à la personne ou à l’entité concernées une possibilité raisonnable d’exposer sa cause aux autorités compétentes, de manière à permettre une contestation effective des mesures litigieuses. Pour s’assurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer l’ensemble des procédures judiciaires et administratives applicables (Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 95, 11 décembre 2018 et les références qui y figurent).
Application au cas d’espèce
101. La Cour observe qu’en 2016, l’administration a engagé une procédure d’expropriation d’urgence visant le bien des requérants, et que conformément à la législation en vigueur, à savoir l’article 27 de la LRE, elle a saisi à cette fin le TGI compétent, versé l’indemnité provisionnelle puis a pris possession du bien après y avoir été autorisée par l’autorité judiciaire.
102. Quoiqu’en dise le Gouvernement, il ne ressort nullement des rapports d’expertises que l’administration n’aurait pris possession du bien qu’après le 2 octobre 2020. En effet, le procès-verbal de visite des lieux dans le cadre de la première procédure indique clairement que toutes les constructions se trouvant sur la zone d’expropriation avaient été détruites et que de nouvelles infrastructures avaient été érigées sur la partie du bien non visé par l’expropriation (voir paragraphe 12 ci-dessus). Le procès-verbal de visite dressé au cours de la seconde procédure mentionne ne fait que confirmer ce point. En effet, il indique la présence de constructions et de silos sur le terrain des requérants et non sur la partie du terrain qui faisait l’objet de l’expropriation et précise que cette dernière faisait l’objet d’une emprise de l’administration (voir paragraphe 17 ci-dessus).
103. Par la suite, l’administration, toujours en application de la procédure prévue par la législation, a saisi le TGI sur le fondement de l’article 10 de la LRE afin de faire déterminer le montant de l’indemnité d’expropriation et d’obtenir le transfert de propriété.
104. Toutefois, cette première procédure n’a pas été menée à son terme et s’est soldée par une décision de rejet en raison du refus persistant de l’administration de consigner le complément d’indemnité dont le montant avait été déterminé par le TGI.
105. Une seconde procédure introduite par l’administration sur le fondement de l’article 10 de la LRE a également été rejetée, pour le même motif.
106. Ce n’est qu’au cours de la troisième procédure que l’administration a fini par consigner le complément d’indemnité et que les requérants ont enfin pu obtenir, le 10 novembre 2022, l’intégralité de leur indemnité d’expropriation.
107. En d’autres termes, l’intégralité de la somme à laquelle les requérants avaient droit en dédommagement de l’expropriation de leur bien ne leur a été versée que plus de six ans après la prise de possession de celui‑ci par l’administration, et ce en raison du comportement de l’autorité expropriante, qui a empêché que la procédure prévue par la loi fût menée à son terme.
108. La question que la Cour est dès lors appelée à trancher est celle de déterminer si le droit interne offrait des garanties suffisantes pour protéger les droits des requérants d’atteintes arbitraires de la puissance publique soit en les prévenant soit en y remédiant.
109. Elle constate, en premier lieu, que les parties s’accordent sur le fait que le droit interne n’autorise pas le juge de l’expropriation, lorsque l’administration s’abstient de consigner l’indemnité ou le complément d’indemnité, à requalifier l’action en expropriation dont il a été saisi en action pour expropriation de facto et à ordonner à l’administration de verser la somme en question. En d’autres termes, ledit juge ne peut prendre d’autre décision que celle de rejeter l’action.
110. La Cour observe ensuite que dans une procédure d’expropriation ordinaire, le rejet par le tribunal, lorsque l’administration n’a pas consigné l’indemnité d’expropriation, de l’action introduite par elle sur le fondement de l’article 10 de la LRE vise clairement à protéger les droits du propriétaire du bien en empêchant l’autorité expropriante d’en obtenir la propriété tant qu’elle n’a pas versé l’indemnité.
111. Le recours à ce procédé en matière d’expropriation d’urgence n’a cependant pas le même effet protecteur à l’égard du propriétaire du bien puisque, dans le cadre de ladite procédure, l’administration a déjà légalement pris possession du bien de façon anticipée. Au contraire, le rejet de l’action en raison du refus de consignation du complément d’indemnité par l’administration a pour conséquence de retarder le moment où l’exproprié pourra obtenir l’intégralité de l’indemnisation et permet à l’administration de tirer bénéfice de son propre comportement abusif.
112. Dans ces conditions, il apparaît que la seule voie qui s’offrait aux requérants face au défaut de consignation était l’introduction d’une action en expropriation de facto. Il convient donc de déterminer si pareille action était de nature à constituer une garantie suffisante.
113. À titre préliminaire, la Cour rappelle qu’en principe, lorsque les biens d’un individu font l’objet d’une expropriation, il doit exister une procédure qui assure une appréciation globale des conséquences de l’expropriation, incluant l’octroi d’une indemnité en relation avec la valeur du bien exproprié, la détermination des titulaires du droit à indemnité et toute autre question afférente à l’expropriation (Alfa Glass Anonymi Emboriki Etairia Yalopinakon c. Grèce, précité, §§ 36 à 44, et les références qui y figurent), de sorte que l’on ne peut exiger d’un requérant qui est partie à une procédure d’expropriation et qui a présenté des observations au sujet de l’indemnisation d’intenter une nouvelle action (Yel et autres c. Turquie, no 28241/18, § 72, 13 juillet 2021).
114. Or, l’obligation pesant sur l’exproprié de recourir à une procédure en expropriation de facto, c’est-à-dire d’introduire une nouvelle action se concilie mal avec le principe de la procédure unique décrite au paragraphe précédent.
115. La Cour rappelle également qu’elle a déjà eu à se prononcer sur des expropriations de facto à l’occasion de plusieurs affaires, et notamment dans l’arrêt Sarica et Dilaver (précité), dans lequel l’administration avait pris possession du terrain des requérants sans titre pour ce faire et où les intéressés avaient dû engager une action pour obtenir une indemnité d’expropriation.
116. La Cour a indiqué, dans cette affaire, que l’expropriation de facto constituait une pratique permettant à l’administration d’occuper un bien et de le transformer sans avoir indemnisé au préalable son propriétaire. Elle a relevé que ce sont les particuliers visés par cette mesure qui doivent entamer une action en indemnisation et engager des frais de procédure pour faire valoir leurs droits, alors qu’en matière d’expropriation formelle, la procédure est déclenchée par l’administration expropriante, qui doit en principe supporter les frais de justice à défaut de règlement amiable. La Cour a estimé que ce procédé rendant possible le contournement par l’administration des règles de l’expropriation formelle exposait les individus au risque d’un résultat imprévisible et arbitraire, qu’il n’était pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique, qu’il permettait à l’administration de tirer bénéfice de son comportement illégal et qu’il ne pouvait constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme, avant de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
117. Dans plusieurs affaires italiennes (voir, par exemple, Guiso‑Gallisay c. Italie, no 58858/00, § 91, 8 décembre 2005, ou Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, § 96, 17 mai 2005), elle a en outre retenu, pour conclure à la violation de ladite disposition, que le prix à payer par l’administration ayant recours au procédé en question n’était supérieur que de 10 % à celui acquitté dans le cas d’une expropriation en bonne et due forme.
118. La Cour relève que la Cour constitutionnelle adopte une approche similaire en la matière (paragraphe 43 ci-dessus).
119. Il est vrai que la situation en cause dans le cas d’espèce présente au moins une différence avec celles qui étaient soumises à la Cour dans les affaires susmentionnées : dans ces dernières, l’administration avait occupé et transformé les biens des requérants sans base légale alors qu’en l’espèce, la DGR a initialement agi dans un cadre légal, notamment en obtenant une déclaration d’utilité publique et une autorisation d’emprise émise par l’autorité judicaire, avant de méconnaître la procédure prévue par la loi.
120. Néanmoins, cette seule différence ne justifie pas d’adopter en l’espèce une autre approche. Que l’illégalité soit survenue dès le début ou par la suite en raison d’un refus de l’administration de se conformer à la procédure, le résultat est similaire (mutatis mutandis, Guiso‑Gallisay c. Italie, précité, § 87). En effet, l’action pour expropriation de facto ne permet pas de remédier à la circonstance que l’administration tire profit de son comportement abusif puisque, d’une part, elle n’empêche pas cette dernière de reporter le paiement de l’intégralité de l’indemnité à une date ultérieure à celle qu’induisait la procédure prévue à l’article 10 de la LRE et, d’autre part, elle n’entraîne aucun surcoût pour l’autorité expropriante, dont le comportement n’est pas sanctionnée. Cette situation n’est à l’évidence pas de nature à favoriser la bonne administration des procédures d’expropriation et à prévenir des épisodes d’abus.
121. Au demeurant, la Cour ne perd pas de vue que, comme le soulignent les requérants, la possibilité de poursuivre et de mener à son terme une action pour expropriation de facto est dans une certaine mesure tributaire du bon vouloir de l’administration, puisque l’introduction par celle-ci d’une action fondée sur l’article 10 en suspend l’examen.
122. D’ailleurs, l’action en expropriation de facto intentée par les requérants à la suite du rejet par le tribunal de la deuxième action en expropriation a été suspendue après l’introduction par l’administration d’une troisième action (voir paragraphe 24 ci-dessus).
123. La Cour note, par ailleurs, qu’absolument rien dans la règlementation ou dans la jurisprudence interne n’empêchait l’administration de s’abstenir à nouveau de consigner le complément d’indemnité tout en intentant une quatrième action après un rejet de la troisième, et d’obtenir par ce biais une nouvelle suspension de l’examen de l’action en expropriation de facto engagée par les requérants, repoussant ainsi à nouveau le paiement de l’intégralité de l’indemnité.
124. Il résulte de ce qui précède que la possibilité d’introduire une action en expropriation de facto ne permet pas de prévenir les agissements abusifs pouvant survenir dans le cadre d’une procédure d’expropriation d’urgence, ni de remédier à ceux-ci de façon effective.
125. La Cour estime donc que, dans les circonstances de l’espèce, le droit interne n’a pas offert aux requérants de garanties suffisantes contre des atteintes arbitraires de la puissance publique, de sorte que la privation de propriété subie par les intéressés ne peut passer pour avoir satisfait à l’exigence de légalité prévue par l’article 1 du Protocole no 1 (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano, précité, § 143).
126. Par conséquent, il y a eu violation de cette disposition.
DAKHKILGOV c. RUSSIE du 8 décembre 2020 Requête no 34376/16
Art 1 P1 • Privation de propriété • Expropriation arbitraire et illégale d’une partie du terrain du requérant lors de l’installation sur celui-ci d’un stade sportif attenant à une école publique • Requérant propriétaire légitime et incontesté au moment de l’ingérence • Expropriation de facto de son bien sans contrôle juridictionnel préalable, dans le cadre d’une procédure légalement prévue, de l’utilité publique de la privation de sa propriété et en l’absence de toute indemnisation • Autorités nationales ayant tiré bénéfice de leurs comportement illégal
CEDH
a) Sur l’existence d’un « bien » et sur la nature de l’ingérence
42. Il n’est pas contesté que le terrain d’implantation du dépôt pétrolier, mesurant 10 614 m2, était un « bien » du requérant, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il n’est pas non plus contesté que l’occupation de ce terrain – par l’installation d’un stade sportif attenant à l’école sur une partie de celui-ci – a constitué une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens. La Cour note que le requérant est resté formellement propriétaire du terrain occupé. Or, ce terrain non arpenté n’existe plus que sur papier, et il est inclus dans deux autres parcelles appartenant aux autorités (paragraphe 28 ci-dessus), avec comme résultat l’impossibilité de faire tout usage de ce terrain pour l’intéressé. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’ingérence ayant engendré des conséquences graves à telle enseigne qu’elle va au-delà de la « réglementation de l’usage des biens », au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, engendrant dès lors une « privation des biens », au sens de la seconde phrase du premier alinéa dudit article (voir, mutatis mutandis, Papamichalopoulos et autres c. Grèce, 24 juin 1993, §§ 44-45, série A no 260-B).
43. La Cour doit rechercher à présent si l’ingérence se justifie sous l’angle de cette disposition. Pour être compatible avec celle-ci, la mesure doit remplir trois conditions : elle doit être effectuée « dans les conditions prévues par la loi », « pour cause d’utilité publique » et dans le respect d’un juste équilibre entre les droits du propriétaire et les intérêts de la communauté.
b) Sur le respect du principe de légalité
44. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est une notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, §§ 94-95, 25 octobre 2012). Il en découle que la nécessité d’examiner la question du juste équilibre « ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n’était pas arbitraire » (Guiso-Gallisay c. Italie, no 58858/00, § 80, 8 décembre 2005, avec les références qui y sont citées). L’expression « dans les conditions prévues par la loi » présuppose l’existence et le respect de normes de droit interne suffisamment accessibles et précises (Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 110, série A no 102) et offrant des garanties contre l’arbitraire (Vistinš et Perepjolkins, précité, § 95).
45. En l’espèce, la Cour relève que l’emprise d’une partie du terrain d’implantation de l’ancien dépôt pétrolier pour étendre le territoire de l’école et l’installation du stade sportif a été prévue par les actes adoptés par les autorités républicaines et locales en 2006 (paragraphes 5-7 ci-dessus). Or, près de trois ans après l’adoption de ces actes, les autorités républicaines, locales et fédérales ont adopté d’autres actes concernant ce terrain, allant dans le sens opposé. En effet, en 2009, l’administration du district a approuvé le plan du terrain en confirmant que celui-ci avait été octroyé à M. K - prédécesseur du requérant. Elle lui a également conféré un droit d’usage permanent sur ce terrain, puis le ministère républicain du Patrimoine a vendu le terrain à M. K. L’autorité en charge de l’enregistrement des droits réels a procédé à son tour à l’enregistrement du droit de propriété de M. K. puis du requérant sur le terrain, en confirmant par cela la licéité de ces transactions (paragraphe 32 ci-dessus et la référence y citée).
46. Les tentatives des différentes autorités tendant à annuler les ventes du terrain ont échoué. À cet égard, la Cour trouve sans pertinence l’argument du Gouvernement selon lequel l’intéressé savait au moment de l’acquisition du terrain que celui-ci était destiné à l’extension de l’école en vertu des actes adoptés en 2006 (paragraphe 39 ci-dessus). En effet, une telle connaissance de la part du requérant ou l’ignorance de celui-ci auraient dû faire l’objet d’une appréciation par les tribunaux dans le cadre de l’action en annulation de la vente. Or les demandes en justice introduites par les autorités tendant à l’annulation des ventes n’ont pas fait l’objet d’examen, et aucune appréciation de la bonne foi du requérant n’a eu lieu. De l’avis de la Cour, le Gouvernement ne peut pas valablement avancer de thèses non débattues devant les juridictions internes (voir, pour une situation similaire, OOO KD-Konsalting c. Russie, no 54184/11, § 47, 29 mai 2018).
47. Il résulte de ce qui précède que, au moment de l’ingérence, le requérant restait propriétaire légitime et incontesté du terrain.
48. Dans ce contexte, pour pouvoir occuper ce terrain, les autorités n’ont pas, comme elles en avaient la possibilité en droit russe, engagé une procédure d’expropriation comportant plusieurs étapes et garanties contre l’arbitraire, dont la notification écrite de la décision d’expropriation, la rédaction d’une convention de rachat, en cas de désaccord du propriétaire, un droit pour l’autorité publique compétente d’intenter une action en expropriation (paragraphe 30 ci-dessus ; voir, pour un résumé de la portée des dispositions pertinentes, Tkachenko c. Russie, no 28046/05, § 54, 20 mars 2018) et, surtout, le paiement d’une indemnité.
49. En revanche, en l’espèce, le requérant a été exproprié de facto de son bien sans contrôle juridictionnel préalable, dans le cadre d’une procédure légalement prévue, de l’utilité publique de la privation de sa propriété et sans avoir bénéficié d’une quelconque indemnité. Puis, lorsqu’il a demandé le démontage du stade occupant son terrain contre sa volonté, les juridictions se sont bornées à constater que les actes relatifs à l’extension du territoire de l’école avaient été adoptés antérieurement à l’acquisition du terrain par l’intéressé et que la construction du stade respectait les règles d’urbanisme et de sécurité.
50. Dans ces circonstances, la Cour conclut que l’ingérence, opérée en méconnaissance complète par les autorités de la procédure légalement prévue pour opérer une d’expropriation et en l’absence de toute indemnisation, a permis aux autorités de tirer bénéfice de leur comportement illégal (Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 94, 22 décembre 2009). Cette expropriation de fait a été arbitraire et donc « illégale » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Cette conclusion rend superflu l’examen des autres exigences de cette disposition (voir aussi Abiyev et Palko c. Russie, no 77681/14, §§ 66-67, 24 mars 2020).
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
ELIF KIZIL c. TURQUIE du 24 mars 2020 requête n° 4601/06
Art 1 P1 • Respect des biens • Inscription d’un terrain au nom du Trésor public sans information individuelle du propriétaire • Usage du bien par le propriétaire et prise de connaissance de la situation plus de vingt ans après • Applicabilité examinée au vu du comportement des autorités • Rejet du recours en annulation par application du délai de la prescription extinctive en dépit de l’absence de notification individuelle à l’intéressé • Poids disproportionné accordé à la sécurité juridique des transactions immobilières.
FAITS
8. À l’issue des travaux de cadastrage réalisés en 1974, le terrain de la requérante fut enregistré comme propriété du Trésor avec les références cadastrales « îlot 823 parcelle 6 ». Le procès-verbal indique que le terrain avait appartenu à un certain R.B., le père d’O.B., qu’il avait été vendu à une personne dont le nom n’avait pu être identifié malgré les recherches effectuées notamment sur les registres fonciers, et qu’il convenait d’enregistrer le bien au nom du Trésor afin d’éviter que l’acquéreur non encore identifié subisse un préjudice, et ce en vertu de l’article 22 H de la loi no 2613 relative au cadastre et à l’enregistrement des titres fonciers (voir paragraphes 39 et 40 ci-dessous).
9. L’ensemble des procès-verbaux relatifs à la zone de cadastrage fit l’objet d’un affichage public pendant deux mois.
10. Aucune notification ou démarche, autre que cet affichage, ne fut entreprise pour informer la requérante.
11. Cette dernière aurait pris connaissance de l’enregistrement de son bien comme propriété du Trésor le 16 juillet 2002 lorsque des fonctionnaires de cette administration lui auraient oralement exposé la situation lors d’une visite.
12. Le 17 juillet 2002, la requérante signa une demande de rachat à l’administration du terrain litigieux. Le document dactylographié présente, en guise de signature, le prénom et le nom de la requérante en lettres majuscules qui semblent avoir été tracées avec difficulté.
13. Le 24 juillet 2002, la requérante adressa à la direction générale du cadastre un courrier où elle reprochait à l’administration de s’être emparé de son bien à la faveur d’une opération de cadastrage malgré l’existence d’un titre de propriété immatriculé et de ne l’avoir informé à aucun moment ni de ladite opération ni de ses conséquences. Elle affirmait faire usage du terrain depuis son achat en 1973. La lettre présente une empreinte digitale apposée en lieu et place de signature.
14. Par la suite, la requérante saisit les services d’inspection de la direction générale du cadastre et des registres fonciers.
15. Le 25 juillet suivant, l’administration notifia à l’époux de l’intéressée une injonction de payer une indemnité d’occupation illégale d’un bien public pour les années 2001 et 2002, en l’occurrence le terrain en cause.
CEDH
a) Les principes généraux
86. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 1 du Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (voir, notamment, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 37, série A no 98) : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Les deuxième et troisième normes, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 134, CEDH 2004-V, et Bruncrona c. Finlande, no 41673/98, §§ 65-69, 16 novembre 2004).
87. Pour se concilier avec la règle générale énoncée à la première phrase du premier alinéa de l’article 1, une atteinte au droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l’individu (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).
88. L’article 1 du Protocole no 1 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre toute atteinte de l’Etat au respect de ses biens. Or, en vertu de l’article 1 de la Convention, chaque État contractant « reconna[ît] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention ». Cette obligation générale de garantir l’exercice effectif des droits définis par cet instrument peut impliquer des obligations positives. En ce qui concerne l’article 1 du Protocole no 1, de telles obligations positives peuvent entraîner pour l’État certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété (Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 96, CEDH 2002-VII, et Broniowski c. Pologne, précité, § 143).
89. Nonobstant le silence de cette disposition en matière d’exigences procédurales, les procédures applicables à une espèce doivent aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte au droit au respect des biens (Zehentner c. Autriche, no 20082/02, § 73, 16 juillet 2009, Société Anonyme Thaleia Karydi Axte c. Grèce, no 44769/07, § 36, 5 novembre 2009, et Gereksar et autres c. Turquie, nos 34764/05 et 3 autres, § 51, 1er février 2011).
b) Le cas d’espèce
90. La Cour observe que le grief de la requérante concerne la perte de son bien et l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de contester judiciairement cette mesure en raison du délai de la prescription extinctive de dix ans. Elle estime que les questions ainsi soulevées relèvent de la première norme mentionnée plus haut.
91. D’emblée, elle considère qu’elle n’est pas appelée à déterminer de manière générale et abstraite si le délai de prescription décennale prévue à l’article 12 de la loi relative au cadastre est compatible ou non avec la Convention, mais uniquement à dire si, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’application de ce délai a porté atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens.
92. Elle note en premier lieu que ce délai est explicitement prévu par l’article 12 de la loi no 3402 (voir paragraphe 43 ci-dessus). Quoiqu’en dise la requérante, c’est sur cette loi, qui était en vigueur à l’époque où l’intéressée a initié son action, que repose l’ingérence litigieuse. La décision des autorités judiciaires de rejeter le recours en raison de la prescription disposait donc d’une base légale. Sur ce point, la Cour estime utile de préciser que la question de savoir si ce n’est pas l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation qui, en supprimant toute possibilité pour la requérante d’agir en justice, a constitué une ingérence, peut en l’espèce demeurer indécise étant donné que le grief n’a pas été explicitement formulé en ces termes.
93. La
Cour observe que la mise en place d’un délai au-delà
duquel les droits antérieurs au cadastrage s’éteignent et
les conclusions cadastrales
– qui établissent de nouveaux titres de propriété –
deviennent inattaquables et privent d’effets les anciens
titres vise à garantir la sécurité des transactions
immobilières ; ce qui constitue indéniablement un but d’intérêt
général d’une importance considérable.
94. Il convient dès lors de vérifier si le but poursuivi était proportionné à l’atteinte portée au droit de propriété de la requérante. Cette vérification revient à mettre en balance les divers intérêts en jeu.
95. Si la sécurité juridique visée par la règle de prescription présente en soi un but légitime important, l’intérêt de mettre l’administration à l’abri d’un recours de la requérante demeure en l’espèce limité aux yeux de la Cour.
96. S’agissant des intérêts de la requérante, la Cour observe que cette dernière, qui avait régulièrement acquis le bien au registre foncier en 1973, c’est-à-dire moins d’un an avant les travaux de cadastrage, s’est finalement trouvée privée de son bien.
97. En outre, elle n’a pu faire valoir ses droits en contestant cette mesure devant les tribunaux, et ce en raison de la prescription extinctive. Sur ce point, il convient de relever que l’intéressée ne s’est vu notifier ni le début des travaux de cadastrage ni les conclusions cadastrales. Elle affirme n’avoir pris connaissance de l’inscription de son bien comme propriété du Trésor qu’en 2002, date jusqu’à laquelle elle aurait, selon elle et selon le TGI, continuer à jouir paisiblement de son bien (voir paragraphes 74 et 24 ci-dessus).
98. À cet égard, la Cour réitère que les procédures applicables doivent aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte à son droit de propriété (voir paragraphe 89 ci-dessus). Elle rappelle que dans l’affaire Société Anonyme Thaleia Karydi Axte, précitée, elle a conclu que la société requérante s’était vu imposer une charge disproportionnée au motif que même si les procédures mises en place en droit interne n’étaient pas critiquables en soi, l’intéressée avait été privée de son bien sans avoir aucune possibilité de réagir lors de la procédure d’exécution forcée visant son terrain. La Cour a souligné que même si la requérante avait de sérieux arguments à faire valoir devant les juridictions compétentes afin d’obtenir l’annulation de la vente aux enchères, son recours avait été déclaré irrecevable pour non-respect du délai alors que la procédure d’exécution forcée n’avait pas été portée à sa connaissance.
99. En l’espèce, il convient dès lors de déterminer si la requérante avait ou aurait dû avoir connaissance du cadastrage et des conclusions cadastrales ignorant son titre de propriété et ayant pour effet de le rendre caduc.
100. S’il est vrai que le début des travaux de cadastrage est annoncé, que lesdits travaux font l’objet d’une publicité (voir paragraphes 34 à 37 ci-dessus), et que ces mesures permettent d’informer largement le public, celles-ci ne garantissent pas que la requérante ait effectivement été informée. Il en va de même de l’affichage des conclusions cadastrales (voir paragraphe 38 ci-dessus).
101. Sur ce point, la Cour estime utile de rappeler que la requérante affirme, sans être contredite par le Gouvernement, qu’elle résidait en Allemagne. Elle affirme en outre qu’elle ne sait ni lire ni écrire ; ce que semble confirmer la manière dont elle a signé les documents présents dans le dossier (voir paragraphes 12 et 13 ci-dessus).
102. Par ailleurs, s’agissant plus spécifiquement de l’affichage, la Cour rappelle que, dans l’affaire Rimer et autres c. Turquie (no 18257/04, § 27, 10 mars 2009) où les recours des requérants contre les conclusions cadastrales avaient été rejetés pour non-respect du délai de dix ans commençant à courir après l’affichage et où le Gouvernement soulevait une exception d’irrecevabilité tirée de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, elle a indiqué qu’il n’avait pas été démontré que les requérants avaient reçu une notification des conclusions en question.
103. Elle estime en outre que le Gouvernement n’a pu exposer aucun élément permettant raisonnablement d’affirmer que la requérante avait connaissance des travaux de cadastrage et de leur teneur ou qu’elle ne pouvait ignorer leur existence. De plus, la Cour réitère que les autorités ne semblent avoir entrepris aucune démarche pour identifier et informer la requérante alors même que l’inscription du bien au nom du Trésor en 1974 avait un but préventif.
104. Le Gouvernement relève certes qu’un tiers, en l’occurrence un voisin, a fait usage du bien et qu’il a tenté d’en faire l’acquisition auprès du Trésor (voir paragraphes 29 à 32 ci-dessus). Il en déduit que la requérante aurait abandonné le bien parce qu’elle aurait su qu’elle n’en était plus la propriétaire sur le registre.
105. La Cour relève en premier lieu que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si M.Ç. avait utilisé le terrain avec ou sans le consentement de la requérante (voir, notamment paragraphe 84 ci-dessus). En outre, elle constate que le TGI a établi que la requérante avait exercé sur le bien une possession paisible et ininterrompu depuis 1973 (voir paragraphe 24 ci-dessus) et que cet élément factuel n’a pas été remis en cause par la Cour de cassation. Elle n’aperçoit pas de motifs sérieux lui permettant de se départir des constations factuelles des juridictions internes sur ce point.
106. Par ailleurs, la Cour estime que la fiabilité des informations contenues dans les ordonnances de paiement dressées par l’administration est toute relative. En effet, ces ordonnances sont incohérentes quant à la période pendant laquelle M.Ç. aurait utilisé le bien, étant donné qu’elles semblent non seulement se contredire entre elles (voir paragraphe 31 ci-dessus) mais aussi contredire les déclarations faites par l’intéressé à l’administration en vue d’acquérir le bien et dans lesquelles il admet ne pas remplir les conditions prévues par la loi no 4070 (voir paragraphes 12 et 47 à 48 ci-dessus). De plus, il convient de relever que deux ordonnances ont été établies pour l’année 2001, l’une destinée à M.Ç. et l’autre à l’époux de la requérante (voir paragraphes 29 et 15 ci-dessus). La Cour estime par conséquent qu’il serait déraisonnable de se fonder sur ces documents administratifs pour s’écarter des conclusions factuelles des juridictions nationales.
107. En tout état de cause, la circonstance que le terrain ait été utilisé pendant un temps par l’un des voisins, avec ou sans le consentement de la requérante, et que l’intéressé ait cherché à s’approprier le bien, n’est pas de nature à démontrer que la requérante avait pris connaissance des conclusions cadastrales de 1974 et de ses conséquences.
108. Il en va de même en ce qui concerne la circonstance que la requérante ait signé, le lendemain de la date à laquelle elle affirme avoir été informée de la situation, une demande visant le rachat de son bien à l’administration. Celle-ci ne démontre en rien que la requérante aurait eu connaissance des faits litigieux bien avant qu’une ordonnance de paiement ne lui soit adressée.
109. Rien ne permet donc d’affirmer que la requérante avait ou aurait dû avoir connaissance de l’inscription de son bien comme propriété du Trésor avant d’en avoir été informé par les agents de l’administration en 2002 ni que les autorités, qui ont bénéficié de l’inscription au registre dans le seul but d’éviter que le bien de la requérante ne soit accaparé par des tiers, ont procédé à une démarche quelconque dans le but de déterminer l’identité du légitime propriétaire et l’informer de la situation.
110. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que le juste équilibre voulu par la Convention a été rompu au détriment de la requérante.
111. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
ABIYEV ET PALKO c. RUSSIE du 24 mars 2020 Requête no 77681/14
Art 1 P1 • Privation des biens • Démolition des biens immobiliers des requérants et la mainmise sur leur terrain pour les besoins de la reconstruction d’une ville • Expropriation de fait arbitraire en méconnaissance de la procédure obligatoire et en l’absence de toute indemnisation
FAITS
4. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain et d’un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments situés dans le centre de la ville d’Argun. Ils habitaient l’un de ces bâtiments.
5. En décembre 2010, les autorités tchétchènes créèrent une entité nommée « état-major chargé de la reconstruction (???? ?? ?????????????) de la ville d’Argun ».
6. Le 4 décembre 2010, l’état-major susmentionné tint une réunion, présidée par le premier vice-président du gouvernement tchétchène, qui rassemblait les fonctionnaires de la ville d’Argun, du gouvernement tchétchène et les représentants de différentes entreprises. Lors de cette réunion, il fut décidé qu’une entreprise d’État commencerait à démolir les immeubles se trouvant dans le périmètre de la construction d’un nouveau quartier résidentiel, « Argun City 1 », et construirait des logements pour les personnes dont les immeubles seraient démolis. La mairie de la ville d’Argun était chargée de trouver des terrains pour la construction de ces nouveaux logements.
7. En décembre 2010, les immeubles des requérants, qui se trouvaient dans le périmètre du quartier à reconstruire, furent démolis en quelques jours, puis leur terrain fut occupé.
8. Le 26 janvier 2011, le gouverneur de Tchétchénie adopta un décret officialisant la création de l’« état-major opérationnel (??????????? ????) républicain pour la reconstruction et le développement économique et social d’Argun » (« l’état-major »). Celui-ci était dirigé par le gouverneur de Tchétchénie et était constitué des autorités d’Argun et de la République tchétchène ainsi que des représentants de différentes entreprises.
9. Selon le décret précité, l’état-major devait assurer la planification, la coordination et le contrôle des mesures de reconstruction et de développement de la ville, tandis que les autorités publiques et les entreprises participant à ce projet devaient aider à la réalisation de celui-ci, conformément aux décisions prises par l’état-major.
10. À un moment non précisé dans le dossier, l’état-major fut dissous.
CEDH
a) Sur l’existence et la nature de l’ingérence
56. En l’espèce, il n’est pas contesté que trois bâtiments et un terrain étaient les « biens » des requérants au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il n’est pas non plus contesté que la démolition de ces bâtiments et l’occupation du terrain ont été effectuées par les autorités publiques, au sens large du terme, pour les besoins de la reconstruction de la ville d’Argun. La Cour considère qu’il s’agissait de « privation des biens » au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
57. Elle doit rechercher à présent si l’ingérence se justifie sous l’angle de cette disposition. Pour être compatible avec celle-ci, la mesure doit remplir trois conditions : elle doit être effectuée « dans les conditions prévues par la loi », « pour cause d’utilité publique » et dans le respect d’un juste équilibre entre les droits du propriétaire et les intérêts de la communauté.
b) Sur le respect du principe de légalité
58. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est une notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, §§ 94-95, 25 octobre 2012). Il en découle que la nécessité d’examiner la question du juste équilibre « ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n’était pas arbitraire » (Guiso-Gallisay c. Italie, no 58858/00, § 80, 8 décembre 2005, avec les références qui y sont citées). L’expression « dans les conditions prévues par la loi » présuppose l’existence et le respect de normes de droit interne suffisamment accessibles et précises (Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 110, série A no 102) et offrant des garanties contre l’arbitraire (Vistinš et Perepjolkins, précité, § 95).
59. La Cour a déjà eu l’occasion de dire qu’une ingérence effectuée en violation des dispositions internes ne satisfaisait pas au critère de la « légalité » (voir, par exemple, East West Alliance Limited c. Ukraine, no 19336/04, §§ 179-181 et 195, 23 janvier 2014, et Tkachenko, précité, § 56). Cependant, toute irrégularité procédurale n’est pas de nature à rendre l’ingérence incompatible avec l’exigence de « légalité » (Ukraine-Tioumen c. Ukraine, no 22603/02, § 52, 22 novembre 2007). La Cour rappelle à cet égard qu’elle dispose d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué ; elle ne peut dès lors mettre en cause l’appréciation des autorités internes quant à des erreurs de droit prétendues que lorsque celles-ci sont arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, parmi beaucoup d’autres, Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 116, 15 mars 2018).
60. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour relève que, n’ayant pas pu obtenir d’indemnisation pour la privation de leurs biens, les requérants ont intenté une action en réparation de leur préjudice contre la République tchétchène. Leur action a été rejetée essentiellement pour trois motifs : i) le ministère des Finances et la mairie d’Argun n’avaient pas procédé à la démolition des immeubles et à l’occupation du terrain et n’étaient pas les bons défendeurs ; ii) les requérants n’avaient pas formulé de prétentions relativement à violation de la procédure d’expropriation ; iii) ils n’avaient pas allégué ni, surtout, démontré une « illicéité » des actes ou omissions des autorités ou fonctionnaires au sens de l’article 1069 du code civil.
61. Quant au premier motif, la Cour note que les requérants n’ont jamais allégué que l’ingérence en cause avait été opérée par le ministère des Finances. Au contraire, ils estimaient que le défendeur à l’instance était la République tchétchène, représentée par le ministère des Finances conformément aux dispositions internes. Pourtant, les juridictions civiles ont adopté une approche formaliste, légitimant la conclusion que personne n’était responsable de la privation des biens des requérants.
62. Quant aux deuxième et troisième motifs, la Cour a déjà établi que les requérants ont bien formulé les prétentions et moyens concernant un irrespect par les autorités de la procédure d’expropriation (paragraphe 48 ci-dessus), et cela contrairement aux considérations des juges de cassation à cet égard (paragraphes 22-24 ci-dessus ; comparer aussi avec Adikanko et Basov-Grinev c. Russie, nos 2872/09 et 20454/12, § 50, 13 mars 2018, dans le contexte de l’article 6 § 1 de la Convention).
63. La procédure d’expropriation comportait plusieurs étapes et garanties contre l’arbitraire, dont la notification écrite de la décision d’expropriation, la rédaction d’une convention de rachat, en cas de désaccord du propriétaire, un droit pour l’autorité publique compétente d’intenter une action en expropriation (paragraphe 31 ci-dessus ; voir, pour un résumé de la portée des dispositions pertinentes, Tkachenko, précité, § 54) et, surtout, le paiement d’une indemnité. Or, en l’espèce, cette procédure obligatoire a été méconnue, sans qu’une explication ne soit fournie et sans que les requérants ne bénéficient d’une indemnité (comparer avec Tkachenko, précité, où la procédure d’expropriation n’a pas été suivie mais les requérants ont été relogés, et voir, a contrario, Sigunovy c. Russie (déc.) [comité], no 18836/11, 12 février 2019, où les requérantes ont obtenu un logement équivalent).
64. De l’avis de la Cour, c’est bien l’irrespect de cette procédure obligatoire et l’absence de toute indemnisation qui constituait l’aspect d’« illicéité » de l’ingérence au sens des articles 16 et 1069 du code civil. Constatant que les requérants ont soulevé cet aspect devant les juridictions internes et considérant que l’action en réparation était une voie appropriée susceptible d’aboutir à l’allocation d’une indemnisation, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité implicite du Gouvernement (paragraphe 48 ci-dessus).
65. La Cour note enfin que les autorités ont tout de même présenté aux requérants quelques offres de relogement, mais que ces offres ont été faites en dehors de tout cadre légal et apparaissent plutôt comme des offres ex gratia, et que l’on ne peut pas dire que leur rejet par les requérants puisse s’analyser en une renonciation à leur droit à une indemnisation (comparer avec Volchkova et Mironov c. Russie, nos 45668/05 et 2292/06, § 125, 28 mars 2017). Elle estime également que l’allégation du Gouvernement selon laquelle le requérant est devenu locataire d’une parcelle en 2014 n’a aucune pertinence pour la présente affaire.
66. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’ingérence, opérée en méconnaissance complète par les autorités de la procédure obligatoire d’expropriation et en l’absence de toute indemnisation, a permis aux autorités de tirer bénéfice de leur comportement illégal (Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 94, 22 décembre 2009).
67. Cette expropriation de fait a été arbitraire et donc « illégale » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Cette conclusion rend superflu l’examen des autres exigences de cette disposition.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Mocanu et autres c. République de Moldova du 26 juin 2018 requête n° 8141/07
Article 1 du Protocole 1 : Expropriation de fait non protégé par les juridictions.
25. Les requérants soutiennent que la procédure légale d’expropriation n’a pas été respectée en l’espèce. Ils affirment notamment ne pas avoir reçu un juste et préalable dédommagement, ce qui serait contraire à la Constitution et aux lois applicables en la matière.
26. Le Gouvernement avance que les requérants ont été privés de leurs biens dans les conditions prévues par la loi et pour une cause d’utilité publique. Il soutient notamment que la base légale de l’expropriation litigieuse reposait sur l’article 46 § 2 de la Constitution ainsi que sur les dispositions de la loi sur l’expropriation. De plus, il affirme qu’en l’espèce l’État a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu et argue que les requérants, en refusant à plusieurs reprises les offres de dédommagement, ont rendu difficiles les négociations avec l’expropriant.
27. La Cour renvoie à sa jurisprudence constante relative à la structure de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, aux trois normes distinctes que cette disposition contient et aux conditions qu’une mesure d’expropriation doit remplir (voir, parmi beaucoup d’autres, Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, §§ 93-94, 25 octobre 2012).
28. Dans la présente affaire, elle note que les parties s’accordent à dire qu’il y a eu privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
29. Elle rappelle que cet article exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale (voir, parmi beaucoup d’autres, Vergu c. Roumanie, no 8209/06, § 45, 11 janvier 2011, et Vistinš et Perepjolkins, précité, §§ 95-97). Elle redit en outre que la pratique de l’expropriation de fait permet à l’administration d’occuper un bien immobilier et d’en transformer irréversiblement la destination, de telle sorte qu’il soit finalement considéré comme acquis au patrimoine public sans qu’il y ait eu le moindre acte formel et déclaratoire du transfert de propriété (mutatis mutandis Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, § 93, 17 mai 2005, et Sarica et Dilaver c. Turquie, no 11765/05, § 43, 27 mai 2010). Elle a déjà jugé que ce procédé permettant à l’administration de passer outre les règles de l’expropriation formelle expose les justiciables au risque d’un résultat imprévisible et arbitraire, qu’il n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique et qu’il ne saurait constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme (voir, par exemple, Guiso-Gallisay c. Italie, no 58858/00, §§ 87-89, 8 décembre 2005, et Halil Göçmen c. Turquie, no 24883/07, § 32, 12 novembre 2013).
30. En l’espèce, la Cour observe que les requérants ont perdu la maîtrise de leurs terrains à partir du moment où l’État a occupé puis transformé de manière définitive ces terrains. Elle ne saurait accueillir l’argument du Gouvernement selon lequel l’occupation litigieuse a été effectuée dans les conditions prévues par la loi. Force est pour elle de constater que, dans la présente affaire, les différentes étapes d’une expropriation formelle, établies par la loi sur l’expropriation (paragraphe 20 ci-dessus), n’ont pas été respectées. En particulier, elle relève l’absence en l’espèce d’une déclaration d’utilité publique, destinée à mettre en mouvement la procédure d’expropriation en bonne et due forme. Elle prête une attention particulière au fait que les autorités moldaves ont elles-mêmes reconnu qu’une expropriation régie par la loi sur l’expropriation n’avait pas été mise en œuvre en l’espèce (paragraphe 10 ci-dessus) (comparer avec Sharxhi et autres c. Albanie, no 10613/16, §§ 169-174, 11 janvier 2018).
31. En parallèle, la Cour observe que, selon les dispositions du droit interne (paragraphes 18-20 ci-dessus), il ne peut y avoir d’expropriation sans un juste et préalable dédommagement et que, en cas de désaccord entre l’exproprié et l’expropriant quant aux modalités d’expropriation – ce qui était le cas en l’espèce –, le transfert du droit de propriété ne peut s’effectuer qu’en vertu d’une décision de justice passée en force de chose jugée. Or, elle constate que, dans la présente affaire, l’État s’est approprié les terrains des requérants sans leur verser au préalable des indemnités à ce titre et sans éventuellement recourir à un juge.
32. La Cour note également que les juridictions moldaves ont entériné la pratique de l’expropriation de fait en jugeant que les requérants avaient été privés de leurs biens pour une cause d’utilité publique.
33. Elle relève enfin que, pour ce qui est des deux premiers requérants, l’acte formel de transfert de propriété n’a été conclu qu’au bout de trois ans d’occupation par l’État des terrains litigieux (paragraphe 17 ci-dessus). Quant au troisième requérant, elle constate que le transfert de propriété n’a pas encore été acté et que, à ce jour, il n’a reçu aucune indemnisation ou terrain en échange. Dès lors, elle estime que la situation des requérants ne saurait être considérée comme « prévisible » et comme répondant à l’exigence de « sécurité juridique » (comparer avec Burghelea c. Roumanie, no 26985/03, § 39, 27 janvier 2009, Rolim Comercial, S.A. c. Portugal, no 16153/09, § 67, 16 avril 2013). De plus, elle considère que la situation en cause a permis à l’administration de tirer parti d’une occupation illégale des terrains au détriment des requérants.
34. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit des requérants au respect de leurs biens. Une telle conclusion la dispense de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels
35. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
MESSANA c. ITALIE du 9 février 2017 requête 26128/04
Violation de l'article 1 du Protocole 1, l'État Italien construit sur le terrain des requérants sans les exproprier, ils ont eu une indemnité ridicule devant les juridictions italiennes. Le gouvernement propose une transaction devant
ÉCHEC DE LA NÉGOCIATION PAR LES REQUÉRANTS
21. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 16 décembre 2015, le Gouvernement a informé la Cour qu’il a formulé une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention en contrepartie du versement d’une somme globale (236 777 EUR), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et de la reconnaissance de la violation du droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention.
22. Le 15 janvier 2016, les requérants ont déclaré qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale compte tenu du montant offert.
23. La Cour a affirmé que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire au sens de l’article 37 § 1 in fine (voir, parmi d’autres, Tahsin Acar c. Turquie (exceptions préliminaires) [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2003-VI; Melnic c. Moldova, no 6923/03, § 14, 14 novembre 2006).
24. Parmi les facteurs à prendre en compte à cet égard figure, entre autres, si dans sa déclaration unilatérale le Gouvernement défendeur formule l’une ou l’autre concession en ce qui concerne les allégations de violations de la Convention et, dans cette hypothèse, quelles sont l’ampleur de ces concessions et les modalités du redressement qu’il entend fournir au requérant. Quant à ce dernier point, dans les cas où il est possible d’effacer les conséquences d’une violation alléguée (par exemple dans certaines affaires de propriété) et où le Gouvernement défendeur se déclare disposé à le faire, le redressement envisagé a davantage de chances d’être tenu pour adéquat aux fins d’une radiation de la requête (voir Tahsin Acar, précité, § 76).
25. Quant au point de savoir s’il serait opportun de rayer la présente requête sur la base de la déclaration unilatérale du Gouvernement, la Cour relève que le montant du dédommagement offert est insuffisant par rapport aux sommes octroyées par elle dans des affaires similaires en matière d’expropriation indirecte (voir Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009 ; Rivera et di Bonaventura c. Italie, no 63869/00, 14 juin 2011 ; De Caterina et autres c. Italie, no 65278/01, 28 juin 2011 ; Macrì et autres c. Italie, no 14130/02, 12 juillet 2011).
26. Dans ces conditions, la Cour considère que la déclaration unilatérale litigieuse ne constitue pas une base suffisante pour conclure que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête.
27. En conclusion, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de l’affaire sur la recevabilité et le fond.
ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1
a) Sur l’existence d’une ingérence
35. La Cour renvoie à sa jurisprudence constante relative à la structure de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et aux trois normes distinctes que cette disposition contient (voir, parmi beaucoup d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 61, série A no 52, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999 II, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 44, CEDH 1999 V, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 134, CEDH 2004 V, et Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 93, 25 octobre 2012).
36. La Cour constate que les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu une « privation » de propriété au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
37. La Cour doit donc rechercher si la privation dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.
b) Sur le respect du principe de légalité
38. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » ; le second alinéa reconnaît aux États le droit de réglementer l’usage des biens en mettant en vigueur des « lois ». De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Iatridis c. Grèce [GC], précité, § 58).
39. La Cour renvoie ensuite à sa jurisprudence en matière d’expropriation indirecte (voir, parmi d’autres, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-VI ; Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, 17 mai 2005, et Velocci c. Italie, no 1717/03, 18 mars 2008) pour une récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence dans la matière, notamment en ce qui concerne la question du respect du principe de légalité dans cette typologie d’affaires.
40. Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions internes ont considéré les requérants privés de leur bien à compter de la date de la cessation de la période d’occupation légitime. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n’est que par la décision judiciaire définitive que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition du terrain par les pouvoirs publics a été consacrée. Par conséquent, les requérants n’ont eu la sécurité juridique concernant la privation du terrain qu’au plus tôt le 12 janvier 2004, date à laquelle le jugement de la cour d’appel de Palerme est devenu définitif.
41. La Cour observe ensuite que la situation en cause a permis à l’administration de tirer parti d’une occupation de terrain illégale. En d’autres termes, l’administration a pu s’approprier le terrain au mépris des règles régissant l’expropriation en bonne et due forme.
42. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérants.
43. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
ARTICLE 41
53. La Cour rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], précité, la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte en établissant que l’indemnisation à octroyer doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois déduite la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation et assorti d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains. Enfin, il y a lieu de d’évaluer la perte de chances éventuellement subie par les intéressés.
54. En l’espèce, d’après les juridictions nationales, les requérants ont perdu la propriété de leur terrain le 18 juin 1986. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Palerme que la valeur du terrain à cette date était de 45,45 EUR le mètre carré, soit 167 710,50 EUR au total (paragraphe 13 ci-dessus). Compte tenu de ces éléments, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants, conjointement, 323 800 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
55. Quant à la perte de chance subie à la suite de l’expropriation, la Cour juge qu’il y a lieu de prendre en considération le préjudice découlant de l’indisponibilité du terrain pendant la période allant du début de l’occupation légitime (16 juillet 1980) jusqu’au moment de la perte de propriété (18 juin 1986). Du montant ainsi calculé sera déduit la somme déjà obtenue par les requérantes au niveau interne à titre d’indemnité d’occupation. La Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants, conjointement, 2 500 EUR.
Papamichalopoulos et autres C. Grèce du 24 juin 1993, requête 14556/89
41. L’occupation des terrains litigieux par le Fonds de la marine nationale a représenté une ingérence manifeste dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens. Elle ne relevait pas de la réglementation de l’usage de biens, au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). D’autre part, les intéressés n’ont pas subi d’expropriation formelle: la loi no 109/1967 n’a pas transféré la propriété desdits terrains au Fonds de la marine nationale.
42. La Convention visant à protéger des droits "concrets et effectifs", il importe de déterminer si la situation incriminée n’équivalait pas néanmoins à une expropriation de fait, comme le prétendent les requérants (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 24, par. 63).
45. La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’échec des tentatives menées jusqu’ici pour remédier à la situation incriminée, a engendré des conséquences assez graves pour que les intéressés aient subi une expropriation de fait incompatible avec leur droit au respect de leurs biens.)
Satka et autres contre Grèce du 27 mars 2003 Hudoc 4229 requête 55828/00
"§48: Ainsi les requérants, puisque propriétaires de leurs terrains, se trouvent depuis 1991 année de la restitution de ceux-ci par l'armée, dans l'impossibilité d'exploiter leurs biens, car il est de notoriété publique que ceux-ci passeront dans l'avenir sous le contrôle de l'Etat.
§49: Il en est résulté que les requérants ont eu à supporter et supportent encore une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
§50 : Il y a donc violation de l'article 1 du Protocole n°1"
CHIRO CONTRE ITALIE DU 11 OCTOBRE 2005 Requête N° 63630/00
L'expropriation indirecte soit utiliser et transformer un bien immobilier au seul profit de l'administration est interdit
70. L’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Iatridis précité, § 58). Le principe de légalité signifie l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, pp. 19-20, § 42, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 47, § 110).
71. Dans l’arrêt Belvedere Alberghiera srl et dans l’arrêt Carbonara et Ventura précités, la Cour n’avait pas estimé utile de juger in abstracto si le rôle qu’un principe jurisprudentiel, tel que celui de l’expropriation indirecte, occupe dans un système de droit continental est assimilable à celui occupé par des dispositions législatives, ce qui compte étant – en tout état de cause – que la base légale réponde aux critères de prévisibilité, accessibilité et précision énoncés plus haut. La Cour est toujours convaincue que l’existence en tant que telle d’une base légale ne suffit pas à satisfaire au principe de légalité et estime utile de se pencher sur la question de la qualité de la loi.
72. La Cour prend note de l’évolution jurisprudentielle qui a conduit à l’élaboration du principe de l’expropriation indirecte. Elle relève également que ce principe a été transposé dans des textes de loi, tels que la loi no 458 de 1988, la loi no 662 de 1996 et, tout dernièrement, dans le Répertoire des dispositions en matière d’expropriation. Ceci étant, la Cour ne perd pas de vue les applications contradictoires qui ont lieu dans l’historique de la jurisprudence. Ce point de vue a d’ailleurs été adopté par le Conseil d’Etat (paragraphe 43 ci-dessus) qui, dans son arrêt no 2 de 2005 rendu en séance plénière, a reconnu que l’expropriation indirecte n’a jamais donné lieu à une réglementation stable, complète et prévisible.
73. La Cour relève également des contradictions entre la jurisprudence et les textes de loi écrits susmentionnés. A titre d’exemple, la Cour note que s’il est vrai que la jurisprudence a exclu, à compter de 1996-1997, que l’expropriation indirecte puisse s’appliquer lorsque la déclaration d’utilité publique a été annulée, il est également vrai que le Répertoire a tout dernièrement prévu qu’en l’absence de déclaration d’utilité publique, tout terrain peut être acquis au patrimoine public, si le juge décide de ne pas ordonner la restitution du terrain occupé et transformé par l’administration.
74. A vu de ces éléments, la Cour n’exclut pas que le risque d’un résultat imprévisible ou arbitraire pour les intéressés subsiste.
75. La Cour note ensuite que le mécanisme de l’expropriation indirecte permet en général à l’administration de passer outre les règles fixées en matière d’expropriation, avec le risque d’un résultat imprévisible ou arbitraire pour les intéressés, qu’il s’agisse d’une illégalité depuis le début ou d’une illégalité survenue par la suite. En effet, dans tous les cas, l’expropriation indirecte tend à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l’administration, à régler les conséquences pour le particulier et pour l’administration, au bénéfice de celle-ci. Que ce soit en vertu d’un principe jurisprudentiel ou d’un texte de loi comme l’article 43 du Répertoire, l’expropriation indirecte ne saurait donc constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme (voir, sur ce point également, l’opinion du Conseil d’Etat, au paragraphe 43 ci-dessus).
76. A cet égard, la Cour note que l’expropriation indirecte permet à l’administration d’occuper un terrain et de le transformer irréversiblement, de telle sorte qu’il soit considéré comme acquis au patrimoine public, sans qu’en parallèle un acte formel déclarant le transfert de propriété ne soit adopté. En l’absence d’un acte formalisant l’expropriation et intervenant au plus tard au moment où le propriétaire a perdu toute disponibilité du bien, l’élément qui permettra de transférer au patrimoine public le bien occupé et d’atteindre une sécurité juridique est le constat d’illégalité de la part du juge, valant déclaration de transfert de propriété. Il incombe à l’intéressé -qui continue d’être formellement propriétaire - de solliciter du juge compétent une décision constatant, le cas échéant, l’illégalité assortie de la réalisation d’un ouvrage d’intérêt public, conditions nécessaires pour qu’il soit déclaré rétroactivement privé de son bien.
77. Au vu de ces éléments, la Cour estime que le mécanisme de l’expropriation indirecte n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique.
78. La Cour note ensuite que l’expropriation indirecte permet en outre à l’administration d’occuper un terrain et de le transformer sans pour autant verser d’indemnité en même temps. L’indemnité doit être réclamée par l’intéressé et cela dans un délai de prescription de cinq ans, commençant à compter de la date à laquelle le juge estime que la transformation irréversible du terrain a eu lieu. Ceci peut entraîner des conséquences néfastes pour l’intéressé, et rendre vain tout espoir de réparation (Carbonara et Ventura, précité, § 71).
79. La Cour relève enfin que le mécanisme de l’expropriation indirecte permet à l’administration de tirer parti de son comportement illégal, et que le prix à payer n’est que de 10% plus élevé que dans le cas d’une expropriation en bonne et due forme. Selon la Cour, cette situation n’est pas de nature à favoriser la bonne administration des procédures d’expropriation et à prévenir des épisodes d’illégalité.
80. En tout état de cause, la Cour est appelée à vérifier si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué produit des effets conformes aux principes de la Convention.
81. Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions italiennes ont considéré les requérants privés de leur bien à compter du moment où les travaux de construction de la route ont irréversiblement transformé les lieux, les conditions d’illégalité de l’occupation et d’intérêt public de l’ouvrage construit étant réunies. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n’est que par la décision définitive – le jugement du tribunal de Lucera ayant acquis force de chose jugée – que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition du terrain au patrimoine public a été sanctionnée. Par conséquent, les requérants n’ont eu la « sécurité juridique » concernant la privation du terrain qu’à partir de janvier 2003, date à laquelle le jugement du tribunal de Lucera est devenu définitif.
82. La Cour observe ensuite que la situation en cause a permis à l’administration de tirer parti d’une occupation de terrain illégale. En d’autres termes, l’administration a pu s’approprier le terrain au mépris des règles régissant l’expropriation en bonne et due forme, et, entre autres, sans qu’une indemnité soit mise en parallèle à la disposition des intéressés.
83. S’agissant de l’indemnité, la Cour constate que l’application rétroactive de la loi budgétaire no 662 de 1996 au cas d’espèce a eu pour effet de priver les requérants d’une réparation intégrale du préjudice subi.
84. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérants.
85. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
OZBEK CONTRE TURQUIE DU 27 MAI 2010 REQUETE N° 25327/04
34. S’agissant en l’espèce de l’argument du Gouvernement relatif à l’application du droit national, en particulier la manière dont les juridictions nationales doivent appliquer les articles 993 à 995 du code civil, la Cour réaffirme qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Yagtzilar et autres c. Grèce, n 41727/98, § 25, CEDH 2001-XII). Dans la présente affaire, le rôle de la Cour se limite donc à vérifier la compatibilité avec la Convention et ses Protocoles de la demande du requérant visant à l’obtention d’une indemnité à raison de l’occupation de son terrain par l’État.
35. La Cour observe qu’il n’est pas contesté par les parties que le terrain appartenant au requérant a été occupé par l’armée, classé zone militaire et entouré de fils de fer barbelés, du moins pour la période du 6 mars 1997 au 7 août 2001, date à laquelle les barbelés ont été enlevés, même si, pour le requérant, la date de fin d’occupation de son terrain est plus tardive et correspond à celle à laquelle il a été informé par l’armée du retrait des barbelés (paragraphe 18 ci-dessus). Se plaignant de l’occupation illicite de son terrain, le requérant a introduit une action en dommages et intérêts devant la juridiction interne compétente. La Cour estime que le requérant a souffert de la mainmise de l’armée sur son terrain et note qu’il n’a obtenu aucune compensation de la part de l’État pour ce préjudice.
36. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’occupation illicite par l’armée, même limitée dans le temps, du terrain appartenant au requérant a porté atteinte au droit de l’intéressé au respect de ses biens.
Ensuite, s’agissant de l’argument du Gouvernement selon lequel la situation du requérant, installé à l’étranger, l’empêchait de mener une activité de culture sur son terrain classé terrain agricole, la Cour estime que le fait de résider à l’étranger n’est pas en soi un obstacle à l’exploitation agricole par son propriétaire d’un terrain situé en Turquie. Elle n’est dès lors pas convaincue par la pertinence de cet argument.
37. En conséquence, elle conclut que l’absence de toute indemnisation en contrepartie de l’occupation illicite du terrain du requérant par l’armée a rompu, en la défaveur de celui-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général.
GIACOBBE ET AUTRES c. ITALIE Requête no 16041/02 du 15 décembre 2005
La construction sur un terrain sans l'exproprier n'est pas compatible avec la convention
89. L’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Iatridis précité, § 58). Le principe de légalité signifie l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296 - A, pp. 19-20, § 42, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 47, § 110).
90. Dans les arrêts Belvedere Alberghiera srl et Carbonara et Ventura précités, la Cour n’avait pas estimé utile de juger in abstracto si le rôle qu’un principe jurisprudentiel, tel que celui de l’expropriation indirecte, occupe dans un système de droit continental est assimilable à celui occupé par des dispositions législatives, ce qui compte étant – en tout état de cause–que la base légale réponde aux critères de prévisibilité, accessibilité et précision énoncés plus haut. La Cour est toujours convaincue que l’existence en tant que telle d’une base légale ne suffit pas à satisfaire au principe de légalité et estime utile de se pencher sur la question de la qualité de la loi.
91. La Cour prend note de l’évolution jurisprudentielle qui a conduit à l’élaboration du principe de l’expropriation indirecte. Elle relève également que ce principe a été transposé dans des textes de loi, tels que la loi no 458 de 1988, la loi no 662 de 1996 et, tout dernièrement, dans le Répertoire des dispositions en matière d’expropriation. Ceci étant, la Cour ne perd pas de vue les applications contradictoires qui ont lieu dans l’historique de la jurisprudence. Ce point de vue a d’ailleurs été adopté par le Conseil d’Etat (paragraphe 53 ci-dessus) qui, dans son arrêt no 2 de 2005 rendu en séance plénière, a reconnu que le principe jurisprudentiel de l’expropriation indirecte n’a jamais donné lieu à une réglementation stable, complète et prévisible.
92. La Cour relève également des contradictions entre la jurisprudence et les textes de loi susmentionnés. A titre d’exemple, elle note que s’il est vrai que la jurisprudence a exclu, à compter de 1996-1997, que l’expropriation indirecte puisse s’appliquer lorsque la déclaration d’utilité publique a été annulée, il est également vrai que le Répertoire a tout dernièrement prévu qu’en l’absence de déclaration d’utilité publique, tout terrain peut être acquis au patrimoine public, si le juge décide de ne pas ordonner la restitution du terrain occupé et transformé par l’administration.
93. A vu de ces éléments, la Cour n’exclut pas que le risque d’un résultat imprévisible ou arbitraire pour les intéressés subsiste.
94. La Cour note ensuite que le mécanisme de l’expropriation indirecte permet en général à l’administration de passer outre les règles fixées en matière d’expropriation, avec le risque d’un résultat imprévisible ou arbitraire pour les intéressés, qu’il s’agisse d’une illégalité depuis le début ou d’une illégalité survenue par la suite. En effet, dans tous les cas, l’expropriation indirecte vise à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l’administration, à régler les conséquences pour le particulier et pour l’administration, au bénéfice de celle-ci. Que ce soit en vertu d’un principe jurisprudentiel ou d’un texte de loi comme l’article 43 du Répertoire, l’expropriation indirecte ne saurait donc constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme (voir, sur ce point également, la position du Conseil d’Etat, au paragraphe 53 ci-dessus).
95. A cet égard, la Cour note que l’expropriation indirecte permet à l’administration d’occuper un terrain et de le transformer irréversiblement, de telle sorte qu’il soit considéré comme acquis au patrimoine public, sans qu’en parallèle un acte formel déclarant le transfert de propriété ne soit adopté. En l’absence d’un acte formalisant l’expropriation et intervenant au plus tard au moment où le propriétaire a perdu toute maîtrise du bien, l’élément qui permettra de transférer au patrimoine public le bien occupé et d’atteindre une sécurité juridique est le constat d’illégalité de la part du juge, valant déclaration de transfert de propriété. Il incombe à l’intéressé -qui continue d’être formellement propriétaire - de solliciter du juge compétent une décision constatant, le cas échéant, l’illégalité assortie de la réalisation d’un ouvrage d’intérêt public, conditions nécessaires pour qu’il soit déclaré rétroactivement privé de son bien.
96. Au vu de ces éléments, la Cour estime que le mécanisme de l’expropriation indirecte n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique.
97. La Cour note ensuite que l’expropriation indirecte permet en outre à l’administration d’occuper un terrain et de le transformer sans pour autant verser d’indemnité en même temps. L’indemnité doit être réclamée par l’intéressé et cela dans un délai de prescription de cinq ans, commençant à compter de la date à laquelle le juge estime que la transformation irréversible du terrain a eu lieu. Ceci peut entraîner des conséquences néfastes pour l’intéressé, et rendre vain tout espoir de réparation (Carbonara et Ventura, précité, § 71).
98. La Cour relève enfin que le mécanisme de l’expropriation indirecte permet à l’administration de tirer parti de son comportement illégal, et que le prix à payer n’est que de 10% plus élevé que dans le cas d’une expropriation en bonne et due forme. Selon la Cour, cette situation n’est pas de nature à favoriser la bonne administration des procédures d’expropriation et à prévenir des épisodes d’illégalité.
99. En tout état de cause, la Cour est appelée à vérifier si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué produit des effets conformes aux principes de la Convention.
100. Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions italiennes ont considéré les requérants privés de leur bien à compter du moment où l’occupation avait cessé d’être autorisée, les conditions d’illégalité de l’occupation et d’intérêt public de l’ouvrage construit étant réunies. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n’est que par la décision définitive – l’arrêt de la cour d’appel ayant acquis force de chose jugée – que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition du terrain au patrimoine public a été consacrée. Par conséquent, les requérants n’ont eu la « sécurité juridique » concernant la privation du terrain que le 20 octobre 2001, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Catane est devenu définitif.
101. La Cour observe ensuite que la situation en cause a permis à l’administration de tirer parti d’une occupation de terrain illégale. En d’autres termes, l’administration a pu s’approprier le terrain au mépris des règles régissant l’expropriation en bonne et due forme, et, entre autres, sans qu’une indemnité soit mise en parallèle à la disposition des intéressés.
102. S’agissant de l’indemnité, la Cour constate que l’application rétroactive du délai de prescription de cinq ans au cas d’espèce a eu pour effet de priver les requérants de toute réparation du préjudice subi.
103. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérants.
104. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
POTOMSKA ET POTOMSKI C. POLOGNE 29 MARS 2011 requête 33949/05
L'interdiction de construire pour préserver un ancien cimetière sans exproprier ou sans proposer un terrain de remplacement est une charge excessive pour une famille.
Les faits
Les requérants, Zygmunt Potomski et son épouse Zofia Potomska, sont deux ressortissants polonais nés en 1937 et 1939 respectivement et résidant à Darlowo (Pologne).
En novembre 1974, à Rusko, le couple acheta à l’Etat un terrain classé dans la catégorie des terres agricoles. Ils souhaitaient y construire une maison et un atelier.
En mai 1987, l’inspecteur régional des monuments historiques de Koszalin décida d’inscrire le terrain sur le registre des monuments historiques, au motif qu’il avait accueilli un cimetière juif à partir du début du 19e siècle et était l’un des rares vestiges de la culture juive dans la région. En conséquence, et conformément à la loi de 1962 sur la protection du patrimoine culturel, le couple était soumis à l’obligation de préserver le terrain et à l’interdiction d’y faire de quelconques travaux ou d’en aménager fût-ce une partie, sauf obtention préalable d’un permis à cet effet.
En 1992, 2001 et 2003, l’inspecteur régional forma des demandes d’expropriation du terrain. Les deux premières démarches échouèrent. Après la dernière demande, le maire de la localité déclara qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour indemniser le couple et que dès lors il ne pouvait pas engager de procédure d’expropriation. Pareille procédure ne pouvait être entamée que si l’inspecteur lui-même parvenait à obtenir les ressources permettant de couvrir l’indemnité d’expropriation.
Entre-temps, en 1995, les requérants avaient demandé qu’on leur attribuât un autre terrain, mais en vain. En 2002, ils firent à nouveau savoir qu’ils étaient prêts à accepter un règlement du litige passant par un échange de terrains. En 2003, les autorités leur firent deux offres distinctes, mais le couple refusa les terrains proposés – constitués de champs et de marécages – au motif qu’ils ne correspondaient pas à la valeur du terrain possédé.
Plus récemment, en octobre 2005, le couple apprit que, les autorités ayant refusé d’accorder les fonds nécessaires au rachat de leur terrain, il n’était pas possible à ce stade de résoudre le litige.
Article 1 du Protocole no1
Le gouvernement polonais admet qu’il y a eu ingérence dans les droits de propriété des requérants, et les parties s’accordent à dire que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément la loi de 1962 sur la protection du patrimoine culturel, et poursuivait le but légitime consistant à protéger le patrimoine culturel polonais.
La Cour estime que la mesure la mieux adaptée pour faire contrepoids à cette ingérence aurait consisté à exproprier et indemniser les requérants ou à leur proposer un terrain convenable en lieu et place du leur.
Or, toutes les démarches entreprises pour obtenir l’expropriation ont échoué, l’absence de fonds ayant figuré parmi les motifs invoqués. La Cour rappelle que l’absence de fonds ne saurait justifier le manquement des autorités à remédier à la situation. De plus, le couple requérant n’avait aucun moyen d’obliger les autorités à racheter leur terrain, le droit interne ne prévoyant aucune procédure qui leur eût permis de porter leur cause devant un organe judiciaire. La seule possibilité qui s’offrait à eux consistait à demander le déclenchement d’une procédure d’expropriation et à compter sur le pouvoir discrétionnaire des autorités.
Par ailleurs, il n’existait aucun mécanisme procédural permettant de régler un litige portant – comme dans la cause des requérants – sur les qualités du terrain proposé en échange. L’on ne saurait reprocher aux requérants d’avoir refusé les deux offres qui leur ont été faites, car celles-ci ne garantissaient pas une protection suffisante de leurs intérêts. Du reste, le droit interne ne les obligeait pas à accepter un autre terrain, même à supposer que celui-ci correspondît à la valeur du terrain original.
En outre, la Cour observe que l’état d’incertitude dans lequel s’est trouvé le couple, qui ne pouvait ni aménager son terrain ni se faire exproprier, a duré pendant un laps de temps considérable. Dès lors, elle estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection de la propriété a été rompu, et que le couple requérant a dû supporter une charge excessive, au mépris de l’article 1 du Protocole no 1.
Article 41 (satisfaction équitable)
La Cour dit que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état et réserve sa décision sur ce point.
BRANISTE c. ROUMANIE requête du 5 novembre 2013 n° 19099/04
Les terrains nationalisés en Roumanie sont rendue mais la construction de deux coopérative empêchent les requérants d'en prendre possession d'une partie.
6. Par un arrêt définitif du 17 juin 2002, le tribunal départemental de Mure? condamna les autorités départementales à octroyer au requérant et à ses frères et sœurs un titre de propriété sur un terrain de 8 700 m2 situé dans la ville de Sighisoara et qui avait appartenu, avant sa nationalisation, à leurs aïeuls. Le 2 octobre 2003, le titre de propriété fut délivré.
7. Le requérant et les autres propriétaires furent empêchés de prendre possession de leur bien en raison de l’existence, sur une partie du terrain, de plusieurs constructions appartenant à deux sociétés coopératives : Prestarea Sighisoara (« la société P. ») et Sinco Sighisoara (« la société S. »). Ces constructions avaient été érigées avant l’octroi du titre de propriété sur la base d’un droit d’usage gratuit au profit des sociétés coopératives.
33. Le requérant considère qu’il aurait dû jouir de tous les attributs du droit de propriété reconnus par le titre de propriété.
34. Le Gouvernement soutient que le requérant était responsable de la situation créée au motif qu’il aurait revendiqué auprès des autorités locales la restitution du terrain ayant appartenu à ses aïeuls, sur l’emplacement d’origine, tout en sachant qu’une partie de ce terrain était occupée par les bâtiments de deux sociétés coopératives.
35. En tout état de cause, il estime que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit de propriété était légale et qu’elle préservait un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’intéressé.
36. La Cour constate que le droit de propriété sur le terrain litigieux, tel que reconnu par le titre de propriété du 2 octobre 2003, était absolu et exclusif, et qu’il ne pouvait faire l’objet d’aucun démembrement ou condition (voir, mutatis mutandis, Moculescu, précité, § 28). Cependant, le requérant a été privé de la possibilité de jouir de son bien ou d’en recueillir les fruits, en application de la loi no 109/1996 qui avait établi un droit de superficie gratuit en faveur des sociétés coopératives.
37. Il y a donc eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens.
38. La Cour ne doute pas que la reconnaissance en faveur des sociétés coopératives du droit de superficie avait une base légale en droit interne, à savoir la loi no 109/1996 et qu’elle poursuivait un but d’intérêt général, à savoir, le maintien des activités économiques et des services fournis par ces sociétés.
39. Cela étant, la Cour se doit de rechercher, à la lumière du principe général du respect de la propriété consacré par la première phrase du premier alinéa de l’article 1 précité, si les autorités roumaines ont ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69).
40. A cet égard, la Cour constate que la législation interne excluait complètement toute possibilité de mise en balance des intérêts de la communauté et ceux des propriétaires dont les terrains étaient occupés par des locaux appartenant à des sociétés coopératives (voir, mutatis mutandis, Moculescu, précité, § 34).
41. La pleine jouissance du droit de propriété du requérant sur son terrain ayant été entravée pendant l’occupation des locaux par les sociétés coopératives, la Cour estime que la situation ainsi créée a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général (voir, mutatis mutandis, Moculescu, précité, § 35).
42. Par ailleurs, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché au requérant d’avoir réclamé la restitution sur le même emplacement du terrain ayant appartenu à ses aïeuls, comme l’affirme le Gouvernement, dès lors que sa demande était fondée sur les dispositions de la loi no 18/1991 et que les juridictions internes l’ont bel et bien accueillie.
43. Par conséquent, la Cour conclut que le requérant a supporté, avant l’entrée en vigueur de la loi no 1/2005, une charge spéciale et excessive que seule aurait pu rendre légitime la possibilité de réclamer une réparation.
44. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
HÜSEYIN KAPLAN C TURQUIE du 1er octobre 2013 Requête 24508/09
L'édification d’un établissement d’enseignement technique et professionnel sur le terrain du requérant sans l'exproprier est une violation de la Convention.
34. Le requérant soutient que la situation dénoncée a emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il allègue subir une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de ses biens depuis 1982, date à laquelle l’administration aurait décidé d’affecter son terrain à un service public. Pendant toute cette période, son terrain – doté du statut de terrain constructible en 1991 – aurait été frappé d’une restriction d’usage consistant en une interdiction de construire ou de planter des arbres, jusqu’à ce que l’administration procédât, à une date indéterminée, à son expropriation. Le requérant se plaint de cette situation d’incertitude. Il reproche aux autorités leur inertie et déplore l’absence d’indemnisation pour le sacrifice qui lui serait imposé. Il soutient qu’il a perdu de la sorte la pleine jouissance du terrain et que la situation litigieuse a en outre éliminé toute possibilité concrète de trouver un acheteur et donc de vendre le terrain. Compte tenu de la situation dénoncée, il estime qu’il y a eu une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens.
35. Le Gouvernement se borne à réitérer ses exceptions préliminaires et ne se prononce pas sur le fond de l’affaire.
36. Aux yeux de la Cour, il y a eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens. La Cour note en effet que, depuis 1982, le terrain du requérant a été affecté à un service public et que le registre foncier a été annoté en conséquence. Elle relève qu’il ressort des éléments du dossier que ledit terrain, qui avait initialement le statut de prairie, a acquis le statut de terrain constructible en 1991 (paragraphes 8 et 9 ci-dessus) et qu’il a été affecté dans le plan d’urbanisme à l’édification d’un établissement d’enseignement technique et professionnel. Or plus de vingt ans se sont écoulés et l’administration n’a pas même démarré la construction de l’école ni exproprié le requérant de son terrain. La Cour estime que la situation décrite a eu incontestablement pour effet de créer une restriction de la disponibilité du bien en cause. Reste à savoir si cette ingérence a enfreint ou non les dispositions de l’article 1 du Protocole no 1.
37. La Cour observe qu’il n’y a pas eu de privation formelle de propriété puisque le droit de propriété du requérant est resté juridiquement intact. Cependant, elle rappelle que, en l’absence d’un transfert de propriété, elle doit aussi regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de la situation litigieuse (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 63, série A no 52, et Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 38, série A no 50 ; voir également, mutatis mutandis, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 25, série A no 32).
38. A cet égard, elle relève que les effets de la situation litigieuse dénoncés par le requérant découlent tous des limitations apportées au droit de propriété et des conséquences de celles-ci sur la valeur de l’immeuble ; ils résultent donc tous de la restriction exercée sur la faculté de l’intéressé de disposer de son bien. Cela étant, la Cour note que, bien qu’il ait perdu de sa substance, le droit en cause n’a pas disparu. Les effets des mesures en question ne sont pas tels qu’on puisse les assimiler à une privation de propriété. Le requérant n’a perdu ni l’accès à son terrain ni la maîtrise de celui-ci et, en principe, la possibilité de vendre son bien, bien que rendue plus malaisée, a subsisté. Dans ces conditions, la Cour estime que la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce (Scordino c. Italie (no 2), no 36815/97, § 71, 15 juillet 2004, et Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal, 16 septembre 1996, § 85, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).
39. En revanche, elle considère que la situation dénoncée par le requérant relève de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 (Sporrong et Lönnroth, précité, § 65 ; Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 74, série A no 117 ; Poiss c. Autriche, 23 avril 1987, § 64, série A no 117 ; Elia S.r.l. c. Italie, no 37710/97, § 57, CEDH 2001-IX ; Scordino (no 2), précité, § 73 ; Köktepe c. Turquie, no 35785/03, § 85, 22 juillet 2008 ; Hakan Ari c. Turquie, no 13331/07, § 37, 11 janvier 2011, et Ziya Çevik c. Turquie, no 19145/08, § 36, 21 juin 2011).
40. La Cour doit donc rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant (Sporrong et Lönnroth, précité, § 69, et Phocas c. France, 23 avril 1996, § 53, Recueil 1996-II).
41. Elle constate que le terrain n’était plus libre de toute contrainte depuis son affectation, en 1982, à un service public. Elle note également qu’avec le développement urbain il a perdu son caractère initial de prairie et qu’il a acquis la qualité de terrain constructible en 1991 (paragraphes 8 et 9 ci-dessus).
42. Or ce terrain, destiné à être exproprié, a été soumis à une interdiction de construire en vertu d’un plan d’urbanisme l’ayant affecté à l’édification d’une école. Cette interdiction a été maintenue de manière continue (paragraphe 24 ci-dessus).
43. La Cour rappelle avoir jugé que, dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement du territoire, les Etats contractants jouissaient d’une large marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique (Sporrong et Lönnroth, précité, § 69). Dans les circonstances de la cause, elle tient pour établi que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens répondait aux exigences de l’intérêt général. Néanmoins, elle ne saurait renoncer pour autant à exercer son pouvoir de contrôle.
44. Elle observe que, durant toute la période concernée, le requérant est resté dans une incertitude complète quant au sort de sa propriété. A la date du 20 mars 2013, l’intéressé n’était toujours pas exproprié de son bien.
45. La Cour estime que cet état des choses a entravé la pleine jouissance du droit de propriété du requérant, lequel ne peut ni construire sur un terrain doté du statut de terrain constructible ni même y planter des arbres. Cette situation a, de plus, eu des répercussions dommageables en ce qu’elle a, entre autres, considérablement affaibli les chances de l’intéressé de vendre son terrain.
46. Enfin, la Cour constate que le requérant n’a vu sa perte compensée par aucune indemnisation.
47. A la lumière de ces considérations, elle estime que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect de ses biens (Hakan Ari, précité, § 47 ; Ziya Çevik, précité, § 47 ; Sporrong et Lönnroth, précité, §§ 73 et 74 ; Erkner et Hofauer, précité, §§ 78 et 79 ; Elia, précité, § 83 ; Rossitto c. Italie, no 7977/03, § 45, 26 mai 2009 ; Skibinscy c. Pologne, no 52589/99, § 98, 14 novembre 2006 ; Skrzynski c. Pologne, no 38672/02, § 92, 6 septembre 2007 ; Rosinski c. Pologne, no 17373/02, § 89, 17 juillet 2007 ; Buczkiewicz c. Pologne, no 10446/03, § 77, 26 février 2008, et Pietrzak c. Pologne, no 38185/02, § 115, 8 janvier 2008).
48. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
HALIL GÖÇMEN c. TURQUIE du 12 novembre 2013 requête n° 24883/07
Le requérant vit à Thiers en France. Les autorités turques n'arrivant pas à le joindre pour entamer une procédure d'expulsion en faveur du rectorat, ont décidé d'occuper son terrain de fait sans l'indemniser. La violation de la convention est constatée.
26. En ce qui concerne la question de l’existence d’une ingérence, nul ne conteste que l’expropriation de facto du terrain de M. Göçmen constitue une privation de propriété.
27. A cet égard, la Cour relève que les juridictions nationales ont constaté que l’administration avait occupé le terrain du requérant sans qu’ait été mise en oeuvre une procédure d’expropriation en bonne et due forme. En conséquence, elles ont décidé d’octroyer à l’intéressé des dommages et intérêts pour expropriation de fait en contrepartie de l’inscription du bien en cause au nom de l’administration dans le registre foncier. La Cour conclut que le jugement définitif du 17 mai 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Kayseri a bien eu pour effet de priver le requérant de son bien au sens de la deuxième phrase de l’article 1 du Protocole no 1 (Sarica et Dilaver c. Turquie, no 11765/05, § 40, 27 mai 2010, Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, § 61, CEDH 2000-VI, et Brumarescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).
28. Or pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, une telle ingérence doit être opérée « pour cause d’utilité publique » et « dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux de droit international » : elle doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52).
29. En effet, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, étant inhérente à l’ensemble de la Convention (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II), l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale.
30. Dans ce contexte, la Cour observe d’abord que la pratique de l’expropriation de fait permet à l’administration d’occuper un bien immobilier et d’en transformer irréversiblement la destination, de telle sorte qu’il soit finalement considéré comme acquis au patrimoine public sans qu’il y ait eu le moindre acte formel pour déclarer le transfert de propriété. En l’absence d’un tel acte, le seul élément qui permette de légitimer le transfert du bien occupé et de garantir rétroactivement une certaine sécurité juridique est le jugement du tribunal saisi qui,a posteriori, ordonne le transfert de propriété après avoir constaté l’illégalité de l’occupation dénoncée et alloué aux demandeurs des dommages et intérêts, dits « indemnité d’expropriation de fait ».
31. L’expropriation de fait constitue ainsi une pratique permettant à l’administration de s’approprier un bien sans avoir indemnisé au préalable son propriétaire. Elle a pour effet de contraindre les propriétaires – qui jusqu’alors conservent formellement leur titre sur le plan juridique – à ester en justice contre l’administration. En effet, les intéressés se voient obligés d’entamer une action en indemnisation et, de ce fait, d’engager des frais de procédure pour faire valoir leurs droits, alors qu’en matière d’expropriation formelle, la procédure est déclenchée par l’administration expropriante, qui à défaut de règlement amiable doit en principe supporter les frais de justice.
32. À l’aune de ce qui précède, la Cour estime que ce procédé permettant à l’administration de passer outre les règles de l’expropriation formelle expose les justiciables au risque d’un résultat imprévisible et arbitraire. Il n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique et ne saurait constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme (Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, § 89, 17 mai 2005 et Guiso-Gallisay c. Italie, no 58858/00, § 87, 8 décembre 2005).
33. Dans la présente affaire, la Cour observe que l’administration s’est approprié le terrain du requérant au mépris des règles régissant l’expropriation formelle et sans lui verser d’indemnité. Le fait que le rectorat de l’université d’Erciyes ait en réalité bien pris une décision d’expropriation mais n’ait pas pu la notifier au requérant au motif qu’il habitait à l’étranger ne change en rien ce constat. D’ailleurs, il n’y a aucun document dans le dossier démontrant que le rectorat a cherché à trouver l’adresse de l’intéressé. Au lieu de suivre la procédure légale pour exproprier le requérant de son bien en bonne et due forme, l’administration a préféré délimiter le terrain et l’entourer de barbelés, prenant ainsi possession des lieux.
34. La Cour note que les juridictions turques ont entériné la pratique de l’expropriation de fait en jugeant que le requérant avait été privé de son bien du fait de l’occupation de son terrain par l’administration.
35. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne pouvait être considérée comme « prévisible » pour M. Göçmen puisque ce n’est que depuis que le jugement du tribunal de grande instance de Kayseri est devenu définitif que l’on peut conclure à l’application effective de la pratique de l’expropriation de fait et que la méthode employée par l’administration pour rattacher le terrain litigieux au domaine public a été sanctionnée. Autrement dit, ce n’est que le 17 mai 2007 – date du jugement définitif du tribunal de grande instance de Kayseri – que le requérant a bénéficié de la « sécurité juridique » concernant la privation de son terrain.
36. De plus, à l’analyse des éléments du dossier et notamment des rapports d’expertise, la Cour observe qu’un laps de temps notable s’est écoulé depuis la prise de possession du terrain litigieux par l’administration sans que le projet d’utilité publique fondant la privation de propriété ait été réalisé. Or une telle situation, de nature à priver le requérant exproprié de facto de son terrain d’une plus-value rapportée par le bien en cause, est également incompatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 (Motais de Narbonne c. France, no 48161/99, § 19, 2 juillet 2002, Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Marin, no 40786/98, § 33, 13 octobre 2004, et Keçecioglu et autres c. Turquie, no 37546/02, § 28, 8 avril 2008). Néanmoins, la Cour ne s’attardera pas davantage sur ce point dans la mesure où le requérant n’a pas intenté de recours en droit interne sur cette question spécifique.
37. En ce qui concerne la question de l’indemnisation, la Cour rappelle que sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, série A no 98, p. 36, § 54, Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, série A no 301, p. 35, § 71, Malama c. Grèce, no 43622/98, § 52, CEDH 2001-II, Platakou c. Grèce, no 38460/97, CEDH 2001-I, Jokela c. Finlande, no 28856/95, CEDH 2002-IV et Yiltas Yildiz Turistik Tesisleri A.S. c. Turquie, no 30502/96, § 38, 24 avril 2003.
38. La Cour observe que, dans la présente espèce, la qualification du terrain litigieux (terrain à bâtir ou terrain agricole) et sa valeur ont été l’objet d’une controverse. Même si la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales et d’indiquer la manière dont les faits doivent être établis, il lui revient toutefois de s’assurer qu’ils ne l’ont pas été de manière inéquitable ou déraisonnable (Gereksar et autres c. Turquie, nos 34764/05, 34786/05, 34800/05 et 34811/05, § 55, 1er février 2011).
39. La Cour relève que la juridiction de première instance, se fondant sur le rapport d’expertise qu’elle avait demandé, avait initialement fixé l’indemnité pour expropriation de facto à 18 000 livres turques (TRL) (soit environ 11 000 EUR (euros) à l’époque des faits). Cette décision ayant été censurée par la Cour de cassation, le tribunal de grande instance de Kayseri, après avoir pris connaissance des conclusions du nouveau rapport d’expertise, a estimé que le montant de l’indemnité à allouer au requérant était de 754,29 TRL (soit environ 420 EUR à l’époque des faits). Cette différence notable dans la détermination de la valeur du bien était due au fait que dans le premier rapport d’expertise, le terrain avait été qualifié de constructible, et dans le second, de terrain agricole.
40. La Cour estime qu’avant de fixer la valeur du terrain à 1,50 TRL (0,86 EUR) le mètre carré, il revenait au tribunal de grande instance d’exposer les raisons pour lesquelles il écartait les arguments du requérant. L’intéressé, qui avait notamment démontré avoir payé de 1998 à 2003 la taxe foncière à l’Etat sur la base d’une qualification de terrain à bâtir et non de terrain agricole, pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit procédé à une nouvelle expertise pour écarter les contradictions des deux expertises initiales.
41. Dès lors, la Cour considère que les faits n’ont pas été établis de manière suffisamment motivée et qu’une explication de nature à répondre aux attentes légitimes et aux arguments qui étaient ceux du requérant n’a pas été fournie.
42. A la lumière de ce qui précède, outre le défaut de légalité de l’expropriation litigieuse, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, l’obligation d’offrir des procédures judiciaires présentant les garanties procédurales requises n’a pas été suffisamment respectée.
43. Partant il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
SOCIEDAD ANÓNIMA DEL UCIEZA c. ESPAGNE du 4 novembre 2014 requête 38963/08
Une expropriation de fait contraire à l'Article 1 du Protocole 1. La requérante allègue avoir été privée d’une partie de sa propriété, comprenant une église médiévale, sans cause d’utilité publique et en l’absence de toute indemnisation, sur le fondement d’une loi préconstitutionnelle. Elle situe cette privation dans la décision du responsable du livre foncier d’Astudillo d’inscrire l’église médiévale en cause comme appartenant à l’Évêché de Palencia au seul vu d’un certificat de propriété ad hoc établi le 16 décembre 1994 par le secrétaire général dudit Évêché, faisant valoir que pareille inscription crée une présomption iuris tantum de propriété au profit de l’Évêché. Déboutée dans la procédure judiciaire engagée par elle en réaction, la requérante estime avoir été de ce fait définitivement déchue du droit qui, selon elle, était antérieurement le sien.
70. L’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes. La première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété. La deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapports entre elles : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe général consacré par la première (voir, parmi beaucoup d’autres, Bruncrona c. Finlande, no 41673/98, § 65, 16 novembre 2004), respecter le principe de légalité et viser un but légitime par des moyens raisonnablement proportionnés à celui-ci (voir, par exemple, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, §§ 108-114, CEDH 2000-I).
71. La notion d’« utilité publique » de la seconde phrase du premier alinéa est ample par nature. En particulier, la décision d’adopter des lois sur le droit de propriété implique d’ordinaire l’examen de questions politiques, économiques et sociales. Une privation de propriété opérée dans le cadre d’une politique légitime – d’ordre social, économique ou autre – peut répondre à l’utilité publique même si la collectivité dans son ensemble ne se sert ou ne profite pas elle-même du bien dont il s’agit.
72. Les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique ». Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’« utilité publique » sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de fondement. Tant que le législateur ne dépasse pas les limites de sa marge d’appréciation, la Cour n’a pas à dire s’il a choisi la meilleure façon de traiter le problème ou s’il aurait dû exercer son pouvoir différemment (James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 51, série A no 98).
73. Une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit toutefois ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier, qui doit se lire à la lumière du principe général consacré par la première phrase. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ou réglementant l’usage de celle-ci.
74. Nonobstant le silence de l’article 1 du Protocole no 1 en matière d’exigences procédurales, afin d’évaluer la proportionnalité de l’ingérence, la Cour regarde le niveau de protection contre l’arbitraire dispensé par la procédure en cause (Hentrich c. France, 22 septembre 1994, § 46, série A no 296-A). Lorsqu’il s’agit d’une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, les procédures applicables doivent aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte au droit en cause. Une telle ingérence ne peut avoir de légitimité en l’absence d’un débat contradictoire et respectueux du principe de l’égalité des armes, qui permette de discuter des aspects d’importance pour l’issue de la cause. Pour s’assurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer les procédures applicables d’un point de vue général (voir, parmi d’autres, Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 45, CEDH 2002-IV, AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, § 55, série A no 108, Hentrich v. France, précité, § 49 et Gáll c. Hongrie, no 49570/11, § 63, 25 juin 2013).
75. Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 89, CEDH 2000-XII).
76. Sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1. Cependant, ce dernier ne garantit pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes « d’utilité publique » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir, parmi d’autres, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 48, CEDH 1999-II). Une privation de propriété sans indemnisation peut, dans certaines circonstances, être conforme à l’article 1 (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 117, CEDH 2005-VI).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
i. Sur l’existence d’une ingérence dans le droit de propriété de la requérante
77. La requérante se plaint d’avoir été privée d’un bien qu’elle estimait lui appartenir, une église cistercienne enclavée dans un terrain dont elle est la propriétaire, par l’effet de l’immatriculation de ladite église au profit de l’Église catholique sur présentation par cette dernière du certificat prévu par l’article 206 de la loi hypothécaire pour les biens immeubles non-inscrits au livre foncier.
Le Gouvernement conteste ces affirmations et explique que, comme l’ont reconnu les juridictions internes, l’église en cause n’a jamais appartenu à la requérante ni à ceux qui lui ont vendu sa propriété rurale, l’Église catholique ayant toujours été la seule propriétaire de l’église en cause. Il souligne que le certificat de propriété délivré par l’Évêché n’était pas un mode d’ « acquisition » de la propriété, mais simplement une formalité pour l’inscription au livre foncier des biens immeubles appartenant déjà à l’Église.
78. La Cour observe qu’avant le 22 décembre de 1994, date à laquelle l’Évêché de Palencia fit procéder à l’inscription litigieuse dans le livre foncier d’Astudillo (paragraphe 8 ci-dessus), le terrain en cause, comportant, entre autres, l’église cistercienne litigieuse, était déjà inscrit au livre foncier.
En effet, les inscriptions foncières antérieures à son acquisition par la requérante indiquaient l’existence sur la propriété en cause d’ « un bâtiment qui était anciennement l’église du prieuré de Santa Cruz » (paragraphe 7 ci-dessus). Quant à l’inscription foncière de 1979 au nom de la requérante, à la suite de l’acquisition par cette dernière de la propriété en cause par un acte authentique de vente conclu avec les anciens propriétaires le 12 juillet 1978, elle mentionnait que dans la propriété étaient enclavées « une église, une maison, (...) » (paragraphe 6 ci-dessus).
Aux yeux de la Cour, l’église en cause était donc expressément inscrite au livre foncier. Les juridictions espagnoles et, en particulier, l’Audiencia provincial de Palencia, ont admis l’existence de cette inscription foncière, bien que cette dernière l’ait qualifiée d’« équivoque » concernant la description de la propriété et les bâtisses y enclavés (paragraphe 12 ci-dessus).
79. La Cour note que selon la législation espagnole, celui qui inscrit son bien au livre foncier est réputé titulaire d’un droit réel sur ledit bien. Selon l’article 38 de la loi hypothécaire du 8 février 1946, il est en effet présumé que les droits réels inscrits au livre foncier existent et appartiennent à leur titulaire. Lorsqu’un titre est inscrit au livre foncier, aucun autre titre incompatible ne peut être inscrit (paragraphe 22 ci-dessus).
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’inscription d’un bien au livre foncier confère d’importants avantages d’ordre substantiel et procédural à son propriétaire, le livre foncier se présentant comme un instrument de publicité de la propriété foncière destiné à garantir la propriété des biens, ainsi que la circulation et le commerce desdits biens.
80. Or malgré son inscription au livre foncier en 1979, la Cour relève que le titre dont se prévalait la requérante a été réduit à néant par les juridictions internes. Elle observe à cet égard que, selon ce qu’expose le Gouvernement (paragraphe 51 ci-dessus), la loi ouvre aux tiers dont les droits auraient été méconnus une action contre le propriétaire d’un bien inscrit à la suite d’une mutation de propriété dans un délai de deux ans à compter d’une telle inscription. L’Évêché de Palencia, qui n’avait pas exercé une telle action en temps utile, est toutefois parvenu à faire immatriculer seize ans plus tard le même bien immeuble que celui déjà inscrit au nom de la requérante, par un moyen qui était réservé par la loi aux seuls cas d’absence d’inscription préalable du bien en cause.
81. Dès lors, cette nouvelle inscription, à l’initiative du secrétaire général de l’Évêché de Palencia, de l’église cistercienne en cause comme bien appartenant audit Évêché, a privé la requérante des droits qu’elle tirait de l’inscription préalable de l’immeuble à son nom. Elle a donc constitué une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens.
82. Il reste à examiner si ladite ingérence était compatible avec l’article 1 du Protocole no 1.
ii. Sur la justification de l’ingérence
a) Sur la règle applicable
83. La requérante se dit victime d’une expropriation, du fait de l’immatriculation par l’Église catholique de l’église enclavée dans le terrain dont elle est propriétaire, et qui selon elle était inscrite à son nom au livre foncier. Au demeurant, elle rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 est aussi applicable à l’expropriation de fait et aux cas d’ingérence dans l’usage d’un bien même sans transfert formel de propriété.
Le Gouvernement conteste ces thèses.
84. La Cour estime que la question dans la présente affaire est essentiellement celle de l’inscription de l’église litigieuse au livre foncier : si l’église était déjà mentionnée au livre foncier comme enclavée dans le terrain appartenant à la requérante sans que ladite inscription ait été attaquée en temps utile, il y aurait lieu de considérer que l’immatriculation ultérieure de ladite église au nom de l’Évêché de Palencia a privé le titre de propriété de la requérante de tout effet utile.
85. En l’absence d’un transfert indiscuté de propriété, la Cour doit regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de la situation litigieuse (voir, mutatis mutandis, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 25, série A no 32). À cet égard, la présente situation ne s’apparente pas à une expropriation de fait ni à une mesure de réglementation de l’usage des biens, au sens du deuxième alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
86. La Cour estime dès lors qu’il convient d’apprécier la situation dénoncée par la requérante comme relevant de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 65, série A no 52, Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 74, série A no 117, Poiss c. Autriche, 23 avril 1987, § 64, série A no 117 et Elia S.r.l. c. Italie, no 37710/97, § 57, CEDH 2001-IX).
ß) Sur le respect de la norme énoncée à la première phrase du premier alinéa
87. Aux fins de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté, en l’espèce la sécurité dans le commerce des biens immeubles par leur inscription au livre foncier, et les impératifs de la sauvegarde du droit fondamental de la requérante (Sporrong et Lönnroth, précité, § 69 ; Phocas c. France, 23 avril 1996, § 53, Recueil 1996-II). Pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence, la Cour a égard aussi au degré de protection offert contre l’arbitraire par la procédure mise en œuvre (Hentrich, précité, § 44).
88. Eu égard à la marge d’appréciation accordée aux États en la matière, la Cour tient pour établi que l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens répondait aux exigences de l’intérêt général.
Pour autant, la Cour ne saurait renoncer à son pouvoir de contrôle. Il lui appartient en effet de vérifier que l’équilibre voulu a été préservé d’une manière compatible avec le droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de la première phrase de l’article 1.
89. La Cour relève d’une part que le droit espagnol prévoit qu’aucun autre titre n’est opposable à un titre inscrit au livre foncier, et que les droits réels inscrits au livre foncier sont présumés exister et appartenir à leur titulaire (paragraphe 22 ci-dessus). Elle observe d’autre part que, selon le droit espagnol, l’immatriculation des propriétés non inscrites au livre foncier ne peut être effectuée que par le biais de l’un des moyens établis par l’article 199 de la loi hypothécaire, à savoir : a) au terme d’une procédure de reconnaissance de propriété, ou b) au vu d’un titre public d’acquisition, complété par un acte de notoriété lorsque le titre acquisitif du vendeur ou de celui qui le transmet n’est pas attesté de manière irréfutable, ou encore c) au vu du certificat auquel se réfère l’article 206, qui dans le cas de l’Église catholique est délivré par l’évêque diocésain (paragraphe 22 ci-dessus).
90. La Cour considère qu’aucune justification à l’immatriculation du bien en cause, autre que celle prévue par l’article 206 de la loi hypothécaire, n’a été donnée par l’Évêché de Palencia. Or il est à noter les dispositions dudit article ne jouent qu’en cas d’absence d’inscription foncière préalable. Dans la mesure où dans la présente affaire il existait une inscription foncière préalable portant sur le même bien et datant de 1979, l’immatriculation au nom de l’Évêché de Palencia en 1994 a impliqué la perte des droits qui découlaient pour la requérante de l’inscription de 1979.
91. L’immatriculation foncière demandée par l’Évêché de Palencia s’est faite sans tenir compte de l’inscription qui figurait au nom de la requérante au livre foncier d’Astudillo. Il ressort des faits de l’espèce que l’absence d’inscription foncière préalable de l’église cistercienne en question, condition requise pour l’application de l’article 199 de la loi hypothécaire au livre foncier, prêtait pour le moins à discussion. La Cour estime que même si, comme l’a confirmé l’Audiencia provincial dans son arrêt du 5 février 2001 (paragraphe 12 ci-dessus), les termes de l’inscription antérieure de l’église en cause étaient équivoques, son inscription au nom de l’Évêché aurait dû être refusée par le responsable du livre foncier, qui, comme le prévoit l’article 306 du règlement hypothécaire, n’aurait pas dû permettre la coexistence de deux inscriptions apparemment contradictoires portant sur le même bien (paragraphe 23 ci-dessus).
92. Le responsable du livre foncier a néanmoins procédé à l’immatriculation demandée par l’Évêché de Palencia, qui emportait des effets préjudiciables pour la requérante, sans donner à cette dernière la possibilité de formuler des objections tirées de l’inscription foncière préalable de l’église en cause, qui auraient rendu inapplicables les articles 199 et 206 de la loi hypothécaire. Ainsi, c’est en l’absence de toute possibilité de faire valoir ses motifs d’opposition que la requérante a été privée des droits qui découlaient pour elle de l’inscription au livre foncier qu’elle avait obtenue en 1979.
93. Par la suite, la requérante a engagé une procédure civile à l’encontre de l’Évêché de Palencia afin de faire déclarer la nullité de l’immatriculation de l’église et de ses dépendances faite par l’Évêché en 1994 (paragraphe 10 ci-dessus). Cette procédure n’a pas abouti. Les juridictions internes ont estimé que, pour des raisons historiques, l’église en question ne figurait pas parmi les biens acquis par les propriétaires successifs du terrain en cause et ses dépendances depuis leur première acquisition par le sieur M. en 1841 (paragraphe 12 ci-dessus). Le juge de première instance no 5 de Palencia avait par ailleurs retenu dans son jugement du 28 mars 2000 que l’église en cause ne pouvait pas non plus avoir été acquise par la requérante par la voie de l’usucapion, en considérant : 1o que la prescription acquisitive ne pouvait en la matière avoir lieu qu’en faveur de personnes morales ecclésiastiques ; 2o que la requérante n’avait en tout état de cause pas exercé sur l’église une possession durant le temps requis par la loi, le diocèse s’étant comporté en tant que propriétaire jusqu’au conflit sur la propriété de ladite église ; 3o qu’au demeurant, le fait que les employés de la requérante disposaient de la clé de l’église n’était pas un élément déterminant en termes de possession, la détention de cette clé n’ayant eu selon lui d’autre objet que de permettre de montrer l’église aux visiteurs.
94. La Cour observe que les arguments retenus reposaient sur des considérations historiques ainsi que sur l’interprétation de certaines institutions du droit civil telles que l’usucapion ou la possession. Elle relève toutefois qu’aucune discussion sur les dispositions de la loi ou du règlement hypothécaires applicables en l’espèce n’a eu lieu au sein des juridictions internes ayant examiné l’affaire de la requérante. Or, il convient d’observer qu’aux termes de l’article 38 de la loi hypothécaire, il est présumé que les droits réels inscrits au livre foncier existent et appartiennent à leur titulaire enregistré. La Cour s’étonne que les motifs adoptés par les juridictions d’instance et d’appel en l’espèce n’aient aucunement abordé certaines questions clés telles que celle de la légalité de l’inscription au nom de l’Évêché de Palencia d’un bien déjà inscrit au livre foncier et de l’applicabilité des articles 199 et 206 de la loi hypothécaire aux faits de la cause.
95. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’inscription de l’église au nom de l’Évêché de Palencia par le responsable du livre foncier d’Astudillo au seul vu du certificat émis par l’évêché lui-même est intervenue de manière arbitraire et guère prévisible, et n’a pas offert à la requérante les garanties procédurales élémentaires pour la défense de ses intérêts. En particulier, tel qu’appliqué dans la présente affaire, l’article 206 de la loi hypothécaire ne satisfaisait pas suffisamment aux exigences de précision et de prévisibilité qu’implique la notion de loi au sens de la Convention.
96. Dès lors qu’elle revient à priver de tout effet utile un droit réel inscrit au livre foncier, l’immatriculation d’un bien déjà évoqué dans une inscription antérieure ne saurait avoir de légitimité en l’absence d’un débat contradictoire et respectueux du principe de l’égalité des armes. Un tel débat au stade même de l’immatriculation aurait dû permettre de discuter la question de l’origine de la propriété et celle de la validité des transactions successives sur un pied d’égalité. Ce sont là autant d’éléments qui ont manqué dans la présente affaire (voir Hentrich, précité, § 42). En l’espèce, la requérante s’est trouvée dans l’impossibilité de se défendre contre l’effet de la mesure d’immatriculation litigieuse, ce qui la rend en soi disproportionnée.
97. À cela s’ajoute le fait que les juridictions du fond ont interprété la loi interne comme autorisant l’Évêché de Palencia à faire usage de son droit d’immatriculation sur la base de considérations historiques d’ordre général.
98. Or, par l’effet d’une telle interprétation, les droits qui découlaient pour la requérante de l’inscription de l’église litigieuse à son nom dans le livre foncier se sont vus amputés de tout effet utile, alors qu’à aucun moment il n’a été question de mauvaise foi ou de fraude de sa part ; et ce, au terme d’une procédure expéditive dans laquelle le seul titre présenté au responsable du livre foncier afin de procéder à l’immatriculation de l’église au nom de l’Évêché de Palencia consistait en un certificat de propriété délivré ex novo par le secrétaire général de ce même Évêché, alors même que celui-ci se référait à un bien sis à l’intérieur d’un terrain appartenant à la requérante.
99. La Cour estime pour le moins surprenant qu’un certificat délivré par le secrétaire général de l’Évêché puisse avoir la même valeur que les certificats délivrés par de fonctionnaires publics investis de prérogatives de puissance publique, et se demande par ailleurs pourquoi l’article 206 de la loi hypothécaire se réfère aux seuls évêques diocésains de l’Église catholique, à l’exclusion des représentants d’autres confessions. Elle note également qu’il n’y a aucune limitation dans le temps à l’immatriculation ainsi prévue et qu’elle peut donc se faire, comme cela a été le cas en l’espèce, de manière intempestive, sans condition de publicité préalable et en méconnaissance du principe de la sécurité juridique.
100. La Cour constate enfin que l’église litigieuse ayant été considérée par les juridictions internes comme appartenant depuis toujours à l’Évêché de Palencia vu son caractère d’église paroissiale, il n’a pas été possible pour la requérante en l’espèce d’obtenir une indemnisation quelconque.
101. Prenant en compte l’ensemble de ces éléments ainsi que le fait que la requérante s’est vue privée de son droit d’accès à l’instance de cassation pour l’examen de ces questions (paragraphes 24 et suiv., et en particulier voir le paragraphe 40 ci-dessus), la Cour retient que la requérante a été victime de l’exercice du droit d’immatriculation reconnu par la législation interne à l’Église catholique sans justification apparente et sans que l’Évêché de Palencia eut contesté, dans les délais légaux (paragraphe 51 ci-dessus), son droit de propriété à l’époque de l’inscription du bien au livre foncier. Dès lors, la requérante a « supporté une charge spéciale et exorbitante », que seule aurait pu rendre légitime la possibilité de contester utilement, et en tenant compte des dispositions applicables du droit hypothécaire, la mesure prise à son égard. Les circonstances de la cause, notamment l’exceptionnalité de la mesure en question, doublée de l’inexistence d’un titre de propriété dans le chef de la partie adverse, de l’absence d’un débat contradictoire et de l’inégalité des armes, combinées avec l’entrave à la pleine jouissance du droit de propriété et l’absence d’indemnisation, amènent la Cour à considérer que la requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens (Sporrong et Lönnroth, précité, §§ 73-74, arrêt Erkner et Hofauer, précité, §§ 78-79, Poiss précité, §§ 68,69 ; Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, § 54, CEDH 2000-I, Elia srl, précité, § 83).
102. En conclusion, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no1.
COUR DE CASSATION FRANÇAISE
LES TERRAINS AU BORD DE MER A 50 PAS EN MARTINIQUE SONT A L'ÉTAT
cour de cassation chambre civile 3 arrêt du 4 mai 2011 N° de pourvoi: 09-70161 rejet
Attendu selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mai 2009) rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 16 novembre 2005, pourvoi n° 04-12. 917), que les consorts X... ont saisi la commission départementale de vérification des titres pour obtenir la validation de leur droit de propriété sur une parcelle cadastrée V 444, située au Robert (Martinique), Pointe Royale
Mais attendu que le refus, dans le cadre de la procédure juridictionnelle mise en place par l'article 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de la validation d'un titre portant sur une parcelle de la zone domaniale des cinquante pas géométriques au motif que ce titre émane d'une personne privée et n'établit pas que l'Etat ait entendu soustraire le bien de son domaine public, ne caractérise pas une privation du bien au sens de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais relève d'une réglementation, justifiée par l'intérêt général, de l'usage des biens du domaine public maritime de l'Etat, n'entraîne pas une discrimination illicite et ne traduit pas une ingérence prohibée dans la vie privée et familiale
L'ABATTAGE D'UN TROUPEAU POUR SANTE PUBLIQUE
S.A. BIO D’ARDENNES c. BELGIQUE du 12 novembre 2019 requête n° 44457/11
Non violation de l'article 1 du Protocole 1 : Un troupeau abattu pour cause de brucellose n'a pas été indemnisé car la requérante n'a pas respecté les règlements.
La requérante a été indemnisée pour 89 bêtes pour cause de faute de l'administration mais pas pour les 264 têtes de bovin restantes.
La Cour constate, entre autres, que la société requérante s’est vu refuser l’octroi d’une indemnité en raison des multiples manquements qu’elle avait commis aux obligations sanitaires lui incombant, ce qui était prévu par le droit interne. Elle précise aussi que les autorités nationales disposent d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de protéger la santé publique et la sécurité alimentaire sur leur territoire et déterminer les sanctions du non-respect des obligations sanitaires, selon les risques engendrés par ce non-respect et les caractéristiques des maladies animales que ces obligations visent à éradiquer. Ainsi, eu égard à l’importance pour les États de lutter contre les maladies animales et compte tenu de la marge d’appréciation dont ils bénéficient en la matière, la Cour juge que la société requérante n’a pas subi une charge spéciale ou exorbitante du fait du refus d’indemnisation pour l’abattage de ses bovins.
La CEDH motive :
"53. Elle a tenté, en vain, de démontrer devant les juridictions internes que les autorités avaient commis un certain nombre de fautes qui étaient à l’origine du dommage qu’elle a subi. Sa demande a été dûment examinée par les juridictions nationales lesquelles ont estimé, après avoir entendu contradictoirement les arguments des parties et examiné tous les éléments du dossier, que sa demande à l’égard de l’AFSCA n’était pas fondée. Ce faisant, les juridictions internes ont vérifié que les conditions justifiant une atteinte au droit de propriété tel qu’interprété par la Cour étaient remplies dans les circonstances de l’espèce, en particulier que les mesures d’abattage étaient prévues par la loi, qu’elles poursuivaient un but légitime et qu’elles étaient proportionnées au but poursuivi (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). La Cour ne décèle dans le raisonnement des juridictions nationales aucun élément permettant de conclure que leurs décisions étaient arbitraires ou manifestement déraisonnables.
54. Par ailleurs, la Cour note et tient compte, dans l’examen de la proportionnalité des mesures litigieuses, du fait que la requérante a obtenu une compensation financière pour 89 des bovins abattus pour des fautes commises par la DGZ (paragraphes 25 et 28 ci-dessus).
55. Le fait que d’autres législations similaires sanctionnent le non-respect d’obligations sanitaires qu’elles édictent en réduisant le droit à l’indemnisation plutôt qu’en l’excluant n’est pas en l’espèce de nature à rompre le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Les autorités nationales disposent d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de protéger la santé publique et la sécurité alimentaire sur leur territoire (Chagnon et Fournier, précité, §57) pour déterminer les sanctions du non-respect des obligations sanitaires, selon les risques engendrés par ce non-respect et les caractéristiques des maladies animales que ces obligations visent à éradiquer."
CEDH
Recevabilité
36. La Cour constate que la requérante a introduit un recours indemnitaire en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil qu’elle a mené à bien devant les juridictions internes jusque devant la Cour de cassation en invoquant une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Le recours avait pour but d’obtenir une indemnisation pour l’abattage de 253 bovins en démontrant que l’AFSCA et la DGZ avaient commis des fautes sans lesquelles la requérante n’aurait pas subi de dommage. La requérante a ainsi donné la possibilité aux juridictions internes de remédier à la violation alléguée. Il ne saurait lui être reproché, comme le fait le Gouvernement, de ne pas avoir également fait usage du recours prévu à l’article 11 des lois sur le Conseil d’État. En effet, à supposer même que ce recours aurait permis à la requérante d’obtenir une réparation pour le dommage subi, lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, parmi d’autres, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 58, CEDH 2009, et Uzan et autres c. Turquie, no 19620/05 et 3 autres, § 174, 5 mars 2019).
37. Par ailleurs, constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
Appréciation de la Cour
a) Principes généraux applicables
44. La Cour rappelle que non seulement une ingérence dans le droit de propriété doit viser, dans les faits comme en principe, un « but légitime » conforme à « l’intérêt général », mais il doit aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure appliquée par l’État, y compris les mesures destinées à réglementer l’usage des biens d’un individu. C’est ce qu’exprime la notion du « juste équilibre » qui doit être ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52, et Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 167, CEDH 2006-VIII). En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’État une marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (voir, notamment, Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94 et 2 autres, § 75, CEDH 1999-III, et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 293, 28 juin 2018).
b) Application au cas d’espèce
45. La Cour relève d’emblée que la requérante a obtenu une indemnisation sous forme de dommages et intérêts pour les fautes commises par la DGZ pour 27 bovins abattus et qu’elle a en outre conclu un règlement amiable avec cette association pour 62 bovins supplémentaires (paragraphes 24 et 28 ci-dessus). Lors de la mise à jour du dossier en février 2018, la requérante a néanmoins précisé qu’elle souhaitait maintenir l’ensemble de sa requête dans la mesure où elle considère que les griefs invoqués à l’encontre de l’État belge n’ont pas été affectés par les indemnités partielles qu’elle a reçues, l’essentiel de son préjudice n’ayant pas été indemnisé.
46. La Cour prend note du souhait de la requérante de maintenir l’ensemble de sa requête et constate que le Gouvernement n’a soulevé aucune exception à cet égard. Cela étant, rien n’empêche la Cour de prendre, le cas échéant, ces éléments en compte dans l’examen de la proportionnalité des mesures contestées (voir, par exemple, Pinnacle Meat Processors Company et 8 autres c. Royaume-Uni, no 33298/96, décision de la Commission du 21 octobre 1998, non publiée).
47. Aucune contestation ne s’élève quant au fait que les mesures d’abattage litigieuses constituent une atteinte à la propriété de la requérante au regard de l’article 1 du Protocole no 1.
48. La Cour a déjà considéré qu’une mesure d’abattage préventif d’ovins afin de prévenir le déclenchement d’une épizootie de fièvre aphteuse sur le territoire national s’analysait en une réglementation de l’usage des biens (Chagnon et Fournier c. France, nos 44174/06 et 44190/06, § 36, 15 juillet 2010). Il n’y a pas lieu de décider autrement en l’espèce dès lors que, comme l’a relevé le Gouvernement, les bovins abattus sont restés la propriété de la requérante, qui pouvait les vendre et en percevoir la valeur bouchère. L’ingérence relève donc du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
49. Ceci étant dit, cette règle doit en tout cas s’interpréter à la lumière du principe général du respect de la propriété énoncé dans le premier paragraphe du premier alinéa de l’article précité (G.I.E.M. S.R.L. et autres, précité, § 289, et Lekic c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 92, 11 décembre 2018).
50. La requérante ne conteste pas la légalité des mesures d’abattage et du refus d’indemnisation qui étaient prévus par l’arrêté royal du 6 décembre 1978, ni le but légitime d’intérêt public qu’ils poursuivaient. Les parties sont toutefois en désaccord sur la question de savoir si ces mesures étaient proportionnées au but poursuivi.
51. La requérante soutient qu’en application de la jurisprudence de la Cour, seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un défaut total d’indemnisation (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99 et 2 autres, § 94, CEDH 2005-VI, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 95, CEDH 2006-V). La jurisprudence sur laquelle se fonde la requérante a trait à une privation de propriété relevant de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. Or ce critère n’est pas applicable lorsqu’est en cause une mesure de réglementation de l’usage des biens. Dans ce cas-là, l’absence d’indemnisation est l’un des facteurs à prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté mais elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 91, CEDH 2010, et Malfatto et Mieille c. France, no 40886/06 et 51946/07, § 64, 6 octobre 2016). La Cour va dès lors s’attacher à vérifier si l’abattage des bovins sans indemnisation a, dans les circonstances de l’espèce, ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits fondamentaux de la requérante, ou si celui-ci a fait peser sur elle une charge spéciale ou exorbitante.
52. La Cour note que l’arrêté royal du 6 décembre 1978 prévoit en principe une indemnisation partielle pour l’abattage de bovins atteints de la brucellose. La requérante s’est vu refuser l’octroi de cette indemnité en raison des multiples manquements qu’elle a commis aux obligations lui incombant. Le refus d’indemnisation dans ce cas est expressément prévu par l’article 23 § 3 dudit arrêté royal, et la requérante n’a pas fait valoir qu’elle ignorait ses obligations réglementaires ni qu’elle n’avait pas commis les manquements qui lui ont été reprochés.
53. Elle a tenté, en vain, de démontrer devant les juridictions internes que les autorités avaient commis un certain nombre de fautes qui étaient à l’origine du dommage qu’elle a subi. Sa demande a été dûment examinée par les juridictions nationales lesquelles ont estimé, après avoir entendu contradictoirement les arguments des parties et examiné tous les éléments du dossier, que sa demande à l’égard de l’AFSCA n’était pas fondée. Ce faisant, les juridictions internes ont vérifié que les conditions justifiant une atteinte au droit de propriété tel qu’interprété par la Cour étaient remplies dans les circonstances de l’espèce, en particulier que les mesures d’abattage étaient prévues par la loi, qu’elles poursuivaient un but légitime et qu’elles étaient proportionnées au but poursuivi (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). La Cour ne décèle dans le raisonnement des juridictions nationales aucun élément permettant de conclure que leurs décisions étaient arbitraires ou manifestement déraisonnables.
54. Par ailleurs, la Cour note et tient compte, dans l’examen de la proportionnalité des mesures litigieuses, du fait que la requérante a obtenu une compensation financière pour 89 des bovins abattus pour des fautes commises par la DGZ (paragraphes 25 et 28 ci-dessus).
55. Le fait que d’autres législations similaires sanctionnent le non-respect d’obligations sanitaires qu’elles édictent en réduisant le droit à l’indemnisation plutôt qu’en l’excluant n’est pas en l’espèce de nature à rompre le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Les autorités nationales disposent d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de protéger la santé publique et la sécurité alimentaire sur leur territoire (Chagnon et Fournier, précité, § 57) pour déterminer les sanctions du non-respect des obligations sanitaires, selon les risques engendrés par ce non-respect et les caractéristiques des maladies animales que ces obligations visent à éradiquer.
56. De l’avis de la Cour, déterminer si les bovins constituaient « l’outil de travail » de la requérante tel qu’interprété par la Cour (voir, à cet égard, Lallement c. France, no 46044/99, 11 avril 2002) ne modifie pas en l’espèce la conclusion à laquelle elle aboutit. Comme l’a fait remarquer le Gouvernement, la requérante pouvait poursuivre son activité en accueillant de nouveaux bovins dès la levée des mesures sanitaires le 20 juin 2000 (paragraphe 16 ci-dessus). La requérante n’a pas fait valoir que cela lui avait été impossible ou exagérément difficile.
57. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, eu égard à l’importance pour les États de lutter contre les maladies animales et compte tenu de la marge d’appréciation dont bénéficient les États en la matière, la requérante n’a pas eu à subir une charge spéciale ou exorbitante du fait du refus d’indemnisation pour l’abattage de ses bovins.
58. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no1.
N.M. et autres c. France du 3 février 2022 requête no 66328/14
Art 1 du Protocole 1 Indemnisation des frais liés à la prise en charge du handicap de l’enfant non décelé lors du diagnostic prénatal : l’application rétroactive de la loi est contraire à la Convention
Art 1 P1 • Privation de propriété • Absence d’indemnisation des charges résultant du handicap d’un enfant né comme tel en raison d’une faute lors du diagnostic prénatal, par application rétroactive de la loi • Dispositions légales pertinentes ne pouvant être appliquées à des faits nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, quelle que soit la date d’introduction de l’instance • Absence de jurisprudence constante et stabilisée des juridictions internes • Atteinte rétroactive aux biens non prévue par la loi
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire N.M. et autres c. France (requête n o 66328/14), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne le rejet, par le juge administratif, des conclusions des parents demandant l’indemnisation des charges particulières résultant du handicap de leur enfant. Ce handicap n’avait pas été décelé lors de l’établissement du diagnostic prénatal. Des dispositions législatives – issues de la loi du 4 mars 2002, et codifiées à l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) – excluant de telles charges du préjudice indemnisable par le juge, entrées en vigueur après la naissance de l’enfant mais avant la demande des parents de réparation du préjudice, ont été appliquées au litige. Ce litige s’inscrit dans la suite des affaires Maurice et Draon c. France (Draon c. France [GC], n° 1513/03, et Maurice c. France [GC], n° 11810/03). La Cour a d’abord considéré que les requérants pouvaient légitimement espérer pouvoir obtenir réparation de leur préjudice correspondant aux frais de prise en charge de leur enfant handicapé dès la survenance du dommage, à savoir la naissance de cet enfant et qu’ils étaient donc titulaires d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle a ensuite relevé qu’en vertu de la décision n° 2010-2 QPC du Conseil constitutionnel, l’ensemble des dispositions transitoires qui avaient prévu l’application rétroactive de l’article L. 114-5 du CASF avait été abrogé. Alors que l’abrogation de la totalité du dispositif transitoire laissait en principe place à l’application des règles de droit commun relatives à l’application de la loi dans le temps, la Cour a constaté la divergence entre l’interprétation retenue par le Conseil d’État et celle retenue par la Cour de cassation quant à la possibilité d’appliquer l’article L. 114-5 du CASF à des faits nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le 7 mars 2002. Alors que dans son arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de cassation avait exclu l’application de l’article L. 114-5 du CASF à des faits nés antérieurement au 7 mars 2002, quelle que soit la date d’introduction de l’action indemnitaire, le Conseil d’Etat avait réglé le litige dans le droit fil de sa décision du 13 mai 2011 qui avait, pour sa part, maintenu une certaine portée rétroactive à cette disposition. La Cour en a déduit qu’elle n’était pas en mesure de considérer que la légalité de l’ingérence résultant de l’application, par le Conseil d’État de l’article L. 114-5 du CASF dans sa décision du 31 mars 2014, pouvait trouver un fondement dans une jurisprudence constante et stabilisée des juridictions internes. Pour la Cour, l’atteinte rétroactive ainsi portée aux biens des requérants ne saurait donc être regardée comme ayant été « prévue par la loi » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1.
FAITS
Les requérants Mme N.M., M. M et leur fils A., sont des ressortissants français, nés en 1972, 1971 et en 2001 et résident à Sainte-Anne de Guadeloupe. En mai 2001, au cours de sa grossesse, Mme N.M. demanda au Centre hospitalier de S. d’établir un diagnostic prénatal approfondi. Aucune anomalie ne fut décelée. Le 30 décembre 2001, naquit A., un garçon atteint d’un ensemble de malformations désignées sous le terme de « syndrome de VATERL » se traduisant par une imperforation anale, des anomalies touchant les reins, une vertèbre et l’un de ses membres supérieurs, ainsi qu’une asymétrie faciale. Le 16 septembre 2002, les deux parents, estimant qu’une erreur de diagnostic prénatal avait été commise, sollicitèrent et obtinrent la désignation d’un expert qui rendit un rapport concluant à une erreur lors de l’interprétation des échographies effectuées par la requérante pendant sa grossesse. À la suite de ce rapport, les requérants engagèrent la responsabilité pour faute du Centre hospitalier devant le tribunal administratif d’Amiens et demandèrent réparation de plusieurs chefs de préjudice. Deux actions indemnitaires, portant sur les préjudices des parents ainsi que les dépenses liées au handicap, posaient notamment la question de l’application dans le temps des dispositions du I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, codifiées à l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Par un jugement rendu le 30 décembre 2008, le tribunal administratif d’Amiens écarta l’application au litige des dispositions précitées, lesquelles étaient restrictives des droits de créance dont pouvaient se prévaloir les parents. Relevant la faute commise lors du suivi de la grossesse, le tribunal retint la responsabilité du centre hospitalier et le condamna à réparer les préjudices subis tant par les parents que par leur enfant. Il fixa à 100 % le taux de la perte de chance subie par les deux premiers requérants d’éviter la naissance de l’enfant. Le 9 mars 2009, le Centre hospitalier releva appel de ce jugement et les requérants introduisirent un appel incident le 13 juillet 2009. Le 11 juin 2010, le Conseil Constitutionnel rendit la décision QPC n° 2010-2 abrogeant le 2 du paragraphe II de l’article 2 de la loi du 11 février 2005. Par un arrêt rendu le 16 novembre 2010 statuant sur les appels, la cour administrative d’appel de Douai écarta, à son tour, l’application des dispositions de l’article L. 114-5 du CASF en se fondant sur la décision QPC n° 2010-2 du Conseil constitutionnel et l’abrogation de ces dispositions avec prise d’effet le 12 juin 2010. La cour administrative confirma que la faute commise par le Centre hospitalier de S. était à l’origine directe du préjudice subi par les deux premiers requérants. Deux pourvois en cassation furent présentés par le Centre hospitalier de S. et par les requérants. Faisant suite à sa décision du 13 mai 2011 (Assemblée du contentieux, Lazare), le Conseil d’Etat, par une décision du 31 mars 2014, considéra que l’article L. 114-5 du CASF était applicable au litige, les requérants n’ayant engagé une instance en réparation que postérieurement au 7 mars 2002, date d’entrée en vigueur de la loi dont sont issues les dispositions de cet article, et annula l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit. Le Conseil d’État estima que, faute d’avoir engagé une instance avant le 7 mars 2002, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les requérants n’étaient pas titulaires, à cette date, d’un droit de créance indemnitaire qui aurait été luimême constitutif d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Statuant ensuite sur la responsabilité du centre hospitalier, le Conseil d’État exclut toute indemnisation des préjudices propres à l’enfant. Il retint en revanche l’existence d’un lien de causalité directe et certaine entre les préjudices des parents et la faute commise par le centre hospitalier dans la réalisation de l’échographie qui, les ayant empêchés de déceler l’affection grave et incurable de l’enfant à naître, les avait privés de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans les conditions légales. Après avoir relevé que « les dispositions de l’article L. 114-5 du CASF interdisent d’inclure dans le préjudice indemnisable des parents les charges particulières résultant du handicap de leur enfant, non détecté pendant la grossesse », il en déduisit que « les conclusions de M. et Mme M. tendant à ce que les frais liés au handicap de leur fils soient mis à la charge du [Centre hospitalier de S.] ne sauraient [...] être accueillies ». S’agissant des autres chefs de préjudice, l’indemnité à verser fut portée à 80 000 EUR (40 000 EUR chacun) en réparation du préjudice moral propre aux parents et de leurs troubles dans leurs conditions d’existence.
ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1
Les deux premiers requérants contestent l’application par le Conseil d’État, dans son arrêt du 31 mars 2014, des 1 er et 3 e alinéa de l’article L. 114-5 du CASF. Ils soutiennent que l’application de ces dispositions qui a conduit à exclure par principe l’indemnisation des frais liés à la prise en charge du handicap de leur fils a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour relève que ni le centre hospitalier, ni le Gouvernement ne contestent que l’erreur de diagnostic commise lors des échographies prénatales ait été constitutive d’une faute ayant causé un dommage. Le seul point en litige est la date du fait générateur de la créance. La Cour estime que, compte tenu des principes de droit commun français et de la jurisprudence constante en matière de responsabilité selon lesquels la créance en réparation prend naissance dès la survenance du dommage qui en constitue le fait générateur, les requérants pouvaient légitimement espérer pouvoir obtenir réparation de leur préjudice correspondant aux frais de prise en charge de leur enfant handicapé dès la survenance du dommage, à savoir la naissance de cet enfant. Il s’ensuit que les requérants détenaient une créance qu’ils pouvaient légitimement espérer voir se concrétiser, conformément au droit commun de la responsabilité pour faute, s’agissant d’un dommage survenu antérieurement à l’intervention de la loi litigieuse. Ils étaient donc titulaires d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1.
En l’espèce, la Cour relève qu’il n’est pas contesté que l’application au litige porté par les requérants des dispositions de l’article L. 114-5 du CASF qui ont exclu par principe l’indemnisation des frais liés à la prise en charge du handicap de leur fils constitue une ingérence s’analysant en une privation de propriété. La Cour doit donc rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour constate, en premier lieu, que, selon les termes de la décision n° 2010-2 QPC du Conseil constitutionnel, l’ensemble du dispositif transitoire ayant prévu l’application rétroactive de l’article L. 114-5 du CASF, est abrogé. La suppression de cette disposition de droit transitoire laisse immédiatement place à l’application des règles de droit commun relatives à l’application de la loi dans le temps. Il s’ensuit que, compte tenu de l’abrogation de la totalité du dispositif transitoire et en l’absence d’autre disposition législative le prévoyant expressément, l’article L. 114-5 du CASF ne saurait être appliqué à des faits nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, quelle que soit la date d’introduction de l’instance. La Cour relève, en second lieu, la divergence entre l’interprétation retenue par le Conseil d’État et l’interprétation retenue par la Cour de cassation. Dans son arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de cassation excluait l’application de l’article L. 114-5 du CASF à des faits nés antérieurement au 7 mars 2002, date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, quelle que soit la date d’introduction de l’action indemnitaire. La Cour de cassation a confirmé cette solution par la suite. Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de considérer que la légalité de l’ingérence résultant de l’application, par la décision du Conseil d’État du 31 mars 2014, de l’article L. 114-5 du CASF, pouvait trouver un fondement dans une jurisprudence constante et stabilisée des juridictions internes. La Cour en déduit que l’atteinte rétroactive portée aux biens des requérants ne saurait être regardée comme ayant été « prévue par la loi » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention en ce qui concerne les deux premiers requérants.
CEDH
RECEVABILITE
41. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence (voir en particulier sur ce point les arrêts précités Maurice c. France [GC], no 11810/03, CEDH 2005-IX et Draon c. France [GC], no 1513/03, 6 octobre 2005), un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions litigieuses se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris, dans certaines situations bien définies, des créances. Pour qu’une créance puisse être considérée comme une « valeur patrimoniale » relevant du champ de l’article 1 du Protocole no 1, il faut que le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base suffisante en droit interne, résultant par exemple d’une jurisprudence bien établie des tribunaux. Dès lors que cela est acquis, peut entrer en jeu la notion « d’espérance légitime ».
42. Dans toute une série d’affaires, la Cour a jugé que les requérants n’avaient pas « d’espérance légitime » au motif que l’on ne pouvait considérer qu’ils possédaient de manière suffisamment établie une créance immédiatement exigible. Selon sa jurisprudence, l’existence d’une « contestation réelle » ou d’une « prétention défendable » ne constitue pas un critère permettant de caractériser l’existence d’une « espérance légitime » protégée par l’article 1 du Protocole no 1. La Cour estime que lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme possédant une « valeur patrimoniale » que s’il a une base suffisante en droit interne, par exemple quand il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 35 et 48 à 52, CEDH 2004-IX).
43. La Cour se réfère à cet égard à l’affaire Pressos Compania Naviera S.A. et autres précitée qui concernait des créances en réparation d’accidents de navigation dont il était soutenu qu’ils avaient été causés par la négligence de pilotes belges. En vertu du droit belge de la responsabilité et de la jurisprudence des juridictions internes, la Cour a relevé que la créance en réparation naissait dès la survenance du dommage, la décision juridictionnelle ne faisant qu’en confirmer l’existence et en déterminer le montant. Se fondant ainsi sur la manière dont la créance serait traitée en droit interne au vu de la jurisprudence constante des juridictions belges, la Cour a considéré que les requérants pouvaient prétendre avoir une « espérance légitime » de voir concrétiser leurs créances quant aux accidents en cause. Mais l’« espérance légitime » ainsi identifiée n’était pas en elle-même constitutive d’un intérêt patrimonial ; elle se rapportait à la manière dont la créance qualifiée de « valeur patrimoniale » serait traitée en droit interne, et spécialement à la présomption selon laquelle la jurisprudence constante des juridictions nationales continuerait de s’appliquer à l’égard des dommages déjà causés ».
44. Les affaires précitées Maurice et Draon illustrent, dans des hypothèses proches de celle en litige, la portée de la notion « d’espérance légitime ». Dans ces deux affaires, les parents d’enfants nés avec un handicap non décelé au cours de la grossesse avaient introduit une action en responsabilité devant les tribunaux internes avant l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002. Se fondant sur l’affaire Pressos Compania Naviera S.A. et autres précitée, la Cour a jugé qu’en tant qu’il avait été fait application aux instances en cours des règles fixées par l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, il avait été porté une atteinte injustifiée aux droits de créance détenus par ceux qui avaient engagé ces instances sur les auteurs des fautes ayant rendu possible la survenance des dommages, et que, dès lors, avaient été méconnus les droits que les requérants tiraient de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention.
45. Pour ce faire, la Cour a vérifié, en se plaçant avant l’intervention de la loi litigieuse, si les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute étaient réunies et a considéré que les requérants disposaient d’une créance s’analysant en une « valeur patrimoniale ». Examinant ensuite la manière dont cette créance aurait été traitée en droit interne sans l’intervention de la loi litigieuse, la Cour a estimé que, compte tenu de l’arrêt Quarez et de la jurisprudence constante établie depuis par les juridictions administratives en la matière, les requérants pouvaient légitimement espérer pouvoir obtenir réparation de leur préjudice, y compris les charges particulières découlant du handicap de leur enfant tout au long de sa vie.
46. La Cour en a déduit que l’application rétroactive de la loi du 4 mars 2002 avait fait perdre aux parents « une valeur patrimoniale préexistante et faisant partie de leurs biens, à savoir une créance en réparation établie dont ils pouvaient légitimement espérer voir déterminer le montant conformément à la jurisprudence fixée par les plus hautes juridictions nationales » (§ 82 de l’arrêt Draon et § 90 de l’arrêt Maurice).
47. S’agissant du cas de l’espèce, pour caractériser l’existence d’un bien au sens de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, il convient de tenir compte du droit interne en vigueur lors de l’ingérence dont se plaignent les requérants : il s’agissait du régime prétorien de responsabilité pour faute présenté ci-dessus. La Cour relève que ni le centre hospitalier, ni le Gouvernement ne contestent que l’erreur de diagnostic commise lors des échographies prénatales ait été constitutive d’une faute ayant causé un dommage. Le seul point en litige est la date du fait générateur de la créance. Le Gouvernement, reprenant la solution retenue par le Conseil d’État dans sa décision du 31 mars 2014, soutient que, faute d’avoir engagé une instance avant le 7 mars 2002, les requérants n’étaient pas titulaires à cette date d’un droit de créance indemnitaire, lui-même constitutif d’un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention.
48. La Cour ne saurait souscrire à cette thèse. Elle relève que les juridictions nationales ont établi sans ambiguïté, dans le cadre des décisions rendues, et à tous les stades de ces procédures, l’existence d’une faute ainsi que d’un lien de causalité directe entre la faute commise et le préjudice subi. Les juridictions ont en effet considéré qu’en l’espèce la faute du centre hospitalier a conduit les requérants à croire que l’enfant conçu n’était pas atteint d’anomalie et que la grossesse pouvait être normalement menée à son terme, alors que les requérants avaient clairement manifesté leur volonté d’éviter le risque d’un accident génétique. La faute ainsi commise a dissuadé la requérante de pratiquer tout examen complémentaire qu’elle aurait pu faire dans la perspective d’une interruption de grossesse pour motif thérapeutique. Pour effectuer ce constat, les juridictions se sont fondées d’abord sur la jurisprudence Quarez précitée, puis sur les dispositions de la loi du 4 mars 2002, qui n’ont d’ailleurs pas modifié les conditions d’établissement du lien de causalité entre la faute, même caractérisée, et le préjudice des parents de l’enfant né handicapé.
49. Les conditions d’engagement de la responsabilité du Centre hospitalier étaient donc bien réunies, et les requérants disposaient par conséquent d’une créance correspondant au droit à l’indemnisation des frais liés à la prise en charge d’un enfant né handicapé après une erreur de diagnostic prénatal s’analysant en une « valeur patrimoniale ». Quant à la date à laquelle cette créance aurait été constituée en droit interne sans l’application contestée des dispositions de l’article L. 114-5 du CASF, les jurisprudences administratives et judiciaires sont, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, concordantes : le droit à réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause, et ce indépendamment de la date d’introduction d’une demande en justice tendant à la réparation de ce dommage (voir paragraphe 19 ci-dessus). La Cour estime que, compte tenu des principes de droit commun français et de la jurisprudence constante en matière de responsabilité selon lesquels la créance en réparation prend naissance dès la survenance du dommage qui en constitue le fait générateur (voir le paragraphe 19 ci-dessus), les requérants pouvaient légitimement espérer pouvoir obtenir réparation de leur préjudice correspondant aux frais de prise en charge de leur enfant handicapé dès la survenance du dommage, à savoir la naissance de cet enfant. S’agissant de la date du fait générateur de la créance en réparation, qui est la question centrale relative à l’existence de l’espérance légitime contestée par le Gouvernement, cette affaire, comme les affaires Maurice et Draon, se distingue donc de l’affaire Pellegrin c. France citée par le Gouvernement, relative au droit successoral et dans laquelle il existait une controverse sur l’interprétation et l’application du droit interne.
50. Il s’ensuit que, de l’avis de la Cour, les requérants détenaient une créance qu’ils pouvaient légitimement espérer voir se concrétiser, conformément au droit commun de la responsabilité pour faute, s’agissant d’un dommage survenu antérieurement à l’intervention de la loi litigieuse. Ils étaient donc titulaires d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, lequel s’applique dès lors en l’espèce.
51. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
AU FOND
a) Sur l’existence d’une ingérence dans le droit au respect d’un « bien »
56. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 1 du Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteinte au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, parmi d’autres, Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, pp. 21-22, § 33).
57. En l’espèce, la Cour relève qu’il n’est pas contesté que l’application au litige porté par les requérants des dispositions de l’article L. 114-5 du CASF qui ont exclu par principe l’indemnisation des frais liés à la prise en charge du handicap de leur fils constitue une ingérence s’analysant en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. Il lui faut donc rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.
b) Sur la justification de l’ingérence
58. Les parties divergent sur la question de savoir si l’ingérence litigieuse a été « prévue par la loi », ainsi que l’exige l’article 1 du Protocole no 1.
59. La Cour relève d’abord que toute atteinte aux droits protégés par l’article 1 du Protocole no 1 doit en effet satisfaire l’exigence de légalité (Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 95, 25 octobre 2012, c. Lettonie [GC], et Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 112). Toutefois, l’existence d’une base légale en droit interne ne suffit pas, en tant que telle, à satisfaire au principe de légalité. Il faut, en plus, que cette base légale présente une certaine qualité, celle d’être compatible avec la prééminence du droit et d’offrir des garanties contre l’arbitraire. Les normes juridiques sur lesquelles se fonde une privation de propriété doivent ainsi être suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application (Lekic c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 95, 11 décembre 2018 ; Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 109, CEDH 2000-I [GC] ; Hentrich c. France, § 42 ; Lithgow et autres c. Royaume-Uni, § 110 ; Ališic et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 60642/08, § 103, CEDH 2014 ; Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 187 ; Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 163, CEDH 2006-VIII; Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], §§ 96-97). Des divergences dans la jurisprudence peuvent créer une insécurité juridique qui est incompatible avec les exigences de l’état de droit (Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 153, 19 décembre 2018).
60. En l’espèce, la Cour constate, en premier lieu, que, selon les termes de la décision no 2010-2 QPC du Conseil constitutionnel, le 2 du II de l’article 2 de la loi du 11 février 2005, soit l’ensemble du dispositif transitoire ayant prévu l’application rétroactive de l’article L. 114-5 du CASF, est abrogé. Ainsi que cela ressort du commentaire rédigé par les services du secrétariat général du Conseil constitutionnel (voir paragraphe 29), la suppression de cette disposition de droit transitoire laisse immédiatement place à l’application des règles de droit commun relatives à l’application de la loi dans le temps.
61. Il s’ensuit que, compte tenu de l’abrogation de la totalité du dispositif transitoire et en l’absence d’autre disposition législative le prévoyant expressément, l’article L. 114-5 du CASF ne saurait être appliqué à des faits nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, quelle que soit la date d’introduction de l’instance, en vertu des règles de droit commun relatives à l’application des lois dans le temps (voir paragraphes 20 et suivants ci-dessus),
62. La Cour relève, en second lieu, la divergence entre l’interprétation retenue, de manière prétorienne, par le Conseil d’État de la volonté du législateur et de la portée de l’abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel (Ass. 13 mai 2011 précitée) et celle retenue par la Cour de cassation (Cass. Civ., 15 décembre 2011 précitée). Dans ces conditions, elle n’est pas en mesure de considérer que la légalité de l’ingérence résultant de l’application, par la décision du Conseil d’État du 31 mars 2014, de l’article L. 114-5 du CASF, pouvait trouver un fondement dans une jurisprudence constante et stabilisée des juridictions internes. La Cour en déduit que l’atteinte rétroactive portée aux biens des requérants ne saurait être regardée comme ayant été « prévue par la loi » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
63. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention en ce qui concerne les deux premiers requérants.
Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie du 16 avril 2019 requête n°19965/06
Article 1 du Protocole 1 : L’application rétroactive d’une loi dans le cadre d’une affaire de protection de marque est contraire à la Convention
L’affaire concerne une procédure en protection de marque dans le cadre de laquelle la requérante avait été déboutée en raison de l’application rétroactive d’une loi par les juridictions internes. La Cour relève que la Cour constitutionnelle turque avait par la suite annulé la loi sur laquelle les juridictions internes s’étaient fondées pour rejeter le grief de la requérante, la jugeant contraire aux droits de propriété fondamentaux. En outre, la Cour ne voit aucun motif d’intérêt général permettant de justifier l’atteinte aux droits de propriété du requérant. Partant, elle conclut à une violation de la Convention.
LES FAITS
La requérante, Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S., est une société turque immatriculée à Ankara (Turquie). En 1999, une société affiliée à la requérante lança un nouveau journal, Özlenen Gazete Vatan, après en avoir enregistré le nom comme marque déposée. Elle dut cependant en cesser la publication au bout de deux mois, pour des raisons financières. Une autre société, Bagimsiz Gazetecilik Yayincilik A.S., commença en septembre 2002 à publier un journal intitulé Vatan. La société affiliée à la requérante saisit alors le tribunal de la propriété intellectuelle d’Istanbul en vue de protéger sa marque. Par la suite, la marque fut cédée à la requérante, qui devint alors partie à la procédure. La juridiction de première instance débouta la requérante en 2004, et la Cour de cassation confirma cette décision en appel en 2005. Les juridictions internes s’appuyèrent en particulier sur l’article 31 2) de la loi turque relative à l’Institut des brevets. Entrée en vigueur en novembre 2003 alors que la procédure était en cours, cette loi disposait que les autorités ne pouvaient pas se fonder sur le droit des marques, et plus précisément sur le décret-loi n o 556 relatif à la protection des marques, pour interdire la publication d’un périodique. Bagimsiz Gazetecilik engagea ensuite une procédure distincte et parvint en 2006 à obtenir l’annulation de la marque déposée de la requérante et le droit d’utiliser le nom en question.
ARTICLE 1 du protocole 1
La requérante estimait qu’elle avait été indûment privée de son droit à la marque du fait de l’application rétroactive, en sa défaveur, de la loi. Le Gouvernement soutenait qu’il n’y avait pas eu atteinte aux droits de la requérante. Il alléguait en particulier qu’un journal appelé Vatan avait déjà existé par le passé et qu’il s’agissait d’un nom connu. Il considérait donc que la requérante avait uniquement joui d’un droit conditionnel à l’égard de la marque. Il affirmait également qu’au moment où Bagimsiz Gazetecilik avait engagé sa propre action en annulation, cela faisait cinq ans que la requérante n’avait pas utilisé le nom en question. Concernant l’application rétroactive de la loi, le Gouvernement plaidait que les juridictions du pays devaient appliquer la législation en vigueur au moment où elles statuaient. La Cour considère que la requérante était titulaire d’un bien au sens de la Convention, puisqu’elle pouvait se prévaloir d’un droit reconnu par la loi et pas seulement d’une espérance légitime d’obtenir un droit de propriété. L’application de l’article 31 2) de la loi turque relative à l’Institut des brevets a induit une atteinte au bien de la requérante. Partant, la Cour a dû chercher à déterminer si cette atteinte était justifiée, et plus particulièrement si un intérêt public était en jeu. La Cour n’accorde aucun poids à l’argument du Gouvernement consistant à dire que la requérante n’avait pas utilisé la marque depuis cinq ans lorsque Bagimsiz Gazetecilik avait engagé sa propre action en annulation de marque. En fait, la requérante ne se plaignait pas de ce que sa marque avait été annulée pour non-utilisation pendant cinq ans, ce que le droit des brevets permettait, mais de ce que les juridictions internes n’avaient pas protégé son droit à la marque en question au cours de sa période de validité de cinq ans. Cette période n’avait pas encore expiré lorsque les juridictions internes ont appliqué l’article 31 2) de la loi relative à l’Institut des brevets, qui était alors en vigueur. De plus, la Cour de cassation s’est uniquement appuyée sur l’article 31 2), sans mentionner à aucun moment la période de cinq ans en question. La Cour relève que la Cour constitutionnelle a annulé cette disposition par la suite, au motif qu’elle vidait de son sens le droit des marques et violait des droits fondamentaux. Le Gouvernement n’a fourni aucun argument permettant de considérer que la loi en question poursuivait un but légitime. Il n’est pas parvenu non plus à apporter la preuve que l’application rétroactive de la loi dans le cadre de la procédure qui opposait les deux sociétés était justifiée par un motif d’intérêt général. Pour ces motifs, le Gouvernement n’a pas démontré que l’atteinte aux droits de propriété de la requérante visait un but d’utilité publique. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
LA LIMITATION DU DROIT D'USAGE D'UN BIEN
Marckx contre Belgique du 13 juin 1979 Hudoc 119 requête 6833/74
"§63: En reconnaissant le droit au respect de ses biens, l'article P1-1 garantit en substance le droit de propriété. Les mots "biens", "propriété", "usage des biens" en anglais "possessions" et "use of property", le donnent nettement à penser; de leur côté, les travaux préparatoires le confirment sans équivoque; les rédacteurs n'ont cessé de parler de "droit de propriété" pour désigner la matière des projets successifs d'où est sorti l'actuel article (P1-1). Or le droit de disposer de ses biens constitue un élément traditionnel fondamental du droit de propriété"
Cliquez sur un lien bleu pour accéder gratuitement à LA JURISPRUDENCE :
- interdiction de construire sur son terrain ou d'en faire usage
- saisie conservatoire d'un bien
- limitation de l'utilisation des biens culturels
- échelonnement de la dette d'État
INTERDICTION DE CONSTRUIRE SUR SON TERRAIN OU D'EN FAIRE USAGE
HASTAOĞLU c. TÜRKİYE du 7 octobre 2025 requête n° 29061/21
Art 1 P1 • Respect des biens • Impossibilité pour la requérante d’obtenir réparation des restrictions apportées à son droit d’user, de jouir et de disposer de plusieurs de ses terrains découlant de leur classement dans la bande littorale • Charge spéciale et exorbitante subie par la requérante
69. La requérante se plaint des restrictions affectant ses biens, de l’impossibilité pour elle de contraindre les autorités à exproprier lesdits biens en échange d’une indemnité et de la situation d’incertitude dans laquelle elle s’est trouvée quant au sort de ceux-ci.
70. Le Gouvernement conteste les thèses de la requérante.
71. Il estime que l’ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime. Il soutient en outre qu’elle a respecté le juste équilibre requis dans la mesure où la requérante disposait, selon lui, de la possibilité d’obtenir une indemnisation.
Appréciation de la Cour
a) La norme applicable
72. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, qui figure dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au respect des biens, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, entre autres, Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 60642/08, § 98, CEDH 2014).
73. Elle relève que si les titres de propriété de la requérante n’ont pas été formellement annulés, il résultait des restrictions litigieuses dénoncées par l’intéressée une importante réduction de la disponibilité des biens en cause. Elle rappelle en outre que lesdites restrictions reposaient sur des dispositions législatives et constitutionnelles en vertu desquelles les terrains en cause sont sous « le contrôle et à la disposition de l’État » et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée.
74. Elle estime par conséquent que l’ingérence doit être examinée sur le terrain de la norme générale (Scordino c. Italie (no 2), no 36815/97, § 73, 15 juillet 2004).
b) L’observation de l’article 1 du Protocole no 1
75. La Cour rappelle que pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, une atteinte au droit de propriété d’une personne doit respecter le principe de légalité et servir un intérêt public (ou général) légitime (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 112 et 113, 13 décembre 2016). Elle doit en outre maintenir un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir « une charge spéciale et exorbitante » (Alpaslan c. Türkiye, no 2832/21, § 60, 4 juin 2024).
76. En l’espèce, la Cour observe qu’il n’y a pas de controverse entre les parties au sujet des deux premières conditions. Il convient donc de déterminer si l’ingérence en cause a ménagé un juste équilibre entre les intérêts divergents qui étaient en jeu.
77. Elle relève, à titre liminaire, qu’un an après avoir statué sur le recours de la requérante, la Cour constitutionnelle a opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt rendu en assemblée plénière dans une affaire qui portait sur une question juridique similaire à celle que soulève l’affaire de l’intéressée (paragraphes 46 à 49 ci-dessus). Elle a conclu que l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une indemnisation du préjudice découlant des restrictions pesant sur son bien situé dans la bande littorale avait constitué une charge excessive et violé le droit de propriété de l’intéressé.
78. Relevant qu’en vertu de l’article 53 de la Convention, les autorités nationales demeurent libres d’aller au-delà du standard minimum de protection offert par la Convention, la Cour estime que le fait que la Cour constitutionnelle ait modifié sa jurisprudence pour renforcer la protection du droit de propriété ne signifie pas nécessairement que l’approche qu’elle avait adopté auparavant à l’égard de la requérante était contraire à la Convention.
79. La Cour a déjà examiné par le passé des affaires dans lesquelles les titres de propriété des requérants, qui concernaient des biens situés dans la bande littorale ou avaient un caractère forestier, avaient été annulés au motif que les biens en question ne pouvaient, en vertu du droit interne, faire l’objet d’une propriété privée. Elle a estimé que l’absence d’indemnisation avait rompu le juste équilibre exigé et conclu à la violation du droit au respect des biens des intéressés (voir N.A. et autres c. Turquie, précité, Taci et Eroğlu c. Turquie, no 18367/04, 10 mai 2007, et Turgut et autres c. Turquie, no 1411/03, 8 juillet 2008).
80. La Cour prend note de ce que le droit turc a évolué pour permettre l’indemnisation des propriétaires dans pareils cas (voir paragraphes 33 et 37 ci-dessus).
81. Néanmoins, en l’espèce, les titres de la requérante n’ont pas été annulés et le grief de l’intéressée consiste précisément à se plaindre d’un défaut d’annulation qui l’empêche d’obtenir une indemnité alors que la disponibilité de ses biens a été fortement réduite.
82. La question à trancher consiste dès lors à déterminer si les restrictions dans le droit au respect des biens de la requérante étaient d’une ampleur ou d’une intensité nécessitant le versement d’une indemnité pour que le juste équilibre entre les intérêts en jeu fût respecté.
83. Sur ce point, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la non-violation du droit au respect des biens dans des affaires où les biens des requérants étaient frappés d’inconstructibilité sans indemnisation en raison de leur classement en zone d’intérêt archéologique. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur la circonstance que les requérants n’avaient pas dû modifier l’usage de leur terrain à la suite du classement et qu’ils n’avaient pas manifesté avant le classement en question leur intention de construire, alors qu’ils auraient pu le faire (voir par exemple Longobardi et autres c. Italie (déc.), no 7670/03, 26 juin 2007, et Sinan Yıldız et autres c. Turquie, no 37959/04, 12 janvier 2010).
84. Elle a adopté une approche similaire dans une affaire française qui concernait le classement en zone naturelle et inconstructible d’un bien situé dans la bande littorale (Malfatto et Mieille c. France, nos 40886/06 et 51946/07, 6 octobre 2016).
85. En revanche, dans des affaires où les biens des requérants avaient fait l’objet d’une inconstructibilité en vue de leur expropriation future en vertu d’un plan d’urbanisme sur lequel ils avaient été réservés à un usage d’intérêt général (voir Scordino c. Italie (no 2), précité, et Hakan Arı c. Turquie, no 13331/07, 11 janvier 2011), la Cour a conclu à la violation du droit au respect des biens en raison d’une absence d’expropriation qui avait duré pendant une longue période et avait mis les requérants dans une situation d’incertitude complète quant au sort de leur propriété.
86. La Cour estime que le cas d’espèce se rapproche davantage des affaires relatives aux emplacements réservés dans le plan d’urbanisme que de celles relatives aux classements en zone naturelle ou en zone d’intérêt archéologique.
87. En effet, tout comme dans les affaires où l’absence d’expropriation d’un bien qui a vocation à l’être crée une incertitude prolongée pour le propriétaire, en l’espèce les titres de propriété de la requérante avaient vocation à être annulés au profit des autorités, ce qui la plaçait également dans une situation d’incertitude.
88. En outre, le classement des biens de la requérante dans la bande littorale n’avait pas pour seule conséquence de les rendre inconstructibles.
89. Il est vrai que les titres de propriété de la requérante n’ont pas été formellement annulés et transférés aux autorités. Néanmoins, compte tenu des dispositions constitutionnelles et législatives en vertu desquelles pareils biens sont « sous le contrôle et à la disposition de l’État », et ne peuvent in fine faire l’objet d’une propriété privée, le classement litigieux avait pour conséquence de priver la requérante des prérogatives habituellement attachés au droit de propriété. À cet égard, la Cour note qu’il ressort de l’arrêt Abdullah Tantaş de la Cour constitutionnelle qu’un tel classement prive le propriétaire du bien de la possibilité d’utiliser, de jouir et de disposer normalement de celui-ci (voir paragraphe 47 ci-dessus).
90. En conséquence, les biens litigieux sont devenus, en pratique, propriété de l’État, et les titres de la requérante n’avaient dès lors plus qu’une valeur purement formelle.
91. S’il ne fait aucun doute que le classement et les dispositions susmentionnées poursuivent un but d’intérêt général particulièrement important qui consiste à faire du littoral un bien public dans le but de le protéger et d’en faire bénéficier chacun de façon libre et égalitaire, il n’en demeure pas moins que la requérante n’a pas été indemnisée et que la totalité de la charge qui découle de la préservation de cet intérêt général a pesé exclusivement sur elle.
92. Le droit interne permet aux autorités de faire annuler les titres officiels de propriété privée portant sur des biens classés comme relevant de la bande littorale, et qui n’ont donc plus qu’une valeur formelle. En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, une telle annulation formelle s’accompagne d’un droit à indemnisation pour l’ancien propriétaire privé.
93. Cependant, le droit en question ne peut entrer en jeu qu’à partir du moment où le registre foncier a été modifié de façon à refléter la réalité de la situation du bien, c’est-à-dire lorsque le titre de propriété a été formellement annulé.
94. Or, une telle annulation relève de l’initiative de l’administration.
95. Ainsi, comme la Cour constitutionnelle l’a d’ailleurs souligné, en refusant d’entamer une action en annulation au motif que le droit interne ne l’y obligeait pas, l’administration a privé abusivement la requérante de la possibilité d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle subissait en raison des graves restrictions apportées à son droit d’user, de jouir et de disposer de ses biens.
96. La Cour relève en outre que l’action engagée par l’intéressée devant les juridictions administratives s’est révélée infructueuse, dans la mesure où celles-ci, au seul motif que l’ingérence découlait non pas d’un acte administratif mais de la loi, n’ont pas fait une application par analogie de la jurisprudence relative à la « prise de possession juridique » qu’elles avaient développée en matière d’emplacement réservé à la suite de l’arrêt Hakan Arı, précité, refusant ainsi d’examiner l’inertie de l’administration.
97. Par conséquent, la Cour estime, à l’instar de la Cour constitutionnelle, que la requérante a subi une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre voulu par l’article 1 du Protocole no 1.
98. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de cette disposition.
Pialopoulos et autres c. Grèce du 7 septembre 2017 requête 40758/09
Article 1 du Protocole 1 et article 13 : le Conseil d'État et le préfet annulent des expropriations pour cause de non paiement de l'indemnité. Toutefois les requérants qui récupèrent les terrains ne peuvent rien en faire. Les terrains sont gelés indéfiniment en attendant une nouvelle expropriation. Les requérants ne peuvent donc pas construire dessus. L'interdiction de fait, d'usage des biens pendant une longue période n'est pas conforme à la Convention.
CEDH
46. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (Kudla c. Pologne, [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
47. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (ibid.)
48. En l’espèce, la Cour note que les intéressés se sont vu imposer trois expropriations successives depuis 1988. Si les arrêts précités rendus par la Cour le 15 février 2001 et le 27 juin 2002 leur ont alloué une indemnité pour le préjudice subi du fait de la première de ces mesures, et si la troisième expropriation a été annulée par le Conseil d’Etat le 10 juillet 1995, la deuxième est demeurée en vigueur du 21 mai 1990 au 17 janvier 2005, date à laquelle le préfet l’a annulée pour défaut d’indemnisation.
49. Or les requérants n’ont pas été indemnisés pour cette expropriation. Si celle-ci a fini par être annulée, il n’en reste pas moins que le bien des intéressés a été immobilisé tant pendant la procédure devant le Conseil d’Etat, qui avait accordé un effet suspensif au recours de la municipalité, que dans l’attente d’une décision de la municipalité quant au sort à réserver à cette propriété.
50. De l’avis de la Cour, pareille pratique pourrait permettre à l’administration grecque de parvenir à confisquer arbitrairement les biens des requérants et ceux d’autres personnes. Celle-ci pourrait en pratique ordonner des expropriations sans indemnisation dans le but de laisser s’enliser une situation à son profit pendant plusieurs années quitte à payer de temps en temps, en cas de condamnation par les tribunaux, des indemnités pour perte de jouissance des biens expropriés.
51. Dans ces conditions, la Cour estime que la présente requête soulève des griefs défendables aux fins de l’article 13 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 pour autant que le grief tiré de ce dernier article concerne l’absence d’un recours effectif pour faire constater la pratique précitée, et que ceux-ci doivent être examinés.
52. En premier lieu, la Cour constate que l’article 17 § 4 de la Constitution énonce qu’une privation de propriété pour cause d’utilité publique dûment prouvée doit dans tous les cas donner lieu au versement d’une indemnité payable au plus tard un an et demi après la date de publication de la décision du tribunal fixant provisoirement le montant de l’indemnité et que, lorsque la demande porte sur la fixation de l’indemnité définitive, le versement doit en être effectué après la publication de la décision du tribunal, faute de quoi l’expropriation est caduque de plein droit.
53. Toutefois, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat (paragraphe 25 ci-dessus) réaffirmée dans l’arrêt qu’elle a rendu dans la présente affaire (paragraphe 16 ci-dessus), l’annulation d’une expropriation pour défaut de paiement de l’indemnité, qu’elle soit prononcée par voie administrative – comme dans la présente affaire – ou par voie judiciaire, ne suffit pas à elle seule à libérer un terrain des charges le rendant inconstructible. Dans l’arrêt qu’il a rendu le 28 janvier 2009, le Conseil d’Etat a indiqué que la question du statut juridique du bien litigieux n’était « pas réglée sur le plan urbanistique » après l’annulation de l’expropriation et qu’il incombait à l’administration de rechercher si le terrain devait faire l’objet d’une nouvelle expropriation, rester inconstructible ou être déclaré constructible en tenant compte des caractéristiques de celui-ci, des besoins de la collectivité en matière d’aménagement du territoire et de la politique d’urbanisme applicable au secteur dans lequel le terrain était situé.
54. Or la Cour relève que cette situation correspond à celle qui se présente en l’espèce. Le Conseil d’Etat a annulé la décision du préfet portant annulation de l’expropriation prononcée le 21 mai 1990 et a renvoyé l’affaire à l’administration pour que celle-ci règle le statut du terrain sur le plan urbanistique. L’administration a invité la municipalité de Neo Psichiko à lui faire savoir si elle entendait procéder à une nouvelle expropriation.
55. La Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle le terrain des requérants était constructible mais réservé à la construction d’immeubles d’habitation et non de centres commerciaux. En réalité, la question du statut juridique du terrain était restée longtemps en suspens. Elle n’était « pas réglée sur le plan urbanistique » (voir l’arrêt du Conseil d’Etat no 289/2009 – paragraphe 16 ci-dessus) car était restée suspendue à une nouvelle appréciation de l’administration, en la personne non plus du préfet, mais du Président de la République, ce qui supposait que le ministère de l’Environnement mette en œuvre la procédure requise en vue de l’édiction d’un décret présidentiel.
56. De ce fait, les requérants se trouvaient pendant une longue période dans une impasse juridique qui ne leur offrait aucune possibilité de provoquer eux-mêmes la levée de la charge grevant leur terrain. Dans ces circonstances, les autorités auraient pu de facto faire indéfiniment obstacle à l’usage du terrain exproprié ou procéder à une nouvelle expropriation sans pour autant verser l’indemnité due aux intéressés (Valyrakis c. Grèce, no 27939/08, § 53).
57. La Cour souligne à cet égard que le grief des requérants tiré de l’article 13 avait trait à l’impossibilité pratique d’exploiter la propriété litigieuse suite à la constatation de la levée de l’expropriation faute d’indemnisation, et non à l’impossibilité d’obtenir un dédommagement pour privation de la jouissance de leur bien.
58. Au vu de ce qui précède et eu égard aux circonstances de l’espèce, force est à la Cour de constater que l’État a manqué à ses obligations découlant de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a lieu de déclarer recevable ce grief et de conclure à la violation de ces deux dispositions combinées.
KUTLU ET AUTRES c. TURQUIE requête 51861/11 du 13 décembre 2016
Article 1 du protocole 1, les requérants ont subi la construction d'un barrage. Leurs situés à coté n'ont pas été exproprié mais ils n'y ont plus accès sauf en barque sans moteur. Ils ont une interdiction absolue de construire ou d'exploiter. L'un des requérants a demandé à être exproprié. Les autorités judiciaires ont refusé sa demande sans motivation explicite pour justifier leur refus. Le droit d'usage n'a pas été respecté.
49. La notion de « biens » évoquée dans la première partie de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des « droits de propriété » et donc des « biens » aux fins de cette disposition. En fait, il importe d’examiner dans chaque cas si les circonstances de l’affaire, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 1999-II, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-I, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 129, CEDH 2004-V, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 63, CEDH 2007-I).
50. De plus, la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens existants » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit patrimonial (voir, dans ce sens, Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35 c), CEDH 2004-IX, et Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, § 74 c), CEDH 2005-V).
51. En outre, lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne (Kopecký c. Slovaquie, précité, § 52 et Draon c. France [GC], no 1513/03, § 68, 6 octobre 2005.
52. Par ailleurs, pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens doit être légale et être dépourvue d’arbitraire. Elle doit également ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Perdigão c. Portugal [GC], no 24768/06, § 63, 16 novembre 2010).
a) Quant aux terrains no 84/72 et no 84/76
53. La Cour observe que l’usage des terrains no 84/72 et no 84/76 est affecté de restrictions physiques et juridiques extrêmement rigoureuses : l’accès aux terrains nécessite l’usage d’une embarcation non motorisée, aucune construction n’y est possible et l’agriculture y est prohibée.
54. Les requérants indiquent qu’ils ont été indemnisés à hauteur du préjudice qu’ils auraient subi alors que, en vertu du droit national, ils auraient dû, selon eux, être expropriés et percevoir une indemnité équivalant à la valeur totale des biens en cause.
55. La question que la Cour est appelée à trancher en l’espèce n’est pas celle de savoir si le montant de l’indemnité payée aux requérants suffisait à compenser le préjudice découlant des restrictions imposées à l’usage de leurs biens, pas plus qu’elle n’est de déterminer si l’article 1 du Protocole no 1 garantit d’une manière générale le droit d’un requérant à être exproprié. La tâche de la Cour est plutôt de déterminer si la législation nationale instaurait au profit des requérants un droit de délaissement avec une certitude suffisante pour pouvoir constituer un intérêt patrimonial protégé par la Convention.
56. La Cour observe que l’article 12, alinéa 9, de la loi no 2942 impose l’expropriation lorsque le terrain situé dans le voisinage d’un barrage n’est « plus utilisable ». Si le texte ne précise pas lui-même ce qu’il faut entendre par ces termes, il renvoie cependant à un règlement.
57. Ledit règlement énonce, quant à lui, de manière non équivoque en son article 17 que les terrains situés dans la zone de protection absolue entourant une réserve d’eau potable « sont expropriés ». Compte tenu de l’utilisation du verbe « être » et non du verbe « pouvoir », ce texte n’accorde aucune marge d’appréciation discrétionnaire à l’administration qui ne dispose pas de la liberté de choisir entre l’expropriation et le versement d’une indemnité moindre. Au contraire, la réglementation place les autorités sous l’égide d’une compétence liée en obligeant celles-ci à acquérir les biens et accorde ainsi aux propriétaires des terrains situés dans la zone de protection absolue un véritable droit de délaissement, c’est-à-dire un « droit à être exproprié ».
58. Aux yeux de la Cour, ce droit au délaissement prévu par la réglementation interne constitue un « intérêt patrimonial » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. En d’autres termes, le droit à être exproprié et à obtenir le versement d’indemnités correspondant à la valeur des terrains constitue, un « bien » aux fins de la disposition susmentionnée (comparer avec Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, §§ 122 à 125 et 129 à 133, CEDH 2004-V, qui concerne le refus d’exécuter un droit à une mesure compensatoire – qualifié de droit à être crédité – reconnu par le droit national).
59. En refusant d’exproprier les terrains concernés et en optant pour le versement d’une indemnité en compensation du préjudice lié aux restrictions imposées à l’usage des biens, les autorités ont porté atteinte à cet intérêt patrimonial conféré par le droit interne et protégé par la Convention.
60. Une telle atteinte ne peut passer pour conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 étant donné non seulement qu’elle ne repose sur aucune base légale mais encore qu’elle ne bénéficie d’aucune justification sérieuse. En effet, les autorités judiciaires ont insuffisamment motivé leur choix d’ordonner le versement d’une indemnité correspondant à la dépréciation de la valeur du bien plutôt que de mettre en œuvre le droit de délaissement des requérants en prononçant l’expropriation et en octroyant une indemnité correspondant à la valeur des biens. À cet égard, force est de constater que les tribunaux nationaux ne se sont pas prononcés sur l’article 17 du règlement susmentionné. Le Gouvernement n’a, lui non plus, avancé aucun motif sérieux justifiant cette ingérence.
61. Partant, il y a eu violation de cette disposition en ce qui concerne les terrains immatriculés au registre foncier comme « lot 84 parcelle 72 » et « lot 84 parcelle 76 ».
b) Quant au terrain no 81/44
62. La Cour observe que le terrain no 81/44, qui est situé dans la zone de protection rapprochée, fait lui aussi l’objet d’un certain nombre de restrictions visant à protéger la qualité de l’eau du barrage. Ainsi, toute construction sur ce terrain est prohibée. Par ailleurs, les activités agricoles n’y sont autorisées que sur agrément du ministère compétent et sous réserve qu’aucun engrais artificiel ou autre produit chimique ne soit utilisé.
63. Les autorités ont versé aux intéressés des indemnités pour compenser le préjudice découlant de ces restrictions.
64. Les requérants mettent en cause, comme pour les deux autres biens, la décision de les indemniser à hauteur du préjudice plutôt que de les exproprier.
65. La Cour relève que la situation de ce bien, qui se trouve dans la zone de protection rapprochée, diffère de celle des deux autres terrains.
66. En effet, la réglementation nationale n’établissait pas, s’agissant de ce terrain, de « droit à être exproprié ».
67. L’article 12 de la loi no 2942 lie l’obligation d’exproprier les biens situés dans le voisinage d’un barrage à la condition que ceux-ci ne soient « plus utilisables ». Or les juridictions nationales n’ont jamais considéré que le bien litigieux était devenu inutilisable au sens de cette disposition. On ne saurait dès lors affirmer qu’en l’espèce les requérants tenaient de cet article un droit à être expropriés.
68. Quant au règlement, il n’énonce pas que les restrictions affectant les biens situés dans une zone de protection rapprochée rendent par principe ces biens inutilisables et ne prévoit pas autrement d’obligation d’exproprier.
69. Par conséquent, en l’absence de « droit à être exproprié » reconnu par le droit interne et susceptible de constituer un intérêt patrimonial protégé par la Convention et donc un « bien », le versement d’une indemnité correspondant au préjudice découlant des restrictions réglementaires était de nature à établir un juste équilibre entre les droits des requérants et ceux de la société.
70. Cela étant, le versement d’une indemnité ne peut maintenir un tel équilibre que s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre son montant et le préjudice qu’il vise à compenser.
71. À cet égard, la Cour observe que l’expert mandaté par le TGI avait estimé à 40 % la dépréciation de la valeur du terrain causée par les restrictions affectant son usage. Or le juge a fixé les indemnités à 25 % de la valeur du bien.
72. Il est vrai que le rapport d’expertise ne liait pas le TGI, qui pouvait allouer une indemnité inférieure à celle déterminée par l’expert. Cependant pour faire cela dans le respect de l’article 1 du Protocole no 1, il lui revenait d’exposer les raisons pour lesquelles il écartait les conclusions de l’expertise et les motifs précis pour lesquels il convenait de diminuer le pourcentage de la dépréciation. À cet égard, la Cour estime qu’un simple énoncé des critères à prendre en compte ne peut passer pour une motivation suffisante dès lors que le juge n’a pas indiqué pourquoi et comment la prise en compte desdits critères devait conduire à limiter la dépréciation à 25 %.
73. Malgré la compétence limitée dont elle dispose pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions nationales, la Cour estime que la manière dont le montant des indemnités a été fixé ne lui permet pas d’affirmer que celui-ci est raisonnablement en rapport avec le préjudice subi.
74. Sur ce point, la Cour rappelle que les garanties procédurales de l’article 1 du Protocole no 1 impliquent qu’une absence d’obligation pour les tribunaux d’exposer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils fondent leurs décisions rendrait théoriques et illusoires les droits garantis par la Convention. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose, tout de même, que la partie lésée puisse s’attendre à un traitement attentif et soigné de ses prétentions essentielles (Gereksar et autres c. Turquie, nos 34764/05, 34786/05, 34800/05 et 34811/05, § 54, 1erfévrier 2011, et les références qui y figurent).
75. Par conséquent, rien ne permet de conclure que le juste équilibre devant régner entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits des requérants ait été maintenu.
76. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en ce qui concerne le terrain immatriculé au registre foncier comme « lot 81 parcelle 44 ».
MALFATTO ET MIEILLE c. FRANCE du 6 octobre 2016, requêtes nos 40886/06 et 51946/07
Non violation de l'article 1 du Protocole 1, la construction sur la bande de 100 mètres de la plage est interdite pour des causes d'intérêt général évident après les tempêtes de type Xynthia. Cette interdiction ne viole pas la Convention alors que le requérant a eu bel de construire durant 15 ans.
58. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 1 du Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (voir, notamment, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 37, série A no 98) : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Les deuxième et troisième normes, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 134, CEDH 2004-V).
59. La Cour relève que les terrains des requérants, classés comme constructibles, avaient fait l’objet d’une autorisation de lotir, et qu’en vertu de l’adoption de deux textes successifs (la directive d’aménagement national du 25 août 1979 et la « loi littoral » du 3 janvier 1986), ils ont été frappés d’une interdiction absolue de construire en raison de ce qu’ils étaient situés dans la bande de cent mètres du littoral.
60. Le Gouvernement reconnaît qu’il s’agit d’une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. La Cour observe que ces derniers n’ont pas été privés de leur propriété et que leurs droits réels sur leurs biens restent intacts, même si leur valeur a été affectée. Elle considère en conséquence que cette ingérence relève de la réglementation de l’usage des biens, au sens du deuxième alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Sporrong et Lönnroth, précité, § 64, Longobardi et autres c. Italie (déc.), no 7670/03, 26 juin 2007, Depalle, précité, § 80 et Antunes Rodrigues c. Portugal, no 18070/08, § 27, 26 avril 2011).
61. Selon une jurisprudence bien établie, cet alinéa doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article 1. En conséquence, une mesure d’ingérence doit respecter le principe de légalité et ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (Depalle, précité, § 83 et Perdigão c. Portugal [GC], no 24768/06, § 67, 16 novembre 2010).
62. En l’espèce, les requérants ne contestent pas la légalité de l’ingérence. La Cour doit donc déterminer si le « juste équilibre » a été respecté.
63. S’agissant en premier lieu de la finalité de l’ingérence, la Cour constate qu’elle relevait d’une politique générale d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement et rappelle avoir dit en particulier que la protection du rivage de la mer constitue un but légitime dans l’intérêt général (Depalle, précité, § 81).
64. La Cour a par ailleurs souvent rappelé que les politiques d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, où l’intérêt général de la communauté occupe une place prééminente, laissent à l’État une marge d’appréciation plus grande que lorsque sont en jeu des droits exclusivement civils. Dans la mise en œuvre de ces politiques, l’État peut notamment être amené à intervenir dans le domaine public et même à prévoir, dans certaines circonstances, l’absence d’indemnisation dans plusieurs situations relevant de la réglementation de l’usage des biens (Antunes Rodrigues, précité, § 32 et la jurisprudence citée). En effet, dans de telles situations, l’absence d’indemnisation est l’un des facteurs à prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté, mais elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Depalle, précité, § 91).
65. La Cour observe que, tel qu’il a été interprété par le Conseil d’État, l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme permet au propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude de prétendre à une indemnisation devant la juridiction administrative « dans le cas exceptionnel où il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi » (paragraphe 37 ci-dessus).
66. La Cour estime qu’il s’agit là d’un système qui permet de mettre en balance les intérêts de l’intéressé et ceux de la communauté (Antunes Rodrigues, précité, § 35).
67. En l’espèce, les juridictions françaises ont estimé, après avoir entendu contradictoirement les arguments des parties et examiné tous les éléments pertinents, que le préjudice subi par les requérants n’ouvrait pas droit à indemnisation. La Cour ne décèle aucun élément permettant de conclure que leurs décisions seraient entachées d’arbitraire ou manifestement déraisonnables (Antunes Rodrigues, précité, § 36), compte tenu notamment de ce que la servitude d’inconstructibilité s’applique à la totalité du littoral français.
68. La Cour relève en particulier que la cour administrative d’appel a estimé que M. Henri Malfatto n’établissait pas un lien de causalité direct entre la servitude et son préjudice : elle a noté que s’il avait effectué, entre 1965 et 1972 des travaux préparatoires et de viabilisation du lotissement, il n’avait engagé, entre 1972 et 1989, date à laquelle il s’était vu opposer un refus de permis de construire (soit pendant quinze ans), aucune action tendant à la mise en œuvre des droits qu’il détenait de l’autorisation de lotir dont il bénéficiait depuis 1964.
69. Dès lors, la Cour observe que M. Henri Malfatto s’est abstenu pendant de nombreuses années d’exploiter son bien (mutatis mutandis décision Longobardi et autres précitée et Sinan Yildiz et autres c. Turquie, no 37959/04, 12 janvier 2010). Elle relève d’ailleurs que, pendant cette période, le seul lot qui a été vendu en 1972 à un tiers a pu être construit (paragraphe 12 ci-dessus).
70. S’agissant des autres requérants, la Cour estime également raisonnable la conclusion des juridictions internes qui ont considéré qu’ils n’avaient pas personnellement supporté le coût des travaux et rappelé qu’une autorisation de lotir n’impliquait pas automatiquement le droit de construire. La Cour estime que la baisse de la valeur des terrains en cause ne saurait suffire, en tant que telle et en l’absence d’autres éléments, à mettre en cause ces conclusions.
71. Au vu de l’ensemble des considérations ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas eu rupture de l’équilibre entre les droits des requérants et l’intérêt général de la communauté.
72. Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
MAHMUT SEZER c. TURQUIE du 23 septembre 2014 Requête 43545/09
Violation de l'article 1 du protocole 1 : le requérant achète un terrain pour construire. Classé en zone verte, il ne peut pas construire. Il n'a donc pas usage de son bien.
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, reprochant au requérant de ne pas s’être opposé au plan local d’urbanisme litigieux et de ne pas en avoir demandé l’annulation. Il soutient que l’intéressé aurait également dû saisir les tribunaux administratifs d’une action en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative.
18. S’agissant en premier lieu de la procédure visant à l’annulation d’un plan d’urbanisme déterminé, la Cour estime qu’elle ne pouvait avoir une incidence sur la présente requête, étant donné que le requérant se plaint des répercussions des limitations ayant frappé son terrain en l’absence d’indemnisation et non de l’irrégularité du plan d’urbanisme en question (Ziya Çevik c. Turquie, no 19145/08, § 27, 21 juin 2011, Hakan Ari c. Turquie, no 13331/07, § 28, 11 janvier 2011, Rossitto c. Italie, no 7977/03, § 19, 26 mai 2009, et Scordino c. Italie (no 2) (déc.), no 36815/97, 12 décembre 2002).
19. S’agissant en deuxième lieu de l’action en dommages et intérêts devant les tribunaux administratifs, la Cour considère que le requérant peut passer pour avoir épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il a saisi les juridictions nationales d’une demande tendant à faire annuler le refus de l’administration à sa demande alternative de permis de construire ou d’expropriation. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle applique la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte et avec une certaine souplesse, sans formalisme excessif. Elle réaffirme que, lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Kozacioglu c. Turquie [GC], no 2334/03, §§ 39-43, CEDH 2009, et Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29801/03, § 84, CEDH 2008). Dès lors, elle estime, eu égard aux circonstances de la cause, qu’il serait excessif de reprocher au requérant de n’avoir pas introduit devant les tribunaux administratifs le recours mentionné par le Gouvernement. Autrement dit, la Cour considère que le requérant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (Ilhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 59, CEDH 2000-VII). Au demeurant, elle observe que le Gouvernement n’a pas démontré que la voie de recours visée par lui était disponible et adéquate dans la pratique relative à la violation incriminée. La Cour n’est pas convaincue que le recours fondé sur l’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative était accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès.
20. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement.
21. Elle constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le requérant soutient que la situation dénoncée a emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il allègue subir une ingérence dans l’exercice du droit au respect de ses biens depuis 1982, date à laquelle l’administration a décidé de classer son terrain d’« espace vert ». Pendant toute cette période, son terrain doté du statut de terrain constructible aurait été frappé d’une restriction d’usage consistant en une interdiction de construire, jusqu’à ce que l’administration procédât, à une date indéterminée, à son expropriation. Le requérant se plaint de cette situation d’incertitude. Il reproche aux autorités leur inertie et soutient avoir perdu de la sorte la pleine jouissance du terrain. Compte tenu de la situation dénoncée, il estime qu’il y a eu une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens.
23. Le Gouvernement réitère ses exceptions préliminaires. Il ajoute que la restriction dénoncée a été réalisée pour cause d’utilité publique et que celle-ci n’a pas imposée au requérant une charge excessive.
24. La Cour considère qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens.
25. Elle note en effet que, depuis 1982, le terrain de l’intéressé est classé « espace vert » dans le plan d’urbanisme alors qu’il a le statut de terrain constructible sur le registre foncier.
26. Cette situation a eu pour conséquence non seulement que le terrain a été frappé d’une interdiction de construire mais aussi qu’il y a eu une restriction de la disponibilité du bien en cause.
27. L’administration n’a pas exproprié pour autant le requérant de son terrain.
28. Reste à savoir si cette ingérence a enfreint ou non les dispositions de l’article 1 du Protocole no 1.
29. La Cour observe qu’il n’y a pas eu de privation formelle de propriété puisque le droit de propriété du requérant est resté juridiquement intact. Cependant, elle rappelle que, en l’absence d’un transfert de propriété, elle doit aussi regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de la situation litigieuse (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 63, série A no 52, et Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 38, série A no 50).
30. À cet égard, elle relève que les effets de la situation litigieuse dénoncés par le requérant découlent tous des limitations apportées au droit de propriété et des conséquences de celles-ci sur la valeur de l’immeuble ; ils résultent donc tous de la restriction exercée sur la faculté de l’intéressé de disposer de son bien. Cela étant, la Cour note que, bien qu’il ait perdu de sa substance, le droit en cause n’a pas disparu. Les effets des mesures en question ne sont pas tels qu’on puisse les assimiler à une privation de propriété. Le requérant n’a perdu ni l’accès à son terrain ni la maîtrise de celui-ci et, en principe, la possibilité de vendre son bien, bien que rendue plus malaisée, a subsisté. Dans ces conditions, la Cour estime que la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce (Scordino c. Italie (no 2), no 36815/97, § 71, 15 juillet 2004, et Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal, 16 septembre 1996, § 85, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).
31. En revanche, elle considère que la situation dénoncée par le requérant relève de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1. (Sporrong et Lönnroth, précité, § 65, Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 74, série A no 117, Poiss c. Autriche, 23 avril 1987, § 64, série A no 117, Elia S.r.l. c. Italie, no 37710/97, § 57, CEDH 2001-IX, Scordino (no 2), précité, § 73, Köktepe c. Turquie, no 35785/03, § 85, 22 juillet 2008, Hakan Ari, précité, § 37, Ziya Çevik, précité, § 36, et Hüseyin Kaplan c. Turquie, no 24508/09, § 39, 1 octobre 2013).
32. La Cour doit donc rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant (Sporrong et Lönnroth, précité, § 69, et Phocas c. France, 23 avril 1996, § 53, Recueil 1996-II).
33. Sur ce point, la Cour considère que dans la mesure où le terrain du requérant était constructible sur le registre foncier, le requérant était légitimement en droit d’attendre l’obtention d’un permis de construire. Or le terrain a par la suite été soumis à une interdiction de construire en vue de son expropriation, et ce en vertu du plan d’urbanisme ayant affecté ce terrain à l’aménagement d’un « espace vert ». Cette interdiction a été maintenue de manière continue.
34. La Cour rappelle avoir jugé que, dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement du territoire, les États contractants jouissaient d’une large marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique (Sporrong et Lönnroth, précité, § 69). Dans les circonstances de la cause, elle tient pour établi que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens répondait aux exigences de l’intérêt général. Néanmoins, elle ne saurait renoncer pour autant à exercer son pouvoir de contrôle.
35. Elle observe que, durant toute la période concernée, le requérant est resté dans une incertitude complète quant au sort de sa propriété. À la date du 25 mai 2011, l’intéressé n’était toujours pas exproprié de son bien.
36. La Cour estime que cet état des choses a entravé la pleine jouissance du droit de propriété du requérant, lequel ne peut ni construire sur un terrain doté du statut de terrain constructible. Cette situation a, de plus, eu des répercussions dommageables en ce qu’elle a, entre autres, considérablement affaibli les chances de l’intéressé de vendre son terrain.
37. Enfin, la Cour constate que le requérant n’a vu sa perte compensée par aucune indemnisation. À cet égard, comme il a été précédemment souligné (voir paragraphe 19 ci-dessus), le Gouvernement n’a fait parvenir à la Cour aucune décision de justice démontrant que le droit interne eût été en mesure de remédier à l’incertitude attachée au sort du terrain de l’intéressé. Autrement dit, à la date d’introduction de la requête devant la Cour, quand un plan d’urbanisme était adopté et qu’il n’était pas exécuté, le droit turc ne prévoyait aucun recours en indemnisation pour les administrés lésés (voir dans le même sens, Ziya Çevik, précité, § 42).
38. À la lumière de ces considérations, elle estime que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect de ses biens (Hüseyin Kaplan, précité, § 47, Hakan Ari, précité, § 46, Ziya Çevik, précité, § 47, Sporrong et Lönnroth, précité, §§ 73 et 74, Erkner et Hofauer, précité, §§ 78 et 79, Elia, précité, § 83, Rossitto, précité, § 45, Skibinscy c. Pologne, no 52589/99, § 98, 14 novembre 2006, Skrzynski c. Pologne, no 38672/02, § 92, 6 septembre 2007, Rosinski c. Pologne, no 17373/02, § 89, 17 juillet 2007, Buczkiewicz c. Pologne, no 10446/03, § 77, 26 février 2008, et Pietrzak c. Pologne, no 38185/02, § 115, 8 janvier 2008).
39. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
LA SAISIE CONSERVATOIRE D'UN BIEN
Uzan et autres c. Turquie du 5 mars 2019 requêtes n° 19620/05, 41487/05, 17613/08 et 19316/08
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme (à la majorité) dans le chef de Jasmin Paris Uzan et Renç Emre Uzan et (à l’unanimité) dans le chef de Ayla Uzan-Ashaboglu, Nimet Hülya Talu et Bilge Dogru. Mesures conservatoires ordonnées sur les biens de trois proches des dirigeants d’Imarbank et de deux de leurs employés : violation du droit de propriété.
La Cour juge en particulier que les autorités turques n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et les exigences de la protection des droits des requérants au respect de leurs biens. Dans son raisonnement, la Cour relève entre autres que la durée de validité des restrictions en cause a duré près de 10 ans pour une requérante et plus de 12 ou 15 ans pour les autres requérants. Elle constate aussi le caractère automatique, généralisé et inflexible de ces mesures, ainsi que leur étendue (deux requérants, mineurs à l’époque des faits, ont été privés de la possibilité d’acquérir toutes sortes de biens ; les autres requérantes ont été empêchées de disposer de leur salaire, de leur véhicule etc.). Elle relève enfin l’absence d’éléments portant sur l’implication des requérants sur une quelconque fraude. La Cour rappelle qu’une ingérence dans les droits prévus par l’article 1 du Protocole n o 1 ne peut avoir de légitimité en l’absence d’un débat contradictoire et respectueux du principe de l’égalité des armes.
À cet égard, elle constate que les requérants, qui n’étaient pas parties à la procédure pénale principale, n’ont pas bénéficié de ces garanties procédurales.
CEDH
a) Sur l’existence d’un bien et sur la nature de l’ingérence
189. En premier lieu, en ce qui concerne l’existence d’un bien, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, en mettant en vigueur les lois qu’ils estiment nécessaires à cette fin. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, parmi beaucoup d’autres, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 37, série A no 98, et Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], no 40167/06, § 217, CEDH 2015).
190. La Cour rappelle également que la notion de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits de propriété » et donc des « biens » aux fins de cette disposition (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 1999-II, et Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-I, Parrillo c. Italie [GC], no 46470/11, § 211, CEDH 2015).
191. La Cour réaffirme en outre que, bien que l’article 1 du Protocole no 1 ne vaille que pour des « biens actuels » et ne crée aucun droit d’en acquérir (Stummer c. Autriche [GC], no 37452/02, § 82, CEDH 2011), dans certaines circonstances des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété, peuvent également bénéficier de la protection de cette disposition (voir, parmi beaucoup d’autres, Fabris c. France [GC], no 16574/08, § 50, CEDH 2013 (extraits), et Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 142-143, 20 mars 2018).
192. À ce sujet, elle redit qu’une espérance légitime doit être plus concrète qu’un simple espoir et se fonder sur une disposition juridique ou un acte juridique tel qu’une décision judiciaire. L’espoir de voir renaître un droit patrimonial éteint depuis longtemps ne peut être considéré comme un « bien », pas plus qu’une créance conditionnelle devenue caduque par la non-réalisation d’une condition (Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, §§ 69 et 73, CEDH 2002-VII).De plus, on ne peut conclure à l’existence d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 50, CEDH 2004-IX). En revanche, un intérêt patrimonial reconnu par le droit interne – même s’il est révocable dans certaines circonstances – peut s’analyser en un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Beyeler, précité, § 105).
193. En l’espèce, pour ce qui est des requérantes Ayla Uzan-Ashaboglu, Nimet Hülya Talu et Bilge Dogru, compte tenu des faits et décisions de justice exposés ci-dessus, la Cour considère, à la différence du Gouvernement, qui s’est exprimé sur ce point de manière générale sans rentrer dans les détails, que les salaires, les avoirs et les biens mobiliers et immobiliers sur lesquels les tribunaux internes ont ordonné des mesures conservatoires s’analysent en des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Pour ce qui est des requérants Jasmin Paris Uzan et Renç Emre Uzan , à l’instar des juridictions internes et du Gouvernement, la Cour observe, d’une part, que ces deux requérants, qui étaient mineurs à l’époque des faits, n’avaient pas de biens actuels au sens de l’article 1 du Protocole 1 à la Convention et, d’autre part, qu’ils avaient l’espérance légitime d’en avoir pour le reste de leur vie. Eu égard au constat des juridictions internes selon lequel ils jouissaient de l’aptitude à avoir des droits et des obligations et qu’ils pourraient acquérir certains droits par le biais de l’héritage et des donations (paragraphe 33 ci-dessus), repris par le Gouvernement (paragraphe 185 ci-dessus), et eu égard au caractère automatique, généralisé et inflexible des mesures conservatoires et à leur durée incertaine, la Cour conclut que, bien que mineurs, les requérants susmentionnés pouvaient nourrir une « espérance légitime » relevant de la notion de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
194. En deuxième lieu, en ce qui concerne la nature de l’ingérence, la Cour rappelle que la rétention des biens saisis par les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale doit être examinée sous l’angle du droit pour l’État de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 54, CEDH 2007-VII, Borjonov c. Russie, no 18274/04, § 57, 22 janvier 2009, et Adamczyk c. Pologne (déc.), no 28551/04, 7 novembre 2006). Elle constate qu’en l’espèce les mesures conservatoires prises contre les requérants avaient en principe pour but non pas de priver ces derniers de leurs biens, mais seulement de les empêcher temporairement d’en user, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ainsi que du recouvrement des sommes réclamées par le FADE.
La Cour note également que selon Mme Ayla Uzan les autorités compétentes auraient mis en vente aux enchères ses biens, mais estime qu’une éventuelle privation de propriété dans ce contexte ne change à rien à la nature de l’ingérence qui doit toujours être examinée sous l’angle du droit pour l’État de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (Frizen c. Russie, no 58254/00, § 31, 24 mars 2005, Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie, no 75909/01, § 129, 20 janvier 2009, et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie (fond) [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 290, 28 juin 2018).
195. La Cour doit à présent rechercher si l’ingérence se justifie sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. À cet égard, il convient de redire que, pour être compatible avec cette disposition, une ingérence doit remplir trois conditions : elle doit « mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens », être conforme « à l’intérêt général » et respecter un juste équilibre entre les droits du propriétaire et les intérêts de la communauté.
b) Sur le respect du principe de légalité
196. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est une notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, §§ 94 et 95, 25 octobre 2012). Il en découle que la nécessité d’examiner la question du juste équilibre « ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n’était pas arbitraire » (Guiso-Gallisay c. Italie, no 58858/00, § 80, 8 décembre 2005, avec les références qui y sont citées).
197. La Cour rappelle aussi que le principe de la légalité présuppose également l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application (Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 79, CEDH CEDH 2000-XII, Beyeler, précité, §§ 109 et 110, et Fener Rum Patrikligi c. Turquie, no 14340/05, § 70, 8 juillet 2008). Quant à la portée de la notion de « prévisibilité », elle dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine que celui-ci couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (voir, mutatis mutandis, Sud Fondi srl et autres c. Italie, no 75909/01, § 109, 20 janvier 2009, et Yasar Holding A.S., précité, § 92, 4 avril 2017).
198. En l’espèce, la Cour relève que les mesures conservatoires ont été ordonnées et maintenues sur le fondement de l’article 2 provisoire de la loi no 4969 du 31 juillet 2003, de l’article additionnel 1 de l’ancienne loi no 4389, telle que modifiée par la loi no 5020 du 26 décembre 2003, et de l’article 135 de la loi no 5411 du 19 octobre 2005. Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer in abstracto sur la compatibilité de ces dispositions avec la Convention, mais d’apprécier in concreto l’incidence de l’application de ces lois sur le droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1.La Cour rappelle que le pouvoir qu’elle a de contrôler le respect du droit interne est limité. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne, même dans les domaines où la Convention s’en « approprie » les normes : par la force des choses, lesdites autorités sont spécialement qualifiées pour trancher les questions surgissant à cet égard (Zagrebacka banka d.d. c. Croatie, no 39544/05, § 263, 12 décembre 2013). C’est d’autant plus vrai lorsque sont en cause, comme en l’espèce, de difficiles questions d’interprétation du droit national (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007 I). Sauf si l’interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, la tâche de la Cour se limite à déterminer si ses effets sont compatibles avec la Convention (ibidem, §§ 83 et 86). C’est pour cette raison que la Cour a jugé que, en principe, un requérant ne peut passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une « valeur patrimoniale » aux fins de l’article 1 du Protocole no 1 lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que la question du respect par lui des prescriptions légales appelle une décision de justice (voir, par exemple, Kopecký, précité, §§ 50 et 58, et Milašinovic c. Croatie (déc.), no 26659/08, 1er juillet 2010, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 149, 20 mars 2018, S., V. et A. c. Danemark [GC], nos 35553/12 et 2 autres, § 148, 22 octobre 2018, et Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 149, 19 décembre 2018).
199. Dans la présente affaire, la Cour note que la loi no 4969 du 31 juillet 2003, qui, en son article 2 provisoire, a servi de fondement à l’ordonnance de mesures conservatoires et les autres lois applicables en l’espèce, qui ont servi à motiver le maintien de ces mesures, sont entrées en vigueur après la date de transfert de la gestion et du contrôle de Imarbank. Cela dit, une éventuelle application de l’article additionnel 1 de l’ancienne loi no 4389, telle que modifiée par la loi no 5020 du 26 décembre 2003, et de l’article 135 de la loi no 5411 du 19 octobre 2005 au cas des requérants n’aurait pas constitué per se une violation de l’article 1 du Protocole no 1, car cette dernière disposition n’interdit pas, en tant que telle, l’application rétroactive d’une loi en matière civile (voir, mutatis mutandis, M.A. et autres c. Finlande (déc.), no 27793/95, 10 juin 2003, et Di Belmonte c. Italie (no 2) (déc.), no 72665/01, 3 juin 2004).
200. En l’occurrence, aux yeux de la Cour, se posent plutôt la question de savoir si les lois qui ont servi de fondement aux mesures conservatoires étaient suffisamment accessibles, précises et prévisibles, et celle de savoir si les requérants, qui ont tous bénéficié d’une décision de non-lieu le 21 janvier 2004 – soit quelques mois après le déclenchement de l’affaire – et qui n’ont jamais été condamnés par les juridictions internes dans le cadre de cette affaire, pouvaient ou devaient s’attendre à une application automatique de ces mesures tout au long de la procédure. Il convient ainsi de déterminer, à la lumière de l’article 135 de la loi no 5411 – selon lequel les tribunaux internes doivent désigner les responsables des pertes financières, qui seront alors tenus de rembourser au FADE les sommes que ce dernier a dû verser aux clients de la banque dans le cadre de l’assurance sur les dépôts d’épargne –, si et dans quelle mesure, après l’adoption de la décision de non-lieu (pour tous les requérants) et celle des décisions d’acquittement (pour les requérantes Nimet Hülya Talu et Bilge Dogru), les requérants pouvaient être tenues responsables du préjudice matériel subi par le FADE. La Cour est d’avis qu’une réponse affirmative ne semble pas être évidente.
201. En tout état de cause, la Cour note qu’il était loisible aux tribunaux, en vertu des lois en question, de décider le maintien des mesures conservatoires tant que toutes les sommes réclamées par le FADE n’avaient pas été recouvrées, et ce dans un contexte marqué par une incertitude quant à l’issue de la procédure pénale visant les responsables présumés des pertes financières étant donné l’absence de ces personnes. Pour les raisons énoncées ci-après, elle ne juge pas nécessaire d’examiner plus avant le point de savoir si un pouvoir discrétionnaire aussi vaste réponde au critère de légalité.
c) Sur le but légitime de l’ingérence
202. La Cour note qu’il n’est pas controversé entre les parties que les mesures litigieuses répondaient à un intérêt général, qui était d’empêcher l’usage de biens susceptibles d’avoir été acquis avec des fonds provenant d’activités criminelles. La question qui se pose est celle de savoir si, dans les circonstances concrètes de l’affaire, l’application des lois en question et la durée excessive et incertaine des mesures conservatoires ont imposé aux requérants des charges excessives.
d) Sur la proportionnalité de l’ingérence
203. Quant à la proportionnalité des mesures en cause, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige pour toute ingérence un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, §§ 83-95, CEDH 2005-VI). Ce juste équilibre est rompu si la personne concernée doit supporter une charge excessive et exorbitante (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, §§ 69-74, série A no 52, Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, § 57, 31 mai 2011, et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie (fond) [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 300, 28 juin 2018).
204. En l’espèce, la Cour dit tout d’abord reconnaître l’importance et la complexité de l’affaire Imarbank pour les autorités financières, administratives et judiciaires turques, ainsi que la nécessité de prendre des mesures afin de protéger les droits d’un large nombre d’individus affectés par la situation, de minorer les pertes éventuelles et de prévenir tout acte frauduleux, de recouvrer les fonds publics et de trouver les responsables présumés des pertes financières. Destinées à empêcher les transferts frauduleux de fonds publics, les mesures conservatoires peuvent constituer une arme efficace et nécessaire pour combattre des actes frauduleux dans le milieu financier (voir, mutatis mutandis, Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 30, série A no 281-A, et Arcuri c. Italie (déc.), no 52024/99, CEDH 2001-VII). Dans ce contexte, la Cour constate que l’imposition des mesures provisoires par la 2e chambre du tribunal de police de Sisli, le 14 août 2003, ne va pas en soi à l’encontre du principe de proportionnalité. Elle constate en même temps que les mesures conservatoires et les saisies des biens appartenant aux requérants, que ces derniers soient parties ou non aux procédures, sont, par nature, des mesures sévères et restrictives. Pareilles mesures et saisies sont susceptibles d’affecter les droits d’un propriétaire à un point tel que son activité principale, voire ses conditions de vie, peuvent être compromises (voir, mutatis mutandis, JGK Statyba Ltd et Guselnikovas c. Lituanie, no 3330/12, § 129, 5 novembre 2013, Markass Car Hire Ltd c. Chypre, no 51591/99, § 39, 2 juillet 2002, et Vendittelli c. Italie, 18 juillet 1994, § 35, série A no 293-A).
205. La Cour admet que l’ordonnance de mesures provisoires, en tant que telle, peut être justifiée par « l’intérêt général » si elle vise à prévenir les actes frauduleux afin de garantir la satisfaction du créancier. Toutefois, compte tenu du caractère restrictif des mesures préventives, il faut mettre fin à ces dernières dès lors qu’elles se révèlent ne plus être nécessaires (voir, mutatis mutandis, Raimondo, précité, § 36, et Vendittelli, précité, § 40) : en effet, plus les mesures provisoires restent en vigueur, plus l’impact sur la jouissance paisible du bien par le propriétaire est important (JGK Statyba Ltd et Guselnikovas, précité, § 130).
206. En l’occurrence, la Cour constate que le problème de la proportionnalité des mesures provisoires se pose plutôt à partir de la date à laquelle les requérants ont bénéficié de la décision de non-lieu du 21 janvier 2004.
207. Elle estime qu’en l’espèce la violation alléguée du droit de propriété des requérants est étroitement liée, entre autres, à la durée de la procédure et en est une conséquence indirecte (voir, mutatis mutandis, Kunic c. Croatie, no 22344/02, § 67, 11 janvier 2007, et JGK Statyba Ltd et Guselnikovas, précité, § 131). Il y a lieu de souligner que les mesures conservatoires litigieuses sont restées en vigueur au moins près de dix ans dans le cas de chacun des requérants.
208. Plus précisément, dans le cas des requérants Jasmin Paris Uzan et Renç Emre Uzan, la Cour remarque que les mesures conservatoires ont été levées le 5 mai 2015.
209. En ce qui concerne la requérante Ayla Uzan-Ashaboglu, la Cour note que le Gouvernement et l’intéressée s’accordent pour dire que les mesures prises à encontre de celle-ci sont toujours en vigueur.
210. Elle note que, pour la requérante Nimet Hülya Talu, ces mesures ont été levées le 16 avril 2013, alors que celle-ci a été acquittée 13 mars 2008, par la cour d’assises, des chefs de gestion d’opérations bancaires frauduleuse et de non-communication des documents et renseignements requis par les autorités judiciaires.
211. Enfin, s’agissant de la requérante Bilge Dogru, il convient d’observer que, alors que le Gouvernement a informé la Cour de la levée, le 4 novembre 2013, des mesures conservatoires imposées à ladite requérante, le représentant de cette dernière a fourni des documents démontrant que les mesures visant le patrimoine de sa cliente – pourtant acquittée le 8 juillet 2008, par la cour d’assises, des chefs de gestion d’opérations bancaires frauduleuse et de non-communication des documents et renseignements requis par les autorités judiciaires – étaient maintenues, du moins partiellement.
212. En évaluant la gravité de la charge imposée aux requérants, la Cour juge également pertinents les éléments suivants.
– La durée de la validité des restrictions en cause, qui se sont poursuivies sur plus de douze ans pour les requérants Jasmin Paris Uzan et Renç Emre Uzan, sur près de dix ans pour la requérante Nimet Hülya Talu, et sur plus de quinze ans pour les requérantes Bilge Dogru et Ayla Uzan-Ashaboglu (voir, par exemple, les affaires Sporrong et Lönnroth, précité, § 72, et JGK Statyba Ltd et Guselnikovas, précité, § 143, où les restrictions à la pleine jouissance du droit de propriété ont duré respectivement douze ans et plus de dix ans ; voir aussi Zelenchuk et Tsytsyura c. Ukraine, nos 846/16 et 1075/16, § 144, 22 mai 2018).
– L’étendue des restrictions en question, en ce qu’elles privent les requérants Jasmin Paris Uzan et Renç Emre Uzan de la possibilité d’acquérir toutes sortes de biens, et en ce qu’elles empêchent la requérante Nimet Hülya Talu de disposer de son salaire de professeur à l’université et de son véhicule, la requérante Bilge Dogru de ses économies et également de sa voiture, et la requérante Ayla Uzan-Ashaboglu de son domicile et aussi de son véhicule.
– Le caractère automatique, généralisé et inflexible des restrictions en cause, qui ne font pas l’objet d’un contrôle régulier individuel (comparer, mutatis mutandis, avec Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 54, CEDH 1999-V, § 54, où la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 en partie car aucun tribunal n’était compétent pour statuer sur les conséquences pouvant découler du retard dans l’exécution des ordonnances d’expulsion dans l’affaire d’un propriétaire donné, Spadea et Scalabrino c. Italie, no 12868/87, §§ 37-40, 28 septembre 1995, et P. Plaisier BV et autres c. Pays-Bas (déc.), nos 46184/16, 47789/16 et 19958/17, § 91, 14 novembre 2017, où une évaluation individualisée de la gravité de la charge imposée à la requérante par les juridictions nationales n’a pas été exclue). À cet égard, il convient de constater que les requérants de la présente espèce n’ont jamais été condamnés par les juridictions internes dans le cadre de l’affaire pénale, et que les ordres de paiement émis à leur encontre ont été annulés par les tribunaux compétents. Ces derniers ont ainsi établi que les intéressés ne pouvaient être tenus pour responsables du préjudice matériel subi par le FADE.
– L’absence, dans le dossier, d’éléments qui laisseraient à penser que les requérants pouvaient avoir été impliqués dans une quelconque fraude. À cet égard, il importe de relever que les intéressés ont tous bénéficié d’une décision de non-lieu le 21 janvier 2004, approuvée par la cour d’assises de Beyoglu le 10 mai 2004, et qu’ils n’étaient pas visés par la procédure pénale principale. Pour autant, les autorités internes n’ont envisagé de mesures alternatives que très tardivement, voire jamais. Dans le cas des requérantes Nimet Hülya Talu et Bilge Dogru, il y a lieu de noter que celles-ci ont bénéficié de décisions d’acquittement, le 13 mars 2008 et le 8 juillet 2008 respectivement, mais qu’une partie importante des mesures imposées sur leurs biens a continué à être en vigueur – et ce alors qu’aucune autre procédure pénale dirigée contre les intéressées n’était pendante –, et que les arriérés de salaire sur dix ans de la première de ces requérantes n’ont été versés qu’en 2013. De même, en ce qui concerne la requérante Ayla Uzan-Ashaboglu, il ne ressort pas du dossier que cette dernière, qui a pourtant bénéficié de décisions de justice rendues en sa faveur, s’est vu appliquer une quelconque mesure alternative.
Toujours est-il qu’aucun élément du dossier n’indique que le recouvrement des créances publiques, dont le montant s’élevait à plus de 4 milliards EUR, méritait une meilleure protection que les biens des requérants (voir, mutatis mutandis, JGK Statyba Ltd et Guselnikovas, précité, § 120, et Lachikhina c. Russie, no 38783/07, § 63, 10 octobre 2017).
213. Par ailleurs, la Cour constate que l’attribution par la cour d’assises d’Istanbul à certains des requérants d’« une qualité autre que celle de parties au procès » a empêché et empêche toujours les intéressés de participer à la procédure pénale principale, à laquelle est pourtant attaché le sort de leurs droits. Or ni les juridictions internes, dans leurs décisions, ni le Gouvernement, dans ses observations, n’ont expliqué quel était le fondement de l’octroi de cette qualité auxdits requérants.
214. En outre, la Cour estime qu’il convient de ne pas négliger l’importance des obligations procédurales au titre de l’article 1 du Protocole no 1. Ainsi, elle a maintes fois relevé que, nonobstant le silence de l’article 1 du Protocole no 1 en matière d’exigences procédurales, une procédure judiciaire afférente au droit au respect des biens doit aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition (Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 96, CEDH 2002-VII, Capital Bank AD c. Bulgarie, no 49429/99, § 134, CEDH 2005-XII (extraits), Anheuser-Busch Inc., précité, § 83, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, § 57, CEDH 2007-III, Zafranas c. Grèce, no 4056/08, § 36, 4 octobre 2011, et Giavi c. Grèce, no 25816/09, § 44, 3 octobre 2013 ; voir également, mutatis mutandis, Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, § 123, 20 juin 2002, et Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10 et 4 autres, § 188, 4 mars 2014). Une ingérence dans les droits prévus par l’article 1 du Protocole no 1 ne peut ainsi avoir de légitimité en l’absence d’un débat contradictoire et respectueux du principe de l’égalité des armes, qui permette de discuter des aspects présentant de l’importance pour l’issue de la cause. Pour s’assurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer les procédures applicables d’un point de vue général (voir, parmi d’autres, AGOSI c. Royaume-Uni, no 9118/80, § 55, 24 octobre 1986, Hentrich c. France, § 49, 22 septembre 1994, série A no 296-A, Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 45, CEDH 2002-IV, Gáll c. Hongrie, no 49570/11, § 63, 25 juin 2013, Sociedad Anónima del Ucieza c. Espagne, no 38963/08, § 74, 4 novembre 2014, et G.I.E.M. S.R.L. et autres, précité, § 302).
215. Dans la présente affaire, la Cour estime que l’imposition et le maintien automatique des mesures conservatoires sur les biens des requérants en application des lois susmentionnées, justifiés, dans le cas des uns, par le seul fait de l’existence d’un lien de parenté avec les dirigeants de la banque et, dans le cas des autres, par le seul fait de l’exercice, à un moment donné, de responsabilités au sein de la banque – et ce en dépit du prononcé de décisions de non-lieu et d’acquittement pour tous les chefs d’accusation –, s’accordent mal avec ces principes puisqu’ils ne permettent pas au juge d’évaluer quels sont les instruments les plus adaptés aux circonstances spécifiques de l’espèce ni, plus généralement, d’effectuer une mise en balance entre le but légitime sous-jacent et les droits des intéressés touchés par ladite sanction. De plus, les requérants n’ayant pas été parties à la procédure pénale principale, ils n’ont bénéficié d’aucune des garanties procédurales visées au paragraphe précédent (voir, mutatis mutandis, G.I.E.M. S.R.L. et autres, précité, § 303).
216. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les autorités turques n’ont pas ménagé un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et les exigences de la protection des droits des requérants au respect de leurs biens. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no1 à la Convention.
LIMITATION DE L'UTILISATION D'UN BIEN CULTUREL
Petar Matas c. Croatie du 4 octobre 2016, requête no 40581/12
Violation de l'article
1 du Protocole 1 : Restrictions excessives de l’usage d’un
atelier de réparation automobile dans l’attente d’une
évaluation pour le patrimoine culturel
La Cour relève que les autorités savaient que M. Matas avait
acheté le bâtiment en question pour en faire un usage
commercial, et qu’à l’époque de cet achat rien n’indiquait
que des mesures seraient appliquées à des fins de protection du
patrimoine culturel. De plus, bien que les mesures de protection
préventive n’aient pas privé M. Matas de son atelier,
elles ont entraîné un certain nombre de restrictions
importantes à l’usage de sa propriété, notamment à la
possibilité d’en faire un usage commercial si bon lui
semblait.
Cette mesure de contrôle, fondée sur l’article 10 de la loi sur le patrimoine culturel, était prévue par la loi et poursuivait le but légitime consistant à protéger et à faire connaître les racines historiques, culturelles et artistiques d’une région et de ses habitants.
La Cour juge cependant que cette atteinte aux droits de propriété de M. Matas pour des raisons liées au patrimoine culturel ne satisfait pas aux exigences en matière de protection du droit de propriété qui découlent de la Convention européenne. Elle souligne notamment ses réserves quant à deux aspects de la conduite des autorités dans la cause de M. Matas.
En premier lieu, alors que deux mesures de protection préventive ont été appliquées au bâtiment de M. Matas sur une période de six ans, les autorités ne semblent avoir procédé pendant cet intervalle à aucun mesurage ni aucune évaluation ou étude destinés à déterminer la valeur du bien pour le patrimoine culturel. La Cour ne peut accepter la justification donnée à une si longue application des mesures de prévention, à savoir l’impossibilité où les autorités se seraient trouvées d’obtenir auprès du tribunal municipal de Split un extrait du cadastre concernant le bâtiment en question. En effet, les données cadastrales sont des informations publiques faciles à obtenir par le biais d’Internet et par d’autres moyens.
En second lieu, la procédure menée par les autorités nationales dans la cause de M. Matas a été entachée de plusieurs omissions d’ordre procédural. Lorsqu’elles ont ordonné les mesures de protection préventive en mars 2003 et en janvier 2007, les autorités locales n’ont pas informé M. Matas de la nécessité de prendre ces mesures ; elles n’ont pas non plus transmis leurs décisions à l’intéressé. Elles n’ont donc pas tenu compte de son avis sur la question et de l’impact que ces mesures auraient sur ses droits de propriété.
En outre, en dépit des arguments clairs de M. Matas quant à l’impact des restrictions litigieuses sur ses projets commerciaux liés à l’atelier, le tribunal administratif n’a pas cherché à savoir si l’application prolongée des mesures de protection préventive avait eu un effet disproportionné sur les droits de propriété du requérant. De surcroît, les omissions du tribunal administratif n’ont pas été réparées par la Cour constitutionnelle. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
DÉCISION D'IRRECEVABILITE DU 3 JUIN 2013
Fürst von Thurn und Taxis c. Allemagne requête no 26367/10
EN MATIÈRE DE PATRIMOINE CULTUREL
Le refus de lever les restrictions à l’usage de biens hérités ayant une valeur historique et culturelle se justifie par des raisons d’intérêt général
L'affaire concerne la plainte introduite par le prince Albert von Thurn und Taxis au sujet de certaines restrictions à l’usage d’une bibliothèque et d’archives présentant une grande valeur historique et culturelle, biens dont il a hérité et qui ont appartenu à un fonds fiduciaire familial jusqu’en 1939.
La Cour conclut notamment que la préservation d’un élément important du patrimoine culturel peut justifier un contrôle de la part d’une autorité de l’Etat, que le requérant ne s’est pas vu refuser l’autorisation d’effectuer certaines transactions particulières à propos de ces biens et qu’il n’est en conséquence pas établi qu’il a été totalement privé de la possibilité d’user de ses biens de manière raisonnable ; elle dit aussi qu’il ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d’un propriétaire de biens n’ayant jamais appartenu à un fonds fiduciaire familial.
Article 1 du Protocole no 1
Etant donné que la plainte du requérant porte seulement sur le refus opposé par les tribunaux allemands, à la suite de sa demande formulée en 2002, de lever les mesures prises en 1943, et non l’adoption même de ces mesures, la compétence de la Cour pour connaître de cet aspect de la requête n’est pas exclue ratione temporis.
La Cour considère que les dispositions pertinentes de la loi sur la dissolution des fonds fiduciaires familiaux, même si elles sont rédigées en termes généraux, constituent une base légale suffisante pour les mesures restrictives en cause. De plus, le requérant ne conteste pas que l’ingérence dans ses droits visait un but légitime, à savoir la protection du patrimoine culturel allemand.
S’agissant de l’équilibre devant être ménagé entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits du requérant, la Cour note que ce dernier a acquis par voie de succession la propriété de la bibliothèque et des archives alors que ces biens faisaient déjà l’objet de restrictions, puisqu’elles ont été imposées en 1943. Au moment de cette acquisition, il ne pouvait donc ignorer l’existence des restrictions en cause.
Au sujet de la première mesure – le placement des biens sous le contrôle des directeurs de la bibliothèque et des archives du Land de Bavière – la Cour considère que la protection d’un élément important du patrimoine culturel peut justifier de le placer sous le contrôle d’une autorité compétente de l’Etat. De plus, le requérant n’a nullement avancé que cette autorité exerçait son pouvoir de contrôle de manière disproportionnée.
La deuxième mesure – l’obligation pour le propriétaire d’alors et ses héritiers d’obtenir l’autorisation de l’autorité de contrôle avant de modifier, déplacer ou céder la bibliothèque ou les archives – la Cour observe que le requérant n’a pas déclaré qu’il avait sollicité l’autorisation d’effectuer une certaine transaction portant sur ses biens et qu’elle lui avait été refusée. Dès lors, il n’est pas établi qu’il a été entièrement privé de la possibilité de faire usage de ses biens de manière raisonnable. De plus, les tribunaux allemands ayant examiné au fond sa demande de levée des mesures, le requérant a pu contester en justice la nécessité des restrictions.
Quant à la troisième mesure, à savoir l’obligation pour le propriétaire de conserver la bibliothèque et les archives « en bon ordre », la Cour reconnaît que les frais d’entretien de tels biens sont considérables. Elle estime cependant que ces frais sont également nécessaires pour préserver la valeur des biens du requérant.
Vu ces considérations et eu égard à l’ample marge d’appréciation reconnue à l’Etat dans le domaine du contrôle de l’usage des biens, la Cour considère que la décision de ne pas lever les mesures de restriction n’a pas fait peser sur le requérant une charge disproportionnée et excessive. Il n’y a dès lors aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole no 1. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté.
Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1
La Cour n’a pas compétence ratione temporis pour rechercher si les décisions émises en 1943, soit avant l’entrée en vigueur de la Convention, ont entraîné une discrimination envers les propriétaires antérieurs des biens détenus par le requérant. Pour ce qui est de la décision de ne pas lever les mesures, adoptée par les tribunaux allemands après que le requérant les eut saisis en 2002, la Cour prend note de la conclusion de ces juridictions selon laquelle les circonstances sociales et historiques relatives à l’acquisition de biens ayant appartenu à des fonds fiduciaires familiaux ne sauraient se comparer avec les conditions d’acquisition d’autres biens « civils ». Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant, en sa qualité de propriétaire de biens auparavant acquis dans des conditions privilégiées et ayant appartenu à un fonds fiduciaire familial, se trouve dans une situation qui n’est pas comparable à celle des propriétaires de biens n’ayant jamais appartenu à un tel fonds. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, ce grief est lui aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté.
ÉCHELONNEMENT DE LA DETTE DE L'ÉTAT
Décision d'Irrecevabilité du 4 septembre 2012 Dumitru et autre C. Roumanie Requête 57265/08
L'ETAT SOUMIS A UNE CRISE ECONOMIQUE PEUT ECHELONNER LE PAIEMENT DE SES DETTES DUES A SES FONCTIONNAIRES.
38. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt de justice fait partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
L’inexécution par un État contractant d’une décision de justice rendue contre lui peut constituer une violation du droit du justiciable à un tribunal consacré par l’article 6 § 1 de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III). Elle peut, en outre, porter atteinte au droit du justiciable au respect de ses biens, lorsque le jugement en sa faveur fait naître une créance certaine qui doit être qualifiée de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Bourdov, précité, § 40).
39. Une autorité de l’État ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice. S’il est vrai qu’un retard dans l’exécution d’une décision de justice peut se justifier dans des circonstances particulières, ce retard ne saurait être tel que la substance même du droit protégé par l’article 6 § 1 de la Convention s’en trouverait affectée (voir, entre autres, Hornsby précité, § 40; Jasiuniene c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003 ; Qufaj Co. Sh.p.k. c. Albanie, no 54268/00, § 38, 18 novembre 2004, et Beshiri et autres c. Albanie, no 7352/03, § 60, 22 août 2006).
40. En même temps, pour juger du respect de l’exigence d’exécution dans un délai raisonnable, la Cour prend en compte la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que l’objet de la décision à exécuter (Raïlian c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007).
Afin de répondre à la question de savoir si l’article 6 a été respecté, la Cour doit prendre en compte le comportement de toutes les autorités nationales concernées, y compris celle du législateur national (voir, mutatis mutandis, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, §§ 48-49, série A no 44).
41. Appelée à se prononcer sur le respect de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour a considéré que le législateur devait jouir, dans la mise en œuvre de ses politiques, notamment sociales et économiques, d’une grande latitude pour se prononcer tant sur l’existence d’un problème d’intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d’application de cette dernière. La Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’intérêt général, sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (Mellacher et autres c. Autriche, 19 décembre 1989, § 45, série A no 169).
42. En outre, elle a jugé incompatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention un aménagement du paiement de dettes établies par voie judiciaire, dès lors que l’acte d’aménagement n’avait pas qualité de « loi » au sens de la jurisprudence de la Cour (SARL Amat-G et Mébaghichvili c. Géorgie, no 2507/03, § 61, CEDH 2005-VIII) ou que le mécanisme d’aménagement, bien que répondant à la notion de « loi », avait été appliqué d’une manière défectueuse (Suljagic c. Bosnie-Herzégovine, no 27912/02, §§ 56-57, 3 novembre 2009).
43. En l’espèce, la Cour observe qu’il n’est pas reproché au gouvernement défendeur d’avoir refusé d’exécuter des décisions de justice reconnaissant aux requérants des droits de nature patrimoniale. Les intéressés ne prétendent pas non plus que les dispositions légales adoptées en la matière visaient à laisser sans aucun effet ces décisions judiciaires.
44. Les requérants se plaignent essentiellement de l’échelonnement, décidé par voie législative, de l’exécution des créances qui leur sont dues en vertu de décisions de justice.
La Cour est appelée à examiner si cet échelonnement, tel qu’appliqué aux requérants, est compatible avec la Convention.
45. Elle constate qu’entre 2008 et 2011, l’État roumain a adopté plusieurs actes normatifs suspendant de jure l’exécution forcée de créances dues aux fonctionnaires en vertu de décisions judiciaires et introduisant un système d’exécution de ces créances consistant en des versements par tranches annuelles.
La première ordonnance du 11 juin 2008 (déclarée inconstitutionnelle le 12 mai 2009), fut suivie de l’OGU no 71/2009 fixant le règlement de ces créances en trois tranches annuelles, de 2010 à 2012.
En 2010, l’OGU no 45/2010 prescrivit que le paiement des sommes dues se ferait toujours par trois tranches annuelles, mais entre 2012 et 2014.
Enfin, en décembre 2011, la loi no 230/2011 étala ce règlement sur cinq ans, de 2012 jusqu’en 2016, avec des annuités progressives, allant de 5 % lors de la première année à 35 % la dernière année (paragraphes 24-27 ci-dessus).
46. Le Gouvernement justifie ces mesures par le fait qu’en 2008 le pays s’est trouvé confronté à une situation de déséquilibre budgétaire important, susceptible de mettre en péril la santé financière du pays. Selon lui, ce déséquilibre résultait, entre autres, d’un très grand nombre de décisions judiciaires octroyant à certaines catégories de fonctionnaires, par voie d’interprétation des dispositions légales destinées à d’autres catégories, des droits de caractère patrimonial. En outre, la dégradation de la situation financière du pays a continué au-delà de l’année 2008, dans un contexte de crise financière très sévère touchant de nombreux pays, de sorte que le Gouvernement a dû adapter aux réalités économiques le mécanisme d’échelonnement mis en place.
47. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que des mesures prises afin de sauvegarder l’équilibre budgétaire entre les dépenses et les recettes publiques pouvaient être considérées comme poursuivant un but d’utilité publique (Mihaies et Sentes c. Roumanie (déc.), no 44232/11 et 44605/11, 6 décembre 2011, Šulcs c. Lettonie (déc.), no 42923/10, § 24, 6 décembre 2011, et Panfile c. Roumanie (déc.), no 13902/11, § 21, 20 mars 2012).
48. En l’espèce, elle note qu’à partir de 2009, la Roumanie a dû faire face à une grave crise économique et financière. Les autorités nationales se trouvant en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d’« utilité publique », la Cour est prête à admettre que, comme le soutient le Gouvernement, les mesures contestées visaient un but d’utilité publique.
49. Pour déterminer si lesdites mesures étaient proportionnées au but poursuivi – établir l’équilibre budgétaire tout en évitant la dégradation de la situation sociale la Cour estime qu’il y a lieu de rechercher si, en l’espèce, le traitement réservé aux requérants a permis le maintien d’un équilibre entre les intérêts en cause.
50. Elle note que les requérants disposaient de droits fermes et intangibles en vertu de décisions de justice définitives prononcées entre février et avril 2008. La Cour constate que, bien que le mécanisme d’échelonnement mis en place ait subi de modifications, les autorités de l’État l’ont respecté, en faisant preuve de diligence dans l’exécution des décisions de justice susmentionnées.
Ainsi, conformément au droit en vigueur (paragraphe 24 ci-dessus), les requérants ont reçu dès octobre 2008 une première tranche représentant 30 % du montant total des créances dues. En septembre 2010, une somme supplémentaire égale à 25 % de la deuxième tranche de 34 % du montant total leur a été versée, alors même qu’en vertu de l’OGU no 45/2010 du 19 mai 2010, la deuxième tranche aurait dû être payée en 2012.
Comme l’exigeait la loi, le montant des sommes versées était à chaque fois indexé sur l’indice des prix à la date du versement.
A ce jour, les requérants ont reçu plus d’un tiers de la somme totale octroyée par les tribunaux, le restant de cette somme devant être versé, selon la législation en vigueur, de manière échelonnée, jusqu’en 2016. Rien dans le dossier n’indique que le Gouvernement n’ait pas l’intention de respecter ce calendrier.
51. Compte tenu de ce qu’une partie substantielle des créances dues aux requérants leur a déjà été versée, la Cour ne saurait considérer que la substance même du droit des requérants s’est trouvée affectée.
En tout état de cause, au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus et du contexte particulier de la présente affaire, la Cour considère que l’aménagement du règlement des créances dues aux requérants ne saurait être considéré comme déraisonnable.
52. Partant, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.
Le Décret n° 2015-1572 du 2 décembre 2015 est relatif à l'établissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds.
L'INTERDICTION D'EXPORTER DES OEUVRES D'ART
CONSEIL CONSTITUTIONNEL : Décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014
Le Conseil
constitutionnel a été saisi le 8 septembre 2014 par le Conseil
d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée
par M. Alain L. Cette question était relative à la conformité
aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article
2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des
œuvres d'art.
La loi du 23 juin 1941 a régi l'exportation des œuvres d'art
jusqu'à son abrogation par la loi du 31 décembre 1992. Son
article 2 instaure, au profit de l'État, le droit de retenir des
objets présentant un intérêt historique ou artistique dont l'autorisation
d'exportation a été refusée en application de l'article 1er de
la même loi. Ce droit peut être exercé pendant une période de
six mois suivant la demande tendant à obtenir cette autorisation
d'exporter sans que le propriétaire ne manifeste aucune
intention de les aliéner.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la possibilité pour l'État
de refuser l'autorisation d'exportation, qui fait obstacle à
toute sortie de ces biens du territoire national, assure la
réalisation de l'objectif de maintien sur le territoire national
des objets présentant un intérêt historique ou artistique. Il
en a déduit que la privation de propriété permise par les
dispositions contestées n'est pas nécessaire pour atteindre un
tel objectif. Dès lors, le Conseil a jugé qu'en prévoyant l'acquisition
forcée de ces biens par une personne publique, alors que leur
sortie du territoire national a déjà été refusée, le
législateur a instauré une privation de propriété sans fixer
les critères établissant une nécessité publique. Les
dispositions contestées méconnaissent donc les exigences de l'article
17 de la Déclaration de 1789.
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 de la loi
du 23 juin 1941 prend effet à compter de la date de la
publication de la décision du Conseil. Elle peut être invoquée
dans toutes les instances introduites à la date de la
publication de la présente décision et non jugées
définitivement à cette date.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la
Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 2595 du 23 juin 1941 relative à l'exportation des
œuvres d'art ;
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et
de douane ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie
devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires
de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Lionel
Levain, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 30 septembre
2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre,
enregistrées le 30 septembre 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Levain, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné
par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience
publique du 4 novembre 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant
qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative
à l'exportation des œuvres d'art : « L'État a le droit de
retenir, soit pour son compte, soit pour le compte d'un
département, d'une commune ou d'un établissement public, au
prix fixé par l'exportateur, les objets proposés à l'exportation.
« Ce droit pourra s'exercer pendant une période de six mois »
;
2. Considérant que, selon le requérant, les dispositions
contestées, qui permettent à l'État de retenir certaines
œuvres d'art au profit de collections publiques, portent
atteinte au droit de propriété ; qu'il fait notamment valoir
que ces dispositions ne prévoient pas une juste et préalable
indemnisation du propriétaire de l'œuvre ainsi expropriée
;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La propriété
étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé,
si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste
et préalable indemnité » ; qu'afin de se conformer à ces
exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser qu'une
personne ne soit privée de sa propriété qu'en vertu d'une
nécessité publique légalement constatée ;
4. Considérant que la loi du 23 juin 1941 a régi l'exportation
des œuvres auxquelles elle était applicable jusqu'à son
abrogation par la loi du 31 décembre 1992 susvisée ; qu'elle
avait pour objet d'interdire la sortie du territoire, sans
contrôle, des objets présentant un intérêt national d'histoire
ou d'art ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941,
l'exportation de tels objets requiert la délivrance d'une
autorisation du secrétaire d'État à l'Éducation nationale et
à la Jeunesse, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois à
compter de la déclaration fournie à la douane par le
propriétaire qui entend exporter ces objets ; que ce régime d'autorisation
est applicable aux objets d'ameublement antérieurs à 1830, aux
œuvres des peintres, graveurs, dessinateurs, sculpteurs et
décorateurs antérieures au 1er janvier 1900 ainsi qu'aux objets
provenant des fouilles pratiquées en France ou en Algérie ;
5. Considérant que les dispositions contestées de l'article 2
de la loi du 23 juin 1941 instaurent, au profit de l'État, le
droit de « retenir » les objets dont l'autorisation d'exportation
a été refusée en application de l'article 1er ; que ce droit
peut être exercé pendant une période de six mois suivant la
demande tendant à obtenir cette autorisation d'exporter sans que
le propriétaire ne manifeste aucune intention de les aliéner ;
que, par suite, cette appropriation par une personne publique de
biens mobiliers entraîne une privation du droit de propriété
au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant que la possibilité de refuser l'autorisation d'exportation
assure la réalisation de l'objectif d'intérêt général de
maintien sur le territoire national des objets présentant un
intérêt national d'histoire ou d'art ; que la privation de
propriété permise par les dispositions contestées alors en
vigueur n'est pas nécessaire pour atteindre un tel objectif ; qu'en
prévoyant l'acquisition forcée de ces biens par une personne
publique, alors que leur sortie du territoire national a déjà
été refusée, le législateur a instauré une privation de
propriété sans fixer les critères établissant une nécessité
publique ; que, par suite, les dispositions contestées ne
répondent pas à un motif de nécessité publique ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la
privation du droit de propriété permise par les dispositions
contestées méconnaît les exigences de l'article 17 de la
Déclaration de 1789 ; que, par suite, l'article 2 de la loi du
23 juin 1941 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article
62 de la Constitution : « Une disposition déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est
abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil
constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions
et limites dans lesquelles les effets que la disposition a
produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si,
en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit
bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de
constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la
Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours
à la date de la publication de la décision du Conseil
constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la
Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la
date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de
prévoir la remise en cause des effets que la disposition a
produits avant l'intervention de cette déclaration ;
9. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article
2 de la loi du 23 juin 1941 prend effet à compter de la date de
la publication de la présente décision ; qu'elle peut être
invoquée dans toutes les instances introduites à la date de la
publication de la présente décision et non jugées
définitivement à cette date,
D É C I D E :
Article 1er.- Les dispositions de l'article 2 de la loi du 23
juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art sont
contraires à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article
1er prend effet à compter de la publication de la présente
décision dans les conditions fixées par son considérant 9.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française et notifiée dans les
conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7
novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13
novembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président,
M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET,
MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC,
Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
LES SERVITUDES SUR LES CHALETS D'ALPAGE
Conseil Constitutionnel Décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016
Société civile Groupement foncier rural Namin et Co [Servitude administrative grevant l'usage des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive]
Le Conseil
constitutionnel a été saisi le 12 février 2016 par le Conseil
d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité
relative à la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit du second alinéa du paragraphe I de l'article
L. 145-3 du code de l'urbanisme.
Ces dispositions permettent à l'autorité administrative de
subordonner la délivrance d'un permis de construire ou l'absence
d'opposition à une déclaration de travaux à l'institution d'une
servitude restreignant l'usage, en période hivernale, des
chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive non desservis par des
voies et réseaux.
La société requérante soutenait notamment que ces dispositions
portent atteinte au droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions
contestées ont pour objectif de ne pas créer de nouvelles
obligations de desserte des bâtiments en cause par les voies et
réseaux et de garantir la sécurité des personnes en période
hivernale.
Compte tenu du caractère circonscrit du champ d'application des
dispositions contestées et des conditions dans lesquelles la
servitude peut être instituée, le Conseil constitutionnel a
jugé que les dispositions contestées ne portent pas une
atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré conforme
à la Constitution le second alinéa du paragraphe I de l'article
L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de
la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 12 février 2016 par le Conseil d'État (décision n° 394839 du 10 février 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société civile Groupement foncier rural Namin et Co, par la SELARL Redlink, avocat au barreau de Paris. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa du paragraphe I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-540 QPC.
Au vu des
textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de l'urbanisme ;
la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant
le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de
constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour la société requérante par
la SELARL Redlink, enregistrées les 7 et 22 mars 2016 ;
les observations présentées pour la commune des Fourgs, partie
en défense, par Me Gregory Mollion, avocat au barreau de
Grenoble, enregistrées le 7 mars 2016 ;
les observations présentées par le Premier ministre,
enregistrées le 7 mars 2016 ;
les observations en intervention présentées par l'association
nationale des élus de la montagne, enregistrées le 29 février
2016 ;
les observations en intervention présentées par l'association
France nature environnement, enregistrées le 7 mars 2016 ;
les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Alexandre Le Mière, avocat au barreau de
Paris, pour la société requérante, Me Mollion, pour la partie
en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier
ministre, à l'audience publique du 19 avril 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL s'est fondé sur ce qui suit :
1. La société requérante a saisi le tribunal administratif d'un recours. Ce recours tend, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 2015 par laquelle le maire de la commune des Fourgs a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 5 mars 2004 instituant, sur la parcelle cadastrée ZE 27 dont elle est propriétaire dans cette commune, la servitude prévue au paragraphe I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. Ce recours tend, d'autre part, à l'abrogation de cet arrêté du 5 mars 2004. La question prioritaire de constitutionnalité devant être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée, le Conseil constitutionnel est saisi du second alinéa du paragraphe I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 2 juillet 2003 mentionnée ci-dessus.
2. Le second alinéa du paragraphe I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 2 juillet 2003 dispose : « Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement ».
3. La société requérante soutient qu'en permettant à l'autorité administrative d'instituer une servitude interdisant l'usage des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive en période hivernale sans prévoir une indemnisation du propriétaire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette servitude, qui ne serait ni justifiée par un motif d'intérêt général ni proportionnée à l'objectif poursuivi et dont l'institution ne serait entourée d'aucune garantie procédurale, méconnaîtrait également les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789. Il en résulterait enfin une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et à la liberté d'aller et de venir.
- SUR L'ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ :
4. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Selon son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
5. Les dispositions contestées permettent à l'autorité administrative de subordonner la délivrance d'un permis de construire ou l'absence d'opposition à une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude interdisant ou limitant l'usage, en période hivernale, des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive non desservis par des voies et réseaux.
6. D'une part, la servitude instituée en vertu des dispositions contestées n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation à l'exercice du droit de propriété.
7. D'autre part, en permettant d'instituer une telle servitude, le législateur a voulu éviter que l'autorisation de réaliser des travaux sur des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive ait pour conséquence de faire peser de nouvelles obligations de desserte de ces bâtiments par les voies et réseaux. Il a également voulu garantir la sécurité des personnes en période hivernale. Ainsi le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général.
8. Le champ d'application des dispositions contestées est circonscrit aux seuls chalets d'alpage et bâtiments d'estive conçus à usage saisonnier et qui, soit ne sont pas desservis par des voies et réseaux, soit sont desservis par des voies et réseaux non utilisables en période hivernale. La servitude qu'elles prévoient ne peut être instituée qu'à l'occasion de la réalisation de travaux exigeant un permis de construire ou une déclaration de travaux. Elle s'applique uniquement pendant la période hivernale et ne peut excéder ce qui est nécessaire compte tenu de l'absence de voie ou de réseau.
9. La décision d'établissement de la servitude, qui est subordonnée à la réalisation, par le propriétaire, de travaux exigeant un permis de construire ou une déclaration de travaux, est placée sous le contrôle du juge administratif. Le propriétaire du bien objet de la servitude dispose de la faculté, au regard des changements de circonstances, d'en demander l'abrogation à l'autorité administrative à tout moment.
10. Il résulte des motifs exposés aux paragraphes 7 à 9 que les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.
- SUR LES AUTRES GRIEFS :
11. Le seul fait de permettre dans ces conditions l'institution d'une servitude ne crée aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Les dispositions contestées, qui se bornent à apporter des restrictions à l'usage d'un chalet d'alpage ou d'un bâtiment d'estive, ne portent aucune atteinte à la liberté d'aller et de venir.
12. De l'ensemble de ces motifs, il résulte que les dispositions du second alinéa du paragraphe I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Le second alinéa du paragraphe I de l'article L.
145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est
conforme à la Constitution.
Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de
la République française et notifiée dans les conditions
prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mai 2016 où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
RÈGLES DE CRÉDIT POUR PROTÉGER LE CONSOMMATEUR
Merkantil Car Zrt. c. Hongrie du 20 décembre 2018 requête n° 22853/15 et quatre autres
Article 1 du Protocole 1 : La CEDH rejette les griefs tirés par des banques hongroises d’une loi de 2014 sur les clauses abusives dans les prêts à la consommation
Dans cette affaire, les cinq sociétés requérantes, toutes membres du groupe OTP Bank, soutenaient qu’une législation présumant abusives certaines clauses types de contrats de prêt avait violé leur droit à un procès équitable et au respect de leurs biens. La Cour a joint les requêtes et les a déclarées irrecevables pour défaut manifeste de fondement. Elle a jugé en particulier que les stricts délais procéduraux et les autres règles de forme appliqués dans les procédures au cours desquelles les banques contestaient la présomption d’abus frappant certaines clauses types de contrats de prêt n’avaient pas violé le droit à un procès équitable. Les sociétés requérantes n’avaient pas été empêchées de plaider en faveur de leurs clauses contractuelles et ce n’est pas parce que leurs arguments avaient été rejetés que la procédure avait été inéquitable. La Cour a observé que la loi de 2014 sur l’uniformité avait introduit une réforme législative visant à aider la Hongrie à résoudre un problème d’endettement des consommateurs, en particulier les prêts libellés en devises étrangères, postérieurement à la crise financière de 2008. La législation n’avait donc pas rompu l’équilibre entre la protection des droits des sociétés requérantes et l’intérêt général.
LES FAITS
Les requérantes, Merkantil Car Zrt, Merkantil Bank Zrt, OTP Jelzálogbank Zrt, OTP Bank Nyrt et OTP Ingatlanlízing Zrt, sont des sociétés financières basées à Budapest. Elles sont membres du groupe OTP Bank. En Hongrie, plusieurs lois furent adoptées après la crise financière de 2008 afin de faire face au niveau d’endettement élevé des consommateurs dans le pays. En 2014, le Parlement adopta la loi sur l’uniformité qui transposa dans la législation différentes décisions de la Kúria (Cour suprême) concernant le crédit à la consommation. Elle introduisit également une présomption selon laquelle les clauses contractuelles types qui n’avaient pas été négociées individuellement et qui permettaient une augmentation unilatérale des taux d’intérêt, des frais et des coûts étaient présumées abusives à moins de respecter sept principes auparavant établis par la Kúria. En vertu de la loi sur l’uniformité, la présomption d’abus pouvait être renversée devant un tribunal. Les sociétés requérantes engagèrent des actions à cette fin. Elles arguèrent dans le même temps qu’en introduisant de nouvelles dispositions rétroactives, la loi sur l’uniformité avait porté atteinte à leurs droits. Les juridictions internes jugèrent que l’une au moins des clauses contractuelles ne respectait pas les sept principes établis. Elles se référèrent à une décision de la Cour constitutionnelle de novembre 2014 qui avait approuvé la nouvelle législation. La Cour constitutionnelle avait conclu que la loi avait précisé des exigences générales d’équité qui existaient déjà et ne pouvaient être considérées comme de nouvelles dispositions rétroactives.
Elle confirma également les restrictions procédurales contenues dans la loi, dont des délais plus courts, et se déclara favorable à l’objectif que poursuivait la loi de rationaliser le processus judiciaire, compte tenu du contentieux potentiellement important concernant des prêts litigieux.
Article 6
Joignant les requêtes en raison de leur similarité, la Cour observe que le grief des requérantes est double. Elles soutiennent, premièrement, que les strictes règles de forme étaient contraires au principe de l’égalité des armes et, deuxièmement, que la présomption d’abus était irréfragable en pratique et a eu une incidence sur l’issue de procédures en cours entamées par des emprunteurs. La Cour juge que les règles de forme s’appliquaient à toutes les parties, pas seulement aux sociétés requérantes. Elle n’a aucun doute non plus qu’un traitement accéléré et simplifié de ces litiges, du fait duquel les sociétés requérantes ont par exemple dû présenter un seul exposé de leurs prétentions pour toutes les clauses contractuelles types qu’elles voulaient faire contrôler, poursuivait le but légitime de la protection du consommateur et de la bonne administration de la justice. Rien n’indique que les sociétés requérantes n’aient pas été en mesure de respecter les délais, ce qu’elles étaient d’ailleurs censées faire puisqu’elles avaient elles-mêmes entamé les procédures. La Cour note que les arguments des sociétés requérantes sur la seconde question sont similaires à ceux avancés dans l’affaire Bárdi et Vidovics c. Hongrie, qu’elle avait jugée manifestement mal fondée en décembre 2007 et qui concernait les conséquences de la loi sur l’uniformité sur les variations de taux dans les prêts libellés en devises étrangères.
La Cour observe que les sociétés requérantes n’ont pas précisément indiqué quels litiges en cours étaient touchés par la loi de 2014. En tout état de cause, la législation a été mise en œuvre dans le but non pas de faire en sorte que l’issue des procédures soit favorable à l’État – un motif de violation dans des affaires antérieures –, mais de protéger le consommateur et l’intérêt général. Il devait également être clair depuis un certain temps aux yeux des sociétés requérantes que les clauses contractuelles types en question pouvaient être considérées comme abusives au regard de la directive de l’Union européenne 1993 sur les clauses abusives, applicable en Hongrie depuis 2004. La Cour rejette la thèse des sociétés requérantes selon laquelle la présomption d’abus était irréfragable. Si cette présomption jouait certes en faveur du consommateur, les sociétés ont eu la possibilité de présenter leurs arguments et rien n’indique que le critère de preuve fût excessivement strict. Les juridictions internes n’ont pas agi de manière arbitraire et le fait que les arguments des sociétés requérantes ont été rejetés n’emporte pas en lui-même violation des principes du procès équitable ou de l’égalité des armes. La Cour conclut que ni la législation ni ses conséquences sur les droits et obligations à caractère civil des sociétés requérantes ne font apparaître une violation de la Convention. Le grief de violation de l’article 6 doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
Article 1 du Protocole n° 1
La Cour recherche si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général et la nécessité de protéger les droits des sociétés, relevant que les États jouissent d’une marge d’appréciation étendue lorsqu’il s’agit de réglementer le secteur bancaire et de réagir à une crise financière. Les sociétés requérantes soutiennent que la loi de 2014 a rétroactivement qualifié d’abusives les clauses contractuelles et que le groupe OTP Bank a dû rembourser 142 000 000 000 HUF à des consommateurs. Selon elles, les mesures dénoncées n’ont pas tenu compte des avantages offerts aux clients grâce aux prêts libellés en devises étrangères ni qu’une autre loi avait déjà offert une solution favorable au consommateur. Les sociétés requérantes ajoutent que la législation a pour but d’aider les consommateurs ayant contracté des prêts libellés en devises étrangères dont le montant des mensualités a augmenté en raison de la crise. Or, selon elles, cette augmentation est due aux fluctuations des devises étrangères et non à une hausse unilatérale des taux d’intérêt et des frais. La Cour constate que les juridictions internes ont conclu que la législation de 2014 avait codifié la jurisprudence antérieure appliquant les lois en vigueur et n’avait pas introduit de nouvelles dispositions. Si les sept principes n’avaient été énoncés pour la première fois qu’en 2012 dans une décision de la Kúria, toute clause contractuelle créant un déséquilibre majeur dans les droits et obligations des parties était déjà considérée comme abusive au regard de la directive européenne. Il revient aux juridictions internes d’interpréter et d’appliquer la législation interne : la Cour constitutionnelle a expliqué que, si les lois antérieures permettaient des modifications unilatérales dans les clauses contractuelles types, elles n’accordaient pas aux établissements financiers un droit inconditionnel et ceux-ci demeuraient tenus par les conditions d’équité et de bonne foi. La Cour estime que la disposition de la loi sur l’uniformité relative à la prescription n’est pas incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. Pour ce qui est de la proportionnalité, la Cour note que les sociétés requérantes ont eu la possibilité de chercher à réfuter la présomption légale d’abus. De plus, les actions intentées par des consommateurs contre les sociétés étaient déjà en cours lorsqu’est entrée en vigueur la nouvelle loi, et leur issue aurait très vraisemblablement été la même que sous l’empire de la loi sur l’uniformité, si ce n’est au bout d’un délai beaucoup plus long. Hormis les clauses litigieuses, les contrats de prêt continuaient par ailleurs à produire leurs effets et les prétentions des sociétés requérantes fondées sur ces contrats n’étaient pas éteintes
La Cour juge que, compte tenu de la marge d’appréciation des États, la loi sur l’uniformité n’a pas rompu l’équilibre entre l’intérêt général et la protection des droits des sociétés requérantes. Le grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 doit donc lui aussi être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
LA SAISIE D'UN BIEN PAR UN CRÉANCIER
DOIT ÊTRE PROPORTIONNÉE ET LÉGALE
MAZZOLI C. ITALIE du 16 juin 2015 requête 20485/06
Pas de violation, le requérant n'a pas démontré qu'il est tondu et qu'il risque de subir une vie financièrement indigne.
60. Le requérant dénonce la compensation intégrale de sa créance comme étant particulièrement insupportable en raison de ses difficultés économiques, son âge et son état de santé délicat et précaire. Il maintient que les décisions contestées sont en contradiction avec une décision rendue par le juge administratif dans une affaire similaire l’opposant à l’Administration. Il dénonce de ce chef un conflit de jurisprudence.
61. Le Gouvernement considère tout d’abord qu’en cas d’arriérés de salaire, la limite de la saisie à un cinquième du montant global n’est pas applicable. La raison de cette limite repose sur la nécessité de laisser au saisi le minimum vital, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. En deuxième lieu, le Gouvernement observe qu’il ne s’agit pas d’un cas de compensation, au sens propre, mais d’une simple vérification comptable dite compensation « a-technique », tel qu’élaborée par une jurisprudence bien établie. À cet égard, lorsque les positions respectives de crédit et de débit trouvent leur origine dans le même rapport, il est admis de procéder à une simple opération comptable jusqu’à compensation.
62. La
Cour observe que l’article 1 du Protocole no 1 garantit en
substance le droit de propriété. Toute atteinte à ce droit
doit être conforme au principe de légalité et poursuivre un
but légitime par des moyens raisonnablement proportionnés à
celui-ci (pour un rappel des principes pertinents voir, par
exemple, Metalco Bt. c. Hongrie, no 34976/05, § 16,
1er février 2011, avec d’autres références).
63. Une
mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit
ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde
des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres,
Sporrong et Lönnroth c. Suède,
23 septembre 1982, § 69, série A no 52). Le souci d’assurer
un tel équilibre se reflète dans la structure de l’article
1 du Protocole no 1 tout entier, donc aussi dans la seconde
phrase, qui doit se lire à la lumière du principe consacré par
la première. En particulier, il doit exister un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le
but visé par toute mesure appliquée par l’État, y compris
les mesures privant une personne de sa propriété (voir, parmi d’autres,
Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre
1995, § 38, série A no 332 ; Ex-roi de Grèce et autres c.
Grèce [GC], no 25701/94, § 89-90, CEDH 2000-XII ;
Sporrong et Lönnroth, précité, § 73).
64. En l’espèce, le requérant s’est vu reconnaître, par un jugement du TAR du Frioul du 23 mars 2001, une créance pour arriérés de salaire. Par la suite, la compensation intégrale entre cette créance et sa dette envers l’Administration militaire a été validée par les juges administratifs, en dernier l’arrêt du Conseil d’État du 17 avril 2009. Il y a donc eu une ingérence au droit de l’intéressé au respect de ses biens au regard de l’article 1 du Protocole no 1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-III).
65. Les juges internes ont fondé leur décision de compensation intégrale sur une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation qui a développé une interprétation consolidée de l’article 1241 du code civil selon laquelle il existe une distinction entre la compensation technique (à laquelle s’applique la limite de saisie du cinquième des salaires et pensions aux sens de l’article 1246, alinéa 1, no3 du code civil) et celle dite a-technique.
66. Cette interprétation a été validée par l’arrêt de la Cour Constitutionnelle no 259/2006. Dans cet arrêt, la Cour Constitutionnelle a statué qu’en cas de compensation « a-technique » la limite de saisie du cinquième n’a pas à s’appliquer. Les critères pour ce type de compensation a-technique sont réunis lorsque les positions de crédit de chaque partie trouvent leur titre dans le même rapport. Dans ce cas, il est légitime de procéder à un simple calcul comptable où les positions actives et passives de chaque partie sont définies et effacées jusqu’à compensation réciproque.
67. En particulier, dans son arrêt, la Cour Constitutionnelle a affirmé que, lorsque le crédit de l’employeur trouve sa source dans un délit commis par le salarié, dans le cadre de son activité professionnelle, contre l’employeur lui-même, il est pleinement justifié de ne pas appliquer la limite du cinquième.
68. En l’espèce, la Cour relève que l’ingérence dans le droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 constituée par la compensation intégrale était prévue par la loi et faisait l’objet d’une jurisprudence bien établie.
69. Quant
à l’exigence d’un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi,
la Cour a reconnu que les États contractants jouissent d’une
grande marge d’appréciation tant pour choisir les moyens de
recouvrement des créances que pour juger si leurs conséquences
se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le
souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause. En
pareil cas, la Cour se fiera au jugement des autorités
nationales quant à l’intérêt général, à moins qu’il
soit manifestement dépourvu de base raisonnable (Benet Czech,
spol. s r.o.
c. République Tchèque, no 31555/05, §§ 30 et 35, 21
octobre 2010).
70. La Cour note que la compensation litigieuse ne touche que la créance pour arriérés de salaire reconnue par jugement du TAR de Frioul. Les autres revenus du requérant, en particulier sa pension, sont saisis dans la limite légale du cinquième en application des dispositions du code civil.
71. La Cour observe, en outre, que l’ingérence litigieuse ne supprime pas les moyens dont le requérant nécessite pour subvenir à ses besoins et à ses exigences vitales. Il ne ressort pas des documents soumis à la Cour que le requérant n’est pas en mesure de maintenir un niveau de vie suffisamment adéquat et digne, indépendamment du remboursement de sa dette envers l’Administration (voir Laduna c. Slovaquie, no 31827/02, § 85, CEDH 2011).
72. Eu égard aux informations en sa possession, et considérant la marge d’appréciation accordée aux États contractants dans des affaires similaires, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi.
73. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
MELO TADEU c. PORTUGAL du 23 octobre 2014 requête 27785/10
Le refus par l'administration fiscale, de main levée des parts de société était illégal puisque la requérante a été relaxée au pénal de l'accusation de gérante de fait.
70. La requérante estime que la saisie par l’administration fiscale de sa part sociale dans la société B. s’analyse en une ingérence incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1.
71. Le Gouvernement conteste l’argument de la requérante. Il fait valoir que la mesure en cause a été ordonnée dans le cadre de la procédure d’exécution fiscale. Il observe en outre qu’il s’est avéré que la part sociale en question n’avait aucune valeur marchande et qu’elle n’avait donc pu être vendue, la société B. ayant par la suite demandé à être placée en situation de liquidation judiciaire.
72. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété ; quant à la troisième, contenue dans le second alinéa, elle reconnait aux États le pouvoir de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, parmi d’autres, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 134, CEDH 2004-V ; Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, 23 février 1995, § 55, série A no 306-B).
73. La Cour rappelle aussi que la notion de « biens » prévue par la première partie de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des « droits de propriété » et donc des « biens » au sens de cette disposition. Ce qui importe, c’est de rechercher si les circonstances d’une affaire donnée, considérées dans leur ensemble, peuvent passer pour avoir rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 62, CEDH 2010 c. France [GC], § 62 ; Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 63, CEDH 2007-I ; Öneryildiz c. Turquie [GC], no 48939/99, § 214, CEDH 2004-XII ; Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-I ; Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 1999-II).
74. La Cour a déjà considéré que des actions ayant une valeur économique peuvent être considérées comme des biens (Olczak c. Pologne (déc.), no 30417/96, § 60, CEDH 2002-X ; Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 91, CEDH 2002-VII). Ceci s’applique également aux parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée, comme dans le cas d’espèce.
75. En l’espèce, la Cour note qu’est en cause la saisie par l’administration fiscale d’une part sociale que la requérante détenait dans la société B., laquelle présentait une valeur officielle de 3 750 000 PTE (soit 18 704 EUR). Même si la part sociale en question n’avait plus de valeur patrimoniale au moment de la saisie, comme l’affirme le Gouvernement, il convient de rappeler qu’une violation de la Convention peut intervenir même en l’absence de préjudice, cette dernière question n’entrant en jeu – le cas échéant – que sur le terrain de l’article 41 (Ilhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 52, CEDH 2000-VII ; Jorge Nina Jorge et autres c. Portugal, no 52662/99, § 39, 19 février 2004 ; et Guerrera et Fusco c. Italie, no 40601/98, § 53, 3 avril 2003). La Cour en déduit que la part sociale en cause constituait dans le chef de la requérante un « bien » aux fins de l’article 1 du Protocole no 1.
76. La Cour rappelle que la saisie en question a été ordonnée par l’administration fiscale dans le but de garantir le paiement d’une dette fiscale de la société V. L’acte dénoncé résulte donc de l’exercice de prérogatives conférées dans le cadre du recouvrement de créances fiscales et de l’application des règles relatives aux procédures d’exécution forcée. Le grief doit donc être examiné sur le terrain du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, à savoir du droit reconnu aux États de mettre en place un cadre légal pour réglementer l’usage des biens dans l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
77. La Cour rappelle que, pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, une atteinte au droit d’une personne au respect de ses biens doit d’abord respecter le principe de la légalité et ne pas revêtir un caractère arbitraire (Iatridis c. Grèce [GC], précité, § 58). Elle doit également ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52).
78. Ce « juste équilibre » doit exister même lorsqu’est concerné le droit qu’ont les États de « mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ». En effet, comme le second alinéa doit s’interpréter à la lumière du principe général énoncé au début de l’article 1 du Protocole no 1, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; en d’autres termes, il incombe à la Cour de rechercher si l’équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et l’intérêt des individus concernés (Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, précité, § 60).
79. En l’espèce, ordonnée le 8 mars 2000 (voir ci-dessus paragraphe 16), la saisie de la part sociale de la requérante dans la société B. était prévue par le code de procédure fiscale (voir partie droit interne, ci-dessus au paragraphe 40) et visait au recouvrement d’une dette fiscale de la société V., dont la requérante était considérée comme responsable solidaire en sa qualité de gérante de fait.
80. Par un jugement du tribunal criminel d’Almada du 14 juillet 2000, la requérante a été acquittée du crime d’abus de confiance fiscal au motif qu’elle ne pouvait être considérée comme gérante de fait de la société V.
81. La Cour estime qu’il était légitime pour celle-ci de s’attendre à la levée de la saisie à partir de ce jugement. En refusant de lever la saisie de la part sociale que la requérante détenait dans la société B. malgré cet acquittement, les autorités portugaises ont rompu l’équilibre à ménager entre la protection du droit de la requérante au respect de ses biens et les exigences de l’intérêt général. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no1.
PAULET C. ROYAUME UNI requête 6219/08 du 13 mai 2014
Violation de l'article 1 du protocole 1 : Les juridictions britanniques auraient dû mettre en balance les droits de propriété du requérant et l’intérêt général dans une affaire de saisie sur salaire.
Dans cette affaire, M. Paulet se plaignait de la saisie sur salaire ordonnée contre lui après sa condamnation pour obtention d’un emploi au moyen d’un faux passeport. Il alléguait que l’ordonnance de saisie était disproportionnée en ce qu’elle aboutissait à la confiscation de l’intégralité des économies qu’il avait réalisées en près de quatre ans de travail effectif, sans qu’aucune distinction n’ait été établie entre son affaire et d’autres affaires portant sur des infractions plus graves telles que le trafic de stupéfiants ou le crime organisé.
La Cour estime que la portée du contrôle effectué en l’espèce par les juridictions nationales était trop étroite. Notamment, celles-ci se sont limitées à déclarer que l’ordonnance de saisie contre M. Paulet était justifiée par l’intérêt général, sans mettre en balance cet intérêt avec le droit de l’intéressé au respect de ses biens comme le veut la Convention.
Principaux faits
Le requérant, Didier Pierre Paulet, est un ressortissant ivoirien né en 1984 et résidant à Leeds (Angleterre).
Entré sur le territoire britannique en janvier 2001, le requérant vécut dans la clandestinité à Bedford.
Entre avril 2003 et février 2007, il exerça successivement trois emplois différents – dans une agence de recrutement, dans une entreprise de libre-service et comme conducteur de chariot élévateur –, se faisant recruter au moyen d’un faux passeport français.
La falsification du passeport de M. Paulet fut découverte en janvier 2007, lorsque l’intéressé sollicita l’octroi d’un permis de conduire provisoire, et des poursuites furent ouvertes contre lui. En juin 2007, devant la Crown Court de Luton, le requérant reconnut être coupable de plusieurs infractions, notamment d’avoir obtenu un avantage pécuniaire de manière frauduleuse. Il fut condamné à dix sept mois d’emprisonnement et fit l’objet d’une ordonnance de saisie d’un montant de 21 949,60 livres sterling.
Il fit appel de cette décision, arguant que l’ordonnance de saisie constituait un abus de procédure en ce qu’elle aboutissait à la confiscation de l’intégralité des économies qu’il avait réalisées en près de quatre ans de travail effectif. Il soutint en particulier qu’une ordonnance de saisie pouvait être qualifiée de « coercitive » si elle ne poursuivait pas le but légitime d’enlever au délinquant le produit de son crime, et rappela que le Parlement avait souhaité que la législation pertinente fût compatible.
La Cour admet qu'au moment où le requérant a introduit ses griefs devant les juridictions internes, il était pertinent d’argumenter en ce sens. À cet égard, elle note que ce n'est qu'en 2012, à l'occasion du prononcé d'un arrêt dans une autre affaire de saisie (R. v. Waya), que la Cour suprême britannique a estimé qu'il serait préférable en droit britannique d'analyser les affaires de ce type en termes de proportionnalité au regard de l'article 1 du Protocole n° 1 pour les plaignants qui invoquaient la notion d’« abus de procédure ».
Toutefois, la Cour estime qu'étant donné que le droit interne, au moment où l'affaire de M. Paulet a été tranchée, autorisait les juridictions nationales à examiner uniquement si une ordonnance de saisie était « coercitive » ou constituait un « abus de procédure », la portée du contrôle qu’elles exerçaient alors était trop étroite. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 dans les circonstances de l’espèce.
Article 41 (satisfaction équitable)
La Cour dit, par cinq voix contre deux, que le Royaume-Uni doit verser au requérant 2 000 euros (EUR) pour dommage moral et 10 000 EUR pour frais et dépens.
VARVARA c. ITALIE Arrêt du 29 octobre 2013 Requête 17475/09
UNE SAISIE DOIT ÊTRE PREVUE PAR LA LOI
84. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » ; le second alinéa reconnaît aux États le droit de réglementer l’usage des biens en mettant en vigueur des « lois ». De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II ; Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III). Il s’ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52 ; Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 89, CEDH 2000-XII) ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire.
85. La Cour vient de constater que l’infraction par rapport à laquelle la confiscation a été infligée au requérant n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 7 de la Convention et était arbitraire (paragraphes 72-73 ci-dessus). Cette conclusion l’amène à dire que l’ingérence dans le droit au respect des biens du requérant était contraire au principe de la légalité et était arbitraire et qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. Cette conclusion dispense la Cour de rechercher s’il y a eu rupture du juste équilibre.
ARRÊT MAZELIE c. FRANCE du 27 JUIN 2006 Requête no 5356/04
21. La Cour estime que l’examen de l’affaire sous l’angle du droit de l’intéressé au respect de ses biens oblige – tout en gardant à l’esprit le contexte particulier dans lequel elle s’inscrit – à distinguer trois griefs relatifs, respectivement, à la responsabilité de l’Etat quant aux dégâts causés au bien du requérant, à la vente forcée de la propriété du requérant et à l’attitude de la commune de la Ferté-Milon et de l’Etat.
1. La responsabilité de l’État quant aux dégâts causés au bien du requérant
22. Selon la Cour, si les dégâts causés à l’immeuble du requérant à l’occasion des travaux effectués sur la muraille posent manifestement une question sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, force est de constater que le juge administratif a conclu à la responsabilité de l’Etat et l’a condamné à payer au requérant une somme correspondant au coût de la remise en état ainsi que 15 245 EUR au titre de la réparation du trouble de jouissance (voir le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 16 mai 2002 et l’arrêt de la cour administrative l’appel de Douai du 29 juin 2004 ; paragraphe 13 ci-dessus). Ainsi les juridictions saisies ont constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 – en substance tout au moins – et ont pris des mesures propres à y remédier, de sorte que le requérant ne peut plus à cet égard, se dire « victime » de la violation dénoncée.
Cette partie de la requête est en conséquence irrecevable et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. La vente forcée de la propriété du requérant sur demande d'un créancier
23. Il n’est pas exclu que la vente forcée d’un bien par adjudication judiciaire à la demande d’un créancier du propriétaire emporte violation de l’article 1 du Protocole no 1 lorsque – comme, aux dires du requérant, cela fut le cas en l’espèce – la créance est sans rapport avec la valeur réelle dudit bien ou que la vente judiciaire aboutit à la cession de celui-ci à vil prix.
Cependant, à supposer qu’il puisse être considéré que le requérant a développé ne serait-ce qu’en substance un grief de cette nature dans le cadre de la procédure de saisie immobilière (paragraphe 15 ci-dessus), force est de constater que cette procédure s’est achevée avec l’arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2003, soit plus de six mois avant la saisine de la Cour.
Par ailleurs, si, au vu des motifs du jugement du 15 avril 2005 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Soissons (paragraphe 16 ci-dessus), il n’est pas exclu que la procédure diligentée ensuite – vainement – par le requérant devant ce magistrat (afin de voir condamner son créancier à des dommages intérêts pour avoir mis en œuvre une procédure d’exécution disproportionnée et constitutive d’un abus de droit) puisse constituer une voie de recours interne au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour constate que le requérant n’a pas interjeté appel dudit jugement, donc n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de ces dispositions.
La Cour déduit de ce qui précède que cette partie de la requête est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. L’attitude de la commune de la Ferté-Milon et de l’État
24. Le requérant dénonce l’attitude de la ville de La Ferté-Milon et de l’Etat à son égard ; il leur impute la volonté de lui imposer indûment la propriété de remparts appartenant à l’État et jouxtant son immeuble, dans le but de mettre leur restauration à sa charge ; il se plaint en particulier des procédures causée par eux à cette illégitime fin durant plus de 30 ans, et des conséquences que ces circonstances eurent sur l’exercice et la jouissance de son droit de propriété.
25. La Cour considère que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Relevant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle la déclare recevable.
26. Ceci étant, la Cour relève que, tenant le requérant pour propriétaire des remparts litigieux jouxtant le fonds de ce dernier, la commune de la Ferté-Milon lui a attribué la responsabilité de l’onéreuse consolidation de ceux-ci et, agissant en conséquence, l’a mis en demeure de réaliser divers travaux. S’en est suivi un contentieux de plusieurs années, au cœur duquel se trouvait la question de la propriété du requérant sur lesdits remparts. Durant cette longue période, le droit de propriété de l’intéressé sur son fonds s’est trouvé lesté d’une charge qui en affectait notablement le plein exercice, dès lors qu’un bien ainsi grevé perd indubitablement de sa valeur marchande et que, de fait, la capacité de son propriétaire d’en disposer se trouve limitée. Il en va d’autant plus de la sorte que s’ajoute à cela le fait que la commune a, en 1985, pris une hypothèque sur ledit bien afin de garantir le remboursement par l’intéressé de travaux qu’elle avait elle-même effectués sur les remparts litigieux.
La Cour estime que ces circonstances caractérisent une ingérence dans l’exercice du droit de propriété du requérant – ce que le Gouvernement ne conteste d’ailleurs pas – à la base de laquelle se trouve l’attitude de la commune de la Ferté-Milon.
27. Selon la Cour, ces circonstances relèvent de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, aux termes de laquelle « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ».
28. Aux fins de cette disposition, la Cour doit en principe rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, par exemple, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52 § 69). A cet égard, la Cour considère que les mesures prises par les autorités administratives pour parer aux dangers résultant d’immeubles menaçant ruine répondent à l’évidence à des objectifs d’utilité publique et à un but d’intérêt général (voir SCP la Providence c. France, requête no 78070/01, décision du 22 septembre 2005.)
L’article 1 du Protocole no 1 exige cependant avant tout et surtout qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale ; il s’ensuit que « la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire » (arrêt Iatridis v. Greece [GC] du 25 mars 1999, no 31107/96, ECHR 1999-II, § 58).
29. La Cour constate qu’il est aujourd’hui clair que les remparts litigieux sont la propriété de l’Etat dès lors qu’il sont une dépendance et constituent l’accessoire d’un château inscrit au tableau des biens de l’Etat établi en 1926 – comme étant affecté au ministère de l’instruction publique et des beaux arts depuis 1856 – et qu’il revient en conséquence à l’Etat d’en assurer la maintenance. Cela ressort en particulier de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 25 mai 2000 (paragraphe 14 ci-dessus) et du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 16 mai 2002 (paragraphe 13 ci-dessus), ainsi que des observations déposées par le ministre de la culture et de la communication le 27 janvier 2003 devant la cour administrative d’appel de Douai (dont le requérant produit une copie).
La Cour ne peut que s’étonner qu’il ait fallu plus de trente ans et plusieurs procédures pour parvenir à un constat qui semble relever de l’évidence. Elle a en particulier des difficultés à comprendre que l’Etat, assigné dès le 27 février 1973 en intervention forcée dans l’instance civile dont l’objet était précisément de déterminer le propriétaire des remparts litigieux (paragraphe 8 ci-dessus), ne soit pas de bonne heure parvenu à cette conclusion. Elle ne peut voir dans cette attitude qu’une grave négligence administrative, qui a eu pour le requérant d’importantes conséquences préjudiciables.
30. Comme évoqué précédemment, l’ingérence litigieuse a sa source dans les arrêtés de péril du maire de la Ferté-Milon des 14 novembre 1969 et 23 avril 1970 mettant le requérant en demeure de procéder à des travaux sur les remparts dont il est question, lesquels, pris en application des articles 303 et 304 du code de l’urbanisme, reposaient sur le postulat erroné que l’intéressé en était propriétaire.
Or les événements qui suivirent en sont la conséquence directe. C’est en effet ce postulat erroné qui a obligé le requérant à saisir, le 29 septembre 1970, le tribunal de grande instance de Soissons pour voir trancher la question de la propriété des remparts et à s’engager ainsi dans une procédure qui dura presque 20 ans (paragraphe 8 ci-dessus), question qui ne fut complètement et définitivement réglée en sa cause qu’avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 juin 2005 clôturant la procédure entamée le 17 février 1998 devant le juge administratif (paragraphe 13 ci-dessus). Là se trouve également le fondement de l’hypothèque prise par la commune de la Ferté-Milon de 1985 à 1990 sur le bien du requérant (paragraphe 10 ci-dessus) et de la condamnation de ce dernier, en 1989, au remboursement partiel du coût des travaux exécutés par celle-ci (paragraphe 11 ci-dessus).
Il apparaît ainsi que l’ingérence dont le requérant a eu à souffrir dans l’exercice de son droit au respect de son bien repose, dans son fondement même, sur une erreur de droit entièrement imputable aux autorités et portant sur la propriété de la plus grande partie des remparts bordant la propriété du requérant. La Cour en déduit que, dans les circonstances particulières de la cause, elle ne s’appuyait pas sur une base légale suffisante, et qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no1 de ce chef.
COUR DE CASSATION FRANÇAISE
UNE SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS SUR LE PATRIMOINE PERSONNEL D'UN DIRIGEANT DE SOCIETE
SANS CREANCE EXIGIBLE ET LIQUIDE EST CONFORME A L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 31 mai 2011 requête n° 10-18472 REJET
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2010), que la SAS
Lenny Spangberg organisation internationale (la société) a
été mise le 27 mars 2009 en liquidation judiciaire, la
société Gauthier Sohm étant désignée liquidateur (le
liquidateur) ; que celui-ci a engagé une action en
responsabilité pour insuffisance d'actif notamment contre M. X...,
ancien dirigeant, et présenté une requête aux fins de saisies
conservatoires sur certains de ses biens ; que ces saisies ont
été autorisées par ordonnances des 6 mai et 15 mai 2009 et
dénoncées à M. X... qui en a demandé l'annulation et
subsidiairement la rétractation
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble
de ses demandes et confirmé les ordonnances des 6 mai et 15 mai
2009, alors, selon le moyen, que toute personne a droit au
respect de ses biens ; qu'une mesure conservatoire ne peut être
ordonnée sur les biens d'un débiteur que si son créancier
dispose d'une créance paraissant fondée dans son principe et
justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le
recouvrement ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes en
nullité ou en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées
à son encontre et des ordonnances autorisant celles-ci, après
avoir constaté que le président du tribunal de commerce qui les
avait prononcées s'était borné à relever l'utilité de la
prise de mesures conservatoires sur les biens de M. X..., la cour
d'appel a violé par refus d'application, l'article 67 de la loi
du 9 juillet 1991, et l'article 210 du décret du 31 juillet 1992,
ensemble l'article 1er du protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt, sans violer les
dispositions de l'article 1er du protocole additionnel à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, retient que l'article L. 651-4, alinéa 2, du code
de commerce, dérogeant à l'article 67 de la loi du 9 juillet
1991, permet au président du tribunal, pour l'application des
dispositions de l'article L. 651-2 du même code, d'ordonner
toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des
dirigeants et des représentants permanents des dirigeants
personnes morales mentionnés à l'article L. 651-1 ; que le
moyen n'est pas fondé.
DROIT AU LOGEMENT CONTRE DROIT DU BAILLEUR
Cliquez sur un lien bleu pour accéder au :
- DROIT AU LOGEMENT PEUT S'OPPOSER A L'EXPULSION DES LOCATAIRES
- REFUS DU PREFET D'EXPULSER DES LOCATAIRES SANS INDEMNISER LE BAILLEUR EST UNE VIOLATION
- REFUS D'EXPULSION DU SQUATTER
- BLOCAGE DES LOYERS, NON CONFORME SI LES LOYERS SONT TROP BAS.
LE DROIT AU LOGEMENT PEUT S'OPPOSER A L'EXPULSION DES LOCATAIRES
DÉCISION DE REJET COFINFO CONTRE FRANCE REQUÊTE 23516/08 DU 12/10/2010
LA COFINFO A ETE INDEMNISEE DU REFUS D'EXPULSER MAIS ELLE CONSIDERE QUE L'INDEMNISATION NE CORRESPOND PAS A LA VALEUR DE L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION
La Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judicaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, entre autres, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
Par ailleurs, la Cour a considéré que si on peut admettre que les Etats interviennent dans une procédure d'exécution d'une décision de justice, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d'empêcher, d'invalider ou encore de retarder de manière excessive l'exécution, ni moins encore, de remettre en question le fond de cette décision (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, CEDH 1999-V). Un sursis à l'exécution d'une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d'ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (ibidem, § 69).
La Cour rappelle en outre que, si le droit à l'exécution d'une décision de justice est un des aspects du droit d'accès à un tribunal (Hornsby, précité, § 40), ce droit n'est pas absolu et appelle par sa nature même une réglementation par l'Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il revient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime, et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si la restriction est compatible avec ses principes, il n'y a pas de violation de l'article 6 (Popescu c. Roumanie, no 48102/99, 2 mars 2004, § 66, et Matheus, précité, § 55).
En l'espèce, la Cour observe que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris n'a pas reçu exécution jusqu'à l'évacuation du bâtiment litigieux pour raisons de sécurité, soit pendant plus de sept années. Certes, elle note que la requérante a été indemnisée pour responsabilité de l'Etat du fait du refus de prêter son concours à l'exécution de cette ordonnance, au titre d'une partie de la période en question. Néanmoins, cette indemnisation ne saurait, en tout état de cause, constituer une exécution ad litteram de la décision litigieuse, de nature à permettre à la requérante de recouvrer la jouissance de son bien (Matheus, précité, § 58).
Pour autant, la Cour estime qu'il y a lieu de prendre en considération les circonstances particulières de l'affaire. Ainsi, elle observe que le refus des autorités de procéder à l'exécution de la décision ne résultait pas d'une carence de leur part. A la différence de l'affaire Matheus précitée, les juridictions administratives n'ont d'ailleurs retenu aucune faute à l'encontre de l'administration. Il apparaît au contraire qu'un tel refus répondait au souci de pallier les risques sérieux de troubles à l'ordre public liés à l'expulsion de plusieurs familles, parmi lesquelles se trouvaient majoritairement des enfants, et ce d'autant que cette occupation s'inscrivait dans le cadre d'une action militante à visée médiatique. De surcroît, les occupants se trouvaient en situation de précarité et fragilité, et apparaissaient mériter, à ce titre, une protection renforcée (voir, a contrario, Immobiliare Saffi, précité, § 58, et Matheus, précité, § 59).
La Cour note également que les refus successifs opposés à la requérante ont été soumis à un contrôle juridictionnel, en l'occurrence celui du juge administratif (voir, a contrario, Immobiliare Saffi, précité, § 72), lequel a rejeté à trois reprises ses recours.
Quant au fait que l'attitude de l'administration a perduré dans le temps, la Cour considère, tout en rappelant que l'absence de logements de substitution ne saurait justifier un tel comportement (Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 53, CEDH 2004-III (extraits)), que les autorités ne sont pas restées inertes pour trouver une solution au problème posé. Dans ce contexte, la Cour rappelle également qu'une certaine marge d'appréciation est reconnue aux autorités nationales dans l'application des lois relevant de la politique sociale et économique, plus particulièrement dans le domaine du logement ou de l'accompagnement social de locataires en difficulté (voir, a contrario, Matheus, précité, § 68, et R.P. c. France, no 10271/02, § 36, 21 janvier 2010). Il y a lieu de prendre en compte, à cet égard, les délais qui auraient, en tout état de cause, été nécessaires au relogement de soixante-deux personnes, soit seize familles. La Cour note que les autorités municipales ont exercé leur droit de préemption lorsque la requérante a mis en vente l'immeuble en 2001, puis qu'une procédure d'expropriation, certes contestée par la requérante et encore pendante de ce fait, a été ensuite mise en œuvre par l'Etat.
La Cour estime enfin devoir tenir compte de l'atteinte portée aux intérêts de la requérante. Elle note à cet égard que la société Kentucky, aux droits de laquelle vient la requérante, qui n'a fait état d'aucun projet de viabilisation des lieux dans le délai de deux ans antérieur à leur occupation, a par ailleurs tardé à contester le premier refus qui lui a été opposé, comme l'a noté le juge administratif dans son ordonnance du 1er juin 2002. Cette société a ensuite mis en vente l'immeuble, afin d'obtenir le bénéfice d'une disposition fiscale, avant de se rétracter, alors que la ville de Paris avait exercé son droit de préemption. Enfin, il apparaît qu'après le rejet, le 10 octobre 2003, de sa requête en référé au motif de l'exercice de ce droit, la société Kentucky, puis la requérante, bien qu'ayant ensuite renoncé à la vente, n'ont pas renouvelé de demande directe d'exécution de la décision du 22 mars 2000.
Dans ces conditions, si elle retient que la requérante a indéniablement subi une atteinte à ses intérêts, la Cour n'estime pas devoir qualifier celle-ci de disproportionnée au regard des considérations sérieuses d'ordre public et social ayant motivé le refus qui lui a été opposé, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, par l'administration.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le refus des autorités françaises de prêter leur concours à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 22 mars 2000 n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la substance du droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
SUR L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1
La requérante se plaint également, du fait du défaut d'octroi de la force publique, d'avoir subi une atteinte au droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement affirme à titre principal que la requérante ne peut plus prétendre être victime d'une atteinte au respect de ses biens. En effet, pour le Gouvernement, le juge administratif a reconnu le préjudice subi par la requérante du fait de l'inexécution d'une décision de justice, constitutive de l'atteinte litigieuse, et a procédé, par une décision dont le Gouvernement rappelle les motifs, à une réparation appropriée en lui allouant une indemnité. En outre, pour le Gouvernement, la réparation du préjudice est totale du fait de l'évacuation de l'immeuble en 2007, le grief étant par ailleurs prématuré pour la période courant à compter du 29 juin 2005.
Le Gouvernement estime subsidiairement que l'existence d'un préjudice tiré d'une perte de loyers n'est pas avérée. Se référant à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris, il fait valoir que la requérante n'avait pas l'intention de se comporter en bailleur. Il fait à nouveau remarquer que la requérante n'aurait pas formé le recours approprié pour recouvrer l'usage de son bien. De surcroît, le Gouvernement avance que le refus du concours de la force publique résulte d'impératifs d'ordre public et social et non d'une carence des autorités, qui auraient au contraire cherché à reloger les occupants de l'immeuble. D'ailleurs, selon le Gouvernement, le juge administratif aurait reconnu la légitimité de la position de l'administration en allouant à la requérante des indemnités sur le fondement de la responsabilité sans faute. Le Gouvernement en conclut que ces indemnités, même réduites en appel, ont permis de maintenir un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts de la requérante.
La requérante se plaint en revanche de ne pas avoir obtenu de réparation adéquate. Elle considère que la juridiction administrative a procédé, sans recourir à une méthode d'évaluation du préjudice, à une indemnisation incomplète, ignorant les pertes de loyers, les charges liées à l'occupation et les dégradations commises par les occupants, alors même que la requérante aurait été empêchée de rénover l'immeuble du fait de son occupation. Elle ajoute qu'il lui a été impossible de reprendre possession du bien, du fait de l'arrêté préfectoral d'interdiction d'occuper l'immeuble, puis de l'expropriation.
La Cour observe que le grief soulevé par la requérante sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 se confond dans une large mesure avec celui tiré de l'article 6 de la Convention. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue au regard de ce dernier article, et sans qu'il soit besoin d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose au regard de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, a contrario, Matheus, précité, § 72). En particulier, à supposer même que la question de la qualité de victime de la requérante puisse se poser, compte tenu de la décision interne d'indemnisation, son examen distinct n'est pas justifié, étant donné la réponse précédemment apportée par la Cour sous l'angle de la proportionnalité de l'action des autorités.
Partant, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
LE REFUS DU PREFET D'EXPULSER DES LOCATAIRES
SANS INDEMNISER LE BAILLEUR EST UNE VIOLATION
Arrêt Matheus contre France du 31/03/2005 requête 62740/00
Le refus par le préfet, d'expulser un locataire après une décision de justice est une violation de l'article 1 du protocole 1
68. La Cour est d’avis qu’à la différence de l’affaire Immobiliare Saffi (§ 46), l’interférence mise en cause par le requérant ne s’analyse pas en une mesure de réglementation de l’usage des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Certes, la procédure d’expulsion et l’octroi de la force publique en cas de difficulté ne reposent plus sur de simples circulaires administratives ou sur la jurisprudence (Hayot et société caraïbe de développement c. France, no 19053/91, Rapport de la Commission du 5 septembre 1995) puisqu’elle a reçu des fondements législatifs avec notamment les articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 (voir § 37 ci-dessus). Toutefois, en l’espèce, et bien que la question du relogement de l’occupant au travers de la procédure d’exécution dût être prise en compte, le refus du concours de la force publique ne découle pas de l’application d’une loi relevant d’une politique sociale et économique dans le domaine du logement ou d’accompagnement social de locataires en difficulté mais d’une carence des huissiers et du préfet, voire d’un refus délibéré de la part de ce dernier, dans des circonstances locales particulières, et pendant seize années de prêter main-forte dans une procédure d’expulsion. Selon la Cour, il serait exagéré au vu de ces circonstances de considérer que la situation dénoncée ayant entraîné le maintien de l’occupant sur le terrain relève d’une réglementation de l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La Cour estime plutôt que le défaut d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Basse Terre du 11 avril 1988 doit être examiné à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole No 1 à la Convention qui énonce le droit au respect de sa propriété.
69. A cet égard, la Cour rappelle que l’exercice réel et efficace du droit que cette l’article 1 du Protocole No 1 garantit ne saurait dépendre uniquement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (arrêt Öneryildiz c. Turquie [GC], no 48939/99, 30 novembre 2004, § 134).
70. Par ailleurs, combiné avec la première phrase de l’article 1 du Protocole No 1, la prééminence du droit, l’un des principe fondamentaux d’une société démocratique, inhérente à l’ensemble des articles de la Convention, justifie la sanction d’un Etat en raison du refus de celui-ci d’exécuter ou de faire exécuter une décision de justice (arrêts Georgiadis c. Grèce, no 41209/98, 28 mars 2000, § 31 et Katsaros c. Grèce, no 51473/99, 6 juin 2002, § 43).
71. La Cour observe que seize années durant, les autorités et agents de l’Etat ont refusé d’apporter leur concours à l’exécution de la décision litigieuse sans que des considérations sérieuses d’ordre public ou social, n’expliquent ce laps de temps déraisonnable. Il en résulte qu’elles n’ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauvegarder les intérêts patrimoniaux du requérant. Certes, leur responsabilité a été engagée du fait de la faute commise, et le requérant s’est vu allouer des indemnités qui ont effectivement été versées. Toutefois, la Cour est de l’avis que l’attribution de ces indemnités n’est pas de nature à combler l’inaction des autorités. Face aux intérêts individuels en cause, il appartenait à celles-ci de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires au respect de la décision de justice. Force est de constater que le refus d’apporter le concours de la force publique en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont l’occupant illégal s’est retrouvé bénéficiaire. Cette situation renvoie au risque de dérive - en l’absence d’un système d’exécution efficace - rappelé dans la Recommandation du Comité des Ministres en matière d’exécution des décisions de justice, d’aboutir à une forme de « justice privée » (voir § 40 ci-dessus) contraire à la prééminence du droit.
72. Pour des raisons similaires à celles exposées au regard de l’allégation de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour considère, eu égard à ce qui précède, qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole No1.
FERNANDEZ et AUTRES c. FRANCE du 21 JANVIER 2010 Requête 28440/05
Une confirmation de la jurisprudence Matheus
30. Comme dans l’affaire Matheus (précitée), la Cour considère que le refus de concours de la force publique en l’espèce ne découle pas de l’application d’une loi relevant d’une politique sociale et économique dans le domaine, par exemple, du logement ou d’accompagnement social de locataires en difficulté, mais d’une carence des autorités locales et notamment du préfet, voire d’un refus délibéré de la part de celles-ci, dans des circonstances locales particulières et pendant une longue période, de prêter main-forte aux occupations illégales de terres. Le défaut d’exécution de la décision définitive du 19 avril 1983 doit dès lors être examiné à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 qui énonce le droit au respect de sa propriété.
31. La Cour rappelle, à cet égard, que l’exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit ne saurait en effet dépendre uniquement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (Öneryildiz c. Turquie [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII, et Matheus précité, § 68).
32. Par ailleurs, combiné avec la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, la prééminence du droit, l’un des principe fondamentaux d’une société démocratique, inhérente à l’ensemble des articles de la Convention, justifie la sanction d’un Etat en raison du refus de celui-ci d’exécuter ou de faire exécuter une décision de justice (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 43, 6 juin 2002, et Georgiadis c. Grèce, no 41209/98, § 31, 28 mars 2000).
33. En l’espèce, la Cour constate qu’une grande partie des terres, à savoir 880 hectares, a été vendue en 1983 et qu’il n’y a donc pu y avoir, ultérieurement à cette vente, d’occupation illégale sur les terrains cédés au préjudice des requérantes. Par ailleurs, la Cour note que ces dernières n’ont pas fait l’objet d’un refus exprès de la part du préfet, faute pour elles de l’avoir saisi d’une demande, et ce indépendamment de l’utilité d’une telle démarche au regard du contexte local. Il reste que la Cour prend note des observations du Gouvernement et relève que depuis le 19 avril 1983, date de la décision judiciaire définitive d’expulsion, les autorités n’ont rien entrepris pour faire libérer les terres encore illégalement occupées. Elle constate que le Gouvernement ne justifie aucunement l’inaction des autorités.
34. Bien que consciente des difficultés rencontrées par les autorités françaises pour renforcer l’Etat de droit en Corse, la Cour estime que les arguments avancés en l’espèce ne sauraient constituer un motif légitime sérieux et suffisant pour justifier la carence des autorités, qui avaient l’obligation de protéger les intérêts patrimoniaux des requérantes. Ainsi, la Cour constate, contrairement à ce que le Gouvernement semble soutenir en faisant référence à l’affaire Lunari (précité), que les autorités n’ont pas sursis à l’exécution de la mesure judiciaire, ni cherché une autre solution pour remédier à la situation, mais qu’elles refusaient de l’exécuter lorsqu’elles étaient saisies d’une telle demande (Barret et Sirjean c. France (déc.), no 13829/03, 3 juillet 2007).
35. De l’avis de la Cour, il appartenait aux autorités, dès qu’elles furent informées de la situation des requérantes, de prendre, dans un délai raisonnable, toutes les mesures nécessaires afin que la décision de justice soit respectée et que les requérantes retrouvent la pleine jouissance de leurs biens. Elle estime que l’inaction des autorités en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont les occupants illégaux se sont retrouvés bénéficiaires (Matheus précité, § 71). En laissant perdurer une telle situation, les autorités ont non seulement encouragé certains individus à dégrader en toute impunité les biens des requérantes, mais également laissé s’installer un climat de crainte et d’insécurité non propice à leur retour sur leur domaine.
36. La Cour remarque que ce type de situation témoigne de l’inefficacité du système d’exécution et renvoie au risque de dérive – rappelé dans la Recommandation du Comité des Ministres en matière d’exécution des décisions de justice – d’aboutir à une forme de « justice privée » qui peut avoir des conséquences négatives sur la confiance et la crédibilité du public dans le système juridique (ibid.).
37. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il a été porté atteinte au droit au respect des biens des requérantes. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
BARRET ET SIRJEAN c. FRANCE du 21 JANVIER 2010 Requête 13829/03
une confirmation de la jurisprudence Matheus
39. S’agissant tout d’abord des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, lequel invoque la perte alléguée de la qualité de victime des requérants et le défaut d’épuisement partiel des voies de recours internes, en se fondant sur la procédure en responsabilité de l’Etat, la Cour rappelle d’emblée que, par une décision du 3 juillet 2007, elle a déclaré la présente requête recevable après avoir déjà examiné cette question. En effet, dans sa décision, pour écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la Cour, après avoir observé que les requérants se plaignent du défaut du concours de la force publique pour assurer l’exécution de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance du 22 novembre 2000, a relevé qu’une action devant le juge administratif pour une mise en cause de la responsabilité de l’Etat en raison du refus implicite opposé par le préfet n’était pas de nature à aboutir directement à l’exécution de cette décision, les requérants invoquant l’atteinte à leur droit de propriété et demandant la libération des lieux (voir, mutatis mutandis, Matheus c. France (déc.) no 62740/00, 18 mai 2004) ; elle a également jugé que ce sont les autorités qui sont tenues de prêter leur concours à l’exécution de l’arrêt afin que les requérants récupèrent leur bien immobilier et que, dès lors, l’obligation d’agir pesait sur les autorités et non pas sur les requérants. Il s’ensuit que les exceptions du Gouvernement, qui sont identiques ou se confondent avec l’exception déjà rejetée dans le cadre de la décision de recevabilité du 3 juillet 2007, ne sauraient être retenues.
40. Par ailleurs, comme dans l’affaire Matheus (précitée), la Cour considère que le refus de concours de la force publique ne découle pas de l’application d’une loi relevant d’une politique sociale et économique dans le domaine, par exemple, du logement ou d’accompagnement social de locataires en difficulté, mais d’une carence des autorités locales et notamment du préfet, voire d’un refus délibéré de la part de celles-ci, dans des circonstances locales particulières et pendant une longue période, de prêter main-forte aux requérants pour faire libérer leurs terres. Le défaut d’exécution de l’ordonnance du 22 novembre 2000 doit dès lors être examiné à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 qui énonce le droit au respect de sa propriété.
41. La Cour rappelle, à cet égard, que l’exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit ne saurait en effet dépendre uniquement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (Öneryildiz c. Turquie [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII, et Matheus précité, § 68).
42. Par ailleurs, combiné avec la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, la prééminence du droit, l’un des principe fondamentaux d’une société démocratique, inhérente à l’ensemble des articles de la Convention, justifie la sanction d’un Etat en raison du refus de celui-ci d’exécuter ou de faire exécuter une décision de justice (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 43, 6 juin 2002, et Georgiadis c. Grèce, no 41209/98, § 31, 28 mars 2000).
43. La Cour prend note des observations du Gouvernement et relève que depuis le 22 novembre 2000, date de la mesure judiciaire d’expulsion, les autorités n’ont rien entrepris pour faire libérer les terres illégalement occupées. Elle constate que le Gouvernement ne justifie pas l’inaction des autorités et se contente de faire référence, d’une façon générale et non suffisamment circonstanciée, aux nécessités de l’ordre public, ainsi qu’au risque d’une nouvelle occupation illégale de la propriété des requérants après l’évacuation par la force, ce qui, pour la Cour, est un motif inacceptable dès lors que les autorités internes étaient précisément censées protéger les requérants d’un tel risque.
44. Bien que consciente des difficultés rencontrées par les autorités françaises pour renforcer l’Etat de droit en Corse, la Cour estime que les arguments avancés en l’espèce ne sauraient constituer un motif légitime sérieux et suffisant pour justifier la carence des autorités, qui avaient l’obligation de protéger les intérêts patrimoniaux des requérants. Ainsi, la Cour constate, contrairement à ce que le Gouvernement semble soutenir en faisant référence à l’affaire Lunari (précité), que les autorités n’ont pas sursis à l’exécution de la mesure judiciaire, ni cherché une autre solution pour remédier à la situation, mais qu’elles ont simplement refusé de l’exécuter. Elles n’ont pas cherché pendant ce laps de temps à trouver une solution à l’amiable – même provisoire – avec les différents intéressés alors que, selon le Gouvernement, les nécessités de l’ordre public pouvaient le justifier ; et elles n’ont pas non plus tenté, après le rapport de gendarmerie transmis au préfet au mois de janvier 2002, de réévaluer la situation pour envisager une expulsion.
45. De l’avis de la Cour, il appartenait aux autorités, dès qu’elles furent informées de la situation des requérants, de prendre, dans un délai raisonnable, toutes les mesures nécessaires afin que la décision de justice soit respectée et que les requérants retrouvent la pleine jouissance de leurs biens. Elle estime que l’inaction des autorités en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont l’occupant illégal s’est retrouvé bénéficiaire (Matheus précité, § 71). En laissant perdurer une telle situation, les autorités ont non seulement encouragé certains individus à dégrader en toute impunité les biens des requérants, mais également laissé s’installer un climat de crainte et d’insécurité non propice au retour des requérants sur leurs terres.
46. La Cour remarque que ce type de situation témoigne de l’inefficacité du système d’exécution et renvoie au risque de dérive – rappelé dans la Recommandation du Comité des Ministres en matière d’exécution des décisions de justice – d’aboutir à une forme de « justice privée » qui peut avoir des conséquences négatives sur la confiance et la crédibilité du public dans le système juridique (ibid.).
47. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en refusant de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’occupation illégale des terres appartenant aux requérants et ce, pendant plusieurs années, les autorités françaises ont rompu l’équilibre à ménager entre les exigences de l’intérêt général et la protection de leurs intérêts patrimoniaux, et ont porté atteinte à leur droit au respect leurs biens. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
R.P c. FRANCE DU 21 JANVIER 2010 Requête 10271/02
encore une confirmation de la jurisprudence Matheus
36. Comme dans l’affaire Matheus (précitée), la Cour considère que le refus de concours de la force publique en l’espèce ne découle pas de l’application d’une loi relevant d’une politique sociale et économique dans le domaine, par exemple, du logement ou d’accompagnement social de locataires en difficulté, mais d’une carence des autorités locales, et notamment du préfet, voire d’un refus délibéré de la part de celles-ci, dans des circonstances locales particulières et pendant une longue période, de prêter main-forte au requérant pour faire libérer ses terres. Le défaut d’exécution de l’arrêt du 9 avril 1998 doit dès lors être examiné à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 qui énonce le droit au respect de sa propriété.
37. La Cour rappelle, à cet égard, que l’exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit ne saurait en effet dépendre uniquement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (Öneryildiz c. Turquie [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII, et Matheus précité, § 68).
38. Par ailleurs, combiné avec la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, la prééminence du droit, l’un des principe fondamentaux d’une société démocratique, inhérente à l’ensemble des articles de la Convention, justifie la sanction d’un Etat en raison du refus de celui-ci d’exécuter ou de faire exécuter une décision de justice (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 43, 6 juin 2002, et Georgiadis c. Grèce, no 41209/98, § 31, 28 mars 2000).
39. La Cour prend note des observations du Gouvernement et relève que depuis le 9 avril 1998, date de la mesure judiciaire d’expulsion, les autorités n’ont rien entrepris pour faire libérer les terres illégalement occupées. Elle constate que le Gouvernement ne justifie pas l’inaction des autorités et se contente de faire référence, d’une façon générale et non suffisamment circonstanciée, aux nécessités de l’ordre public et à un risque d’affrontements armés.
40. Bien que consciente des difficultés rencontrées par les autorités françaises pour renforcer l’Etat de droit en Corse, la Cour estime que les arguments avancés en l’espèce ne sauraient constituer un motif légitime sérieux et suffisant pour justifier la carence des autorités, qui avaient l’obligation de protéger les intérêts patrimoniaux du requérant. Ainsi, la Cour constate, contrairement à ce que le Gouvernement semble soutenir en faisant référence à l’affaire Lunari (précité), que les autorités n’ont pas sursis à l’exécution de la mesure judiciaire, ni cherché une autre solution pour remédier à la situation, mais qu’elles ont simplement refusé de l’exécuter. Le fait que la durée de l’occupation illégale ne puisse être déterminée avec exactitude n’est pas de nature à justifier ce refus. La Cour relève d’ailleurs que non seulement l’occupant illégal n’a pas été expulsé, mais qu’il a au contraire bénéficié d’une aide active du préfet pour déposséder le requérant de ses terrains par le biais d’un arrêté finalement annulé par le juge administratif (paragraphe 24 ci-dessus).
41. De l’avis de la Cour, il appartenait aux autorités, dès qu’elles furent informées de la situation du requérant, de prendre, dans un délai raisonnable, toutes les mesures nécessaires afin que la décision de justice soit respectée et que le requérant retrouve la pleine jouissance de ses biens. Elle estime que l’inaction des autorités en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont l’occupant illégal s’est retrouvé bénéficiaire (Matheus précité, § 71). En laissant perdurer une telle situation, les autorités ont non seulement encouragé certains individus à dégrader en toute impunité les biens du requérant, mais également laissé s’installer un climat de crainte et d’insécurité non propice au retour du requérant sur ses terres.
42. La Cour remarque que ce type de situation témoigne de l’inefficacité du système d’exécution et renvoie au risque de dérive – rappelé dans la Recommandation du Comité des Ministres en matière d’exécution des décisions de justice – d’aboutir à une forme de « justice privée » qui peut avoir des conséquences négatives sur la confiance et la crédibilité du public dans le système juridique (ibid.).
43. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le refus continu des autorités de prêter main-forte au requérant pour mettre fin à l’occupation illégale de ses terrains a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
SUD EST REALISATIONS contre FRANCE du 2 décembre 2010 requête 6722/05
encore une confirmation de la jurisprudence Matheus
49. Comme elle l’a fait dans les affaires Matheus, R.P., Barret et Sirjean et Fernandez précitées, la Cour considère que le refus de concours de la force publique ne découle pas de l’application d’une loi relevant d’une politique sociale et économique dans le domaine, par exemple, du logement ou d’accompagnement social de locataires en difficulté, mais d’un refus des autorités locales, dans des circonstances particulières et pendant une longue période, de prêter main-forte à la requérante pour faire libérer ses terres. Le défaut d’exécution du jugement du 19 novembre 1992 doit dès lors être examiné à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, qui énonce le principe du respect de la propriété.
50. La Cour rappelle, à cet égard, que l’exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit ne saurait en effet dépendre uniquement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (Öneryildiz c. Turquie [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII, et Matheus précité, § 68).
51. Par ailleurs, combinée avec la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, la prééminence du droit, l’un des principe fondamentaux d’une société démocratique, inhérente à l’ensemble des articles de la Convention, justifie la sanction d’un Etat en raison du refus de celui-ci d’exécuter ou de faire exécuter une décision de justice (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 43, 6 juin 2002, Georgiadis c. Grèce, no 41209/98, § 31, 28 mars 2000, et Barret et Sirjean précité, § 42).
52. La Cour observe que les motifs avancés par les autorités internes pour refuser le concours de la force publique en vue de l’expulsion des époux C. répondaient au souci d’éviter des troubles à l’ordre public. Devant les juridictions administratives, les autorités ont également fait valoir des considérations d’ordre social. La Cour examinera successivement ces deux types de motifs.
53. Sur le premier point, le préfet et le sous-préfet ont constamment fait valoir que l’expulsion des époux C. était susceptible de provoquer des troubles graves à l’ordre public ; la lettre du préfet du 24 septembre 2002 (paragraphe 17 ci-dessus) soulignait qu’Alain C. « a(vait) toujours fait savoir clairement qu’il se défendrait par les armes ». Ce risque est corroboré par d’autres éléments du dossier, notamment par la lettre de l’huissier de justice du 9 septembre 1993.
54. La Cour relève qu’à la différence de l’affaire Matheus précitée, les juridictions administratives ont considéré que l’administration n’avait pas commis de faute en refusant le concours de la force publique et note que le juge des référés du Conseil d’Etat a constaté, au vu de procès-verbaux de gendarmerie, la réalité des troubles à l’ordre public que l’expulsion aurait engendrés (paragraphe 30 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour admet que les autorités internes ont pu, dans le cadre de leur marge d’appréciation, estimer que les nécessités de l’ordre public imposaient de différer le concours de la force publique (a contrario Matheus précité, §§ 59 et 71).
55. Toutefois, même si la Cour a dit mutatis mutandis dans plusieurs affaires (notamment Immobiliare Saffi c. Italie ([GC], no 22774/93, § 69, CEDH 1999-V et Lunari c. Italie, no 21463/93, § 45, 11 janvier 2001) « qu’un sursis à l’exécution d’une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire pour trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles », elle estime qu’un laps de temps de plus de seize ans ne correspond pas à la notion de « temps strictement nécessaire ».
56. En ce qui concerne les motivations d’ordre social, elles ont été soulevées devant les juridictions par l’administration, qui a fait valoir que la situation sociale et financière des époux C., qui ne disposaient pas de solution de relogement, était très difficile et que Mme C. connaissait de graves problèmes de santé. La Cour observe que les juridictions internes, et notamment la cour administrative d’appel et le juge des référés du Conseil d’Etat, ont estimé ces affirmations établies. Elle relève à cet égard que les circonstances de la présente affaire sont très différentes de celles des affaires Matheus, R.P., Barret et Sirjean et Fernandez précitées, où des occupants sans titre s’étaient installés ou maintenus illégalement sur les terres des requérants, alors qu’en l’espèce la requérante a acquis aux enchères publiques une propriété agricole qu’occupait encore l’ancien propriétaire.
57. La Cour considère toutefois que, aussi louables fussent-elles en leur temps (Matheus précité, § 59), ces considérations d’ordre social ne sauraient justifier une aussi longue période d’occupation sans titre. Elle estime surtout que le temps écoulé aurait dû permettre de trouver une solution au relogement des époux C., comme le laissaient supposer les lettres du préfet à la requérante des 11 janvier 1999 et 24 septembre 2002 (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Or, la Cour constate qu’il ne ressort pas du dossier que les autorités aient fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de trouver une solution de relogement satisfaisante pour les occupants et de sauvegarder ainsi les intérêts patrimoniaux de la requérante (a contrario et mutatis mutandis Société Cofinfo c. France (déc.), no 23516/08, 2 octobre 2010). En particulier, le Gouvernement n’a donné aucun détail sur les démarches qui ont pu être faites en ce sens, notamment depuis la lettre du préfet du 24 septembre 2002. La Cour relève en outre que les autorités internes n’ont pas contesté l’argument de la requérante selon laquelle M. C. disposait, pour se reloger, d’une maison en indivision proche de l’habitation qu’il occupait illégalement, et que le Gouvernement ne s’est pas davantage expliqué sur ce point.
58. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que, si les motifs avancés par les autorités françaises revêtaient un caractère sérieux de nature à différer la mise en œuvre de l’expulsion pendant un laps de temps raisonnable (a contrario, Matheus précité, § 71 et Barret et Sirjean précité, § 44), ils n’apparaissent cependant pas suffisants pour justifier pendant une aussi longue période le refus de concours de la force publique (a contrario décision Société Cofinfo précitée).
59. Certes, la responsabilité sans faute de l’Etat a été engagée, et la requérante, qui par ailleurs a revendu une grande partie de la propriété, s’est vu allouer des indemnités qui ont effectivement été versées. Toutefois, la Cour est de l’avis que l’attribution de ces indemnités n’est pas de nature à compenser l’inaction des autorités.
60. Face aux intérêts individuels en cause, il appartenait à celles-ci, après un laps de temps raisonnable pour trouver une solution satisfaisante, de prendre les mesures nécessaires au respect de la décision de justice. Force est de constater que le refus prolongé d’apporter le concours de la force publique en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont l’occupant illégal s’est retrouvé bénéficiaire. Cette situation renvoie au risque de dérive - en l’absence d’un système d’exécution efficace - rappelé dans la Recommandation du Comité des Ministres en matière d’exécution des décisions de justice, d’aboutir à une forme de « justice privée » contraire à la prééminence du droit (Matheus précité, § 71).
61. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1.
FONDATION FOYERS DES ÉLÈVES DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE ET STANOMIRESCU c. ROUMANIE
Requêtes 2699/03 et 43597/07 du 7 janvier 2014
45. Se référant à la requête introduite par la Fondation Foyers des élèves de l’Église réformée, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. A l’appui de sa thèse, il présente trois raisons : il reproche à la requérante d’avoir renoncé, en 2001, à l’exécution forcée du jugement définitif du 15 octobre 1998, de ne pas avoir introduit également à l’encontre de la régie une action visant à l’expulsion des locataires et de ne pas avoir formé un recours en garantie d’éviction à l’encontre de l’ancien propriétaire du terrain (sur ce dernier point, il renvoie à l’arrêt Tudor Tudor c. Roumanie, no 21911/03, §§ 38-43, 24 mars 2009).
46. En réponse aux observations du Gouvernement, la requérante affirme que, en dépit de toutes les démarches qu’elle dit avoir entreprises pendant plusieurs années en vue de l’exécution du jugement définitif rendu en sa faveur, l’exécution forcée n’a pas été réalisée.
47. S’agissant du premier argument avancé par le Gouvernement, la Cour observe que, s’il est vrai que la requérante, dans l’espoir d’un accord avec la débitrice, a renoncé à sa demande d’exécution en 2001, il n’est pas moins vrai que l’intéressée a formulé, après l’échec d’un tel accord, une nouvelle demande d’exécution forcée du jugement définitif du 15 octobre 1998 (paragraphes 14-17 ci-dessus).
48. S’agissant de la possibilité qu’aurait eue la requérante d’obtenir l’expulsion des occupants du bâtiment litigieux, la Cour note que tous les efforts que la requérante a déployés aux fins de faire expulser les locataires ont été vains (paragraphes 16 et 21-22 ci-dessus) et qu’il serait excessif de demander à l’intéressée d’introduire une nouvelle action en expulsion à l’encontre de la régie, alors que des baux ont été conclus après son action en expulsion et que la propriété des bâtiments a été transférée par la suite à la ville de Zetea.
49. S’agissant du troisième argument du Gouvernement, la Cour note que, à la différence de l’arrêt Tudor Tudor (précité) invoqué par le Gouvernement, affaire dans laquelle il y avait concurrence de deux titres de propriété sur un même bien, la requérante bénéficie en l’espèce d’une décision définitive de justice ordonnant aux autorités locales de procéder à un acte précis et que l’obligation qui en est résultée n’a pas été satisfaite en raison du refus de la régie d’obtempérer.
50. En tout état de cause, la Cour rappelle, à la lumière de sa jurisprudence constante en la matière, qu’il n’est pas opportun d’exiger d’un individu ayant obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire qu’il engage par la suite une nouvelle procédure afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, §§ 68-70, CEDH 2009). Par conséquent, aucune démarche supplémentaire n’était requise de la part de la requérante. Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
51. Constatant que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
a) Principes généraux découlant de la jurisprudence de la Cour
55. La Cour rappelle que le droit à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire restât inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, Okyay et autres c. Turquie, no 36220/97, § 72, CEDH 2005-VII, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V, et Costin c. Roumanie, no 57810/00, § 26, 26 mai 2005).
56. La Cour rappelle également que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier au jugement ou à l’arrêt qui sera éventuellement rendu contre elle en dernier ressort. Si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby, précité, § 41, Okyay et autres, précité, § 72, Nitescu c. Roumanie, no 26004/03, § 32, 24 mars 2009, Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 34, 22 décembre 2005, et Costin, précité, § 27).
57. La Cour rappelle en outre qu’un délai d’exécution déraisonnablement long d’un jugement obligatoire peut également emporter violation de la Convention (Bourdov (no 2), précité, § 66). Le caractère raisonnable d’un tel délai doit s’apprécier en tenant compte en particulier de la complexité de la procédure d’exécution, du comportement du requérant et des autorités compétentes, et de l’ampleur et de la nature de la réparation octroyée par le juge (Raylyan c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007).
58. En tout état de cause, une personne qui a obtenu un jugement contre l’État n’a pas à ouvrir une procédure distincte pour en obtenir l’exécution forcée : c’est au premier chef aux autorités de l’État qu’il incombe de garantir l’exécution d’une décision de justice rendue contre celui-ci, et ce dès la date à laquelle cette décision devient obligatoire et exécutoire. Pareil jugement doit être signifié en bonne et due forme à l’autorité concernée de l’État défendeur, laquelle est alors à même de faire toutes les démarches nécessaires pour s’y conformer ou pour le communiquer à une autre autorité de l’État compétente pour les questions d’exécution des décisions de justice. Il s’agit là d’un élément particulièrement important dans une situation où, du fait des complexités et du chevauchement possible des procédures de mise en œuvre volontaire ou d’exécution forcée, le justiciable peut raisonnablement être dans le doute quant au point de savoir quelle autorité est responsable en la matière (Metaxas, précité, § 19, Akachev c. Russie, no 30616/05, § 21, 12 juin 2008, Bourdov (no 2), précité, § 68, et Gjyli c. Albanie, no 32907/07, § 44, 29 septembre 2009).
59. Certes, les intéressés peuvent devoir effectuer certaines démarches procédurales de manière à permettre ou à accélérer l’exécution d’un jugement. L’obligation faite aux individus de coopérer ne doit toutefois pas excéder ce qui est strictement nécessaire et, quoi qu’il en soit, elle n’exonère pas l’administration de l’obligation que fait peser sur elle la Convention d’agir de sa propre initiative et dans les délais prévus, en se fondant sur les informations à sa disposition, afin d’honorer le jugement rendu contre elle (Akachev, précité, § 22, Bourdov (no 2), précité, § 69, Chvedov c. Russie, no 69306/01, §§ 29-37, 20 octobre 2005, et Kosmidis et Kosmidou c. Grèce, no 32141/04, § 24, 8 novembre 2007).
60. Enfin, quelle que soit la complexité de ses procédures d’exécution ou de son système budgétaire, l’État demeure tenu par la Convention de garantir à toute personne le droit à ce que les jugements obligatoires et exécutoires rendus en sa faveur soient exécutés dans un délai raisonnable. Une autorité de l’État ne peut pas non plus prétexter du manque de fonds ou d’autres ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (Bourdov (no 2), précité, § 70, et les références qui y figurent, et Société de gestion du port de Campoloro et Société fermière de Campoloro c. France, no 57516/00, § 62, 26 septembre 2006).
b) Application des principes susmentionnés dans la présente affaire
i. Le jugement définitif du 15 octobre 1998 (requête no 2699/03)
61. La Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties que le jugement définitif du 15 octobre 1998 n’a été ni exécuté ni annulé ni modifié à la suite de l’exercice par la requérante d’une voie de recours prévue par le droit interne. Il n’est pas non plus contesté que les débiteurs de l’obligation à exécuter sont partie intégrante de l’administration.
62. Toutefois, nonobstant la décision de justice favorable à la requérante, autant la régie que la mairie de Zetea se sont toujours opposées à l’exécution du jugement au motif que les bâtiments en question étaient occupés par des tierces personnes. À ce sujet, la Cour note que la thèse du Gouvernement se fonde sur l’inopposabilité du jugement aux tierces personnes occupant les bâtiments.
63. Sur ce point, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de confirmer ou d’infirmer le contenu d’une décision de justice interne. Elle ne peut cependant se dispenser de constater la situation juridique établie par les tribunaux à l’égard des parties. À cet égard, elle note que, en l’espèce, même à supposer qu’une divergence d’interprétation pût exister quant aux effets de l’occupation des bâtiments par des tierces personnes, les tribunaux nationaux ont jugé, en se fondant sur les éléments de preuve présentés par les parties, que la démolition desdits bâtiments s’imposait afin de permettre à la requérante d’avoir la libre jouissance de son terrain. Dès lors, ayant à l’esprit le principe de la prééminence du droit dans une société démocratique, la Cour estime que la décision définitive rendue par les juridictions nationales prévaut et que les autorités administratives étaient tenues de s’y conformer entièrement (Pântea c. Roumanie, no 5050/02, § 35, 15 juin 2006).
64. Bien que la Cour admette, comme le soutient le Gouvernement, qu’il existe des circonstances justifiant parfois l’échec de l’exécution en nature d’une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, elle estime que l’État ne peut pas se prévaloir d’une telle justification sans avoir dûment informé le requérant, par l’intermédiaire d’une décision judiciaire ou administrative formelle, de l’impossibilité d’exécuter telle quelle l’obligation initiale, surtout quand il agit en double qualité de détenteur de la force publique et de débiteur de l’obligation (Costin, précité, § 57).
65. Or, en l’espèce, les juridictions nationales n’ont jamais estimé que les autorités administratives n’étaient pas tenues d’exécuter le jugement définitif favorable à la requérante et elles n’ont pas constaté non plus l’existence d’une « impossibilité objective » susceptible de justifier leur refus de l’exécuter (voir, en ce sens, Ana Pavel c. Roumanie, no 4503/06, § 26, 16 mars 2010, et, a contrario, Strachinaru c. Roumanie, no 40263/05, § 16, 21 février 2008, Nitescu c. Roumanie, no 26004/03, § 16, 24 mars 2009, et Pistireanu c. Roumanie, no 34865/02, § 15, 30 septembre 2008).
66. Quant à la situation découlant de l’occupation des bâtiments à démolir, la Cour note que, ainsi qu’il ressort du dossier, les occupants n’avaient initialement aucun titre légal les autorisant à s’installer dans ces lieux (paragraphes 11-13 ci-dessus) et que ce n’est qu’après le prononcé du jugement favorable à la requérante et le début des démarches d’exécution forcée que les autorités ont conclu avec eux des baux de location (paragraphe 21 ci-dessus). Or ce constat vient contredire la thèse du Gouvernement en faveur de l’impossibilité objective d’exécution, car l’administration – dont l’intérêt doit être celui d’une bonne administration de la justice – a, par ses démarches, diminué les chances de la requérante de voir exécuter son jugement définitif. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre qu’il s’agit, en l’espèce, d’une situation dans laquelle l’inexécution du jugement en question était justifiée (voir, mutatis mutandis, Babei et Clucerescu c. Roumanie, no 27444/03, §§ 26-29, 23 juin 2009).
67. Enfin, s’agissant de l’affirmation du Gouvernement concernant l’éventuelle prescription du titre exécutoire de la requérante, la Cour observe que, ainsi qu’il ressort du dossier, la demande d’exécution forcée n’a pas été rejetée pour cause de prescription. Cette situation est confirmée également par la procédure d’exécution forcée qui est actuellement pendante (paragraphes 25-26 ci-dessus).
68. En tout état de cause, la Cour note que le jugement rendu par le tribunal de première instance d’Odorheiul Secuiesc le 15 octobre 1998 est devenu définitif et exécutoire le 5 octobre 2000, date à partir de laquelle les autorités défenderesses savaient ou étaient censées savoir qu’elles étaient tenues de procéder à la démolition des bâtiments édifiés sur le terrain de la requérante. À compter de ladite date, les autorités défenderesses étaient donc tenues de prendre, elles-mêmes ou en coopération avec d’autres organes compétents, départementaux et/ou locaux, toutes les mesures requises pour se conformer au jugement contraignant et exécutoire rendu à leur encontre. En s’abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au jugement définitif prononcé le 15 octobre 1998, les autorités ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
69. Par ailleurs, en refusant de se conformer au jugement définitif du 15 octobre 1998, les autorités nationales ont également privé la requérante de la possibilité d’utiliser son terrain, et ce sans lui fournir de justification pour l’inaction prolongée de l’État. L’impossibilité pour la requérante d’obtenir l’exécution de son jugement a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de ses biens, tel qu’énoncé dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1. À supposer que l’occupation desdits bâtiments par des tierces personnes pût justifier le défaut d’exécution, la Cour constate qu’aucune mesure compensatoire n’a été proposée par les autorités à la requérante pour que le juste équilibre commandé par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne fût pas rompu.
70. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu dans plusieurs affaires que l’omission des autorités, sans justification valable, d’exécuter dans un délai raisonnable une décision définitive rendue à leur encontre s’analyse en une violation du droit d’accès à un tribunal ainsi que du droit au respect des biens (Metaxas, précité, § 26, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-38, CEDH 2002-III, Sandor c. Roumanie, no 67289/01, §§ 23-37, 24 mars 2005, Orha c. Roumanie, no 1486/02, §§ 23-38, 12 octobre 2006, Ruxandra Trading c. Roumanie, no 28333/02, §§ 54-75, 12 juillet 2007, Pistireanu, précité, §§ 36-41, Nitescu, précité, §§ 39-41, Aurelia Popa c. Roumanie, no 1690/05, §§ 24-25, 26 janvier 2010, et Ana Pavel, précité, §§ 26-28).
71. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente espèce. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
ii. L’arrêt du 29 mai 2001 et le jugement définitif du 12 septembre 2005 (requête no 43597/07)
72. S’agissant de l’obligation mise à la charge du centre territorial par l’arrêt du 29 mai 2001, la Cour observe qu’elle a été exécutée avec un certain retard (paragraphe 32 ci-dessus), et ce sous la menace d’une astreinte comminatoire. Sur ce point, elle observe que la procédure engagée par le requérant avait pour but unique d’obliger les autorités administratives à procéder à une opération technique qui leur incombait afin qu’il pût exploiter le bois de sa propriété. Malgré le paiement de la prestation, malgré les relances successives effectuées par le requérant et malgré l’astreinte comminatoire, les autorités ne se sont acquittées de leur obligation qu’après un délai de plus d’un an et sans avancer aucun argument propre à justifier leur passivité.
73. S’agissant du jugement définitif du 12 septembre 2005 imposant deux obligations à la charge du centre départemental, la Cour observe que l’obligation d’estimation et de marquage du nombre d’arbres correspondant aux quotas pour les années 2001 et 2002 n’a pas été exécutée à ce jour. La thèse du Gouvernement, étayée par la seule lettre du centre départemental, n’est corroborée par aucun autre élément de preuve. Quant à l’obligation pécuniaire à la charge du centre départemental, la Cour constate qu’elle reste inexécutée à ce jour et que les héritiers du requérant n’ont toujours pas perçu la somme dont le paiement a été ordonné par les juridictions internes. D’ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas l’inexécution de cette obligation.
74. Renvoyant à sa jurisprudence pertinente en matière d’inexécution ou d’exécution tardive de décisions définitives de justice (paragraphes 55-60 et 70 ci-dessus), la Cour constate, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime que l’État, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires en vue de faire exécuter l’arrêt du 29 mai 2001 (dans sa partie concernant l’obligation d’estimation et de marquage des arbres) et le jugement définitif du 12 septembre 2005. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
LE REFUS D'EXPULSER LES SQUATTEURS
Papachela et Amazon S.A. c. Grèce du 3 décembre 2020 requête n° 12929/18
Article 1 du Protocole 1 : Inaction de l’État face au squat d’un hôtel par des migrants: violation du droit de propriété garanti par la Convention
L’affaire concerne l’occupation de l’hôtel de Mme Papachela et d’une société anonyme (dont Mme Papachela est l’unique actionnaire), pendant plus de trois ans, par des migrants et des personnes solidaires de ceux-ci. Les requérantes se plaignaient de l’inaction des autorités pour faire évacuer leur hôtel, dont l’occupation débuta en avril 2016 et s’acheva en juillet 2019, lorsque les occupants quittèrent l’hôtel de leur propre gré. Entretemps, les requérantes introduisirent plusieurs plaintes qui, soit furent ajournées soit ne furent pas examinées. En outre, la décision rendue par un juge de paix, ordonnant l’évacuation des lieux et la restitution de l’hôtel, ne fut jamais exécutée. Pendant ce temps, Mme Papachela dut vendre sa maison pour les dettes engendrées par l’occupation (taxes, factures d’eau et d’électricité), afin d’éviter des poursuites pénales. La Cour juge en particulier que, compte tenu des intérêts des requérantes, les autorités auraient dû, après un laps de temps raisonnable consacré à la recherche d’une solution satisfaisante, prendre les mesures nécessaires au respect de la propriété litigieuse. En restant inactives pendant plus de trois ans face à une situation qui a eu des répercussions importantes sur la propriété des requérantes, les autorités nationales ont rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels.
Article 34 • Qualité de victime de la société requérante, propriétaire de l’hôtel, et de la première requérante, seule actionnaire de cette société • La société et son actionnaire se confondant au point qu’il serait artificiel de les distinguer • Exception au principe que les actionnaires ne peuvent pas se prétendre victimes d’actes et de mesures affectant la société en tant que telle
Article 1 du Protocole no 1 • Obligations positives • Inaction des autorités face à l’occupation par des migrants de l’hôtel des requérantes pendant plus de trois ans, en dépit d’un ordre d’évacuation du procureur puis d’une décision judiciaire • Considérations publiques d’ordre social en période d’afflux migratoire • Long blocage du bien sans possibilité de l’exploiter et alourdissement des charges financières par des frais importants de consommation énergétique du bâtiment • Examen des plaintes des requérantes différé ou inexistant • Absence de prise en compte par les compagnies nationales d’électricité et d’eau de l’appel des requérantes de ne pas les tenir redevables de la consommation générée par les tiers • Absence de réponse de l’État à la tentative d’accord des requérantes visant le paiement des taxes et des factures atteignant plusieurs centaines des milliers d’euros • Absence de mesures nécessaires au respect de la propriété privée après un laps de temps raisonnable consacré à la recherche d’une solution satisfaisante • Juste équilibre rompu au détriment des requérantes
FAITS
En avril 2016, Mme Papachela constata que des personnes solidaires aux réfugiés avaient squatté son hôtel, lequel était inoccupé depuis mars 2010 et situé au centre d’Athènes. Elle en informa la police qui, lorsqu’elle arriva sur place, se contenta d’observer les mouvements des squatters. Mme Papachela porta plainte à plusieurs reprises contre différentes personnes. Plus tard, l’avocat des requérantes écrivit au procureur pour se plaindre qu’aucune action n’avait été entreprise pour faire évacuer l’hôtel. Le procureur ordonna une enquête préliminaire. Entretemps, les « solidaires » qui occupaient l’hôtel reconnectèrent illégalement l’électricité et l’eau. La société de Mme Papachela écrivit à la compagnie nationale d’électricité et à la compagnie nationale d’eau pour les informer de la situation. Aucune des deux compagnies ne répondirent. En revanche, en mars 2017, la société de Mme Papachela fut sommée de payer une facture de 81 500 euros (EUR), somme qui avait atteint 141 990 EUR le 12 février 2018. En avril 2017, la société de Mme Papachela déposa devant le juge de paix d’Athènes une demande de mesures provisoires tendant à faire expulser de l’hôtel ses occupants. En mai 2017, Mme Papachela fut informée qu’un ordre d’évacuation avait été émis par le procureur, mais qu’il n’avait pas été exécuté. En juillet 2017, le juge de paix (décision n o 1023/2017 du 26 juillet 2017) accueillit la demande de mesures provisoires de la société de Mme Papachela et ordonna au « réseau pour les droits civils et politiques » de restituer l’hôtel, sous peine d’une amende de 1 000 EUR et de la mise en détention, pendant deux mois, du représentant dudit réseau. Le juge de paix releva notamment qu’en dépit de la demande de Mme Papachela du 22 avril 2016 invitant la police à faire évacuer l’hôtel, aucune mesure ne fut prise. Il releva aussi que, en dépit des demandes envoyées par l’intéressée, en juin 2016 au chef de la police et au ministre adjoint de l’Intérieur, l’État n’intervint pas pour l’assister, ce qui l’amena à porter plainte contre eux le 3 mars 2017. En août 2017, un huissier de justice se rendit au commissariat d’Aghios Panteleïmonas et y notifia la décision du juge de paix d’Athènes, demandant l’intervention de la police pour faire évacuer l’hôtel conformément à cette décision. Par la suite, l’huissier réitéra, sans succès, cette demande les 6 et 18 septembre 2019, puis le 2 octobre 2019. Plus tard, les requérantes saisirent également le Conseil juridique de l’État qui ne donna aucune suite à leur demande. Selon les requérantes, leur dette envers l’État pour diverses taxes atteignait, jusqu’en juin 2017, 101 885,35 EUR, et les factures d’eau impayées, jusqu’au 12 février 2018, s’élevaient à 141 990 EUR ; à cela s’ajouteraient les factures d’électricité ; et la valeur commerciale de l’hôtel depuis son occupation serait tombée de 9 millions à 4 millions d’euros. En janvier 2018, Mme Papachela reçut un avis de confiscation de sa maison personnelle pour dettes envers l’État. Elle dut la vendre pour s’acquitter de ses dettes et éviter les poursuites pénales. En janvier 2018, la société de Mme Papachela saisit le juge de paix d’Athènes pour demander l’éviction des occupants de l’hôtel. En août 2018, le chef de la Police grecque informa le secrétaire générale du ministère de la Politique migratoire que l’exécution de la décision d’évacuation ne serait pas simple et qu’il faudrait au préalable repérer les lieux où pourraient être placés ceux qui auraient quitté l’hôtel. En définitive, l’occupation des lieux, qui débuta en avril 2016, s’acheva en juillet 2019 lorsque les occupants quittèrent l’hôtel de leur propre gré.
Article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété)
La Cour observe que l’omission des autorités de prendre des mesures pour évacuer l’hôtel des requérantes de ses occupants illégaux, alors même qu’un ordre d’évacuation avait été émis par le procureur, a eu pour conséquence le blocage du bien pendant plusieurs années sans qu’il soit possible pour les requérantes de l’exploiter, alourdissant ainsi les charges financières de l’hôtel suite à une accumulation importante des frais de consommation énergétique du bâtiment. Le Gouvernement justifie l’inaction des autorités par des raisons d’ordre public, notamment le souci de pallier le risque de troubles à l’ordre public lié à l’expulsion de dizaines de personnes et à l’évacuation d’un bâtiment dont l’occupation s’inscrivait dans le cadre d’une action militante, ainsi que par des motivations d’ordre social, surtout l’absence, pendant une période où les flux migratoires avaient atteint leur pic, de solutions de relogement des migrants qui s’y étaient trouvés. La Cour reconnaît que les craintes suscitées par les motivations susmentionnées pouvaient justifier dans une certaine mesure des hésitations de procéder à une libération rapide et brutale des lieux. Cela ne saurait cependant justifier une telle inaction totale et prolongée des autorités. En effet, la Cour note que malgré la plainte des requérantes par laquelle celles-ci demandaient le concours immédiat de la police pour évincer les occupants de l’hôtel, le déroulement de la procédure a fait l’objet de plusieurs atermoiements. En outre, deux plaintes des requérantes contre toute personne responsable de la situation n’ont fait l’objet d’aucun début d’examen. Par ailleurs, les compagnies nationales d’électricité et d’eau qui avaient consenti à réapprovisionner l’hôtel, alors que les requérantes avaient arrêté dans le passé aussi bien l’électricité que l’eau, n’ont pas répondu à l’appel de ces dernières de ne pas les tenir redevables de la consommation qui serait générée par les occupants de l’hôtel. En revanche, un an après le début de l’occupation de l’hôtel, la compagnie nationale d’eau a sommé la société de Mme Papachela de payer une facture de 81 000 EUR sous peine de confiscation de l’hôtel, somme qui avait atteint 141 990 EUR le 12 février 2018. La dette envers le fisc pour différentes taxes atteignait en juin 2017 la somme de 101 885,35 EUR, dont 22 000 EUR par an au titre de la taxe foncière. De surcroît, les requérantes tentèrent de conclure un accord avec l’État visant le paiement des taxes et des factures d’eau et d’électricité qui s’étaient accumulées sur leur bien. Pour cela elles ont écrit au Conseil juridique de l’État qui était le seul habilité à négocier un tel accord, mais ce dernier ne leur a fourni aucune réponse. Puis, en janvier 2018, Mme Papachela a reçu un avis de confiscation de sa maison personnelle pour dettes envers l’État. Enfin et surtout, la décision n o 1023/2017 par laquelle le juge de paix, tout en constatant l’inactivité des autorités de police, ordonnait, au titre des mesures provisoires, l’évacuation des lieux et la restitution de l’hôtel aux requérantes, n’a jamais été exécutée : la police n’a donné aucune suite aux quatre demandes par lesquelles l’huissier de justice mandaté par les requérantes lui demandait son concours pour l’exécution de la décision. L’action tendant à l’éviction des occupants de l’hôtel, introduite par la société de Mme Papachela en janvier 2018 devant le juge de paix, n’avait pas été examinée jusqu’en juillet 2019, date à laquelle les occupants ont quitté l’hôtel de leur propre gré. Compte tenu des intérêts des requérantes, les autorités auraient dû, après un laps de temps raisonnable consacré à la recherche d’une solution satisfaisante, prendre les mesures nécessaires au respect de la propriété litigieuse. En restant inactives pendant plus de trois ans face à une situation qui a eu des répercussions importantes sur la propriété des requérantes, les autorités nationales ont rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
Satisfaction équitable (Article 41)
La Cour dit que la Grèce doit verser aux requérantes 300 000 euros (EUR) pour perte de chance (dommage matériel) et 2 500 EUR pour frais et dépens. La Grèce doit aussi verser 10 000 EUR, pour dommage moral, à Mme Papachela
CEDH
54. La Cour rappelle d’emblée que l’exercice réel et efficace du droit que l’article 1 du Protocole no 1 garantit ne saurait dépendre uniquement du devoir de l’État de s’abstenir de toute ingérence et qu’il peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (Öneryildiz c. Turquie [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII).
55. La Cour observe que l’omission des autorités de prendre des mesures pour évacuer l’hôtel des requérantes de ses occupants illégaux, alors même que un ordre d’évacuation fut émis par le procureur (voir paragraphe 18 ci-dessus), a eu pour conséquence le blocage du bien de celles-ci pendant plusieurs années sans qu’il soit possible pour elles de l’exploiter de quelque façon que ce soit ainsi que l’alourdissement des charges financières le concernant suite à une accumulation importante des frais de consommation énergétique du bâtiment.
56. La Cour observe par ailleurs avoir affirmé, à plusieurs reprises, qu’en matière de politique sociale, les États disposent d’une grande latitude sur la manière de concevoir les impératifs de « l’utilité publique » ou de l’intérêts général, à conditions que leur jugement ne se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 166, CEDH 2006-VIII). Pour apprécier la conformité à l’article 1 du Protocole no 1, la Cour doit se livrer à un examen global des divers intérêts en jeu, en gardant à l’esprit que la Convention a pour but de sauvegarder des droits qui sont « concrets et effectifs ». Elle doit aller au-delà des apparences et rechercher la réalité de la situation litigieuse. S’il est vrai, d’une part, que les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence lorsqu’une question générale est en jeu, il faudrait, d’autre part, s’assurer de l’existence des garanties propres à assurer que la mise en œuvre et l’impact de cette réaction sur les droits patrimoniaux du propriétaire visé par les mesures litigieuses ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (ibidem, § 168).
57. En l’espèce, la Cour note que le Gouvernement justifie l’inaction des autorités par des raisons d’ordre public, notamment le souci de pallier le risque de troubles à l’ordre public lié à l’expulsion des dizaines de personnes et à l’évacuation d’un bâtiment dont l’occupation s’inscrivait dans le cadre d’une action militante, ainsi que par des motivations d’ordre social, surtout l’absence, pendant une période où les flux migratoires avaient atteint leur pic, de solutions de relogement des migrants qui s’y trouvés.
58. La Cour reconnait que les craintes suscitées par les motivations susmentionnées pouvaient justifier dans une certaine mesure des hésitations de procéder à une libération rapide et brutale des lieux. Cela ne saurait cependant justifier une telle inaction totale et prolongée des autorités.
59. S’agissant en premier lieu des tergiversations des autorités concernant le concours de la puissance publique, la Cour note que malgré la plainte des requérantes par laquelle celles-ci demandaient le concours immédiat de la police pour évincer les occupants de l’hôtel, le déroulement de la procédure a fait l’objet de plusieurs atermoiements. Quelle que soit la version des parties (paragraphes 8 et 9 ci-dessus) qui correspond à la réalité des faits, il ne fait pas de doute que l’examen de la plainte introduite en avril 2016 par la société requérante était toujours pendant plus d’un an plus tard, à savoir le 17 mai 2017, lorsque le parquet a renvoyé le dossier à la Direction de la police pour un complément d’enquête (paragraphe 11 ci-dessus).
60. En outre, il ressort du dossier que les deux plaintes des requérantes, des 3 mars et 17 octobre 2017 (paragraphes 16 et 21 ci-dessus), contre toute personne responsable de la situation n’avaient fait l’objet d’aucun début d’examen.
61. La Cour relève ensuite que les compagnies nationales d’électricité et d’eau qui avaient consenti à réapprovisionner l’hôtel, alors que les requérantes avaient arrêté dans le passé aussi bien l’électricité que l’eau, n’ont pas répondu à l’appel de ces dernières de ne pas les tenir redevables de la consommation qui serait générée par les occupants de l’hôtel. En revanche, un an après le début de l’occupation de l’hôtel, la compagnie nationale d’eau a sommé la seconde requérante de payer une facture de 81 000 euros sous peine de confiscation de l’hôtel, somme qui avait atteint 141 990 euros le 12 février 2018 (paragraphe 12 ci-dessus). La dette envers le fisc pour différentes taxes atteignait en juin 2017 la somme de 101 885,35 euros, dont 22 000 euros par an au titre de la taxe foncière (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour note aussi que le 14 novembre 2017, les requérantes tentèrent de conclure un accord avec l’État visant le paiement des taxes et des factures d’eau et d’électricité qui s’étaient accumulées sur leur bien. Pour cela elles ont écrit au Conseil juridique de l’État qui était le seul habilité à négocier un tel accord, mais ce dernier ne leur a fourni aucune réponse à cette demande (paragraphes 23-24 ci-dessus). Le 18 janvier 2018, la première requérante a reçu un avis de confiscation de sa maison personnelle pour dettes envers l’État (paragraphe 26 ci-dessus).
62. Enfin et surtout, la Cour note que la décision no 1023/2017 par laquelle le juge de paix, tout en constatant l’inactivité des autorités de police, ordonnait, au titre des mesures provisoires, l’évacuation des lieux et la restitution de l’hôtel aux requérantes (paragraphe 19 ci-dessus), n’a jamais été exécutée : la police n’a donné aucune suite aux quatre demandes par lesquelles l’huissier de justice mandaté par les requérantes lui demandait son concours pour l’exécution de la décision (paragraphes 20-21 ci-dessus). L’action tendant à l’éviction des occupants de l’hôtel, introduite par la seconde requérante le 25 janvier 2018 devant le juge de paix, n’avait pas été examinée jusqu’au 10 juillet 2019, date à laquelle ceux-ci ont quitté l’hôtel de leur propre gré (paragraphes 27 et 29 ci-dessus) (voir aussi Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l., précité, § 58).
63. Compte tenu des intérêts des requérantes, les autorités auraient dû, après un laps de temps raisonnable consacré à la recherche d’une solution satisfaisante, prendre les mesures nécessaires au respect de la propriété litigieuse. En restant inactives pendant plus de trois ans face à une situation qui a eu répercussions importantes sur la propriété des requérantes, les autorités nationales ont rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels.
64. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no1.
CASA DI CURA VALLE FIORITA S.R.L. c. ITALIE du 13 décembre 2018 requête 67944/13
Violation de l'article 1 du Protocole 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention : Les autorités n'ont rien fait pour reloger et expulser la centaine de squatteurs qui ont occupé la clinique désaffectée située à Rome et appartenant à la société.
a) Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
46. La Cour a récemment résumé les principes de sa jurisprudence en matière de droit d’accès à un tribunal dans l’arrêt Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], no 76943/11, §§ 84-90, 29 novembre 2016). Aussi, la Cour rappelle que le droit à l’exécution d’une décision de justice est un des aspects du droit d’accès à un tribunal. Comme la Cour l’a déjà affirmé, le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire restât inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les États contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (voir, entre autres, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil 1997-II).
47. Par ailleurs, la Cour rappelle que, si l’on peut admettre que les États interviennent dans une procédure d’exécution d’une décision de justice, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d’empêcher, d’invalider ou encore de retarder de manière excessive l’exécution, et encore moins de remettre en question le fond de cette décision (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 63 et 66, CEDH 1999-V). Un sursis à l’exécution d’une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire pour trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (ibidem, § 69).
48. Il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a pour tâche d’examiner si en l’espèce les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie [GC], no 31679/96, § 108, CEDH 2000-I).
49. En l’espèce, la Cour note tout d’abord que la décision du juge des investigations préliminaires de Rome du 9 août 2013 portait sur un droit de caractère civil de la requérante, à savoir la protection de son droit de propriété. Par ailleurs, ladite décision de saisie revêtait de par sa nature même un caractère d’urgence, dans la mesure où elle était destinée à empêcher la poursuite d’une infraction dans le but de préserver l’intégrité du bien de la partie lésée (paragraphe 10 ci-dessus). En outre, il n’est pas contesté que la décision litigieuse avait un caractère définitif et exécutoire.
50. Or force est de constater que la saisie de l’immeuble demeure aujourd’hui encore non exécutée en dépit des nombreuses démarches accomplies régulièrement par la requérante pour obtenir l’exécution de cette décision. De plus, la Cour observe qu’aucune tentative d’exécution n’a été effectuée par les autorités depuis que le juge a ordonné la saisie en question.
51. Certes, le Gouvernement a justifié le retard pris dans l’exécution par des raisons liées à l’ordre public et par des motivations d’ordre social. La Cour observe à cet égard que les motifs avancés par les autorités pour justifier l’inexécution de la saisie concernent principalement l’absence de solutions de relogement des occupants en raison notamment de difficultés financières de la municipalité (paragraphe 18 ci-dessus), les raisons liées au risque de troubles à l’ordre public n’ayant été évoquées que de manière générale et non circonstanciée. Néanmoins, la Cour est prête à admettre que les autorités internes ont pu avoir également le souci de pallier le risque sérieux de troubles à l’ordre public lié à l’expulsion de plusieurs dizaines de personnes, et ce d’autant que l’occupation de l’immeuble s’inscrivait dans le cadre d’une action militante à fort impact médiatique.
52. Toutefois, force est de constater que le Gouvernement n’a donné aucune information quant aux démarches qui auraient été accomplies par l’administration pour trouver des solutions de relogement depuis le début de l’occupation ou, du moins, depuis la note officielle envoyée par le préfet le 30 mars 2016. Par ailleurs, rien dans le dossier n’évoque une quelconque disposition qui aurait été prise en ce sens (voir, a contrario, Société Cofinco c. France (déc.), no 23516/08, 12 octobre 2010).
53. Dès lors, si la Cour reconnaît que les motivations d’ordre social et les craintes relatives au risque de troubles à l’ordre public pouvaient justifier en l’espèce des difficultés d’exécution et un retard dans la libération des lieux, elle estime toutefois injustifiée l’inaction totale et prolongée des autorités italiennes en l’espèce. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un manque de ressources ne saurait constituer en soi une justification acceptable pour l’inexécution d’une décision de justice (voir, mutatis mutandis, Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002-III, et Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 90, CEDH 2006-V), non plus que l’absence de logements de substitution (Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 53, CEDH 2004-III (extraits)).
54. La Cour est d’avis que, en s’abstenant, pendant plus de cinq années, de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire, les autorités nationales ont privé, en l’occurrence, les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile et qu’elles ont porté atteinte à l’État de droit, fondé sur la prééminence du droit et la sécurité des rapports juridiques. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
b) Sur la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
55. La Cour considère en l’espèce que, à l’instar de ce qu’elle a constaté dans l’arrêt Matheus (précité) et à la différence de ce qu’elle a conclu dans l’arrêt Immobiliare Saffi (précité, § 46), le refus des autorités de procéder à l’évacuation de l’immeuble de la requérante ne s’analyse pas en une mesure de réglementation de l’usage des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Dans la présente affaire, et bien que la question du relogement des occupants ait été prise en compte, le refus de procéder à l’expulsion de ces occupants ne découle pas directement de l’application d’une loi relevant d’une politique sociale et économique dans le domaine, par exemple, du logement ou de l’accompagnement social de locataires en difficulté, mais d’un refus des autorités compétentes, dans des circonstances particulières, et pendant plusieurs années, de procéder à l’évacuation de la propriété de la requérante. Selon la Cour, le défaut d’exécution de la décision du juge des investigations préliminaires du 9 août 2013 doit dès lors être examiné à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, qui énonce le droit au respect de la propriété (voir, mutatis mutandis, Matheus, arrêt précité, § 68).
56. La Cour rappelle en outre que l’exercice réel et efficace du droit que l’article 1 du Protocole no 1 garantit ne saurait dépendre uniquement du devoir de l’État de s’abstenir de toute ingérence et qu’il peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (Öneryildiz c. Turquie [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII).
57. Par ailleurs, combinée avec la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, la prééminence du droit, qui est l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique et qui est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention, justifie la sanction d’un État ayant refusé d’exécuter ou de faire exécuter une décision de justice (Matheus, arrêt précité, § 70).
58. En l’espèce, la Cour réitère que, pendant plus de cinq ans, les autorités sont restées inactives face à la décision par laquelle le juge des investigations préliminaires avait ordonné l’évacuation de l’immeuble de la requérante.
La Cour vient de reconnaître que des raisons d’ordre social et des nécessités d’ordre public, qu’elle ne sous-estime pas, auraient pu en l’espèce justifier un retard d’exécution. Cependant, elle ne peut considérer comme acceptable la durée de l’inexécution en l’espèce, qui perdure encore à ce jour, associée à l’absence totale d’informations concernant les démarches entreprises ou envisagées par les autorités pour mettre un terme à la situation. Par ailleurs, la Cour ne perd pas de vue que la requérante est toujours redevable, en attendant, des frais de consommation énergétique des occupants de l’immeuble.
59. Compte tenu des intérêts individuels de la requérante, les autorités auraient dû, après un laps de temps raisonnable consacré à la recherche d’une solution satisfaisante, prendre les mesures nécessaires au respect de la décision de justice.
60. Pour des raisons similaires à celles exposées au regard de l’allégation de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour considère, eu égard à ce qui précède, qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no1.
LE BLOCAGE DES LOYERS EST NON CONFORME SI LES LOYERS SONT TROP BAS
Lindheim et autres c. Norvège du 12 juin 2012 requêtes nos 13221/08 et 2139/10
L’impossibilité pour les propriétaires fonciers en Norvège d’augmenter les loyers a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens
Les parties s’accordaient à reconnaître que l’application de la loi sur les baux fonciers avait constitué une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens et que cette ingérence était prévue par la loi. La Cour observe qu’elle a eu pour effet de contrôler l’usage fait par les requérants de leurs biens. Les parties ne s’entendaient pas en revanche sur les points de savoir si l’ingérence litigieuse poursuivait un but légitime et si elle était proportionnée à ce but, conformément à la Convention.
La Cour rappelle que les autorités nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour apprécier l’intérêt général de leur société, notion qui est en tout état de cause très large. De plus, ces autorités – y compris le législateur – jouissent d’une grande latitude (marge d’appréciation) dans la mise en œuvre de leurs politiques socioéconomiques.
En l’espèce, les autorités avaient pour but d’assurer aux locataires qui ne pouvaient pas acheter leurs parcelles un droit durable de jouissance et de disposition sur ces parcelles.
Pour parvenir à ce but, elles ont adopté l’article 33 de la loi, en vertu duquel les locataires peuvent bénéficier d’une reconduction sans limite de durée de leurs baux aux mêmes conditions que celles prévalant précédemment. Cet article est applicable en général aux anciens baux arrivant à leur terme, indépendamment des moyens financiers du locataire ou du fait que le terrain soit utilisé à titre de résidence principale ou secondaire. Même si cette mesure semble refléter des considérations de politique sociale au sens large et non se limiter aux cas où les locataires pourraient se trouver en proie à des difficultés financières, la Cour observe que le but consistant à protéger les intérêts des locataires disposant de peu de moyens financiers est légitime au regard de la Convention.
En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, la Cour note que, du point du vue des bailleurs, le bail foncier en résultant ne correspond pas à la réalité du marché, étant donné que les prix de l’immobilier ont énormément augmenté depuis les années 80. De leur côté, les locataires ont fortement intérêt à conserver les mêmes conditions contractuelles après l’expiration de leur bail. Il y a donc là deux intérêts divergents, difficiles à concilier, et les questions qu’a eu à trancher le législateur norvégien étaient particulièrement complexes. La nécessité de disposer de solutions claires et prévisibles pour éviter des litiges longs et coûteux à une échelle potentiellement massive (compte tenu du fait qu’il y a environ 300 000 locataires fonciers en Norvège) correspondait à un objectif compréhensible.
Examinant la situation qui prévalait immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi sur les baux fonciers en 2002, la Cour observe que, du fait d’une disposition permettant un ajustement partiel des loyers fonciers compte tenu de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, plusieurs locataires ont subi une augmentation importante de leur loyer, à laquelle ils n’étaient pas préparés. Le fossé entre les loyers contrôlés et l’augmentation des prix sur le marché du logement s’est creusé avec le temps. Même si elle n’a été que partielle, la levée du contrôle des loyers après 2002 a frappé de plein fouet bon nombre de ménages. La solution retenue par le Gouvernement et adoptée par le législateur a été une règle permettant une mise à niveau en une fois des contrats comportant une clause d’ajustement lié à la valeur du terrain, suivie de l’introduction d’un processus d’ajustement lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
La Cour est frappée par le fait qu’il n’a pas été procédé à une étude spécifique de la question de savoir si la modification de l’article 33, qui régit la prolongation du type de bail foncier en cause dans le cas des requérants, respectait un juste équilibre entre les intérêts respectifs des bailleurs et des locataires. De fait, dans le cadre des différents baux tels qu’ils ont été prolongés en vertu de l’article 33 de la loi sur les baux fonciers, les requérants ont perçu des loyers particulièrement bas, correspondant à moins de 0,25 % de la valeur marchande de leurs terres.
En effet, la prolongation des baux conclus par les requérants est valable pour une durée indéterminée, sans autre possibilité d’ajustement positif que celle liée à l’indice des prix à la consommation. Il n’est donc pas possible, dans ces contrats, de tenir compte de la valeur du terrain pour fixer le niveau du loyer. Seul le locataire peut choisir de mettre fin au bail, soit en le résiliant soit en achetant le terrain à des conditions préférentielles. Par ailleurs, il est libre de céder son bail à des tiers avec l’habitation s’y rattachant : en pareil cas, c’est à lui seul que profiterait toute augmentation de la valeur du terrain. Au contraire, un bailleur qui choisirait de vendre à un tiers sa créance sur le locataire ne bénéficierait pas de l’augmentation de la valeur du terrain, le loyer restant plafonné indéfiniment. Or la Cour considère que les requérants pouvaient légitimement s’attendre à ce que leurs baux expirent dans les conditions qui y étaient prévues, indépendamment des débats qui auraient pu naître ou des mesures législatives qui auraient pu être adoptées dans l’intervalle.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il a été imposé une charge financière et sociale exclusivement aux bailleurs. Il n’a donc pas été ménagé un juste équilibre entre les intérêts de la communauté et le droit des requérants au respect de leurs biens. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Exécution de l’arrêt (article 46)
La Cour juge que le problème sous-tendant la violation qu’elle constate dans cette affaire est lié à la législation en cause. Ayant relevé les principaux défauts de cette législation et laissant aux autorités nationales le choix des moyens à employer, elle dit que la Norvège doit mettre en place dans son ordre juridique interne un mécanisme garantissant le respect d’un juste équilibre entre l’intérêt particulier des bailleurs et l’intérêt général de la communauté.
Cliquez sur un lien bleu pour accéder à :
- LA FAILLITE BANCAIRE
- LA DURÉE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE ENTREPRISE
Freire Lopes c. Portugal du 23 février 2023 requête n° 58598/21
Placer son argent dans une banque Luxembourgeoise même avec un relai bancaire d'un autre Etat de l'UE comme le Portugal : il ne faut pas s'étonner de perdre son argent.
Art 1 du Protocole 1 : Décision d’irrecevabilité dans une affaire où le requérant se plaignait des conséquences sur son patrimoine de la liquidation d’une banque privée en difficulté
L’affaire concerne le non-remboursement de 3 700 produits financiers qui avaient été vendus au requérant, en 2012, dans le cadre d’un contrat d’intermédiation financière, par la Banque Banco Espírito Santo (BES) qui a fait, par la suite, l’objet d’une mesure de résolution appliquée par la Banque du Portugal (BdP) en vertu de son pouvoir de contrôle sur le secteur bancaire. Vu le contexte économique et la situation financière défaillante de la BES au moment des faits, la Cour reconnaît d’emblée que l’État, au travers de la BdP, disposait d’une marge d’appréciation pour déterminer les mesures à prendre au niveau tant préventif que réparatoire envers la BES. En l’occurrence la mesure de résolution visait à débarrasser la BES de tous les produits jugés toxiques dès lors qu’ils étaient exposés à la dette du Groupe Espírito Santo qui avait plongé la BES dans un grand marasme financier, évitant ainsi une faillite totale de la BES qui aurait eu des conséquences générales sur l’ensemble du système bancaire interne voire européen. La Cour comprend que le non-transfert de la créance du requérant à la banque-relais qui venait d’être renflouée par des fonds publics a réduit les chances pour lui d’obtenir le remboursement de sa créance vis-à-vis de la BES. Cela dit, elle rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention ne peut être interprété comme faisant peser sur les États contractants une obligation générale d’assumer les dettes d’entités privées. Par ailleurs, étant donné la situation financière hautement déficitaire de la BES au moment des faits, il n’est pas certain que la BES eût pu honorer sa dette vis-à-vis du requérant. La Cour conclut qu’un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt public poursuivi et le droit de propriété du requérant et de toutes les personnes se trouvant dans la même situation que lui. La requête est donc manifestement mal fondée.
FAITS
Le requérant, Diamantino Freire Lopes, est un ressortissant portugais, né en 1944. Il réside au Portugal. À l’époque des faits, le requérant et son épouse possédaient un compte courant à la BES, l’une des principales banques commerciales au Portugal, qui appartenait au Groupe Espírito Santo (GES), une structure de holdings en cascade. Plus de 20 % des actifs de la BES étaient détenus par Espírito Santo Financial Group, S.A. (ESFG), une société holding enregistrée au Luxembourg, détenue à 49 % par Espírito Santo Irmãos SGPS, une société enregistrée au Portugal qui, elle, était détenue à 100 % par Rio Forte Investments, S.A. (Rio Forte), cette dernière étant détenue à 100 % par la société holding mère Espírito Santo International (ESI), enregistrée elle aussi au Luxembourg. En août 2012, le requérant acquit 3 700 produits financiers de la société Poupança Plus Investments Jersey Limited pour un montant total de 185 000 euros (EUR) que la BES, en qualité d’intermédiaire financier, s’était engagée à lui racheter à la date du 24 août 2014 avec un complément de 20 202 EUR d’intérêts rémunératoires.
En mai 2014, les autorités luxembourgeoises détectèrent des irrégularités comptables dans les comptes de la société ESI. Puis, en juillet 2014, ESI, ESFG et Rio Forte demandèrent aux autorités luxembourgeoises d’être placées en redressement judiciaire au motif qu’elles n’étaient plus en mesure de payer leurs dettes.
En juillet 2014, la BES publia son bilan financier semestriel, révélant une perte record de 3,57 milliards d’euros en raison de son exposition à la dette du GES. La BES informa la Banque du Portugal (BdP) qu’elle n’était pas en mesure de recapitaliser l’entreprise dans les conditions et les délais requis, ce qui conduisit la BdP à adopter certaines mesures dont notamment les suivantes. Par une décision du 30 juillet 2014, la BdP décida, avec effet immédiat, d’interdire à la BES de rembourser de façon anticipée tout crédit et tout prêt souscrit par la BES, de soumettre à l’autorisation préalable de la BdP tout remboursement total ou partiel ou même toute opération bancaire simple de débit d’un compte, et d’interdire le paiement par la BES de tout montant dû par l’ESI, ESFG et Rio Forte ou de toute entité liée à ces sociétés.
Par une décision du 3 août 2014, la BdP décida d’appliquer une mesure de résolution à l’égard de la BES pour remédier à la situation financière de la banque et préserver la stabilité du système financier portugais. La BdP créa une banque-relais, la Novo Banco, S.A. (N.B.) à laquelle elle transféra notamment un ensemble d’actifs, de passifs, d’éléments patrimoniaux. La BdP précisa que « la finalité de cette décision d’intérêt public manifeste et urgent est d’éloigner les risques pour la stabilité financière et de libérer la nouvelle banque des actifs de mauvaise qualité qui ont mené à cette situation ». Par une décision du 11 août 2014, la BdP précisa quels étaient les actifs et les passifs qui devaient être transférés à la banque-relais N.B. Par une décision du 29 décembre 2015, alors que de nombreuses actions civiles étaient en train d’être intentées contre la banque N.B., la BdP clarifia sa décision du 3 août 2014, précisant en particulier quels étaient les passifs qui n’avaient pas été transférés par la BES à la banque N.B. Entretemps, en août 2014, la Banque Centrale Européenne (BCE) décida de suspendre la qualité de contrepartie de la BES, dans le cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème, ce qui obligeait la BES à rembourser les 10 milliards EUR de dettes qu’elle avait contractées vis-à-vis de l’Eurosystème. Puis, en juillet 2016, la BCE retira l’autorisation pour l’exercice de l’activité bancaire qui avait été octroyée à la BES.
À la suite de cette décision, la BES fut mise en liquidation d’office par la BdP. La procédure de liquidation est depuis lors pendante devant le tribunal du commerce de Lisbonne. À la suite de la mesure de résolution adoptée par la BdP à la BES, le requérant intenta contre la banque-relais N.B. une action en remboursement de la somme de 185 000 EUR ainsi que de 20 202 EUR d’intérêts, estimant que ses créances constituaient des passifs de la BES qui avaient été transférées à la banque N.B. Il alléguait avoir acquis ces actions sans avoir été informé de la nature et des risques d’un tel investissement financier, ajoutant que la BES lui avait vendu ce produit comme une épargne sûre avec un taux de rémunération avantageux. En juillet 2016, le tribunal de Santarém fit droit à ses prétentions, condamnant la banque N.B. à payer au requérant la somme totale de 205 202 EUR qu’il réclamait. La BdP et la banque N.B. firent appel de ce jugement. En février 2021, la cour d’appel d’Évora infirma le jugement de première instance et débouta le requérant, estimant que les créances de ce dernier constituaient des passifs de la BES qui n’avaient pas été transférés à la banque N.B. Se référant à la décision de la BdP du 29 décembre 2015, la cour d’appel indiqua que les responsabilités et les aléas découlant de l’activité d’intermédiaire financier de la BES n’étaient pas entrés dans le domaine patrimonial de la banque N.B.
En juin 2021, la Cour suprême confirma l’arrêt de la cour d’appel d’Évora, estimant que les responsabilités de la BES pour les dommages causés par son activité d’intermédiation financière constituaient des « aléas » au sens des décisions de la BdP du 3 août 2014 et du 29 décembre 2015, et qu’elles n’avaient pas été transférées à la banque N.B.
CEDH
a) Sur la norme applicable
86. La Cour constate qu’à l’origine des faits de l’espèce se trouve une relation commerciale entre un particulier et une banque commerciale ayant fait l’objet d’une mesure de résolution appliquée par la BdP en vertu des articles 144 alinéa b) et 145-C du RGICSF (paragraphes 17-19 et 53 ci-dessus). Elle note que dans le cadre de cette mesure de résolution, aux termes de l’article 145-G § 3 du RGICSF, une banque-relais, N.B., fut créée pour assurer la continuité de l’activité bancaire de la BES, assainie de l’exposition au GES, qui était responsable de la situation déficitaire de la BES (paragraphes 5-9, 19 et 56 ci-dessus). Conformément à l’article 145-H du RGICSF (paragraphe 53 ci-dessus), un ensemble d’actifs et de passifs appartenant à la BES furent transférés par la BdP à la banque-relais, N.B., dont le capital social, renfloué par l’État à hauteur de 4,9 milliards d’euros, était détenu par le Fonds de résolution mis en place par l’État aux termes de l’article 4 des statuts de la N.B. (paragraphe 18, 20 et 22 ci-dessus). Les éléments considérés comme toxiques par la BdP restèrent quant à eux dans le patrimoine de la BES (paragraphe 56 ci-dessus), devenue ainsi une structure de défaisance qui, par la suite, fut mise en liquidation d’office (paragraphe 13 ci-dessus).
87. Au vu de ces constations, la Cour estime que la mesure de résolution prise par la BdP, selon les modalités décrites au paragraphe précédent, relevait du pouvoir de contrôle exercé par celle-ci sur le système bancaire national et visait à en assurer le bon fonctionnement (paragraphes 51-52 ci-dessus). Faisant sienne la conclusion à laquelle a abouti la CJUE dans l’arrêt BPC Lux 2 et autres (arrêt du 5 mai 2022, C-83/20- point 50 ; paragraphe 71 ci-dessus), elle estime donc que la situation litigieuse relevait de la réglementation de l’usage des biens au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Süzer et Eksen Holding A.S. c. Turquie, no 6334/05, § 146, 23 octobre 2012, § 146, et Project-Trade d.o.o. c. Croatie, no 1920/14, § 76, 19 novembre 2020).
b) Sur la nature de la violation alléguée
88. Le requérant se plaint de ce que la cour d’appel d’Évora et la Cour suprême (paragraphes 42 et 47 ci-dessus) n’aient pas reconnu que sa créance vis-à-vis de la BES avait été transférée à la N.B., la banque-relais. Il soutient que la perte de sa créance a pour origine la mesure de résolution appliquée par le BdP, une mesure qu’il juge illégale et inconstitutionnelle (paragraphes 71-73 ci-dessus). Le requérant dénonce ainsi tant un manquement de l’État à ses obligations positives pour garantir son droit de propriété qu’une ingérence dans celui-ci.
89. Si à l’origine de la présente espèce se trouve une relation commerciale entre un particulier et une banque privée (paragraphes 3-5 ci-dessus), la Cour estime qu’on peut effectivement considérer que les mesures que la BdP a prises vis-à-vis de la BES en vertu de son pouvoir de contrôle sur le secteur bancaire ont eu des conséquences sur la créance du requérant. En effet, tout d’abord, la BES s’est vu interdire dès le 30 juillet 2014 de rembourser de façon anticipée toute valeur mobilière émise par la banque (paragraphes 14-15 ci-dessus), ce qui a touché ainsi directement la créance du requérant vis-à-vis de la BES. Ensuite, en vertu de la mesure de résolution appliquée le 3 août 2014, les actifs, passifs et autres éléments patrimoniaux considérés comme sains de la BES ont été transférés à la banque-relais, N.B. (paragraphes 17-19 ci-dessus). Par conséquent, la BES est devenue une structure de défaisance réservée aux actifs et passifs douteux, parmi lesquels se trouvait, selon les juridictions internes, la créance du requérant. La Cour relève enfin que la BES a finalement été mise en liquidation par la BdP consécutivement au retrait par la BCE de son autorisation d’exercice de l’activité bancaire (paragraphes 12-13 ci-dessus). La Cour estime qu’on ne saurait spéculer quant à la somme que le requérant aurait reçue si la mesure de résolution n’avait pas été appliquée. En effet, comme tout investissement financier, les produits en cause étaient sujets aux aléas du marché dans un contexte de crise économique générale (à cet égard, voir Mamatas et autres, précité, § 94), d’autant plus qu’en l’occurrence, il s’agissait d’un marché non réglementé (paragraphe 28 ci-dessus).
90. Dans ces conditions, la Cour juge inutile de déterminer précisément s’il faut aborder la cause sous l’angle des obligations positives de l’État ou sur le terrain de l’obligation négative pesant sur celui-ci de s’abstenir d’ingérences injustifiées dans le droit au respect des biens. Elle examinera donc si la conduite des autorités portugaises – que celle-ci puisse être considérée comme une ingérence ou comme un manquement à agir, ou encore comme une combinaison des deux – se justifiait à la lumière des principes applicables exposés ci-dessous (voir, en comparaison, Broniowski, précité, § 146, et Ališic et autres, précité, § 102).
c) Sur le respect du principe de la légalité et l’intérêt légitime poursuivi par les autorités internes
91. Le requérant allègue que la mesure de résolution est illégale et inconstitutionnelle. La cour d’appel d’Évora et la Cour suprême ont toutefois rejeté ces thèses (paragraphes 42 et 47 ci-dessus).
92. La Cour renvoie aux principes généraux concernant le principe de la légalité exposés dans l’arrêt Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie ([GC], no 71243/01, §§ 95-98, 25 octobre 2012).
93. En l’espèce, la Cour constate que, d’une part, la mesure de résolution litigieuse a été adoptée en vertu des articles 144 b) et 145-C du RGICSF et que, d’autre part, la liquidation de la BES décidée d’office par la BdP a pour base l’article 145-M du RGICSF (paragraphe 53 ci-dessus). Les mesures litigieuses étaient donc bien conformes au droit interne (voir, a contrario, Cingilli Holding A.S. et Cingillioglu c. Turquie, nos 31833/06 et 37538/06, § 50, 21 juillet 2015).
94. Il ne fait pas non plus de doute que ces mesures s’inscrivaient également dans le cadre des mesures mises en place par l’Union européenne, au lendemain de la crise financière de 2008, pour harmoniser et améliorer les instruments de règlement des crises bancaires au niveau européen (paragraphe 67 ci-dessus).
95. Comme l’a d’ailleurs relevé la CJUE dans son arrêt BPC Lux 2 et autres (arrêt du 5 mai 2022, C-83/20 -point 54 de l’arrêt ; paragraphe 71 ci-dessus), il ne fait pas davantage de doute qu’elles poursuivaient un objectif d’intérêt général puisqu’elles visaient à assurer la continuité de la prestation des services financiers essentiels, à prévenir le risque pour le système, à préserver les intérêts des contribuables et du Trésor Public et à sauvegarder la confiance des épargnants (paragraphes 13, 18 et 19 ci-dessus), alors que la BCE venait de suspendre la qualité de contrepartie de la BES dans le cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème (paragraphe 11 ci-dessus).
d) Sur le respect d’un juste équilibre par les autorités internes
96. Vu le contexte économique (à cet égard, voir les constatations faites dans la décision Da Silva Carvalho Rico c. Portugal (déc.), no 13341/14, §§ 43-44, 1er septembre 2015) et la situation financière défaillante de la BES au moment des faits, la Cour reconnaît d’emblée que l’État, au travers de la BdP, disposait d’une marge d’appréciation pour déterminer les mesures à prendre au niveau tant préventif que réparatoire envers la BES. En l’occurrence, tel qu’il a déjà été relevé précédemment (paragraphe 89 ci-dessus), la mesure de résolution visait à débarrasser la BES de tous les produits jugés toxiques dès lors qu’ils étaient exposés à la dette du GES qui avait plongé la BES dans un grand marasme financier (paragraphe 9 ci-dessus), évitant ainsi, comme l’a bien relevé la Cour suprême dans son arrêt du 26 septembre 2007 (paragraphe 56 ci-dessus),une faillite totale de la BES qui aurait eu des conséquences générales sur l’ensemble du système bancaire interne voire européen. La Cour comprend que le non-transfert de la créance du requérant à la banque-relais qui venait d’être renflouée par des fonds publics a réduit les chances pour lui d’obtenir le remboursement de sa créance vis-à-vis de la BES. Cela dit, elle rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 ne peut être interprété comme faisant peser sur les États contractants une obligation générale d’assumer les dettes d’entités privées (voir Kotov, précité, § 111 et les références qui y sont citées). Par ailleurs, étant donné la situation financière hautement déficitaire de la BES au moment des faits (paragraphe 9 ci-dessus), il n’est pas certain que la BES eût pu honorer sa dette vis-à-vis du requérant.
97. En
ce qui concerne l’appréciation des faits litigieux par les
juridictions internes saisies de l’action civile engagée
par le requérant contre la N.B., la Cour note que le tribunal de
Santarém a fait droit aux prétentions de l’intéressé en
jugeant que sa créance vis-à-vis de la BES avait été
transférée à la banque-relais consécutivement à la mesure de
résolution appliquée par la BdP à la BES (paragraphes 27 et 30
ci-dessus), mais que la cour d’appel d’Évora et la
Cour suprême ont abouti à la conclusion inverse en se fondant
sur les clarifications apportées le 11 août 2014 et le 29
décembre 2015 à la mesure de résolution de la BdP du 3 août
2014 (paragraphes 41-42 et 47
ci-dessus).
98. Le requérant conteste la conclusion à laquelle ont abouti les juridictions internes. La Cour ne saurait toutefois remettre en cause l’interprétation des faits et du droit en l’espèce. En effet, celle-ci appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux nationaux, son rôle à elle se limitant à vérifier la compatibilité des effets d’une telle interprétation avec la Convention (voir, mutatis mutandis, Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 149, 19 décembre 2018 et les références qui y sont citées). Par ailleurs, l’interprétation retenue n’apparait ni arbitraire ni déraisonnable et s’aligne avec la jurisprudence de la Cour suprême dans le cadre d’affaires similaires (paragraphes 56-62 ci-dessus).
99. En
ce qui concerne l’argument tiré par le requérant d’une
atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au
principe de la sécurité juridique qu’aurait entraînée la
décision de la BdP de retransférer vers la BES des passifs qui
avaient été initialement transmis à la N.B. (paragraphe 73
ci-dessus), la Cour constate que, à la date du jugement du
tribunal de Santarém au sujet des faits de la présente espèce,
la décision de la BdP du 29 décembre 2015 avait déjà
été publiée (paragraphe 24 ci-dessus). Elle ne voit donc pas
en quoi, en adoptant cette décision, la BdP aurait porté
atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au
principe de la sécurité juridique. Aussi, la présente affaire
est à distinguer sur ce point de l’affaire Banco de
Portugal et autres, sur laquelle la CJUE a statué dans son
arrêt du 29 avril 2021 (C- 04/19- point 62 de l’arrêt- paragraphe 70
ci-dessus).
100. Pour finir, la Cour observe que le requérant aurait pu déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation relative à la BES pendante devant le tribunal de commerce de Lisbonne, comme l’a relevé la Cour suprême dans un arrêt rendu le 22 mars 2018 (paragraphe 59 ci-dessus). En effet, il paraît clair que, dans ce cadre, le requérant n’aurait pas pu subir une perte supérieure à celle qu’il aurait connue si la BES avait été immédiatement mise en liquidation, comme le prévoit l’article 145-B § 1 c) du RGICSF conformément à l’article 73 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (paragraphes 53 et 69 ci-dessus et point 58 de l’arrêt de la CJUE BPC Lux 2 et autres du 5 mai 2022 (affaire C-83/20) au paragraphe 71 ci-dessus). La Cour note que, dans le cas contraire, conformément à l’article 145-B § 3 du RGSFIC, le requérant aurait pu réclamer au Fonds de résolution la réparation de tout préjudice subi dans le cadre du remboursement de sa créance (paragraphe 53 ci-dessus).
101. La Cour en conclut que, dans la présente espèce, un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt public poursuivi et le droit de propriété du requérant et de toutes les personnes se trouvant dans la même situation que lui (voir, mutatis mutandis, Trajkovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), no 53320/99, CEDH 2002-IV)
102. Compte tenu des observations qui précèdent (paragraphes 93-95 et 101 ci-dessus) et de la marge d’appréciation dont jouissait l’État au vu des circonstances exceptionnelles qui étaient en cause, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Grande Chambre KOTOV C RUSSIE requête 54522/00 du 3 avril 2012
Le droit de propriété d'un créancier a été suffisamment protégé par l'Etat à l'issue d'une faillite bancaire, même si le requérant n'est pas intégralement remboursé de ses dépôts.
Un mandataire liquidateur agit dans son intérêt et n'est pas une autorité publique.
89. La Cour rappellera tout d’abord brièvement les éléments de fait et de droit au sujet desquels il n’y a pas de controverse entre les parties. Premièrement, le Gouvernement reconnaît que le montant alloué par la décision de justice de 1995 s’analyse en un « bien » du requérant au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Deuxièmement, il convient avec l’intéressé que le liquidateur a agi illégalement en ce que les actifs de la banque, qui auraient normalement dû être répartis également entre les créanciers de premier rang, ont servi à désintéresser en intégralité au sein de cette catégorie les créanciers « privilégiés ». Troisièmement, il admet que, à la suite de cette distribution, les autres créanciers de premier rang de la banque, dont le requérant, ont reçu une somme bien inférieure à celle qu’ils pouvaient légitimement espérer toucher compte tenu de la situation financière de la banque.
90. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de l’avis des parties sur les points ci-dessus. Elle rappelle avoir toujours qualifié de « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, toute créance pécuniaire fondée sur une décision de justice définitive (« judgment debt ») (Burdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-III, et Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A no 301-B). Certes, lorsque le débiteur est un particulier ou une société privée, une créance pécuniaire, fût-elle constatée par jugement, est moins certaine car ses chances de recouvrement dépendent dans une large mesure de la solvabilité du débiteur. Comme la Cour l’a dit à maintes reprises, « en principe, l’Etat n’est pas directement tenu de rembourser les dettes des acteurs privés et ses obligations se limitent à apporter le concours nécessaire aux créanciers dans l’exécution des décisions de justice en cause, par exemple par le biais d’un service d’huissiers ou de procédures de faillite » (voir, par exemple, Shestakov c. Russie (déc.), no 48757/99, 18 juin 2002, Krivonogova c. Russie (déc.), no 74694/01, 1er avril 2004, et Kesyan c. Russie, no 36496/02, 19 octobre 2006 ; voir aussi Scollo c. Italie, 28 septembre 1995, § 44, série A no 315-C, et Fuklev c. Ukraine, no 71186/01, § 84, 7 juin 2005). Il n’en reste pas moins qu’une créance pécuniaire de ce type peut elle aussi être qualifiée de « bien ». En l’espèce, avant leur distribution par le liquidateur, les actifs de la banque étaient suffisants pour rembourser au moins une part non négligeable de la somme due au requérant. Aussi le montant octroyé par le juge en 1995 était-il recouvrable au moins en partie. Le requérant était un créancier de premier rang, et les obligations qu’avait la banque à son égard auraient dû être honorées à ce titre. Or, en violation de la loi, le liquidateur a distribué les sommes dégagées principalement aux créanciers « privilégiés ». Cette action illégale a fait perdre à l’intéressé une bonne partie du montant auquel il avait initialement droit. Telle est la conclusion à laquelle est parvenue la chambre (paragraphe 53 de l’arrêt) ; les parties y ont l’une et l’autre pleinement souscrit et la Grande Chambre ne voit aucune raison de s’en écarter. Il s’ensuit que le requérant a été privé de son bien par un acte illégal du liquidateur.
1. Statut juridique du liquidateur
91. Devant la Grande Chambre, le Gouvernement plaide l’incompétence ratione personae de la Cour pour connaître du grief du requérant relatif à l’action du liquidateur, en ce que ce dernier aurait agi non pas comme un agent de l’Etat mais comme un particulier. La Cour examinera tout d’abord cette question.
a) La jurisprudence de la Cour
92. La Cour a déjà statué sur le point de savoir si, sur le terrain de la Convention, l’Etat peut être tenu pour responsable des actes d’un particulier ou d’une société. Une première catégorie d’affaires (dont la présente espèce relève) porte sur la responsabilité ratione personae de l’Etat du fait d’un organe qui, au moins d’un point de vue formel, n’est pas une « autorité publique ». Dans son arrêt Costello-Roberts (précité, § 27), la Cour a dit que l’Etat ne pouvait se soustraire à sa responsabilité en déléguant ses obligations à des organismes privés ou des particuliers, en l’occurrence une école privée. De la même manière, dans l’arrêt Storck c. Allemagne (no 61603/00, § 103, CEDH 2005-V), elle a jugé que l’Etat demeurait tenu d’exercer une surveillance et un contrôle sur les établissements psychiatriques privés où des patients pouvaient été internés contre leur gré (voir également l’arrêt Evaldsson et autres c. Suède, no 75252/01, § 63, 13 février 2007, concernant l’organisation du marché du travail, l’arrêt Buzescu (précité, § 78), relatif aux barreaux d’avocats, et l’arrêt Wos (précité, §§ 71-74), portant sur le statut de la Fondation pour la réconciliation germano-polonaise).
93. Une seconde catégorie d’affaires concerne la qualité pour agir d’une personne morale requérante sur le terrain de l’article 34 de la Convention et la notion d’« organisation gouvernementale ». Dans la décision Radio France et autres c. France ((déc.), no 53984/00, § 26, CEDH 2003-X), la Cour a dit :
« Entrent dans la catégorie des « organisations gouvernementales », les personnes morales qui participent à l’exercice de la puissance publique ou qui gèrent un service public sous le contrôle des autorités. Pour déterminer si tel est le cas d’une personne morale donnée autre qu’une collectivité territoriale, il y a lieu de prendre en considération son statut juridique et, le cas échéant, les prérogatives qu’il lui donne, la nature de l’activité qu’elle exerce et le contexte dans lequel s’inscrit celle-ci, et son degré d’indépendance par rapport aux autorités politiques. »
94. Concernant la société Radio France, la Cour a relevé que, si celle-ci s’était vu assigner des missions de service public et dépendait en grande partie de l’Etat pour son financement, le législateur avait mis en place un régime dont l’objectif était sans aucun doute de garantir son indépendance éditoriale et son autonomie institutionnelle. Sur ce point, Radio France différait peu des sociétés exploitant des radios dites privées, lesquelles étaient elles-mêmes également soumises à diverses contraintes légales et réglementaires. La Cour en a conclu que Radio France était une organisation non gouvernementale au sens de l’article 34 de la Convention. De même, dans l’arrêt Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran c. Turquie (no 40998/98, § 79, CEDH 2007-V), elle a qualifié la société requérante d’organisation non gouvernementale alors même que cette entité était entièrement propriété de l’Etat iranien et que la majorité des membres de son conseil d’administration étaient nommés par lui. Elle a en effet relevé que cette société était juridiquement et financièrement indépendante de l’Etat et gérée comme une société commerciale.
95. Malgré les différences entre les notions d’« organisation gouvernementale » et d’« autorité publique », la Cour a retenu un mode de raisonnement similaire dans un cas comme dans l’autre. Ainsi, elle a appliqué les principes élaborés dans la décision Radio France à l’affaire Mikhaïlenki et autres c. Ukraine (nos 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02 et 42814/02, §§ 43-46, CEDH 2004-XII), où se posait la question de la responsabilité de l’Etat à raison des dettes d’une entreprise opérant dans le secteur privé (voir également Yershova c. Russie, no 1387/04, §§ 55 et 62, 8 avril 2010).
96. Pour ce qui est du statut juridique des liquidateurs de faillite, la Cour l’a examiné dans les affaires suivantes. Dans l’arrêt Katsyuk (précité, § 39), elle a notamment dit que le liquidateur ne présentait aucune des caractéristiques d’une « organisation gouvernementale », considérant que sa désignation et l’approbation de son rapport par le juge commercial ne pouvaient pas, à elles seules, lui conférer cette qualité (voir aussi Bakalov et autres c. Bulgarie (déc.), no 55796/00, 18 septembre 2007). Il faut toutefois noter que, dans cette affaire, le liquidateur avait été désigné alors que la société débitrice était déjà incapable d’honorer ses obligations. De plus, ni la légalité ni le bien-fondé de l’action du liquidateur n’avaient été contestés. La question essentielle qui se posait était plutôt celle de savoir si, par le fait même de désigner un liquidateur, les autorités ukrainiennes avaient endossé la responsabilité des dettes d’une société privée, ce à quoi la Cour a répondu par la négative.
97. Dans l’affaire Sychev c. Ukraine (no 4773/02, §§ 54-56, 11 octobre 2005), la Cour a examiné le statut du comité de liquidation pour conclure que l’inexécution prolongée par celui-ci d’une décision de justice était due à « l’absence de mise en place par l’Etat d’un mécanisme effectif d’exécution des jugements rendus contre une société visée par une procédure de faillite » (voir aussi Pokutnaya c. Russie (déc.), no 26856/04, 3 juillet 2008). Cependant, elle n’a pas recherché si le comité de liquidation était une « autorité publique », s’attachant plutôt au non-respect par l’Etat de ses obligations positives en la matière. Elle n’a pas non plus examiné cette question dans des affaires où elle était appelée à dire si l’article 6 était applicable aux litiges nés de procédures de liquidation (voir, par exemple, Werner c. Pologne, no 26760/95, § 34, 15 novembre 2001, et Ismeta Bacic c. Croatie, no 43595/06, § 27, 19 juin 2008), ni dans celles où elle a statué sur la durée d’une procédure de ce type (Luordo c. Italie, no 32190/96, §§ 67-71, CEDH 2003-IX).
98. Dès lors, en raison principalement de la diversité des situations qui se présentent dans les affaires soumises à la Cour, il apparaît que la jurisprudence sur le statut juridique des liquidateurs de faillite appelle quelque clarification. La Cour va donc rechercher si, en l’espèce, le liquidateur peut passer pour avoir agi comme un agent de l’Etat, eu égard aux critères exposés ci-dessous.
b) Le liquidateur en l’espèce
99. La Cour souligne d’emblée que les règles du droit interne en vigueur à l’époque des faits ne qualifiaient pas le liquidateur d’agent de la fonction publique, l’administration des faillites étant supposée relever du secteur privé. Elle va à présent examiner si le statut formel du liquidateur correspondait à la réalité du processus de liquidation.
i. Désignation
100. Au moment des faits, le liquidateur en Russie était un particulier engagé par l’organe représentatif des créanciers, entité mue par ses propres intérêts. Il était choisi de gré à gré parmi d’autres professionnels en concurrence pour les mêmes fonctions. Il touchait des honoraires fixés librement et payés par l’organe représentatif des créanciers. Pour autant que l’Etat participait à la procédure de liquidation, il agissait en qualité de créancier et non en tant qu’« autorité publique ».
101. La désignation du liquidateur était confirmée par les tribunaux. Toutefois, comme le Gouvernement l’a expliqué de manière convaincante, le juge se contentait de valider la décision de l’organe représentatif des créanciers après avoir vérifié si le candidat satisfaisait à tous les critères d’éligibilité. En soi, pareille validation n’impliquait pas que l’Etat fût responsable de la manière dont le liquidateur s’acquittait de sa tâche.
ii. Contrôle et responsabilité
102. Alors que la chambre a accordé une grande importance au contrôle de la légalité de l’action du liquidateur opéré par le juge interne, la Grande Chambre note que ce contrôle était d’une portée très limitée et ne s’exerçait qu’a posteriori, les tribunaux n’ayant pas à vérifier si les décisions du liquidateur étaient justifiées d’un point de vue économique ou commercial. Le juge n’était pas habilité à donner au liquidateur des instructions quant à la manière de gérer la société en faillite, tâche qui relevait du pouvoir discrétionnaire de ce dernier. Il ne faisait que contrôler la conformité de l’action du liquidateur aux règles matérielles et procédurales de la législation interne en matière de faillite. Son rôle se limitait à servir d’instance de règlement des litiges entre les créanciers de la société insolvable, ses débiteurs et le liquidateur. En cela, le juge avait la même fonction que dans tout autre contentieux d’ordre privé.
103. Par ailleurs, en vertu de la loi de 1992, le liquidateur n’avait de comptes à rendre à aucune instance réglementaire. Il ne répondait que devant l’organe représentatif des créanciers ou devant chaque créancier individuellement. Ses relations avec les créanciers (dont l’Etat) étaient régies par le droit des sociétés, qui prévoyait que sa responsabilité personnelle était engagée devant eux. Le liquidateur ne recevait aucun denier public. La loi de 1992 était muette sur la question de la réparation des actes illégaux pouvant être commis par un liquidateur. Cette lacune fut comblée par la loi de 1998, qui permettait aux créanciers s’estimant lésés par des actions illégales du liquidateur de lui demander réparation. La responsabilité pénale du liquidateur pouvait être engagée notamment pour abus de confiance ou détournement de fonds, mais non pour les infractions ne pouvant être commises que par les agents publics. Enfin, le droit de la responsabilité délictuelle prévoyait non pas la responsabilité de l’Etat du fait du liquidateur, mais celle du liquidateur devant les créanciers.
iii. Objectifs
104. S’il est clair que, à l’époque des faits, la législation relative à l’insolvabilité cherchait à réaliser un juste équilibre entre tous les intérêts concurrents en matière de faillite, notamment en instaurant différents niveaux de priorité entre créanciers et en mettant en place des procédures de liquidation équitables, la Grande Chambre considère que le liquidateur lui-même n’était pas tenu de se livrer à une telle mise en balance. Pour la Grande Chambre, la mission du liquidateur était bien plus proche de celle de n’importe quel autre professionnel engagé par des clients – en l’occurrence les créanciers – pour servir au mieux leurs intérêts et, au bout du compte, le sien propre. A ce titre, le seul fait que ses services pussent revêtir une utilité pour la société ne faisait pas de lui un agent public agissant dans l’intérêt général.
iv. Pouvoirs
105. Surtout, le liquidateur avait des pouvoirs très limités : il était certes habilité à administrer le patrimoine de la société en faillite, mais il ne jouissait d’aucun pouvoir coercitif ou réglementaire à l’égard des tiers. Il ne bénéficiait d’aucune délégation formelle de pouvoirs d’une autorité de l’Etat (et donc d’aucun financement public). Contrairement à un huissier, il ne pouvait pas saisir des biens, collecter des informations, infliger des amendes ou prendre d’autres décisions du même ordre contraignantes à l’égard des tiers. Ses pouvoirs se limitaient au contrôle opérationnel et à la gestion du patrimoine de la société en faillite.
v. Fonctions
106. Acteur central du processus de liquidation, le liquidateur peut à ce titre être appelé à désintéresser les créanciers dont les créances ont été, comme en l’espèce, constatées par un tribunal. Il existe donc certaines similitudes entre ses fonctions et celles de l’huissier de justice, qui est incontestablement une autorité publique. De fait, dans la plupart des pays européens, des organes de l’Etat interviennent dans les procédures d’exécution et, par l’action des huissiers, des policiers et d’autres agents de ce type, aident les demandeurs ayant obtenu gain de cause devant le juge à recouvrer les sommes fixées par celui-ci. La Cour a dit à de nombreuses reprises que l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention font peser sur l’Etat l’obligation positive d’aider les particuliers à faire exécuter les jugements rendus en leur faveur contre d’autres particuliers (Fuklev, précité, §§ 84 et 91, Scollo, précité, § 44, Fociac c. Roumanie, no 2577/02, § 70, 3 février 2005, et Kesyan, précité, §§ 79 et 80). Cependant, ces similitudes n’apparaissent pas déterminantes au vu des différences marquantes qui existent entre les fonctions d’huissier et celles de liquidateur. Premièrement, si les huissiers sont chargés d’exécuter les décisions de justice, les liquidateurs traitent toutes sortes de demandes, dont certaines ne sont pas fondées sur des jugements exécutoires. Deuxièmement, surtout, les huissiers, contrairement aux liquidateurs, sont investis de pouvoirs coercitifs en plus d’être désignés, rémunérés et étroitement contrôlés par l’autorité compétente de l’Etat. Par conséquent, si, dans le cadre des procédures de faillite, l’Etat défendeur a confié l’administration des sociétés insolvables à leurs créanciers et aux liquidateurs désignés par eux, il a, dans le cadre des procédures d’exécution, choisi d’agir par le biais de ses propres agents et d’être directement responsable de leur fait.
vi. Conclusion
107. Il apparaît que, au moment des faits, le liquidateur jouissait d’une indépendance opérationnelle et institutionnelle considérable, dès lors que les autorités de l’Etat n’étaient pas habilitées à lui donner des instructions et ne pouvaient donc pas intervenir directement dans le processus de liquidation lui-même. A cet égard, le rôle de l’Etat se limitait à la mise en place du cadre légal de la procédure de liquidation, à la définition des fonctions et pouvoirs de l’organe représentatif des créanciers et du liquidateur et au contrôle du respect des règles. Dès lors, l’action du liquidateur n’était pas celle d’un agent de l’Etat. Aussi l’Etat défendeur ne peut-il être tenu pour directement responsable des irrégularités commises par le liquidateur en l’espèce. Le fait qu’un juge était habilité à exercer un contrôle sur la légalité de l’action du liquidateur ne change rien à ce constat.
108. Cela étant, la Cour doit aussi rechercher si l’Etat défendeur a manqué à l’une quelconque des obligations positives qui lui incombaient en l’espèce.
2. Nature et étendue des obligations positives de l’Etat dans le cadre des procédures de faillite
a) Principes généraux
109. La Cour a dit à maintes reprises que l’article 1 du Protocole no 1 renferme également certaines obligations positives. Ainsi, dans l’arrêt Öneryildiz c. Turquie ([GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII), qui concernait la destruction des biens du requérant à la suite d’une explosion de gaz, elle a dit que l’exercice réel et efficace du droit garanti par cette disposition ne dépend pas uniquement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence mais peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par l’intéressé de ses biens. Même dans le cadre de relations horizontales il peut y avoir des considérations d’intérêt public susceptibles d’imposer certaines obligations à l’Etat. Ainsi, dans l’arrêt Broniowski c. Pologne ([GC], no 31443/96, § 143, CEDH 2004-V), la Cour a dit que les obligations positives découlant de l’article 1 du Protocole no 1 peuvent entraîner pour l’Etat certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété. Dès lors, des considérations d’intérêt général susceptibles d’imposer certaines obligations à l’Etat peuvent entrer en jeu même dans le cadre de relations horizontales.
110. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’Etat au titre de l’article 1 du Protocole no 1 ne se prête pas à une définition précise, mais les principes applicables n’en sont pas moins comparables. Que l’on analyse l’affaire sous l’angle de l’obligation positive de l’Etat ou sous celui de l’ingérence des pouvoirs publics, qui doit être justifiée, les critères à appliquer ne sont pas différents en substance. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble. Il est également vrai que les objectifs énumérés dans cette disposition peuvent jouer un certain rôle dans l’appréciation de la question de savoir si un équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt public et le droit fondamental du requérant à la propriété. Dans les deux cas, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer les mesures à prendre afin d’assurer le respect de la Convention (voir, mutatis mutandis, Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, §§ 98 et suiv., CEDH 2003-VIII, et Broniowski [GC], précité, § 144).
111. La nature et l’étendue des obligations positives de l’Etat varient selon les circonstances. Par exemple, dans l’affaire Öneryildiz précitée, la privation de propriété subie par le requérant avait pour origine une négligence manifeste des autorités dans une situation particulièrement dangereuse. En revanche, lorsque sont en cause des relations commerciales ordinaires entre particuliers, ces obligations positives sont bien plus limitées. Ainsi, la Cour a souligné à de nombreuses reprises que l’article 1 du Protocole no 1 ne peut être interprété comme faisant peser sur les Etats contractants une obligation générale d’assumer les dettes d’entités privées (voir, mutatis mutandis, la décision Shestakov précitée et l’arrêt Scollo précité, § 44 ; voir en particulier le raisonnement de la Cour dans la décision Anokhin c. Russie (déc.), no 25867/02, 31 mai 2007).
112. Toutefois, la Cour a également dit que, dans certaines circonstances, l’article 1 du Protocole no 1 peut imposer « certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété (...), même dans les cas où il s’agit d’un litige entre des personnes physiques ou morales » (Sovtransavto Holding, précité, § 96). Ce principe a été largement appliqué dans le contexte de procédures d’exécution dirigées contre des débiteurs privés (Fuklev, précité, §§ 89-91, Kesyan, précité, §§ 79-80 ; voir également Kin-Stib et Majkic c. Serbie, no 12312/05, § 84, 20 avril 2010, Marcic et autres c. Serbie, no 17556/05, § 56, 30 octobre 2007, et, mutatis mutandis, Matheus c. France, no 62740/00, §§ 68 et suiv., 31 mars 2005).
113. Dans son arrêt Blumberga c. Lettonie (no 70930/01, § 67, 14 octobre 2008), la Cour a dit : « toute atteinte au droit au respect des biens commise par un particulier fait naître pour l’Etat l’obligation positive de garantir dans son ordre juridique interne que le droit de propriété sera suffisamment protégé par la loi et que des recours adéquats permettront à la victime de pareille atteinte de faire valoir ses droits, notamment, le cas échéant, en demandant réparation du préjudice subi ». Il s’ensuit que l’Etat peut être tenu de prendre en pareilles circonstances soit des mesures préventives, soit des mesures de réparation.
114. Parmi les mesures de réparation que l’Etat peut être tenu de prendre dans certaines circonstances, il y a la mise en place de voies de droit adéquates permettant à la partie lésée de se prévaloir effectivement de ses droits. L’existence d’obligations positives de nature procédurale sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, malgré le silence de cette disposition sur ce point, a été reconnue par la Cour aussi bien dans des affaires concernant des autorités de l’Etat (Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 45, CEDH 2002-IV ; voir également Zehentner c. Autriche, no 20082/02, § 73, 16 juillet 2009) que dans des affaires portant, comme en l’espèce, sur un litige opposant uniquement des particuliers. Ainsi, dans une affaire relevant de la seconde catégorie, la Cour a jugé que l’Etat avait l’obligation de prévoir une procédure judiciaire offrant les garanties procédurales nécessaires et permettant ainsi aux tribunaux nationaux de trancher efficacement et équitablement tout litige éventuel entre particuliers (Sovtransavto Holding, précité, § 96 ; voir aussi Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007-I, et Freitag c. Allemagne, no 71440/01, § 54, 19 juillet 2007).
115. La Cour rappelle enfin que, lorsqu’elle contrôle le respect de l’article 1 du Protocole no 1, elle doit se livrer à un examen global des divers intérêts en jeu en gardant à l’esprit que la Convention vise à sauvegarder des droits concrets et effectifs. Elle doit aller au-delà des apparences et s’enquérir des réalités de la situation dénoncée (Plechanow, précité, § 101).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
116. La Cour observe d’emblée que l’action illégale du liquidateur a causé au requérant un préjudice, comme l’ont confirmé les tribunaux russes. Elle rappelle toutefois que l’Etat ne peut être tenu pour directement responsable des dettes d’une société privée ni des fautes commises par ses dirigeants (ou, comme en l’occurrence, par un liquidateur de faillite). En déposant son argent dans une banque privée, le requérant en l’espèce a pris certains risques, tenant notamment à la possibilité d’erreurs de gestion voire d’abus de confiance. L’Etat n’avait donc pas à assumer la moindre responsabilité civile pour des irrégularités commises par le liquidateur.
117. La Cour relève toutefois que les irrégularités commises par le liquidateur en l’espèce étaient graves et qu’elles ont donné lieu à d’importantes réclamations, auxquelles le juge interne a fait droit. De plus, elles se sont produites dans un domaine où toute négligence de la part de l’Etat dans la lutte contre la mauvaise gestion ou la fraude peut avoir des conséquences catastrophiques sur l’économie du pays et léser un grand nombre de personnes dans leur droit de propriété. Dans ces conditions, la Cour estime que, au titre des obligations découlant de l’article 1 du Protocole no 1, l’Etat doit à tout le moins instaurer un cadre législatif minimum, prévoyant notamment une instance adéquate permettant aux personnes se trouvant dans une situation telle que celle du requérant en l’espèce de se prévaloir effectivement de leurs droits et d’en obtenir la sanction. Un Etat qui n’agirait pas ainsi manquerait en effet gravement à son obligation de protéger la prééminence du droit et de prévenir l’arbitraire. La Cour va donc examiner si, en l’espèce, l’Etat défendeur a respecté cette obligation en mettant à la disposition du requérant des voies de droit propres à lui permettre de faire réellement valoir ses droits et en créant une instance de règlement appropriée à cette fin.
118. Quant aux mesures préventives que l’Etat aurait pu être tenu de prendre, la Cour rappelle que, la Convention n’étant entrée en vigueur à l’égard de la Russie que le 5 mai 1998, elle n’est pas compétente ratione temporis pour examiner ce que l’Etat aurait pu faire pour empêcher la distribution illégale des actifs de la banque par le liquidateur en 1996. Elle peut toutefois déterminer si, en 1998 et 1999, il existait dans ce pays un quelconque mécanisme propre à réparer le tort causé au requérant par les irrégularités du liquidateur et, dans l’affirmative, pourquoi il n’a pas été effectif dans son cas.
i. Sur l’existence de voies de droit adéquates
a) Le recours dirigé contre la banque
119. La Cour constate que le requérant a cherché à deux reprises à être rétabli dans ses droits. En 1998, il assigna en justice le liquidateur en sa qualité d’administrateur de la banque, invoquant les dispositions de la loi sur la faillite qui prévoyaient le contrôle par le juge de l’action du liquidateur (paragraphe 46 ci-dessus). Dans sa décision définitive du 12 novembre 1998, le tribunal fédéral de commerce du Caucase du Nord lui donna gain de cause et ordonna au liquidateur de le dédommager. Or cette décision ne fut pas exécutée, la distribution d’argent aux créanciers « privilégiés » ayant absorbé la quasi-totalité des actifs de la banque sans qu’aucun nouvel actif ne fût découvert. Ce recours s’est donc révélé ineffectif et inapte à réparer le tort causé à l’intéressé. La seule voie de droit restante était donc un recours en responsabilité délictuelle contre le liquidateur.
ß) Le recours en responsabilité délictuelle contre le liquidateur
120. Nul ne conteste qu’à l’époque des faits le requérant aurait pu agir en réparation contre le liquidateur à titre personnel sur la base des dispositions générales du droit russe de la responsabilité délictuelle. La Cour constate qu’avant 1998 il n’existait aucune disposition légale prévoyant expressément l’engagement de la responsabilité personnelle du liquidateur en cas de faute de gestion, ni aucune jurisprudence constante en la matière. La situation a évolué depuis lors, la loi de 1998 sur la faillite, en son article 21 § 3, permettant aux créanciers de se faire indemniser par le liquidateur de tout dommage susceptible d’avoir été causé par une action ou une omission illégale de sa part. La Cour est néanmoins disposée à croire que, comme le Gouvernement le dit, cette disposition n’a pas instauré la responsabilité personnelle du liquidateur en droit russe, elle n’a fait qu’en confirmer l’existence. Il s’ensuit que, au moment des faits, le droit russe permettait, du moins en théorie, de demander réparation au liquidateur lui-même. La Cour doit à présent examiner l’effectivité de cette voie de droit dans les circonstances de l’espèce.
ii. Sur l’effectivité de la voie de droit existante
121. Le Gouvernement soutient que la loi permettait à tout créancier lésé par un liquidateur de demander réparation à celui-ci à titre personnel mais que le requérant n’a pas correctement usé de cette possibilité, et ce pour deux raisons. Premièrement, en saisissant un tribunal de commerce plutôt qu’un tribunal de droit commun, l’intéressé ne se serait pas adressé à la bonne juridiction. A l’appui de cet argument, le Gouvernement invoque la décision du Tribunal supérieur de commerce du 17 avril 2001. Deuxièmement, le requérant aurait formulé sa demande trop tôt, à savoir avant la clôture de la procédure de faillite.
a) Quant à savoir si le requérant s’est adressé à la juridiction compétente
122. Sur la question de savoir si le requérant a saisi ou non la juridiction compétente, la Cour reconnaît que, en principe, les tribunaux internes sont mieux placés qu’elle pour interpréter la législation nationale. Elle constate à cet égard que les deux procédures dirigées contre le liquidateur, closes respectivement en 1998 et 1999, ont été examinées par les tribunaux de commerce. Or, en 2001, le Tribunal supérieur de commerce a annulé la décision rendue à l’issue de la procédure conduite en 1999 au motif que, l’intéressé ayant demandé réparation au liquidateur à titre personnel (et non en tant qu’administrateur de la banque), il lui aurait fallu saisir le juge de droit commun. La Cour n’est pas convaincue que dans les circonstances de l’espèce le requérant aurait pu savoir que seuls les tribunaux ordinaires étaient alors compétents pour connaître de sa demande.
123. De fait, si le code de procédure civile disposait à l’époque que les litiges d’ordre pécuniaire entre un individu et une société devaient être portés devant le juge de droit commun (paragraphe 52 ci-dessus), les lois de 1992 et 1998 sur l’insolvabilité, ainsi que le code de procédure commerciale et la loi de 1999 sur l’insolvabilité des banques (dans lesquelles il faut apparemment voir des lex specialis) prévoyaient une règle différente, faisant passer sous la compétence des tribunaux de commerce tout litige né d’une procédure de faillite (paragraphes 53 et suiv. ci-dessus). Par ailleurs, aucune de ces lois n’établissait de distinction entre les actions formées par les créanciers contre le liquidateur en sa qualité d’administrateur de la personne morale en faillite et celles formées contre lui personnellement en tant qu’auteur d’une faute.
124. De surcroît, le Gouvernement ne s’appuie sur aucun précédent remontant à l’époque des faits qui serait de nature à confirmer l’existence d’une telle distinction en droit russe. Il cite bien l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 12 mars 2001 (no 4-P), mais celui-ci est postérieur aux faits en cause. En outre, la Cour constitutionnelle y a simplement dit que, si un juge commercial se déclare incompétent pour examiner la demande d’un créancier personne physique, celui-ci peut saisir les tribunaux ordinaires. Elle a par ailleurs souligné que rien dans les dispositions de la loi sur la faillite « n’empêch[ait] les tribunaux de commerce de rendre des décisions garantissant pleinement aux intéressés leur droit à la protection judiciaire dans le cadre de la procédure de faillite ».
125. Enfin, la Cour relève que, quand bien même le requérant aurait commis une erreur, celle-ci n’a sauté aux yeux ni des parties ni du représentant de la Banque centrale de Russie qui avait participé à la procédure conduite en 1999. De surcroît, les tribunaux de commerce de trois degrés se sont déclarés compétents pour connaître du litige. Ce n’est qu’en 2001 que l’exception d’incompétence a été soulevée dans le cadre de la procédure de supervision introduite après la communication de l’affaire au Gouvernement par la Cour et à l’issue de laquelle ont été annulées toutes les décisions antérieures des tribunaux de commerce (celles du 4 février, du 31 mars et du 9 juin 1999).
126. Il s’ensuit que les règles qui régissaient à l’époque la compétence des tribunaux en question n’étaient pas claires et que, en saisissant une juridiction qui apparaissait compétente, le requérant a agi de manière raisonnable. Dans ces conditions, la Cour estime que, après l’annulation en 2001 par voie de supervision des décisions rendues en 1999, on ne pouvait attendre de l’intéressé qu’il formât le même recours devant un autre tribunal. A la date de l’introduction de sa requête devant la Cour, le requérant avait de bonnes raisons de penser qu’il avait emprunté les bonnes voies légales et que le jugement du 9 juin 1999 constituait la décision définitive en la matière. Dès lors, même s’il s’est effectivement adressé à une juridiction incompétente, cette erreur ne saurait raisonnablement être retenue contre lui.
ß) Quant à savoir si le requérant a esté en justice trop tôt
127. Le Gouvernement soutient également que si le requérant n’a pas obtenu gain de cause, c’est parce que la procédure de liquidation était toujours pendante. Il estime que, tant que la banque continuait d’exister, il demeurait possible que la somme initialement allouée à l’intéressé lui fût remboursée sur le reste des actifs. Il en conclut que, si le juge avait indemnisé le requérant, celui-ci aurait pu prétendre au recouvrement de la même somme deux fois : des mains de la banque et de celles du liquidateur (thèse dite du double recouvrement). Il estime en revanche qu’une fois la procédure de liquidation clôturée, l’intéressé avait effectivement le droit de former un nouveau recours et de solliciter une indemnisation adéquate. En somme, pour le Gouvernement, le requérant n’a été que provisoirement empêché de demander réparation au liquidateur, à savoir pendant que la procédure de liquidation était en cours. La Cour va à présent examiner cet argument en se basant sur le raisonnement développé par les juridictions internes dans le cadre de l’instance conduite en 1999.
128. La Grande Chambre relève que, dans son jugement du 9 juin 1999, je juge commercial a clairement fait fond sur la thèse du double recouvrement. Pour l’essentiel, à partir du 17 juin 1999, date de l’homologation par le tribunal de commerce de la liquidation de la banque, le requérant avait la possibilité de former contre le liquidateur une action en responsabilité délictuelle pour négligence et faute professionnelle. Or, pour des raisons qui demeurent inconnues, il ne l’a pas fait. Quelles qu’aient pu être ces raisons, rien dans ce jugement n’était de nature à empêcher l’intéressé d’assigner le liquidateur en justice une fois close la procédure de liquidation.
129. Aux yeux de la Cour, la thèse du double recouvrement retenue par les juridictions internes n’est pas dénuée de pertinence. En effet, si le requérant avait attaqué le liquidateur en justice avec succès puis recouvré ultérieurement la somme que la banque avait initialement été condamnée à lui rembourser, il aurait effectivement été dédommagé deux fois de ce qui était essentiellement le même préjudice financier. Dès lors, le refus par le juge de connaître des demandes formulées par l’intéressé contre le liquidateur tant que la procédure de liquidation était pendante avait une raison d’être. Même si, au vu des circonstances de l’espèce, la probabilité d’un recouvrement de la somme due par la banque était faible, la règle générale appliquée par le tribunal dans sa décision du 9 juin 1999 ne saurait être considérée comme dépourvue de justification raisonnable.
130. Cette règle a certes pour conséquence qu’un créancier lésé doit attendre la dissolution de la société débitrice avant de pouvoir demander réparation au liquidateur à titre personnel. La Cour souligne toutefois que, dans les affaires introduites par voie de requête individuelle, elle n’a pas pour tâche de contrôler dans l’abstrait la législation litigieuse. Elle doit au contraire se limiter autant que possible à examiner les questions soulevées par l’affaire dont elle est saisie (voir, mutatis mutandis, parmi de nombreux autres précédents, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 83, CEDH 2010). En l’espèce, la banque a été liquidée le 17 juin 1999, soit huit jours après que les tribunaux eurent statué sur les demandes formulées par l’intéressé contre le liquidateur. Si l’on examine les choses dans leur globalité, seul un bref laps de temps s’est donc écoulé entre le moment où le requérant a appris que la banque n’avait plus d’actifs pour lui rembourser la somme qui lui revenait en vertu de la décision du 12 novembre 1998 et la date à laquelle il lui est devenu possible de poursuivre le liquidateur en réparation.
131. La Cour rappelle en outre que la marge d’appréciation devant être accordée au législateur pour la mise en œuvre de ses choix en matière économique ou sociale doit être étendue (voir, parmi de nombreux précédents, Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 91, CEDH 2005-VI), surtout dans un cas comme celui-ci, où l’Etat doit avoir égard aux intérêts privés entrant en concurrence dans le cadre de relations horizontales dans un domaine tel que celui de la faillite bancaire.
132. En somme, la loi prévoyait un mécanisme compensatoire « différé », mais le requérant n’en a pas fait usage au moment où il en a eu la faculté. L’impossibilité de demander réparation au liquidateur ayant été brève dans sa durée – concomitante à celle de la procédure de liquidation – et le requérant n’ayant avancé aucun argument propre à expliquer en quoi cette durée aurait été excessive au vu des circonstances, la Cour considère que la restriction litigieuse n’a pas porté atteinte à la substance des droits résultant pour l’intéressé de l’article 1 du Protocole no 1 et qu’elle relevait de la marge d’appréciation reconnue à l’Etat.
133. Il s’ensuit que le cadre légal mis en place par l’Etat offrait au requérant un mécanisme lui permettant de faire respecter les droits que lui garantissait l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, la Cour conclut que l’Etat a satisfait aux obligations positives découlant pour lui de cette disposition. Eu égard à ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément l’exception préliminaire du Gouvernement.
DURÉE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE
TETU C. FRANCE du 22 septembre 2011 Requête 60983/09
53. Le requérant se plaint de ce que la procédure de liquidation judiciaire l’a dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens pendant plus de vingt ans. Il dénonce une atteinte au droit au respect de ses biens.
54. Le Gouvernement soutient que la procédure de liquidation judiciaire est prévue par la loi et poursuit un but légitime, à savoir garantir aux créanciers le recouvrement de leurs créances. Il souligne également que le requérant été privé, non pas de sa propriété, mais de la disposition et de l’administration de ses biens. Selon lui, l’ingérence dans le droit au respect des biens du requérant s’analyse en une réglementation des biens. Quant à la durée de la procédure, le Gouvernement rappelle qu’elle est imputable aux difficultés liées au règlement de la succession et au comportement du requérant, qui a fait preuve d’un manque de diligence caractérisé. Il ajoute que celui-ci aurait pu lui-même rechercher et proposer des acquéreurs pour ses biens, à charge pour lui d’obtenir l’aval du liquidateur et du juge commissaire. Le Gouvernement souligne également que le requérant n’a effectué aucune démarche pour obtenir la clôture de la procédure collective, alors qu’il pouvait agir auprès du liquidateur, du juge commissaire ou du ministère public en ce sens.
55. La Cour constate que les parties s’entendent sur le fait que la procédure de liquidation judiciaire a constitué une ingérence dans le droit au respect des biens du requérant. Elle partage ce point de vue.
56. La Cour observe qu’à la suite du jugement du 11 octobre 1990 prononçant la liquidation judiciaire et en application de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 (paragraphe 30 ci-dessus), le requérant n’a pas été privé de sa propriété, mais dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens. L’ingérence litigieuse s’analyse donc en une réglementation de l’usage des biens, au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
57. La Cour relève que l’interdiction faite au débiteur d’administrer ses biens et d’en disposer durant la procédure de liquidation judiciaire poursuit un but légitime, à savoir garantir aux créanciers du débiteur le recouvrement de leurs créances.
58. Elle rappelle qu’une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 49, CEDH 1999-V).
59. Comme elle l’a déjà rappelé dans d’autres affaires, la Cour considère que la limitation du droit du requérant au respect de ses biens n’est pas critiquable en soi, compte tenu notamment du but légitime visé et de la marge d’appréciation autorisée par le second alinéa de l’article 1. Cependant, un tel système emporte le risque d’imposer au requérant une charge excessive quant à la possibilité de disposer de ses biens, notamment à la lumière de la durée d’une procédure qui, telle la présente, s’étale sur plus de vingt ans (Luordo c. Italie, no 32190/96, § 70, CEDH 2003-IX).
60. Compte tenu de la durée excessive de la procédure constatée en l’espèce (paragraphe 45 ci-dessus), la Cour estime que la limitation du droit du requérant au respect de ses biens n’était pas justifiée tout au long de la procédure dès lors que, nonobstant le fait qu’en principe la privation de l’administration et de la disponibilité des biens est une mesure nécessaire afin d’atteindre le but poursuivi, cette nécessité s’amenuise avec le temps (voir, entre autres, Luordo précité). De l’avis de la Cour, la durée de cette procédure a donc entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l’intérêt individuel du requérant au respect de ses biens. L’ingérence dans le droit du requérant se révèle dès lors disproportionnée à l’objectif poursuivi.
61. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
UNE PROCÉDURE PÉNALE NE PEUT PAS PORTER
ATTEINTE A LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE
Le Décret n° 2016-499 du 22 avril 2016 porte publication de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ensemble une annexe), signée par la France à Strasbourg le 23 mars 2011.
Cliquez sur un lien bleu pour accéder :
- A LA PROCÉDURE D'ACCUSATION PÉNALE QUI DOIT RESPECTER LA PROPRIÉTÉ
- LA SAISIE D'UN BIEN QUI SERT A COMMETTRE l'INFRACTION
- LA SAISIE D'UN BIEN ACQUIS PAR UN GAIN DÉLICTUEUX
- A LA JURISPRUDENCE INTERNE FRANÇAISE
UNE PROCÉDURE D'ACCUSATION PÉNALE
DOIT RESPECTER LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
AMERISOC CENTER S.R.L. c. LUXEMBOURG du 17 octobre 2024 requête 50527/20
Art 1 P1 • Réglementer l’usage des biens • Absence de recours permettant de contester utilement la saisie d’avoirs bancaires luxembourgeois suite à une demande d’entraide internationale • Juridictions nationales n’ayant pas évalué la proportionnalité de la mesure qui, de par sa nature et son ampleur, apparaissait a priori comme importante et sévère et qui perdure depuis six ans • Portée trop étroite du contrôle • Absence d’une possibilité raisonnable pour la requérante de faire valoir son point de vue dans le cadre d’une procédure contradictoire • Mesure disproportionnée
CEDH
38. Le 5 décembre 2018, le juge d’instruction luxembourgeois a ordonné, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale additionnelle émise le 22 novembre 2018 par le parquet de Lima, une perquisition ainsi que la saisie des avoirs inscrits sur le compte bancaire de la requérante (paragraphe 14 ci-dessus). Les parties s’accordent sur le fait que cette saisie visait à garantir la confiscation ultérieure des fonds dans le cadre de la procédure ouverte par les autorités pénales péruviennes.
39. Les fonds ont ainsi été saisis à hauteur de 2 605 589 USD, ce qui, d’après la requérante, constituait la quasi-totalité de ses actifs et l’a amenée à s’endetter par la suite. La requérante a formé, en vain, plusieurs recours contre la saisie, auprès des autorités aussi bien péruviennes que luxembourgeoises.
40. La Cour estime que l’ordonnance du 5 décembre 2018 relative à la saisie des avoirs inscrits sur le compte bancaire constitue une ingérence dans la jouissance du droit de la requérante au respect de ses biens.
41. La Cour rappelle que le gel d’avoirs prononcé dans le cadre d’une procédure pénale en vue de les garder disponibles pour faire face à une éventuelle sanction pécuniaire doit être analysé au regard de l’article 1, deuxième alinéa, du Protocole no 1, qui permet notamment aux États de contrôler l’utilisation de biens pour garantir le paiement des sanctions (Shorazova, précité, § 104). Selon la Cour, il en est de même lorsqu’un État a imposé le gel dans le contexte de l’entraide judiciaire internationale, sur requête des autorités d’un autre État dans lequel des procédures pénales ont été engagées.
42. Dans de tels cas, outre le point de savoir si la mesure était prévue par la loi, « conforme à l’intérêt général » et proportionnée au but recherché, une question peut également se poser, en fonction des circonstances de l’espèce, quant au respect des obligations procédurales inhérentes à l’article 1 du Protocole no 1. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, nonobstant le silence dudit article en matière d’exigences procédurales, une procédure judiciaire afférente au droit au respect des biens doit aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition. Une ingérence dans les droits prévus par l’article 1 du Protocole no 1 ne peut ainsi avoir de légitimité en l’absence d’un débat contradictoire et respectueux du principe de l’égalité des armes, qui permette de discuter des aspects présentant de l’importance pour l’issue de la cause. Pour s’assurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer les procédures applicables d’un point de vue général (G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 302, 28 juin 2018).
43. La saisie litigieuse a été ordonnée conformément à la loi sur l’entraide judiciaire internationale, de sorte qu’il s’agit d’une ingérence prévue par la loi.
44. La mesure en question vise en outre à la coopération entre États en vue de combattre la criminalité organisée, et tend à empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de biens dont la provenance légitime n’a pas été démontrée. Elle poursuit donc un but légitime.
45. Il reste par conséquent à vérifier la proportionnalité de ladite ingérence.
46. Dans le cadre de cet examen, la Cour va se pencher sur la question de savoir si la requérante avait la possibilité de contester la mesure et de solliciter le déblocage, au moins partiel, de l’argent saisi par les autorités luxembourgeoises, question qui est indissolublement liée à celle de l’effectivité des recours judiciaires. La Cour est, certes, consciente de l’importance que revêt pour les États membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites et pouvant servir à financer des agissements criminels. Les juridictions internes n’en sont toutefois pas moins tenues à une obligation de contrôle face à un grief sérieux et fondé de défaillance dans la protection d’un droit consacré par la Convention.
47. Lorsqu’une saisie est effectuée par les autorités luxembourgeoises à la suite d’une demande émanant d’une autorité étrangère, l’article 9 de la loi sur l’entraide judiciaire internationale prévoit un contrôle d’office de la régularité de la procédure (paragraphe 23 ci-dessus). Dans le cadre de cette procédure, le « tiers concerné » peut présenter un « mémoire » dans un délai de dix jours à partir de la notification de la saisie à la banque.
48. Dans le cas où la banque révèle l’existence de l’ordonnance de saisie des avoirs au client qui en fait l’objet, ce dernier peut utilement déposer un mémoire et faire valoir ses arguments, y compris ceux tendant à une restitution des fonds saisis.
49. Il en va autrement si la banque fait le choix de ne pas dévoiler l’existence d’une telle ordonnance au client concerné. La loi sur l’entraide judiciaire internationale ne prévoit en effet aucun mécanisme obligatoire en vue d’assurer que le tiers concerné soit informé de la demande d’entraide judiciaire internationale relative à une saisie de fonds ou d’avoirs bancaires (paragraphe 25 in fine ci-dessus). En pareille hypothèse, ledit client ignore donc que le délai de forclusion de dix jours prévu à l’article 9 de la loi sur l’entraide judiciaire internationale a commencé à courir.
50. Or, tel était précisément le cas en l’espèce. Ainsi, la requérante indique sans être contredite par le Gouvernement, qu’elle n’a appris l’existence de l’ordonnance de saisie du 5 décembre 2018 qu’après l’échéance du délai prévu par l’article 9 de la loi sur l’entraide judiciaire internationale pour l’introduction d’un mémoire. L’intéressée ne pouvait en effet constater l’application de la mesure de saisie de son propre chef, les fonds lui étant en tout état de cause inaccessibles en vertu de la mesure de blocage, qu’elle avait du reste contestée (paragraphes 5 et 7 ci-dessus). L’ordonnance de la chambre du conseil du 1er février 2019 a dès lors été rendue sans que la requérante n’ait pu présenter de mémoire (paragraphe 16 ci-dessus).
51. Lorsque la requérante a introduit, ultérieurement, une demande en restitution en vertu de l’article 11 de la loi sur l’entraide judiciaire internationale, sa requête a été rejetée comme étant non fondée.
En effet, la chambre du conseil du tribunal a estimé, dans son ordonnance du 4 mars 2020, qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier un déblocage même partiel des avoirs saisis. Elle a ajouté ne pas pouvoir examiner, dans la procédure en cause, le moyen tiré du caractère disproportionné de la saisie, dès lors que la régularité formelle de la procédure avait été constatée dans le cadre de l’ordonnance du 1er février 2019, laquelle avait été rendue sans qu’un mémoire exposant cette critique n’eût été produit par la requérante (paragraphe 20 ci-dessus).
La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du 4 mars 2020, précisant en outre qu’il appartenait aux titulaires des biens saisis de s’adresser aux autorités de l’État requérant pour solliciter la mainlevée de la saisie. Elle a ajouté que « si certes, sais[ie] par [F.], la Cour supérieure de justice spécialisée péruvienne a[vait] déclaré irrecevable la demande en mainlevée de la procédure luxembourgeoise de saisie, ce fait n’a[vait] cependant aucune incidence sur les conditions légales régissant au Luxembourg une demande en restitution formulée en raison d’une saisie opérée sur base d’une sollicitation d’entraide judiciaire internationale » (paragraphe 21 ci-dessus).
52. Il en résulte qu’à aucun moment les autorités luxembourgeoises n’ont procédé à une évaluation de la proportionnalité de la mesure qui, de par sa nature et son ampleur, apparaissait a priori comme importante et sévère et qui, au demeurant, perdure depuis six ans.
53. Le Gouvernement ne saurait utilement invoquer le fait que, aux termes de l’article 9 de la loi sur l’entraide judiciaire internationale, le législateur a confié à la chambre du conseil le soin d’examiner d’office la régularité de la procédure. En effet, la motivation fournie par la chambre du conseil dans son ordonnance du 1er février 2019 est, en elle-même, une parfaite illustration de l’absence d’examen minutieux de la situation pertinente, puisque ladite juridiction déclare « se limit[er] à constater la régularité purement formelle des actes d’exécution de la demande d’entraide » (paragraphe 16 ci-dessus).
54. En conclusion, les autorités luxembourgeoises n’ont à aucun stade de la procédure déterminé si l’équilibre requis était atteint d’une manière conforme à l’article 1 du Protocole no 1.
55. Or, il appartenait aux juridictions internes de s’assurer que le gel des avoirs de la requérante ne causerait pas plus de dommages que ceux qui découlent inévitablement de pareille mesure (Apostolovi c. Bulgarie, no 32644/09, § 104, 7 novembre 2019). En effet, la Cour a déjà indiqué par le passé que si toute saisie entraîne un préjudice, le préjudice réel subi par les personnes affectées par une mesure de ce type ne doit pas, pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, être plus important que celui qui est inévitable. Certes, la Cour est consciente des difficultés inhérentes à la coopération internationale. Toutefois, même lorsqu’une mesure a été ordonnée dans le contexte d’une demande d’entraide judiciaire internationale émanant d’un autre État, comme c’était le cas en l’espèce, les autorités nationales se doivent d’appliquer en substance lesdits principes, et cela même en tenant compte des caractéristiques et mécanismes particuliers liés à l’entraide judiciaire internationale.
56. En l’espèce, la Cour se doit de constater que la portée du contrôle effectué par les juridictions luxembourgeoises était trop étroite pour satisfaire à l’exigence du respect d’un « juste équilibre » inhérente au second paragraphe de l’article 1 du Protocole no1.
57. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le Pérou n’a pas davantage examiné la question en cause (paragraphe 18 ci-dessus).
58. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les juridictions nationales n’ont pas offert à la requérante une possibilité raisonnable de faire valoir son point de vue dans le cadre d’une procédure contradictoire (voir, a contrario, Telbis et Viziteu c. Roumanie, no 47911/15, § 81, 26 juin 2018, et Ipek c. Turquie (déc.), no 4158/19, § 83, 21 septembre 2021).
59. Cette situation résulte, d’une part, de la loi sur l’entraide judiciaire internationale, qui ne prévoit pas la communication de l’information relative à la mesure de saisie au client de la banque concerné (lequel est, au final, en tant que déposant des fonds, la personne principalement visée par la mesure en question) et, d’autre part, de la décision des juridictions nationales de ne pas analyser les moyens invoqués par la requérante sur le terrain de l’article 11 de ladite loi.
60. Rappelant qu’il incombe en premier lieu aux Parties contractantes de garantir le respect des droits et libertés définis dans la Convention et ses Protocoles, la Cour estime que les États sont mieux placés pour choisir les moyens propres à garantir un système judiciaire conforme aux exigences de la Convention. Ainsi, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de savoir lequel des deux recours luxembourgeois – prévus respectivement à l’article 9 et à l’article 11 de la loi sur l’entraide judiciaire internationale – est le plus apte à assurer le respect desdites exigences conventionnelles. En l’occurrence, c’est bien l’absence de tout recours qui est problématique et amène au constat de violation.
61. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut qu’en l’espèce, la saisie des actifs de la société constitue une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens qui, en l’absence de recours permettant de contester utilement la mesure, était disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.
62. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement.
63. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention.
SCI Le Chateau du Francport c. France du 7 juillet 2022 requête no 3269/18
Article 1 du Protocole 1 : Refus d’indemniser le préjudice subi du fait de la dégradation d’un château saisi dans le cadre d’une instruction pénale faute de preuve de la responsabilité de l’État : violation du droit au respect des biens
L’affaire concerne, après la saisie, dans le cadre d’une instruction pénale, d’un château appartenant à la requérante – la Société Civile Immobilière Le Château du Francport, sa restitution dans un état dégradé quatre ans plus tard et le rejet de la demande en réparation formée par la société requérante, faute pour elle d’avoir rapporté la preuve que le préjudice résultait d’une faute lourde de l’État. La Cour estime que l’absence d’un inventaire complet effectué au moment de la pose des scellés sur le château ainsi que l’absence totale de suite donnée aux différentes alertes de la part de la société requérante, privée d’accès au château pendant toute la durée de la saisie, ont fait obstacle à ce que cette dernière puisse établir un lien de causalité entre le dysfonctionnement du service public de la justice constaté par les juges internes et le préjudice subi. La charge de la preuve concernant les dégradations du bien saisi incombait au service public de la justice, responsable de la conservation des biens pendant toute la période de la saisie et du placement sous scellés, et non à la société requérante, qui s’est vu ainsi imposer « une preuve impossible », ce qui constitue une charge excessive incompatible avec le respect de l’article 1 du Protocole n° 1. Les juridictions internes, qui ont examiné la demande de la société requérante, n’ont ni tenu compte de la responsabilité du service public de la justice ni permis à la société requérante d’obtenir réparation pour le préjudice résultant de la conservation défectueuse du bien saisi.
Photo du conte Olympe Aguado, dans la collection de J. Paul Getty au Getty Museum à Los Angeles en Californie.
 Quand la justice française et l'irresponsabilité
des juges empêchent le développement touristique d'une région.
Quand la justice française et l'irresponsabilité
des juges empêchent le développement touristique d'une région.
A Choisy-au-Bac, le projet d'hôtel-restaurant 4 étoiles au château du Francport est au point mort depuis une quinzaine d'années. « C'est l'arlésienne cette affaire-là » soupire Jean-Noël Guesnier, maire (SE). Racheté par des Anglais en 1999 pour environ 1 M€, le lieu verra les projets mis au pas par des procédures en justice portant sur des soupçons d'argent blanchi. Puis, plus tard, par un litige entre les propriétaires et l'exploitant, à qui a été confiée la restauration du lieu en 2013. Entre-temps, des dégradations, des vols et de nouvelles normes ont contribué à enterrer le projet hôtelier dans cette demeure datant de la fin du XIXe siècle.
ART 1 P1 • Réglementer l’usage des biens • Rejet des juridictions internes de la demande en réparation, suite à la saisie, lors d’une instruction pénale, d’un château, restitué dans un état dégradé quatre ans plus tard, faute pour la société requérante d’avoir rapporté la preuve que le préjudice résultait d’une faute lourde de l’État • Charge de la preuve incombant au service public de la justice responsable de la conservation des biens
FAITS
La requérante est la Société Civile Immobilière Le Château du Francport, personne morale de droit français. En mai 2000, le château du Francport fut vendu, par une société irlandaise, à la société requérante. Une information judiciaire fut ouverte le 5 juin 2002, notamment des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, banqueroute, à l’encontre, notamment, de R.P., promoteur immobilier de nationalité britannique, président du conseil d’administration de la SA Château du Francport et gérant de la société requérante.
Le 27 août 2002, le juge d’instruction ordonna la saisie et le placement sous scellés du château. La levée des scellés fut ordonnée par le juge le 26 juillet 2006. Le 12 mars 2010, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel (du chef de blanchiment) et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Compiègne. Le 17 mai 2011, ce dernier relaxa tous les prévenus, dont R.P. poursuivi des chefs de banqueroute par détournement d’actifs ainsi que par tenue d’une compatibilité fictive et d’abus de biens sociaux. Sur appel du procureur de la République, par un arrêt du 15 mars 2013, la cour d’appel d’Amiens déclara R.P., en sa qualité de président-directeur général de la SA Château du Francport, coupable de banqueroute par détournement d’actifs au préjudice de cette société. R.P. fut condamné à trois mois de prison avec sursis ainsi qu’au paiement d’une amende de 5 000 euros (EUR) ; sa relaxe des chefs de banqueroute par tenue d’une compatibilité fictive et d’abus des biens sociaux fut confirmée. Le 13 septembre 2010, la société requérante engagea la responsabilité de l’État, réclamant la réparation d’un préjudice évalué à 5 534 075,14 EUR, au motif que le service de la justice avait commis une faute lourde en raison d’un manque de protection du château durant la période de placement sous scellés. Le 7 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris rejeta la demande pour défaut de qualité à agir, en raison du caractère fictif de la requérante. La cour d’appel de Paris infirma ce jugement et débouta la société requérante de ses demandes. Après avoir constaté que la requérante était propriétaire du château et avait donc intérêt à agir, la cour d’appel considéra notamment que la requérante : « ne rapporte pas la preuve du préjudice directement imputable au dysfonctionnement du service public de la justice [...] ». La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante.
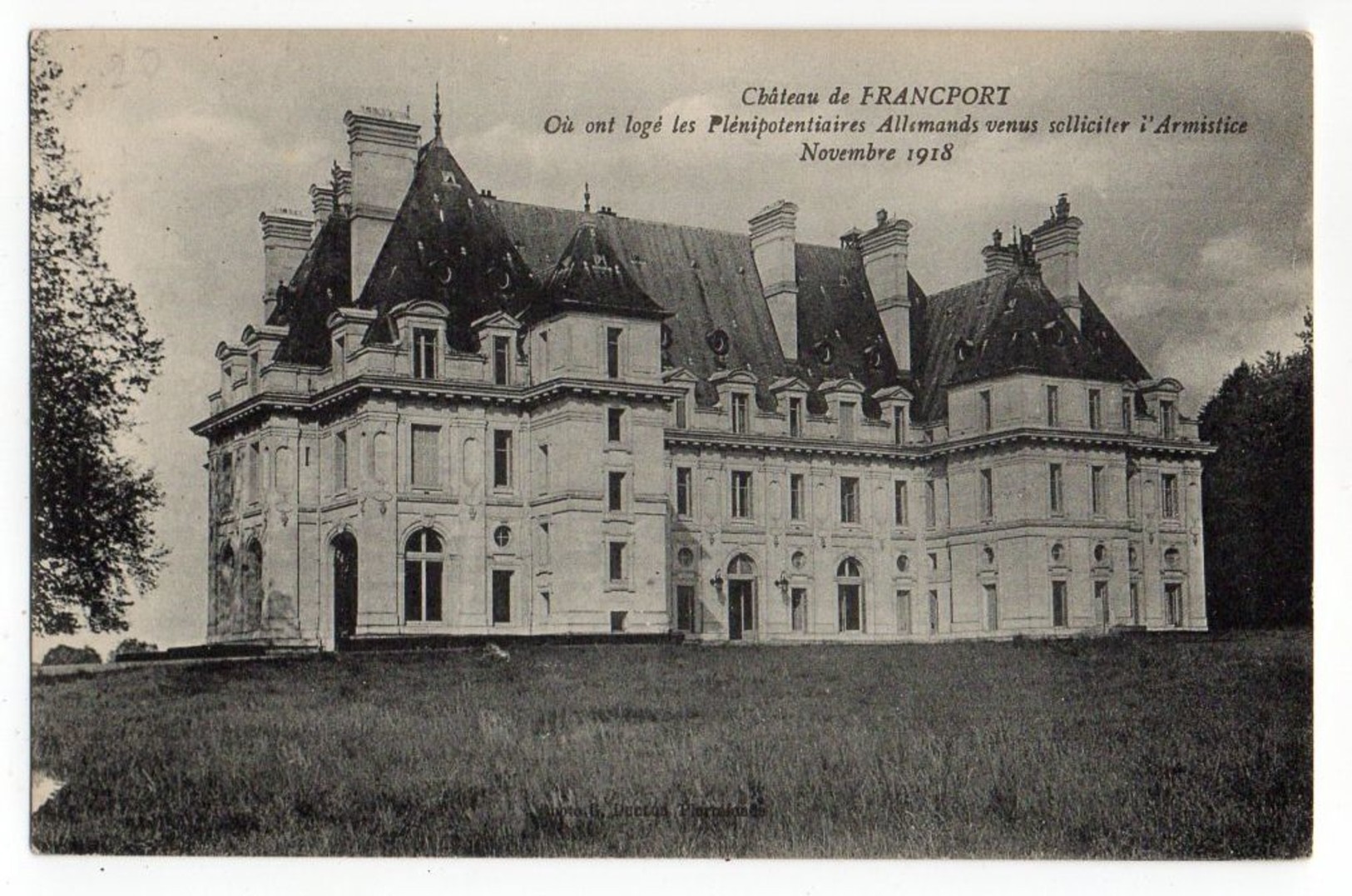 CEDH
CEDH
42. La Cour rappelle que la rétention des biens saisis par les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale doit être examinée sous l’angle du droit pour l’État de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 54, CEDH 2007-VII, Borjonov c. Russie, no 18274/04, § 57, 22 janvier 2009, et Tendam, précité, § 47). Lorsqu’elles saisissent ainsi des biens, les autorités doivent prendre les mesures raisonnables et nécessaires à leur protection et conservation (Dzugayeva c. Russie, no 44971/04, §§ 26-27, 12 février 2013), notamment en dressant un inventaire des biens et de leur état au moment de la saisie, ainsi que lors de leur restitution au propriétaire. Par ailleurs, la législation interne doit prévoir la possibilité d’engager une procédure contre l’État, afin d’obtenir réparation pour les préjudices résultant d’une conservation défectueuse de ces biens. Encore faut-il que cette procédure soit effective, pour permettre au propriétaire de défendre sa cause (Tendam, précité, § 51, et Dabic c. Croatie, no 49001/14, § 55, 18 mars 2021).
43. La Cour constate qu’en l’espèce, la saisie cherchait non pas à priver la société requérante de son bien de manière définitive, mais seulement à l’empêcher d’en user de façon temporaire ou de le dissiper par changement de propriétaire, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
44. Pour ce qui est de la base légale, la Cour observe que le procès-verbal (paragraphe 5 ci-dessus) se réfère notamment à l’article 92 du CPP, relatif au transport sur les lieux de la saisie, et non à l’article 97 invoqué par le Gouvernement (paragraphe 37 ci-dessus). Elle relève également que selon le rapport préparatoire à la loi no 2010-768 (paragraphe 20 ci-dessus), le droit français présentait des lacunes à l’époque des faits s’agissant des saisies immobilières prises à des fins conservatoires. En effet, les dispositions existantes étaient conçues principalement pour permettre l’appréhension matérielle de biens meubles corporels et étaient peu adaptées aux saisies d’immeubles ou de meubles incorporels, ainsi qu’aux saisies n’impliquant pas dépossession, l’article 97 ne visant que les biens utiles à l’enquête. Dans ce contexte, la société requérante a soutenu, sans que le Gouvernement le conteste, qu’en pratique les juridictions internes avaient eu recours à des saisies sans dépossession avant même l’adoption de la loi no 2010-768 (paragraphe 34 in fine ci-dessus).
45. Les parties ne s’accordent non plus sur la question de savoir si le château en question était ou non l’instrument de l’infraction pour laquelle R.P, le gérant de la requérante, a finalement été condamné, et si la saisie poursuivait effectivement le but de lutter contre le détournement d’actifs. La Cour note sur ce point que les poursuites de R.P. pour le délit de blanchiment se sont terminées par un non-lieu (paragraphe 9 ci-dessus) et que ce dernier n’a été condamné que pour le délit de détournement d’actifs dû à de la simple négligence de sa part et non pas à la mise en place de montages et d’opérations poursuivant un objectif frauduleux (paragraphe 10 ci-dessus). Cela permet de conclure que le château en question n’a pas été le produit d’une entreprise « criminelle » de grande envergure.
46. Dans ces conditions, la Cour reste dubitative quant à la légalité de l’ingérence litigieuse ainsi qu’à la légitimité du but poursuivi par celle-ci. Elle estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce de trancher ces questions dès lors que cette ingérence méconnaît l’article 1 du Protocole no 1 pour d’autres raisons exposées ci-après.
47. La Cour rappelle qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but poursuivi par les mesures appliquées par l’État, y compris celles destinées à contrôler l’usage de la propriété individuelle. Cette exigence s’exprime dans la notion de « juste équilibre » à ménager entre les impératifs de l’intérêt général de la communauté d’une part et les exigences de la protection des droits fondamentaux de l’individu d’autre part (Smirnov c. Russie, précité, § 57). Par ailleurs, malgré le silence de l’article 1 du Protocole no 1 en matière d’exigences procédurales, les règles applicables en la matière doivent aussi offrir à la personne ayant subi une ingérence dans la jouissance de ses biens une occasion de faire valoir sa cause devant les autorités compétentes. Elle doit notamment avoir la possibilité de contester de manière effective les mesures portant atteinte aux droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Tendam, précité, § 49).
48. La Cour rappelle en outre que c’est aux autorités qu’il incombait en l’espèce de prendre les mesures raisonnables et nécessaires à la protection et à la conservation en bon état du bien en question et de dresser un inventaire de celui-ci au moment de la saisie ainsi que lors de sa restitution, comme l’exige sa jurisprudence citée au paragraphe 42 ci-dessus. Or, il n’est pas contesté en l’occurrence que le château a subi, pendant la période de la saisie et de placement sous scellés, d’importantes dégradations allant manifestement au-delà des altérations inévitables dues à l’usure ou à des événements imprévisibles (paragraphe 8 in fine ci-dessus). Il semblerait en outre qu’un inventaire complet de l’état du bien n’ait pas été effectué au moment de sa saisie puisque, selon la cour d’appel de Paris, l’intérieur du château au moment de l’apposition des scellés n’était que partiellement connu.
 49. La Cour relève également que, selon
la cour d’appel, il appartenait au service public de la
justice d’assurer la conservation du bâtiment sur lequel il
avait fait apposer des scellés et qu’il avait donc rendu
inaccessible à la société requérante. Malgré ce constat, la
cour d’appel a néanmoins reproché à cette dernière de ne
pas avoir assuré le gardiennage du château entre août 2002 et
novembre 2004 et n’a retenu aucune responsabilité de l’État
pendant cette période. Sur ce point, la Cour observe pourtant
que l’article 706-143 du CPP, selon lequel le propriétaire
est responsable, à sa charge, de l’entretien et de la
conservation du bien saisi jusqu’à la mainlevée, n’a
été introduit dans le CPP qu’en juillet 2010, soit
plusieurs années après la restitution du château à la
requérante. Bien que le Gouvernement ait indiqué que cette
disposition traduisait la pratique judiciaire telle qu’elle
existait avant cet amendement (paragraphe 40 ci-dessus), aucun
exemple d’une telle pratique n’a été fourni à la
Cour. Le rapport préparatoire à la réforme législative
intervenue ultérieurement reconnaît d’ailleurs
expressément qu’aucune politique d’ensemble de gestion
de ces biens n’était conduite jusqu’alors, que la
sécurisation des biens saisis était problématique et que l’administration
de ces biens restait à la charge des parquets (paragraphe 20 ci-dessus).
49. La Cour relève également que, selon
la cour d’appel, il appartenait au service public de la
justice d’assurer la conservation du bâtiment sur lequel il
avait fait apposer des scellés et qu’il avait donc rendu
inaccessible à la société requérante. Malgré ce constat, la
cour d’appel a néanmoins reproché à cette dernière de ne
pas avoir assuré le gardiennage du château entre août 2002 et
novembre 2004 et n’a retenu aucune responsabilité de l’État
pendant cette période. Sur ce point, la Cour observe pourtant
que l’article 706-143 du CPP, selon lequel le propriétaire
est responsable, à sa charge, de l’entretien et de la
conservation du bien saisi jusqu’à la mainlevée, n’a
été introduit dans le CPP qu’en juillet 2010, soit
plusieurs années après la restitution du château à la
requérante. Bien que le Gouvernement ait indiqué que cette
disposition traduisait la pratique judiciaire telle qu’elle
existait avant cet amendement (paragraphe 40 ci-dessus), aucun
exemple d’une telle pratique n’a été fourni à la
Cour. Le rapport préparatoire à la réforme législative
intervenue ultérieurement reconnaît d’ailleurs
expressément qu’aucune politique d’ensemble de gestion
de ces biens n’était conduite jusqu’alors, que la
sécurisation des biens saisis était problématique et que l’administration
de ces biens restait à la charge des parquets (paragraphe 20 ci-dessus).
50. Puis, en ce qui concerne les dégradations ayant pu être commises entre novembre 2004 et avril 2006, la cour d’appel de Paris a admis que celles-ci ont été signalées par la requérante au juge d’instruction et a constaté qu’il y avait eu une inertie fautive du service public de la justice pendant cette période, qui trouve son origine dans l’absence de réaction du juge d’instruction, ce qui a engagé la responsabilité de l’État. La cour d’appel a cependant débouté la société requérante de sa demande en réparation, au motif que ses lettres d’avertissement ne mentionnaient aucun élément précis et n’auraient donc pas apporté une preuve certaine du préjudice directement imputable au dysfonctionnement du service public de la justice (paragraphe 13 ci-dessus).
51. La Cour estime néanmoins que l’absence d’un inventaire complet effectué au moment de la pose des scellés ainsi que l’absence totale de suite donnée aux différentes alertes de la part de la société requérante, qui restait privée d’accès au château pendant toute la durée de la saisie, ont fait obstacle à ce que celle-ci puisse établir un lien de causalité entre le dysfonctionnement du service public de la justice constaté et le préjudice subi.
52. De l’avis de la Cour, la charge de la preuve concernant les dégradations du bien saisi incombait donc au service public de la justice, responsable de la conservation des biens pendant toute la période de la saisie et du placement sous scellés (voir, mutatis mutandis, Tendam, précité, § 54), et non à la société requérante, qui s’est vu ainsi imposer « une preuve impossible », ce qui constitue une charge excessive incompatible avec le respect de l’article 1 du Protocole no1.
53. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les juridictions internes, qui ont examiné la demande de la société requérante, n’ont ni tenu compte de la responsabilité du service public de la justice ni permis à la société requérante d’obtenir réparation pour le préjudice résultant de la conservation défectueuse du bien saisi (voir, mutatis mutandis, Tendam, précité, § 55).
54. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no1.


Shorazova c. Malte du 3 mars 2022 requête no 51853/19
Art 1 du Protocole 1 : Gel d’avoirs à Malte, opéré à la demande des autorités kazakhes
Mme Shorazova est née au Kazakhstan et, à l’époque des faits, était mariée à Rakhat Aliyev, ex-gendre de l’ancien président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, dont il était par la suite devenu l’adversaire politique. L’affaire concerne le gel des avoirs de la requérante à Malte, à la demande des autorités kazakhes. Mme Shorazova était alors inculpée au Kazakhstan de multiples infractions graves. La Cour considère qu’en l’espèce il y a des raisons suffisantes de s’interroger sur la nature réelle des actions entreprises par le Kazakhstan et donc sur l’intérêt général lié à la mesure litigieuse. Elle constate que, dans le cadre de la procédure menée devant la juridiction pénale qui a adopté puis prolongé plusieurs fois la décision de gel des avoirs dans la cause de la requérante, l’intéressée a été privée pendant près de huit ans de garanties procédurales contre l’arbitraire ou les ingérences disproportionnées. La Cour estime en revanche que la durée de la procédure constitutionnelle que la requérante a engagée pour se plaindre d’une violation de ses droits n’a pas été excessive dans les circonstances de l’espèce.
FAITS
La requérante, Elnara Shorazova, est une ressortissante autrichienne. Elle est née en 1976 et réside à Vienne (Autriche). Mme Shorazova est la veuve de Rakhat Aliyev. Celui-ci avait été le gendre de Nursultan Nazarbayev, qui fut le président du Kazakhstan de 1991 à 2019. M. Aliyev exerça des hautes fonctions diverses et en 2002 devint ambassadeur en Autriche, puis en 2005 rentra au Kazakhstan pour y occuper le poste de vice-ministre des Affaires étrangères. On parlait de lui comme d’un candidat à la succession de M. Nazarbayev à la fonction présidentielle. Vers le milieu des années 2000, des tensions politiques surgirent entre les deux hommes. En fin de compte, un mandat d’arrêt fut délivré contre M. Aliyev. M. Aliyev épousa la requérante en 2009 et le couple résida à Malte jusqu’en 2013. M. Aliyev décéda en prison en Autriche en 2015
En 2008 et en 2009, à l’issue de deux procès tenus au Kazakhstan en l’absence de M. Aliyev, celui-ci fut déclaré coupable, notamment pour des infractions à caractère politique, et condamné les deux fois à une peine de vingt ans d’emprisonnement. En 2007, l’Autriche reçut une première demande d’extradition visant M. Aliyev et la rejeta au motif que l’intéressé risquait de ne pas être traité conformément aux normes de la Convention européenne. En 2011, une seconde demande d’extradition fut rejetée, les autorités autrichiennes ayant pris note de la condamnation par défaut de M. Aliyev et estimé qu’il pouvait s’agir d’un procès politique. Dans les années qui suivirent, en Allemagne, à Chypre, au Liechtenstein et en Grèce, une série d’enquêtes furent ouvertes et des décisions de gel des avoirs du couple furent adoptées à la demande des autorités kazakhes. Toutefois, l’ensemble de ces mesures et décisions furent abandonnées et levées. En 2013, les autorités maltaises reçurent au sujet de M. Aliyev et de la requérante une demande d’entraide judiciaire relative à l’audition de divers témoins et à la collecte de preuves. Mme Shorazova et M. Aliyev ne furent pas informés de cette mesure procédurale. En 2014, à la suite d’une nouvelle demande des autorités kazakhes, les autorités maltaises prirent la décision de geler les avoirs du couple à Malte. Celle-ci était encore en vigueur au moment de l’introduction de la requête auprès de la Cour, car elle avait plusieurs fois été prolongée par la juridiction pénale pour des périodes de six mois. En juin 2014, le couple engagea une procédure de recours constitutionnel fondée sur l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. Les époux soutinrent qu’ils n’avaient aucune garantie que leurs droits seraient respectés au Kazakhstan et qu’en conséquence Malte ne devait pas coopérer dans le cadre des demandes d’entraide judiciaire, et ils demandèrent l’abandon de toute procédure à Malte. En avril 2019, la Cour constitutionnelle confirma le jugement de première instance et accueillit en partie la demande pour ce qui concernait l’article 6, mais rejeta le grief formulé sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, considérant que la décision de gel des avoirs n’était qu’une mesure provisoire et que celle-ci était légale, correspondait à l’intérêt général et était proportionnée au but poursuivi. Le 23 juillet 2021, après la notification de cette requête au Gouvernement, la juridiction pénale leva la décision de gel des avoirs, jugeant que dès lors qu’aucune procédure pénale n’était pendante contre Mme Shorazova au Kazakhstan, la décision litigieuse n’était pas justifiée au regard du droit maltais
Article 1 du Protocole n o 1 et article 6 § 1, concernant la procédure ordinaire
La Cour juge que la décision de geler les avoirs en question a constitué une ingérence dans l’exercice par la requérante de ses droits patrimoniaux. Elle déclare qu’elle ne saurait se substituer aux autorités nationales pour statuer sur la légalité de la mesure, mais elle estime troublant que, pendant près de huit ans, la légalité de la mesure et la situation de la requérante n’aient pas fait l’objet d’un examen approfondi des juridictions nationales. Cela révèle à ses yeux l’existence d’un problème grave au niveau national. La Cour considère qu’il y a suffisamment d’éléments pour indiquer que la procédure menée au Kazakhstan avait peut-être des motivations politiques. Ainsi, le point de savoir si la décision de gel des avoirs qui avait été prise et maintenue par les autorités maltaises dans les circonstances spécifiques de l’espèce reposait sur un intérêt général est une question qui méritait un examen particulier des juridictions nationales. La Cour souligne l’importance de l’entraide judiciaire mutuelle fondée sur la Convention des Nations unies, mais estime toutefois que pareille entraide doit se dérouler dans le respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme. En outre, la Cour – relevant que la requérante n’a été inculpée dans aucun État européen en dépit de multiples enquêtes et prenant note de la situation au Kazakhstan concernant toute procédure pénale susceptible d’y être menée contre la requérante – doute que l’intérêt général qui était poursuivi en l’espèce ait été la lutte contre la criminalité. Pour ce qui est de la décision même de geler les avoirs, la Cour estime qu’elle a constitué une mesure sévère et restrictive : elle concernait la totalité des biens des requérants à Malte et aucune juridiction nationale n’a évalué sa portée par rapport aux « chefs d’accusation », ni au moment où elle a été adoptée ni lors des prorogations ultérieures. Les juridictions n’ont pas non plus recherché s’il était légitime et proportionné d’appliquer une telle mesure, au vu des circonstances de l’affaire. Par ailleurs, la Cour observe que les prorogations de la décision se faisaient de manière automatique, sans audition de la requérante. En fin de compte, ce n’est que lorsque la Cour a notifié le grief au Gouvernement que la juridiction pénale est intervenue et que la décision litigieuse a été levée. De manière générale, la Cour estime que les procédures relatives à l’adoption et à la prorogation de la décision de gel des avoirs n’ont pas ménagé à la requérante la possibilité de se protéger contre l’arbitraire et que les juridictions à compétence constitutionnelle n’ont pas résolu ce problème. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Eu égard à ces conclusions, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner la procédure ordinaire sous l’angle de l’article 6 § 1.
Article 6 § 1, concernant la durée de la procédure constitutionnelle
Au total, la procédure constitutionnelle a duré près de quatre ans et dix mois pour deux degrés de juridiction. Le Gouvernement assure que l’affaire était complexe, qu’elle comportait d’abondants éléments de preuve et que les questions juridiques soulevées étaient nouvelles. Il ajoute que les juridictions ont agi avec diligence. En outre, il déclare que les obligations en matière de diligence ne sont pas les mêmes pour la Cour constitutionnelle et pour les juridictions ordinaires. La Cour constate qu’il n’y a eu ni périodes d’inactivité ni défaillance de la part des autorités. Elle relève en particulier le défaut d’arguments du côté de la requérante. Globalement, elle considère que la durée de la procédure, bien que longue, n’a pas été excessive dans les circonstances de l’espèce. En conséquence, il n’y a pas eu violation de la Convention à raison de la durée de la procédure constitutionnelle.
SEBELEVA ET AUTRES c. RUSSIE du 1er mars 2022 Requête no 42416/18
Art 1 P1 • Règlementer l’usage des biens • Saisie des actions d’une société détenues par les requérants avec un blocage total, pendant quatre ans et huit mois, de tous les droits étant rattachés à celles-ci • Raisons plausibles des autorités de croire que les actions avaient été utilisées par un tiers pour commettre les délits lui étant reprochés • Restrictions moins radicales non envisagées • Renouvellement de la saisie quasi automatique • Justifications insuffisantes de la nécessité de la saisie litigieuse et de sa prolongation • Proportionnalité
53. Les principes pertinents concernant les saisies sont rappelés dans l’arrêt OOO Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo c. Russie (no 5738/18, § 60, 7 avril 2020). Conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, la mesure litigieuse de saisie relevait de la règlementation de l’usage des biens et n’était pas constitutive d’une privation de propriété au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
a) Sur la légalité et le but légitime de l’ingérence
54. La Cour observe que les juridictions internes ont fondé la saisie et ses renouvellements tant sur l’article 115 § 1 du CPP (au motif qu’il s’agissait de biens appartenant à la personne mise en examen et que la mesure était destinée à assurer l’indemnisation du préjudice causé par les délits et le paiement d’une éventuelle amende pénale) que sur l’article 115 § 3 du CPP (au motif que les actions appartenaient officiellement à des personnes tierces à la procédure mais qu’il s’agissait, en fait, d’un instrument qui avait été utilisé par S. pour la commission de délits). Elle relève qu’est venu s’y ajouter un troisième fondement juridique, l’article 81 du CPP, lorsque l’enquêteur a qualifié les actions de « preuves matérielles » renfermant des informations de nature à contribuer à l’établissement des faits de l’affaire (paragraphe 14 ci-dessus).
55. S’agissant de l’article 115 § 1 du CPP, la Cour observe que les requérants n’ont pas été mis en examen ni appelés à la procédure en qualité de défendeurs civils. Cette disposition ne peut dès lors être considérée comme constituant la base légale de l’ingérence litigieuse au regard de l’article 1 du Protocole no 1.
56. En ce qui concerne les articles 81 et 115 § 3 du CPP, la Cour considère qu’ils pouvaient constituer une base légale de la mesure dès lors que les autorités avaient des raisons plausibles de croire que les actions avaient été utilisées par S. pour commettre les délits qui lui étaient reprochés (voir, concernant une situation similaire, OOO Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo, précité, § 66).
57. Par conséquent, la Cour estime que l’ingérence reposait sur une base légale au sens de l’article 1 du Protocole no 1 – les articles 81 et 115 § 3 du CPP – et qu’elle poursuivait un but légitime d’intérêt général, à savoir la prévention de la commission de délits.
58. Cependant, la Cour s’accorde à dire, avec les requérants, que pendant deux mois et treize jours, la saisie n’a été autorisée par aucune décision judiciaire. En effet, l’arrêt d’appel en vertu duquel la saisie avait été prolongée, a été annulé en cassation le 21 décembre 2020 et ce n’est que le 3 mars 2021 qu’elle a été renouvelée (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que, nonobstant ces décisions, la saisie a été maintenue dans les faits. Partant, la saisie était illégale et donc incompatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 durant ce laps de temps.
59. Néanmoins, la saisie ayant été reconduite après le 3 mars 2021, la Cour se prononcera sur la proportionnalité de l’ingérence dans sa globalité.
b) Sur la proportionnalité de l’ingérence
Les facteurs à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité d’une mesure de saisie ont été rappelés dernièrement dans l’arrêt OOO Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo (précité, § 69).
61. Si la durée totale de la saisie des actions – quatre ans et huit mois, du 27 mai 2017 au 25 janvier 2022 – ne rend pas, en soi, l’ingérence disproportionnée (ibidem, § 71, et les références citées), la Cour attache une grande importance à la motivation des décisions relatives à cette mesure compte tenu, d’une part, de cette longue durée et, d’autre part, de la nature et du degré des restrictions qui en découlent.
62. À cet égard, elle observe d’emblée que la saisie des actions des requérants a privé ceux-ci de tous les droits qui y étaient attachés (voir, pour un exemple contraire, Invest Kapa A.S. c. République tchèque (déc.) [comité], no 19782/13, § 42, 5 juillet 2018), y compris du droit d’obtenir des informations relatives à la société (paragraphe 25 ci-dessus), sans que les juridictions internes compétentes n’aient envisagé de restrictions moins radicales au droit de propriété des requérants (paragraphe 32 ci-dessus).
63. La Cour relève également que les juridictions internes ont renouvelé la saisie de façon quasi automatique, en invoquant systématiquement les mêmes motifs, dont la nécessité, d’une part, de protéger les droits de la victime et d’empêcher S. de continuer à gérer les biens d’OTS, et, d’autre part, de garantir le paiement d’une éventuelle amende pénale.
64. Force est de constater que les juridictions internes n’ont aucunement apprécié la proportionnalité du maintien prolongé de la saisie ni envisagé d’alternatives à celle-ci, nonobstant les indications de la Cour constitutionnelle (paragraphes 32-33 ci-dessus, voir aussi OOO Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo, précité, §§ 23, 35 et 73).
65. Par ailleurs, la Cour note que les tribunaux n’ont pas expliqué en quoi les actions pouvaient constituer un « instrument du délit », pas plus qu’ils n’ont expliqué en quoi ces actions dématérialisées pouvaient contenir des informations de nature à contribuer à l’établissement des faits de la cause. En outre, il n’a jamais été expliqué quel lien pourrait exister entre les votes exprimés lors des assemblées générales tenues entre 2009 et 2015 et les ventes de biens appartenant à OTS. Un tel lien n’a jamais été établi par les autorités internes.
66. Enfin, la Cour observe que les juridictions russes ne se sont livrées, à aucun moment, à une appréciation des arguments que les requérants avaient soulevés pour contester les allégations selon lesquelles ils avaient agi sur ordre de S. Au contraire, elles se sont déclarées incompétentes à cet égard, tout en reprochant aux intéressés de ne pas avoir réfuté la thèse des autorités de poursuite (paragraphe 13 ci-dessus). À cet égard, s’il est incontesté que les requérants ont des liens de parenté ou d’alliance avec S., force est de constater qu’aucun de ceux-ci n’a été inculpé de la commission d’un quelconque délit en lien avec les faits reprochés à S. (voir aussi Uzan et autres c. Turquie, nos 19620/05 et 3 autres, § 215, 5 mars 2019). Le fait qu’en février et mars 2017, les actionnaires, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont adopté des résolutions qui furent par la suite qualifiées d’illégales et d’abusives (paragraphe 9 ci-dessus), n’a à aucun moment été invoqué pour justifier la saisie des actions ou le renouvellement de cette mesure.
67. En définitive, les juridictions internes n’ont pas justifié à suffisance la nécessité de la saisie litigieuse et de sa prolongation (voir OOO Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo, précité, §§ 73-74, et aussi, mutatis mutandis, Eilders et autres c. Russie [comité], no 475/08, § 23, 3 octobre 2017). Eu égard à ces éléments, la Cour estime que l’ingérence n’était pas proportionnée, ce qui rend superflu l’examen des autres arguments soulevés par les parties.
68. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
AKPAZ SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE c. TURQUIE du 18 janvier 2022 Requête no 6800/09
Art 1 P1 • Réglementer l’usage des biens • Rétention continue des marchandises de la société requérante durant près de neuf ans par les autorités dans le cadre d’une procédure pénale • Mesures alternatives à la saisie non envisagées • Aucune raison légitime depuis l’arrêt d’acquittement pour le maintien pendant plus de cinq ans des mesures de saisie en vigueur • Absence de proportionnalité
44. En ce qui concerne le défaut de qualité de victime, se référant à la jurisprudence de la Cour (Ohlen c. Danemark (radiation), no 63214/00, 24 février 2005, et Dimitrescu c. Roumanie, nos 5629/03 et 3028/04, §§ 33-34, 40, 3 juin 2008), le Gouvernement rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle au motif que la qualité de victime du requérant a pris fin, soit en raison du règlement de l’affaire au niveau national à la suite de la décision sur la recevabilité, soit dans le cas d’un accord concernant la cession de droits. Se référant à la lettre de la Direction du registre de commerce d’Izmir du 5 avril 2019, il souligne qu’en l’espèce, le 12 août 2014, la société requérante a été radiée du registre de commerce et que l’annonce à ce sujet a été publiée, en vertu de l’article 7 provisoire du code commercial turc. Il en conclut que la société requérante n’exerce plus aucune activité.
45. Il prie la Cour d’examiner également, à la lumière des incidents survenus à la suite de l’introduction de la requête, s’il est nécessaire de radier de l’affaire du rôle pour certaines raisons relevant de l’article 37 de la Convention, indépendamment de ce que la société requérante serait fondée ou persisterait à alléguer qu’elle a conservé sa « qualité de victime ».
46. À la lumière de ces explications, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité de victime de la société requérante.
47. La société requérante conteste cet argument. Elle explique que s’il est exact que son inscription auprès du bureau d’enregistrement de commerce d’Izmir sous le numéro MERKEZ-59282 a été supprimée d’office du registre de commerce en 2014, elle a subi une ruine financière en raison des événements faisant l’objet de la présente requête ; qu’en raison de ces circonstances, elle s’était retrouvée dans l’incapacité de poursuivre ses activités commerciales pendant un certain temps ; que, par conséquent, elle a été radiée du registre au motif qu’elle « n’a[vait] aucune activité en cours » ; que la radiation en question a été faite le 12 août 2014 conformément à l’article 7 provisoire du code de commerce turc no 6102, dont les passages pertinents peuvent se lisent comme suit : « Les créanciers et les parties prenantes liés à la société ou à la coopérative dont l’inscription est supprimée du registre de commerce peuvent, dans les cinq ans suivant la date de la radiation, demander au tribunal de rétablir la société ou la coopérative pour des motifs justifiés. ».
48. La société requérante informe la Cour que, le 17 janvier 2019, conformément à cette disposition de la loi, elle a demandé à la 6e chambre du tribunal de commerce d’Izmir sa réinscription au registre (no du dossier 2019/113 E.) en précisant qu’une procédure concernant la saisie de ses marchandises était pendante devant la Cour. Le 9 décembre 2020, elle a communiqué à la Cour le jugement du 29 novembre 2019 par lequel le tribunal de commerce avait ordonné sa réinscription au registre de commerce.
49. La Cour rappelle que le fait qu’une personne morale soit mise en faillite au cours d’une procédure conduite devant elle ne lui ôte pas forcément la qualité de victime (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 94, 27 juin 2017). Il en va de même d’une société qui a été dissoute et dont les seuls actionnaires ont fait part de leur intérêt à poursuivre la requête au nom de celle-ci (Euromak Metal Doo c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 68039/14, §§ 32-33, 14 juin 2018, concernant un litige d’ordre fiscal examiné sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1).
50. En l’espèce, la Cour note que la société requérante a été radiée du registre de commerce en raison de ses difficultés financières qui seraient liées aux faits de l’espèce, postérieurement à l’introduction de sa requête, et que finalement, le 29 novembre 2019, sa réinscription au registre de commerce fut prononcée, conformément aux dispositions du droit national.
51. La Cour observe que l’exception du Gouvernement se fonde sur l’idée que, depuis cette date, la société requérante et ses actifs ont été gérés par le syndic de faillite et que l’évolution de sa situation juridique l’a privée de la qualité de victime.
52. La Cour constate tout d’abord qu’il n’y a pas de controverse au sujet du fait que la société requérante a introduit sa requête bien avant sa radiation du registre de commerce. Elle prend note ensuite de l’argument de la partie requérante selon lequel sa radiation a un lien avec les faits de l’espèce. Elle constate finalement que le tribunal de commerce a ordonné sa réinscription au registre de commerce conformément au droit national turc. Dans ces conditions, elle estime que la société requérante peut toujours se prétendre victime des violations alléguées de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
53. En conséquence, elle rejette la première exception préliminaire du Gouvernement.
54. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes, en trois branches.
55. Tout d’abord, il expose que la Cour devrait examiner la requête sous l’article 6 § 1 de la Convention, et, en faisant référence à la décision dans l’affaire Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09, 26 mars 2013), il soutient que la société requérante peut saisir la commission d’indemnisation.
56. La société requérante s’oppose à cette thèse, soutenant que les faits de cette affaire n’entrent pas dans le champ d’application de la compétence de la commission.
57. La Cour note qu’elle elle examinera l’affaire sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (paragraphe 35 ci-dessus) et que le Gouvernement n’a pas expliqué dans quelle mesure la commission d’indemnisation serait compétente pour une telle affaire.
58. Ensuite, le Gouvernement soutient que la société requérante n’a pas saisi le tribunal civil de première instance d’une action en réparation des dommages subis à raison de la saisie. Rappelant les faits, il explique que la société requérante a été privée de l’usage des marchandises tout au long de la procédure pénale et qu’elle a formé l’action devant le tribunal administratif sur la base de la décision d’acquittement de la cour d’assises alors qu’elle aurait dû saisir les juridictions civiles, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation à l’époque des faits, selon laquelle les dommages résultant d’actions judiciaires relèvent de la compétence de ces juridictions.
59. S’opposant à cette thèse, la société requérante soutient qu’elle a épuisé les voies de recours internes. Elle souligne aussi que le 9 septembre 2004, elle avait introduit une action devant la 11eme chambre du tribunal de grande instance pour l’évaluation des dommages avant d’introduire son action en plein contentieux devant le tribunal administratif.
60. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, qui doivent être à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates. Elle rappelle également qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, notamment, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999-V, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II, Vuckovic et autres c. Serbie (exceptions préliminaires) [GC], no 17153/11 et suiv., § 74, 25 mars 2014, et Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), no 42219/07, § 85, 9 juillet 2015). Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, Prencipe c. Monaco, no43376/06, § 93, 16 juillet 2009, et Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 89, 19 décembre 2018).
61. La Cour rappelle également qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte, en faisant preuve d’une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment qu’elle doit tenir compte de manière réaliste du contexte juridique et politique dans lequel les recours s’inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres, précité, § 69, Selmouni, précité, § 77, Kozacioglu c. Turquie [GC], no 2334/03, § 40, 19 février 2009, Reshetnyak c. Russie, no 56027/10, § 58, 8 janvier 2013, et Azzolina et autres c. Italie, nos 28923/09 et 67599/10, § 114, 26 octobre 2017).
62. La Cour considère que la société requérante peut passer pour avoir épuisé les voies de recours internes puisqu’elle a introduit un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif d’Izmir tendant à ce qu’elle soit indemnisée pécuniairement pour le dommage que lui avait causé la saisie des marchandises après la décision d’acquittement. À cet égard, sans avoir besoin de s’exprimer sur l’effectivité de la voie de recours préconisée par le Gouvernement, elle réaffirme que, lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Hüseyin Kaplan c. Turquie, no 24508/09, § 30, 1er octobre 2013, Kozacioglu c. Turquie [GC], no 2334/03, §§ 39-43, CEDH 2009, et Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 84, CEDH 2008).
63. Par ailleurs, elle constate que le tribunal administratif ne s’est pas déclaré incompétent ratione materiae en raison d’une éventuelle question de compétence ou d’une « erreur procédurale » de la société requérante quant au choix de la juridiction. Bien au contraire, il s’est prononcé sur « le fond de l’affaire » et il a jugé qu’il n’était pas possible d’imputer à l’administration une faute de service ni d’engager sa responsabilité sans faute.
64. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette également cette branche de l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
65. Finalement, le Gouvernement reproche à la société requérante de ne pas avoir fait opposition à la décision de la cour d’assises sur le refus de restitution des marchandises saisies. Il explique que lorsque la cour d’assises a rejeté la demande de la société requérante, elle a accepté la demande de la restitution d’autres parties intéressées. La société requérante aurait dû alors selon lui former une opposition devant une autre cour d’assises.
66. La société requérante rejette également cette thèse en soutenant qu’il s’agissait d’une décision provisoire à laquelle une opposition n’aurait rien changé. Elle soutient par ailleurs qu’elle a préféré que la cour d’assises statue en définitive pour faire appel devant les juridictions compétentes.
67. Comme il a été souligné, la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit être appliquée en tenant dûment compte du contexte, en faisant preuve d’une certaine souplesse et sans formalisme excessif (paragraphe 61 ci-dessus). En l’occurrence, la société requérante peut passer pour avoir épuisé les voies de recours interne pour les raisons qui viennent d’être exposées (paragraphe 62 ci-dessus).
68. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter également la troisième exception préliminaire du Gouvernement et de conclure que les voies de recours internes ont été épuisées.
69. Rappelant les faits et les décisions rendues par les juridictions internes, le Gouvernement argue qu’en principe la preuve des faits matériels qui font l’objet d’une affaire devant les juridictions internes, l’appréciation des éléments de preuve, l’interprétation et la mise en œuvre des règles de droit et la question de savoir si la conclusion à laquelle sont parvenues ces juridictions en ce qui concerne le litige est équitable ne relèvent pas de la compétence de la Cour. Il explique que la seule exception à cette règle est lorsque les décisions et les conclusions des tribunaux internes contiennent une erreur manifeste d’appréciation qui ne tient compte ni de la justice ni du bon sens et que cette situation viole automatiquement les droits et libertés visés par la requête individuelle. Il en conclut que les requêtes assimilables à une plainte en réparation ne peuvent être examinées par la Cour qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou d’arbitraire manifeste. Il considère que, en jugeant inapproprié de verser une compensation à la société requérante, les autorités nationales n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni rendu une décision arbitraire. En conséquence, il invite la Cour à déclarer la présente requête irrecevable au motif qu’elle est manifestement mal fondée, en application des articles 35 et 4 de la Convention.
70. La société requérante s’oppose à cette thèse. Elle soutient que la demande du Gouvernement n’est pas justifiée parce que celui-ci ne précise pas les motifs juridiques pour lesquels l’autorité douanière a refusé la restitution des marchandises, ni par ailleurs les raisons pour lesquelles les marchandises n’ont pas été rendues après la décision d’acquittement.
71. La Cour estime que la thèse soutenue ici soulève des questions appelant un examen au fond du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et non un examen de la recevabilité de ce grief.
72. Par conséquent, elle rejette également cette exception du Gouvernement.
73. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
IPEK SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE c. TURQUIE du 18 janvier 2022 Requête no 29214/09
Art 1 P1 • Réglementer l’usage des biens • Rétention continue des marchandises de la société requérante durant près de neuf ans par les autorités dans le cadre d’une procédure pénale • Mesures alternatives à la saisie non envisagées • Aucune raison légitime depuis l’arrêt d’acquittement pour le maintien pendant plus de cinq ans des mesures de saisie en vigueur • Absence de proportionnalité
a) Sur l’existence d’un bien et sur la nature de l’ingérence
79. En premier lieu, en ce qui concerne l’existence d’un bien, la Cour constate qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que les marchandises saisies constituaient des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
80. En deuxième lieu, en ce qui concerne la nature de l’ingérence, ainsi que la Cour l’a dit à maintes reprises, l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, qui figure dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au respect des biens, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, entre autres, Ališic et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 60642/08, § 98, CEDH 2014).
81. La Cour rappelle que la rétention des biens saisis par les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale doit être examinée sous l’angle du droit pour l’État de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 54, CEDH 2007-VII, Borjonov c. Russie, no 18274/04, § 57, 22 janvier 2009, Adamczyk c. Pologne (déc.), no 28551/04, 7 novembre 2006, et Uzan et autres c. Turquie, nos 19620/05 et 3 autres, § 194, 5 mars 2019).
82. La Cour rappelle également que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne prohibe pas la saisie des biens dans le cadre d’une procédure pénale et qu’une telle saisie s’analyse en une ingérence relevant de la réglementation de l’usage des biens (Lachikhina c. Russie, no 38783/07, § 58, 10 octobre 2017, avec les références citées). Toutefois, pour répondre aux exigences inhérentes à cet article, la saisie doit être légale, poursuivre un but légitime et être proportionnée à ce but (ibidem, § 59).
b) Sur la légalité et le but légitime de l’ingérence
83. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est une notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, §§ 94 et 95, 25 octobre 2012). Il en découle que la nécessité d’examiner la question du juste équilibre « ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n’était pas arbitraire » (Uzan et autres, précité, § 196, avec les références citées).
84. La Cour rappelle aussi que le principe de la légalité présuppose également l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 79, CEDH 2000-XII, Beyeler, précité, §§ 109-110, et Fener Rum Patrikligi c. Turquie, no 14340/05, § 70, 8 juillet 2008). Quant à la portée de la notion de « prévisibilité », elle dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine que celui-ci couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Uzan et autres, précité, § 197, avec les références citées).
85. En l’espèce, le Gouvernement expose que la saisie a été ordonnée sur le fondement des articles susmentionnés de la loi no 1918 sur la prévention et la répression des actes de contrebande. La société requérante ne le conteste pas. Il s’ensuit que la mesure était valablement fondée sur l’article 20, l’article additionnel 2 § 111 et sur les articles 27 §§ 2 et 3 et 33 in fine de la loi no 1918 sur la prévention et la répression des actes de contrebande, alors en vigueur.
86. Il n’est donc pas non plus controversé entre les parties que la mesure de saisie répondait à un motif d’intérêt général, à savoir la protection de l’ordre public et la prévention des délits. La question qui se pose est celle de savoir si, dans les circonstances concrètes de l’affaire, l’application des lois en question et la durée excessive et incertaine de la saisie ont fait peser sur la société requérante une charge excessive.
c) Sur la proportionnalité de l’ingérence
87. Quant à la proportionnalité des mesures en cause, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige pour toute ingérence un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, §§ 83-95, CEDH 2005-VI). Ce juste équilibre est rompu si la personne concernée doit supporter une charge excessive et exorbitante (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, §§ 69-74, série A no 52, Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, § 57, 31 mai 2011, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie (fond) [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 300, 28 juin 2018, et Uzan et autres, précité, § 203).
88. En l’espèce, la Cour note qu’en juillet 1995, une quantité importante des marchandises de la société requérante a été saisie par la Direction générale des douanes d’Izmir parce qu’il existait des soupçons d’infraction de contrebande douanière commise en modifiant délibérément les déclarations. Elle constate en outre que, le 7 juin 1999, la cour d’assises a acquitté les accusés, y compris le représentant de la société requérante, Ç.K., au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves qu’ils avaient commis l’infraction de contrebande douanière, et que cet arrêt est devenu définitif le 30 mai 2001. Elle note ensuite que, le 25 octobre 2001, à la demande de la société requérante, la cour d’assises a ordonné la restitution des marchandises, mais qu’en raison d’un manque de diligence, car la décision de restitution avait été rendue sans qu’une audience ait été tenue (paragraphe 13 ci-dessus), elle n’est devenue définitive que le 8 avril 2004, et que la Direction générale des douanes n’a ordonné la restitution des marchandises que le 29 juin 2004.
89. La Cour note par ailleurs que, le 13 septembre 2004, la société requérante a formé un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif d’Izmir pour demander réparation du dommage causé par la saisie des marchandises, mais que cette demande a été rejetée, de sorte que le jugement en question est devenu définitif le 29 avril 2009.
90. La Cour admet que la décision relative aux mesures de saisie, en tant que telle, peut être justifiée par « l’intérêt général » si elle vise à prévenir les actes de contrebande dans le but de protéger l’ordre public et de prévenir les délits. Toutefois, compte tenu du caractère restrictif des mesures de saisie, il faut mettre fin à ces dernières dès lors qu’elles se révèlent ne plus être nécessaires (voir, mutatis mutandis, Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 36, série A no 281-A, et Vendittelli c. Italie, 18 juillet 1994, § 40, série A no 293) : en effet, plus les mesures de saisie restent en vigueur, plus l’impact sur la jouissance paisible du bien par le propriétaire est important (JGK Statyba Ltd et Guselnikovas c. Lituanie, no 3330/12, § 130, 5 novembre 2013, et Uzan et autres, précité, § 205).
91. La Cour constate que les marchandises appartenant à la société requérante ont été saisies les 21 juillet et 29 août 1995 et ont été rendues le 29 juin 2004 (paragraphes 5 et 20 ci-dessus), et que les mesures de saisie sont restées en vigueur près de neuf ans.
92. Elle estime qu’en l’espèce la violation alléguée du droit de propriété de la société requérante est étroitement liée, entre autres, à la durée de la procédure et qu’elle en est une conséquence indirecte (voir, mutatis mutandis, Kunic c. Croatie, no 22344/02, § 67, 11 janvier 2007, JGK Statyba Ltd et Guselnikovas, précité, § 131, et Uzan et autres, précité, § 207).
93. En outre, la Cour remarque que jusqu’à la clôture de l’enquête pénale, les mesures ont poursuivi un but légitime. Cependant, les autorités internes n’avaient jamais envisagé de mesures alternatives à la rétention continue des marchandises, dont la valeur marchande ne cessait de chuter en raison de leur technologie, par exemple la restitution des marchandises à la société requérante en contrepartie de la présentation d’une lettre de garantie bancaire, et qu’elles ont clairement donné la préférence aux mesures sécuritaires afin de protéger l’intérêt public au cas où la société requérante serait condamnée. Or aucun élément du dossier n’indique que l’intérêt individuel de la société requérante eût mérité moins de protection que l’intérêt général (voir, mutatis mutandis, JGK Statyba Ltd et Guselnikovas, précité, § 130), alors que les autorités sont tenues de réfléchir minutieusement et explicitement à d’autres solutions appropriées mais moins intrusives (voir, mutatis mutandis, Vaskrsic c. Slovénie, no 31371/12, § 83, 25 avril 2017, et la jurisprudence y citée). Pendant cette période déjà les juridictions n’ont pas mis en balance les besoins de l’enquête pénale et l’intérêt légitime de la société requérante à reprendre le contrôle de ses biens (voir aussi, mutatis mutandis, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 303, 28 juin 2018, et Uzan et autres, précité, § 215).
94. La Cour constate que le problème se pose de manière encore plus accentuée à partir de l’arrêt d’acquittement rendu par la cour d’assises le 7 juin 1999 (voir, mutatis mutandis, Uzan et autres, précité, § 206), qu’il n’y avait aucune raison légitime pour le maintien de mesures de saisie en vigueur, et cela pendant plus de cinq ans, le délai étant exclusivement attribuable aux autorités nationales.
95. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la rétention continue des marchandises de la société requérante n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi et que les autorités internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le but poursuivi et les moyens employés dans la procédure de saisie prolongée de ces marchandises. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
KASILOV c. RUSSIE du 6 juillet 2021 requête no 2599/18
Art 1 P1 • Respect des biens • Absence d’un but légitime conforme à l’intérêt général de la rétention de la caution pendant onze moins entre le prononcé du jugement de condamnation et le prononcé de l’arrêt d’appel
46. La Cour estime que, contrairement à la thèse du Gouvernement, la rétention de la caution entre le 3 juillet 2017 et le 7 juin 2018 s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, et, plus particulièrement, en une « réglementation de l’usage des biens », au sens du deuxième alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (UBS AG c. France (déc.), no 29778/15, § 18, 29 novembre 2016).
47. Elle rappelle que toute mesure d’ingérence doit être opérée « dans les conditions prévues par la loi », poursuivre un but d’intérêt public (ou général) légitime et être proportionnée à ce but.
48. S’agissant de la légalité de la rétention, la Cour observe que si le CPP ne prévoit pas expressément de moment où la caution doit être restituée, le Plénum de la Cour suprême a expliqué que le cautionnement est maintenu jusqu’à ce que le jugement devienne définitif (paragraphe 22 ci-dessus). En l’espèce, le tribunal ayant condamné le requérant en première instance a ordonné la restitution de la caution, sans imposer de délai pour une telle restitution. Par la suite, ce tribunal a rejeté la demande de restitution au motif que le jugement de condamnation n’était pas encore devenu définitif (paragraphes 6 et 7 ci-dessus), alors même que le requérant avait déjà été placé en détention. Cette situation a résulté en une application simultanée de deux mesures de sûreté, au sens du droit russe, contrairement à l’article 97 du CPP selon lequel une seule mesure de sûreté peut être appliquée, cela ayant aussi été confirmé par le Gouvernement (paragraphes 18 et 45 ci-dessus).
49. Dans ces circonstances, la Cour demeure dubitative quant au point de savoir si la mesure peut passer pour avoir été opérée « dans les conditions prévues par la loi ». Toutefois, rappelant qu’elle ne dispose que d’une compétence limitée pour interpréter le droit interne et pour en contrôler le respect (Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 116, 15 mars 2018), elle n’estime pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que l’ingérence méconnaît l’article 1 du Protocole no 1 pour d’autres raisons (paragraphe 50 et suivants ; voir, pour une approche similaire, Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 105, 25 octobre 2012).
50. S’agissant d’un « but d’intérêt général » de la rétention, la Cour rappelle que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Dès lors, elles jouissent ici d’une certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquels s’étendent les garanties de la Convention. De plus, les notion d’« utilité publique » et d’« intérêt général » sont amples par nature (mutatis mutandis, ibidem, § 106, et Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 111-112, CEDH 2000-I).
51. En l’espèce, la Cour note que, selon le CPP tel qu’interprété par la Cour suprême, le but du cautionnement est de garantir la comparution du suspect ou du prévenu, de prévenir la commission d’autres délits et toute entrave à la justice pénale, mais n’est point de garantir l’exécution du jugement. Or la Cour ne peut que constater que ces buts, indéniablement légitimes en soi, ont déjà été atteints par le placement immédiat du requérant en détention. Dans cette situation, la rétention de la caution – qui n’a jamais fait l’objet de saisie et qui ne servait pas au paiement de l’amende pénale – a perdu sa nécessité, ceci d’autant plus que le paiement de l’amende a déjà été garanti par la saisie des biens du requérant (paragraphes 6, 19 et 20 ci-dessus ; comparer avec UBS AG, décision précitée, § 19), et le Gouvernement n’a pas démontré le contraire.
52. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut à l’absence d’un but légitime conforme à l’intérêt général de la rétention de la caution pendant onze moins et donc à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Cette conclusion rend non nécessaire l’examen de la proportionnalité de la mesure.
Ooo Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo c. RUSSIE du 7 avril 2020 requête n°5738/18
Violation de l'article 1 du Protocole 1 : la saisie pénale durant 6 ans d'un terrain appartenant à une personne non concernée par la procédure d'accusation pénale en cours, n'est pas proportionnée à son droit de propriété.
Art 1 P1 ? Réglementation de l’usage des biens ? Saisie prolongée de parcelles de terrain appartenant à un promoteur immobilier dans le cadre d’une enquête pénale contre des tiers ? Durée totale de la saisie de plus de six années non disproportionnée en soi ? Alignement quasi-automatique des renouvellements de la saisie sur les prolongations de l’enquête ? Bonne foi et absence de négligence de la société requérante ? Absence de mise en balance des besoins et intérêts en présence ? Autorités n’ayant rien entrepris pour empêcher les divisions et reventes de parcelles visées par les poursuites ? Charge excessive ayant compromis l’activité principale de la société requérante
FAITS
6. En août 2009 et en mars 2010 respectivement, plusieurs enquêtes pénales pour escroquerie aggravée, abus de confiance, blanchiment de fonds, faux et usage de faux, et détournement de pouvoir furent ouvertes contre A., ancien directeur d’une banque sise au Kazakhstan (« la banque »), et contre plusieurs autres personnes. À différentes dates non précisées dans le dossier, A. et ses complices présumés fuirent à l’étranger.
7. Selon les autorités de poursuite, les faits à l’origine de l’ouverture des enquêtes étaient les suivants. Les dirigeants et employés de la banque, étant sous l’influence des personnes mises en examen, avaient accordé des prêts à des sociétés appartenant de fait à A. Au moyen de ces prêts, d’autres sociétés, contrôlées par A., – notamment la société ZAO TDK – avaient fait l’acquisition de plusieurs grands terrains dans la région de Moscou. Les prêts avaient été nantis au moyen d’hypothèques sur ces mêmes terrains. Puis, A. et ses complices présumés, agissant par l’intermédiaire de ces dernières sociétés, avaient fait frauduleusement résilier les contrats d’hypothèque, diviser les terrains en plusieurs centaines de parcelles et revendre celles-ci, et cela dans le but de blanchiment des fonds illicitement obtenus et de dissimulation des traces des délits.
8. Le 20 septembre 2010, la société ZAO TDK vendit treize parcelles à la société requérante.
9. À une date non précisée dans le dossier, la banque se constitua partie civile et demanda une indemnisation pour le préjudice qu’elle disait avoir subi, estimé à près de 25 milliards de roubles (RUB).
10. Le 30 octobre 2012 et le 13 août 2018, A. et ses complices présumés furent mis en examen pour de nouveaux épisodes d’escroquerie, de blanchiment de fonds et de détournement de pouvoir aggravés. Le 21 août 2019, le tribunal du district Taganski de Moscou tint une audience préliminaire en l’affaire.
11. À une date non précisée dans le dossier, l’enquêteur chargé de l’affaire pénale demanda au tribunal du district Tverskoï de Moscou d’autoriser la saisie provisoire des parcelles mentionnées au paragraphe 7 ci-dessus.
12. Par une ordonnance du 9 août 2012, le tribunal du district Tverskoï, statuant sur le fondement de l’article 115 du code de procédure pénale (CPP), fit droit à la demande et autorisa la saisie de toutes les parcelles précitées. Il estima que celles-ci avaient été obtenues, par la société ZAO TDK notamment, au moyen d’agissements délictueux (???????? (...) ? ?????????? ?????????? ????????) de A. et de ses complices et qu’elles avaient servi à financer un groupe criminel organisé (??? ??????????? ?????????????? ?????????????? ??????) constitué par ceux-ci. Le tribunal considéra que la saisie était nécessaire pour assurer l’exécution d’un futur jugement de condamnation, ainsi que pour protéger les intérêts des propriétaires légitimes des terrains et ceux de la victime et partie civile.
Le 12 décembre 2012, la cour de la ville de Moscou (« la cour de Moscou ») confirma l’ordonnance du tribunal en appel.
13. Le 5 février 2013, la société requérante demanda à l’enquêteur la levée de la saisie de ses treize parcelles. Par une décision du 8 février 2013, l’enquêteur rejeta cette demande. L’intéressée forma un recours en justice contre cette décision. Le 4 juin 2013, le tribunal du district Tverskoï rejeta le recours, et, le 24 juillet 2013, la cour de Moscou confirma la décision de ce tribunal en appel.
60. La Cour rappelle que la saisie de biens pour les besoins d’une procédure pénale relève de la réglementation de l’usage des biens (Lachikhina, précité, § 58, avec les références qui y sont citées). Elle rappelle également que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne prohibe pas la saisie dans le cadre d’une procédure pénale, mais que, pour répondre aux exigences inhérentes à cet article, la saisie doit être prévue par la législation interne, poursuivre un but légitime et être proportionnée au but poursuivi, c’est-à-dire ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit de l’individu au respect de ses biens (ibidem, §§ 59-60).
CEDH
a) Sur la légalité et le but légitime de l’ingérence
61. La société requérante soulève deux moyens tirés d’une illégalité de la mesure : premièrement, la saisie serait devenue contraire à la législation interne dès l’ouverture, en 2014, de la procédure de faillite contre elle ; et deuxièmement, la saisie et ses renouvellements manqueraient en soi de base légale.
62. Se tournant vers le premier moyen, la Cour note ce qui suit. D’un côté, selon l’article 126 § 1 de la loi fédérale relative à la faillite, l’ouverture par un tribunal de la procédure de faillite emporte la levée des saisies antérieures des biens du failli. D’un autre côté, selon l’article 115 § 9 du CPP, lorsqu’une saisie n’est plus nécessaire ou lorsqu’elle a vu son délai d’application expirer et qu’elle n’a pas été renouvelée, elle est levée par une autorité chargée de l’affaire pénale (comparer les paragraphes 31, 37 et 43 ci-dessus). En outre, selon la Cour constitutionnelle, la levée d’une saisie imposée sur le fondement de l’article 115 du CPP, même pour les biens du failli, s’effectue toujours par l’autorité chargée de l’affaire pénale, qui jouit d’un pouvoir d’appréciation des faits (paragraphe 44 ci-dessus). Un certain conflit apparaît ainsi entre les dispositions de la loi relative à la faillite et celles du CPP. En même temps, il n’a pas été démontré qu’il existe une pratique judiciaire unanime consistant à donner priorité à l’une ou l’autre de ces dispositions ou à obliger les autorités à faire lever les saisies dans pareille situation.
63. Rappelant qu’il ne lui appartient pas d’interpréter le droit interne (voir, par exemple, Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 116, 15 mars 2018), la Cour considère que l’ouverture en l’espèce de la procédure de faillite contre la société requérante ne suffit pas, en soi, à rendre la saisie « illégale » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
64. Se tournant vers le deuxième moyen – existence d’une base légale de la saisie des parcelles et des renouvellements de celle-ci –, la Cour observe que la mesure avait dès le début un double fondement légal. D’une part, cette mesure a été appliquée et renouvelée pour protéger les droits de la victime et partie civile et pour assurer l’éventuelle confiscation des parcelles comme sanction pénale pour le blanchiment de fonds (article 115 § 1 du CPP). D’autre part, selon les autorités internes, ces biens ont été obtenus au moyen d’agissements délictueux et avaient servi à financer un groupe criminel organisé (article 115 § 3 du CPP). Ces deux fondements légaux pouvaient chacun, en soi, justifier une saisie.
65. S’agissant du premier fondement (article 115 § 1 du CPP), il ressort de la lecture de l’article 115 du CPP ainsi que de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 octobre 2014 que la saisie, protégeant les intérêts des victimes et parties civiles, ne pouvait être appliquée qu’à l’égard des biens des personnes mises en examen et des défendeurs civils (paragraphes 30 et 34 ci-dessus). Le Gouvernement n’ayant pas démontré qu’il existe une lecture différente de ces dispositions, et la société requérante ainsi que ses dirigeants et employés n’étant ni mis en examen ni défendeurs civils, la Cour conclut que, en l’espèce, la saisie ne pouvait pas être valablement fondée sur l’article 115 § 1 du CPP.
66. S’agissant du second fondement (article 115 § 3 du CPP), la Cour relève que la société requérante conteste les conclusions des autorités relatives à l’origine et à la destination criminelle des parcelles. Or, rappelant qu’il ne lui revient pas d’apprécier les faits et de réexaminer les conclusions des instances nationales, sauf dans les cas où cela est rendu inévitable (Novikov c. Russie, no 35989/02, § 38, 18 juin 2009), la Cour estime que, en l’espèce, aucun élément dans le dossier ne permet de critiquer la thèse des autorités relative à l’origine et à la destination de ces biens.
67. Il s’ensuit que la mesure a été valablement fondée sur l’article 115 § 3 du CPP et était donc « légale » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il s’ensuit également que la mesure poursuivait au moins un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public et la prévention des délits.
68. Toutefois, ce constat n’empêche pas la Cour de tenir compte des considérations relatives au premier fondement légal (paragraphe 65 ci-dessus) dans son examen de la proportionnalité de la mesure.
b) Sur la proportionnalité de l’ingérence
69. Pour déterminer la proportionnalité d’une mesure de saisie, il convient de prendre en compte plusieurs facteurs. La durée de la saisie constitue l’un de ces facteurs, bien qu’elle ne soit pas un critère absolu. D’autres facteurs pertinents sont la nécessité de maintenir la saisie eu égard au déroulement des poursuites pénales, les conséquences de son application pour l’intéressé (Lachikhina, précité, § 59), le comportement des parties, les moyens employés par l’État et leur mise en œuvre (Forminster Enterprises Limited c. République tchèque, no 38238/04, § 75, 9 octobre 2008), l’existence d’un recours permettant de s’opposer au maintien d’une saisie (Benet Czech, spol. s r.o. c. République tchèque, no 31555/05, § 49, 21 octobre 2010), ainsi que la mise en œuvre des garanties procédurales découlant de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 302, 28 juin 2018).
70. En l’espèce, la Cour constate que, à la date des dernières observations des parties en octobre 2019, la durée de la saisie et de ses renouvellements était comprise entre le 9 octobre 2012 et le mois d’octobre 2019. Pendant ces sept ans, il y a eu trois périodes – trois mois, puis encore deux mois en 2015, et trois mois en 2019 – au cours desquelles les parcelles n’étaient pas visées par la saisie (paragraphes 16-20 et 24-25 ci-dessus).
71. De l’avis de la Cour, cette durée de la saisie des parcelles, avec des périodes d’interruption de la mesure, est certes conséquente mais ne rend pas, en soi, l’ingérence disproportionnée (comparer avec BENet Praha, spol. s r.o. c. République tchèque, no 33908/04, 24 février 2011, concernant une saisie durant près de quatre ans et neuf mois, et avec Invest Kapa c. République tchèque (déc.) [comité], no 19782/13, § 42, 12 juin 2018, concernant une saisie durant près de onze ans). Aussi convient-il d’analyser d’autres aspects de la proportionnalité de la mesure.
72. La Cour note que, entre 2012 et 2014, la saisie des biens de la société requérante n’était assortie d’aucun délai et il n’y avait pas de contrôle périodique de la nécessité de cette mesure. Puis, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 21 octobre 2014, les juridictions ont commencé à assortir la saisie de délais et elles ont dû, à l’expiration de chaque délai ainsi fixé, se prononcer sur la possibilité de renouvellement de la mesure, en statuant en présence de la société requérante et en lui permettant d’exposer ses arguments. Les décisions de renouvellement de la saisie pouvaient être frappées d’appel. Par la suite, le CPP a été modifié (paragraphes 37-39 ci-dessus). Les changements ainsi opérés semblent assurer aux propriétaires tiers à la procédure pénale un « recours effectif », et une « protection judiciaire effective », d’après les termes employés par la haute juridiction (paragraphes 15, 33 et 36 ci-dessus) (comparer avec Borjonov c. Russie, no 18274/04, §§ 52-53, 22 janvier 2009, s’agissant de l’absence, à l’époque, de recours contre la saisie continue de biens).
73. En même temps, la Cour observe que les renouvellements de la saisie semblent en l’espèce s’aligner de façon quasi automatique sur les prolongations des délais de l’enquête pénale. Par ailleurs, en ordonnant les renouvellements, les juridictions ont systématiquement invoqué les mêmes motifs, notamment la nécessité de protéger les droits de la victime et partie civile, alors que ces considérations – comme il a déjà été établi – ne pouvaient pas justifier la saisie sans que la société requérante fût attraite à la procédure comme défenderesse civile (paragraphe 65 ci-dessus). Les juridictions ne semblent pas s’être assurées de l’existence de nouvelles circonstances justifiant le maintien prolongé de la mesure, en dépit de la position de la Cour constitutionnelle à cet égard (paragraphe 23 ci-dessus).
74. En outre, la Cour relève qu’aucun élément dans le dossier ne laisse penser que la société requérante ait été de mauvaise foi ou négligente lors de l’achat des parcelles, ou que ses dirigeants ou employés aient été liés aux délits imputés à A. et à ses complices (Lachikhina, précité, § 63, et Uzan et autres c. Turquie, no 19620/05 et 3 autres, § 212, 5 mars 2019). La bonne foi de l’intéressée n’est pas contestée (voir à cet égard également la position de la Cour constitutionnelle, paragraphe 35 in fine ci-dessus). Or les juridictions n’ont pas tenu compte de ces éléments et elles n’ont pas recherché non plus si la société requérante avait été au courant ou aurait dû être au courant de l’origine et de la destination criminelles des biens en question, ce qui va à l’encontre des exigences du CP et de la Cour constitutionnelle (paragraphes 35 et 41 ci-dessus). Les juridictions n’ont pas procédé non plus à une mise en balance entre les besoins de l’enquête pénale, les intérêts de la partie civile et l’intérêt légitime de la société requérante – acquéreur de bonne foi – à reprendre le contrôle de ses biens (voir aussi, mutatis mutandis, G.I.E.M. S.R.L. et autres, précité, § 303, et Uzan et autres, précité, § 215).
75. Par ailleurs, il est surprenant que, en dépit de l’ouverture des poursuites pénales en août 2009 et en mars 2010, les autorités n’aient rien entrepris pour empêcher les divisions et les reventes des parcelles visées par ces poursuites (comparer avec Anna Popova c. Russie, no 59391/12, §§ 10-12 et 35, 4 octobre 2016, s’agissant des reventes d’un appartement visé par une enquête pénale).
76. Enfin, bien que la saisie des parcelles emportât seulement une impossibilité d’en disposer, la Cour observe que l’activité statutaire de la société requérante était la promotion immobilière, ce qui impliquait la revente de parcelles constructibles. Aussi la saisie a-t-elle compromis l’activité principale de l’intéressée (voir aussi, mutatis mutandis, Petyo Petkov c. Bulgarie, no 32130/03, § 106, 7 janvier 2010, et comparer avec Nikolayenko et autres c. Russie (déc.) [comité], nos 78494/14 et 41461/16, § 48, 10 octobre 2019) en lui imposant ainsi une charge excessive.
77. Eu égard à ces éléments, la Cour conclut que les autorités n’ont pas ménagé un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et les exigences de la protection des droits de la société requérante au respect de ses biens. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
STEPANOVA c. RUSSIE du 8 janvier 2019 requête n° 7506/17
Violation de l'article 1 du Protocole 1 : une dame poursuivie pour escroquerie voit sa maison et son terrain saisis pour payer une amende pénale non encore fixée. Il y a disproportion de la saisie pour payer une amende non encore fixée.
28. Il ne se prête pas à polémique entre les parties que la maison et le terrain en question étaient les « biens » de la requérante, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et que la saisie de ces biens a constitué une ingérence dans le droit de l’intéressée au respect de ses biens.
29. La Cour rappelle que la saisie d’objets pour les besoins d’une procédure pénale s’analyse en une ingérence relevant de la réglementation de l’usage des biens (voir, par exemple, Lachikhina c. Russie, no 38783/07, § 58, 10 octobre 2017, avec les références qui y sont citées). Elle rappelle également que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne prohibe pas la saisie d’un bien dans le cadre d’une procédure pénale, mais, pour répondre aux exigences inhérentes à cet article, la saisie doit être prévue par la législation interne, poursuivre un but légitime et être proportionnée au but poursuivi (Lachikhina, précité, § 59).
30. La Cour relève que, en l’espèce, la saisie des biens de la requérante était fondée sur les articles 115 et 165 du CPP. Elle note que l’article 115 du CPP permet d’imposer une saisie tant dans les intérêts des parties civiles que pour garantir le paiement d’une possible amende ou l’application d’une possible confiscation (paragraphe 16 ci-dessus). Elle observe que, d’après les motifs exposés par les juridictions internes, la saisie des biens de la requérante, qui n’étaient pas présumés d’être le produit d’une infraction ou pouvoir être reliés à une infraction, avait une double finalité. Elle note que cette saisie était destinée à assurer l’exécution d’un futur jugement de condamnation, d’une part dans sa partie concernant une possible action civile, et d’autre part dans sa partie concernant l’imposition d’une amende pénale. Elle note aussi que, si aucune action civile n’a pour le moment été formée dans l’affaire, l’amende est bien une sanction prévue pour l’infraction dont la requérante est accusée (paragraphe 19 ci-dessus). Ainsi, la Cour accepte que la mesure de saisie était fondée sur la loi et qu’elle poursuivait le but légitime de paiement des amendes, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Reste à déterminer si cette mesure était proportionnée, c’est-à-dire si elle a respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et le droit de la requérante de disposer de ses biens.
31. La Cour considère que, même si la saisie en tant que telle ne prête pas à critique, une telle mesure risque toujours d’imposer à la personne concernée une charge excessive en ce qui concerne son droit de disposer de ses biens, c’est pourquoi son application ne doit pas être arbitraire et doit être assortie de certaines garanties procédurales. Ces garanties procédurales impliquent, entre autres, une obligation pour les autorités compétentes de motiver les décisions relatives aux saisies et d’en apprécier la proportionnalité (Džinic c. Croatie, no 38359/13, §§ 68 et 70, 17 mai 2016).
32. La Cour relève que, en l’occurrence, la requérante était accusée d’avoir détourné une somme d’au moins 396 422 RUB et que cette infraction est passible d’une amende d’un montant maximal de 500 000 RUB. Elle note que l’enquêteur n’a pas fourni au tribunal du district Starorousski d’informations sur la valeur des biens dont il demandait la saisie, et que le tribunal n’a pas examiné cette question d’office. Elle relève que, comme la requérante n’avait pas été informée de l’examen de la demande de saisie, conformément à l’article 165 du CPP (paragraphe 18 ci-dessus), elle n’a pas pu présenter ses arguments à cet égard. La Cour observe que, en appel, l’intéressée a fourni un rapport estimatif confirmant que la valeur des biens saisis était plusieurs fois supérieure aux montants du préjudice allégué et d’une possible amende, mais que la cour régionale de Novgorod a rejeté ce document comme non pertinent (comparer avec Džinic, précité, § 71). Même s’il n’était pas possible d’accepter le rapport estimatif susmentionné en tant que document déterminant la valeur exacte de la maison et du terrain, dans tous les cas, les allégations de la requérante concernant l’importante disproportion entre, d’un côté, les biens saisis et, de l’autre, le préjudice qui aurait été causé par l’escroquerie et une possible amende pénale n’étaient pas dénuées de pertinence.
33. De l’avis de la Cour, une totale omission par les juridictions d’examiner la valeur des biens saisis et de comparer cette valeur au montant du dommage pécuniaire imputé à la requérante et à celui de l’amende susceptible d’être encourue n’a pas été justifiée. En outre, il ne ressort pas des documents du dossier et il n’a pas été allégué que les autorités internes s’étaient penchées sur ces questions après que le montant du préjudice eût été réévalué, en août 2017.
34. La Cour note de surcroît que les juridictions se sont bornées à indiquer, sans plus de précisions, que le principe de proportionnalité avait été observé (paragraphes 11 et 13 ci-dessus ; comparer avec Džinic, précité, §§ 75 et 78, et voir, a contrario, UBS AG c. France (déc.), no 29778/15, 12 janvier 2017, concernant le cautionnement d’un montant élevé dont l’imposition avait été particulièrement bien motivée par les juridictions françaises).
35. Dans ces circonstances, la Cour considère que, bien que la saisie ait été en principe légitime, la manière dont elle a été imposée n’a pas satisfait au critère du « juste équilibre ».
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
NURMIYEVA c. RUSSIE du 27 novembre 2018 requête n° 57273/13
Violation de l'article 1 du protocole 1 : Des dalles de parking retirées dans le cadre d'une enquête pour vol sont remises à la société fabricante. Celle-ci les revend alors que l'enquête pénale se termine par un non lieu. La requérante subit une indemnisation partielle. Elle avait une espérance légitime d'être entièrement remboursée par l'entreprise qui a fait retirer les dalles et revendues. Elle n'est pas remboursée intégralement de "sa créance". Les obligations tirées de l'article 1 du Protocole 1 de la Convention ne sont pas respectées.
LES FAITS
8. Le 20 septembre 2007, une enquête pénale contre X fut ouverte pour vol de dalles appartenant à la société Tsentr. La requérante fut interrogée comme témoin. Le 16 novembre 2007, un enquêteur inspecta le parking de la requérante et qualifia de preuves matérielles certaines dalles pavant celui-ci.
9. Le 22 mai 2009, un enquêteur ordonna le retrait de soixante dalles du parking de la requérante, en tant que preuves matérielles, ainsi que leur remise, pour conservation, à la société Tsentr. Le même jour, les employés de cette société retirèrent ces dalles.
11. Le 6 septembre 2010, l’enquête fut classée sans suite en raison de l’absence de faits constitutifs du délit. La requérante se vit informer qu’elle pouvait saisir la justice d’une demande de restitution des dalles « illicitement retirées ».
12. La société Tsentr ayant entretemps revendu les dalles en question, la requérante ne put en obtenir la restitution.
La requérante ne fut que partiellement remboursé du retrait des dalles.
ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1
a) Sur l’existence d’un « bien » et de l’ingérence
31. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il conteste se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « bien » a une portée autonome qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne, et elle englobe les biens meubles, les biens immeubles, ainsi que certains autres droits et intérêts constituant des actifs. Bien que l’article 1 du Protocole no 1 ne vaille que pour les biens actuels et ne crée aucun droit d’en acquérir, dans certaines circonstances, l’« espérance légitime » d’obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de cette disposition (voir, parmi beaucoup d’autres, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 65, CEDH 2007-I). Une espérance légitime est plus concrète qu’un simple espoir et doit avoir une base suffisante en droit interne. Elle doit se fonder sur une disposition législative ou sur un acte juridique concernant l’intérêt patrimonial en question, et, en principe, un requérant ne peut passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une « valeur patrimoniale » aux fins de l’article 1 du Protocole no 1 lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 45-52, CEDH 2004-IX, et Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 149 in fine, 20 mars 2018).
32. En l’espèce, la Cour relève que le Gouvernement n’a pas répondu à la question de savoir si le parking constituait pour la requérante un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, mais qu’il s’est contenté d’alléguer que ce parking n’était pas un immeuble au sens du droit russe. Elle note également que les juridictions internes n’ont ni remis en cause l’existence même du parking en tant qu’objet (certes, meuble) ou installation (paragraphes 16 et 18 ci-dessus), ni dénié la qualité de propriétaire de celui-ci à la requérante. La Cour considère ainsi que le parking inachevé était le « bien » de l’intéressée.
33. La Cour observe en outre que le parking a été endommagé, certaines de ses composantes ayant été retirées. Ainsi, se pose la question de savoir si, en l’espèce, la requérante avait une « espérance légitime » de recevoir une indemnisation intégrale pour le préjudice subi, au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
34. À cet égard, la Cour relève que les dispositions légales internes, telles qu’interprétées par les hautes juridictions rendaient la requérante titulaire d’un droit à la réparation intégrale du préjudice réel, et que les juridictions commerciales amenées à statuer dans le litige engagé par l’intéressée ont confirmé l’existence de ce droit (paragraphes 15, 18, 20 et 21 ci-dessus). La Cour observe de surcroît que le Gouvernement n’a indiqué aucune disposition interne interdisant d’allouer les frais de reconstruction à l’égard des biens meubles. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante avait une « espérance légitime », fondée sur la loi interne, de se voir indemniser pour tout le préjudice subi du fait du retrait des dalles, y compris pour les frais de reconstruction du parking (voir aussi, mutatis mutandis, Weissman et autres c. Roumanie, no 63945/00, § 63, CEDH 2006-VII (extraits)).
35. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’article 1 du Protocole no 1 s’applique en l’espèce et que l’ingérence est constituée par le rejet de la demande de la requérante d’indemnisation pour le préjudice causé, et plus particulièrement pour les frais de reconstruction du parking.
b) Sur la compatibilité de la mesure avec les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
36. La Cour rappelle que, pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, toute mesure doit remplir trois conditions : elle doit être effectuée « dans les conditions prévues par la loi », « pour cause d’utilité publique » et dans le respect d’un juste équilibre entre les droits du propriétaire et les intérêts de la communauté.
37. En l’occurrence, la Cour observe que les parties n’ont pas soumis d’observations quant à la « légalité » de la mesure et à l’existence d’un but d’utilité publique. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ces questions, puisque, en tout état de cause, la mesure n’a pas respecté le juste équilibre exigé (Novikov c. Russie, no 35989/02, § 44, 18 juin 2009).
38. La Cour rappelle qu’elle dispose d’une compétence limitée pour vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué, et qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, qui sont mieux placés pour apprécier les preuves et pour qualifier un bien de meuble ou d’immeuble, son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste (voir, parmi beaucoup d’autres, Kushoglu c. Bulgarie, no 48191/99, § 50, 10 mai 2007).
39. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour rappelle avoir déjà constaté que le droit de la requérante de se faire indemniser pour l’intégralité du dommage résultant du retrait des dalles jugé « illicite » a été consacré par le droit interne et confirmé par les juridictions commerciales (paragraphe 34 ci-dessus). En effet, le tribunal de commerce a accueilli l’action en responsabilité de l’État intentée par la requérante du fait de la perte des dalles pavant le parking, et il a rejeté sa demande relative aux frais de livraison de dalles de remplacement au motif que l’intéressée n’avait pas démontré la réalité de ces frais (paragraphe 15 ci-dessus). Ce faisant, le tribunal a encore une fois confirmé le droit de la requérante à une indemnisation, y compris pour les frais de livraison des dalles de remplacement occasionnés par le retrait des anciennes dalles.
40. La Cour note que, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, le tribunal de commerce a néanmoins rejeté en bloc la demande de la requérante relative aux frais de reconstruction du parking, refusant ainsi d’accepter le devis estimatif en tant que preuve de ces frais, au seul motif que le parking n’était pas un bien immobilier, et que cela a été confirmé par la 18e cour de commerce d’appel (paragraphes 16 et 18 ci-dessus).
De l’avis de la Cour, en statuant ainsi, les juridictions commerciales sont parvenues à deux conclusions contradictoires. D’un côté, elles ont confirmé le droit de la requérante à une indemnisation intégrale pour le préjudice subi du fait du retrait des dalles de son parking, sous condition de présentation des preuves du préjudice. D’un autre côté, elles lui ont dénié ensuite ce même droit, ayant considéré que le seul préjudice causé à des immeubles pouvait être réparé, et, de ce fait, elles n’ont pas permis à la requérante de prouver la réalité des frais relatifs à la reconstruction de son bien. La Cour estime que ce raisonnement des juridictions internes a été pour le moins incohérent, sinon manifestement contradictoire.
41. Dans ces circonstances, la Cour conclut que le refus des juridictions commerciales d’ordonner une indemnisation de la requérante pour les frais de reconstruction du parking causés par un acte « illicite » des autorités a fait peser sur l’intéressée une charge excessive rompant le juste équilibre entre les intérêts de l’individu et ceux de la société.
Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
OOO KD-KONSALTING c. RUSSIE du 29 mai 2018 Requête n° 54184/11
Violation de l'article 1 du Protocole 1 : une saisie d'une livraison de zinc est ensuite volée et non retrouvée. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables nécessaires à leur conservation. La procédure s'est enlisée au point que la prescription est acquise. Durant la procédure, la société requérante n'a pas pu agir pour récupérer son bien. La société requérante s’est retrouvée pendant plusieurs années dans l’impossibilité d’entamer une procédure contre l’État afin de prouver que les autorités avaient failli à leur obligation de protéger ses biens et de réclamer une indemnisation en raison de leur manquement.
2. L’appréciation de la Cour
43. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il conteste se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « bien » a une portée autonome qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne. Ce qui importe, c’est de rechercher si les circonstances d’une affaire donnée, considérées dans leur ensemble, peuvent passer pour avoir rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi les arrêts récents, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 73 et 76, CEDH 2016).
44. La Cour rappelle également que, en vertu du principe de subsidiarité, elle n’a normalement pas pour tâche de se prononcer sur la qualité de propriétaire des biens d’un requérant car l’examen de cette question, impliquant une interprétation des dispositions internes, incombe aux autorités nationales (Järvi-Eristys Oy, décision précitée).
45. Elle observe en l’espèce que, dans sa décision du 24 novembre 2009, le tribunal de district a reconnu la qualité de propriétaire du zinc à la société requérante. Bien que cette décision ait été ultérieurement annulée pour des motifs liés à la répartition des compétences entre les tribunaux et les organes de poursuites, la qualité de propriétaire de l’intéressée n’a pas été remise en question (paragraphes 17 et 21 ci-dessus). Le tribunal de commerce a également reconnu que la société requérante était propriétaire du zinc et la juridiction d’appel n’a pas contesté cette conclusion (paragraphes 25-26 ci-dessus). C’est seulement la juridiction de cassation qui a, pour la première fois, laissé entendre qu’il pouvait y avoir un doute sur la qualité de propriétaire de la société requérante (paragraphe 27 ci-dessus). Quant aux autorités chargées des poursuites, la Cour relève qu’elles ne sont parvenues à aucune conclusion formelle concernant la propriété du zinc, que ce soit en faveur de la société requérante ou d’un tiers.
46. Dans les circonstances où la question de savoir qui était propriétaire des biens n’a pas été tranchée par les juridictions internes, la Cour doit se livrer à sa propre analyse de la situation (voir aussi, pour une approche similaire, Uniya OOO et Belcourt Trading Company, précité, §§ 297-299, et Novikov c. Russie, no 35989/02, § 38, 18 juin 2009). En l’espèce, elle relève tout d’abord que ni la société requérante ni ses dirigeants n’ont jamais été inculpés d’une quelconque infraction en lien avec ce bien. De surcroît, elle note que, pendant dix ans, personne d’autre que la société requérante n’a revendiqué de droits à l’égard du zinc (voir aussi Uniya OOO et Belcourt Trading Company, précité, § 303, et Novikov, précité, § 35 ; comparer avec Järvi-Eristys Oy, décision précitée). La Cour constate également que la société requérante a fourni, tant aux instances internes qu’à la Cour, plusieurs documents justifiant raisonnablement son droit de propriété. Elle considère que, à la différence des affaires citées par le Gouvernement, où les requérants avaient la possibilité de contester les mesures prises à l’égard de leurs biens dans le cadre de procédures contradictoires devant des juridictions, l’intéressée n’a pas eu, en l’espèce, l’occasion de prouver qu’elle avait légalement acquis le zinc car les juridictions ont finalement décidé que cette question ne pouvait être débattue qu’à la fin de l’enquête pénale.
47. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel le contrat d’achat du zinc était fictif, mais elle estime que le Gouvernement ne peut pas valablement avancer de thèses non débattues devant les instances internes (voir aussi, dans le contexte de l’article 10 de la Convention, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, no 68354/01, §§ 30-31, 25 janvier 2007).
48. La Cour considère ainsi que la société requérante a démontré que le zinc constituait son « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae de la requête.
49. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
50. Le Gouvernement considère que, les circonstances de l’acquisition du zinc étant selon lui suspicieuses, la saisie du métal par les autorités était justifiée et sa rétention demeurait nécessaire tout au long de l’enquête, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans l’affaire pénale pour escroquerie, affaire qu’il estime être particulièrement compliquée.
51. Quant à la disparition du zinc et au rejet de la demande d’indemnisation à cet égard, le Gouvernement soutient qu’aucune faute ne peut être imputée aux autorités ayant déposé le métal dans un entrepôt de la société Elektrotsink, et que, de toute façon, la conformité de ce dépôt à la loi doit être examinée dans le cadre de l’enquête pénale pour vol de zinc.
52. La société requérante considère que, indépendamment de la légalité de la saisie initiale du zinc, la rétention des marchandises pendant l’enquête pénale, sans qu’il y ait eu de mesures d’instruction les concernant, a été disproportionnée. Selon elle, l’enquête pénale pour escroquerie s’était enlisée et n’a été reprise qu’après la communication de la présente requête par la Cour, à un moment où l’action publique était déjà prescrite, ce qui aurait obligé les autorités chargées des poursuites à rendre une décision de non-lieu à poursuivre.
53. La société requérante reproche en outre à l’enquêteur d’avoir omis de conclure un contrat de dépôt des preuves matérielles, en violation de l’arrêté du Gouvernement du 20 août 2002, et elle déplore que le CPP ne réglemente pas les conséquences de la perte de preuves matérielles dans les affaires pénales. Elle assimile la présente affaire à l’affaire Novikov (précitée), où la Cour avait constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 car les autorités n’avaient ni rendu les biens saisis au requérant ni versé de dédommagement.
2. L’appréciation de la Cour
a) Sur l’objet de l’analyse par la Cour
54. La Cour observe que le grief de la société requérante comporte trois branches. Premièrement, l’intéressée se plaint de la saisie de ses biens en 2007. Deuxièmement, elle se plaint de leur rétention continue en tant que preuves matérielles jusqu’à leur disparition. Enfin, elle dénonce le refus des juridictions internes de lui accorder une indemnisation pour la disparition de ses biens.
55. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les deux premières mesures contestées par la société requérante, à savoir la saisie et la rétention des biens en cause, car la situation a radicalement changé avec leur disparition. En effet, elle note que les mesures temporaires de saisie et de rétention se sont transformées en une perte définitive des biens de la société requérante. Les biens disparus, tout en gardant le statut de preuves matérielles, n’étaient plus retenus par les autorités.
56. La Cour relève en outre que, bien que l’action en indemnisation introduite par la société requérante devant les juridictions commerciales concernait la saisie, la rétention et la disparition de ses biens, son but principal était bien d’obtenir une réparation pour la perte du zinc. Aussi analysera-t-elle uniquement la disparition du zinc et les événements subséquents (voir aussi, pour une approche similaire, Uniya OOO et Belcourt Trading Company, précité, §§ 275 et 309, et Novikov, précité, § 44).
b) Sur le respect de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
57. La Cour rappelle que, lorsque les autorités judiciaires ou de poursuite saisissent des biens, elles doivent prendre les mesures raisonnables nécessaires à leur conservation (Dzugayeva c. Russie, no 44971/04, § 27, 12 février 2013), notamment en dressant un inventaire des biens et de leur état au moment de la saisie. Par ailleurs, la législation interne doit prévoir la possibilité d’entamer une procédure contre l’État afin d’obtenir réparation pour les préjudices résultant d’une conservation défectueuse de ces biens. Encore faut-il que cette procédure soit effective, pour permettre au propriétaire de défendre sa cause (Tendam c. Espagne, no 25720/05, § 51, 13 juillet 2010, et les affaires qui y sont citées).
58. En l’occurrence, la Cour observe que les juridictions pénales se sont déclarées finalement incompétentes pour examiner le recours de la société requérante concernant le devoir de l’enquêteur de conserver le zinc saisi. En effet, elles ont considéré que cette question ne pouvait pas être réglée avant qu’un tribunal ait statué sur la responsabilité pénale des personnes accusées du vol de ce métal (paragraphes 21-22 ci-dessus). Or cette enquête était toujours en cours en avril 2017, soit près de sept ans et demi après son ouverture et sans aboutir à aucun résultat concret (paragraphes 14-15 ci-dessus).
59. Elle observe en outre qu’il ressort des dispositions de l’article 82 du CPP interprétées par la Cour constitutionnelle que les preuves matérielles ne doivent pas faire l’objet de rétentions illimitées dans le temps et, dans certains cas, peuvent être restituées à leurs possesseurs légitimes avant la fin de l’enquête pénale (paragraphes 30-31 ci-dessus). Néanmoins, en l’espèce, les juridictions commerciales ont aussi refusé de statuer sur la demande d’indemnisation formulée par la société requérante avant la clôture de l’enquête pénale pour escroquerie, alors que cette dernière s’est enlisée et était toujours pendante dix ans après son ouverture (paragraphes 13, 26-29 ci-dessus).
La Cour estime donc que, nonobstant la disparition du zinc, la société requérante s’est retrouvée pendant plusieurs années dans l’impossibilité d’entamer une procédure contre l’État afin de prouver que les autorités avaient failli à leur obligation de protéger ses biens et de réclamer une indemnisation en raison de leur manquement (voir aussi paragraphe 46 ci-dessus, in fine).
De l’avis de la Cour, la société requérante a ainsi dû supporter une charge excessive, incompatible avec le respect de l’article 1 du Protocole no 1. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
PETYO PETKOV C. BULGARIE du 7 janvier 2010 Requête no 32130/00
La CEDH constate que la durée de la saisie d'une voiture rendue quand elle a perdu toute valeur, a porté atteinte à la propriété individuelle.
102. La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole n°1 ne prohibe pas la saisie d'un bien à des fins d'administration de la preuve dans le cadre d'une procédure pénale. Toutefois, il s'agit d'une mesure qui restreint temporairement l'usage des biens et qui, dès lors, pour répondre aux exigences du l'article 1 du Protocole n°1, doit être prévue par la législation interne, poursuivre un but légitime et être proportionnée au but poursuivi (voir l'arrêt Karamitrov et autres, précité, § 72).
103. La Cour observe que la saisie du véhicule du requérant était prévue par les dispositions du code de procédure pénale (voir l'arrêt Karamitrov et autres, précité, §§ 29 à 33) et que le requérant ne conteste ni la prévisibilité, ni l'accessibilité des dispositions législatives en cause (voir paragraphe 100 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime que les parties s'accordent sur l'existence de cette première condition pour la régularité de la mesure litigieuse et elle ne voit pas de raison d'arriver à une conclusion différente dans le cas d'espèce.
104. Elle observe ensuite que la voiture du requérant a été saisie comme preuve matérielle dans le cadre des poursuites pénales menées à son encontre et qu'elle a fait l'objet d'une identification par un témoin (voir paragraphe 9 ci-dessus). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la mesure en cause visait le but légitime d'assurer le bon fonctionnement de la justice et qu'elle relevait donc du domaine de l'intérêt général.
105. Il reste donc à déterminer si les autorités ont ménagé en l'occurrence un juste équilibre entre l'intérêt général et le droit du requérant d'utiliser son bien. Pour déterminer la proportionnalité de la mesure en cause, la Cour estime opportun de prendre en compte sa durée, sa nécessité au vu du déroulement des poursuites pénales, les conséquences de son application pour le requérant et les décisions prises par les autorités à ce sujet pendant et après le fin du procès pénal.
106. La Cour constate que le véhicule de l'intéressé a été saisi le 5 février 2002 et lui a été restitué le 26 avril 2006. La mesure en cause a donc été appliquée pendant plus de quatre ans. La Cour relève ensuite que le véhicule saisi n'était pas simplement un moyen de locomotion pour le requérant, mais son principal outil de travail : il était chauffeur de taxi et la voiture lui servait pour transporter des clients (voir paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Par ailleurs, la voiture lui a été restituée en panne et sans un certain nombre d'accessoires, ce que le Gouvernement ne conteste pas (voir paragraphe 99 ci-dessus). Ainsi, la mesure en cause a pu affecter également l'activité professionnelle principale du requérant, notamment pendant la période suivant sa libération.
107. Il ressort des pièces du dossier que les actes d'instruction impliquant la reconnaissance de la voiture saisie ont été effectués au début de la période litigieuse (voir paragraphe 9 ci-dessus). Toutefois, cette preuve matérielle avait une importance particulière pour la vérification de l'alibi du requérant (voir paragraphe 8 ci-dessus) et de là pour l'issue de la procédure pénale. Dans ces circonstances, la Cour admet que la rétention du véhicule du requérant pendant la durée des poursuites pénales à son encontre s'avérait nécessaire.
108. Cependant, la Cour observe que la procédure pénale a pris fin le 19 janvier 2005 avec l'arrêt de la Cour suprême de cassation (paragraphe 13 ci-dessus) et que la rétention du véhicule du requérant comme preuve matérielle n'était plus nécessaire à compter de cette date. L'intéressé n'a pu reprendre possession de la voiture qu'un an et trois mois plus tard. La Cour constate que le retard en cause est imputable aux autorités : les tribunaux internes ont omis d'ordonner la remise du véhicule au requérant après son acquittement (voir paragraphe 11, ci-dessus, in fine), ce qui a obligé ce dernier à intenter une nouvelle procédure pour demander au tribunal de district de se prononcer sur cette question (voir paragraphe 14 ci-dessus). Par ailleurs, le requérant a dû formuler deux demandes consécutives à cet effet, le 2 septembre 2005 et le 9 mars 2006, et le Gouvernement n'a apporté aucun élément susceptible de justifier le retard de l'examen des demandes du requérant. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de constater s'il existait d'autres circonstances susceptibles de justifier la rétention du véhicule de l'intéressé après le 19 janvier 2005.
109. En conclusion, compte tenu de la durée de la mesure en cause, de son impact sur la situation du requérant, du déroulement des poursuites pénales à l'encontre de l'intéressé et des manquements des autorités dans le cas d'espèce, la Cour estime que la rétention du véhicule du requérant n'était plus proportionnée au but légitime poursuivi à compter de la date de son acquittement.
110. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
TENDAM C ESPAGNE DU 13 JUILLET 2010 REQUETE N°25720/05
UNE PROCÉDURE D'ACCUSATION PENALE NE PEUT PAS PORTER ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Le requérant, Hans Erwin Tendam, est un ressortissant allemand né en 1937 et résidant à Santa Cruz de Tenerife (Espagne). En 1986, il fit l’objet de poursuites pénales pour vol et recel, puis fut acquitté. Invoquant l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait du refus des autorités espagnoles de lui octroyer une indemnisation pour la détention provisoire qui lui fut imposée au cours de la procédure pour vol. Invoquant l’article 1 Protocole no 1 (protection de la propriété), il se plaignait en outre de la disparition et de la détérioration de biens qui lui furent saisis dans le cadre de la procédure pour recel.
La
CEDH suit le requérant et constate une:
- Violation de l’article 6 § 2
- Violation de l’article 1 du Protocole no
1
47. La Cour rappelle que la rétention des biens saisis par les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale doit être examinée sous l'angle du droit pour l'État de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, au sens du second paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 54, CEDH 2007-VII, Adamczyk c. Pologne (déc.), no 28551/04, 7 novembre 2006, et Borjonov c. Russie, no 18274/04, § 57, 22 janvier 2009). Elle constate qu'en l'espèce, la saisie cherchait non pas à priver le requérant de ses biens, mais seulement à l'empêcher d'en user de façon temporaire, dans l'attente de l'isssue de la procédure pénale.
48. La Cour observe que rien dans le dossier ne permet d'établir que la saisie et la rétention des biens litigieux n'avait pas une base légale. Elle relève que l'ingérence avait pour but de garantir la satisfaction des demandes que d'éventuelles parties civiles auraient pu chercher à formuler (voir, mutatis mutandis, Földes et Földesné Hajlik c. Hongrie, no 41463/02, § 26, CEDH 2006-XII). A cet égard, la Cour admet que la saisie et la rétention des biens objet d'une infraction pénale puisse être nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui constitue un but légitime relevant de “l'intérêt général” de la communauté (voir, mutatis mutandis, Smirnov, précité, § 57).
49. Toutefois, la Cour rappelle qu'il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but poursuivi par les mesures éventuellement appliquées par l'État, y compris celles destinées à contrôler l'usage de la propriété individuelle. Cette exigence s'exprime dans la notion de « juste équilibre » à ménager entre les impératifs de l'intérêt général de la communauté d'une part et les exigences de la protection des droits fondamentaux de l'individu d'autre part (voir Smirnov, précité, § 57). Par ailleurs, nonobstant le silence de l'article 1 du Protocole no 1 en matière d'exigences procédurales, les procédures applicables en l'espèce doivent aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition. Pour s'assurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer les procédures applicables d'un point de vue général (Zehentner c. Autriche, no 20082/02, § 73, CEDH 2009-...).
50. La Cour a déjà affirmé que toute saisie entraîne un dommage, lequel ne doit toutefois pas dépasser les limites de l'inévitable (Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 33, série A no 281-A). Elle a reconnu en outre que le propriétaire acquitté du chef de contrebande doit en principe avoir le droit de recouvrer les articles saisis à la suite de sa relaxe (Jucys c. Lituanie, no 5457/03, § 36, 8 janvier 2008).
51. Il est vrai que l'article 1 du Protocole no 1 ne consacre pas un droit pour la personne acquittée d'obtenir réparation pour tout dommage résultant de la saisie de ses biens effectuée au cours de l'instruction dans une procédure pénale (voir Adamczyk, décision précitée, et Andrews c. Royaume-Uni (déc.), no 49584/99, 26 septembre 2002). Toutefois, lorsque les autorités judiciaires ou de poursuite saisissent des biens, elles doivent prendre les mesures raisonnables nécessaires à leur conservation, notamment en dressant un inventaire des biens et de leur état au moment de la saisie ainsi que lors de leur restitution au propriétaire acquitté. Par ailleurs, la législation interne doit prévoir la possibilité d'entamer une procédure contre l'État afin d'obtenir réparation pour les préjudices résultant de la non-conservation de ces biens dans un relativement bon état (voir Karamitrov et autres c. Bulgarie, no 53321/99, § 77, 10 janvier 2008, se référant à l'article 13 de la Convention, et Novikov c. Russie, no 35989/02, § 46, 18 juin 2009). Encore faut-il que cette procédure soit effective, pour permettre au propriétaire acquitté de défendre sa cause.
52. En l'occurrence, la Cour observe que le requérant a entamé une action à l'encontre de l'État pour l'endommagement des biens saisis et recouvrés après son acquittement, ainsi que pour la disparition d'une partie des biens saisis et non restitués, sur la base de l'article 292 de la LOPJ relatif au fonctionnement anormal de la justice. La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter les faits et la législation interne, et la Cour ne substituera pas sa propre appréciation des faits et du droit à la leur en l'absence d'arbitraire (voir, entre autres, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII). Par ailleurs, il appartient aux États contractants de définir les conditions du droit à réparation en cas de préjudices résultant d'une saisie (Adamczyk, décision précitée).
53. Cela étant, la Cour note qu'en l'espèce, dans l'acte de restitution du 22 janvier 1994 le requérant fit état de la disparition de certains biens, ainsi que de la détérioration de tous les biens recouvrés. Elle observe en outre que dans cet acte, le greffier du juge d'instruction no 1 de La Orotava constata le mauvais état de plusieurs objets. Par ailleurs, il ressort du dossier que certaines demandes de restitution du juge d'instruction à des tiers ayant reçu des biens saisis en 1986 furent infructueuses. A cet égard, la Cour note que ces biens avaient été remis aux prétendues victimes en qualité de dépôt, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant. Or, les autorités nationales, et en dernier ressort le Tribunal suprême, ont rejeté la réclamation du requérant, au motif que ce dernier n'avait pas prouvé la disparition et la détérioration des biens saisis.
54. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la charge de la preuve concernant la situation des biens saisis manquants ou dégradés incombait à l'administration de justice, responsable de la conservation des biens pendant toute la période de la saisie, et non au requérant, acquitté plus de sept ans après la saisie des biens. L'administration de justice n'ayant fourni après l'acquittement du requérant aucune justification sur la disparition et la dégradation des biens saisis, les préjudices résultant de la saisie lui sont imputables.
55. La Cour constate que les juridictions internes qui ont examiné la réclamation du requérant n'ont ni tenu compte de la responsabilité de l'administration de justice dans les faits de la cause ni permis au requérant d'obtenir réparation pour les préjudices résultant de la non-conservation des biens saisis.
56. Aux yeux de la Cour, les autorités internes ayant refusé l'indemnisation réclamée par le requérant ont fait peser sur le requérant une charge disproportionnée et excessive.
57. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
Satisfaction équitable : question réservée pour décision à une date ultérieure concernant le préjudice matériel et 15 600 euros (EUR) pour dommage moral.
Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie du 20 septembre 2011 requête no 14902/04
La Cour européenne conclut que la Russie n’a pas détourné de procédure judiciaire pour détruire YUKOS mais constate des violations des droits fondamentaux de cette société notamment dans la procédure pénale qui a porté atteinte aux biens du requérant
Principaux faits
La requérante, OAO Neftyanaya kompaniya YUKOS, (YUKOS), était une société pétrolière et l’une des entreprises les plus importantes et florissantes de Russie. Enregistrée à
Nefteyugansk, dans le district autonome de Khantis-Mansis (Fédération de Russie), elle était à 100 % publique jusqu’à sa privatisation en 1995-1996.
A la fin de l’année 2002, YUKOS fit l’objet d’une série de contrôles fiscaux et de procédures fiscales, à l’issue desquels elle fut reconnue coupable de fraude fiscale avec récidive, en particulier pour avoir recouru, en 2000-2003, à un montage illégal d’évasion fiscale impliquant la création de sociétés fictives.
Le 15 avril 2004, une procédure judiciaire fut ouverte contre YUKOS concernant l’année fiscale 2000 et il fut interdit à la société de vendre certains actifs en attendant l’issue de l’affaire. Le 26 mai 2004, le tribunal de commerce de Moscou condamna YUKOS à verser un montant total de 99 375 110 548 roubles (RUB), soit environ 2 847 497 802 euros (EUR), en arriérés d’impôts, intérêts et pénalités. Son jugement fut rendu public le 28 mai 2004. YUKOS interjeta appel et la procédure d’appel débuta le 18 juin 2004. Le 29 juin 2004, l’instance d’appel débouta YUKOS, rejetant notamment ses moyens tirés de ce que la procédure aurait présenté des irrégularités et de ce qu’elle n’aurait pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense.
Le 7 juillet 2004, YUKOS forma en vain un pourvoi en cassation contre les décisions du 26 mai et du 29 juin 2004 et, parallèlement, contesta celles-ci par voie de révision devant la Cour suprême de commerce russe. Elle soutenait notamment que les faits retenus contre elle étaient prescrits, excipant de ce que l’article 113 du code des impôts russes n’aurait permis d’imposer des pénalités à un contribuable coupable de fraude que dans un délai de trois ans commençant à courir à compter du premier jour suivant l’année fiscale concernée.
Le présidium de la Cour suprême de commerce (« le présidium ») sollicita l’avis de la Cour constitutionnelle, laquelle confirma, par une décision du 14 juillet 2005, que le délai de prescription de trois ans fixé par l’article 113 devait s’appliquer mais que, en cas d’obstruction au contrôle fiscal par le contribuable, ce délai s’arrêtait dès la production du rapport de contrôle fiscal. Le 4 octobre 2005, sur la base de cette décision, le présidium rejeta le recours de YUKOS au motif que, cette société ayant énergiquement fait obstacle aux contrôles fiscaux en question et le rapport du ministère des Finances pour l’année 2000 lui ayant été signifié le 29 décembre 2003, c’est-à-dire dans le délai de trois ans, il n’y avait pas eu prescription.
En avril 2004, les autorités russes ouvrirent également une procédure de recouvrement, qui se solda par la mise sous séquestre des actifs de YUKOS sis en territoire russe, par le blocage partiel de ses comptes bancaires russes et par la saisie des actions de ses filiales russes.
Le 2 septembre 2004, le ministère des Finances estima que YUKOS avait recouru essentiellement au même montage fiscal en 2001 qu’en 2000. Au motif que la société avait été récemment reconnue coupable d’une infraction similaire, la pénalité imposée fut doublée.
Au total, YUKOS fut condamnée à payer 132 539 253 849,78 RUB (soit environ 3 710 836 129 EUR) pour l’année fiscale 2001; 192 537 006 448,58 RUB (soit environ 4 344 549 434 EUR) pour 2002 ; et 155 140 099 967,37 RUB (soit environ 4 318 143 482 EUR) pour 2003.
YUKOS devait également verser aux huissiers des frais de recouvrement qui s’élevaient à 7 % du total de la dette et dont le paiement ne pouvait être suspendu ou rééchelonné.
YUKOS était tenue de payer toutes ces sommes dans des délais très brefs et elle demanda à plusieurs reprises en vain l’allongement de ces délais.
Le 20 juillet 2004, le ministère de la Justice annonça la vente prochaine par adjudication d’OAO Yuganskneftegaz, la filiale de production principale de YUKOS, donc son actif le plus précieux. Le 19 décembre 2004, 76,79 % des actions de cette filiale furent adjugées aux fins du recouvrement de la dette fiscale de YUKOS. Deux jours plus tard, les huissiers évaluèrent la dette consolidée de YUKOS à 344 222 156 424,22 RUB (soit 9 210 844 560,93 EUR).
YUKOS fut déclarée insolvable le 4 août 2006 et mise en liquidation le 12 novembre 2007.
Recevabilité
La Cour examine si l’affaire est recevable ou non au regard des dispositions de l’article 35 § 2 de la Convention, aux termes duquel elle ne retient aucune requête qui est essentiellement la même qu’une requête déjà soumise à une autre instance internationale et qui ne contient pas de faits nouveaux.
La Cour considère que l’instance introduite à la Cour permanente d’arbitrage de La Haye par les actionnaires majoritaires de YUKOS ainsi que les procédures ouvertes en vertu de traités bilatéraux d’investissement par des groupes d’actionnaires minoritaires de YUKOS ne sont pas « essentiellement les mêmes » que celle en l’espèce. Les demandeurs dans ces procédures arbitrales étaient des actionnaires de YUKOS agissant en leur qualité d’investisseurs, et non YUKOS elle-même, qui était encore alors une entité juridique indépendante. La Cour relève en outre que l’affaire dont elle est aujourd’hui saisie a été introduite et poursuivie par YUKOS pour son propre compte. Dès lors, les parties dans ces procédures arbitrales et en l’espèce sont différentes et les deux cas ne sont pas «essentiellement les mêmes» au sens de l’article 35 § 2 b). La Cour en conclut, par six voix contre une, que rien ne l’empêche d’examiner la présente affaire.
Article 6 §§ 1 et 3 b)
En ce qui concerne la procédure fiscale pour l’année 2000, la Cour constate une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) aux motifs que YUKOS n’avait pas eu suffisamment de temps (quatre jours) pour étudier le dossier (au moins 43 000 pages) en première instance, et que le bref laps de temps (21 jours) écoulé entre la fin de la procédure devant le tribunal de première instance, dont le jugement a été publié le 28 mai 2004, et le début de la procédure d’appel (le 18 juin 2004), réduisant ainsi de neuf jours le délai légal, a nui à la capacité de YUKOS à présenter ses arguments et, plus généralement, à préparer le procès en appel.
En revanche, la Cour ne considère pas que l’action dirigée contre YUKOS fût arbitraire ou injuste; que les tribunaux aient arbitrairement ou injustement restreint le comportement des conseils de YUKOS au cours du procès ; que le tribunal de Moscou ait statué sans avoir étudié le dossier ; ni que l’accès de YUKOS à un pourvoi en cassation ait été injustement limité.
Article 1 du Protocole no 1
Procédure fiscale pour les années 2000-2001
Constatant que la procédure fiscale dirigée contre YUKOS était de nature pénale, la Cour rappelle que la loi seule peut définir une infraction ainsi que la peine concomitante et qu’elle doit être accessible et prévisible. Or la décision du 14 juillet 2005 a modifié les règles régissant le délai de prescription légal en introduisant une exception qui a eu une incidence sur l’issue de la procédure fiscale pour 2000.
C’est sur la base de cette même condamnation fondée sur l’article 122 du code des impôts dans le cadre de la procédure fiscale pour 2000 que YUKOS a également été jugée récidiviste, doublant ainsi les pénalités imposées dans le cadre de la procédure fiscale pour 2001.
La Cour en conclut à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à raison de l’imposition et du calcul des pénalités lors des redressements fiscaux pour 2000-2001 pour deux raisons, en l’occurrence la modification rétroactive des règles régissant le délai de prescription légal et le doublement en conséquence des pénalités dues pour l’année fiscale 2001.
Autres éléments concernant la procédure fiscale (2000-2003)
La Cour constate que, pour le reste, la procédure fiscale pour les années 2000 à 2003 était prévue par la loi, poursuivait un but légitime, à savoir obtenir le paiement d’impôts, et constituait une mesure proportionnée. Les taux des amendes et intérêts n’étaient pas particulièrement élevés et rien ne permet de dire qu’ils aient fait peser sur YUKOS un fardeau singulier ou disproportionné. Aussi la Cour ne constate-t-elle aucune violation de l’article 1 du Protocole no 1 concernant cette procédure pour le surplus.
Procédure de recouvrement
La Cour estime que le recouvrement des dettes fiscales nées des redressements opérés pour les années fiscales 2000 à 2003 a donné lieu à la saisie des actifs de YUKOS, à des frais de recouvrement s’élevant à 7 % du montant total de la dette et à la vente forcée d’OAO Yuganskneftegaz. Ces mesures ont porté atteinte aux droits que YUKOS tire de l’article 1 du Protocole no 1.
Tout au long de la procédure, les mesures prises par les diverses instances intervenues étaient manifestement prévues par la loi et les dispositions légales en question étaient suffisamment précises et claires pour satisfaire aux critères de la Convention.
La Cour constate que YUKOS était l’un des plus gros contribuables de Russie et qu’elle a été soupçonnée puis reconnue coupable de s’être servie d’un montage d’évasion fiscale de 2000 à 2003. Il semble évident que cette société n’avait pas suffisamment de liquidités dans ses comptes bancaires russes pour s’acquitter immédiatement de sa dette fiscale et que, compte tenu de la nature et de l’ampleur de cette dette, aucun tiers n’aurait vraisemblablement accepté de l’aider par l’octroi d’un prêt ou d’une quelconque forme de garantie. Compte tenu de l’ampleur de cette évasion fiscale, des sommes en jeu pour les années 2000 à 2003, du fait que, en droit russe, celles-ci étaient recouvrables presque dès la signification du titre d’exécution en question, et des constats précédents de la Cour concernant les amendes infligées pour les années 2000 à 2001, on peut douter que, au moment où les autorités russes ont décidé de saisir et adjuger OAO Yuganskneftegaz, YUKOS fût solvable au sens de l’article 3 de la loi russe sur l’insolvabilité (faillite), qui donne en principe au débiteur insolvable, pour rembourser sa dette, «trois mois à compter de la date ou le paiement est censé avoir lieu».
Les griefs de YUKOS sont essentiellement axés sur le bref délai de paiement qui lui avait été imparti et sur la célérité du déroulement de l’adjudication.
La Cour considère que les autorités russes n’ont pas minutieusement et explicitement pris en compte, comme elles étaient tenues de le faire, l’ensemble des éléments pertinents du processus de recouvrement. En particulier, aucune des différentes décisions prises par elles ne prévoyait ni n’envisageait de quelque manière que ce soit d’autres modalités de recouvrement. Or il était capital de le faire pour ménager un équilibre entre les intérêts en cause étant donné que, au vu des sommes déjà dues par YUKOS en juillet 2004, il était assez évident que décider en premier lieu d’adjuger OAO Yuganskneftegaz risquait de porter un coup fatal à la capacité de YUKOS à surmonter ses dettes fiscales et à rester en activité.
La Cour admet que les huissiers étaient tenus de suivre la législation russe applicable, ce qui pouvait limiter les modalités de recouvrement possibles. Néanmoins, les huissiers jouissaient encore d’une liberté de choix décisive quant à l’opportunité de la survie ou non de YUKOS. La Cour estime que l’adjudication d’OAO Yuganskneftegaz n’était pas une décision dépourvue de tout sens, compte tenu notamment du montant global de la dette fiscale et des réclamations qui étaient alors ou allaient probablement être formées contre YUKOS. Elle considère toutefois que, avant de décider définitivement de vendre l’actif qui était le seul espoir de survie de YUKOS, les autorités auraient dû très sérieusement envisager d’autres solutions, surtout vu que les actifs de YUKOS en Russie avaient été mis sous séquestre par ordonnance du juge et étaient directement utilisables et YUKOS ne semble pas s’opposer ou s’être opposée à leur vente.
La Cour relève en outre que les frais de recouvrement ont été calculés selon un taux préfix de 7 % que les autorités avaient apparemment refusé de réduire et que YUKOS devait acquitter ces frais avant même de pouvoir rembourser le montant primitif de la dette. Au vu des circonstances de l’espèce, ces frais étaient totalement disproportionnés à ceux qui pouvaient être escomptés ou à ceux réellement engagés. Cette application rigide des textes a grandement contribué à la disparition de YUKOS.
Les autorités ont fait preuve de la même inflexibilité sans faille dans la conduite de la procédure de recouvrement, agissant très promptement et refusant constamment d’accorder à YUKOS les délais supplémentaires demandés par elle. Ce manque de souplesse a lui aussi eu des conséquences globales négatives sur le déroulement de la procédure de recouvrement contre YUKOS.
Compte tenu de la célérité avec laquelle s’est déroulée la procédure de recouvrement, de l’obligation de verser l’intégralité des frais de recouvrement et de l’absence de prise en compte adéquate par les autorités des conséquences de leurs actes, la Cour considère que les autorités russes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les buts légitimes poursuivis et les mesures employées, en violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Article 14
La Cour rappelle que rien dans le dossier ne permet de dire que les instances fiscales ou les juridictions internes étaient globalement au fait des montages fiscaux utilisés par YUKOS en 2000-2003, notamment du recours à des sociétés commerciales enregistrées frauduleusement, ni qu’elles les avaient auparavant considérés comme conformes à la loi. Les autorités ne peuvent donc passer pour avoir toléré passivement ou approuvé activement ces méthodes.
YUKOS n’est pas parvenue à établir que d’autres contribuables russes utilisaient ou continuent d’utiliser des montages fiscaux identiques ou similaires ni qu’elle a été prise pour seule cible. Il a été jugé qu’elle avait employé un montage fiscal extrêmement complexe impliquant notamment l’usage frauduleux de sociétés commerciales enregistrées dans des zones à fiscalité privilégiée en Russie. Il ne s’agissait pas simplement du recours à des zones de ce type, qui pourrait être légal par ailleurs.
La Cour en conclut à l’absence de violation de l’article 14, en combinaison avec l’article 1 du Protocole no 1.
Article 18
La Cour constate que la dette de YUKOS dans le cadre de la procédure de recouvrement avait pour origine des mesures légitimes prises par le gouvernement russe contre l’évasion fiscale à laquelle se livrait cette société.
Relevant notamment que YUKOS dit avoir été poursuivie pour des raisons politiques, la Cour reconnaît que l’affaire a attiré une attention considérable. Cependant, en dehors des violations constatées, rien n’indique que la procédure dirigée contre YUKOS eût connu d’autres problèmes ou défaillances qui lui permettraient de conclure que la Russie a détourné cette procédure pour détruire YUKOS et prendre le contrôle de ses actifs.
La Cour en conclut à l’absence de violation de l’article 18, en combinaison avec l’article 1 du Protocole no 1, eu égard aux griefs tirés de ce que les biens de YUKOS auraient fait l’objet d’une expropriation déguisée et de ce que cette société elle-même aurait été délibérément détruite.
Opinions séparées
Le juge Jebens joint à l’arrêt l’exposé de son opinion partiellement dissidente et le juge Bushev l’exposé de son opinion partiellement dissidente, à laquelle se rallie en partie le juge Hajiyev.
Rafig Aliyev C. Azebaïdjan requête n° 45875/06 du 6 décembre 2011
Durée excessive de la détention d’un homme d’affaires et blocage illégal de ses actifs
Durée de la détention provisoire (article 5 § 3)
La détention provisoire du requérant a duré deux ans et six jours au total. Même si les soupçons raisonnables dont il faisait l’objet au départ ont pu suffire à l’origine à justifier sa détention, au fil du temps, d’autres motifs pertinents auraient dû être avancés par les autorités qui auraient dû prendre en considération la situation personnelle de l’intéressé.
Les décisions de première instance ont à chaque fois évoqué la gravité des infractions dont le requérant était soupçonné et l’éventualité qu’il se soustraie à la justice. Certes, il s’agit là d’éléments pertinents à examiner par les tribunaux pour apprécier la nécessité de maintenir une personne en détention dans l’attente de son procès et de son jugement, mais ils ne sont en soi pas suffisants. Loin d’examiner les circonstances personnelles du requérant et comment celles-ci ont pu évoluer au fil du temps, les tribunaux ont utilisé une formule stéréotypée et n’ont pas vérifié au cours de la procédure si les motifs initiaux sur lesquels ils avaient fondé la décision de mise en détention restaient valables tout au long de la procédure.
Quant à la décision de la cour d’assises prolongeant la détention du requérant, elle a été prise à l’égard de plusieurs suspects collectivement. Dès lors, la cour d’assises a failli à apprécier la situation au cas par cas et à donner des motifs propres à chaque détenu, en violation des garanties de l’article 5 § 3.
Dès lors, la Cour conclut à la violation de cette disposition.
Contrôle de la détention provisoire (article 5 § 4)
Le droit interne donnait au requérant la possibilité de contester les décisions ordonnant et prolongeant sa détention. Il a formé des recours contre toutes ces décisions. Or, s’il a assisté aux débats concernant son premier recours contestant sa mise en détention, il a été absent de toutes les audiences relatives à ses recours ultérieurs par lesquels il a contesté la prolongation de sa détention, son avocat étant seul présent.
Compte tenu de la durée totale de la détention provisoire du requérant et de l’enjeu pour celui-ci, à savoir sa liberté, les juridictions nationales auraient dû veiller à l’entendre en personne et donc à lui donner la possibilité de présenter directement sa situation personnelle et les arguments militant pour sa libération. A défaut, les tribunaux auraient dû s’assurer qu’il bénéficiait de la représentation effective d’un avocat.
Toutefois, si son avocat était présent aux audiences du tribunal, ces audiences étaient purement formelles, et n’étaient pas véritablement contradictoires. De plus, les observations de l’accusation n’ont pas été transmises à l’avocat de la défense, ce qui a privé celui-ci de la possibilité de contester effectivement les raisons invoquées par le parquet pour prolonger la détention provisoire. Les tribunaux n’ont pas même répondu aux moyens spécifiques avancés par le requérant dans ses observations écrites contestant son maintien en détention, alors que ses arguments n’étaient ni hors de propos ni manifestement dépourvus de fondement.
La Cour conclut que les tribunaux azerbaïdjanais ont failli à procéder à un contrôle juridictionnel de la nature et de la portée requises par la Convention, en violation de l’article 5 § 4 de celle-ci.
Droit à la protection des biens (article 1 du Protocole n° 1)
Etant donné que le requérant ne s’est pas au préalable plaint devant les tribunaux nationaux de la perquisition et de la saisie de ses possessions familiales et personnelles, la Cour déclare ce grief irrecevable.
Quant à la mise sous séquestre de ses parts sociales de la Banque de Bakou, la Cour relève que le requérant n’en a pas été privé mais qu’il a été temporairement empêché d’en faire usage et d’en disposer jusqu’à son procès. Le droit azerbaïdjanais de l’époque n’autorisait que la mise sous séquestre des actifs des individus «accusés» d’une infraction, en vue de garantir une éventuelle peine de confiscation imposée à l’issue d’une procédure pénale. Toutefois, au moment où la décision de saisie a été prise, le requérant n’était pas « accusé » puisqu’il n’avait pas été formellement inculpé des infractions spécifiques dont les parts sociales de la banque étaient considérées comme étant le produit. La Cour observe que, certes, il appartient en premier lieu aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’appliquer et d’interpréter le droit interne, et rappelle que son propre pouvoir à cet égard est limité, mais elle relève que ni les tribunaux azerbaïdjanais ni le Gouvernement n’ont expliqué pourquoi et comment les dispositions sur la mise sous séquestre des biens des « accusés » pouvaient s’appliquer au requérant à un moment où celui-ci n’avait pas été inculpé des infractions en question.
En conséquence, la saisie des parts de l’intéressé dans le capital de la Banque de Bakou n’était pas prévue par la loi. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
DRAGHICI c. PORTUGAL du 19 juin 2014 requête 43620/10
Violation de l'article 1 du Protocole 1 : un bien saisi à titre préventif n'est pas rendu à la fin du procès pénal alors qu'une décision pénale ordonnait de le rendre.
30. Le requérant se plaint de ne pas avoir récupéré les biens saisis au moment de la perquisition, alors que le tribunal de Lisbonne avait ordonné, dans son jugement du 10 avril 2007, qu’ils soient restitués lorsque le jugement deviendrait définitif.
31. Le Gouvernement allègue que la saisie et la rétention des biens étaient prévues par la loi et justifiées, eu égard aux exigences de la procédure pénale.
32. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. En particulier, le second paragraphe de l’article 1, s’il reconnaît que les États ont le droit de réglementer l’usage des biens, soumet ce droit à la condition qu’il soit exercé au travers de la mise en vigueur de « lois ». Le principe de légalité présuppose également que les dispositions applicables du droit interne soient suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application (Baklanov c. Russie, no 68443/01, §§ 39-40, 9 juin 2005).
33. La Cour admet que la rétention de preuves matérielles puisse être nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qui constitue un « but légitime » relevant de « l’intérêt général » de la communauté. Toutefois, elle observe qu’il doit aussi y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but poursuivi par les mesures éventuellement appliquées par l’État, y compris celles destinées à contrôler l’usage de la propriété individuelle. Cette exigence s’exprime dans la notion de « juste équilibre » à ménager entre les impératifs de l’intérêt général de la communauté d’une part et les exigences de la protection des droits fondamentaux de l’individu d’autre part (Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 54, 7 juin 2007, Borjonov c. Russie, no 18274/04, § 57, 22 janvier 2009).
34. En l’espèce, la Cour constate que la saisie des biens du requérant avait été ordonnée conformément à l’article 178 § 1 du code de procédure pénale, cette mesure cherchait, non pas à le priver de ses biens, mais seulement à l’empêcher de les utiliser de façon temporaire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. La saisie poursuivait donc un intérêt général, à savoir la bonne administration de la justice.
35. La Cour observe ensuite que, dans son jugement du 10 avril 2007, le tribunal de Lisbonne avait dicté la restitution des biens saisis à leurs propriétaires au moment où le jugement deviendrait définitif. Or, ce n’est que le 14 septembre 2012 que le requérant a été mis en possession de ses biens, soit plus de quatre ans après la clôture de la procédure pénale et plus de deux ans après son expulsion vers la Roumanie. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication à cet égard.
36. La Cour ne parvient pas discerner la moindre raison justifiant la poursuite de la rétention des biens après la clôture de la procédure pénale.
37. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que autorités portugaises n’ont pas ménagé un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et les exigences de la protection du droit du requérant au respect de ses biens. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no1.
LA SAISIE D'UN BIEN QUI SERT A L'INFRATION
Ya?ar c. Roumanie du 26 novembre 2019 requête n° 64863/13
Non violation de l'article 1 du Protocole 1 : La confiscation d’un navire utilisé pour des activités de pêche illégale dans la mer Noire était justifiée
L’affaire concernait la confiscation du navire de M. Yasar, lequel avait été utilisé pour des activités de pêche illégale dans la mer Noire. La Cour constate en particulier que ladite confiscation a constitué une privation de propriété en ce que le navire a finalement été vendu à un particulier et l’argent de la vente versé à l’État. Elle juge toutefois que les juridictions internes ont soigneusement mis en balance les droits en jeu et estimé à juste titre que les exigences de l’intérêt général de prévenir des activités menaçant gravement les ressources biologiques de la mer Noire l’emportaient sur le droit de propriété de M. Yasar.
LES FAITS
Le requérant, Erol Yasar, est un ressortissant turc né en 1971. Il réside à Çayirli (Turquie). Le navire de M. Yasar fut confisqué en 2010 lorsque des poursuites pénales furent engagées contre son capitaine, Kadir Dikmen, qui utilisait ledit navire en vertu d’un accord verbal avec le requérant. M. Dikmen fut déclaré coupable en 2012 à la suite d’une procédure simplifiée au cours de laquelle il avait reconnu, en particulier, avoir pêché sans avoir de permis pour ce navire et avoir utilisé du matériel de pêche sans autorisation. Pendant la procédure, M. Yasar produisit une copie de son titre de propriété et déclara que le navire avait été « pris à son insu dans les eaux territoriales roumaines ». Le jugement devint définitif à l’égard de M. Dikmen, mais l’affaire fut renvoyée pour réexamen relativement à la confiscation. Les juridictions considérèrent que la mesure de confiscation n’avait pas été prise dans le cadre d’une procédure contradictoire en ce que le propriétaire du navire n’avait pas été cité à comparaître dans la procédure dirigée contre M. Dikmen. Au cours de la seconde procédure, M. Yasar fut cité à comparaître et représenté par un avocat de son choix, qui plaida que la confiscation était disproportionnée compte tenu de la valeur importante du navire et de l’absence de tout dommage avéré. Par une décision définitive rendue en 2013, les juridictions conclurent toutefois que M. Yasar savait nécessairement que le navire avait été utilisé pour les infractions en cause compte tenu de la présence à bord de matériel spécifiquement utilisé pour la pêche illégale, dont il avait reconnu qu’il lui appartenait. Elles évoquèrent également la gravité de l’infraction commise au moyen du navire confisqué, ce type d’infraction pouvant porter préjudice aux réserves de poissons protégés dans la mer Noire et provoquant fréquemment des blessures aux dauphins.
Le navire fut finalement vendu à un particulier en 2016 pour un montant d’environ 1 900 euros, sa valeur s’étant dans l’intervalle fortement dépréciée. L’argent de la vente fut versé au Trésor public.
ARTICLE 1 PROTOCOLE 1
Aucune des deux parties ne conteste le fait que la confiscation du navire de M. Yasar a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de ses biens. La Cour considère par ailleurs que ladite confiscation s’analyse en une privation de propriété en ce qu’il s’agit d’une mesure permanente qui a comporté un transfert définitif de propriété en 2016. Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir le droit interne en matière de pêche et d’aquaculture, et elle poursuivait le but légitime de prévenir les activités menaçant gravement les ressources biologiques de la mer Noire, telles que la pêche illégale. La confiscation a donc été ordonnée dans l’intérêt général. La Cour cherche ensuite à déterminer si l’ingérence a ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection du droit de propriété du requérant. Elle observe tout d’abord que M. Yasar a bénéficié d’une possibilité raisonnable de présenter ses arguments devant les autorités nationales. Son affaire a, en particulier, été renvoyée pour réexamen afin que la mesure de confiscation soit prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire. Dans la procédure de réexamen, l’intéressé a été cité à comparaître, il a été représenté par un avocat de son choix et il a eu la possibilité de présenter les moyens de preuve et les arguments qu’il a estimés nécessaires pour sauvegarder ses intérêts. Rien dans le dossier n’indique que les tribunaux roumains ont fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des éléments de preuve. Par ailleurs, les juridictions ont soigneusement mis en balance les droits en jeu, se référant à la gravité de l’infraction commise au moyen du navire et jugeant que la confiscation sous la forme d’un équivalent monétaire serait inappropriée. La confiscation du navire n’a pas non plus imposé une charge exorbitante à M. Yasar : devant les tribunaux celui-ci n’a démontré ni la valeur du navire ni le fait que, comme il l’alléguait, la location dudit navire était sa seule source de revenu. Le navire a finalement été vendu pour un montant de 1 900 EUR environ. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
LA SAISIE D'UN BIEN ACQUIS PAR UN GAIN DÉLICTUEUX
Godlevskaya c. Russie du 7 décembre 2021 requête no 58176/18
Article 1 du Protocole 1 : La saisie-vente des biens de la requérante, en raison de la condamnation de son ex-époux, n’était pas prévue par le droit interne
Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme L’affaire concerne une saisie-vente (????????? ????????? ?? ?????????) des biens immobiliers de la requérante ordonnée judiciairement consécutivement à la condamnation pénale de son ex-époux. La Cour précise que la saisie-vente s’analyse en une ingérence – relevant de la réglementation de l’usage des biens – dans le droit de la requérante au respect de ses biens. Elle rappelle que toute mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit avoir une base légale en droit interne. En l’espèce, elle conclut que cette mesure était dépourvue de base légale et qu’il y a violation de la Convention.
Art 1 P1 • Respect des biens • Illégalité de la saisie-vente sans indemnisation, non encore exécutée, des immeubles de la requérante ordonnée judiciairement par suite de la condamnation pénale de son ex-époux
FAITS
En 1996, la requérante se maria avec G. avec lequel elle conclut un contrat de mariage en 2000. Entre 2011 et 2014, la requérante acheta deux appartements et un local. En 2015, les époux divorcèrent. Entretemps, en 2011, une enquête pénale fut ouverte pour détournement de fonds de l’usine où G. était directeur depuis 2006. En 2015, ce dernier fut mis en examen dans cette affaire. L’année suivante, à la demande de l’usine, qui s’était constituée partie civile, le tribunal autorisa la saisie provisoire des biens immobiliers de la requérante, estimant qu’il y avait des raisons plausibles de croire que lesdits biens avaient été obtenus au moyen d’agissements délictueux de G. Cette décision fut confirmée par la cour régionale. En 2017, G. fut condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour deux faits de détournement de fonds commis entre 2007 et 2009. Notant que les immeubles litigieux avaient été acquis pendant le mariage de G. au nom de la requérante, le tribunal ordonna leur saisie-vente au profit de l’usine. L’appel et le pourvoi formés par la requérante furent rejetés. Cette dernière engagea ensuite trois actions au civil en mainlevée de saisies (???? ?? ???????????? ?? ??????) qui furent également rejetées. En 2020, G. décéda.
Article 1 du Protocole n° 1
La Cour observe que le contrat de mariage plaçant la requérante et G. sous le régime de la séparation des biens n’a été ni contesté, ni annulé, ni résilié, que l’intéressée a acheté les immeubles litigieux et les a fait enregistrer à son nom, et qu’elle en est propriétaire au sens du droit russe. Elle considère donc que ces immeubles sont les « biens » de la requérante au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle estime ensuite qu’une saisie-vente, quoique non encore exécutée, s’analyse en une ingérence – relevant de la réglementation de l’usage des biens – dans le droit de la requérante au respect de ses biens. Elle rappelle aussi que toute mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit avoir une base légale claire en droit interne. Ceci est d’autant plus vrai s’agissant d’une privation définitive et sans indemnisation des biens d’origine licite d’une personne qui n’a été ni pénalement poursuivie ni a fortiori condamnée. Elle note à cet égard que, pour justifier la saisie-vente, les juridictions russes ont invoqué différentes dispositions, à savoir les articles 115 § 3 et 299 § 11 du code de procédure pénale (CPP) et l’article 45 du code de la famille. Elle décide d’examiner successivement chacune de ces dispositions afin de vérifier si le droit interne offrait une base légale répondant aux exigences de la sécurité juridique inhérentes à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. En ce qui concerne l’article 115 § 3 du CPP, elle observe d’emblée que cette disposition régit les seules mesures temporaires de saisie (????????? ??????), et non les saisies-ventes qui emportent la privation définitive des biens concernés (????????? ?????????). Concernant l’article 299 § 1 du CPP, elle constate que celui-ci renferme une liste de « questions » que le tribunal doit trancher lorsqu’il rend un jugement de condamnation ou de relaxe. Si l’alinéa 11 de l’article 299 § 1 oblige le tribunal à se prononcer sur le sort des biens saisis, il ne peut être considéré, en tant que tel, comme constituant une base légale suffisamment claire et prévisible au regard de l’article 1 du Protocole n o 1 pour justifier la saisie-vente. En effet, le Gouvernement n’a jamais soutenu que l’expression « se prononcer sur le sort des biens » puisse être comprise comme autorisant le transfert de propriété des biens. Il ressort également, de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 avril 2019 que l’article 299 CPP ne peut pas servir de base légale à une saisievente de biens appartenant à des tiers aux fins de l’indemnisation de victimes d’un délit pénal. Quant à l’article 45 § 2 du code de la famille, la Cour note qu’il permet de procéder à une saisievente des biens, totale ou partielle, si un jugement de condamnation pénale établit qu’un bien commun aux époux a été acquis ou revalorisé au moyen de fonds provenant de l’activité illicite de l’un des époux. Cet article pouvait donc constituer une base légale pour l’ingérence à deux conditions, cumulatives : 1) la mesure devait viser des biens communs aux époux ; 2) il fallait qu’un jugement de condamnation pénale établisse que ces biens communs avaient été acquis ou revalorisés au moyen de fonds provenant de l’activité délictueuse. Or, il n’a pas été démontré que ces conditions se trouvaient réunies dans le cas de la requérante. En effet, la saisie-vente litigieuse concerne un bien propre de la requérante et non un bien commun aux époux. En outre, les juridictions pénales ont admis que le patrimoine propre de la requérante était suffisant pour lui permettre d’acheter les immeubles litigieux, et elles n’ont jamais établi que les fonds détournés avaient servi à financer ces acquisitions. Dès lors, l’article 45 § 2 du code de la famille ne peut pas constituer une base légale suffisante pour fonder l’ingérence litigieuse en l’espèce. Par conséquent, le Gouvernement n’ayant cité aucune autre disposition susceptible de fonder la saisie-vente relative aux immeubles de la requérante, la Cour conclut que cette mesure était dépourvue de base légale. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.
CEDH
Sur l’existence de biens et d’une ingérence dans le droit de la requérante, et sur la règle applicable
48. La Cour observe que le contrat de mariage plaçant la requérante et G. sous le régime de la séparation des biens n’a été ni contesté, ni annulé, ni résilié, que l’intéressée a acheté les immeubles litigieux et les a fait enregistrer à son nom, et qu’elle en est propriétaire au sens du droit russe. Elle considère donc, sans préjudice de la question distincte de la provenance des fonds qui ont permis ces acquisitions, que ces immeubles sont les « biens » de la requérante au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Une saisie-vente, quoique non encore exécutée, s’analyse en une ingérence – relevant de la réglementation de l’usage des biens – dans le droit de la requérante au respect de ses biens, au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Bokova c. Russie, no 27879/13, § 51, 16 avril 2019). Il convient dès lors de déterminer si cette ingérence répond aux exigences de cette disposition.
b) Sur la légalité de l’ingérence
50. La Cour rappelle que toute mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit avoir une base légale en droit interne (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 292, 28 juin 2018) et ne pas être arbitraire (Vistinš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 69, 25 octobre 2012). La légalité constitue une condition primordiale de la compatibilité avec l’article 1 du Protocole no 1 d’une ingérence dans un droit protégé par cette disposition (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 112, 13 décembre 2016), et implique que les normes de droit interne soient suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application afin de prévenir des atteintes arbitraires de la puissance publique (Lekic c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 95, 11 décembre 2018). À cet égard, même si la Cour ne peut que dans une certaine mesure apprécier les faits et examiner les conclusions des instances internes (Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 116, 15 mars 2018), le principe de légalité lui commande de vérifier si la manière dont les juridictions internes ont appliqué le droit national a produit des effets conformes aux principes de la Convention (Lelas c. Croatie, no 55555/08, § 76, 20 mai 2010, avec les références qui y sont citées).
51. En l’espèce, la mesure contestée n’est pas une confiscation d’armes ou du produit d’une activité criminelle, au sens de l’article 104.1 du code pénal russe (voir OOO Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo c. Russie, no 5738/18, §§ 40-41, 7 avril 2020). La requérante n’a pas non plus été appelée à l’affaire comme défenderesse civile, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été déclarée civilement responsable du préjudice causé par un délit pénal (ibidem, § 46). Enfin, les immeubles litigieux n’ont pas été qualifiés de preuves dans l’affaire pénale, au sens des articles 81 et 82 du CPP (voir OOO KD-Konsalting c. Russie, no 54184/11, §§ 30-32, 29 mai 2018). Ainsi, et les parties ne prétendent d’ailleurs pas le contraire, aucune de ces dispositions ne pouvait constituer une base légale pour l’ingérence.
52. En l’occurrence, pour justifier la mesure contestée – une saisie-vente ordonnée dans le cadre d’un procès pénal aux fins de la réparation du préjudice matériel causé à la victime et partie civile –, les juridictions russes ont invoqué différentes dispositions : les articles 115 § 3 et 299 § 11 du CPP et l’article 45 du code de la famille (paragraphes 15 et 19 ci-dessus).
53. Gardant à l’esprit que la mesure litigieuse constitue une ingérence grave, visant à la privation définitive sans indemnisation de biens d’une personne qui n’a pas été accusée d’avoir commis une infraction ni a fortiori condamnée, la Cour examinera successivement chacune de ces dispositions invoquées afin de vérifier si le droit interne offrait une base légale répondant aux exigences de la sécurité juridique inhérentes à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
54. Tout d’abord, en ce qui concerne l’article 115 § 3 du CPP, elle observe d’emblée que cette disposition régit les seules mesures temporaires de saisie (????????? ??????), et non les saisies-ventes qui emportent la privation définitive des biens concernés (????????? ?????????). Ainsi, elle ne peut souscrire aux conclusions des juridictions russes (voir, en particulier, paragraphe 19 ci-dessus), ni à la thèse du Gouvernement selon laquelle la saisie-vente pouvait être ordonnée sur le même fondement qu’une saisie temporaire. En effet, une telle analogie ne ressort ni du libellé des dispositions légales ni de la jurisprudence interne produite devant la Cour. Il ressort au contraire de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qu’une saisie ordonnée sur le fondement de l’article 115 du CPP n’a qu’un caractère temporaire (paragraphe 31 ci-dessus) et ne peut subsister après le jugement de condamnation ou de relaxe qui est devenu définitif, ainsi que la Cour l’a constaté à plusieurs reprises (voir, dernièrement, par exemple, OOO SK Stroykompleks et autres c. Russie, nos 7896/15 et 48168/17, §§ 56 et 73 in fine, 17 décembre 2019).
55. Ensuite, se tournant vers l’article 299 § 1 du CPP, la Cour constate que celui-ci renferme une liste de « questions » que le tribunal doit trancher lorsqu’il rend un jugement de condamnation ou de relaxe. Si l’alinéa 11 de l’article 299 § 1 oblige le tribunal à se prononcer sur le sort des biens saisis (paragraphe 29 ci-dessus), il ne peut être considéré, en tant que tel, comme constituant une base légale suffisamment claire et prévisible au regard de l’article 1 du Protocole no 1 pour justifier la saisie-vente.
56. En effet, le Gouvernement n’a jamais soutenu que l’expression « se prononcer sur le sort des biens » puisse être comprise comme autorisant le transfert de propriété des biens. Il ressort également, de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 avril 2019 que l’article 299 CPP ne peut pas servir de base légale à une saisie-vente de biens appartenant à des tiers aux fins de l’indemnisation de victimes d’un délit pénal (paragraphe 32 ci-dessus). Par ailleurs, cette disposition n’a pas été retenue par la cour régionale dans l’arrêt d’appel confirmant la condamnation pénale de G. (paragraphes 17-19 ci-dessus). Réitérant qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter le droit interne (par exemple, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 81, 5 avril 2018), la Cour estime qu’en l’espèce elle n’a aucune raison de s’écarter de la lecture de la législation interne par les juridictions nationales.
57. Quant à l’article 45 § 2 du code de la famille, la Cour note qu’il permet de procéder à une saisie-vente des biens, totale ou partielle, si un jugement de condamnation pénale établit qu’un bien commun aux époux a été acquis ou revalorisé au moyen de fonds provenant de l’activité illicite de l’un des époux (paragraphe 35 ci-dessus). Cet article pouvait donc constituer une base légale pour l’ingérence à deux conditions, cumulatives : i) la mesure devait viser des biens communs aux époux ; ii) il fallait qu’un jugement de condamnation pénale établisse que ces biens communs avaient été acquis ou revalorisés au moyen de fonds provenant de l’activité délictueuse. Or, il n’a pas été démontré que ces conditions se trouvaient réunies dans le cas de la requérante.
58. Concernant la première de ces conditions, la Cour relève que la saisie-vente litigieuse concerne un bien propre de la requérante et non un bien commun aux époux. Sur ce point, elle observe que ni les dispositions pertinentes du code civil et du code de la famille ni les exemples de pratique interne fournis par le Gouvernement (paragraphes 33-36 et 39 ci-dessus) ne permettent de conclure à l’inopposabilité à la partie civile au procès pénal de G. du contrat de mariage signé plusieurs années avant les achats immobiliers et les activités illicites en cause.
59. Certes, les biens propres de la requérante pouvaient, conformément à l’article 37 du code de la famille, tomber dans la masse commune s’il était établi en justice que, pendant le mariage, des améliorations considérables y avaient été apportées grâce à des fonds de la communauté ou à des fonds propres à son époux. Toutefois, cette disposition concerne l’apport d’« améliorations considérables » aux biens et non leur acquisition en elle-même, et, à aucun moment dans la présente affaire, cet article 37 n’a été invoqué ni a fortiori appliqué.
60. De surcroît, s’agissant de la seconde condition posée par l’article 45 § 2 du code de la famille – à savoir l’établissement dans le jugement de condamnation pénale de l’acquisition des biens au moyen des fonds détournés par G. –, la Cour observe que les juridictions pénales ont admis que le patrimoine propre de la requérante était suffisant pour lui permettre d’acheter les immeubles litigieux, et qu’elles n’ont jamais établi que les fonds détournés avaient servi à financer ces acquisitions (paragraphes 15 et 18 ci-dessus).
61. Partant, la Cour ne peut considérer que l’article 45 § 2 du code de la famille soit propre à constituer une base légale suffisante pour fonder l’ingérence litigieuse dans la présente affaire.
62. Eu égard à ce qui précède, la position adoptée par la Cour dans l’arrêt Bokova (précité) ne peut être transposée dans le présent cas d’espèce. Dans l’affaire Bokova, la Cour avait estimé, en l’absence d’observations particulières des parties et avant que la Cour constitutionnelle ne livrât son interprétation de l’article 299 du CPP, que cette disposition pouvait constituer une base légale pour une saisie-vente de biens d’une personne tierce à la procédure pénale. Cependant, les circonstances de cette affaire étaient différentes de celles dont la Cour a présentement à connaître. En effet, dans l’affaire Bokova, le bien ayant fait l’objet de la saisie-vente était tombé dans la masse commune car il avait été établi au pénal que ce bien avait bénéficié de certains investissements provenant des activités délictueuses du mari de la requérante, et pouvait dès lors être partiellement aliéné en vertu de l’article 45 § 2 du code de la famille (ibidem, §§ 45 et 53). Or, tel n’est pas le cas dans la présente affaire.
63. En l’espèce, le Gouvernement n’ayant cité aucune autre disposition susceptible de fonder la saisie-vente relative aux immeubles de la requérante, la Cour conclut que cette mesure était dépourvue de base légale (voir, mutatis mutandis, Frizen c. Russie, no 58254/00, §§ 34-37, 24 mars 2005). Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Cette conclusion rend superflu l’examen du respect des autres exigences de cet article et des autres arguments des parties.
Djordjevic c. France du 7 octobre 2021 requête no 15572/17
Irrecevabilité Art 1 du Protocole 1 et article 8 La confiscation d’un immeuble en application d’une peine complémentaire n’est pas une mesure disproportionnée pour lutter contre le crime organisé
L’affaire concerne la confiscation d’un immeuble appartenant au requérant, condamné pour récidive d’association de malfaiteurs, en application d’une peine complémentaire permettant la confiscation générale du patrimoine. La Cour constate que la confiscation a été ordonnée sur une base légale, accessible, précise et prévisible, visant à lutter contre le crime organisé en réprimant la participation à une association de malfaiteurs par une sanction patrimoniale dissuasive. La Cour relève que la confiscation de patrimoines criminels a acquis une place importante, tant dans l’ordre juridique de plusieurs États contractants que sur le plan international et qu’elle est aujourd’hui utilisée en tant que sanction indépendante d’un délit. Eu égard au caractère hautement répréhensible du comportement du requérant et au profit réalisé par l’organisation criminelle qu’il dirigeait, la Cour conclut que la confiscation n’était pas disproportionnée. Enfin, la Cour note que le requérant a pu présenter sa cause de manière adéquate devant trois degrés de juridiction.
FAITS
Le requérant, M. Zlatimir Djordjevic, est un ressortissant serbe né en 1961 et résidant à Bondy. Une information judiciaire ouverte en avril 2010, établit qu’une dizaine de jeunes femmes avaient commis une série de cambriolages en Suisse et en Allemagne entre septembre 2009 et mai 2010. Il fut démontré que ces vols avaient été perpétrés sur les instructions et au profit d’hommes appartenant à une même organisation criminelle, que M. Djordjevic contrôlait depuis la région parisienne. Le 22 novembre 2010, le juge d’instruction ordonna la saisie de deux immeubles d’habitation situés à Bondy. L’immeuble A, acquis en indivision par M. Djordjevic et sa compagne en 1990, et où le couple était domicilié, fut évalué à 350 000 EUR. L’immeuble B, dont M. Djordjevic était l’unique propriétaire depuis 1998, fut estimé à 817 000 EUR. Le 2 avril 2013, M. Djordjevic fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour récidive d’association de malfaiteurs. Par un jugement du 9 mai 2014, le tribunal correctionnel de Colmar le déclara coupable. Il ordonna notamment la confiscation de l’immeuble A. Tenant compte de son état de santé, le tribunal correctionnel ne délivra pas de mandat de dépôt. En appel, M. Djordjevic et sa compagne ne contestèrent que les confiscations qui avaient été ordonnées. Par un arrêt du 6 octobre 2015, la cour d’appel de Colmar infirma la confiscation de l’immeuble A et ordonna la confiscation de l’immeuble B. Leur pourvoi fut rejeté.
Article 1 du Protocole n° 1
La Cour constate que la confiscation a été ordonnée conformément à l’article 450-1 du code pénal. Cette base légale, accessible, précise et prévisible, vise à lutter contre le crime organisé en réprimant la participation à une association de malfaiteurs par une sanction patrimoniale dissuasive. Aux yeux de la Cour, il ne fait pas de doute que la lutte contre le crime organisé est un but d’intérêt général. En ce qui concerne la proportionnalité, la Cour relève que la confiscation de patrimoines criminels a acquis une place importante, tant dans l’ordre juridique de plusieurs États contractants que sur le plan international et qu’elle est aujourd’hui utilisée non seulement comme moyen de preuve, mais aussi en tant que sanction indépendante d’un délit. La Cour a déjà admis qu’une peine de confiscation puisse porter sur une partie du patrimoine, sans que celle-ci ne constitue ni l’objet, ni le moyen ni le produit direct de l’infraction. La Cour souligne que la confiscation litigieuse est venue sanctionner des faits particulièrement graves, commis en récidive légale. La Cour observe en l’espèce, que les juridictions internes n’ont prononcé qu’une confiscation partielle du patrimoine immobilier du requérant, en tenant compte de l’ampleur des profits réalisés par l’organisation criminelle dirigée par le requérant. La Cour note que le requérant a pu présenter sa cause de manière adéquate devant trois degrés de juridiction, dans le cadre d’un procès pénal contradictoire, durant lequel il a été assisté d’un avocat et a pu faire valoir tous ses arguments. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur, en particulier dans le cadre d’une politique visant à combattre des phénomènes criminels, la Cour considère que la confiscation critiquée n’est pas disproportionnée par rapport au but d’intérêt général poursuivi. Cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Article 8
La Cour constate qu’aucun élément ne vient établir que le requérant était domicilié dans l’immeuble confisqué au moment où les juridictions internes ont statué. À l’instar de la cour d’appel, la Cour observe par ailleurs que le requérant est propriétaire d’un autre bien, situé à proximité immédiate du bien confisqué, où il peut héberger ses proches. La Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention. Ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
CEDH
26. Même si elle implique une privation de propriété, la Cour considère que la confiscation critiquée relève du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, notamment, Soun c. Russie, no 31004/02, § 25, 5 février 2009, et Grifhorst c. France, no 28336/02, §§ 85-86, 26 février 2009, et la jurisprudence citée).
27. Elle rappelle par ailleurs que toute ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens doit être prévue par la loi. De plus, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, la Cour reconnaissant aux États une ample marge d’appréciation en pareille matière (voir, parmi beaucoup d’autres, G.I.E.M. S.R.L. et autres, précité, §§ 292-293). En outre, il doit être offert à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de pouvoir contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition (ibidem, § 302).
28. La Cour constate que la confiscation contestée a été ordonnée conformément à l’article 450-1 du code pénal (paragraphe 21 ci-dessus), et que cette base légale était accessible, précise et prévisible.
29. Cette disposition vise à lutter contre le crime organisé en réprimant la participation à une association de malfaiteurs par une sanction patrimoniale dissuasive. Aux yeux de la Cour, il ne fait pas de doute que la lutte contre le crime organisé est un but d’intérêt général.
30. S’agissant de la proportionnalité, la Cour relève à nouveau que la confiscation de patrimoines criminels a acquis une place importante, tant dans l’ordre juridique de plusieurs États contractants que sur le plan international (voir, par exemple, les instruments cités aux paragraphes 16, 18 et 20 ci-dessus) et qu’elle est aujourd’hui utilisée non seulement comme moyen de preuve, mais aussi en tant que sanction indépendante d’un délit (Tas c. Belgique (déc.), no 44614/06, 12 mai 2009, et Aboufadda c. France (déc.), no 28157/10, § 27, 4 novembre 2014).
31. La Cour a déjà admis qu’une peine de confiscation puisse porter sur une partie du patrimoine de la personne condamnée, sans que celle-ci ne constitue ni l’objet, ni le moyen ni le produit direct de l’infraction (Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 53, CEDH 2001-VII, Loriel c. France (déc.), no 63846/09, 21 septembre 2010, et Aboufadda, précitée, §§ 14 et 31-33). À ce titre, la Cour s’attache d’abord au comportement du requérant (Grifhorst, précité, §§ 95, 102 et 105, Tas et Loriel, précitées).
32. En l’espèce, la Cour relève d’abord que les juridictions internes ont estimé que le requérant avait joué un rôle prépondérant dans une organisation criminelle responsable d’un nombre considérable de cambriolages. Elles ont souligné celle-ci avait limité le risque pénal encouru par ses membres en exploitant des jeunes femmes parfois mineures et en opérant de manière transfrontalière et itinérante. Dans le choix des peines à appliquer, les juges internes ont pris en compte la particulière gravité des faits imputables au requérant, ses lourds antécédents judiciaires et son état de santé. La Cour convient du caractère hautement répréhensible du comportement du requérant, que son état de récidive vient renforcer.
33. La Cour constate ensuite que les juges internes se sont efforcés d’évaluer le produit criminel. Ils ont rappelé que l’une des personnes mises en cause avait évalué le produit des seuls vols auxquels avait participé depuis qu’elle avait rejoint l’organisation à 860 000 EUR (paragraphe 4 ci-dessus). La cour d’appel s’est attachée à corroborer ses affirmations par divers éléments issus du dossier pénal. Par ailleurs, elle a relevé que le requérant avait constitué un patrimoine immobilier significatif, sans corrélation avec ses revenus professionnels passés.
34. De plus, la Cour observe que les juridictions internes n’ont prononcé qu’une confiscation partielle de ce patrimoine immobilier. Dans son arrêt du 6 octobre 2015, la cour d’appel a privilégié la confiscation d’un immeuble appartenant au seul requérant, dont la valeur correspondait à 70 % de son patrimoine immobilier en France et où il n’était pas domicilié. La Cour relève que la valeur du bien immobilier détenu par le requérant en Serbie est inconnue et que la valeur des autres biens confisqués dans cette affaire apparaît marginale au vu des intérêts en jeu.
35. La Cour note enfin que le requérant a pu présenter sa cause de manière adéquate devant trois degrés de juridiction, dans le cadre d’un procès pénal contradictoire, durant lequel il a été assisté d’un avocat et a pu faire valoir tous ses arguments.
36. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur, en particulier dans le cadre d’une politique visant à combattre des phénomènes criminels (Yildirim c. Italie (déc.), no 38602/02, § 1, 10 avril 2003, CEDH 2003-IV, et Tas, précitée), la Cour considère que la confiscation critiquée n’est pas disproportionnée par rapport au but d’intérêt général poursuivi. Manifestement mal fondée, cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
37. Le requérant invoque également une atteinte à son domicile et à sa vie privée et familiale.
38. La Cour constate toutefois que le bien confisqué ne correspondait pas au domicile du requérant au moment où les juridictions internes ont statué. Le requérant a constamment déclaré aux autorités internes qu’il résidait dans l’immeuble A et aucun élément ne vient établir qu’il occupait alors le bien confisqué, fusse occasionnellement.
39. La Cour relève de plus que le requérant a également déclaré être domicilié dans l’immeuble A lors de l’introduction de sa requête et, en dernier lieu, dans le pouvoir qu’il a signé le 19 mai 2021. La Cour prend note de la production récente d’un constat d’huissier établi à la demande du requérant le 3 mai 2021, par lequel celui-ci entend démontrer qu’il résiderait désormais dans le bien confisqué et qu’il utiliserait indifféremment les deux habitations. Elle relève pour autant qu’aucun élément ne vient établir que le requérant était domicilié, ou même résidait, dans l’immeuble confisqué au moment où les juridictions internes ont statué.
40. À l’instar de la cour d’appel, la Cour observe par ailleurs que le requérant reste propriétaire d’une maison de grande taille, située à proximité immédiate du bien confisqué, où il peut héberger ses proches.
41. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées devant elle, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention. Manifestement mal fondé, ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Todorov et autres c. Bulgarie du 13 juillet 2021 requêtes n° 50705/11, 11340/12, 26221/12, 71694/12, 44845/15, 17238/16 et 63214/16
Art 1 Protocole 1 Confiscation d'avoirs criminels présumés en vertu de la loi sur les produits du crime
L’affaire concerne la saisie de biens appartenant aux requérants dont on pense qu'ils sont le produit d'un crime. La Cour juge en particulier que, dans trois des affaires, les juridictions internes ont examiné les questions de manière approfondie et mis en balance les droits des requérants et l’intérêt général. Toutefois, dans les cas où elle a constaté une violation, la Cour estime que les juridictions internes n'ont pas réussi à établir un lien entre les biens confisqués et l'activité criminelle ou entre la valeur des biens et la différence entre les revenus et les dépenses constatés. La décision de confiscation était donc disproportionnée. Une quarantaine de requêtes similaires sont pendantes devant la Cour.
FAITS
Les requérants sont 14 ressortissants bulgares qui vivent à divers endroits en Bulgarie et, dans le cas de Zheko Zhekov, à Athènes (Grèce). Dans chaque requête, au moins un requérant a été condamné pour des infractions - parmi lesquelles abattage illégal de bois, privation de liberté, tentative d'extorsion, détournement de fonds aggravé, détention d'armes à feu, vol qualifié, falsification de documents aggravée, détention illégale de stupéfiants et fraude fiscale - par des tribunaux de différentes régions de Bulgarie entre 2000 et 2012.Toutes ces personnes ont été condamnées en vertu de la loi de 2005 sur les produits du crime. Cette loi permet aux autorités de confisquer certains biens considérés comme des produits du crime. Les requérants ont fait l'objet d'une enquête de la Commission pour la découverte des produits du crime, qui a examiné, entre autres, leurs revenus et leurs dépenses au cours de la période concernée. À la suite des demandes de la Commission, certains biens appartenant aux requérants - tels que des biens immobiliers, des entreprises, des véhicules, de l'argent liquide et ainsi de suite - ont été confisqués par l'État. Les tribunaux nationaux ont conclu que les dépenses des requérants au cours de la période examinée avaient largement dépassé leurs revenus légaux. Les tribunaux ont déclaré que l'on pouvait raisonnablement présumer que les autres actifs acquis étaient les produits du crime. Les arguments avancés par certains des requérants selon lesquels les biens étaient le résultat de dons ou de successions ont été rejetés par les tribunaux. Les arguments des requérants selon lesquels il n'y avait aucun lien entre ces biens et la criminalité ont été jugés sans fondement. Ces décisions ont été confirmées par les juridictions supérieures. L'État n'a pas été en mesure de saisir la totalité des biens en question, notamment parce qu'une partie d'entre eux a été revendue.
CEDH
Article 1 du Protocole n° 1 La Cour rappelle qu'en vertu de la Convention, la privation de propriété est soumise à certaines conditions et que les États contractants peuvent contrôler l'utilisation des biens conformément à l'intérêt général. Il n'a pas été contesté que la confiscation constituait une ingérence dans le droit de propriété des requérants. La Cour est convaincue que la confiscation était légale car elle était fondée sur la loi sur les produits du crime. En outre, elle indique que la saisie d'avoirs obtenus par la criminalité est conforme à l'intérêt général, comme c'est le cas en l'espèce. En ce qui concerne la proportionnalité, la Cour réitère qu'un juste équilibre doit être trouvé entre l'intérêt général et la protection des droits fondamentaux d'un individu. Une partie de cet équilibre peut inclure la possibilité de soumettre son cas aux autorités compétentes. La Cour note que le large champ d'application de la loi applicable en l'espèce, tant en ce qui concerne les infractions susceptibles d'engager ses pouvoirs que le temps qui peut s'écouler avant l'engagement d'une procédure, peut présenter des difficultés pour les requérants. Elle précise que de tels problèmes de droit pourraient faire pencher la balance des poursuites en faveur de l'État. Il est donc essentiel que cet avantage soit contrebalancé par, notamment, l'obligation de démontrer certains liens avec une criminalité réelle dans la provenance des biens à confisquer. La Cour déclare qu'elle s'en remet aux juridictions internes pour déterminer si une telle compensation a eu lieu, à moins qu'il ne soit démontré que le raisonnement des juridictions a été arbitraire ou manifestement déraisonnable. Dans les affaires Todorov et autres (requête n° 50705/11), Gaich (n° 11340/12), Barov (n° 26221/12) et Zhekovi (n° 71694/12), la Cour estime qu'il n'y a pas eu d'erreur dans le raisonnement des juridictions. Dans les affaires Todorov et autres (requête n° 50705/11), Gaich (n° 11340/12), Barov (n° 26221/12) et Zhekovi (n° 71694/12), la Cour estime qu'il n'y a pas eu de garanties suffisantes pour parvenir au juste équilibre requis pour garantir les droits des requérants au titre de l'article 1 du Protocole n° 1, notamment l'absence d'examen du lien entre les biens et l'activité criminelle présumée et la détermination par les tribunaux de l'adéquation entre les biens confisqués et la différence entre les dépenses et les revenus des requérants. La confiscation de leurs biens a été disproportionnée, entraînant une violation de la Convention. Toutefois, dans les affaires Rusev (no 44845/15), Katsarov (no 17238/16) et Dimitrov (no 63214/16), la Cour estime que les juridictions internes ont examiné les questions en détail - en particulier leurs dépenses et leurs revenus à l'époque -, ont donné à ces requérants la possibilité de présenter des arguments, ont répondu à ces arguments et ont donné une motivation suffisante. La confiscation des biens des requérants n'a pas été disproportionnée et il n'y a pas eu de violation des droits de la Convention dans ces affaires.
Bokova c. Russie du 16 avril 2019 requête no 27879/13
Violation de l'article 1 du Protocole 1 : Aliénation de la maison de la requérante en raison de la condamnation de son époux : garanties procédurales insuffisantes contre l’arbitraire.
L’affaire concerne la saisie provisoire puis l’aliénation définitive d’une maison appartenant à Mme Bokova – acquise par héritage en 2003 – par la juridiction pénale ayant jugé puis condamné son mari pour escroquerie. Le tribunal, qui statua sur la responsabilité pénale du mari de Mme Bokova, estima que la maison de cette dernière avait fait l’objet de certains travaux et aménagements pendant la période d’activité illicite de son mari, et en ordonna l’aliénation afin d’indemniser la victime. Ni ce tribunal, ni d’autres juridictions saisies par Mme Bokova, ne déterminèrent le montant des investissements dont la maison avait bénéficié pendant l’activité illicite. La Cour juge que Mme Bokova, qui avait hérité de la maison avant le début de l’activité criminelle imputée à son mari, pouvait légitimement prétendre à la conservation d’au moins une partie de la valeur de ce bien, à savoir celle étrangère aux investissements provenant d’activités illicites. La Cour juge aussi que la mesure d’aliénation litigieuse n’a pas été entourée des garanties procédurales suffisantes contre l’arbitraire, aucune des juridictions internes n’ayant examiné la question du montant des fonds de provenance illicite investis dans la maison, ni offert à Mme Bokova une possibilité adéquate d’exposer sa cause et de défendre ses droits à l’égard d’une partie de ce bien
a) Sur l’existence d’une ingérence et sur la règle applicable
50. La Cour observe que la maison litigieuse a fait l’objet d’abord d’une mesure temporaire de saisie, puis d’une mesure définitive d’aliénation conformément au jugement de condamnation du mari de la requérante. Compte tenu du fait qu’une saisie ne peut pas subsister après un jugement définitif de condamnation (paragraphe 28 ci-dessus), la Cour estime qu’en l’espèce l’ingérence est constituée par l’ordonnance d’aliénation de la maison. Cette mesure, bien qu’ordonnée au profit d’une personne privée, peut être assimilée, pour les besoins de l’analyse par la Cour, à une mesure de future confiscation de biens illégalement acquis.
51. En ce qui concerne la règle applicable, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la confiscation, quoiqu’elle entraîne une privation de propriété, constitue néanmoins une mesure de réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Gogitidze et autres c. Géorgie, no 36862/05, § 94, 12 mai 2015, avec les références qui y sont citées). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche dans la présente affaire.
Il reste à déterminer si, en l’espèce, cette mesure était conforme à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
b) Sur le respect de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
52. La Cour rappelle que, pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, une ingérence dans l’exercice du droit de propriété doit être opérée « pour cause d’utilité publique » et « dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux de droit international ». L’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, par exemple, S.C. Service Benz Com S.R.L. c. Roumanie, no 58045/11, § 28, 4 juillet 2017, avec les références qui y sont citées). S’agissant d’apprécier la proportionnalité d’une mesure d’ingérence, il convient de prendre en compte la procédure qui s’est déroulée dans l’ordre juridique interne pour évaluer si celle-ci offrait au requérant, compte tenu de la gravité de la mesure susceptible d’être imposée, une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes, en alléguant, le cas échéant, une violation de la légalité ou l’existence de comportements arbitraires ou déraisonnables (ibidem, § 29).
53. En l’espèce, la Cour observe que l’aliénation de la maison a été ordonnée par le tribunal du district Nikoulinski sur le fondement de l’article 299 § 1, 10) et 11), du CPP (paragraphe 30 ci-dessus). Elle admet que ces dispositions constituaient la base légale de l’ingérence en cause et que cette ingérence visait un but légitime de répression des infractions pénales et de sauvegarde des droits des victimes et des parties civiles.
54. En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, la Cour rappelle que celle-ci a été prononcée dans le cadre de la procédure pénale qui fut menée contre le mari de la requérante. Pour ordonner l’aliénation de toute la maison, le tribunal a considéré que cette dernière avait bénéficié d’améliorations financées par certains fonds d’origine illicite apportés par B., mais il n’a pas examiné la question du montant de ces investissements. Certes, en vertu de l’article 309 du CPP et de l’article 45 du code de la famille, le tribunal n’était pas obligé de procéder lui-même aux calculs nécessaires, mais il pouvait renvoyer cette question devant les juridictions civiles (paragraphe 31 ci-dessus) en leur laissant le soin de décider si la maison entrait ou pas dans la masse commune, de déterminer, au besoin en recourant à une expertise, quels étaient les montants des investissements qui y avaient été apportés pendant l’activité illicite de B. et d’en soustraire la part étrangère à ces investissements, laquelle revenait uniquement à la requérante. Le tribunal ne l’a toutefois pas fait, et la requérante n’avait aucun moyen de l’y contraindre.
55. Par ailleurs, la Cour a déjà dit que, en principe, les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée (Silickiene c. Lituanie, no 20496/02, § 50, 10 avril 2012). Or, en l’espèce, la requérante n’a eu qu’un statut de témoin dans la procédure pénale concernant son mari et elle n’a pas joui de droits procéduraux qui lui auraient permis de combattre la thèse selon laquelle la maison avait été construite et aménagée grâce à des fonds d’origine illicite apportés par son mari (comparer avec Denisova et Moiseyeva c. Russie, no 16903/03, § 60, 1er avril 2010).
56. La Cour note que la requérante s’est pourvue en cassation contre le jugement de condamnation, mais la juridiction de cassation n’a pas répondu à ses griefs ni examiné la question du montant des investissements d’origine illicite réalisés dans la maison (voir, a contrario, par exemple, Aboufadda c. France (déc.), no 28457/10, § 29, avec les références qui y sont citées). Cette juridiction, comme du reste le juge unique qui a refusé de transmettre le pourvoi de la requérante pour examen par le présidium et les juridictions pénales qui ont ordonné la saisie sur le fondement de l’article 115 du CPP, se sont limités à indiquer que la requérante pouvait faire valoir ses droits en introduisant une action en mainlevée de la saisie devant les juridictions civiles (comparer les paragraphes 12, 13, 22 et 23 ci-dessus).
57. La Cour relève que la requérante a effectivement exercé cette action le 22 mai 2012, à un moment où la saisie ordonnée sur le fondement de l’article 115 du CPP était en vigueur, puisque le jugement de condamnation n’avait pas encore été rendu. Le tribunal de Dmitrov a examiné l’action sur le fond et a ordonné la mainlevée de la saisie. Or la cour de Moscou, statuant en appel, a annulé ce jugement, estimant que les juridictions civiles n’étaient pas compétentes pour lever la saisie ordonnée sur le fondement de l’article 115 du CPP. La juridiction de cassation a confirmé à son tour l’incompétence des juridictions civiles pour examiner le grief de la requérante, mais sur un fondement différent. En effet, elle s’est basée sur le jugement de condamnation ayant établi que la maison avait bénéficié de certains investissements d’origine criminelle. Ainsi, l’action en mainlevée intentée par la requérante n’a pas été examinée sur le fond.
58. Il s’ensuit qu’aucune des juridictions internes n’a examiné la question du montant des fonds de provenance illicite investis dans la maison ni offert à la requérante une possibilité adéquate d’exposer sa cause et de défendre ses droits à l’égard d’une part de ce bien (voir, mutatis mutandis, Denisova et Moiseyeva c. Russie, no 16903/03, §§ 60-64, 1er avril 2010, ainsi que Rummi c. Estonie, no 63362/09, §§ 83-85 et 108, 15 janvier 2015).
59. La Cour conclut que la mesure d’aliénation litigieuse n’a donc pas été entourée des garanties procédurales suffisantes contre l’arbitraire requises par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
Goguitidzé et autres c. Géorgie arrêt du 12 mai 2015 requête no 36862/05
Non violation de l'article 1 du Procotocole 1 : Confiscation de biens acquis par le fruit de la corruption : non-violation du droit des requérants au respect de leurs biens.
La Cour observe d’abord que l’ordonnance de confiscation concernant les biens mobiliers et immobiliers des requérants a porté atteinte au droit de ceux-ci au respect de leurs biens.
La confiscation des biens a été ordonnée sur le fondement des dispositions pertinentes du code de procédure pénale et du code de procédure administrative. Concernant l’argument des requérants selon lequel l’application rétroactive dans leur affaire de la modification législative du 13 février 2004 était illégale, la Cour observe que cet amendement n’a fait que réglementer à nouveau les aspects patrimoniaux des normes juridiques existantes en matière de lutte contre la corruption – dès 1997 la loi sur les conflits d’intérêts et la corruption dans le service public traitait déjà de questions telles que les infractions de corruption. En outre, les États membres peuvent réglementer l’usage des biens par de nouvelles dispositions à portée rétroactive réglementant d’une autre façon des situations factuelles continues ou des relations juridiques. La confiscation des biens des requérants était donc légale.
En ce qui concerne la légitimité du but poursuivi par la mesure de confiscation, la Cour observe que cette mesure constitue une partie essentielle d’un ensemble législatif plus large visant à intensifier la lutte contre la corruption dans le service public. L’application de cette mesure était conforme à l’intérêt général qu’il y a à veiller à ce que les requérants ne puissent pas bénéficier des biens en question au détriment de la collectivité.
La Cour examine ensuite la question de la proportionnalité de l’ingérence et le point de savoir si un juste équilibre a ou non été ménagé entre les moyens employés pour la confiscation des biens des requérants et l’intérêt général à la lutte contre la corruption dans le service public.
La Cour se penche d’abord sur la question de savoir si la procédure de confiscation était arbitraire.
Elle note que la modification du 13 février 2004 a été adoptée à la suite de rapports d’organes internationaux spécialisés qui ont constaté les niveaux alarmants de corruption en Géorgie.
Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL), Groupe d’États contre la corruption (GRECO) et Réseau anticorruption de l’OCDE pour les économies de transition.
La Cour souligne sur ce point que les nouvelles mesures législatives ont largement contribué à faire prendre à la Géorgie la voie de la lutte contre la corruption. Comme dans des affaires antérieures similaires, elle considère, dans le cas d’espèce, qu’il n’était pas contraire à l’article 1 du Protocole no 1 d’ordonner la confiscation des biens des requérants sur la base d’une forte probabilité qu’ils soient d’origine illicite, d’autant que les propriétaires des biens n’avaient pas prouvé le contraire. Par conséquent, la Cour estime, à l’instar de la Cour constitutionnelle de Géorgie, que la procédure de confiscation administrative conduite dans l’affaire des requérants ne peut passer pour arbitraire, considérant en particulier que les États membres doivent disposer d’une ample marge d’appréciation dans la façon dont ils traitent le problème des produits du crime.
La Cour examine ensuite l’argument des requérants selon lequel les juridictions internes ont fait preuve d’arbitraire. Elle note que Sergo et Aleksandre Goguitidzé n’ont pas comparu devant la Cour suprême adjare ; quant à Anzor Goguitidzé, certains de ses arguments et éléments de preuve ont abouti au retrait de biens de la liste de confiscation. En ce qui concerne la procédure de cassation, les requérants n’ont pas allégué devant la Cour suprême de Géorgie que la procédure a été marquée par un manque d’équité. En outre, ce n’est qu’après avoir procédé à un examen approfondi des éléments de preuve et de la situation financière des requérants que les juridictions internes ont confirmé l’existence d’un décalage considérable entre les revenus des intéressés et leur fortune et ont pris la décision de confiscation. Dès lors, on ne saurait affirmer que les requérants ont été privés d’une occasion adéquate d’exposer leur cause ou que les conclusions des juridictions internes étaient manifestement entachées d’arbitraire. Par conséquent, la Cour estime qu’un juste équilibre a été ménagé entre les moyens employés pour la confiscation des biens des requérants et l’intérêt général à la lutte contre la corruption dans le service public. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Articles 6 §§ 1 et 2
La cour rejette pour défaut manifeste de fondement le grief des requérants tiré de l’article 6 § 1, considérant qu’ils ont eux-mêmes choisi de renoncer à leur droit de participer à la procédure et qu’il n’y avait rien d’arbitraire à attendre d’eux qu’ils s’acquittent de leur partie de la charge de la preuve en repoussant les soupçons fondés du procureur.
La Cour rejette également le grief tiré par Sergo Goguitidzé de l’article 6 § 2, cette disposition n’étant pas applicable à la confiscation de biens ordonnée à l’issue d’une procédure civile (étant donné que la mesure n’était pas punitive mais qu’elle revêtait un caractère préventif et/ou indemnitaire).
Décision Aboufadda c. France du 27 novembre 2014 requête no 28457/10
Non violation de l'article 8 de la Convention et 1 du Protocole 1 La confiscation d’une maison de famille, financée par le trafic de stupéfiants était justifiée.
Article 1 du Protocole no 1
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 prévoit spécialement le droit pour les États de « mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement de l’impôt ou d’autres contributions ou des amendes ». Elle recherche si, en l’espèce, la confiscation de bien, prévue par le code pénal dans le cas de délits de trafic de stupéfiants, était une mesure proportionnée au but d’intérêt général que représente la lutte contre le recel et le blanchiment.
La mise en oeuvre de cette mesure a certes eu des conséquences importantes sur le patrimoine des requérants. Néanmoins, la Cour rappelle notamment que la confiscation de patrimoines criminels a acquis une place importante, tant dans l’ordre juridique de plusieurs États membres que sur le plan international, avec par exemple la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
La Cour souligne ensuite que les époux Aboufadda avaient la possibilité d’échapper à une condamnation en établissant l’origine licite de leurs ressources et biens. Les juridictions françaises, après avoir constaté que le train de vie des requérants était sans rapport avec les revenus qu’ils déclaraient, ont dûment examiné leurs allégations, et notamment celle selon laquelle leurs ressources provenaient d’un héritage et de la vente d’un terrain au Maroc, constatant ensuite qu’ils n’apportaient pas la preuve du transfert des fonds correspondants en France. En outre, la Cour ne voit rien d’excessif dans la conclusion de la cour d’appel de Colmar selon laquelle « l’essentiel » du patrimoine des époux Aboufadda provenait des fruits du trafic de stupéfiants auquel se livrait leur fils (seules les ressources postérieures à 2006 n’étaient pas en cause).
Par ailleurs, elle voit dans la décision des juridictions françaises de confisquer la maison dans son intégralité à titre de peine, l’expression d’une volonté légitime de sanctionner sévèrement des faits graves dont les requérants s’étaient rendus coupables, qui s’apparentaient à du recel de délit, et qui, de surcroît, s’inscrivaient dans le contexte d’un trafic de stupéfiants d’une grande ampleur au niveau local. Étant donné les ravages de la drogue, la Cour conçoit que les autorités des États parties fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau.
Ces éléments, ainsi que l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposent les États pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, conduisent la Cour à considérer que l’atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens n’a pas été disproportionnée par rapport au but d’intérêt général que représente la lutte contre le trafic de stupéfiants. Par conséquent, elle rejette ce grief pour défaut manifeste de fondement.
Article 8
La Cour constate que le bien confisqué était le domicile familial des requérants. Cette mesure, qui les a contraints à déménager, s’analyse donc en une ingérence d’une autorité publique dans
l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile.
Pareille ingérence méconnaît l’article 8, sauf si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou des buts légitimes prévus par l’article 8 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre. Pour ce qui est de la première condition, la Cour rappelle que la confiscation en question était prévue par le code pénal. Deuxièmement, l’ingérence litigieuse tendait à « la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales » au sens de l’article 8 puisqu’elle visait à lutter contre le trafic de stupéfiants et à le prévenir en dissuadant le recel et le blanchiment. Pour ce qui est de la troisième condition, la Cour renvoie tout d’abord à ses conclusions concernant le grief des requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. Elle constate ensuite que les autorités compétentes ont dûment pris en compte la situation des requérants au regard de l’article 8 en les autorisant à rester dans leur domicile jusqu’à ce qu’ils aient été en mesure de s’installer dans un autre lieu, soit durant plus d’un an et six mois après la fin de la procédure interne.
Par conséquent, même si la marge d’appréciation dont disposent les États est plus restreinte dans le contexte de l’application de l’article 8 que de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête et à son rejet.
Arrêt Silickiené C. Lituanie du 10 avril 2012 requête n° 20496/02
La confiscation de biens acquis grâce à des gains d’origine délictueuse n’a pas porté atteinte à la Convention
Article 1 du Protocole no 1
Fondée sur l’article 72 du code pénal, la confiscation des biens de la requérante était régulière. Elle portait sur des biens illicitement acquis par l’association de malfaiteurs dirigée par le mari de l’intéressée et poursuivait un but légitime consistant à empêcher celle-ci de profiter de gains d’origine délictueuse au détriment de la société.
La Cour relève en outre que la requérante a elle-même reçu des sommes provenant de la vente de marchandises de contrebande. Dans ces conditions, l’intéressée savait forcément que les sommes ayant servi à l’acquisition des biens confisqués ne pouvaient provenir que des gains tirés des activités de l’association de malfaiteurs. En outre, la requérante a été reconnue coupable de détournement de fonds et de falsification de documents.
De surcroît, la question de la confiscation a été examinée par trois juridictions internes distinctes, qui ont toutes constaté que les biens confisqués avaient été acquis grâce aux gains illicites générés par les activités de l’association de malfaiteurs. Enfin, les activités en question présentaient un caractère massif et systématique, 22 actes de contrebande ayant été recensés. En pareilles circonstances, la confiscation litigieuse apparaissait comme une mesure essentielle à la lutte contre la criminalité organisée.
Au vu de ce qui précède, et eu égard à la latitude (ou marge d’appréciation) dont jouissent les Etats membres pour mener des politiques de lutte contre les infractions graves, la Cour conclut que la confiscation litigieuse n’a pas porté atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
JURISPRUDENCE INTERNE FRANÇAISE
UN BIEN CORPOREL NE PEUT PAS ÊTRE SAISI PAR LE JUGE PENAL MÊME S'IL S'AGIT DE VÊTEMENTS DE HAUTE COUTURE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE, arrêt du 7 août 2019 Pourvoi n° 18-87.174 Cassation sans renvoi
Vu les articles 94, 97 et 706-141 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte du troisième de ces textes que les dispositions des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale s’appliquent aux saisies réalisées en application de ce code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien ;
Que, selon les deux premiers, avec l’accord du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire a le pouvoir de saisir les biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ;
Qu’il s’en déduit que la saisie en valeur
des biens meubles corporels, qui ne sont pas visés à l’article
706-141 du code de procédure pénale, ne peut être effectuée
que sur le fondement des articles 94 et 97 du même code ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance attaquée, l’arrêt
retient notamment que l’article 131-21, alinéa 9, du code
pénal prévoit que la confiscation en valeur peut être
exécutée sur tous les biens, quelle qu’en soit la nature,
appartenant au condamné ou sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, qu’il
découle de ce texte que ce qui peut être confisqué peut être
saisi et qu’en l’espèce, le juge d’instruction a
expressément visé ce texte pour justifier de la saisie pénale
d’objets mobiliers et effets vestimentaires garnissant le
logement de la mise en examen, dont la valeur, après évaluation
par un professionnel, équivaut à une partie du produit de l’infraction
et constitue une partie du patrimoine de la personne mise en
examen ; que les juges ajoutent que cette saisie a eu lieu
au cours d’une perquisition patrimoniale dans le respect de
l’article 97 du code de procédure pénale prévoyant qu’avec
l’accord du magistrat instructeur l’officier de police
judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et
données informatiques utiles à la manifestation de la vérité,
ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article
131-21 du code de procédure pénale et qu’elle a ensuite
donné lieu, conformément à l’article 706-148 du code de
procédure pénale, à une confirmation par ordonnance faisant
suite aux réquisitions en ce sens du procureur de la République ;
qu’ils en concluent que, les conditions légales étant
réunies et les formalités ayant été respectées, la saisie
pénale décidée par le magistrat instructeur est bien-fondée ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les biens objet de la saisie étaient des biens meubles corporels, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
L'AMENDE DOIT ÊTRE PROPORTIONNEE AUX FAITS, A LA SITUATION DU PREVENU ET A SES REVENUS
Cour de Cassation chambre criminelle du 15 mai 2019 pourvoi n° 18-84.494 cassation partielle
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des articles 130-1, 132-1 et 132-20 alinéa 2 du code pénal, ainsi que des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner M. X... à 10 000 euros d’amende, l’arrêt retient, après avoir fait état des antécédents judiciaires de l’intéressé et relevé que ses ressources s’élèvent à 2 000 euros par mois, qu’il y a lieu d’ajouter cette peine à la confiscation ordonnée ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’expliquer sur la gravité des faits, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
La saisie des bien incorporels par le juge d'instruction pour lutter contre la fraude fiscale est conforme à la constitution
Conseil Constitutionnel Décision n° 2016-583/584/585/586 QPC du 14 octobre 2016
Société Finestim SAS et autre [Saisie spéciale des biens ou droits mobiliers incorporels]
Le Conseil
constitutionnel a été saisi le 20 juillet 2016 par la Cour de
cassation de quatre questions prioritaires de constitutionnalité
(QPC) posées pour les sociétés Finestim SAS et autre relatives
à la conformité aux droits et libertés que la Constitution
garantit de l'article 706-153 du code de procédure pénale (CPP).
Les dispositions contestées fixent les règles régissant la
procédure de saisie pénale spéciale des biens ou droits
mobiliers incorporels. Elles désignent les juges compétents
pour autoriser ou ordonner la saisie, déterminent les voies de
recours devant la chambre de l'instruction ainsi que les
modalités de mise à disposition du dossier de la procédure.
Le juge des libertés et de la détention, dans le cadre d'une
enquête de flagrance ou préliminaire, et le juge d'instruction,
dans le cadre d'une information, peuvent autoriser, pour le
premier, et ordonner, pour le second, la saisie de biens ou
droits incorporels. L'ordonnance de saisie peut être contestée
devant la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à
compter de sa notification.
Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à
la Constitution après avoir relevé les points suivants.
En premier lieu, si la mesure de saisie a pour effet de rendre
indisponibles les biens ou droits incorporels saisis, elle est
ordonnée par un magistrat du siège et ne peut porter que sur
des biens ou droits dont la confiscation peut être prononcée à
titre de peine complémentaire en cas de condamnation pénale.
En deuxième lieu, toute personne qui prétend avoir un droit sur
un bien placé sous main de justice peut en solliciter la
restitution par requête auprès, selon le cas, du procureur de
la République, du procureur général ou du juge d'instruction.
En troisième lieu, l'ordonnance du juge des libertés et de la
détention ou du juge d'instruction autorisant ou prononçant la
saisie est notifiée au propriétaire du bien ou du droit saisi
et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou
sur ce droit qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction.
Ces personnes, qu'elles aient fait appel ou non, peuvent par
ailleurs être entendues par la chambre de l'instruction avant
que celle-ci ne statue. Elles ne sont donc pas privées de la
possibilité de faire valoir leurs observations et de contester
la légalité de la mesure devant un juge.
En quatrième lieu, en ne prévoyant pas de débat contradictoire
devant le juge ayant autorisé ou ordonné la saisie et en ne
conférant pas d'effet suspensif à l'appel devant la chambre de
l'instruction, le législateur a entendu éviter que le
propriétaire du bien ou du droit concerné puisse mettre à
profit les délais consécutifs à ces procédures pour faire
échec à la saisie par des manœuvres. Ce faisant, il a
assuré le caractère effectif de la saisie et, ainsi, celui de
la peine de confiscation.
En dernier lieu, le juge devant toujours statuer dans un délai
raisonnable, l'absence d'un délai déterminé imposé à la
chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance
autorisant ou prononçant la saisie ne saurait constituer une
atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature
à priver de garanties légales la protection constitutionnelle
du droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 juillet 2016 par la Cour de
cassation (chambre criminelle, arrêts nos 4003 et 4005 du 12
juillet 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1
de la Constitution, de deux questions prioritaires de
constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour la
société Finestim SAS par Me Didier Bouthors, avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées
au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos
2016-583 QPC et 2016-584 QPC.
Il a également été saisi le même jour par la Cour de
cassation (chambre criminelle, arrêts nos 4004 et 4006 du 12
juillet 2016), de deux questions prioritaires de
constitutionnalité posées pour la société Art Courtage France
SAS, par Me Bouthors. Elles ont été enregistrées sous les nos
2016-585 QPC et 2016-586 QPC.
Ces questions sont relatives à la conformité aux droits et
libertés que la Constitution garantit de l'article 706-153 du
code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre
la fraude fiscale et la grande délinquance économique et
financière.
Au vu des textes
suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte
contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et
financière ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie
devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires
de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les sociétés requérantes
par Me Bouthors, enregistrées les 11 et 26 août 2016 ;
- les observations présentées pour M. Laurent AUMONIER et
autres, parties en défense, par Me Matthias Pujos, avocat au
barreau de Paris, enregistrées les 3 et 22 août 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre,
enregistrées le 11 août 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Bouthors, pour les sociétés
requérantes, Me Pujos, pour les parties en défense, et M.
Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience
publique du 4 octobre 2016;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre les quatre questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. L'article 706-153
du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de
la loi du 6 décembre 2013 mentionnée ci-dessus, prévoit : «
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête
préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi
par requête du procureur de la République, peut autoriser par
ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des
biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par
l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au
cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes
conditions.
« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est
notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du
droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur
ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre
de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un
délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans
ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la
procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne
sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent
néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans
toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la
procédure »
3. Selon les sociétés requérantes, ces dispositions portent atteinte au droit de propriété, dès lors que la saisie de biens ou droits incorporels qu'elles instituent peut être ordonnée sur un soupçon et se prolonger jusqu'au jugement. Ces dispositions méconnaîtraient également le droit à un recours juridictionnel effectif dans la mesure où la décision de saisie n'est pas précédée d'un débat contradictoire, l'appel de cette décision n'est pas assorti d'un effet suspensif et aucun délai déterminé n'est imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur cet appel.
4. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
5. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire.
6. En application de l'article 706-153 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, et le juge d'instruction, dans le cadre d'une information, peuvent autoriser pour le premier et ordonner pour le second la saisie de biens ou droits incorporels. L'ordonnance de saisie peut être contestée devant la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
7. En premier lieu, si la mesure de saisie prévue par les dispositions contestées a pour effet de rendre indisponibles les biens ou droits incorporels saisis, elle est ordonnée par un magistrat du siège et ne peut porter que sur des biens ou droits dont la confiscation peut être prononcée à titre de peine complémentaire en cas de condamnation pénale.
8. En deuxième lieu, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut en solliciter la restitution par requête auprès, selon le cas, du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction.
9. En troisième lieu, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction autorisant ou prononçant la saisie est notifiée au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction. Ces personnes, qu'elles aient fait appel ou non, peuvent par ailleurs être entendues par la chambre de l'instruction avant que celle-ci ne statue. Elles ne sont donc pas privées de la possibilité de faire valoir leurs observations et de contester la légalité de la mesure devant un juge.
10. En quatrième lieu, en ne prévoyant pas de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge d'instruction et en ne conférant pas d'effet suspensif à l'appel devant la chambre de l'instruction, le législateur a entendu éviter que le propriétaire du bien ou du droit visé par la saisie puisse mettre à profit les délais consécutifs à ces procédures pour faire échec à la saisie par des manœuvres. Ce faisant, il a assuré le caractère effectif de la saisie et, ainsi, celui de la peine de confiscation.
11. En dernier lieu, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l'absence d'un délai déterminé imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance prise par un juge autorisant la saisie ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.
12. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences découlant des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration de 1789. Les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du droit de propriété doivent donc être écartés. Par conséquent, les dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Les dispositions de l'article 706-153 du code de
procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi n°
2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et
financière sont conformes à la Constitution.
Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de
la République française et notifiée dans les conditions
prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
susvisée
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
LES SAISIES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION EST CONFORME AU DROIT INTERNE
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 23 mai 2013 requête n° 12-87473 cassation
Vu les articles
131-21 du code pénal et 706-148 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que la saisie, à titre
conservatoire, des biens de la personne susceptible d'être mise
en examen ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne
foi, des biens dont elle a la libre disposition, peut être
autorisée, au cours de l'instruction, lorsque la loi qui
réprime le crime ou le délit poursuivi prévoit la confiscation
;
Attendu que, pour infirmer les ordonnances du juge d'instruction
ayant ordonné la saisie de la créance constituée, au profit de
l'indivision X...à hauteur de 3 982 000 euros sur la société
Marienthal ainsi que la restitution du passif exigible de cette
société, exception faite des avances en compte courant
consenties par M. Guy X..., l'arrêt énonce que la société est
seule propriétaire du produit de la cession d'une partie de ses
actifs immobiliers ; que les juges ajoutent que rien ne permet de
considérer que ce produit pourrait faire l'objet d'une décision
des actionnaires, précipitée ou clandestine, de distribution,
au titre d'un hypothétique bénéfice ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les héritiers
indivisaires susceptibles d'être mis en examen du chef de
blanchiment, qui détiennent 99, 5 % des parts de la société
civile immobilière, ont le pouvoir de décider de l'affectation
de l'actif net social résultant de la vente de l'immeuble de
cette société, de sorte qu'ils ont la libre disposition de cet
élément d'actif, au sens des articles susvisés, dans leur
rédaction, issue de la loi du 27 mars 2012, la chambre de l'instruction
a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé
LE JUGE DES LIBERTES N'EST COMPETENT POUR SAISIR QUE DURANT L'INSTRUCTION
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 8 avril 2021, pourvoi n° 20-85.474 Cassation sans renvoi
Vu l’article 706-150 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ce texte qu’au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal.
9. Pour écarter le moyen pris de la nullité des ordonnances de saisies tiré de ce qu’à la date où elles ont été rendues l’enquête n’était plus en cours, l’arrêt retient qu’il appartenait au juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le parquet dans les temps de l’enquête, de statuer sur la demande qui lui était faite.
10. Les juges ajoutent que le fait que l’enquête ait été clôturée le 21 novembre 2019 ne peut dans ces conditions rendre les décisions irrégulières, les possibilités de recours restant par ailleurs ouvertes aux intéressés dans un délai de dix jours à compter de leur notification.
11. En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’à la date des ordonnances critiquées l’enquête était terminée, en sorte que le juge des libertés et de la détention n’était plus compétent pour ordonner les mesures contestées, peu important qu’il ait été saisi par le procureur de la République pendant l’enquête, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
LA CONFISCATION DES BIENS QUI ONT PERMIS DE COMMETTRE L'INFRACTION PENALE
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 14 avril 2015, pourvoi n° 14-80896 Rejet
Attendu que, pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisi et confisqués (AGRASC), aux fins d'aliénation, d'un véhicule BMW appartenant à M. X..., gérant de sociétés, mis en examen du chef, notamment, de travail dissimulé, l'arrêt retient que celui-ci utilisait le véhicule pour se rendre sur les chantiers où il surveillait les travailleurs en cause et qu'il s'en était servi pour transporter l'un d'eux ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que le véhicule saisi a servi directement ou indirectement à commettre le délit de travail dissimulé ou été utilisé à cette occasion, de sorte qu'il était susceptible d'une confiscation en application de l'article L. 8224-3, 3°, du code du travail, et, par voie de conséquence, d'une remise à l'AGRASC dans les conditions fixées par l'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur.
LA PROPORTION DE LA SAISIE AVEC LE DROIT DE PROPRIÉTÉ
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 24 octobre 2018, pourvoi n° 16-80834 cassation
Vu les articles 706-141-1 et 706-150 du code procédure pénale, 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal ;
Attendu qu’il résulte de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale que le montant d’une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ;
Que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d’eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n’excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ;
Que, si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur du produit direct ou indirect de l’infraction (Crim., 5 janvier 2017, n° 16-80.275, Bull. Crim. 2017, n° 7), le juge qui ordonne la saisie en valeur d’un bien appartenant ou étant à la libre disposition d’une personne, alors qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu’elle a bénéficié de la totalité du produit de l’infraction, doit cependant apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont elle n’aurait pas tiré profit ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance attaquée, l’arrêt retient notamment que le préjudice de l’Etat sur les ventes réalisées par la société Car Business est estimé entre 9 398 421 et 11 278 105 euros, que cette somme est susceptible de confiscation au titre du produit direct ou indirect de l’infraction et ce en quelque main qu’elle se trouve en application de l’alinéa 3 de l’article 131-21 du code pénal et qu’aux termes de l’alinéa 9 de ce texte la confiscation peut être ordonnée en valeur ; que les juges en déduisent que l’ensemble immobilier objet de l’ordonnance de saisie pénale est susceptible de confiscation en tant qu’immeuble appartenant au mis en examen en application des alinéas 3 et 9 de l’article 131-21 précité ; qu’ils indiquent enfin que la saisie de ce bien est proportionnée au but poursuivi qui est de garantir l’exécution d’une éventuelle peine de confiscation, les faits objet de l’enquête étant susceptibles d’avoir porté sur un montant total supérieur à celui de la seule saisie autorisée, la valeur du bien saisi ayant été estimée au 12 juillet 2016 à la somme de 245 000 euros ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’assurer que la valeur de l’immeuble saisi n’excédait pas le produit de la seule infraction reprochée au demandeur, commise de courant 2011 à juin 2016, dans le cadre de ses fonctions au sein des sociétés AML Consulting, Pro Car Diffusion et PCN Auto, non plus que rechercher, dans l’hypothèse où il serait apparu que l’intéressé n’aurait pas bénéficié du produit de l’infraction, si l’atteinte portée par la saisie au droit de propriété de l’intéressé était proportionnée s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont il n’aurait pas tiré profit, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 13 juin 2017, pourvoi n° 16-83201 Rejet
Attendu que le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l'atteinte spécifique portée au droit de propriété de l'intéressé par la mesure de confiscation de son véhicule prononcée par le tribunal de police et confirmée par la cour d'appel, en violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
LA CONFISCATION DES BIENS PERSONNELS EN CAS DE CONDAMNATION POUR TRAFIC DE DROGUE
Article 222-49 du Code Pénal
Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-38 et 222-39-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-86938 Rejet
Vu l'article
222-49, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la confiscation de tout ou
partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il
soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis
illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect de
l'infraction ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable, notamment, d'infractions
à la législation sur les stupéfiants en récidive commises du
1er novembre 2013 au 29 avril 2014, l'arrêt attaqué, pour dire
n'y avoir lieu à confiscation de l'appartement situé à
Poitiers dont celui-ci est propriétaire, ainsi que des sommes
saisies sur ses comptes bancaires, énonce que, d'une part, il n'est
pas établi que ce logement, acquis le 16 janvier 2011 à l'aide
d'un prêt bancaire, aurait été financé par des fonds
frauduleusement obtenus, d'autre part, aucune investigation n'a
réellement été effectuée sur les mouvements des comptes du
prévenu, dont l'existence ou le fonctionnement ne peuvent être
rattachés à une activité illicite ;
Mais attendu qu'en s'interdisant de prononcer la confiscation de
ces biens, alors que cette mesure était encourue,
indépendamment de l'origine des biens concernés, et pouvait
être prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et
le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
LA CONFISCATION DES BIENS PRODUITS DE L'INFRACTION PENALE
Article 131-21 alinéa 2 du Code Pénal
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
LES IMMEUBLES QUI SERVENT A L'INFRACTION SONT SAISIS
Il loge gratuitement des réfugiés ukrainiens, pour pouvoir violer et filmer le viol de la fille et de la nièce mineures
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 24 octobre 2018, pourvoi n° 18-82370 rejet
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a été mis en examen le 5 mai 2017 des chefs susvisé; qu’il est notamment reproché à l’intéressé d’avoir filmé les relations sexuelles qu’il aurait imposées à X... et B...Z... , mineures de moins de quinze ans, avec la participation de Mme Z... , mère de la première mineure et tante de la seconde ; que ces faits se seraient déroulés dans un immeuble dont le mis en examen est propriétaire, situé à [..], où il aurait accueilli les victimes, d’origine ukrainienne, et où les enquêteurs ont saisi des accessoires susceptibles d’être utilisés, notamment, lors de relations sexuelles sadomasochistes, parmi lesquels certains auraient été employés lors des actes sexuels poursuivis ; que, par ordonnance du 21 août 2017, le juge d’instruction a ordonné la saisie pénale immobilière de l’immeuble du mis en examen en tant qu’instrument de l’infraction ; que l’intéressé a relevé appel de la décision;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance attaquée, l’arrêt relève notamment, après avoir énoncé que le mis en examen encourt la peine de confiscation des immeubles dont il est propriétaire ayant servi à commettre les infractions poursuivies, que les investigations ont permis d’établir que la vidéo dans laquelle l’intéressé est vu en train de pratiquer des actes sexuels sur la personne de X... Z... a été enregistrée à son domicile [...] , lieu discret et hors de la vue du public, où il a fait venir la victime ainsi que sa mère, et où se trouvent des meubles et accessoires utilisés au cours des actes enregistrés ; que les juges ajoutent, après avoir constaté que le mis en examen avait formulé le souhait d’adopter X... Z... afin qu’elle vive chez lui sans sa mère, que l’intéressé utilisait son appartement pour l’accomplissement des infractions pour lesquelles il est poursuivi notamment en conviant les victimes depuis leur pays d’origine à venir séjourner chez lui et que la mise à disposition de cet immeuble constituait même l’un des moyens permettant d’attirer de jeunes femmes et mineures vulnérables sur le plan économique, en leur proposant notamment un hébergement dans la capitale ; qu’ils en déduisent que le domicile du mis en examen constituait le moyen permettant la commission des infractions poursuivies;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d’appréciation, la chambre de l’instruction, qui ne s’est pas bornée à relever que l’immeuble saisi était le lieu des faits, a établi sans insuffisance ni contradiction qu’il avait permis la commission des infractions poursuivies, peu important que son usage n’ait pas été déterminant de leur commission, et a ainsi justifié sa décision;
LES IMMEUBLES INDIVIDIS SONT DIFFICILEMENT SAISISSABLES
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 30 mai 2022, pourvoi n° 21-82.217 cassation
Sur le moyen
soulevé d'office et mis dans le débat
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à
justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des
motifs équivaut à leur absence.
9. Pour ordonner la confiscation en valeur, à titre de produit
de l'infraction commise par M. [O], de l'immeuble situé à [Localité
1] (60), l'arrêt retient que les faits sont d'une gravité
déjà évoquée et n'ont eu comme motivation que l'enrichissement
frauduleux de ses auteurs, dont M. [O] mais aussi son épouse,
également propriétaire du bien en cause, de sorte qu'il est
particulièrement adapté d'envisager une sanction d'ordre
pécuniaire à leur encontre.
10. Les juges précisent que le produit de l'infraction d'escroquerie
en bande organisée, à laquelle M. [O] a pris part, est une
somme totale de plusieurs centaines de milliers d'euros obtenue
frauduleusement des époux [H].
11. Ils en concluent que la confiscation en valeur de l'immeuble
est une peine complémentaire adaptée à la gravité des faits,
à la personnalité de leur auteur et à sa situation personnelle,
et parfaitement proportionnée.
12. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'immeuble
appartenait à M. [O] ainsi qu'à son épouse, Mme [N], et qu'il
lui appartenait donc de rechercher si ce bien était en état d'indivision
ou bien s'il appartenait à la communauté conjugale, la cour d'appel,
qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son
contrôle sur les conditions de la mesure de confiscation
ordonnée, a insuffisamment justifié sa décision.
13. En effet, lorsque le bien dont la confiscation est envisagée
est en état d'indivision entre la personne condamnée et son
époux de bonne foi, cette peine ne peut porter que sur la part
indivise de la personne condamnée, les droits de l'époux de
bonne foi devant lui être restitués, y compris lorsque le bien
constitue le produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 7
novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188).
14. En revanche, lorsque le bien dont la confiscation est
envisagée est commun à des époux mariés sous le régime de la
communauté légale réduite aux acquêts et que l'époux non
condamné pénalement est de bonne foi, la confiscation ne peut
qu'emporter sa dévolution pour le tout à l'Etat, sans qu'il
puisse demeurer grevé des droits de l'époux de bonne foi, la
confiscation faisant naître un droit à récompense pour la
communauté lors de la dissolution de celle-ci (Crim., 9
septembre 2020, pourvoi n° 18-84.619).
15. Dans ce cas, il appartient à la cour d'appel saisie de l'appel
interjeté par l'époux de bonne foi contre le jugement rejetant,
en raison du prononcé de la peine complémentaire de
confiscation, sa requête en restitution d'un bien commun placé
sous main de justice, d'abord de s'assurer du caractère
confiscable du bien dont la restitution est sollicitée, en
application des conditions légales, en précisant la nature et l'origine
de ce bien ainsi que le fondement de la mesure (Crim., 27 juin
2018, pourvoi n° 16-87.009, Bull. crim. 2018, n° 128). Il lui
appartient ensuite d'apprécier si, nonobstant la reconnaissance
d'un droit à récompense pour la communauté, il y a lieu de
confirmer la confiscation en tout ou partie, en restituant tout
ou partie du bien à la communauté, au regard des circonstances
de l'infraction, de la personnalité et de la situation de son
auteur, ainsi que de la situation personnelle de l'époux de
bonne foi, en s'expliquant, hormis le cas où la confiscation, qu'elle
soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa
totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, sur
le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de
propriété de l'époux de bonne foi lorsqu'une telle garantie
est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit
d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 20 mai 2015, pourvoi n° 14-81741 rejet
Vu les articles 710 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 131-21 et 222-49 du code pénal ;
Attendu, d'une part, que doit être examinée, au regard des articles susvisés du code pénal, la requête de toute personne non condamnée pénalement qui est copropriétaire d'un bien indivis et qui soulève des incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision pénale ordonnant la confiscation de ce bien ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 28 septembre 2010, la cour d'appel de Lyon a déclaré M. X...coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a notamment prononcé la confiscation de l'immeuble situé à Vaulx-en-Velin dont il était propriétaire, en indivision avec son épouse, mesure devenue définitive le 3 novembre 2011 ; que, le 14 novembre 2013, les demandeurs ont présenté devant cette juridiction une requête fondée sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale et tendant à voir restituer à Mme X...les droits qu'elle détenait sur cet immeuble ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt relève notamment que la décision du 28 septembre 2010 ayant prononcé la confiscation de l'immeuble dans son entier s'applique " erga omnes " ;
Attendu que les juges ont, à bon droit, rejeté la requête de M. X..., qui n'avait pas qualité pour la présenter et dont le moyen sera, en ce qui le concerne, écarté ;
Mais attendu qu'en omettant dans son dispositif de statuer sur la demande en restitution de Mme X..., sans dire si celle-ci pouvait ou non être considérée comme propriétaire de bonne foi de sa part indivise, au sens des articles 131-21 et 222-49 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce dernier chef
L'AVIS DU PARQUET EST NECESSAIRE POUR SAISIR UN COMPTE BANCAIRE POUR CAUSE DE TRAFIC DE DROGUE
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 27 novembre 2012, pourvoi n° 12-85344 Cassation
Statuant sur le
pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel
de VERSAILLES, en date du 10 avril 2012, qui, dans l'information
suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur
les stupéfiants, a prononcé sur le maintien de la saisie de
sommes inscrites au crédit de comptes bancaires
Vu l'article 706-148
du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si l'enquête porte sur
une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le
juge d'instruction peut, dans les cas prévus aux cinquième et
sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, sur
requête du procureur de la République ou d'office après avis
du ministère public, ordonner la saisie de tout ou partie des
biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit
la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou
lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure qu'au cours d'une information ouverte contre M. X...
du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le
juge d'instruction a, le 12 décembre 2011, au visa des articles
131-21 du code pénal, 706-153 et 706-154 du code de procédure
pénale, rendu une ordonnance maintenant la saisie, opérée le 6
décembre 2011 sur son autorisation, des sommes inscrites au
crédit de quatre comptes ouverts à la Caisse d'Epargne et à la
Banque Postale au nom de M. X..., en retenant que ces sommes
constituaient le produit direct ou indirect des infractions
poursuivies ; que le mis en examen a interjeté appel de cette
décision ;
Attendu que, pour confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance
entreprise et rejeter l'argumentation de M. X... qui faisait
valoir que les sommes inscrites au crédit de ses comptes
bancaires avaient une origine sans rapport avec les infractions
pour lesquelles il avait été mis en examen, l'arrêt énonce
que, selon l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal, lorsque
la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la
confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant
au condamné ; que les juges ajoutent que M. X..., mis en examen
pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et
notamment pour le délit visé à l'article 222-37 du code pénal,
encourt la confiscation de tout ou partie de ses biens, sans qu'il
soit nécessaire d'établir qu'ils proviendraient des infractions
reprochées ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction,
qui, sous le couvert d'une substitution de motifs, a en réalité
modifié le fondement de la saisie effectuée, laquelle
constituait, au sens de l'article 706-148 du code de procédure
pénale, une saisie de patrimoine nécessitant l'avis préalable
du ministère public, a méconnu le texte susvisé et le principe
ci-dessus rappelé
LA PERSONNE SAISIE DOIT ÊTRE EN MESURE D'Y REPONDRE
Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 17 février 2021, pourvoi n° 20-81.397 Cassation
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 706-153 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes qu’en cas d’appel interjeté par le procureur de la République, en application de l’article 185 du code de procédure pénale, à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie de bien ou droit incorporel, le propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui doivent être convoqués devant la chambre de l’instruction, peuvent prétendre dans ce cadre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie.
8. Pour ordonner la saisie de la créance figurant sur le contrat d’assurance sur la vie dont est titulaire M. X... après avoir écarté le moyen pris du caractère inconventionnel des dispositions de l’article 706-153 du code de procédure pénale tiré de ce que ce texte ne prévoit pas, en cas d’appel interjeté par le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie, la mise à disposition des pièces de la procédure de saisie au titulaire du contrat, l’arrêt retient qu’en matière de contentieux des saisies dans le cadre d’une enquête préliminaire, seules les pièces soumises par le ministère public au juge des libertés et de la détention sont communicables aux parties à l’exclusion de l’entier dossier.
9. Les juges ajoutent que l’avocat de M. X... pouvait avoir régulièrement communication des pièces relatives à la procédure de saisie de créances, ce qu’il lui appartenait de demander, et qu’il ne saurait en conséquence se prévaloir de son inaction.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle devait s’assurer que la requête du procureur de la République aux fins de saisie et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention avaient été mises à la disposition du demandeur, et au besoin renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure pour permettre le respect de cette formalité, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 17 février 2021, pourvoi n° 20-83.504 annulation
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 186 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit du second de ces textes que le président de la chambre de l’instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d’un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale.
7. Il se déduit du premier qu’il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d’appel lorsque l’appelant démontre l’existence d’un obstacle de nature à le mettre dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile.
8. Pour déclarer non-admis l’appel formé par Mme X... contre l’ordonnance de saisie pénale de la créance figurant sur un contrat d’assurance-vie dont elle est titulaire, le président de la chambre de l’instruction constate que l’appel, en date du 13 janvier 2020, a été interjeté hors le délai de dix jours prévu par l’article 186 du code de procédure pénale, ce délai, dont le point de départ court à compter de la date d’envoi de la notification, ayant expiré le 30 décembre 2019.
9. En statuant ainsi, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
10. En effet, il ne détenait pas le pouvoir de déclarer non-admis l’appel formé par Mme X....
11. Au surplus, il résulte de l’avis de passage du facteur et d’une attestation de La Poste, que ce courrier a été présenté pour la première fois à Mme X... le 8 janvier 2020, postérieurement à l’expiration du délai de recours de dix jours prévu par l’article 706-153 du code de procédure pénale.
12. L’annulation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de l’annulation
13. En application des articles 706-153 et D 43-5 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour statuer seul sur l’appel de l’ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l’auteur du recours a précisé qu’il saisit la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale.
14. Il en résulte que, du fait de l’annulation de l’ordonnance de non-admission attaquée et faute de précision dans le recours formé par Mme X..., le président de la chambre de l’instruction se trouve saisi, au fond et selon la procédure applicable devant la chambre de l’instruction, de l’appel formé contre l’ordonnance de saisie pénale du juge d’instruction.
L'AVOCAT JUSTIFIE QUE L'ORIGINE INCONNU DES FONDS NE SIGNIFIE PAS QU'ILS SOIENT LE PRODUIT DE L'INFRACTION.
IL N'EST PAS SUIVI PAR LA COUR DE CASSATION.
Cour de Cassation Chambre Criminelle arrêt du 29 janvier 2014 Pourvoi n° 13-80062 rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours d'une information ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, faux et usage et non-justification de ressources, le juge d'instruction a, le 25 août 2012, rendu au visa des articles 131-21, 222-37, 222-49, 321-6 et 321-10-1 du code pénal, une ordonnance de saisie d'un immeuble appartenant à une société civile immobilière X... , dont les intéressés sont les uniques porteurs de parts, de sorte qu'ils ont la libre disposition de cet immeuble ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la confiscation des biens prévue par l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal, concerne tous les biens dont les mis en examen ont la libre disposition, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté.
Cour de Cassation Chambre Criminelle arrêt du 29 janvier 2014 Pourvoi n° 13-80063 rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours d'une information ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, faux et usage, non-justification de ressources et infraction à la législation sur les armes, le juge d'instruction a, le 25 août 2012, rendu au visa des articles 131-21, 222-37, 222-49, 321-6 et 321-10-1 du code pénal, une ordonnance de saisie d'un fonds de commerce exploité par une société Apple Food dont Mme Y...est porteur de parts unique, de sorte que les époux X... ont la libre disposition de ce fonds
RESTITUTION DES OBJETS SAISIS
Article 41-4 du Code de Procédure Pénale
Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
JURISPRUDENCE
La Cour de cassation rappelle que les règlements européens imposent de protéger les tiers de bonne foi même pour un véhicule
Cour de Cassation Chambre Criminelle arrêt du 19 avril 2023 Pourvoi n° 22-85.243 cassation
Vu l'article 99,
alinéa 4, du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, il n'y a pas lieu à restitution par la
juridiction d'instruction notamment lorsque le bien saisi est l'instrument
ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
9. Cependant, ce texte doit être interprété à la lumière des
dispositions de l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du
Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ce dont il
résulte que les droits du tiers de bonne foi doivent être
réservés, que le bien soit l'instrument ou le produit direct ou
indirect de l'infraction.
10. L'arrêt attaqué mentionne qu'aux termes de son mémoire
régulièrement déposé, le tiers appelant expose qu'il est
titulaire d'un contrat de leasing sur le véhicule saisi, qu'il a
loué au garage GS Auto SA, que des sous-locations ont été
organisées sans l'en informer, et qu'il produit la carte grise
dudit véhicule, les contrats de location ainsi que la plainte
déposée par lui à la suite du vol du véhicule.
11. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la
demande de restitution de l'appelant, les juges énoncent qu'il
résulte des éléments de la procédure que le véhicule dont la
restitution est sollicitée est l'instrument de l'infraction.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a refusé
de restituer un bien constituant l'instrument de l'infraction
sans constater que le demandeur ne faisait valoir sur celui-ci
aucun titre de détention régulier, ni rechercher s'il était de
bonne foi, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus
rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
LA SAISIE D'UN VEHICULE APPARTENANT A UNE SOCIETE POUR FAUTE PENALE DU CONDUCTEUR
REFUS DE LA COUR D'APPEL SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA SARL NAALA aux motifs que le tribunal a justement procédé à la saisine (sic) du véhicule ayant servi à commettre l’infraction puisque le prévenu qui n’a de cesse de conduire sans permis se verra entraver dans sa conduite délictueuse par la confiscation de ce véhicule ; que si celui-ci est effectivement la propriété de la SARL Naala, il n’en demeure pas moins que M. X... en avait la libre disposition, en tant que gérant, ce que ses propres salariés ont déclaré, en précisant même que cette voiture n’était utilisée que par le patron ; que l’intervention volontaire, en cause d’appel, de cette société est irrecevable car si l’article 131-21 du code pénal fait référence aux droits du légitime propriétaire, encore faut-il que celui-ci soit de bonne foi ce dont la cour doute puisque le prévenu est le gérant unique de cette société, mais surtout l’action de cette société ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure de restitution, procédure exigeant un formalisme qui n’a pas été respectée en l’espèce.
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 15 janvier 2014 pourvoi 13-81 874 Rejet
Attendu que si c’est à tort que la cour d’appel a énoncé, pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Naala, propriétaire du véhicule automobile dont la confiscation, assortie de l’exécution provisoire, avait été ordonnée, que l’action de cette société ne pouvait intervenir que dans le cadre d’une procédure de restitution, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que les juges ont souverainement apprécié, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, que ladite société n’était pas propriétaire de bonne foi au sens des dispositions de l’article 131-21 du code pénal
Une cour d'Appel refuse de rendre les biens confisqués alors que le prévenu est relaxé !
Cour de Cassation Chambre Criminelle arrêt du 14 février 2023 Pourvoi n° 21-85.689 cassation
Vu les articles
567 et 609 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit de ces textes que, d'une part, si le pourvoi a
pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision
attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la
qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à
agir, d'autre part, après cassation, l'affaire est dévolue à
la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de
pourvoi.
10. L'arrêt attaqué déclare M. [I] coupable de travail
dissimulé.
11. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel de renvoi n'était
plus saisie de l'action publique de ce chef, la relaxe prononcée
ayant acquis l'autorité de chose jugée, les juges ont méconnu
les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Cour de Cassation Chambre Criminelle arrêt du 20 mars 2019 Pourvoi n° 18-82.198 cassation partielle
Vu l’article 41-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte du texte susvisé que toute décision de non restitution d’un objet placé sous main de justice, prise par le procureur de la République ou le procureur général dans les conditions prévues au premier alinéa de ce texte, peut être déférée à la chambre de l’instruction par la personne intéressée, que le refus ou l’irrecevabilité opposée à la demande soit fondé sur l’un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou sur la circonstance que l’objet réclamé est devenu la propriété de l’Etat par suite de l’expiration du délai de six mois fixé au troisième alinéa ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un jugement du tribunal correctionnel en date du 16 décembre 2013 ayant constaté l’extinction de l’action publique par suite du décès d’Z... A..., les demandeurs, en leur qualité d’héritiers du prévenu, ont saisi le procureur général d’une requête en restitution de la somme de 14 060 euros qui aurait appartenu à leur auteur, en faisant notamment valoir que cette somme avait été saisie dans le cadre des investigations diligentées à l’encontre d’Z... A... ; que, par courrier du 23 février 2017, le procureur général a rejeté la requête au motif qu’il avait été définitivement statué sur l’action publique à l’égard d’Z... A... par le jugement du 16 décembre 2013 et que, cette somme n’ayant pas été réclamée dans le délai de six mois ayant suivi cette décision, elle était devenue propriété de l’Etat ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mars 2017, les requérants ont déféré cette décision à la chambre de l’instruction ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l’arrêt retient notamment que le courrier du 23 février 2017 adressé par le procureur général au conseil des demandeurs ne constitue pas une décision de non restitution susceptible d’un recours devant la chambre de l’instruction ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
En cas d'appel de l'ordonnance de destruction, ou de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation ou d'affectation de biens meubles placés sous main de justice, rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir de statuer sur la restitution des biens objet de ces décisions. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir infirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de remise d'un véhicule automobile à l'AGRASC aux fins d'affectation à un service de police judiciaire, en ordonne la restitution à l'appelant
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 11 mai 2022, Pourvoi n° 21-85.420 Cassation
4. Il résulte du
second de ces textes que les décisions de destruction, ou de
remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation ou d'affectation de
biens meubles placés sous main de justice, rendues par le juge d'instruction,
sont notifiées au ministère public, aux parties intéressées
et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant
des droits sur le bien, qui peuvent les déférer à la chambre
de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et
sixième alinéas de l'article 99.
5. Ce texte ne prévoit pas, contrairement à l'article 41-5 du
code de procédure pénale applicable pendant l'enquête ou
lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction
saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort
des scellés, qu'à l'occasion de leur recours ces personnes
peuvent demander la restitution des biens saisis ni que la
chambre de l'instruction peut en ordonner d'office la restitution.
6. Par ailleurs, le deuxième alinéa du premier de ces textes
donne compétence à la chambre de l'instruction pour directement
statuer sur les requêtes en restitution seulement lorsque la
requête a été formée conformément à l'avant-dernier alinéa
de l'article 81 du même code et que le juge d'instruction s'est
abstenu de statuer dans le délai d'un mois, le requérant
pouvant alors saisir directement le président de la chambre de l'instruction
qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l'article
186-1 de ce code.
7. Enfin, interpréter l'article 99-2 du code de procédure
pénale comme permettant à l'appelant des décisions de
destruction, ou de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation ou d'affectation
de biens meubles placés sous main de justice, rendues par le
juge d'instruction, de saisir la chambre de l'instruction d'une
demande de restitution des biens objet de ces décisions,
porterait atteinte aux droits des parties intéressées,
lesquelles s'entendent des personnes à qui la restitution est
susceptible de faire grief (Crim., 8 juillet 1997, pourvoi n° 96-84.306,
Bull. crim. 1997, n° 268), à qui les décisions de restitution
rendues par le juge d'instruction doivent être notifiées et qu'elles
peuvent déférer à la chambre de l'instruction en application
de l'article 99 du code de procédure pénale.
8. Il s'en déduit qu'en cas d'appel de l'ordonnance de
destruction, ou de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation ou d'affectation
de biens meubles placés sous main de justice, rendue par le juge
d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir de
statuer sur la restitution des biens objet de ces décisions.
9. En l'espèce, après avoir infirmé l'ordonnance de remise à
l'AGRASC rendue par le juge d'instruction en raison de l'atteinte
disproportionnée portée au droit de propriété de M. [V], l'arrêt
retient qu'il convient d'en ordonner la restitution à l'intéressé.
10. En se déterminant ainsi, alors que, saisie de l'unique objet
du recours formé contre une ordonnance de remise à l'AGRASC aux
fins d'affectation, elle ne pouvait pas prononcer sur la demande
de restitution dont l'avait saisie le demandeur, la chambre de l'instruction
a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation
étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de
mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du
code de l'organisation judiciaire.
Article 41-6 du Code de Procédure Pénale
Par dérogation aux articles 41-4 et 41-5, lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d'ordonner la remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d'un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition. En cas d'opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n'entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l'opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice.
Cour de Cassation Chambre Criminelle arrêt du 19 février 2014 Pourvoi n° 13-81159 rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en exécution de la demande d'entraide du magistrat instructeur informant à l'encontre, notamment, de M. X... des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, les autorités judiciaires belges ont procédé, le 22 janvier 2002, au blocage de deux comptes bancaires dont celui-ci était titulaire ; que le tribunal correctionnel, qui, par jugement contradictoire du 20 juin 2008, a déclaré M. X... coupable des faits reprochés et a prononcé sur les peines, n'a pas ordonné la confiscation des sommes versées sur ces comptes ; que la requête en mainlevée de la saisie de ces sommes dont M. X... a saisi le procureur de la République le 26 décembre 2011 a été déclarée irrecevable, en application de l'article 41-4, troisième alinéa, du code de procédure pénale, pour avoir été présentée plus de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ; que, contestant cette décision, l'intéressé a présenté au tribunal correctionnel la même requête, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts et sur lequel ont été saisies au cours de l'enquête ou de l'instruction des sommes d'argent dont ni la confiscation ni la restitution n'a été ordonnée par une décision définitive de la juridiction de jugement, ne peut en obtenir restitution que selon les modalités et délais prévus par l'article 41-4 du code de procédure pénale, et dès lors que ce texte ne met pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, à laquelle il ne porte pas une atteinte disproportionnée, la cour d'appel a justifié sa décision.
AFFAIRE DES CARNETS SARKOZY : LA PORTE EST OUVERTE POUR LA CEDH.
Comme un non lieu a été prononcé, la Cour de Cassation a décidé qu'il n'a pas besoin de récupérer ses carnets saisis pendant l'instruction. Sa demande est sans objet. Qu'il se rassure, c'est juridiquement plus facile de lui rendre les carnets pour les lui reprendre aussitôt que de les saisir à nouveau entre les mains de la justice, sans faire de détournement de procédure.
Cour de Cassation Chambre Criminelle arrêt du 11 mars 2014 Pourvoi n° 13-86965 Cassation partielle sans renvoi
Sur le pourvoi formé par M. X... :
Attendu que M. X..., mis en examen du chef d’abus de faiblesse, a fait l’objet, le 7 octobre 2013, d’une ordonnance de non-lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel, devenue définitive à son égard ; Qu’en application de l’article 606 du code de procédure pénale, il n’y pas lieu de statuer sur son pourvoi devenu sans objet.
Cliquez sur le lien bleu pour accéder à l'arrêt complet de la Cour de Cassation du 11 mars 2014 en format PDF.
RÉTENTION OU SAISIE DE BIENS PAR LES DOUANES
Cliquez sur un lien bleu pour accéder :
- AUX RETENTIONS DES OBJETS ET SOMMES D'ARGENT PAR LA DOUANE
- AUX SAISIES ILLÉGALES DES DOUANES FRANCAISES
RETENTIONS DES OBJETS ET SOMMES D'ARGENT PAR LA DOUANE
STOYAN NIKOLOV c. BULGARIE du 20 juillet 2021 Requête no 68504/11
Art 1 P1 • Réglementer l’usage des biens • Cumul non nécessaire d’une amende administrative avec la confiscation de la totalité d’une somme non déclarée à la douane pour assurer l’effet dissuasif et punitif de la sanction et prévenir d’autres infractions à l’obligation déclarative • Confiscation disproportionnée • Poursuite d’un but purement punitif
Art 13 (+ Art 1 P1) • Recours interne effectif pour remédier à l’atteinte alléguée au droit au respect des biens
ARTICLE 1 PROTOCOLE 1
55. La Cour note que, en l’espèce, le requérant a été condamné au paiement d’une amende et à la confiscation de la somme qu’il n’avait pas déclarée à la douane (paragraphes 11 à 16 ci-dessus). À la lumière de sa jurisprudence en la matière (voir, notamment, Grifhorst c. France, no 28336/02, §§ 84-86, 26 février 2009, et Gabric c. Croatie, no 9702/04, § 33, 5 février 2009), elle estime qu’il s’agit d’une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, que les mesures contestées relèvent de la réglementation de l’usage des biens et que cette situation entre dans le champ d’application du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
56. La Cour doit donc établir si cette ingérence était « prévue par la loi », si elle poursuivait un but légitime et si elle était proportionnée au but poursuivi (Togrul c. Bulgarie, no 20611/10, § 39, 15 novembre 2018).
57. Elle observe, en premier lieu, que les deux sanctions appliquées au requérant étaient prévues par les articles 11, 18 et 20 de la loi de 1999 sur les devises et par l’arrêté ministériel no 10 du 16 décembre 2003, qui réprimaient l’infraction reprochée à l’intéressé, à savoir la non-observation des règles relatives à la déclaration des sommes d’argent en espèces lors du passage à la frontière bulgare (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Il ressort également des dispositions pertinentes du TFUE et du Règlement (CE) no 1889/05 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence, que le droit primaire et le droit dérivé de l’Union européenne ne s’opposent pas en principe à ce que les États membres de l’Union mettent en place une obligation déclarative pour les particuliers transférant de l’argent liquide d’un État membre à un autre (paragraphes 22, 23, 25 et 26 ci-dessus). Il convient de noter à cet égard que, d’après l’information dont dispose la Cour, plusieurs États membres de l’Union européenne ont choisi de mettre en place des mesures similaires de contrôle, sous différentes formes et conditions (paragraphe 24 ci-dessus).
58. La Cour ne s’estime pas appelée dans la présente espèce à déterminer de manière abstraite si, compte tenu des sanctions prévues par le droit bulgare pertinent, cette réglementation nationale pouvait être considérée comme compatible avec les articles 63 et 65 du TFUE (paragraphe 22 ci-dessus). Elle observe qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, même lorsque celui-ci renvoie au droit international ou à des accords internationaux. De même, les organes judiciaires de l’Union européenne sont mieux placés pour interpréter et appliquer le droit de l’Union (Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, § 143, CEDH 2005-VI, et Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 110, 3 octobre 2014). Sur la base des éléments dont elle dispose dans le cadre de la présente affaire, la Cour estime que l’ingérence dont se plaint le requérant était « prévue par la loi » au sens de sa jurisprudence (voir, par exemple, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, §§ 108 et 109, CEDH 2000-I). Dans son analyse de la proportionnalité de l’ingérence en cause, elle prendra en compte la nature et la sévérité des sanctions infligées au requérant (paragraphes 60 in fine et 63 ci-dessous).
59. La Cour peut accepter l’argument du Gouvernement (paragraphe 53 ci-dessus), selon lequel les mesures contestées visaient à contrôler l’importation et l’exportation d’argent liquide et donc à lutter contre l’exportation illicite de moyens de paiement, ce qui s’analyse en des « buts légitimes » répondant à l’intérêt général, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1.
60. Il reste à établir si les autorités ont, dans la présente affaire, ménagé un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. En d’autres termes, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux de l’individu, compte tenu de la marge d’appréciation reconnue à l’État en pareille matière (Grifhorst, précité, § 94). Pour cela, elle tiendra compte de la nature et de la gravité de l’infraction reprochée au requérant, du comportement de celui-ci et de la nature et de la sévérité des sanctions infligées (Grifhorst, précité, §§ 95-105, et Gabric, précité, §§ 36-39).
61. La Cour constate tout d’abord que le requérant a été sanctionné dans le cadre d’une procédure administrative pour ne pas avoir déclaré à la douane bulgare la somme de 34 300 EUR qu’il transportait. Il apparaît que la légalité de l’origine de cet argent n’inspirait pas le moindre soupçon : le requérant avait présenté des documents bancaires et donné des explications cohérentes à ce sujet au cours de la procédure pénale concomitante et les organes chargés de l’enquête pénale avaient retenu ces explications (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Les poursuites pénales ouvertes contre lui pour les mêmes faits ont été abandonnées et les autorités bulgares n’ont soupçonné l’intéressé d’aucune activité illégale. Il en ressort que l’infraction pour laquelle le requérant a été sanctionné était le manquement à une obligation déclarative à la douane.
62. Pour ce qui est du comportement du requérant, la Cour observe que lorsque l’intéressé a été interrogé par la douanière, il n’a pas cherché à dissimuler l’argent, mais a au contraire immédiatement présenté la somme en question (paragraphe 5 ci-dessus). Les autorités internes, qui avaient examiné les affaires pénale et administrative ouvertes à ce sujet, ont constaté que le requérant n’avait pas commis de faute intentionnelle, mais une infraction administrative par négligence (paragraphes 9 et 16 ci-dessus).
63. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, dans pareille situation, la sanction doit correspondre à la gravité du manquement constaté, à savoir un manquement à l’obligation de déclaration, et non pas à la gravité d’un manquement présumé non avéré, tel qu’un blanchiment d’argent ou une fraude fiscale (Ismayilov c. Russie, no 30352/03, § 38, 6 novembre 2008, et Grifhorst, précité, § 102). Dans la présente affaire, le requérant a été sanctionné par une amende de 1 000 BGN (soit environ 500 EUR), qui était le montant minimum prévu par la loi nationale sur les devises (paragraphe 17 ci-dessus). Il s’est également vu confisquer, conformément à la législation interne (paragraphe 17 in fine ci-dessus), la totalité de la somme non déclarée, à savoir 34 300 EUR. Force est de constater que la confiscation de cette somme poursuivait un but purement punitif, puisqu’elle ne visait à compenser aucun préjudice qui aurait été subi par l’État et qui aurait résulté de l’infraction du requérant. Le Gouvernement n’a pas démontré de manière convaincante qu’il était nécessaire de cumuler l’amende administrative avec la confiscation de cent pour cent de la somme non déclarée aux fins d’assurer l’effet dissuasif et punitif de la sanction administrative et de prévenir d’autres infractions à l’obligation déclarative en question.
64. La Cour estime qu’il y a lieu de distinguer la présente espèce de l’affaire Karapetyan c. Géorgie (no 61233/12, 15 octobre 2020), dans laquelle elle a conclu à une non-violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention dans la mesure où la requérante dans cette affaire était bien au courant de l’existence d’une obligation déclarative en cas de franchissement de la frontière avec de l’argent liquide, où elle avait intentionnellement dissimulé l’argent non déclaré, où elle avait été sanctionnée seulement par une confiscation de la somme non déclarée sans faire l’objet en plus d’une amende, et où elle n’avait présenté aucun document permettant d’établir l’origine licite de l’argent confisqué (ibid., §§ 38 et 39).
65. En revanche, la situation du requérant dans la présente espèce présente des similitudes avec celle des requérants dans les affaires précitées Gabric (§ 39), Ismayilov (§ 38) et Togrul (§ 45). De la même manière que dans ces affaires, la Cour conclut en l’espèce que la confiscation de cent pour cent du montant non déclaré infligée au requérant pour son manquement à l’obligation déclarative était disproportionnée et qu’elle lui a imposé un fardeau excessif.
66. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
ARTICLE 13
69. Le requérant allègue qu’il n’avait à sa disposition aucune voie de recours effective susceptible de remédier à l’atteinte selon lui injustifiée à son droit au respect de ses biens. Il expose en particulier que les tribunaux n’ont pas répondu à son argument fondé sur une incompatibilité alléguée des sanctions imposées avec le droit de l’Union européenne et qu’ils n’ont pas cherché à établir si les mesures en cause étaient proportionnées, de sorte que son recours devant les tribunaux administratifs aurait été dépourvu d’effectivité.
70. Le Gouvernement répond que le recours introduit par le requérant devant les tribunaux administratifs présentait tous les attributs d’un recours effectif. Il soutient que le seul fait que le requérant n’a pas obtenu gain de cause ne saurait amener la Cour à constater une violation de l’article 13 dans le cas d’espèce.
71. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit aux requérants un recours interne « effectif », en ce sens qu’il peut empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 158, CEDH 2000-XI).
72. La Cour observe que la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention constatée en l’espèce découlait de la décision prise le 25 novembre 2009 par le directeur du service des douanes, lequel a imposé au requérant une amende et la confiscation de l’argent qu’il transportait. Or cet acte était susceptible d’un recours devant les tribunaux administratifs, que le requérant a d’ailleurs exercé (paragraphes 11 à 16 ci-dessus).
73. Force est de constater que rien dans le cas d’espèce ne permet de conclure que ce recours n’était pas de nature à empêcher la survenance de l’atteinte alléguée au droit au respect des biens : il s’agissait d’un recours judiciaire, soumis à des tribunaux établis par la loi, offrant toutes les garanties du procès équitable, disposant des compétences nécessaires pour examiner le litige sur le fond et dont les décisions auraient pu conduire à l’annulation de la décision litigieuse prise par le directeur du service des douanes. Le seul fait que le requérant s’est vu débouter par les tribunaux ne peut pas à lui seul remettre en cause l’efficacité de ce recours, étant donné que l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudla, précité, § 157).
74. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que le requérant disposait d’un recours interne effectif pour remédier à l’atteinte alléguée à son droit au respect de ses biens.
75. Partant, en l’espèce il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
Sadocha c. Ukraine du 11 juillet 2019 requête n° 77508/11
Violation article 1 du Protocole 1 : Les autorités ukrainiennes ont imposé une charge spéciale et exorbitante en confisquant à la frontière l’intégralité d’une somme en espèces non déclarée
Le requérant se plaint que les douaniers ukrainiens aient saisi, à l’aéroport Jouliany de Kiev, 31 000 euros qu’il transportait en espèces. La Cour juge en particulier que la confiscation de l’intégralité de la somme d’argent non déclarée, ordonnée par les tribunaux nationaux, a imposé au requérant une charge spéciale et exorbitante et qu’elle était disproportionnée à l’infraction commise.
Le requérant, Vasil Sadocha, est un ressortissant tchèque né en 1972 et résidant à Olomouc (République tchèque). En juillet 2011, M. Sadocha se rendit d’Ukraine en Pologne. Il transportait 41 000 euros (EUR). On lui demanda s’il transportait des espèces et son bagage à main passa aux rayons X. M. Sadocha montra au douanier l’argent qu’il transportait. Il fut accusé d’infraction au code des douanes pour n’avoir pas déclaré la somme totale et se vit saisir sur-le-champ 31 000 EUR. L’affaire passa au tribunal en août de la même année. L’avocat de M. Sadocha admit que son client n’avait pas déclaré la somme transportée, mais plaida qu’il ignorait devoir le faire. Il précisa que les 31 000 euros provenaient d’un prêt privé et produisit l’accord de prêt. Le tribunal émit néanmoins une ordonnance de confiscation, jugeant que la provenance de l’argent était sans pertinence pour l’appréciation de la responsabilité de M. Sadocha. En appel, l’avocat de M. Sadocha soutint que la juridiction inférieure avait infligé à son client une peine injuste et disproportionnée et qu’elle n’avait pas dûment examiné les arguments plaidant pour une sanction moins sévère, tels que l’origine licite de l’argent et l’absence d’intention délictueuse. La cour d’appel confirma le jugement de première instance.
Article 1 du Protocole n° 1 :
La Cour dit tout d’abord que la confiscation de la somme d’argent était basée sur la loi, en particulier le code des douanes et une réglementation bancaire nationale relative à l’obligation de déclarer les montants supérieurs à 10 000 EUR. Par ailleurs, les États ont un intérêt légitime à mettre en œuvre des mesures destinées à contrôler les flux d’argent en espèces à travers les frontières, pour lutter contre le blanchiment d’argent, le trafic de drogue, le financement du terrorisme et d’autres crimes. La question qui se pose dans la cause de M. Sadocha est de savoir si les autorités ont ménagé le juste équilibre requis entre la protection des droits patrimoniaux et l’intérêt général, compte tenu de la latitude (« marge d’appréciation ») dont jouit l’État en la matière. En particulier, le propriétaire du bien ne doit pas avoir à supporter une « charge spéciale et exorbitante ». La Cour observe qu’il n’est pas illégal en Ukraine de faire sortir du pays une somme en espèces. Au moment des faits, il n’y avait pas de restrictions quant aux montants qui pouvaient légalement être transférés ou transportés physiquement au-delà de la frontière douanière, tant qu’ils étaient déclarés. Le requérant a affirmé que la somme en espèces provenait d’un prêt privé, mais les tribunaux n’ont pas cherché à vérifier si l’argent avait été obtenu légalement. Le Gouvernement lui-même n’a pas émis de doute sur la validité de l’accord de prêt et la Cour n’est donc pas en position de remettre en question l’origine légale de la somme confisquée. Par ailleurs, aucun élément n’indique que le requérant ait délibérément cherché à contourner la réglementation douanière et, de fait, les autorités n’ont pas déclenché de poursuites pénales, ce qui montre qu’elles n’ont pas décelé d’intention frauduleuse de sa part. Ainsi, la seule conduite illégale, bien que non délictueuse, qui a été imputée au requérant réside dans le fait qu’il n’a pas livré aux autorités douanières de déclaration écrite sur le montant en espèces qu’il transportait. Une atteinte à des droits patrimoniaux est proportionnée si elle correspond à la gravité du manquement, et la peine à la gravité de l’infraction qu’elle vise à sanctionner. Le montant était important pour le requérant, mais non pour l’État. La Cour déclare donc que la confiscation ne visait pas à compenser financièrement le dommage, mais qu’elle avait plutôt un but dissuasif et répressif. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement consistant à dire que les décisions nationales comprenaient une analyse de la proportionnalité, notamment des considérations sur l’origine légale de l’argent, le défaut d’intention ou l’absence d’antécédents en matière d’infractions douanières. Globalement, la portée du contrôle des tribunaux a été trop étroite pour satisfaire à l’exigence d’un « juste équilibre ».
Les tribunaux avaient également la possibilité d’infliger une amende au requérant ; or le Gouvernement n’a pas expliqué pourquoi une telle mesure n’aurait pas permis d’obtenir l’effet dissuasif et répressif recherché. Pour la Cour, la confiscation de l’intégralité de la somme non déclarée a imposé au requérant une charge spéciale et exorbitante et était disproportionnée à l’infraction commise. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
Togrul c. Bulgarie du 15 novembre 2018 requête n° 20611/10
Article 1 du Protocole 1 : Confiscation et rétention, pendant plus de neuf ans, de sommes d’argent non déclarées à la douane bulgare : violation du droit de propriété
L’affaire concerne la confiscation, par les autorités bulgares, d’une somme de 199 400 euros (EUR) que M. Togrul n’avait pas déclarée à la douane, ainsi que la rétention d’une somme de 9 100 EUR
La CEDH relève que M. Togrul a été sanctionné dans le cadre d’une procédure administrative pour ne pas avoir déclaré à la douane bulgare la somme de 199 400 EUR qu’il transportait. En l’espèce, il n’y avait aucun soupçon quant à la légalité de l’origine de l’argent, et les poursuites pénales ont été abandonnées. La Cour juge en particulier que la confiscation de la totalité de la somme non déclarée (199 400 EUR) avait un but purement punitif, puisqu’elle ne visait à compenser aucune perte qui aurait été subie par l’État. Cette confiscation était donc disproportionnée et a imposé un fardeau excessif à M. Togrul. En outre, la rétention de la somme de 9 100 EUR n’était plus proportionnée au but légitime poursuivi (la conservation d’une preuve matérielle) à compter de la clôture de la procédure pénale, le 26 janvier 2009. Au-delà de cette date, l’argent a donc été retenu sans aucun fondement.
PRINCIPAUX FAITS
En octobre 2008, M. Togrul pénétra sur le territoire bulgare à bord d’un véhicule. À sa sortie du territoire, le douanier bulgare lui demanda s’il avait quelque chose à déclarer. L’intéressé répondit par l’affirmative et présenta la somme de 199 400 EUR en espèces, expliquant que l’argent provenait de la vente de son véhicule et de son compte bancaire. Il présenta des documents justificatifs. Le même jour, le chef de la douane de Svilengrad établit un constat d’infraction administrative, reprochant à M. Togrul de ne pas avoir déclaré ladite somme à la douane. Le policier enquêteur saisit les 199 400 EUR, ainsi que deux billets d’une valeur totale de 600 EUR. Ensuite, M. Togrul lui remit d’autres billets d’une valeur totale de 8 500 EUR. Des poursuites pénales furent engagées à son encontre mais, en janvier 2009, le parquet estima que les faits n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale. En février 2009, le chef de la douane de Svilengrad imposa à M. Togrul une amende d’environ 1 533,88 EUR, estimant que l’intéressé n’avait pas accompli ses obligations déclaratives en ce qui concerne la somme de 199 400 EUR qui fut confisquée. En outre, les 9 100 EUR que M. Togrul avait remis au policier enquêteur furent retenus.
CEDH
37. La Cour rappelle que les principes relatifs à l’application et à l’interprétation de l’article 1 du Protocole no 1 dans des situations similaires à celles de l’espèce, ont été résumées dans les arrêts et décisions suivantes : Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 62, CEDH 2007-I ; J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, § 52, CEDH 2007-III ; Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I ; Gasus Dosier - und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, 23 février 1995, § 60, série A no 306-B ; AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, §§ 51 et 52, série A no 108 ; Grifhorst c. France, no 28336/02, §§ 84-86, 26 février 2009, et Gabric c. Croatie, no 9702/04, § 33, 5 février 2009.
38. La Cour note que, en l’espèce, le requérant a été condamné au paiement d’une amende et à la confiscation de la somme qu’il n’avait pas déclarée à la douane. À la lumière de sa jurisprudence en la matière (paragraphe 37 ci-dessus), elle estime qu’il s’agit d’une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, que les mesures contestées relèvent de la réglementation de l’usage des biens et que cette situation entre dans le champ d’application du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
39. La Cour doit donc établir si cette ingérence était « prévue par la loi », si elle poursuivait un but légitime et si elle était proportionnée au but poursuivi (paragraphe 37 ci-dessus).
40. Elle observe, en premier lieu, que les deux sanctions appliquées au requérant étaient prévues par les articles 11, 18 et 20 de la loi sur les devises qui répriment l’infraction reprochée à l’intéressé, à savoir la non-observation des règles relatives à la déclaration des sommes d’argent en espèces lors du passage à la frontière bulgare (paragraphes 24 et 25 ci-dessus).
41. Elle constate ensuite que les mesures contestées visaient à contrôler l’importation et l’exportation d’espèces, ce qui s’analyse en un « but légitime » répondant à l’intérêt général, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1.
42. Il reste à établir si les autorités ont, dans la présente affaire, ménagé un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. En d’autres termes, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux de l’individu, compte tenu de la marge d’appréciation reconnue à l’État en pareille matière (Grifhorst, précité, § 94). Pour cela, elle tiendra compte de la nature et de la gravité de l’infraction reprochée au requérant, du comportement de celui-ci et de la nature et de la sévérité des sanctions infligées (Grifhorst, précité, §§ 95-105, et Gabric, précité, §§ 36-39).
43. La Cour constate d’abord que le requérant a été sanctionné dans le cadre d’une procédure administrative pour ne pas avoir déclaré à la douane bulgare la somme de 199 400 EUR qu’il transportait. Il apparaît qu’il n’y avait aucun soupçon quant à la légalité de l’origine de cet argent : le requérant avait présenté des documents bancaires et donné des explications cohérentes à ce sujet (paragraphe 6 ci-dessus). Les poursuites pénales ouvertes à son encontre pour les mêmes faits ont été abandonnées et l’intéressé n’a été soupçonné d’aucune activité illégale par les autorités bulgares. Il en ressort que l’infraction pour laquelle le requérant a été sanctionné était le non-accomplissement d’une obligation déclarative à la douane.
44. Pour ce qui est du comportement du requérant, la Cour observe qu’il n’a pas cherché à dissimuler l’argent lorsqu’il a été interrogé par le douanier, qu’il a immédiatement présenté la somme en question et qu’il a fourni des documents et donné des explications quant à son origine (paragraphe 6 ci-dessus). Les autorités internes, qui avaient examiné les affaires pénale et administrative ouvertes à ce sujet, ont constaté que le requérant n’avait pas commis de faute intentionnelle, mais une infraction administrative par négligence (paragraphes 11 et 17 ci-dessus).
45. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, dans pareille situation, la sanction doit correspondre à la gravité du manquement constaté, à savoir le manquement à l’obligation de déclaration, et non pas à la gravité d’un manquement présumé non avéré, tel que le blanchiment d’argent ou la fraude fiscale (Ismayilov c. Russie, no 30352/03, § 38, 6 novembre 2008, et Grifhorst, précité, § 102). Dans la présente affaire, le requérant a été sanctionné par une amende de 3 000 BGN (soit environ 1 533,88 EUR), qui était le montant maximum prévu par la loi nationale sur les devises (paragraphe 25 ci-dessus). Il s’est également vu confisquer, conformément à la législation interne (paragraphe 25 in fine ci-dessus), la totalité de la somme non déclarée, à savoir 199 400 EUR. Force est de constater que la confiscation de cette somme avait un but purement punitif, puisqu’elle ne visait à compenser aucune perte qui aurait été subie par l’État et qui aurait résulté de l’infraction du requérant. Le Gouvernement n’a pas démontré de manière convaincante qu’il a été nécessaire de cumuler l’amende administrative avec la confiscation de cent pourcent de la somme non déclarée pour assurer l’effet dissuasif et punitif de la sanction administrative et pour prévenir d’autres infractions à l’obligation déclarative en question. À l’instar de ses conclusions dans les affaires relativement similaires (Gabric, précité, § 39, Ismayilov, précité, § 38, et Boljevic, précité, § 45), la Cour conclut que la confiscation de cent pourcent du montant non déclaré, infligée au requérant pour son manquement à l’obligation de déclarer l’argent, était disproportionnée et qu’elle lui a imposé un fardeau excessif.
46. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention de ce chef.
2. Grief relatif à la rétention de la somme de 9 100 EUR
a) Arguments des parties
47. Le requérant expose qu’il a remis aux autorités 9 100 EUR qui ont été conservés comme preuve matérielle dans le cadre des poursuites pénales engagées contre lui. Il précise que cette somme ne lui a pas été restituée à l’issue de la procédure pénale et que toutes ses tentatives subséquentes ont été rejetées par la police, le parquet ou les autorités administratives. Il estime que cette situation s’analyse en une violation de son droit au respect de ses biens.
48. Le Gouvernement combat la thèse du requérant, soutenant qu’il s’agissait d’une mesure prévue par la loi, poursuivant un but légitime et proportionnée. Il indique que la somme avait été saisie dans le cadre de la procédure pénale menée contre le requérant, qu’elle n’a pas fait l’objet de la procédure administrative subséquente, qu’elle se trouve toujours au commissariat de police de Svilengrad, que le requérant n’en a pas demandé la restitution à la police et qu’il n’a intenté contre le policier enquêteur ni une action civile en répétition de l’indu ni une action en indemnisation pour enrichissement injustifié.
b) Appréciation de la Cour
49. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 ne prohibe pas la saisie d’un bien à des fins d’administration de la preuve dans le cadre d’une procédure pénale. Toutefois, il s’agit d’une mesure qui restreint temporairement l’usage des biens et qui, dès lors, pour répondre aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1, doit être prévue par la législation interne, poursuivre un but légitime et être proportionnée au but poursuivi (Karamitrov et autres c. Bulgarie, no 53321/99, § 72, 10 janvier 2008, et Petyo Petkov c. Bulgarie, no 32130/03, § 102, 7 janvier 2010).
50. La Cour observe que l’argent en cause a été saisi en tant que preuve matérielle en vertu du CPP (paragraphes 9 et 10 ci-dessus) et que le requérant ne conteste ni la prévisibilité ni l’accessibilité des dispositions législatives en cause (paragraphe 47 ci-dessus). La Cour constate ainsi que les parties s’accordent pour dire que la première condition de la régularité de la mesure litigieuse est remplie et elle ne voit pas de raison d’aboutir à une conclusion différente. Elle estime que la mesure en cause visait le but légitime d’assurer le bon fonctionnement de la justice et qu’elle relevait donc de l’intérêt général.
51. Il reste donc à déterminer si les autorités ont ménagé en l’occurrence un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit du requérant d’utiliser son bien. Pour déterminer la proportionnalité de la mesure en cause, la Cour estime opportun de prendre en compte sa durée, sa nécessité au vu du déroulement des poursuites pénales, les conséquences de son application pour le requérant et les décisions prises par les autorités à ce sujet pendant et à l’issue du procès pénal (Petyo Petkov, précité, § 105).
52. La Cour constate que la somme de 9 100 EUR, saisie le 8 octobre 2008, n’avait toujours pas été restituée au requérant à la date du 1er novembre 2017 (paragraphes 9, 10 et 23 ci-dessus). Cette somme a donc été retenue par les autorités pendant plus de neuf ans.
53. La Cour accepte que la rétention de cette somme était justifiée jusqu’à la fin de la procédure pénale contre le requérant, à savoir le 26 janvier 2009 (paragraphe 11 ci-dessus). Au-delà de cette date, le requérant était poursuivi administrativement uniquement pour ne pas avoir déclaré la somme de 199 400 EUR. Le reste de l’argent saisi le 8 octobre 2008, à savoir les 9 100 EUR en question, a été retenu par les autorités sans aucun fondement.
54. La Cour relève que le requérant a saisi tant la police que le parquet de Svilengrad, lesquels n’ont pas fait suite à ses demandes de restitution de cette somme (paragraphes 14, 21 et 22 ci-dessus), et que le recours qu’il avait formé devant le tribunal de district de Svilengrad à cet égard n’a pas été examiné (paragraphes 15 et 18 ci-dessus). Pour ce qui est de l’argument du Gouvernement tiré de l’omission du requérant de saisir les tribunaux civils d’une action en répétition de l’indu ou d’une action en indemnisation pour enrichissement injustifié contre le policier enquêteur, la Cour réitère son constat selon lequel le Gouvernement n’a présenté aucune décision de justice dans laquelle les deux voies de recours en question auraient été exercées avec succès dans une situation similaire à celle de l’espèce (paragraphe 33 ci-dessus). La Cour ne saurait donc retenir cet argument contre le requérant.
55. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la rétention de la somme de 9 100 EUR appartenant au requérant n’était plus proportionnée au but légitime poursuivi à compter de la clôture de la procédure pénale menée à l’encontre de l’intéressé. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention de ce chef.
LES SAISIES ILLÉGALES DES DOUANES FRANCAISES
GRIFHORST c. FRANCE du 26 FEVRIER 2009 Requête 28336/02
Un hollandais vivant à Andorre se fait arrêter en introduisant de l'argent en France sans le déclarer. Il se voit confisquer la somme et subir une amende de 50% du Montant de la somme saisie ! Il se plaint d'une violation de P1-1. Cette somme était compatible avec sa fortune, le trafic de drogue n'est pas démontré. Il n'y a pas de lien de proportionnalité entre un la sanction et le fait reproché:
"1. Rappel des principes
81. L’article 1 du Protocole no 1, qui garantit le droit au respect des biens, contient trois normes distinctes. La première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété. La deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapports entre elles : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteinte au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe général consacré par la première (voir, entre autres, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 29-30, § 37, et les récents arrêts Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 62, CEDH 2007-..., et J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, § 52, CEDH 2007-....).
82. Pour se concilier avec la règle générale énoncée à la première phrase du premier alinéa de l’article 1, une atteinte au droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l’individu (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I, et Air Canada c. Royaume-Uni, arrêt du 5 mai 1995, série A no 316-A, p. 16, § 36).
83. Pour ce qui est des ingérences relevant du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, lequel prévoit spécialement le « droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) », il doit exister de surcroît un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. A cet égard, les États disposent d’une ample marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (AGOSI c. Royaume-Uni, arrêt du 24 octobre 1986, série A no 108, § 52).
2. Application au cas d’espèce
a) Sur la norme applicable
84. La Cour considère que l’amende infligée au requérant s’inscrit dans le deuxième alinéa de l’article 1 (cf. Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 51, CEDH 2001-VII, et, mutatis mutandis, Valico S.r.l. c. Italie (déc.), no 70074/01, CEDH 2006-...).
85. S’agissant de la confiscation de la somme transportée par le requérant, la Cour rappelle avoir affirmé dans plusieurs affaires que, même si une telle mesure entraînait une privation de propriété, elle relevait néanmoins d’une réglementation de l’usage des biens (voir AGOSI précité, p. 17, § 51, Raimondo c. Italie, arrêt du 22 février 1994, série A no 281-A, p. 16 , § 29, Butler c. Royaume-Uni (déc.), no 41661/98, CEDH 2002-VI, Arcuri c. Italie (déc.), no 52024/99, CEDH 2001-VII, et Riela et autres c. Italie (déc.), no 52439/99, 4 septembre 2001, C.M. c. France (déc.), no 28078/95, CEDH 2001-VII ). Il s’agissait entre autres dans ces affaires de législations s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants ou contre les organisations de type mafieux (voir aussi, en matière de non-respect de sanctions internationales Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi (Bosphorus Airways) c. Irlande [GC], no 45036/98, § 142, CEDH 2005-...).
86. La Cour est d’avis que cette approche doit être appliquée à la présente affaire, puisque la confiscation de la somme non déclarée a été prononcée en l’espèce en vertu d’un texte introduit dans le code des douanes (l’article 465) par la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
b) Sur le respect des exigences de l’article 1 du Protocole no 1
87. La Cour relève que l’obligation de déclaration est prescrite par le droit interne, à savoir l’article 464 du code des douanes et que l’article 465 du même code prévoit les sanctions en cas de non-respect, à savoir la confiscation et l’amende.
88. Le requérant soutient pour sa part que la condition de légalité de l’ingérence n’est pas remplie, aux motifs que la rédaction de l’article 464 au moment des faits ne permettait pas de savoir clairement s’il s’appliquait à lui en tant qu’étranger et par ailleurs la Cour de cassation a rendu elle-même deux arrêts contradictoires sur ce point en 1998 et 2000.
89. La Cour n’est pas convaincue par ces arguments. En premier lieu, dans sa rédaction applicable au moment des faits, l’article 464 précité visait « les personnes physiques » effectuant des transferts, formulation large paraissant devoir s’appliquer à tous, résidents comme non résidents. En second lieu, les arrêts mentionnés par le requérant ont été rendus par la Cour de cassation postérieurement aux faits de la présente requête. En tout état de cause, la Cour observe qu’il ne s’agit pas d’un revirement de jurisprudence, dans la mesure où ces arrêts ont été rendus dans le cadre d’une même affaire, le second arrêt ayant été rendu par la Cour de cassation sur opposition de l’administration des douanes et ayant mis à néant le premier (voir paragraphes 25-26 ci-dessus).
90. La Cour estime devoir également tenir compte de ce que la Cour de justice des Communautés européennes a retenu dans plusieurs arrêts (paragraphes 28-30 ci-dessus) que, contrairement à un système d’autorisation préalable, un système de déclaration préalable tel qu’en l’espèce était compatible avec le droit communautaire et avec la libre circulation des capitaux.
91. Dès lors, la Cour conclut que la loi était suffisamment claire, accessible et prévisible (voir a contrario Frizen c. Russie, no 58254/00, § 36, 24 mars 2005 et, Baklanov c. Russie, no 68443/01, § 46, 9 juin 2005) et que l’ingérence en cause était prévue par la loi, au sens de sa jurisprudence.
92. S’agissant du but visé, la Cour relève que l’article 465 précité a été introduit dans le code des douanes par la loi du 12 juillet 1990 dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Il ne fait pas de doute pour la Cour qu’il s’agit là d’un but d’intérêt général (cf. notamment Air Canada précité, § 42, Phillips précité, § 52, et décision Butler précitée).
93. La Cour est consciente à cet égard de l’importance que revêt pour les Etats membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites et pouvant servir à financer des activités criminelles (notamment en matière de trafic de stupéfiants ou de terrorisme international). Elle observe que, depuis quelques années, un nombre croissant d’instruments internationaux (conventions des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, recommandations du GAFI) et de normes communautaires (directive du 10 juin 1991 et règlement du 26 octobre 2005) visent à mettre en place des dispositifs efficaces permettant notamment le contrôle de flux transfrontaliers de capitaux. Le système de déclaration obligatoire au passage de la frontière des espèces transportées et de sanction en cas de non déclaration s’inscrit dans ce contexte.
94. Reste à établir si les autorités ont en l’espèce ménagé un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. En d’autres termes, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux de l’individu, compte tenu de la marge d’appréciation reconnue à l’Etat en pareille matière
95. La Cour s’est tout d’abord attachée au comportement du requérant. Elle relève qu’il s’est abstenu, malgré les demandes faites à deux reprises par les douaniers, de déclarer les sommes importantes qu’il transportait. Ce faisant, il a enfreint en connaissance de cause l’obligation édictée par l’article 464 du code des douanes, de déclarer au franchissement de la frontière toute somme dépassant un certain plafond (7 600 EUR au moment des faits).
96. Le Gouvernement s’appuie également sur les renseignements transmis par les autorités néerlandaises quant aux activités délictueuses du requérant. A cet égard, la Cour relève que, selon la télécopie de l’attaché douanier de l’ambassade de France aux Pays-Bas du 29 janvier 1996, le requérant est « connu des services judiciaires » pour des faits remontant à 1983 (notamment menaces, extorsion de fonds, enlèvement et détention d’arme à feu). Selon une télécopie du même attaché du 23 avril 1997, sa seule activité connue serait l’immobilier et il serait soupçonné par la police néerlandaise d’utiliser cette façade pour blanchir des capitaux.
97. La Cour note toutefois qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait fait l’objet de poursuites ni de condamnations de ce chef ou du chef d’infractions liées (notamment trafic de stupéfiants), que ce soit au Pays-Bas ou à Andorre où il réside. La Cour observe d’ailleurs que, dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel, l’administration des douanes a reconnu que la somme saisie sur lui était compatible avec sa fortune personnelle.
98. Le seul comportement délictueux qui puisse donc être retenu à l’encontre du requérant consiste dans le fait de n’avoir pas déclaré au passage de la frontière franco-andorrane les espèces qu’il transportait. Le Gouvernement n’a d’ailleurs pas soutenu que les sommes transportées seraient issues d’activités illicites ou destinées à de telles activités.
99. La Cour estime donc que la présente affaire se distingue des affaires similaires dont elle a eu à connaître jusqu’ici, où les mesures de confiscation ordonnées par les autorités internes étaient de deux ordres : soit elles s’appliquaient à l’objet même du délit (AGOSI et Bosphorus Airways précités) ou au moyen utilisé pour le commettre (cf. Air Canada précité, décision C.M. précitée et, mutatis mutandis, Yildirim c. Italie (déc.), no 38602/02, CEDH 2003-IV ), soit elles visaient des biens présumés acquis au moyen d’activités délictueuses, (voir en matière de trafic de stupéfiants décision Phillips précitée et, mutatis mutandis, Welch c. Royaume-Uni, arrêt du 9 février 1995, série A no 307-A, et en matière d’activités d’organisations de type mafieux arrêt Raimondo précité et décisions Arcuri et Riela précitées), ou des sommes destinées à de telles activités (décision Butler précitée).
100. La Cour a également eu égard à l’importance de la sanction qui a été infligée au requérant pour ce défaut de déclaration, à savoir le cumul de la confiscation de l’intégralité de la somme transportée, soit 233 056 EUR, avec une amende égale à la moitié de ce montant (116 528 EUR), soit au total 349 584 EUR. Elle relève qu’en vertu de l’article 465 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, le défaut de déclaration entraînait automatiquement la confiscation de l’intégralité de la somme, seule l’amende pouvant être modulée par les juridictions internes (de 25 à 100 % de la somme non déclarée).
101. La Cour relève que, parmi les autres Etats membres du Conseil de l’Europe, la sanction la plus fréquemment prévue est l’amende. Elle peut être cumulée avec une peine de confiscation, notamment lorsque l’origine licite des sommes transportées n’est pas établie, ou en cas de poursuites pénales à l’encontre de l’intéressé. Toutefois, lorsqu’elle est prévue, la confiscation ne concerne en général que le reliquat de la somme excédant le montant à déclarer ; seul un autre Etat (la Bulgarie) prévoit le cumul d’une amende pouvant aller jusqu’au double de la somme non déclarée avec la confiscation automatique de l’intégralité de la somme.
102. La Cour rejoint l’approche de la Commission européenne qui, dans son avis motivé de juillet 2001 (paragraphe 29 ci-dessus), a souligné que la sanction devait correspondre à la gravité du manquement constaté, à savoir le manquement à l’obligation de déclaration et non pas à la gravité du manquement éventuel non constaté, à ce stade, d’un délit tel que le blanchiment d’argent ou la fraude fiscale.
103. La Cour relève qu’à la suite de cet avis motivé, les autorités françaises ont modifié l’article 465 précité. Dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er octobre 2004, cet article ne prévoit plus de confiscation automatique et l’amende a été réduite au quart de la somme sur laquelle porte l’infraction. La somme non déclarée est désormais consignée pendant une durée maximum de six mois, et la confiscation peut être prononcée dans ce délai par les juridictions compétentes lorsqu’il y a des indices ou raisons plausibles de penser que l’intéressé a commis d’autres infractions au code des douanes ou y a participé. De l’avis de la Cour, un tel système permet de préserver le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux de l’individu.
104. La Cour observe enfin que, dans la plupart des textes internationaux ou communautaires applicables en la matière, il est fait référence au caractère « proportionné » que doivent revêtir les sanctions prévues par les Etats.
105. Au vu de ces éléments et dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour arrive à la conclusion que la sanction imposée au requérant, cumulant la confiscation et l’amende, était disproportionnée au regard du manquement commis et que le juste équilibre n’a pas été respecté (cf. Ismayilov c. Russie, no 30352/03, § 38, 6 novembre 2008).
106. Il y a donc eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention."
GRIFHORST c. FRANCE du 12 décembre 2009 Requête 28336/02
LA COUR Constate l'accord amiable entre la France et le requérant
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28336/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant néerlandais, M. Robert Grifhorst (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me B.J. Tieman, avocat à Amsterdam et par Me J. de Jongh-Dunand, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, au motif que la sanction dont il avait fait l’objet pour non-déclaration d’une somme au passage de la douane, à savoir la confiscation de la totalité de la somme non déclarée et l’amende correspondant à la moitié de la somme non déclarée, était disproportionnée par rapport à la nature du fait reproché.
4. Par un arrêt du 26 février 2009 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Grifhorst c. France, no 28336/02, CEDH 2009-...).
5. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait, au titre du préjudice matériel, la somme de 226 890,11 euros (EUR) correspondant aux 500 000 florins confisqués, assortie des intérêts. Il demandait également 37 772,44 EUR au titre des frais d’avocat et 3 249,89 EUR au titre des frais de traduction.
6. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 110 et point 3 du dispositif).
7. Le 14 septembre 2009, la Cour a reçu une lettre de l’avocat du requérant l’informant qu’un accord avait été trouvé entre le Gouvernement et le requérant au sujet de la satisfaction équitable et qu’en conséquence l’affaire pouvait être rayée du rôle.
8. Le 29 septembre 2009, la Cour a reçu une lettre du Gouvernement confirmant que les parties étaient parvenues à un accord et indiquant qu’il s’associait à la demande de la radiation du rôle faite par le requérant.
La CEDH a confirmé pour les mêmes faits, dans son arrêt Moon contre France du 9 juillet 2009 dans la requête 39973/03.
NOUVELLE CONDAMNATION DE LA FRANCE PAR LA CEDH POUR LES SAISIES DOUANIERES
BOWLER INTERNATIONAL UNIT c. FRANCE DU 23 /07/2009 Requête 1946/06
La CEDH condamne la saisie de poupées près desquelles étaient cachées le cannabis découvert à Coquelle centre du tunnel sous la Manche. L'entreprise anglaise qui n'est pas concernée par ce trafic de cannabis réclame en vain ses poupées. Les juridictions françaises considèrent qu'il avait fallu déplacer la palette de cartons de poupées pour trouver le cannabis dans le camion et que par conséquent, les poupées étaient saisies car elles ont participé à l'infraction. La CEDH rappelle que les propriétaires sont de bonne foi et ne doivent pas subir les conséquences de l'infraction surtout que des poupées ne permettent pas à commettre une infraction comme des armes !
"34. La Cour observe en premier lieu que les parties s'accordent toutes deux sur l'existence d'une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens.
35. La Cour rappelle ensuite que l'article 1 du Protocole no 1 garantit en substance le droit de propriété et contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le droit de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou d'assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir les arrêts AGOSI, précité, § 48, et Air Canada, précité, § 30).
36. La Cour estime nécessaire d'établir si la confiscation des marchandises propriété de la requérante a constitué une réglementation des biens ou une privation de propriété.
37. Elle relève que la confiscation des marchandises a été opérée sur le fondement des articles 323 § 2 et 414 du code des douanes au motif qu'elles auraient servi à masquer une fraude et note qu'aux termes de l'article 376 du code des douanes « les objets confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires ». Par ailleurs, la direction générale des douanes de Dunkerque a fait savoir à la requérante que la mainlevée des marchandises était subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une consignation d'une somme de 165 000 FRF égale à la valeur de celle-ci. De plus, suite à une décision initialement favorable, la requérante a été condamnée par la cour d'appel de renvoi au paiement d'une somme « correspondant à valeur de la marchandise à l'époque de la saisie pour tenir lieu de la confiscation » de la marchandise.
38. Une telle situation atteste d'une véritable privation de propriété et ne peut pas s'analyser en une mesure temporaire de saisie et restitution contre un versement (voir l'affaire Air Canada, précitée). De plus, le constat du Gouvernement quant à l'absence d'un recours pour permettre au propriétaire de solliciter la restitution de son bien en faisant valoir sa bonne foi permet de considérer que la confiscation emportait transfert définitif de propriété et ne constituait pas une restriction temporaire à son utilisation (voir a contrario l'affaire C.M. c. France, précitée).
39. Cependant, la Cour rappelle que, bien qu'elle comporte une privation de propriété, la confiscation de biens ne relève pas nécessairement de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 63, série A no 24, et AGOSI, précité, § 51).
40. En l'espèce, la législation applicable laisse apparaître que la confiscation de la marchandise ayant servi à masquer la fraude poursuivait les buts légitimes de lutte contre le trafic international de stupéfiants et de responsabilisation des propriétaires de marchandises dans le choix des transporteurs auxquels ils ont recours, ce dont les parties conviennent.
41. Or, comme telle, l'ingérence relève de la réglementation de l'usage de biens. Dès lors, c'est le second alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 qui s'applique en l'espèce (voir, mutatis mutandis, AGOSI, pre´cite´, § 51, et Grifhorst c. France, no 28336/02, §§ 85-86, 26 février 2009).
42. Reste la question de savoir si la mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens a ménagé un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir, parmi d'autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52). En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 38, série A no 332).
43. Si l'on peut considérer comme le Gouvernement que la confiscation était prévue par la loi et répondait à l'objectif légitime de lutte contre le trafic international de stupéfiants, l'argument selon lequel cette mesure est uniquement préventive et destinée à garantir l'indemnisation du Trésor public ne semble pas pertinent. Cette garantie est en effet déjà assurée par la condamnation de l'auteur de la fraude à une amende très importante. Par ailleurs, et de l'avis de la Cour, il convient également de noter que la sanction constituée par la confiscation des biens ayant servi à masquer la fraude paraît très rigoureuse lorsque, comme en l'espèce, elle ne concerne pas des produits dangereux ou prohibés.
44. S'agissant du recours que peut exercer le propriétaire de bonne foi en pareille situation, il ressort de la législation qu'il est limité à une action contre l'auteur principal. La Cour observe par conséquent qu'il s'agit d'un problème législatif de caractère général. Toutefois, compte tenu du montant des amendes douanières auxquelles les auteurs des fraudes sont condamnés au profit de l'administration des douanes, créancière privilégiée selon le droit interne, ainsi que du risque d'insolvabilité de l'auteur de la fraude, ce recours ne saurait être considéré comme offrant une possibilité adéquate à cette catégorie de propriétaires d'exposer sa cause aux autorités compétentes (voir a contrario AGOSI, précité, § 62).
45. La requérante a été ainsi privée de la propriété de ses biens, puis condamnée – après leur restitution – au paiement de leur valeur, sans toutefois avoir la possibilité d'exercer un recours effectif permettant de remédier à cette ingérence et alors même que les juridictions internes avaient reconnu sa bonne foi. La Cour observe qu'une telle faculté est pourtant offerte par le droit français aux propriétaires de bonne foi des moyens de transport.
46. Par conséquent, tout en reconnaissant la nécessité des mesures de lutte contre ce fléau qu'est le trafic international de stupéfiants, et quelle que soit la marge d'appréciation importante qui doit être laissée aux Etats en la matière, la Cour estime que l'ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante n'a pas ménagé un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu puisqu'aucun mécanisme ne permet d'y remédier directement. En effet, la Cour considère que l'instauration d'un mécanisme dérogatoire lorsque le propriétaire est de bonne foi, prévu dans d'autres cas par la législation nationale (voir article 326 du code des douanes), ne saurait, en tant que telle, porter atteinte aux intérêts de l'Etat (voir, mutatis mutandis, C.M c. France. précitée).
47. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement et conclut à la violation de l'article 1 du Protocole no 1."
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A CONFIRME LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH
Conseil Constitutionnel Décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012
Le Conseil
constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2011 par le Conseil d'Etat
(décision n° 351085 du 17 octobre 2011), dans les conditions
prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts B.,
relative à la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit des articles 374 et 376 du
code des douanes.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067
du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17
août 1948 relative au redressement économique et
financier ;
Vu le décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes,
annexé
à la loi n° 48-1973 du 31
décembre 1948 de finances pour 1949 ;
Vu le code des douanes;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie
devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires
de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par Me Xavier
Morin, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 8 et 22
novembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre,
enregistrées le 8 novembre 2011 ;
Vu la demande de récusation présentée par les requérants,
enregistrée le 26 octobre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Morin, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par
le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique
du 13 décembre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 374
du code des douanes:
« 1. La confiscation des marchandises saisies peut être
poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration
des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires
quand même ils lui seraient indiqués.
« 2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient
appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été
faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les
interventions ou les appels en garantie » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 376 du même code :
« 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être
revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit
consigné ou non, réclamé par les créanciers même
privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
« 2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente
expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables »
;
3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions
portent atteinte, d'une part, au droit de propriété garanti par
les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 et, d'autre part, aux droits de la défense et
au principe du droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'elles
méconnaîtraient, en outre, les principes d'égalité et de
nécessité des peines ainsi que l'article 9 de la Déclaration
de 1789 ;
4. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de
l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de
1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant
un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce
n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de
propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article
2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce
droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt
général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration
de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a
point de Constitution » ; que sont garantis par cette
disposition le droit des personnes intéressées à exercer un
recours juridictionnel effectif, le droit à un procès
équitable ainsi que le principe du contradictoire ;
6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article
374 du code des douanes permettent à l'administration des
douanes de poursuivre, contre les conducteurs ou déclarants, la
confiscation des marchandises saisies sans être tenue de mettre
en cause les propriétaires de celles-ci, quand même ils lui
seraient indiqués ; qu'en privant ainsi le propriétaire de la
faculté d'exercer un recours effectif contre une mesure portant
atteinte à ses droits, ces dispositions méconnaissent l'article
16 de la Déclaration de 1789 ;
7. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article
376 du même code interdisent aux propriétaires des objets
saisis ou confisqués de les revendiquer ; qu'une telle
interdiction tend à lutter contre la délinquance douanière en
responsabilisant les propriétaires de marchandises dans leur
choix des transporteurs et à garantir le recouvrement des
créances du Trésor public ; qu'ainsi elles poursuivent un but d'intérêt
général ;
8. Considérant, toutefois, qu'en privant les propriétaires de
la possibilité de revendiquer, en toute hypothèse, les objets
saisis ou confisqués, les dispositions de l'article
376 du code des douanes portent au droit de propriété une
atteinte disproportionnée au but poursuivi ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il
soit besoin d'examiner les autres griefs, les articles 374 et 376 du
code des douanes doivent être déclarés contraires à la
Constitution ;
10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article
62 de la Constitution : « Une disposition déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est
abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil
constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions
et limites dans lesquelles les effets que la disposition a
produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si,
en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit
bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de
constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la
Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours
à la date de la publication de la décision du Conseil
constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la
Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la
date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de
prévoir la remise en cause des effets que la disposition a
produits avant l'intervention de cette déclaration ;
11. Considérant que l'abrogation immédiate des articles 374 et 376 du
code des douanes aurait des conséquences manifestement
excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de
remédier à l'inconstitutionnalité de ces articles, il y a lieu
de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation,
Décide :
ARTICLE 1
Les articles 374 et 376 du code des douanes sont contraires à la Constitution.
ARTICLE 2
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 11.
ARTICLE 3
La présente
décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance
du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12
janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président,
M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET,
Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM.
Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
S.C. SCUT S.A. c. ROUMANIE du 26 juin 2018 requête n° 43733/10
Violation de l'article 1 du protocole 1 : Le redressement fiscal n'est pas légal. Il est non prévisible et porte atteinte à la sécurité juridique. Pour des faits semblables, la France n'aurait pas été condamnée.
29. La Cour note que la requérante bénéficie d’un intérêt patrimonial, puisqu’elle est titulaire, depuis 2000, d’une licence d’exploitation dont la redevance a été établie à 2 % et, depuis 2007, d’un permis d’exploitation dont la redevance a été fixée à 6 % (paragraphes 6 et 8 ci-dessus). Elle souligne que cet intérêt patrimonial a le caractère d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, 29 novembre 1991, § 51, série A no222).
30. Aux yeux de la Cour, il faut voir dans l’ingérence dénoncée en l’espèce – à savoir l’ingérence dans le droit de propriété de la requérante que représente la majoration de la redevance imposée par la direction générale avec effet au 1er janvier 2007 – une forme de réglementation de l’usage des biens, dans l’intérêt général « pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions », laquelle relève de la règle énoncée au second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Megadat.com SRL c. Moldova, no 21151/04, § 65, CEDH 2008). Il convient donc d’examiner si cette ingérence était légale.
31.
La Cour rappelle que, pour apprécier la conformité de la
conduite de l’État à l’article 1 du Protocole no 1,
elle doit se livrer à un examen global des divers intérêts en
jeu, en gardant à l’esprit que la Convention a pour but de
sauvegarder des droits qui sont « concrets et effectifs ». Elle
doit aller
au-delà des apparences et rechercher la réalité de la
situation litigieuse. Cette appréciation peut porter sur la
conduite des parties, y compris les moyens employés par l’État
et leur mise en œuvre. À cet égard, il faut souligner que
l’incertitude – qu’elle soit législative,
administrative, ou tenant aux pratiques appliquées par les
autorités – est un facteur qu’il faut prendre en
compte pour apprécier la conduite de l’État. En effet,
lorsqu’une question d’intérêt général est en jeu,
les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de
façon correcte et avec la plus grande cohérence (Broniowski c.
Pologne [GC], no 31443/96, § 151, CEDH 2004-V).
32. À ce sujet, la Cour redit que, si elle jouit d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 108, CEDH 2000-I), elle peut en revanche vérifier si la base légale de l’ingérence satisfait les exigences de la Convention quant à la qualité de la loi (Driha c. Roumanie, no 29556/02, § 31, 21 février 2008). En effet, l’existence d’une base légale en droit interne ne suffit pas, en tant que telle, à satisfaire au principe de légalité. Il faut, en plus, que cette base légale présente une certaine qualité, celle d’être compatible avec la prééminence du droit et d’offrir des garanties contre l’arbitraire. À cet égard, il faut rappeler que la notion de « loi », au sens de l’article 1 du Protocole no 1, a la même signification que celle qui lui est attribuée par d’autres dispositions de la Convention (voir, par exemple, Yasar Holding A.S. c. Turquie, no 48642/07, § 91, 4 avril 2017).
33. La Cour rappelle ensuite que le principe de légalité présuppose l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application (Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 163, CEDH 2006-VIII). Quant à la portée de la notion de « prévisibilité », elle dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine que celui-ci couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (voir, mutatis mutandis, Sud Fondi srl et autres c. Italie, no 75909/01, § 109, 20 janvier 2009). Leur contenu ou leur application par les autorités ou les juridictions nationales ne doivent pas être contradictoires (voir, parmi d’autres affaires portant sur les effets sur le droit de propriété du requérant d’une interprétation contradictoire des questions fiscales essentielles faite par les autorités internes, Shchokin c. Ukraine, nos 23759/03 et 37943/06, § 56, 14 octobre 2010).
34. La Cour rappelle que, dans une affaire issue d’une requête individuelle, il lui faut se borner à l’examen du cas concret dont elle a été saisie. Sa tâche ne consiste point à contrôler in abstracto la loi applicable en l’espèce au regard de la Convention, mais à rechercher si la manière dont elle a été appliquée au requérant ou a touché celui-ci a enfreint la Convention (Kanaginis c. Grèce, no 27662/09, § 51, 27 octobre 2016).
35. En l’espèce, la Cour constate que la redevance était établie dans chacune des autorisations d’exploitation (la licence et le permis), délivrées à la requérante. Ce point n’a d’ailleurs jamais été contesté par la direction générale. Par ailleurs, l’agence nationale, l’autorité compétente pour contrôler l’application de la législation sur les mines, a confirmé en 2009 le taux de ces redevances (paragraphe 11 ci-dessus).
36. Les deux autorités susmentionnées, compétentes l’une et l’autre pour procéder au contrôle du calcul et du versement des redevances dues en vertu des autorisations d’exploitation, sont arrivées, en procédant à des contrôles indépendants portant sur les mêmes périodes, à des conclusions contradictoires. Ainsi, après que la direction générale eut conclu, début 2009, que la requérante n’avait pas calculé de manière correcte les redevances dues (paragraphe 10 ci-dessus), l’agence nationale conclut, peu de temps après, que la requérante avait respecté la législation applicable (paragraphe 11 ci-dessus).
37. En outre, la Cour constate que la direction générale elle-même afficha successivement deux attitudes différentes. Ainsi, après le contrôle qu’elle avait diligenté en janvier 2009, où elle avait conclu à une violation des dispositions légales en vigueur par la requérante, elle constata plus tard, en décembre 2010, que la requérante respectait la législation, malgré le fait que celle-ci avait continué à exploiter le sable en vertu de la même licence (paragraphe 6 ci-dessus) et à verser une redevance inchangée de 2 %. La même question fiscale s’est posée de nouveau en 2014, lors d’un nouveau contrôle fiscal effectué par la direction générale, concernant le premier semestre 2009 (paragraphe 17 ci-dessus), où la direction constata à nouveau le non-respect de la législation par la requérante, alors que celle-ci s’acquittait toujours de la redevance calculée au même taux qu’auparavant.
38. Au niveau des juridictions amenées à se prononcer sur cette question, la Cour constate que celles-ci n’ont pas davantage contribué à clarifier la situation. Ainsi, alors que la procédure judiciaire engagée par la requérante en 2009 pour contester la décision de la direction générale lui imposant un redressement fiscal (paragraphe 10 ci-dessus) aboutit, le 17 décembre 2009, à un arrêt de la cour d’appel de Constanta qui conclut à l’application des taux légaux (paragraphe 15 ci-dessus), la même cour arriva à la conclusion, le 21 décembre 2016, que les taux applicables étaient ceux prévus dans la licence d’exploitation (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour constate partant une contradiction dans la motivation des juridictions.
39. Eu égard à ces circonstances, la Cour doute que l’application dans le cas de la requérante des dispositions légales relatives au taux de la redevance correspondant aux activités d’exploitation minière, ainsi que de celles relatives à la procédure de renégociation des conditions d’exploitation, puisse être considérée comme « prévisible » et comme répondant à l’exigence de « sécurité juridique ».
40. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la décision de la direction générale, confirmée par la cour d’appel, de relever d’office le taux de la redevance est intervenue de manière arbitraire et guère prévisible sur le plan du droit interne et, par conséquent, de manière incompatible avec le droit au respect des biens de la requérante. La Cour rappelle que c’est à l’État qu’il incombe d’assumer le risque d’une faute des pouvoirs publics et qu’il ne faut pas y remédier aux dépens de la personne touchée, surtout lorsqu’aucun autre intérêt privé concurrent n’est en jeu (voir Romankevic c. Lituanie, no 25747/07, §§ 38-39, 2 décembre 2014, et, mutatis mutandis, Tomina et autres c. Russie, nos 20578/08 et 19 autres, § 39, 1er décembre 2016).
41. Une telle conclusion la dispense de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels.
42. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no1 à la Convention.
PROCÉDURE COMPENSATOIRE DE RÉPARATION D'UN BIEN SAISI
S.C. SERVICE BENZ COM S.R.L. c. ROUMANIE du 4 juillet 2017 requête 58045/11
Atteinte aux biens au sens de l'article 1 du Protocole 1 : Procédure de saisie de deux camions citernes pour lutter contre la fraude fiscale qui ne concerne par le requérant. Une procédure compensatoire effective pour obtenir réparation du bien saisi, répond aux exigences de l'article 1 du Protocole 1
a) Les principes généraux
27. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, en mettant en vigueur les lois qu’ils estiment nécessaires à cette fin. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième règles ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, parmi beaucoup d’autres, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 37, série A no 98, et récemment, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 72, CEDH 2016).
28. Pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1 une ingérence dans le droit de propriété doit être opérée « pour cause d’utilité publique », et « dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux de droit international ». L’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52, et Granitul S.A. c. Roumanie, no 22022/03, § 46, 22 mars 2011). Lorsqu’elle contrôle le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’État une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, § 52, série A no 108).
29. Enfin, la Cour rappelle qu’en matière de confiscation des biens ayant été utilisés illégalement, pareil équilibre dépend de maints facteurs, parmi lesquels, l’attitude du propriétaire. La Cour doit donc rechercher si les autorités ont eu égard au degré de faute ou de prudence de l’intéressé ou, pour le moins, au rapport entre sa conduite et l’infraction commise. De plus, il convient de prendre en compte la procédure qui s’est déroulée dans l’ordre juridique interne pour évaluer si celle-ci offrait au requérant, compte tenu de la gravité de la mesure susceptible d’être imposée, une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes, en alléguant, le cas échéant, une violation de la légalité ou l’existence de comportements arbitraires ou déraisonnables (AGOSI, précité, §§ 54-55 ; voir également, mutatis mutandis, Riela et autres c. Italie (déc.), no 52439/99, 4 septembre 2001). Le juste équilibre sera rompu si la personne concernée a eu à subir « une charge spéciale et exorbitante » (Waldemar Nowakowski, précité, § 47).
b) L’application de ces principes en l’espèce
30.
La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que la saisie
et la confiscation des deux camions-citernes de la société
requérante s’analysent en une atteinte au droit de celle-ci
au respect de ses biens. Elle observe ensuite que la confiscation
des deux biens a été une mesure définitive par laquelle leur
propriété a été transférée à l’État (Andonoski précité,
§ 30, et, a contrario, JGK Statyba Ltd et Guselnikovas c.
Lituanie, no 3330/12, § 115, 5 novembre
2013, Hábenczius c. Hongrie, no 44473/06, § 28, 21 octobre 2014).
Le Gouvernement n’a pas soutenu non plus qu’il était
loisible à la société requérante d’en réclamer la
restitution des
camions-citernes (Andonoski précité, § 30, et B.K.M. Lojistik
Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi c. Slovénie, no 42079/12, § 38, 17 janvier 2017
; voir, a contrario, C.M. c. France (déc.), no 28078/95, CEDH 2001-VII). Dans
ces conditions, la Cour conclut que l’atteinte subie s’analyse
en une privation de propriété au sens du premier alinéa de l’article
1er du Protocole no 1 à la Convention.
31. Sur le point de savoir si l’atteinte au droit de propriété de la requérante était conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour relève que la confiscation litigieuse est intervenue en application des dispositions pertinentes du CPF, à savoir l’article 220 §§ 1 k) et 2 b) (paragraphe 16 ci-dessus).
Dans la mesure où la requérante allègue une violation du principe de légalité, la Cour observe qu’elle soulevé cet argument devant les juridictions nationales (paragraphe 11 ci-dessus), lesquelles l’ont écarté. La Cour n’aperçoit en l’espèce aucune trace d’arbitraire dans l’interprétation en question. Compte tenu de ce qui précède et ayant à l’esprit qu’elle jouit d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 108, CEDH 2000-I), la Cour conclut donc que l’atteinte était conforme au droit interne de l’État défendeur.
32. Par ailleurs, force est de constater que l’intéressée ne conteste pas davantage les considérations d’intérêt général qui ont abouti à la mesure de confiscation. Pour la Cour, à l’examen du régime établi par le CPF, on ne saurait douter que la confiscation des camions-citernes de la requérante répondait à l’intérêt général qu’il y a à réprimer les faits de fraude fiscale (voir, mutatis mutandis, Dukmedjian c. France, no 60495/00, § 56, 31 janvier 2006).
33. Il reste à la Cour à examiner s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés par les autorités en l’espèce pour garantir l’intérêt général que représente la lutte contre la fraude fiscale, d’une part, et la protection du droit fondamental de la requérante au respect de ses biens, d’autre part.
34. La Cour note qu’en l’espèce, la confiscation des camions-citernes de la société requérante a été décidée dans le cadre d’une procédure contraventionnelle dirigée contre la société propriétaire de la marchandise que la société requérante transportait.
Si le premier tribunal a conclu qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la requérante et y a vu motif à déclarer la mesure de confiscation abusive et illégale, le tribunal de dernier ressort s’est départi de cette approche.
Il a ainsi jugé, d’une part, qu’aucune recherche d’une faute propre de la requérante ne s’imposait, car la confiscation s’était opérée en vertu de la loi.
Il a également, d’autre part, déclaré bien-fondé – sans plus de précisions – le moyen de recours de l’administration fiscale tiré de l’absence de diligence du transporteur qui est directement responsable de l’intégrité et de la légalité des biens transportés.
De fait, la Cour constate que, en application des paragraphes 1 k) et 2 b) de l’article 220 du CPF, lus de manière combinée, la confiscation du moyen de transport utilisé pour le transport illégal d’une marchandise soumise au droit d’accise était obligatoire (voir, mutatis mutandis, Andonoski, précité, § 37, et Vasilevski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 22653/08, § 57, 28 avril 2016 ; voir aussi, a contrario, Waldemar Nowakowski précité, § 51). En l’espèce, le tribunal ayant tranché la procédure en dernière instance a considéré qu’il s’agissait d’une confiscation automatique ayant vocation à s’appliquer sans qu’il y eût lieu de distinguer selon que le moyen de transport appartenait au contrevenant lui-même ou à un tiers ni, dans ce dernier cas, de tenir compte de l’attitude personnelle de ce dernier, ou de la nature de son lien avec la contravention. Il s’ensuit que, dans le cadre de la procédure engagée par la requérante, le tribunal départemental a opposé à celle-ci une présomption irréfragable, qui rendait inopérante la thèse de l’intéressée fondée sur son éventuelle bonne foi (paragraphe 14 ci-dessus).
35. Eu égard à l’objet de la contravention en cause, à savoir le transport de produits soumis au droit d’accise effectué en l’absence du « document d’accompagnement de la marchandise » requis, il n’apparaît pas que la mesure de confiscation des camions-citernes échappait aux objectifs des dispositions nationales consistant en la lutte contre la fraude fiscale.
36. Toutefois, la Cour note l’argument du Gouvernement, non contesté par la société requérante, selon lequel celle-ci avait la possibilité de se retourner contre sa cocontractante pour lui demander réparation du préjudice découlé pour elle de la confiscation des camions-citernes, en engageant au besoin une action en responsabilité contractuelle devant les juridictions internes en cas de refus de dédommagement opposé par sa cocontractante (paragraphe 25 ci-dessus).
37. La Cour est d’avis qu’une telle forme de contrôle juridictionnel pourrait en principe répondre aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. En effet, elle rappelle que, dans des affaires précédentes, elle n’a pas écarté la possibilité qu’un tel recours puisse l’amener à conclure à l’existence d’un équilibre entre les moyens employés par les autorités pour garantir l’intérêt général et la protection du droit fondamental de l’individu au respect de ses biens. Dans ces affaires, elle a estimé que les recours n’étaient pas effectifs pour des raisons liées aux cas concrets d’espèce, comme, par exemple, la faillite ou la dissolution de la société commerciale responsable (Merot D.O.O. et Storitve Tir D.O.O. c. Croatie (déc.), nos 29426/08 et 29737/08, § 33, 10 décembre 2013, et Vasilevski, précité, § 60), le risque sérieux de faillite compte tenu de la sévérité des amendes infligées aux auteurs de fraudes (Bowler International Unit c. France, no 1946/06, § 44, 23 juillet 2009), le décès de l’auteur du délit ayant conduit à la confiscation (Vasilevski, précité, § 59) ou l’absence de pratique des tribunaux internes en la matière (Andonoski, précité, § 39). En revanche, lorsqu’un recours permettant au propriétaire du bien confisqué d’obtenir une compensation s’est révélé effectif, la Cour s’est montrée prête à conclure à l’existence d’un équilibre entre les moyens employés par les autorités pour garantir l’intérêt général et la protection du droit fondamental de l’individu au respect de ses biens (Sulejmani c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 74681/11, § 41, 28 avril 2016).
38. En conséquence, il convient de vérifier si, dans la présente affaire, la requérante disposait bien d’un recours de la nature de celui mentionné par le Gouvernement, par le biais duquel elle aurait pu faire valoir plus utilement la thèse de sa bonne foi devant une juridiction nationale.
39. La Cour constate que la Cour constitutionnelle roumaine a été saisie à plusieurs reprises de la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article 220 § 2 b) du CPF, qui était mise en doute au nom du respect dû au droit de propriété au motif qu’elles autorisaient la confiscation de biens appartenant à d’autres personnes que le contrevenant.
Or, dans sa décision no 685 du 16 novembre 2006 – antérieure, donc, à la genèse de la présente affaire –, la haute juridiction a estimé que ces dispositions étaient bien constitutionnelles, en considérant : premièrement, qu’en confiant le véhicule au contrevenant, son propriétaire avait assumé le risque que celui-ci vienne à l’utiliser d’une manière pouvant engendrer un danger pour la société ; deuxièmement, qu’il restait en tout état de cause loisible au propriétaire des biens confisqués de réclamer réparation de son préjudice auprès du contrevenant, par le biais d’une action en justice sur la base du contrat qui les liait (paragraphe 17 ci-dessus), et troisièmement, qu’une interprétation différente aurais permis le contournement facile des dispositions légales compte tenu de ce que le contrevenant aurait pu invoquer à sa défense sa qualité de détenteur précaire du moyen de transport, de sorte que l’activité de transport illégal ait pu continuer.
40. La Cour constate donc que, bien avant les faits de la présente requête, la Cour constitutionnelle a confirmé l’existence d’un recours que le propriétaire d’un moyen de transport confisqué pouvait engager contre le contrevenant sur la base des règles générales de la responsabilité civile contractuelle (voir également, mutatis mutandis, Sulejmani, précité, § 41). À ses yeux, cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle, comportant une interprétation du droit national faisant autorité, suffit pour conclure à l’effectivité du recours susmentionné.
41. Qui plus est, la Cour note que cette approche a reçu une consécration législative explicite en matière de transport à travers les dispositions de l’article 1961 § 3 du nouveau code civil. Or, cette disposition, bien qu’entrée en vigueur quelques mois après le terme de la procédure judiciaire engagée par la société requérante (paragraphe 20 ci-dessus), était déjà publique depuis juillet 2009, date de la première publication du nouveau code civil.
42. Eu égard à ce qui précède, la Cour est prête à admettre que la société requérante avait à sa disposition un recours judiciaire aux fins de la réparation du préjudice subi. Or, celle-ci n’invoque aucun motif de nature à faire naître un doute quant à l’effectivité dudit recours (voir également, mutatis mutandis, Sulejmani, précité, § 41).
43. Dans ces conditions, la Cour estime qu’un juste équilibre était en l’espèce ménagé entre le respect des droits de l’intéressée protégés par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et l’intérêt général de la société. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition.
Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH, lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organismede règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.